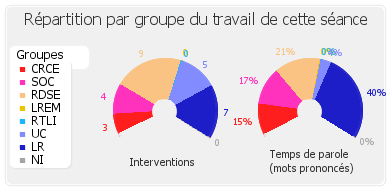Séance en hémicycle du 25 juin 2009 à 9h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle le débat sur le volet agricole de la négociation OMC.
La parole est à M. Jean-Pierre Chevènement, au nom du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, auteur de la demande d’inscription à l’ordre du jour.
Applaudissements sur les travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la décision relative à la conclusion du cycle de Doha a été reportée, à la demande de la nouvelle administration américaine.
Ce report constitue une relativement bonne nouvelle, car l’Europe protège son agriculture, comme les États-Unis qui, vous le savez, n’ont pas maintenu le découplage des aides qu’ils avaient introduit pendant deux ans. Ce report nous donne donc le temps nécessaire à la réflexion avant la révision de la politique agricole commune, qui devrait s’appliquer à partir de 2013.
Ce délai est particulièrement opportun parce que l’agriculture, comme les industries lourdes, exige des investissements à long terme. Les éleveurs qui quittent leurs exploitations ne se remplacent pas ; la population active agricole dans le monde représente encore plus de deux hommes sur cinq, elle est souvent majoritaire dans les pays du Sud, comme en Chine, en Inde, ou en Afrique. En Europe, la moyenne exploitation agricole façonne la plupart de nos paysages. L’alimentation, enfin, est une préoccupation qui s’impose prioritairement à tout gouvernement, aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs.
C’est pourquoi, madame le secrétaire d’État, nous ne pouvons qu’être inquiets en lisant les propos tenus par M. Pascal Lamy, directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, le 10 mai 2009 : « L’intégration mondiale en matière agricole nous permet d’envisager l’efficience au-delà des frontières nationales [...] en déplaçant la production agricole vers les lieux plus appropriés. » M. Lamy précise que les rendements sont généralement plus élevés sur les grandes propriétés foncières que sur les petites exploitations. « Nous devons nous rappeler, ajoute-t-il, que les frontières nationales n’ont été définies par rien d’autre qu’un long jeu historique de chaises musicales. »
Ce mépris des sociétés rurales et, plus encore, des communautés historiquement constituées que sont les nations est tout à fait caractéristique de la pensée libérale la plus dogmatique. Malheureusement, cette pensée qui domine les travaux de l’OMC appliqués à l’agriculture recèle des menaces considérables pour l’agriculture mondiale en général, et pour la nôtre en particulier.
Je ne reviens pas sur le fait que trois orientations dominent la négociation : l’amélioration de l’accès aux marchés, la réduction tendant vers l’élimination des subventions à l’exportation et, surtout, la réduction substantielle des mesures de soutien interne « ayant pour effet de distordre les échanges » – pour reprendre le vocabulaire en cours à l’OMC –, tout se passant comme si, d’une part, un libre-échangisme sans frontières et, d’autre part, des prix qui sont bien souvent des prix de braderie devaient servir d’étalon ou de paradigme aux politiques agricoles. Ainsi la négociation se déroule-t-elle dans un cadre libéral fixé à l’avance.
Si le projet de libéralisation des marchés agricoles s’était concrétisé avant 2006, la crise alimentaire de 2007-2008 aurait certainement été beaucoup plus grave. Monsieur le ministre – je saisis cette occasion pour vous féliciter de votre nomination à ce poste –, cette orientation « laissez-fairiste » pèse évidemment dès aujourd’hui sur l’adaptation de la politique agricole commune et pourrait déboucher à terme, en 2014, sur son démantèlement, s’il n’y était mis bon ordre d’ici là.
Vous n’étiez pas encore ministre à cette époque, mais il est regrettable que, lors de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, les 11 et 12 décembre 2008, dans le cadre d’un « bilan de santé » de la politique agricole commune, la PAC, la décision ait été prise de relever de 1 % chaque année les quotas laitiers, en attendant leur suppression définitive en 2014. Cette décision était particulièrement inopportune, compte tenu de la chute des prix du lait, d’environ 50 % depuis le pic enregistré à la fin de l’année 2007.

Plus généralement, la réduction des droits de douane qui résulterait d’un accord à l’OMC se traduirait par des importations massives de viande bovine, pénalisant ainsi un grand nombre de petites et moyennes exploitations françaises, en particulier dans des régions de moyenne montagne que je connais bien ; mais d’autres régions sont également concernées, je pense au Morvan ou au Massif central.
Certes, la politique agricole commune actuelle peut être critiquée. Observons qu’elle a été minée dès le départ par la fixation de prix irréalistes et mal hiérarchisés. En raison d’excédents imprévus à l’origine, il a été mis fin à la politique de soutien des marchés. Chacun se souvient que la politique agricole commune a été révisée en 1992, sur l’initiative du commissaire Mac Sharry : des paiements directs aux agriculteurs ont alors été instaurés, en contrepartie de baisses de prix drastiques.
Les réformes ultérieures, en 1999 et 2003, ont persévéré dans la même veine : celle du découplage des soutiens et des prix, en favorisant des rentes de situation rigides, au prorata des surfaces exploitées, sans aucune modulation liée à la conjoncture ou aux productions qu’il eût fallu – ou non – encourager. Il faut rompre avec la pensée libérale dogmatique qui gouverne une politique agricole commune inefficace, coûteuse et, par conséquent, fragile. Il faut, pour cela, fonder la future politique agricole commune qui entrera en vigueur après 2013, sur un concept cohérent, ayant pour objectif une relative autosuffisance alimentaire de l’Europe. Monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, vous disposerez pour cela du temps de la réflexion, puisque nous ne sommes pas encore en 2013 ! Mais les conversations se donnent déjà libre cours.
Les grands pays d’Asie, dont la population dépasse le milliard d’habitants, chercheront à assurer leur sécurité alimentaire, sans qu’on puisse exclure qu’ils deviennent, au-delà de la crise économique actuelle et au fur et à mesure de leur industrialisation, des importateurs de produits agricoles, du fait de la rareté de leurs ressources en terres et en eau et de la montée de classes moyennes dont les habitudes alimentaires se modifieront profondément. Ces pays devront limiter leurs importations pour privilégier leurs propres producteurs, qui représentent encore plus de la moitié de leur population active : c’est une évidence, car ils doivent préserver leur équilibre social. On a déjà vu l’Inde refuser, l’an dernier, la conclusion du cycle de Doha plutôt que de sacrifier ses 700 millions de petits agriculteurs. D’ailleurs, si ces pays acceptaient que leurs paysans quittent leurs terres, l’exode rural ne se dirigerait pas seulement vers leurs villes, mais il contribuerait aussi à gonfler le nombre des migrants vers nos pays.
Comme l’a fort bien écrit M. Pierre Lelong, ancien directeur du Fonds d’orientation et de régularisation des marchés agricoles, prenant le contre-pied de M. Lamy, « la théorie des avantages comparatifs ignore le fait qu’à l’échelle planétaire les hommes et les sociétés ne sont guère délocalisables ». Tout est là !

Passons sur le fait que les États-Unis ne peuvent, à la fois, soutenir un libéralisme de principe, subventionner leur agriculture et inonder de leurs produits les économies des pays les moins avancés.
Il convient donc de revenir à des notions simples.
Premièrement, il n’existe pas de vérité en matière de prix agricoles, en dehors d’une zone géographique donnée, compte tenu des paramètres sociaux, géographiques et environnementaux, qui varient d’une zone du globe à l’autre.

La recherche d’une certaine autosuffisance agricole à l’échelle de grandes régions du globe se justifie tout à fait : non que le marché n’ait plus aucun rôle à jouer, mais ce rôle, s’il n’est pas marginal, ne saurait être essentiel. Le commerce agricole ne représente, d’ailleurs, que moins du dixième du commerce mondial. C’est dire que l’exception libre-échangiste britannique, telle qu’elle a existé depuis 1846, ne peut se comprendre que dans le cadre d’un monde organisé pour le plus grand profit de la puissance impériale dominante qu’était alors le Royaume-Uni.
Deuxièmement, l’intervention sur les marchés, et donc par les prix, est la façon la moins coûteuse et la plus efficace de soutenir le revenu des agriculteurs et d’orienter les productions. Il faudrait donc rompre avec le système qui privilégie les aides directes. Or, c’est justement pour se conformer aux exigences de l’OMC qu’on remplit des « boîtes vertes » de mesures budgétaires coûteuses et à l’efficacité problématique. Or, selon une étude récente de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, et de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, l’évolution probable des prix agricoles tend vers une hausse modérée, qui nous offre une chance exceptionnelle de revenir aux concepts raisonnables qui fondaient la première politique agricole commune.
Troisièmement, l’action en matière agricole doit être conçue en termes de régularisation plutôt que de soutien, en fonction d’une grille de prix ne s’écartant pas trop, par souci d’économie, des prix internationaux observés sur le long terme, et tenant compte de multiples paramètres régionaux – hommes, terroirs, ressources en eau, débouchés, etc.
Quatrièmement, les mécanismes de régularisation doivent, autant que possible, associer les producteurs d’une manière décentralisée et converger avec les actions de conversion et d’orientation nécessaires.
Bref, il faut trouver un équilibre, à travers des prix modérés, entre les exigences de la cohésion à l’intérieur de l’Union européenne et le souci de nos relations avec les pays tiers, sans oublier le cas spécifique de l’Afrique.
Pour élaborer un concept cohérent, à même de fonder une PAC renouvelée et viable, il faut donc partir d’une idée simple : le monde de demain ne sera pas celui des marchés agricoles unifiés sur lesquels s’effectuerait l’essentiel des transactions en fonction de prix internationaux variables et difficilement prévisibles. L’agriculture ne peut s’accommoder de tels aléas.
Le monde de demain sera composé de quelques grands espaces agricoles dont il faudra organiser les relations commerciales. Chacun d’eux cherchera, autant qu’il le pourra, à atteindre une certaine autosuffisance. Mais la dépendance par rapport aux marchés et donc aux prix internationaux ne s’exercera qu’à la marge. Une telle orientation permettrait de sauver les paysanneries européennes ou plutôt ce qu’il en reste. Cela éviterait un immense gaspillage, car il sera coûteux et difficile de rebâtir des systèmes agricoles après qu’on les aura laissé péricliter, voire disparaître. Une telle orientation doit commander notre attitude dans les négociations à l’OMC.
Disons les choses clairement : ces négociations ont été mal engagées sur des bases faussées dès l’origine.
Je ne reviens pas sur les trois orientations qui figurent dans le projet de l’OMC concernant l’agriculture de juillet 2008.
Comme chacun le sait, ce projet n’a pas abouti à ce jour et le directeur général de l’OMC l’a remis en chantier, sans pour autant s’écarter des principes qui le fondent, à savoir, pour l’essentiel, la théorie libérale des avantages comparatifs, que j’ai tout à l'heure critiquée.
C’est ainsi que la mesure globale de soutien, censée fausser les échanges, devrait être réduite de 80 % pour l’Union européenne, 70 % pour les États-Unis et le Japon, 55 % pour le reste. Ces réductions seraient mises en œuvre sur cinq ans pour les pays développés, huit ans pour les pays dits sous-développés.
Trois observations s’imposent à ce stade.
D’abord, l’Union européenne est pénalisée.
Ensuite, les pays en voie de développement constituent une catégorie fourre-tout : on y trouve aussi bien certains pays du groupe de Cairns que les pays les moins avancés.
Enfin, les réductions s’appliquent pour l’essentiel à la catégorie « orange » et épargnent la catégorie dite « verte », c’est-à-dire les aides découplées du revenu. Conclure sur ces bases la négociation engagée à l’OMC, ce serait figer la politique agricole commune - qui repose déjà, pour l’essentiel, sur le découplage entre les aides et la production - et la fragiliser gravement pour l’avenir.
L’Union européenne ne devrait pas accepter de conclure à l’OMC un accord qui l’empêcherait de revenir à un système d’aides plus raisonnable, fondé principalement sur des prix garantis modérés à la production. Un tel système éviterait le gaspillage et permettrait de réduire le coût de la PAC, dans des conditions qui seraient à la fois conformes aux intérêts de la France et à celui des paysanneries européennes, et acceptables pour nos partenaires européens, …

… qui considèrent que la part de l’agriculture dans le budget européen est trop importante.
Par ailleurs, les réductions de tarifs selon la méthode de l’étagement frapperaient plus sévèrement l’Union européenne que ses concurrents potentiels.
Pour l’Union européenne, l’abaissement prévu est de 70 % pour les tarifs supérieurs à 75 %, de 64 % pour les tarifs compris entre 50 % et 75 %, de 57 % pour les tarifs compris entre 20 % et 50 % et de 50 % pour les tarifs inférieurs à 20 %
Que resterait-il de la protection tarifaire pour l’agriculture européenne ? Par comparaison, les pays dits en voie de développement - parmi lesquels figurent certains pays du groupe de Cairns - verraient abaisser de 46, 7 % les tarifs supérieurs à 130 %, de 42, 7 % les tarifs compris entre 80 % et 130 %, de 38 % les tarifs compris entre 30 % et 80 % et de 33, 3 % seulement les tarifs inférieurs à 30 %
C’est donc d’un véritable démantèlement tarifaire qu’il s’agirait pour l’Europe, démantèlement de surcroît asymétrique, si l’on tient compte du fait que certains pays, comme le Brésil, disposent d’avantages comparatifs supérieurs aux nôtres ; je pense en particulier à la viande bovine.
La politique agricole commune initiale avait été fondée sur le principe des prélèvements à l’importation, remplacés par des droits de douane, d’abord variables, puis fixes. Le dernier acte sera accompli avec le démantèlement tarifaire, dont le projet de l’OMC a dessiné la perspective.
Si l’on peut admettre que les pays les moins avancés d’Afrique disposent de contingents tarifaires en franchise de droits, il est légitime de protéger nos agriculteurs contre la concurrence de ce que l’on appelait autrefois « les pays neufs », qui, pour des raisons géographiques, peuvent produire à très bas coût sur des exploitations latifundiaires.
Une troisième catégorie de mesures concerne l’élimination d’ici à 2013 des subventions à l’exportation. Je ne suis pas du tout certain que ces mesures bénéficieront aux agriculteurs des pays les moins avancés, qui, en cas de famine ou de crise alimentaire grave ou même de pénurie structurelle, peuvent avoir besoin d’importer à bas prix.
En tout cas, il faudrait veiller que, au-delà de l’aide alimentaire, nos exportations vers les grands pays importateurs de demain ne soient pas handicapées. La visibilité manque aujourd’hui pour prendre de pareils engagements. J’admets cependant que plutôt que de verser des subventions à l’exportation on préfère développer des possibilités de stockage pour reporter la production sur une période moins excédentaire. Une certaine régulation de la production éviterait tout écart durable entre production et consommation.
D’une manière générale, il faut opposer au libre-échangisme doctrinaire le principe d’une concurrence équitable dans les échanges internationaux. Nous voyons les produits industriels fabriqués dans les pays à bas coût envahir nos marchés à des prix de dumping, qu’il s’agisse de dumping social, monétaire ou environnemental. La France et l’Europe seraient bien inspirées de ne pas poursuivre dans le domaine agricole le désarmement unilatéral auquel elles ont procédé en matière industrielle.
De lourdes menaces pèsent sur l’avenir de l’agriculture française à l’OMC et au niveau européen.
Nous savons très bien que d’autres intérêts sont en jeu, notamment dans les services. Nous craignons que le Gouvernement ne soit tenté de faire prévaloir l’intérêt de quelques multinationales qui ne sont bien souvent françaises que de nom. Leur logique de développement, essentiellement financière, est très éloignée des intérêts de l’économie française.
Nous demandons donc, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, à être rassurés quant à votre détermination pour éviter que la Commission européenne ne soit tentée, encore une fois, de brader les intérêts de l’agriculture. Ce n’est pas le protectionnisme qui a créé la crise économique actuelle, c’est la liberté absolue laissée aux capitaux de spéculer et aux multinationales de se déplacer, dans une économie totalement ouverte qui nous désarme face à la concurrence sauvage du dollar ou de pays à très bas coûts salariaux.
Je souhaite que la France défende ses intérêts, qui sont aussi ceux de l’Europe.
L’Europe doit assumer pour l’essentiel son autosuffisance alimentaire. Elle doit veiller à l’équilibre de sa société ; il n’est pas nécessaire que l’exode rural vienne gonfler le nombre des chômeurs. Elle doit aussi veiller à la protection de ses paysages et à la qualité de son alimentation. Bien entendu, il convient de traiter à part les pays les moins avancés dont le destin est lié au nôtre ; j’ai déjà évoqué la question des pays d’Afrique et des Caraïbes.
Nous attendons donc, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, que la France utilise, le cas échéant, son droit de veto à l’OMC afin de faire obstacle à la conclusion d’une négociation qui empêcherait une réorientation efficace de la politique agricole commune.
Il est temps de remettre les pendules à l’heure et d’avoir une vraie discussion avec nos partenaires européens. Mieux vaut, selon moi, une absence d’accord qu’une négociation bâclée, car l’avenir de l’agriculture française et européenne est incompatible avec l’acceptation du cadre libéral mondialisé.
L’OMC mériterait mieux son nom si les marchés étaient véritablement organisés. C’est l’organisation qui manque. Dans le sigle de l’OMC, le « O » aujourd’hui n’a pas sa place. Nous ne voulons pas que notre agriculture disparaisse comme ont déjà disparu des pans entiers de notre industrie. Nous voulons une Europe qui protège et non une Europe ouverte et offerte, simple relais du libéralisme mondialisé.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, il convient d’aborder ce débat sur le volet agricole des négociations à l’OMC sans dogmatisme, mais avec toute la lucidité nécessaire face à l’urgence et aux enjeux fondamentaux que représentent les agricultures mondiales et la sécurité alimentaire pour tous dans les échanges de demain.
À l’heure actuelle, on ne peut plus, en effet, déconnecter le terme « mondialisation » de l’expression « sécurité alimentaire », c’est-à-dire sécurité en approvisionnement, sécurité des stocks, sécurité sanitaire, qualitative et même environnementale.
Dans son éditorial du 8 avril dernier, l’Agence Europe reconnaissait ainsi que, « dans le domaine agricole, le souci prioritaire est non pas le développement des échanges mondiaux en lui-même, mais la recherche de la sécurité alimentaire et le droit pour chacun de poursuivre un degré aussi élevé que possible d’autosuffisance alimentaire. »
Telle qu’elle est organisée jusqu’à présent et à la suite des négociations engagées depuis plusieurs années sur les accords concernant les produits agricoles, l’OMC, avec son orientation libérale, a montré non seulement ses limites, mais aussi ses effets néfastes.
Si, globalement, on peut admettre qu’une organisation du commerce réglementant et facilitant les échanges commerciaux mondiaux, a contribué à favoriser le développement de certains pays et à améliorer les conditions de vie de nombre de leurs habitants, nous devons dresser l’amer constat d’une cruelle absence de résultats dans la lutte contre la faim et la malnutrition.
Pis encore, les phénomènes de concurrence et de spéculation inhérents au processus de libéralisation ont aggravé ces problèmes et éloigné l’horizon d’une sécurité alimentaire partagée.
Tout le monde se souvient des « émeutes de la faim » de 2008. La misère et la faim touchaient une population non habituée aux pénuries ou aux prix exorbitants, les urbains des classes défavorisées et moyennes. Là, tout à coup, bon nombre de dirigeants ont pris conscience de la nécessité de repenser ces règles commerciales mondiales sous peine de révoltes, voire de révolutions.
Pourtant, de nombreuses voix se sont élevées pour nous alerter sur le fait que non seulement nous ne satisferons pas aux objectifs fixés par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, pour faire régresser la misère et diminuer le nombre de sous-nutris ou malnutris, mais que, depuis 1998, le nombre de personnes touchées a même augmenté, atteignant aujourd’hui presque un milliard, dont 80% sont des paysans.
Parmi les plus menacés et les plus désarmés face à ces fluctuations liées à un commerce mondial débridé, les petits agriculteurs, notamment africains, n’ont qu’une solution, reconnue par tous actuellement : permettre à leur propre agriculture, souvent vivrière, de se développer. Mais ce mouvement aura forcement des conséquences sur les agricultures traditionnellement exportatrices et donc sur notre propre agriculture européenne.
Alors, comment lutter contre l’insécurité alimentaire qui menace la planète ? Comment organiser équitablement le marché mondial des productions agricoles ? Comment orienter notre agriculture européenne et française pour permettre à nos agriculteurs de continuer à produire, de vivre décemment, de respecter l’environnement et de continuer à aménager et de dynamiser nos territoires ?
À l’opposé de certains, nous souhaitons qu’un cadre international soit maintenu, ne serait-ce que pour permettre l’exercice de notre responsabilité en matière agricole.
Cependant, les vraies questions ne figurent malheureusement pas sur l’agenda des négociations internationales conduites dans le cadre de l’OMC : une ouverture supplémentaire des frontières de l’Union européenne provoquera sans nul doute une diminution de la production agricole. Quels en seront alors les effets sur la protection de l’environnement ? Les produits importés seront-ils tenus de respecter les normes environnementales et les règles de sécurité alimentaire ? Et que dire du respect des normes sociales dans la production ?
Avec mon groupe, nous plaidons pour une mondialisation régulée, où l’activité agricole n’est pas banalisée, où les échanges sont encadrés au sein de grandes « régions » qui détermineront elles-mêmes la place qu’elles souhaitent donner à leur agriculture, comme l’Europe a su le faire à la signature du traité de Rome.
Un autre point important que je souhaiterais aborder a trait à la manière de remédier concrètement aux dérives concernant les produits agricoles et alimentaires à l’OMC.
Si l’on part du principe que les accords du GATT - Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce - puis de l’OMC ne correspondent plus aux ambitions affichées en termes de développement économique et d’augmentation du niveau de vie dans les pays les plus pauvres, c’est le signe qu’une profonde refonte des règles s’impose au plus vite.
Cette démarche est possible sans attendre une éventuelle réussite du cycle de Doha. Elle doit être engagée en amont. Il suffit d’invoquer de nouveaux facteurs légitimes permettant de justifier des restrictions aux échanges agricoles.
Les préoccupations non commerciales relèvent d’attentes sociétales et même humanitaires, mais elles ne sont nullement contradictoires avec les logiques économiques.
C’est également la conclusion auquel aboutit dans son rapport le Conseil national de l’alimentation : il faut tenter de faire accepter ces facteurs légitimes et leurs préoccupations non commerciales, sociales, environnementales ou éthiques, car ils ne s’accompagnent pas de clauses de compensation que seuls les pays riches peuvent se permettre de payer. Ils seront ainsi sources d’un rééquilibrage et d’une plus grande justice internationale dans l’espace et dans le temps.
Il est donc grand temps de revoir ce droit de l’OMC, qui, je le rappelle, concerne le droit international entre les États et non le droit commercial entre les acteurs économiques mondiaux. Son objectif, comme celui de l’Europe, devrait être non pas la libre concurrence à tout prix, mais la régulation des échanges.
Les droits humains fondamentaux à la vie, à la santé et à l’alimentation, donc à la sécurité des approvisionnements, au développement durable et à la protection des ressources naturelles, devraient prévaloir sur les simples règles du commerce.
Il est temps désormais de mettre en adéquation les règles de l’OMC avec celles de tous les autres grands accords internationaux : la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, ainsi que le protocole de Kyoto, qui, il faut l’espérer, sortira renforcé de la conférence de Copenhague en décembre prochain.
Seule une Europe unie, forte de ses vingt-sept États-membres, et volontaire sur la question agricole pourra peser efficacement en ce sens.
Il s’agit d’un beau défi, mais qui semble mal engagé.
Je ne peux passer sous silence la position pour le moins timide – le mot est faible – de la France dans un dossier d’actualité, celui du lait, qui illustre ce dont nous débattons actuellement. Comment vouloir que l’Europe soit unie sur ce sujet et laisser Mme Merkel se battre seule sur la revendication d’options de gestion de l’offre pour stabiliser le marché du lait ?
Encore récemment, un grand quotidien régional rapportait, dans son édition de samedi, que « l’indifférence des Français » sur le dossier brûlant du lait avait été relevée à Bruxelles – dans les couloirs, bien évidemment ! – et citait l’entourage du président de la République pour qui « c’était l’affaire d’Angela Merkel et pas la nôtre ».
Nos producteurs apprécieront, au moment même où ils envisagent d’organiser leur résistance au niveau européen.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à remercier Jean-Pierre Chevènement d’avoir proposé l’inscription à l’ordre du jour de nos travaux d’un débat sur le volet agricole de la négociation OMC. Le débat qui suivra sur la crise de la filière laitière sera d’ailleurs une parfaite illustration de ce sujet.
Le blocage constaté des négociations de l’OMC et la non-conclusion du cycle de Doha, qui a débuté en 2001 et qui devait se terminer le 1er janvier 2005, nous donnent de nouveau l’occasion de demander l’exclusion du secteur agricole de ces négociations.
Nul ne saurait se satisfaire d’un éventuel échec ou d’un improbable succès des discussions multilatérales menées dans un cadre ultralibéral, dont la crise économique et financière actuelle montre encore les limites.
Depuis la création de l’OMC en 1995, la mise en concurrence de toutes les agricultures du monde n’a fait que le bonheur des spéculateurs et, il faut le souligner, mis en péril, sur le plan alimentaire, près d’un milliard d’individus à l’échelle de la planète.
Il s’agit là d’un enjeu vital, et personne ne peut oublier les « émeutes de la faim » qui ont secoué et fragilisé de nombreux pays en 2007 et 2008. Ces émeutes se poursuivent, dans l’indifférence générale, alors que le milliard d’êtres humains souffrant de malnutrition vient d’être dépassé.
Le modèle concurrentiel et la logique de l’offre prônés par les organisations internationales, qui ne tiennent pas compte des différences climatiques, des cycles de productions, des types d’exploitations ou tout simplement des terres arables disponibles, sont aujourd’hui dans une impasse totale, pour les agricultures des pays développés comme pour celles des pays du Sud. La sécurité et la souveraineté alimentaires doivent devenir le point central des discussions en matière agricole.
En juillet 2008, la réunion de l’OMC à Genève proposait d’entériner une diminution comprise entre 60 %, selon la proposition de Pascal Lamy, et 80 %, selon celle de Peter Mandelson, des droits à paiement unique européens, pour achever coûte que coûte les négociations du cycle de Doha., ce qui aurait entraîné une baisse de 60 % à 70 % des tarifs douaniers aux frontières de l’Union européenne pour le blé dur et le blé tendre, les viandes ovine et porcine, les volailles et les fromages. S’il y avait cumul avec la diminution des aides européennes, les facilités d’exportation accordées aux pays tiers et les baisses des prix à la production entraînées par les importations, rares sont les agriculteurs français et européens qui y auraient survécu.
Si l’on ajoute à cela l’adoption par la Commission européenne en juin de la même année, dans le cadre de la « simplification » de la politique agricole commune, de la suppression de l’obligation de présenter des certificats d’importation et d’exportation pour près de 1 500 produits agricoles ou dérivés, il ne reste plus aucun outil d’application de la préférence communautaire. Ces certificats représentaient le dernier moyen de suivi et de régulation des échanges dans le secteur agricole.
Si la réunion de Genève a échoué, c’est aussi « grâce à » l’intervention du ministre indien du commerce, M. Kamal Nath, qui, précisément au nom de la souveraineté alimentaire de son peuple, a exigé d’inclure un mécanisme spécial de sauvegarde pour éviter que les paysans de son pays ne soient ruinés par les importations. Cette clause de sauvegarde, permettant de relever les tarifs douaniers lorsque trop de produits importés provoquent un effondrement des cours, existe et pourrait être utilisée en France, comme dans le reste de l’Europe, plus fréquemment, y compris en ajoutant un cahier des charges qui préciserait les garanties sociales et sanitaires des travailleurs et producteurs agricoles.
Le dogme de la concurrence libre et non faussée est devenu une certitude et, dans le bilan de la présidence française de l’Union européenne, on a omis de s’étendre sur ces sujets vitaux pour nos agriculteurs et nos concitoyens. Oubliés les discours de 2007 sur la préférence communautaire agricole, les prix rémunérateurs pour les producteurs ! Aujourd’hui, l’horizon est barré par le démantèlement de la PAC et l’alignement, d’ici à 2013, sur les cours mondiaux.
Le monde agricole, dans sa quasi-unanimité, de la FNSEA au MODEF, le Mouvement de défense des exploitants familiaux agricoles, en passant par les Jeunes Agriculteurs ou la Confédération paysanne, réclame que l’OMC sorte de l’agriculture, ou que l’agriculture et l’alimentation sortent du cadre de l’OMC !
Sur le plan de la production, nous le savons, d’autres modèles que celui de l’agro-industrie qui procureraient des revenus décents aux producteurs sont envisageables.
Il en est de même pour la commercialisation des denrées agricoles. La piste d’une refondation de la FAO, à laquelle seraient confiés les échanges agricoles, institués sur des bases bilatérales ou régionales dans un cadre d’un commerce équitable, est une proposition de rupture que nous souhaitons défendre.
Les plus faibles relèvent la tête aujourd’hui, pour sauver ce qui reste d’une production nationale qui fait vivre des millions de familles de petits producteurs, à l’instar d’un certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest – Burkina-Faso, Tchad, Mali et Bénin –, qui se sont alliés au sein de « l’initiative sectorielle en faveur du coton » pour tenter de résister aux États-Unis. En Amérique latine, l’Alternative bolivarienne pour les Amériques, ALBA, permet à ses membres, depuis 2001, de « donner selon ses possibilités et recevoir selon ses besoins » : Cuba envoie des médecins bien formés et la Bolivie exporte à des tarifs respectueux de ses producteurs du quinoa et des camélidés.
Nous devons tenir compte de l’émergence de cette thématique de la « survie » dans les enceintes de négociations internationales, car il en va également de la survie de milliers d’exploitations agricoles dans notre pays, où les disparités de revenus ne font que s’accroître et où la concentration s’accélère aux dépens des plus faibles.
Les agriculteurs français et européens attendent que nous revenions à une véritable préférence communautaire, qui s’articulerait autour de deux piliers.
D’une part, il faut instaurer un prix minimum européen qui serait un prix de négociation, et qui ne résulterait pas d’un alignement, à la baisse, sur les cours mondiaux, lequel nous est présenté comme inéluctable.
D’autre part, la constitution de stocks de sécurité, pour renforcer la souveraineté alimentaire de chaque État, est un véritable choix politique. Ces stocks, qui sont aujourd’hui au plus bas, mettraient un terme à la spéculation que subissent tour à tour les producteurs de lait, de porcs, de fruits et légumes, de bananes outre-mer, pour le plus grand bénéfice des actionnaires de la grande distribution et des géants de l’agro-alimentaire.
Nous partageons d’ailleurs cet objectif avec beaucoup de paysans et de responsables agricoles d’autres régions du monde. C’est également au nom de ces principes que l’Inde, la Chine et l’Indonésie ont dit « non » aux négociateurs de l’OMC à Genève, contre l’avis des États-Unis, du Brésil et de l’Australie, dont l’avocat n’était autre que Pascal Lamy !
En 2050, il y aura 9 milliards d’hommes, de femmes et d’enfants à nourrir sur notre planète ; c’est bien pour cela qu’il faut sortir l’agriculture et l’alimentation du cadre multilatéral et ultralibéral de l’OMC. La France, premier pays agricole de l’Union, doit avoir le courage de porter à la fois l’ambition d’une nouvelle PAC, rémunératrice, solidaire et durable, et de jouer un rôle déterminant dans le concert des nations pour que les échanges mondiaux s’établissent sur des bases de coopération alimentaire et de commerce équitable. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les négociations du cycle de Doha à l’OMC achoppent depuis quelques années sur la question agricole. Cet état de fait, qui peut sembler quelque peu paradoxal pour des produits représentant seulement 10 % de l’ensemble des échanges mondiaux, souligne à quel point le secteur agricole reste stratégique et constitue une composante forte de la souveraineté alimentaire de nombreux pays.
Les rapports entre la PAC et l’OMC ont été souvent conflictuels et révélateurs de toutes les tensions qui opposent les trois grands partenaires mondiaux : les États-Unis, l’Union européenne et l’OMC, cette dernière apparaissant à la fois comme juge et partie. L’agriculture est à la fois un thème central de conflit et un enjeu pour ces partenaires.
Le président du groupe de négociations sur l’agriculture de l’Organisation mondiale du commerce, David Walker, a annoncé, le 18 juin dernier, que les négociations sur l’agriculture reprendraient dans un cadre multilatéral, c’est-à-dire avec la participation de tous les membres et sous leur contrôle, ce qui reflète le souhait de ces derniers de voir les négociations reprendre de l’élan.
M. Walker a confirmé qu’il était important désormais de faire avancer le processus, de réduire les divergences qui subsistent et de régler les questions techniques.
II faut tout d’abord se réjouir que le climat politique des négociations se soit amélioré depuis l’échec de juillet 2008, et ce malgré l’aggravation de la crise économique. Cet échec n’a rien à voir avec la France ou l’Union européenne. Les négociations n’ont pas abouti parce qu’il n’y a pas eu d’entente entre les États-Unis, l’Inde et la Chine sur les importations agricoles, plus spécialement sur l’établissement d’un mécanisme de sauvegarde spécifique qui aurait permis aux pays en développement de relever le montant de leurs droits de douane sur certains produits agricoles, comme le riz, en cas d’afflux soudain d’importations.
L’Union européenne a été d’autant moins partie prenante de cet échec qu’elle avait proposé une diminution de ses droits de douane agricoles de 60 % et un démantèlement de ses subventions à l’exportation d’ici à 2013, concessions que je qualifierais d’audacieuses de l’Union européenne et de son commissaire européen au commerce extérieur de l’époque, M. Mandelson.
En fait, l’échec du cycle de Doha traduit une évolution profonde de la donne économique et politique mondiale.
Le rapport des forces en présence à l’OMC a changé. Un accord entre les États-Unis et l’Europe suffit de moins en moins à construire les bases du consensus multilatéral. Il faut désormais compter avec les puissances émergentes, tout en se mettant à l’écoute des pays les plus pauvres, comme l’a fait l’Union européenne, notamment la France.
Cet échec a fait surtout apparaître que le cycle de Doha, qui a commencé en 2001, est peut-être aujourd’hui déconnecté des réalités. Il est donc plus que temps de le conclure pour repartir sur un cycle ouvert aux nouvelles réalités de ce XXIe siècle.
L’OMC reste incontestablement un concept d’une grande pertinence. Elle ne doit pas être remise en cause, mais, au contraire, consolidée, parce qu’elle a des règles et un organisme de règlement des différends. Elle constitue l’un des meilleurs exemples de la régulation des affaires économiques mondiales, que la mondialisation rend toujours plus nécessaire.
De même, le développement, c’est-à-dire le progrès des pays les plus pauvres, doit rester l’objectif majeur de toute future négociation.
La défense d’un modèle européen fondé sur un équilibre entre ouverture et protection, qui ne signifie en rien protectionnisme, doit continuer à inspirer notre action politique au sein de l’Union européenne.
En mai dernier, la Commission européenne est arrivée à un accord préliminaire avec les États-Unis afin de régler le contentieux qui les oppose à l’Union européenne en ce qui concerne l’interdiction d’importations de viande aux hormones.
Par cet accord, les États-Unis s’engagent à supprimer l’ensemble des sanctions appliquées actuellement à de nombreux produits européens, notamment sur ce produit emblématique qu’est le roquefort. En échange, l’Union européenne autorise l’importation de quantités supplémentaires de viande américaine sans hormones ; elle suspend également pour dix-huit mois la procédure contentieuse engagée à l’OMC contre les États-Unis pour faire reconnaître l’illégalité des sanctions subies.
La France a obtenu un résultat satisfaisant, préservant la sécurité alimentaire et permettant le maintien de nos préférences communautaires. Il faut saluer une telle évolution.
L’Europe doit promouvoir sa conception de la politique agricole au niveau mondial, que ce soit en faisant entendre sa voix à l’OMC ou en contribuant à l’émergence d’une nouvelle gouvernance mondiale de l’agriculture.
Il n’est pas concevable que l’OMC, à laquelle nous avons fait de nombreuses concessions, continue de militer en faveur d’un dumping général en matière agricole, que ce soit sur le plan sanitaire, écologique ou social.
Il n’est pas concevable non plus que nous tournions le dos à notre agriculture quand, parallèlement, les États-Unis, avec leur Farm bill, soutiennent massivement leurs producteurs. Je le dis très clairement, je souhaite que l’agriculture européenne et, à travers elle, l’agriculture française, utilise comme moyen de défense non pas la préférence communautaire, mais ce que j’appellerais la spécificité communautaire. Je suis contre une conception de type « ligne Maginot » de l’Union européenne.

Je rappelle que le principe de préférence communautaire n’a plus de support juridique dans les traités communautaires. La Cour de justice de Luxembourg l’a affirmé à plusieurs reprises. En revanche, c’est une notion politique, qui, en tant que telle, peut être un choix des décideurs de l’Union européenne.
En fait, la préférence communautaire existe, mais elle est résiduelle. Elle se traduit par l’existence d’un tarif extérieur commun. Symbole de la préférence communautaire, ce tarif extérieur n’est presque plus utilisable comme instrument en raison de nos engagements internationaux, notamment de la consolidation de nos droits de douane auprès de l’OMC. Des pressions constantes s’exercent même sur l’Union européenne pour que celle-ci réduise encore ses droits de douane, essentiellement sur les produits agricoles. Tel est l’enjeu du cycle de négociations commerciales lancé à Doha.
Cela ne signifie pas qu’il faille abandonner toute protection, qui sera seulement concentrée sur une liste de produits sensibles. En tout état de cause, toute mesure de type protectionniste est vouée à l’échec, sans compter l’utilité économique contestable de ces démarches.
Que peut faire l’Union européenne si elle ne peut utiliser la protection tarifaire ? À mon sens, elle doit promouvoir ses valeurs, notamment celles qui concernent le respect de l’environnement ou les normes sociales, et, ainsi, d’une certaine manière, exporter son modèle. Certes, il faut remarquer que l’OMC ne permet pas aujourd’hui d’inclure dans les négociations commerciales des thèmes comme ceux-ci, mais des liens peuvent être faits grâce aux résultats obtenus dans d’autres organisations, comme l’ONU pour l’environnement – c’est le sens du protocole de Kyoto –, l’Organisation internationale du travail pour les normes sociales ou l’UNESCO pour la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Il faut également faire observer que, sous réserve de non-discrimination, l’article XX du GATT permet des restrictions à la libéralisation pour un certain nombre de motifs légitimes, que ce soit la santé publique, l’environnement ou la protection des espèces.
Le discours du Président de la République à l’OIT, le 15 juin dernier, ne nous dit pas autre chose. La nouvelle régulation de la mondialisation doit lier le progrès économique au progrès social. Voilà un enjeu majeur que l’Europe doit relever avec ses propres valeurs, au premier rang desquelles je place la raison et la justice.
Jusqu’à présent, l’Union européenne n’est pas parvenue à faire adhérer les pays en voie de développement à sa stratégie en faveur de certaines « préférences communautaires ».
Faire jouer la préférence communautaire, c’est également permettre à l’Union européenne de faire respecter les « règles du jeu ». Il serait faux de dire que l’Union européenne ne défend pas ses droits. Les chiffres de l’OMC montrent exactement le contraire : c’est l’Union européenne qui dépose le plus de plaintes, notamment contre les États-Unis, et qui obtient le plus souvent gain de cause. Enfin, comme vous le savez, je suis sensible à la défense des indications géographiques protégées dans le domaine agricole. C’est un dossier important.
Pour finir, la préférence communautaire telle que je l’entends ne peut se passer d’une politique véritablement offensive en faveur de la recherche et du développement, de l’innovation et de tout ce qui participe à la stratégie de Lisbonne. C’est une nécessité absolue pour conserver notre avance technologique et, plus largement, c’est un atout pour que nos entreprises se valorisent à l’étranger. Faire valoir « l’excellence communautaire » dans le domaine du développement durable, de l’environnement, c’est ouvrir de nouveaux marchés d’avenir aux entreprises européennes. Nous sommes là au cœur du green business, comme le dit M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État.
Voilà ce que j’appelle la spécificité communautaire. Elle ne possède aucun caractère protectionniste et s’inscrit parfaitement dans la logique du prochain cycle de l’OMC, tout en préservant nos intérêts.
Le débat entre la « préférence communautaire » et l’ouverture au marché mondial s’était ouvert dès la négociation du traité de Rome. Dans une Communauté économique européenne à six, la France parvenait, non sans mal, à faire prévaloir son attachement à la « préférence communautaire ». Au fil des élargissements, les tendances favorables au libre-échange n’ont cessé de se renforcer. La succession des cycles de négociation a permis à ces dernières de l’emporter et de démanteler les outils d’une « préférence communautaire » qui, aux yeux des autres parties prenantes aux négociations du GATT, n’est toujours apparue que comme l’utilisation des outils traditionnels d’un certain protectionnisme. Je crois que le virage décisif a été le passage du GATT à l’OMC. À ce moment-là, la notion de « préférence communautaire » a de fait disparu.
Rien ne sert de revenir inlassablement sur une notion disparue. Il faut trouver une arme efficace, un moyen de défense qui soit en harmonie avec le monde d’aujourd’hui et les règles du commerce mondial. Cette arme doit nous aider à imposer un modèle de développement soucieux, je le répète, de la protection de l’environnement, de la sécurité sanitaire et du progrès social. C’est ce que j’appelle la spécificité communautaire, qui est vitale pour notre modèle agricole.
Au cours du dernier cycle de négociation, l’OMC a ainsi traité une partie des questions agricoles au sein d’un accord spécifique qui déroge à certaines règles générales du commerce multilatéral. Au cours des prochaines négociations, le Gouvernement doit totalement se mobiliser pour que la sensibilité particulière du secteur agricole soit prise en compte dans le cadre du cycle de Doha. Cela semble d’autant plus nécessaire que la situation de crise alimentaire mondiale que nous vivons actuellement prouve encore une fois la nécessité d’un traitement particulier et spécifique de l’agriculture sur le plan mondial. Compte tenu de l’enjeu majeur que revêt cette négociation pour l’avenir de l’agriculture européenne, la France ne peut pas accepter un accord qui sacrifierait l’agriculture européenne sans la moindre contrepartie.
L’échec de juillet dernier ne doit pas changer le fond de la position française : un accord à l’OMC ne sera acceptable que si est apportée la garantie que l’agriculture européenne pourra en supporter les conséquences sans dommages irréparables. Nous devons être particulièrement vigilants sur le soutien dédié aux productions et aux zones les plus fragiles.
Voilà, à mon sens, la problématique qui devra s’inscrire dans un nouveau cycle de négociation de l’OMC. Le monde a changé. Des priorités nouvelles apparaissent. La régulation mondiale que la crise actuelle rend de plus en plus urgente va devoir accoucher d’un nouveau modèle de développement. L’Europe a un rôle majeur à jouer et une carte maîtresse à abattre, l’affirmation de ses valeurs. À nous de trouver le courage et la volonté politique de nous imposer.
Monsieur Chevènement, je ne partage pas votre analyse. Loin de stigmatiser, comme vous, « une Europe ouverte et offerte », même si la formule est élégante, ce qui ne nous surprend pas, je préfère une Europe qui ne reste pas à l’écart du monde, mieux encore une Europe qui sache « exporter l’excellence communautaire » qu’elle a patiemment construit depuis le traité de Rome de 1957.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le cycle de Doha est en panne depuis son ouverture en 2001. Cependant, le directeur de l’OMC, Pascal Lamy, optimiste, vient de déclarer avoir décelé des « signes positifs » quant à la reprise des négociations sur la libéralisation du commerce mondial. Il entrevoit même un accord en 2010.
Peut-être les changements politiques en Inde et aux États-Unis ont-ils déclenché la reprise d’un dialogue bilatéral. Pourtant, ces deux pays avaient fortement contribué à l’échec des négociations de l’été dernier. Le groupe de Cairns s’est félicité de cette ébauche de discussion.
Pourquoi cet optimisme alors que le commerce mondial va vraisemblablement chuter de 9 % cette année ? Comment peut-on croire à une harmonisation des points de vue quand le secteur agricole, principale pomme de discorde entre les membres de l’OMC, est soumis à de fortes turbulences, entraînant une crise alimentaire des uns et une déstabilisation des revenus des producteurs des autres ?
En période de croissance, les membres de l’OMC n’ont pas réussi à se mettre d’accord. En période de crise économique, il est probable que les anciennes postures, responsables de l’enlisement de Doha, vont ressurgir, voire se radicaliser.

Il en sera difficilement autrement alors que les modèles agricoles et les intérêts qui en découlent divergent d’un groupe de pays à un autre.
Au-delà des différences structurelles liées à la géographie ou au poids de l’histoire qui distinguent quatre grands ensembles – les États-Unis, l’Union européenne, les pays en voie de développement et le groupe de Cairns –, nous savons qu’il existe deux conceptions alimentant les désaccords au sein de la négociation du volet agricole de l’OMC : d’un côté, une agriculture simple activité marchande impliquant le coût le plus bas possible des produits afin de se positionner au mieux sur un marché très concurrentiel ; de l’autre, une agriculture dont la dimension stratégique est prise en compte par les nations ayant choisi l’autonomie alimentaire, sa fonction nourricière, son rôle dans l’équilibre du territoire, ses conséquences sur l’environnement et la santé, entrainant bien sûr des surcoûts de production.
Dans ces conditions, il est très difficile d’envisager un consensus si l’OMC ne revoit pas ses règles du jeu. Dans le droit-fil du GATT, l’OMC persiste à vouloir supprimer les distorsions de concurrence, mais toujours selon le principe « a minima » afin, certes, de faciliter l’accès aux marchés, la baisse des tarifs douaniers et la diminution des subventions aux exportations, initiées par l’accord de l’Uruguay Round. Elles doivent demeurer des objectifs à long terme.
Mais il est nécessaire de prendre en compte l’évolution des attentes de la société. On ne peut demander à des pays aux fortes exigences sociales, sanitaires et environnementales en matière d’agriculture d’affronter ceux qui produisent sans ces mêmes contraintes. On se retrouverait alors dans le cadre d’une concurrence faussée que l’OMC est censée combattre.
Nous savons très bien qu’un agriculteur français ne produit pas au même coût qu’un agriculteur brésilien. Pour autant, on ne peut demander au Brésil, au stade actuel de son développement, d’avoir le même modèle agricole que le nôtre.
Le processus de disparition du dumping social prendra du temps. L’OMC doit donc proposer un cadre très progressif de libéralisation du commerce agricole afin qu’aucune des parties ne soient lésées.
Néanmoins, la plus grande hypocrisie règne souvent au sein des relations commerciales, quoi qu’en disent les pays les plus libéraux, qui se défendent abusivement d’être les plus transparents et les plus ouverts.
Près de nous, la crise des prix du lait est un exemple frappant du décalage entre les discours prônant la dérégulation et la réalité qui consiste presque partout à soutenir les agriculteurs. Dès que l’Union européenne a autorisé les aides financières au secteur laitier, les États-Unis se sont empressés de réintroduire les leurs. Cette escalade témoigne d’un fort souci de protection des filières.
Mes chers collègues, bien que l’agriculture ne représente que 10 % des échanges mondiaux, elle constitue la principale pierre d’achoppement des négociations de l’OMC. Motivés par des intérêts souvent divergents, les pays membres de l’Organisation mondiale du commerce campent sur des positions durcies par une crise économique, propice au repli sur soi, voire au protectionnisme.
Pour sortir de cette spirale, l’OMC, lors des prochaines négociations agricoles, doit fixer des objectifs aboutissant à la mise en place d’outils permettant sur le long terme d’harmoniser les conditions de production. Il faut absolument privilégier le modèle le plus humaniste et le plus durable, celui qui respecte le mieux les hommes et leur planète.
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, notre débat sur l’agriculture et l’OMC ne saurait se limiter aux savantes considérations strictement commerciales que nous imposerait le statut d’une organisation dont l’objet n’est pas l’alimentation humaine – qui est pourtant la fonction première de l’agriculture ! –, mais est seulement la liberté du commerce.
La crise économique et sociale qui sévit actuellement tend à faire oublier la situation gravissime dans laquelle se trouve le monde sur le plan alimentaire : une image chassant l’autre, les piquets de grève devant nos usines tendent à faire disparaître des esprits les émeutes de la faim de l’année dernière en Égypte ou en Côte d’Ivoire.
Or, depuis l’an dernier, la situation alimentaire mondiale, loin de s’améliorer, s’est au contraire encore dégradée. La FAO annonçait vendredi dernier, 19 juin, qu’un milliard de personnes souffraient de la faim, dont 642 millions dans la zone Asie-Pacifique, 265 millions en Afrique sub-saharienne, 53 millions en Amérique latine et dans les Caraïbes et 42 millions au Proche-Orient et en Afrique du Nord.
Lors d’une table-ronde sur la politique agricole que j’avais organisée ici même le 9 avril dernier, Edgard Pisani, ancien ministre de l’agriculture du général de Gaulle, remarquait : « Aujourd’hui la faim tue bien plus de monde que les conflits. »

Pourtant, toujours selon la FAO, la quantité de nourriture à disposition de l’humanité n’a jamais été aussi élevée qu’aujourd'hui : elle est suffisante pour nourrir 12 milliards de personnes !
Comment expliquer ce paradoxe ? Comment expliquer que les premières victimes de la sous-alimentation, voire de la famine, soient des paysans ?
La réponse est à chercher dans la dérégulation systématique des marchés agricoles promue par l’OMC. L’ouverture imposée des marchés conduit à mettre en concurrence les systèmes de production agricoles traditionnels avec ceux, industriels et subventionnés, des pays industrialisés.
Dans les pays dits du Sud, l’effondrement des cultures vivrières qui résulte de cette mise en concurrence sape la base même du développement puisque les flux de nourriture sont inversés : les villes nourrissent les campagnes avec des produits importés ; autrement dit, ce sont les urbains qui nourrissent les paysans ! Symétriquement, les cultures d’exportation prolifèrent, notamment pour alimenter le bétail des pays industrialisés. Au final, les déficits agro-alimentaires se creusent, les pays industrialisés finissent par prétendre nourrir le monde, mais les paysans paupérisés, toujours plus nombreux, ne mangent plus à leur faim !
Sur ces mécanismes pervers viennent se greffer de sinistres considérations géostratégiques : la nourriture peut devenir une arme.
Chacun aura donc compris que la question de la souveraineté alimentaire devient centrale et pèse beaucoup plus lourd que la liberté du commerce. C’est pourquoi nous devons affirmer que la capacité ; pour une entité politique – qu’il s’agisse d’un pays ou d’un groupe de pays –, à maîtriser son alimentation, et par conséquent à développer son propre modèle agricole, à l’abri des turpitudes d’un marché mondial toujours en proie à des fluctuations erratiques, est un droit fondamental.
Alors, que faire ?
D’abord, il faut réaffirmer et appliquer ce principe de souveraineté alimentaire que l’OMC met à mal depuis des décennies en considérant que l’alimentation est un bien comme un autre et qu’il convient de le soumettre aux sacro-saintes lois du marché.
Ensuite, il convient de se rappeler le positionnement audacieux de la Communauté économique européenne qui, en 1962, contre la logique néolibérale du GATT, avait osé mettre en œuvre sa politique agricole commune en protégeant son agriculture du marché mondial.
Aujourd’hui, devant la gravité de la crise alimentaire, et au nom du droit à l’alimentation ratifié par la majorité des pays via la Déclaration universelle des droits de l’homme, il nous faut, je le dis sans ambages, faire sortir l’agriculture de l’OMC et de sa logique aveugle !
Cette nouvelle orientation passe par l’application de dispositions claires.
La première consiste à mettre en place des marchés locaux et régionaux protégés de la concurrence déloyale provoquée par la surproduction des agricultures industrielles et subventionnées des pays industrialisés.
La deuxième suppose la modification des accords de partenariat économique, ou APE, qui imposent aux pays ACP – Afrique, Caraïbes et Pacifique –, toujours au nom de l’OMC, l’ouverture de leurs marchés aux exportations européennes.
La troisième réside dans la mise en œuvre d’un moratoire mondial sur les agro-carburants, qui, selon Edgard Pisani, constituent « un obstacle considérable et insurmontable à l’équilibre alimentaire du monde ».
La quatrième consiste à supprimer toutes les subventions aux exportations et, pour ce qui concerne l’Union européenne, les fameuses restitutions à l’exportation ; sur ce point très précis, je ne serai pas en contradiction avec l’OMC.
Va-t-on prendre cette direction ? À la fin du mois de janvier, l’ONU a réuni à Madrid de nombreux acteurs internationaux de premier plan pour aborder la question essentielle de la « sécurité alimentaire pour tous ». On y a lancé l’idée d’ouvrir un nouvel espace de discussion, « un partenariat mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire ». Cette proposition rejoint celle d’Edgard Pisani, qui affirmait encore lors de la table-ronde que j’évoquais : « Je crois absolument nécessaire la création d’un Conseil de sécurité alimentaire et environnementale à l’échelle du monde. » En clair, il faut introduire du politique là où l’OMC s’évertue à imposer le seul marché.
Je laisserai le mot de la fin à Guy Paillotin, secrétaire perpétuel de l’Académie d’agriculture et président honoraire de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, qui concluait notre table-ronde en déclarant : « Je ne suis pas idéologue, je regarde les faits. […] le nombre de personnes qui meurent de faim augmente. […] Or on nous avait dit, et je n’avais pas a priori à récuser cette idée, que le libre-échange des marchandises ferait que ce nombre diminuerait. Donc, ce n’est pas vrai. »
Monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’OMC doit être remise à sa place pour que l’agriculture puisse répondre à sa vocation fondamentale, qui est de nourrir les hommes, afin que cesse enfin le scandale de la faim.
La France et l’Europe, au nom de leurs valeurs fondatrices, doivent prendre leurs responsabilités.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

La parole est à M. le ministre. (Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.)
Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis très heureux que la première occasion de m’exprimer publiquement non plus comme responsable des affaires européennes, mais en tant que ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche, me soit donnée au Sénat.
Cela étant, comme l’ont signalé les différents intervenants, les champs que recouvrent ces deux départements ministériels ont entre eux des relations liens plus qu’étroits.
Quoi qu'il en soit, je n’ignore pas les relations existant entre le Sénat et le monde agricole. C’est pourquoi le fait que je sois amené à prononcer devant vous ma première intervention dans mes nouvelles fonctions est chargé de signification. En tout cas, c’est avec beaucoup de plaisir que je parle ici ce matin.
Il y a un point sur lequel je serai d’accord avec l’ensemble des intervenants et que je souhaite donc souligner d’emblée : comme l’ont rappelé M.M Jean-Pierre Chevènement, Jean Bizet, Aymeri de Montesquiou et Jacques Muller, le secteur agricole présente un caractère essentiel et stratégique dans la vie économique internationale. C’est un secteur qui, Jean-Pierre Chevènement l’a fort justement dit, fait vivre directement ou indirectement des millions de personnes dans le monde, qui représente, dans certains pays en voie de développement, une part très importante de la population active, occupant, par exemple, 800 millions de personnes en Inde.
Il s’agit d’un secteur clé, car lui seul permettra de garantir l’alimentation d’une population mondiale qui, M. Muller l’a rappelé, reste en forte augmentation. Lui seul garantira aussi une alimentation saine face à des crises sanitaires qui inquiètent de plus en plus nos concitoyens. La question de la sécurité alimentaire a été à juste titre mise en avant par Odette Herviaux.
L’agriculture et l’alimentation sont donc clairement des enjeux mondiaux, et il faut les considérer comme tels même quand notre priorité est de défendre les intérêts de nos agriculteurs et de nos pêcheurs nationaux.
Deux processus sont en cours, qu’il nous faut gérer de front : d’un côté, la négociation internationale dans le cadre de l’OMC, qui fait l’objet du présent débat et sur laquelle Anne-Marie Idrac donnera tous les éclaircissements nécessaires ; de l’autre, la définition d’une nouvelle politique agricole commune.
Le défi, dans les années à venir, consistera à trouver la meilleure articulation possible entre ces deux processus. Mon rôle sera de veiller à ce que le second réponde strictement aux intérêts des agriculteurs et des pêcheurs français.
S’agissant de l’OMC et de la reprise du cycle de Doha, que j’avais déjà eu à traiter dans d’autres fonctions, lorsque je travaillais auprès de Dominique de Villepin, alors Premier ministre, nous sommes allés, pour ce qui concerne l’agriculture, à la limite extrême de ce que nous pouvons accepter, et je le dis avec beaucoup de fermeté et de gravité. Chacun doit entendre ce message : nous n’irons pas plus loin.
Nous ne sacrifierons pas les intérêts de l’agriculture sur l’autel d’un accord international.
On nous dit qu’il faut achever coûte que coûte la négociation, mais il n’y a aucune raison à cela !
Quoi qu’il arrive, l’accord doit être équitable et fondé sur des règles de réciprocité.
M. Muller a parlé tout à l’heure des restitutions à l’exportation. Je ne vois pas pourquoi nous, Européens, abandonnerions ces restitutions si, de leur côté, les autres pays ne renoncent pas à l’ensemble des aides directes qu’ils apportent à l’exportation, qu’il s’agisse d’aide alimentaire en nature, comme aux États-Unis, de crédits à l’exportation, comme au Brésil, ou de monopoles d’État pour les exportations agricoles, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Regardons le monde tel qu’il est, avec lucidité, sans naïveté. Oui à l’amélioration du commerce, oui au commerce équitable, mais oui surtout à la défense des intérêts européens et à la règle stricte de la réciprocité et de l’équité !
Je le redis : nous n’irons pas, en matière agricole, au-delà de ce que nous avons déjà concédé.
Pour ce qui est, maintenant, du processus concernant la politique agricole commune, qui m’occupera, bien sûr, tout particulièrement dans le poste que viennent de me confier le Premier ministre et le Président de la République, nous serons guidés par l’idée selon laquelle l’agriculture et son avenir se jouent avant tout en Europe.
Il a été question du découplage des aides. Il s’agit en grande partie d’un débat aujourd’hui dépassé dans la mesure où aucun État membre n’est prêt à revenir en arrière. Le découplage a eu effectivement, comme l’a souligné Jean-Pierre Chevènement, des effets néfastes sur certains territoires fragiles ; je pense en particulier à l’agriculture de montagne.
Nous avons donc, à l’occasion du bilan de santé de la PAC, mis en place un certain nombre d’outils qui se sont révélés adaptés pour remédier à ces difficultés. Je crois d’ailleurs qu’en matière agricole la lucidité, la régularité des révisions, ainsi que la capacité à revenir sur ses erreurs et à s’apercevoir que certains choix n’ont pas toujours été les bons, sont absolument essentielles.
Et, avec le bilan de santé de la PAC, en instaurant de nouvelles mesures de régulation du marché, en particulier des aides ciblées pour des agricultures plus fragiles comme l’agriculture de montagne, nous avons répondu à des difficultés qui avaient émergé à la suite des choix qui avaient été faits.
Je sais que le bilan de santé de la PAC est souvent critiqué. Il ne faut pourtant pas en ignorer les aspects positifs, notamment en matière d’agriculture durable. Grâce à lui, en effet, nous avons réussi à faire progresser certaines filières, certains types de culture et d’élevage correspondant à la fois aux intérêts des agriculteurs et à la sécurité alimentaire que demandent nos concitoyens. Je pense en particulier au développement de l’élevage à l’herbe et à celui des produits biologiques.
Il s’agit là très exactement de ce qui peut constituer l’avenir du monde agricole – mais aussi, avec ses spécificités propres, de celui du monde de la pêche. Jean Bizet a tracé des perspectives très utiles sur ce sujet. J’aurai l’occasion d’y revenir, car c’est un point clé de la stratégie que nous voulons mettre en œuvre pour l’agriculture française.
La question des quotas laitiers a également été abordée par beaucoup d’entre vous et, dans la mesure où nous aurons tout à l’heure un débat sur ce thème, je me contenterai, en cet instant, de faire quelques remarques, en commençant par un bref rappel historique.
Vous savez tous que les quotas laitiers ont été créés en 1983 pour une durée limitée et afin de faire face à un problème de surproduction. La décision de les suspendre et même de les supprimer a été prise dès 1999. Cela ne date donc ni d’hier ni même d’avant-hier ! En 2003, nous avons décidé de les prolonger jusqu’en 2015. Nous venons de fixer deux rendez-vous, l’un en 2010, l’autre en 2012, pour poser la question de leur avenir. Il est donc caricatural de prétendre, comme on l’entend parfois, que les quotas sont supprimés !
Il a par ailleurs été décidé que chaque État membre pourrait augmenter ses quotas de 1 %. En France, vous le savez, nous avons décidé de geler cette hausse pour la campagne 2009-2010.
Voilà la situation actuelle. Comment pouvons-nous essayer de l’améliorer ? Comment remédier aux difficultés que continuent de rencontrer les producteurs laitiers et, surtout, répondre à leur détresse ?
J’ai eu l’occasion de rencontrer à plusieurs reprises des producteurs laitiers, en particulier en Haute-Normandie, dans les départements de mes amis Charles Revet et Joël Bourdin, et j’ai pu mesurer l’ampleur de leur détresse.
Comme pour le secteur agricole dans son ensemble, nous devons avancer dans deux directions, qui seront d’ailleurs des axes stratégiques de la politique que j’adopterai à la tête de ce ministère.
Première direction : la nécessaire régulation de la production. Quoi qu’il arrive, même si l’on supprime certains instruments, nous avons besoin, en matière agricole, de réguler la production. La liberté absolue, la concurrence absolue ont montré leurs limites ; c’est aussi vrai dans le domaine de l’industrie et des services que dans celui de l’agriculture.
Je me battrai donc pour qu’une régulation de la production s’applique dans le domaine laitier.
C’est du reste ce que Michel Barnier commencé à obtenir lors du Conseil des ministres de l’agriculture du 25 mai dernier, à travers deux mesures importantes : d’une part, la possibilité d’utiliser les outils d’intervention tant que le marché l’exigera ; d’autre part, le paiement anticipé des aides aux producteurs dès le 16 octobre, au lieu du 1er décembre.
Pour ma part, je vais entreprendre trois démarches pour défendre cette idée de régulation de la production et promouvoir des décisions dans ce sens. Aujourd'hui même, à l’occasion d’un déjeuner avec Mme Fischer Boel, je vais lui expliquer ma conception de la régulation de la production dans le secteur laitier. Je me rendrai par ailleurs très prochainement en Allemagne, qui est en l’espèce sur la même ligne que nous, pour discuter avec mon homologue allemande des moyens de faire prévaloir notre position. Enfin, j’irai la soutenir à Bruxelles auprès d’autres représentants de la Commission. J’ai l’avantage de bien connaître les arcanes de cette noble institution européenne et donc de pouvoir y défendre le plus fermement possible les vues du Gouvernement français.
Il a également été question du Conseil européen des 18 et 19 juin dernier, auquel j’ai participé aux côtés du Président de la République et du Premier ministre. Je puis vous dire que, contrairement à ce que laissaient entendre des rumeurs véhiculées par la presse – qu’il ne faut pas toujours écouter ! –, il y a eu, sur le sujet du lait comme sur beaucoup d’autres, une identité de vue totale entre Mme Merkel et M. Sarkozy. Je me suis fortement employé pendant six mois à ce qu’il en soit ainsi, vous le savez, et je compte continuer à le faire au poste que j’occupe aujourd'hui.
Le Président de la République et la Chancelière allemande ont effectivement souhaité que la Commission rende des comptes sur la situation des producteurs laitiers en France et en Europe. Nul ne peut ignorer la détresse des producteurs laitiers dans l’ensemble de l’Union européenne. Personne ne peut dire que les choses vont bien ! Personne ne peut estimer que les bonnes décisions ont été prises dès lors qu’un tel mouvement se développe, qu’une telle désespérance s’installe chez les producteurs laitiers d’Europe !
Il faut donc trouver rapidement des solutions. C’est ce que la France et l’Allemagne ont fait valoir conjointement, c’est ce que nous avons obtenu puisque le Conseil européen demande formellement à la Commission dans ses conclusions de lui remettre, dans les deux mois, des propositions concernant le secteur laitier.
La deuxième direction stratégique dans laquelle nous travaillerons, après la régulation de la production et la mise en place de règles cohérentes pour les marchés, c’est l’innovation et l’excellence rurales. Je ne m’attarderai pas sur ce sujet, car j’aurai l’occasion d’y revenir ultérieurement. Au demeurant, je considère que Jean Bizet l’a remarquablement traité.
Nous constatons tous, dans nos territoires, dans nos circonscriptions, dans nos régions, qu’il n’y a pas d’autre avenir pour le secteur agricole que celui de l’innovation perpétuelle et de la recherche constante de l’excellence rurale. Nos agriculteurs s’y engagent d'ailleurs jour après jour avec beaucoup de détermination et de savoir-faire, en faisant preuve d’un sens de l’innovation et de la technologie…
… parfois beaucoup plus poussé que ceux qui leur reprochent de ne pas être assez audacieux en la matière.
La révision de la stratégie de Lisbonne sera l’un des grands enjeux européen de l’année 2010. Ce sera une priorité de la présidence suédoise, puis de la présidence espagnole. J’avais déjà proposé à plusieurs reprises que nous y incluions des critères contraignants en matière d’innovation et de recherche pour que tous les pays suivent le rythme et que la France et l’Allemagne, notamment, ne soient pas les seules à en supporter le coût. Il me paraîtrait donc utile que la révision de la stratégie de Lisbonne comporte un volet spécifique pour l’agriculture, la pêche et l’alimentation.
En conclusion de ma première intervention dans cet hémicycle en tant que ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, je tiens à vous dire que j’aurai toujours un grand plaisir à enrichir ma réflexion par un dialogue avec l’ensemble du Sénat.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur certaines travées du RDSE.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat vient à point nommé et je tiens à remercier M. Jean-Pierre Chevènement de l’avoir suscité.
Ce débat nous donne d’abord l’occasion de prendre un peu de recul pour examiner à froid l’état des négociations du cycle de Doha après l’échec enregistré au mois de juillet 2008.
Sous la présidence française de l’Union européenne, j’avais conduit, en tandem avec Michel Barnier, les travaux du Conseil de l’Union européenne.
Les élections américaines et, dans une moindre mesure, les élections indiennes ont provoqué une pause politique à Genève. Les gouvernements sont à présent en place, les nouveaux négociateurs ont été nommés. Une réunion des ministres du commerce de l’OCDE a d'ailleurs lieu aujourd'hui même à Paris, et j’aurai l’occasion de les y rencontrer.
Ce débat est également bienvenu puisque, le lendemain même de la formation du Gouvernement, il permet de présenter au Sénat le nouveau binôme que Bruno Le Maire et moi-même formons désormais : nous serons en première ligne, à Bruxelles et à Genève, pour porter la voix de la France.
Je me réjouis de renouveler, avec ce débat, l’expérience que nous avions menée l’année dernière, avant les négociations du cycle de Doha, négociations qui ont duré, je vous le rappelle, une dizaine de jours. Le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, avait en effet organisé une réunion très intéressante au cours de laquelle le sénateur Jean Bizet avait déjà fait la preuve de sa compétence.
Les éléments de réponse que je voudrais vous apporter s’articulent autour de cinq points.
Premièrement, ces dernières années de négociations ont abouti à un point très positif pour l’Europe : à la différence des sessions précédentes de Hong-Kong, l’agriculture européenne n’était plus « dans le collimateur » ; elle a cessé, l’année dernière, à Genève, de focaliser les critiques.
Comme plusieurs d’entre vous l’ont rappelé, le blocage des négociations provenait d’un conflit entre l’Inde et les États-Unis sur les sauvegardes spéciales, c’est-à-dire sur la possibilité pour les pays en développement de réagir à une trop forte augmentation des importations, susceptible de mettre en péril leur agriculture domestique.
Deuxièmement, comme l’a indiqué Bruno Le Maire, la Commission européenne a des lignes rouges à respecter dans les négociations. Il existe une limite ultime, et l’Union européenne, représentée par le commissaire au commerce et par le commissaire à l’agriculture, n’ira pas plus loin. La proposition agricole telle qu’elle a été exprimée l’an dernier dans ce que l’on appelle le « projet de modalités » détermine l’effort maximal que peut fournir l’Union européenne pour parvenir à la conclusion du cycle.
Comme vous le savez, le Gouvernement français est déterminé à ce qu’un accord sur l’agriculture à l’OMC n’oblige pas l’Union européenne à réviser la PAC, réformée en 2003 et confortée récemment par le bilan de santé. Bruno Le Maire a dit cela mieux que je ne saurais le faire, mais je voulais vous assurer, s’il en était besoin, de notre totale cohésion.
Nous avons clairement déclaré que nous ne pourrions donner notre accord à un texte agricole qui nous priverait de leviers de régulation du marché agricole communautaire. Cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant, surtout quand le ministre de l’agriculture n’est pas le seul à le dire, et Bruno Le Maire ne m’en voudra pas d’apporter cette précision.
Sourires
Le président de la Commission européenne, M. Barroso, a d'ailleurs pris la mesure de la détermination du Président Sarkozy et de notre gouvernement puisqu’il est précisé dans son projet pour les cinq ans à venir qu’il s’attachera à défendre la PAC.
Troisièmement, on ne peut pas dire, comme Jean-Pierre Chevènement l’a laissé entendre, que l’agriculture pourrait être sacrifiée au profit des intérêts industriels et des services. Je veux vous rassurer, monsieur le sénateur : non, l’agriculture n’est pas la variable d’ajustement. Elle fait au contraire l’objet d’une attention particulière dans la pondération globale des intérêts offensifs et défensifs de l’Union européenne.
C’est même sans doute l’inverse qui est vrai : l’Union européenne a clairement choisi de modérer ses prétentions ou ses ambitions en matière d’accès aux marchés industriels ou de services, de manière à sanctuariser autant que possible notre position agricole face à des pays émergents comme le Brésil, qui sont prompts à nous reprocher de vouloir agir sur les deux tableaux.
C’est la raison pour laquelle nous pensons que l’étape de juillet 2008 n’est pas mauvaise et que le travail doit se poursuivre sur cette base.
Quatrièmement, cette base est cependant loin d’être figée : il n’y a pas à proprement parler de « paquet » de juillet 2008. De trop nombreux paramètres restent « ouverts » pour que nous puissions baisser les bras ou adopter une position définitive d’adhésion ou de rejet. La vigilance continue à s’imposer, et c’est pourquoi il est particulièrement important de pouvoir associer la représentation nationale, notamment le Sénat, ainsi que les professionnels, à ce travail commun.
Parmi les sujets qui ne sont pas réglés, certains ne sont pas minces : je pense au coton ou encore à la banane, qui concerne plusieurs de nos régions d’outre-mer.
Par conséquent, notre intention n’est pas du tout d’obtenir un accord coûte que coûte : si l’accord nous convient, tant mieux ; s’il ne nous convient pas, nous n’y adhérerons pas.
Cinquièmement, enfin, je voudrais rappeler que nous nous voulons également offensifs dans la négociation à l’OMC. Chargée du commerce extérieur de la France, je suis heureuse de pouvoir compter sur l’excédent du commerce des denrées agricoles et agroalimentaires pour compenser de terribles déficits, celui de la filière automobile entre autres.
Je compte, avec Bruno Le Maire, intensifier encore la professionnalisation de l’ensemble de la filière agricole à l’international. Parmi nos sujets offensifs figure la question des appellations d’origine, des indications géographiques, qui font partie des spécificités européennes, comme l’a fort bien souligné Jean Bizet.
Tels sont les éléments qu’il convient de garder à l’esprit s’agissant du cycle de Doha.
Nous avons certes fait admettre à nos partenaires des lignes rouges, mais nous voulons aller plus loin : nous voulons qu’il y ait un « après-Doha ».
D’ailleurs, nous commençons à tracer des pistes à cet égard.
Nous sommes confrontés à une crise non seulement financière, mais également alimentaire, environnementale et des matières premières. Il faut donc une réponse multilatérale face à de nouveaux défis, aux premiers rangs desquels figurent bien évidemment la sécurité alimentaire et la protection de l’environnement.
C’est la raison pour laquelle le Président de la République s’est exprimé à plusieurs reprises, que ce soit devant la FAO au printemps dernier ou à l’occasion de son récent discours devant le Congrès, pour appeler à de meilleures coordinations avec des enceintes multilatérales telles que la FAO, justement, ou l’Organisation mondiale de l’environnement. Voilà qui répond aux préoccupations exprimées notamment par Mme Odette Herviaux.
Dans le même ordre d’idée, nous souhaitons davantage de réciprocité et de loyauté dans le commerce international. Je reprendrai d’ailleurs, avec sa permission, la formule de Jean-Pierre Chevènement, qui plaidait pour une « concurrence équitable ».
En écoutant les différents orateurs qui se sont succédé, j’ai ressenti une véritable convergence de vue sur cette idée d’une « concurrence équitable », sur le refus de banaliser l’agriculture et sur l’appel à une régulation des échanges. Comme le soulignait Jean Bizet, nous sommes à la recherche d’un équilibre entre ouverture et protection.
Nous faisons le même constat : à un moment où notre monde a tant besoin de régulation, l’OMC est une instance de régulation comme il en existe peu.
Qu’il s’agisse du Gouvernement ou de la représentation nationale, nous partageons tous la volonté de défendre une agriculture à la fois capable d’assurer la sécurité alimentaire et fidèle à notre modèle.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur certaines travées du RDSE.

L’ordre du jour appelle le débat sur la crise de la filière laitière.
La parole est à M. Gérard Bailly, au nom du groupe Union pour un mouvement populaire, auteur de la demande d’inscription à l’ordre du jour.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes plus sincères félicitations pour votre nomination à ce grand ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. Je me réjouis d’ailleurs que le terme « alimentation » figure dans l’intitulé de vos fonctions. En effet, l’alimentation n’est-il pas l’objectif majeur, le plus noble, de notre paysannerie ?
Il me paraît très opportun d’évoquer plus précisément la crise de la filière laitière après avoir débattu du volet agricole de la négociation de l’OMC.
Comme cela a déjà été souligné aujourd'hui, cette filière se trouve actuellement dans une situation préoccupante. La colère des producteurs est réelle et inquiétante. Le 25 mai dernier, 12 000 producteurs ont manifesté à travers toute la France, bloquant certaines laiteries ou usines, ainsi que des supermarchés. Puis le mouvement s’est radicalisé pendant le week-end des 13 et 14 juin. Des manifestations importantes ont eu lieu ces derniers jours à Bruxelles et à Luxembourg. Le blocage d’une quarantaine de plates-formes d’approvisionnement de la grande distribution pendant 48 heures par 7 000 manifestants et des débordements au sein de certaines grandes surfaces suscitent naturellement notre vive inquiétude.
La tension monte et la tournure que peuvent prendre les événements est imprévisible si aucune solution n’est rapidement trouvée. Je ne voudrais pas, chacun le comprendra, que ce dossier passe dans les prochains mois des mains du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche à celles du ministre de l'intérieur pour des raisons liées à la sécurité !
Sourires

Mais revenons à l’origine de cette crise, c'est-à-dire la baisse soudaine et brutale du prix du lait. Ce prix, qui avait connu une flambée entre 2006 et 2008, après n’avoir cessé de baisser entre 2001 et 2006, est retombé à un niveau historiquement bas.
Si l’on se reporte au graphique retraçant les prix à la production en moyenne annuelle depuis dix ans, que constate-t-on ? Le prix payé au producteur pour un litre de lait, qui était de 31 centimes d’euro en 2001, est progressivement tombé à 26, 7 centimes d’euro en 2006 avant de remonter à 33, 6 centimes d’euro l’année dernière. Depuis, ce prix est brutalement retombé à 21, 22 ou 23 centimes d’euro – cela varie selon les régions et les productions –, c'est-à-dire à un niveau très inférieur aux coûts de production.
Au mois d’avril, lors de la dernière livraison, les producteurs ont ainsi dû accepter une baisse des prix de 30 %, décidée unilatéralement par les entreprises de transformation qui assurent la collecte de leur lait. Cette baisse est d’autant plus choquante qu’elle ne s’accompagne pas d’une baisse similaire des prix de vente des produits laitiers acquittés par les consommateurs : au premier trimestre, ces prix-là n’ont reculé que d’environ 2, 2 %.
Comment expliquer un tel écart ? Pas par une diminution brutale de la consommation de ces produits, qui stagne ou qui décroît seulement très légèrement sur le long terme.
Mes chers collègues, j’ai moi-même pu constater l’évolution des prix et je vous invite à vous rendre dans les GMS, les grandes et moyennes surfaces, en province comme à Paris. Chez moi, le litre de lait entier est vendu entre 0, 84 et 0, 99 euro et le litre de lait demi-écrémé, entre 0, 70 et 0, 80 euro. Certes, après m’être renseigné auprès des vendeurs d’un supermarché supposé offrir les meilleurs prix et à l’issue d’un véritable jeu de piste, j’ai pu trouver des briques de lait demi-écrémé à 0, 59 euro, mais elles étaient du côté des eaux minérales, à l’autre bout du magasin ! Bien sûr, c’est ce prix-là qui est annoncé dans les publicités, mais les articles concernés ne sont pas à la vue des consommateurs…
Les GMS devraient nous expliquer quelles sont les charges qui justifient de telles plus-values. Et les transformateurs doivent renoncer à leurs pratiques opaques que personne n’ose dénoncer par crainte d’être déréférencé.
Comme nous le savons, la filière laitière représente un poids économique et social non négligeable. Elle rassemble 95 000 producteurs, contre 151 000 en 1988, 700 entreprises privées et coopératives, pour un total de près de 200 000 emplois. Son chiffre d’affaires était de 23, 5 milliards d’euros en 2007, dégageant un excédent commercial de 2, 9 milliards d’euros.
Outre l’aspect économique et les questions d’emploi, n’oublions pas le rôle des éleveurs dans l’environnement et l’aménagement de nos territoires. Si nous n’y prenions pas garde, la friche prendrait vite le relais de nos verts pâturages dans les zones d’élevage à l’herbe.
Permettez-moi de vous citer quelques chiffres sur la baisse du nombre de vaches laitières. On en dénombre aujourd'hui environ 3, 8 millions, contre 7, 166 millions en 1983, soit une diminution de plus de 3 millions de têtes ! Et je rappelle que, comme François Fortassin et moi-même l’avons souligné dans un rapport, le cheptel français d’ovins est passé de 11 millions à 8, 2 millions de bêtes en quelques années. Cette baisse du nombre d’herbivores domestiques observée sur notre territoire depuis une vingtaine d’années n’est évidemment pas sans conséquences dommageables pour notre environnement.
Bien sûr, à l’instar de nombre de mes collègues, je me félicite que les dernières réformes de la PAC, la politique agricole commune, aient rétabli des primes à l’herbe, afin d’aider les éleveurs des zones difficiles, notamment en montagne. Malheureusement, je crois que ce dispositif n’entrera pas en vigueur avant 2010. Espérons que le découragement ne frappe pas trop d’éleveurs d’ici là !
N’oublions pas non plus le rôle stratégique de notre filière laitière française, qui contribue à la préservation de l’indépendance alimentaire de notre pays, comme cela a été rappelé lors du débat précédent. Qu’adviendrait-il si nous ne maîtrisions plus l’approvisionnement de notre pays ? Comment garantir la qualité et la sécurité sanitaire de produits provenant de pays qui n’ont pas forcément des exigences aussi strictes que nous à cet égard ?
Par ailleurs, je ne pense pas que le dépérissement de notre filière laitière soit compatible avec les objectifs du Grenelle de l’environnement.
Chacun le sait, la production de lait obéit à des contraintes très particulières. Il s’agit d’un produit lourd, volumineux et fragile, qui ne peut pas être stocké longuement. Le métier est particulièrement difficile, avec deux traites quotidiennes et peu de temps libre pour la vie privée. D’ailleurs, on remarque que les producteurs laitiers qui ont quitté la profession n’y reviennent jamais. En outre, les investissements sont très lourds, ce qui rend l’installation délicate, et ils ne sont rentabilisés qu’au bout de nombreuses années. Enfin, les producteurs ne connaissent le prix qui leur sera payé qu’un mois et demi après avoir livré leur lait.
Il faut avoir ces considérations bien présentes à l’esprit lorsqu’on parle de lait. Le lait n’est pas un bien industriel comme un autre ; c’est un produit vivant, étroitement lié à l’animal dont il est issu et à l’homme qui lui a consacré son travail.
Ces dernières années, les prix du lait faisaient l’objet d’une recommandation nationale trimestrielle de l’interprofession, le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, le CNIEL, fondée sur la combinaison de différents indicateurs et à caractère non obligatoire. Les structures régionales interprofessionnelles, les CRIEL, étaient les enceintes de discussion au niveau local entre producteurs et transformateurs, où les prix de base du lait étaient discutés à partir de la recommandation nationale. À ce titre, la filière laitière était souvent citée en exemple non seulement pour son organisation, mais également pour son sens de la responsabilité.
Or une lettre de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, demandant à l’interprofession laitière de cesser ses recommandations en matière d’évolution de prix, a été adressée au président du CNIEL au mois d’avril 2008. Elle y assimilait l’accord interprofessionnel sur le prix du lait à une « entente », interdite par la réglementation communautaire, dont un secteur comme la viande bovine avait déjà fait les frais en France, lors de la crise de la vache folle. Conformément à l’injonction de la DGCCRF, le CNIEL a cessé d’émettre des recommandations dès le 1er juillet 2008.
Depuis cette remise en cause du cadre interprofessionnel, le système a volé en éclats et les acteurs ne s’entendent plus. En effet, les transformateurs et les distributeurs n’ont pas joué le jeu et en ont profité pour ne pas venir à la table de négociations, soit en en ne présentant aucun chiffre, soit en proposant des prix d’achat du lait manifestement trop faibles.
Cependant, le Gouvernement, et plus particulièrement votre prédécesseur, Michel Barnier, auquel je rends hommage, n’est pas resté inactif.

À court terme, deux médiateurs ont été nommés pour encourager la reprise des négociations entre les parties prenantes aux niveaux national et régional. Leurs compétences ont été saluées. Cela a permis d’aboutir, le 3 juin, à un accord qui réévalue légèrement à la hausse le prix du lait pour les prochaines livraisons. Bien qu’il ne règle pas les problèmes sur le long terme, cet accord a le mérite d’exister et de permettre à la filière de « sortir de l’ornière », dans l’urgence.
À moyen terme, il est prévu que le projet de loi de modernisation de l’agriculture, attendu d’ici à la fin de l’année, offre de nouveaux outils permettant d’améliorer la transparence et de mieux organiser la filière. Je sais que votre nomination est toute récente, monsieur le ministre, mais pourriez-vous d’ores et déjà nous apporter quelques éléments sur ce sujet ? Il faut que nous puissions envisager ensemble une meilleure organisation du secteur agricole en général, et du secteur laitier en particulier.
Par ailleurs, dans le cadre du bilan de santé de la PAC, votre prédécesseur a obtenu deux rendez-vous à mi-parcours sur le marché laitier, en 2010 et 2012, rendez-vous qui n’étaient pas prévus au calendrier européen. Et, au vu de la conjoncture européenne et mondiale de cette production, l’idée d’un maintien du système des quotas après 2013 n’est peut-être pas complètement écartée.
Monsieur le ministre, les instances européennes, que vous connaissez bien, sauront peut-être vous écouter. Comme vous l’avez souligné tout à l'heure, la crise du lait a été, sur l’initiative de la France, inscrite à l’ordre du jour du Conseil des ministres européens de l’agriculture du 25 mai dernier. Quelques mesures de soutien ont été annoncées à cette occasion. Je pense notamment au prolongement de l’intervention et des aides au stockage privé du beurre, ainsi qu’au versement anticipé, dès le mois d’octobre prochain, en faveur des producteurs laitiers les plus touchés, de 70 % des subventions prévues au titre de 2010.
Cependant, la Commission a rejeté toute remise en cause de la hausse progressive des quotas d’ici à 2013, puis de leur suppression. Pour Mme Fischer Boel, commissaire européen, ce sont non pas les hausses de quotas qui expliquent la crise actuelle, mais la surproduction mondiale et la baisse de la consommation. On me permettra de m’interroger sur bien-fondé de cette analyse.

Pensez-vous, monsieur le ministre, que nos partenaires européens sont susceptibles d’évoluer sur ce sujet et que cette décision, prise dans un contexte aujourd’hui caduc, pourra être révisée un jour ?
La commission des affaires économiques, pour sa part, a travaillé sur ce thème, plus particulièrement au sein du groupe d’études de l’élevage que j’anime et qui a mis en place un mini-groupe de suivi du dossier laitier. Dans ce cadre, nous avons procédé à un certain nombre d’auditions. Ainsi, nous avons reçu, voilà quelques mois, à leur demande, les Jeunes Agriculteurs, très inquiets. Nous avons également entendu M. Jérôme Bédier, président de la Fédération du commerce et de la distribution, les entreprises Entremont et Danone, la Fédération nationale des producteurs de lait, ainsi que, hier matin, le CNIEL.
En outre, la commission des affaires économiques a auditionné, la semaine dernière, M. Luc Chatel, alors secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation.
Nous poursuivrons nos auditions dans les semaines à venir, et ce jusqu’à la rentrée, puisque nous devrions encore recevoir la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Observatoire des prix et des marges, les médiateurs nommés par le Gouvernement et le président de l’Autorité de la concurrence.
Il me semble que nous pouvons tous nous accorder, aujourd’hui, pour dire qu’il est nécessaire d’aboutir non pas à une baisse du prix des produits laitiers à la consommation, car les producteurs seraient une nouvelle fois les premiers à en pâtir, mais à une répartition de la valeur ajoutée plus équilibrée et plus équitable tout au long de la filière.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, est-il normal et juste qu’un producteur ayant vendu son litre de lait un peu plus de 20 centimes d’euros le voie commercialisé sous une grande marque nationale dans la grande surface proche de chez lui à 1 euro le litre ?
Je le répète, il faut mettre fin à l’opacité entourant la formation de ce prix final. L’Observatoire des prix et des marges, créé par la loi de modernisation de l’économie, doit maintenant travailler sur les moyens de faire prévaloir la transparence en la matière.
Sur un plan plus opérationnel, il faudra que producteurs, transformateurs et distributeurs se retrouvent à nouveau à la même table pour discuter ouvertement de la répartition de la valeur ajoutée entre les différents maillons de la filière. Cela exige que transformateurs et distributeurs prennent leurs responsabilités devant l’opinion et les pouvoirs publics, communiquent leurs chiffres et assument les prix d’achat et de revente, ainsi que les marges qu’ils pratiquent.
M. Bédier nous a fait part de son accord pour participer aux travaux de l’Observatoire des marges sur ce sujet, à condition toutefois, selon ses propres termes, « de ne pas être sur un strapontin ».
La réunion du 17 juin dernier qui s’est tenue au ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi entre tous les acteurs de la filière ne semble pas avoir apporté d’évolution notable. En effet, d’abord, les grandes enseignes de la distribution n’étaient pas toutes directement présentes. Pourquoi ? Ensuite, les positions n’ont guère semblé prêtes à évoluer, jusqu’à paraître définitivement inconciliables, même si chacun a appelé à plus de sérénité au sein de la filière.
Si les GMS, ont aussi peu de marges qu’elles le prétendent, ce ne doit pas être si difficile à prouver… Et, dans un souci d’apaisement, pourquoi ne baisseraient-elles pas leurs marges de quelques centimes compte tenu de l’acuité de la crise actuelle ?
Il reste que les producteurs doivent mieux s’organiser en amont, afin de renforcer leur pouvoir de négociation face aux transformateurs et aux distributeurs. Il convient également de protéger les éleveurs dans leurs relations commerciales avec leurs acheteurs, au moyen d’une contractualisation équilibrée.
Nous sommes tous conscients des pressions pesant sur les éleveurs depuis l’aval de la filière et, à cet égard, la mise en place dans chaque département des brigades de contrôle me paraît être une très bonne initiative. Elle devrait être très utile aux producteurs et aux PME qui hésitent toujours à dénoncer les pratiques illégales de commercialisation.
De plus, l’élaboration d’un cadre interprofessionnel permettant d’instituer une contractualisation à partir de 2010 constitue l’un des trois points issus de l’accord du 3 juin, et il faut aller rapidement dans ce sens.
Par ailleurs, nous n’éviterons pas de revenir, à l’échelon européen, sur le régime laitier et de rediscuter de la fin programmée des quotas laitiers. Les évolutions erratiques des marchés agricoles montrent, une fois de plus, qu’ils ne peuvent être abandonnés au libre jeu de la concurrence et qu’ils doivent faire l’objet d’une régulation par les pouvoirs publics. À cet égard, je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir déjà souligné tout à l'heure que ce point constituait une priorité à vos yeux. Les productions agricoles sont, en effet, très largement soumises aux aléas climatiques, sanitaires ou économiques.
Des mécanismes de stockage et de dégagement doivent être maintenus, voire amplifiés. D’ailleurs, nous aurions échappé à la crise que nous avons connue l’an dernier à la suite de l’augmentation considérable du prix du lait si des stocks avaient existé à ce moment-là. Le stockage représente une méthode efficace pour lisser les prix en cas de surproduction ou de sous-production.
C’est pourquoi on peut déplorer la politique menée depuis plusieurs années tant par l’Europe que par les États-Unis. Ces derniers, qui viennent d’ailleurs de se rendre compte de la situation, ont décidé d’appliquer un vaste programme d’abattage de vaches laitières.
L’Europe doit également soutenir les mécanismes d’assurance récolte pour la filière lait, puisque des possibilités ont été ouvertes en ce sens dans le bilan de santé de la PAC. Notre pays doit veiller à les concrétiser dans le droit national.
Plusieurs questions restent en suspens.
Tout d’abord, comment discuter publiquement de marges sans tomber dans l’entente condamnée par la loi et sans revenir au contrôle des prix ?
M. Jérôme Bédier a proposé d’instaurer « une sorte de prix directeur entre les producteurs et les industriels ». L’idée que le CNIEL établisse des « indices de prix » permettant « d’éclairer les acteurs de la filière », la négociation relevant ensuite des relations contractuelles entre producteurs et transformateurs, nous paraît bonne.
La commission des affaires économiques, sur l’initiative de son président, M. Jean-Paul Emorine, que je salue et remercie, a décidé, comme la LME lui en donne la possibilité, de saisir l’Autorité de la concurrence pour avis sur la question. Les conclusions de cette instance sont attendues pour la rentrée parlementaire d’octobre ; nous ne manquerons pas, alors, d’avoir de nouveau des échanges sur ce point.
Ne pourrait-on, par ailleurs, interdire la vente de lait en dessous de son coût de production, de la même façon que l’on interdit aujourd’hui la revente à perte ? Car c’est bien une vente à perte que subissent aujourd'hui de nombreux éleveurs, qui ont vu leurs charges s’envoler sans pouvoir les répercuter. De fait, l’énergie, la main-d’œuvre, le matériel, les transports, les engrais, les frais vétérinaires, l’alimentation du bétail, les cotisations à la Mutualité sociale agricole, notamment, ont fait grimper considérablement les charges dans les exploitations.
Tels sont, monsieur le ministre, mes chers collègues, les quelques éléments et interrogations que je souhaitais vous livrer pour entamer notre débat d’aujourd’hui.
Nous devons faire preuve de détermination pour trouver des solutions à cette crise, quitte à légiférer si les partenaires de la filière ne parviennent pas à se mettre d’accord. Il est important de montrer, par le présent débat, à quel point notre assemblée est concernée par ce sujet. Il nous faut maintenant apporter des solutions concrètes, et je sais, monsieur le ministre, compte tenu des propos que vous avez tenu voilà quelques minutes, que vous aurez à cœur d’y travailler avec nous.
Ce ne sera sans doute pas facile, mais votre connaissance des problèmes européens, de l’Allemagne, principal pays producteur de lait en Europe, sont autant d’atouts sur lesquels nous comptons. De même, votre lucidité quant à l’importance des mécanismes de l’OMC devrait vous permettre d’exercer avec une grande efficacité vos nouvelles fonctions.
Il vous faudra aussi être convaincant au sein du Gouvernement français pour que se mette en place une bonne organisation des filières agricoles, plus particulièrement de la filière laitière, et donner un réel pouvoir aux interprofessions.
Enfin, nous attendons la réalisation très rapide du contrôle des marges, à laquelle MM. Michel Barnier et Luc Chatel se sont engagés, car le temps est compté.
En tout cas, nous espérons que vous saurez convaincre Mme le commissaire européen chargé de l’agriculture et du développement rural lors du déjeuner que vous prendrez avec elle tout à l'heure, et je vous souhaite bon appétit !
Sourires et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, permettez-moi de vous féliciter, à mon tour, pour votre nomination comme ministre de l’alimentation, de l’agriculture, …

Mme Jacqueline Gourault. C’est vrai, mon cher collègue, il ne faut pas oublier la pêche, même si, en tant qu’élue du Loir-et-Cher, je pense d’abord à l’agriculture, tout en sachant qu’un parlementaire doit avoir une vision nationale.
Sourires

Quoi qu'il en soit, monsieur le ministre, vous qui êtes aussi d’un département où l’agriculture occupe une place importante, vous savez évidemment, non seulement qu’il s’agit d’un secteur fondamental dans l’économie française, mais qu’elle est aussi au cœur d’une vision de la ruralité que nous partageons tous, me semble-t-il : nul ici ne peut imaginer un espace rural sans agriculteurs, et plus précisément sans exploitations familiales, à dimension humaine. Voilà pourquoi nous pensons qu’il faut absolument que ces exploitations puissent vivre : ce sont très largement elles qui font vivre les territoires sur lesquels elles sont implantées, qui font vivre notre ruralité.
Pourquoi une telle crise en 2009 ? En fait, elle n’aurait pas été possible avant les réformes de la PAC de 2003 et de 2006. En effet, les mécanismes de régulation auraient pallié les effets conjoncturels qui l’ont déclenchée et qui sont, pour l’essentiel, les suivants : d’abord, la flambée des cours des matières premières, car les fonds spéculatifs investissent massivement dans les produits laitiers industriels et dans le blé ; ensuite, les sécheresses simultanées en Australie, en Nouvelle-Zélande, notamment ; enfin, le retournement brutal des marchés à la suite de la crise financière.
Avant ces réformes, les mécanismes de régulation auraient consisté à déclencher l’achat au prix d’intervention, à soutenir les exportations en permettant les dégagements de marché de poudre et de beurre, et enfin, à organiser le marché grâce au recours aux quotas.
Or les réformes de la PAC ont visé, sur un fondement que je n’hésiterai pas à qualifier d’idéologique, à augmenter les quotas, ce qui revient à en supprimer l’effet, et nous croyons pouvoir penser que cette augmentation prélude à leur suppression, ainsi qu’à celle du prix d’intervention et des restitutions aux exportations.
Résultat : au plus fort d’une crise conjoncturelle, l’équilibre fragile de toute une filière se mue en une hécatombe économique et sociale. Vous n’ignorez pas les situations dramatiques vécues par de nombreuses familles dont les exploitations ne trouvent pas preneur de leur collecte de lait.
J’ai participé, voilà quinze jours, au comice agricole qui se tenait dans une commune de département, Savigny-sur-Braye, dans le Perche. Les agriculteurs et les producteurs laitiers ont tenu à y mener leur bétail et à participer à cette fête – car les comices agricoles sont des fêtes !

Ils ont tenu à montrer leur volonté de se battre pour sauver leur métier. Mais leur regard trahissait leur grande inquiétude, voire, chez certains, leur désespoir devant leur situation.

Il faut en avoir conscience et prendre rapidement des décisions avant que des drames humains ne se multiplient dans les campagnes françaises.
J’ai parlé tout à l'heure d’idéologie parce que le système des quotas et de régulation des marchés a permis à la filière laitière de fonctionner pendant vingt ans, d’avoir le prix agricole le plus stable de toute l’agriculture, de renouveler ses actifs mieux que toute autre filière, de permettre l’installation de plus de jeunes agriculteurs que dans toute autre filière, et tout cela en coûtant très peu au budget de l’Union européenne puisque l’écoulement, de façon marginale, des stocks sous forme de poudre et de beurre ne représentait que 2 % à 3 % du budget de la PAC.
Dès lors, pourquoi le scénario du pire est-il encore aujourd’hui possible ?
La suppression des quotas est une impasse. Les rapports de force entre les acteurs économiques – producteurs, transformateurs, distributeurs – sont tels, que sans mesures de contingentement de la production pour équilibrer les négociations, les producteurs sont écrasés par la possibilité qu’ont les entreprises d’aval de corriger les effets du marché sur leurs propres marges. Il s’agit d’un phénomène en cascade. Les producteurs sont à la merci de tout retournement de tendance du marché.
Autrement dit, sans mécanisme de régulation du prix à l’échelle collective, nationale ou par grand bassin de collecte, il n’y a aucun espoir pour les producteurs de vivre de ce métier.
Monsieur le ministre, la responsabilité politique des décideurs nationaux et communautaires est extrêmement importante. Il ne sert à rien de faire peser toute la responsabilité sur la grande distribution et les industriels. Il est urgent de partager cette responsabilité et d’aménager le droit de la concurrence de manière à permettre aux producteurs de s’organiser pour rééquilibrer le dialogue interprofessionnel et les négociations commerciales.
J’espère, monsieur le ministre, que votre nomination apportera une réelle solution à la crise que vivent les producteurs de lait en France.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Jean-Pierre Chevènement applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise laitière de 2009 pressentie depuis 2008 fait partie du paysage désormais habituel et cyclique des crises qui frappent de façon quasi chronique les productions agricoles alimentaires dans leur ensemble.
Chaque crise apporte son lot de colère, d’exaspération, de renoncement et de faillites des producteurs, qui constituent pourtant la trame de notre ruralité.
Chaque crise mène à un degré de concentration plus élevé des exploitations au profit d’une rentabilité accrue pour les transformateurs et pour la grande distribution.
Ainsi, le nombre de vaches laitières a reculé de 14, 2 % au cours de la période 2001-2007, et plus de 28 000 exploitations ont disparu. Avec une augmentation de population de plus de 10 millions d’habitants depuis 1985, la collecte annuelle de lait a reculé de 25 milliards de litres à 23 milliards de litres, soit 2 milliards de litres de lait en moins.
Les causes des crises laitières sont multiples et bien identifiées : les crises laitières, elles-mêmes, affaiblissent la production et les producteurs ; le pouvoir d’achat en baisse des Français, qui réduit la consommation des ménages ; la baisse de production de la filière veau, grande consommatrice de poudre de lait, filière qui produisait 405 000 tonnes en 1980 et qui n’en produit plus que 274 000 tonnes aujourd’hui ; les règles économiques du marché et de la concurrence, qui conduisent à la loi de la jungle et aux importations abusives anti-communautaires ; le comportement de prédateur de la grande distribution, qui réalise des marges exagérées via ses centrales d’achat au détriment des transformateurs ; les transformateurs qui, sous la pression de la grande distribution, camouflent leurs marges et sont contraints de répercuter les pressions des grands magasins spécialisés, les GMS, sur les producteurs ; la réduction des soutiens par l’Europe aux produits de dégagement que peuvent être le beurre et la poudre de lait en période de crise ; le poids de l’Europe libérale qui, en accord avec l’OMC, supprime progressivement tous les outils de régulation, dont les quotas laitiers, et libéralise à outrance le marché laitier, pour que le prix de référence mondial soit la règle générale alors que ce prix ne correspond qu’à 6 % des échanges.
M. le secrétaire d’État Luc Chatel a tenté, la semaine passée, au sein de la commission des affaires économiques du Sénat, de justifier la LME, la loi de modernisation de l’économie, et de minimiser son rôle dans la crise laitière.
Pourtant, cette loi, censée améliorer les relations commerciales, a pour effet de les aggraver en livrant les producteurs et les transformateurs aux diktats des centrales d’achat qui font la pluie et le beau temps, la pluie pour les fournisseurs et le beau temps pour elles-mêmes.
Cela n’est pas surprenant quand on sait que de multiples volets de cette loi ont été concoctés entre M. Michel Édouard Leclerc et le Président Sarkozy.
Il y a un an, avec Michel Barnier, le Gouvernement a cédé une fois de plus aux sirènes libérales de Bruxelles et a retiré au Centre national interprofessionnel de l’économie laitière, le CNIEL, le droit de formuler des recommandations trimestrielles sur le prix du lait.
Aujourd’hui, vous nous proposez trois outils qui, sans vouloir faire de procès d’intention, restent inefficaces face au problème de fond de la crise.
Vous nous proposez d’autoriser l’interprofession à établir des indices de prix. Il faut tout de même savoir que les centres d’économie rurale ont déjà tous les chiffres concernant le prix de revient.
Vous nous proposez également de multiplier les contrôles effectués par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, après avoir affaibli cet organisme au nom de la révision générale des politiques publiques.
Vous nous proposez, enfin, de changer le braquet de l’Observatoire des prix et des marges.
Les constats et les contrôles n’ont jamais constitué un outil efficace de prix rémunérateurs. Ils peuvent, à tout le moins, donner des indications souvent déjà connues.
Pendant des années, les producteurs en crise se sont laissés endormir par les instruments classiques de régulation autorisés en Europe, ce qui, à chaque crise, n’empêchait pas la concentration, mais rendait un peu moins douloureuse la situation des dégagés d’office.
La situation appelle autre chose que des mesurettes ou de l’enfumage, monsieur le ministre. C’est une question de jours pour certaines exploitations, de semaines et de mois pour d’autres.
L’exemple calculé par le Centre d’économie rurale des Côtes-d’Armor est éloquent pour prendre la mesure de la gravité de la crise.
Une exploitation laitière dégageait ces dernières années une moyenne de 15 000 à 16 000 euros de revenu par an et par unité de travail humain. Si nous prenons le cas d’un exploitant travaillant seul pour produire un quota annuel de 200 000 litres, nous arrivons à 1 250 euros de revenu net par mois. Si on applique à cet éleveur une baisse de 4 centimes d’euro par litre dès le quatrième trimestre 2008, son revenu net mensuel tombe à 666 euros. Si nous effectuons le même calcul pour un couple qui produit 400 000 litres de lait par an, nous arrivons au même résultat : 1 332 euros net par mois pour deux personnes au travail.
À supposer que la demande des industriels d’une baisse minimale de 100 euros par 1 000 litres de lait soit appliquée dès le mois de janvier, le revenu moyen mensuel calculé à partir des chiffres fournis par l’étude du Centre d’économie rurale des Côtes-d’Armor devient négatif. Un éleveur qui produit 200 000 litres de lait par an perd 416 euros par mois. Un couple qui a un quota annuel de 400 000 litres de lait perd 832 euros par mois.
Les communistes proposent de longue date d’encadrer les marges abusives, de développer la notion de « prix minimum garanti » et de l’élargir à l’Europe, d’utiliser le principe du coefficient multiplicateur qui établit un lien vertueux entre le prix de vente à la production et le prix à la consommation, d’imaginer un partage équitable des marges permettant au producteur de vivre du fruit de son travail sans pénaliser le consommateur. Chaque fois, nos propositions sont caricaturées au nom de l’économie administrée ou de la soviétisation de l’économie !
Je constate aujourd’hui que la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles, la FNSEA, demande « la mise en œuvre d’un dispositif particulier d’encadrement des marges et/ou des coefficients multiplicateurs pour les produits alimentaires de base, qu’il s’agisse de produits agricoles bruts ou de première transformation ». M. Lemétayer serait-il devenu communiste ?
Sourires

Que nenni, monsieur le ministre ! Le bon sens et la pression des campagnes en feu le conduisent simplement à infléchir les règles intangibles du libéralisme.
La contractualisation permet de fixer des prix planchers dans le cadre actuel de la loi de modernisation de l’économie, mais cela ne suffira pas, monsieur le ministre. Il faut réviser cette loi en faveur des producteurs, assurer la pérennité des transformateurs et encadrer rigoureusement la grande distribution, qui assure plus de 75 % de la mise en marché.
Ne nous refaites pas le coup du coefficient multiplicateur pour les fruits et légumes voté au Sénat puis rendu inapplicable par de multiples mesures via les décrets et autres dispositions gouvernementales !
Ne laissez pas la grande distribution répercuter ailleurs ou autrement les pertes de marge qu’elle pourrait subir, comme elle l’a fait à chaque nouvelle loi économique.
Dans l’attente de légiférer efficacement, il est urgent de tenir une nouvelle table ronde pour le second semestre 2009, afin d’assurer la poursuite de l’activité de l’ensemble des exploitations laitières et des transformateurs.
À ce propos, la situation difficile d’Entremont Alliance dans l’Ouest laisse présager les pires scénarii si le Gouvernement n’agit pas en accordant prioritairement son aide aux producteurs dont le lait est payé en fonction des débouchés beurre-poudre, en mettant en place une caisse de péréquation nationale et un outil de gestion collective des volumes excédentaires.
Demain, dans l’Ouest, nous craignons de voir des producteurs abandonnés par leurs laiteries parce qu’ils sont trop petits ou trop éloignés.
Demain, nous craignons que les outils de transformation ne soient rachetés par la grande distribution, ce qui accentuerait encore la dépendance des producteurs, lesquels sont déjà bien affaiblis.
Monsieur le ministre, vous êtes confrontés à des responsabilités importantes pour l’agriculture et le commerce. Votre mission sera déterminante si nous voulons conserver une agriculture française et européenne face à la mondialisation des échanges et aux critères ultralibéraux qui la guide.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
M. Charles Revet applaudit.

Monsieur le ministre, comme beaucoup de mes collègues présents aujourd’hui, je vis au quotidien la crise du secteur laitier. Je vois la colère et les attentes des éleveurs.
Cependant, en dépit de la résonance locale de cette crise, il me semble qu’il nous faut aussi raisonner au niveau européen, car la crise est précisément européenne.
C’est d’ailleurs la mission que m’a confiée récemment la commission des affaires européennes du Sénat, et ce tour d’Europe me semble instructif pour comprendre nos similitudes et nos différences.
Dans les débats actuels et, surtout, à venir autour de la PAC, il faut s’inscrire dans une stratégie d’alliance et commencer par écouter les autres.
Votre nomination à ce poste, monsieur le ministre, est une preuve parfaite de ces ponts entre l’agriculture et les affaires européennes.
Le rapport d’information sort aujourd’hui et mes collègues comme vous-même, monsieur le ministre, pourrez en prendre connaissance si vous le souhaitez. Ce tour d’Europe que j’ai mené par internet me conduit à formuler quelques observations.
D’abord, tous les États acceptent les nouvelles règles du jeu du marché. Même si la révolution du secteur n’a qu’à peine dix ans, le régime de prix indicatifs est totalement oublié, enterré. Il n’y a plus que le marché et son produit, inconnu du consommateur, mais essentiel pour l’industriel, à savoir la poudre de lait, qui détermine aujourd’hui une sorte de prix directeur.
Tous les États sont également très attachés à la liberté contractuelle entre les producteurs et les acheteurs. D’ailleurs, dans plusieurs pays, les acheteurs sont des coopératives, codétenues par les éleveurs, ce qui facilite ces ponts. Le poids de l’industrie de transformation dans les achats de lait est une spécificité française.
Tous les États ont connu des variations de prix considérables. Je dis « variation » et non pas « baisse », car l’année 2007-2008 avait été marquée par une flambée des prix. La période 2008-2009 est frappée par une baisse aussi brutale.
Inutile de passer en revue les situations particulières des États, je retiendrai seulement le cas des nouveaux États membres dont la situation est très préoccupante. Ils ont moins profité de la hausse et ont plus souffert de la baisse que les autres États de l’Union européenne. Cela crée une sorte d’amertume sinon de rancœur dont il faut être conscient. Votre expérience européenne, monsieur le ministre, permet de bien mesurer ces écarts et cette sensibilité.
Quelles leçons pouvons-nous tirer pour la crise française ? Il y a deux problèmes à régler : les revenus des éleveurs et les variations de prix.
Je commencerai par évacuer une piste chère aux éleveurs français et pourtant bien mal engagée, je veux bien sûr parler des quotas laitiers.
La crise a-t-elle changé la position de nos partenaires sur ce sujet ? La réponse est clairement non. À aucun moment, les États n’ont changé d’avis, et ce pour deux raisons très simples.
D’abord, tous les analystes considèrent que la crise actuelle est liée à l’insuffisance de la demande et non à un excès de l’offre.
L’augmentation des quotas ne change rien. La preuve en est que beaucoup de pays n’ont pas atteint leurs quotas. Ils pouvaient produire plus et ils ne l’ont pas fait. En ce qui concerne la France, je me permets de vous rappeler qu’elle est en sous-réalisation pour cette année, de près de 1 milliard de litres de lait, preuve que la crise est liée à la demande et non à l’offre.
La production s’est adaptée, parfois avec lenteur ou avec retard, mais l’ajustement s’opère. On annonce déjà que la collecte de lait à l’automne sera l’une des plus faibles des dix dernières années.
Ensuite, plusieurs pays ont intérêt à l’augmentation des quotas, soit tout simplement pour valoriser leur potentiel qui semble entravé par ce qu’ils considèrent comme un carcan réglementaire, soit pour éviter une baisse brutale des prix avant l’abandon des quotas, considéré comme acquis.
Sur ce sujet, nous avions un allié de poids : l’Allemagne, pays que vous connaissez bien, monsieur le ministre. Mais il faut se rendre à l’évidence, c’était plutôt un allié de circonstance, que j’analyse dans mon rapport. L’Allemagne accepte la fin des quotas. L’abandon des quotas a été décidé en 2005 et programmé en 2008. D’ailleurs, il n’est pas dans l’habitude allemande de remettre en cause les décisions collectives du Conseil européen. La France me paraît plutôt isolée sur ce point. Même notre plus grand allié sur la PAC, l’Irlande, ne nous suit pas au sujet des quotas.
Dans la stratégie d’alliances que j’appelle de mes vœux, il nous faut choisir d’autres combats.
Face à la volatilité des prix, je crois notamment à la nécessité de maintenir une politique publique assise sur des instruments de régulation.
Certes, quelques pays éprouvent des réticences, mais l’instabilité a été excessive et il me semble qu’il est possible de dégager une majorité sur ce concept de régulation à condition que l’on veuille bien lui apporter quelques ajustements.
À Bruxelles, l’intervention est toujours actionnée à contrecœur, car elle évoque encore les « montagnes de beurre » dont on nous renvoie sans cesse l’image. Cette situation est révolue. Le concept doit donc être renouvelé. L’intervention doit être moins conçue comme un moyen de réduire des excédents que comme un moyen de lisser les évolutions de prix.
Les variations sont considérables. Le stockage régulateur est un moyen simple, facile à mettre en œuvre et à gérer, qui correspond parfaitement à cette situation – je profite de l’occasion pour le souligner, car il a souvent été caricaturé.
Le bilan de santé de la PAC n’a pas supprimé, tant s’en faut, les outils de régulation, que ce soient l’intervention ou même les restitutions. Aujourd’hui, celles-ci ne sont plus « OMC-compatibles », on le sait. Cependant, si l’intervention n’a pas eu la pertinence et la signature politique espérées, c’est, à mon avis, tout simplement parce qu’elle reste sous-dimensionnée.
Les droits à paiement unique, les DPU, pourraient aussi être modifiés. Ils sont indispensables pour assurer des revenus aux éleveurs en temps de crise, ne serait-ce que pour respecter les objectifs du traité de Rome ; le restent-ils lorsque les prix flambent ? Il faudra, sur ce point, mener une réflexion : peut-être pourrait-on imaginer des DPU modulables, variables en fonction des crises, notamment des crises laitières ?
Je crois enfin que la politique agricole commune doit être mieux évaluée. Toutes les politiques européennes sont évaluées, toutes sauf une : la PAC. L’élevage, en particulier, ne peut être évalué selon les seuls critères de prix et de coût. D’autres critères doivent être pris en compte, par exemple celui de la biodiversité.
Les politiques publiques peuvent concerner tous les États membres, mais cela ne doit pas nous exonérer d’une réflexion sur notre propre organisation.
La contractualisation est une piste certes semée d’embûches et de pièges – je les évoque dans mon rapport –, mais sans doute utile et nécessaire, voire, peut-être faut-il aujourd’hui y insister, incontournable, à condition qu’elle soit pertinemment encadrée.
Les éleveurs ont besoin de visibilité. Cette visibilité était, au moins en partie, assurée par les quotas, qui, bien que décidés par la puissance publique, étaient vécus comme une manière de contrat moral. Leur fin étant annoncée, il faut trouver d’autres formes de régulation et passer de cette sorte de contrat moral public à des contrats privés professionnels et régionaux, des contrats qui, éventuellement, associeraient la distribution au cœur de la bataille des prix, qu’elle le veuille ou non. J’apporte quelques précisions utiles pour éviter d’être trop manichéen, en faisant la distinction, par exemple, entre lait et produits laitiers. Aujourd’hui, trop de non-dits subsistent, qui laissent une détestable impression. Quelques correctifs à la loi LME, la loi de modernisation de l’économie, pourraient s’avérer utiles.
J’évoque aussi quelques pistes nationales. Ainsi, quels sont les moyens, acceptables sur le plan communautaire, dont dispose le ministère pour accompagner la restructuration des élevages, pour développer des formules de commercialisation nouvelles, pour favoriser le concept de proximité ? Cela est appliqué avec succès ici ou là dans quelques régions françaises.
En conclusion, je crois pouvoir affirmer que, si la crise est générale, les réactions sont diverses. Pour beaucoup de pays, la crise est un mauvais moment, en attendant le rebond, une forme de passage qui permet de faire émerger les plus compétitifs. Dans d’autres pays, la colère est vive. Mais un point fait l’unité : la profession ne peut vivre dans un chaos permanent. Les éleveurs ont besoin de visibilité et d’être remis en confiance.
Chacun doit jouer son rôle, en France et en Europe, et le Gouvernement doit assurer le sien. Nous avons confiance en vous, monsieur le ministre, et nous attendons des résultats.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Tout d’abord, monsieur le ministre, vous me permettrez de vous souhaiter la bienvenue dans notre assemblée. Vous êtes précédé de la flatteuse réputation d’être une personne rompue aux questions européennes : cela vous sera certainement utile dans vos nouvelles fonctions.

Je souhaite évoquer la dramatique crise laitière qui affecte notre pays.

Les campagnes sont en ébullition, et la colère est très grande. Notre rôle de parlementaires est de traduire cette colère ; car la situation est inacceptable, scandaleuse, par bien des points amorale, et suicidaire.
Près de 100 000 exploitations agricoles sont aujourd’hui touchées, ainsi que plusieurs centaines de milliers d’emplois, directs ou indirects.
Cela est totalement inacceptable et scandaleux : les producteurs ne peuvent pas être en permanence la variable d’ajustement !
C’est amoral : comment peut-on accepter que, au même moment où les agriculteurs, les producteurs de lait, n’arrivent pas à vivre de leur travail, 80 % des quatre cents plus grosses fortunes françaises se trouvent dans la grande distribution ? Ces fortunes ont été réalisées non pas sur plusieurs générations, comme ce fut le cas des grandes industries au XIXe siècle et au début du XXe siècle, mais simplement en quelques années !
Il est scandaleux et amoral que les producteurs et les industriels soient contraints de fournir des marchandises qu’on ne leur paie pas : on achète, par exemple, 500 000 pots de yaourt, mais on demande d’en livrer 550 000. Un grand hebdomadaire parlait de « racket » ; pour ma part, je considère que c’est du « gangstérisme légal », il ne faut pas avoir peur des mots.
Il faut créer dans notre pays une véritable solidarité de la filière. Celle-ci est constituée des producteurs, des transformateurs et de la distribution. « Le soleil brille pour tout le monde », rappelle le vieil adage. Alors, que chacun puisse vivre décemment de son travail ! Nous attendons, monsieur le ministre, que vous agissiez dans ce domaine. Sinon, on en arrivera à une situation suicidaire.
L’élevage laitier a des contraintes importantes – mes collègues les ont exposées –, en particulier la traite deux fois par jour. Un élevage laitier demande au moins dix ou douze ans avant d’être constitué valablement. Les investissements sont très lourds. Il faut être conscient que, lorsque ces éleveurs laitiers auront abandonné, on ne reviendra pas en arrière : ils ne reprendront pas cette activité. Il est donc de notre responsabilité, de la vôtre aussi, monsieur le ministre, de faire savoir que, si nous ne prenons pas des mesures extrêmement draconiennes, une pénurie de lait pourra s’installer en quatre ou cinq ans.

M. François Fortassin. C’est vrai, le problème est européen. Mais il est aussi français ! La loi LME est totalement bafouée.
M. Jean Bizet opine.

Il faut la faire respecter, il faut créer les conditions d’une véritable solidarité de l’ensemble des acteurs de la production. Aujourd’hui, les producteurs ont le sentiment d’être abandonnés en rase campagne, tandis que pour les autres partenaires de la filière, c’est le sauve-qui-peut, chacun rejetant la faute sur l’autre, ou sur l’Europe. Une telle attitude est inacceptable. Nous attendons, monsieur le ministre, que la politique reprenne ses droits d’une façon forte.
J’approuve la déclaration de M. le Président de la République, que nous avons attentivement écouté lundi : « L’économie doit être au service de l’homme et non le contraire. » La crise laitière nous fournit la possibilité de mettre en pratique cette déclaration forte. Quelles que soient nos sensibilités, nous ne pouvons que la partager.
Monsieur le ministre, je n’évoquerai pas l’action que vous pourrez mener sur le plan européen, ni les causes des fluctuations du prix du lait, qui, très élevé en 2007-2008, s’est effondré en 2009 – mes collègues les ont déjà évoquées. Mais je vous demande, monsieur le ministre, de tout faire pour créer les conditions de cette solidarité, et d’imposer le double étiquetage, qui ne doit d’ailleurs pas porter seulement sur les produits laitiers : vous êtes ministre de l’alimentation ! Cet élément me paraît être d’une importance capitale. On peut exiger la transparence et, sur ce point, demander l’aide des consommateurs, de façon que certaines pratiques qui ne devraient pas avoir cours cessent le plus rapidement possible.
Applaudissements sur les travées du RDSE et de l ’ UMP, ainsi que sur les travées du groupe socialiste. – M. Gérard Le Cam applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs semaines désormais, l’économie agricole, à travers la production laitière, fait débat dans notre pays. La situation des producteurs nous interpelle par les conséquences, qui se dessinent de plus en plus nettement, de l’effondrement du prix du lait qui leur est payé. Le constat des causes peut être dressé aisément et souffre d’ailleurs assez peu de controverses.
À quoi tiennent ces causes ? à quelles orientations stratégiques ? à quelles décisions politiques ? Elles tiennent à la volonté clairement affichée, et mise en application, de considérer cette activité économique comme identique aux autres, c’est-à-dire de la soumettre aux règles et à la loi sans limite du marché libéral…
C’est faire abstraction d’une réalité : la production laitière, par nature, est liée à des cycles de production longs, comme les investissements qu’elle nécessite. Elle ne peut donc s’adapter instantanément à une conjoncture économique variable ou volatile, et ce d’autant moins qu’elle ne maîtrise que partiellement ses coûts de production. Que ce soient le coût des mises aux normes ou le prix des matières premières ou de l’énergie, nombre de charges ne sont pas compressibles.
La production laitière est par ailleurs un facteur déterminant de la vie économique et de l’activité de bien des régions. Elle constitue par là un élément déterminant de l’aménagement des territoires, raison supplémentaire pour qu’elle soit organisée et régulée.
Or, les décisions arrêtées depuis plusieurs années en Europe, au terme de négociations entre les gouvernements, vont dans un sens absolument opposé : réduction des outils de régulation, abandon programmé des quotas laitiers montrent bien quelles orientations ont été choisies… À cet égard, se référer au marché mondial pour la détermination des prix, alors que celui-ci ne concerne que 5 % de la production globale des produits laitiers, est une aberration. C’est pourtant aujourd’hui la référence prise en compte, celle qui permet de tirer les prix vers le bas.
Peut-on dès lors attendre du marché qu’il se corrige de lui-même, par sa propre vertu ? On peut légitimement en douter. Sans la volonté du politique de remettre l’action publique au cœur du débat, des orientations et des décisions nécessaires, il est peu probable qu’une solution durable puisse émerger.
La situation actuelle exige donc le retour d’un projet, d’une vision européenne de l’agriculture, de l’implication forte de la France dans la recherche de solutions collectives.
Comme cela a été rappelé à propos d’une autre crise, l’Europe doit retrouver sa fonction protectrice. C’est là le premier objectif. Il faut donner à l’échelle de l’Europe un coup d’arrêt aux orientations appliquées par la Commission et Mme Fischer Boel.
Le démantèlement des quotas laitiers, qui ont depuis de nombreuses années démontré leur utilité et leur justification, doit être stoppé. Il faut même leur rendre toute leur portée à court terme en tant qu’instrument indispensable de la maîtrise de la production, et à moyen terme en tant que condition de la survie financière d’une majorité de producteurs.
Nous le savons bien, la chute des prix n’est pas proportionnelle à l’ampleur de la surproduction, elle est même disproportionnée par rapport à celle-ci dès lors que l’équilibre de la production et du marché est rompu. L’Europe doit donc s’engager dans une gestion des volumes, il est urgent de les réduire et de les compenser dans un contexte de surproduction.
Quant à la France, en ayant adopté la loi LME, elle ajoute à cette situation déjà difficile une incroyable asymétrie dans le rapport entre la production et la distribution, au détriment de la première, bien entendu, ce qui est même dénoncé, parfois, par des parlementaires de la majorité.
Enfin, au plus près de nous, les producteurs sont d’ores et déjà dans une situation préoccupante. Les études produites en Bretagne par les centres d’économie rurale montrent que l’équilibre de gestion moyen des exploitations se situe aux alentours d’un prix de 305 euros pour 1000 litres de lait payés aux agriculteurs. Or, aujourd’hui nous en sommes loin, très loin même dans certaines laiteries.
Interrogez à ce sujet les producteurs livrant à l’entreprise Entremont Alliance, citée par notre collègue Gérard Le Cam tout à l’heure, quatrième entreprise française du secteur avec 2, 3 milliards de litres collectés et qui compte 6000 livreurs en Bretagne.
Avec un prix payé actuellement de 205 euros pour 1000 litres, leur situation est intenable. À ce compte, la crise va éliminer d’abord les plus fragiles, c’est-à-dire bien souvent les investisseurs récents, autrement dit les plus jeunes. Lorsqu’on sait qu’aujourd’hui près de la moitié des 4 300 producteurs des Côtes-d’Armor, troisième département pour la production laitière, ont plus de cinquante ans, on mesure mieux de quelle hypothèque on gage l’avenir.
Il est donc urgent qu’après avoir tergiversé le Gouvernement se saisisse enfin de la situation. Il est à craindre sinon qu’à très court terme nombre de producteurs ne soient acculés à la cessation d’activité dans les pires conditions et, par conséquence, que l’économie agricole dans toutes ses composantes ne soit touchée. Il est vital d’intervenir dès maintenant comme il l’est aussi de réfléchir à l’avenir de la filière dans sa globalité.
Sur toutes ces questions, la parole et les actes du Gouvernement sont attendus dans l’urgence, monsieur le ministre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Gérard Le Cam applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la crise qui secoue depuis plusieurs semaines nos campagnes est profonde. Elle vient légitimement se manifester jusqu’au cœur de nos villes. Elle résulte essentiellement de la conjonction de deux phénomènes.
Le premier est l’augmentation des quotas laitiers, qui préfigure leur disparition programmée par la Commission européenne. Cette dérégulation de la production laitière résulte essentiellement d’une approche néolibérale des marchés agricoles chère à Mme Fischer Boel.
Chacun sait pourtant que les marchés agricoles sont particulièrement volatils, en raison d’une inélasticité de la demande par rapport au prix : les augmentations de production, dès qu’elles excèdent la demande, font mécaniquement plonger les prix, à moins de disposer de moyens adaptés de transformation et de stockage... qui ont un coût et par conséquent aussi des limites ! Telle est la raison qui avait conduit à instaurer les quotas laitiers en 1983.
La Commission joue avec le feu en ouvrant la voie, pour des raisons idéologiques, à la suppression de ces quotas et en tablant sur la demande mondiale pour absorber les excédents de lait en poudre et de beurre.
C’est un pari aussi hasardeux que détestable sur le fond. Hasardeux, parce que la demande mondiale n’est pas un débouché stable : après l’embellie de 2007, qui a fait illusion, le marché s’est effondré en 2008, mettant en difficulté les transformateurs d’excédents laitiers. Détestable, parce que contraire au principe essentiel de souveraineté alimentaire déjà évoqué dans notre débat sur l’OMC : quand les pays industrialisés, dont l’Europe, cesseront-ils de déverser leurs excédents agricoles sur les pays en développement, avec pour conséquence le blocage structurel, dramatique, du développement de leurs agricultures vivrières ?
Le second phénomène est le problème de la représentation du monde agricole au sein des instances interprofessionnelles, caractérisée par ce qu’il faut appeler « le monopole du syndicat majoritaire », alors qu’il ne fédère que la moitié des producteurs laitiers. Les compromis qu’il négocie avec les firmes agroalimentaires du secteur laitier en termes de répercussion de la crise du marché mondial sur les prix versés aux producteurs ne sont pas supportables pour la grande majorité des petits et moyens producteurs, qui sont aujourd’hui littéralement asphyxiés. Implicitement, ces compromis font le jeu des grands groupes privés ou coopératifs que nous connaissons tous, qui transfèrent la crise engendrée par la gestion des 90 000 tonnes de lait en poudre et des 120 000 tonnes de beurre sur le monde agricole, et qui traduisent sur le terrain les velléités inavouables de la Commission européenne : engager une nouvelle étape dans la restructuration du secteur laitier, en quelque sorte « refaire du Mansholt » et liquider les petites et moyennes exploitations laitières jugées « improductives ».
Vous l’aurez compris, cette crise pose fondamentalement la question du modèle agricole laitier européen. Quel type d’exploitation laitière veut-on promouvoir ? Des « usines à lait » avec des vaches à potentiel maximisé, gavées d’ensilage de maïs et de tourteau de soja importé, produisant de manière intensive pour le stockage et l’exportation ? Ou bien des exploitations agricoles avec des vaches plus rustiques, par conséquent moins « traitées », permettant de valoriser les herbages, produisant pour un marché intérieur et valorisant dès que possible leurs produits sur des circuits courts ?
Une nouvelle fois, nous mesurons combien les dimensions économique, sociale et environnementale, loin de s’opposer se conjuguent. Encore convient-il de rompre avec les fantasmes néolibéraux selon lesquels il faut réintroduire à tout prix du marché dans l’agriculture et continuer d’affaiblir les outils de régulation...
C’est pourquoi les Verts demandent le rétablissement des quotas laitiers : malgré leurs inconvénients – le principe des quantums nous semblait plus intéressant –, les quotas avaient permis de gérer dans la durée l’évolution du secteur laitier, de prévenir les crises de surproduction.
Ma collègue et amie Bernadette Bourzai, sénatrice de la Corrèze, se joint à moi pour mettre également en exergue une autre dimension des quotas : les quotas régionaux apparaissent comme le seul moyen de répartir harmonieusement la production laitière sur le territoire et d’éviter que les régions de plaine et surtout portuaires à bas coûts de production ne viennent concurrencer abusivement les régions de montagne ou dites défavorisées, dont la seule ressource agricole est l’herbe. Cette herbe doit être valorisée par nos élevages, y compris laitiers : c’est un enjeu environnemental qui, à l’heure du Grenelle de l’environnement, n’aura échappé à personne. Mais c’est également un enjeu sociétal en termes d’aménagement du territoire : nous devons tout faire pour éviter le déménagement programmé de la production laitière, engagé par l’augmentation et la suppression des quotas laitiers !
Monsieur le ministre, chers collègues, je vous invite à considérer cette crise laitière comme une opportunité de remettre à plat la politique agricole, d’en stopper les dérives néolibérales et de promouvoir un modèle agricole européen en phase avec les attentes de nos concitoyens, qui se sont récemment exprimés clairement dans ce sens : un modèle plus respectueux de l’environnement et pourvoyeur d’emplois car moins intensif, moins dépendant d’importations et plus territorialisé, un modèle implicitement plus solidaire des pays du Sud car tourné vers une demande intérieure de produits de qualité.
Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste. – M. Gérard Le Cam applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez à un non-spécialiste d’intervenir dans ce débat.
Aujourd’hui, la crise de la production laitière n’occupe plus l’espace médiatique avec la même intensité que ces dernières semaines, mais cela risque de revenir. Cependant, les problèmes soulevés par les producteurs, les difficultés économiques qu’ils rencontrent, l’état catastrophique de leurs bilans financiers, notamment chez les jeunes agriculteurs, perdurent.
Monsieur le ministre, les quelques mesures annoncées par votre prédécesseur n’ont pas réglé le problème ; au mieux, elles n’ont fait que gagner quelques mois. D’ailleurs, 1 500 producteurs réunis le 23 juin à Saint-Hilaire-du-Harcouët, dans le département de la Manche, ont voté en faveur d’une grève européenne du lait, qui consiste, comme vous le savez, à jeter ou à donner le lait trait pour faire pression sur l’industrie laitière et les instances politiques afin que les prix remontent. C’est une action de désespoir aux conséquences très graves.
Je suis élu de ce département, la Manche, comme mon collègue Jean Bizet dont je suis loin de partager la compétence… en matière laitière, bien évidemment ; pour le reste, nous pourrons en discuter.
Sourires.
Nouveaux sourires.

La Manche est le deuxième département producteur en volume et le premier en nombre de producteurs. Lors d’une table ronde organisée à la préfecture de région à Caen, le 11 juin dernier, j’ai pu constater que les situations variaient d’un département à l’autre, selon que la production de lait est l’activité principale – ce qui est souvent le cas chez nous –, voire exclusive du producteur ou une production complémentaire. Mais ce qui est certain, c’est qu’il est impossible de vivre avec les prix pratiqués depuis le début de l’année, pour une production moyenne d’environ 300 000 litres, si j’ai bien compris.
Les producteurs de mon département l’ont dit clairement : l’accord signé portant à 280 euros les 1 000 litres de lait est tout à fait insuffisant, notamment pour les jeunes producteurs. En effet, il ne leur permet pas de couvrir le coût des investissements nécessaires, notamment en matière d’environnement et de normes réglementaires, et il les contraint toujours à produire à perte.
De même, si dans ma région, les représentants des grandes et moyennes surfaces présents à la table ronde se sont engagés à ne pas renégocier à la baisse les prix d’achat des produits laitiers de grande consommation jusqu’au 31 décembre 2009, cet engagement doit faire l’objet d’une validation au niveau national, et il est, reconnaissez-le, très largement insuffisant.
Quant aux autres mesures suggérées notamment du côté des banques – le report d’un an des annuités d’investissement, en particulier pour la mise aux normes – et du côté de l’État – les reports ou dégrèvements de charges sociales –, ce ne sont que des mesures palliatives, qui ne pourront régler le fond du problème.
Le problème vient bien d’abord de la déréglementation au niveau européen. J’ai bien entendu les propos et l’analyse de mon collègue Jean Bizet tout à l’heure concernant l’augmentation des quotas et leur suppression en 2015. Je pense néanmoins que cela a contribué à déstabiliser la rémunération de la production. Et si en France la situation est aussi grave, monsieur le ministre, c’est parce que s’ajoute à cette déréglementation au niveau européen la fameuse loi LME, la loi de modernisation de l’économie. La négociation libre et non encadrée, qui devait soi-disant permettre au marché de s’autoréguler et devait être favorable aux consommateurs, s’avère être une erreur fatale tant pour les producteurs que pour les consommateurs – qui n’ont pas perçu de baisse des prix. Au passage, personne ne peut croire que la mise en place d’un observatoire des prix et des marges suffira à remédier à cette situation.
À qui cela profite-t-il ? En posant la question, j’y réponds, comme notre collègue François Fortassin l’a fait tout à l’heure, avec la verve que chacun lui connaît. Une plus grande transparence est nécessaire pour évaluer les marges des différents acteurs de la chaîne, surtout quand on sait que le prix du lait payé par le consommateur a augmenté de 17 % entre l’été 2007 et l’été 2008 et n’a baissé que de 2 % depuis l’été 2008 !
Aujourd’hui, les producteurs attendent donc des actes forts. Ils sont dans une situation sociale intenable. Ce qui est en jeu, c’est leur avenir, l’avenir de leur famille, l’avenir de leur exploitation.
Monsieur le ministre, nous attendons des propositions susceptibles d’apporter une réponse à la détresse des producteurs et de remettre de l’ordre dans la filière, notamment en révisant la loi LME dont nous avions à l’époque longuement expliqué les dérives qu’elle risquait de produire. La politique européenne ne peut pas rester figée en la matière. Les producteurs doivent pouvoir compter sur un prix de vente de leur production garanti, la juste rémunération de leur travail ainsi que sur des volumes régulés par une plus grande maîtrise de la production.
Monsieur le ministre, c’est un message que je tenais à vous transmettre en tant que membre de la commission des affaires sociales car j’ai bien compris lors de la réunion qui a eu lieu à Caen, au mois de juin, que les producteurs étaient dans une très grande détresse ; après les avoir entendus, j’estimais tout à fait normal de vous interroger à cet égard.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, comment ne pas saisir l’occasion de ce débat pour rappeler d’abord que, dans un département comme le mien, la Haute-Loire, la production laitière occupe une place prépondérante dans l’économie agricole : 2 400 producteurs, soit à peu près les deux tiers des exploitations.
Comment ne pas relever ensuite qu’après les manifestations, l’accord du 4 juin a été accueilli avec une certaine résignation et le sentiment aigu que le problème de fond demeure.
À cet égard, je prendrai un exemple concret, je vous demande d’ailleurs, mes chers collègues, d’excuser le caractère factuel de mon propos.
Le 23 juin dernier, a été organisée une réunion de l’interprofession régionale Auvergne-Limousin au cours de laquelle sont apparues de vives tensions entre producteurs et transformateurs. Ceux-ci ne sont parvenus à aucun accord, la discussion reste donc ouverte. Ce cas précis illustre bien le fait que le malaise persiste.
Monsieur le ministre, je tiens à rendre hommage à votre prédécesseur, Michel Barnier, qui a su, dans l’urgence, mettre autour de la table les trois partenaires de la filière laitière et proposer quelques mesures de nature à alléger les charges de certains producteurs et à pallier quelques difficultés.
Toutefois, si je me réfère à la situation de mon département, je crains que les exploitations laitières susceptibles d’être touchées par la crise ne soient les plus performantes
M. le président de la commission des affaires économiques opine

Comme je l’ai lu dans le bulletin des commissions, M. Luc Chatel, alors secrétaire d’État chargé de l’industrie et de la consommation, avait rappelé devant votre commission, monsieur le président Emorine, que l’ancien système de régulation du prix du lait fondé sur une recommandation du CNIEL n’était pas suffisant, ne respectait pas les règles de la concurrence, et n’était pas, au demeurant, efficace. Il avait évoqué les mesures prises, à savoir la création d’une brigade de contrôle et le lancement d’une grande enquête sur les prix des produits laitiers pour accélérer les travaux de l’Observatoire des prix et des marges. J’avoue moi aussi mon scepticisme face à ces mesures, mais attendons de voir leurs effets. Toujours est-il qu’une plus grande clarté est nécessaire dans ce secteur, notamment pour ce qui concerne la répartition de la valeur ajoutée.
Dans son intervention intéressante, M. Luc Chatel avait indiqué avec beaucoup de fermeté que la répartition de cette valeur ajoutée était déséquilibrée. Monsieur le ministre, ce constat nous invite à l’action. Qui ne voit ce déséquilibre ? Et qui ne voit également le déséquilibre des forces en présence entre les cinq grandes centrales et les centaines de transformateurs. La situation est donc structurellement déséquilibrée.
À cet égard, je souhaiterais évoquer l’importance, dans la plupart des cas, des marges arrière, en citant un exemple qui est, je vous l’assure, avéré.
Je veux parler d’une coopérative qui n’est certes pas située dans mon département, mais les chiffres que je vais vous communiquer émanent d’un membre du conseil d’administration. Celle-ci réalise un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros. Or ses marges arrière s’élèvent à 2 millions d’euros, soit 10 % de son chiffre d’affaires ! Ce n’est pas normal, ni supportable !

Monsieur le ministre, j’imagine que toutes les situations ne sont pas identiques, …

… mais il n’en demeure pas moins qu’il y a là un réel problème ! Il est évident que les conséquences sont extrêmement fâcheuses pour la lisibilité du processus économique. Or, vous le savez bien, monsieur le ministre, on en a bien besoin !
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour vous parler de la situation de l’entreprise Via Lacta, implantée à Saint-Germain-Laprade, près du Puy-en-Velay, dans mon département. Certes, il s’agit d’une petite entreprise, mais, avec 180 salariés et environ 150 producteurs, son poids économique est important pour le bassin du Puy-en-Velay.
Cette entreprise est actuellement en grande difficulté. D’après les informations dont je dispose, le projet de reprise en cours n’a pas abouti, de nombreuses conditions restant encore en suspens. Monsieur le ministre, je sais bien que vous avez à traiter de nombreux dossiers, mais je vous saurai gré de bien vouloir examiner celui-ci. Si le projet de reprise n’aboutissait pas, ce serait – je pèse mes mots ! – tout à fait catastrophique pour le bassin économique du Puy-en-Velay.
Enfin, je dirai quelques mots en ce qui concerne la surproduction dont on a l’habitude de parler.
Comme mon collègue Jean Bizet me le disait tout à l'heure en aparté en me fournissant des éléments qu’il développe dans son rapport, la France n’est pas en surproduction.

M. Adrien Gouteyron. Elle n’a pas réalisé la totalité de son quota, avec moins 5 %. Le problème réside non pas dans la surproduction, mais essentiellement dans la demande
M. Joël Bourdin opine

En conclusion, monsieur le ministre, nous attendons beaucoup de vous. Au niveau européen, vous avez pris toute votre place et vous avez la capacité d’agir : il faut que l’Europe joue pleinement son rôle de régulation. Ce sera l’une de vos tâches, et je suis persuadé que vous aurez à cœur de la mener à bien. Nous comptons sur vous et avons confiance en vous.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Hervé Maurey applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je commencerai mon intervention en formulant trois remarques qui iront du général au particulier.
Je veux tout d’abord préciser à M. Muller la vision de long terme que je me fais de la filière laitière et de la production laitière dans notre pays.
Pour être clair, je ne souhaite pas encourager une production laitière intensive dans des fermes où seraient entassées des milliers de bêtes produisant un lait qui ne correspondrait pas à nos exigences en matière de sécurité sanitaire.
Je veux bien plus promouvoir des produits de qualité, soucieux de la sécurité sanitaire et respectueux de l’identité de nos territoires. Nous n’allons pas laisser disparaître les exploitations laitières de nos territoires au motif qu’elles seraient trop petites ou, paradoxalement, de trop grande qualité, car c’est bien de cela qu’il s’agit.
Ma deuxième remarque portera sur les moyens permettant de sortir de cette crise.
À mon sens, nous devons travailler sur deux questions très différentes, mais complémentaires.
Ainsi, dans le prolongement des mesures qui ont déjà été annoncées par Michel Barnier, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement, et de l’accord interprofessionnel qui a été signé, nous devons réussir dans l’immédiat à résoudre la crise à l’échelle nationale. Je rencontrerai demain des producteurs laitiers dans ma région et nous examinerons les mesures susceptibles d’améliorer la situation actuelle.
Parallèlement, nous devons offrir aux producteurs laitiers une perspective et une prévisibilité sur le long terme. Aucun responsable d’une activité commerciale ne pourrait survivre avec des prix variant de 30 % à chaque saison ! Il est impossible de n’avoir, à long terme, aucune prévisibilité sur le prix de sa production !
Nous devons apporter prévisibilité et stabilité, ce qui passe à la fois par des décisions nationales, comme la contractualisation, point sur lequel je reviendrai, et par des décisions bien évidemment communautaires.
Enfin, ma troisième remarque vise à répondre à Adrien Gouteyron.
Monsieur le sénateur, même si de nombreux dossiers s’accumulent, il est vrai, sur mon bureau – mais vous connaissez mon goût pour le travail ! –, j’examinerai le cas de l’entreprise Via Lacta, et ce pour trois raisons : cette entreprise concerne le secteur laitier, vous me l’avez demandé et, enfin, elle se situe près de la ville de mon ami Laurent Wauquiez.
M. Yannick Botrel s’exclame.
J’en viens à la situation laitière dans son ensemble, dont vous avez tous dressé un tableau très clair. Jacqueline Gourault a évoqué sa participation à un comice agricole dans son département. Moi-même, samedi dernier après-midi, lors d’un comice agricole dans la commune des Andelys, j’ai eu l’occasion de discuter de ce sujet. Je reprendrai un terme que j’ai employé tout à l'heure au cours du débat précédent, la détresse des producteurs laitiers est perceptible en France, comme dans les autres pays européens. Il nous faut donc y répondre.
Cela ne vous étonnera pas, mesdames, messieurs les sénateurs, la réponse doit d’abord venir de l’Union européenne. À cet égard, je voudrais revenir très précisément sur quelques points qui ont été soulevés à juste titre par l’ensemble de ceux qui se sont exprimés.
Le bilan de santé de la PAC, la politique agricole commune, a permis de réintroduire un vrai pilotage économique et politique de la production et des marchés laitiers. Nous avons deux rendez-vous politiques en 2010 et en 2012 pour décider des options à retenir, notamment sur l’avenir des quotas laitiers, ainsi que je l’ai déjà dit tout à l'heure.
Je partage totalement – et je l’assume pleinement – l’analyse de Jean Bizet. Après avoir examiné attentivement le dossier depuis mon entrée en fonctions, je constate que la question est non pas celle de l’offre, mais celle de la demande. Il ne s’agit pas de savoir s’il faut maintenir les quotas laitiers, il faut déjà savoir si nous les remplissons ! Or tel n’est pas le cas !
Je veux bien plaider matin, midi et soir auprès de la Commission européenne et du Conseil européen pour le rétablissement de quotas laitiers, mais je n’aime pas livrer des batailles inutiles ou perdues d’avance. Je préfère me battre pour essayer d’améliorer la situation concrète de nos concitoyens.
Tout d’abord, je ne suis pas sûr d’obtenir la majorité nécessaire au Conseil européen pour obtenir le rétablissement de quotas laitiers. Ensuite, à supposer que j’obtienne ces quotas, j’ai bien peur de rétablir une ligne Maginot qui ne permettra pas de répondre aux interrogations des producteurs laitiers en France.
Cela signifie-t-il qu’il ne faut prévoir aucune régulation et qu’il faut laisser la libre concurrence gérer ce secteur ? Comme je l’ai dit précédemment, la réponse est clairement non. Nous avons besoin d’une régulation, parce que la production laitière n’est pas une production comme les autres : le marché n’y est pas systématiquement stable, le climat serein, la production et la demande ne sont pas systématiquement garanties.
Face à l’instabilité caractéristique de ce marché, il faut donc mettre en place une régulation de la production ; nous devons nous battre sur ce point.
La vraie question est de définir le type de régulation qui sera efficace pour garantir, à long terme, une stabilité des cours du lait en France et en Europe, et donc la soutenabilité de l’activité économique de la production laitière en Europe ? Ne nous focalisons pas sur le débat des quotas, qui risque d’être, à mon sens, un débat plus théologique que pratique.
Pour instaurer cette régulation de la production dans les meilleures conditions possible et essayer d’offrir un avenir cohérent à la production laitière, il est indispensable de savoir sur quels partenaires européens nous pourrons nous appuyer. C’est pourquoi je me rendrai très rapidement en Allemagne, comme je l’ai indiqué tout à l'heure, pour mener une stratégie d’alliance très utile et tout à fait nécessaire.
L’accord que nous avons conclu à l’échelle européenne a permis de limiter les effets de la crise, même si ce fut insuffisant.
Les aides au stockage privé de beurre ont été mises en place dès le 1er janvier 2009 ; les restitutions à l’exportation ont été réintroduites à la fin du mois de janvier dernier pour une large gamme de produits laitiers ; et, à partir du 1er mars dernier, les achats à l’intervention publique sont d’abord intervenus à prix fixe, puis par adjudication à des prix très proches des prix d’intervention. Ces mesures ont permis de stabiliser la situation, les cours du beurre et de la poudre de lait se situant quasiment aujourd'hui au prix d’intervention. Certes, ce n’est pas parfait, mais, je le dis simplement, ces décisions ont permis d’améliorer la situation.
Néanmoins, pour reprendre ce que j’ai dit lors du précédent débat, des incertitudes persistent et l’insatisfaction subsiste. Lors du dernier Conseil européen, la France a donc demandé, conjointement avec l’Allemagne, une plus forte mobilisation des outils de régulation des marchés. La Commission l’a fait, notamment concernant les restitutions à l’exportation et les mesures de stockage, qui sont efficaces et cohérentes, et qui pourraient être, selon moi, utilisées davantage sur le long terme. Elles devraient être prolongées au-delà des dates actuellement prévues par la réglementation.
Ces questions feront également l’objet de mon entretien avec Mme Fischer Boel tout à l’heure. J’essaierai de la convaincre d’aller plus loin dans ces mesures, de façon à répondre aux interrogations des producteurs laitiers.
Enfin, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, l’accord sur le bilan de santé de la politique agricole commune permet également à chaque État membre d’orienter une partie des aides directes en fonction de choix nationaux. C’est une nouveauté dont nous avons su tirer profit.
Les mesures qui ont été décidées le 23 février dernier conduiront ainsi à réorienter en 2010 près de 1, 4 milliard d’euros, soit 18 % des aides directes reçues par les agriculteurs, en faveur de l’élevage à l’herbe.
Une enveloppe de 45 millions d’euros sera également consacrée à la production laitière en montagne, par le biais d’une aide couplée au litre de lait, de l’ordre de 20 euros les 1 000 litres.
Je le répète, la direction que j’entends donner à ces négociations communautaires est simple : il s’agit de la mise en place d’une régulation efficace de la production dans le secteur laitier, fondée sur des alliances solides avec nos partenaires européens.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez eu la gentillesse de me reconnaître une expérience européenne. Elle me permet d’affirmer que rien n’est pire, au niveau communautaire, qu’il s’agisse du Conseil européen ou de la Commission, que de s’arc-bouter sur une position sans disposer des alliances nécessaires pour la soutenir. En effet, vous risquez, à un moment ou un autre de la négociation, d’être contourné. À force d’avoir tenu une position trop rigide et peu raisonnable qui ne soit pas tournée vers l’avenir, vous devez ensuite céder face à des partenaires plus nombreux et revenir en France avec un accord qui n’est pas bon pour nos concitoyens. C’est précisément ce que je m’efforcerai d’éviter pour le secteur agricole.
Au niveau national, mon prédécesseur, M. Michel Barnier, avait décidé de geler la première hausse de 1 % des quotas, j’en ai parlé tout à l’heure.
Une mission de médiation a également été mise en place, conjointement avec le secrétariat d’État chargé de l’industrie et de la consommation.
Nous avons aussi proposé un nouveau cadre de régulation pour le secteur laitier. Vous le connaissez parfaitement, il repose sur le rôle central de l’interprofession laitière, tel qu’il a été défini en décembre dernier dans la loi de finances pour 2009. Il donne à l’interprofession les moyens de construire de nouvelles relations contractuelles durables, qui porteront notamment sur la définition du prix, les engagements sur les volumes, les calendriers de livraison – cet aspect, qui n’a pas été soulevé, est également important –, les modalités de règlement, de renégociation et de résiliation des contrats.
La question de la contractualisation est absolument majeure. Dans aucun secteur économique, on ne peut avancer et progresser sans savoir comment et quand sont fixés les prix et quels sont les délais de livraison et de paiement.
Le secteur laitier constitue une exception dans la mesure où ces règles ne s’y appliquent pas. Il faut donc les définir, les appliquer et, le cas échéant, les faire respecter.
Contrairement à ce que disait tout à l’heure M. Le Cam, la contractualisation n’est pas un écran de fumée, mais bien la solution. Évidemment, il faut vérifier qu’elle est appliquée et respectée par tous les acteurs de la profession et tous les signataires. C’est sans doute l’une des voies d’avenir les plus prometteuses.
Par ailleurs, je note que la négociation de cet accord a au moins permis aux différents acteurs de l’interprofession de rediscuter ensemble, ce qui a conduit à trouver une solution, signée en présence de mon prédécesseur, M. Michel Barnier. Le prix qui a été fixé à 280 euros pour 1 000 litres de lait est un prix « moyen ». Mais cet accord étant aujourd’hui la seule base d’entente entre les différents acteurs de la filière, nous aurions tort de l’affaiblir ou de le remettre en cause. Dans la situation de crise actuelle, il constitue une base stable, solide. Loin de penser que cet accord est parfait pour les producteurs, je sais très bien ce qu’il signifie, pour eux, en termes de revenus. Toutefois, mieux vaut une base stable et solide ayant fait l’objet d’un accord qu’une remise en cause radicale, qui, à mon sens, poserait de sérieuses difficultés.
Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, vous savez qu’un certain nombre d’aides directes ont été mises en place directement par le Gouvernement.
Le Premier ministre a notamment annoncé que 70 % des aides communautaires directes pour la campagne 2009 seraient versées par anticipation dès le 16 octobre prochain.
Il a également décidé d’obtenir une transparence totale sur les prix et les marges. Je souhaite m’arrêter un instant sur ce point, qui découle d’une conviction profonde.
(Sourires.) Je dis simplement que la transparence totale est une exigence républicaine.
Très bien ! sur les travées de l ’ UMP.
Pour ce faire, nous allons lancer une enquête auprès des entreprises de la grande distribution et des centrales d’achat. Les données qui en résulteront seront communiquées dans le cadre de l’Observatoire des prix et des marges. Je ne reprendrai pas les propos de François Fortassin sur les comportements des uns et des autres, pour ne pas abréger trop rapidement ma carrière ministérielle. §
Personne ne peut se satisfaire d’une situation dans laquelle on ne sait pas qui paye quoi, qui gagne quoi, qui empoche la plus-value. Ce n’est acceptable ni pour les producteurs laitiers ni pour les citoyens français dans leur ensemble.
Mesdames, messieurs les sénateurs, tels sont les éléments que je souhaitais porter à votre connaissance. Vous pouvez compter sur mon travail et ma totale détermination.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Je constate que ce débat est achevé.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.