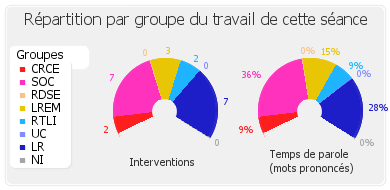Séance en hémicycle du 5 avril 2011 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Fin de mission d'un sénateur
- Demande d'inscription à l'ordre du jour d'une proposition de résolution
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi
- Décisions du conseil constitutionnel sur des questions prioritaires de constitutionnalité
- Communication du conseil constitutionnel
- Questions orales (voir le dossier)
- Situation des enseignants résidents travaillant au lycée français théodore monod de nouakchott (voir le dossier)
- Évolution des crédits d'entretien des routes nationales et ses conséquences pour la sécurité des usagers (voir le dossier)
- Conséquences de l'article 28 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (voir le dossier)
- Fiscalité des sociétés de recherche et d'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Par lettre en date du 4 avril 2011, M. le Premier ministre a annoncé la fin, à compter du 6 avril 2011, de la mission temporaire confiée à M. Denis Badré, sénateur des Hauts-de-Seine, auprès de M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, dans le cadre des dispositions de l’article L.O. 297 du code électoral.
Acte est donné de cette communication.

En application de l’article 50 ter de notre règlement, j’informe le Sénat que Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, présidente du groupe CRC-SPG, a demandé, le 31 mars 2011, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, relative à la politique énergétique de la France (n° 397, 2010 2011), qu’il a déposée le 31 mars 2011.
Cette demande a été communiquée au Gouvernement dans la perspective de la prochaine réunion de notre conférence des présidents qui se tiendra le mercredi 6 avril 2011.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen d’un projet de loi organique et de deux projets de loi, déposés sur le bureau de notre assemblée : le projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique, et le projet de loi autorisant la ratification du traité entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du nord relatif à des installations radiographiques et hydrodynamiques communes.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courriers en date du 1er avril 2011, quatre décisions du Conseil sur des questions prioritaires de constitutionnalité (nos 2011-112 QPC, 2011-113/115 QPC, 2011-114 QPC et 2011-119 QPC).
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le vendredi 1er avril 2011, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-133 QPC).
Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
J’informe le Sénat que la question orale n° 1224 de M. David Assouline qui devait être examinée ce jour, est retirée du rôle des questions orales, à la demande de son auteur.

La parole est à M. Paul Blanc, auteur de la question n° 1229, adressée à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur les problèmes de différents ordres que pourrait poser la création de l’hôpital transfrontalier de Puigcerdá : déclaration de naissances d’enfants nés à l’étranger, transfert des corps de personnes décédées en Espagne et devant être incinérées en France, enquête de gendarmerie à la suite d’un accident de la circulation en France avec blessés hospitalisés en Espagne, enquête judiciaire auprès de délinquants également hospitalisés.
Un groupe de travail devait être constitué pour apporter des solutions et pour répondre à toutes les questions qui se posent.
Je souhaite savoir s’il est constitué – s’il ne l’est pas, quand le sera-t-il ? – et quand ses conclusions peuvent être espérées.
Monsieur le sénateur, vous avez souhaité attirer l’attention de M. le ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la construction de l’hôpital transfrontalier de Puigcerdá.
La réalisation de cet hôpital est le fruit d’une volonté des élus locaux partagée par les gouvernements français et catalan.
La maîtrise d’ouvrage, puis, à terme, la gestion de cet hôpital de soixante-douze lits, est assurée par un groupement européen de coopération territoriale, ou GECT, constitué entre l’État français, la Généralité de Catalogne, l’agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon et la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, la CNAMTS.
Comme vous le soulignez à juste titre, monsieur le sénateur, la mise en service de l’hôpital n’est pas sans poser des difficultés sur le plan pratique, notamment pour nos ressortissants, s’agissant tant des remboursements de soins, de la compétence judiciaire en cas d’accident que du transfert des corps des personnes qui décéderaient en Espagne, lors de leur hospitalisation dans cet établissement.
C’est dans ce contexte particulier que nous avons été conduits à proposer à nos partenaires du GECT, comme vous l’avez rappelé, la constitution d’un groupe de travail visant à examiner l’ensemble de ces questions.
Côté français, ce groupe de travail sera conduit par le ministère des affaires étrangères et européennes. Des représentants des ministères de la justice, de l’intérieur et de la santé, ainsi que le préfet des Pyrénées-Orientales y seront associés. Les membres du GECT y participeront également, de même que les autorités centrales espagnoles compétentes.
La multiplicité des acteurs pour régler ces différents problèmes administratifs, en France comme en Espagne, a amené les autorités françaises à demander, en préambule à la réunion du groupe de travail, une identification exhaustive de tous les problèmes qui pourraient se poser, ainsi que du cadre juridique approprié à leur réponse.
Ces éléments seront très prochainement mis à la disposition du groupe de travail.
Monsieur le sénateur, notre objectif est d’aboutir à la stabilisation de la situation juridique de l’hôpital avant l’ouverture de ce dernier à la fin 2012. Nous œuvrons bien entendu avec vigueur en ce sens.

Monsieur le ministre, je vous ai bien entendu mais cette réponse avait déjà été faite en octobre 2009 à mon collègue et ami le député François Calvet.
L’ouverture de l’hôpital étant prévue pour le mois de juillet 2012, vous me permettrez, compte tenu de tout ce qu’il faut mettre en place, de nourrir quelques inquiétudes quant aux solutions à apporter à ces problèmes.
D’ailleurs, il existe peut-être des solutions très simples. Par exemple, pourquoi ne pas transcrire sur les registres d’état civil, lors d’un décès, ce qui a été déclaré à la commune de Puigcerdá et qui doit, ensuite, transiter par le consulat à Barcelone ? Il n’est pas utile d’essayer de trouver des solutions très compliquées.
En outre, des conventions doivent être passées et des solutions ont également déjà prouvé leur efficacité pour résoudre certains problèmes rencontrés entre la Belgique et la France.
Je souhaite que l’on sorte très rapidement de cette situation car le mois de juillet 2012, c’est demain, monsieur le ministre !

La parole est à Mme Christiane Kammermann, auteur de la question n° 1221, adressée à M. le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Monsieur le ministre, de retour de Mauritanie, je souhaite attirer votre attention sur la situation particulière des enseignants résidents dans ce pays travaillant au lycée français Théodore Monod de Nouakchott, ainsi que sur la difficulté pour recruter des enseignants titulaires de l’éducation nationale française en Mauritanie.
En effet, depuis quelques années, le contexte sécuritaire en Mauritanie s’est fortement détérioré, avec, pour conséquence, la dégradation des conditions de vie des résidents. Le nécessaire respect des consignes de vigilance entraîne des restrictions de déplacement à Nouakchott et dans le pays, ce qui engendre des coûts supplémentaires pour sortir de la Mauritanie pour les enseignants et leurs familles.
L’insécurité entraîne également un sentiment d’angoisse exprimé par les résidents. Certains n’envisagent plus sereinement leur vie professionnelle et personnelle, et souhaitent vraiment quitter le pays.
Les conséquences sur le lycée français Théodore Monod peuvent être importantes et avoir des effets négatifs sur la qualité du recrutement de ses futurs enseignants résidents titulaires de l’éducation nationale, car il sera difficile, à l’avenir, d’attirer et de maintenir en poste ces enseignants.
De plus, les restrictions en termes de déplacement émanant du ministère des affaires étrangères et européennes obligent les futurs enseignants recrutés à entrer en Mauritanie par la voie aérienne et à organiser un déménagement beaucoup plus coûteux.
En conséquence, je demande au Gouvernement d’étudier très favorablement la prise en compte urgente de mesures financières compensatoires, en particulier la revalorisation de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, l’ISVL, en Mauritanie, ainsi que la prise en charge du coût réel du déménagement pour la première installation en Mauritanie.
De telles mesures favoriseraient l’attractivité de ce lycée d’excellence qui participe au premier chef à la coopération franco-mauritanienne et lui permettraient, dans cette période de recrutement, de reconstituer un vivier d’enseignants investis et motivés.
Madame le sénateur, vous avez attiré l’attention du ministre d’État, ministre des affaires étrangères et européennes, sur la situation des enseignants du lycée français Théodore Monod de Nouakchott et plus généralement sur les difficultés de recrutement d’enseignants titulaires de l’éducation nationale en Mauritanie, où vous étiez voilà peu et où je me suis également rendu récemment.
Comme vous l’avez rappelé, la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne a conduit le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des ressortissants français. Tout le monde convient de cette nécessité, même si nous pouvons regretter que la sécurité soit parfois relativement aléatoire.
Pour ce qui concerne le lycée français Théodore Monod de Nouakchott, des mesures spécifiques de sécurisation ont été prises.
Sur le plan scolaire, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, détache vingt-neuf enseignants résidents en premier et second degrés dans cet établissement.
À l’issue des commissions consultatives paritaires locales de l’agence pour l’enseignement français à l’étranger, ou CCPLA, seul un poste d’enseignant résident se trouve encore non pourvu dans le premier degré. Ce poste a été proposé au candidat classé en seconde position à l’issue de la réunion des commissions locales de recrutement.
Pour ce qui concerne le second degré, trois postes demeurent non pourvus : deux en anglais et un en technologie. L’établissement recherche d’autres candidatures, et des solutions locales sont également envisagées.
Madame le sénateur, vous le savez, le ministère des affaires étrangères est particulièrement attentif à la situation délicate des établissements scolaires situés en zone subsaharienne, notamment au Mali, au Niger et en Mauritanie. C’est pourquoi, pour ces trois pays, les modalités de revalorisation de l’indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale sont aujourd’hui examinées.
Enfin, une étude est actuellement en cours afin de déterminer les possibilités d’aide aux personnels résidents et recrutés locaux du lycée français Théodore Monod de Nouakchott. Deux représentants de l’AEFE sont actuellement sur place afin de trouver les meilleures solutions et de poursuivre le dialogue constructif qui a été engagé entre les enseignants, l’administration du lycée et le poste diplomatique.

Je suis bien consciente de tous les efforts qui sont consentis en faveur de cet établissement et je vous en suis très reconnaissante, monsieur le ministre. Mais il faut continuer. Lors de mon séjour à Nouakchott, j’ai rencontré les professeurs du lycée Théodore Monod ; or beaucoup m’ont dit qu’ils partaient, d’où mon inquiétude. Il s’agit d’un établissement magnifique, et il faut vraiment faire un effort pour que les professeurs soient tous au rendez-vous.

La parole est à M. Yannick Bodin, auteur de la question n° 1188, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Monsieur le ministre, ma question concerne la création d’une prime au mérite pour les chefs d’établissement.
Le 25 janvier dernier, vous avez annoncé la création d’une prime, pouvant aller jusqu’à 6 000 euros sur trois ans, pour les principaux de collège et les proviseurs de lycées.
Le principe de cette prime se fonde sur la volonté du Gouvernement d’avoir, selon vos propres termes, monsieur le ministre, « un système éducatif moderne qui se fixe des objectifs et qui cherche à améliorer ses performances » […] « comme cela existe dans l’immense majorité des entreprises de notre pays ». À la seule différence, monsieur le ministre, que l’école est non pas une entreprise, mais une institution républicaine de service public.
La mise en œuvre de cette prime suscite de ma part quelques craintes. La plus importante porte sur les critères qui déterminent son obtention. Ces derniers ne sont, à ma connaissance, pas définitivement établis, mais ils pourraient concerner, entre autres, la lettre de mission du chef d’établissement, le projet pédagogique, les résultats scolaires ou encore la capacité à intégrer les élèves en grande difficulté ou en situation de handicap. La mise en place de contrats d’objectifs et de performance a également été abordée.
Monsieur le ministre, je m’interroge : comment évaluer l’apport individuel dans une action collective telle que l’éducation ? Et surtout, comment ces critères d’évaluation prendront-ils en compte la diversité des situations des établissements scolaires, notamment les données sociales et culturelles qui marquent des inégalités profondes, y compris entre les territoires ?
Une autre de mes craintes concerne le risque d’individualisation des carrières que va engendrer la création de cette prime. On sait pourtant que le travail d’équipe est une nécessité pour améliorer le projet éducatif dans un établissement scolaire. Dès lors, pourquoi rémunérer le chef d’établissement et non chacun de ceux qui ont participé au projet collectif ? L’instauration de cette prime risque de provoquer une rupture entre les enseignants et les chefs d’établissement.
Monsieur le ministre, je souhaite que vous nous précisiez les critères qui seront appliqués à l’évaluation des chefs d’établissement.
Monsieur le sénateur, j’assume et je revendique pleinement la mise en place d’une prime au mérite pour les proviseurs.
L’État a besoin d’une organisation moderne de gestion de ses ressources humaines. D’ores et déjà – et j’insiste sur ce point –, la rémunération de quelque 40 000 cadres de l’État comprend une prime qui varie selon leurs performances, leurs résultats, et donc leur mérite. Et c’est une bonne chose ! Si nous voulons des collaborateurs et des cadres d’État motivés, impliqués dans leur mission, et qui s’attachent à atteindre les objectifs qui leur sont fixés, cet élément de rémunération me paraît nécessaire.
Nous considérons qu’une prime au mérite est applicable aux chefs d’établissement. Dans un système éducatif moderne, le pilotage est en effet une donnée capitale. Un lycée, un collège ne doivent pas fonctionner sous le mode de l’autogestion. Ils doivent être dirigés par un pilote, par un responsable. Le Gouvernement considère qu’il faut faire confiance aux acteurs locaux, donc accorder une marge de manœuvre aux établissements. Or, plus cette marge de manœuvre est importante, plus il faut déléguer, fixer des objectifs, évaluer, être transparent et associer les cadres, ce qui suppose de les rémunérer en fonction de leur engagement.
Les organisations syndicales représentant les chefs d’établissement, avec lesquelles nous avons engagé la discussion sur ce sujet depuis de nombreux mois, adhèrent au principe de ce dispositif. Il nous reste maintenant à fixer des critères objectifs de performance.
Monsieur le sénateur, en observateur avisé du système éducatif français, vous savez que la responsabilité de l’implication du chef d’établissement est capitale pour l’aboutissement du projet éducatif, les performances et la réussite des élèves. Lorsqu’on entre dans un lycée ou dans un collège, on comprend tout de suite combien l’implication du chef d’établissement est déterminante pour les résultats, les performances des élèves.
Je pense que nous pouvons nous accorder, sur toutes les travées de cette assemblée, pour reconnaître l’importance de critères tels que la réussite scolaire, le taux d’accès d’une classe d’âge au niveau du baccalauréat, la capacité à intégrer davantage d’enfants issus de milieux défavorisés. Nous travaillons, avec les recteurs, à la définition des différents critères qui seront retenus. Il reviendra ensuite à chaque académie de passer un contrat avec les lycées pour fixer des objectifs, puis évaluer les résultats obtenus. C’est ainsi que le système éducatif pourra améliorer ses performances.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, même si la définition des critères appelle, me semble-t-il, des précisions supplémentaires.
Comme vous l’avez souligné – et je suis d’accord avec vous sur ce point –, le rôle du chef d’établissement est déterminant. Une fois les critères fixés, monsieur le ministre, il sera essentiel que vous mainteniez un climat de transparence dans les établissements. Il serait en effet très dommageable pour l’ambiance générale collective d’un collège ou d’un lycée que circulent des non-dits, de mauvaises interprétations concernant le fait que le proviseur de tel autre lycée ait bénéficié d’un avantage au mérite …
J’insiste sur la nécessité de la transparence. Grâce aux grilles de la fonction publique, tous les salaires des fonctionnaires de l’éducation nationale sont connus. Je vous demande donc de faire en sorte que la transparence reste la règle en ce qui concerne les chefs d’établissement.
Et puis, échaudé, en quelque sorte, par ce qui s’est passé dans d’autres administrations, j’espère que certains des critères qui seront retenus ne favoriseront pas ce que l’on appelle, dans la police, la « politique du chiffre ». Aussi, sans nier en rien le mérite des chefs d’établissement, je vous demande d’être attentif au climat moral et psychologique que le dispositif que vous proposez peut créer au sein des collèges et des lycées.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 1230, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur le nombre à peine croyable de suppressions de postes dans l’académie de Nancy-Metz pour la rentrée de 2011.
Cette académie paie un lourd tribut à la politique de réduction des emplois dans l’éducation nationale puisque ce sont au total 841 postes qui seront supprimés : près de 300 dans le premier degré, plus de 500 dans le second degré et une vingtaine d’emplois administratifs. Cette annonce porte à près de 4 000, en six ans, les postes d’enseignant supprimés dans cette région. Ce seront ainsi 3, 4 % des emplois en un an qui disparaîtront dans l’enseignement secondaire, soit un poste pour quatre élèves. La région Lorraine détient ainsi le triste record de ces coupes franches.
Pour le seul département de Meurthe-et-Moselle, ce sont 90 postes dans le premier degré et 53 postes dans les collèges qui vont disparaître, alors que le nombre de collégiens est en augmentation.
Comment oser parler de résorption d’un surnombre de postes alors que le niveau éducatif de la France se détériore dans les enquêtes internationales, que nous consacrons 15 % de moins que la moyenne des pays de l’OCDE à notre système éducatif, que la proportion des élèves éprouvant de graves difficultés de lecture augmente et que 150 000 jeunes par an sortent du système scolaire sans qualification ni diplôme ?
Ces décisions auront de dramatiques conséquences pour les élèves de notre région.

Il est indéniable que les conditions de l’éducation des jeunes Lorrains seront dégradées : augmentation du nombre d’élèves par classe, impossibilité de mener un soutien individualisé, détérioration de la prise en charge des élèves en difficulté, impossibilité d’assurer les remplacements d’enseignants.
Cette décision touche tout particulièrement les lycées professionnels qui, nous le savons, joue un rôle important en Lorraine ; elle entraînera la suppression de certaines filières, mettant à court terme en difficulté des secteurs économiques qui finiront par recruter de la main-d’œuvre qualifiée.
Monsieur le ministre, quelles mesures le Gouvernement envisage-t-il pour soutenir réellement l’éducation des jeunes Lorrains ?
Monsieur le sénateur, conformément au projet de loi de finances pour 2011, dans l’éducation nationale, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne sera pas remplacé, soit un total de 16 000 postes. J’ajoute immédiatement qu’il y aura plus de professeurs à la rentrée de 2011 qu’il n’y en avait voilà une quinzaine d’années, et ce malgré un nombre d’élèves moins élevé.
Le non-remplacement d’un enseignant sur deux partant à la retraite se fera sur la base d’un échange, d’un dialogue avec les acteurs de terrain. Nous agissons avec discernement, au niveau de chaque académie, afin de ne pas interférer sur l’offre scolaire.
Monsieur le sénateur, je voudrais vous rappeler les chiffres de l’académie de Nancy-Metz.
Depuis plusieurs années et de manière continue, on constate une diminution importante des effectifs dans votre académie, qui a perdu plus de 16 000 élèves en cinq ans. Vous pouvez donc aisément comprendre que, dans ce contexte, il y ait moins de professeurs.
Examinons à présent les chiffres dans votre département, la Meurthe-et-Moselle.
Dans le premier degré, c’est bien parce qu’il y aura 269 élèves de moins à la prochaine rentrée que la dotation de postes est revue à la baisse.
Malgré ces réajustements, le nombre de postes pour 100 élèves reste dans votre département bien plus élevé que la moyenne nationale.
Pour le second degré, la dotation de chaque collège a été calculée dans l’objectif de maintenir les taux d’encadrement actuels, taux qui sont également conservés dans l’éducation prioritaire.
Vous m’interpellez également sur la situation des lycées professionnels : là encore, la baisse des moyens est avant tout liée à la baisse prévisionnelle des effectifs : 1 671 élèves de moins à la prochaine rentrée par rapport aux 22 959 élèves qui avaient choisi cette voie à la rentrée 2010.
Pour autant, nous nous sommes mobilisés pour faire en sorte que ces lycées professionnels permettent à un nombre plus important d’élèves d’être diplômés. C’est ainsi que, dans l’académie de Nancy-Metz, nous avons réussi, dès 2008, à transformer plus de 50 % des brevets d’études professionnelles, les BEP, en baccalauréat professionnel.
Enfin, monsieur le sénateur, un dialogue véritablement concerté avec le conseil régional et les branches professionnelles est absolument nécessaire afin d’obtenir une meilleure organisation de la carte des formations. Tel est l’enjeu de la préparation du schéma qui est en cours dans votre région comme dans l’ensemble des autres régions françaises.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, dans le contexte budgétaire contraint que vous connaissez, nous nous efforçons, en Lorraine comme ailleurs, d’agir avec discernement pour ne pas réduire l’offre scolaire.

Je vous écoute, monsieur le ministre, mais je vous entends mal : vous me parlez chiffres, gestion des ressources et contraintes budgétaires, quand, moi qui étais professeur, je vois des enfants qui entrent à la maternelle – autrefois acceptés à l’âge de deux ans, ils doivent maintenant attendre trois ans –, des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants, des maîtres ; je vois tous ces visages de Lorraine, cette région qui a tellement souffert !
Peut-être ne savez-vous pas que, au début des années quatre-vingt, seulement 30 % des élèves de Lorraine atteignaient le baccalauréat, alors que la moyenne nationale était déjà de 50 % ?
Nous avons accompli un effort exceptionnel pour que le taux de bacheliers dans cette région industrielle passe en moins de vingt ans de 30 % à 65 % – ce chiffre a été atteint aux alentours des années 2 000, et depuis, nous ne progressons plus –, un effort en termes de moyens, d’équipements, mais aussi un effort de persuasion des familles. Autrefois, les filles quittaient le collège en classe de cinquième pour entrer en apprentissage, avant d’intégrer une usine de chaussures ou de textile ; de la même manière, les garçons allaient facilement à l’usine ou à la mine. Évidemment, ce n’était plus possible après.
Monsieur le ministre, vous êtes en train de casser cette évolution dont je viens de rappeler les étapes !
M. le ministre fait un signe de dénégation.

Permettez-moi de vous le dire, ce que traduisent vos chiffres – ces 841 postes supprimés, ces classes surchargées –, …

La parole est à M. Alain Dufaut, auteur de la question n° 1235, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Monsieur le ministre, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 », a instauré l’interdiction pour les élèves d’utiliser un téléphone mobile dans l’enceinte d’une école maternelle, d’une école élémentaire et au collège afin de les protéger des ondes électromagnétiques.
Toutefois, le texte ne précise pas s’il reviendra aux enseignants de faire respecter la loi et ce que pourraient risquer les contrevenants, surtout les parents, en cas d’infraction.
Ces imprécisions entraînent bien sûr la non-application de cette mesure.
Or une récente enquête réalisée par TNS Sofres montre que 47 % des adolescents de 12 à 17 ans utilisent leur portable en cours et que 54 % d’entre eux reçoivent des appels. De plus, depuis l’explosion des ventes de smartphones, les jeunes jouent et prennent des photos avec leur téléphone mobile. À ce propos, on observe le développement important du sexting : les jeunes se photographient dans des postures plus ou moins sexy, puis s’échangent les clichés en classe par le biais de leur téléphone mobile, avant de les diffuser sur internet ; 7 % des jeunes avouent d’ailleurs avoir filmé leur professeur à leur insu.
Face à cette utilisation croissante des téléphones portables en classe, qui perturbent les cours et exaspèrent les professeurs, on ne peut plus se contenter de dire que la décision d’interdire ces appareils dans l’enceinte des établissements scolaires relève simplement des conseils d’administration de ces derniers et du règlement intérieur.
Il serait souhaitable que le Gouvernement s’engage vraiment. Ce serait une marque de soutien, un signe fort donné aux enseignants pour les aider à lutter efficacement contre ce fléau envahissant face auquel ils se sentent seuls et désemparés.
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire en la matière ?
Monsieur le sénateur, comme vous, je suis tout à fait convaincu que les élèves et les équipes pédagogiques ont besoin du meilleur environnement éducatif possible pour travailler sereinement.
Il est évident que l’utilisation du téléphone portable peut nuire à la réalisation de cette ambition. Elle peut en effet entraîner, comme vous l’avez rappelé, des troubles de l’attention préjudiciables pour nos élèves et ainsi perturber l’organisation des enseignements.
Dès que l’usage du téléphone portable s’est répandu dans les établissements scolaires, ces derniers l’ont pris en compte dans leur règlement intérieur. Aujourd’hui, le processus est quasiment généralisé dans l’ensemble des collèges et des lycées, une disposition spécifique à l’usage de ces appareils au sein des établissements figurant dans les règlements intérieurs.
Récemment, vous avez voulu aller plus loin – vous l’avez rappelé – dans le cadre de la loi « Grenelle 2 ». Nous avons réaffirmé le principe que je viens d’évoquer s’agissant des écoles et des collèges, en modifiant le code de l’éducation.
Pour autant, les débats parlementaires qui ont eu lieu ici même – vous vous en souvenez, monsieur le sénateur – et à l’Assemblée nationale ont montré la nécessité de prendre en compte la réalité du terrain : l’usage des portables étant entré dans les pratiques quotidiennes, nous ne pouvons ignorer le besoin de communiquer, notamment entre les enfants et leurs parents, qui sont eux-mêmes demandeurs, naturellement en dehors des heures de cours.
Il nous faut donc trouver un bon équilibre quant à l’utilisation de ces téléphones, et il faut surtout que l’école soit un lieu où l’on éduque à l’utilisation de ce type d’instruments.
Nous disposons aujourd’hui d’un outil pour informer et sensibiliser les élèves aux précautions d’usage des portables : la validation du brevet informatique et internet, B2i, qui aborde, je le rappelle, le principe du droit à l’image et du respect de l’autre sur internet – vous avez cité des cas récents contre lesquels nous devons absolument lutter – et permet de traiter directement avec les collégiens de ce thème et de les sensibiliser aux enjeux.
La loi a posé un principe : à partir de ce cadre formel, c’est à chaque établissement, dans le cadre du règlement intérieur, d’établir les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Certaines dispositions permettent d’aller jusqu’à la confiscation. En cas de manquements répétés et de récidive, il est possible d’imposer des punitions scolaires, voire des sanctions disciplinaires.
Grâce au débat qui est intervenu l’année dernière et au vote de la loi précitée, les établissements scolaires bénéficient aujourd’hui d’un arsenal comprenant à la fois des mesures destinées à lutter contre les dérives de l’utilisation de ces appareils et un volet éducatif, qui me semble aller dans le sens d’un équilibre entre le respect du bon déroulement des cours et l’utilisation de ce type d’appareils à laquelle sont attachés les parents.

Monsieur le ministre, j’ai bien écouté le rappel des principes, que je connaissais. Il faut effectivement trouver un juste équilibre, parce que les enfants ont de plus en plus besoin de communiquer avec leurs parents par le biais des téléphones portables.
Toutefois, pour siéger moi-même dans des conseils d’administration d’établissements scolaires, je sais qu’il est très difficile d’établir des règles et de sanctionner leur non-respect.
Monsieur le ministre, dès que ma question a été mise en ligne sur le site du Sénat, j’ai reçu beaucoup d’emails, notamment de la part de parents d’élèves me signalant que, avant de se préoccuper des enfants, il faudrait interdire l’utilisation des portables aux professeurs ! Un tel usage par les enseignants, s’il est extrêmement rare, doit cependant être signalé, car les enseignants doivent être les premiers à respecter la règle, qui s’applique à tous.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 1216, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la situation de tous les établissements scolaires va être fortement dégradée à la prochaine rentrée scolaire. La suppression de 16 000 postes aura une incidence certaine sur la qualité des enseignements.
Les dispositions de la réforme des lycées viennent tout juste d’être intégrées dans les actes que des décisions sont prises sans laisser de temps à leur mise en place. La suppression de la classe de seconde au lycée Martin Nadaud est en cela fort symptomatique. Le rapport qui vous a été remis le 15 mars dernier reconnaît qu’il « faut donc respecter cette durée nécessaire, permettre aux professeurs d’expérimenter, de faire eux aussi des erreurs, les rassurer et les accompagner dans ces transformations... »
C’est tout simplement le contraire qui a été fait dans notre ville : peu de temps après la création de cette classe de seconde, le recteur a décidé que cette dernière ne pouvait continuer à exister pour la simple raison qu’elle n’aurait pas rempli ses objectifs.
Le procédé est particulièrement cavalier. Sans aucune évaluation dans un temps raisonnable, l’administration décide de la disparition brutale d’une classe, qui répond à un réel besoin. Lors des portes ouvertes de l’établissement, nombre de familles étaient venues pour inscrire leurs enfants sans savoir que la classe était fermée…
Les inspecteurs généraux, dans leur rapport, considèrent qu’il faudrait « accompagner plutôt que prescrire, valoriser et mutualiser les expériences réussies, aider à l’évaluation. »
Dans le cas qui nous préoccupe, c’est l’inverse qui a été fait, sans tenir compte de l’avis de la communauté éducative. La montée en charge des effectifs a été forte, passant de 8 à 19 élèves l’an dernier. Avant l’annonce de cette décision de suppression, l’établissement prévoyait une augmentation de 15 élèves à la prochaine rentrée. Il avait même engagé un partenariat avec les clubs sportifs de football et de rugby situés à proximité immédiate.
Le travail effectué en amont avec les collèges laissait aussi entrevoir un potentiel réel de développement. La décision rectorale n’a réussi qu’à annihiler ces bonnes volontés. Pourquoi le moratoire qui a été accepté pour certains établissements similaires de notre région ne le serait-il pas pour Martin Nadaud ?
Placer les gens devant le fait accompli : telle est la méthode employée, puisque, avec la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, les moyens sont de plus en plus diminués. Pourtant, la population rajeunit en Indre-et-Loire.
Que ce soit dans l’enseignement secondaire ou dans l’enseignement élémentaire, cette situation devient intenable. Avec 116 élèves supplémentaires à la rentrée prochaine dans l’enseignement élémentaire, 28 postes devraient disparaître, ce qui est, me semble-t-il, très contradictoire avec la réponse que vous avez apportée tout à l’heure à notre collègue Daniel Reiner.
J’ai rencontré récemment les maires et les parents d’élèves de plusieurs communes de mon département et j’ai constaté qu’aucune concertation n’a vraiment eu lieu pour préparer cette future rentrée.
Les maires de Bossay-sur-Claise et de Chaumussay, dans le sud du département, sont très inquiets pour l’avenir de leur école, qui annonce de fait la mort de leurs villages. Ceux de Lerné, Seuilly – je pourrais en citer bien d’autres – sont dans une situation identique et ne comprennent pas que de telles questions, qui touchent non seulement à l’existence future de leurs enfants mais aussi à la pérennité de la vie de leurs communes, soient traitées sans tenir compte des conséquences humaines qu’elles entraînent.
Dans ma commune, c’est la capacité à prendre en charge l’éducation des enfants de deux ans et demi dans les zones d’éducation prioritaire, les ZEP, qui est mise en cause.
La colère monte chez les parents, les enseignants et les élus.
Alors que notre pays pouvait s’enorgueillir d’avoir un système éducatif des plus modernes et des plus performants, vous n’avez fait que le dégrader, à tel point qu’il se situe désormais à la quatre-vingt-douzième place mondiale pour ce qui concerne le taux d’encadrement des élèves.

Monsieur le ministre, je vous demande ce que vous comptez faire pour le lycée des métiers Martin Nadaud, mais aussi pour l’avenir de tous nos collégiens et élèves des écoles maternelles et élémentaires, qui subissent de plein fouet des restrictions budgétaires insupportables.
Demander aux dirigeants d’autres pays d’écouter leurs peuples me semble être une bonne chose, mais commencer par écouter les Français me paraîtrait tout aussi pertinent.
Madame le sénateur, vous attirez mon attention sur la situation du lycée Martin Nadaud de Saint-Pierre-des-Corps.
Je vous rappelle tout d’abord que le projet de fermeture de l’unique classe de seconde de ce lycée repose sur le constat objectif d’un manque d’élèves et s’appuie sur une procédure qui, contrairement à vos affirmations, avait été annoncée dès le mois de novembre 2009.
Plus généralement, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours a demandé aux lycées professionnels dotés d’une seule classe de seconde générale et technologique à faible effectif de se constituer en réseau, ce afin de pouvoir alimenter correctement les classes de première technologique.
Le lycée Martin Nadaud est dans cette situation : son unique classe de seconde accueille, depuis 2006, entre dix et dix-huit élèves par an.
Ainsi, dès 2009, le maintien de cette classe à la rentrée 2011 avait été subordonné à l’inscription de plus de vingt-quatre élèves pour l’année scolaire 2010-2011. Or, comme vous le savez, madame le sénateur, cette classe ne compte actuellement que dix-huit élèves.
Vous évoquez la qualité du service public de l’éducation nationale, madame Beaufils… Mais il me semble précisément que le maintien de cette classe se ferait au détriment des élèves. Ainsi, à titre d’exemple, il serait impossible de proposer l’ensemble des enseignements d’exploration créés par la réforme du lycée dans un établissement comprenant une classe unique de seconde composée de dix-huit élèves. Voilà pourquoi la suppression de cette classe a été décidée.
J’évoquais tout à l’heure le discernement dont nous faisons preuve : il se trouve que, dans le même lycée, nous avons également décidé de mener une politique active afin d’attirer des élèves – et pas seulement ceux qui sont issus de la classe de seconde de cet établissement – en première STI, ou Sciences et technologies industrielles, et de conforter ainsi cette dernière filière. C’est la raison pour laquelle les services académiques ont décidé d’ouvrir dans ce lycée une nouvelle spécialité, « Architecture et construction ».
Nous nous efforçons donc de tenir compte de la réalité locale, madame la sénatrice. Cette décision de fermeture avait été anticipée et concertée, mais nous sommes aussi capables de créer de nouvelles filières lorsque des besoins et, surtout, des perspectives d’insertion professionnelle existent.

Je souhaite brièvement réagir à vos propos, monsieur le ministre, notamment livrer quelques réflexions sur la qualité de l’enseignement.
La presse vient précisément de se faire l’écho du travail exceptionnel d’accompagnement des élèves et de soutien pédagogique accompli dans cette classe de seconde du lycée Martin Nadaud. Ces efforts ont permis une réussite des élèves bien au-delà de ce que l’on constate habituellement dans ce type de classes.
En outre, et même si des éléments avaient en effet été communiqués dès le mois de novembre 2009, c’est seulement en 2010 que l’inspection académique a commencé à délivrer une information adéquate en direction de dix collèges, afin d’élargir le périmètre de recrutement du lycée Martin Nadaud.
On le voit, de multiples obstacles ont été placés sur le chemin d’une intégration véritable de cette classe de seconde au paysage éducatif de notre département. La mobilisation dans le domaine des formations sportives, qui avait été décidée et que j’ai évoquée précédemment, aurait notamment pu y contribuer.
Quant à l’ouverture de cette classe « architecture et construction », elle ne fait que concrétiser le travail mené depuis de nombreuses années par ce lycée du bâtiment en vue de modifier la perception étriquée que l’on a traditionnellement de ces établissements.
Toutes les expériences conduites dans cet établissement auraient à mon avis mérité qu’un moratoire soit appliqué dans ce lycée, comme cela a été le cas par ailleurs à Orléans et à Vierzon. Je regrette qu’une telle décision n’ait pas été prise.

La parole est à M. Yves Daudigny, auteur de la question n° 1203, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nos routes restent aujourd’hui le principal vecteur de mobilité de nos concitoyens et assurent toujours 90 % du transport de voyageurs et 88 % de celui des marchandises.
Pourtant, les crédits affectés à l’entretien de notre réseau routier national n’ont de cesse de baisser alors même que le schéma national d’infrastructures de transport, ou SNIT, présenté en janvier dernier, fait le constat que 16 % des chaussées sont en mauvais état et qu’il ne faudrait pas moins de 120 millions d’euros supplémentaires par an pendant sept ans pour rattraper le retard, auxquels il conviendrait d’ajouter 10 millions d’euros par an pour les ouvrages d’art.
Si le plan de relance a permis, par l’injection de 70 millions d’euros, de porter le taux de renouvellement annuel des revêtements à 8 % en 2008, celui-ci est retombé à 5 % en 2010.
Une comparaison des crédits strictement liés à l’entretien et à l’exploitation des routes montre, entre 2010 et 2011, une baisse de 25 % des crédits pour l’entretien routier et de presque 30 % pour les actions de rénovation de la chaussée. À titre d’exemple, pour la direction interdépartementale des routes du Nord, les crédits d’entretien sont ainsi passés de 51 millions d’euros en 2010 à 36 millions d’euros pour cette année.
Voilà peut-être un début d’explication au fait que l’état de nos routes ne cesse de se dégrader !
Récemment, dans un article publié par le journal Le Monde, le président de l’Union des syndicats de l’industrie routière française, par ailleurs directeur général adjoint d’Eurovia, s’est inquiété de cette diminution des crédits. Il a ainsi jugé très insuffisant les 74, 5 millions d’euros crédités cette année pour l’entretien préventif et la réparation des chaussées, compte tenu de la nécessité de rénover les revêtements tous les sept à douze ans.
Sur ce point, le rapport général sénatorial fait au nom de la commission des finances sur le projet de loi de finances pour 2011 regrettait lui aussi que « la gestion budgétaire de l’entretien des routes relève plutôt du coup par coup que d’une stratégie durable ». Pourtant, il y a urgence à agir, car, si l’on n’investit pas aujourd’hui, on payera plus cher demain, et ce coût sera bien sûr porté à la charge du contribuable !
On laissera aussi les usagers emprunter des routes potentiellement dangereuses.
C’est ainsi que, à l’heure actuelle, certains secteurs voient s’accumuler les nids de poule. Dans l’Aisne, sur la RN 2, il a fallu limiter la vitesse et le tonnage, et même neutraliser une voie à Crouy, dans l’agglomération de Soissons, depuis maintenant quatre ans !
En outre, la situation paraît d’autant plus critique que ces crédits servent aussi à payer la viabilité hivernale qui, au vu du dernier mois de décembre, va fortement amputer des budgets déjà très contraints. L’abondance de neige va en effet accélérer la détérioration des chaussées, entre gel et dégel et, au printemps, les restes de crédits d’entretien ne suffiront vraisemblablement pas à masquer les dégâts. D’ailleurs, les directeurs interdépartementaux des routes le reconnaissent, eux qui sont déjà appelés depuis le printemps dernier à opérer des économies substantielles en diminuant si nécessaire les niveaux de service.
Le réseau routier de l’État constitue pourtant le maillage stratégique des transports routiers. Il est également une fierté nationale de par sa longue histoire.
Qu’entendez-vous faire pour éviter ce que l’on pourrait appeler, si le sujet n’était pas aussi grave, une « sortie de route » ? Quels moyens comptez-vous mettre en œuvre pour financer l’entretien et l’exploitation de nos routes afin d’assurer la sécurité des usagers et de ceux qui y travaillent ?
Monsieur Daudigny, il est exact que, pour faire face à notre objectif global de réduction des dépenses de l’État, le budget de l’entretien du réseau routier national non concédé a diminué en 2011.
Le Gouvernement assume sa volonté claire, nette et précise de réduire les dépenses publiques.
Pour déterminer les besoins d’entretien du réseau routier national, les services du ministère disposent d’indicateurs qui permettent de suivre l’état du patrimoine.
Les chaussées représentent une part importante du patrimoine de l’État, et le suivi de l’évolution de leur état qualitatif est assuré grâce à la démarche IQRN, ou image qualité du réseau national. Des campagnes de mesure sont faites tous les trois ans sur le réseau.
Le réseau est globalement en état correct, avec un faible pourcentage de chaussées en mauvais état nécessitant des interventions lourdes. Ce chiffre est toutefois en légère augmentation.
Depuis 2008, des moyens importants et croissants ont pu être mobilisés, notamment grâce au plan de relance de 2009.
La succession de deux hivers rigoureux a provoqué une dégradation sensible du réseau routier national. Cette situation nécessitera sans doute d’effectuer des redéploiements de moyens par rapport aux prévisions pluriannuelles.
Dans cette attente, les services sont évidemment mobilisés pour assurer, en priorité, la sécurité des usagers. Ils interviendront au plus tôt, dès l’apparition des dégradations, d’une part en opérant une signalisation adéquate du danger, voire en imposant des restrictions de circulation, d’autre part en réparant temporairement les dégradations – je pense évidemment aux nids de poule, problème que vous venez d’évoquer, monsieur le sénateur.
Puis, au printemps, dès que les conditions atmosphériques le permettront, des travaux de remise en état définitive seront programmés.

Je vous ai écouté avec attention, monsieur le secrétaire d’État. Je ne puis toutefois partager l’idée selon laquelle l’application d’un dogme budgétaire aurait pour conséquence une grave détérioration de l’état de nos routes nationales.
Les chiffres sont têtus : le schéma du projet de loi de finances pour 2011 indique bien que les crédits destinés à l’entretien préventif et à la réparation des chaussées, qui s’élevaient à 179 millions d’euros en 2008, ont été réduits à 74, 5 millions d’euros pour 2011. À cette diminution considérable des crédits s’ajoute aujourd’hui la nouvelle réorganisation faisant suite à la disparition des directions départementales de l’équipement. L’efficience des nouvelles directions interdépartementales des routes ne semble pas encore maximale, et de nombreux témoignages marquent aujourd’hui le désarroi des salariés qui y travaillent.
Il ne faut pas négliger ce problème, car il en va de la sécurité des usagers comme du développement économique, en raison des volumes de travaux confiés à nos entreprises.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 1140, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Le transport de marchandises polluantes ou dangereuses par la mer s’est accru de 40 % depuis dix ans. Aujourd’hui, un navire convoyant des marchandises dangereuses ou polluantes passe toutes les trente minutes au large d’Ouessant, soit un total de 17 000 navires par an. La tendance reste à la hausse, avec le projet des « autoroutes de la mer » qui vise à transférer sur le transport maritime une grande partie du fret routier européen.
Or, comme vous le savez, de nouveaux risques sont également apparus avec les substances nocives et potentiellement dangereuses, qu’il s’agisse de produits chimiques ou de produits toxiques que l’on sait difficilement gérer en pleine mer lors d’une fuite, et dont le transport ne cesse de croître.
Cette insécurité est renforcée par le design des navires modernes, imposé par les réglementations récentes – double coque, Marpol Annex IV –, qui ont eu pour effet de rendre les cuves de ces navires encore plus inaccessibles par l’extérieur en cas d’accident.
Ainsi, les gigantesques navires d’aujourd’hui ne sont absolument pas équipés pour limiter les conséquences environnementales des accidents de mer. Tout ou presque est prévu à bord pour éviter l’accident, mais rien pour mieux gérer ce dernier lorsqu’il n’a pas pu être évité. Nous savons maintenant que le risque zéro n’existe pas, et pourtant, en cas de problème, les navires d’aujourd’hui sont toujours aussi démunis et passifs qu’il y a vingt ans.
À ce défi technique du navire accidenté, une filière jeune et « verte », la sécurité passive embarquée, propose des réponses fiables et certifiées. La France est en pointe sur ce sujet et développe, avec les Fast Oil Recovery Systems, des solutions agréées par les sociétés de classification, recommandées par les compagnies de sauvetage et soutenues par les associations de protection de l’environnement.
En cas d’accident de mer, ces systèmes permettent d’accéder plus rapidement aux cuves et font gagner un temps précieux pour limiter la diffusion des hydrocarbures sur la côte. En fait, ce type d’intervention sur l’épave exigera dix fois moins d’efforts que si les hydrocarbures parviennent à la côte et préservera véritablement l’environnement.
Face à l’émergence de ces nouveaux risques et à l’apparition simultanée d’innovations technologiques pertinentes de nature à renforcer la sécurité environnementale en mer, il semble que les réglementations internationales, ainsi que les dispositifs nationaux de prévention et de lutte contre les pollutions marines, doivent être revus.
Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous, d’une part, m’indiquer si une révision des plans nationaux d’organisation et des moyens de lutte contre les pollutions marines accidentelles est prévue et, d’autre part, me faire connaître la position de la France, et les éventuelles initiatives qu’elle défend en la matière auprès de l’Organisation maritime internationale et de l’Union européenne concernant notamment un éventuel « paquet ERIKA IV ».
Monsieur le sénateur, la question des pollutions marines a été abordée de manière approfondie dans le cadre des travaux du Grenelle de la mer.
Le comité opérationnel spécialisé dans les « pollutions marines » a rendu ses conclusions au printemps 2010. La réponse de l’État dans ce domaine doit être globale et intégrée.
Elle doit d’abord porter sur la prévention des accidents. Telle est la mission des seize centres de sécurité des navires chargés du contrôle des navires sous pavillon français et du contrôle des navires sous pavillon étranger. Ces centres sont rattachés aux nouvelles directions interrégionales de la mer, mises en place au début de l’année 2010.
Le socle réglementaire dont ces centres contrôlent l’application a été considérablement renforcé. Sur l’initiative de la France, l’Union européenne a récemment adopté le paquet de mesures relatives à la sécurité maritime, dit « paquet ERIKA III ». Ainsi, depuis le 1er janvier 2011, 100 % des navires qui fréquentent les ports de l’Union européenne doivent faire l’objet de contrôles périodiques et rigoureux, ce qui va dans le sens d’un renforcement de la sécurité maritime.
Notre réponse doit porter également sur la surveillance des espaces maritimes, la détection des pollutions et la lutte contre les auteurs des pollutions maritimes. Cette mission est pleinement assurée par les sept CROSS français, les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage, qui agissent en liaison avec les préfets maritimes et les procureurs de la République.
Vous le savez, monsieur le sénateur, la loi du 1er août 2008 relative à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de l’environnement a ainsi porté à 15 millions d’euros et à dix ans d’emprisonnement les peines encourues en cas de rejet volontaire.
Enfin, en cas d’accident maritime entraînant une pollution maritime, il s’agit pour l’État d’assurer la lutte en mer et à terre sous l’autorité des préfets maritimes et des préfets terrestres grâce aux différentes dispositions de l’ORSEC.
Les équipements de lutte et les moyens d’intervention sont mis en œuvre par le ministère de la défense pour la lutte en mer et par le ministère chargé de la mer pour la lutte à terre. Un travail interministériel d’actualisation et de mise en cohérence des différentes instructions est en cours, sous l’égide du secrétariat général de la mer.
Enfin, sur le plan international, je citerai deux initiatives françaises.
En premier lieu, le système des navires à double coque, ainsi que, plus récemment, celui de la protection des soutes, ont été largement soutenus par la France auprès de l’Organisation maritime internationale, qui les a adoptés.
En second lieu, ainsi que vous l’avez évoqué, monsieur le sénateur, il existe en France une société spécialisée dans le développement du système FORS, dont l’objet est le développement de la sécurité passive embarquée à bord des navires.
Mis en contact avec les services du ministère en vue de promouvoir l’installation de ce système sur les navires de commerce, nous avons favorisé la participation d’experts de cette société aux travaux du sous-comité Design Equipment de l’Organisation maritime internationale.
Dans ce cadre, une proposition a été déposée en 2011 auprès de cette organisation, en vue de favoriser la mise en place de cet équipement sur les navires.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, de votre réponse.
Les nouveaux systèmes que j’ai évoqués permettent, je le répète, d’accéder plus rapidement aux cuves pour traiter les produits dangereux des navires accidentés. Surtout, ils permettent de gagner du temps, et donc de limiter les fuites ou le déversement des produits polluants sur la côte, et ce avec dix fois moins d’efforts que si lesdits produits parviennent à la côte. Il faut donc impérativement encourager l’installation de ces systèmes, mais nous aurons l’occasion de reparler de cette question prochainement.

La parole est à M. Michel Doublet, en remplacement de M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 1194, transmise à M. le ministre de la culture et de la communication.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous prie, tout d’abord, de bien vouloir excuser l’absence de notre collègue Daniel Laurent, retenu par les obsèques d’un adjoint au maire de sa commune.
L’article 28 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a modifié le dispositif relatif aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, pour les remplacer par des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, les AVAP.
Cette nouvelle disposition s’applique aux ZPPAUP en cours de création, de révision ou de modification, ainsi qu’aux zones existantes.
Dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France, le Sénat a adopté un amendement de notre collègue Philippe Paul, auquel nous nous sommes associés, Daniel Laurent et moi-même, et dont l’objet visait à rectifier l’article L. 642-8 du code du patrimoine, issu de l’article 28 de la loi « Grenelle 2 ».
Ainsi, l’article L. 642-8 du code du patrimoine, qui précise les conditions du passage d’une procédure à l’autre, prévoit que les ZPPAUP « en cours de révision » sont instruites conformément à la nouvelle procédure lorsqu’elles n’ont pas encore fait l’objet d’une enquête publique.
Cette disposition permet d’approuver immédiatement la révision dès lors que celle-ci a été réalisée. Elle a, toutefois, involontairement oublié le cas des ZPPAUP en cours d’élaboration qui ont été soumises à enquête publique avant la publication de la loi. L’amendement ainsi adopté vise à réparer cet oubli. Gageons que cette disposition sera actée dans le texte définitif.
Un autre cas de figure mérite d’être mis en exergue, celui des communes dont la révision du PLU, le plan local d’urbanisme, aurait été approuvée par le conseil municipal avant la loi Grenelle 2, et qui aurait souhaité, après l’entrée en vigueur de cette même loi, procéder à une modification du règlement de la ZPPAUP pour intégrer, qui un nouveau projet urbanistique, qui une opération de développement touristique, etc.
Or que constate-t-on ? Il est tout simplement impossible de débuter une nouvelle modification de ZPPAUP, aussi modeste soit-elle, sans adopter une AVAP, aucune mesure transitoire n’étant prévue.
Comment peut-on imaginer qu’une modification, qui n’obère en rien la philosophie d’une zone de protection patrimoniale et architecturale, puisse nécessiter plusieurs mois d’instruction, pour ne pas dire plus, et entraîner des surcoûts injustifiés pour les finances de nos collectivités ?
Dans son discours du 2 mars 2010, le Président de la République a demandé aux parlementaires de consacrer une partie de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et du Sénat à « délégiférer » et nous l’a rappelé encore lors de la présentation des vœux en janvier dernier.
Par ailleurs, le Président de la République a demandé au président Larcher de formuler des propositions concernant les normes applicables aux collectivités territoriales. La commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire s’en est saisie, et nous avons dès lors identifié plusieurs domaines, dont l’urbanisme.
Je ferai enfin référence à l’excellent rapport d’information de notre collègue et ami Claude Belot, fait au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, au titre pour le moins explicite : La maladie de la norme, qui ne dit pas autre chose. Les procédures de modification et de révision des documents d’urbanisme sont contraignantes, longues et coûteuses pour les finances publiques.
Dès lors qu’il s’agit d’adaptations mineures et marginales de ces règles, ne pourrait-on pas envisager la réalisation de ces projets sans une modification du document d’urbanisme ou en simplifiant significativement la procédure ? Les élus locaux, notamment en milieu rural, nous font savoir qu’ils sont dépassés, voire exaspérés, par l’empilement des textes et l’excès normatif, tout particulièrement en matière d’urbanisme, qui pénalisent, voire freinent la mise en œuvre de projets qui peuvent paraître modestes d’un point de vue réglementaire mais se révéler importants pour le dynamisme de nos communes.
Je partage pleinement ces légitimes préoccupations, que nous avions anticipées avec mon collègue Daniel Laurent, en nous abstenant lors du vote de la loi Grenelle 2.
Monsieur le secrétaire d'État, quelles réponses concrètes pouvez-vous nous apporter sur cette problématique et quelles mesures comptez-vous mettre en œuvre pour simplifier le code de l’urbanisme ?
M. Laurent a souhaité attirer l’attention du Gouvernement sur les difficultés rencontrées par les modifications des ZPPAUP en AVAP, telles qu’elles sont prévues par les dispositions de la loi portant engagement national pour l’environnement.
La représentation nationale a souhaité une mise en œuvre rapide de la loi Grenelle 2, et c'est la raison pour laquelle il ne peut effectivement plus être créé, depuis le 14 juillet 2010, de ZPPAUP, mais seulement des AVAP.
Cette volonté du législateur manifeste le désir que les objectifs liés au développement durable soient pris en compte le plus rapidement possible dans les documents d’urbanisme. Ainsi, le fait qu’il n’existe pas de dispositions transitoires pour l’entrée en vigueur de cette loi traduit non pas un frein à la mise en place des projets de ZPPAUP en voie d’aboutissement, mais la volonté de ne plus créer de telles zones, appelées à être remplacées dans tous les cas par des AVAP.
Cependant, lors de la première lecture de la proposition de loi visant à faciliter la mise en chantier des projets des collectivités locales d’Île-de-France, le Sénat a adopté, le 30 mars 2011, un article 2 visant à permettre de continuer à instruire, selon la procédure applicable au ZPPAUP, les projets en cours d’élaboration à la date de publication de la loi portant engagement national pour l’environnement.
En tout état de cause et dans l’attente du vote de l’Assemblée nationale sur ce dernier texte, je tiens à préciser que les acquis des études patrimoniales réalisées et du projet établi ne sont nullement remis en cause.
La poursuite de la démarche nécessite de compléter le dossier par un diagnostic environnemental, dont la synthèse et les conclusions devront figurer au rapport de présentation, et de mettre au point les prescriptions nécessaires à la prise en compte des objectifs de développement durable, en particulier en matière d’économie d’énergie et d’exploitation des énergies renouvelables.
Un acte portant mise à l’étude d’une AVAP peut d’ores et déjà être pris par délibération du ou des organes délibérants des collectivités territoriales compétentes, sans que soit encore paru le décret d’application de cette loi. Cet acte devra mentionner les modalités de concertation prévues par le code du patrimoine. Cependant, le décret d’application, qui doit être soumis prochainement au Conseil d’État, précise les dispositions législatives relatives à la composition de la commission locale, et la procédure de création ne peut être poursuivie avant la parution de ce décret.
Je précise, enfin, que le ministère de la culture et de la communication, qui a la charge de ce dispositif et de sa mise en œuvre, a prévu, dès le présent exercice budgétaire, un accroissement des crédits concernés, de manière à poursuivre l’attribution de subventions conséquentes auprès des collectivités territoriales qui s’engageront en particulier dans la transformation de ZPPAUP existantes ou en cours d’instruction en AVAP. Cet effort budgétaire, qui se répartira nécessairement dans le temps, sera consenti au moins jusqu’au terme du délai de cinq ans prévu par la loi pour la mise en œuvre de cette transformation.

Je prends acte des déclarations de M. le secrétaire d’État, que je transmettrai bien sûr à notre collègue Daniel Laurent, et j’espère que celles-ci seront suivies d’effet.

Mes chers collègues, en raison de l’absence de l’auteur de l’une des questions orales, qui s’est excusé de ne pouvoir être présent ce matin, nous avons pris un peu d’avance. Aussi devons-nous attendre l’arrivée de Mme la secrétaire d'État chargée de la santé.
Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq, est reprise à dix heures cinquante.

La parole est à M. Jean Besson, auteur de la question n° 1196, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la santé.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, je me fais ici l’écho du cri d’alarme lancé par les élus de la Drôme, et plus particulièrement des Baronnies provençales, concernant la baisse continue du nombre de médecins généralistes.

La situation sur ce territoire n’est malheureusement pas une exception dans notre pays.

Elle illustre parfaitement la désertification médicale en marche, dont on connaît bien maintenant les rouages ainsi que les conséquences.
Au sein de nos cantons ruraux, il suffit du décès ou du départ à la retraite d’un seul médecin pour que l’ensemble de la chaîne des soins médicaux s’enraye.
En effet, dans ce cas d’espèce, les praticiens en exercice, déjà surchargés de travail, se retrouvent le plus souvent dans l’obligation de refuser toute nouvelle clientèle. Moyennant quoi les tours de garde ne peuvent plus être assurés, les permanences de nuit et les visites à domicile sont supprimées.
Ce scénario noir que nous connaissons tous dans nos territoires n’est pas le fruit de la fatalité ; il est bien plutôt le résultat d’une politique d’abandon. C’est pourquoi, dans la Drôme, à l’image de nombreux départements, les élus locaux luttent d’arrache-pied aux côtés des professionnels de santé pour essayer d’attirer de nouveaux généralistes. Mais il est fort à craindre que, sans l’intervention volontariste et rapide de l’État, l’offre de soins ne continue localement à se dégrader.
La situation est d’autant plus préoccupante que, dans le sud de mon département, les Baronnies et le Tricastin, les statistiques montrent que 62 % des médecins ont plus de cinquante-cinq ans.
Aussi, madame la secrétaire d'État, devant cet état des lieux alarmant, je souhaite connaître les mesures que vous et vos services comptez prendre dans les Baronnies provençales et, d’une manière plus générale, dans la Drôme, afin de redynamiser une médecine de proximité bien mal en point.
Monsieur le sénateur, la démographie de la médecine générale appelle une vigilance particulière, dans la Drôme comme dans de nombreux départements.
Prenant en compte les évolutions inéluctables de la démographie médicale, les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ont progressivement augmenté le numerus clausus des études médicales depuis 2000. Celui-ci a été relevé de 3 850 en 2000 à 7 400 en 2009, ce chiffre ayant été confirmé depuis lors.
Parallèlement, le nombre de postes offerts aux épreuves classantes nationales en médecine générale dans la région Rhône-Alpes a été porté de 195 en 2004-2005 à 316 en 2010-2011 ; tous les postes ouverts cette dernière année ont été pourvus.
En complément, la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, dite loi HPST, prévoit la détermination du nombre d’internes à former par spécialité et subdivision territoriale pour une période de cinq ans. Ces quotas sont établis en fonction des besoins de soins, au vu des propositions de l’Observatoire national de la démographie des professions de santé, l’ONDPS, sur la base de travaux réalisés par les comités régionaux de cet observatoire. Il est désormais possible d’adapter la proposition des postes d’internes au plus près des besoins de prise en charge spécialisée.
Ainsi, monsieur le sénateur, en Rhône-Alpes, votre région, il est prévu que le nombre de postes ouverts en médecine générale serait croissant les prochaines années, pour atteindre un total de 1 940 internes à former entre 2010 et 2015.
Par ailleurs, la mise en place de la filière universitaire de médecine générale est une volonté forte du Gouvernement. Les efforts continuent à se porter sur l’orientation des étudiants et internes vers la médecine générale, et sur la valorisation de la filière universitaire de médecine générale.
Ainsi, la généralisation du stage de deuxième cycle de médecine générale permettra à chaque étudiant de découvrir la spécialité et, éventuellement, de s’y orienter ultérieurement. De plus, il est prévu d’offrir aux futurs internes, pour la période 2010-2014, plus de la moitié des postes en médecine générale, afin de favoriser des vocations dans cette spécialité.
Par ailleurs, l’article 47 de la loi HPST prévoit la montée en charge concrète de la filière universitaire de médecine générale en programmant chaque année, pendant quatre ans, la nomination de vingt professeurs, de trente maîtres de conférences et de cinquante chefs de clinique.
Enfin, l’article 46 de cette même loi a instauré un contrat d’engagement de service public, CESP, à destination des étudiants admis à poursuivre des études médicales à l’issue de la première année du premier cycle ou ultérieurement. Les étudiants bénéficiaires se verront verser une allocation mensuelle de 1 200 euros jusqu’à la fin de leurs études. En contrepartie, ces étudiants s’engagent à exercer leurs fonctions, à compter de la fin de leur formation, dans des lieux d’exercice spécifiques proposés dans des zones où la continuité des soins fait défaut pour une durée correspondant à celle du versement de l’allocation.
À ce jour, sept contrats ont été signés en région Rhône-Alpes sur les 34 postes ouverts, dont deux avec des internes en médecine générale. L’un d’entre eux est en dernière année d’étude et est donc sur le point de s’installer.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d'État.
Étant également de Rhône-Alpes, vous savez que la région ne se limite pas à l’axe Lyon-Grenoble, qui attire davantage les étudiants. Les parties drômoise et ardéchoise, plus éloignées, posent des problèmes !
Madame la secrétaire d'État, permettez-moi de profiter de votre présence pour, au-delà des médecins généralistes, vous faire part de nos inquiétudes sur ce secteur.
En effet, nos hôpitaux ruraux rencontrent de nombreux problèmes. Je citerai, de tête, ceux de Nions, Buis-les-Baronnies, Dieulefit et Die. Mais des problèmes se posent également à la maternité à Valréas. Voilà pourquoi je tenais à attirer votre attention.

La parole est à Mme Odette Terrade, auteur de la question n° 1225, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question concerne votre décision de fermeture du centre de chirurgie cardiaque du centre hospitalier universitaire Henri-Mondor, unique service de ce type de tout l’est francilien.
Dans le cadre du plan stratégique de l’AP-HP, l’agence régionale de santé d’Île-de-France confirmait en janvier dernier, alors qu’aucune concertation n’avait été menée avec les élus locaux et le monde hospitalier, la fermeture du service de cardiochirurgie d’Henri-Mondor, afin de transférer ses activités vers l’hôpital de la Salpêtrière à Paris.
Cette décision inique va à l’encontre d’une organisation cohérente du territoire. Elle est inconcevable tant en ce qui concerne la prise en charge des patients que les conditions de travail du personnel ou d’enseignement des étudiants et chercheurs.
Faut-il rappeler la qualité de ce service de pointe, à la renommée internationale, également service de proximité de la banlieue sud, assurant les urgences cardiologiques vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour un bassin de population de 1 800 000 habitants ?
C’est donc l’accès à la santé et la vie de nos concitoyens que vous mettez en jeu avec cette décision de fermeture. En effet, vous le savez bien, plus on éloigne les lieux de soins des lieux d’habitation, plus on multiplie les risques pour les patients.
La mobilisation commune et déterminée des élus et de la population le montre bien, cette décision est contraire au simple bon sens, dans le cadre d’une politique d’accès à la santé égal pour tous.
Puisque l’hôpital public est aujourd’hui ausculté sous le seul angle comptable, sachez que ce service de chirurgie cardiaque contribue à l’activité de tout l’hôpital Henri-Mondor. Avec 600 opérations et plus de 3, 6 millions d’euros d’excédents par an, c’est un service rentable et bénéficiaire qui assure plus de 20 % des recettes de cet établissement et, par là même, son équilibre financier.
Enfin, je tiens à signaler que le CHU Henri-Mondor, indissociable de l’image d’excellence hospitalière du département du Val-de-Marne, est l’objet de plusieurs projets, notamment dans le cadre du contrat État-région.
Ainsi, alors que l’État et la région d’Île-de-France s’associent et investissent pour que l’hôpital Henri-Mondor devienne un campus incontournable dans l’enseignement supérieur et la recherche aux niveaux national et européen, aucun argument autre que politique ne justifie l’annonce de cette fermeture.
Une telle décision est même contraire à la notion de Grand Paris, destinée à rééquilibrer l’offre de services publics entre Paris et sa banlieue.
Maintenir la programmation de cette fermeture reviendrait à cautionner une organisation territoriale de la santé bénéficiant aux seuls hôpitaux parisiens, au détriment de ceux qui sont implantés en banlieue.
Élue d’un département francilien de première couronne, je m’insurge contre le manque de concertation et l’absence de dialogue avec l’ARS et l’AP-HP. Je refuse que l’on vide la banlieue de ses forces vives, de ses équipements de pointe et de ses réussites humaines et scientifiques.
Par vos décisions, vous ne défendez pas le droit légitime de nos concitoyens à un service public de santé de qualité et vous ne respectez pas les promesses faites aux élus lors de la conférence de territoire et concernant le maintien du plateau chirurgical de cardiologie sur le site Henri-Mondor.
Plutôt que d’opposer les services, n’y a-t-il pas lieu de rechercher des coopérations ?
Madame la secrétaire d’État, avec les 20 000 Val-de-Marnais et professionnels de santé qui ont déjà signé une pétition contre cette fermeture, je vous demande de revenir sur votre décision de supprimer le service de chirurgie cardiaque du CHU Henri-Mondor et d’engager le plus rapidement possible la concertation avec les différents partenaires, afin de travailler à une restructuration qui soit guidée non pas uniquement par la recherche systématique de la rentabilité financière, mais bien par l’amélioration de l’offre de soins.
Madame la sénatrice, la région d’Île-de-France compte actuellement quatorze sites autorisés à pratiquer la chirurgie cardiaque adulte et trois sites consacrés à la chirurgie cardiaque infantile. Le schéma régional d’organisation des soins prévoit de réduire le nombre de sites, qui passerait de quatorze à dix.
Il s’agit en effet de doter la région d’Île-de-France de centres de tailles plus significatives qu’aujourd’hui, par le regroupement de cette activité dans un nombre plus restreint de centres.
C’est dans ce contexte que l’ARS prévoit la fermeture de certains sites de chirurgie cardiaque et qu’il a été demandé à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris de réduire le nombre d’implantations de tels services.
Le regroupement de la chirurgie cardiaque doit permettre à l’AP-HP de figurer aux premières places des comparaisons internationales, dans un contexte où les centres de chirurgie cardiaque britanniques ou allemands, notamment, présentent des niveaux d’activité très nettement supérieurs à ceux de chacun des sites de l’AP-HP.
Vous avez raison, madame la sénatrice, il est nécessaire que l’AP-HP engage sans délai une réflexion sur l’organisation que pourraient mettre en place, conjointement, les équipes de l’hôpital Henri-Mondor et celles d’autres centres, éventuellement dans le cadre de coopérations, pour l’organisation des soins, le renforcement des activités de recherche et le maintien des capacités d’enseignement.
Cette réflexion doit concerner non seulement la chirurgie cardiaque générale, mais également, et plus spécifiquement, les modalités de prise en charge des patients susceptibles de bénéficier de techniques peu invasives pour la pose de valves cardiaques.
Compte tenu des enjeux d’articulation entre les facultés de médecine et les territoires, il est essentiel – je vous rejoins sur ce point – que cette réorganisation puisse se faire de manière concertée.
Le ministère a demandé à l’ARS d’être particulièrement attentive aux impacts hospitalo-universitaires que ce projet pourrait avoir, notamment sur la stratégie de l’hôpital Henri-Mondor, et plus particulièrement sur sa collaboration avec le centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Madame la secrétaire d’État, j’ai bien entendu vos remarques. Si des évolutions sont nécessaires, ce que personne ne conteste, il faut toutefois revoir la décision de fermeture du service de chirurgie cardiaque à l’hôpital Henri-Mondor. Certaines évolutions techniques, il est vrai, permettent des opérations moins invasives que par le passé, qui nécessitent donc moins de matériels.
Comprenez-le, cet établissement est essentiel, car il ne concerne pas uniquement le Val-de-Marne, mon collègue de l’Essonne vous en parlera tout à l’heure. C’est en fait toute la banlieue sud qui est concernée. Nous le savons bien, la population et les personnels de santé se mobilisent également contre le projet impliquant l’hôpital Albert-Chenevier, à propos duquel il est question d’opérations immobilières.
C’est la raison pour laquelle nous souhaitons que toute l’attention soit apportée à cette situation, en vue du maintien, à terme, de ces services. Les nécessaires restructurations ne doivent pas toujours se faire au détriment de la banlieue. C’est la situation de l’ensemble de la région parisienne, et notamment de Paris, qu’il convient d’examiner !

La parole est à M. Bernard Vera, auteur de la question n° 1280, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, les hôpitaux de mon département traversent une crise profonde. L’année dernière, j’interrogeais la ministre de la santé, Mme Bachelot-Narquin, sur la situation de l’hôpital de Juvisy-sur-Orge et les risques de fermeture pesant sur ses services de chirurgie, sa maternité et son centre IVG.
Aujourd’hui, ces services ont fermé, comme le seront demain d’autres services. En effet, l’agence régionale de santé, l’ARS, impose la fusion de services hospitaliers à Évry-Corbeil, Dourdan-Étampes et Orsay-Longjumeau. De plus, elle prévoit de fermer, à la fin de l’année 2011, l’hôpital Georges-Clemenceau à Champcueil et l’hôpital Joffre-Dupuytren à Draveil.
La décision de l’ARS de fermer les urgences des hôpitaux de proximité de dix-huit heures trente à huit heures du matin pour les concentrer sur un seul site, celui du futur hôpital sud-francilien à Évry-Corbeil, est tout aussi inquiétante. Deux hôpitaux assureront les urgences chirurgicales la nuit, au lieu de cinq actuellement. Les Essonniens seront confrontés à une réduction sans précédent de l’offre publique de soins, cette politique de restructurations hospitalières, de fermetures de lits et de suppressions d’emplois étant en réalité une politique de réduction du service public hospitalier propre à restreindre toujours davantage l’accès aux soins.
Deux solutions s’imposeront alors aux patients : soit retarder cet accès aux soins, voire y renoncer, ce qui est une catastrophe en termes de santé publique, soit se tourner vers des établissements de santé privés, ce que tous ne pourront pas faire en raison du coût que représente un tel choix.
La politique de fermeture de services hospitaliers répondant au seul objectif de réduction de la dépense publique est de nature à accentuer le déséquilibre sanitaire, social et territorial de l’offre publique de soins, si on la rapporte aux besoins croissants des populations.
De plus, une telle logique rompt avec le principe de subsidiarité, selon lequel la continuité des soins s’organise à partir d’un maillage hospitalier adapté aux pathologies. L’exemple de l’hôpital Georges-Clemenceau à Champcueil est édifiant à ce propos. Avec sa fermeture, à laquelle il faut ajouter la perte de 230 lits à la suite de la fermeture de l’hôpital Joffre-Dupuytren à Draveil, c’est l’offre de soins dans le domaine de la gériatrie qui est ici menacée. C’est aussi le démantèlement de l’AP-HP, à laquelle sont rattachés ces deux établissements, qui est visé, et notamment la faculté d’une telle structure à développer de nouvelles avancées scientifiques et médicales.
Pourtant, la question de la dépendance liée au grand âge est au cœur des débats. À l’horizon 2040, la proportion de personnes concernées devrait augmenter de 1, 5 % par an. Alors que l’Essonne connaîtra une croissance exponentielle, la plus forte d’Île-de-France, de sa population âgée de plus de quatre-vingts ans, la décision de fragiliser l’offre de soins en gériatrie est inacceptable.
Madame la secrétaire d’État, la politique comptable revendiquée dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ne peut tenir lieu de politique de santé publique.
Un an s’est écoulé depuis l’entrée en vigueur de cette loi. Il est aujourd’hui urgent d’apprécier ses répercussions sur le terrain. Je vous demande par conséquent d’engager un moratoire concernant les fermetures d’hôpitaux. Je pense à l’hôpital Georges-Clemenceau à Champcueil, ainsi qu’à différents services implantés dans le département de l’Essonne.
Monsieur Vera, vous le savez, la réorganisation et la restructuration de l’offre de soins sur l’ensemble du territoire national représentent un objectif affiché et assumé du Gouvernement.
Les agences régionales de santé, créées par la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, ont pour mission d’opérer cette réorganisation globale, région par région, dans le cadre des schémas régionaux de l’offre de soins.
Concernant le cas spécifique que vous évoquez, il est exact que des réflexions sont actuellement menées sur l’éventuelle réorganisation des activités du groupe hospitalier Mondor-Chenevier-Dupuytren-Clemenceau.
Contrairement aux informations erronées qui ont pu circuler, il n’est pas prévu de fermer l’hôpital Georges-Clemenceau à la fin de cette année. La destination de cet établissement, dont l’activité est très majoritairement orientée vers la prise en charge de patients résidant dans le département de l’Essonne, n’est donc pas remise en cause.
En tout état de cause, si des restructurations devaient être opérées, elles ne se feraient pas sans une concertation préalable avec l’ensemble des acteurs, laquelle serait conduite par l’agence régionale de santé, dans le cadre du projet régional de santé.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. Toutefois, mes inquiétudes sont loin d’être apaisées.
Lorsque l’on regarde une carte de l’Essonne et de ses hôpitaux publics, on constate que tous sont menacés, ici par des fermetures pures et simples, là par des suppressions de lits ou de services.
C’est pourquoi les mobilisations des personnels et les inquiétudes des patients sont grandissantes, au niveau du département comme de la région.
Nous avons d’ailleurs pu le constater samedi dernier, lors de la manifestation destinée à défendre notre santé, l’accès aux soins et nos hôpitaux publics. C’est également dans ce contexte que vont être organisées les Assises régionales de la santé, regroupant des professionnels, des usagers, des organisations syndicales et des élus. Leurs exigences en termes de santé publique seront ainsi rappelées, ainsi que leurs propositions pour améliorer le service public de santé.
Animé par le souci de la démocratie sanitaire, madame la secrétaire d’État, je souhaite l’instauration d’un moratoire, à la fois sur les fusions, comme à Étampes-Dourdan, les fermetures, comme à Champcueil, bien que vous nous ayez indiqué que celle-ci n’aurait pas lieu cette année, et les partenariats public-privé, lesquels – je pense notamment au centre hospitalier sud-francilien – coûteront au final plusieurs milliards d’euros à l’État.
J’espère, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement saura entendre ces revendications.

La parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la question n° 1170, transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le secrétaire d’État, la Française des Jeux a confié à une grande entreprise, en l’occurrence Sagem Sécurité, filiale du groupe Safran, le marché du renouvellement de ses terminaux.
La Française des Jeux est détenue à 72 % par l’État ; le Gouvernement ne peut donc rester indifférent à son activité et aux décisions d’ordre économique qui y sont prises.
Au début de l’année 2014, le parc de 40 000 terminaux de jeux présents chez les buralistes va être renouvelé. Or il est quasi avéré que la production de ces machines a été confiée par ladite entreprise à des sociétés chinoises. Cette fabrication va être étalée sur deux ans à compter de janvier 2012. Jusqu’à présent, les pièces y afférentes étaient construites sur notre territoire, plus particulièrement dans le département de la Seine-Maritime.
Ainsi, voilà une décennie, lors de la mise en place du précédent parc de terminaux, l’usinage, la tôlerie, la plasturgie, le traitement de surface, le montage et d’autres activités avaient été assurés par des PME françaises.
Ce sont près de 10 millions d’heures de travail par an réparties dans une quarantaine d’entreprises de la Seine-Maritime qui risquent ainsi d’être perdues.
Des agglomérations, par exemple celles de Rouen et de Dieppe, vont être impactées économiquement. De ce fait, des emplois y sont menacés. On sait qu’un premier lot de prototypes va être livré à la Française des Jeux en juin 2011. Celle-ci devra en examiner la fiabilité.
Monsieur le secrétaire d'État, au regard de l’implication de l’État dans la Française des Jeux, pouvez-vous garantir que le panel de fournisseurs qui seront en définitive choisis sera composé exclusivement d’entreprises françaises ?
De plus, puis-je avoir l’assurance que l’appellation made in France ne sera pas détournée ?
Monsieur le sénateur, au préalable, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de François Baroin, lequel m’a demandé de vous apporter les éléments de réponse suivants.
Vous m’interrogez sur un marché confié par la Française des Jeux à une entreprise du CAC 40.
Le renouvellement des terminaux de jeux de la Française des Jeux installés chez les buralistes suscite de nombreuses interrogations de la part des élus de la Seine-Maritime. Cela fait en effet plusieurs semaines que le Gouvernement est régulièrement interrogé à ce sujet.
S’agissant d’un monopole de l’État, ce sont des interrogations légitimes et je veux vous apporter quelques éclairages.
Je souhaite toutefois vous rappeler que nous parlons d’un contrat commercial conclu entre la Française des Jeux et un groupe industriel français, Safran. Ce contrat doit être protégé par le secret des affaires. Ainsi, le détail des modalités de fabrication tout comme les éléments commerciaux de ce contrat ne peuvent être divulgués sans mettre en difficulté l’entreprise en question, c’est-à-dire sans profiter indûment à ses concurrents.
Il n’en demeure pas moins, monsieur le sénateur, que l’État, principal actionnaire de la Française des Jeux, demeure attentif à la stratégie industrielle de celle-ci.
D’ailleurs, plusieurs éléments de nature à rassurer les élus des territoires concernés peuvent être rappelés.
D’une part, la chaîne de fabrication des terminaux est installée près de Rouen, précisément à Saint-Étienne-du-Rouvray, et elle le restera.
D’autre part, la maintenance des terminaux sera réalisée pendant la durée du contrat, soit neuf ans, au même endroit.
L’emploi local sera donc préservé, comme cela a d’ailleurs été précisé à plusieurs reprises, aussi bien par le Gouvernement que par la direction de la Française des Jeux.
Nous sommes, croyons-nous sincèrement, victimes d’une rumeur qui est née à partir de chiffres faux. J’en veux pour exemple le volume d’heures de travail nécessaire à la production et à la maintenance des terminaux de jeux de la Française des Jeux, qui est sans rapport avec celui qui a été avancé, à savoir 10 millions d’heures.

« Rumeur, rumeur », dites-vous, monsieur le secrétaire d'État… Il n’y a pas de fumée sans feu, dit-on.
J’ai ici un courrier de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises patrimoniales. Cela démontre bien que, outre certains salariés et élus, ce sont bien sûr l’ensemble des PME et des PMI qui se posent des questions.
Vos propos, dans votre réponse, se sont voulus rassurants. J’ose espérer que la réalité, sur le terrain, sera bien celle du maintien de ces terminaux et de ces emplois au cours des neuf prochaines années. En tout état de cause, je ne manquerai pas de m’en assurer.
Par ailleurs, je comprends bien la nécessité de préserver le secret des affaires, mais, monsieur le secrétaire d'État, je le rappelle, l’État détient 72 % du capital de la Française des Jeux. C’est pourquoi je vous demande, une nouvelle fois, de veiller à ce que l’appellation made in France ne soit pas détournée et à ce que ces marchés restent en France, de manière que le département de la Seine-Maritime conserve ces centaines de milliers d’heures de travail.

La parole est à Mme Nicole Bricq, auteur de la question n° 1220, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

En réponse à la vive émotion suscitée par l’octroi des permis de recherche d’hydrocarbures de schiste, Mme la ministre de l’écologie a annoncé, le 4 février dernier, la mise en place d’une mission pour évaluer les enjeux environnementaux et sanitaires liés aux gaz et huiles de schiste. Le rapport d’étape devrait être connu dans quelques jours.
Mon département, la Seine-et-Marne, est particulièrement concerné par cette nouvelle activité. De nombreux permis – plus de trente – ont été déposés, notamment le « permis de Château-Thierry », qui autorise l’exploration aux alentours de Doue et de Jouarre sur une superficie de 779 kilomètres carrés. Ce permis a été accordé le 4 septembre 2009 à la société Toreador, une société française cotée au New York Stock Exchange. Elle s’est associée avec Hess, une société nord-américaine, pour explorer et exploiter l’huile présente dans les roches.
Cette société annonce et espère des perspectives d’exploitation de l’ordre de 90 millions de barils, avec de substantiels profits à la clé, comme c’est le cas aux États-Unis, où Exxon espère que, d’ici à 2030, la moitié de la demande portera sur les ressources en schiste.
On comprend donc que les réserves subodorées en Île-de-France notamment aiguisent les appétits.
La prévention des risques environnementaux induits par cette technique particulière d’exploitation, le souci de préservation de nos espaces naturels ainsi que de l’agriculture et du tourisme, qui sont deux leviers économiques essentiels dans le département de la Seine-et-Marne, sont légitimes. Ils soulèvent la question du soutien fourni à l’activité de forage, notamment les incitations fiscales.
Il convient donc de connaître la position exacte du Gouvernement. En effet, la loi de finances pour 2011 a modifié le dispositif relatif à la détermination des bénéfices imposables de ces sociétés de recherche et d’exploitation prévu à l’article 39 ter du code général des impôts. L’Assemblée nationale avait supprimé cet article, avec l’avis favorable du ministre du budget. Or, au Sénat, nos collègues de la majorité ont défendu son rétablissement. Finalement, la commission mixte paritaire a décidé de maintenir l’article 39 ter, mais en excluant de son bénéfice les exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
À l’époque, alors même que la chasse aux niches fiscales était déclarée, cette gymnastique parlementaire n’avait pas manqué de m’étonner.
La position de la ministre de l’environnement face à la montée des protestations, le changement d’attitude, d’une chambre à l’autre, du Gouvernement, tout cela n’est pas de nature à lever l’ambiguïté sur les intentions réelles de celui-ci. Si le bénéfice du dispositif fiscal était prolongé par le Gouvernement lors d’un prochain exercice budgétaire, la mission diligentée par Mme la ministre de l’écologie n’aurait été qu’un leurre.
Monsieur le secrétaire d'État, qu’en est-il réellement de la position du Gouvernement ? Est-il favorable à la suppression définitive de la disposition fiscale destinée à favoriser le développement d’exploitations aujourd’hui contestées ? Prendra-t-il l’initiative, lors d’une prochaine loi de finances, d’abroger cet article 39 ter du code général des impôts ?
Madame la sénatrice, vous m’interrogez sur l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz de schiste en France.
La France étant importatrice d’hydrocarbures malgré ses lourds investissements dans les énergies renouvelables, gaz et huiles de schiste présentent un potentiel économique important et une opportunité de réduire notre dépendance énergétique.
Toutefois, compte tenu des préoccupations environnementales importantes que suscite ce sujet complexe, la ministre de l’écologie et du développement durable et le ministre de l’industrie et de l’énergie ont décidé de confier une mission, d’une part, au Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies, le CGIET, d’autre part, au Conseil général de l’environnement et du développement durable, le CGEDD, afin d’éclairer le Gouvernement sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux des gaz et huiles de schiste.
Un rapport d’étape doit être remis le 15 avril 2011, tandis que le rapport final le sera le 31 mai 2011. Les rapports seront rendus publics et les conclusions en seront tirées avant la fin du mois de juin 2011.
Sur le plan fiscal, les dispositions de l’article 39 ter du code général des impôts dont bénéficiaient les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuaient la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer ont été supprimées, pour l’avenir, par l’article 18 de la loi de finances pour 2011, c’est-à-dire pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
Madame la sénatrice, je vous rappelle que ce dispositif permettait aux entreprises concernées de déduire de leur bénéfice net d’exploitation une provision pour reconstitution des gisements d’hydrocarbures dans la limite de certains plafonds.
Le Gouvernement, après s’être montré favorable à cette suppression lors des débats devant l’Assemblée nationale, s’en est effectivement remis par la suite à la sagesse de la Haute Assemblée. En effet, tout en estimant que le dispositif présentait un coût non négligeable pour un intérêt très limité, il ne souhaitait pas non plus qu’une telle suppression aboutisse à fragiliser les quelques entreprises de taille modeste du secteur.
Il faut en effet comprendre que la première version du texte consistait à abroger purement et simplement la provision.
Toutefois, cette abrogation créait un flou juridique dès lors que le texte ne prévoyait pas le sort des provisions antérieurement dotées et non encore reprises à la date de l’abrogation. Ces provisions devaient-elles être utilisées et reprises dans les conditions prévues par le dispositif antérieur ou bien, au contraire, devaient-elles être intégralement reprises à la date de l’abrogation du dispositif ? C’est ce qui explique ce revirement de position.
C’est la raison pour laquelle le Sénat a choisi de rétablir l’article 39 ter précité, laissant expressément à la commission mixte paritaire le soin de trouver, comme l’a dit le président de la commission des finances au cours de la séance du 19 novembre 2010, un « mécanisme de transition ».
Ainsi, en commission mixte paritaire, la provision pour reconstitution de gisements d’hydrocarbures a été définitivement supprimée pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2010. Cette rédaction vise simplement à maintenir les règles jusqu’alors applicables pour les entreprises ayant constitué une telle provision au cours d’un exercice clos avant le 31 décembre 2010.
Cette rédaction garantit la sécurité juridique des entreprises ayant bénéficié de la mesure, sans pour autant la maintenir.

Mme Nicole Bricq. Pour ma part, je n’ai pas été « sage » au cours de cette séance de nuit du 19 novembre, séance à laquelle vous étiez d’ailleurs présent, monsieur le secrétaire d'État.
M. le secrétaire d’État acquiesce.

En ce qui me concerne, je suis favorable à l’abrogation définitive de l’article 39 ter du code général des impôts. Je note d’ailleurs, monsieur le secrétaire d'État, que vous avez repris en partie les arguments qui sont généralement avancés pour justifier son maintien.
Premièrement, c’est certes une niche, mais elle est peu coûteuse, environ 15 millions d’euros par an. Une société en bénéficiait, en l’occurrence Vermilion.
Je répondrai que cette niche fiscale étant assise sur le volume des ventes des produits d’exploitation, son importance ne fera que croître à l’avenir puisque les modèles économiques prévoient une explosion de leurs ventes.
Deuxièmement, monsieur le secrétaire d'État, vous avez avancé un argument juridique.
Toujours est-il qu’il est parfaitement possible de disposer dans la seconde partie d’une loi de finances que telle ou telle disposition ne prendra effet qu’à compter d’une certaine date, en l’occurrence en 2012 ou en 2013.
Le Gouvernement n’a pas choisi cette voie et argué du fait qu’il ne fallait pas fragiliser une entreprise de taille modeste, en l’occurrence la société Vermilion. Je vous signale tout de même que l’entreprise Toreador, après avoir rapatrié tous les actifs qu’elle détenait en Turquie et en Hongrie, a vu sa capitalisation boursière multipliée par dix !
Il y a donc bien un modèle économique et financier dont il faut tenir compte : voilà pourquoi le lobbying ne s’est pas arrêté à 2010 ou à 2011 et reprendra par la suite. On verra bien ce que décidera le Gouvernement, mais sachez que la mobilisation ne faiblira pas. Au-delà des problèmes environnementaux et sanitaires, pour lesquels on attend les conclusions de la mission, n’oublions donc pas le poids du modèle économique, et surtout financier.

La parole est à M. Robert Laufoaulu, auteur de la question n° 1208, adressée à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.

Monsieur le ministre, ma question porte sur la situation du service bancaire à Wallis-et-Futuna, et plus particulièrement à Futuna.
Unique banque présente sur le territoire, la banque de Wallis-et-Futuna, ou BWF, filiale de BNP-Paribas, ne dispose que d’une seule agence, située à Wallis, avec un seul distributeur automatique de billets.
Cet état de fait est déjà difficile à gérer pour les Wallisiens, qui font longtemps la queue au guichet. Rappelons aussi que la BWF, profitant de sa situation de monopole, n’effectue que les opérations courantes et des prêts à la consommation à des taux prohibitifs.
Pour les 4 000 habitants de Futuna, île distante de Wallis de 280 kilomètres, la situation est insupportable : deux agents de la BWF ne s’y rendent qu’une seule fois par mois pendant deux ou trois jours consécutifs, au cours desquels ils assurent les opérations de guichet et quelques conseils commerciaux pour le millier de comptes existant ; l’accueil y est effectué dans un espace loué, qui ne respecte ni la confidentialité ni la sécurité des clients.
La BWF, arguant de la rentabilité pour refuser d’installer un distributeur automatique et un comptoir digne de ce nom à Futuna, souhaite l’assistance des agents publics. Je tiens toutefois à dire ici que la BWF a dégagé un résultat de 123 millions de francs Pacifique en 2008 et de 78 millions en 2009, alors que le coût estimé d’un distributeur automatique à Futuna, y compris le personnel à mettre en place, n’est que de 12 millions de francs Pacifique.
Je voudrais aussi établir une comparaison avec les autres collectivités françaises du Pacifique : en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, on trouve une offre bancaire concurrentielle et 353 guichets automatiques ; de plus, l’Office des postes et télécommunications de ces deux territoires y exerce une activité de services financiers.
La situation bancaire de Wallis-et-Futuna est dramatique et dure depuis des années. Nous ne pouvons plus continuer à crier dans le désert.
Monsieur le ministre, seules l’intervention et la médiation de l’État sont susceptibles de permettre une résolution du problème, et le préfet a d’ores et déjà attiré l’attention du Gouvernement sur le sujet.
Je demande donc instamment au Gouvernement de s’impliquer sérieusement dans ce dossier afin qu’une solution soit trouvée. Il pourrait solliciter BWF, filiale, je le répète, de BNP-Paribas, banque qui a bénéficié du soutien de l’État il n’y a pas si longtemps, ou, mieux encore, mettre à contribution les services de l’État pour que les habitants de Futuna ne soient plus traités avec un tel mépris. Je le rappelle, par dérogation à la métropole, le Trésor public est en droit, à Wallis-et-Futuna, d’exercer une activité bancaire pour les particuliers, ce qu’il fait seulement actuellement avec les dépôts à vue.
Monsieur Laufoaulu, je vous prie tout d’abord d’excuser Mme Christine Lagarde, qui, ne pouvant être présente ce matin, m’a chargé de répondre à votre interpellation bien légitime.
L’État, conscient de la situation très spécifique de Wallis-et-Futuna en ce qui concerne les services bancaires, a décidé, en 2002, d’y maintenir la possibilité, pour le Trésor public, de continuer à gérer des comptes de dépôts pour les particuliers, alors que, vous le savez, cette possibilité a été supprimée partout ailleurs sur le territoire de la République.
Ainsi, aujourd’hui, la banque de Wallis-et-Futuna et le payeur apportent-ils des services bancaires.
En août dernier, Mme Lagarde a demandé au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, d’ouvrir une concertation avec les partenaires financiers qui y exercent une activité.
Cette concertation n’a pas permis, à ce stade, de trouver un accord, en raison d’une faible bancarisation des habitants de Futuna. Dans un rapport, l’Institut d’émission d’outre-mer indique une baisse de 4 % du nombre de porteurs de cartes bancaires en 2009 et constate que le nombre de cartes en circulation n’a cessé de diminuer depuis 2004.
Malgré tout, Mme Lagarde soutient le souhait des habitants de Futuna de pouvoir accéder aux services bancaires dans des conditions satisfaisantes. Il ressort de la concertation menée par l’administrateur supérieur qu’un partenariat entre les services du payeur et la banque de Wallis-et-Futuna pourrait permettre l’installation d’un distributeur automatique de billets à Futuna.
Aussi, Mme Lagarde a demandé à M. Baroin de faire étudier par la Direction générale des finances publiques les modalités d’un partenariat exceptionnel envisageable entre la régie de Futuna et la Banque de Wallis-et-Futuna.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement est et restera attentif à ce qu’une solution pratique, pragmatique et acceptable pour tous les acteurs puisse être trouvée.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions et salue l’implication du Gouvernement. Je répercuterai vos propos auprès de la population de Futuna, qui sera certainement très satisfaite des perspectives envisagées, car le fait de disposer au moins d’un distributeur automatique de billets sur Futuna arrangerait déjà beaucoup la situation.

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 1215, adressée à M. le ministre de la ville.

Monsieur le ministre, l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances, l’ACSE, a revu, à la fin du mois de décembre 2010, les modalités de répartition des crédits d’intervention de la politique de la ville entre les territoires.
Il semblerait que le principal critère retenu soit la part, dans chaque département, de la « population ZUS », autrement dit le nombre d’habitants en zones urbaines sensibles.
Or, les trois ZUS drômoises sont nettement sous-dimensionnées par rapport à d’autres. Ce sous-dimensionnement permet, comme à Romans-sur-Isère et à Montélimar, de cibler de petits quartiers très homogènes socialement, mais dont les indicateurs sociaux sont nettement plus préoccupants que ceux de la moyenne des ZUS en France.
S’il est confirmé que la population ZUS sert de critère à la réaffectation des crédits par l’ACSE, cela risque de pénaliser les quartiers homogènes dont la population est plus réduite.
Une telle orientation conduit à s’interroger sur plusieurs points.
Tout d’abord, si, comme l’indique le Livre vert présenté en mars 2009, une réforme de la géographie prioritaire s’impose, pourquoi s’appuyer sur une géographie à réformer pour prendre une décision ?
Ensuite, si la définition d’une règle doit permettre de sortir de l’attribution intuitive des crédits de la politique de la ville – point également souligné dans le Livre vert –, cette règle ne doit-elle pas être discutée devant la représentation nationale plutôt qu’au sein du conseil d’administration de l’ACSE ?
Au-delà, comment imagine-t-on à l’ACSE l’impact de réduction de crédits pouvant dépasser les 30 % sur certains territoires ? Qui doit être en capacité de se substituer aux financements étatiques ? Doit-on laisser les porteurs de projet, essentiellement des associations, faire leur affaire de réductions de recettes drastiques à leur échelle ?
Enfin, peut-on disposer d’un tableau de synthèse présentant, département par département et quartier par quartier, les évolutions des enveloppes affectées à la politique de la ville – relatives, pour l’essentiel, aux contrats urbains de cohésion sociale et aux dispositifs de réussite éducative – entre 2010 et 2011 ?
Monsieur le ministre, êtes-vous aujourd'hui en mesure de répondre à toutes ces questions, que de nombreux acteurs locaux de la politique de la ville se posent ?
Monsieur Piras, vous vous inquiétez des modifications que l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances a apportées aux modalités de répartition des crédits d’intervention de la politique de la ville entre les territoires.
Comme vous le soulignez, le Livre vert présenté en mars 2009 suggérait de revoir les critères de répartition territoriale des crédits de la politique de la ville.
Le Gouvernement a souhaité approfondir cette réflexion en 2011, de manière à dégager des hypothèses envisageables dans le cadre d’une future réforme de la géographie prioritaire. Il a voulu donner de la lisibilité et de la visibilité aux acteurs de terrain, au premier rang desquels figure l'ensemble du tissu associatif – auquel vous avez rendu un hommage tout à fait justifié –, en prolongeant les contrats urbains de cohésion sociale jusqu’en 2014. Il s’agit d’une décision importante prise très officiellement lors d’une réunion du Comité interministériel des villes présidée par le Premier ministre, François Fillon. Voilà qui mérite d’être souligné, car, comme tous les maires le savent, le système manquait jusqu’à présent de clarté.
Il n’en demeure pas moins qu’il a fallu, dans un contexte de nécessaire maîtrise des dépenses publiques, procéder à la répartition territoriale des crédits de la politique de la ville.
Cette répartition, qui n’anticipe en aucune manière la réforme de la géographie prioritaire, a été effectuée, sous le contrôle de son conseil d’administration, par l’ACSE, en utilisant des critères classiques et éprouvés, notamment l’importance de la population des quartiers, critère objectif et absolument incontestable utilisé sous tous les gouvernements qui se sont succédé dans notre pays au cours des vingt dernières années.
Par ailleurs, j’ai souhaité que l’ACSE privilégie l’utilisation des crédits sur les axes thématiques qui m’apparaissent comme prioritaires : l’éducation, l’emploi, le développement économique, la prévention de la délinquance et la santé. Je suis sûr que vous partagez ces priorités. De plus, j’ai demandé à l’Agence de veiller à une mobilisation maximale des moyens de droit commun, notamment là où les crédits de la politique de la ville ne doivent être qu’un complément.
J’ai souhaité qu’un effort particulier soit engagé en faveur des associations, afin, d’une part, de simplifier la procédure de demande de subventions et, d’autre part, de leur verser celles-ci beaucoup plus rapidement pour réduire de manière très sensible les frais financiers qu’elles supportent.
Je m’arrête un instant sur ce point car il est à mes yeux très important. Les crédits en question ont été votés à l’ACSE le 20 décembre dernier, puis, sur mon instruction, délégués très rapidement, en janvier, aux préfets de tous les départements concernés. J’ai demandé à ces derniers de les mettre à disposition au plus tôt, le dernier délai étant fixé à la fin du mois : ce sera d’ailleurs une première en France. Je considère en effet que les crédits de l’État ne doivent pas servir aux associations à payer à la banque les agios nés de la subvention de l’année n-1.
Monsieur Piras, comme vous le savez, il faut aussi resituer ces crédits dans le cadre des moyens que l’État consacre à la politique de la ville, qui ne se résument pas aux seuls crédits du programme budgétaire du même nom.
Ainsi, la dotation de solidarité urbaine a été augmentée de 6 % et la dotation de développement urbain maintenue à son niveau de 2010 : vous conviendrez aisément que, dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, c’est un effort substantiel, d’autant qu’il n’est trop souvent question que des crédits de l’ACSE. Or, je le dis sans esprit polémique, la dotation de solidarité urbaine permet également aux communes de financer le tissu associatif et les actions de la politique de la ville.

M. le président. La parole est à M. Bernard Piras, que la réponse de M. le ministre a dû convaincre !
Sourires.

M. Bernard Piras. Vous anticipez mes propos, monsieur le président ! Laissez-moi parler ! Après quoi, vous verrez si je suis convaincu !
Nouveaux sourires.

Pour l’instant, je note que des efforts sont faits pour instaurer le dialogue. Et je remercie M. le ministre pour la rapidité avec laquelle les crédits seront débloqués afin d’éviter aux associations de payer des agios.
Je voudrais, en revanche, vous sensibiliser sur un point, le critère « population ». Je ne conteste nullement la hiérarchie des priorités que vous établissez pour les actions que vous menez. Ces priorités, je les partage. Je veux simplement attirer votre attention sur le fait que le seul critère de la population ne me semble pas suffisant. Il y a des « poches » dans lesquelles la population est plus faible qu’ailleurs et où les problèmes se posent avec une acuité plus forte. Cet élément devrait, à mon sens, être pris en compte, en tout cas dans le cadre de la réforme que vous envisagez de mettre en place en 2011. Si je suis assez sensible à cet aspect et vous interpelle à son propos, c’est parce que ma commune s’est vue quelque peu spoliée sur un certain nombre de crédits.

La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 1175, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Monsieur le ministre, j’aimerais attirer votre attention sur les nouveaux barèmes horaires des forces de gendarmerie fixés par l’arrêté du ministère de l’intérieur en date du 28 octobre 2010.
De 2, 40 euros de l’heure, le taux horaire est passé à 12, 33 euros au 1er janvier 2011, soit plus de 400 % d’augmentation ! Le taux devrait augmenter chaque année début juillet pour atteindre environ 20 euros de l’heure en 2014.
L’explication donnée est la volonté d’harmoniser les barèmes des prestations de la gendarmerie nationale sur ceux de la police, d’autant que, depuis 2009, les gendarmes relèvent non plus du ministère de la défense mais du ministère de l’intérieur.
Une autre explication consiste à recentrer les forces de l’ordre sur leurs vrais métiers, qui consistent à assurer la sécurité, à lutter contre la délinquance et à inciter les organisateurs de manifestations à recourir davantage à des personnels bénévoles ou rémunérés. Nous pouvons nous accorder sur ces points sans pour autant méconnaître leurs incidences.
Ce nouvel état de fait risque d’avoir des conséquences très dommageables, allant jusqu’à mettre en cause la pérennité de manifestations sportives, culturelles ou festives qui ont lieu dans nos territoires.
Je vais citer deux exemples : d’abord, la Percée du Vin Jaune. Organisée dans mon département, le Jura, elle a lieu tous les premiers week-ends de février depuis plus de quatorze ans et rassemble 50 000 personnes. Cette année, 60 000 personnes se sont réunies en Arbois. Cet événement, qui est un immense succès populaire, a des retombées très importantes pour notre filière viticole jurassienne et pour le tourisme de la région. Mais cette année, il nous en a coûté une augmentation de 500 % pour la prestation de la gendarmerie. Elle est passée de 8 500 euros en 2010 à près de 30 000 euros en 2011. Or nous savons que les dépenses liées à la sécurité sanitaire ont également augmenté dans des proportions considérables.
Course de ski de fond internationalement connue, la Transjurassienne, qui réunit 4 400 participants et s’est tenue le deuxième week-end de février, a, elle aussi, subi cette très grosse augmentation.
Il est bien évident que de tels coûts compromettent, à terme, l’équilibre de telles manifestations, qui jouent pourtant un rôle déterminant pour l’image de notre région, la Franche-Comté. Elles mobilisent près d’un demi-millier de bénévoles. Il n’en demeure pas moins impératif de prévoir, dans certains domaines, la présence du gendarme, beaucoup plus dissuasive pour faire respecter la réglementation que celle d’un simple bénévole, même pourvu d’un signe distinctif.
J’aimerais donc attirer votre attention, monsieur le ministre, pour que nous recherchions et trouvions ensemble des solutions afin de permettre aux organisations en charge de ces manifestations de faire face à ces dépenses importantes pour leurs budgets.
Nous voudrions surtout savoir, sur le long terme, comment assurer l’avenir de telles manifestations. Je pense aussi à celles qui, pour être moins importantes, sont toutefois l’essence même de la vie de nos associations dans nos bourgs et petites villes, déjà fragilisées financièrement par le statu quo ou les baisses des subventions publiques et de sponsoring.
Monsieur le sénateur, permettez-moi d’excuser Claude Guéant, ministre de l’intérieur, qui ne pouvait être présent ce matin et me charge de vous répondre.
S’il est normal que l’État satisfasse, pour leur bon déroulement, aux obligations normales qui incombent à la puissance publique, il est tout aussi naturel que, lorsque l’intervention des forces de sécurité dépasse ces obligations, le coût ne soit pas exclusivement assumé par l’État et donc mis à la charge des contribuables.
Le ministre de l’intérieur a donc proposé un nouveau dispositif de tarification, qui a fait l’objet d’un décret en Conseil d’État du 28 octobre 2010, suivi d’un arrêté. Conformément aux règles de la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF, la ratification du décret a eu lieu par le projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Ainsi, pour ne pas remettre en cause les événements et les manifestations qui font la richesse de nos territoires, ce nouveau dispositif se fixe, quant à lui, deux objectifs.
Le premier objectif consiste à recentrer les forces de la police et de la gendarmerie sur leur priorité, qui est la lutte contre la délinquance. Pour cela, il convient de facturer aux organisateurs à un coût adapté au coût réel la mise à disposition de forces pour la partie non liée à l’ordre public, afin de les inciter à recourir de préférence à des personnels bénévoles ou rémunérés. Ainsi, le nouvel arrêté de tarification prévoit une réévaluation progressive étalée dans le temps.
Le deuxième objectif consiste, bien évidemment, à accompagner les manifestations. Cette réforme n’a pour vocation ni de faire gagner de l’agent à l’État ni de mettre en péril certaines manifestations. Nous veillerons tout particulièrement à une application équitable à l’ensemble des événements et organisateurs concernés.
Un dialogue a ainsi été engagé depuis plusieurs mois avec les organisateurs. Ces concertations ont déjà abouti à la signature de conventions-cadre entre le ministère de l’intérieur et, par exemple, les responsables nationaux des courses cyclistes, le 7 janvier 2011, ou la Fédération française du sport automobile et la Fédération française motocycliste, le 31 mars 2011.
Parmi les mesures, un principe de plafonnement à 15 % de l’augmentation de la facturation par rapport au coût réellement facturé l’année précédente a ainsi été instauré.
Par ailleurs, l’objectif de l’évolution vise à définir de façon plus précise pour chaque événement un diagnostic de sécurité concerté entre les représentants de l’État et les organisateurs de manifestations sportives ou culturelles.
Monsieur le sénateur, c’est précisément sur ce fondement qu’ont été engagées des concertations entre la préfète du Jura et les organisateurs des manifestations que vous avez citées : Percée du Vin Jaune et Transjurassienne. Après l’établissement d’un diagnostic de sécurité pour chacun de ces deux événements, la hausse de la facturation a été inférieure à 15 % par rapport à la facturation observée lors de l’édition précédente.
Si le Gouvernement veillera au respect de cette équité et continuera d’assumer toutes ses missions, il ne veut pas perdre de vue l’objectif essentiel, qui nous est commun, j’en suis sûr, et qui consiste à faire en sorte que les forces de l’ordre assurent le service attendu des citoyens : la sécurité et la tranquillité de tous.

Monsieur le ministre, la dernière partie de votre intervention va dans le bon sens, celui d’instaurer une discussion en prévision de ces événements. Je sais, monsieur le ministre, combien vous êtes attaché à un territoire et à un département que vous connaissez bien. Je vous sais très proche de tout le monde associatif et des collectivités qui organisent des manifestations. Comme l’ensemble du Gouvernement, vous ne souhaitez pas voir disparaître ces manifestations qui font l’essence même de la richesse de la vie dans nos bourgs et nos territoires.

On le sait bien, certaines actions ne peuvent être menées que par des policiers ou des gendarmes, principalement dans nos secteurs ruraux où leur présence est indispensable. Il ne faudrait pas que le coût vienne en quelque sorte à bout de ces manifestations ! Essence même de nos territoires ruraux, elles mobilisent déjà 500 bénévoles, qui s’emploient à les préparer pendant presque un an.
Certes, cette année, nous avons pu régler ces deux grandes manifestations. Mais ma crainte porte pour l’avenir. Et j’aimerais sensibiliser le Gouvernement à mon propos pour que soit pérennisée toute la richesse de ces manifestations organisées par nos associations.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.