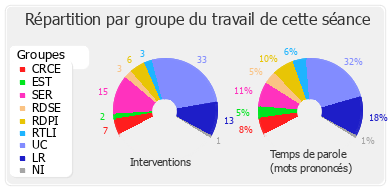Séance en hémicycle du 8 avril 2021 à 10h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Mise au point au sujet d'un vote (voir le dossier)
- Service public d'eau potable et d'assainissement en guadeloupe (voir le dossier)
- Adoption des conclusions d'une commission mixte paritaire sur une proposition de loi (voir le dossier)
- Rappels au règlement (voir le dossier)
- Réforme de la formation des élus locaux (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Mes chers collègues, j’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Gérard Claudel, qui fut sénateur du Val-d’Oise de mai à septembre 2004.

Lors du scrutin n° 105 sur l’amendement n° 237 rectifié bis, à l’article 25 du projet de loi confortant le respect des principes de la République, Mme Véronique Guillotin souhaitait voter pour.

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe (texte de la commission n° 471, rapport n° 470).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteure.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie au Sénat le mardi 23 mars est parvenue sans difficulté à un accord sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe.
J’ai déjà insisté dans cet hémicycle, voilà quelques semaines, sur l’utilité de ce texte. Nos concitoyens guadeloupéens connaissent d’inacceptables difficultés dans leur accès à une ressource aussi essentielle que l’eau potable. Il nous fallait donc agir avec célérité et efficacité : c’est l’ambition de cette proposition de loi.
Le texte retenu par la commission mixte paritaire est, pour l’essentiel, sous réserve de rares modifications rédactionnelles, celui qu’a élaboré et voté le Sénat lors de sa séance du 10 mars dernier. Cette proposition de loi, déposée, en des termes similaires, par la députée Justine Benin et notre collègue Dominique Théophile, a donc été utilement enrichie et complétée lors de son examen par notre assemblée. Je m’en félicite.
Dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, la proposition de loi posait d’ores et déjà le principe d’un syndicat mixte unique de gestion des services publics d’eau potable et d’assainissement de Guadeloupe et en prévoyait les principales modalités de fonctionnement. Les débats de l’Assemblée nationale avaient surtout été l’occasion de garantir la pleine association des usagers de ces services en prévoyant la création d’une commission de surveillance ad hoc, chargée d’émettre des avis sur l’exercice par le syndicat mixte unique de ses compétences.
L’examen par notre assemblée a été l’occasion, outre l’apport de modifications de nature rédactionnelle, de parfaire le fonctionnement de ce syndicat mixte unique.
En outre, il nous a semblé nécessaire de permettre à de nouveaux membres de rejoindre, s’ils le souhaitent, le syndicat mixte unique ainsi créé.
Encadrée par l’autorisation du préfet et l’accord unanime des membres, cette procédure permettra d’éviter, dans l’éventualité où un tel cas se présenterait, une nouvelle modification législative.
Par ailleurs, nous avons prévu de permettre au comité syndical de décider, à l’unanimité des membres, de déroger à la clé de répartition des contributions financières afin de prémunir le syndicat mixte d’une rigidité excessive dans ses décisions d’investissement.
L’examen du texte au Sénat a également été l’occasion de renforcer les attributions de la commission de surveillance, prévue à l’article 2 de la proposition de loi, et d’en modifier la composition. Le texte issu de la commission mixte paritaire conserve, en la matière, deux apports significatifs du Sénat : ainsi, nous avons souhaité assurer une meilleure représentation des élus municipaux au sein de la commission de surveillance et permettre à des personnalités qualifiées d’y siéger.
Dans le même esprit, nous avons prévu l’obligation d’une audition annuelle du président du comité syndical par la commission de surveillance.
Ces dispositions sont essentielles afin de restaurer la confiance des usagers, majoritaires au sein de la commission de surveillance, dans les services publics de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe.
Ainsi enrichie, la proposition de loi a recueilli le plein assentiment de nos collègues députés. Je souhaite ainsi les remercier pour l’esprit de consensus et d’efficacité dans lequel ils ont inscrit les travaux de notre commission mixte paritaire. Je salue tout particulièrement Justine Benin, signataire et rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, pour nos échanges constructifs. Je remercie également notre collègue Dominique Théophile pour son travail de sensibilisation, au sein de notre assemblée comme en dehors de cette enceinte, sur cette question.
Le texte adopté par la commission mixte paritaire apportant une réponse rapide et pragmatique à un problème qui n’a que trop duré, je vous invite, mes chers collègues, à approuver les conclusions de la commission mixte paritaire.
La satisfaction d’un travail législatif consensuel et de qualité n’équivaudra néanmoins pas à donner quitus au Gouvernement sur cette question.
Lors de la réunion de la commission mixte paritaire, j’ai eu l’occasion de rappeler que ce texte, bien qu’utilement enrichi, ne constituera qu’un premier pas dans la résolution d’une situation particulièrement complexe. Nous sommes parfaitement conscients qu’il ne suffira pas, à lui seul, ni à restaurer la confiance des Guadeloupéens dans leurs services publics ni à résoudre les problèmes qu’ils déplorent au quotidien. L’amélioration de l’accès à l’eau pour nos concitoyens guadeloupéens suppose en effet de mettre en œuvre d’autres mesures, qui ne relèvent pas du domaine législatif.
Le législateur a fait sa part ; il revient désormais à l’ensemble des acteurs de se saisir des outils ainsi mis à leur disposition. Je me tourne vers vous, monsieur le ministre : l’État doit se montrer à la hauteur du mécontentement des Guadeloupéens et des attentes générées par cette proposition de loi.
Ce texte ne dispensera pas le Gouvernement, qui dispose des moyens humains, techniques et financiers de l’État, d’agir rapidement et efficacement pour nos compatriotes guadeloupéens. Notre assemblée sera vigilante, monsieur le ministre, à ce que ce souhait, que je formule devant vous solennellement, ne demeure pas un vœu pieux.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, INDEP, RDSE et RDPI.

Monsieur le président, madame la rapporteure, madame la vice-présidente de la commission des lois, monsieur le sénateur Dominique Théophile, auteur de cette proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d’abord de vous adresser mes remerciements sincères pour le travail accompli en bonne intelligence bicamérale entre le Sénat et l’Assemblée nationale, comme vient de le souligner Mme la rapporteure, en bonne intelligence aussi entre le Parlement et le Gouvernement et plus encore entre Paris et Pointe-à-Pitre.
Au fond, le véritable sujet consistait à traiter d’une compétence véritablement décentralisée, celle de l’eau – je sais combien Françoise Gatel y est attachée –, …

… particulièrement symbolique de la décentralisation depuis des années.
Cette proposition de loi devait tout d’abord répondre à une problématique de service public : comment tolérer, en 2021, que 100 000 Français n’aient pas accès à l’eau potable ? Comment tolérer un défaut aussi majeur et ses conséquences environnementales, sanitaires et même économiques – notamment sur le tourisme ? Comment 65 % de l’eau produite en Guadeloupe peut-elle être perdue ? À la différence de Mayotte, il ne s’agit pas d’un problème de production, mais bien d’acheminement de l’eau potable. Il nous fallait répondre à cet enjeu, posé par la députée Benin et par le sénateur Théophile, de rétablir le service public sans pour autant abîmer la décentralisation.
Je vous ai écoutée avec attention, madame la rapporteure – de la Guadeloupe au Var, il n’y a parfois qu’un pas.
Sourires.

Toutefois, nous savons très bien qu’il ne s’agit pas que d’une question d’argent. Au fond, on demande à l’État de régler un problème relevant d’une compétence décentralisée sans abîmer la décentralisation. C’est une réflexion à mener dans le cadre du projet de loi « 4D », madame la présidente Gatel.

Parfois, la vie locale ne permet pas de résoudre les problèmes d’organisation d’une compétence – le ministre Lurel et le sénateur Théophile savent que je dis cela avec beaucoup de respect et de prudence, car il faut défendre les élus locaux et la démocratie représentative. On a pu assister en Guadeloupe à des phénomènes d’« élu-bashing » – en mauvais français – consistant à pointer du doigt les élus locaux et à les rendre responsables de tout. Ce serait bien trop facile ! Pour autant, il faut trouver le point d’équilibre.
L’État est-il présent en matière d’ingénierie ? Oui, il l’est depuis longtemps : en 2020, 4 000 fuites ont été réparées, pour 6 millions d’euros – derrière ces chiffres concrets, on trouve des foyers, des familles… Voilà l’action de l’État, en bonne intelligence. Des choses ont été faites sous Nicolas Sarkozy comme sous François Hollande et continuent d’être faites aujourd’hui. On constate une continuité de l’État dans sa volonté de régler cette affaire. Pour le coup, il ne faut pas jouer Paris contre Pointe-à-Pitre ou Pointe-à-Pitre contre Paris, cela ne ferait pas avancer le dossier.
Ce n’est pas qu’une affaire d’argent ; c’est aussi une question d’organisation du service public. Vous l’avez souligné, madame la rapporteure, et c’est aussi tout le sens de la proposition de loi de M. Théophile : dans un milieu archipélagique, et surtout insulaire – on s’est intéressé ici à la Guadeloupe, sans Marie-Galante –, il y a forcément besoin de solidarité entre production, acheminement, distribution et interconnexion des réseaux. Cela peut aussi interroger d’autres services publics, interdépendants entre eux.
Pour avancer, il nous fallait un acteur unique. Dès lors, deux possibilités s’offraient : soit un consensus local s’établissait et tout le monde se rassemblait au sein des commissions départementales de la coopération intercommunale (CDCI) – le fonctionnement en Guadeloupe est le même que dans l’Hexagone – ; soit nous n’arrivions pas à rassembler l’ensemble des intercommunalités, et notamment celle qui joue un rôle central dans l’organisation du service public d’eau potable en Guadeloupe, et il fallait alors se tourner vers le législateur.
J’ai parfois été un peu chagriné d’entendre que l’intervention du législateur revenait à remettre en cause la démocratie locale. Au contraire, quand le Sénat intervient, c’est pour organiser la vie locale. Peut-être suis-je juge et partie, mais la Haute Assemblée est légitime à légiférer dans ce sens en tant que chambre des élus locaux. Nous avons accompli quelque chose qui va dans le bon sens.
Le rôle de la gouvernance a été souligné dans beaucoup des amendements déposés au Sénat, lors de l’examen de ce texte. Les élus décident, certes – et c’est leur rôle –, mais les usagers du service public ont aussi besoin d’être entendus. Il fallait trouver un équilibre pour permettre aux usagers d’être entendus sans empiéter sur les prérogatives des élus. Le dispositif trouvé en commission mixte paritaire est parvenu à cet équilibre, ce qui nous permet de faire quelque chose d’assez nouveau en donnant la parole à tout le monde.
L’ingénierie est un sujet majeur. Certains de mes propos ont pu être caricaturés ou détournés – c’est peut-être le début de la campagne électorale sur le terrain qui veut cela… Nous devons nous mobiliser, avec les forces du territoire, avec les équipes sur place, pour répondre aux besoins de formation et pour se renforcer en ingénierie là où c’est nécessaire, ponctuellement ou durablement. Nous devrons nous accorder sur ces chantiers.
Je voudrais redire ici les engagements du Gouvernement, et donc de l’État, en ce qui concerne la dette et les ressources humaines : aucun agent du syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la Guadeloupe (Siaeag) ne devra être abandonné. Une solution sur mesure devra être trouvée sur cette question comme sur celle de la dette, EPCI par EPCI. Le ministre Lurel était revenu sur ce sujet lors de ses différentes interventions. Il s’agit bien évidemment d’un sujet majeur.
Une fois ce texte adopté au Sénat et à l’Assemblée nationale, le Président de la République promulguera rapidement cette loi pour une installation de ce syndicat unique dès septembre prochain. Une initiative locale intéressante, qui montre la mobilisation des élus locaux, existe aujourd’hui. Mais ce syndicat ne pourra fonctionner que si l’ensemble des intercommunalités se rassemblent. C’est le sens de cette proposition de loi.
Avec ce texte, la députée Benin et le sénateur Théophile, ainsi que l’ensemble des parlementaires qui ont travaillé sur cette question, nous ont donné l’occasion de faire un sérieux bond en avant dans l’organisation du service public de l’eau potable en Guadeloupe.
Merci au Sénat, au Parlement, d’avoir su prendre ses responsabilités. Je sais que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens nous attendaient collectivement sur ce sujet.
M. Dominique Théophile applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis qu’une solution très constructive soit issue de la commission mixte paritaire, qui s’est déroulée dans une très bonne entente.
Il fallait régler ce problème qui durait depuis trop longtemps. Pour autant, il ne faut pas enterrer l’affaire et croire que tout est réglé. Au contraire, cela doit nous faire réfléchir sur les dysfonctionnements dans la gestion quotidienne des collectivités induits par la décentralisation.
Très honnêtement, le Gouvernement, dont je ne suis pas un soutien, n’y est pour rien. Il a reçu un héritage de longue date, qui remonte au président Sarkozy, voire bien avant – et cela vaut aussi pour les problèmes sanitaires, de police ou de justice que nous connaissons aujourd’hui.
L’inaction du pouvoir central s’explique par la décentralisation. Les vrais responsables sont les élus locaux, ceux qui géraient le service de l’eau et de l’assainissement. De cette question, personne ne parle : on fait semblant de ne pas comprendre que nous n’en serions pas là si cette compétence avait été bien gérée !
La vraie leçon à tirer, c’est que la décentralisation est très positive, mais qu’elle suppose des responsables locaux parfaits. Or nous en sommes très loin dans certains endroits, en outre-mer comme en métropole.
J’ai connu la vie parlementaire avant 1982, donc avant les lois de décentralisation. Par le passé, les représentants du pouvoir central avaient un rôle plus fort. Je ne propose pas un retour en arrière, mais cela avait parfois un effet positif : on ne laissait pas filer les choses comme aujourd’hui, quand les élus locaux ne sont pas à la hauteur.
L’eau est un très bon exemple. Dans certaines communes, les nouvelles équipes municipales découvrent parfois des situations désastreuses. On en rencontre partout. Il s’agit parfois de petites communes, parfois de plus grandes… C’est un véritable problème.
Il faut non pas enterrer ce dossier, mais plutôt en tirer des leçons.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous le savons tous ici : depuis plusieurs années, la gouvernance de l’eau et de l’assainissement en Guadeloupe n’est pas à la hauteur des attentes de nos concitoyens guadeloupéens.
Ce sont ainsi près de 100 000 usagers qui sont régulièrement victimes de « tours d’eau », suscitant colère et exaspération.
Cette situation est d’autant plus difficile à accepter qu’elle ne résulte pas de causes naturelles propres à la Guadeloupe, où la ressource en eau est abondante. Un des principaux problèmes réside dans le caractère éclaté de la gestion des services d’eau et d’assainissement, qui fait obstacle à la gouvernance d’ensemble dont la Guadeloupe a besoin.
En outre, les syndicats compétents sont dans une situation difficile : la plupart d’entre eux ne peuvent ni effectuer les investissements nécessaires à l’entretien et à l’amélioration du réseau, ni entreprendre les travaux d’urgence, ni payer les fournisseurs.
Il apparaît donc crucial et urgent d’unifier la gouvernance de la gestion des services publics d’eau et d’assainissement en Guadeloupe, car nous ne pouvons pas laisser nos compatriotes souffrir davantage d’une telle indignité.
Aussi, cette proposition de loi, qui a été discutée et enrichie par nos deux assemblées, concourt à répondre à une situation inacceptable et persistante.
C’est pourquoi je me réjouis que la commission mixte paritaire se soit déroulée dans un esprit de recherche de complémentarité et de consensus et qu’elle ait abouti à un texte commun.
Je me félicite également de ce que le Sénat ait apporté de nombreuses modifications afin d’améliorer l’effectivité des dispositions de cette proposition de loi.
Le Sénat a ainsi enrichi l’article 1er d’un certain nombre d’assouplissements. Je veux parler de la possibilité pour une autre personne publique d’adhérer au syndicat mixte, après accord unanime de ses membres et accord exprès du représentant de l’État en Guadeloupe.
Je veux également évoquer la possibilité pour le comité syndical de déroger, après accord unanime de ses membres, à la répartition des contributions financières lorsqu’un projet d’investissement le nécessite.
Je veux enfin mentionner la possibilité, pour le syndicat mixte, d’étudier la faisabilité d’une tarification sociale de l’eau.
Concernant l’article 2, qui prévoit la constitution d’une commission de surveillance auprès du syndicat mixte, le Sénat a souhaité rationaliser la composition de celle-ci, notamment en prévoyant la présence de représentants des communes et de personnalités qualifiées et en supprimant la présence des parlementaires en son sein.
Il a, par ailleurs, prévu une audition annuelle et obligatoire du président du comité syndical par la commission de surveillance, de façon à favoriser la fluidité entre leurs travaux.
Avant de conclure, je tiens à saluer la qualité des travaux de notre collègue Françoise Dumont, qui a œuvré de façon constructive pour élaborer un texte commun si important pour la Guadeloupe.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi constitue une étape importante vers la résolution d’une situation complexe et inacceptable pour les Guadeloupéens.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte, lequel apportera une première réponse concrète et pragmatique aux multiples dysfonctionnements auxquels sont confrontés les services publics de l’eau potable et de l’assainissement en Guadeloupe.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous partageons le constat : la situation de l’eau en Guadeloupe est un problème à bien des égards – citoyens sujets à de nombreuses coupures, dépenses trop importantes, gaspillage de la ressource, non-entretien du réseau, dette abyssale des structures gestionnaires, tarification et facturation opaques.
Il était plus qu’urgent d’agir au bénéfice des usagers, d’agir contre le gaspillage de l’eau et d’améliorer véritablement la qualité de celle-ci.
Si plusieurs initiatives se sont succédé afin de résoudre ces difficultés, rien n’avait permis, à ce jour, d’envisager une réelle restructuration pérenne, apte à résoudre les problèmes structurels du système de gestion de l’eau en Guadeloupe.
Surmontant l’échec des tentatives passées, le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, qui refond la gouvernance du service public de l’eau, est une victoire en soi.
Le Parlement a, dans son ensemble, perçu le constat de carence du système actuel, également partagé par les acteurs institutionnels locaux et par l’ensemble des habitants.
La rénovation concrète que permet ce texte est certes nécessaire, mais pas suffisante : il est urgent de réagir et de permettre un moindre gaspillage de l’eau pour les usagers, tout comme une amélioration forte de sa qualité.
Lors de l’examen de cette proposition de loi, en février dernier, nous avons eu l’occasion de rappeler les travaux du groupe régional d’experts sur le climat (GREC). Dans un rapport de novembre 2020, le GREC a pointé l’immense gâchis de l’eau : « En 2016, le volume d’eau consommé était de 26, 4 millions de m3, alors que 73, 1 millions de m3 étaient produits. » Les pertes représentent donc 177 % de la consommation.
Ses conclusions sont sans appel : pour un litre d’eau consommé, un litre et demi de perdu, ce qui entraîne une pression bien trop importante sur les ressources comme les eaux souterraines du Nord Grande-Terre.
De plus, la qualité de l’eau est « inquiétante », en raison « du très mauvais niveau d’assainissement et de l’utilisation historique de polluants » comme le chlordécone.
Pour la Guadeloupe, le GREC a aussi mis en avant de possibles problèmes de sécheresse en se fondant sur des prévisions de précipitations qui diminueront dans une large partie des zones habitées.
L’article 1er met en place une autorité unique, sous une forme proche d’un syndicat mixte dirigé par un comité syndical. Il conserve deux apports sénatoriaux majeurs.
Premièrement, la possibilité d’une future adhésion, de manière plus souple, de nouvelles collectivités au syndicat mixte, sans avoir à passer par une lourde réécriture législative.
Deuxièmement – et c’est essentiel –, l’ouverture d’une réflexion sur la tarification sociale de l’eau.
À titre personnel, je regrette toujours l’absence de personnes qualifiées et de représentants d’associations d’usagers au sein de ce comité syndical. Au regard des enjeux, ces personnes devraient pouvoir non seulement commenter les décisions de cette nouvelle institution, mais aussi y participer pleinement.
Par ailleurs, les conditions de transfert de la dette, qui font aussi l’objet de cet article 1er, ont des contours trop flous.
Si l’article 2 prend bien en compte l’apport sénatorial d’une audition annuelle obligatoire du président du comité syndical, les pouvoirs de la commission de surveillance restent trop faibles.
Cette réforme ne sera que le premier pas important d’une gestion durable de l’eau en Guadeloupe.
En ce qui concerne le financement et les modalités de transition entre les deux systèmes, notre groupe reste prudent et attend un engagement financier fort de l’État, comme nous l’avons rappelé en première lecture.
Notre groupe appelle à la plus grande vigilance sur le transfert des dettes actuelles à la nouvelle structure. Une attention particulière devra être portée au volume des dettes transférées, ainsi qu’aux dettes qui resteraient à la charge des entités actuelles.
Aussi, tout en alertant sur ces points de vigilance fondamentaux, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la commission mixte paritaire réunie le 23 mars dernier est donc parvenue à un accord sur la proposition de loi rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe.
Les quelques dispositions qui restaient en discussion ont fait l’objet d’un consensus que nous saluons et qui reflète l’esprit dans lequel la députée Justine Benin et moi-même avons souhaité inscrire ces débats.
Nous avons eu l’occasion, ces dernières semaines, à l’Assemblée nationale comme au Sénat, de décrire les dysfonctionnements qui ont entaché nos services publics, ainsi que leurs conséquences sur notre économie, sur notre système de santé ou sur notre environnement. Il n’est plus utile d’y revenir.
La proposition de loi dont nous discutons aujourd’hui – vraisemblablement pour la dernière fois – entend satisfaire une revendication ancienne, portée par les élus locaux et les forces vives de notre territoire, à savoir la création d’une structure unique consacrée à la gestion de l’eau potable et de l’assainissement.
Plusieurs rapports et audits, dont celui du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), en mai 2018, ont d’ailleurs démontré la pertinence de ce projet.
Ce texte est le fruit d’un travail collectif qu’il convient de rappeler brièvement. Il se veut d’abord fidèle aux échanges et aux attentes des élus, des associations d’usagers et des Guadeloupéens, que nous avons rencontrés régulièrement, et des semaines durant, avec ma collègue Justine Benin.
À l’Assemblée nationale, les députés ont enregistré un certain nombre d’avancées.
C’est le cas de la création d’une commission de surveillance, en lieu et place de la commission consultative initialement envisagée, afin de garantir la juste représentation des usagers et de tenter de retrouver une confiance aujourd’hui perdue.
C’est le cas également du compromis trouvé avec le Gouvernement sur la question des dettes fournisseurs.
Au Sénat, le travail de Mme la rapporteure Françoise Dumont et de l’ensemble de nos collègues a permis d’apporter, pour ne citer que ces quelques exemples, davantage de souplesse au fonctionnement du comité syndical et de renforcer les prérogatives de la commission de surveillance.
Ces apports ont été conservés dans leur grande majorité par la commission mixte paritaire, preuve, s’il en fallait une, de la qualité des échanges et des travaux menés par nos deux assemblées.
Si le texte qui nous revient aujourd’hui et sur lequel nous nous prononcerons dans quelques instants est un préalable à la remise en état du système de distribution d’eau potable en Guadeloupe, il n’en demeure pas moins une étape. Cette étape ne pourra seule résoudre les difficultés que nous connaissons.
Plusieurs chantiers s’ouvriront donc dans les jours et les semaines qui viennent. Il s’agira de clarifier le traitement de la ressource pour assurer une gestion durable de notre sous-sol, de mobiliser des financements pour assurer à ce syndicat un fonctionnement pérenne et, enfin, de définir et de réaliser les investissements les plus urgents.
C’est pourquoi j’invite l’ensemble des élus guadeloupéens, qu’ils soient municipaux, communautaires, départementaux ou régionaux, les syndicats et les associations d’usagers, ainsi que le personnel affecté aux services d’eau potable et d’assainissement, que je sais motivé et qui doit trouver toute sa place dans cette nouvelle structure, à créer dès à présent les conditions de sa mise en œuvre.
Le chantier qui s’annonce est immense, mais il est nécessaire et ô combien salutaire.
Je salue enfin l’engagement constant du ministre des outre-mer dans ce dossier. Je le rappelle, nous attendons de l’État un accompagnement financier à la hauteur des enjeux.
Le groupe RDPI votera les conclusions de la commission mixte paritaire et vous invite bien évidemment, mes chers collègues, à en faire de même.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, chacun d’entre nous avait pu faire état, déjà lors de la première lecture, de son inquiétude, voire de sa stupéfaction, face aux différents rapports, bilans et analyses sur la situation du service public de l’eau potable en Guadeloupe.
Je n’y reviendrai pas dans le détail. Toutefois, je veux redire, comme l’avait fait notre collègue président de la délégation aux outre-mer, Stéphane Artano, combien il est inacceptable que, en 2021, certains de nos concitoyens aient des difficultés d’accès à l’eau potable, non pas en raison d’une catastrophe soudaine, mais à cause d’un réseau en mauvais état et d’une gestion désastreuse.
La France de l’outre-mer ne saurait être une oubliée de la République. Face à cela, le principe de la libre administration des collectivités territoriales doit donc céder. En effet, pour qu’il puisse être pleinement efficace, il faut qu’en cas de défaillance l’État reprenne la main.
Pourvu, cependant, que ce recours à la loi demeure occasionnel ! Ce sera à nous d’y veiller.
Tel est l’objet de cette proposition de loi : apporter un correctif à un service que la liberté locale n’a pas pu ou su faire fonctionner. Cependant, il est plus que regrettable que cela ait touché durant plusieurs années un service aussi essentiel que celui de la gestion de l’eau potable.
En réponse à une telle situation, le consensus de nos deux assemblées dans le cadre de la commission mixte paritaire est une première satisfaction. Le sujet était trop important pour que nous ne puissions pas y parvenir. Nous répondrons dans l’unité aux Guadeloupéens qui subissent cette situation.
Aussi, les solutions proposées sont satisfaisantes, en permettant la création d’un syndicat mixte et d’une commission de surveillance. Ces deux institutions laissent espérer, tant à court qu’à long terme, une restauration du service public au travers d’une mutualisation et d’une unification de sa gouvernance.
Du point de vue du syndicat mixte, nous pouvons nous réjouir que certaines souplesses aient été introduites au cours de la navette parlementaire. Si la loi doit intervenir pour pallier les carences de la libre administration locale, elle doit le faire avec mesure, notamment en permettant à de nouveaux membres de bénéficier à l’avenir des apports de ce nouveau système.
S’agissant, ensuite, de la commission de surveillance, elle permettra d’associer l’ensemble des acteurs locaux dans la gestion du service. Le Sénat avait proposé certains ajustements concernant sa composition ; ils ont été retenus dans ce texte.
Je pense notamment au retrait des parlementaires. En effet, chacun doit demeurer dans ses fonctions et cette présence n’était pas nécessairement judicieuse, d’autant que, comme notre rapporteure l’a souligné, cette présence aurait tendu à diluer la représentation des usagers au sein de la commission, tout en risquant d’entraver la fluidité de ses travaux, en raison d’un trop grand nombre de membres.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas encore nous féliciter du travail accompli, dans la mesure où il ne s’agit que d’une première étape dans un processus long et laborieux. Ces seules institutions ne suffiront pas à régler toutes les difficultés de l’accès à l’eau potable en Guadeloupe.
Le groupe RDSE votera donc en faveur de ce texte, mais fera preuve d’une vigilance particulièrement accrue au cours de ces prochaines années, afin de veiller à ce que ce territoire de la République ne demeure pas enlisé dans cette crise.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte arrêté en commission mixte paritaire permet de conserver des apports du Sénat, afin de rendre un peu plus souple le fonctionnement du syndicat mixte créé par la présente proposition de loi ou encore d’intégrer une réflexion sur la tarification sociale de l’eau, qui est un impératif de justice sociale.
Toutefois, nous estimons que cette structure imposée d’en haut aux Guadeloupéens demeure très contraignante et l’obligation pour l’ensemble des communautés d’agglomération d’y adhérer en est emblématique. Une telle dépossession des compétences des EPCI peut être interprétée comme une ingérence importante de l’État dans la libre administration des collectivités, surtout dans un contexte local de négociation entre les acteurs intéressés.
Une « feuille de route » a été adressée aux élus locaux par le Gouvernement. Elle est vécue par beaucoup comme une mise sous tutelle et une mise à l’écart de l’expertise guadeloupéenne. La crainte du retour des multinationales pour gérer la production et la distribution de l’eau et la nécessité de recueillir une aide financière renforcent la pression sur les élus.
Ce consensus forcé pour aboutir à une entité formelle ne garantit en rien son bon fonctionnement et la manière dont le syndicat s’intégrera au préexistant. Nous le répétons, la forme est là, mais le fond nous questionne.
En effet, plusieurs interrogations demeurent. S’agissant du financement du département et de la région, l’État s’est engagé à ne pas alourdir le budget des collectivités du fait de dépenses nouvelles. Mais comment compte-t-il concrétiser cet engagement ? Les élus locaux ne peuvent se contenter de promesses tant ils savent par ailleurs l’érosion dans le temps des compensations financières de l’État.
Les principales dettes des EPCI devront être transférées au nouveau syndicat pour éviter que cette instance soit mort-née. La question est toujours latente et les élus attendent des réponses.
L’avenir des salariés des structures actuelles n’est toujours pas clair. Des garanties devront être apportées, pour que chacun puisse retrouver un emploi au sein de la nouvelle structure.
Sur le terrain, le comité de défense des usagers de l’eau de la Guadeloupe ne se satisfait pas du texte. Il a récemment demandé un référendum sur le sujet et souhaite que les usagers soient mieux impliqués dans le processus de gouvernance de l’eau. Ses réclamations portent sur le montant excessif des factures envoyées aux usagers, l’instauration d’un tarif équitable pour tous et l’arrêt des poursuites judiciaires, alors que les services sont défaillants.
Le sujet en toile de fond de ce texte est celui de l’accès à l’eau et de la raréfaction des ressources en eau, qui touche en premier les territoires marins et nécessite l’appel à la solidarité nationale et internationale. Les collectivités d’outre-mer sont impactées par des réseaux vétustes, où plus de la moitié de l’eau se perd dans les fuites. Pourtant, les habitants, dont le quotidien est rythmé par des coupures d’eau, continuent de payer des factures.
L’eau est un bien commun essentiel à la vie impliquant des enjeux écologiques, sociaux et économiques, d’où l’importance d’une gestion publique pour garantir son accès, mais également sa qualité. Alors que le droit à l’eau et à un assainissement de qualité a été reconnu par l’ONU en 2010 comme « un droit fondamental essentiel au plein exercice du droit à la vie et de tous les droits de l’homme », ce droit est bafoué et les inégalités liées à cette ressource s’aggravent.
Le 15 avril prochain, notre groupe proposera de faire de ce droit à l’eau, aujourd’hui fictif, un droit réel. Nous défendrons, dans le cadre d’une proposition de loi, un accès pour toutes et tous à l’eau potable et à l’assainissement. Nous défendrons la gratuité des premiers litres d’eau nécessaires au quotidien, nécessaires à la vie.
Présentement, nous restons dubitatifs, il faut bien le dire, pour ce qui concerne le schéma proposé pour la gouvernance du service d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe, sur les plans tant administratif que financier.
Nous maintenons donc notre position d’abstention sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.
Mme Françoise Gatel applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, mes chers collègues, notre groupe avait approuvé ce texte au cours de sa première lecture. Prenant acte de la décision favorable de la commission mixte paritaire, nous soutenons bien évidemment ses conclusions. Nous aurions mauvaise grâce à briser le consensus qui s’est dégagé.
Je tiens tout d’abord à saluer votre travail, madame la rapporteure, qui n’était pas facile et que vous avez réalisé avec ténacité.
Notre groupe interviendra aujourd’hui sur ces sujets avec beaucoup d’humilité, les membres de l’Union Centriste élus des départements et territoires d’outre-mer n’étant pas présents aujourd’hui. Nos deux collègues de la Guadeloupe, MM. Lurel et Théophile, sont bien sûr plus qualifiés que votre serviteur pour s’exprimer sur ces sujets.
Malgré notre approbation des dispositions retenues, nous voulons vous faire part de notre perplexité. Un certain nombre d’orateurs l’ont d’ailleurs souligné, il s’agit d’une première étape, en vue d’améliorer la situation.
Le fait que la question des ressources humaines ne soit pas traitée constitue pour nous un élément de surprise. Nous y voyons des difficultés à venir.
Nous regrettons également que la situation financière ne soit pas traitée, dans la mesure où des ambiguïtés subsistent concernant les orientations données, qui peuvent conduire à des lectures différentes. J’imagine qu’elles seront à l’origine de débats assez vifs entre le syndicat, les intercommunalités et l’État.
Comme je l’ai dit en première lecture, même si nous oublions les dispositions traditionnelles en matière d’autonomie des collectivités locales – il a été fait référence au travail de Mme Gatel et de M. Darnaud sur le projet de loi 4D –, la situation n’en demeure pas moins étonnante. S’il est rassurant que le futur syndicat rassemble l’ensemble des intercommunalités de la Guadeloupe, il est plus inquiétant en revanche qu’il intègre le département et la région sur la base de statuts définis par l’État. Notre expérience de la vie publique nous fait apparaître que, lorsque tout le monde fait partie de la même structure et qu’il n’y a pas de « patron » ou, plus exactement, de dirigeant réel, c’est, certes, bien sympathique, mais toutes les ambiguïtés se révèlent rapidement.
Par ailleurs, sur ce type de sujets très technique, dans lequel l’ingénierie constitue un élément essentiel, le diagnostic de la connaissance des éléments et le système d’information géographique sont indispensables. Or le texte ne précise pas qui aura la main sur ce système d’information géographique. Dépendra-t-il du syndicat, des intercommunalités ou bien du niveau départemental ou régional ? Ces ambiguïtés devront à l’évidence être clarifiées, pour que la nouvelle structure soit efficace et raisonnable sur le plan financier.
Monsieur le ministre, vous portez ce texte avec beaucoup d’ambition et dynamisme. Je le rappelle, le « quoi qu’il en coûte » concerne le traitement de la pandémie ; il ne semble pas avoir vocation à s’appliquer à tous les domaines de la société française.

Sinon, nous avons peu de chance d’y arriver !
La question devait être traitée, et la voie législative était seule à même d’y réussir. Ces dispositions devront s’inscrire dans la durée, au regard d’une situation qui est en soi insupportable. Le fait que, dans notre pays, des tours d’eau soient organisés nous plonge dans une grande stupéfaction.
En revanche, je ne suis pas certain qu’il faille invoquer, sur ce problème, les grands principes. J’ai écouté avec beaucoup d’attention l’oratrice qui a évoqué le droit à l’eau. Or s’il est bien un sujet sur lequel le droit à l’eau n’est pas en débat, c’est bien celui-ci ! Il y a suffisamment d’eau en Guadeloupe. Le problème concerne non pas les éléments de production, mais les éléments de distribution. Je ne suis pas certain que le débat sur le prix de l’eau constitue l’essentiel du problème. À cet égard, je ne serai pas cruel et ne rappellerai pas le taux de paiement de l’eau.
Très clairement, la situation de la Guadeloupe relève non pas des grands principes, mais au contraire d’une mise à exécution très technique des bonnes pratiques en cette matière. J’espère que l’ensemble des parties prenantes en Guadeloupe sera en mesure, dans un délai raisonnable, de mener à bien ce chantier tout à fait considérable. En la matière, je renouvelle le soutien de mon groupe.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

M. Victorin Lurel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je l’avoue, en venant à cette tribune, je suis un peu partagé. J’aime bien mon ministre
Sourires.
Mêmes mouvements.

… sa bonhomie et sa rondeur. Il cherche à ne pas présenter d’aspérités. De fait, on a du mal à dire du mal d’un texte qu’il porte. Pourtant, celui-ci est un curieux objet. Fort heureusement, la commission des lois et Mme la rapporteure Françoise Dumont ont mené un excellent travail pour aboutir à de solides et belles constructions juridiques et légistiques. Franchement, ils ont rendu le texte un peu plus acceptable.
J’ai pris beaucoup de plaisir à lire le texte issu de l’Assemblée nationale. Je l’ai comparé aux propositions de la commission des lois puis aux conclusions adoptées par la commission mixte paritaire.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne pourra pas voter ce texte et s’abstiendra. Mais cette sage abstention sera constructive.
M. Mathieu Darnaud rit.

Absolument, mon cher collègue.
Lorsqu’on connaît les oppositions à ce texte qui se sont fait jour en Guadeloupe – mon collègue Dominique Théophile peut en témoigner –, on peut affirmer que nous avons beaucoup évolué.
Il faut le dire, si le ministre n’avait pas adopté une sorte de positionnement bonapartiste, nous en serions encore à discuter entre nous. C’est la seule plus-value : forcer les élus à s’entendre.
Monsieur le ministre, soyons honnêtes ! Je n’oublierai jamais une fort belle séance, en 1978 – je n’étais alors pas un élu –, avec Mme Lucette Michaux-Chevry, à l’époque présidente du conseil général. La décentralisation n’existait pas, on ne savait pas qui « hachait » et qui « coupait », comme on dit dans ma belle langue créole, les affaires de l’eau en Guadeloupe.
Ce fut la DDA, la direction départementale de l’agriculture, puis la DAAF, la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt. À cet égard, on pourrait citer un certain nombre de grands fonctionnaires. Le contrôle de légalité n’existait pas. Pourtant, c’était le préfet qui faisait les appels d’offres. On n’a jamais contrôlé la Compagnie générale des eaux, filiale de Suez, qui est encore présente en Guadeloupe.
Si le contrôle de légalité n’a pratiquement jamais existé, je ne sous-estimerai pas la responsabilité de nos élus. En la matière, on est passé d’une collectivité à une autre, les communes ont délégué à des syndicats, à des communautés d’agglomération, avec plusieurs opérateurs qui n’arrivaient pas à s’entendre sur le prix de l’eau et la gestion de la ressource, notamment les schémas directeurs. Bref, nous avons assisté au désordre le plus total. L’État assistait à tout cela et finançait, par le biais du FNDAE, le fonds national pour le développement des adductions d’eau. Il a laissé faire et a même accompagné.
Avec la décentralisation, il y a eu des gabegies, des relations incestueuses et de la corruption. Mon collègue Dominique Théophile, qui a travaillé pendant quarante ans dans ce domaine, peut en parler mieux que moi. Nous sommes tous coupables !
Pour autant, je ne comprends pas la solution proposée. C’est la raison pour laquelle nous nous abstiendrons. Ce texte est insuffisant, mais nécessaire. Il permettra de forcer au moins un établissement public sur les cinq que réunira ce nouveau syndicat à participer. C’est le seul avantage.
Pour l’ensemble des opérateurs, la dette s’élève tout de même à 193 millions d’euros. Monsieur le ministre, à l’Assemblée nationale, vous avez proposé, avec générosité, de ne faire remonter que 44 millions de dettes « financières », même si je ne sais pas très bien ce que cela veut dire. Je passe sur le fait que vous avez traité nos parlementaires en « supplétifs ».

Heureusement, la commission était là pour réparer, corriger et embellir.
Je le rappelle, au 31 décembre 2019, il y avait 81 millions d’euros de dettes bancaires. Pour ce qui concerne les dettes fiscales, l’État pourrait recouvrer, puisque vous n’avez pas dit que vous y renonciez, 11 millions d’euros. En outre, si l’on considère de nouveau l’ensemble des opérateurs, le personnel s’élève à 563 personnes. Le Siaeag, qui est le seul syndicat que vous allez dissoudre, à compter du 1er septembre, emploie au moins 153 salariés. Certes, vous prenez ici des engagements verbaux, que j’entends. Nous resterons toutefois vigilants sur ce point.
Vous dites qu’il n’y aura pas de plan social, qu’il n’y aura pas de licenciement sec et que les emplois seront préservés. Tel n’est pas le sentiment des syndicats, qui restent mobilisés.
Je recommande, monsieur le ministre, que, d’ici au 1er septembre prochain, puisque le préfet est mandaté, que nous restions en contact, pour discuter d’un plan d’apurement des dettes.

Vous avez poussé le raffinement jusqu’à créer un deuxième syndicat mixte local.

Je demande donc que nous réglions le problème de l’articulation entre ces deux syndicats, dans le cadre d’une solution pérenne.
Mon groupe s’abstiendra sur ce texte, dans un esprit constructif.
M. Lucien Stanzione applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la vice-présidente de la commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, après que notre collègue Victorin Lurel, ancien ministre de l’outre-mer, a dit tout l’attachement qu’il portait à l’actuel ministre de l’outre-mer, qu’il me soit permis de dire tout le bien que je pense de notre rapporteure pour tout le travail qu’elle a accompli.
Tout le monde ici aura compris la nécessité de ce texte, face à toutes les formes d’inégalités relevées sur ce territoire. Malgré les imperfections qu’il a relevées, M. Lurel l’a dit, avec la faconde qu’on lui connaît. Il y a donc urgence à agir, même si cette urgence aboutit à ce que l’on revienne vraisemblablement sur le texte que nous nous apprêtons à adopter.
En effet, pour ce qui concerne les financements, M. le ministre a affirmé que l’État serait au rendez-vous, avec tous les partenaires, pour essayer d’avancer concrètement et d’entrer dans un cercle vertueux. La finalité, il faut le dire et le redire, est bien d’apporter des solutions concrètes aux usagers. À cet égard, il convient de saluer l’action de nos collègues à l’Assemblée nationale et au Sénat, cher Dominique Théophile. C’est la raison pour laquelle j’ai rendu hommage au travail mené par notre collègue Françoise Dumont, rapporteure de ce texte. Le Sénat a essayé d’apporter des compléments utiles, de trouver un niveau d’agilité et d’imaginer ce qui pourrait se passer à l’avenir, en permettant notamment l’adhésion de nouvelles intercommunalités. À tout le moins, on pourra saluer le travail de notre assemblée comme un travail pragmatique et, surtout, utile pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Être utile, c’est l’une des ambitions de ce texte.
Outre les avancées que je viens de citer, je pense également à la possibilité de déroger à l’unanimité à la clé de répartition financière, ainsi qu’au remaniement de la composition de la commission de surveillance.
J’évoquerai également, cher Victorin Lurel, l’inclusion de l’évaluation des possibilités d’une tarification sociale, dont vous vous êtes fait écho ici même avec notre collègue Victoire Jasmin.
C’est dire si ce texte, aussi imparfait soit-il, a été enrichi. Je partage les inquiétudes exprimées par notre collègue Philippe Bonnecarrère, car je me méfie toujours des structures qui épousent tout ce que nos institutions comptent de collectivités. En effet, à un moment donné, il faut prendre des décisions. Sur un sujet aussi important, qui touche, je le répète, au quotidien de nos concitoyens, il faut de l’agilité.
Pour ce qui concerne les financements, nous devrons être au rendez-vous. Mais je sais pouvoir compter, monsieur le ministre, sur la volonté de l’État pour avancer sur ce sujet.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe Les Républicains votera ce texte, en espérant qu’il trouve des compléments utiles, afin de répondre aux problématiques des usagers guadeloupéens. Je souligne une dernière fois le travail mené par Mme la rapporteure.
Ce n’est pas la première fois que nous parlons de l’eau au Sénat.

Je suis certain, monsieur le ministre, que nous en parlerons de nouveau dans quelques semaines.

M. Mathieu Darnaud. À cet égard, je me tourne vers ma collègue Françoise Gatel. Finalement, l’eau et l’assainissement sont des sujets qui trouvent toujours des solutions au Sénat. Je ne doute pas que tel soit de nouveau le cas dans les prochaines semaines.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ».
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales.
Après avis des organes délibérants des membres du syndicat mixte mentionnés au II du présent article, les statuts du syndicat mixte sont arrêtés par le représentant de l’État en Guadeloupe. À défaut de délibération des organes délibérants dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet de statuts, l’avis est réputé favorable.
Le syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée.
II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe :
1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ;
2° La région de Guadeloupe ;
3° Le département de la Guadeloupe.
En cas de modification du périmètre, par fusion ou partage, d’une communauté d’agglomération mentionnée au 1° du présent II, le ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en résultent deviennent automatiquement membres du syndicat mixte.
Une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à sa demande, après autorisation expresse du représentant de l’État en Guadeloupe et avec l’accord unanime des délégués du comité syndical mentionné au V du présent article, adhérer au syndicat mixte. Les modalités de son adhésion sont précisées par les statuts du syndicat mixte.
III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi.
Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes :
1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
2° Service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du même code ;
3° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l’article L. 2226-1 dudit code.
Le syndicat mixte assure la gestion d’un service d’information, de recueil et de traitement des demandes des usagers des services publics mentionnés aux 1° à 3° du présent III.
III bis. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe produit des études et analyses visant à :
1°
Supprimé
2° Intégrer les politiques d’eau potable et d’assainissement dans les enjeux de développement durable du territoire ;
3° Participer à l’élaboration des schémas stratégiques relatifs aux politiques d’eau potable et d’assainissement à l’échelle du territoire ;
4° Conduire une réflexion globale sur la gestion de la ressource en eau et de l’assainissement sur le territoire ;
5° Étudier la faisabilité de la mise en œuvre d’une tarification sociale de l’eau pour les usagers les plus modestes.
III ter. – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable.
IV. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe exerce, en lieu et place du département de la Guadeloupe et de la région de Guadeloupe, la compétence en matière d’étude, d’exécution et d’exploitation de tous les travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence visant les missions prévues au I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, hors celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du même article L. 211-7 relevant de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations.
V. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe est administré par un comité syndical qui comprend des délégués de ses membres.
Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du syndicat mixte est représenté par quatre délégués au sein du comité syndical. La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe sont chacun représentés par quatre délégués. Le président de la commission de surveillance mentionnée à l’article 2 de la présente loi participe aux travaux du comité syndical avec voix consultative.
Le président du syndicat mixte est élu par les membres du comité syndical.
Le comité syndical se dote d’un bureau. Chaque membre du syndicat mixte désigne un de ses délégués au comité syndical pour y siéger.
VI. – Les biens, équipements et services publics nécessaires à l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont mis à sa disposition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres dans les conditions prévues à l’article L. 5721-6-1 du code général des collectivités territoriales.
Par dérogation au premier alinéa du I du même article L. 5721-6-1, les droits et obligations rattachés aux biens, équipements et services publics mis à la disposition du syndicat mixte lui sont transférés, dans les conditions prévues à l’article L. 1321-1 du même code, dans un délai d’un an à compter de sa création.
Par dérogation à la deuxième phrase du troisième alinéa du même article L. 1321-1, à défaut d’accord entre les parties au terme du délai mentionné au deuxième alinéa du présent VI, le transfert est prononcé par décret en Conseil d’État, pris après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et des outre-mer et qui comprend des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat mixte.
Les transferts prévus au présent VI sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement ou honoraire, ni à aucune indemnité ou perception de droit ou taxe.
VI bis. – Les dettes financières des établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences mentionnées au III et relatives aux investissements nécessaires à l’exercice de celles-ci sont transférées au Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe.
Les autres dettes exigibles et les créances des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au premier alinéa du présent VI bis ne sont pas transférées au syndicat mixte.
VII. – Les activités industrielles et commerciales exercées par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe sont financées dans les conditions prévues aux articles L. 2224-12-1 à L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales.
Dans les conditions prévues à l’article L. 2224-2 du même code, les membres du syndicat mixte peuvent prendre en charge des dépenses au titre des services publics de l’eau et de l’assainissement, par décision motivée du comité syndical mentionné au V du présent article. Dans ce cas, les contributions des membres du syndicat mixte sont ainsi réparties :
1° La région de Guadeloupe et le département de la Guadeloupe contribuent chacun à hauteur de 25 % ;
2° Les contributions restantes sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres au prorata du nombre d’abonnés situés dans leur périmètre géographique respectif, en distinguant les contributions dues au titre du service public de l’eau et celles dues au titre du service public de l’assainissement.
À l’unanimité de ses membres, le comité syndical peut décider de déroger à la répartition des contributions définie au présent VII lorsqu’un projet d’investissement le nécessite.
Ces contributions ont un caractère obligatoire.
VIII. – L’adhésion des membres mentionnés au II vaut retrait des syndicats auxquels ces membres appartiennent pour les compétences mentionnées aux III à IV.
IX. – Toute modification des statuts du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe est prononcée par arrêté du représentant de l’État en Guadeloupe, dans les conditions fixées par les statuts de l’établissement ou, à défaut, dans les conditions fixées à l’article L. 5721-2-1 du code général des collectivités territoriales.
I. – Une commission de surveillance est placée auprès du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe mentionné au I de l’article 1er. Elle comprend :
1° Des représentants des membres du syndicat mixte, désignés selon les règles fixées dans ses statuts ;
2° Des représentants d’associations d’usagers des services publics de l’eau et de l’assainissement ;
2° bis Des représentants d’associations de protection de l’environnement ;
3° Des représentants de la chambre de commerce et d’industrie des îles de Guadeloupe, de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe et de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région de Guadeloupe ;
4°
Supprimé
5° Le président de l’association des maires de Guadeloupe et des représentants des communes ;
6° Des personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence en matière d’eau et d’assainissement.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 2°, 2° bis et 6° du présent I sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, après avis du président du syndicat mixte. Cet avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu, par écrit, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de nomination faite par le représentant de l’État en Guadeloupe. Les membres mentionnés au 2° représentent au moins la moitié des membres de la commission de surveillance.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 3° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition des présidents des chambres consulaires concernées.
Les membres de la commission de surveillance mentionnés au 5° sont nommés par le représentant de l’État en Guadeloupe, sur proposition de l’association des maires de Guadeloupe.
Les membres sont nommés pour six ans. Les membres sortants sont reconductibles. Leurs fonctions sont exercées à titre gratuit.
La commission de surveillance élit son président parmi les membres mentionnés au 2°. Lors des délibérations de la commission de surveillance, en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
II. – La commission de surveillance formule des avis sur l’exercice de ses compétences par le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, en particulier sur :
1° Le projet stratégique du syndicat mixte et ses projets d’investissements ;
2° La politique tarifaire et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement ;
3° Le service public de défense extérieure contre l’incendie, au sens de l’article L. 2225-2 du code général des collectivités territoriales ;
4° La gestion de la ressource en eau ;
5° La satisfaction des usagers du service public de l’eau.
Les avis de la commission de surveillance sont transmis au comité syndical mentionné au V de l’article 1er de la présente loi.
III. – La commission de surveillance examine chaque année, sur le rapport du président du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe, les rapports mentionnés à l’article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales.
Elle est consultée pour avis sur les projets mentionnés au même article L. 1413-1 par le comité syndical mentionné au V de l’article 1er de la présente loi.
IV. – La commission de surveillance peut adresser des propositions au comité syndical mentionné au V de l’article 1er de la présente loi. À l’initiative de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, elle peut également solliciter, en fonction de l’ordre du jour du comité syndical, l’inscription à celui-ci de toute question en lien avec ses compétences.
IV bis. – En fonction de son ordre du jour, la commission de surveillance peut, sur proposition de son président ou à la demande de la majorité de ses membres, procéder à l’audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l’exercice de sa mission. Le président du comité syndical mentionné au V de l’article 1er est auditionné annuellement par la commission de surveillance. Il présente, à cette occasion, un rapport faisant état des travaux réalisés et des emprunts contractés au cours de l’année précédente, des investissements programmés et de l’évolution de la politique tarifaire des services publics d’eau potable et d’assainissement.
V. – Le président de la commission de surveillance présente chaque année avant le 1er juillet au comité syndical mentionné au V de l’article 1er un état des travaux réalisés au cours de l’année précédente.

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Personne ne demande la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi.
La proposition de loi est adoptée.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon rappel au règlement concerne l’article 25 du règlement, relatif à l’organisation de nos travaux.
Nous examinons cette semaine le projet de loi, très important, confortant le respect des principes de la République. Il reste plus d’une centaine d’amendements à examiner.
La discussion de ce texte a été interrompue à plusieurs reprises pour adopter d’autres textes, également importants, ce qui n’a pas permis l’examen dans la continuité d’un texte aussi essentiel, ce que nous ne pouvons que déplorer.
Nous reprendrons tout à l’heure nos travaux, sans pouvoir être certains de les achever aujourd’hui dans des conditions satisfaisantes.
Par conséquent, il semble que la poursuite de nos travaux dans le cadre de la journée de demain puisse être envisagée. En effet, je ne sais pas à quelle heure nous pourrons lever la séance, compte tenu des sujets très importants qui restent à traiter et qui ne doivent pas être « bradés » au motif que nous devrions finir ce soir.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.
S’agissant de l’organisation de nos travaux, des décisions ont été prises, qui reviennent à hacher la discussion de ce projet de loi. Toutefois, nous ne pouvons préjuger de la vitesse avec laquelle nous examinerons les amendements restant en discussion, qui sont au nombre de 155.
Nous verrons ce soir ce qu’il en est. Sans doute conviendra-t-il effectivement d’ouvrir la séance demain pour terminer l’examen de ce texte.

J’ai bien noté le rappel au règlement de notre collègue Nathalie Goulet. Il faut tenir compte néanmoins, me semble-t-il, de l’organisation globale de nos vies de sénateurs et de sénatrices.
La semaine dernière, nous avons déjà œuvré sur ce texte mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Or il est tout de même nécessaire que nous recevions ou rencontrions de temps en temps nos concitoyens, et nous sommes probablement nombreux à avoir prévu, demain, un emploi du temps chargé. Nous n’arrêtons pas !
Mon groupe n’est pas très favorable à l’idée d’ouvrir la séance de demain. Peut-être parviendrons-nous à achever l’examen du texte en discussion au cours de la nuit ; j’en émets en tout cas le vœu.

Nous avons déjà eu de longs débats sur le fond. Aussi, peut-être y arriverons-nous. À défaut, je serai plutôt partisan d’une reprise de nos travaux sur ce projet de loi la semaine prochaine.

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, mon cher collègue.
Un point sera réalisé avec la commission des lois, en début d’après-midi, sur les conditions d’examen des amendements restant à examiner. La séance sera probablement prolongée tard ce soir ; cela dépendra à la fois du ministre présent au banc du Gouvernement et de la présidence de séance.
La parole est à Mme le vice-président de la commission.

En l’absence du président de la commission des lois, je me permets d’intervenir ; je pense qu’il partagera mon point de vue.
L’ordre du jour ne prévoit pas qu’une séance soit ouverte demain, et nous ne souhaitons pas que tel soit le cas ; vous avez raison sur ce point, monsieur Sueur. Il appartient donc à chacun de bien mesurer le temps de ses interventions.

Il ne s’agit nullement de brimer quiconque dans son expression, mais, dès lors qu’une décision semble faire consensus, on peut éviter d’ajouter encore et encore des commentaires aux commentaires.
Je compte donc sur chacun. Nous pouvons raisonnablement croire en notre capacité de finir ce soir à minuit et demi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Françoise Gatel applaudit également.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux (projet n° 377, texte de la commission n° 506, rapport n° 505).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Monsieur le président, madame la vice-présidente de la commission des lois, madame la rapporteure, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, mesdames, messieurs les sénateurs, le sujet de la formation des élus locaux, qui nous rassemble aujourd’hui, constitue un enjeu essentiel au bon fonctionnement de notre vie démocratique.
Ce sujet me tient particulièrement à cœur ; nombre d’entre vous étaient déjà sur ces travées lorsque nous avons adopté, en 2015, la proposition de loi de M. Jean-Pierre Sueur et moi-même, qui a créé notamment le droit individuel à la formation des élus locaux.
Nous savons tous ici ce que la fonction d’élu local suppose d’exigences, parfois paradoxales : tirant sa légitimité du seul suffrage universel, l’élu local doit maîtriser des dossiers dont la complexité va croissant, tout en étant parfois bien seul face aux difficultés.
C’est pour cette raison qu’un système de formation bien spécifique a été mis en place pour les élus locaux.
Il s’agit tout d’abord de leur permettre d’être mieux « armés » dans l’exercice de leur fonction d’élu, ce qui appelle une formation bien différente d’une formation professionnelle classique. Deux principes doivent être garantis : la pluralité de l’offre – les besoins peuvent en effet être variés, depuis les approches politiques, elles-mêmes nécessairement diverses, jusqu’à des formations plus techniques – et, naturellement, la qualité des formations.
Il s’agit également d’accompagner les élus dans le parcours professionnel que, comme c’est souvent le cas, ils poursuivent pendant leur mandat ou reprennent après son terme, cette fois par des formations professionnelles classiques. Nous savons tous que le retour à la vie professionnelle à l’issue d’un mandat est parfois difficile.
Le texte présenté aujourd’hui va permettre de consolider fortement notre dispositif de formation des élus locaux.
À la fin de l’année 2019, dans la loi Engagement et proximité, défendue par le ministre Sébastien Lecornu, le Parlement a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet.
Après avoir rendu public un rapport d’inspection aux constats parfois préoccupants, nous avons lancé un vaste cycle de concertations, avec, d’une part, les associations nationales d’élus, et, d’autre part, les organismes de formation agréés. Je veux ici les remercier de leur implication.
Cette concertation a conduit à un projet d’ordonnance sur lequel le Conseil national d’évaluation des normes a rendu un avis favorable unanime.

Permettez-moi de revenir en quelques mots sur les caractéristiques du système actuel et sur ses limites, qui sont l’objet de cette réforme.
Tout d’abord, les organismes de formation doivent disposer d’un agrément ministériel pour former des élus. Cet agrément n’a, hélas, pas permis d’éviter des dérives dans le secteur.
Ensuite, la formation des élus est financée par deux dispositifs complémentaires.
Depuis 1992, les collectivités doivent prévoir un budget de formation de leurs élus, égal au minimum à 2 % des indemnités qui peuvent leur être versées. Ce budget minimum devrait représenter au moins 34 millions d’euros. Mais les petites communes n’ont parfois pas les moyens nécessaires pour faire face aux demandes.
Les élus bénéficient également du droit individuel à la formation des élus, le DIFE, véritablement opérationnel depuis 2019. Ils disposent, à ce titre, de vingt heures de formation par an cumulables.
Ce droit est financé par une cotisation d’un montant égal à 1 % des indemnités versées aux élus, ce qui représente environ 16 millions d’euros. Force est de constater un certain nombre de dérives par rapport à l’esprit de la loi : prix élevés, faible nombre d’élus formés, concentration de la dépense sur quelques organismes, déficit très important.

La réforme dont nous allons discuter s’attaque à chacun de ces sujets.
Premièrement, l’ordonnance conforte le dispositif de financement par les collectivités, auquel celles-ci sont très attachées.
Pour répondre aux besoins des petites communes, l’intercommunalité à fiscalité propre pourra désormais, selon des modalités absolument souples, contribuer à la formation des conseillers municipaux, sans exercer cette compétence pour autant.

En outre, une collectivité pourra désormais abonder très facilement le compte DIFE de l’élu, afin qu’il puisse cumuler aisément les deux sources de financement.
Deuxièmement, l’ordonnance assouplit et pérennise le DIFE. Il faut sortir du système de droits en heures qui régit actuellement ce dispositif et qui a conduit certains organismes indélicats – je pèse mes mots – à présenter leur offre de formation comme « gratuite », alors qu’elle coûtait en réalité de plus en plus en cher.

L’ordonnance prévoit donc de doter annuellement chaque élu d’une enveloppe en euros.
L’élu pourra ainsi choisir le meilleur rapport qualité-prix et se former deux fois plus longtemps s’il choisit un organisme de formation deux fois moins cher.
Il aura accès à une vision d’ensemble de l’offre grâce à l’intégration du DIFE dans la plateforme « moncompteformation.gouv.fr », qui gère déjà le compte personnel de formation. La procédure d’inscription sera accélérée. Les frais de gestion seront réduits. Ce dispositif continuera de reposer sur la Caisse des dépôts et consignations, dont je veux saluer l’engagement dans cette réforme.
Pour ce qui est des formations de réinsertion professionnelle, l’élu pourra facilement cumuler les droits acquis dans le cadre de sa vie professionnelle, de ses engagements bénévoles et de son mandat d’élu, ainsi que les différents compléments de financement qui existent en matière de formation professionnelle de droit commun.
Cette réforme est aussi, tout simplement, une opération de sauvetage du DIFE, qui aurait été, en l’absence de ladite réforme, en cessation de paiements d’ici à l’été.

Très précisément, alors que les recettes annuelles sont de 15, 9 millions d’euros, le déficit du fonds a atteint 11, 9 millions d’euros en 2019 et 23, 6 millions d’euros en 2020.
Afin de faire face à l’épuisement de la trésorerie, la Caisse des dépôts et consignations se voit accorder la faculté de consentir une avance de fonds au DIFE.
À moyen terme, l’équilibre financier sera garanti par la faculté donnée au pouvoir réglementaire, après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, le CNFEL, de modifier les conditions d’organisation des formations, de moduler le taux de cotisation ou de moduler l’enveloppe accordée annuellement aux élus.
Cette enveloppe sera fixée dans la concertation, de manière transparente, en divisant les ressources disponibles par le nombre d’élus demandeurs.
Sur ce point, votre rapporteur a déposé, au nom de la commission des lois, deux amendements auxquels le Gouvernement est favorable et dont il partage complètement les objectifs.
Le premier vise à garantir la stabilité de l’enveloppe annuelle accordée aux élus pour trois ans, à compter de 2023.
Le second a pour objet de prévoir la conversion en euros des heures non utilisées à l’issue de la période transitoire de six mois prévue par l’ordonnance. Ce montant issu de la conversion s’ajouterait à l’enveloppe annuelle en euros qui sera accordée de manière identique à tous les élus locaux.
Il convient de garder à l’esprit que les droits en euros du DIFE s’ajouteront aux financements que pourront accorder les collectivités et les intercommunalités, soit en prenant directement en charge une formation soit en abondant le compte DIFE de l’élu.
Troisièmement, cette réforme devrait permettre de garantir des formations de qualité, délivrées par des organismes rigoureux.
Un répertoire national de la formation des élus sera élaboré de manière concertée, afin de cerner les sujets de formation éligibles au financement public.
Cette concertation permettra de conduire une réflexion sur les besoins des élus – je pense par exemple aux besoins spécifiques des élus de l’outre-mer, problème soulevé à juste titre par Lana Tetuanui, qui m’a écrit à ce propos.
Les organismes de formation des élus seront désormais soumis au même statut, et aux mêmes obligations, que les organismes de formation de droit commun. L’ordonnance formalise en outre la procédure de retrait de l’agrément en cas de manquement de l’organisme à ses obligations.
Quatrièmement, et enfin, la gouvernance du secteur sera simplifiée et renforcée.
L’ordonnance conforte le CNFEL, qui reprendra les missions de la commission DIFE, en lui confiant tous les leviers nécessaires pour rendre des avis parfaitement informés sur l’ensemble des enjeux de la formation des élus.
Le CNFEL bénéficiera également des avis d’un conseil d’orientation placé auprès de lui, dans lequel seront notamment représentés les organismes de formation.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, la réforme que le Gouvernement soumet à votre approbation. Mme la rapporteure et la commission des lois, dont je tiens à saluer le travail, ont apporté des amendements utiles au texte du Gouvernement dont elles partagent, me semble-t-il, les objectifs.
La discussion qui s’ouvre sur ce texte nous permettra, j’en suis certaine, d’avancer vers une réforme qui confortera la formation des élus locaux.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le dossier dont nous allons parler aujourd’hui, à savoir la formation des élus, est un dossier très important pour le Sénat – vous l’avez rappelé, madame la ministre.
Aussi, je suis très heureuse de saluer les auteurs ici présents du dispositif de droit individuel à la formation des élus : vous-même, madame la ministre, et notre collègue Jean-Pierre Sueur, qui présenta également, lorsqu’il était secrétaire d’État chargé des collectivités locales, un projet de loi sur les conditions d’exercice des mandats locaux portant notamment sur l’autre volet, hors DIFE, de la formation des élus.
Je salue également Catherine Di Folco, vice-président de la commission des lois, qui fut rapporteur de la proposition de loi DIFE. Merci à ces membres de la famille, si je puis dire, de leur investissement !
Sourires.

La formation des élus – vous l’avez dit, madame la ministre –, est extrêmement importante, et cela à deux niveaux.
D’une part, les élus doivent être formés à l’exercice de leurs compétences. D’autre part – nous l’avons vu en examinant le projet de loi Engagement et proximité, et mon collègue Mathieu Darnaud, qui était corapporteur, y avait beaucoup insisté –, la formation est nécessaire pour faciliter l’engagement des élus : il s’agit non seulement de les former à l’exercice de leurs compétences, donc, mais surtout de faciliter un retour à la vie professionnelle qui peut n’être pas souhaité.
C’est sur cette base que le DIFE, c’est-à-dire le droit individuel à la formation des élus, a été créé sur proposition de Jean-Pierre Sueur et de Jacqueline Gourault, sur le modèle de ce qui existait dans le droit commun. Je veux vous remercier très sincèrement, madame la ministre, ainsi que vos collaborateurs, du travail très positif que nous avons réalisé ensemble sur cette question.
Certes, vous le savez bien, nous étions extrêmement réservés, lorsque nous examinions le projet de loi Engagement et proximité, à l’idée de laisser le Gouvernement œuvrer par ordonnances – le Parlement n’aime guère confier à d’autres la mission qui est la sienne. Mais le travail qui est présenté aujourd’hui me semble extrêmement intéressant. Je salue les propositions que vous avez formulées et qui ont été enrichies par le Sénat.
Le dispositif du DIFE, ce droit individuel à la formation des élus, souffre, à cause de ce qu’il est, de différents maux.
Tout d’abord, il est alimenté par un prélèvement sur les indemnités des élus indemnisés, qui ne représentent qu’une petite minorité des élus ; la collecte s’élève ainsi à 16 millions d’euros par an seulement, alors même que 520 000 élus locaux y ont droit. Autrement dit, l’enveloppe est fermée, alors que le nombre de personnes éligibles est considérable.
Un autre problème doit être soulevé, Mme la ministre l’a souligné à juste titre : la qualité des formations dispensées. Il ne s’agit pas ici de critiquer les organismes de formation ; toutefois, tout de même, néanmoins et cependant
Sourires.

Quoi qu’il en soit, l’enveloppe a été asséchée, il faut le dire, par quelques organismes qui ont dépensé beaucoup d’énergie à proposer des formations aux élus. Aujourd’hui, la situation est très simple : le déficit est de près de 24 millions d’euros, alors que la collecte n’est que de 16 millions d’euros et que, en outre, il faut tenir compte des droits acquis.
Il est temps, donc, de remplir les objectifs légitimes que nous nous sommes fixés.
Il s’agit, en premier lieu, de faciliter l’accès des élus à leurs droits. La création d’une plateforme unique où chaque élu aura son compte, comme dans le droit commun, rendra plus aisé l’accès à la formation.
Madame la ministre, puisque nous sommes entre nous
Sourires.

Aujourd’hui, il faut cinquante personnes pour gérer 16 millions d’euros. On peut supposer que demain, avec ce que nous proposons, il en faudra vingt. Il va donc falloir que la Caisse des dépôts et consignations réalise un gros effort d’optimisation de ses talents.
Nous proposons également un meilleur contrôle des organismes de formation. Il ne s’agit pas d’empêcher qui que ce soit d’offrir des formations différenciées et de qualité. Mais je crois nécessaire qu’existent aujourd’hui à la fois un référentiel des formations proposées aux élus et une évaluation des formations dispensées, afin que chaque élu, au moment de choisir librement son organisme de formation, ait à sa disposition une appréciation de la qualité et du sérieux des différents organismes.
Par ailleurs, une sous-traitance en cascade, dont le terme est parfois invisible, est très souvent pratiquée – nous avons pu le constater. Il convient, là aussi, de sécuriser les choses. Quand vous signez un contrat de formation avec un organisme, vous devez savoir qui va dispenser la formation, et celle-ci ne doit pas être déléguée à un organisme X ou Y qui ne serait pas agréé.
Nous proposons donc de limiter la sous-traitance au second rang. Des exceptions seront prévues pour des formations quelque peu exceptionnelles, par exemple en droit de l’urbanisme – quand une association d’élus travaille sur le plan local d’urbanisme, le PLU, un expert en la matière doit pouvoir intervenir.
Autre point décisif, on voit bien aujourd’hui que le déficit évolue au fil de l’eau. La consommation des crédits est cyclique : le droit individuel à la formation étant fait essentiellement pour la reconversion, on sait bien que c’est en fin de mandat, au bout de six ans, que les élus consomment les crédits, ce qui provoque une concentration de la demande. Et nous n’avons pas de visibilité.
Il est extrêmement important, pour les organismes de formation, qui sont aussi des employeurs, comme pour les collectivités, de connaître à un horizon de trois ans le montant du crédit en euros dont chaque élu pourra bénéficier. Nous avons donc, avec Mme la ministre, trouvé une date raisonnable, qui nous semble juste.
Il faut redresser la situation ; la prévisibilité à trois ans est certes un objectif difficile à remplir, mais nous proposons qu’il soit atteint en 2023.
J’en viens à un autre sujet essentiel : le système de conversion. Jusqu’à présent, les élus cumulaient un droit à la formation de vingt heures par an. À partir du mois de juillet prochain, le droit individuel à la formation sera calculé en euros. Un système de conversion est prévu. Comme c’est le cas pour tous les régimes transitoires, il faut à la fois respecter les droits acquis et veiller à l’équilibre financier.
Je remercie Mme la ministre d’avoir accepté une proposition fort raisonnable, en vertu de laquelle les droits acquis en heures par les élus et non liquidés à la fin du mois de juillet, date à laquelle ils commenceront à acquérir des droits en euros, ne seront ni perdus ni diminués.
Nous proposons par ailleurs un cumul des droits année après année, tout en le plafonnant, car, comme je l’ai dit, nous sommes des gens très raisonnables.
Nous avons également conforté le rôle du Conseil national de la formation des élus locaux, en assimilant son mode d’action à celui du Conseil national d’évaluation des normes, que nous aimons beaucoup – le CNFEL émettra un avis sur les projets que vous aurez à lui soumettre, madame la ministre.
Très clairement, si Mme la ministre souhaite modifier les leviers employés pour rétablir l’équilibre financier du fonds DIFE, elle devra en rendre compte auprès du CNFEL. Vous n’êtes pas sous contrôle, madame la ministre, mais sous notre exigence et notre bienveillance, vous le savez bien !
Sourires.

Je veux une nouvelle fois saluer le travail qui a été réalisé avec vous, avec la commission des lois et avec mes collègues de chaque groupe ; nous avons entretenu un dialogue responsable, mais volontaire. La formation est un enjeu majeur pour les élus ; en la matière, nous devons tenir compte d’une situation difficile et promouvoir une exigence de qualité.
Je souhaite donc que nous puissions aboutir de façon positive en ce qui concerne ces ordonnances.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, Les Républicains et RDPI. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quand je présidais l’union des maires de mon département – après plusieurs années, j’ai dû abandonner cette présidence, …
Sourires.

… frappé, comme beaucoup d’entre vous, par une interdiction du cumul des mandats que je continue de regretter –, la formation des élus comptait parmi les principaux dossiers dont nous nous occupions.
En effet, parce que le retrait progressif de l’État d’un certain nombre de missions qu’il exerçait dans les territoires s’accentuait, le besoin d’ingénierie territoriale a crû peu à peu.
C’est ainsi que nous avons accompagné les 816 maires de l’Aisne, principalement ruraux, au fur et à mesure de la décentralisation, via des sessions de formation organisées tout au long de l’année, qui rencontraient et continuent de rencontrer beaucoup de succès.
C’est donc tout naturellement que, en 2012, dans le cadre de notre délégation aux collectivités territoriales, que vous présidiez à l’époque, madame la ministre, je commettais un rapport intitulé La Formation des responsables locaux : un enjeu pour nos territoires, assorti de la conclusion suivante : « La formation, en ce qu’elle permet une amélioration des connaissances, des compétences et des aptitudes, constitue un outil qui répond à la fois aux intérêts des élus et des agents des collectivités territoriales. En ce sens, le droit à la formation doit être préservé et consolidé. »
J’y formulais une quinzaine de propositions, dont bon nombre ont finalement été intégrées dans notre droit, par exemple l’instauration d’un plancher de crédits budgétaires consacrés à la formation, ou encore la mise en place d’un droit individuel à la formation, le DIFE, qui fut créé par la loi de 2015 que vous avez évoquée, madame la ministre.
En 2018, avec mes collègues Michelle Gréaume et François Bonhomme, que je salue, j’ai sur le métier remis l’ouvrage, comme eût dit Boileau, en rédigeant un nouveau rapport intitulé Faciliter l ’ exercice des mandats locaux : la formation et la reconversion. Complexification du droit, augmentation des compétences des collectivités au fur et à mesure de la décentralisation, montée des intercommunalités : voilà en effet autant de dynamiques qui ont fait de la formation des élus et des agents publics un défi pour l’avenir des collectivités territoriales.
C’est donc peu de dire que la formation des élus est un serpent de mer, indissociable de celui du statut de l’élu.
Si nous avons pu avancer sur ce dernier point depuis quelque temps, la formation reste un défi majeur et crucial, car la compétence des élus locaux est la véritable condition d’un bon exercice du mandat. Elle permet de compenser les inégalités de formation initiale et elle est devenue une condition de la démocratisation de l’accès aux fonctions politiques.
Former les élus, c’est aussi les préparer à l’après-mandat – vous y avez fait référence, madame la ministre. À l’heure où plus personne n’envisage qu’un élu local occupe un mandat toute sa vie, la sortie du mandat et la reconversion supposent une formation adaptée et une bonne préparation en amont.
Dans notre rapport de 2018, nous avions fait des propositions dont l’adoption aurait permis d’avancer, mais, d’une part, de mauvaises habitudes avaient été prises, assorties de pratiques à tout le moins perfectibles, et, d’autre part, la soutenabilité financière du schéma adopté pour gérer le DIFE apparaissait au mieux fragile, comme l’a expliqué Mme la ministre.
La décision fut donc prise, fin 2019, de légiférer par ordonnance. Soit ! Nous avions alors regretté le choix de ce véhicule, sachant que nous aurions pu « boucler » le sujet lors de la discussion du projet de loi Engagement et proximité.
Cette ratification tardive, bien au-delà des délais impartis, nous aura fait perdre un temps précieux, d’autant que le personnel élu a entre-temps été en partie renouvelé à l’occasion des élections municipales de 2020.
Les ordonnances ont été substantiellement amendées par notre rapporteur, également présidente de la délégation aux collectivités territoriales, qui y a précisé, comme elle vient de l’exposer, d’une part, le contour du DIFE, et, d’autre part, les modalités de contrôle des organismes, mais aussi la pérennisation du financement et la protection des droits non entièrement liquidés.
Si nous souhaitons développer la culture de la formation, il faut précisément que les dispositifs en vigueur facilitent l’accès à cette dernière, pour les uns comme pour les autres, pour les ruraux comme pour les urbains, pour les élus majoritaires comme pour les élus d’opposition.
Ce projet de ratification sera soutenu par notre groupe, car il représente une avancée notable dans ce domaine essentiel pour les élus locaux.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France compte environ 510 000 élus locaux.
Pour faire face à leurs lourdes responsabilités et exercer efficacement leurs fonctions, les élus doivent être correctement formés. En outre, il paraît important, pour préserver l’attractivité des fonctions électives, que les élus qui le souhaitent puissent s’inscrire dans un processus de réinsertion professionnelle à la fin de leur mandat.
La loi a ainsi prévu deux dispositifs pour répondre aux besoins des élus locaux en matière de formation.
Le premier, introduit en 1992, prévoit le financement des formations demandées par les collectivités territoriales, qui doivent inscrire à leur budget chaque année un montant minimum équivalent à 2 % des indemnités dues aux élus.
Le second, le droit individuel à la formation des élus, ou DIFE, introduit en 2015, est financé par un fonds national, alimenté par 1 % des indemnités perçues par les élus indemnisés, soit une somme de 17 millions d’euros annuels.
Or ce dispositif n’a pas réussi à garantir des formations de qualité facturées au juste prix ; de nombreux exemples d’abus et de dérives ont été constatés. Le fonds DIFE géré par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, s’est trouvé dans une impasse financière : il enregistrait un déficit de 12 millions d’euros en 2019 et de 24 millions d’euros en 2020.
À cet égard, je veux attirer votre attention sur la gestion scandaleuse de la CDC, qui perçoit 20 % des montants collectés au titre des frais de gestion. Comment justifie-t-elle ces 3, 5 millions d’euros ?
Vous en conviendrez, il existe une véritable urgence à réformer le dispositif de formation des élus locaux.
Dans le cadre de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, le Gouvernement a sollicité du Parlement une habilitation pour légiférer par ordonnance, afin de rénover en profondeur l’ensemble du dispositif de formation. Un travail en commission nous a permis de comprendre le sens d’une telle demande.
Le projet de loi qui nous est soumis vise à ratifier deux ordonnances prises sur le fondement de l’article 105 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Ces ordonnances visent non seulement à faciliter l’accès à la formation et à garantir la qualité des formations dispensées, mais également à rénover la gouvernance du système de formation des élus locaux. Elles apporteraient ainsi une amélioration certaine et bienvenue.
Par ailleurs, je me félicite des travaux en commission, qui ont enrichi le dispositif. De nombreuses dispositions vont dans le bon sens.
Je veux parler, tout d’abord, du rétablissement du cumul des droits à la formation des élus locaux sur toute la durée du mandat, afin de leur permettre d’utiliser leurs droits acquis sur plusieurs années, à l’instar du fonctionnement du compte personnel de formation des salariés.
Je veux parler également de l’extension des possibilités d’abondements complémentaires par des personnes publiques telles que l’État, Pôle emploi et d’autres collectivités territoriales, afin qu’elles puissent cofinancer les formations à la reconversion des élus locaux déjà financées partiellement par le DIFE.
Je veux parler enfin de la possibilité offerte aux élus locaux de s’inscrire, dès la première année de leur mandat et gratuitement, à des modules de formations pouvant être accessibles à distance via la plateforme numérique et leur permettant d’acquérir les connaissances indispensables à l’exercice de leur mandat.
De même, il était particulièrement nécessaire d’approfondir le contrôle des organismes de formation. À cet égard, je me réjouis qu’un certain nombre de dispositions concernant les conditions de sous-traitance par les organismes de formation agréés aient été introduites, afin de garantir la qualité des formations dispensées.
Je pense, notamment, à la mesure prévoyant qu’un organisme titulaire d’un agrément ne puisse sous-traiter l’exécution des prestations de formations à destination des élus financés par le DIFE qu’à la condition de justifier la nécessité de cette sous-traitance, comme le besoin d’un savoir particulier ou d’une expertise.
Je veux aussi mentionner l’interdiction de la sous-traitance de second rang des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux, afin d’éviter un contournement des exigences de qualité.
Enfin, je rejoins la position de la commission lorsque celle-ci a souhaité garantir la stabilité du système de formation des élus, notamment en stipulant que le Conseil national de la formation des élus locaux doit privilégier, dans les propositions de retour à l’équilibre qu’il formule au ministre chargé des collectivités territoriales, les leviers qui sont le moins attentatoires aux droits acquis des élus.
Madame la ministre, chers collègues, la réforme de la formation des élus locaux constitue une réponse bienvenue en raison des importants dysfonctionnements du dispositif actuel.
Aussi, reconnaissant pleinement la nécessité de cette réforme et soucieux de répondre aux attentes légitimes des élus locaux en matière de formation, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera ce texte modifié et enrichi par la commission.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici devant un problème simple à énoncer, mais complexe à résoudre : nous souhaitons mieux et davantage former les élus, mais les moyens disponibles sont trop faibles et mal utilisés.
Ce projet de loi de ratification vise à gommer quelques anomalies et à améliorer certains fonctionnements, mais sans avancer suffisamment dans la réforme de la formation des élus.
Il fallait néanmoins prendre ces ordonnances, qui, dans la continuité de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, « afin d’améliorer les conditions d’exercice des mandats et de renforcer les compétences des élus locaux pour les exercer », participent à la refonte nécessaire du droit à la formation des élus.
Ces ordonnances visent à encadrer la formation de manière plus sûre juridiquement et plus soutenable financièrement. Elles visent également à en rendre le contenu plus qualitatif.
Actuellement, comme cela a été rappelé, deux dispositifs existent.
Le premier, instauré en 1992 et financé par les collectivités à hauteur d’un plancher de 2 % des indemnités perçues par les élus, permet le financement de formations liées à l’exercice du mandat. Ce système est largement sous-utilisé, près de deux tiers des collectivités territoriales ne dépensant pas ces crédits budgétés, ou ne les dépensant que très peu, alors que leur consommation est obligatoire.
Le second dispositif, datant de 2015, a instauré un réel droit individuel à la formation des élus locaux, à hauteur de 1 % des indemnités perçues. Destiné initialement principalement à financer des formations liées à la reconversion des élus, il permet des formations en lien, ou pas, avec l’exercice du mandat, et cumulables sur cinq ans.
Les abus des structures de formation sont connus et dénoncés. Celles-ci réalisent une véritable captation du marché de la formation des élus : ainsi, deux organismes ont capté, en 2019, quelque 40 % du financement du DIFE. Il y avait donc urgence à réguler le marché des formations.
J’insiste sur le caractère réel de l’accès à la formation et son égal accès : il existe des inégalités de formation en fonction des territoires, de la taille des communes, mais aussi parfois entre les élus majoritaires et minoritaires.
J’insiste aussi sur la visibilité limitée du montant annuel des droits de formation pour chaque élu, en raison de la méconnaissance du nombre d’élus qui auront recours à ce dispositif. À cet effet, la commission propose d’instaurer une visibilité à trois ans de ces montants dès 2023, ce qui est souhaitable.
La formation est un élément majeur pour l’exercice du mandat de l’élu, mais elle manque de financement. La diminution des coûts grâce à la rationalisation des frais de gestion élevés de la Caisse des dépôts et consignations constituera de ce point de vue une avancée.
Les montants et cumuls envisagés, aujourd’hui insuffisants, détournent clairement le DIFE de l’une de ses fonctions initiales primordiales : aider à la reconversion des élus en fin de mandat. Pour cela, nous demandons et attendons depuis longtemps une vraie loi et un vrai projet sur le statut de l’élu.
Faute d’un contrôle suffisant, le recours généralisé à la sous-traitance a pu priver d’effet bénéfique l’agrément demandé et accordé aux organismes de formation. Le texte vise à imposer de nouvelles obligations et une certification de qualité aux organismes concernés, pour mettre fin aux dérives nuisant à la qualité des formations.
Si les abus sont évidemment à combattre dans la facturation des formations, il convient de s’assurer que les droits des élus permettront un accès réel à ces dernières.
Pour rappel, le coût moyen des formations suivies par les salariés du secteur privé, via le compte personnel de formation, ou CPF, s’établirait autour de 1 200 euros, contre 700 euros pour le montant annuel du DIFE affecté à chaque élu. Notre groupe restera donc vigilant sur l’encadrement financier de cette réforme.
Mes chers collègues, bien que regrettant le recours à l’habilitation, force est de reconnaître que les mesures comprises dans ces ordonnances semblent nécessaires pour sécuriser temporairement la formation des élus, pour la rendre plus accessible et pour en assainir le cadre financier.
Ce n’est qu’un début ; malgré des réserves de fond et de forme, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, on dénombre sur notre territoire quelque 500 000 élus locaux.
Pour faire face à la complexité et à la technicité croissantes des compétences que requiert l’exercice de leur mandat, mais aussi pour préparer leur retour à une vie professionnelle, la loi a établi deux dispositifs de formation.
Le premier, introduit par la loi du 3 février 1992, dont notre collègue, Jean-Pierre Sueur, alors secrétaire d’État chargé des collectivités locales, est l’auteur, prévoit que les collectivités doivent budgéter chaque année un montant minimum équivalant à 2 % des indemnités dues aux élus, dans le but de financer des formations pour eux en lien avec l’exercice de leur mandat.
Le second, plus récent puisqu’il date de 2015, là encore créé par notre collègue Sueur et vous-même, madame la ministre, instaure un droit individuel à la formation des élus, le DIFE, abondé par les indemnités des élus locaux à hauteur de 1 % et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
Il ouvre plus largement droit à des formations non seulement en lien avec le mandat, mais aussi avec une future reconversion professionnelle.
Dans la pratique, et malgré des besoins importants pris en compte par ces dispositifs, il est apparu que ceux-ci n’ont permis qu’à une poignée d’élus de se former, que les communes les plus peuplées concentraient la quasi-totalité des efforts de formation et que le DIFE connaissait une situation déficitaire.
Il était donc nécessaire de refondre le système, afin de garantir effectivement cet accès à la formation indispensable pour tous nos élus.
Aussi, l’article 105 de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique du 27 décembre 2019 a habilité le Gouvernement à légiférer par ordonnances dans un délai de neuf mois à compter de la publication de ladite loi.
Un rapport, commandé par les ministres du travail et des collectivités territoriales auprès de l’inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, et de l’inspection générale de l’administration, l’IGA, afin de dresser un bilan des dispositifs existants, et remis en janvier 2020, confirmait ce constat et l’urgence à agir.
Les ordonnances portant réforme de la formation des élus locaux et de ceux des communes de Nouvelle-Calédonie, que nous nous apprêtons à examiner, certes, avec un peu de retard – n’oublions pas que la crise sanitaire a quelque peu bouleversé notre agenda –, viendront faciliter et moraliser l’accès à la formation des élus locaux.
Elles viendront le faciliter, tout d’abord, grâce à la création d’une plateforme numérique permettant aux élus de mieux visualiser leurs droits et les formations auxquelles ils peuvent s’inscrire. Elles le faciliteront aussi grâce à la modification des modalités de calcul du DIFE, comptabilisé dorénavant en euros et non plus en heures, ou encore grâce à la modernisation du recouvrement du fonds du DIFE, qui se fera par un prélèvement à la source des cotisations des élus.
Elles viendront le moraliser, ensuite, en renforçant les prérogatives du Conseil national de la formation des élus locaux et de la Caisse des dépôts et consignations dans la gestion du fonds du DIFE, et le maintien de son équilibre financier, ou encore en instaurant un contrôle plus accru des organismes de formations aptes à délivrer les formations aux élus locaux, afin d’éviter les abus.
Nous nous félicitons de ce que la commission – je souligne la qualité du travail de Mme la rapporteure – ait adopté l’amendement de notre collègue Alain Richard visant à anticiper les problèmes qui auraient pu se poser au moment de la transition.
Cet amendement tend à prévoir que les formations entamées avant le 22 juillet 2021 puissent se dérouler jusqu’à la fin de l’année. L’adoption d’une telle mesure assurera, à n’en point douter, une sortie plus douce du système actuel, tant pour les élus titulaires de droits que pour les organismes de formation.
Je tiens enfin à rappeler ici l’importance de la formation des élus dans les collectivités d’outre-mer, lesquelles, de par leur éloignement géographique, sont, au même titre que les territoires ruraux, confrontés à une ingénierie souvent plus modeste, à des difficultés réelles lorsque la collectivité est récente – je pense, bien évidemment, à mon territoire, Mayotte –, ou encore à une offre de formation moins diversifiée.
Au vu de nos échanges en commission et aujourd’hui en séance, il ne fait aucun doute que ce projet de loi recueillera l’assentiment de tous. En tout état de cause, mon groupe l’adoptera volontiers.
MM. Alain Richard et Jean-Pierre Sueur applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce texte est issu de l’habilitation que nous avons accordée au Gouvernement, de façon un peu forcée, il faut bien le dire, lors de l’examen, à la fin de 2019, du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique.
Vous êtes aujourd’hui, madame la ministre, en raison de la crise du covid, un peu en retard sur cette réforme, mais elle est enfin là ! Je salue la qualité des échanges que nous avons eus tout au long de sa conception avec les cabinets des ministres, tout d’abord avec celui de Sébastien Lecornu, dont l’action a été déterminante, puis avec le vôtre, depuis le remaniement.
Quelles raisons ont poussé le Gouvernement à réformer le système de la formation des élus locaux, sinon le constat d’un double échec ?
Échec à maintenir les coûts de formation à un niveau raisonnable, avec quelques organismes peu scrupuleux qui ont essoré un système ayant pu faire figure parfois de nouvel eldorado. Le rapport de l’IGA et de l’IGAS a été très explicite en la matière.
Échec également de la Caisse des dépôts et consignations, qui a affiché des dépenses totalement injustifiables et disproportionnées en matière de frais de gestion du fonds de formation, auxquelles s’ajoutent des délais de réponse démesurés, voire des non-réponses.
Madame la ministre, vous avez agi, et c’était nécessaire. Mais vous avez été bien plus loin que l’habilitation. Aussi, revenons-en aux termes de cette habilitation pour étudier votre réforme.
Le premier point concerne l’accès au droit à la formation tout au long de la vie, le compte personnel de formation et la portabilité des droits. La fongibilité entre le DIFE et le CPF ouvre de vraies passerelles entre le parcours d’un élu et son parcours professionnel. Sur ce point, nous ne sommes pas encore parvenus à un véritable statut de l’élu, mais c’est un pas en avant qui est toujours le bienvenu.
Le deuxième objectif de l’habilitation est de faciliter l’accès des élus locaux à la formation, tout particulièrement lors de leur premier mandat. Le point central de la réforme réside dans le passage des droits ouverts en équivalent heures et non plus en euros.
Je ne reviendrai pas sur le détail du calcul, mais j’insisterai sur un point de divergence que j’ai avec votre approche sur la fin du cumul du DIFE d’année en année tout au long du mandat.
Tout ne se joue pas la première année, madame la ministre. J’ai donc du mal à concevoir ce qui ferait obstacle à ce cumul dans le temps. Je prends acte néanmoins de l’amendement que vous avez déposé en séance et qui me semble nature à faire l’objet d’un compromis, en introduisant un plafonnement de ce cumul.
Le troisième point de l’habilitation est le référentiel de la formation et la mutualisation du financement. J’ai soulevé plusieurs interrogations quant à l’adaptabilité de ce référentiel aux problématiques nouvelles qui verront le jour et à sa nécessaire actualisation. Les réponses apportées m’ont plutôt convaincue.
Nous sommes donc dans le difficile équilibre à trouver : d’un côté, poser un cadre pour éviter que le contenu des formations ne dérive et, de l’autre, laisser suffisamment d’ouverture pour faire face aux besoins de formation pointue ou à l’évolutivité des matières traitées par les élus locaux.
Au rang des innovations intéressantes se trouve l’abondement du compte des élus par leurs collectivités, ce qui permet à la collectivité d’honorer son obligation de formation hors DIFE, mais aussi la possible intercommunalisation. En cela, je crois que le Gouvernement répond de façon opérationnelle à nos exigences.
Le quatrième et dernier axe de la réforme est d’assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation, ainsi que de renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation.
Ce point suscite davantage d’interrogations. Quels moyens humains et financiers seront mis en œuvre ? Quelles compétences seront mobilisées ? Je me pose également des questions sur les membres du nouveau conseil d’orientation ou sur la procédure d’attribution et de renouvellement désagréments. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de surveiller ces éléments d’alerte.
Pour finir, j’y insiste, la Caisse des dépôts et consignations devra rendre des comptes sur sa gestion. C’est un point dur sur lequel nous ne devons pas céder, chers collègues, compte tenu des leçons du passé.
De plus, j’ai noté l’engagement du Gouvernement sur un délai de réponse de sept jours à propos des dossiers de demande de prise en charge, ce qui est osé dans un contexte où la dématérialisation des procédures ne réglera pas tout, puisqu’un certain nombre d’élus locaux ne sont pas outillés ou connectés.
Mes chers collègues, le groupe du RDSE votera en faveur de cette réforme si nous parvenons aujourd’hui à un compromis.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis l’examen de la loi relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, nous avons laissé sur un coin de la table la réforme de la formation des élus. Nous nous retrouvons aujourd’hui autour de la ratification de ces ordonnances, dont les objectifs initialement fixés étaient assez ambitieux.
Le résultat du travail à huis clos du Gouvernement, méthode que nous ne cessons de dénoncer, est néanmoins décevant et risque fort de laisser les élus sur leur faim.
Face aux dysfonctionnements des dispositifs de formation actuels, des réponses fortes étaient attendues. Si nous approuvons plusieurs mesures, nous estimons qu’elles sont insuffisantes, voire qu’elles participent à la confusion.
Le travail en commission, grâce à l’adoption, notamment, de certains de nos amendements, a amélioré le texte en préservant des garanties quant aux droits des élus, comme leur cumulabilité, en donnant à ces derniers une meilleure visibilité, en offrant davantage de transparence ou encore en renforçant les obligations des organismes de formations ajoutées par les ordonnances.
Cela étant, rendre possible des abondements de la part des collectivités ou des élus eux-mêmes pour renflouer le gouffre financier du fonds pour le droit individuel à la formation des élus ne freine pas les inquiétudes.
Comment des communes qui ne respectent déjà pas leur obligation légale de financer la formation de leurs élus pourraient-elles, en plus, financer le DIFE ? Cela ouvre la voie aux inégalités entre les collectivités qui en seront capables et celles qui ne le pourront pas, donc aux inégalités entre élus.
Le principe de l’équilibre financier du DIFE inscrit ici ne pourra être respecté sans moyens nouveaux. Il est déjà déficitaire, alors que, aujourd’hui, moins de 3 % des élus bénéficient du DIFE. Qu’en sera-t-il demain ?
La gestion en euros, et non plus en heures, permettra de limiter les abus des organismes. Mais les élus craignent que les nouvelles règles aient un impact négatif sur leurs droits et sur le montant de leur cotisation.
La rémunération que s’accorde la Caisse des dépôts et consignations pour gérer le DIFE à hauteur de 25 % de l’enveloppe du fonds sera-t-elle revue à la baisse malgré la création de la plateforme numérique ?
Si les ordonnances ne suscitent pas d’avis défavorable, elles soulèvent des interrogations.
Depuis la loi de 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, les compétences des collectivités ont gagné en technicité. C’est pourquoi nous souhaitons réaffirmer le droit à la formation des élus créé par cette loi et nous déplorons que le financement de ce dispositif par les collectivités, qui sont tenues par la loi d’y consacrer entre 2 % et 20 % des indemnités des élus, soit sous-exécuté. Le non-respect de cette obligation touche inégalement les collectivités.
Les communes sont principalement concernées, et plus d’une sur deux n’a engagé aucune dépense de formation en 2018. Mais celles de plus de 200 000 habitants y consacrent 1, 9 % des indemnités, contre 0, 4 % dans celles de moins de 500 habitants.
Le coût de la formation pour ces petites communes peut se révéler prohibitif. Très souvent, les élus ne souhaitent pas faire passer leur propre formation avant des priorités d’intérêt général.
Pourtant, dans ces petites communes et communes rurales déjà pénalisées par l’insuffisance ou l’absence de services d’ingénierie, les besoins en formation sont plus forts qu’ailleurs. Cette problématique étant ignorée par le texte, nous avons proposé de réparer cet oubli.
En 2015, nous avons créé un second dispositif, le DIFE, financé par une cotisation obligatoire de 1 % des indemnités des élus. Cette voie indépendante de la collectivité permet aux élus de recevoir également des formations sans lien avec leur fonction, donc de favoriser leur réinsertion professionnelle.
Ces deux dispositifs se complètent et sont nécessaires pour démocratiser la fonction d’élu. Sa complexité croissante peut freiner les citoyens à s’engager, d’où la nécessité que les élus soient formés afin de ne pas réserver l’élection aux « élites » et aux technocrates. Parallèlement, la réinsertion professionnelle anticipe l’après-mandat et doit permettre un brassage des représentants politiques.
Nous constatons un déséquilibre entre les deux types de formations permises par ces dispositifs : celles qui sont liées à la reconversion professionnelle sont très peu utilisées et ne représentent que 3 % des demandes au titre du DIFE. Cette tendance est dommageable pour les élus et pour la démocratie.

En l’état, le texte n’est pas selon nous à la hauteur de ses ambitions. Il aurait mérité un travail incluant davantage le Parlement. Notre groupe préférera donc s’abstenir.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

M. Jean-Pierre Sueur . Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lorsque, en 1992, j’ai présenté ici même, au nom du gouvernement de l’époque, la première loi sur les conditions d’exercice des mandats locaux, j’étais loin d’imaginer que, au siècle suivant et quelques décennies plus tard, je continuerai à parler du même sujet !
Sourires.

Cette loi fut fondatrice : auparavant, il n’y avait pas de droit à la formation pour les élus locaux, non plus d’ailleurs que de droit à la retraite. Elle fut un premier pas. Depuis lors, il y en a eu d’autres.
Lorsque l’ancien président du Sénat Jean-Pierre Bel a organisé des états généraux de la démocratie locale, il eut le souci de les faire aboutir. À cette fin, il fit appel à une sénatrice et à un sénateur censés représenter des courants quelque peu différents, mais susceptibles de converger.
Sourires.

Cela nous permit d’écrire et de faire adopter deux propositions de loi, l’une qui a créé le Conseil national d’évaluation des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, l’autre portant sur les conditions d’exercice des mandats locaux.
Je crois que nous avons bien fait de créer ce droit individuel à la formation. Néanmoins, le réalisme doit nous inciter maintenant à reconnaître que, si le principe est bon, s’il est vraiment nécessaire qu’il y ait des formations servant à l’activité des élus et leur permettant de préparer leur avenir une fois leur mandat achevé, le dispositif doit désormais être beaucoup mieux encadré, pour des motifs financiers évidents et en raison de dérives que nous avons pu constater et qui ont été déjà soulignées.
Cette proposition de loi, madame la ministre, est donc nécessaire, et nous y souscrirons pour l’essentiel, comme nous le manifesterons par notre vote.
J’insisterai, et mon collègue Éric Kerrouche y reviendra également, sur la question de l’agrément des organismes.
En 1992, je n’étais pas partisan que les partis politiques puissent créer des instances de formation. J’étais minoritaire, y compris au sein du Gouvernement, on peut le dire maintenant. Je suis donc attentif au fait que, cela étant désormais possible, il est très important, madame le ministre, que la procédure d’agrément soit extrêmement forte – le rapport de l’IGA et de l’IGAS est à cet égard explicite.
Il faut une très grande rigueur quant aux compétences des organismes, quant à leur gestion, quant à leur indépendance et quant à la qualité et aux coûts de leurs formations.
À cet égard, je ne serais pas choqué que soient prises des décisions de retrait ou de suspension d’un certain nombre d’agréments : il s’agit d’argent public et d’une mission de service public.
Se pose toujours la question du recours relativement faible à la formation. Selon le rapport précité, seulement 3 % des élus suivent une formation chaque année.
Quant au droit à la formation, il est soixante fois plus élevé pour les conseillers régionaux que pour les conseillers municipaux. Pour ce qui est du DIFE, 50 % de la dépense est affectée à la formation de 14 % des bénéficiaires. Ces points doivent donc être réformés.
La démarche dont nous allons débattre est pragmatique. Nous serons vigilants sur la question des filiales, dont nous reparlerons.
Ce pragmatisme, c’est le recours à l’intercommunalité.

M. Jean-Pierre Sueur. Je conclus, monsieur le président, vous le voyez bien !
Sourires.

En l’état actuel des choses, on ne peut pas demander davantage aux communes. En revanche, la mutualisation opérée de manière souple, telle qu’elle est proposée par les intercommunalités, est une bonne idée.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question de la formation des élus se dessine quelque peu en clair-obscur. Je précise immédiatement que le groupe Union Centriste soutiendra les dispositions qui nous sont présentées.
Je voudrais en préambule vous remercier, madame la ministre, de votre présentation, mais surtout des efforts que vous avez prodigués afin d’aboutir à ces dispositions. Nous mesurons le travail qui a été réalisé par vous-même et par votre cabinet, que l’on sait très impliqué, et plus généralement la bienveillance et la bonne volonté qui ont présidé à ces travaux. Vous auriez pourtant pu trouver dans le rapport de janvier 2020 de l’inspection générale de l’administration, l’IGA, des éléments propices à moins de bienveillance…
Nous avons bien perçu la convergence de points de vue dans l’intervention de M. le ministre Jean-Pierre Sueur, qui vous a invitée à mieux cadrer les dispositions d’agrément. Il a même eu la courtoisie de nous faire part des réflexions ou des interrogations qui furent les siennes à certains moments, quant aux liens entre les centres de formation et les partis politiques.
Je vous remercie également, madame le rapporteur, de votre travail, de la bienveillance dont vous avez également fait preuve, de votre souci d’associer les nombreuses associations et fédérations d’élus locaux à la réflexion et de votre souhait d’améliorer le texte via deux amendements, sur lesquels Mme la ministre nous a d’ores et déjà indiqué qu’elle émettrait un avis favorable.
En parlant de clair-obscur, je fais tout d’abord référence au mécanisme des ordonnances. Plusieurs intervenants l’ont dit, le Sénat ne les aime pas. Or, dans ce cas précis, j’admets volontiers que vous n’en avez pas abusé, madame la ministre. Le travail réalisé a été très clairement partenarial et s’inscrit bien dans le mandat confié à votre ministère.
On peut parler de clair-obscur, ensuite, pour ce qui concerne la situation financière.
Notre pays est quelquefois étrange… Le Président de la République a parlé d’addiction à la dette ou au déficit. Sans revenir sur le principe du « quoi qu’il en coûte », nous réussissons à créer des déficits à peu près partout : budget de l’État, sécurité sociale, Unédic… Tout cela, vous le savez parfaitement. Pour ce qui est de la formation des élus locaux, un domaine auquel on n’aurait pas pensé spontanément à cet égard, nous avons collectivement accompli la performance d’atteindre un déficit de 24 millions d’euros !
Le clair-obscur s’impose, enfin, quand on considère l’importance du sujet.
On nous a dit à l’instant que seulement 3 % des élus locaux suivaient une formation, ce qui est très étonnant. Nous savons tous, pour avoir participé largement à la vie publique locale, que le besoin de formation est manifestement important, car la technicité des sujets augmente. Les demandes de formation sont pourtant très peu nombreuses.
Lorsque nous organisons des formations ou en favorisons la tenue, au sein des collectivités – cet exercice vous est certainement familier, mes chers collègues –, nous constatons que, en dépit de l’intérêt des sujets retenus, il y a très peu de participants.
J’évoquerai cependant deux exceptions.
La première concerne le DIFE : il existe un fort besoin en termes de reconversion professionnelle.
Pour revenir sur vos propos, madame le rapporteur, ces reconversions professionnelles ne sont pas toujours consécutives à des situations d’échec vécues par des élus déstabilisés parce qu’ils ne peuvent pas poursuivre leur mandat. Ces cas peuvent certes exister, mais on sait aussi que la vie professionnelle bouge beaucoup et que les carrières sont moins linéaires qu’auparavant. Surtout, certains élus locaux ayant découvert dans la vie locale des champs d’intérêt intellectuel qu’ils n’avaient pas encore abordés et qui les passionnent, ils ont envie d’approfondir leurs connaissances.
Dans ce cadre, le DIFE et les dispositifs que vous avez présentés, comme les plateformes, permettent de donner une réponse certes partielle, mais très intéressante.
La deuxième exception concerne les besoins de formations plus classiques. Je suis frappé par l’évolution des demandes au cours de la dernière année, depuis le renouvellement municipal. L’association des maires de mon département m’a ainsi indiqué que le champ des formations avait complètement changé, même s’il était difficile de les dispenser, compte tenu du contexte sanitaire.
Au temps jadis, les élus souhaitaient suivre des formations techniques, budgétaires ou relatives au droit de l’urbanisme. Aujourd’hui, leurs demandes sont totalement différentes, et portent sur des sujets que, à titre personnel, je n’aurais jamais imaginés.
Il peut ainsi s’agir de formations dans les domaines du coaching ou de la médiation, pour répondre à des problèmes que nous connaissons bien au Sénat : les élus locaux se trouvent de plus en plus souvent dans des situations de rencontre frontale avec nos concitoyens ; ils souhaitent donc bénéficier de formations adaptées à la gestion en première ligne des relations avec ces derniers.
Je tiens à saluer les préoccupations de stabilité financière et de transparence qui ont été exprimées. Les orateurs précédents l’ont indiqué : les établissements intercommunaux sont le bon niveau de formation.
Je souligne le souhait de Mme le rapporteur d’améliorer les dispositions présentées au travers de deux amendements, qui devraient recueillir un avis favorable.
Permettez-moi de formuler deux interrogations, sachant que je ne prétends nullement être un spécialiste de ces sujets et que je ne comprends pas toujours la différence marquée existant entre la formation des élus et celle de nos agents. Il conviendrait d’optimiser ce point, car les centres de gestion sont de véritables réservoirs de compétences. D’aucuns en sont spécialistes au sein de la commission des lois.
La séparation opérée entre élus et agents au niveau du CNFPT me choque quelque peu, à la fois, sur le plan technique et au regard de la situation de nos collectivités.
Pour en revenir aux situations de reconversion professionnelle, j’ai bien entendu qu’il y avait une fongibilité entre les fonds. Comment cela fonctionne-t-il entre privé et public ?
La plateforme prévue pour le DIFE est comparable à celle qui existe en matière de formation professionnelle dans le privé. Comment pourra-t-on cumuler, demain, les droits à la formation acquis lors de sa vie de salarié avec ceux qui ont été acquis au titre du DIFE ? Je serai attentif à ce que nos collègues élus aient le maximum de chances de mener à bien la reconversion professionnelle qu’ils souhaitent opérer.
Pour finir, je renouvelle le soutien du groupe Union Centriste au présent texte.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chacun sait que la formation est un enjeu essentiel, tant pour les élus que pour les agents territoriaux. Je me réjouis donc que le présent projet de loi vienne ratifier deux ordonnances et apporte une réponse aux difficultés d’un dispositif considéré par beaucoup comme largement insatisfaisant.
Depuis des années, une nouvelle réglementation de la formation des élus locaux était, en ce sens, attendue dans les territoires.
Certes, la loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat a doublé le droit à la formation des élus d’un droit individuel à la formation des élus, le DIFE, financé par un apport de 1 % de leurs indemnités versé à un fonds national géré par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC. Il s’agit pourtant d’une évolution insuffisante.
Chacun le sait, les résultats ont été contrastés et limités. Quelques chiffres permettent de l’illustrer : sur le terrain, moins de 3 % des élus locaux suivent annuellement une formation, et les collectivités n’y consacrent en moyenne que la moitié des sommes que la loi les obligerait à budgéter. En outre, si le texte de 2015 a permis un octroi des heures dès le début du mandat, il limitait cependant la prise en charge des frais.
J’ajoute que la réforme de la formation des élus est devenue particulièrement opportune avec l’arrivée de la crise sanitaire, compte tenu des défis que la situation impose aux élus.
De manière générale, l’armature financière globale du système de formation souffre de nombreux dysfonctionnements
Le premier de ces dysfonctionnements se caractérise par une contradiction inhérente entre la réalité de cette organisation financière et la volonté partagée de l’exécutif et du législateur de renforcer l’accès à la formation des élus. À titre d’exemple, la combinaison d’une sous-exécution chronique des dépenses potentielles, non plafonnées, du DIFE et d’une faiblesse du fonds de financement du DIFE, qui est quant à lui plafonné, entraîne une grande fragilité financière.
De nombreux organismes de formation peu scrupuleux ont, par ailleurs, abusé du recours à la sous-traitance. Ces derniers n’opéraient jusqu’à présent pas de contrôle de la qualité des formations dispensées, tout en pratiquant bien souvent des tarifs exorbitants. Cette situation a jeté l’opprobre et le doute sur le principe même de la formation.
Ces abus et dérives ont fragilisé la mission de la CDC, chargée de la gestion du fonds, dont les moyens humains demeurent par ailleurs insuffisants. Cette situation a naturellement suscité un embouteillage de dossiers, en allongeant mécaniquement l’ensemble des délais. Ces difficultés, et bien d’autres, justifient une réforme dont les ordonnances aujourd’hui proposées à la ratification constituent le cadre.
Face aux défaillances constatées du système, les objectifs définis par le législateur étaient déclinés de la façon suivante.
Le premier de ces objectifs visait, entre autres, à « permettre aux élus locaux de bénéficier de droits individuels à la formation professionnelle tout au long de la vie et d’accéder à une offre de formation plus développée, en mettant en place un compte personnel de formation analogue » à celui qui existe en droit commun.
Le deuxième était de faciliter l’accès des élus locaux à la formation.
Le troisième prévoyait de « définir un référentiel unique de formation en s’adaptant aux besoins des élus locaux, en garantissant une offre de formation accessible dans les territoires » – on sait ce qu’il en est des inégalités à cet égard – et de « mutualiser le financement entre les collectivités et leurs établissements publics de coopération intercommunale ».
Le dernier objectif était d’« assurer la transparence et la qualité des dispositifs de formation et renforcer le contrôle exercé sur les organismes de formation des élus locaux ».
Je veux saluer très largement les travaux conduits par la commission des lois, en particulier par Françoise Gatel.
Tout en approuvant la démarche du Gouvernement visant à assainir la situation financière du système et à renforcer les droits des élus, la commission a souhaité, en adoptant quinze amendements, améliorer le dispositif, en vue de renforcer les garanties relatives aux droits des élus à la formation ; d’améliorer la prévisibilité financière du système ; d’affermir le contrôle des organismes de formation et même parfois les rendre effectifs, ce qui est la moindre des choses ; enfin, de préserver les droits acquis à la formation des élus.
Ces amendements tendent à rétablir des équilibres et garanties bienvenus. Ce texte devrait donc nous permettre de franchir une étape importante pour rendre plus opérationnel un véritable droit à la formation des élus, lequel est une condition essentielle du bon exercice de leur mission, mais également une voie indispensable pour favoriser la nécessaire montée en compétences des élus.
Par conséquent, je suis en parfait accord avec le texte proposé.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

M. Éric Kerrouche. Tout d’abord, nous ne débattrions pas de ce projet de loi aujourd’hui sans les travaux précurseurs de Jean-Pierre Sueur, datant de 1992, et sans ceux qu’il a menés en 2015 avec vous, madame la ministre, lorsque vous siégiez sur ces travées. Et il continue à sévir…
Sourires.
Nouveaux sourires.

On peut décerner un satisfecit global au travail réalisé, notamment par la commission des lois, sur le présent texte. Les orateurs précédents ont souligné les avancées réalisées ; elles sont réelles et s’ajoutent aux améliorations qui avaient été suggérées par Mme le rapporteur Françoise Gatel.
Ces ordonnances montrent que nous sommes arrivés au bout d’un système. Il est nécessaire de mettre en place un véritable statut de l’élu.
Le satisfecit ne saurait être complet. En effet, la réforme a une connotation trop budgétaire. Elle excède pour partie le champ de l’habilitation accordée au Gouvernement par le Parlement. Elle s’inscrit dans la perspective d’un statut de l’élu qui n’existe qu’en creux.
Madame la ministre, je pense que ce texte est en deçà des attentes que vous aviez en tant que sénatrice. Nous pouvons encore faire mieux.
Le questionnaire que nous avions envoyé en 2018 aux élus locaux faisait ressortir deux éléments : tout d’abord, la question de la formation est essentielle pour les élus ; ensuite, ces derniers souhaitent davantage de formations.
J’évoquerai trois points de questionnement et des pistes d’amélioration.
Il faut tout d’abord partir de la sous-utilisation, soulignée par les orateurs qui m’ont précédé, des possibilités de formation et de leur concentration sur quelques élus – en bref des raisons pour lesquelles les dispositions de la loi de 2015 ne s’appliquent pas, ou mal. La sous-budgétisation des collectivités locales traduit également un manque de moyens.
Le DIFE permet de financer un accompagnement à la validation des acquis de l’expérience, la VAE, et au bilan de compétences. Mais il ressort des résultats du questionnaire du Sénat que 83 % des répondants ignoraient cette possibilité…
Plus fondamentalement, la tripartition de l’espace électif n’est pas prise en compte. Il existe en France une opposition entre deux catégories d’élus : les simples conseillers – ce terme n’est pas péjoratif – et les exécutifs, au sein desquels il y a aussi une dualité – d’une part, les maires et adjoints de petites ou moyennes communes, et, d’autre part, les exécutifs des communes les plus grandes.
Qu’observe-t-on ? Les maires ruraux, qui sont au centre des dispositifs dans les petites communes, ne peuvent accéder à une formation qui leur est pourtant très nécessaire, justement en raison de leur manque de moyens et d’ingénierie.
Par ailleurs, le groupe intermédiaire des élus bénéficie de formations techniques très précises, par exemple sur les déchets ou les mobilités. Il aurait été normal de prévoir, pour cette catégorie comme pour celle des exécutifs des collectivités les plus grandes, non seulement une variabilité du prélèvement sur l’indemnité, mais aussi une variabilité du quota d’heures disponibles. À défaut, il n’y aura pas de démocratisation de ce point de vue.
J’en viens à ma conclusion. Dans la sociologie des professions, deux critères permettent de marquer la professionnalisation : tout d’abord, l’exercice d’une activité rémunérée ; ensuite, une formation spécifique pour remplir cette activité.
L’actuel statut de l’élu fait comme si cette formation ne participait pas de la professionnalisation. Il faut rompre avec cette logique et construire, enfin, un statut de l’élu qui permette une véritable professionnalisation et, surtout, je le précise, une authentique démocratisation.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les ordonnances dont ce projet de loi nous propose la ratification étaient largement attendues par les élus locaux. Elles visent juste lorsqu’elles opèrent, à la fois, le renforcement des droits des élus à la formation et l’assainissement budgétaire du fonds DIFE.
Même si le champ de l’habilitation, madame la ministre, ne semble pas avoir été intégralement respecté, la commission des lois a fait le choix d’accepter cette ratification. À titre personnel, j’approuve naturellement cette position. En effet, dès lors que seule une très faible minorité d’élus locaux recourt actuellement au DIFE et que, par ailleurs, le budget du fonds est largement dépassé – il a même explosé –, il convient d’agir rapidement, à la fois sur les dépenses et sur les recettes.
Tel est l’objet de l’ordonnance n° 2021-45, qui prévoit que les droits individuels à la formation seront comptabilisés non plus en heures, mais en euros, afin d’induire une diminution du prix moyen des heures de formation dispensées.
C’est également ce qui est prévu lorsque sont introduites de nouvelles modalités de cofinancement des formations des élus locaux, que ce soit par les collectivités locales, qui pourront abonder le compte DIFE après délibération, ou par les élus eux-mêmes, qui pourront abonder leur compte DIFE de droits issus de leur compte personnel de formation.
S’y ajoutent des dispositifs rénovés de mutualisation des dépenses de formation au niveau intercommunal. C’est très utile pour les petites communes, dont les orateurs précédents se sont tous inquiétés.
Citons aussi la possibilité pour la CDC de consentir, en cas de déséquilibre du fonds DIFE, une avance de trésorerie. Dès lors, on peut assurément envisager avec confiance une meilleure réponse, à l’avenir, à cette légitime attente des élus en matière de formation.
Pour autant, la commission des lois a estimé que le dispositif proposé pouvait encore donner lieu à certaines améliorations. Elle a ainsi décidé, sur la proposition de Mme le rapporteur, de rétablir la possibilité de cumul du DIFE sur toute la durée du mandat des élus, afin de permettre à ceux-ci d’utiliser leurs droits sur plusieurs années.
La commission a également décidé d’élargir les possibilités d’abonder le fonds à l’État, à Pôle emploi, ainsi qu’à d’autres collectivités territoriales, afin de financer au titre du DIFE des formations de réinsertion professionnelle, notamment en fin de mandat.
La commission a enfin permis que les élus locaux puissent s’inscrire, dès la première année de leur mandat, à des modules de formation leur permettant d’acquérir les connaissances indispensables à l’exercice de leur mandat.
Ces modifications, madame la ministre, madame le rapporteur, sont particulièrement bienvenues et adaptées à la situation des élus locaux.
Je reviens sur la dernière modification que j’ai citée : il est très important qu’un élu local en début de mandat puisse bénéficier au plus vite de la formation indispensable à la mise en œuvre de ces nouvelles attributions. Trop souvent par le passé, pour des raisons de méconnaissance ou d’indisponibilité de l’offre de formation, les élus locaux ne bénéficiaient que tardivement des formations nécessaires. Cela peut désormais être corrigé.
De même, à l’approche de la fin du mandat, les élus en quête de réinsertion professionnelle pourront mieux que par le passé profiter, grâce à des financements élargis, de formations individualisées adaptées à leur profil professionnel. Cette dernière possibilité est à mon sens très importante et trouvera sa place dans ce statut de l’élu que nous sommes nombreux à appeler de nos vœux.
Certes, la CDC doit encore mettre en œuvre la plateforme de formation pour les élus, qui permettra un accès dématérialisé et rapide au montant de leurs droits personnels, comme aux formations éligibles. Gageons cependant que cette réforme de la formation, tant attendue par les élus et si légitime, trouvera rapidement son public.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à vous remercier de vos interventions ; elles témoignent de l’esprit de responsabilité qui nous anime collectivement sur ce sujet.
Le Gouvernement partage avec vous l’objectif de réduction des frais de gestion des dossiers par la CDC.
J’ai bien noté les difficultés rencontrées par les petites communes, dont vous avez tous parlé. C’est pour elles que nous avons prévu la disposition visant à permettre aux EPCI d’apporter une contribution financière.
La procédure d’agrément, cher Jean-Pierre Sueur, sera considérablement renforcée, avec l’introduction d’un critère de régularité de gestion de l’organisme. La CDC pourra également faire part de ses alertes au Conseil national de la formation des élus locaux, le CNFEL, ce qui est très important.
Pour ce qui concerne la formation des agents et des élus, un consensus se dégage pour maintenir deux systèmes distincts de formation, l’un plutôt d’ordre professionnel, l’autre davantage axé sur la mission de responsabilité politique des élus.
Le cumul des droits du DIFE et de ceux du contrat de formation professionnelle sera possible uniquement en vue d’une réinsertion professionnelle. Ce sera très facile : il suffira de faire un clic sur son ordinateur.
Je ne reprendrai pas tout ce qui a été dit lors de la discussion générale. Nous avons mené un travail tout à fait positif avec la commission, dans un esprit d’équilibre. Il était absolument nécessaire de réformer, mais aussi de renforcer l’effectivité de ce droit essentiel pour les élus.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Mes chers collègues, je vous prie de faire preuve de concision, afin que nous puissions achever l’examen du présent texte vers treize heures trente.
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ratifiée.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous étudions un texte qui concerne tous les élus.
Je souhaite d’ailleurs y associer ces élus de proximité que sont les 443 conseillers des Français de l’étranger, désignés au suffrage universel direct pour un mandat de six ans par les 2 millions, ou presque, de nos ressortissants établis à l’étranger. Ils siègent dans les conseils consulaires, qui sont en quelque sorte nos conseils municipaux. Répartis sur les cinq continents, ils demeurent des élus de la République attachés à l’exercice de leur mandat.
La formation n’est pas seulement utile ; elle est essentielle pour nos élus locaux, d’autant que nombre d’entre eux siégeront pour la première fois en juin prochain.
Le législateur a prévu en 1992 le financement par les collectivités des formations demandées par les élus. Le droit individuel à la formation des élus, le DIFE, introduit en 2015 et ouvert à tous les élus, indemnisés ou non, donne droit à vingt heures de formation par an.
Ce droit individuel vise non seulement à perfectionner les connaissances des élus en tant que tels, mais aussi à acquérir des savoirs spécifiques, précieux dans l’exercice du mandat. Tout cela a été rappelé par les orateurs précédents.
L’article 24 du décret du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires à l’Assemblée des Français de l’étranger et à leurs membres prévoit que les conseillers des Français de l’étranger reçoivent une formation pour couvrir l’ensemble de leurs domaines de compétence, avec un accès aux actions de formation organisées localement au bénéfice des personnels diplomatiques et consulaires.
Pourtant, ce décret ne semble pas suffisamment appliqué depuis six ans. En effet, les élus se sont plaints régulièrement de ne pas avoir eu accès à une formation, la majorité des postes diplomatiques semblant ignorer que cette possibilité doit leur être offerte.
Ce dispositif a été renforcé dans le cadre de la loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui, dans son article 111, prévoit également pour les conseillers des Français de l’étranger un droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Ces formations, pilotées par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, devraient être organisées à distance ou lors des sessions de l’Assemblée des Français de l’étranger. Au vu du renouvellement qui aura lieu en mai 2021, il serait bon qu’elles puissent leur être offertes au plus tard à la rentrée prochaine.
Je voudrais également souligner la nécessité de prévoir des formations accessibles à tous, qui soient dispensées en présentiel dès que cela sera possible, afin que les conseillers puissent interagir avec leurs formateurs et leur poser des questions.
Cependant, j’imagine que ces élus ont aussi droit, comme tous les élus de la République, à des formations dispensées par tout autre organisme de formation agréé. J’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi les conseillers des Français de l’étranger seraient les seuls élus à ne bénéficier que d’une seule formation, dispensée par une seule administration. Affaire à suivre, donc !

Madame la ministre, la mise en place du droit individuel à la formation des élus a été une très bonne initiative dont je vous félicite encore, ainsi que Jean-Pierre Sueur. Chaque élu a pu avoir accès à une formation destinée à l’aider dans l’exercice de ses fonctions. Néanmoins, le DIFE a suscité des abus, qui sont à l’origine des modifications que vous proposez.
Le problème de ce projet de loi est qu’il renvoie à des ordonnances dont nous ne maîtrisons pas le contenu. Comme c’est le Gouvernement qui tient la plume, il pourra en écrire et réécrire les différentes dispositions au fil du temps…
J’ai l’impression que ce sont les petites associations locales d’élus, et non les grandes structures de formation, qui vont payer les frais des nouvelles mesures correctives.
En effet, un certain nombre d’associations départementales de maires organisent, pour le compte de leurs membres – maires, adjoints, conseillers municipaux –, des formations adaptées aux besoins qui se font ressentir sur le terrain : c’est de l’artisanat, du cousu main, du « mijoté », bref de la formation aux petits oignons, et cela pour des coûts très nettement inférieurs à ceux qui se pratiquent dans les grands cabinets.
Comme ces formations sont adaptées, elles rencontrent un grand succès et sont bien suivies, à la plus grande satisfaction des élus. Former des élus en nombre avec des coûts maîtrisés : les associations départementales des maires savent le faire.
Certes, toutes les associations départementales ne dispensent effectivement pas de formations, mais il faut préserver celles qui le font, parce qu’elles le valent bien et parce qu’elles le font bien. Mon impression est que l’on veut, et c’est un peu un mal français, de nouveau tout recentraliser autour de grands cabinets ou de grandes structures, alors que, localement, on sait faire mieux et avec moins.
Pour l’Association des maires du Haut-Rhin que je préside, il est tout de même plus simple de faire appel à un avocat strasbourgeois qui connaît le droit local qu’à un avocat parisien aussi « agrémenté », labellisé ou certifié qu’il soit…
Nos associations d’élus ont leurs agréments et elles sont contrôlées. Chaque élu disposait d’un quota de vingt heures de formation. Encadrer le prix de l’heure de formation est une très bonne chose, qui aurait dû être faite dès le départ, ce qui aurait peut-être permis d’éviter certains abus.
Pour résumer rapidement mon propos, madame la ministre, faites confiance aux associations départementales de maires dans votre réforme de la formation des élus locaux. N’y allez ni trop vite ni trop fort !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La confusion entre les deux dispositifs est entretenue dans les ordonnances, ce qui ne permet pas de sortir des difficultés.
C’est la raison pour laquelle nous voulons conforter le financement lié à l’application de la loi de 1992, tout en renforçant le DIFE et le rôle du Conseil national de la formation des élus locaux. Nous reviendrons sur ces sujets via nos amendements, mais les propositions du Gouvernement nécessitent d’être encadrées par des garanties.
Enfin, nous ne comprenons pas que notre amendement visant simplement à consacrer les deux voies de formation ait été déclaré irrecevable, alors qu’il ne tendait pas à créer de nouvelles charges.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par M. Klinger, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Courtial, Paccaud et Pellevat, Mme Deromedi, MM. Cardoux et Meurant, Mmes Dumont et Noël, MM. Bonhomme et Lefèvre, Mmes Deroche et Lassarade, MM. Milon, Mouiller, Laménie, Rapin et Brisson, Mme Muller-Bronn, MM. Savary, Rietmann, Perrin et D. Laurent, Mmes Garnier et Drexler, MM. Bouchet, B. Fournier, Rojouan et Sautarel, Mme Gosselin, M. Cuypers et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du I de l’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « à un seuil fixé à 200 000 euros ».
La parole est à M. Christian Klinger.

Cet amendement vise à fixer à 200 000 euros le seuil pour les organismes titulaires d’un agrément qui exercent une activité de formation.
L’objectif est de ne pas renvoyer à un décret la fixation de ce montant qui, d’après ce que nous entendons dans nos associations départementales et à l’AMF (Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité), pourrait être de 100 000 euros. Ce montant pénaliserait les petites structures comme les associations départementales. En effet, au-delà de ce seuil, il faudrait obtenir une certification dont nous ne connaissons pas les modalités.
Je le rappelle, madame la ministre, les associations départementales d’élus qui organisent de la formation ont reçu un agrément après avis du Conseil national de la formation des élus locaux, et elles sont suivies par votre ministère.
Mon amendement tend à promouvoir le rôle des associations départementales dans la formation des élus locaux, car celles-ci jouent un rôle important en matière de formation sur le terrain.
C’est aussi un message que nous vous adressons : nous sommes 33 sénateurs à avoir cosigné cet amendement en vingt-quatre heures, ce qui n’est pas anodin. Le sujet est réel, et le mécontentement gronde dans les associations départementales d’élus, comme en témoignent les appels téléphoniques passés entre les directeurs et les présidents.
Certes, vous avez en face de vous l’AMF, mais il me semble que celle-ci a quelque peu oublié en chemin nos associations…
Sourires sur les travées du groupe RDPI.

M. Christian Klinger. Néanmoins, si d’aventure dans votre décret apparaissait le montant de 200 000 euros pour les associations départementales d’élus, madame la ministre, il est certain que mon amendement s’autodétruirait… Ce n’est donc pas Mission impossible pour vous !
Sourires.

Mon cher collègue, vous rendez hommage à raison aux associations départementales de maires – Antoine Lefèvre les a évoquées, et j’ai moi-même eu le bonheur d’en présider une –, qui se sont engagées dans la mise en place de formations pour les élus. Nous reconnaissons ce qu’elles ont fait, et notre travail a été conduit en étroite concertation avec les associations d’élus.
S’agissant de la notion de seuil, le Sénat n’aime pas, un peu par religion je dois le reconnaître, fixer des seuils, parce que ces seuils paraissent trop ingénieux pour être pertinents dans le temps. Nous ne disposons pas aujourd’hui d’étude d’impact nous permettant de dire si le seuil doit être de 200 000 ou de 100 000 euros. Cela doit être fixé non pas dans la loi, mais de manière réglementaire.
Je sais qu’un travail très étroit de concertation est mené entre le Gouvernement et les associations d’élus, comme me l’a confirmé l’AMF, et je ne doute pas que ce qui doit être élaboré au niveau réglementaire le sera de manière constructive.
Sachez que je suis très sensible à votre amendement, que je considère comme un amendement d’appel, pour reconnaître collectivement que les associations de maires ont, si je puis dire, une nature de formatrices.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, sinon l’avis sera défavorable. Néanmoins, je tiens à exprimer une nouvelle fois ma gratitude aux élus locaux pour leur engagement sur ce sujet.

Mme la rapporteure et moi-même – nous sommes d’ailleurs toutes deux d’anciennes présidentes d’associations de maires – allons continuer la concertation, pour fixer le montant qui figurera dans le décret que je vais publier. Comme vous l’avez dit dans votre première intervention, monsieur le sénateur, nous faisons confiance aux élus locaux, auxquels je prête une grande attention.
Par ailleurs, j’ai effectivement déjà eu des discussions avec l’AMF, et je ne puis croire que vous n’ayez pas été consulté.
Enfin, je voulais vous faire remarquer que, lorsque la loi fixe des seuils, des chiffres ou des dates, cela pose toujours des problèmes. Par exemple, si la date des élections est fixée dans la loi – vous voyez à quoi je fais allusion ! –, il faut revenir dessus… Et si l’on fixe des seuils, il faut les modifier régulièrement.
La sagesse consiste donc plutôt à prévoir que le seuil relève du domaine réglementaire et qu’il sera fixé par décret, ce qui offre davantage de souplesse, permet la négociation et d’éventuelles adaptations ultérieures.
Par conséquent, si vous pouviez retirer votre amendement, cela nous ferait très plaisir !

M. Christian Klinger. Être dans le dialogue, ce n’est pas Mission impossible… L’amendement s’autodétruit donc, puisque je le retire, monsieur le président !
Sourires.

L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
L’amendement n° 4, présenté par Mmes Gréaume, Cukierman, Assassi, Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 2123-14-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil municipal des communes membres ayant transféré la compétence. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fixe le montant entre ces deux seuils et fait connaître sa base de calcul. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Le Gouvernement propose dans ces ordonnances de favoriser la mutualisation du droit à la formation des conseillers municipaux au niveau des intercommunalités. Plus précisément, l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-45 renforce les possibilités et obligations de délibération des EPCI en matière d’exercice du droit à la formation.
Ces dispositions ont pour but d’encourager la fixation d’orientations communes et la mise en commun d’outils, ainsi que la participation financière à ces formations liées à l’exercice du mandat.
Face aux difficultés que rencontrent de nombreuses communes pour répondre à leurs obligations en matière de droit à la formation des élus, la mutualisation peut être une solution, notamment d’un point de vue financier.
Rappelons que, dans une commune de moins de 2 000 habitants, la dépense moyenne par élu n’atteint que 9 euros par an, contre 376 euros dans une commune de plus de 100 000 habitants. Nous le répétons, des solutions doivent être trouvées pour résoudre ce paradoxe inéquitable et anti-redistributif, qui dessert les petites communes.
Les mairies ont déjà la possibilité de transférer à l’EPCI leur compétence en matière de formation, mais elles le font très rarement. Cette mutualisation peut permettre de rassembler les élus autour d’enjeux partagés dans une dynamique collective et de rencontre, mais les relations entre EPCI et communes et la « confiance » des élus envers ces structures risquent de freiner ce mouvement.
Comme nous l’avons relevé dans le rapport sénatorial sur l’exercice des mandats locaux, les élus sont prudents et craignent une régression de leurs droits en l’absence de dispositions législatives claires sur le mode de calcul du budget « formation » en cas de mutualisation.
Nous proposons donc, par cet amendement, de sécuriser juridiquement les modalités financières de mutualisation, en reprenant les règles prévues pour les communes.

Je remercie Michelle Gréaume de son amendement : elle connaît bien le sujet, puisqu’elle a contribué avec Antoine Lefèvre et François Bonhomme au rapport de la délégation.
L’amendement est intéressant, car il vise à mettre en avant l’intérêt de la mutualisation de la formation qui a été évoquée par nos collègues Philippe Bonnecarrère et Raymonde Poncet Monge. En effet, comment permettre au maximum d’élus, notamment des plus petites communes, d’avoir accès à la formation ? Dans cette perspective, la mutualisation au sein de l’intercommunalité est intéressante, me semble-t-il.
Cela me permet de vous encourager, madame la ministre, à continuer de faire œuvre de souplesse, comme nous le recommandons au Sénat, en imaginant des mutualisations qui ne nous condamnent pas à des transferts obligatoires de compétences. En effet, nous sommes convaincus ici, au Sénat, et nous ne désespérons pas de vous convaincre prochainement que ces transferts ne sont pas forcément l’alpha et l’oméga.
Dans la proposition que vous formulez, ma chère collègue, vous évoquez le cas dans lequel les communes décident de transférer à l’intercommunalité leur compétence.
Dans ce cas, mais nous demanderons confirmation à Mme la ministre, la loi prévoit qu’il y a transfert des obligations. L’intercommunalité devra donc inscrire des dépenses d’un montant équivalent à celles des communes, c’est-à-dire entre 2 % et 20 % des indemnités de fonction. L’amendement est donc satisfait par la loi, mais vous serez peut-être davantage convaincue si Mme la ministre vous confirme mon propos.
La mutualisation sous toutes ses formes, notamment par des groupements de commandes, permettra effectivement de diminuer les coûts et d’augmenter le nombre d’élus qui auront accès à la formation.
Je demande donc le retrait de cet amendement, puisqu’il est satisfait.

Je confirme tout à fait le propos de Mme la rapporteure.
Deux solutions se présentent : soit la compétence est transférée, et les intercommunalités sont soumises aux mêmes obligations de financement que les communes ; soit elle ne l’est pas, et l’EPCI peut alors participer au financement de la formation des élus communaux.
Madame la sénatrice, il me semble que vous pouvez retirer votre amendement.

L’amendement n° 4 est retiré.
L’amendement n° 3, présenté par Mmes Gréaume, Cukierman, Assassi, Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi rédigée : « Ce conseil est composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, d’élus locaux représentatifs de la diversité politique et de l’ensemble des collectivités. »
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Le Conseil national de la formation des élus locaux, le CNFEL, est l’organe consultatif qui s’est vu confier le soin de définir les orientations des formations proposées aux élus. Cette instance régule le marché de la formation, en donnant un avis sur les décisions ministérielles d’agrément délivré aux organismes de formation.
La présente ordonnance renforce le rôle du CNFEL, et les ajouts de la commission des lois le confortent également en encadrant ses nouvelles missions. Le Conseil devra notamment s’assurer de l’équilibre financier du fonds DIFE, formuler des propositions au Gouvernement pour le rétablir, puis donner un avis assez contraignant sur le projet de rétablissement de l’équilibre financier.
Nous espérons que cette amélioration apportée par la commission demeurera dans le texte, tout comme la formulation de prévisions du montant des droits des élus. Nous tenons également au caractère public du rapport annuel qu’il devra établir sur la formation et sur la gestion du DIFE.
Alors que le CNFEL gagne en importance, nous sommes étonnés que le Gouvernement ait profité de la réécriture législative du rôle de cette instance pour supprimer la disposition prévoyant que le Conseil était composé au moins pour moitié d’élus locaux.
Nous proposons donc, par cet amendement, le rétablissement de cette précision : il nous semble important que le Conseil conserve cette parité entre personnalités qualifiées et élus.
Nous en profitons également pour rappeler dans la loi que les membres du Conseil doivent représenter le pluralisme politique et l’ensemble des collectivités territoriales, afin d’y assurer au mieux la représentation de tous les élus locaux.

Ma chère collègue, vous évoquez la nécessité de représenter l’ensemble des collectivités dans leur diversité.
Il s’agit des différentes catégories de collectivités, mais aussi des diverses tailles de ces dernières, sans oublier que, en plus des territoires métropolitains, il faut représenter les territoires d’outre-mer. Ce sont les associations d’élus qui sont chargées de la désignation des membres, comme c’est habituellement le cas.
Vous demandez également que le pluralisme politique soit représenté, ce qui me pose problème. Vous le savez, dans la plupart des communes de France, les élus sont sans étiquette politique et ne veulent surtout pas en avoir. L’exercice me semble donc difficilement réalisable, même si je souscris comme vous à la nécessité de représentation des équilibres entre familles politiques dans les organismes.
Il appartiendra donc à chaque famille politique d’être très attentive et d’éveiller, si cela était nécessaire, l’attention des associations d’élus à cette représentativité politique.
Le reste de votre amendement est satisfait, mais ce point n’est pas acceptable, car il est techniquement infaisable. Je vous remercie de ce rappel à l’ordre, si je puis dire, mais je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, sinon l’avis de la commission sera défavorable.

Mes arguments sont exactement les mêmes que Mme la rapporteure. J’en ajoute simplement un qu’elle ne pouvait donner : je m’engage formellement à prévoir un pourcentage de 50 % d’élus dans le décret que je prendrai.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.
À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ». –
Adopté.
La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : «, cumulable sur toute la durée du mandat ».

L’amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après le mot :
mandat
insérer les mots :
dans la limite d’un plafond
La parole est à Mme la ministre.

Mesdames, messieurs les sénateurs, votre commission a souhaité rétablir de manière explicite le caractère cumulable des droits accordés annuellement aux élus dans le cadre du DIFE. Je le comprends parfaitement, mais ce principe doit être concilié avec l’objectif de pérennité financière du DIFE.
C’est pourquoi le Gouvernement propose que le montant global des droits cumulables puisse être plafonné, comme c’est d’ailleurs le cas pour le compte personnel de formation.
Ce plafond permettra d’éviter que les droits accordés annuellement aux élus ne soient réduits par anticipation des dépenses importantes qui pourraient découler de la consommation en fin de mandat des droits accumulés.
Permettez-moi d’illustrer ce qui pourrait se produire si vous ne prévoyez pas un tel plafonnement. Supposons que le nombre d’élus bénéficiaire du DIFE demeure, comme en 2020, autour de 13 000 élus et que l’enveloppe accordée annuellement aux élus s’élève à 700 euros. Au bout de six ans, la consommation des droits accumulés par ces 13 000 élus susciterait une dépense annuelle de plus de 54 millions d’euros, alors que les recettes du fonds s’élèvent à 16 millions par an.
Cet exemple montre qu’il est nécessaire de prévoir un plafonnement.

C’est un point sur lequel nous avons, je le crois, cheminé de manière exigeante et positive.
Au départ, l’ordonnance n’intégrait pas le cumul des droits acquis chaque année. Il nous a semblé que cet oubli devait être bien involontaire et commis à l’insu de tous ! Mais la vigilance du Sénat est bien connue, et notre attention a été attirée par ce sujet.
Comme dans le droit commun, il doit y avoir un cumul des droits, puisque ces derniers sont acquis. Toutefois, comme nous l’avons dit précédemment, et comme l’a indiqué Mme la Ministre, nous devons faire preuve, même si c’est à regret, de responsabilité sur ce sujet.
Aujourd’hui, nous essayons d’assainir une situation très difficile. Il serait dommage que nous ne fassions pas preuve de la même responsabilité en ne sécurisant pas la fin du dispositif.
En effet, je le rappelle, tous les six ans, la fin des mandats donne lieu à une sorte de bulle de crise, avec une forte augmentation des demandes de fonds. Dans six ans, ceux qui parleront de ce sujet ne pourraient que nous en vouloir d’avoir été quelque peu inconséquents…
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement. Toutefois, j’attire l’attention du Gouvernement sur le plafonnement qu’il introduit. J’entends la notion de préservation de l’intérêt des élus, et je remercie Mme la ministre d’avoir accepté de présenter cet amendement, mais il faut que ce soit un vrai plafond, et non un plancher de plafond, si j’ose dire. Ce sera l’épisode suivant…
Je le répète, par souci de responsabilité, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er ter est adopté.
Le second alinéa du 3° du I de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12, L. 7227-12 du présent code. » ;
2° Au début de la seconde phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État, de Pôle Emploi ou d’une autre collectivité territoriale, ou » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »

L’amendement n° 8, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
des droits individuels
par les mots :
du droit individuel
La parole est à Mme le rapporteur.

La présentation de cet amendement me donne l’occasion d’apporter des réponses aux questions posées par nos collègues André Reichardt et Philippe Bonnecarrère, car ces réponses existent, et elles sont satisfaisantes.
On l’a dit, le droit individuel à la formation, qui est à la main de l’élu, peut être abondé de différentes manières, qui sont cumulables.
La collectivité peut décider d’abonder les droits de l’élu dès lors qu’elle a pris une délibération pour fixer le cadre de son intervention, et cela, pour répondre à Philippe Bonnecarrère, afin qu’il y ait une transparence totale et qu’aucun élu, parce qu’il serait de l’opposition ou subirait les humeurs du maire, ne soit écarté du dispositif. Les droits acquis à titre personnel en vertu de son activité professionnelle peuvent également abonder le dispositif.
Je le rappelle, le compte personnel de formation, pour tous les salariés en droit commun, est géré par le ministère du travail. Il faut trouver un moyen de coordination qui permette d’éviter qu’une autre organisation n’intervienne en complément.
Je confirme que ce sera bien le cas grâce à cet amendement rédactionnel : il s’agit, pour l’essentiel, d’une histoire de tuyaux, car nous souhaitons que le dispositif soit le plus simple et le plus efficace possible.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er quater est adopté.
Après le huitième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l’article L. 1221-1 formule chaque année des prévisions triennales sur les perspectives financières et les conditions de l’équilibre financier du fonds pour le financement du droit individuel à la formation, qui incluent une estimation prévisionnelle du montant annuel des droits que les élus acquièrent. »

L’amendement n° 9, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Après le huitième alinéa
par les mots :
Le 3°
2° Remplacer les mots :
, il est inséré
par les mots :
est complété par
II. – Alinéa 2
Après les mots :
à la formation
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er quinquies est adopté.

L’amendement n° 10 rectifié, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La première phrase du premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 6 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est complétée par les mots : « dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Après le sigle : « CFP », sont insérés les mots : «, dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. » ;
2° Le mot : « et » est remplacé par les mots : « Il est ».
III. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet équilibre est apprécié sur une période de trois ans. » ;
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « garantir cet équilibre » sont remplacés par les mots : « le garantir ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La parole est à Mme le rapporteur.

Cet amendement vise à répondre à une demande que nous avons formulée les uns et les autres sur toutes les travées, afin de garantir de la visibilité s’agissant du fonds de formation et des droits des élus.
Nous estimons que cette visibilité est nécessaire pour les élus et les collectivités, mais aussi pour les organismes de formation, lesquels sont, je le rappelle, des entreprises qui doivent avoir être assurées de quelque sécurité.
Toutefois, là encore pour les mêmes motifs que précédemment, c’est-à-dire la raison et la responsabilité, nous considérons que la prévision triennale qui sera réalisée par le CNFEL, composé pour moitié d’élus comme vient de le confirmer Mme la ministre, ne pourra se faire de manière sérieuse qu’à partir de 2023.
Nous sommes en 2021 et nous avons récupéré cette année un déficit de près de 24 millions d’euros. En 2023, nous devrions être au début du régime de croisière, et le CNFEL sera alors en mesure d’élaborer des prévisions triennales.

Je suis tout à fait d’accord pour une telle visibilité triennale.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quinquies.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Wattebled, Decool, A. Marc, Guerriau et Chasseing, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen, Menonville et Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Daubresse, Longeot et Bonhomme, Mme Borchio Fontimp, M. Lefèvre, Mme Saint-Pé, MM. Milon, Laménie et Klinger, Mme Dumont et M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sans préjudice des dispositions du présent article, le Conseil national de la formation des élus locaux mentionné au même article L. 1221-1 formule une proposition de montant minimum garanti de la valeur des droits individuels à la formation. »
La parole est à M. Dany Wattebled.

Le retour à l’équilibre d’un fonds déjà déficitaire à hauteur de 25 millions d’euros en 2020 peut entraîner une baisse substantielle de la valeur des droits à la formation dont disposent les élus locaux si des garanties ne sont pas fixées.
La commission a apporté des ajouts salutaires concernant la mise en place d’une prévision triennale de la valeur des droits et la primauté des propositions du CNFEL, sauvegardant la valeur des droits et la stabilité des cotisations.
Mme la rapporteure porte également un amendement visant la fusion triennale des droits. Cette disposition est tout à fait salutaire.
La proposition que je défends représente un complément aux améliorations déjà apportées ou proposées. Cet amendement tend à charger le CNFEL de l’établissement d’un montant minimum à valeur consultative, qui serait fixé en fonction des besoins des élus, et non des moyens du fonds.
En définitive, ce seuil servirait d’objectif à atteindre en matière de droits élaborés par le CNFEL, auquel sa composition permet de représenter les attentes des élus locaux.
Cette proposition d’un montant minimum garanti serait communiquée au ministère chargé des collectivités territoriales, afin que celui-ci en tienne compte dans le cumul annuel des droits. Elle viendrait s’ajouter aux apports de la commission.

Mon cher collègue, vous souhaitez, comme nous, vous assurer d’une certaine prévisibilité.
Nous sommes allés dans cette direction en faisant preuve de raison dans les souhaits que nous avons formulés. Je reprends ce que vous avez évoqué au moment de la discussion générale et dont nous avons beaucoup parlé : il faut aussi que la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, contribue de manière efficace à l’optimisation du fonds.
Avec la facilité d’accès apportée par la plateforme – chaque élu va pouvoir gérer sa situation – et le référentiel, on ne peut pas considérer aujourd’hui des frais de gestion de 20 % comme acceptables.
Je compte aussi sur vous, madame la ministre, pour que cet acteur important de la formation qu’est la CDC optimise sa participation, car il en est certainement capable.
Mon cher collègue, je considère que votre amendement est satisfait. J’en sollicite donc le retrait ; sinon, l’avis de la commission serait défavorable.
Avant la dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 portant réforme de la formation des élus locaux, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le Conseil national de la formation des élus locaux privilégie les propositions qui n’ont ni pour objet ni pour effet de diminuer la valeur des droits que les élus acquièrent ou d’augmenter le montant de leurs cotisations. » –
Adopté.
La dernière phrase du onzième alinéa de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Ces propositions sont transmises au ministre chargé des collectivités territoriales, qui les prend en compte dans l’élaboration d’un projet de rétablissement de l’équilibre financier, soumis pour avis au Conseil national de la formation des élus locaux. Lorsque celui-ci émet un avis défavorable sur tout ou partie de ce projet, le ministre transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d’une seconde délibération. Lorsque le Conseil national de la formation des élus locaux a rendu un avis favorable sur l’ensemble du projet ou à l’issue de cette seconde délibération, le ministre arrête les mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du fonds dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » –
Adopté.
Le septième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « dispose », sont insérés les mots : « et des abondements dont il peut bénéficier » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Au moins une fois par an, le gestionnaire du service dématérialisé informe, par l’intermédiaire du système d’information du compte personnel de formation, les élus locaux disposant d’un tel compte de l’existence du droit individuel à la formation des élus locaux, dans des conditions définies par décret. » –
Adopté.
Après le huitième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont accessibles aux titulaires de droits individuels à la formation, dès la première année de leur mandat et gratuitement, sur ce service dématérialisé des modules de formations élémentaires nécessaires à l’exercice de leur mandat. Les modalités d’inscription et le contenu de ces formations sont définis par décret. »

L’amendement n° 11, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de droits individuels à la formation
par les mots :
desdits droits
La parole est à Mme le rapporteur.

Les dispositions de notre amendement n° 2, qui a été jugé irrecevable, allaient plus loin et complétaient l’article en instaurant une formation pour l’ensemble des conseillers municipaux, dès la première année.
La loi prévoit que seuls les élus ayant reçu une délégation sont concernés. Je le regrette fortement, car de nombreuses communes ont du mal à trouver des candidats aux élections, notamment parce que l’on demande toujours plus de technicité aux élus.
Je déplore que notre amendement ait été recalé.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er nonies est adopté.
La cinquième phrase du troisième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et participe aux réunions du conseil avec voix consultative ». –
Adopté.
La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complétée par les mots : « et rendu public ». –
Adopté.
L’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’organisme public ou privé titulaire d’un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code ne peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l’exécution des prestations de son contrat ou marché qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs. Les modalités de mise en œuvre de la sous-traitance par les organismes de formation agréés sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« L’exécution des formations liées à l’exercice du mandat des élus locaux ne peut être confiée par un organisme titulaire d’un agrément qu’à des sous-traitants de premier rang. Ces sous-traitants de premier rang sont soumis à des obligations spécifiques de qualité des formations déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le rapport annuel d’activité mentionné au quatrième alinéa du présent article ne fait apparaître aucune activité de formation, ou n’a pas été adressé au ministre chargé des collectivités territoriales ainsi qu’au Conseil national de la formation des élus locaux. » ;
3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, les mots : « l’abrogation » sont remplacés par les mots : « le retrait » ;
b) À la troisième phrase, le mot : « abrogé » est remplacé par le mot : « retiré ».

L’amendement n° 12, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3
1° Première phrase
a) Supprimer les mots :
au titre de leur droit individuel à la formation mentionné aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 du présent code
b) Remplacer les mots :
qu’à la condition de justifier l’absence d’un savoir-faire particulier, d’expertise ou de capacités techniques non satisfaisants ou d’une insuffisance ponctuelle d’effectifs
par les mots :
qu’à un organisme également titulaire d’un agrément, dans la limite d’un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Les prestations de son contrat ou marché peuvent toutefois être réalisées, en tout ou partie, par une personne physique non titulaire d’un agrément qui exerce à titre individuel une activité de formation.
II. – Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme le rapporteur.

Monsieur le président, si vous me le permettez, je répondrai à Michelle Gréaume s’agissant de son amendement qui visait à prévoir une formation pour l’ensemble des élus en début de mandat. Nous ne l’avons pas retenu, car il tendait à créer des dépenses supplémentaires.
Je ne l’ai peut-être pas assez dit, mais je profite de l’occasion pour le rappeler : en début de mandat, notamment pour les élus municipaux, des formations sont organisées par les associations départementales d’élus et les services de l’État, mais elles ne sont accessibles qu’aux maires.
Nous proposons que, sur la plateforme, soit disponible un module relatif aux principales compétences et au paysage institutionnel, ouvert non seulement aux élus municipaux, mais aussi aux élus des intercommunalités, des départements et des régions.
Ma chère collègue, votre amendement est donc plus que satisfait : ce que vous demandiez se fera, et cela sans charge supplémentaire.
Pour revenir à l’amendement n° 12, comme cela a été dit par de nombreux collègues, l’exigence de qualité des organismes de formation suppose que l’on évite des chaînes de sous-traitance, qui sont parfois des puits sans fond.
Je le rappelle, nous avons limité la sous-traitance. En revanche, le Gouvernement et les associations d’élus, notamment de maires, ont mis en évidence des besoins parfois spécifiques nécessitant de recourir à une expertise très pointue, pour un temps limité, qui n’existerait pas dans un organisme de formation.
Par exemple, les élus suivent une formation à l’urbanisme, mais il pourrait être nécessaire qu’ils fassent appel à un spécialiste du droit de l’urbanisme pour une question extrêmement particulière relative au droit et à l’environnement. Nous ne manquerons pas de le faire, d’ailleurs, quand nous serons condamnés à faire de la « zéro artificialisation ».
Si l’on n’introduisait pas cette exception, on empêcherait le recours à cette solution sans en proposer une autre. Cette disposition permet donc de recourir à un formateur qui interviendrait à titre individuel, sous le statut, par exemple, d’autoentrepreneur, et qui cosignerait le contrat de formation.
Naturellement, tout cela sera suivi de près par le CNFEL et par la Caisse des dépôts et consignations, mais il faut que l’on prévoie cette disposition, sans quoi nous serions les premiers, ici, à reprocher au texte d’être, par souci de pureté absolue, condamné à l’inefficacité.

Je suis tout à fait d’accord avec cette proposition.
Il s’agit en effet de prévoir la possibilité de faire intervenir des gens extrêmement spécialisés dans tel ou tel domaine. Autant il me semblait nécessaire de supprimer la sous-traitance, autant il me paraît important de permettre cette souplesse ; cela peut concerner l’artificialisation des sols ou l’enseignement de la langue bretonne dans les écoles, par exemple.
Sourires.

Nous ne voterons pas cet amendement en l’état.
Pourtant, cet amendement est très sage et même excellent dans sa première partie, parce que l’on a déjà vu des organismes agréés sous-traitant leur activité à des organismes non agréés, ce qui représente un dévoiement.
Néanmoins, nous pensons qu’il faut aller jusqu’au bout de la logique et, si vous retiriez le 2° du I de cet amendement, celui-ci serait parfait.
En effet, madame la rapporteure, madame la ministre, un organisme agréé peut tout à fait embaucher, comme contractuel ou dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, un CDD, toute personne ayant une compétence particulière. Ce n’est pas la peine de mettre en place une sous-traitance spécifique destinée aux autoentrepreneurs.
Si vous retirez le 2° du I, nous voterons donc cet amendement. Sinon, j’en suis désolé, mais nous voterons contre.

À désolation, désolation et demie, mon cher collègue…
Je ne pense pas qu’un organisme de formation puisse conclure un contrat de travail pour une intervention de, disons, deux heures… Vous avez raison, il faudra surveiller ce point, mais la mesure proposée ici me paraît nécessaire.
Aussi, non, je ne rectifierai pas mon amendement dans le sens que vous suggérez, monsieur Sueur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er duodecies est adopté.
L’article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) Après les mots : « et du », sont insérés les mots : « gestionnaire du » ;
b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621-3 du présent code » ;
2° Le XII est ainsi modifié :
a) Après le mot : « le », sont insérés les mots « gestionnaire du » ;
b) Après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales ».

L’amendement n° 13, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer le mot :
le
par les mots :
la première occurrence du
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 1 er terdecies est adopté.
L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque des actions de formation ainsi financées ont débuté dans ce délai, elles peuvent être réalisées jusqu’au 31 décembre 2021. »

L’amendement n° 14, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en euros ou en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa des articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, et L. 7227-12-1 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l’article 6 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »
II. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les droits individuels à la formation comptabilisés en heures détenus par les élus locaux à cette date sont convertis en francs CFP selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces droits convertis n’entrent pas en compte dans le calcul du montant annuel des droits individuels à la formation des élus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de l’article 2 de la présente ordonnance, et font l’objet d’un versement qui augmente le montant des droits précités. »
La parole est à Mme le rapporteur.

Ce sujet a été soulevé par nos collègues Alain Richard, Michelle Gréaume et Cécile Cukierman, que je remercie de nous avoir permis d’y travailler. Il s’agit du dispositif de transition entre les deux régimes.
Nous sommes encore sous le régime des droits acquis comptabilisés en heures, qui seront convertis, en juillet prochain, en euros. Or il y a, comme dans tout système transitoire, des plaques tectoniques qu’il convient de maîtriser, car il n’était pas question que des élus ayant acquis des droits comptabilisés en heures soient perdants.
Chaque fois qu’il y a transition entre deux régimes – c’était le cas avec la formation professionnelle de droit commun et le régime de retraite –, la bascule coûte un peu d’argent, afin d’atteindre un système totalement égalitaire.
Au travers de cet amendement, nous souhaitons que les élus qui ont un crédit d’heures ne soient pas perdants au moment de la conversion et qu’ils ne perdent aucun de leurs droits nouveaux, qu’ils acquerront en euros, au prétexte qu’ils avaient déjà des heures ; l’objectif est que leur crédit d’heures s’ajoute à leurs nouveaux droits, en euros.
Vous me demanderez bien sûr, mes chers collègues, combien cela coûte. Eh bien, je répondrai à cette excellente question, que personne ne m’a posée
Sourires.

Le Gouvernement partage tout à fait cette vision. Il a travaillé à cette solution avec Mme la rapporteure. Bien entendu, les élus régionaux et départementaux pourront bénéficier de la conversion, et le dispositif concernera également les élus municipaux élus en 2020.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 1er quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux est ainsi modifiée :
1° Le tableau constituant le troisième alinéa de l’article 14 est ainsi rédigé :
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE
L. 1221-1
La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1221-2
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1221-3 et L. 1221-4
La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
2° La quatrième ligne du tableau constituant le troisième alinéa de l’article 15 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 1621-3
La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-4
L’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
L. 1621-5
La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
3° Le tableau constituant le quatrième alinéa de l’article 16 est ainsi rédigé :
L. 2123-12 et L. 2123-12-1
La loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux
La parole est à Mme la ministre.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er quaterdecies.
L’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie est ratifiée. –
Adopté.
I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « francs CPF », sont insérés les mots : «, cumulable sur toute la durée du mandat » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements complémentaires peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121-37 du présent code. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Il peut également contribuer à son financement » sont remplacés par les mots : « Son financement peut être complété, à sa demande, par un abondement complémentaire de l’État ou de Pôle Emploi, ou » ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements complémentaires n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
II. – À l’intitulé du titre IV de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de Nouvelle-Calédonie, le mot : « disposition » est remplacé par le mot : « dispositions ».

L’amendement n° 15, présenté par Mme Gatel, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 6
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour assurer le financement d’une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires. Ces abondements peuvent être financés par le conseil municipal selon les modalités définies à l’article L. 121-37 du présent code. » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces abondements n’entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant des droits individuels à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article. »
La parole est à Mme le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 3 est adopté.

L’amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 121-37-1 et aux articles L. 121-37-2 et L. 121-37-3 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « l’ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux » sont remplacés par les mots : « la loi n° … du … ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux ».
La parole est à Mme la ministre.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 3.

Personne ne demande la parole ? …
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 106 :
Nombre de votants345Nombre de suffrages exprimés330Pour l’adoption330Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, RDPI et INDEP.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures dix.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures quarante, est reprise à quinze heures dix, sous la présidence de M. Pierre Laurent.