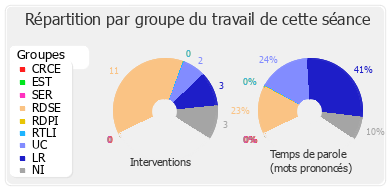Séance en hémicycle du 27 janvier 2009 à 16h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

M. Henri de Raincourt, président du groupe de l’Union pour un mouvement populaire, m’a informé qu’il retirait sa demande d’inscription à l’ordre du jour réservé du mercredi 11 février de la proposition de loi de M. Philippe Marini visant à responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation et à lutter contre le surendettement.
Acte est donné de cette demande et la proposition de loi est donc retirée de l’ordre du jour de la séance du 11 février.

J’informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de plusieurs organismes extraparlementaires.
Conformément à l’article 9 du règlement, j’invite :
- la commission des affaires sociales à présenter deux candidatures pour le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion et une candidature pour le Conseil national de la montagne ;
- la commission des finances à présenter une candidature pour la Commission centrale de classement des débits de tabac et une candidature pour l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement ;
- la commission des affaires économiques et la commission des lois à présenter respectivement trois et une candidatures pour le Conseil national de la montagne.
La nomination au sein de ces organismes extraparlementaires aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (nos 42 et 165).
Avant d’ouvrir le débat, je dois rappeler que le Conseil économique, social et environnemental a demandé que, conformément aux dispositions de l’article 69 de la Constitution, M. Paul de Viguerie, rapporteur de la section du cadre de vie du Conseil économique, social et environnemental, puisse exposer, devant le Sénat, l’avis du Conseil.
Conformément à l’article 69 de la Constitution et à l’article 42 de notre règlement, huissiers, veuillez faire entrer M. Paul de Viguerie.
M. le rapporteur de la section du cadre de vie du Conseil économique, social et environnemental est introduit dans l’hémicycle selon le cérémonial d’usage.

Monsieur le rapporteur de la section du cadre de vie du Conseil économique, social et environnemental, je vous souhaite la bienvenue dans cet hémicycle.
Mes chers collègues, je suis heureux d’accueillir au Sénat Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie.
Applaudissements

Madame la secrétaire d’État, je forme des vœux pour le succès de l’importante mission qui vous a été confiée aux côtés de M. Borloo.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre d’État.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires économiques, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, permettez-moi d’abord de vous dire tout le plaisir que Chantal Jouanno, Dominique Bussereau, Hubert Falco, Christian Blanc et moi-même avons à vous retrouver pour le deuxième acte parlementaire du Grenelle de l’environnement, après l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale de ce projet de loi de programme.
Le temps parlementaire, comme l’expérience récente l’a montré, est un temps nécessaire, incontournable d’interrogation, de précision, de clarification, de confirmation et, en tout état de cause, de validation démocratique de la feuille de route de la nation.
Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire devant les députés, le Parlement n’est pas un collège de plus du Grenelle de l’environnement, même s’il a été associé à tout le processus dans les groupes de travail, les comités opérationnels ou les groupes de suivi parlementaires : il est bel et bien le dépositaire ultime de ses conclusions, celui qui fixe de façon définitive et irrémédiable le cap et la stratégie de la nation, à un moment clé de l’histoire de notre pays, de l’Europe et du monde.
Le temps du Parlement sera particulièrement riche cette année puisque, après avoir examiné ce projet de loi de programme, après avoir débattu du projet de loi de finances pour 2009, nous nous retrouverons dans quelques semaines pour discuter du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, la « brique territoriale » du Grenelle de l’environnement, dont l’objet est essentiellement de lever les obstacles juridiques et techniques, de clarifier les compétences et de simplifier considérablement l’ensemble des branches de notre droit afin de donner aux collectivités territoriales les outils nécessaires à l’accomplissement de cette mutation. Je suis très heureux que le Sénat soit la première chambre saisie de ce texte.
Permettez-moi, à cet instant, de remercier très sincèrement les membres de la commission des affaires économiques du Sénat et son président, Jean-Paul Emorine, qui se sont impliqués de façon déterminante et continue tout au long du processus. C’est à Jean-Paul Emorine que nous devons la création du comité de suivi parlementaire du Grenelle de l’environnement, qui réunit des sénateurs de tous bords ayant participé soit directement aux travaux préparatoires, soit à des groupes de travail, initiative menée en partenariat avec Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’Assemblée nationale.
Permettez-moi également de saluer l’intensité du travail fourni par Bruno Sido, rapporteur de ce texte, la qualité de ses auditions et la profondeur de son analyse sur des sujets d’une très grande technicité.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat intervient à un moment charnière de notre histoire politique, économique et industrielle, où finalement le monde semble s’être décidé à gravir les premières marches du siècle à venir.
Ce débat parlementaire coïncide avec un grand moment de rupture, où l’on sent bien que, des États-Unis au Japon, du Brésil à la Chine, en passant par l’Europe, tout est en train de basculer, où l’on voit des pays ou des secteurs industriels entiers s’engager, à des rythmes différents, en fonction de leurs spécificités ou de leurs contraintes, dans une grande mutation économique, énergétique et écologique.
C’est d’abord la France qui, à l’issue de l’élection présidentielle de juin 2007 et sous l’impulsion du Président de la République, a choisi de procéder à ce vaste exercice de radiographie ou d’introspection qu’est le Grenelle de l’environnement, afin de construire étape par étape, secteur par secteur, une nouvelle feuille de route pour les quinze à vingt années à venir.
C’est ce « Grenelle déjà en actes » ou ce « Grenelle déjà concret et opérationnel » dans un certain nombre de secteurs –la grande distribution, l’industrie aéronautique, la publicité, les transports –, la plupart du temps sur la base du volontariat ou dans le cadre de conventions d’engagements, qui démontre que le marché a déjà pris quelques initiatives.
Ce sont 62 millions de consommateurs formés et informés qui veulent plus de qualité, plus de sécurité sanitaire, plus de traçabilité, plus d’efficacité, tout en améliorant leur pouvoir d’achat et en réduisant leur facture énergétique.
Ce sont vingt-sept États européens aux histoires économiques, industrielles et géographiques radicalement différentes qui ont décidé à l’unanimité, en décembre dernier, de s’engager sur des objectifs à la fois précis, contraignants et quantifiables, engagements dont ils devront rendre compte devant l’opinion publique et devant la Cour de justice des Communautés européennes.
C’est la mise en œuvre opérationnelle de l’objectif dit des « 3 fois 20 » en 2020 : réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne, voire de 30 % en cas d’accord international à Copenhague ; porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique final ; améliorer de 20 % l’efficacité énergétique.
C’est la mise en mouvement de l’ensemble des secteurs industriels européens avec la révision de la directive ETS sur les échanges de quotas d’émission, l’inclusion partielle des activités aériennes dans le système d’échanges de quotas, l’accord sur le règlement dit « du CO2 des voitures », qui fixe un objectif d’émissions de 130 grammes de CO2 par kilomètre en 2012 et de 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020 et qui concerne potentiellement 18 millions de véhicules, ainsi que le retrait programmé de 4, 2 milliards d’ampoules à incandescence, dont la consommation électrique représente l’équivalent de la production de quarante-cinq centrales thermiques.
C’est encore hier, à Bonn, la signature par soixante-quinze pays – cent vingt pays ayant en fait donné leur accord – du traité fondateur de l’IRENA, l’Agence internationale pour les énergies renouvelables. Il s’agit de la première agence internationale dédiée à la diffusion des connaissances et à la coopération en matière d’énergies renouvelables. La France est candidate à sa direction générale, à défaut d’en accueillir le siège.
Ce moment charnière de notre histoire est également marqué par la prise de position du président des États-Unis d’Amérique, Barack Obama, qui a clairement indiqué, dans son discours d’investiture, après l’avoir fait lors de sa campagne électorale, qu’il prônait une économie respectueuse de l’environnement, un « Green New Deal », et l’amélioration de l’efficacité énergétique afin de réduire la dépendance de son pays dans ce domaine.
Pas plus tard qu’hier, il a proposé de créer une coalition mondiale de lutte contre le changement climatique, dont le leadership serait assuré par les États-Unis, avec l’Inde et la Chine. Nous sommes donc bien à un moment crucial de notre histoire.
Devant une telle rapidité d’évolution de la situation, il y avait deux manières de procéder.
Soit nous décidions d’imposer une mutation d’en haut, de façon totalement verticale et non concertée, dans la précipitation, les convulsions et les crispations, au risque de bloquer une partie de la société et de dresser les différents membres du corps social les uns contre les autres.
Soit nous choisissions, comme l’ont souhaité le Président de la République et sa majorité, de poser le débat autrement, en sortant des affrontements réducteurs et faciles, en refusant les anathèmes et le mépris de l’autre, pour élaborer, avec tous les acteurs de la société, un diagnostic à la fois réel, sincère et sans concessions, afin de trouver les moyens acceptables par tous d’assumer cette transition.
Car, au fond, le plus grand défi qui était devant nous était de savoir comment une société démocratique comme la nôtre, où les intérêts sont parfois concurrents et contradictoires, parviendrait à effectuer de façon collective, organisée et loyale une forme de remise en cause conceptuelle de ses modes de production et de consommation, ainsi que de ses modes de gouvernance.
Dans cette perspective, le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est le résultat d’une triple conviction.
La première conviction concerne la méthode : la mutation est tellement vaste et touche tant de sujets de société en même temps qu’elle ne peut se faire que par la mise en mouvement de tous les acteurs. Aucun corps social, aussi puissant soit-il, n’a à lui seul la capacité d’imposer aux autres ses solutions.
La deuxième conviction est qu’avant de proposer des solutions, il fallait procéder à une ample radiographie collective et partagée, à un vaste exercice d’introspection sociale et économique. Commençant par un travail de diagnostic très en profondeur, réunissant pendant des milliers d’heures des scientifiques, des économistes, des chefs d’entreprise, des syndicalistes, des biologistes, des représentants des organisations territoriales d’élus ainsi que des pouvoirs publics, ce travail s’est poursuivi dans le cadre d’un débat élargi, avec près de 14 000 contributions sur Internet, quelque 300 000 internautes présents sur le forum du Grenelle et 15 000 participants à dix-neuf réunions régionales, pour aller au-delà des slogans et des réponses faciles.
Au fond, ce qui m’a le plus frappé, sous la présidence française de l’Union européenne, au cours des négociations sur le paquet « énergie-climat » que nous avions la responsabilité de mener à bien, c’est l’extrême rugosité, la grande violence du débat dans presque tous les pays européens, rappelant d’une certaine façon celui que nous avions eu, en France, au moment du référendum sur le traité constitutionnel pour l’Europe.
Si le climat était beaucoup plus apaisé chez nous, c’est sans doute parce que nous avions tellement travaillé sur ces sujets que nous avions pu sortir des idées reçues et parvenir à un consensus sur la nécessité d’assumer cette mutation en prenant en compte l’ensemble des aspects, en particulier en veillant à ne pas handicaper notre compétitivité en créant des charges à court terme que nous serions seuls à supporter.
Ce contraste m’a beaucoup impressionné. Durant ce grand débat à l’échelon européen, l’opposition ne s’est pas exprimée contre les positions du Gouvernement, et je l’en remercie.
La troisième conviction, unanime et maintes fois confortée par les faits, est que derrière tout cela se dessinait progressivement un nouveau modèle de croissance économique, un nouveau chemin de compétitivité.
Ce nouveau modèle est fondé sur la sobriété en carbone et en énergie, principe sous-tendu au fond par l’idée assez simple qu’une société qui consomme globalement moins de ressources fossiles, moins de matières premières, moins d’emballages, est une société qui dépense moins d’argent et qui est donc plus compétitive.
Il est fondé également sur les nouvelles technologies de l’environnement, sur les moteurs hybrides, sur la capture et le stockage de carbone, sur les nouveaux matériaux de construction, sur les réseaux électriques intelligents. Ces nouvelles technologies sont en train d’arriver à maturité et sont même, pour certaines d’entre elles, déjà en phase d’industrialisation.
On peut regretter que la France ait pris du retard par rapport à ses concurrents dans certaines filières industrielles, comme le solaire ou l’éolien, pour lesquelles le marché mondial est à conquérir.
J’étais récemment à Abou Dhabi, où débute la réalisation d’un énorme projet expérimental de ville nouvelle, Masdar, sans émissions de CO2, sans rejets, sans déchets. J’ai pu y constater la présence d’intervenants américains, notamment le prestigieux MassachusettsInstituteoftechnology, japonais, coréens, allemands ou espagnols, alors que les Français étaient assez peu représentés. Il existe une compétition mondiale dans ces domaines, et il nous appartient d’y participer.
Ce nouveau modèle de croissance est en outre fondé sur le retour du long terme dans les stratégies d’investissement industriel. Il permet de desserrer l’étau du court terme qui pèse sur le comportement des acteurs économiques.
Enfin, il est fondé sur la reconnaissance d’une économie locale, à côté de l’économie globalisée, s’appuyant sur le développement de l’énergie solaire, sur la création de nouveaux métiers de proximité et sur un certain nombre de ressources, telle la biomasse. Notre pays, qui possède la première forêt d’Europe, est pourtant importateur net de bois : nous avons par conséquent des progrès à réaliser !
C’est donc ce compromis du possible, ce changement radical de stratégie, ce saut à la fois technologique et qualitatif qui vous est proposé aujourd'hui dans l’énergie, les transports, l’aménagement urbain, la construction : il implique la division par quatre de nos émissions de CO2 entre 1990 et 2050, la réduction de 38 % de la consommation énergétique dans le bâti existant, la baisse de 20 % des émissions de CO2 dans les transports à l’horizon 2020, le passage à 23 % de la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique en 2020, le placement de 2 % du territoire sous protection forte d’ici à dix ans, un bon état écologique des eaux à l’horizon 2015, l’affectation de 6 % de la surface agricole utile, la SAU, à l’agriculture biologique en 2013, la mise en place d’une démarche environnementale dans 50 % des exploitations d’ici à 2012…
Ce changement de stratégie irréversible qui vous est proposé aujourd'hui se traduit d’une manière visible dans six grands chantiers.
Le premier, c’est le chantier thermique dans le secteur du bâtiment, avec, dans le neuf, la mise en œuvre des normes les plus élevées possible au regard des capacités de notre outil de production. Dans le domaine du bâti existant, les obligations s’appliqueront d’abord à l’État, puis aux collectivités territoriales et au tertiaire commercial, et enfin aux logements. Pour le patrimoine existant, nous avons prévu un certain nombre de dispositifs, essentiellement d’ordre fiscal et budgétaire, par exemple l’éco-prêt à taux zéro, cumulable avec le dispositif de l’article 200 du code général des impôts. Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions, mais il s’agit de disposer des outils financiers permettant, à partir d’un petit investissement, d’obtenir ultérieurement de grandes économies d’énergie.
Le deuxième chantier, celui du transport, vous sera présenté par Dominique Bussereau. Il s’agit de fixer le cap pour les grandes infrastructures, notamment ferroviaires : construction de lignes à grande vitesse, développement du fret, réaménagement de l’hinterland des ports afin d’éviter que 80 % des marchandises ne quittent ceux-ci par camion, comme c’est le cas actuellement. En outre, les transports en commun en site propre seront soutenus.
L’idée est que la part de l’engagement de l’État soit connue à l’avance. Les partenaires d’un projet doivent connaître la règle du jeu, qui aura d’ailleurs été établie avec eux, car on a trop souvent vu, dans le passé, l’État revenir sur son engagement.
Le troisième chantier est celui de l’énergie, avec la création d’un fonds, doté de 1 milliard d'euros sur trois ans, destiné à financer la production de chaleur renouvelable. Par ailleurs, les collectivités locales se verront ouvrir la possibilité de bénéficier elles-mêmes des tarifs spécifiques de rachat de l’électricité produite à partir de sources renouvelables.
Le quatrième chantier est celui, capital, de la biodiversité, avec la mise en place de la trame verte et bleue sur l’ensemble du territoire et la création de dix aires marines protégées, dont le coût sera en quasi-totalité pris en charge par l’État. Dans le domaine de la qualité de l’eau, 2 milliards d'euros de prêts à taux bonifiés seront affectés aux opérations de mise aux normes des stations d’épuration.
Le cinquième chantier, celui de la santé, comporte l’élaboration d’un deuxième plan national santé-environnement pour la période 2009-2012 et d’un plan de réduction des particules. Il s’agit de lutter contre les pollutions sonores et lumineuses, ainsi que de renforcer les contrôles exercés sur les nanoparticules.
Enfin, le sixième chantier est celui, immense, de la gouvernance, qui reste encore à inventer et à construire, pour associer les acteurs aux décisions ayant une incidence sur l’environnement.
Au total, avec le Grenelle de l’environnement, l’État facilite le financement de près de 20 milliards d'euros d’investissements sur la période 2009-2020, directement au profit des collectivités locales.
Avons-nous les moyens d’engager une mutation pareille, comme tous les pays le font ? Est-ce le moment ? La réponse à ces deux questions est positive.
Une économie qui n’est pas fondée sur la performance énergétique est condamnée à terme. Dès lors que le mécanisme de financement est mis en place, un investissement modeste en vue de réaliser des économies d’énergie dans un bâtiment, privé ou public, favorise le pouvoir d’achat, permet de réduire la consommation énergétique et donc la dépense, ainsi que la dépendance énergétique de notre pays.
Dans le cadre de la loi de finances, quarante-trois mesures de « verdissement » de notre fiscalité ont été prises. C’est la plus grande mutation de ce type jamais réalisée par un pays en Europe. Je crois que nous avons les moyens d’opérer cette transition.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes à un moment absolument crucial de l’histoire de l’humanité. Nous sommes à mi-chemin entre le sommet de Bali et celui de Copenhague, dans un an, où tous les pays du monde ont rendez-vous avec leur histoire.
À Copenhague, un accord mondial sur l’efficacité énergétique et les émissions de CO2, engageant notamment la République populaire de Chine, l’Inde, les États-Unis d’Amérique et l’Europe, devra être recherché. En Europe, la France, par sa méthode du Grenelle de l’environnement, par son organisation publique, par la qualité de ses collectivités territoriales et de ses entreprises, est, objectivement, l’un des bons élèves de la classe. Si nous suivons ce programme, elle sera probablement le pays de « vieille industrie » – d’autres ont parlé naguère de la « vieille Europe » – le mieux placé pour parvenir dans les délais prévus à un développement soutenable et durable.
À mon sens, si nous ne parvenons pas à un tel accord à Copenhague, nous entrerons alors dans des périodes de turbulences extrêmement graves sur les différents continents, car les populations voudront savoir quels sont les responsables de l’aggravation de la situation.
Je souhaite tout particulièrement insister sur le point suivant.
Quoi que vous puissiez entendre dire à l’extérieur du Sénat, sachez que l’ensemble des mesures contenues dans le présent projet de loi ont fait l’objet de milliers d’heures de discussions associant tous les groupes de travail et les spécialistes des cinq collèges du Grenelle de l’environnement.
En réalité, il s’est agi non pas d’une négociation au sens traditionnel du terme, mais d’un véritable projet collectif. Les décisions qui ont été prises à propos des chantiers thermiques des bâtiments existants ont été validées par les architectes, les énergéticiens et l’Union sociale pour l’habitat, afin d’aller aussi loin que le permettent aujourd’hui les techniques.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous ne vous apprêtez pas seulement à examiner un texte et à voter des dispositions ; vous allez aussi adresser un signal à nos universités, à nos chercheurs, à nos entreprises, à nos artisans, à nos branches professionnelles et, d’une manière plus générale, à la nation entière, afin de leur montrer que notre pays se tourne résolument, sereinement et sérieusement vers cette nouvelle économie et cette nouvelle forme de compétitivité !
Chaque jour se manifeste davantage, partout dans le monde, un véritable engouement pour une telle mutation. Ainsi, aux États-Unis, l’on considère désormais que la réponse à la crise réside dans une croissance fondée sur les nouvelles technologies et les nouvelles normes : ce sont elles qui permettront demain d’accroître la compétitivité et de créer de l’emploi.
C’est donc une proposition globale que nous formulons, tout en étant conscients de l’extrême difficulté de réussir. Nous travaillons avec honnêteté, avec humilité et avec le sens des responsabilités, dans l’intérêt supérieur de notre pays, de nos entreprises et de l’avenir de nos enfants.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.

La parole est à M. le rapporteur de la section du cadre de vie du Conseil économique, social et environnemental.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au nom du président du Conseil économique, social et environnemental, M. Jacques Dermagne, je vous remercie de m’inviter à rendre compte de l’avis de notre assemblée, qui a été adopté le 28 mai dernier par 154 voix sur 187 votants.
Je remercie le président de la commission des affaires économiques, M. Jean-Paul Emorine, et le rapporteur, M. Bruno Sido, de nous avoir permis, dès le mois de juin dernier, de faire part de nos observations à la commission des affaires économiques.
Le Conseil économique, social et environnemental se trouve depuis plus de dix ans au premier rang des acteurs institutionnels qui participent à la construction d’une politique nationale, européenne et mondiale de lutte contre les effets désastreux du changement climatique.
Avec sa contribution au débat national sur l’environnement et le développement durable en octobre 2007, il a pris toute sa place dans les échanges du Grenelle de l’environnement, en reprenant l’ensemble des soixante-dix rapports et avis adoptés au cours des deux dernières mandatures, dont la plupart portaient sur les trois dimensions, économique, sociale et environnementale, du développement durable.
Nous avons la prétention de penser que ces travaux ont contribué à la prise de conscience de l’ensemble des acteurs de la société civile composant notre assemblée.
Monsieur le ministre d’État, madame la secrétaire d’État, entre l’avant-projet de loi dont vous nous aviez saisis pour avis au début du mois de mai 2008 et le texte présenté au Parlement par le Gouvernement, il n’y avait pas de différences essentielles. Mais, depuis le 28 mai dernier, la dynamique du Grenelle de l’environnement s’est intensifiée, et ce dès le point d’étape tenu le 23 septembre dernier : nous en voulons pour preuves le projet de loi, amendé par l’Assemblée nationale, qui est aujourd'hui soumis au Sénat, la loi de finances de 2009 et les nombreux textes de nature réglementaire qui ont été publiés.
Le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, qui a été adopté par le conseil des ministres le 7 janvier dernier, devrait concrétiser nombre des engagements du Grenelle de l’environnement et de l’actuel projet de loi. Surtout, et cela doit être souligné, le paquet « énergie-climat », qui a été adopté sous présidence française de l’Union européenne, et le plan de relance rendu nécessaire par la crise profonde que traverse notre économie conduisent à accélérer les efforts de tous pour atteindre les objectifs ambitieux fixés en matière d’économie d’énergie et de lutte contre le changement climatique. Ainsi, nombre des questions ou des interrogations de notre assemblée exprimées au travers de cet avis ont été entendues et plusieurs de nos préconisations devraient trouver une traduction concrète.
En outre, le Conseil économique, social et environnemental avait souhaité que l’ensemble des textes donnant corps et vie à l’avant-projet de loi vous soient soumis avant la fin de l’année 2008, mesdames, messieurs les sénateurs. L’actualité économique ne l’a pas permis, mais cela sera fait, semble-t-il, d’ici à l’été.
Certaines des mesures proposées en mai dans l’avant-projet de loi d’orientation faisaient déjà débat. Je pense notamment aux dispositions relatives à l’agriculture, aux déchets ou à la définition des énergies renouvelables. Nous constatons que ces débats perdurent, même s’ils avancent. Le processus du Grenelle de l’environnement n’est pas achevé, loin de là, ce qui prouve qu’il vit. Institutionnaliser un comité de suivi devrait encourager encore la maturation des questions en débat, présentes et à venir.
Je reprendrai maintenant devant vous quatre des principaux axes ayant fondé la démarche que le Conseil économique, social et environnemental s’est efforcé de suivre.
Premièrement, la priorité absolue est donnée à l’effort de formation, de recherche et d’innovation, afin de développer une politique de l’offre.
Deuxièmement, il est impératif d’assurer une cohérence des mesures budgétaires, fiscales et financières.
Troisièmement, ces deux premières politiques doivent être mises en œuvre selon une gouvernance combinant équité et efficacité dans toutes ses dimensions.
Quatrièmement, l’État et, plus largement, les différents acteurs publics ou issus de la société civile doivent montrer l’exemple.
S’agissant du premier axe, il convient de mettre en place une politique de l’offre à la hauteur des défis à relever. Il y a urgence à agir, et c’est bien à cette tâche qu’il faut s’atteler. Tel est le sens de la priorité qui doit être donnée à la formation, à la qualification et au développement accéléré de la recherche.
Il y a là, à n’en pas douter, un formidable gisement d’emplois ; l’exploiter nécessite d’accomplir un effort sans précédent, afin de ne laisser personne au bord du chemin. La bataille pour l’emploi et la lutte contre le changement climatique se gagneront en même temps ou ne se gagneront pas ! La réussite dépendra en grande partie de la capacité de tous les corps professionnels à s’approprier expertise et nouvelles technologies ou compétences.
Au mois de mai dernier, le Conseil économique, social et environnemental estimait déjà que « tous les moyens juridiques et financiers devaient être fléchés dès aujourd’hui et pour les dix-huit mois à venir sur ce chantier ». C’est encore plus vrai aujourd'hui !
L’édiction de normes donne à la fois un point d’arrivée et un délai. Le Conseil partage les objectifs ainsi fixés. Toutefois, deux interrogations demeurent.
Dans le secteur du bâtiment, les innovations sont là – nous les connaissons –, mais nous sommes encore loin du compte pour qu’elles soient à la portée de tous les métiers et de toutes les entreprises. Dans ce domaine, nos inquiétudes concernent davantage l’ancien que la construction neuve. Fondé sur les textes législatifs « Grenelle I » et « Grenelle II », le plan « bâtiment » présenté le 23 janvier dernier permettra certainement de relever un tel défi.
Dans le secteur des transports, nous assistons tous les jours à une formidable mutation. Seules des technologies nouvelles pouvant être mises à la portée de tous permettront de réaliser rapidement des progrès sensibles dans des délais que je qualifierai d’« acceptables ».
Le temps des grandes infrastructures dans le domaine du fret ferroviaire ou des transports urbains « propres » est un temps long. Il est très directement pris en compte et reconnu comme tel par ce texte. Or la réponse aux défis représentés par les transports individuels, toujours nécessaires eu égard à une métropolisation accrue, doit être trouvée dans un temps court.
Dans le même sens, le projet de loi aborde la nécessité de repenser la conception de l’aménagement urbain. Le Grenelle II introduit une certaine révision de notre droit de l’urbanisme. Nous nous en félicitons.
S’agissant du deuxième axe, dans votre assemblée comme dans la nôtre, les regards sont tournés vers les conséquences financières et budgétaires et la cohérence des mesures à prendre en ce domaine. Au mois de mai, le Conseil économique, social et environnemental a formulé explicitement ses interrogations à cet égard, sinon son inquiétude, en l’absence d’une visibilité à court et à moyen termes sur les réponses apportées ou envisagées.
À ce stade de mon intervention, je souhaite rappeler à cette tribune la volonté qui est la nôtre.
Pour assurer l’avenir et le succès du Grenelle, dont elle entérine la dynamique et les résultats, cette première loi est une étape essentielle et primordiale. Le Conseil économique, social et environnemental était, et est toujours, soucieux de voir assurer aux yeux de l’opinion publique la faisabilité et la crédibilité de ce texte au cours de l’ensemble du processus législatif.
À notre sens, quatre observations peuvent inspirer le travail, présent et futur, de votre assemblée.
D’abord, un équilibre nouveau entre les efforts contributifs de toutes les parties prenantes – État, collectivités, entreprises et usager final – doit être trouvé et affiché clairement.
Ensuite, le « signal prix » est l’une des conditions du succès, nous en sommes persuadés, mais il ne peut être dissocié de la dynamique de l’offre, et donc de la politique industrielle amenée à se développer.
En outre, la neutralité fiscale a été posée comme principe par notre Conseil. Nous nous féliciterions de ce qu’il soit définitivement validé.
Enfin, comme nous l’avons souligné, il convient de travailler à mettre en ligne et en cohérence tous les instruments financiers à notre disposition, et sans doute d’en inventer de nouveaux, par exemple des quotas énergie-carbone pour les bâtiments, de façon à récompenser financièrement les propriétaires vertueux.
En effet, la marge de manœuvre de chacune des institutions concernées est chaque jour plus étroite. La diminution du pouvoir d’achat et le rétrécissement actuel de l’épargne, même sous les formes les plus sécurisées, compromettent la confiance dans un retour rapide sur investissement grâce aux économies d’énergie engendrées.
S’agissant du troisième axe, en matière de gouvernance, une étape importante a été franchie avec la révision constitutionnelle adoptée par le Congrès le 21 juillet dernier. Nous le rappelons, le socle constitué par la stratégie nationale de développement durable doit constituer le fil rouge de tous les textes qui nous seront soumis.
C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que cette stratégie fasse l’objet d’un débat annuel, sanctionné par un vote dans les deux assemblées parlementaires et précédé de l’avis préalable et systématique du Conseil économique, social et environnemental.
Par ailleurs, les collectivités locales jouent et joueront un rôle de plus en plus essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie nationale. Le Conseil national des élus, quelles que soient les décisions qui seront prises, doit pouvoir délibérer de l’ensemble des mesures envisagées et programmées. En effet, l’action et les interventions des collectivités territoriales, liées à l’évolution de la fiscalité locale, ont des conséquences directes sur les comptes publics.
Enfin, nous approuvons l’inscription de la dimension environnementale dans la gouvernance de toute entreprise. Le Conseil économique, social et environnemental a estimé que l’avant-projet manifestait une volonté politique forte dans ce domaine. Sa rédaction traduit bien notre souhait de voir ces questions encore largement débattues et approfondies.
S’agissant du quatrième axe, le projet de loi pose en principe l’exemplarité de l’État. Deux aspects, entre autres, y contribuent.
Tout d’abord, le titre III, qui traite de la politique de santé, nous parait extrêmement important. L’État est le garant et le régulateur de cette politique. C’est la première fois, à notre connaissance, qu’un texte de portée générale pose comme principe la mise en œuvre d’une politique globale de santé publique prenant en compte des facteurs environnementaux.
Ensuite, si le Conseil économique, social et environnemental a pu contribuer à éclairer vos débats et vos votes passés et futurs, il en est d’autant plus heureux qu’il entend poursuivre avec vous cette démarche. Il en sera ainsi à l’occasion de sa saisine par le Premier ministre, datée du 20 janvier dernier, sur le projet d’introduction d’un indicateur « empreinte écologique » dans l’analyse de la performance économique et du progrès social.
La réforme de la Constitution, au mois de juillet dernier, a rétabli la saisine parlementaire du Conseil économique, social et environnemental. C’est dire que nous restons à votre entière disposition, sur ce sujet comme sur tout autre.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous voici enfin réunis pour examiner le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, près de sept mois après son adoption en conseil des ministres et quinze mois après le discours du Président de la République clôturant les travaux du Grenelle.
Ces délais peuvent paraître longs, mais beaucoup a été fait dans l’intervalle. Les 263 engagements pris à l’issue du Grenelle ont en effet déjà commencé à être mis en œuvre, soit par voie réglementaire ou conventionnelle, soit dans d’autres textes législatifs, comme la loi de finances de 2009 ou la loi de finances rectificative pour 2008, soit encore à l’échelon européen, à travers l’action menée par la France durant sa présidence de l’Union européenne.
Cela nous permet de répondre à une première question que pourrait susciter l’examen du seul calendrier parlementaire : la mise en œuvre du Grenelle, loin d’être enlisée, avance sur de nombreux sujets.
Ce constat nous amène directement à une deuxième question, qui me semble devoir être abordée frontalement : quelle est l’utilité du texte qui nous est aujourd’hui soumis ? Le Gouvernement a fait le choix de présenter au Parlement, comme le lui permet l’article 34 de la Constitution, une loi de programmation, qui se borne à afficher les objectifs de l’action de l’État sans comporter de dispositions normatives d’application directe qui rendraient leur mise en œuvre immédiatement effective.
De ce fait, ce texte peut déconcerter au premier abord, d’autant que le Parlement est régulièrement accusé par de hautes instances juridiques de produire trop de textes, notamment trop de textes pas suffisamment normatifs. Je rappelle, à cet égard, que l’actuel président du Conseil constitutionnel avait fait la déclaration suivante, alors qu’il était président de l’Assemblée nationale : « Affirmer que l’air doit être pur et l’eau limpide, c’est bien, mais cela ne suffit pas à rendre l’air pur et l’eau limpide. Cela relève de déclarations politiques, et non de dispositions législatives. La loi doit seulement dire concrètement comment, par quelles règles juridiques, on arrive au but recherché. »
Je crois que deux réponses peuvent être apportées aux critiques formulées sur ce point.
Tout d’abord, sur un plan strictement juridique, le Conseil constitutionnel a autorisé le Parlement à approuver, dans le cadre des lois de programmation, « des dispositions dénuées d’effets juridiques, mais fixant des objectifs qualitatifs et quantitatifs à l’action de l’État ».
Ensuite, d’un point de vue politique, le processus du Grenelle de l’environnement s’est concrétisé, surtout dans sa première phase, par un dialogue mené par le Gouvernement avec la société civile plutôt qu’avec le Parlement, faiblement associé en tant qu’institution, même si un certain nombre de parlementaires ont, heureusement, participé aux travaux.
Ce texte permet donc au Parlement de reprendre la main et de se prononcer sur l’ensemble des engagements du Grenelle, qui, comme je l’ai rappelé, ne nécessiteront pas tous des mesures législatives. Il permettra du même coup à la représentation parlementaire de mieux contrôler, en aval, leur mise en œuvre. À ce sujet, nous ne pouvons que nous féliciter de ce que le Sénat soit, conformément au souhait que nous avons exprimé à de nombreuses reprises auprès de M. le ministre d’État, la première assemblée saisie sur le projet de loi portant engagement national pour l’environnement.
Sur le fond, le présent projet de loi de programme retranscrit fidèlement les engagements pris à l’automne 2007, qui portent sur des changements très profonds dans tous les secteurs contribuant à la dégradation de l’environnement ou au réchauffement climatique, notamment le bâtiment, avec l’objectif d’une réduction des consommations énergétiques de 38 % d’ici à 2020, et les transports, pour lesquels l’objectif est de réduire de 20 % les émissions de CO2 d’ici à 2020.
Or ces objectifs très ambitieux ne peuvent manquer de susciter une interrogation, que la crise économique ne rend que plus aiguë : la France a-t-elle les moyens de ses ambitions en matière environnementale ? En d’autres termes, la mise en œuvre des orientations du Grenelle est-elle compatible avec l’état économique et budgétaire du pays ?
Face à l’urgence écologique, que personne ou presque ne nie plus, notre pays pourrait en effet se satisfaire du constat suivant lequel la France n’est pas en retard. Par exemple, les émissions nationales de gaz à effet de serre par habitant sont inférieures de 21 % à la moyenne européenne, et même de 30 % à 40 % par rapport à nos grands voisins.
Le Grenelle a montré que la France ne se satisfaisait pas aujourd’hui de ne pas être en retard, mais souhaitait être en avance. En a-t-elle les moyens ?
Je crois que l’un des mérites du Grenelle est précisément d’avoir accéléré la prise de conscience du potentiel de croissance que recèle l’écologie – ce que l’on appelle la « croissance verte » –, dont l’intérêt est particulièrement mis en évidence aujourd’hui, dans le contexte de la crise économique.
Je ne citerai que deux chiffres à cet égard, qui ont le mérite de provenir de sources très différentes.
À l’échelon international, selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, le PNUE, le marché des produits et services écologiques pourrait doubler d’ici à 2020, pour atteindre 2 740 milliards de dollars.
En France, les mesures proposées dans le cadre du Grenelle devraient aboutir à court terme à des investissements sources de croissance, dans des activités à forte intensité de main-d’œuvre et peu délocalisables, notamment le bâtiment, les transports et l’énergie. L’étude d’impact réalisée en novembre 2008 par le ministère a ainsi montré que près de 500 000 emplois devraient être créés. En outre, il faut souligner que de très nombreuses mesures seront, à terme, financées par les économies d’énergie réalisées.
Toutefois, ces prévisions ne se réaliseront que si un certain nombre de conditions sont réunies. Cela m’amène à évoquer les principes qui ont guidé la commission des affaires économiques dans l’examen de ce texte.
Je voudrais tout d’abord rappeler que notre commission s’est très tôt impliquée dans le processus du Grenelle. Elle fut en effet à l’origine de la création, à l’été 2007, du groupe sénatorial de suivi du Grenelle. Celui-ci a travaillé parallèlement au processus du Grenelle, puis a procédé à soixante-quinze auditions sur le présent projet de loi.
J’ai ainsi pu mesurer pleinement l’ampleur des évolutions proposées et le chemin parcouru par les différentes parties en présence pour rapprocher des positions au départ éloignées.
Ces auditions ont également montré qu’il faut, dans l’intérêt même de la réussite du Grenelle, rester vigilants sur plusieurs points, s’agissant non seulement de ce texte, mais aussi de ceux qui suivront.
Premièrement, la pression fiscale globale ne doit en aucun cas être alourdie et la fiscalité environnementale doit servir à financer des actions environnementales. C’est dans cet esprit que la commission a adopté un amendement faisant clairement référence au nécessaire respect de ces principes.
Deuxièmement, les nouveaux dispositifs ne doivent pas alourdir les contraintes qui pèsent notamment sur les petites et moyennes entreprises, mais aussi, plus généralement, sur les projets d’investissement. Après l’examen au Parlement d’un projet de loi visant à simplifier les procédures pour relancer l’économie, ce serait vraiment contradictoire.
Troisièmement, le manque de compétences pourrait freiner la progression envisagée des créations d’emplois. Ainsi, les 88 000 emplois supplémentaires prévus d’ici à 2012 par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, au titre de l’amélioration énergétique du secteur résidentiel dépassent largement le rythme actuel de formation. En conséquence, un effort devra impérativement être fait en la matière.
Quatrièmement, toute adoption ou modification de réglementation nationale en matière d’environnement doit être précédée d’une étude d’impact. C’est notamment pour cette raison que la commission a adopté un amendement tendant à demander la réalisation d’une étude de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur le sujet, particulièrement important, des bâtiments à basse consommation avant de fixer la modulation de la norme de consommation des nouveaux bâtiments.
Enfin, les collectivités territoriales ne doivent en aucun cas supporter les coûts supplémentaires engendrés par le manque de moyens budgétaires de l’État. Ce point suscite de réelles inquiétudes au sein des associations d’élus, s’agissant notamment de la question du financement des transports collectifs. Je souhaiterais, monsieur le ministre, que vous puissiez les rassurer à cet égard.
Sur la forme, l’adoption par les députés, dans des conditions d’examen qui n’ont pas toujours été optimales, de 390 amendements a quelque peu éloigné le texte transmis au Sénat du projet de loi initial. C’est pourquoi la commission a adopté un certain nombre d’amendements visant à revenir à l’esprit d’une loi de programmation.
Enfin, sans entrer davantage dans le détail de ces amendements, j’indique que la commission vous proposera un certain nombre d’ajouts, portant notamment sur les points suivants : la discussion par les partenaires sociaux de la création d’un « carnet de santé » du travailleur lui permettant de disposer, tout au long de son parcours professionnel, d’informations précises sur les substances auxquelles il a été exposé sur son lieu de travail ; la demande au Gouvernement d’un rapport sur les enjeux et l’impact, d’une part, de l’autorisation de circulation des poids lourds de 44 tonnes, et, d’autre part, de la réduction à 80 kilomètres-heure de la limite de vitesse et de l’interdiction des dépassements pour tous les poids lourds circulant sur autoroute ; la création d’une instance de médiation des éco-organismes compétents en matière de gestion des déchets, qui s’avèrera particulièrement utile après le récent scandale lié à la gestion des fonds d’Éco-Emballages.
En conclusion, ce projet de loi devrait favoriser la mobilisation de toutes les énergies en fixant des objectifs très ambitieux. Il nous restera, bien entendu, à en examiner la déclinaison concrète dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement. La commission des affaires économiques vous propose donc d’adopter le présent texte, mes chers collègues, sous réserve de la centaine d’amendements qu’elle vous soumet.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, l’urgence écologique était une vérité qui dérange ; c’est aujourd’hui une exigence partagée.
Le film de l’ancien vice-président des États-Unis Al Gore et l’attribution à ce dernier du prix Nobel ont indéniablement marqué une étape importante dans la prise de conscience écologique à l’échelle internationale.
« Nous allons exploiter l’énergie du soleil, du vent et du sol pour faire marcher nos voitures et nos usines. » Ces mots, prononcés il y a une semaine seulement par le président Obama lors de sa cérémonie d’investiture, ont, par leur évidente simplicité, concrétisé le changement d’orientation de l’administration américaine, dont nous devons nous réjouir.
Je n’oublie cependant pas que cette prise de conscience a été longue à se dessiner, tant sur le plan mondial que dans notre pays, et que certains doivent encore être convaincus. Je n’oublie pas non plus les textes, les discours et les écrits de ceux qui, en France, ont été les premiers militants de l’urgence écologique, en particulier dans les années soixante-dix. À l’époque, ils étaient bien seuls.
C’est dire si le texte qui nous est présenté aujourd’hui vient de loin. Pour cette raison, il laissera sans doute une trace dans notre histoire législative, mais, pour qu’il marque vraiment, il faut aussi qu’il soit suivi d’effets.
Or, de ce point de vue, les incertitudes sont grandes. Peut-être partagez-vous d’ailleurs, monsieur le ministre d’État, certaines de nos inquiétudes. Elles portent sur le financement des engagements du Grenelle, le recul des services publics, l’influence des lobbies.
Sans anticiper sur nos débats ni sur le vote final du groupe socialiste, je peux vous dire que nous nous engagerons dans cette discussion avec le même état d’esprit que nos collègues de l’Assemblée nationale, c'est-à-dire avec responsabilité et pragmatisme.
Oui, nous approuvons la démarche visant à établir un diagnostic partagé pour faire bouger les consciences et pour infléchir la courbe des certitudes concernant la lutte contre l’effet de serre.
Oui, nous approuvons la démarche concertée, élargie, coproductrice de pratiques nouvelles et de solutions innovantes du Grenelle, avec ses comités opérationnels, les COMOP.
Oui, nous approuvons également l’idée d’un compromis du possible, car il serait présomptueux de notre part de donner des leçons à quiconque sur un sujet aussi complexe.
Oui, nous sommes pour le volontarisme en matière d’économies d’énergie.
Ce texte vient de loin, ai-je dit ; j’aurais aussi pu dire qu’il revient de loin, car son parcours parlementaire a déjà été pour le moins chaotique.
Des voix se sont élevées, à l’Assemblée nationale, pour en amoindrir la portée, sinon en dénaturer le contenu. Cela risque de se produire également dans notre assemblée.
En tout état de cause, j’ai déjà entendu quelques apartés, au sein de notre commission, pouvant donner à penser que ce texte pourrait essuyer quelques déboires au cours de nos discussions…
Le parcours risque encore de se compliquer puisque, vous l’avez confirmé, monsieur le ministre d’État, la navette parlementaire sur le présent texte ne sera pas achevée que nous devrons déjà aborder l’examen du projet de loi dit « Grenelle II ».
Il a fallu d’ailleurs toute la ténacité de nos collègues députés socialistes pour conserver sa force au texte et en améliorer la portée sur certains points. Ainsi, 150 amendements de notre groupe ont été adoptés à l’Assemblée nationale, où le projet de loi a été voté à la quasi-unanimité. On pourrait dire, en forçant un peu le trait, que c’est la gauche qui a sauvé votre texte, monsieur le ministre d’État !
À mes yeux, cela montre d’une part la possibilité du consensus entre nous, d’autre part l’utilité du droit d’amendement parlementaire. Au moment où nous nous apprêtons à débattre du projet de loi organique relatif à l’organisation de nos travaux, il n’est pas superflu de rappeler la valeur de ce droit constitutionnel.
Ce texte revient également de loin du point de vue gouvernemental. Le moins que l’on puisse dire, c’est que son portage ministériel a connu quelques soubresauts ! À quelques jours près, monsieur le ministre d’État, vous vous présentiez au Sénat pour défendre ce texte sans secrétaire d’État chargé de l’écologie. Heureusement, le Président de la République a pourvu au remplacement de Mme Kosciusko-Morizet, et je veux saluer la nomination de Mme Jouanno, dont je connais les compétences puisqu’elle a occupé des fonctions opérationnelles à Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l’ADEME, dont le siège social se trouve dans ma ville !
Exclamations amusées sur les travées de l ’ UMP.

Nous approuvons, je le redis, le constat et les principes qui sous-tendent ce projet de loi : l’urgence écologique est majeure et il est juste qu’elle soit reconnue par la loi ; la démarche participative est innovante, mais l’affirmation du rôle de l’État est nécessaire ; dans la période de crise que nous vivons, le besoin d’investir massivement dans la croissance durable est réel.
Cependant, des questions importantes se posent et de sérieuses contradictions existent, hélas ! entre le texte présenté aujourd’hui et la réalité de la politique gouvernementale.
Une première question est liée à la crise économique actuelle : les moyens mobilisés dans le cadre du plan de relance permettent-ils de procéder à une mise en œuvre accélérée des orientations du Grenelle de l’environnement ?
S’il s’agit, comme nous le pensons, d’une crise du système économique lui-même et pas seulement d’un retournement de conjoncture, alors cette crise appelle des réponses de long terme et une réorientation profonde des investissements et de la consommation en faveur de l’économie verte.
Cette exigence est-elle prise en compte dans le plan de relance que le Sénat a examiné la semaine dernière ? À l’évidence, non !
Une deuxième question de fond découle de cette analyse : l’échec du système ultralibéral ne démontre-t-il pas que ce dernier est fondamentalement incompatible avec le développement durable ? La spéculation sur les matières premières et la prise en otage des peuples souffrant de la faim sont des illustrations significatives de cette incompatibilité. Malheureusement, la privatisation de Gaz de France et sa fusion avec Suez montrent que les logiques libérales sont toujours à l’œuvre.
Une troisième question a trait au rôle et à la place de l’État en matière de développement durable : le désengagement de l’État et le recul des services publics sont-ils « grenello-compatibles » ?
Je rappelle que le développement durable, c’est « penser global » et « agir local ». Autrement dit, il faudrait proposer des réponses de proximité, notamment pour ne pas multiplier les déplacements. Or le gouvernement auquel vous appartenez prend des décisions allant dans le sens inverse !
Comment prétendre que l’on respecte les principes du Grenelle lorsque, à la suite de la fermeture d’un tribunal, un justiciable doit effectuer un trajet d’une heure et demie en voiture pour un problème de tutelle ? Il en va de même pour les fermetures d’hôpitaux, de bureaux de poste ou pour les suppressions d’emplois dans l’éducation nationale.
Avez-vous chiffré le bilan « carbone » des déménagements des services de l’État que le Gouvernement organise, qui induisent des déplacements pour les agents des administrations, mais aussi pour les administrés ?
Comment expliquer que notre assemblée ait adopté, la semaine dernière, un amendement concernant l’organisation d’un grand prix de Formule 1 dans les Yvelines, département cher à notre président ?
Sourires

Une autre difficulté pourrait naître de l’opposabilité juridique des principes du Grenelle inscrits dans la loi. C’est là d’ailleurs un des arguments avancés par les nombreuses communes qui ont déposé un recours devant le Conseil d’État contre la fermeture de leur tribunal. En clair, révision générale des politiques publiques ou Grenelle, il vous faut choisir !
Sur le plan financier, l’absence de garanties durables pour les financements annoncés et l’impasse budgétaire dans laquelle se trouvent des pans entiers des politiques nationales en faveur du logement, de la recherche, des transports et de l’agriculture posent question.
J’illustrerai mon propos par deux exemples.
Tout d’abord, le budget du logement pour 2009 marquant une diminution de 7 % des crédits, comment voulez-vous que les bailleurs sociaux puissent satisfaire aux exigences de consommation énergétique s’appliquant aux nouvelles constructions ? Tous les acteurs du logement considèrent qu’il sera difficile d’atteindre l’objectif ambitieux de 50 kilowattheures par mètre carré et par an pour les logements neufs. Nous aurons l’occasion de revenir sur ce point lors de l’examen de l’article 4, et en particulier de l’amendement de la commission visant à demander la réalisation d’une expertise par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Il faudra pourtant bien prendre en compte ces deux priorités que sont la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la réponse à la demande de logements, ce qui suppose un compromis sur le plan énergétique.
J’évoquerai ensuite le financement des projets de transports collectifs en site propre. J’attire votre attention sur le fait que les crédits mobilisés au titre de la mise en œuvre du dispositif de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, la loi TEPA, suffiraient à financer l’ensemble des projets de transports collectifs en site propre. Comparaison n’est pas raison, certes, mais cela montre en tout cas que des moyens existent !
De ce point de vue, pour assurer le financement des dispositions du Grenelle, nous proposerons l’instauration d’une taxe « carbone » tenant compte de l’aménagement du territoire, la création d’un prélèvement sur les superprofits des compagnies pétrolières pour financer les transports collectifs, ainsi que la baisse de la TVA sur les produits « verts ».
Cela étant, pour nous, la question écologique est aussi, et peut-être avant tout, une question sociale, qui n’a d’ailleurs pas été prise en compte dans le plan de relance.
Ainsi que l’observent Jean-Paul Fitoussi et Éloi Laurent dans leur ouvrage intitulé La Nouvelle Écologie politique, paru en septembre 2008, « la solution au problème écologique n’est donc pas la fin de la croissance des niveaux de vie, mais la décroissance des inégalités : il faudra alors moins de croissance pour satisfaire les besoins de la population, car une part moins importante en sera accaparée par les plus riches, et les plus pauvres, délivrés de contraintes du quotidien, pourront de nouveau penser à l’avenir ».
À cet égard, il convient de rappeler que le poids des dépenses énergétiques dans le budget des ménages n’a cessé d’augmenter ces dernières armées, tandis que les inégalités s’accroissaient.
C’est pourquoi nous avons déposé plusieurs amendements visant à éviter que l’amélioration de l’efficacité et de la sobriété énergétiques ne rende l’énergie inaccessible à certains. Il faut, en effet, garantir un accès minimal à l’énergie pour tous grâce à la préservation d’un tarif abordable.
Mes chers collègues, nous abordons ce débat avec vigilance mais dans un esprit de responsabilité, afin d’éviter qu’il n’aboutisse à une dénaturation du texte, comme ce fut le cas à l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, avec quelques mois de retard sur le calendrier initial, le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, ou « Grenelle I », nous est finalement soumis.
Je déplore d’autant plus ce retard que l’ordonnancement prévu des textes relatifs à la mise en œuvre des orientations du Grenelle de l’environnement a été bouleversé.
Ainsi, nous avons déjà voté les dispositions du « Grenelle III », qui ont été incluses dans la loi de finances de 2009. Par ailleurs, le « Grenelle Il » a déjà été présenté en conseil des ministres et se trouve désormais au cœur des débats entre les parties prenantes au Grenelle.
De ce fait, le présent projet de loi se trouve quelque peu court-circuité, alors même que c’est pourtant un texte fondamental, qui fixe les grandes orientations. Il reprend les objectifs issus du processus du Grenelle, qui a été un véritable succès dans la mesure où il a déclenché une prise de conscience de l’urgence environnementale chez l’ensemble de nos concitoyens.
Il est, en effet, indispensable que nous soyons tous convaincus que nous devons agir pour protéger notre environnement.
On a tendance à l’oublier, la consommation d’énergie des ménages continue de croître tous les ans, alors que le secteur industriel a entrepris depuis déjà plusieurs années sa mue énergétique.
Ce projet de loi, dont la forme très déclarative est pour le moins étonnante, aborde pêle-mêle une multitude de secteurs d’activité et d’actions à mener. Compte tenu du temps limité qui m’est imparti, je bornerai mon intervention à la problématique agricole.
Tout d’abord, je regrette que ce projet de loi donne de l’activité agricole une image un peu caricaturale, se réduisant à une opposition entre l’agriculture intensive, qui détruirait notre environnement, et l’agriculture biologique. Cela ne reflète pas la réalité agricole.
L’agriculture que nous connaissons aujourd’hui résulte directement de la mission qui lui a été confiée : nourrir les hommes. Plus de 900 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde aujourd’hui et, il faut le dire, ce n’est pas l’agriculture biologique qui permettra de nourrir la planète. Je suis d’autant plus à l’aise pour le dire que j’apprécie cette forme d’agriculture, à laquelle j’ai toujours apporté mon soutien dans le cadre de mes responsabilités. Il n’y a donc aucune ambiguïté sur ce point.
De nombreux agriculteurs se sont engagés dans des démarches responsables, prenant en compte la protection de l’environnement tout en cherchant à maintenir des rendements élevés. C’est notamment le cas de l’agriculture raisonnée.
Or ce type cultural n’est même pas cité dans le projet de loi, alors qu’il s’inscrit dans la même logique que la certification environnementale des exploitations portée par ce texte. C’est là une lacune à laquelle il convient de remédier. J’ai d’ailleurs déposé un amendement en ce sens.
En ce qui concerne la réduction des intrants, le Parlement européen a
Cette réglementation, qui entre en vigueur dès cette année, logique.
Toutefois, les conditions d’application des produits phytosanitaires ne sont nullement anodines, monsieur le ministre d’État. Il importe de se montrer prudents en matière de préconisations, car de trop fortes contraintes peuvent empêcher de traiter la récolte, et donc de la préserver.
Dans un pays comme la France, qui figure au troisième rang des consommateurs de pesticides dans le monde et au premier dans l’Union européenne, la réduction de l’emploi des pesticides n’est pas un vain mot. Elle devrait entrer en vigueur non seulement par le biais de la directive européenne, mais aussi au travers du plan Ecophyto présenté en conseil des ministres en septembre dernier.
Ce plan prévoit d’interdire les cinquante-trois molécules les plus dangereuses et de réduire de moitié l’usage des pesticides d’ici à dix ans. Nous sommes tous favorables au principe de la réduction de l’usage des produits phytosanitaires, pour des raisons tant sanitaires qu’économiques, mais elle ne doit pas porter préjudice aux filières de production qui ne disposent aujourd’hui d’aucune molécule pouvant se substituer à celles qui sont interdites ou le seront prochainement.
Les petites productions, telles certaines cultures légumières et fruitières, ne sont pas rentables pour les sociétés privées. Néanmoins, elles comptent beaucoup sur le plan local, car elles assurent une véritable vitalité économique des territoires.
Il est donc nécessaire que l’État puisse accorder des moyens spécifiques à ces productions mineures et leur appliquer un régime plus souple. Parallèlement, il faudra orienter la recherche et l’innovation publiques dans ces secteurs. L’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, a une responsabilité éminente dans ce domaine et il revient à l’État de l’inciter à accélérer et à approfondir ses efforts.
Enfin, je me réjouis que ce projet de loi prévoie le stockage de l’eau. J’ai déposé un amendement spécifiant que ce stockage aura pour objet de créer de nouvelles ressources en eau. Stocker l’eau quand elle est abondante, en prévision des périodes plus sèches, relève du bon sens et répond au principe de précaution. Cette disposition sera particulièrement utile aux agriculteurs du Sud-Ouest, qui sont confrontés à de très forts besoins en eau pratiquement tous les étés, alors que, par ailleurs, les pluies hivernales et printanières, nécessaires pour réalimenter les réserves naturelles des sols et sous-sols, sont parfois insuffisantes pour recharger les nappes phréatiques.
Aussi, afin de répondre aux besoins tant de la population que des activités économiques, pour lesquelles il est indispensable de mieux utiliser les eaux de surface plutôt que de puiser dans les réserves profondes, et afin de soutenir le débit des rivières en période d’étiage, de manière à maintenir la vie aquatique et la production piscicole, la création de ressources nouvelles est urgente et indispensable pour amortir les effets du réchauffement climatique.
Au moment où nous parlons d’environnement et de climat, permettez-moi, monsieur le président, d’avoir une pensée pour toutes les victimes de la catastrophe que nous venons de connaître dans le grand Sud-Ouest. Je tiens à remercier ici tous ceux de nos collègues qui se sont déjà emparés de ce dossier.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Mon cher collègue, nous étions hier à Gujan-Mestras, avec les maires des communes sinistrées, pour marquer la solidarité du Sénat.
M. Bernard Frimat remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, aujourd’hui s’ouvre dans notre assemblée le débat tant attendu sur le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, qui a été adopté en conseil des ministres le 11 juin 2008.
Nous regrettons que l’urgence ait été déclarée récemment pour ce texte, privant les parlementaires d’une seconde lecture, pourtant promise aux députés après qu’ils eurent consenti à l’accélération de leurs débats.
M. le ministre d’État fait un geste de dénégation.

Nous saluons la qualité des travaux qui ont réuni pendant de longs mois des représentants des collectivités territoriales, des organisations non gouvernementales, des professionnels, des syndicats, de l’État et, peut-être dans une moindre mesure, du Parlement.
Nous nous félicitons, à ce titre, de l’initiative du président de la commission des affaires économiques, qui, avec l’accord de M. le rapporteur, a constitué un groupe sénatorial de suivi du Grenelle de l’environnement, dont les nombreuses auditions ont débuté dès l’automne 2007. Les échanges au sein des différents groupes de travail ont permis d’éclairer utilement le Parlement sur des dossiers aussi divers et techniques que le réchauffement climatique, la biodiversité, les déchets, ainsi que sur les enjeux en termes de santé publique. Ces débats furent source de renseignements précieux.
Cette démarche est d’autant plus louable qu’elle illustre une nouvelle forme de gouvernance à laquelle nous souscrivons : établissant un lien direct avec la société civile, elle renforce la prise de conscience de nos concitoyens.
Monsieur le ministre d’État, devant nos collègues députés vous avez affirmé « qu’il était plus facile d’être dans le déni ou dans le mépris de l’autre, de lancer des anathèmes plutôt que d’élaborer avec tous les acteurs de la société un diagnostic réel, sincère et sans concession ». Je vous rassure, nous partageons le diagnostic grave établi par les scientifiques, nous sommes conscients, comme la majorité de nos concitoyens, de l’urgence qu’il y a d’agir, et nous sommes déterminés à mener la lutte jusqu’au bout.
Cependant, si le constat est partagé, il est de notre responsabilité politique d’affirmer, dès la discussion générale, que la protection de l’environnement et la mise en œuvre des droits qui y sont attachés, ainsi que de ceux qu’il nous reste à consacrer, nécessitent des politiques publiques fortes au service de l’homme et de l’intérêt général : autrement dit, les préoccupations environnementales et sociales sont intimement liées.
Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dit « Grenelle I », décline de bonnes intentions, parfois des objectifs plus précis, en répondant inégalement, selon les domaines, aux attentes qu’il a suscitées. Nous pouvons, d’ores et déjà, même si c’est de façon incomplète, avoir une idée de la manière dont le Gouvernement souhaite les mettre en œuvre.
Tout d’abord, le projet de loi portant engagement national pour le l’environnement, dit « Grenelle II », a été déposé sur le bureau du Sénat le 12 janvier. C’est un texte très technique et, en même temps, très politique, dont l’étude demande un travail approfondi. Ce texte n’a pas encore été examiné précisément, il est donc difficile de préjuger du résultat final. Cependant, en l’état actuel, des mesures structurantes font défaut en termes de fiscalité, ainsi que dans les domaines de la santé, de la protection des lanceurs d’alerte ou de la responsabilité sociale et environnementale.
Ensuite, les mesures en faveur de l’environnement contenues dans les lois de finances ne sont pas plus satisfaisantes. Rappelons que les quatre cinquièmes du financement de la réforme échappent à l’autorisation budgétaire annuelle. Le plan triennal de financement du Grenelle révèle en effet que, sur 7, 3 milliards d’euros qui seront consacrés à la mise en œuvre des orientations de celui-ci, seulement 17 % de cette somme prendra la forme de crédits budgétaires, tandis que 38 % consistera en allégements fiscaux nouveaux et 45 % en ressources affectées aux opérateurs ou en contributions de la Caisse des dépôts et consignations.
Nous avons eu l’occasion de donner notre sentiment sur ce que vous appelez, monsieur le rapporteur, le « verdissement » des mesures fiscales, qu’il s’agisse du prêt acquisition à taux zéro, du crédit d’impôt prévu dans la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de l’éco-prêt rénovation à taux zéro et du crédit d’impôt développement durable.
Le prêt à taux zéro ne doit pas être considéré comme la réponse miracle au désengagement financier de l’État : il s’agit, d’abord et avant tout, d’un cadeau aux établissements bancaires. On pourrait d’ailleurs disserter longuement sur les pratiques discriminatoires de certains établissements dans l’attribution des prêts ! L’efficacité de telles mesures est discutable, là où un engagement financier fort de l’État serait nécessaire.
Que penser des objectifs ambitieux affichés en matière de maintien de la biodiversité lorsque le programme « Urbanisme, paysage, eau et biodiversité » est amputé d’une partie des crédits prévus pour la mission « Écologie, développement et aménagement durables » ? Quelle portée accorder à vos bonnes intentions, quand l’Office national des forêts, dont on connaît le rôle dans la préservation de la biodiversité, voit ses crédits diminuer chaque année ? Depuis vingt-trois ans, cet établissement public a perdu près de 37 % de ses effectifs !
D’autres coupes budgétaires pourraient être dénoncées, et nous ne manquerons pas de le faire au cours des débats. Ainsi, le sort réservé aux budgets de la recherche et de l’éducation a provoqué, encore ces dernières semaines, la colère des enseignants, des lycéens et des chercheurs. Pourtant, plusieurs articles de ce projet de loi présentent la recherche et l’enseignement comme les moteurs du développement durable !
Enfin, vous comptez beaucoup sur l’engagement des collectivités locales. Celles-ci n’ont d’ailleurs pas attendu pour prendre en compte les impératifs de protection de l’environnement. Cependant, l’État ne peut pas se désengager financièrement à leur détriment, sauf à mettre en péril le grand chantier que nous souhaitons tous lancer. À ce titre, la révision générale des politiques publiques prive nos territoires de personnels et de compétences qui étaient utiles aux collectivités territoriales.
Vous comprendrez donc que l’appréciation que nous portons sur le projet de loi ressorte quelque peu ternie de l’examen des financements réellement engagés.
Sur le fond, le projet de loi « Grenelle I » présente certaines avancées, tandis qu’il marque au contraire un recul sur d’autres points au regard des exigences formulées au sein des groupes de travail. De plus, les avancées doivent souvent être relativisées, compte tenu des récentes décisions prises dans le cadre des politiques gouvernementales.
En ce qui concerne la lutte contre le réchauffement climatique, nous sommes d’accord avec les objectifs affichés et les efforts consentis sur le plan européen, en dépit d’un contexte politique difficile. Diviser par quatre nos émissions de CO2 entre 1990 et 2050, réduire de 20 % les émissions de CO2 dans le secteur des transports à l’horizon 2020, porter à 23 % la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique en 2020 : cela constitue une feuille de route cohérente, même si l’urgence nous aurait poussés à demander plus. Cependant, il ne convient pas de fixer des objectifs inatteignables !
En tout état de cause, la mise en place du système d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre sur un marché évidemment « libre et non faussé » ne sert pas l’objectif de réduction des émissions de tels gaz ! Rappelons que le bilan des mécanismes d’échanges n’a pas été dressé. Cette spéculation sur la tonne de dioxyde de carbone au service de l’environnement me semble être une fausse bonne idée !
En ce qui concerne le secteur des transports, vos politiques en faveur de l’ouverture à la concurrence du transport des marchandises et, bientôt, du transport des voyageurs entraînent l’abandon des lignes de proximité les moins rentables, laissant aux collectivités locales la responsabilité d’assurer la desserte de leurs territoires !
Prenons l’exemple de la SNCF : cette entreprise, qui était complètement intégrée, est en train d’être découpée et segmentée, afin d’éliminer les activités non rentables et de confier les plus lucratives au secteur privé. C’est là une pratique habituelle ! Est-ce promouvoir un développement véritablement durable ? Cette politique remet dangereusement en cause les objectifs affichés en termes de report modal. Quant aux futures « autoroutes ferroviaires », elles ne suffiront pas à assurer une véritable relance du fret ferroviaire.
Enfin, en ce qui concerne le bâtiment, la précarité énergétique, tant dans le logement social que dans le secteur privé, n’est pas prise en compte dans le texte. De nombreuses personnes n’ont pas les moyens de financer les travaux visant à réaliser des économies d’énergie. Je pense, notamment, aux propriétaires disposant de ressources modestes qui ont économisé toute leur vie pour acquérir une petite maison : ils auront énormément de mal à faire face à ces dépenses.
En ce qui concerne les mesures relatives à la biodiversité, nous soutenons la mise en place d’une « trame verte », pour rétablir les continuités écologiques, et celle d’une « trame bleue », qui constitue son équivalent pour les milieux aquatiques. Nous reviendrons sur ces sujets lorsque nous aborderons les articles concernant la politique de l’eau.
Dans le secteur agricole, l’objectif est de réduire l’usage des produits phytosanitaires et de porter à 6 % en 2013, puis à 20 % en 2020, la part de la SAU consacrée à l’agriculture biologique, contre 2 % actuellement. Ce sont de bonnes mesures, mais quelle crédibilité accorder sur ce point au Gouvernement ? Comment oublier les débats sur les organismes génétiquement modifiés ou la philosophie qui guide, depuis la loi d’orientation agricole jusqu’à la réforme de la politique agricole commune, vos choix en faveur d’une agriculture intensive ? Là encore, ce projet de loi met en avant l’agriculture biologique, sans prévoir de soutien réel à ce mode de production.
S’agissant des agrocarburants, nous nous réjouissons que le projet de loi vise ceux de deuxième et troisième générations. En effet, la question du coût environnemental des agrocarburants ne doit pas être ignorée. Nous savons qu’ils présentent de sérieux inconvénients en termes d’érosion des sols et d’atteinte à la biodiversité. De plus, ces cultures ont commencé à se développer au détriment des productions destinées à l’alimentation des populations, ce que nous ne pouvons accepter !
Les chapitres consacrés à la prévention des risques pour l’environnement et la santé et à la prévention de la production de déchets mériteraient une loi de programmation détaillée.
On sait que les avancées en la matière s’obtiennent au prix de luttes difficiles. Je pense ici au règlement sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques, dit REACH, qui, sous la pression de lobbies puissants, est malheureusement resté en deçà des objectifs de départ. L’engagement d’instaurer une responsabilité élargie des producteurs de déchets est un premier pas. Cependant, la réflexion n’a pas été poussée assez loin pour que la production de déchets soit réduite à la source. Nous aurons également l’occasion d’en reparler.
Nous défendrons l’instauration d’un moratoire sur la construction d’incinérateurs. On connaît les conséquences du fonctionnement de telles installations sur la santé des populations, ce qui nous rend responsables, dès aujourd’hui, de l’adoption des mesures nécessaires pour préserver la santé de nos concitoyens.
Enfin, nous porterons une attention particulière, comme nous l’avions fait lors de l’élaboration de la loi relative à la responsabilité environnementale, à la responsabilité sociale des entreprises, notamment celle des sociétés mères.
Promouvoir un développement durable suppose une refonte radicale de nos modes de production et de consommation, mais également une lutte contre les inégalités entre les peuples et les individus. C’est pourquoi les sénateurs du groupe CRC-SPG soutiendront des mesures visant non seulement à améliorer la protection de l’environnement, mais également à promouvoir les intérêts sociaux.
Tant que le Gouvernement continuera de croire que l’économie libérale et la croissance verte peuvent tout résoudre, toutes les bonnes intentions sous-tendant le Grenelle de l’environnement resteront lettre morte ! Notre collègue Daniel Raoul a dit qu’il faudrait choisir entre la RGPP et le Grenelle ; je pense, quant à moi, qu’il faudra un jour choisir entre l’économie libérale et le développement durable !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, avec l’examen de ce projet de loi, nous sommes en train de gagner un pari qui ne l’était pas d’avance.
Après avoir relevé le défi du Grenelle de l’environnement, formidable et inédit processus de consultation et de dialogue démocratiques, qui ne fut pas simplement un événement médiatique, le Gouvernement en a concrétisé les engagements et les objectifs dans le présent projet de loi de programme, ainsi que dans le projet de loi portant engagement national pour l’environnement, que nous discuterons dans quelques semaines.
À ce propos, monsieur le ministre, le groupe UMP apprécierait que ce dernier texte soit d’abord inscrit à l’ordre du jour du Sénat, eu égard au rôle central assigné aux collectivités locales dans la mise en œuvre de la plupart de ses dispositions.
Je ne vais pas revenir sur les principales mesures du présent texte ; elles ont été parfaitement détaillées par notre collègue Bruno Sido, dont je tiens tout particulièrement à saluer l’excellent travail.
Dans son ensemble, le groupe UMP adhère aux objectifs affichés par le projet de loi, notamment celui des « 3 fois 20 » issu du paquet « climat-énergie » élaboré à l’échelon européen : réduction de 20 % des consommations d’énergie, diminution de 20 % des émissions de gaz à effet de serre et passage à 20 % de la part des énergies renouvelables dans notre consommation d’énergie en 2020.
Nous sommes tous d’accord pour reconnaître et saluer l’occasion historique que constitue ce texte : celle de passer d’un modèle économique à un autre, à savoir l’économie de marché sobre en carbone.
Il s’agit plus d’une mutation que d’une révolution ou d’une simple réforme, car nous devons conserver les fondamentaux de la société actuelle et tenir compte des réalités économiques et sociales. La crise économique et financière que connaît le monde aujourd’hui me semble être le contexte idéal pour effectuer ce passage vers un nouveau modèle de développement.
Nous avons le devoir de trouver de nouveaux gisements de croissance et d’emploi pour assurer un niveau de vie décent à nos concitoyens, et ce que l’on appelle la croissance verte, qui est non pas une décroissance ou un retour en arrière, mais bien une projection dans l’avenir, constitue ce gisement à découvrir et à valoriser.
Monsieur le ministre, je voudrais insister sur un point.
Sans minimiser l’importance de cette mutation, je suis persuadé qu’il ne faut pas que nous nous éloignions du monde économique et de ses réalités, au risque de créer une véritable fracture économique entre nos entreprises et celles de nos voisins ou des pays émergents qui ne respectent pas les mêmes normes.
Cela impose une autre exigence : nous ne devons pas nous éloigner des normes européennes qui existent déjà en ces matières. Tout risque de distorsion de concurrence est à éviter, même si la marche vers certains objectifs très ambitieux s’en trouve rallongée. Nous ne changerons pas notre modèle économique de façon isolée et nous n’imposerons pas au monde entier des normes qu’il ne peut pas, pour des raisons économiques ou culturelles, aujourd'hui accepter.
Il faut donc inscrire notre démarche dans une méthode pragmatique, ce qui n’exclut nullement l’ambition. En clair, il est parfait d’ouvrir la voie vers de nouvelles solutions, mais nous ne devons pas être naïfs en oubliant, par exemple, que, dans les négociations actuelles au sein de l’OMC, la contrainte environnementale n’est toujours pas intégrée. Elle ne le sera qu’au cours du prochain cycle, après celui de Doha.
Ne fragilisons donc pas un peu plus encore notre modèle de développement en faisant abstraction du monde qui nous entoure. Jouer les chevaliers blancs est séduisant, mais peut se révéler dangereux pour nos entreprises, à qui seraient imposées des obligations certes vertueuses, mais porteuses de risques.
En revanche, sous les réserves que je viens d’exprimer, démontrer que cette économie de marché sobre en carbone, cette fameuse croissance verte, peut exister et qu’il suffit de l’inventer est une grande ambition, une ambition européenne, et non pas seulement française. Soyons-en persuadés, tous nos choix futurs, notamment en matière d’énergie, d’investissement, de recherche, de transports, d’équipements ou de nouvelles technologies, doivent s’inscrire dans le cadre européen.
N’oublions pas que le mouvement de prise de conscience de la contrainte environnementale et de ses enjeux économiques est lent, car il est mondial. Il a fallu attendre près de vingt-cinq ans pour qu’un pays, le nôtre, l’inscrive dans la loi et dans un cadre d’action politique.
Le processus du Grenelle se situe dans ce mouvement. Le contexte de son aboutissement a été marqué par les travaux de l’économiste britannique Nicholas Stern et les prévisions du GIEC, le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, sur le changement climatique.
Je veux également évoquer notre action au cours de la présidence française de l’Union européenne, pour laquelle nous avions choisi comme priorité, malgré le contexte difficile, l’adoption du paquet « énergie-climat ». Un accord historique a été conclu le 12 décembre dernier, qui répond à l’objectif des « 3 fois 20 en 2020 » contenu dans les conclusions du Grenelle.
Par ailleurs, lors de la conférence de Poznan de décembre dernier, une étape cruciale a été franchie avec l’adoption d’une feuille de route pour 2009, jusqu’à la conférence de Copenhague, qui devra mettre en place une gouvernance mondiale en matière de climat.
En conclusion, si l’économie de marché reste au cœur de notre société, il faut considérer qu’il y a un « dû à l’homme et à sa dignité ». C’est aussi et surtout dans cette perspective qu’il faut appréhender le dossier du dérèglement climatique et diminuer l’empreinte écologique de l’homme sur cette planète, non par la décroissance, mais par la recherche sans cesse renouvelée de sauts technologiques.
Je voterai ce texte et suis persuadé que le groupe UMP en fera autant à une très forte majorité, sinon à l’unanimité. Avec l’amitié, la fidélité et le respect que je leur porte, c’est le conseil que je donnerai à mes collègues.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, la gravité de la crise écologique qui touche notre planète n’est plus à démontrer. Les tempêtes du week-end dernier qui ont frappé le Tarn-et-Garonne et de nombreux autres départements du sud-ouest de la France…

… sont une illustration malheureuse de dérèglements climatiques de plus en plus fréquents dans le monde.
Toutes les forces vives de la société, que ce soient les pouvoirs publics, les chercheurs, les associations ou les entreprises, partagent un même diagnostic : notre monde entre dans une ère nouvelle, marquée par un climat instable, une raréfaction des ressources naturelles et une biodiversité en danger.
Au-delà de ces menaces, qui sont les plus évidentes, pourraient même survenir des « conflits verts » qui s’ajouteraient aux guerres traditionnelles provoquées par des causes sociales, ethniques, économiques et politiques. L’arme alimentaire, d’ailleurs déjà utilisée dans certaines régions du monde, pourrait devenir l’un des principaux facteurs de déséquilibre géopolitique.
Depuis longtemps, les radicaux sont sensibles aux questions environnementales. Notre ami Michel Crépeau avait très tôt placé l’écologie au cœur de l’action politique. C’est donc très naturellement que les radicaux ont adhéré au constat établi par le GIEC sur le lien entre émissions de gaz à effet de serre et réchauffement climatique.
Oui, mes chers collègues, les hommes portent la responsabilité des maux qui affectent la planète. Nos industries, nos modes de vie, l’ensemble des activités humaines produisent des émissions de gaz qui compromettent jusqu’à la survie de l’espèce humaine. À cet égard, des chiffres alarmants circulent, dont nous avons tous connaissance : en particulier, il nous resterait seulement sept ans pour inverser la courbe d’évolution des températures…
Il aura fallu du temps pour qu’émerge une prise de conscience collective ! Aujourd’hui, c’est une véritable course contre la montre qui est engagée. Dans cette lutte, il faut bien reconnaître que la France ne ménage pas ses efforts. Alors que nos émissions de gaz par habitant sont inférieures de 25 % à la moyenne européenne, l’adoption du paquet « énergie-climat », arrachée par la présidence française de l’Union européenne en décembre dernier, et la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qui nous occupe aujourd’hui en témoignent.
Certes, on peut penser que les 265 engagements du Grenelle de l’environnement ne sont pas suffisants ou que certains d’entre eux ne sont pas assez contraignants. Cependant, il est urgent d’agir. Pour les radicaux, la volonté politique ne doit jamais se résigner au pire et chaque initiative porteuse d’espoir mérite d’être saluée.
C’est dans cet esprit, monsieur le ministre, que nous avions approuvé certaines dispositions fiscales « vertes » adoptées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2009.
Nous attendons du présent projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement qu’il présente de nouvelles règles et une législation adaptée à l’objectif d’une croissance durable dans les entreprises, dans les territoires, à chaque instant de la vie quotidienne. Il n’est pas trop tard pour concilier l’exigence d’efficacité économique avec celle de respect de l’environnement.
Parmi les points forts du texte, je relève l’ambitieuse nouvelle politique de l’habitat en matière d’économies d’énergie et de performance énergétique des techniques et des matériaux de construction. Les radicaux espèrent seulement que le rythme de progression sera maintenu. Surtout, nous veillerons à ce que les dispositions concernées n’engendrent pas une fracture sociale supplémentaire en matière d’habitat.
S’agissant des transports, qui représentent 26 % des émissions de gaz à effet de serre, tout le monde s’accorde sur la nécessité d’intervenir.
Les radicaux, comme je l’ai déjà souligné, ont pratiqué l’écologie urbaine dès les années quatre-vingt. Aujourd’hui, l’explosion des trafics routier et aérien complique la donne. C’est pourquoi la mise en place d’un schéma national des nouvelles infrastructures de transport reçoit notre soutien.
Cependant, monsieur le ministre, il ne faudra pas, une fois de plus, trop demander aux collectivités territoriales, qui n’ont pas les moyens d’assumer seules le développement des transports collectifs, trop délaissés par l’État. Les besoins dans ce domaine sont évalués à 10 milliards d’euros, et vous ne garantissez pourtant que 2, 5 milliards d’euros.

Nous touchons là à l’une des limites de ce texte. Dans le contexte de la crise économique actuelle, comment, monsieur le ministre, allez-vous financer toutes ces mesures ?
Il est certain que la prise en compte de la préoccupation environnementale va amener la création de nombreux emplois, mais, en attendant que la croissance verte produise ses effets, il n’est pas possible d’accroître la pression fiscale sur nos concitoyens, qu’ils soient particuliers, agriculteurs ou entrepreneurs. La fiscalité écologique doit être incitative, et non punitive.
À quelques semaines de l’examen du projet de loi portant engagement national pour l’environnement, qui concrétisera véritablement les engagements du Grenelle, les radicaux attendent des réponses sur le volet financier.

En tout cas, mes chers collègues, nous sommes nombreux ici à militer depuis longtemps pour la prise en compte des questions environnementales dans les politiques publiques, notamment en matière d’aménagement du territoire. C’est pourquoi nous ne pouvons que souhaiter la réussite de ce pari écologique.
Dans cet esprit, nous prendrons part au débat afin que les idées les plus novatrices et les plus décisives soient mises en œuvre. L’humanité doit relever le plus grand défi qu’elle ait eu à affronter. À cette échelle, tout effort peut paraître modeste, mais c’est l’addition des volontés nationales qui garantira au monde sa survie !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, dès 1977, André Gorz parlait du « bon sens de constater que, même stabilisée, la consommation de ressources limitées finira inévitablement par les épuiser complètement, et que la question n’est donc point de ne pas consommer de plus en plus, mais de consommer de moins en moins : il n’y pas d’autre moyen de ménager les stocks naturels pour les générations futures ».
De 1977 à 2009, il nous aura fallu vingt-deux ans pour accéder au « bon sens », en ordre dispersé, pour ne pas dire dans le désordre, et avec plus ou moins de conviction, il faut bien le reconnaître.
André Gorz ajoutait : « C’est cela le réalisme écologique. » J’estime, pour ma part, que c’est sans doute là ce qui nous manque encore : le réalisme écologique, trop souvent concurrencé par un autre réalisme, moins efficace, le réalisme politique. C’est à ce dernier que nous devons peut-être la trop grande distance entre le consensus des comités opérationnels du Grenelle et la traduction législative qui nous est proposée. Je déplore cette situation. « Notre maison brûle » toujours, et nous ne regardons que du coin de l’œil l’incendie se répandre.
Vous me direz, monsieur le ministre d’État, que nous ne restons plus sans rien faire, comme le prouvent le processus du Grenelle, ses heures de concertation et de débat, ses kilomètres de papier noircis de propositions et de contributions.
Pourtant, si l’effet d’affichage et le volontarisme sont incontestables, les actes posés nous laissent à ce stade, mes collègues et moi-même, sur notre faim. De même qu’il ne suffit pas d’établir un diagnostic pour soigner, il ne suffit pas de prescrire des médicaments – comprenez : fixer des objectifs et des principes – pour guérir, c’est-à-dire modifier la donne.
Je prendrai deux exemples : le logement et l’urbanisme. Ces deux problématiques sont au cœur du quotidien des Français, en même temps qu’au centre de la lutte contre le changement climatique. Hélas, toutes deux sont insuffisamment traitées dans le projet de loi qui nous est soumis.
S’agissant tout d’abord du logement, j’observerai que le bâtiment est le secteur le plus consommateur d’énergie en France : il absorbe 42, 5 % de l’énergie finale totale – excusez du peu ! – et il est responsable, à lui seul, de 23 % des émissions nationales de gaz à effet de serre.
Au sein de ce secteur, le tertiaire est une piste de travail importante, en raison des surfaces qu’il représente : 850 millions de mètres carrés, dont la moitié relève du secteur public. La mise à niveau de ce parc et, pour les constructions neuves, la fixation d’exigences élevées sont donc indispensables.
Quelques grandes entreprises et certains promoteurs l’ont bien compris : ils testent de nouvelles méthodes de construction, par exemple à l’occasion de la réalisation d’un nouveau siège social ou de quelques rares « opérations blanches ». Leurs efforts se concentrent toutefois sur la production neuve, et non sur la réhabilitation, qu’il faudra encourager, de même qu’il faudra soutenir les efforts des PME, dont le patrimoine immobilier est souvent vieillissant.
Des collectivités territoriales travaillent également sur la question. Un bilan « carbone » adapté à leurs problématiques a en effet été expérimenté par l’ADEME au cours des deux dernières années. Nombre d’entre elles ont d’ailleurs anticipé, dans leurs règlements d’urbanisme et dans leurs modes de gestion internes, la RT 2010, voire, sous certaines conditions, la RT 2015.
On voit également fleurir des panneaux photovoltaïques sur les toits d’écoles, de bâtiments communaux, de logements sociaux, de piscines, et des chaudières à bois commencent aujourd'hui à équiper des centres de loisirs, des mairies, des crèches ou des salles polyvalentes.
L’État n’en est pas là ! Il pourra donc s’inspirer de l’expertise développée par les autorités locales.
Le logement proprement dit représente, quant à lui, 2, 6 milliards de mètres carrés. Le défi majeur s’inscrit donc dans ce secteur, où les consommations d’énergie sont les plus importantes, où les ménages de France verront la traduction concrète des mesures que nous serons amenés à adopter.
Outre, bien entendu, la taille du parc, on peut voir deux raisons principales à cette situation : les logements consomment « mal », avec un recours majoritaire aux énergies fossiles, et trop, puisque leurs besoins en énergie s’élèvent à 240 kilowattheures par mètre carré et par an en moyenne.
Dans ce contexte, les objectifs pour la construction neuve qui devront être atteints en matière de basse consommation dès 2012, voire dès maintenant pour les opérations de renouvellement urbain, et à partir de 2020 en matière d’énergie passive sont pertinents, à condition toutefois que les filières professionnelles suivent, notamment en termes de disponibilité des matériaux et des techniques et de formation des artisans. Tel n’est pas le cas aujourd'hui ; j’attire donc l’attention du législateur et des acteurs locaux sur ce point.
Je continue par ailleurs à m’inquiéter des conditions dans lesquelles le parc ancien sera réhabilité. Le projet de loi définit en effet un objectif annuel de rénovation de 400 000 logements à compter de 2013, ce qui est énorme ! Les moyens mobilisés pour y parvenir nous laissent perplexes.
Je voudrais évoquer particulièrement, à cet instant, la question du parc social.
L’article 5 du projet de loi tend à fixer comme objectif « la rénovation de l’ensemble du parc de logements sociaux ». Cette formule suggère que l’ensemble du parc aurait besoin d’être rénové, ce qui est inexact. Dans ce domaine, je voudrais rétablir quelques vérités qui paraîtront peut-être surprenantes à certains, car elles sont méconnues.
La performance énergétique moyenne des logements sociaux – 160 kilowattheures par mètre carré et par an – est meilleure que celle du parc privé – 250 kilowattheures par mètre carré et par an.

Cette bonne performance est due à une attention constante à l’évolution des charges supportées par les locataires, ainsi qu’à la qualité et au bon entretien du patrimoine.
Quant à la construction neuve, de nouveaux programmes de logements sociaux bénéficient déjà du label de haute performance énergétique.
Comme vous le voyez, monsieur le ministre d’État, les élèves dont le bulletin de notes mériterait de comporter l’appréciation « doit mieux faire » ne sont pas forcément ceux que l’on croit !
Toutefois, après avoir rectifié cette erreur de diagnostic, je dois m’étonner d’une grave lacune du projet de loi : les financements publics pour la rénovation du parc HLM sont, pour l’heure, introuvables !
En effet, tous les acteurs concernés conviennent que 800 000 logements sociaux, les plus énergivores, méritent d’être mis à niveau. Mais les financements publics font défaut. Monsieur le ministre d’État, pourquoi la rénovation du logement pour tous devrait-elle bénéficier de moins d’aides que celle du logement réservé à certains ? Cela est inéquitable et, à ce stade, inacceptable pour nous ! Dans les HLM aussi, il faut diminuer la facture pour réduire la fracture énergétique !
Je veux croire que l’État n’entend pas se désintéresser de la durabilité du logement pour tous. Aussi je vous demande, sur ce dossier qui est crucial à nos yeux, de faire concorder les annonces volontaristes du Gouvernement et les actes qu’il pose.
En ce qui concerne les moyens, le groupe socialiste proposera notamment, en toute responsabilité, une hausse du plafond de dépôt du livret A, afin de dégager, à défaut d’effort budgétaire, de nouvelles sources de financement en faveur de l’amélioration de l’habitat social.
En ce qui concerne maintenant l’urbanisme, l’urgence est à l’aménagement durable du territoire et à la ville compacte.
Toutefois, il ne suffit pas de définir des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, il nous faut aussi faire œuvre de pédagogie et de persuasion.
J’en appelle donc à une réconciliation affective des Français avec la ville. Le choix de la vie urbaine doit être guidé non pas uniquement par la raison, mais également par le désir, ce qui sera possible à condition que nous travaillions à créer une ville conviviale, respectueuse et mixte. Je pense ici à toutes les mixités, d’usage et sociales, que nous n’obtiendrons qu’à une double condition : la responsabilisation des acteurs locaux et la vision intercommunale.
Il sera donc nécessaire de doter les autorités locales d’outils puissants pour atteindre les objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain et le changement climatique.
À ce titre, l’approche urbanistique sous-tendant le projet de loi est trop timide.
Par exemple, le volet concernant les transports, qui constituent pourtant le poumon de la vie urbaine, est très insuffisant. Le désenclavement des quartiers et l’amélioration de toutes les mobilités – géographiques, sociales, symboliques – exigent des transports collectifs performants.
Responsabiliser les territoires, c’est donc trouver des financements pour les infrastructures de transports afin de compléter les subsides de l’État, qui sont aujourd'hui en régression.
Avec les collègues de mon groupe, je proposerai, en particulier, la création d’une taxe de valorisation immobilière : par exemple, lorsqu’un projet de tramway entraînera la valorisation de biens ou de terrains situés à proximité de la future ligne, le produit de cette taxe permettra aux collectivités de financer d’autres projets d’infrastructures ou d’assurer le portage d’emprises foncières.
Par ailleurs, les élus locaux ont besoin de documents d’urbanisme plus incitatifs et plus précis qu’ils ne le sont aujourd’hui et que ne le prévoit le projet de loi. Bref, il est nécessaire d’assurer une compatibilité active des documents prospectifs élaborés par les différents niveaux de collectivités.
Les membres du groupe socialiste prennent à cœur leur rôle de législateur. Nous ferons, au cours du débat, de très nombreuses propositions d’amélioration du projet de loi, outre celles que je viens d’évoquer rapidement. Nous attendons en retour, de la part du Gouvernement et de la majorité sénatoriale, le même esprit constructif, sans lequel le débat ne pourra déboucher sur aucun vote favorable : le rendez-vous serait alors manqué.
À cet instant, je me tourne plus particulièrement vers vous, monsieur le ministre d’État, et j’en appelle à vos souvenirs.
Le projet de loi portant engagement national pour le logement comprenait onze articles lorsqu’il fut déposé sur le bureau du Parlement, à l’automne 2005. Après son adoption définitive, au terme du processus législatif, il en comptait plus de cent, fruits du travail parlementaire. Je souhaite que vous puissiez à nouveau, cette semaine, permettre aux membres de la Haute Assemblée d’accomplir la tâche pour laquelle ils ont été élus : légiférer, …

… avec audace, dans un esprit de responsabilité, avec une liberté que le Sénat doit revendiquer s’agissant d’un texte portant sur un sujet essentiel, qui place une fois de plus les acteurs locaux en première ligne !
Les collectivités territoriales représentées dans cet hémicycle n’en ont que plus de légitimité pour exiger une amélioration du contenu du texte qui nous est proposé : c’est le seul chemin qui pourrait nous permettre de nous retrouver le jour du vote sur l’ensemble de ce projet de loi. Vous avez les cartes en mains, nous avons nos convictions : il est de votre responsabilité de trouver les voies de notre rapprochement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous commençons donc la discussion au Sénat de ce projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : c’est un texte fondateur pour les temps à venir.
Je veux rappeler la tenue de ces assises de l’environnement qui ont fait suite à l’élection présidentielle, et leur heureux aboutissement, grâce à l’esprit qui a animé les participants tout au long de ces semaines de discussions du second semestre de 2007. Vous avez, monsieur le ministre d’État, avec vos secrétaires d’État et tous vos collaborateurs, réussi à réunir et à faire dialoguer des personnes dont la sincérité n’est pas en cause, mais qui n’avaient pas l’habitude de se parler. Vous avez permis de dégager un consensus qui va guider l’action politique en la matière pendant longtemps.
Au total, le Grenelle de l’environnement a débouché sur 263 engagements, dont l’échéance est certes plus ou moins proche, et la mise en œuvre plus ou moins facile. Néanmoins, un tel résultat était impensable il y a deux ans !
Il va s’ensuivre une longue période de débats, afin qu’émerge dans l’opinion publique une prise de conscience permettant de soutenir une volonté politique qui devra être durable si nous voulons être fidèles aux engagements pris lors de ces assises, en 2007.
Nous sommes aujourd'hui engagés dans une période d’évolution où nous devons faire montre d’une forte dose de pédagogie. Il faut réussir à faire passer l’idée que, pour l’avenir de la planète, et donc de la France, les problèmes environnementaux, au sens large, sont prioritaires et doivent progressivement être traités comme tels dans tous les secteurs où les décisions engagent de manière irréversible.
Le Gouvernement a choisi d’atteindre ces objectifs en plusieurs étapes. Comme le permet la Constitution, il a d’abord élaboré un projet de loi de programme, qui se borne à afficher des objectifs sans comporter de dispositions normatives d’application directe qui rendraient leur mise en œuvre rapidement effective. Viendront ensuite, nous le savons, d’autres textes, pour lesquels il sera sans doute beaucoup plus difficile de réunir une majorité, d’autant que le calendrier, marqué notamment par un télescopage avec la crise économique, amplifiée par la crise financière, n’est pas favorable. Nous n’avons pas choisi !...
Vous devrez résister, monsieur le ministre d’État, à ceux qui continueront à vous dire que la réflexion sur l’environnement est réservée aux périodes fastes dans les pays riches, que l’écologie et le développement économique ne sont pas compatibles. Cela est faux, et vous en êtes convaincu.
La vérité, c’est que la France, qui compte au nombre des pays les plus riches du monde et les plus avancés sur le plan scientifique, a un devoir de solidarité et d’exemplarité.
Il faut le redire, il existe un chemin vers un développement économique et des créations d’emplois obtenus grâce à une véritable croissance, nouvelle, fondée sur la promotion de technologies émergentes plus respectueuses de l’environnement. Des études réalisées par différentes instances le confirment, je n’y insisterai pas.
Pour convaincre les plus réticents, il faut mettre en valeur les conclusions du rapport de sir Nicholas Stern, qui démontrent que si l’on ne fait rien, cela coûtera, à terme, largement plus cher qu’agir, et que conduire une politique de développement durable, en y consacrant une part du PIB tout à fait raisonnable, est à notre portée.
Tous ceux qui trouvent que le Gouvernement en fait trop en matière environnementale vous diront que les actions à mener devront être compatibles avec nos équilibres budgétaires. On trouve dans ce texte toutes les réponses propres à dissiper leurs inquiétudes.
Je voudrais saluer au passage le travail considérable fourni par le rapporteur, Bruno Sido, que je remercie pour tous ses apports au texte déjà riche issu des travaux de l'Assemblée nationale. Je n’ai pas le temps de parler du contenu du texte dans le détail.
J’ai été le rapporteur d’une proposition de résolution du Sénat sur le paquet « énergie-climat ». Le Gouvernement français a fait adopter par les Vingt-Sept, le 12 décembre dernier, au cours de sa présidence semestrielle de l’Union européenne, une position qui nous convient. Les orientations du texte qui nous est soumis aujourd’hui sont tout à fait en phase avec cette position européenne : le programme est ambitieux, puisqu’il est déjà question des objectifs à l’horizon de 2020.
Je veux néanmoins rappeler la nécessité d’améliorer le système d’échanges de quotas d’émission de CO2, et notamment de préciser les règles d’affectation des produits des enchères.
J’insisterai également sur la mise en place d’un mécanisme d’ajustement aux frontières, afin d’éviter que les secteurs exposés aux fuites de carbone ne soient éventuellement pénalisés, ce qui aggraverait nos problèmes d’emploi.
S’agissant des énergies renouvelables, je rappellerai que la France s’est engagée à porter leur part dans le bouquet énergétique à 23 %. Si nous voulons atteindre ce pourcentage, nous devons tenir les objectifs assignés à l’éolien. Cela étant, le véritable enjeu est le développement important de la biomasse, particulièrement de la « raffinerie verte », qui aplanira notamment la voie pour la deuxième génération de biocarburants.
D’une manière générale, il faut lever tous les obstacles au développement des différentes filières en matière d’énergies renouvelables si nous voulons mettre toutes les chances de notre côté et, bien sûr, accentuer les efforts de recherche, notamment en ce qui concerne les technologies de captage et de stockage du carbone.
J’évoquerai maintenant la sobriété en matière de consommation d’énergie – c’est mon dada ! : je parle bien de sobriété, et non de privation. Ce qui coûte le moins cher en CO2, c’est de consommer moins.
Élu de la Picardie, je suis conduit à vous rappeler, du fait de mes préoccupations environnementales, que la ville d’Amiens n’a toujours pas de TGV, que le projet du canal Seine-Nord Europe mérite d’être accéléré au moyen d’un financement original, que la ligne ferroviaire Amiens-Boulogne attend d’être électrifiée, de même que le raccordement d’Amiens avec Roissy. Il est possible de réaliser ces chantiers tout en tenant vraiment compte de l’environnement.
L’agriculteur retraité que je suis sait combien l’agriculture française se prépare à prendre le virage d’une véritable agriculture durable à travers la certification « haute valeur environnementale », dont l’un des objectifs doit être de montrer que les agriculteurs français n’ont pas attendu le Grenelle pour s’occuper d’environnement.
Lorsque nous aurons bien intégré dans nos comportements toutes les mesures que comprend ce texte en matière d’énergie, de bâtiments, de transports et de biodiversité, et forts des progrès réalisés à Poznań, il nous faudra préparer sérieusement Copenhague, pour en faire le point de départ d’une ère de prospérité mondiale à fondements différents. Nous comptons sur vous, monsieur le ministre d’État, pour satisfaire cette grande ambition en menant à bien le chantier qui est ouvert.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d’État, mes chers collègues, dès les années quatre-vingt-dix, la région Réunion s’est résolument engagée dans une stratégie de développement durable, notamment avec la maîtrise de l’énergie, la recherche et l’utilisation d’énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité et la lutte pour la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
Cette situation n’est pas le fait du hasard, puisque le président de la région, Paul Vergès, ancien sénateur, est l’auteur de la proposition de loi tendant à conférer à la lutte contre l’effet de serre et à la prévention des risques liés au réchauffement climatique la qualité de priorité nationale, adoptée ici même, à l’unanimité, en 2001, puis par l’Assemblée nationale. Aussi l’environnement est-il devenu un axe fort de son action régionale.
Dès 1999, lors du colloque organisé par le syndicat des énergies renouvelables au siège de l’UNESCO, la région s’est fixé pour objectif l’autonomie énergétique de l’île dès 2025. Ce projet ambitieux, exemplaire au niveau mondial, qui vise à atteindre l’autosuffisance en matière de production d’électricité a suscité une nouvelle politique énergétique fondée sur l’utilisation de la biomasse, des énergies solaire et éolienne et la recherche sur les énergies marines, ainsi que la géothermie. Cet objectif est au cœur du plan régional de développement durable adopté en novembre 2006. Il a aussi inspiré l’an dernier le programme GERRI lancé par le Gouvernement et le projet « Réunion Île verte » porté par l’association La Réunion économique.
Plus récemment, le comité français de l’Union mondiale pour la nature, l’UICN, a organisé à la Réunion, en juillet 2008, une conférence internationale intitulée « l’Union européenne et l’outre-mer - Stratégies face au changement climatique et à la perte de la biodiversité ». À cette occasion, la Réunion s’est engagée à réduire de 100 %, d’ici à 2050, le taux de pollution en CO2 dans l’île. Dans le même temps, le G8, réuni en Europe, a fixé, pour la même échéance, son objectif de réduction à 50 % seulement.
Au-delà de ces proclamations, la Réunion peut déjà afficher un certain nombre de résultats de nature à prouver qu’elle est en mesure d’atteindre ces objectifs.
La Réunion détient l’une des plus importantes fermes nationales de panneaux photovoltaïques d’une capacité de 1, 5 mégawatt. Grâce à des aides substantielles d’abord de la région, puis de l’État, la Réunion possède l’un des meilleurs taux d’équipement en chauffe-eau solaire au monde. Ainsi, 36 % de la production d’électricité dans notre île sont obtenus à partir d’énergies renouvelables : l’énergie hydraulique, solaire, éolienne, ainsi que la biomasse, avec deux centrales thermiques bagasse et charbon. Ce pourcentage devrait encore s’accroître à l’avenir avec les projets d’énergie solaire en cours de réalisation.
Le Grenelle de l’environnement accorde une importance particulière à la préservation de la biodiversité et aux services qui y sont associés.
De ce point de vue, la Réunion dispose encore d’une biodiversité riche et unique au monde. L’Union européenne, lors de la conférence avec l’UICN, que j’ai évoquée précédemment, a déjà souligné la contribution importante de notre département au patrimoine mondial de la biodiversité et l’urgence de mener des actions de masse pour préserver la richesse de ce patrimoine gravement menacé.
Dans cette optique, la Réunion a décidé de créer une réserve naturelle marine et un parc national couvrant 42 % de son territoire. L’importance de cette superficie soumise aux contraintes qui s’imposent pour sanctuariser ce périmètre montre l’intérêt que portent les Réunionnaises et les Réunionnais à leur patrimoine.
La sauvegarde de ce patrimoine et la mise en œuvre de ce projet nécessitent toutefois la création de milliers d’emplois. À ce sujet, nous avons eu l’occasion de proposer M. le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté la création, dans ce domaine, d’un vrai service public, qui entrerait dans le champ d’application du RSA, le revenu de solidarité active.
À la Réunion, la prise en compte de l’urgence écologique constitue donc une volonté politique forte et concrète. Elle se traduit déjà par des résultats qui ont d’ailleurs été soulignés au plus haut niveau de l’État, même si beaucoup reste encore à faire.
Monsieur le ministre d’État, votre projet de loi est un outil qui pourrait aider la Réunion dans les efforts qu’elle accomplit en la matière, mais il convient de l’amender pour qu’il ne soit pas en deçà de la volonté affichée par notre département.
C’est ainsi que l’article 49 du projet de loi limite à 50 % le taux de pénétration des énergies renouvelables pour l’ensemble de l’outre-mer, alors que la Réunion, qui s’est inscrite dans une démarche d’autonomie énergétique fondée sur la maîtrise de la demande en énergie, table sur un taux de 100 %.
En outre, le programme relatif à la maîtrise des consommations semble se limiter à l’adoption d’un plan climat-énergie territorial dans chaque collectivité en 2012. Or cet axe est prioritaire et mérite, dès maintenant, la mise en œuvre d’actions concrètes, notamment la fixation d’une date pour la mise en place de la réglementation thermique par décret interministériel. Ces mesures doivent cependant tenir compte des niveaux d’engagement différents dans chaque département d’outre-mer, afin de ne pénaliser aucun d’entre eux.
Votre projet de loi affiche des ambitions certaines. Tout en se distinguant par son caractère innovant, il dénote toutefois quelques insuffisances, notamment pour ce qui concerne les moyens financiers et leur répartition entre tous les partenaires, l’État et les collectivités locales, notamment. Au-delà, le développement durable implique une remise en cause des comportements actuels ainsi que des modèles de développement qui conduisent à des catastrophes économiques, sociales et écologiques. Par ailleurs, il doit conduire à faire surgir chez chacun d’entre nous une nouvelle façon de penser, fondée sur la solidarité des humains entre eux et avec toutes les espèces animales et végétales de la planète.
Cette prise de conscience collective passe aussi par des actions ponctuelles collectives ou individuelles. Même si nous sommes dans une petite île, monsieur le ministre d’État, nous souhaitons apporter notre modeste contribution.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et sur quelques travées du groupe socialiste, du RDSE et de l ’ Union centriste.

Monsieur le ministre d’État, ce projet de loi de programme est issu d’une démarche quasi unique, qui marque une rupture avec les modalités habituelles de concertation et que je n’hésiterai pas à aller jusqu’à qualifier de « révolutionnaire ».
Non seulement votre démarche est innovante, mais vous avez la volonté d’aboutir, en proposant un texte prospectif, qui séduit tant par son architecture que par son contenu. Nous voudrions parfois aller plus loin – je fais partie des sénateurs qui vous feront des propositions en ce sens –, mais il ne faudrait pas, sous prétexte que le contenu ne nous convient pas totalement, mésestimer l’ampleur du défi qui est ici relevé d’une manière, j’y insiste, tout à fait novatrice.
À cet égard, je tiens à adresser toutes mes félicitations au Président de la République et aux membres du Gouvernement, notamment à M. Borloo, pour l’importance de l’entreprise et la détermination avec laquelle ils se sont, les uns et les autres, engagés pour faire en sorte que le Grenelle de l’environnement soit une réussite. Oui, monsieur le ministre d’État, madame, messieurs les secrétaires d’État, je suis fier d’appartenir à un groupe politique qui soutient l’action de ce gouvernement.
J’ai été, dans ma jeunesse, comme d’autres, militant au sein de mouvements environnementaux, puis j’ai participé pendant trente ans à la vie publique en tant qu’élu, notamment en qualité de responsable de l’environnement au sein de l’ex-UDF. Mais je dois à la vérité de dire que nous n’étions, ni à droite ni à gauche, à la hauteur de la tâche qui est ici menée sous l’impulsion du Président de la République, Nicolas Sarkozy.
Même si votre action, monsieur le ministre d’État, est sans doute dictée par l’urgence et l’ampleur des défis que nous avons à relever, il me faut souligner qu’elle est unique et réhabilite le politique, en lui redonnant ses lettres de noblesse. En effet, la politique ne consiste pas à juxtaposer purement et simplement les actions ; elle doit donner un sens au « vivre ensemble ». Or les mesures proposées dans le domaine du développement durable sont à ce titre fondamentales.
Toutefois, je formulerai quelques remarques sur un certain nombre de défis qui sont devant nous encore.
Le premier de ces défis concerne l’infinitésimal. Au cours de ces dernières années, on s’est attaqué aux grandes pollutions visibles, c'est-à-dire, par exemple, à ces grandes cheminées qui crachent leurs fumées. Lutter contre les pollutions visibles, nous savons faire ! Mais, aujourd'hui, se pose un autre problème, celui des particules fines, invisibles, elles, et qui entraînent pourtant le décès de 350 000 personnes par an en Europe, une surmortalité qui n’est pas mince, mes chers collègues.
Les nanoparticules ont des conséquences monstrueuses pour la planète, notamment dans le domaine sanitaire. On n’a même pas encore pris en considération l’air l’intérieur de nos maisons, alors que l’on y trouve des émanations dues au traitement des murs, des bois, des sols ou encore des meubles, avec les composés organo-volatils, les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou autres substances.
Le deuxième défi a trait à la persistance des polluants. Il en a été question ces derniers jours, on retrouve dans les eaux traitées par les stations d’épuration tous les médicaments que nous absorbons, notamment la pilule contraceptive, lesquels ne sont pas transformés et ont des conséquences sur les animaux et sur toute la chaîne alimentaire. La concentration des polluants dans les sols, la sédimentation en strates des rejets atmosphériques font que l’on dépasse ce que l’on appelle les « charges critiques », contribuant ainsi à la disparition de certaines espèces végétales, dont nous pensons pourtant qu’elles sont remarquables. Cette situation conduira à une stérilisation des milieux sensibles.
Le troisième défi est relatif aux interactions et aux transformations. L’ozone n’est pas un polluant habituel, c’est un polluant secondaire que nous ne parvenons pas à maîtriser. La tâche en la matière est de plus en plus délicate.
Pour conclure, j’émettrai trois souhaits.
Premièrement, n’oublions pas que, dans « développement durable », il y a « développement ». À cet égard, je me félicite de ce que nous continuions tout de même ici à parler de développement. En effet, sans développement, il n’y a pas de création de richesse. Il faut donc développer, tout en tenant compte de l’environnement et de l’équilibre nécessaire en termes de solidarité. Nous ne devons pas aller trop loin dans la satisfaction des demandes de certains ayatollahs de la décroissance.
Deuxièmement, comme je l’ai déjà souvent indiqué, il est impératif aujourd'hui de considérer le réchauffement climatique non pas en tant que tel, mais par rapport à ses conséquences sanitaires. C’est au nom de cette transversalité que nous, législateurs, devrons systématiquement prendre en compte l’air, le climat et l’énergie dans les textes que nous élaborons ; je vous proposerai d’ailleurs quelques amendements en ce sens.
Ainsi, je relève que, dans le chapitre consacré à l’énergie, il n’est nullement fait allusion au climat, ni à l’air. Pourtant, cela devrait être systématique et nous devrions retrouver ces points dans le texte.
Enfin, troisièmement, il serait important à l’avenir de tenir compte des conséquences des décisions qui sont prises.
Pour prendre le secteur automobile, par exemple, la création du bonus-malus m’a fait très mal !
Sourires

Il faut faire preuve de plus de cohérence dans les décisions qui sont prises et, surtout, bien considérer leurs conséquences sur le plan environnemental.
Cela dit, je ne voudrais pas que ces quelques suggestions fassent oublier les propos que j’ai tenus en commençant : monsieur le ministre d’État, cet engagement extraordinaire témoigne d’un changement de stratégie par rapport au développement durable. C’est une belle illustration de ce que nous sommes capables de faire lorsque nous acceptons de nous écouter et de travailler ensemble.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, le texte de loi que nous avons à examiner tend à marquer une prise de conscience collective, à imposer un changement radical des modes de vie, de production, de consommation, et il s’inscrit dans le long terme.
Toutefois, on peut regretter que le projet de loi ne contienne aucune disposition normative.
Ce texte, qui se situe donc dans la durée, fait honneur à notre assemblée. Monsieur le ministre d’État, je vous remercie de l’avoir proposé, car il fait l’objet d’un large consensus. Nous, radicaux, nous sentons particulièrement concernés, car l’humanisme, la qualité de vie et le sort réservé aux générations futures sont des préoccupations qui nous sont particulièrement chères.
Au-delà de ces objectifs largement partagés, je considère que nous devons engager quelques réflexions en profondeur, afin d’éviter les écueils auxquels, sinon, nous n’allons pas manquer de nous heurter à un moment ou à un autre.
Au travers de ce texte, je voudrais que nous fassions appel à la « pédagogie du bon sens », sans toutefois donner à l’expression plus d’importance qu’elle ne mérite. Pour illustrer ce que j’entends par là, permettez-moi de prendre quelques exemples.
Des salades cultivées en Roussillon sont acheminées à Rungis pour être vendues le lendemain à Montpellier ou à Béziers. On peut sans doute avoir des pratiques plus intelligentes !
Dans le même ordre d’idées, pourquoi ne pas lancer de grandes campagnes en faveur d’une consommation de fruits et de légumes de saison, ceux qui ne le sont pas étant fortement consommateurs d’énergie ?
Tout le monde s’accorde à dire que la consommation d’énergie doit baisser, mais, sachant la corrélation extrêmement étroite qui existe entre consommation d’énergie et développement, il ne faudrait pas que l’on en vienne à faire payer aux populations pauvres le prix du sous-développement !
Outre ces écueils, je me dois de mentionner certains effets pervers, au risque peut-être de faire grincer des dents, mais cela n’a aucune importance.
Tout le monde est favorable à l’agriculture biologique, mais sait-on que les rendements de ce type d’agriculture sont divisés par deux, voire par trois ? Une agriculture biologique très développée parviendra-t-elle à nourrir les populations, …

…ce qui est quand même le fondement même de l’agriculture ?
Le problème des OGM ne doit-il pas être abordé à l’occasion de l’examen de ce texte ?

À titre personnel, je n’ai pas de religion en la matière. Par conséquent, si l’on me démontre que les OGM ne sont pas dangereux pour la santé, je ne vois pas au nom de quel principe supérieur ou de quelle philosophie je devrais m’inscrire dans le camp de ceux qui veulent les supprimer !
Entre condamner à la famine les générations futures ou, au contraire, pouvoir leur promettre une nourriture relativement abondante, j’ai choisi. Je ne crois pas être de cette génération qui a connu les problèmes de la faim, mais c’est la vision humaniste des choses dont je parlais qui me permet d’engager la réflexion à ce niveau.
J’en viens au problème de l’eau, de sa qualité sans doute, mais aussi de sa quantité. Là encore, le simple bon sens commande de stocker l’eau qui coule en grande quantité pour la restituer en période de pénurie.
Il convient également, là où c’est possible, de privilégier de façon systématique le système d’adduction d’eau gravitaire. D’abord, sur le plan économique, c’est beaucoup plus rentable que le pompage à l’échelle de vingt-cinq ou trente ans. Ensuite, cela permet d’avoir de l’eau même en cas de panne d’électricité, ce qui est loin d’être négligeable, comme on le voit aujourd'hui !
Pourquoi ne pas adopter quelques attitudes courageuses, même au risque d’aller à l’encontre de certaines idées reçues ?
Prenons les compagnies aériennes à bas coûts – mon anglais étant extrêmement médiocre, je préfère l’expression française ! – qui se développent aujourd’hui : elles vous permettent d’aller à l’autre bout de la planète pour un prix nettement inférieur à celui du billet d’avion Aurillac – Paris !
Sourires

Mais que d’émissions de CO2 ! Ne devrait-on pas surtaxer ces déplacements touristiques qui non seulement ne sont pas indispensables, mais engendrent des émissions de CO2 ?
Sourires
Ça décoiffe !

Je n’hésite pas à mettre aujourd’hui ces problèmes dans le débat, même si cela peut paraître quelque peu inconvenant ; c’est une question de courage !
De même, quelle sera la position de l’Europe à l’égard de nos amis polonais, qui ont sous les pieds encore trois siècles de consommation de charbon, quand nous allons devoir leur expliquer qu’il faut arrêter de recourir à ce combustible ? Ce sera sans doute un peu difficile ; je crains même que nous n’y parvenions pas. Voilà encore un problème qui mérite d’être posé !
Monsieur le ministre d’État, permettez-moi de vous proposer une mesure utile qui ne coûtera rien. L’idée m’est venue à la suite de la récente tempête qui a frappé le Sud-Ouest.
Toute personne est autorisée, en bordure de sa propriété, à planter des arbres en toute liberté. Après quelques années, ces arbres peuvent atteindre vingt-cinq ou trente mètres de hauteur et, s’ils tombent, risquent fort de s’écraser non pas sur la maison du propriétaire, mais sur celle du voisin !
Ne serait-il pas plus judicieux d’imposer au propriétaire de tailler tout arbre situé à moins de trente mètres d’une habitation, afin qu’il ne dépasse pas quatre ou cinq mètres de hauteur ? Voilà une mesure qui ne coûterait pas très cher !
Permettez-moi de faire référence à notre histoire. Pourquoi des clairières entouraient-elles les châteaux de la Renaissance, pourtant construits généralement sur de grands espaces boisés, lesquels constituaient d’ailleurs à l’époque 80 % de notre territoire ?

Ils étaient intelligents, mais ils ne manquaient surtout pas de place, à cette époque-là !

Pour deux raisons. D’abord, cela permettait de faire entrer le soleil. Ensuite, et c’est essentiel, les futaies de chênes ou de hêtres situées à proximité, mais pas trop, ne risquaient pas d’écraser les bâtiments.
Ne pourrait-on agir aussi intelligemment que nos ancêtres le faisaient voilà trois siècles, surtout quand cela ne coûte rien ? Vous le savez, monsieur le ministre d’État, je suis toujours soucieux de garder une vision économique des mesures à prendre…

M. François Fortassin. Globalement, la démarche qui est la vôtre en nous soumettant ce texte est intelligente. C’est pourquoi nous vous apporterons notre soutien, tout en gardant l’espoir que vous accepterez les amendements que nous avons déposés et dont nous avons la faiblesse de penser qu’ils sont également intelligents !
Sourires et applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous vivons aujourd’hui un moment sans précédent au sein de la Haute Assemblée. En effet, nous débattons d’un projet de loi dit Grenelle I qui doit devenir l’aboutissement d’un processus inédit, lequel a fait se rencontrer et travailler ensemble les organisations de défense de l’environnement, les acteurs économiques et l’État.
Très sincèrement, je me réjouis de cette mobilisation sans précédent, au demeurant réussie, de la société civile : la crise écologique est grave ; il fallait prendre l’initiative d’un tel événement, qui non seulement marque les esprits, mais constitue le point d’ancrage de la révolution écologique à laquelle nous sommes tous conviés.
Cela étant, permettez-moi, monsieur le ministre d’État, de regretter un processus parlementaire chaotique qui rend possible l’adoption antérieure d’un projet de loi de finances pour 2009 et d’un plan de relance dont une grande partie des dispositions sont franchement contraires non seulement à l’esprit, mais même aux engagements du Grenelle.

D’où l’importance stratégique de ce texte de programmation qui devrait être l’occasion de graver dans le marbre, avec toute la clarté requise, les nouveaux principes fondateurs de nos politiques publiques, de manière à éviter de nouvelles trahisons...
En l’état, le texte de programmation qui nous est soumis n’est pas satisfaisant : je relève des lacunes graves dans les fondements scientifiques et des ambiguïtés dans les concepts mis en avant. De plus, un certain nombre de dispositions ne sont pas à la hauteur des enjeux.
En effet, il a manqué un maillon clé dans le processus du Grenelle. Au risque de vous surprendre, mes chers collègues, il s’agit des scientifiques ! En effet, les compromis issus de cette belle concertation/négociation traduisent plus l’état des rapports de force entre les différentes parties de la société civile que les apports des scientifiques, sur lesquels ils auraient également dû être fondés.
En témoigne l’objectif affiché dans l’article 4, c'est-à-dire la division par quatre de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050. Vous nous proposez implicitement de suivre les préconisations du rapport 2001 du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le GIEC, alors que ce même GIEC, au vu des derniers éléments scientifiques disponibles, revoyait sa copie en 2007 dans son Résumé à l’attention des décideurs, en invitant la France à diviser par douze d’ici à 2050 ses émissions de gaz à effet de serre, et les États-Unis, par vingt-cinq !
En témoigne surtout l’absence totale de toute problématique intégrant la finitude de notre planète : si les questions de la biodiversité de l’air et de l’eau sont effectivement abordées, l’épuisement des ressources fossiles est ignoré. Cette dimension géologique, objective, très concrète, a pourtant des conséquences essentielles sur le type de développement que nous voulons promouvoir.
En clair, le texte prend en compte le protocole de Kyoto de l’après-carbone – c’est bien –, mais il oublie le protocole de déplétion des matières premières non renouvelables, énergétiques ou pas, mis en évidence voilà déjà un siècle par Hubbert et ses successeurs : ce processus, parfaitement décrit, conduit, à moyenne échéance, à l’épuisement définitif des ressources fossiles, et l’uranium en fait partie !
C’est pourquoi je regrette profondément l’a priori gouvernemental d’écarter par principe toute réflexion sur l’énergie nucléaire. Ce que l’on pourrait qualifier de péché originel du Grenelle commence déjà à produire ses effets, puisqu’il est question de construire non plus une mais deux centrales EPR, l’une par EDF et l’autre par GDF-Suez et Total.
Tout d’abord, notre démocratie mérite mieux qu’un tel passage en force ! Ensuite, au-delà des problèmes encore non résolus de la gestion des risques, de la gestion des matières fissiles, notamment des déchets, ainsi que du démantèlement et du traitement des sites en fin de vie, se pose aussi la question de la déplétion des matières nucléaires fossiles. Le Gouvernement s’apprête à reproduire avec le nucléaire les mêmes erreurs qu’avec le pétrole, mais avec à la clé des risques incomparables, dans le monde instable et incertain d’aujourd’hui et sans doute de demain.
J’en viens enfin à l’ambiguïté majeure de ce projet de loi, qui fait référence au « développement durable ». La notion n’est pas scientifique, ce qui permet les pires interprétations, y compris dans le texte qui nous est soumis : en témoigne ce concept nouveau, qui apparaît à l’article 1er, de « croissance durable », qui ne doit pas « compromettre les besoins des générations futures ». Sur le plan scientifique, c’est tout simplement un oxymore !
En revanche, la notion d’ »empreinte écologique », dont les modes de calculs peuvent certes encore être affinés, mais qui vaut infiniment mieux qu’un PIB dit « durable », a un sens très précis. Elle prend en considération une réalité, certes difficile à regarder en face lorsqu’on fait partie de ce petit quart de la population mondiale qui accapare plus de 80 % des richesses de la Terre : notre planète n’est ni infinie ni extensible, et nous n’en avons pas de rechange !
Monsieur le ministre d’État, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, je regrette profondément que la problématique essentielle de la décroissance de notre empreinte écologique soit totalement absente du texte qui nous est soumis. En effet, la réalité de la déplétion des ressources non renouvelables nous oblige, en tant que législateur, à parler clairement : le type de développement de nos sociétés industrielles est, en toute rigueur, parfaitement insoutenable. Je reviendrai bien sûr sur ce point lors de la discussion des amendements.
En conclusion, je relève que la mobilisation remarquable des parties prenantes au Grenelle a marqué positivement les esprits de nos concitoyens : en ce sens, le Grenelle constitue une référence et permet un certain nombre d’avancées qu’il serait de mauvaise foi de contester. Pour autant, cette loi de programme, qui ressemble d’ailleurs beaucoup trop, par certains aspects, à une loi de programmation, souffre encore cruellement de ses fondements, confus et déconnectés d’une certaine réalité scientifique, ce qui ouvre la porte aux traductions les plus fantaisistes, comme en témoigne le plan de relance récemment adopté.
C’est bien dommage ! À nous, mes chers collègues, d’apporter à ce texte les clarifications conceptuelles nécessaires. Il est de notre responsabilité de parlementaires de faire réussir le Grenelle.

Dans le court temps de parole qui m’est imparti, il me sera impossible d’aborder tous les sujets traités par ce projet de loi. Je me contenterai donc d’évoquer l’énergie et, notamment, les énergies renouvelables, ainsi que les transports.
En ce qui concerne l’énergie, je voudrais attirer votre attention, monsieur le ministre d’État, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, sur le caractère très ambitieux de l’article 17, qui fixe un objectif de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale de notre pays à l’horizon 2020, c'est-à-dire un quasi-doublement par rapport à la situation actuelle. Dans cet esprit, la France souhaite produire 10 % d’électricité d’origine éolienne d’ici à 2020, soit une puissance installée de 25 000 mégawatts.
Si l’énergie éolienne présente un indéniable avantage en matière de rejets de C02, elle comporte également un certain nombre d’inconvénients, qui, personnellement, me font douter de la pertinence d’un tel choix.
Sur le plan économique, le développement de cette énergie est plus qu’intéressant, dans la mesure où EDF achète les kilowatts produits par l’énergie éolienne plus cher que ce que lui coûte l’électricité qu’elle produit elle-même, ce qui explique sans doute le développement de cette industrie dont le retour sur investissement est très élevé.
Toutefois, j’ai sérieusement commencé à douter de l’intérêt de l’énergie éolienne lorsque j’ai appris que, pour cette énergie forcément aléatoire, il faudra augmenter ce que l’on appelle les « réserves d’ajustement », par le biais, sans doute, de centrales thermiques, ce qui est évidemment totalement contraire aux objectifs fixés par le Grenelle de l’environnement.
J’ai eu l’occasion d’interroger le Gouvernement sur tous ces points le 28 octobre 2008 à l’occasion d’une question orale, mais je ne sais toujours pas ce que coûtera l’éolien à notre collectivité d’ici à 2020, et au-delà.
Certaines études laissent entendre que le développement de l’éolien, du fait du caractère aléatoire de cette énergie – rappelons qu’une éolienne ne fonctionne que 25 % du temps-, obligera à avoir recours à d’autres énergies, afin de ne pas être en rupture de production d’électricité. Quelle autre énergie pourra être utilisée, si ce n’est l’énergie thermique, produite par le gaz, le charbon ou le fuel ? Pour cette raison, je vous proposerai d’adopter un amendement tendant à préciser que le développement de l’éolien ne devra pas entraîner un accroissement des réserves d’ajustement délivrées par des centrales thermiques.
En ce qui concerne les biocarburants, je regrette que la loi de finances de 2009 ait réduit l’aide fiscale accordée aux biocarburants par l’intermédiaire de l’exonération partielle de taxe intérieure sur les produits pétroliers. Cela est particulièrement dommageable pour les esters méthyliques d’huiles animales, dont une unité de production est en cours de construction dans mon département. Il s’agit de biocarburants de deuxième génération, ceux que le Gouvernement souhaite justement promouvoir.
Je proposerai par voie d’amendement que l’État tienne compte de l’évolution de la législation communautaire, qui prévoit que la contribution de ces biocarburants est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants pour le calcul de la TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes.
En ce qui concerne les transports, je souscris pleinement aux objectifs affichés dans ce projet de loi. Ils devront permettre un très vaste report modal vers les moyens de communication peu émetteurs de C02.
En février 2008, avec mes collègues Daniel Reiner et Michel Billout, nous avons présenté un rapport d’information portant sur le fonctionnement et le financement des infrastructures de transports terrestres.
Je suis heureux de constater que certaines de nos réflexions et de nos propositions se retrouvent dans le texte que nous examinons aujourd’hui.
Nous avions fait le constat inquiétant du sous-investissement en infrastructures de transports terrestres de notre pays, en précisant que le Gouvernement se trouvait devant un double défi : trouver de nouvelles ressources et financer les projets du Grenelle de l’environnement.
Compte tenu des objectifs très ambitieux fixés par le Grenelle de l’environnement, nous avions calculé que l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, devrait trouver, outre ses ressources pérennes, 2, 1 milliards d’euros supplémentaires par an sur la période 2009-2012 et 2, 7 milliards d’euros sur la période 2013-2020.
Nous avions proposé la mise en place d’une redevance kilométrique pour les poids lourds, qui a été retenue dans le projet de loi et fait l’objet de l’article 10. Je regrette cependant la mise en œuvre tardive de cette éco-redevance, dans la mesure où l’AFITF a un besoin urgent de ressources.
Je proposerai que cette taxe puisse être répercutée par tous les redevables sur les bénéficiaires de la circulation des marchandises.
Je présenterai également un amendement tendant à minorer le montant de cette taxe, notamment pour les transports routiers de pré-acheminement et de post-acheminement ferroviaires et fluviaux, afin que ces derniers puissent être considérés d’une manière particulière.
J’observe aussi que l’article 14 du projet de loi modifie la loi d’orientation des transports intérieurs, en précisant que celle-ci doit prendre en compte, dans la programmation des infrastructures, les enjeux du désenclavement.
À cet égard, afin de sanctuariser la politique de désenclavement, je proposerai par voie d’amendement de modifier les dispositions de l’article 9 du projet de loi relatives aux nouveaux objectifs en matière de transport routier, afin que l’État programme désormais clairement les moyens financiers dévolus à l’augmentation des capacités routières liée aux besoins d’intérêt local.
En ce qui concerne le ferroviaire, je suis heureux que l’État et Réseau ferré de France, RFF, consacrent 400 millions d’euros supplémentaires par an à la régénération du réseau ferroviaire, y compris pour des secteurs qui se situent au-delà de nos frontières : nous vivrons de ce fait à l’heure européenne.
Par ailleurs, des économistes ont calculé que la baisse du pouvoir d’achat entraînée pour les particuliers par ces dépenses nouvelles sera d’environ 4 %, ce qui devrait faire perdre environ 800 000 emplois. Nous devons comparer cette situation à la création ou à la préservation des 535 000 emplois liés à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
Monsieur le ministre d’État, madame, monsieur les secrétaires d’État, nos concitoyens adhèrent pour l’instant aux principes du Grenelle de l’environnement. Prenons garde cependant que ce texte ne suscite un vif sentiment de rejet lorsque la facture, qui promet malheureusement d’être un peu salée, leur sera présentée.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre d’État, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, je souhaite tout d’abord exprimer ma solidarité avec les élus et les populations du Sud-Ouest qui ont souffert de la récente tempête. À la Réunion, nous sommes habitués aux cyclones qui dévastent tout, année après année ! Après avoir découvert à la télévision que nos compatriotes devaient faire face à ces graves intempéries, je souhaite leur témoigner aujourd’hui très sincèrement la solidarité des populations d’outre-mer.
Cela étant, monsieur le ministre d’État, madame, monsieur les secrétaires d’État, nous constatons avec plaisir que les promesses du candidat Sarkozy durant la campagne électorale sont en train de se réaliser sous nos yeux, avec ce premier projet de loi relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
À ce stade, on peut dire que le Gouvernement a déjà deux succès à son actif.
Tout d’abord, à l’Assemblée nationale – je tiens à en remercier ici tous les groupes politiques –, ce projet de loi a fait l’objet d’un consensus.
Ensuite, nous pouvons nous réjouir de l’adoption du paquet européen « climat-énergie ». Il faut cependant le souligner, la vraie difficulté, nous la rencontrerons au sommet de Copenhague, car le problème n’est ni national ni européen, il est bien mondial.
À partir de là, je vous livrerai, mes chers collègues, deux réflexions sur l’adhésion des peuples à la démarche de protection de la planète.
Premièrement, si l’on veut susciter un mouvement d’adhésion mondial, il faut choisir des paramètres acceptables par tous. L’ancienneté de la pollution en est un, de même que son niveau par habitant : il convient en effet de prendre en compte la démographie propre à chaque pays, ainsi que l’évolution de celle-ci. Dans tous les cas, le critère de l’équité me paraît également fondamental.
Ces principes, mais il y en a d’autres, doivent guider, au plan international, les négociations de Copenhague. Car, si l’on échoue à Copenhague, les grands équilibres ne seront pas sauvegardés, même si l’on adopte le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, même si l’on applique le paquet climat-énergie européen. Tout le monde sait qu’il en ira de la pollution comme du nuage de Tchernobyl : elle ne s’arrêtera pas à nos frontières !
Deuxièmement, comment décliner ces principes pour agir outre-mer ?
Tout à l’heure, mon collègue Marcel Deneux affirmait qu’au-delà de cette loi de programme des actions concrètes devraient être menées. J’ai le plaisir de lui signaler que, le 9 mars prochain, la Haute Assemblée examinera en première lecture le projet de loi pour le développement économique de l’outre-mer, qui vise notamment à créer une zone franche globale d’activités dans les domaines de l’environnement et des énergies renouvelables.
En lui offrant l’essentiel de son espace maritime ainsi que des forêts tropicales à la biodiversité incomparable, l’outre-mer représente une richesse considérable, non seulement pour la France, mais aussi pour l’Europe. S’il est adopté, ce projet de loi nous permettra d’apporter la preuve qu’en développant la recherche, notamment dans les domaines de l’agro-nutrition ou de l’agriculture, la protection de la planète, loin de représenter un frein au développement, en constitue au contraire un levier. En cela, nous assistons à une révolution culturelle et économique. C’est sous l’angle de cette révolution qu’il faudra maintenant acquérir de nouveaux réflexes et adopter de nouveaux comportements.
Mais ne nous faisons pas d’illusions : nous aurons beau utiliser des insecticides et des pesticides « propres », les pays d’Amérique centrale, par exemple, où l’on peut dire que l’esclavage n’a pas été aboli, continueront à utiliser des substances interdites pour produire des bananes à bas coûts qu’ils vendront très cher. C’est la raison pour laquelle, si nous ne voulons pas qu’il y ait deux poids, deux mesures, et que sa mise en œuvre soit insupportable pour l’économie française, l’acte fondateur que nous sommes en train de voter devra avoir un prolongement international.
Je tiens à remercier le Gouvernement de poser cette première pierre et je souhaite un grand succès à Copenhague. Je le dis du fond du cœur car, si les effets du changement climatique sont très élevés sur le continent, ils sont encore plus forts sur nos îles.
Pour des élus, il n’y a pas de plus beau combat que de sauver la vie : celle des espèces végétales et animales, mais aussi, et surtout, celle des êtres humains, car c’est de cela qu’il s’agit.
Chaque grande catastrophe naturelle, et la fréquence de ces phénomènes va, à l’instar des ouragans aux États-Unis, augmenter d’année en année, entraînera malheureusement son lot douloureux de pertes en vies humaines. Nous devrons donc faire sur l’autel de Copenhague les sacrifices équitables que chacun pourra supporter pour sauver demain les grands équilibres et la vie sur notre planète.
Nous voterons ce projet de loi, et nous apporterons également notre contribution à l’effort de réflexion entrepris au niveau national, européen et international, conscients que, pendant trop longtemps, l’on a gaspillé les richesses, mis en péril l’équilibre de nos écosystèmes, bref, détruit la planète.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, mon intervention porte sur le chapitre III, relatif aux transports, du titre Ier de ce projet de loi.
Comme dans les autres parties de ce texte, les principales dispositions de ce chapitre oscillent entre la logique d’une loi-programme et celle d’une loi-cadre, entre les déclarations de principe et l’édiction ou le rappel de quelques normes.
Cela étant, tels qu’ils ont été adoptés par l’Assemblée nationale, qui a largement amendé le texte, les articles relatifs aux transports comportent des aspects positifs et représentent de réelles avancées par rapport à la situation actuelle, même s’ils laissent apparaître aussi des insuffisances politiques et des limites.
Je soulignerai, tout d’abord, les avancées. Les intentions sont louables et les objectifs affichés largement partagés. Comment pourrait-il d’ailleurs en être autrement lorsqu’il est prévu de réduire, dans le domaine des transports, les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020, de faire évoluer la part du non-routier de 14 % à 25 % d’ici à 2022, de créer de nouvelles lignes ferroviaires à grande vitesse permettant en outre de libérer des sillons sur les lignes classiques pour les TER et le fret, d’accroître les moyens dévolus à la régénération du réseau ferroviaire, de développer les autoroutes ferroviaires à haute fréquence, de développer le transport collectif en site propre, ou encore d’améliorer la compétitivité des ports et des voies d’eau ?
Dans sa rédaction initiale, le II de l’article 10 disposait que, « en complément de l’effort des régions pour l’entretien et la régénération du réseau, les moyens dévolus par l’État et ses établissements publics à la régénération [...] seront accrus régulièrement ». Les députés ont donc bien fait de modifier cette rédaction en rappelant, à juste titre, que l’entretien et la régénération du réseau relèvent de la compétence de l’État et non de celles des régions, dont l’intervention en la matière ne peut être que facultative.
L’introduction d’un article nouveau, l’article 15 bis, en vue de la réalisation d’un schéma national des nouvelles infrastructures, en concertation avec les parties prenantes du Grenelle de l’environnement, constitue également une avancée.
Enfin, il convient de citer une disposition de l’article 1er qui s’appliquera aux infrastructures de transport : le renversement de la charge de la preuve. Ainsi, ce sera aux porteurs d’un projet non respectueux de l’environnement d’apporter la preuve qu’une décision alternative plus favorable à l’environnement est impossible à un coût raisonnable.
Voilà pour les principaux aspects positifs de ce projet de loi dans le domaine des transports.
Quelles en sont, maintenant, les insuffisances et les limites ?
Le constat peut être fait que, dans ce texte, l’État « encourage », « incite », « accompagne », « soutient », « étudie », « évalue », « veille ». En revanche, l’État « finance » peu, « crée » peu et « agit » peu. Cela pour dire que la principale insuffisance de ce texte réside dans le financement apporté par l’État, qui apparaît très en retrait par rapport à ce qui serait nécessaire.
Ainsi, l’État contribuera à hauteur de 16 milliards d’euros à la réalisation de 2 000 kilomètres de lignes ferroviaires nouvelles à grande vitesse d’ici à 2020. Mais, étant donné que ce programme représente au moins 79 milliards d’euros d’investissements et qu’il doit être réalisé dans le cadre de partenariats public-privé, la participation de l’État ne sera vraisemblablement pas suffisante pour attirer les investisseurs privés. Les collectivités locales risquent donc, une nouvelle fois, d’être appelées en renfort.
La même remarque vaut pour les investissements en faveur des transports en commun en site propre. L’État s’engage à hauteur de 2, 5 milliards d’euros, et non de 4 milliards d’euros, comme il avait envisagé de le faire, me semble-t-il, lors du Grenelle, alors que le coût prévisionnel pour porter en quinze ans la longueur de ces réseaux de 329 kilomètres à 1 800 kilomètres est de 18 milliards d’euros, hors Île-de France.
L’incertitude demeure également sur les moyens consacrés à la régénération du réseau ferroviaire, action essentielle si l’on veut développer les trafics fret et TER. Il est précisé dans le texte que les moyens apportés par l’État et ses établissements publics seront accrus régulièrement pour atteindre en 2015 un niveau de 400 millions d’euros supplémentaires par rapport au plan de renouvellement actuel, pour la période 2006-2010.
Comment ne pas être sceptique lorsque le constat est fait d’une légère baisse des crédits consacrés à cette action en 2009 par rapport à 2008, hors plan de relance ? En outre, les crédits de la mission « Écologie, développement et aménagement durables » devraient être ramenés d’un peu plus de 9 milliards d’euros en 2009 à 8, 2 milliards d’euros en 2011.
Il me semble donc nécessaire que soit arrêtée une programmation pluriannuelle précise, condition d’une bonne application des dispositions relatives à la régénération contenues dans ce projet de loi.
Le texte est enfin peu précis sur la question de la lutte contre les nuisances, notamment sonores, et sur les problèmes de sécurité. L’augmentation prévue du ferroutage inquiète les riverains des lignes concernées, qui traversent villes et villages. C’est notamment le cas dans la vallée de la Maurienne, avec le Lyon-Turin, à Poitiers, en raison de l’autoroute ferroviaire envisagée entre Paris et l’Espagne, ou encore sur la rive droite du Rhône, avec le projet du contournement fret de Lyon. J’y reviendrai lors de l’examen de l’article 11 du projet de loi.
Avec l’objectif d’aller plus loin et d’affirmer une vraie ambition pour le transport, les membres du groupe socialiste défendront un certain nombre d’amendements qui leur paraissent aller dans ce sens. Ceux-ci tendent, notamment, à définir, dans un article chapeau du chapitre III, une politique des transports qui se veut durable, à instaurer une contribution des compagnies pétrolières à la réduction de la dépendance énergétique, contribution qui serait prélevée sur leurs larges profits, à supprimer les principaux points noirs de bruit ou encore à réduire les péages pour les régions acceptant de participer financièrement, en complément de l’État, à la régénération du réseau ferré national.
Tels sont les quelques commentaires liminaires et généraux que le groupe socialiste souhaitait formuler sur les articles 9 à 15 bis de ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement doit être l’occasion de fonder les bases d’une nouvelle économie autour du principe du développement durable. La France en a besoin, le monde aussi. Il s’agit d’une question de société fondamentale. C’est pourquoi, compte tenu des enjeux, notre groupe au Sénat entend être un élément fédérateur et souhaite enrichir l’action du Gouvernement.
Le Grenelle de l’environnement ouvre des chantiers majeurs comme l’amélioration de l’efficacité énergétique de nos bâtiments, mais aussi l’évolution de nos modes de transport, en glissant progressivement du « tout automobile individuel » vers une approche plus collective du transport, à la fois urbain et rural, grâce au développement du ferroviaire.
Ces projets doivent se réaliser en adéquation avec les hommes de la France d’en bas, ceux qui, au quotidien, vivent dans un environnement qui doit s’améliorer non seulement par la volonté de l’État, mais aussi par celle de ses habitants.
Enfin, ce projet de loi fixe la volonté nationale de désengager notre économie du « tout pétrole ». Cela se justifie pour des raisons d’indépendance nationale et de géopolitique, mais aussi pour des raisons écologiques. Oui, notre, pays doit participer à ce nouveau défi mondial qu’est la réduction des gaz à effet de serre.
En outre, le déséquilibre entre la demande et l’offre de pétrole entraîne des prix toujours plus élevés et menace directement nos équilibres commerciaux et notre compétitivité économique.
Des études récentes ont montré que le trou constaté dans la couche d’ozone était en passe de se résorber, en partie grâce à l’action menée au niveau international pour bannir les aérosols. Voilà bien la preuve que nous avons les moyens d’inverser les tendances lourdes lorsque cela devient vital pour notre monde.
Aujourd’hui, ce sont l’ensemble des leviers dont dispose l’État – réglementaires, budgétaires et fiscaux – qui doivent être mobilisés au service de cette mutation d’intérêt général.
M. le ministre d’État a été, avec ses collègues Nathalie Kosciusko-Morizet et Dominique Bussereau, l’artisan, pour reprendre cette belle expression, de cette conférence des parties prenantes de l’environnement. Il s’agit là, vous le savez, de la conférence des différents acteurs de l’environnement, qui a réuni les collectivités territoriales, les syndicats, les entreprises et les associations au sein de plusieurs groupes de travail. Nous tenons à saluer le caractère innovant de cette démarche. Marcel Deneux l’a dit avant moi, je n’y reviens pas longuement.
Ce texte contient des dispositions intéressantes. Ainsi, il est prévu que la stratégie nationale de développement durable est élaborée par l’État et que le Gouvernement rend compte chaque année de sa mise en œuvre devant le Parlement. Mais comment prendre en compte les modifications permanentes des objectifs en fonction des événements géopolitiques et des percées technologiques à venir qui bouleverseront nécessairement ce projet de loi ?
Que restera-t-il des objectifs du Grenelle si nous vivons à nouveau une crise géopolitique profonde dans certains pays où la production de pétrole est déterminante ?
La France doit construire un projet responsable et cohérent. Ce projet doit être réaliste et appliqué avec bon sens, sinon, c’est chercher une aiguille dans une meule de foin sans même regarder la meule elle-même…
Les objectifs du Grenelle, ainsi que leurs moyens d’exécution, doivent être réactualisés régulièrement. Madame la secrétaire d'État, ne devra-t-on pas s’adapter en fonction de l’évolution de certaines réalités ? Ne devra-t-on pas aussi tout faire pour associer écologie et économie ? Cela me semble très important.
Certaines incohérences doivent être levées, notamment en matière de dates – faut-il retenir 2012, 2015 ou 2020 ? Le Grenelle de l’environnement ne peut être simplement une accumulation de mesures ; il doit être générateur d’un état d’esprit nouveau, un engagement partagé par tous les acteurs de la vie économique et sociale, afin de transformer progressivement notre façon de vivre dans un plus grand respect du monde qui nous héberge, du monde qui nous entoure, du monde qui est le nôtre.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, avec le Grenelle de l’environnement, dont nous discutons aujourd’hui la « programmation », le Gouvernement rend irréversibles un certain nombre de projets structurants pour notre territoire. Tel n’était pas le cas lorsque les mêmes décisions étaient prises dans le cadre de comités interministériels pour l'aménagement et le développement du territoire.
Il faudra sans doute veiller au respect des engagements pris sur le moyen terme et le long terme, mais je veux saluer ici l’important travail accompli, dans la plus grande concertation, parfois, contre toute attente, avec les acteurs concernés.
Le Grenelle de l’environnement ouvre des chantiers majeurs. Oui, il est bien urgent d’agir dans la lutte contre le changement climatique, comme il est urgent d’économiser notre énergie et de mettre en œuvre des solutions de substitution. Oui, la dimension environnementale doit être prise en compte comme une composante de notre politique de santé.
Pour autant, comme en toute chose, il faut définir un juste équilibre pour que les préoccupations environnementales ne nuisent pas au développement économique.
Si la concertation a été large, il semble toutefois que les professionnels du végétal et de l’énergie hydraulique aient eu le sentiment d’avoir été exclus des résultats du Grenelle, alors qu’ils proposaient des avancées parfaitement compatibles avec les objectifs fixés. Je souhaite donc poursuivre la discussion déjà engagée à l’Assemblée nationale sur ces sujets grâce à des amendements auxquels, je l’espère, le Gouvernement sera sensible.
Les transporteurs routiers, quant à eux, sont une profession très sensible, fragilisée et en voie de mutation par la force des choses, puisque d’autres modes de transport sont désormais privilégiés. La création d’une taxe kilométrique sur les poids lourds – l’éco-redevance – pénalise quelque peu des entreprises déjà très malmenées par la concurrence européenne et le cabotage. Il ne faudrait pas que cette taxe devienne, comme d’autres, un droit à polluer. D’une manière générale, il faut toujours privilégier la pédagogie et la prévention.
Madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, pourquoi ne pas expérimenter, comme le font plusieurs de nos partenaires européens, des véhicules plus volumineux sans polluer davantage ? J’ai déposé un amendement dans ce sens et un second visant à ce que les mesures d’accompagnement proposées dans ce texte bénéficient également aux chargeurs, pour des raisons d’équité.
J’en viens maintenant à l’aménagement du territoire, auquel, finalement, le Grenelle de l’environnement fait écho en privilégiant, notamment, le transport ferroviaire par le développement des lignes à grande vitesse.
Dans le cadre de la relance à court terme de notre économie, c’est une bonne chose que des financements aient pu être trouvés en faveur de quatre lignes de TGV, mais la relance doit aussi s’inscrire dans le moyen terme et le long terme. Permettez-moi, madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, de proposer une approche pragmatique, réactive, efficace et, ainsi, de privilégier l’état d’avancement du projet et le désenclavement sur tout autre critère.
À cet égard, un principe de fongibilité pourrait être adopté entre les 2 000 kilomètres de lignes à grande vitesse à l’horizon 2020 et les 2 500 kilomètres supplémentaires.
À l’article 11 du présent projet de loi, il est indiqué que le maillage du territoire par les LGV sera renforcé, d’une part, pour relier les capitales régionales à Paris, d’autre part, pour les relier entre elles et assurer ainsi la connexion du réseau français au réseau européen.
Cela me paraît être un principe d’avenir pour l’ensemble de nos territoires.
La réalisation - enfin ! - d’une ligne de TGV Paris–Orléans–Clermont-Ferrand–Lyon reliant trois capitales régionales avec Paris en est un exemple concret.
Ce projet ouvre de nouvelles perspectives à la fois pour le département du Cher et, plus largement, pour les régions Centre et Auvergne, ainsi que pour la partie ouest de la Bourgogne, aujourd’hui exclues des lignes à grande vitesse. Il s’inscrit parfaitement dans les lignes directrices fixées par le projet de loi.
D’ailleurs, je proposerai, avec plusieurs de mes collègues, des aménagements à ce texte pour faire valoir cette adéquation d’un projet, que nous sommes nombreux à défendre, visant à doubler la ligne Paris-Lyon, aujourd’hui saturée, tout en optimisant la gare d’Austerlitz, sous-exploitée, de telle sorte que l’aménagement du territoire se fasse de manière plus équilibré et profite à des zones défavorisées et en grande difficulté économique.
L’Association TGV Grand Centre Auvergne, que je préside, et dont votre collègue Brice Hortefeux est président d’honneur, attend beaucoup de ce débat parlementaire. Plusieurs de nos collègues députés sont déjà intervenus lors de la discussion à l’Assemblée nationale en octobre dernier.
La nouvelle rédaction de l’article 11 proposée par le Gouvernement a permis des avancées. Les amendements que je proposerai à cet article ne le dénaturent en aucun cas ; au contraire, ils visent à en clarifier quelques aspects.
Le Grenelle de l’environnement est donc un début de réponse à l’urgence et l’amorce d’un processus qui va sans cesse évoluer. Sans doute comporte-t-il des limites et des imperfections, mais l’essentiel est que soit impulsé un changement profond des logiques et des tendances actuelles.
Madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, avec ces quelques amendements que nous avons déposés, auxquels, je l’espère, vous vous montrerez favorables, nous souhaitons vous aider à avancer.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires d'État, mes chers collègues, mon intervention portera sur le volet « transports » de ce projet de loi.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % d’ici à 2020 et promouvoir le transfert modal de la route vers les autres modes de transport constituent, de toute évidence, des objectifs louables, et nous les soutenons. De même, nous soutenons la volonté de donner aux autorités organisatrices de transport la possibilité de définir une politique globale de la mobilité durable. Enfin, il est fort opportun de reprendre les dispositions importantes de la proposition de loi que j’ai fait voter à l’unanimité dans cette enceinte voilà deux ans tendant à promouvoir l’autopartage dans les deux volets législatifs du Grenelle.
À cet égard, il serait souhaitable que cette proposition de loi soit enfin déposée sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Mais, au-delà de ces déclarations de bonnes intentions, je suis au regret de dire qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. La traduction budgétaire de ces belles orientations n’est pas au rendez-vous !
Vous l’avez dit, le budget pour 2009 devait être la traduction du Grenelle pour la période 2009-2011. Or, comme l’avait justement souligné mon collègue Michel Teston lors de la discussion de la loi de finances, les crédits du programme 203, « Infrastructures et services de transports » et, plus précisément, ceux de l’action 10, « Infrastructures de transports collectifs et ferroviaires », sont loin de traduire concrètement les orientations du Grenelle de l’environnement.
En un mot comme en mille, les lettres sont belles, mais les chiffres, pour l’instant, ne suivent pas en loi de finances.
À ce sujet, permettez-moi de revenir sur un dossier particulièrement sensible non seulement pour nos grandes agglomérations, mais aussi, de manière croissante, pour nos agglomérations moyennes, à savoir les investissements nécessaires pour développer les transports en commun en site propre, les TCSP.
Le Groupement des autorités responsables de transports publics, le GART, estime qu’un minimum de 18 milliards d’euros devrait être investi à l’horizon des dix ans qui viennent. Après avoir annoncé dans un premier temps une aide de 4 milliards d’euros, l’État l’a réduite à 2, 5 milliards d’euros. Encore faut-il défalquer de cette somme les 500 millions d’euros du plan Espoir banlieues, destinés au désenclavement des quartiers sensibles.
Dans le même ordre d’idées, et à plus court terme, l’appel à projets TCSP, dont la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 31 janvier, qui concerne les projets susceptibles d’être mis en chantier rapidement, comporte une enveloppe de 710 millions d’euros, alors que le recensement effectué par le GART montre que, additionnés, les projets répondant à ces critères exigeraient plus de 1, 1 milliard d’euros.
Madame la secrétaire d'État, monsieur le secrétaire d'État, nous le savons bien, dans le domaine des transports, la qualité de l’offre détermine très directement la demande et influe sur les choix modaux.
Considérant la part croissante que prennent les collectivités territoriales dans le financement des transports – le poids des transports dans les budgets des régions varie entre 20 % et 25 %, et s’élève même à 35 % pour l’Île-de-France –, il devient chaque jour plus urgent de rechercher de nouvelles sources de financement. À cet égard, on ne peut que regretter de voir combien la fiscalité environnementale se situe souvent en deçà des engagements ou, à tout le moins, des orientations que vous évoquiez vous-même au moment des discussions initiales du Grenelle.
Passons sur l’instauration de l’écotaxe sur les poids lourds qui a connu, il faut bien le reconnaître, un certain « retard à l’allumage ». En Alsace, dont je suis originaire, la mesure n’a toujours pas vu le jour, trois ans après l’adoption du principe de son expérimentation. De toute évidence, il conviendra de mettre en conformité la rédaction relative à l’instauration de cette écotaxe avec l’article 60 de la dernière loi de finances, c’est-à-dire de passer du « on pourra » au « il faudra ».
Je regrette surtout que les nouveaux leviers de financement proposés par le GART, qui ne figuraient pas dans le projet de loi de finances, ne se retrouvent pas davantage dans ce projet de loi, ni dans ce qu’il est aujourd’hui convenu d’appeler le Grenelle II. Je pense en particulier au versement transport, qui constitue, vous le savez, un outil essentiel à la disposition des autorités organisatrices pour leur permettre de satisfaire leurs besoins de financement.
Pour faire face aux nouveaux défis des transports collectifs, des majorations spécifiques du taux plafond du versement transport devraient être rendues possibles dans les agglomérations de moins de 100 000 habitants réalisant un transport collectif en site propre.
Il faut aussi, à mon sens, donner aux régions la possibilité de mettre en place un versement transport en dehors des périmètres de transports urbains, pour financer le développement des services régionaux de transport, comme l’avait du reste préconisé le comité opérationnel du Grenelle n° 7 du transport urbain et périurbain. Cette ressource supplémentaire serait évidemment la bienvenue pour les régions, aujourd'hui étranglées par l’augmentation des charges qui résultent de leurs nouvelles compétences en matière ferroviaire.
La mise en place du versement transport régional aurait aussi pour effet – pourquoi ne pas le dire ? – de réduire les distorsions entre les entreprises selon qu’elles se situent, ou non, à l’intérieur d’un périmètre de transports urbains, un PTU. Cela faciliterait un meilleur équilibre territorial en termes de zones d’activité. Il n’y a pas de raison, en effet, qu’il y ait un versement transport à l’intérieur du périmètre d’une communauté urbaine, par exemple, et rien au-delà, alors que c’est précisément là où se posent avec le plus d’acuité les problèmes de desserte des zones d’activité.
À l’heure où les collectivités territoriales sont amenées à exercer des responsabilités plus importantes en matière de transports, il devient plus que jamais nécessaire de les aider à accéder à d’autres modes de financement. Taxation des plus-values foncières liées aux investissements dans les transports publics, dépénalisation du stationnement, péage urbain, part de TIPP, ce sont quelques-unes des pistes que le GART propose depuis longtemps, mais qui sont absentes du projet de loi. Nous défendrons plusieurs amendements allant dans ce sens.
J’en viens au transport fluvial. Là encore, le texte ne manque pas d’intentions louables. Il met en avant un plan de restauration et de modernisation du réseau fluvial. Un seul projet concret était mentionné dans la rédaction initiale, deux projets figurent dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.
Cela étant, nous avons besoin non pas d’une addition de projets, d’un canevas inachevé, mais bel et bien d’un schéma directeur des voies navigables en France et d’une planification d’ensemble des investissements que l’État est prêt à consentir.
En la matière, l’Europe attend beaucoup de la France et de son réseau fluvial qui est, avec ses 8 500 kilomètres de voies d’eau, le plus long d’Europe.
Telles sont, madame, monsieur les secrétaires d’État, les réflexions que votre projet de loi nous inspire en matière de transports. Nous vous proposerons bien sûr des améliorations mais, nous le savons tous, sans financements adéquats, le Grenelle de l’environnement restera largement en deçà des espérances qu’il a suscitées.
Comme le rappelait fort justement un ancien président du Conseil constitutionnel, « la loi n’est pas faite pour affirmer des évidences, émettre des vœux ou dessiner l’état idéal du monde. Elle est faite pour fixer des obligations » et, devrais-je ajouter, des objectifs précis.
Madame, monsieur les secrétaires d’État, c’est sur ce plan que le groupe socialiste attend des réponses et des mesures concrètes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Madame, monsieur les secrétaires d’État, les riches travaux des différents groupes de travail du Grenelle de l’environnement, conduits sous la houlette de M. le ministre d’État, que je tiens à saleur à travers vous, trouvent dans le Grenelle I leur première traduction législative. Ce projet de loi sera suivi prochainement d’un second, le Grenelle II. Nous nous en félicitons, car nous l’attendions.
Comment ne pas se réjouir que les préoccupations environnementales apparaissent non plus comme des questions dogmatiques, qui empêchent tout développement, mais comme un autre moyen de penser l’économie ? L’économie doit prendre en compte les impératifs du développement durable. Les métiers de l’environnement offrent désormais de belles perspectives de croissance, j’en suis comme vous convaincu. C’est pourquoi il est devenu impératif d’adapter les formations éducatives et professionnelles à ces nouveaux secteurs créateurs d’emplois.
Je vais sans doute m’éloigner quelque peu de l’objet de présent texte, et je vous prie de m’en excuser, madame, monsieur les secrétaires d’État, mais je n’oublie pas pour autant que vous avez voulu, avec ce texte, donner un signal fort.
Je traiterai tout d’abord de l’urbanisme. Je tiens à saluer la politique de lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles chaque jour entamées par l’urbanisation. Nos territoires doivent leur attrait certes à la diversité des paysages, mais aussi à la possibilité pour les agriculteurs d’y vivre ou de s’y installer. Le choix reste délicat entre les vocations naturelles du terrain : produire ou bâtir ?
Par ailleurs, l’agglomération devient l’échelle de référence pour l’établissement des documents de planification. Ce mouvement de mise en cohérence se fera sans doute au détriment des compétences des communes. L’urbanisme remonte d’un échelon par rapport aux lois de décentralisation de 1982. Le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, devient de ce fait essentiel, en raison de la composition de ses instances. Il ne faudra pas l’oublier.
L’article 8 bis prévoit la possibilité de financer les transports par le biais de la participation pour voirie et réseaux, la PVR.
Je partage l’idée d’établir un lien entre l’ouverture à l’urbanisation et le développement des transports collectifs. Néanmoins la PVR, qui suffit à peine à réaliser les objectifs qui lui ont été assignés, ne me semble pas du tout adaptée au financement des infrastructures de transports dont les coûts d’installation sont particulièrement élevés. Je partage donc la volonté du rapporteur de supprimer cet article.
Madame, monsieur les secrétaires d’État, je tiens à attirer l’attention du Gouvernement sur l’inquiétude des élus concernant le nouveau dispositif de financement des raccordements aux réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Cette réforme a notamment pour objectif de responsabiliser les élus locaux dans la lutte contre l’étalement urbain et le mitage en les pénalisant financièrement au travers de leur participation aux financements des extensions de réseaux.
Toutefois, le décret du 28 août 2007, pris en application de l’article 23-1 de la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité du 10 février 2000, a élargi la définition de l’extension en y incluant le renforcement, ce qui augmente notablement l’assiette de la contribution à la charge des communes.
Cela revient à transférer les coûts de renforcement sur les budgets des communes, contrairement à l’esprit du législateur qui a voulu que le renforcement soit financé au travers du tarif d’acheminement que tout usager acquitte via sa facture d’électricité.
Le décret précité mériterait d’être modifié pour devenir compatible avec la loi du 10 février 2000 précitée. Madame, monsieur les secrétaires d’État, je compte sur vos services pour trouver une solution efficace et juste.
Les trames vertes et bleues constituent un engagement fort du Grenelle de l’environnement en faveur de la biodiversité, mais aussi de la qualité des paysages. Leur élaboration se fera au travers des SCOT. Certaines collectivités territoriales du Calvados ont déjà commencé à travailler sur la mise en place de trames vertes ou bleues. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens quant aux modalités de prise en compte de la trame dans les documents d’urbanisme. J’espère que le Grenelle II permettra d’y apporter une réponse.
Madame, monsieur les secrétaires d’État, je souhaite attirer votre attention sur une difficulté concrète – hors sujet, sûrement ! – souvent rencontrée par les maires.
En l’état actuel du droit, il est possible de mettre en demeure les propriétaires riverains de voies communales et départementales de réaliser les travaux d’entretien nécessaires – traitement des racines, élagages des arbres, taille des haies –, mais aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’exécution d’office aux frais du propriétaire défaillant.
À l’inverse, sur les chemins ruraux, l’exécution d’office à la demande du maire peut se faire après une mise en demeure restée sans résultat. Une disposition réglementaire, l’article D. 161-24 du code rural, en dispose expressément.
Il serait donc utile pour nos collègues maires qu’une mesure équivalente figure dans la partie réglementaire du code de la voirie routière.
Madame le secrétaire d’État, en matière de publicité, la réforme de la loi de 1979 soulève de grands défis pour concilier la création, l’économie et la préservation des paysages. M. Hubert Falco et votre prédécesseur, Mme Kosciusko-Morizet, m’ont confié dernièrement une mission de réflexion sur ce thème dont les conclusions devraient s’inscrire dans le Grenelle II.
Dans le domaine de la publicité, beaucoup reste à faire, mais je rappelle que des règles existent. Les maires et, d’une façon générale, les pouvoirs publics les appliquent peu, ou mal. Certaines zones urbaines, notamment dans les entrées de villes, offrent un spectacle lamentable de pollution visuelle tant l’implantation des publicités, enseignes et préenseignes est anarchique. Une application plus rigoureuse de la loi s’impose.
L’article 36 bis qui, introduit par nos collègues de l’Assemblée nationale, vise à remplacer la simple déclaration par une autorisation, me semble inapproprié. C’est de plus l’une des rares mesures techniques de cette loi de programme à vocation générale. J’en proposerai donc la suppression.
De nombreuses mesures du texte prévoient un renforcement des dessertes par rail et la création de lignes à grande vitesse. L’amélioration du transport de passagers était nécessaire.
J’espère que la Normandie ne sera pas oubliée dans les projets ferroviaires en gestation. Je fais confiance à M. Dominique Bussereau sur ce point. Caen, métropole régionale, est moins bien reliée à Paris et à l’Île-de-France aujourd’hui qu’elle ne l’était voilà trente ans. C’est un triste constat. Les usagers sont exaspérés à juste titre et beaucoup d’entre eux prennent la route, avec les problèmes qui en résultent : pollution, accidents.
Je n’oublie pas la dimension de ce texte et je me réjouis des orientations qu’il propose. J’espère que nous saurons en faire un outil pour convaincre chacun de la nécessité de cette grande évolution dans notre façon de vivre. N’oublions pas que nécessité doit faire loi !
Je ne saurais conclure ce propos sans adresser mes félicitations à Mme et MM. les secrétaires d’État, pour avoir mené ce combat, et à notre rapporteur, pour le travail attentif qu’il a accompli avec la commission.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur quelques travées de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires d’État, mes chers collègues, nous participons en ce mois de janvier 2009 à la discussion de ce que l’on appelle communément le Grenelle I, après un vote consensuel intervenu à l’Assemblée nationale en octobre 2008.
Ce texte emblématique est le fruit d’une longue procédure à laquelle j’ai eu l’honneur de participer en qualité de vice-président de la Fédération des parcs naturels régionaux de France et de pilote du comité opérationnel consacré à la biodiversité, le COMOP « biodiversité ».
Ce vote un peu tardif est bouleversé par l’apparition d’une grave crise économique mondiale qui modifie sensiblement l’angle de vue sur la crise écologique.
Mais cette longue procédure de concertation avec les forces vives de la nation et les ONG a permis de faire émerger dans l’opinion publique la conscience de la gravité de la crise écologique mondiale à laquelle nous devons faire face.
C’est un mouvement de fond que le pouvoir politique se doit de prendre en compte.
Nous savons aujourd’hui que nous sommes dans un monde fini où les ressources naturelles sont limitées et qu’il faut donc les utiliser avec parcimonie. Sans tomber dans le catastrophisme facile et la sinistrose ambiante, j’affirme que c’est la survie de l’espèce humaine sur notre planète qui est en jeu.
Il nous faut donc bâtir un autre monde, qui mesure les limites de la science et de la technique et qui, sans oublier la justice sociale, se fonde sur d’autres valeurs, liées à la préservation de notre environnement et au développement durable.
Il nous faut assurer une véritable conversion intellectuelle et morale. C’est à un réel sursaut que nous sommes conviés, car le temps presse, même s’il n’est pas encore trop tard. C’est pourquoi, au-delà des apostrophes incantatoires, il faut une volonté politique forte pour assumer cette transition inévitable.
Ce projet de loi introduit pour la première fois dans un texte législatif les notions de trame bleue et de trame verte. Son but est d’enrayer la chute de la biodiversité. L’objectif est donc de restaurer les continuités, les connectivités écologiques des milieux naturels.
Afin de lutter contre la fragmentation des habitats naturels, il faut mettre en place de véritables réseaux écologiques, tout en s’appuyant sur les besoins de déplacement des espèces principales. Il convient d’essayer de limiter au maximum les ruptures, de raisonner en termes de maillage et de fonctionnalité des écosystèmes.
L’enjeu majeur sera donc de traduire ces objectifs dans les documents d’urbanisme : plan local d’urbanisme, ou PLU, et schéma de cohérence territoriale, ou SCOT.
Aussi, je souhaite que l’État donne davantage de moyens humains et financiers aux petites communes pour élaborer SCOT et PLU. Sinon, la trame verte et bleue restera lettre morte, ce qui serait regrettable pour la préservation des milieux naturels.
Nous ne devons jamais oublier que la trame verte et bleue représente une richesse économique et qu’elle rend des services au niveau du cadre de vie, des activités de loisirs, de l’alimentation des populations, en particulier en eau potable, et de la préservation quant au risque d’inondation.
Avouons que les solutions sont souvent difficiles à mettre en œuvre, surtout quand on a affaire à de grandes infrastructures linéaires de transport. J’ai cru comprendre, à travers les exposés des orateurs précédents, que chacun a un projet de transport linéaire dans sa poche, mais il faudrait faire attention à ce qui existe plutôt que de créer de nouvelles structures, alors que de nombreuses lignes sont mal entretenues.
Tout cela devrait se faire dans la concertation et la contractualisation les plus larges possibles. Quand on a un projet routier, il faut prendre en considération différents critères - largeur, vitesse, trafic, grillage, remblai, mur antibruit, nuisances sonores et éclairage par rapport au milieu naturel environnant.
Aussi faudra-t-il prendre au sérieux l’installation de passages pour les animaux, crapauducs ou autres, en fonction des connaissances scientifiques du terrain.
Le cas échéant, on peut se poser la question des compensations. Mais qu’est-ce qui est compensable en matière de biodiversité ?
On ne doit pas non plus oublier le danger que représentent les plantes invasives ou exotiques qui agressent nos écosystèmes et qui sont une menace permanente sur les écosystèmes atlantiques et méditerranéens.
Sera-t-on cependant capable de construire des servitudes contractuelles pour pérenniser le bon fonctionnement des milieux naturels ? Vaste question qu’il faudra négocier avec le monde agricole.
Il faut nous en convaincre, la trame verte et bleue est une véritable assurance sur la vie pour l’homme sur la planète Terre.
Nous devons donc intégrer plus qu’on ne l’a fait dans le passé une réflexion et une action pour le maintien des espaces et des espèces naturels, les espèces communes comme les espèces exceptionnelles ou rares, et faire l’inventaire des espèces menacées.
La trame verte et bleue pose aussi des questions fiscales et budgétaires qui sont loin d’être réglées dans vos propositions, madame la secrétaire d’État.
Mais la crise écologique peut être une chance pour notre développement économique. L’économie verte est créatrice d’emplois : 440 000 emplois directs pour les seules activités liées à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables, qui représentent un marché de 70 milliards d’euros d’ici à 2012, soit le double de 2007, au cours de laquelle 220 000 emplois directs ont été créés.
À l’heure d’une crise de l’emploi d’une violence inouïe, les travaux d’isolation des bâtiments, les infrastructures nécessaires à l’énergie renouvelable, les infrastructures de transports collectifs sont une chance qu’il faut absolument saisir, conforter et intensifier à l’avenir avec un appui financier plus fort qu’il n’est prévu.
Mais tout cela suppose des modifications dans nos comportements de consommateurs : acheter des voitures plus petites, plus économes, réfléchir à un meilleur dosage de l’éclairage public, en diminuant son intensité lumineuse. Aujourd’hui, 800 000 lampadaires à boule éclairent le ciel, mes chers collègues !
Nous devons aussi mesurer, réduire et compenser les émissions de gaz à effet de serre. Chaque Français émet neuf tonnes équivalent CO2 par an, contre dix-huit tonnes pour un Américain. Or les scientifiques estiment qu’il faudrait parvenir à moins de deux tonnes par habitant pour enrayer l’emballement de la machine climatique. Il reste encore, là aussi, beaucoup à faire ; la volonté politique sera-t-elle suffisante pour atteindre cet objectif ?
Dans notre vie de tous les jours, il faut mettre en œuvre une écologie concrète appliquée. Quand on veut acheter des produits courants en « bio », on est vite désarmé : cela va du biberon en plastique pour bébé aux couches recyclables et aux petits pots sans pesticides, en passant par le shampoing, les peintures ou les papiers peints.
Au-delà des mots, il faut une volonté réglementaire plus affirmée quand on sait que 45 % des légumes et 70 % des fruits contiennent des résidus de pesticides et que, respectivement, 7 % et 8, 5 % d’entre eux dépassent les normes.
Oui, il faut aller vers une agriculture « bio » ou « orientée bio », mais il faut aider les agriculteurs dans leur formation et dans la construction de la « filière bio », afin de leur permettre d’en vivre décemment. Si on pouvait le faire en priorité sur les aires d’alimentation des champs captants, ce serait encore mieux. Il faut changer nos modes de production et de consommation, et le débat actuel sur la nocivité du Roundup montre que le sujet est brûlant.
En conclusion, madame la secrétaire d’État, monsieur le secrétaire d’État, nous souhaitons aujourd’hui que vous ayez la capacité politique de mettre en œuvre ces objectifs auxquels nous souscrivons dans l’ensemble. Mais ils devront être accompagnés de moyens financiers et humains bien plus élevés qu’ils ne le sont aujourd’hui.
Il faudra en outre résister aux nombreux groupes de pression, industriels et financiers, qui ne visent qu’à tirer le maximum de profit du court terme, en oubliant l’intérêt général du long terme.
À cet égard, la façon dont le plan de relance a été présenté m’inquiète énormément. Il ne faut pas céder aux demandes visant à assouplir telle ou telle règle, sous prétexte d’une mise en œuvre plus rapide. Cela ne peut se faire qu’au détriment de l’environnement, de la santé et de nos concitoyens. Nous avons besoin d’être rassurés par des engagements précis.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame, monsieur les secrétaires d’État, le projet de loi que nous examinons est la consolidation du processus du Grenelle de l’environnement. Plusieurs orateurs ont souligné la qualité des très nombreuses rencontres et des travaux des groupes de travail ainsi que le caractère innovant de cette démarche.
Ce texte est bien fondateur d’une stratégie de long terme.
Nul doute que votre capacité à dialoguer, madame la secrétaire d’État, nous conduira à améliorer encore ce projet de loi pour permettre son adoption par la quasi-totalité de nos collègues, comme cela a été le cas à l’Assemblée nationale : je forme le vœu que notre débat nous permette d’aboutir à un tel vote.
Exclamations dubitatives sur les travées du groupe socialiste.

Mes chers collègues, le contexte d’examen de ce « Grenelle I » s’est encore durci.
La crise, qui a atteint l’ensemble des économies mondiales, est désormais profonde et elle fragilise nombre de nos concitoyens et de familles françaises dans leur vie quotidienne.
Ainsi, la fin des contrats d’intérim et des contrats à durée déterminée déstabilise des budgets familiaux tendus. Les aides sociales en atténueront bien sûr l’impact, mais nous savons bien que ce n’est pas une réponse suffisante.
Beaucoup a déjà été dit sur le projet de loi par mes collègues. Je voudrais simplement souligner deux points du Grenelle I dans ce contexte particulier de crise.
Le premier concerne la qualité des logements.
Plus que jamais, notre effort devra porter sur la qualité énergétique et l’isolation des logements. Il s’agit d’investir aujourd’hui pour mieux réduire la facture énergétique de demain, c’est-à-dire de réaliser un double gain dans une perspective à la fois de baisse des charges pour nos concitoyens et de réduction de l’empreinte écologique.
Faisons ensemble de cette crise une occasion et accélérons ces programmes d’amélioration des logements, notamment les logements anciens et les logements HLM.
Je pense aussi aux logements neufs, et je vous propose de ne pas adopter l’amendement qui a été élaboré ce matin en commission et qui vise à atténuer l’objectif de performance énergétique pour les logements neufs : ces logements doivent être exemplaires. Afin de maintenir toute la portée de la mesure, la notion d’énergie « primaire » doit être conservée et associée à l’objectif des cinquante kilowattheures.

Je plaide aussi pour une mobilisation renforcée des villes et des agglomérations en faveur du logement, car rien ne peut se faire sans elles.
Second point, la taxe sur les poids lourds donne, dans le contexte de la crise, une force particulière au « Grenelle ».
Les poids lourds encombrent nos routes et aggravent, dans nos villes, les niveaux de pollution, notamment les pollutions aux particules fines, qui s’ajoutent aux effets négatifs de la circulation automobile. On nous propose aujourd'hui un délai courant jusqu’en 2011. L’expérimentation alsacienne, un temps prévue, semble abandonnée, et je le regrette, comme d’autres Alsaciens dans cet hémicycle.
Cette ressource est stratégique, comme nous le savons, pour doter l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, des moyens de rééquilibrer le fer et la voie d’eau, d’une part, et la route, d’autre part, et de passer en quelque sorte des déclarations, qui sont déjà anciennes, aux actes.
Cette ressource permettra d’engager en particulier des programmes de TGV : je pense au TGV Le Mans-Rennes, au contournement de Nîmes-Montpellier et, bien sûr, à la deuxième phase du TGV Est-européen, autant de lignes de TGV dont notre pays a besoin.
Associée à l’aide aux transports urbains, au développement des modes « doux », comme le vélo, la marche à pied ou l’autopartage, cette politique permettra de proposer à nos concitoyens une véritable solution de remplacement de la voiture individuelle : il y a, là aussi, double gain, et pour le budget des familles et pour l’empreinte écologique de nos déplacements.
Je vous demande donc, madame la secrétaire d’État, de « mettre la pression », pour que la mise en place de cette taxe sur les poids lourds, votée en loi de finances, soit bien effective en 2011. Nous savons tous que c’est un dossier compliqué, qui a besoin de toute votre énergie et votre total engagement.
Mes chers collègues, les orientations présentées dans ce texte sont fondatrices d’une nouvelle société, d’une nouvelle économie, et posent les bases d’une économie durable.
Je note qu’un certain nombre de mesures ont déjà été prises, et je m’en réjouis. Il est parfois un peu compliqué de savoir où l’on en est entre la loi de finances, le plan de relance et le « Grenelle II ». Mais qu’importe le véhicule législatif, l’urgence est là, et je me réjouis, avec la plupart d’entre vous, des mesures déjà engagées.
Beaucoup reste à faire dans les mesures d’application : je forme donc le vœu que, dans des délais très courts, nous puissions examiner les mesures d’application contenues dans le « Grenelle II » et que nos débats pour le « Grenelle I » soient plus denses et plus ramassés ; car, dans l’action concrète, qui ici seule compte, c’est bien la mise en œuvre des politiques qui permettra à notre pays d’être exemplaire.
Mes chers collègues, faisons tous ensemble de la crise une occasion : à l’impératif de l’urgence écologique s’ajoute désormais l’urgence d’agir contre la crise.
Entrons plus vite et plus fort dans cette économie verte qu’avec vous, madame la secrétaire d’État, nous voulons construire avec détermination.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « Je voudrais qu’à cet instant précis tous les Français et les Européens qui nous écoutent prennent conscience de l’immense richesse que nous apporte l’outre-mer ».
Ainsi s’exprimait le Président Nicolas Sarkozy, il y a tout juste un an, à Camopi, en Guyane. Et il rappelait, entre autres, que « l’outre-mer, c’est 97 % de la superficie des eaux maritimes françaises qui sont les deuxièmes plus vastes du monde » et que « cette richesse, présente sur les trois océans, permet à la France de siéger dans la quasi-totalité des instances internationales de préservation de l’environnement... »
Cet appel à une véritable prise de conscience de ce que représente l’outre-mer en matière de biodiversité, à une époque où notre planète est confrontée à de graves périls écologiques, était vraiment nécessaire. Et il a reçu l’écho favorable qu’il méritait chez les ultramarins.
Mais il a fallu assez vite déchanter, d’abord, à cause de la façon dont l’outre-mer a été associé au processus du Grenelle de l’environnement.
Comme souvent, on a d’abord privilégié les réunions à Paris. Puis, on a cru pouvoir se contenter d’un Grenelle de l’outre-mer à la Réunion, pour enfin se résoudre à tenir différents « Grenelle » outre-mer.
Malheureusement, ces « Grenelle » tropicaux ont été organisés dans des conditions de précipitation qui en ont sérieusement limité la portée. C’est ce qui m’a fait qualifier de « session de rattrapage » la réunion qui s’est tenue à la Martinique le 17 octobre 2007. Intervenant à l’ouverture des travaux, j’ai pu souligner que cela était d’autant plus regrettable que le conseil général que je préside avait lancé depuis plus de deux ans une démarche Agenda 21 dont les préconisations n’étaient même pas prises en compte !
Et la déception des ultramarins n’a fait que croître à la lecture du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, que nous examinons aujourd’hui dans une version améliorée sur quelques points par l’Assemblée nationale.
Le texte est en effet insatisfaisant pour des raisons qui ont déjà été exposées par certains de nos collègues, notamment parce qu’il n’est pas du niveau de ce que l’on est en droit d’attendre d’une loi de programme. S’agissant de l’outre-mer, s’y ajoute le décalage vraiment trop grand entre ce que semblait annoncer le Président de la République et le contenu du texte.
Je ne peux pas, dans le temps qui m’est imparti, analyser les différentes mesures intéressant l’outre-mer. Je m’attacherai plutôt à souligner quelques points qui méritent, selon moi, une attention particulière, même si la prise en compte de certains d’entre eux passe par d’autres dispositifs législatifs, réglementaires ou budgétaires.
Le premier point que je veux aborder est la nécessité d’une grande politique de prévention des risques naturels, dont le plan Séisme Antilles doit tout naturellement constituer une composante importante. Les grandes lignes d’une première phase de ce plan ont été présentées en janvier 2007 par Mme Nelly Olin. À cet égard, madame la secrétaire d’État, j’aimerais savoir si l’on en a définitivement arrêté le plan de financement.
Par ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur l’existence d’un important réseau d’accéléromètres télégérés mis en place par le conseil général de la Martinique et intégré au réseau accélérométrique permanent.
Toujours dans le cadre de la politique de prévention des risques naturels, il est indispensable de se préoccuper du risque de tsunami dans la Caraïbe. M. le ministre d’État a bien voulu, dans cette perspective, cofinancer la quatrième rencontre du groupe intergouvernemental de coordination pour les Caraïbes, qui aura lieu en Martinique les 17, 18 et 19 mars prochain. La France est-elle décidée à s’engager dans le programme qui, sous l’égide de l’UNESCO, devrait aboutir en 2010 à la réalisation d’un dispositif d’alerte opérationnel pour la Caraïbe ?
Le deuxième point que je veux évoquer concerne le plan d’action chlordécone 2008-2010. Je tiens à souligner qu’il doit faire l’objet d’une attention soutenue pour que soit prise en compte toute l’acuité des problèmes posés. Je veux par ailleurs vous rappeler, madame la secrétaire d’État, que le laboratoire départemental de la Martinique est toujours en attente d’un agrément qui pourrait lui permettre d’effectuer les analyses de pesticides sur place au lieu d’avoir à les expédier dans la Drôme…
Le troisième point que je souhaite mentionner est la nécessité, en matière de traitement des déchets, de favoriser le développement de programmes intégrés de coopération régionale afin de réaliser des économies d’échelle.
Le quatrième point concerne la prise en compte et la mise en valeur des initiatives originales prises par les collectivités d’outre-mer. Certaines ont déjà débouché sur de véritables pôles d’excellence régionaux, qui peuvent évidemment jouer un rôle important en matière de coopération régionale.
C’est le cas de la Réunion, dans les domaines de l’agroalimentaire et de la recherche médicale ; de la Guadeloupe, dans le domaine des énergies nouvelles ; de la Guyane, dans le domaine des forêts, mais aussi de la Martinique, dans le domaine de l’étude, du suivi et de la prévention des phénomènes naturels.
Le conseil général de la Martinique s’est en effet doté, depuis 1992, d’un important dispositif d’appareils de mesure et d’un système d’information géographique. Cela l’a amené à envisager la création d’un pôle de compétitivité adossé au pôle PACA et au pôle euro-Méditerranée. Je veux, madame la secrétaire d’État, attirer votre attention sur ce dossier.
Le cinquième point concerne la géothermie. Les résultats remarquables obtenus à Bouillante, en Guadeloupe, devraient, me semble-t-il, inciter à donner au Bureau de recherches géologiques et minières, le BRGM, les moyens suffisants pour effectuer les recherches nécessaires, à la Martinique et à la Réunion, compte tenu des potentialités évidentes existant en ce domaine dans ces deux îles volcaniques.
Enfin, je veux évoquer le formidable potentiel qui existe outre-mer en matière de plantes médicinales. Le recensement doit être poursuivi de manière systématique, mais des garde-fous doivent être prévus contre les risques avérés de bio-piraterie.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il ne suffit pas de reconnaître l’extraordinaire richesse de la biodiversité de l’outre-mer ; il faut prendre la mesure de l’importance que revêt ce potentiel, alors que se multiplient les cris d’alarme sur la détérioration croissante de la biodiversité et des écosystèmes de la planète.
Il faut, à partir de là, concevoir et engager des politiques qui soient à la hauteur des enjeux.
Cela ne nécessite pas seulement la mise en œuvre de moyens financiers importants - les moyens sont, pour l’heure, nettement insuffisants -, mais aussi le soutien des politiques dynamiques et des initiatives innovantes menées dans les différents territoires ultramarins. Cela implique surtout de prendre conscience de la diversité de ces territoires et, par conséquent, d’admettre la nécessité de leur appliquer des politiques différenciées et adaptées, tout en reconnaissant à leurs peuples un véritable droit à l’initiative.
C’est ainsi que l’on pourra le mieux sauvegarder et promouvoir non seulement la biodiversité des outre-mers, mais, de surcroît, leur diversité culturelle, une diversité qui participe au maintien de la biodiversité mais qui, surtout, peut apporter une précieuse contribution à l’invention de nouveaux modes de vivre ensemble.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

M. René Vestri. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est un « bleu » qui s’adresse à vous ce soir, et ce à double titre : d’abord, parce que c’est ma première intervention devant cette auguste assemblée
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP

Cette association est également à l’origine du projet Pelagos, qui a réuni la France, Monaco et l’Italie et a abouti, au bout de dix ans, le 25 novembre 1999, à la signature à Rome d’un accord international pour la création d’un sanctuaire ayant pour objet la protection des mammifères marins en Méditerranée.
Cet accord constitue le premier texte juridique au monde conclu par plusieurs pays pour créer une aire marine protégée dans des eaux internationales. Le sanctuaire protégé s’étend sur 87 500 kilomètres carrés, au sein du bassin corso-liguro-provençal.
La Méditerranée ne représente que 0, 7 % de la surface des océans, mais constitue un réservoir majeur de la biodiversité, avec 28 % d’espèces que l’on ne trouve nulle part ailleurs.
La France est présente dans la plupart des océans du globe et dispose du deuxième patrimoine maritime mondial en termes de surface. Sa responsabilité en matière de préservation de l’environnement marin est donc évidente.
Pollution exponentielle, réchauffement climatique fragilisant la faune et la flore, salinité accrue, pêche excessive et illégale… La Méditerranée nécessite une action en profondeur.
Aujourd’hui, le traitement des eaux pluviales doit être, sur l’ensemble du territoire, une priorité pour les communes et communautés de communes, car le développement de nos agglomérations, en affectant les caractéristiques de ruissellement des sols, induit des modifications importantes des conditions d’écoulement des eaux.
L’imperméabilisation des surfaces de recueillement naturel des sols provoque la concentration de déchets qui sont automatiquement rejetés dans la mer. Ces matières polluantes se déposent dans les fonds marins, contaminant ainsi les nombreux organismes qui s’y concentrent. Elles se fixent sur les herbiers de posidonies, qui deviennent dès lors cassants et ne peuvent plus remplir leur rôle irremplaçable de protection de la frange côtière et des plages.
La menace majeure, c’est aussi l’insuffisance des stations d’épuration sur le pourtour méditerranéen. Malgré l’amendement de notre collègue M. Trucy, la loi littoral en a souvent interdit la construction. Notre action dans notre coin de Méditerranée doit s’accompagner d’un effort de persuasion auprès des autres pays riverains pour que ne soit pas annulés ailleurs les efforts consentis ici. Le processus d’Union pour la Méditerranée, initiative que nous devons au Président Nicolas Sarkozy, pourrait à cet égard trouver une application concrète de son volet environnemental.
Le développement de la plaisance est d’ordre général une chance pour le littoral français, mais ce n’est plus du tout le cas lorsque les navires vont au mouillage et créent avec leurs ancres de véritables cratères sous-marins. La situation actuelle est alarmante, car des prairies entières de posidonies ont été dévastées par les mouillages forains des plaisanciers.
La posidonie, classée parmi les espèces protégées par la loi, est une plante marine dont l’importance biologique est fondamentale pour la bonne santé de la mer. En effet, cette plante à fleurs, considérée comme le poumon de la Méditerranée, fixe les fonds marins grâce à ses rhizomes. Elle sert aussi de nourriture, d’abri et de frayère à des milliers d’animaux marins. Elle est à la base d’une importante chaîne alimentaire et contribue également à la production d’oxygène. Bref, elle est à l’origine d’une grande partie de la biodiversité méditerranéenne.
C’est pourquoi il est impératif d’établir un plan de conservation de cet élément naturel en créant des mouillages écologiques sur toute la façade méditerranéenne, à l’aide de bouées spécialement conçues à cet effet.
Je formulerai trois propositions.
D’abord, il faut imposer, dans le cadre du permis bateau, l’obligation de former les plaisanciers au mouillage. Pour faire le parallèle avec la conduite automobile, c’est comme si, actuellement, on vous donnait le permis de conduire sans vous apprendre à faire de créneau ! C’est totalement incohérent, surtout lorsque l’on sait que la destination principale du navire est d’aller au mouillage…
Ensuite, il faut développer les zones de mouillages et d’équipements légers. Pour cela, la procédure prévue dans le décret du 22 octobre 1991 doit être simplifiée, car, aujourd’hui, on n’arrive pas à aménager une zone de mouillages en moins de trente-six mois, alors qu’une saison suffit pour détruire un herbier de posidonies.
Enfin, il faut développer les zones de mouillages propres. Le préfet maritime doit à cette fin imposer, lors de la création des zones de mouillages, que chaque plaisancier soit effectivement équipé de réservoirs, fixes ou mis en place à titre temporaire, destinés à recevoir les déchets organiques et respectant les mesures édictées par le décret du 4 juillet 1996.
Grâce à ces quelques mesures simples, nous pouvons saisir une chance historique et laisser aux générations futures une mer qui soit dans un meilleur état que celui que nous lui connaissons aujourd’hui.
J’ajoute que, protéger les fonds marins, c’est également donner une chance aux petits métiers de la pêche traditionnelle de perdurer. À cet égard, la pêche au gangui, qui ravage les fonds marins en détruisant les herbiers de posidonies et tous les œufs qui y sont fixés, est une hérésie qu’il faut bannir.
Enfin, j’invite mes collègues et le Gouvernement à se pencher sur l’initiative « École de la Mer » que j’ai lancée avec le conseil général des Alpes-Maritimes. Chaque année, des milliers d’enfants apprennent que la mer n’est pas seulement une étendue qui se perd à l’horizon, mais aussi un volume habité par un monde fragile qui produit plus de 80 % de l’oxygène de notre atmosphère. Les enfants doivent apprendre à connaître la mer pour mieux la protéger.
En conclusion de ma modeste contribution à la protection de la Grande Bleue, je rappellerai, madame la secrétaire d’État, que nous, les « bleus », avons un phare au milieu de Paris : l’immeuble de la place Fontenoy qui abrite l’Établissement national des invalides de la marine, l’ENIM.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

J’informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer des textes sur les dispositions restant en discussion respectivement du projet de loi de finances rectificative pour 2009 et du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 sont parvenues à l’adoption de textes communs.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Catherine Tasca.