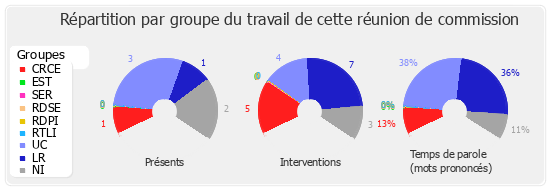Mission commune d'information sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante
Réunion du 13 avril 2005 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. françois martin président de l'association de défense des victimes de l'amiante aldeva de condé-sur-noireau (voir le dossier)
- Audition de m. françois malye auteur de « amiante : 100.000 morts à venir » (voir le dossier)
- Audition de mm. françois desriaux président michel parigot vice-président mme marie-josé voisin trésorière m. andré letouzé administrateur de l'association nationale des victimes de l'amiante andeva et de me michel ledoux avocat de l'andeva (voir le dossier)
La réunion
La mission a d'abord procédé à l'audition de M. François Martin, président de l'association de défense des victimes de l'amiante (ALDEVA) de Condé-sur-Noireau.
a rappelé qu'il était également vice-président de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés (FNATH), celle-ci ayantpris une part importante dans la mise en place de l'association nationale de défense des victimes de l'amiante (ANDEVA).
Il a souligné, qu'outre la vallée de la Veyre, qualifiée par les victimes de « Vallée de la mort », le département du Calvados avait été particulièrement concerné par l'amiante.
Il a expliqué que le nombre des victimes à Condé-sur-Noireau résultait de l'implantation ancienne de filatures utilisant des fibres d'amiante, dès la fin du XIXe siècle, et de celle plus récente d'équipementiers automobiles.
Il a indiqué à cet égard que l'entreprise qui a succédé à Valeo a compté jusqu'à 2 400 salariés permanents, auxquels il fallait ajouter les contrats précaires et les intérimaires.
Il a expliqué que le rôle de l'ALDEVA consistait d'abord à informer et soutenir les victimes, notamment dans le cadre des procédures engagées devant les tribunaux et auprès du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA).
A cet égard, il a souligné que les victimes n'étaient pas seulement les anciens salariés des entreprises utilisatrices, mais se trouvaient aussi parmi la population de la « vallée blanche », ainsi qualifiée parce qu'elle était recouverte de poussière d'amiante.
Il a insisté sur l'étendue géographique de la contamination, les victimes qui s'adressent à l'ALDEVA relevant aussi bien du Calvados que de l'Orne, ou de la Manche, où étaient notamment implantés les chantiers de construction et de réparation navale.
Il a rappelé que le minerai d'amiante utilisé à Condé-sur-Noireau était extrait de la mine de Canari, en Corse, et broyé sur place.
Décrivant une ville sinistrée qui enregistre en moyenne chaque semaine le décès d'une nouvelle victime de l'amiante, il a estimé que la colère et l'incompréhension des victimes étaient d'autant plus vives que dès 1906, un inspecteur du travail de Caen, Denis Auribault, avait révélé la surmortalité des ouvriers d'une usine de textile utilisant l'amiante à Condé-sur-Noireau. Il a considéré que la médecine du travail et l'inspection du travail, ainsi que les caisses régionales d'assurance-maladie n'avaient pas correctement rempli leur rôle.
Il a déploré, par ailleurs, en dépit de l'interdiction de l'amiante depuis 1997, que le désamiantage du principal site industriel de Condé-sur-Noireau ne soit devenu effectif qu'à la fin de l'année 2004, ce qui explique que le certificat de désamiantage n'est toujours pas délivré.
Abordant la question des procédures, il a indiqué que l'ALDEVA avait déposé plus de 700 dossiers devant les tribunaux pour faute inexcusable de l'employeur ainsi que 450 dossiers devant le FIVA.
S'agissant de l'allocation de cessation d'activité, il a estimé nécessaire de l'étendre à tous les salariés exposés à l'amiante, et pas seulement à ceux bénéficiant d'une reconnaissance au titre des maladies professionnelles, l'indemnisation par le FIVA ne pouvant, selon lui, remplacer la réparation due aux victimes par les entreprises « empoisonneuses ».
Concernant le niveau des indemnités, il a indiqué que la majorité des tribunaux, dont la Cour d'appel de Caen, pourtant réputée peu laxiste, accordaient des indemnités supérieures à celles du FIVA.
A cet égard, il a estimé que si on souhaitait réduire le nombre de recours devant les tribunaux civils, il fallait d'une part augmenter le montant des indemnités accordées par le FIVA et, d'autre part, faire avancer le dossier pénal, pour répondre au souci de justice des victimes, mais aussi pour dissuader les entreprises et les pouvoirs publics de reproduire les mêmes erreurs dans l'avenir avec d'autres substances dangereuses.
Il s'est, enfin, inquiété de la sous-évaluation de la dangerosité des produits de substitution de l'amiante qui devraient faire l'objet, à l'instar de ce qui existe pour le nucléaire dans le Cotentin, d'un dispositif de protection beaucoup plus rigoureux.

a souhaité avoir des précisions sur la population susceptible d'avoir été contaminée par l'amiante dans la vallée de Condé-sur-Noireau et a demandé à quelle date on avait cessé d'utiliser ces fibres.
Il s'est ensuite interrogé sur le degré de responsabilité des chefs d'entreprises, sur la sécurité des salariés intervenant aujourd'hui sur les produits de substitution et sur les modalités de versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité.
a indiqué que la population de la vallée était de l'ordre de 15.000 personnes.
Il a estimé que la sécurité des personnels dans les entreprises utilisatrices de produits de substitution ne pouvait être aujourd'hui garantie et a souligné l'attentisme de la médecine du travail en ce domaine.
Exprimant son émotion à l'égard du témoignage du président de l'ALDEVA, M. Jean-Pierre Godefroy, rapporteur adjoint, s'est interrogé sur les conséquences des opérations de désamiantage pour la population, au-delà des seuls salariés directement concernés.
Evoquant les autres maladies pulmonaires liées à l'amiante, il a demandé des précisions sur l'existence d'un nouveau symptôme consistant en l'apparition de nodules.
Concernant, enfin, l'harmonisation du montant des indemnisations accordées par les tribunaux, il s'est demandé s'il était envisageable de créer une Cour d'appel unique, éventuellement itinérante.
a indiqué que s'appliquait à Condé-sur-Noireau la réglementation de droit commun pour les immeubles d'habitation et les bâtiments publics, dont certains avaient été floqués à l'amiante, comme le gymnase du lycée.
S'agissant des autres maladies liées à l'amiante, il a confirmé que des doutes subsistaient sur l'origine de certains cancers, notamment celui du larynx, dont il a estimé qu'il devrait figurer parmi les maladies professionnelles liées à l'amiante, comme c'est le cas en Allemagne.
Il s'est montré réservé sur l'idée d'une cour d'appel unique qui pourrait être de nature à réduire l'individualisation des dossiers.

s'est interrogée sur l'éventualité d'une disparition de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), au profit du seul FIVA, et s'est demandé dans quelle mesure on pouvait mettre en cause la responsabilité des médecins du travail, compte tenu de leurs liens avec l'entreprise.
a rappelé le devoir d'alerte qui incombe à la médecine du travail, et a souligné que le Comité permanent amiante (CPA) avait largement contribué à la minimisation des risques et à la désinformation des pouvoirs publics.
Il a insisté sur la nature spécifique de l'ACAATA, qui est destinée à garantir une retraite anticipée aux salariés exposés, et a souhaité son maintien.

a exprimé son inquiétude quant à l'exposition au risque de la population de Condé-sur-Noireau, mais aussi des anciens salariés de plusieurs usines de Dives-sur-Mer qui n'entraient pas dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité.
a estimé que nombre de salariés de l'usine Tréfimétaux, aujourd'hui fermée, étaient susceptibles de demander le bénéfice de l'ACAATA, compte tenu du temps de latence de la maladie, et s'est inquiété de la situation de ceux qui sont exclus de ce dispositif.
Considérant que la sécurité actuelle des habitants de Condé-sur-Noireau était aujourd'hui assurée, il a insisté, en revanche, sur le sentiment d'injustice ressenti par les populations en raison du fait que les entreprises responsables échappent à toute pénalité et il a déploré que certaines de ces entreprises arguent de l'inopposabilité des jugements rendus pour faute inexcusable, au motif du non-respect de la procédure contradictoire.

s'est enquis de l'état des procédures pénales aujourd'hui engagées et s'est étonné que les entreprises coupables d'une faute inexcusable puissent se soustraire aux conséquences de leur responsabilité.
a indiqué que les plaintes déposées au pénal en 1997 étaient toujours en cours d'instruction, en dépit de la rédaction de plusieurs rapports d'expertise.
Soulignant la lenteur inacceptable des procédures, M. Pierre Fauchon s'est demandé si celle-ci n'était pas imputable au fonctionnement de la justice plutôt qu'au législateur, s'agissant des blocages du dossier pénal dans le cas de l'amiante.

a souhaité savoir si le principe « dose-effet » en matière d'exposition avait été respecté depuis 1997 dans les entreprises ayant été désamiantées.
Elle a ensuite fait état des divergences qui s'exprimaient entre les victimes et les médecins concernant le caractère invalidant et l'évolution des plaques pleurales vers des pathologies plus graves.
a reconnu que ce débat restait difficile à trancher, soulignant que les plaques pleurales n'étaient pas fatales mais que de nombreuses victimes décédées en avaient été atteintes et que ces plaques entraînaient des difficultés respiratoires plus ou moins importantes.

s'est interrogé sur les conséquences de la loi du 10 juillet 2000 sur les recours engagés par les victimes devant les juridictions pénales.
a estimé que cette loi, dite « loi Fauchon », portait préjudice à l'ensemble des victimes de l'amiante et qu'elle limitait le recours aux procédures pénales destinées à établir les responsabilités, alors que ce recours a un aspect pédagogique indéniable.

s'est enquise des initiatives prises pour conserver le témoignage et la mémoire des victimes de l'amiante à Condé-sur-Noireau.
a indiqué que les témoignages des victimes étaient répertoriés dans les dossiers et qu'un documentaire avait été réalisé sur Condé-sur-Noireau. Il a rappelé que les victimes, particulièrement exposées, manipulaient l'amiante sans précaution particulière.

a fait observer que cette audition avait donné l'occasion, pour la première fois, d'évoquer non plus seulement les victimes professionnelles de l'amiante mais également les « victimes environnementales ». Il a voulu savoir, par ailleurs, s'il existait des preuves de la contamination de la population enfantine.
a indiqué que le FIVA pourrait probablement fournir des éléments de preuve concernant ces dossiers, rappelant que les premiers d'entre eux avaient été présentés devant les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions.
a expliqué que la situation de Moulinex était quelque peu différente de celle des autres entreprises, car ses salariés travaillaient sur des produits finis contenant de l'amiante. Il a néanmoins précisé que des cas de maladies professionnelles liées à l'amiante avaient été reconnus dans cette entreprise.
La mission a ensuite procédé à l'audition de M. François Malye, auteur de « Amiante : 100.000 morts à venir ».
a insisté sur la difficulté de l'enquête qu'il avait menée pendant dix ans sur l'amiante et qui couvre un champ extrêmement large, épidémiologique, environnemental, juridique et politique. Il a constaté que l'amiante était la seule affaire de santé publique qui n'avait toujours pas été jugée, alors que la dimension pédagogique de la sanction pénale serait extrêmement importante. Il a souligné, sur un plan général, l'accroissement du poids des industriels du fait de la mondialisation et a cité la responsabilité des industries agro-alimentaires dans le phénomène de l'obésité infantile, longtemps circonscrit aux Etats-Unis mais qui se développe désormais en Europe. Livrant son sentiment personnel, il a estimé que le procès pénal de l'amiante aurait bien lieu, puisqu'il s'agit du plus gros scandale de santé publique survenu en France.
Il a également mis en évidence le volet économique et financier de l'affaire, dont le coût, très élevé, allait continuer de croître, tant en ce qui concerne la prise en charge médicale et l'indemnisation des victimes que les opérations de désamiantage, financées par l'Etat, notamment sur le site de Jussieu, la sécurité sociale et le secteur privé, comme dans le cas de la Tour Montparnasse.
Il a rappelé que 15 % à 20 % des victimes n'avaient pas eu de contact professionnel avec l'amiante et a relevé que les seules mises en examen visaient aujourd'hui les responsables universitaires du site de Jussieu. Enfin, il a qualifié de « catastrophiques » les incidences de la « loi Fauchon » dans le dossier de l'amiante, les décisions de justice pouvant être très différentes selon les juridictions, et a estimé que cette loi aurait un effet dissuasif en termes de dépôt de plaintes.

En réponse à M. Gérard Dériot, rapporteur, M. François Malye a précisé qu'il n'exerçait aucune fonction particulière au sein d'associations de victimes de l'amiante.
a voulu savoir si l'intervenant avait rencontré des difficultés pour mener son enquête et quelles personnes sollicitées avaient refusé de répondre à ses questions. Il lui a également demandé s'il avait le sentiment que les personnes interrogées avaient répondu de façon objective ou si elles n'avaient pas tout dit.
a indiqué qu'il n'avait subi ni pression ni menaces au cours de ses investigations sur l'amiante, mais a insisté sur le mensonge généralisé qu'il avait pu observer, en particulier lorsqu'il avait débuté son enquête en 1994. Il a estimé que, quel que soit leur niveau de responsabilité, tous les acteurs de l'amiante mentaient, les employeurs, la sécurité sociale, l'administration. Il a ajouté que le mensonge, qu'il ait été flagrant ou commis par omission, constituait une stratégie délibérée, rappelant que des milliers de publications scientifiques internationales sur la dangerosité de l'amiante avaient été volontairement ignorées, y compris par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), qui n'a pas rempli, à l'époque, sa mission d'alerte des pouvoirs publics.

a rappelé que les anciens membres du comité permanent amiante (CPA) auditionnés par la mission avaient reconnu, avec le recul, avoir été manipulés et ne pas avoir été informés de l'existence, à l'époque, de produits de substitution de l'amiante. Il s'est interrogé sur la bonne foi de ces personnes et s'est demandé s'il n'était pas trop facile de porter un jugement a posteriori sur l'affaire de l'amiante alors qu'à l'époque, personne ne pouvait véritablement imaginer de telles conséquences sanitaires.
a fait observer que le premier procès engagé contre les industriels de l'amiante aux Etats-Unis datait de 1970. Il a rappelé que la mise en place et l'organisation du CPA avaient été confiées à des professionnels de la communication qui étaient les prestataires habituels des industriels de l'amiante.

s'est interrogé sur la part de responsabilité d'administrations comme la médecine ou l'inspection du travail dans le drame de l'amiante. Il a souhaité obtenir des informations pouvant expliquer la passivité du ministère du travail, en particulier de sa direction des relations du travail, et de celui de la santé. Enfin, il s'est interrogé sur la possibilité qu'un drame comme celui de l'amiante se reproduise dans le contexte actuel, la France s'étant dotée, désormais, d'un dispositif de veille sanitaire.
a considéré que les agences de sécurité sanitaire avaient été mises en place trop tardivement. Il a qualifié d'« accablante» la responsabilité de la médecine du travail, mais a relevé que sa responsable de l'époque au ministère du travail avait auparavant travaillé chez Saint-Gobain.

a noté que l'intervenant, dans son livre, mettait en cause plusieurs personnalités, des scientifiques, des industriels, des fonctionnaires et des anciens ministres. Il a voulu savoir comment celles-ci avaient réagi à la publication de son ouvrage et si certaines d'entre elles avaient cherché à démentir ou nuancer les informations publiées. Il s'est interrogé sur la crédibilité de l'affirmation selon laquelle Mme Martine Aubry, alors directrice des relations du travail, n'avait pas nécessairement été au courant de l'existence du CPA.
a indiqué que Mme Martine Aubry et M. Jean-Louis Beffa, président de Saint-Gobain, avaient refusé de répondre à ses questions sur l'amiante, et s'est interrogé sur la signification de leur silence. Il a néanmoins noté qu'aucune des personnalités évoquées dans son livre n'avait démenti ses affirmations.

relevant que le lobbying des industriels auprès des pouvoirs publics était une pratique courante, s'est demandé pourquoi, dans ces conditions, aucun autre produit professionnel cancérogène n'avait fait l'objet d'un groupe de pression aussi bien organisé.
a estimé que le lobbying en faveur de l'amiante était proportionnel aux dégâts causés par cette fibre : c'est parce que l'amiante était précisément, selon lui, un matériau « indéfendable » que sa promotion nécessitait une structure particulièrement bien organisée et efficace.

s'est étonné de ce que M. Jean-Luc Pasquier, au cours de son audition, ait affirmé ignorer que le CPA avait été organisé par un professionnel de la communication.
a estimé qu'une telle affirmation illustrait parfaitement la façon dont le ministère du travail avait, à l'époque, géré le dossier de l'amiante, préférant le déléguer à une structure extérieure à laquelle il participait néanmoins. Il a jugé que les conditions de la création du CPA auraient dû conduire les responsables du ministère à s'interroger sur les intentions des industriels de l'amiante. Il a souligné la déformation systématique de la réalité de l'amiante par les professionnels de la communication, qui, par exemple, n'employaient jamais les mots « malade » ou « mortalité », tandis que l'entreprise Saint-Gobain citait très rarement le mot « amiante », préférant utiliser le terme « fibres ». Il a également souligné la responsabilité des syndicats qui, à l'exception de Force ouvrière, ont tous participé aux travaux du CPA.

s'est enquis de la date de publication des travaux de M. François Malye sur l'amiante.
a indiqué qu'il avait débuté son enquête en 1994 et rédigé un article dans un numéro de la revue Sciences et Vie en 1995, et qu'il avait publié ses deux ouvrages sur l'amiante en août 1996 et à l'automne 2004.

a rappelé qu'il avait dénoncé l'utilisation de l'amiante dès 1981, alors qu'il était le directeur de l'Institut national de la consommation (INC).
a fait observer que l'INC avait pris part aux travaux du CPA à partir de 1986, son ingénieur compétent pour le bâtiment siégeant dans cette instance.

a rappelé que la loi du 10 juillet 2000, qui porte son nom, avait été votée dans des termes très différents de ceux de sa proposition de loi initiale et a précisé que le texte définitif avait été le résultat d'un compromis entre M. René Dosière, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux de l'époque, et lui-même. Il a insisté sur le fait que le Sénat, sur sa proposition, avait modifié le texte adopté par l'Assemblée nationale qui, pour engager la responsabilité, demandait une faute d'une « exceptionnelle gravité ». Il s'est dit particulièrement choqué par la « conspiration effarante » dont l'amiante avait fait l'objet, y compris de la part des pouvoirs publics.
a expliqué que les journalistes qui avaient traité du dossier de l'amiante s'étaient également interrogés sur la possibilité d'une catastrophe sanitaire identique provoquée par d'autres produits dangereux utilisés massivement par l'industrie.

notant que M. François Malye avait contribué à la prise de conscience publique de l'ampleur de la catastrophe, a souligné le rôle des médias et des associations de victimes dans l'intérêt actuel porté à l'amiante. Elle a fait observé que les victimes et leurs familles s'étaient parfois révoltées face à l'indifférence des pouvoirs publics à leur endroit, à l'exemple des veuves de Dunkerque, et a estimé que ce mouvement allait probablement se poursuivre. Elle a jugé que les victimes allaient demander des comptes aux responsables politiques qui apparaissent trop souvent, selon elles, comme « une caste cherchant à se protéger ». Elle s'est félicitée que le Sénat et, désormais, l'Assemblée nationale, se soient saisis de l'affaire de l'amiante, et que les missions d'information parlementaires aient notamment pour objectif de comprendre les raisons de cette « conspiration du silence ». Enfin, elle s'est demandé comment il était possible de continuer à utiliser l'amiante, en l'exportant dans les pays en développement.
a constaté que tous les Etats n'avaient pas la même législation concernant l'utilisation de l'amiante et que les industriels, canadiens par exemple, profitaient des carences de la législation des Etats du Sud. Il a d'ailleurs fait remarquer que l'action de la France avait abouti à différer d'une vingtaine d'années l'interdiction de l'amiante. Il a néanmoins rappelé que l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'était prononcée contre l'utilisation de l'amiante et que cette position pouvait servir de précédent pour d'autres produits industriels cancérogènes. Il a estimé que les victimes, en attente d'un procès pénal depuis 1996, pourraient se retourner contre les dysfonctionnements du service public de la justice.

a rappelé qu'une entreprise poursuivie au pénal pour avoir distribué de l'eau non potable s'était retournée contre l'Etat, estimant que celui-ci ne lui avait pas donné les moyens de remplir sa mission, et qu'elle avait obtenu gain de cause. Elle a estimé qu'en cas de procès de l'amiante, les industriels devraient payer des réparations à hauteur de leurs responsabilités dans cette contamination. Elle a rappelé que le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais avait entrepris un diagnostic de l'amiante dans les lycées dès 1992 et un recensement des bâtiments et des personnels touchés en 1995, et elle a déploré que ces démarches pédagogiques n'aient pas été médiatisées à l'époque.
a jugé que les industriels étaient les premiers responsables des conséquences sanitaires de l'amiante, puisqu'ils avaient mis en circulation des produits dangereux. Il a néanmoins rappelé que Saint-Gobain était une entreprise publique jusqu'en 1986, date de sa privatisation. Il a fait observer que, pendant une vingtaine d'années, peu de journalistes avaient écrit sur l'amiante, en raison, notamment, du caractère complexe du dossier qui exigeait des investigations longues et approfondies. Il a, par ailleurs, ajouté que le CPA avait cherché par tous les moyens à désamorcer les problèmes éventuels, notamment en vantant ce qu'il appelait « l'usage contrôlé de l'amiante ». Il a estimé que cette attitude, tendant à faire croire que l'on pouvait faire mieux que nos voisins avec le même produit dangereux, était typiquement française.

observant que le CPA avait su exploiter les avis scientifiques divergents sur les méfaits de l'amiante, a voulu savoir si ce type de raisonnement perdurait, alors que d'autres produits sont reconnus comme dangereux, à l'exemple des éthers de glycol et des poussières de bois. Notant que les instructions pénales n'avaient toujours pas abouti, il s'est interrogé sur la possibilité pour le garde des sceaux de donner des instructions aux parquets sur ces dossiers.
a estimé que cette question mettait en évidence la défaillance de la justice qui avait reconnu la responsabilité des industriels en matière civile, mais qui ne parvenait pas à mener à bien l'instruction en matière pénale. Il a considéré que la lenteur de la justice dans cette affaire résultait également d'une absence de volonté politique, en raison des effets, selon lui « dévastateurs », d'un procès pénal de l'amiante. Il a regretté qu'aucune leçon n'ait été tirée de l'affaire de l'amiante en matière de risques sanitaires, et a fait observer que l'absence de sanctions pénales n'incitait pas les industriels à modifier leurs comportements.

s'est étonnée de ce que les autorités canadiennes continuent d'affirmer que le chrysotile pouvait être utilisé sans danger dans des conditions satisfaisantes, et a estimé que la confiance dans les expertises scientifiques ou administratives pouvait dès lors être entamée. Elle a voulu savoir si des documents promotionnels sur l'amiante avaient, à l'époque, été réalisés par les industriels.
a noté que l'Internet avait considérablement accru le caractère contradictoire des expertises et qu'il était aujourd'hui beaucoup plus difficile de maintenir l'opinion publique dans l'ignorance. Il a confirmé que des entreprises, comme Eternit, avaient réalisé des films sur les « bienfaits » de l'amiante, poursuivant l'objectif, du reste atteint, de rassurer les salariés.

a estimé que les responsables connaissaient, à l'époque, la nocivité de l'amiante, mais que les salariés de la construction navale, s'ils étaient dans l'ignorance des risques sanitaires de cette fibre, souhaitaient en priorité obtenir des primes d'insalubrité.

a fait observer que les délais de latence extrêmement longs entre l'exposition à l'amiante et l'apparition des premiers signes de la maladie avaient été mis à profit par les industriels pour mettre en place une politique de communication extrêmement efficace.
a noté que la société française avait beaucoup changé au cours des dernières années et qu'elle portait, désormais, une grande attention aux questions de santé publique et de sécurité sanitaire, notamment depuis l'affaire du sang contaminé.
Audition de Mm. François deSriaux président michel parigot vice-président Mme Marie-José Voisin trésorière M. André Letouzé administrateur de l'association nationale des victimes de l'amiante andeva et de Me Michel Ledoux avocat de l'andeva
Audition de Mm. François deSriaux président michel parigot vice-président Mme Marie-José Voisin trésorière M. André Letouzé administrateur de l'association nationale des victimes de l'amiante andeva et de Me Michel Ledoux avocat de l'andeva
La mission a enfin procédé à l'audition de MM. François Desriaux, président, Michel Parigot, vice-président, Mme Marie-José Voisin, trésorière, M. André Letouzé, administrateur, de l'Association nationale des victimes de l'amiante (ANDEVA), et de Me Michel Ledoux, avocat de l'ANDEVA.
s'est tout d'abord félicité que le Parlement s'intéresse à la contamination par l'amiante, qui est à l'origine de la crise de santé publique la plus grave que notre pays ait jamais connue, puisque l'on estime qu'elle devrait occasionner, à terme, environ 100.000 décès.
a indiqué qu'il souhaitait aborder successivement quatre thèmes : les problèmes de responsabilité pénale, l'indemnisation par le FIVA, l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) et la problématique de la prévention.
Il a rappelé que le drame de l'amiante aurait pu être évité, si des mesures de prévention adéquates avaient été prises en temps utile, et estimé que l'on devrait pouvoir, en conséquence, désigner les responsables de cette carence en matière de prévention. Les premières plaintes devant les juridictions pénales remontent à 1996, sans avoir jusqu'à présent débouché sur aucun procès. La lenteur des instructions pose un problème aux victimes, dont l'espérance de vie est réduite. De plus, alors que des milliers de jugements rendus au civil ont reconnu la faute inexcusable de l'employeur, aucun procureur n'a pris l'initiative d'engager des poursuites pénales contre les chefs d'entreprise ainsi condamnés.
a exposé les critiques de l'ANDEVA sur la loi du 10 juillet 2000, dite « loi Fauchon ». Il a indiqué qu'un juge d'instruction de Dunkerque avait récemment rendu une décision de non-lieu, confirmée par la Cour d'appel de Douai, dans une affaire relative à l'amiante, en s'appuyant sur ce texte. Rappelant que les associations avaient fait part de leurs craintes lors du débat parlementaire, il a estimé que les conséquences de la loi n'avaient pas été, à l'époque, correctement évaluées et que ce texte allait à l'encontre d'une bonne gestion des risques sanitaires.
Il a plus précisément contesté la distinction qu'introduit ce texte entre responsabilité directe et indirecte, avec une mise en cause pénale plus difficile dans le second cas. Il a également indiqué que le texte ne prévoyait de condamnation pénale que dans l'hypothèse où l'accusé avait eu effectivement connaissance du danger qu'il faisait encourir, alors qu'il conviendrait de faire peser sur les responsables un véritable devoir de s'informer. Il a ensuite regretté que le droit pénal ne connaisse qu'une distinction entre délits « volontaires » et « involontaires », l'intention étant l'élément déterminant permettant de retenir l'une ou l'autre de ces qualifications, et plaidé en faveur de la définition d'une troisième catégorie de délits. Il a en effet considéré que les circonstances du drame de l'amiante, avec des responsables qui n'ont pas eu l'intention de tuer, mais dont les actes, motivés par le profit, ont eu cette conséquence, n'étaient pas appréhendées de manière satisfaisante par le droit pénal. Pour toutes ces raisons, M. Michel Parigot a souhaité, au nom de l'ANDEVA, qu'un groupe de travail pluraliste, rassemblant tous les experts concernés, réexamine la loi Fauchon.

a rappelé qu'il était préoccupé par le problème de l'amiante depuis le début des années 1980, comme en attestent les initiatives qu'il avait prises alors, en sa qualité de directeur de l'Institut national de la consommation. Il a souligné que la loi qui portait son nom était le fruit de quatre années de travail approfondi et d'une longue navette parlementaire, au cours de laquelle le texte avait été modifié à l'initiative des députés ou du Gouvernement. Il a jugé infondée la critique selon laquelle le texte s'opposerait à une bonne gestion des risques sanitaires, estimant que tel n'était tout simplement pas son objet, et indiqué que la distinction entre responsabilité directe et indirecte, motivée par des considérations relatives aux règles applicables en matière de sécurité routière, n'avait bien sûr pas pour objet de protéger les responsables de la crise de l'amiante. S'appuyant sur l'exemple de l'affaire du « tunnel du Mont-Blanc », il a estimé que la loi n'empêchait nullement la mise en cause pénale des personnes dont la responsabilité est seulement indirecte. Puis il a expliqué que le point le plus litigieux lors de la discussion du texte avait porté sur la qualification de la faute exigée pour engager la responsabilité pénale en cas de responsabilité indirecte : alors que l'Assemblée nationale avait proposé la notion « d'imprudence d'une extrême gravité », le Sénat a obtenu que soit retenue une qualification moins exigeante, « l'imprudence caractérisée ».
Il a également contesté l'analyse selon laquelle le texte ne permettrait d'engager la responsabilité pénale que dans l'hypothèse où l'accusé aurait eu une connaissance effective du danger. Il a ajouté que la portée du texte dépendrait beaucoup de l'interprétation des tribunaux et de la qualité du travail des juges d'instruction. Il a enfin regretté que le juge d'instruction de Dunkerque ait prononcé un non-lieu, privant ainsi les juges du fond de la possibilité d'apprécier si la faute caractérisée était constituée.

a noté qu'il convenait de bien distinguer les problèmes juridiques éventuellement posés par la loi Fauchon des difficultés inhérentes à la lenteur ou à la mauvaise qualité de certaines instructions.

a observé, citant une affaire impliquant l'entreprise Alstom, que tous les procureurs ne faisaient pas la même interprétation de la loi Fauchon.
a indiqué que la loi Fauchon ne s'appliquait pas en cas de mise en examen d'une personne morale, ce qui est le cas dans l'affaire Alstom. Certains procureurs contournent ainsi la loi Fauchon en mettant directement en cause les personnes morales. Il a ajouté que l'on assistait, depuis l'adoption de la loi, à une baisse spectaculaire du nombre de condamnations de chef d'entreprise dans des affaires d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
a considéré que la loi Fauchon créait une inégalité juridique injustifiée entre différentes catégories de responsables et qu'il revenait aux magistrats d'apprécier les responsabilités de chacun. Il a souligné que la loi Fauchon, en éloignant la perspective d'une sanction, n'encourageait pas les chefs d'entreprise à s'engager dans des démarches de prévention ambitieuse et qu'elle était donc défavorable à une bonne gestion des risques sanitaires.

Répondant à une demande de M. Roland Muzeau, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, président, a souhaité que la mission approfondisse ces questions juridiques en auditionnant, éventuellement sous forme d'une table ronde, d'autres professionnels de la justice et du droit.
a évalué la question de l'indemnisation par le FIVA, en rappelant que sa création avait permis d'améliorer l'indemnisation des victimes et de raccourcir les procédures. Il a cependant exprimé deux griefs : le délai légal de six mois pour le traitement des dossiers n'est pas toujours respecté, en raison d'un manque de moyens, et le niveau des indemnisations est insuffisant : il est, en moyenne, inférieur de moitié aux indemnisations accordées par les tribunaux en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. De plus, le FIVA ne respecte que très imparfaitement l'obligation légale qui lui incombe d'intenter des actions récursoires contre les employeurs pour faire reconnaître la faute inexcusable.

a indiqué que seulement onze actions récursoires avaient jusqu'ici abouti devant les tribunaux et qu'elles avaient permis au FIVA de ne récupérer que 57.000 euros.
a estimé que le FIVA pourrait récupérer des sommes beaucoup plus importantes s'il y consacrait suffisamment de moyens en personnels et s'il travaillait en plus étroite collaboration avec les victimes, afin qu'elles apportent à l'instance les nécessaires éléments de preuve. En réponse à M. Bernard Frimat, il a indiqué que la condamnation de deux entreprises dans l'année permettait de financer la rémunération d'un juriste.

a demandé ce qu'il advenait des actions récursoires lorsque l'entreprise responsable de la contamination avait disparu.
a répondu que, dans ce cas, la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale était mise à contribution. Dans 80 % des cas, toutefois, les actions récursoires sont intentées contre des entreprises encore en activité.

a souhaité connaître la réaction de l'ANDEVA à une recommandation de la Cour des Comptes consistant à recentrer le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA), puis à affecter les sommes ainsi économisées à une meilleure indemnisation des bénéficiaires du FIVA.
a souligné que la Cour des Comptes proposait également de désigner une cour d'appel unique pour connaître du contentieux relatif à l'indemnisation. L'ANDEVA est favorable à cette proposition, à condition qu'elle ne soit pas l'occasion de minorer l'indemnisation accordée aux victimes. La première chambre de la cour d'appel de Paris, qui dispose d'une expertise en matière de santé publique, pourrait assumer convenablement ce rôle.
Une autre proposition de la Cour des Comptes consisterait à accorder automatiquement aux victimes le complément d'indemnisation attaché à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et à financer cette mesure en diminuant le nombre de titulaires de l'ACAATA. M. Michel Parigot a redouté que cette orientation ne conduise à réaliser d'importantes économies au titre de l'ACAATA pour une amélioration modeste de l'indemnisation par le FIVA.
a présenté les principales caractéristiques de l'ACAATA, qui a pour vocation de compenser la moindre espérance de vie des personnes exposées à l'amiante. Le bénéfice de l'ACAATA peut être obtenu en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle ou si le salarié a travaillé dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté ministériel. L'inscription des établissements sur les listes a pu donner lieu à des abus, l'ACAATA étant parfois utilisée comme un instrument de gestion des effectifs. Il a souhaité que le dispositif soit amélioré, notamment par une revalorisation du montant de l'ACAATA. En réponse à Mme Michelle Demessine, qui faisait observer que, seuls, 10 % des titulaires de l'ACAATA étaient atteints d'une maladie causée par l'amiante, M. André Letouzé a indiqué que cette statistique était faussée par la forte sous-déclaration des maladies professionnelles.
a ajouté que le dispositif était inégalitaire puisqu'il concernait principalement des grandes entreprises et excluait de son champ les fonctionnaires. Un contrôle plus strict devrait garantir que le FCAATA n'est pas détourné de son objet et utilisé pour financer des plans sociaux.
a ensuite abordé le thème de la prévention des risques professionnels. Il a souligné que l'interdiction de l'utilisation de l'amiante n'avait pas résolu le problème de l'amiante en place. Puis il a évoqué les risques associés à l'utilisation d'autres produits cancérigènes et observé un renforcement de la protection des salariés ces dernières années, citant le décret relatif aux produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques ou le décret sur l'évaluation des risques. Il a cependant déploré que les textes soient mal appliqués en raison d'une insuffisance des contrôles et des sanctions. Une enquête de l'inspection du travail, menée en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS), a montré que dans 76 % des cas, des éléments essentiels de la réglementation n'étaient pas respectés sur les chantiers de désamiantage.

a regretté l'insuffisance criante des moyens à la disposition de l'inspection du travail ou des caisses régionales d'assurance maladie (CRAM) pour assurer leurs missions de contrôle et de prévention.
a noté que l'inspection du travail manquait de surcroît de la spécialisation technique indispensable pour contrôler certains aspects de la réglementation relative à l'amiante. Il a insisté pour que des études soient diligentées afin d'évaluer le niveau réel d'exposition aux risques. Il a notamment souhaité, conformément à une suggestion du rapport gouvernemental, que soient recensés les bâtiments contenant de l'amiante et que cette information soit rendue publique, notamment via une diffusion sur internet.
a insisté sur le manque de contrôle en cas de démolition d'immeubles et le suivi très imparfait des déchets amiantés.
a conclu en indiquant qu'une politique ambitieuse de prévention était la seule voie permettant d'obtenir, à terme, à une baisse des dépenses d'indemnisation, en évitant de nouvelles contaminations.