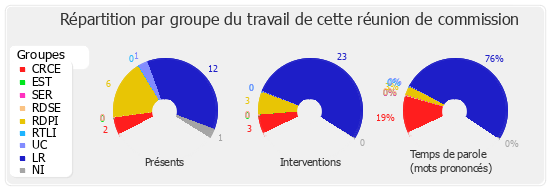Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 23 octobre 2013 : 1ère réunion
Sommaire
- Rôle des douanes dans la lutte contre la fraude sur internet
- Contrôle budgétaire - communication de mm. albéric de montgolfier et philippe dallier rapporteurs spéciaux (voir le dossier)
- Aide personnalisée de retour à l'emploi apre
- Communication de mm. philippe marini et marc massion dans le cadre de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'union européenne prévue à l'article 13 du tscg (voir le dossier)
- Loi de finances pour 2014
- Examen du rapport de m. philippe dominati rapporteur spécial sur la mission « direction de l'action du gouvernement » et sur le budget annexe « publications officielles et information administrative » (voir le dossier)
- Audition de m. jean-marie levaux membre du collège de supervision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution personnalité pressentie pour exercer les fonctions de vice-président de cette autorité (voir le dossier)
La réunion
La commission entend tout d'abord une communication de MM. Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, rapporteurs spéciaux, sur le rôle des douanes dans la lutte contre la fraude sur Internet.

Ce sujet s'inscrit dans la suite des travaux de la commission des finances. En effet, à l'initiative du président Philippe Marini et depuis quelques années, nous nous sommes fait une spécialité de la question de l'optimisation fiscale pratiquée par les géants de l'Internet, qui délocalisent d'autant plus facilement leurs profits que leurs ventes sont constituées de biens immatériels - les films, la musique ou encore la publicité.
Aujourd'hui, nous souhaiterions aborder la vente sur Internet de biens matériels - ceux que l'on peut acheter sur les grands sites tels que la Fnac, Amazon, eBay, de particulier à particulier... mais aussi sur des milliers d'autres. Or cette fois-ci, ce n'est plus d'optimisation dont il s'agit, mais de fraude fiscale pure et simple.
Quel est l'enjeu ? Vous avez ici les chiffres, qui sont relativement importants : aujourd'hui, la vente en ligne représente en France 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour les biens matériels et immatériels, et environ 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel pour la vente à distance de biens matériels. Tout cela ne fait que croître et embellir. En France, 117 000 sites Internet sont actifs, et près de 550 000 en Europe. On estime que 69 % des Français et 250 millions d'Européens achètent en ligne.
Un mot sur le rapport de la Commission européenne paru récemment, qui estimait le manque à gagner en matière de TVA à 32 milliards d'euros pour la France. Ces chiffres ont certes fait l'objet de polémiques car leur mode de calcul n'est pas connu, mais ils donnent une idée des enjeux, qui sont considérables.
Nous avons donc mené une mission de contrôle sur le rôle de l'administration des douanes (la Direction générale des douanes et droits indirects, DGDDI) dans le commerce en ligne. Je vous livre tout de suite notre conclusion. En matière de lutte contre les trafics (stupéfiants, tabacs, alcools, contrefaçons...), la douane conduit ses missions correctement, mais en matière de recouvrement des droits et taxes qui sont dus, nous sommes très en-dessous de ce qu'il serait nécessaire de faire.
Comment se déroulent les contrôles ? Nous nous sommes rendus sur place, à Roissy, pour observer la manière dont sont examinés les colis en provenance de l'étranger, par fret express (par FedEx, UPS, DHL...) et en fret postal. En effet, la quasi-totalité des particuliers qui achètent sur Internet se font envoyer leurs envois par ces moyens-là.
Quatre heures avant l'arrivée de l'avion, les transporteurs doivent envoyer à la douane, par voie électronique, une série d'informations sur les marchandises transportées. Lors du dédouanement, à l'arrivée, une déclaration en douane est remplie, qui permet d'attribuer un statut à la marchandise et de calculer les taxes afférentes. Toutes ces informations sont entrées dans un système de « ciblage », qui permet d'identifier les envois a priori douteux qui seront mis de côté pour être examinés. Ce système est enrichi par de nouvelles données au fil du temps, afin d'interrompre les envois venant d'un même expéditeur.
C'est à ce moment-là qu'ont lieu les contrôles, dans chacun des entrepôts répartis sur la plateforme aéroportuaire. Les agents peuvent se limiter au contrôle des documents, mais aussi ouvrir les colis pour examiner la marchandise. Le cas échéant, celles-ci sont saisies et peuvent donner lieu à une procédure judiciaire.
Pour le fret postal, les choses sont beaucoup plus compliquées puisque les déclarations ne sont pas informatisées. Il est donc impossible d'effectuer un ciblage automatique. Les agents sont alors condamnés au « tri visuel » - autant dire que les résultats ne peuvent pas être à la hauteur de nos espérances, compte tenu à la fois des faibles moyens humains engagés et du secret de la correspondance qui protège les envois postaux.
Quels sont les résultats obtenus en matière de lutte contre les trafics ? Ils peuvent être considérés comme satisfaisants, comme en témoignent les chiffres suivants. En ce qui concerne le fret express et le fret postal, en 2012, la douane a saisi 2,8 tonnes de stupéfiants, 29,5 tonnes de cigarettes de contrebande et 1,4 million d'articles de contrefaçon. Ces résultats représentent une part importante du total des saisies effectuées par la douane en 2012. Cela dit, il convient de relativiser ces résultats : par définition, on ignore le volume des trafics qui réussissent à « passer » sans être contrôlés. D'autant que les moyens humains sont très limités : sur place, une dizaine d'agents sont chargés d'ouvrir à la main les colis dans chaque bureau de contrôle, ce qui paraît bien peu par rapport aux centaines de milliers d'envois qui transitent chaque jour par la plateforme aéroportuaire. Vous avez là quelques photos montrant les saisies effectuées à Roissy : médicaments, accessoires pour smartphone, contrefaçons de vêtements, etc.
Par contre, en matière de recouvrement des prélèvements obligatoires, les méthodes employées sont très largement inefficaces, et c'est surtout sur cet aspect-là que nous pourrions améliorer les choses.

Une petite précision : lorsque nous avons assisté à l'ouverture des colis au centre de tri postal par une dizaine de douaniers et d'agents de la Poste, presque 100 % des colis ouverts contenaient des contrefaçons : cela montre que les agents savent, par habitude et à l'aspect du paquet, ce qu'il contient. Cela dit, il faut préciser que 300 tonnes de fret postal transitent chaque jour à Roissy, pour plus de 35 millions d'envois postaux par an : à huit ou dix personnes, seule une petite minorité d'envois peuvent être ouverts... Il y a donc un ciblage par provenance : quand une enveloppe épaisse vient d'Inde, les chances sont très fortes pour qu'il s'agisse de médicaments de contrefaçon - qui seront certainement placebo, si ce n'est dangereux. Le difficile travail manuel d'ouverture est fait très sérieusement, mais avec toutes les réserves qu'implique le nombre considérable d'envois postaux.
Mais la douane n'a pas qu'une mission de lutte contre les trafics et la contrefaçon. Elle a aussi une mission fiscale, qui porte sur la TVA à l'importation en provenance de pays hors Union européenne, les droits de douane, et plusieurs autres taxes alignées sur la TVA.
Vous voyez ici un bordereau d'envoi en fret express qui accompagne un colis en provenance de Chine : l'expéditeur envoie 850 accessoires pour smartphone, déclarés à 260 euros au total, soit 10 ou 20 centimes d'euros/pièce. Ceci n'est évidemment pas leur valeur dans le commerce... Or c'est cette valeur, purement déclarative, qui sert à établir les droits et taxes à l'importation.
Bien sûr, les grandes entreprises telles que Darty, Amazon ou la Fnac - dont certaines sont d'ailleurs résidents fiscaux en France - ne prendront pas le risque de sous-évaluer la valeur des biens. Mais qu'en est-il pour la multitude des sites de vente, installés notamment à l'étranger ? Naturellement, ces sites dont le nombre est considérable ont un intérêt objectif à la sous-déclaration. En clair : ils ne risquent rien ou presque. La probabilité de contrôle est très faible, et la douane n'aurait de toute façon aucun intérêt à engager une procédure pour récupérer quelques euros. Pour opérer un redressement, il faudrait pouvoir établir la valeur de chaque bien, ce qui - on nous l'a dit très clairement - conduit la douane à abandonner les poursuites dans la plupart des cas. Il y a donc un intérêt des opérateurs à un morcellement des envois.
De plus, les « envois de valeur négligeable » (EVN) bénéficient d'une franchise de droits de douane si leur valeur déclarée est inférieure à 150 euros, et d'une franchise de TVA si elle est inférieure à 22 euros. En pratique, de très nombreux bordereaux mentionnent une valeur inférieure à ces seuils afin d'échapper au contrôle, et ceci quel que soit leur contenu ! Théoriquement, la franchise de TVA n'est pas applicable à la vente à distance - mais il est impossible de faire la distinction en pratique. Ces franchises sont donc une porte ouverte à la fraude massive. C'est pour cela que les redressements opérés à Roissy en matière de fret postal s'élèvent à zéro euro, et les redressements en matière de fret express à 750 000 euros seulement.
Il faut donc se demander si les moyens engagés sont justifiés au regard des faibles montants collectés. Par exemple, 104 agents étaient affectés au contrôle fret express et postal à Roissy en 2012. Ce nombre est bien insuffisant au regard de l'explosion du fret express (8 millions d'envois par an à Roissy) et du fret postal (35 millions d'envois par an à Roissy) qui accompagne la croissance du commerce électronique. Rapporté au montant de taxes redressées à Roissy, on parvient seulement à 7 200 euros redressés par agent et par an...
Les agents font donc tout leur possible en matière de lutte contre la contrefaçon et les stupéfiants, mais ils sont évidemment totalement démunis face à l'enjeu du redressement des droits et taxes.
Au-delà même de ces obstacles pratiques et juridiques, il nous est apparu - et c'est plus grave - que la récupération des droits à l'importation et de la TVA n'était pas une priorité pour la douane. Les services de la DGDDI nous ont clairement dit que leur priorité était de lutter contre les trafics, ce qu'ils font je pense très bien (avec toutes les limites déjà mentionnées). Pour la douane, les enjeux fiscaux ne sont pas prioritaires, du fait du morcellement sous forme d'envois de faible valeur. Mais la somme de ces envois correspond tout de même à des enjeux massifs ! Rappelons les chiffres : le commerce en ligne représente 45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France et 312 milliards d'euros en Europe, le secteur bénéficiant par ailleurs d'une croissance à deux chiffres certaines années.
Un mot sur la cellule « Cyberdouane », que nous avons également visitée. Il s'agit d'un service spécialisé dans la lutte contre la cyberdélinquance, placé depuis 2009 au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). Les agents de Cyberdouane ont pour but de mener une veille sur Internet et de conduire des enquêtes sur un certain nombre de sites.
Là aussi, il nous est apparu que la priorité était de lutter contre les trafics de marchandises, de faux médicaments, de stupéfiants, de contrefaçons etc. qui sont contrôlés par des réseaux criminels. Les enquêtes menées par Cyberdouane produisent à cet égard de bons résultats : sur les 277 dossiers pris en charge depuis 2010, près de 40 % concernent les contrefaçons, suivi des trafics de médicaments, stupéfiants et anabolisants. Ces marchandises prohibées suivies par Cyberdouane sont souvent disponibles sur des sites Internet « cachés », comme nous avons pu le voir lors de notre visite. Mais la lutte contre la vente de marchandises légales qui échappent à l'impôt est totalement oubliée. Le recouvrement de la TVA et des autres taxes ne fait pas partie des priorités de Cyberdouane.
Un autre problème se pose pour faire payer les sites en question : la douane perd sa compétence dès lors qu'un site est hébergé à l'étranger - c'est-à-dire l'immense majorité des cas, y compris les sites en « .fr ».
Nous nous sommes donc demandé si l'enjeu du recouvrement de la TVA - mais aussi de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR) - faisait partie des priorités de la DGFiP, par contraste avec la DGDDI. Cette question n'entre pas dans le champ de notre contrôle, mais compte tenu des enjeux considérables du commerce en ligne, elle mérite d'être posée.
Là encore, nous sommes dubitatifs. Il est ressorti d'un entretien avec le service du contrôle fiscal que seulement 599 « e-commerçants » européens s'étaient déclarés auprès de l'administration fiscale française, sur 550 000 sites recensés en Europe... Normalement, tout site de vente à distance établi dans l'Union européenne et réalisant plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel doit se déclarer auprès de la DGFiP ; mais en pratique, il n'existe aucun moyen de vérifier le respect de cette obligation. Pour savoir si un site dépasse ce seuil, la DGFiP doit s'adresser à l'administration fiscale du pays d'établissement de la société, par exemple la Belgique ou le Luxembourg, dont vous imaginez la bonne volonté...
Le directeur général des finances publiques, Bruno Bézard, avec qui je me suis entretenu avant-hier, est bien conscient des enjeux, mais a confirmé que l'administration manquait de moyens juridiques, que le droit était en retard par rapport à la pratique. J'estime donc que le sujet n'est donc pas la priorité de la DGFiP, qui préfère multiplier les contrôles fiscaux quotidiens sur les contribuables moins « complexes ».

A la suite de ce tableau très mitigé, pour ne pas dire inquiétant, quelles sont les propositions envisageables pour améliorer les choses ? Dans le contexte actuel, il nous paraît pour le moins difficile de proposer une augmentation des effectifs de la DGDDI. Nos propositions portent donc sur la récupération de l'information, qui permettra d'améliorer le recouvrement des prélèvements obligatoires.
Nous proposons donc d'instaurer un droit de communication automatique à l'égard des intermédiaires du commerce en ligne, qui disposent d'informations qui permettront non seulement d'évaluer les montants en jeu, mais aussi de recouper les données en amont, afin de parvenir à un ciblage efficace. Les intermédiaires concernés par cette obligation de transmission d'informations sont les opérateurs de fret bien sûr, mais aussi les fournisseurs d'accès à Internet, les sites de paiement dont le plus connu est PayPal etc.
Une autre idée, peut-être un peu compliquée à mettre en oeuvre, mérite tout de même réflexion : pourquoi ne pas collecter la TVA au moment même où se fait la transaction en ligne entre l'acheteur et le vendeur ? Par définition, les banques et les sites de paiement disposent de ces informations : pourquoi dès lors ne prélever d'un côté le montant de l'achat, et de l'autre côté les taxes afférentes ? D'un point de vue technique, cela imposerait la mise en place - relativement compliquée - d'un système informatique impliquant les banques et les intermédiaires de paiement, mais ce n'est pas impossible. Cette voie permettrait de récupérer une partie significative des droits qui sont dus, et devrait être explorée.
Nous proposons ensuite de lever les exemptions dont bénéficient le fret postal et les « envois de valeur négligeable » inférieurs à 22 euros en fret express. Une réflexion doit être engagée tant sur les obligations déclaratives que sur la pertinence de ces franchises. Naturellement se pose ensuite la question du respect de ces règles dans la pratique.
Nous proposons également d'élargir et de sécuriser le dispositif des « coups d'achats », qui autorise les agents des douanes à acheter anonymement des produits illicites, afin de pouvoir remonter jusqu'aux vendeurs.
La dernière proposition consiste à renforcer les systèmes informatiques et à redéployer les effectifs - dans la mesure du possible bien sûr. Mais une chose est certaine : ce ne sont pas des moyens humains supplémentaires qui permettront de progresser, mais des dispositifs juridiques permettant de récupérer les informations pertinentes auprès des intermédiaires. Ainsi pourrons-nous récupérer les quelques milliards d'euros - je ne donne pas de chiffre - qui échappent à ce jour à l'impôt.

Une petite précision : la DGDDI a redressé, en 2012, 294 millions d'euros sur 68 milliards d'euros collectés, soit une proportion de 0,4 %. Par comparaison, la DGFiP a redressé 18 milliards d'euros sur environ 450 milliards de recettes fiscales, soit une proportion de 4 %...
Je partage ce que vient de dire Philippe Dallier : les flux de marchandises sont tellement importants qu'il est illusoire d'espérer tous les contrôler ; il faut se concentrer sur les flux financiers. En effet, tout achat en ligne donne lieu à un paiement, presque toujours par un compte PayPal ou par carte bancaire.
Nous pourrions aussi évoquer le monde des plateformes de mise en relation entre vendeurs et acheteurs : eBay, Leboncoin, voire même Facebook où de plus en plus de commerce a lieu. De plus en plus de professionnels ou de quasi-professionnels interviennent sur ces sites, où ils échappent largement aux services fiscaux et douaniers. C'est la réalité aujourd'hui.

Ce contrôle est exemplaire, par ses méthodes, par son caractère concret, et bien entendu par le choix du sujet - qui est majeur et ne cessera de grossir davantage. En matière de douane « classique », il existe des dispositifs permettant de s'assurer de la rectitude des déclarations et de l'exactitude des valeurs. Ces dispositifs reposent sur des tiers de confiance, les commissionnaires agréés, qui agissent comme les représentants fiscaux en douane et prennent la responsabilité des valeurs déclarées. Sans doute ce système a-t-il éclaté à la fois du fait des règles européennes - qui prouvent une nouvelle fois leur fréquente nocivité - et du fait du développement du commerce électronique. L'objectif ne devrait-il pas être de retrouver cette catégorie de tiers de confiance agissant comme déclarants auprès de l'administration ?
La proposition consistant à liquider la TVA au moment de la transaction réalisée par le client au moment de l'achat est une bonne approche. Il en est de même pour le projet de doter la douane de nouveaux outils juridiques, et notamment la levée des exonérations dont bénéficient les envois de faible valeur déclarée, qui constituent une formidable opportunité de fraude. Tout ce travail pourrait-il être repris sous forme de propositions législatives et réglementaires, le cas échéant en coopération avec la DGDDI ? Pourrait-il aussi faire l'objet d'une présentation publique ?

La répartition des dossiers pris en charge depuis 2010 par Cyberdouane qui nous a été présentée est-elle différente de la répartition en matière de commerce traditionnel ? Je pense notamment à la question des stupéfiants et anabolisants : y a-t-il une spécificité du commerce en ligne ?

Concernant la question du rapporteur général, la logique de la cellule Cyberdouane n'est pas la même que celle du contrôle des marchandises : d'un côté, il s'agit de mener des enquêtes sur les trafiquants, de l'autre, il s'agit d'examiner des envois. Nous avons pu observer le travail de Cyberdouane dans le cas d'un trafiquant proposant de livrer des stupéfiants commandés par Internet : il s'agit d'abord de déterminer qui se cache derrière les adresses IP masquées sur Internet, pour remonter ensuite jusqu'à la personne physique, avec son adresse réelle. C'est un travail qui est très long, sans comparaison avec ce qui est fait à Roissy.
Concernant la question du président, il y a effectivement une rupture avec le fret cargo classique, où les marchandises étaient connues, puis stockées dans des entrepôts en France que l'on pouvait visiter. L'essor du fret express et l'utilisation du fret postal par la vente en ligne ont complètement changé la donne, et l'administration ne s'est pas vraiment adaptée. Les contrôles physiques tels que réalisés auparavant sont devenus impossibles. Il faut donc changer d'approche.

Il faut distinguer la Poste du fret express. Pour la Poste, il n'y a pas vraiment de commissionnaire en douane : les obligations déclaratives pèsent directement sur l'expéditeur, et sont sous sa responsabilité. En fret express, on privilégie la rapidité, car l'acheteur sur Internet veut recevoir ses colis tout de suite : il est donc hors de question, comme en fret classique, de retenir les marchandises en douane. C'est un enjeu de compétitivité pour les plateformes de fret express. A cela s'ajoute le cas des marchandises en transit pour seulement quelques heures. De plus, à la différence des opérateurs cargo classiques, les expressistes disposent de très peu d'informations, et n'ont pas le numéro de nomenclature de la marchandise : pour vérifier ce que l'on entend par « chargeur de téléphone », il faudrait ouvrir tous les envois... Aujourd'hui, la fluidité et la rapidité l'emportent sur la précision des informations. Les douaniers sont donc condamnés au contrôle physique au cas par cas, c'est-à-dire à un travail long, ingrat et demandant des moyens humains considérables.

Il y a en fait deux sujets : l'importation d'une part, et la question des droits indirects d'autre part. En matière d'importation, la TVA est due à l'entrée sur le territoire français, et pas avant : le paiement de la TVA au moment de la transaction implique des changements normatifs à l'échelle de l'Union européenne. Par ailleurs, le cas est différent selon que l'importation est le fait d'un particulier ou d'une entreprise. Le chemin va donc être long.
Par ailleurs, il est important de respecter la liberté individuelle et d'éviter le matraquage fiscal : la suppression des exemptions aura de lourdes répercussions pour les particuliers qui, de bonne foi, achètent en ligne. Il faut être très prudent sur ce sujet. Je suis donc plutôt favorable à l'idée précédente, consistant à changer le moment où l'on paye les taxes sur les produits importés. Un système comparable existe pour les droits indirects, notamment pour l'alcool. Cela dit, d'un point de vue juridique, le problème est complexe : comment pourrait-on obliger un particulier à payer au moment où il achète, là où une entreprise importatrice n'aurait à payer qu'au moment du dédouanement ? D'autant que ce projet requiert la mise en place d'un système informatique mondial assez lourd.
Il ne faut pas l'oublier qu'une fois les entrepôts franchis, la douane dispose d'un droit de suite très étendu, qu'elle peut exercer sur tout le territoire : le sujet pourrait aussi être traité par là.

Deux observations sur la TVA. D'abord, l'article 42 du code des douanes : ce régime permet de payer la TVA non pas dans le pays d'arrivée sur le territoire de l'Union européenne, mais dans le pays de consommation - et comme par hasard, il y a beaucoup d'évaporation entre temps. On estime les pertes de recettes de TVA liées à ce « régime 42 » à 2 milliards d'euros. L'autre question est la suivante : est-ce normal que ce soit la douane, et pas l'administration fiscale, qui s'occupe de la TVA ?

On peut aussi se demander si ces deux administrations ont vocation à rester éternellement deux directions générales différentes...

Le 20 novembre prochain sera discutée une proposition de loi que nous avons déposée pour combattre un certain nombre des dérives que vous avez pointées, en particulier en donnant des pouvoirs additionnels forts aux douanes : les « coups d'achat » que vous mentionnez, l'infiltration etc. Il s'agit aussi de revenir sur le grand scandale de l'arrêt « Nokia » de la Cour de justice de l'Union européenne, qui interdit aux douanes de pouvoir saisir des marchandises en transbordement, même en sachant que le container est plein de marchandises contrefaites. Il faut combattre cet arrêt pervers qui fera l'objet de différentes propositions.

Je suis scandalisé que ces dernières années, les administrations de l'Etat ne se soient pas mobilisées sur ce sujet, à l'échelle nationale comme européenne. Heureusement que le Sénat est là !

Les « aviseurs » peuvent-ils aider l'administration des douanes en matière de commerce en ligne ?

L'enjeu est considérable... et n'est pas une priorité. Que faire pour résoudre cette antinomie ? Concernant les effectifs, si on ne peut pas les redéployer à la base, peut-être peut-on les redéployer au sommet, afin d'identifier les nouvelles priorités ? Par ailleurs, que fait-on dans les pays voisins, qui font face aux mêmes problématiques ?

Je suis assez surpris par les obligations différenciées en matière d'exemptions qui pèsent sur la Poste et sur les opérateurs de fret express, dans la mesure où la Poste peut concurrencer ces derniers.

Une fois encore, il serait particulièrement utile que le rapport soit conclu par des propositions d'amélioration du droit, de niveau réglementaire ou de niveau législatif.

Jean Germain évoque un problème de liberté et de matraquage fiscal, mais il faut bien avoir conscience que la base fiscale est en train de s'évaporer à toute vitesse.

Chacun comprend que, pour contrôler, il faille réduire la liberté. Le contrôle est indispensable à l'intérêt général.

Bien sûr, il ne s'agit pas de créer un Big brother au niveau mondial permettant de prélever la TVA en chaque point de la planète. Les sujet sont divers : échanges communautaires et extracommunautaires, échanges B2B (entre deux entreprises) et surtout B2C (d'une entreprise vers un particulier qui achète sur Internet). Je pense pour ma part que le prélèvement des droits au moment où le client paie son achat est le meilleur moyen d'éviter l'évaporation fiscale, sans dépendre du moment où le colis arrive sur le sol français.

Un client qui achète sur un site de e-commerce français - par exemple La Redoute - va payer la TVA à 19,6 % au moment de la transaction. Au nom de quoi un client achetant sur un site étranger échapperait-il à ce paiement ? Il y a là un problème d'équité ! La question n'est pas celle du matraquage fiscal, mais du recouvrement de droits et taxes qui sont dus.

Nous sommes évidemment d'accord : c'est une matière extrêmement complexe, qui malheureusement ne relève pas de la simple loi française. Nous ne suggérons que des pistes à explorer, dont nous ne négligeons pas les difficultés. Mais si nous ne faisons rien, la base fiscale s'évaporera. Et cela pose un problème d'équité entre commerçants classiques installés en France qui payent toutes taxes comprises, et exportateurs soumis à l'étranger qui y échappent et payent hors taxe.
La question du régime de l'article 42 du code des douanes soulevée par Richard Yung s'applique plutôt au fret classique.
L'arrêt « Nokia » ne concerne pas non plus directement notre sujet ; il interdit de saisir des marchandises contrefaites ou prohibées dès lors qu'elles ne font que transiter en France, par exemple en provenance de Chine et à destination de l'Italie. Cet arrêt a eu pour conséquence de diminuer de moitié en un an les saisies de contrefaçons. Richard Yung semble suggérer que des voies juridiques peuvent être explorées - mais je vois mal comment une loi française pourrait contrevenir à un arrêt de la CJUE.
Les « aviseurs » des douanes ne servent strictement à rien en matière de fraude sur Internet : il y a une telle multitude de sites qui se créent à chaque instant et dont les montages impliquent tellement de pays et tellement d'intervenants que, dans la pratique, les moyens traditionnellement utilisés pour lutter contre les trafics organisés ne servent à rien.

Pour répondre à la question d'Éric Doligé au sujet des comparaisons avec d'autres pays : nous ne nous sommes pas rendus sur place, mais on nous a dit que nous étions parmi les plus avancés - ce qui ne nous rassure pas sur l'efficacité de nos partenaires européens !

En réponse à la question de Jean-Paul Emorine, il faut distinguer la Poste dans ses activités classiques de fret postal, qui impliquent une multitude de petits paquets dont les bordereaux sont remplis sous la responsabilité de l'expéditeur, et la Poste dans ses activités de fret express - c'est-à-dire Chronopost.

Le sujet est suffisamment intéressant pour ne pas en rester là. Il faut poursuivre le travail avec ténacité, et formuler des propositions de nature à faire évoluer le droit. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde : faire progresser l'intérêt général suppose quelques atteintes, notamment aux libertés de communication, de transaction et du commerce.
La commission donne acte de leur communication à Albéric de Montgolfier et Philippe Dallier, rapporteurs spéciaux, et en autorise la publication sous la forme d'un rapport d'information.
Puis la commission entend une communication de M. Éric Bocquet, rapporteur spécial, sur l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE).

L'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) est une aide réservée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), financée par la mission « Solidarité, insertion, égalité des chances » via le fonds national des solidarités actives. Elle est conçue comme un « coup de pouce » adapté au besoin individuel du bénéficiaire, pour lever des obstacles, en termes de mobilité, d'habillement, de garde d'enfants, à la reprise d'activité des bénéficiaires du RSA.
J'ai souhaité réaliser ce contrôle budgétaire pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la ligne budgétaire de l'APRE a connu des évolutions importantes et peu documentées ces dernières années : elle est ainsi passée de 120 millions d'euros en 2010, 85 en 2011, 50 en 2012, puis 15 millions d'euros en 2013, et repasse à 35 millions dans le projet de loi de finances pour 2014.
De plus, il a toujours été difficile d'obtenir des informations précises sur l'utilisation des crédits : quel est le montant exactement consommé ? Quelle est la part des aides à la mobilité, des aides à la garde d'enfant, etc. ? Quel est, surtout, l'impact réel de ces aides sur le retour à l'emploi des bénéficiaires du RSA ?
Enfin, le Gouvernement réfléchit actuellement à une évolution du RSA « activité » et de l'APRE, qui souffre tous deux, en apparence, des mêmes maux, notamment la difficulté à trouver son public.
J'ai donc décidé de réaliser ce travail de contrôle budgétaire, en menant des auditions à Paris, et en faisant deux déplacements, l'un dans le Pas de Calais, l'autre dans les Hauts de Seine - deux départements aux caractéristiques très différentes.
Au terme de ce travail, je ferai trois principaux constats avant de passer à l'exposé de mes différentes propositions d'évolutions.
S'agissant des constats, l'APRE est une aide essentielle à l'esprit du RSA, très hétérogène, et mal pilotée.
Premier constat : l'APRE est un vrai atout pour la reprise d'emploi des bénéficiaires du RSA. Elle permet de financer des actions qu'aucune aide de droit commun ne prend en charge, qu'il s'agisse du financement des permis de conduire, de la réparation d'une voiture ou encore des vêtements ou de l'équipement matériel pour un nouvel emploi. En 2012, l'APRE a bénéficié à plus de 105 000 personnes, pour un montant moyen de 665 euros. L'APRE est même essentielle à l'esprit du RSA : une des personnes que j'ai entendues sur le terrain a ainsi souligné que « sans l'APRE, le RSA redevient le RMI ».
Cependant, l'APRE souffre d'une lacune dans sa définition même : seuls les bénéficiaires qui ont effectivement retrouvé un emploi peuvent la percevoir. Autrement dit, le « coup de pouce » est toujours a posteriori ; il favorise le maintien dans l'emploi plus qu'il n'impulse directement une reprise d'activité.
Deuxième constat : l'APRE est un dispositif déconcentré très hétérogène. Les préfets ont été libres de définir, en concertation avec les acteurs locaux, les modalités de gestion et de distribution de l'APRE, mais aussi les conditions d'emploi de l'aide. Ainsi, non seulement les responsables ne sont pas les mêmes - il y a plus de 140 gestionnaires à l'échelle nationale -, mais l'APRE est, selon les départements, parfois autorisée, parfois interdite pour la même action, ce qui est notamment le cas des permis de conduire, des frais de formation, ou encore des frais en vue d'un entretien d'embauche.
Troisième constat : l'APRE n'a pas été suffisamment pilotée à l'échelle nationale. C'est le cas du point de vue juridique, les circulaires étant très incomplètes sur les conditions d'emploi. C'est le cas du point de vue financier, les enveloppes annuelles confiées aux départements n'étant notifiées qu'au mois de mai, voire au mois de juin : les gestionnaires départementaux sont ainsi laissés dans l'incertitude sur le montant dont ils disposent pour l'exercice en cours, voire sur la reconduction même du dispositif ! Cela explique en grande partie la sous-consommation des crédits dans les années 2010-2011 ; aujourd'hui, la consommation s'est stabilisée autour de 75 millions d'euros par an, en combinant les dotations annuelles en baisse et les reliquats des exercices précédents.
J'en viens à mes principales propositions.
Je souhaite tout d'abord que soit maintenue l'APRE à l'occasion de la prochaine réforme du RSA et que son enveloppe soit stabilisée au niveau de la consommation actuelle, soit 75 millions d'euros. Il faut cesser d'envoyer aux gestionnaires départementaux des signaux contradictoires qui pénalisent grandement l'efficacité et la régularité de la distribution de l'aide.
Je propose également d'en évaluer de façon scientifique l'impact sur le retour à l'emploi : aujourd'hui, il est impossible de savoir quelle est la proportion des bénéficiaires de l'APRE qui ont retrouvé le chemin de l'emploi au bout de trois mois, six mois ou neuf mois ! Je pense qu'il y aurait pourtant, dans les résultats d'une telle enquête, matière à légitimer définitivement cette prestation.
Je propose par ailleurs de rationnaliser l'architecture globale de l'APRE, en confiant sa gestion à un seul organisme, prioritairement le conseil général, dans chaque département. L'aide devrait rester une aide d'Etat, financée par le budget général, et avec des conditions d'emploi définis par le préfet : j'y insiste, il ne s'agit pas de transférer une charge aux départements ; d'ailleurs, dans certains zones, d'autres gestionnaires, comme Pôle Emploi ou la caisse d'allocations familiales par exemple, pourraient être choisis. Mais il n'est plus possible d'avoir, dans certains départements, trois, quatre et jusqu'à plus de dix gestionnaires pour des enveloppes de quelques millions d'euros. Cet émiettement nuit à la visibilité sur la consommation de l'APRE ; la remontée d'information, aujourd'hui, est difficile et lente, ce qui explique en grande partie les notifications tardives des enveloppes départementales. Il faut briser ce cercle vicieux, qui s'est installé dès la première année du dispositif, où la complexité de l'architecture locale entraîne des lenteurs de mise en place et de remontée d'informations, qui entraînent à leur tour des retards de notification et des baisses de dotations, conduisant, in fine, à une frilosité des référents sociaux chargés, sur le terrain, de prescrire l'APRE aux bénéficiaires.
Dans le même sens, je préconise que l'Etat signe des conventions pluriannuelles avec ces nouveaux gestionnaires départementaux uniques, qui leur donnent une visibilité sur les enveloppes annuelles dont ils disposent à échéance de deux ou trois ans.
Par ailleurs, il convient de limiter les disparités sans pour autant supprimer toute marge de manoeuvre locale. C'est pourquoi je préconise que le Gouvernement publie une nouvelle circulaire qui, sans imposer une doctrine d'emploi unique et tout en permettant des exceptions justifiées, établisse clairement des « lignes rouges ». Une telle démarche permettra à mon sens, paradoxalement, d'élargir le champ de l'APRE, car j'ai constaté qu'il y avait sur le terrain une forme d'autocensure : certains départements n'autorisent pas certaines actions (par exemple le financement de permis de conduire) car ils craignent qu'elles soient implicitement prohibées par les règles nationales.
La circulaire devrait également ouvrir, sous certaines conditions, notamment la précarité du demandeur et la pertinence du parcours d'insertion, le bénéfice de l'APRE avant même la reprise d'activité effective, dans le cas d'un entretien d'embauche notamment. Cela arrive en pratique dans certains départements, mais mériterait d'être généralisé pour répondre à cette faiblesse structurelle de l'APRE que j'évoquais précédemment.
Cette même circulaire devra enfin fixer un « plafond » maximal pour chaque type d'aide. Aujourd'hui, les plafonds d'aide peuvent aller de 400 à 4 000 euros pour les aides au permis de conduire par exemple : une telle différence de traitement ne me semble pas justifiée, même par des contextes locaux différents.
Enfin, je préconise d'élargir le public pouvant bénéficier de l'APRE. Aujourd'hui, seuls les bénéficiaires du RSA peuvent en bénéficier. Or, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), sont dans une situation de précarité similaire et nombre de référents, sur le terrain, soulignent qu'il est difficile de leur expliquer qu'ils ne peuvent bénéficier de l'APRE pour une simple raison de statut. Cet élargissement est important en affichage, puisque 430 000 personnes bénéficient aujourd'hui de l'ASS mais, en réalité, il s'agit surtout d'entériner une pratique déjà très répandue sur le territoire. Pour s'en assurer, une expérimentation pourrait éventuellement être conduite dans certains départements au préalable.
Au total, au cours des auditions, j'ai compris que l'existence même de l'APRE était remise en cause, en particulier par le ministère du budget. Je crois, quant à moi, qu'on n'a pas encore vraiment donné sa chance au dispositif, dont chaque intervenant s'accorde pourtant à dire qu'il est utile au-delà de ses difficultés : non seulement parce qu'on a laissé les acteurs locaux dans une incertitude juridique coupable, mais aussi parce qu'on a réduit les dotations au moment même où les architectures locales se stabilisaient. Il faut donc rationnaliser le dispositif sans perdre son originalité, qui repose sur son adaptation au besoin du bénéficiaire et aux contextes locaux.

Merci pour cette présentation. En pratique, dans un département donné, qui est en charge de distribuer cette aide ? Quel est le circuit administratif ? Est-ce à la charge de Pôle emploi ?

C'est Pôle emploi en partie. Dans le Pas-de-Calais où nous nous sommes rendus, c'est également à la charge des associations gestionnaires des plans locaux pour l'insertion et pour l'emploi (PLIE). Il y a également, très souvent, les référents sociaux des conseils généraux.

Je vous remercie pour cette présentation claire sur cette aide et son historique - nous avons tous nous-mêmes été saisis de doléances s'agissant des inquiétudes sur la reconduction de ces dispositifs. Je suis d'accord avec Éric Bocquet quant à l'objectif de rationalisation : il y avait trop d'acteurs. Je crois également que la gestion unique par le conseil général est une bonne idée, au vu de la spécialisation du département en matière sociale. Serait-ce bien reçu par les départements, ainsi que par les gestionnaires actuels de l'aide ?

Je partage les conclusions de notre rapporteur spécial. Dans le département du Vaucluse, où le conseil général a reçu une complète délégation de gestion, le dispositif fonctionne très bien et a une vraie utilité pour les bénéficiaires, qu'il s'agisse de la mobilité ou de la formation ; nous travaillons en commun avec les services de l'Etat et de Pôle emploi pour définir les conditions d'utilisation. Reste le sujet que vous avez soulevé, à savoir la disparité des conditions d'emploi entre les départements. Il serait bon, en effet, d'uniformiser dans une certaine mesure les cas dans lesquels les bénéficiaires peuvent solliciter l'APRE. Je souligne que le coût d'une délégation de gestion au conseil général est nul pour les départements, puisque l'APRE est prescrite par les personnels qui sont déjà référents sociaux des bénéficiaires du RSA.

Je reprends à mon compte la question du rapporteur général. L'APRE est aujourd'hui très hétérogène. Quel est l'avis de l'assemblée des départements de France (ADF) ? Il ne faudrait pas donner à tous les départements une charge dont ils ne veulent pas nécessairement ! Par ailleurs, s'agissant des permis de conduire, il serait bon de clarifier les interventions respectives des différents acteurs, la région du Centre, par exemple, développant sa propre offre d'aides aux permis.

Je crois que l'intervention de Claude Haut répond en partie aux interrogations. Nous n'avons pas consulté officiellement l'ADF, mais celle-ci s'est exprimée par ailleurs. Je partage évidemment l'inquiétude sur les transferts de charge, dont nous savons dans quelles conditions ils sont compensés : ce n'est donc pas de cela qu'il s'agit. En revanche, l'ADF serait favorable à une délégation de gestion de l'APRE ; d'ailleurs, les conseils généraux sont déjà gestionnaires, de fait, dans beaucoup de départements. Le département me semble être véritablement l'échelon pertinent.
Pour répondre à l'interrogation d'Éric Doligé, je rappelle que l'APRE est une aide subsidiaire, elle n'a donc pas vocation à remplacer ou chevaucher, mais seulement à compléter, les aides existantes à l'échelle locale.
La commission donne acte de sa communication à Éric Bocquet, rapporteur spécial, et en autorise la publication sous la forme de rapport d'information.
Communication de mm. philippe marini et marc massion dans le cadre de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'union européenne prévue à l'article 13 du tscg
Communication de mm. philippe marini et marc massion dans le cadre de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'union européenne prévue à l'article 13 du tscg
La commission entend ensuite une communication de MM. Philippe Marini et Marc Massion dans le cadre de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne, prévue à l'article 13 du TSCG.

Je me suis rendu en Lituanie la semaine dernière, accompagné de notre collègue Marc Massion, pour y représenter le Sénat, à l'occasion de la première Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne (UE). Cette Conférence s'est en effet tenue les 16 et 17 octobre 2013 à Vilnius. Je précise que l'Assemblée nationale y était représentée également, avec nos collègues députés Christophe Caresche, chef de délégation, mais aussi Chantal Guittet, Bernard Deflesselles et Jérôme Lambert. Nous avons également profité de ce déplacement pour conduire quelques entretiens bilatéraux, dont Marc Massion va vous rendre compte tout de suite. Je dresserai ensuite le bilan de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE.

Ce déplacement a été particulièrement instructif, même si son résultat peut paraître en-deçà de nos attentes. Puisqu'il revient au Président de vous rendre compte de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE, mon exposé portera sur la Lituanie plus généralement. Nous avons en effet lors du déplacement mené quelques entretiens bilatéraux en rencontrant Rimantas Sadzius, ministre des finances de la République de Lituanie, Vitas Vasiliauskas, Gouverneur de la Banque centrale de Lituanie, et Maryse Berniau, Ambassadeur de France.
Suite à une chute de 14,7 % de son PIB en 2009, l'une des plus fortes contractions observées en Europe, la Lituanie est parvenue à renouer avec la croissance en enregistrant un chiffre positif dès 2010 : 1,3 %, puis 5,9 % en 2011 et 3,6 % en 2012.
Le contexte politique est marqué par la présidence lituanienne de l'UE au second semestre 2013. Il m'est d'ailleurs apparu que la Lituanie est fortement impliquée dans le cadre communautaire : sa présidente de la République, Dalia Grybauskaite est ancienne commissaire européenne et l'actuel commissaire européen lituanien en charge de la fiscalité et de l'union douanière, de l'audit et la lutte antifraude, Algirdas emeta, est de même une personnalité très reconnue. La Lituanie a donc plutôt des positions favorables à l'Union européenne et le fait qu'elle soit première bénéficiaire net du budget communautaire n'y est sans doute pas étranger. Outre certains grands dossiers, comme la consolidation des finances publiques, la gouvernance économique et budgétaire, la stabilité financière, ou la relance de la croissance, la présidence lituanienne met l'accent sur l'énergie, le partenariat oriental, la stratégie pour la mer Baltique et la sécurité des frontières extérieures.
Il nous a été expliqué que le pays devrait rejoindre la zone euro au 1er janvier 2015 : après la levée en mai 2013 de la procédure de déficit public excessif à l'encontre de la Lituanie, l'évolution des prix et la situation des finances publiques, avec un déficit public 2013 ramené sous les 3 % du PIB et une dette inférieure à 40 % du PIB, lui donnent en effet de bonnes chances de respecter les critères de convergence en 2014, y compris en matière de taux d'inflation. La monnaie locale, le litas, est indexé à l'euro depuis 2002, avec une logique de currency peg, c'est-à-dire de variation automatique des taux d'intérêts pour maintenir le cours du litas.
Pour ce qui concerne l'union bancaire et la résolution des crises bancaires, le ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque centrale de Lituanie nous ont fait part de leur forte mobilisation sur ce dossier. Par ailleurs, il nous a été assuré que l'assainissement du secteur financier se poursuivait, grâce à la mise en oeuvre du renforcement des pouvoirs de supervision de la banque centrale. Au total, la rentabilité du secteur bancaire, à capitaux scandinaves pour l'essentiel, pâtit de la faiblesse des taux d'intérêt, mais sa solvabilité et sa liquidité ne soulèvent pas d'inquiétudes.
En conclusion, je souhaite faire écho aux propos que tenait le rapporteur général la semaine dernière concernant la Lettonie : la Lituanie semble tout comme la Lettonie prête à aller de l'avant dans l'intégration de la zone euro. Il est utile que nous renforcions nos liens avec ces pays qui participeront avec nous, demain, aux décisions qui engageront l'ensemble de la zone euro.

Je remercie Marc Massion de cette présentation de nos entretiens bilatéraux. Le rendez-vous avec Rimantas Sadzius, ministre des finances de la République de Lituanie, a été particulièrement intéressant : il préside les conseils ECOFIN et, à ce titre, il a également pu évoquer les derniers développements en matière d'union bancaire et les obstacles rencontrés à ce sujet.
J'en arrive maintenant au bilan de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE. Il s'agit du premier exercice d'application de l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), qui dispose que « le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité ». Il paraît en effet nécessaire d'appuyer la nouvelle gouvernance économique et budgétaire européenne sur un fondement démocratique solide, dont les parlements nationaux sont les garants. À cet égard, la naissance à Vilnius de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne va dans le bon sens. Toutefois, en dépit de la forte implication de la présidence lituanienne qui a été exemplaire par la qualité de son travail, les ambitions de cette conférence ont été loin de se réaliser. Le titre donné hier par un journaliste spécialisé à un article consacré à cette conférence est parlant : « Tension palpable entre Parlements nationaux et européen ». Le 8 octobre dernier, soit une dizaine de jours avant l'ouverture de la conférence, le président du Parlement européen, Martin Schulz, a adressé un courrier à la présidente du Parlement lituanien dans lequel il a exprimé les fortes divergences de vues entre les parlementaires européens et les propositions de la présidence lituanienne. Il ne s'agissait que d'une demi-surprise puisque la position du Parlement européen était connue depuis plusieurs mois : en novembre 2012, il a ainsi adopté une résolution, suite au rapport rédigé par la députée européenne Marianne Thyssen, dans laquelle il est indiqué que « la création d'un nouvel organe parlementaire mixte serait tout à la fois inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel ». La résolution insiste ensuite « sur la pleine légitimité du Parlement européen, en tant qu'organe parlementaire au niveau de l'Union, en vue d'une gouvernance renforcée et démocratique de l'UEM ». J'indique que ce dernier dispose d'un cadre général communautaire mais aussi de mesures à prendre au niveau national, ce qui justifie l'article 13 du TSCG et l'association des Parlements nationaux.
Je note qu'à l'inverse, un rapport de la commission des affaires européennes de la Chambre des Lords sur la crise de la zone euro a souligné en août 2013 que l'objet principal du TSCG concerne les budgets nationaux, dont les gouvernements nationaux sont responsables vis-à-vis de leurs parlements nationaux. Ce rapport de nos collègues britanniques poursuivait donc en s'interrogeant sur la place incertaine du Parlement européen : puisque le traité budgétaire se situe en dehors des traités de l'UE, pourquoi le Parlement européen se joindrait-il aux parlements nationaux pour déterminer l'organisation de la conférence ? Avec quel rôle et quelle légitimité ?
C'est sous le signe de ces contradictions et de ces ambiguïtés que s'est ouverte la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE. Une telle situation a conduit, la semaine dernière à Vilnius, à une incapacité à adopter de façon consensuelle un ordre du jour, des « conclusions de la conférence » et, encore moins, un règlement de la conférence. Les rules of procedures proposées par nos collègues lituaniens représentaient une véritable avancée, avec par exemple une organisation pratique, des règles de préparation et d'adoption d'un ordre du jour, ou encore une symétrie entre l'anglais et le français parmi les langues de travail utilisées. Au final, seule une contribution, relativement modeste, de la conférence a été adoptée « aux forceps ». Le Parlement européen a été rejoint par la délégation allemande, dont les positions ne s'expliquent pas tant par la question des prérogatives du Parlement européen que par celle du respect de son ordre constitutionnel interne. En dépit du volontarisme de la présidence lituanienne, le texte a été mis au point entre les délégations du Parlement européen et de l'Allemagne. Les délégations nationales, notamment la France et la Grande-Bretagne, ont été traitées de façon périphérique.
Pour nous, l'enjeu de cette conférence est de passer d'un lieu aimable de bavardage entre gens de bonne compagnie à une association efficace des parlements nationaux à la gouvernance économique et financière de l'Union européenne, et plus particulièrement à l'Union économique et monétaire. C'est la position que j'ai pour ma part défendue, avec mes collègues de la délégation française, quelle que soit leur appartenance politique. Une unanimité s'est en effet dégagée sur place entre parlementaires de la majorité et de l'opposition.
Le texte de compromis, sous la forme d'une contribution de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE, présente l'inconvénient de repousser l'adoption d'un règlement de la conférence d'au moins d'un semestre, mais il présente aussi des avantages : il consacre l'existence de la conférence, est relativement consensuel et, enfin, suggère la constitution d'un groupe de travail, qui devra « prendre en considération le projet de règlement proposé par la présidence lituanienne » ainsi que « les amendements des délégations nationales ». On parlera donc désormais d'un « processus de Vilnius ». A ce stade je pense que cette conférence pourra être utile. A titre personnel, j'ai toujours été favorable à la constitution d'un Sénat européen. Or cette conférence interparlementaire peut aller dans ce sens. Nous avons demandé à participer à ce groupe de travail, puisque le futur de cette conférence dépend de ce que l'on décide collectivement d'en faire. Nous suivrons donc les prochaines étapes avec vigilance, mais, pour ma part, je ne donnerai pas indéfiniment crédit à ce type de rencontre, si ses règles du jeu ne sont pas suffisamment précisées.

Je suis sensible au compte-rendu de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE, notamment en ce qui concerne la complexité des relations avec le Parlement européen. Cependant, on a tout fait pour que les choses soient ainsi : les différents traités européens lui ont donné progressivement de plus en plus de pouvoir. Le résultat est qu'il ne comprend pas pourquoi il ne décide pas seul avec la Commission européenne et le Conseil. Pour lui, les conférences interparlementaires n'ont pas de sens. S'agissant de la position de l'Allemagne, dans la mesure où les Allemands tiennent le Parlement européen, elle est favorable à ce dernier. En outre, nos parlementaires européens exercent souvent des mandats courts, alors que nos amis germaniques y restent de manière générale quinze ou vingt ans et contrôlent le secrétariat général et la plupart des structures intermédiaires. Nous faisons figure de parent pauvre dans cette institution. Au total, quel sens l'organisation d'une conférence interparlementaire peut-elle revêtir alors que d'importants pouvoirs ont été dévolus au Parlement européen ?

Ce type de conférence interparlementaire constitue pour moi un alibi démocratique. L'article 13 du TSCG va dans le bon sens, mais la zone euro doit être distinguée du reste de l'Union européenne. La spécificité de la zone euro doit être reconnue. Il s'agit d'un point essentiel que le Parlement européen refuse. Nous gagnerions à nous rapprocher de l'Allemagne pour définir ensemble les conditions d'application de l'article 13. Pour ma part, je plaide pour faire de cette Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE un conseil de surveillance de la zone euro, composé de représentants du Parlement européen et des Parlements nationaux.

Le sujet est extrêmement important. Il faut être conscient que l'Europe n'est pas aujourd'hui un Etat fédéral et que rien ne nous oblige à en rester au traité de Lisbonne. A cet égard, la conférence interparlementaire est tout à fait nécessaire, surtout qu'il n'existe pas de budget communautaire en tant que tel, mais uniquement des contributions nationales. Le Parlement européen s'est sans doute cabré un peu trop vite. Toutefois, il nous revient de nous organiser, en particulier face à l'Allemagne. Je suis convaincu que les élections européennes de 2014 montreront l'intérêt de telles rencontres.

Je remercie le président Philippe Marini et Marc Massion de nous avoir représentés lors de cette première réunion de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE. Ce dispositif est appelé à prendre de la vigueur et l'on voit qu'il s'organise même si ses balbutiements peuvent être désespérants. En effet, la crise financière que nous avons traversée a montré que nous étions démunis et que des avancées dans la gouvernance économique et financière de l'Union européenne étaient nécessaires. Faudra-t-il pour autant un Sénat européen ? C'est une question qui peut être posée. Quoi qu'il en soit l'idée qu'il serait illégitime de faire travailler ensemble les parlements nationaux ne peut pas être partagée.
Par ailleurs, je me réjouis que la Lituanie soit aujourd'hui dans de bonnes conditions pour adhérer à la zone euro, y compris au niveau de son opinion publique. J'estime à cet égard que ce type de rencontre permet de consolider l'attachement de ce pays aux valeurs européennes, ainsi que l'imprégnation de la culture européenne auprès de ses élites.
Et je rejoins le président Marini quant à la nécessité pour la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'UE de se doter d'un contenu, d'un règlement et d'une organisation. J'en appelle donc à une grande vigilance pour la suite.

En réponse à la remarque du rapporteur général, j'indique que la Lituanie avait déjà cherché à rejoindre la zone euro en 2007, mais que sa demande n'avait pas abouti en raison de son inflation. Pour ce qui concerne l'opinion publique, il m'est apparu que les dirigeants lituaniens partageaient désormais une certaine unité de vue quant à l'adhésion à la zone euro.
La conférence interparlementaire de l'article 13 du TSCG est importante, elle constitue une innovation. Je n'ai pas le sentiment d'y avoir perdu mon temps. Cela permet de développer des contacts. Pour certains, il s'agit d'un forum de discussions, tandis que pour d'autres, c'est un processus d'institutionnalisation. Quant à moi, j'estime que cette dernière voie est la bonne et qu'elle sera nécessaire pour lutter contre le rejet dans l'opinion des mesures prises demain par l'Union européenne.
En outre, accroître l'implication des Parlements nationaux ne remet pas en cause le pouvoir du Parlement européen. Ce dernier doit travailler dans le cadre des compétences fixées par les traités, duquel sont exclues la surveillance multilatérale et la programmation des budgets nationaux. Je suis convaincu que nos positions auraient recueilli une très large majorité si nous avions procédé à un vote lors de la conférence interparlementaire à Vilnius. La courtoisie de la présidence lituanienne a permis d'éviter les éclats de voix. Quoi qu'il en soit, point n'est besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.
Puis, la commission procède à l'examen du rapport de M. Philippe Dominati, rapporteur spécial, sur la mission « Direction de l'action du Gouvernement » et sur le budget annexe « Publications officielles et information administrative ».

Nous examinons aujourd'hui les crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » et ceux du budget annexe « Publications officielles et information administrative ». Ces deux missions ont en commun, en effet, différents aspects de la politique de communication et d'information du Gouvernement.
Au total, les crédits des deux missions, inscrits dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, s'élèvent à 1,6 milliard d'euros en autorisations d'engagement (AE) et 1,54 milliard d'euros en crédits de paiement (CP). Ils sont répartis à hauteur de 87 % en faveur de l'action du Gouvernement et de 13 % au profit de l'information administrative et de la diffusion publique.
J'évoquerai tout d'abord la mission « Direction de l'action du Gouvernement » qui constitue un ensemble hétérogène regroupant les crédits consacrés aux fonctions stratégiques et d'état-major du Gouvernement, aux moyens des administrations déconcentrées et aux autorités administratives et constitutionnelles indépendantes, une nouvelle autorité ayant été créée cette année.
Mes observations portent sur deux principaux points : la création d'un programme d'investissement d'avenir rattaché à la mission et les variations de périmètre de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».
En 2014 est créé un nouveau programme, intitulé « Transition numérique de l'État et modernisation de l'action publique ». Il s'agit d'un programme d'investissement d'avenir, doté de 150 millions d'euros et dont le responsable est le Secrétaire général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP).
Il s'agit de financer la modernisation de l'action publique grâce à des appels à projets thématiques. Les grandes lignes sont décrites dans les documents budgétaires : ce programme vise à « développer des projets de simplification engagés dans le cadre de la modernisation de l'action publique, à soutenir les projets de rationalisation et de mutualisation des infrastructures informatiques au service de la transition numérique et à soutenir les projets d'expérimentation de technologies et services innovants susceptibles d'accélérer la modernisation de l'État ».
Certes, en 2010, lors du lancement des premiers programmes d'investissement d'avenir, aucune description détaillée de l'utilisation des crédits n'était disponible. Néanmoins, j'ai souhaité en savoir davantage : en particulier, j'ai voulu pouvoir identifier plus concrètement le type de projets susceptibles d'être financés par cette enveloppe.
Selon les informations communiquées, il s'agira tout à la fois de créer des outils pour simplifier les échanges d'informations entre l'État et les entreprises, de mettre en place un « cloud » privatif de l'État, de financer des laboratoires de l'innovation, sortes d'incubateurs internes à l'administration, de garantir la compatibilité des interfaces entre les logiciels utilisés par les différents ministères, de permettre aux utilisateurs (citoyens et entreprises) d'utiliser les données publiques désormais disponibles...
Une convention doit être signée en 2014 entre le SGMAP, le commissariat général à l'investissement et la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière sera chargée du suivi administratif, budgétaire et comptable des projets. La convention précisera la typologie des projets susceptibles d'être retenus, et déterminera les modalités d'appel à projets et de sélection des projets financés.
Le manque d'informations disponibles dans les documents budgétaires me conduit à considérer qu'un suivi attentif de ce programme d'investissement d'avenir est absolument nécessaire.
Par ailleurs, régulièrement, le rapporteur spécial de cette mission se trouve confronté à des modifications de périmètre, au sein même de chaque programme. À ce titre, en 2014, les trois programmes de la mission (hors programme d'investissement d'avenir) sont touchés.
Ces variations de périmètre sont nombreuses mais de relativement faible ampleur en termes de crédits budgétaires et d'emplois. Il s'agit, par exemple, du rattachement au programme « Coordination du travail gouvernemental » de la Délégation interministérielle à l'intelligence économique, du Haut conseil à l'intégration ou du Haut conseil au financement de la protection sociale.
Certes, on peut considérer que ces transferts sont justifiés. En l'occurrence, il s'agit de renforcer les liens entre ces diverses entités pour adopter des perspectives résolument transversales dans l'analyse des politiques publiques.
Mais la comparaison « à périmètre constant » devient difficile au-delà d'une année, et ces fréquentes modifications brouillent notre perception de l'évolution réelle des crédits à moyen terme.
Les modifications du périmètre de la mission concernent des transferts, à une exception près : au sein du programme « Protection des droits et libertés », est créée une nouvelle action correspondant à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dotée de 2,8 millions d'euros de crédits - notamment au titre des dépenses de personnel.
Cette Haute Autorité, créée par la loi ordinaire et la loi organique du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, se substitue à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Cette dernière relevait de la mission « Conseil et contrôle de l'État » et bénéficiait de crédits ouverts au titre des missions du Conseil d'État. En 2013, son budget s'élève à 620 000 euros environ, 80 % des dépenses correspondant à des dépenses de personnel.
Il résulte de la mise en place de cette autorité la création de 20 emplois (au sens d'équivalent temps plein travaillé « ETPT ») et l'inscription des crédits budgétaires afférents. L'augmentation des moyens de cette institution se justifie par l'élargissement de son champ d'application, de ses missions et surtout de la possibilité pour la Haute Autorité de mettre en oeuvre des prérogatives d'investigation.
La Haute Autorité bénéficie donc d'un budget 4,5 fois supérieur à celui de la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Je considère que l'extension du champ de compétences de cette autorité ne justifie pas, dès la première année, une telle augmentation de ses crédits, et c'est pourquoi je vous soumettrai un amendement visant à réduire le budget de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Néanmoins elle pourra débuter son travail - d'autant que sa charge dépendra en grande partie du cycle électoral. Il est difficile d'évaluer, dès sa création, les besoins à 20 ETPT et c'est le sens de l'amendement que je vous proposerai.
Les dotations du programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » représentent 40 % des crédits de la mission. À périmètre constant, elles diminuent de près de 4 % en 2014 par rapport aux crédits inscrits en loi de finances pour 2013, alors qu'au contraire, les deux années précédentes, les crédits du programme 129 avaient augmenté, traduisant la poursuite de la mise en oeuvre d'une politique de renforcement des systèmes d'information incarnée, d'une part, par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), et, d'autre part, par la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État (DISIC). Je vous rappelle qu'un effort important est nécessaire pour notre protection.
En 2014, l'enveloppe des crédits budgétaires diminue malgré la poursuite de la montée en puissance de l'ANSSI et du réseau interministériel de l'État (RIE) : bien que l'effort en faveur de la cybersécurité soit maintenu, les crédits du programme diminuent, grâce à une baisse importante des dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Le programme 333 « Moyens mutualisés des administrations déconcentrées » constitue l'un des volets de la réforme des administrations territoriales de l'État (RéATE), lancée en 2007. Ainsi, il rassemble en une seule enveloppe budgétaire les crédits de fonctionnement des directions départementales interministérielles (DDI), ainsi que les crédits immobiliers d'une partie des services déconcentrés de l'État et, depuis 2013, les crédits de rémunération de certains emplois déconcentrés, dont ceux des directeurs des directions départementales interministérielles (DDI) et des secrétaires généraux pour les affaires régionales (SGAR).
Les crédits du programme 333, qui représentent 40 % de l'ensemble des crédits de paiement de la mission demandés en 2013, enregistrent une légère baisse de 1 % par rapport à 2013. La dotation globale s'élève à 552 millions d'euros en CP. Je prends acte de la poursuite des regroupements immobiliers de services déconcentrés, et des mesures de rationalisation affectant les marchés mutualisés ou le parc automobile.
Les dotations du programme 308 « Protection des droits et libertés » représentent environ 7 % des crédits de paiement de la mission en 2014, soit 94,5 millions d'euros en CP. Ces crédits sont consacrés aux autorités administratives indépendantes et à l'autorité constitutionnelle. Les crédits augmentent globalement de 3 %, soit 2,8 millions d'euros, correspondant à la création de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Néanmoins, une analyse plus détaillée des crédits fait apparaître des différences marquées entre structures. En 2013, seule la Commission nationale pour l'informatique et les libertés (CNIL) avait vu ses crédits augmenter. Au contraire, en 2014, seuls les crédits du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) diminuent, de telle sorte que la baisse des crédits affectés à cette autorité compense la hausse des crédits des autres.
Enfin, j'évoquerai maintenant brièvement le budget annexe des publications officielles et information administrative. La stratégie de la direction de l'information légale et administrative (DILA) demeure celle du service public de l'accès au droit et à l'information administrative, d'éditeur et d'imprimeur public de référence, s'appuyant principalement sur les ressources des annonces légales. Ces dernières représentent en effet plus de 80 % des recettes du budget annexe.
Les recettes du budget annexe sont estimées à 215 millions d'euros. Malgré une politique éditoriale recentrée sur certains publics et thèmes d'avenir, la DILA anticipe une diminution de ses recettes de 17 millions d'euros, en raison du projet de suppression, pour les entreprises de moins de 10 salariés réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 700 000 euros, de l'obligation de dépôts de leurs comptes annuels aux greffes des tribunaux de commerce et de leur publication au bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC).
Aussi, la DILA envisagerait une augmentation des tarifs d'insertion au BODACC (de l'ordre de 2,5 %) mais également une hausse des tarifs relatifs au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP), de 10 %.
Je regrette qu'à une baisse prévisible des recettes réponde une hausse des tarifs : plutôt que d'augmenter les tarifs, la DILA devrait chercher à augmenter les recettes tirées de ses autres activités (ventes d'abonnements, de publications, etc.) en gagnant des parts de marchés dans les secteurs concurrentiels.
S'agissant des dépenses, les crédits s'élèvent à 205 millions d'euros en CP répartis entre le secteur productif « Edition et diffusion » pour 102 millions d'euros et les « activités de développement des publications », de nature plus commerciales, pour 103 millions d'euros.
En 2014, les dépenses du budget annexe diminuent de 7 millions d'euros, soit 3 %, par rapport à l'année précédente. Il s'agit d'un « retour à la normale » par rapport à l'exercice 2013, marqué par une progression substantielle des dépenses d'investissement - liée notamment à l'achat d'une nouvelle rotative pour renforcer les capacités d'impression de la DILA. Ainsi, les dépenses d'investissement sont divisées par deux par rapport à 2013.
Sous réserve de ces observations et de l'adoption de l'amendement diminuant les crédits du programme « Protection des droits et libertés », je vous propose l'adoption des crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».
Sous réserve de ces observations, je vous propose l'adoption, sans modification des crédits de la mission constituée par le budget annexe « Publications officielles et information administrative ».

Votre avis sur le vote des crédits de la mission dépend-t-il du vote de l'amendement que vous proposez ?

Indépendamment du sort de cet amendement, je vous propose l'adoption des crédits de la mission.
Toutes les autorités du programme « Protection des droits et libertés » ont fait des efforts de réduction de leurs dépenses. Or, je rappelle que l'enveloppe prévue pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique correspond au budget de la commission préexistante multiplié par 4,5. Je pense qu'il faudra éventuellement ajuster les crédits, progressivement. Il revient au Parlement de veiller à ce que l'effort de maitrise des dépenses publiques soit raisonnablement partagé.

Je remercie le rapporteur spécial pour cet exposé très clair, qui viendra nourrir mes propres travaux.

L'un des objectifs du programme de coordination du travail gouvernemental est de veiller à la publication, dans les meilleurs délais, des décrets d'application des lois. Je m'étonne que l'indicateur de performance ne soit pas renseigné. L'application de la loi ne semble pas être une priorité du travail gouvernemental.
Par ailleurs, s'agissant du pavillon de la Lanterne qui est affecté à la Présidence de la République, je souhaiterais savoir pour quelles raisons du personnel est mis à disposition par les services du Premier ministre. Par ailleurs, selon la presse, le Premier ministre aurait récupéré le château de Souzi-la-Briche, dans l'Essonne. Or, il y a deux ans, avec notre collègue Philippe Dallier, en tant que rapporteurs spéciaux du compte d'affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l'État », nous avions contribué à en autoriser la vente. Pourrait-on clarifier cette situation ?

Je pense qu'on pourrait vendre ce château qui n'est pas utilisé...
La droite comme la gauche multiplient les hauts conseils, les autorités, les agences. Cela pose une véritable question quant au fonctionnement de la démocratie. Ainsi, lorsque j'étais ministre, je me suis opposé à la création d'une agence dite indépendante qui avait vocation à analyser le travail parlementaire. Nous faisons face à une multiplication désespérante de ces autorités qui échappent au contrôle démocratique. Avez-vous le sentiment que l'utilité marginale de chacune de ces instances est telle qu'il faut les conserver ?

Je souhaiterais appeler votre attention sur les crédits dont dispose le service d'information du Gouvernement (SIG) qui relève du programme « Coordination du travail gouvernemental ». Il faudra être attentif à ce qu'il y ait bien une campagne de communication au sujet des élections européennes au printemps prochain.

S'agissant des indicateurs de performances, il faut reconnaître que les services du Premier ne sont pas toujours en mesure de recueillir certaines informations de l'administration.
Les documents budgétaires pourraient également être plus précis. J'ai évoqué le programme d'investissement d'avenir doté de 150 millions d'euros et dont l'intitulé est ambitieux mais relativement vague : les documents budgétaires contenaient très peu de précisions sur les projets et la convention entre le SGMAP, le commissariat général à l'investissement et la Caisse des dépôts et consignations.
S'agissant du pavillon de la Lanterne, nous savons tous qu'il y a eu des transferts entre la Présidence de la République et les services du Premier ministre au cours du dernier mandat. Je reconnais que je ne me suis pas penché précisément sur cette question, mais vous m'y incitez.
Comme Roger Karoutchi, je pense que se pose la question de la conservation de tous ces organismes. L'intérêt pour le Premier ministre de regrouper autour de lui ces autorités réside dans la possibilité de les fusionner, dans un second temps. C'est pourquoi la création d'une nouvelle autorité suscite une attention particulière.
L'action dans laquelle figure le service d'information du Gouvernement a connu une baisse importante de ses crédits. Sa mission est essentielle et je serai attentif à transmettre le souci que Michèle André a exprimé.
Je vous ai déjà présenté l'amendement que je vous propose : il s'agit de diminuer les crédits du programme 308 « Protection des droits et libertés » pour réduire le budget de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, en attendant de connaître le niveau de crédits qui sera nécessaire en régime de croisière.

Le président de la Haute Autorité sera-t-il soumis lui-même à l'obligation de déclaration ?

Pour l'instant, nous n'avons pas plus d'éléments. Je vous rappelle que la loi a été votée au mois d'octobre. C'est pourquoi, j'ai trouvé que la multiplication par 4,5 du budget de cette commission était surdimensionnée.
À l'issue de ce débat, la commission adopte l'amendement proposé par le rapporteur spécial et décide de proposer au Sénat l'adoption des crédits de la mission « Direction de l'action du Gouvernement », ainsi modifiés, et du budget annexe « Publications officielles et information administrative ».
Audition de M. Jean-Marie Levaux membre du collège de supervision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution personnalité pressentie pour exercer les fonctions de vice-président de cette autorité
Audition de M. Jean-Marie Levaux membre du collège de supervision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution personnalité pressentie pour exercer les fonctions de vice-président de cette autorité
La commission procède ensuite à l'audition, en application de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, de M. Jean-Marie Levaux, membre du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, personnalité pressentie pour exercer les fonctions de vice-président de cette Autorité.

Par courrier en date du 4 octobre dernier, le secrétaire général du Gouvernement m'a fait savoir que, à la suite de la démission de Jean-Philippe Thierry de ses fonctions de vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution - ACPR - le ministre de l'économie et des finances envisage de nommer Jean-Marie Levaux afin d'achever le mandat de M. Thierry, qui expirera en 2015.
Je rappelle que l'ACPR est née de la fusion de la Commission bancaire, organe placé sous l'égide de la Banque de France, et de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM). Cette dernière avait elle-même résulté de la fusion de l'ancienne Commission de contrôle des assurances et de la Commission de contrôle de mutuelles et des institutions de prévoyance. Avec l'ACPR, nous sommes arrivés au terme de ce processus de fusion gigogne qui a duré plusieurs années.
Lors de cette fusion, l'ACAM et le monde de l'assurance avaient exprimé la crainte de vivre une absorption par la Commission bancaire et, en conséquence, s'étaient interrogés sur le devenir de la régulation applicable au secteur de l'assurance.
C'est pourquoi il a été prévu que le vice-président de l'ACPR serait une personnalité qualifiée dans le secteur de l'assurance, le président étant le Gouverneur de la Banque de France. Le vice-président siège dans toutes les formations du collège de l'ACPR, y compris le sous-collège banques.
En application de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier, les commissions des finances donnent leur avis sur cette nomination. En l'absence d'avis sous un délai de 30 jours, celui-ci est réputé favorable.
Jean-Marie Levaux a été entendu jeudi dernier par la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui a donné un avis favorable à sa nomination. Il nous revient aujourd'hui à notre tour de l'entendre. Nous voterons à l'issue de son audition.
Vous avez eu connaissance de mon curriculum vitae, je vais donc simplement vous rappeler les points essentiels de mon parcours professionnel et de mes fonctions à l'ACPR. J'ai 69 ans et j'ai été nommé en 2010, à la création de l'ACPR, au titre des institutions de prévoyance et pour une durée de cinq ans.
Ma carrière s'est essentiellement déroulée dans le monde de l'assurance : 30 ans à l'UAP, 5 ans chez Axa et enfin 9 ans dans le groupe paritaire de protection sociale Ionis - aujourd'hui Humanis.
J'ai commencé ma carrière au tout début de l'UAP en 1967. Le Président de l'époque m'avait demandé de fusionner les dix statuts de personnel issus du rapprochement de différentes sociétés, ce qui, à vrai dire, n'était pas vraiment ma « tasse de thé » car je suis avant tout un ingénieur. En outre, j'ai géré le déménagement des personnels parisiens dans la tour que nous avons construite à la Défense et l'installation de délégations régionales à la demande de la DATAR. J'ai également obtenu mon diplôme d'actuaire à la même époque. Enfin, j'ai participé à la création des filiales assistance et protection juridique de l'UAP.
Par la suite, en 1977, j'ai été envoyé en Belgique pour réaliser la fusion des succursales de l'ex-Union avec la filiale locale. J'ai été secrétaire général de cette nouvelle société - Urbaine UAP - puis directeur commercial et marketing.
En 1983, je suis parti aux Pays-Bas. Là encore, j'ai réalisé la fusion de plusieurs sociétés acquises par l'UAP avec nos succursales locales. Je me suis plus particulièrement occupé du contrôle de gestion et de l'informatique. J'étais membre du directoire de la holding, en plus d'être nommé directeur général d'une filiale, UAP IARD Nederland, spécialisée dans la souscription maritime, dont les comptes devaient impérativement être redressés.
En 1987, je suis rentré à Paris afin de prendre en charge la direction de l'informatique et des technologies nouvelles du groupe. En parallèle, j'ai été président de la commission informatique de la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA).
En 1992, on m'a demandé de repartir à l'étranger, en Italie, en tant que délégué général de l'UAP. Là encore, il a fallu remettre de l'ordre et redresser les comptes. Je me suis beaucoup occupé de gestion financière à cette époque.
De retour à Paris en 1997, au moment où Axa faisait son OPE sur UAP, je suis rentré dans le comité de direction d'Axa France. J'ai aidé à réaliser la fusion en tant que directeur logistique. Il y avait en effet près de 14 000 personnes à déplacer et 300 établissements à rationaliser en France. Au bout d'un an, je suis devenu directeur marketing et innovation. En 2000, nous nous sommes séparés en bons termes avec la direction d'Axa.
J'ai retrouvé un poste de directeur général dans le groupe Ionis, groupe paritaire de protection sociale, qui comprenait dix caisses de retraite ARRCO et AGIRC, six institutions de prévoyance, une entreprise d'assurance, une société de gestion d'épargne salariale, une société d'investissement, un établissement dépositaire et deux mutuelles ; autrement dit, la panoplie complète de tous les types de sociétés d'assurance possibles dans le système français. Mon métier a alors consisté à fusionner ces différents organismes car l'AGIRC-ARRCO exigeait une seule institution AGIRC et une seule institution ARRCO par groupe. J'ai également préparé des rapprochements avec les groupes de protection sociale Apri et Vauban-Humanis. La société s'appelle désormais Humanis et constitue l'un des premiers groupes de protection sociale en France.
J'ai pris ma retraite en 2009 à 65 ans, âge limite pour tous les dirigeants des groupes de protection sociale.
En parallèle de ma carrière professionnelle, j'ai également été conseiller du commerce extérieur de 1983 à 1997. J'ai été vice-président de la chambre française de commerce aux Pays-Bas et président de la chambre française de commerce en Italie, pays dans lequel j'ai également occupé le poste de président de l'union des chambres de commerce étrangères. Enfin, j'ai été trésorier de l'association des anciens élèves de l'Ecole Polytechnique de 2005 à 2010.
Je suis membre du Collège de l'ACPR, membre du Haut conseil de l'institut des actuaires français et administrateur de la maison des polytechniciens.
Pendant ma carrière, j'ai eu l'avantage d'exercer dans plusieurs types d'entreprises différentes. Vous le savez, le secteur est régulé par plusieurs codes en France : code des assurances, code de la mutualité, code de la sécurité sociale et, de plus en plus, code monétaire et financier. Chacun comporte ses différences et les connaître est toujours très utile à l'ACPR. Nous n'avons jamais de dossiers simples à régler : il n'y a que des dossiers difficiles, avec des particularités liées aux spécificités de ces différents codes - même si l'harmonisation progresse.
J'ai bien sûr une compétence dans le management des sociétés et le redressement des situations délicates, ce qui est un autre point important. Au collège de l'ACPR, nous ne voyons que les dossiers des entreprises en difficulté - les autres étant naturellement examinés dans le cadre de la mission de contrôle exercée par le secrétariat général de l'ACPR. Nous examinons ainsi, à chaque séance du collège, une dizaine de dossiers, dont certains sont excessivement difficiles et il faut prendre des positions vigoureuses pour aider les entreprises à se redresser et protéger les clients.
Je participe, à ce jour, au collège plénier, au sous-collège assurances et, depuis un an et demi, au collège restreint qui s'occupe des grands groupes financiers français. Je m'attache donc à comprendre les problématiques bancaires. Je suis aussi vice-président du comité consultatif des pratiques commerciales, instauré au sein de l'ACPR, où nous recevons les associations de consommateurs et les fédérations professionnelles afin d'étudier comment nous pourrions améliorer les pratiques.

Nous avons bien noté que vous êtes, d'étape en étape de votre carrière, un praticien de la fusion ! Et, avec l'ACPR, vous avez été nommé dans une autorité qui résulte elle-même d'une séquence de fusions.
Nous avons pu observer que vous êtes dans une position d'indépendance, après avoir exercé professionnellement dans le secteur de l'assurance mais, comme vous l'avez relevé, pour des sociétés relevant de plusieurs statuts juridiques.

Nous avons évoqué les craintes du secteur de l'assurance lors de la création de l'ACPR. Avec le recul et votre expérience au collège, quel est votre sentiment sur la façon dont est exercée la régulation ? Est-elle opérée de manière satisfaisante ? Quels enseignements pouvons-nous retirer de ce rapprochement ?
S'agissant de la directive Solvabilité II, il a été dit qu'elle serait de nature à pénaliser le financement de l'économie. On peut se demander si le secteur de l'assurance est prêt à appliquer cette nouvelle législation sans que cela n'ait ce type d'effet pervers.
Plus généralement, selon vous, quels sont les défis que doit relever le secteur de l'assurance dans les années à venir, en particulier les entreprises françaises ? Pourriez-vous également nous livrer votre appréciation sur le secteur bancaire ? La supervision va bientôt être opérée par les soins de la Banque centrale européenne (BCE). Quel est votre sentiment sur la situation de la France et de ses établissements bancaires à cet égard ?
Je terminerai par un sujet d'actualité : les contrats d'assurance-vie en déshérence. On entend parler d'un chiffre de quatre milliards d'euros. Pourriez-vous nous donner une indication sur l'ampleur du phénomène ? Quelles sont les actions engagées par l'ACPR pour y mettre fin ? Je crois que la Caisse des dépôts pourrait notamment intervenir dans la gestion de ce dossier.

L'ACPR doit aussi anticiper les crises. Son récent changement de dénomination souligne également son rôle dans la résolution de ces crises. Il me paraît problématique d'utiliser les fonds destinés à la garantie des dépôts pour redresser une banque ou un établissement financier. À mon avis, cela poserait un problème de confiance. Quelle est votre position sur ce sujet ?
Une question plus personnelle : comment avez-vous été amené à siéger au sein du collège de l'ACPR ?

Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire prévoit la création de certificats mutualistes et paritaires. Quelle est votre appréciation de l'opportunité de cette mesure, tant du point de vue du renforcement des fonds propres des assureurs mutualistes et des institutions de prévoyance que de la protection de la clientèle ?
Le même projet de loi étend les possibilités de coassurance, notamment en matière d'assurance de personnes. Qu'en pensez-vous, notamment au regard de la généralisation des complémentaires santé prévue par la loi sur la sécurisation de l'emploi ?

Quelle est votre appréciation sur le régime actuel de garantie des risques locatifs, qui fonctionne dans le cadre du secteur de l'assurance et qui serait susceptible d'être relayé, à compter du 1er janvier 2016, par une garantie universelle des loyers, mise en oeuvre par un établissement public et dans un cadre susceptible de mettre à contribution les finances publiques ?
Enfin, dans votre expérience de membre du collège de l'ACPR et plus spécialement du sous-collège assurances, y a-t-il des épisodes qui vous ont plus particulièrement marqué ? Pouvez-vous nous faire partager concrètement cette expérience ?
Il est exact que quand l'ACP a été créée, cela a causé une certaine agitation dans le monde de l'assurance qui craignait d'être phagocyté par la Commission bancaire. Des dispositions très précises ont été adoptées, qui ont permis à l'ACP de marcher sur deux pieds, notamment en prévoyant la nomination comme vice-président d'une personnalité qualifiée dans le secteur de l'assurance. Jean-Philippe Thierry a parfaitement rempli ces fonctions. La régulation du secteur de l'assurance n'a pas du tout pâti de la fusion et est aujourd'hui appréciée aussi bien par le marché que par les autres régulateurs européens. Il faut souligner que les techniques de contrôle assurantiel ne sont pas les mêmes que dans le domaine bancaire. Cependant, des partages de bonnes pratiques sont possibles et ont eu lieu, en particulier grâce à des passerelles qui permettent à des contrôleurs bancaires de poursuivre leur carrière dans le contrôle des assurances et réciproquement.
Mon jugement est que la régulation fonctionne bien en France. Nous avons été les premiers à regrouper les régulations bancaire et assurantielle. Nous sommes désormais imités.
Concernant la directive Solvabilité II, il est exact qu'elle aura des effets pervers sur le financement de l'économie. Le fait que les placements en actions demandent plus de fonds propres que ceux en obligations pourrait conduire les assureurs à moins investir dans ces actifs. Ce risque doit toutefois être nuancé, car les compagnies d'assurance doivent investir en actions pour offrir un meilleur rendement à leurs assurés. Tous les six mois, l'ACPR rend un rapport sur l'évolution des portefeuilles actions : nous n'observons pas de baisse significative.
Vous m'interrogez sur les grands défis du secteur de l'assurance : le passage à Solvabilité II en est justement un. On attend les dernières mesures d'application, notamment la directive Omnibus. Les dispositions en matière de gouvernance et de transparence doivent entrer en vigueur au début de l'année prochaine. À mon sens, les organismes d'assurance français sont prêts, même si on peut avoir des soucis avec ce que j'appellerais les « micro-mutuelles », qui du fait de leur petite taille ne peuvent s'adapter aux nouvelles exigences prudentielles. Elles sont obligées de se regrouper ou d'être absorbées.
Tout à fait. C'est un mouvement continu. Depuis 2000, nous sommes passés de 1 600 mutuelles à 300 aujourd'hui. À la fin de cette année, plus de 20 mutuelles vont encore disparaitre. Cela ne pose pas de problèmes pour les assurés dont les garanties sont reprises par l'organisme absorbant.
Au final, je n'ai pas beaucoup d'inquiétudes, le passage à Solvabilité II est bien parti en France.
S'agissant maintenant de mon appréciation sur le secteur bancaire, je dois dire que le sujet est encore assez neuf pour moi. J'observe cependant que les banques françaises ont considérablement renforcé leurs fonds propres. Cela n'est sans doute pas fini, mais au regard des chiffres, je ne suis pas inquiet.
Vous avez évoqué la supervision des banques par la BCE. Effectivement, celle-ci va superviser en direct 170 banques européennes, sur les 3 000 établissements existants. Ce contrôle sera largement sous-traité aux régulateurs nationaux. On s'attend en réalité à ce que seulement environ 15 % des tâches incombant actuellement aux régulateurs nationaux soient centralisés à la BCE.

Cela ne va pas augmenter la comitologie, j'espère ! Un tel processus risque d'être complexe.
L'idée est que la méthode de supervision des banques soit unique et européenne. L'enjeu pour nous est de convaincre nos partenaires que les méthodes françaises sont les bonnes. Elles sont d'ailleurs très connues actuellement. Il est vrai que tout ceci, et notamment l'harmonisation des méthodes de balance sheet assessment, va demander du temps et du travail. Le processus commencera début 2014.
Pour ce qui concerne les contrats d'assurance vie en déshérence, nous avons effectivement constaté, grâce à nos contrôles, des pratiques scandaleuses, dont je ne soupçonnais même pas qu'elles puissent exister malgré mon expérience. Trois grands groupes ont été contrôlés. L'ACP a adressé une lettre de rappel à l'ordre au premier, lui enjoignant de régler les problèmes relevés dans les deux ans. Pour les deux autres groupes, les irrégularités étant plus graves, une procédure de sanction a été engagée. Ce que nous avons vu est vraiment scandaleux, en particulier la passivité de certains assureurs dans le traitement des dossiers. Malgré la loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, de très nombreux dossiers restent en attente.

La commission des finances du Sénat avait contribué à compléter et renforcer cette loi.
En effet. Malgré notre action, la résolution du problème va prendre du temps car les dossiers sont très nombreux et le processus est lent. Je veux également dire que le seuil de 2000 euros en-deçà duquel les compagnies ne vérifiaient pas si l'assuré était encore en vie me paraît tout à fait anormal. Même si la loi de séparation des activités bancaires du 26 juillet 2013 n'a pas retenu ce seuil et que la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) l'a supprimé dans ses engagements professionnels, certains assureurs continuent à s'y référer. Comme si 2 000 euros était une somme négligeable. Pour certaines personnes, cela représente toutes leurs économies.
Nous sommes très mobilisés, mais c'est à la profession de mettre les moyens nécessaires pour résoudre le problème : le règlement de ces centaines de milliers de dossiers demande d'effectuer des recherches et prendra du temps.
Quant à la Caisse des dépôts et des consignations, elle est normalement le réceptacle des contrats en déshérence depuis plus de trente ans, si l'assureur « n'oublie » pas d'effectuer le versement...
S'agissant de l'anticipation des crises, cela relève plutôt du Haut conseil de stabilité financière (HCSF).
S'il y a des mesures individuelles à prendre comme la limitation des rachats de contrats d'assurance vie ou des retraits bancaires, alors ce pourrait être à l'ACPR d'intervenir.
S'agissant du fonds de garantie des dépôts, après l'épisode chypriote, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas toucher aux 100 000 euros de garantie.
Vous m'avez également interrogé sur ce qui m'a conduit à intégrer l'ACPR. C'est le Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) qui m'a demandé en 2008 si je serais prêt, le moment venu, à succéder à leur représentant au terme de son mandat. C'est ce que j'ai fait en 2009, après mon départ en retraite.
M. Germain m'a demandé quelle était ma position sur la création des certificats mutualistes et paritaires. Je dirai qu'il était temps. Avec la directive Solvabilité II, les exigences de fonds propres sont accrues. Les grandes mutuelles et les institutions de prévoyance qui se sont regroupées sont plutôt bien placées dans le cadre de Solvabilité I. Les mutuelles ont un taux de couverture de la marge de solvabilité proche de 300 % alors que seul un ratio de 100 % est exigé. Avec Solvabilité II, leur ratio pourrait tomber à 200 %. Les institutions de prévoyance présentent un profil plus hétérogène, avec actuellement une couverture allant de 100 % à 400 %. La difficulté pour ces organismes est que le seul moyen à leur disposition pour renforcer leurs fonds propres est d'accumuler leurs bénéfices. Le problème, c'est que cette accumulation est très cyclique, avec des hauts et des bas et, ces dernières années, beaucoup de bas à cause de diverses mesures fiscales et contraintes réglementaires. L'exemple de la Mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) est parlant : cette importante mutuelle n'a réalisé en 2012 que 36 millions d'euros pour 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est minuscule. Sans les certificats mutualistes, un problème aurait fini par se poser. Je trouve que leur création est une très bonne chose pour ces organismes qui couvrent des millions de Français.
S'agissant de la coassurance entre codes différents, c'est une très bonne mesure. Certaines mutuelles sont déjà liées par un traité de réassurance avec des assureurs, afin de transférer une partie de leurs risques. Avec la coassurance, cela sera encore plus simple et il y aura un véritable partage des risques, avec désignation d'un apériteur qui gère un contrat commun à différents organismes.
Évidemment, cela prend un intérêt particulier avec la généralisation des complémentaires santé. Il y a eu à ce sujet une « guerre » par médias interposés, certains affirmant que les institutions de prévoyance seraient injustement avantagées et obtiendraient un quasi-monopole. Le Conseil constitutionnel a réglé la question. De toutes les façons, les institutions de prévoyance ont toujours affirmé être pour la concurrence sur ce marché. Après, la véritable question est celle du tarif. En matière de risques collectifs, les tarifs peuvent être très différents. Les institutions de prévoyance ont une expérience certaine dans ce domaine. Les sociétés d'assurance ont un réseau à rémunérer. On verra qui propose les meilleures conditions.

Peut-être les assureurs seront-ils suffisamment avisés pour empêcher une véritable comparaison des tarifs.
En matière de couverture de risques collectifs, les assureurs négocient avec des représentants patronaux et syndicaux qui connaissent extrêmement bien le sujet. Ils sont tout à fait capables d'analyser les offres tarifaires et de garanties des assureurs, même très complexes.
S'agissant de la garantie universelle des loyers, cette mesure peut effectivement avoir un impact sur les assureurs qui proposent des contrats dans le cadre du dispositif actuel de garantie locative. Cependant, ce marché est aujourd'hui peu important. Les propriétaires s'assurent peu. Certains assureurs ont arrêté cette activité, à cause du risque d'antisélection. L'expérience montre que ce type de garantie peut être très couteux.
Vous m'avez demandé de partager des épisodes marquants de mon activité au sein de l'ACPR. Je suis bien entendu soumis au secret professionnel. J'évoquerai simplement le cas d'un grand groupe d'assurance, aujourd'hui tiré d'affaire, pour lequel nous avons dû batailler plus d'un an. Nous ne disposions pas du pouvoir de révoquer le dirigeant. Il a fallu convaincre les membres du conseil d'administration de le faire. Il a fallu ensuite redresser le groupe. Cela m'a beaucoup marqué. C'est là que l'on voit que l'expérience de membres du collège, qui ont eu à gérer des situations difficiles au cours de leur carrière, est particulièrement importante.

Votre curriculum-vitae précise que vous êtes membre du club Pangloss. Je me permets de poser candidement la question : de quoi s'agit-il ?
Entre 1974 et 1976, dans le cadre d'une mission de la fondation Entreprise et Performance (FNEP), j'ai participé à l'élaboration d'un rapport avec d'autres cadres d'entreprises publiques et des hauts fonctionnaires. Le club Pangloss est l'association des lauréats de la FNEP.
Après le départ de M. Jean-Marie Levaux, la commission émet un avis favorable à sa nomination aux fonctions de vice-président du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.