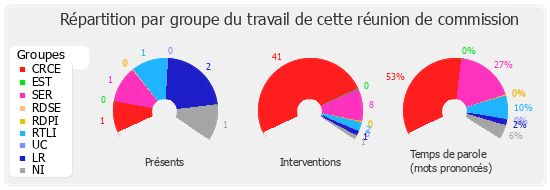Commission d'enquête Evasion des capitaux
Réunion du 29 mai 2012 : 1ère réunion
Sommaire
- Audition de m. christophe de margerie président directeur général de total (voir le dossier)
- Audition de mm. laurent guillot directeur financier de la compagnie saint-gobain marc-antoine jamet secrétaire général de lvmh moët hennessy xavier de mézerac directeur financier d'auchan pierre-françois riolacci directeur financier de veolia environnement et dominique thormann membre du comité exécutif directeur financier de renault (voir le dossier)
- Audition de m. yves nicolas vice-président de la compagnie nationale des commissaires aux comptes (voir le dossier)
- Audition de mm. jean-marc tassetto directeur général de google france olivier esper directeur des relations institutionnelles de google france et marc mossé directeur des affaires publiques et juridiques de microsoft france (voir le dossier)
La réunion
La commission procède tout d'abord à l'audition de M. Christophe de Margerie, président directeur général de Total.

Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous accueillons aujourd'hui Christophe de Margerie, président directeur général de Total.
Je vous rappelle, monsieur le président directeur général, que, conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
En conséquence, je vais vous demander de prêter serment, conformément à la procédure applicable aux commissions d'enquête, et de dire la vérité, rien que la vérité.
Pour ce faire, levez la main droite et dites : « Je le jure. »
(M. Christophe de Margerie prête serment.)
Je vous remercie.
Je vous propose de commencer cette audition par un exposé liminaire destiné à situer votre groupe. Vous pourrez également répondre aux questions que la commission vous a préalablement adressées. Je passerai ensuite la parole à notre rapporteur, M. Éric Bocquet, ainsi qu'aux autres membres de la commission.
Monsieur le président, je suis content, sinon heureux, d'être ici ce matin. L'évasion des capitaux est en effet un sujet particulièrement important, surtout aujourd'hui, puisqu'il explique en partie un manque de compréhension entre l'opinion publique et les acteurs économiques, singulièrement s'agissant de Total, qui est la plus grosse société française, avec toutes les responsabilités et tous les devoirs que cela comporte.
Je me réjouis d'avoir été invité à m'exprimer devant la commission d'enquête, pour répondre à des questions qui me semblent absolument primordiales, sur les interprétations que suscitent nos résultats, nos comptes et nos impôts. Donc, même si l'on peut considérer que je ne fais que répondre à une demande, sachez que je suis content d'avoir l'occasion de m'exprimer devant les sénateurs de la commission d'enquête ici présents et que, oui, je jure de dire toute la vérité.
Je ne suis pas un fiscaliste hors pair, contrairement à certains de mes collaborateurs ici présents. Si des questions techniques sont posées, nous apporterons des précisions sous une forme adéquate. Je ne serai probablement pas toujours en mesure de répondre à des questions trop spécifiques.
Total, qui est présent dans 170 pays, opère réellement dans 130 d'entre eux. Dans les autres, l'entreprise vend les produits qu'elle fabrique.
Notre activité est complètement intégrée dans la chaîne du pétrole, de l'exploration-production au marketing, c'est-à-dire jusqu'au client final. C'est une spécificité de la politique de Total par rapport à ses grands concurrents, qui décident de plus en plus de sortir du marketing. Nous estimons, pour notre part, que la proximité avec nos clients, même si, de temps en temps, cela provoque quelques difficultés, fait partie des responsabilités d'une société. Si celle-ci n'est pas capable ou n'ose pas vendre ses propres produits sous prétexte qu'ils sont trop chers, il faut qu'elle change de métier !
En tout cas, vous ne nous verrez pas adopter, sauf lorsque la situation devient ingérable, une politique consistant à nous désengager de l'aval. J'insiste sur ce point, qui est vraiment une spécificité de la maison.
Nos activités vont de l'exploration production au raffinage, à la pétrochimie et à la chimie. Le groupe a récemment décidé de se restructurer, en regroupant sa pétrochimie et son raffinage, qui sont des métiers tout à fait équivalents et qui permettent, en particulier en Europe, en tout cas nous l'espérons, de redonner une compétitivité à nos grandes installations industrielles.
Bien que le marketing ne soit pas mis à part, il s'agit d'un métier différent, qui entre dans le cadre du commerce international. L'affaiblissement des liens entre le raffinage et le marketing, surtout avec les changements d'acteurs dans le monde - mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui - fait que cette logique de restructuration était évidente à nos yeux. Il s'agit d'un changement assez important pour les employés qui sont amenés à la vivre.
Nous sommes présents dans de nombreux pays, et en France. Permettez-moi de faire passer à ceux qui ne l'auraient pas déjà eue une plaquette présentant l'activité de Total en France. Cela fait maintenant plusieurs années que nous publions un tel document. Pourtant, on a beau distribuer tout ce que l'on veut, il est toujours surprenant de constater que cela ne passe pas ! Je réessaie donc une nouvelle fois.
Cette plaquette est courte, lisible, vérifiable, tous les chiffres ayant été audités par nos commissaires aux comptes. Nous n'avons rien à cacher. Parmi les sociétés internationales et pétrolières intégrées, nous sommes l'une des premières pour ce qui est de la présence dans le pays d'origine, en particulier en matière d'emplois et de personnels, ce dont nous sommes très fiers. De temps en temps revient toutefois un « problème » de désamour, surtout lié, pour moi, à des motivations électoralistes et politiques, face à une entreprise qui gagne beaucoup d'argent. Telle est la raison pour laquelle mon audition revêt une importance particulière.
On prétend très souvent que Total ne paierait pas d'impôts, manipulerait ses prix de transfert pour éviter d'en payer, soit dans les pays producteurs, soit en France.
Notre groupe étant taxé en France à 36,10 %, ailleurs à 80 % et globalement à 53 %, inutile de vous dire que je préfère payer l'impôt en France ! Cette réponse est bien évidemment insuffisante, mais elle devrait tout de même ouvrir les yeux de certains, qui pensent que nous ferions exprès de ne pas payer nos impôts en France.
On dit aussi que Total manquerait de transparence, ce qui empêcherait de savoir où et combien le groupe paie d'impôts. Je reviendrai sur le régime du bénéfice mondial consolidé, ou BMC, dont nous avons été amenés, nous, à demander l'arrêt l'année dernière.
Ce BMC, tout le monde le sait, permettait aux agents du fisc français de vérifier absolument tous nos comptes, dans tous les pays du monde, paradis fiscaux ou non. Nous envoyions nous-mêmes ces fonctionnaires dans un certain nombre de pays qu'ils choisissaient pour parachever leurs vérifications. Aucun pays n'était exclu de la liste ! Je n'irai pas jusqu'à dire que la fin du BMC est une perte de transparence, mais c'est très certainement, pour les inspecteurs du fisc, une perte de contrôle. Quelques personnes, à Bercy, le savent.
Il paraît que le BMC constituait, au bénéfice de Total, une niche fiscale inacceptable. Je vous assure du contraire. En outre, le bénéfice mondial consolidé avait été mis en place par l'Assemblée nationale, donc par les politiques, pour développer les sociétés françaises à l'étranger ; le dispositif a très bien fonctionné. Merci à ces parlementaires courageux ! Apparemment, les temps changent : ce qui était considéré comme un bien pour la France, à savoir le développement à l'étranger, est aujourd'hui, sans vouloir faire de la provocation, dénigré sur le thème des délocalisations. Il ne faut tout de même pas se tromper ! Il existe peut-être des délocalisations, mais il y a aussi une volonté des grandes sociétés de se développer à l'étranger, avec fierté, avec des employés français, avec de la technologie française ! Et tout cela n'a rien à voir avec de la délocalisation.
On nous reproche de nous installer en Tunisie, en qualifiant notre implantation de « délocalisation ». Ensuite, les mêmes personnes viennent nous dire que la seule manière de renforcer la démocratie dans ce pays, c'est d'y investir ! Moi, je ne sais pas faire ! Un jour, c'est de la délocalisation, le lendemain, de l'investissement ! Cette question mériterait un débat un peu moins lapidaire, surtout par les temps qui courent, où chacun est à la recherche de croissance et de création de valeur.
D'aucuns soupçonnent par ailleurs Total d'utiliser des filiales implantées dans des paradis fiscaux et des trusts pour ne pas payer d'impôt. Permettez-moi de revenir sur la notion de bénéfice mondial consolidé. Tous les comptes de ces trusts, ainsi que la raison de leur existence, étaient connus du fisc. De surcroît, toute reconstitution entraînait l'application du taux français. Autrement dit, en l'absence de taux, dans le cadre du BMC, c'est le taux français de 36,10 % qui s'appliquait. C'est moins que 53 %, mais ce n'est pas zéro.
Donc, aucun paradis fiscal ou trust n'est aujourd'hui utilisé par Total pour ne pas avoir à payer d'impôts.
Total ne paierait pas d'impôts ? Je suis au regret de dire que nous sommes l'une des sociétés qui paient le plus d'impôts au monde, avec un peu plus de 14 milliards d'euros en 2011, soit un taux effectif de 53 %, par conséquent supérieur au taux français de 36,10 %.
Indépendamment du fait que nous payons globalement l'impôt, on nous reproche de ne pas acquitter, en France, l'impôt sur les sociétés. C'est faux. Nous avons versé à ce titre environ 300 millions d'euros en 2011. Depuis 2000, c'est-à-dire depuis la fusion de Total et Elf, nous avons acquitté en douze ans environ 2,7 milliards d'euros, soit en moyenne 225 millions d'euros par an.
Bien sûr, par rapport à nos résultats, cela peut paraître faible, surtout aujourd'hui, mais il faut comparer les profits avec les profits. En effet, quand on rapproche les profits que nous réalisons en France avec ceux que nous dégageons dans l'ensemble des pays où nous travaillons, on s'aperçoit que les impôts que nous payons en France sont en ligne avec les résultats que nous y faisons, ce qui paraît tout à fait logique.
En gros, Total paie ses impôts dans les pays où il réalise ses résultats. Il n'y a pas de montages spécifiques qui permettraient de contourner quoi que ce soit. Au cas où cela vous aurait échappé, je rappelle que Total est une société très visible, non seulement en France, mais aussi dans tous les pays où nous sommes présents. Quand nous gagnons beaucoup d'argent en Norvège et en Grande-Bretagne, nous y payons des impôts. En Norvège, le taux est de 78 % ; en Grande-Bretagne, il peut aller jusqu'à plus de 80 %. Ces pays sont très soucieux de s'assurer que nous payions des impôts chez eux, sur des revenus qui viennent de chez eux, afin que nous n'allions pas les payer ailleurs. Cela s'appelle le principe de territorialité de l'impôt, bien connu en France, lié aux conventions fiscales internationales, vues et revues par le Parlement français.
On dit, mais cela n'est pas vraiment entendu, que, si la France n'appliquait pas ce principe de territorialité et taxait les profits de source mondiale, une telle imposition ne pourrait se faire sans déduire de l'impôt français les impôts déjà acquittés à l'étranger. C'est un point important : même si on oubliait le principe de territorialité, les impôts que nous payons à l'étranger viendraient en déduction de l'impôt que nous aurions à payer en France, ce qui reviendrait quasiment au même. Cela découle d'un principe fondamental appliqué dans tous les pays et défendu par l'OCDE, à savoir le principe d'élimination de la double imposition.
Or ce mécanisme de taxation mondiale, avec déduction des crédits d'impôt étrangers, c'était le bénéfice mondial consolidé, que l'on a tant reproché à Total, et qui a été supprimé l'année dernière. Nous avions en fait un système qui permettait au fisc français de tout retraiter, sur une base française, avec un impôt français, dont nous déduisions, avec des certificats, les impôts payés à l'étranger, ce qui est le plus extrême respect de la loi sous toutes ses formes.
On dit aussi que Total et ses filiales françaises paient d'autres impôts. C'est vrai, et nous insistons sur ce point. Bien sûr, l'impôt sur les sociétés est le plus visible, mais c'est surtout le plus utilisé contre nous quand il est nul, parce que cela permet d'éviter de parler des autres impôts. En 2011, nous avons tout de même payé en France 1,2 milliard d'euros d'impôt, non compris bien évidemment toutes les charges sociales que nous acquittons sur nos salariés en France.
Me référant à la brochure que vous avez sous les yeux, j'en citerai très rapidement les chiffres principaux, pour vous montrer l'importance de notre société pour notre pays.
Nous sommes le premier raffineur français, avec près de 50 % des capacités de raffinage, et le deuxième opérateur gazier - c'est le fruit d'une longue histoire, notamment le monopole. Avec plus de 4 000 stations-service, Total est le plus gros distributeur, mais attention, on mélange souvent ici les données : certes, les grandes surfaces réalisent globalement 60 % du volume, contre 20 % pour Total, mais, si l'on considère la taille de chacune des grandes surfaces prises individuellement, nous sommes effectivement le numéro 1.
Avec des investissements s'élevant à 1,5 milliard d'euros, destinés à moderniser notre outil industriel et à le rendre de nouveau compétitif, nous sommes l'un des plus gros investisseurs en France. Notre masse salariale représente 3,2 milliards d'euros, dont 120 millions d'euros sont versés au titre de l'intéressement et de la participation.
La France représente 23 % de notre chiffre d'affaires, 14 % des recrutements mondiaux, 50 % des dépenses de recherche et de développement, soit environ 400 millions d'euros. La France compte 14 % de nos sites industriels, 33 % de l'actionnariat du groupe, avec 520 000 actionnaires individuels.
Globalement, le chiffre d'affaires réalisé avec Total par les fournisseurs français s'élève à plus de 5 milliards d'euros. Voilà pour l'impôt sur les sociétés.
On dit également que Total manipulerait ses prix de transfert pour ne pas payer d'impôts. Parlant aujourd'hui sous serment, je vous dis que c'est faux. Je ne vois pas comment on pourrait le faire ! L'essentiel de nos flux concernent le pétrole brut et les produits pétroliers. Ces prix sont contrôlés de très près par tous les États dans lesquels nous travaillons : c'est en effet leurs propres impôts qui en dépendent. De surcroît, il y a des prix de marché et des cotations, et l'on ne peut pas y toucher. Quand bien même on modifierait une cotation - on n'est pas à un ou deux centimes d'euros près quand il s'agit de prix de transfert, contrairement aux prix à la pompe - parce qu'ils sont vérifiables par des cotations internationales, les prix de transfert sont absolument intouchables ! Tout le monde les connaît, mais, de temps en temps, on fait semblant de les ignorer.
Tous les pays producteurs avec lesquels nous travaillons utilisent exactement les mêmes références, à savoir le Platt's, le marché du Brent ou le celui du WTI. Les formules utilisées sont reconnues dans les États où nous travaillons, en particulier par leurs fiscs. Il ne faut pas croire que ces derniers sont moins intéressés que le fisc français par nos impôts et notre argent !
On pourrait aussi s'amuser à dire qu'il vaut mieux payer des impôts en France plutôt qu'en Grande-Bretagne. En tout cas, tant que le taux français est fixé à 36,10 %, ce serait beaucoup moins cher pour nous ! Mais cela ne correspond pas à la volonté de ces pays.
L'avantage d'une société comme la nôtre, c'est que nos activités sont visibles. Le coût d'une plateforme est de 30 milliards de dollars, voire plus. Il s'agit d'investissements colossaux, qui atteignent plus de 20 milliards par an. Si vous vous demandez où vont nos résultats, ne vous penchez pas sur les dividendes ou les salaires des mandataires sociaux. Il n'y en a d'ailleurs qu'un, c'est moi ! L'investissement est clairement prioritaire. Nos plateformes ne sont ni à Jersey ni au Bermudes. Dans le monde entier, Total est visible, ce qui n'est peut-être pas vrai de toutes les entreprises.
Les 14,1 milliards d'euros d'impôts que nous payons correspondent très exactement à l'impôt sur les sociétés.
Par ailleurs, nous faisons partie d'une association, le EITI, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Total a apporté son franc soutien à cet organisme, né sous l'égide de l'ONU, que le groupe et moi-même respectons beaucoup. J'y ai d'ailleurs pris une part vraiment active. Il se différencie de ce que l'on appelle le Publish What You Pay, défendu par les Anglo-Saxons, en particulier les Américains. Nous estimons cette deuxième formule moins bonne, dans la mesure où, au lieu de pousser les États à changer par toutes sortes de moyens, parfois énergiques, le PWYP impose des solutions. Or nous sommes plus favorables à une évolution des esprits qu'à des changements imposés. Si le EITI n'est pas parfait, il commence cependant à fonctionner. Publish What You Pay remet complètement en cause l'idée selon laquelle on peut faire bouger les choses autrement que par la loi et le droit, c'est-à-dire par la conviction.
Je maintiens que nous défendons le EITI par rapport au PWYP.
Le BMC a permis aux agents du fisc français, qui sont bien évidemment soumis à l'obligation de confidentialité, de connaître toutes les informations concernant les pays dans lesquels nous travaillons, du moins jusqu'à la fin de 2010. Désormais, il faudra procéder de manière un peu différente. Il est vrai que la situation n'est pas identique pour la presse, qui n'a pas accès à ces informations. Mais celle-ci doit-elle avoir accès à toutes les informations dont dispose le fisc français ? Ce n'est pas une décision qui dépend de Total, et encore moins de son président.
On dit que Total utilise des filiales dans les paradis fiscaux et des montages. Je répondrai en donnant quelques chiffres.
Oui, nous sommes dans un certain nombre de paradis fiscaux, mais les montages ne sont pas réalisés à des fins de réduction d'impôt.
A la fin de 2011, nous avions 48 filiales dans des paradis fiscaux, où l'impôt est inférieur à la moitié de l'impôt français, ce qui est la définition du paradis fiscal. Sur ces 48 filiales, 42 réalisent des activités économiques réelles ou remplissent les critères établissant que l'implantation est liée à des raisons autres que fiscales, relatives à une activité industrielle et commerciale normale.
Permettez-moi de prendre l'exemple de Jersey, qui peut paraître quelque peu provocateur. Nous y avons des stations de pétrole. Certes, nous pourrions les retirer, mais il s'agit d'une activité réelle, sans rapport avec les avantages offerts par un paradis fiscal.
Nous avons également des usines de fabrication en Roumanie. Ce pays fait partie des paradis fiscaux, compte tenu de la définition que je viens de vous rappeler. Je pourrais également parler des lubrifiants que nous fabriquons à Hong Kong et de toutes sortes de choses. Il s'agit bien là d'activités réelles.
Pour six filiales, nous ne remplissons pas les critères fixés par les textes pour démontrer que nous ne sommes pas implantés pour des raisons liées aux avantages fiscaux. On applique donc le fameux article 209 B du code général des impôts, et on paye, sur les profits dégagés dans ces six filiales, l'impôt en France, au taux de 36,10 %. Celles-ci ne sont donc pas imposées à zéro, mais bien à 36,10 %. C'est moins que 53 %, mais je suppose que, pour la France, le fait que le contribuable paye 53 % n'est pas une fin en soi ! Ce qui l'intéresse, ce sont les impôts acquittés en France.
En outre, 15 de nos filiales ayant leur siège social aux Bermudes ou ailleurs détiennent des actifs, notamment les champs pétroliers des pays producteurs, où nous sommes fortement taxés. Dans ce cas également, la domiciliation dans un paradis fiscal ne nous donne aucun avantage fiscal par rapport à l'implantation en France. Si ces filiales étaient immatriculées en France, elles ne paieraient aucun impôt, puisqu'elles se contentent le plus souvent de détenir des actifs liés aux acquisitions réalisées.
Aujourd'hui, la vraie difficulté, c'est de rapatrier ces actifs en France ou ailleurs, compte tenu des problèmes juridiques et fiscaux que cela peut poser en termes de plus-values et d'augmentation des valeurs au moment des transferts.
Je le répète, ces sociétés étaient soumises au contrôle de l'administration fiscale française, comme les autres sociétés françaises, dans le cadre du BMC.
Aujourd'hui, très clairement, la politique du groupe est de ne plus créer d'entités dans ces pays et de rapatrier, lorsque c'est possible, les sièges sociaux des entités existantes. Nous avons réalisé, au cours des dernières années, deux rapatriements et une dizaine d'autres sont en cours d'étude. Je sais que ce n'est pas aussi rapide que vous le souhaiteriez, mais ces transferts seront réalisés au fur et à mesure, afin d'éviter une perte de nos droits liée à la liquidation de l'activité. Nous courons en effet le risque d'avoir à justifier de nouveau auprès des pays producteurs que nous n'avons pas perdu nos droits. En temps normal, cela ne pose pas de problème. Dans certains pays producteurs, des négociations sont en cours, ce qui peut nous permettre de sortir gentiment...
S'agissant des fameux ETNC, les États et territoires non coopératifs, la situation est encore plus simple. Nous ne sommes implantés que dans trois pays figurant sur la liste publiée par la France au 1er janvier 2012 : Brunei, le Botswana et les Philippines.
Dans chacun de ces pays, nous exerçons une activité industrielle et commerciale, Brunei étant de surcroît un pays producteur bien connu. On comprend très bien la nécessité de la lutte contre le blanchiment d'argent, mais cela ne peut se faire dans notre cas au détriment de l'activité commerciale que nous exerçons. Dans le cas de Brunei, la plupart des grandes compagnies internationales y sont installées. On y trouve en effet du gaz naturel liquéfié, et une énorme usine de liquéfaction, dont Shell est l'opérateur. Les activités dans ce pays sont donc bien réelles, facilement vérifiables et ne sont en aucun cas menées pour payer moins d'impôt.
J'en profite pour lancer un message au Sénat : pourrait-on envisager une clause de sauvegarde dans les textes sur les ETNC, afin d'éliminer ce type d'effet collatéral, qui ne correspond certainement pas à l'intention du législateur ? Il s'agirait de dissocier la notion de pays « à risques » de celle de pays où sont réalisées, de façon tout à fait légitime et propre, des activités industrielles et commerciales reconnues internationalement.
Enfin, les trusts, sont souvent diabolisés comme étant synonymes de dissimulation. Chez Total, ils existent uniquement pour des raisons juridiques et non pas fiscales.
J'évoquerai un seul exemple, à savoir la remise en état des sites. Dans de nombreux pays, nous sommes amenés à préparer le futur, c'est-à-dire à constituer des provisions, dans certains cas en cash, ce qui permet aussi de récupérer l'argent des partenaires locaux ou des États locaux qui n'ont peut-être pas toujours la même visibilité ni le même esprit éthique que Total. Nous créons donc des trusts, qui sont en fait des comptes séquestres sur lesquels l'argent est déposé et ne peut être utilisé qu'en un temps et un lieu donnés, soit à la fin des concessions. A ce moment-là, on est en mesure de récupérer les sommes en question, pour les utiliser exclusivement à la remise en état des sites ; elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins par les États dans lesquels nous travaillons. Cela ne signifie pas que nous ne leur faisons pas confiance. Simplement, nous nous méfions un peu de certains d'entre eux.
Donc, dans la quasi-totalité des cas, ces trusts ne sont utilisés que pour mettre des fonds de côté pour une utilisation future. On peut le vérifier contrats à l'appui, qui expliquent comment ces fonds peuvent être dégagés ou non. Ils servent uniquement à payer des entreprises qui font du commerce et de l'industrie, et non pas du tout des personnes morales ou physiques, qu'elles soient françaises ou étrangères.

Je vous remercie, monsieur de Margerie, de cet exposé complet.
Je passe maintenant la parole à M. le rapporteur.

Monsieur le président directeur général, votre groupe étant un acteur majeur de l'économie française et internationale, il était tout à fait justifié que nous vous entendions.
Vous indiquez que Total est présent dans 130 pays dans le monde, y compris des paradis fiscaux. Vos propos m'ont en quelque sorte réjoui, dans la mesure où certains ont nié l'existence de leur implantation dans de tels pays.
Vous parlez d'activités « visibles ». Certaines, en effet, le sont, telles l'exploitation, la distribution, le stockage ; mais il en existe également qui le sont moins ou qui ne le sont pas du tout ; je pense notamment à l'assurance. Ainsi, dans les paradis fiscaux où vous êtes implantés, exercez-vous des activités en relation avec l'assurance de vos autres activités ?
J'en viens maintenant à la fiscalité, qui est l'objet central de notre démarche. La politique fiscale du groupe constitue-t-elle selon vous un élément de sa stratégie ? Quels sont les principes sur lesquels cette politique serait définie ?
Ma dernière question, d'ordre plus général, s'adresse davantage à l'acteur économique que vous êtes. Diverses analyses imputent aux paradis fiscaux une responsabilité importante dans la déstabilisation du système financier que nous vivons depuis quelques années et la perturbation des conditions d'une croissance économique équilibrée. Les partagez-vous ?
La première question est probablement la plus facile.
Les assurances font partie des activités historiques du groupe. Elles se trouvent de temps en temps implantées dans des paradis fiscaux, que je maintiens surtout pour des raisons de facilité de fonctionnement. Il faut bien le rappeler, les paradis fiscaux présentent tout de même un certain nombre d'intérêts - je ne parle pas sur le plan fiscal -, en particulier juridiques, puisqu'ils permettent de plus grandes facilités d'opération. Surtout, ne l'oublions pas, si Total est certes une société française, avec des comptes en euros, la formation de nos résultats se fait quasi exclusivement en dollars. Par conséquent, le fait de bénéficier d'une comptabilité en dollars nous aide.
Si la France pouvait, comme certains pays européens, envisager que ses sociétés puissent avoir une comptabilité en dollars, cela permettrait peut-être aussi d'éviter l'utilisation de paradis fiscaux.
De toute façon, les activités d'assurance, qui, comme toutes les autres, relèvent de l'article 209 B du code général des impôts, sont soumises à l'impôt en France, au taux de 36,10 %. Il n'y a donc absolument aucun avantage fiscal de ce côté-là pour Total.
S'agissant de la stratégie fiscale du groupe, si vous m'entendiez soutenir, monsieur le rapporteur, que notre but est de payer le plus d'impôt possible, vous seriez sans doute surpris. Ce n'est donc certainement pas notre objectif, encore que nous sommes présents dans des pays producteurs qui sont très souvent dans un état de pauvreté nettement supérieur à celui de la France. Je suis un peu gêné - c'est d'ailleurs l'un de mes griefs à l'égard de certaines personnes - que l'on ne cesse de mettre en avant les intérêts de la France, alors que l'argent vient d'autres pays dans lesquels les habitants, que l'on ne peut pas oublier, sont plus nombreux et moins riches que nous.
La notion de redistribution est très importante à nos yeux, en particulier pour ce qui concerne le pétrole et le gaz, parce qu'elle va bien au-delà de la seule dimension du revenu et qu'elle implique le futur d'une nation, le futur de ces pays. Allez leur expliquer que le groupe doit payer des impôts à l'étranger sur des profits qui viennent de chez eux... A plusieurs reprises, j'ai demandé à des parlementaires de venir avec moi sur place pour faire comprendre la situation, mais je peux vous dire qu'ils n'en ont rien fait. Or les États dont nous parlons ont un peu de mal à accepter que la France récupère plus de 50 % d'impôts sur leurs produits à la pompe, alors qu'aucun argent n'est dégagé par la France, hormis le fait que Total est l'opérateur. Que nous disent-ils, ces pays ? Occupez-vous de vos vaches, nous nous occupons de nos moutons, et si Total gagne trop d'argent, nous pouvons régler le problème, par exemple en augmentant les impôts sur nos produits, puisque l'argent vient de chez nous ! Je vous assure que ce n'est pas une blague, et cela m'attriste parfois.
Oui, notre objectif est de payer le moins d'impôts possible, tout en veillant, dans le cadre de l'acceptabilité, à en payer suffisamment dans les pays où nous opérons. Ces sommes doivent être versées à qui de droit, c'est-à-dire dans le respect de notre code de conduite et d'éthique : nous ne payons que des organismes officiels, et jamais des personnes physiques, sous quelque prétexte que ce soit... Nous vérifions tout. S'ils ne sont pas d'accord, on ne paie pas. Je peux vous assurer que les choses ont bien changé ces dernières années. Ce qui a malheureusement existé à une époque n'a plus cours, mais on voudrait nous faire croire que tel est encore le cas. Non, désolé, cela n'existe plus, en particulier pour ce qui concerne Total.
Nous vérifions que nos impôts sont bien payés, et nous passons notre temps, surtout lorsque le prix du brut augmente, à négocier avec les États, qui veulent taxer toujours plus. Assez curieusement, plus ils gagnent, plus ils veulent gagner, observant plus notre assiette que la leur. Avec un taux d'imposition à 70 %, quand les prix du brut augmentent, ils gagnent beaucoup plus d'argent ! Nous aussi, mais cela les agace. Ils cherchent donc à en récupérer chez nous.
Notre politique, c'est la négociation contractuelle, et l'impôt en fait partie. Aujourd'hui, nous payons chaque année un peu plus d'impôts que l'année précédente. Sur l'amont pétrolier, notre taux moyen d'imposition doit atteindre 57 %, soit un taux supérieur à celui de notre imposition globale, de 53 %.
Ce qui est un peu compliqué, c'est que l'impôt ne représente pas la totalité de ce que nous payons dans les pays producteurs. Nous leur versons aussi des royalties, qui viennent s'ajouter à l'impôt sur les sociétés, lequel s'élève à 14 milliards d'euros. N'oublions pas non plus le partage de production : nous donnons une partie de la production directement à l'État de production. Ainsi 80 % à 85 % de la rente minière va aux États producteurs. Par conséquent, le premier bénéficiaire est le pays producteur où nous opérons, ce qui est normal.
Enfin, concernant la responsabilité des paradis fiscaux dans la déstabilisation du système financier en cours, si leur existence peut sans doute faciliter certains mouvements, ce serait bien trop simple d'y voir la cause de tous nos maux.
Le cas de Total est très clair à cet égard : notre implantation dans les paradis fiscaux n'est pas motivée par des motifs fiscaux et ne change en rien les impôts que nous payons. Cela est vrai pour la plupart des très grandes sociétés comme Shell, Exxon ou BP, qui représentent la plus grosse partie des flux mondiaux. Peut-on dire la même chose de toutes les sociétés internationales ? La réponse est non !
Ainsi, compte tenu des volumes en cause, je ne peux pas affirmer que les paradis fiscaux constituent la raison majeure des difficultés actuelles de l'économie mondiale. Toutefois, ils y participent sûrement.
Il faut distinguer l'impôt du partage de la rente, car ce n'est pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont le pays où nous récupérons le moins : nous gagnons très exactement un dollar par baril, le prix du marché étant à 120 dollars le baril. Vous voyez donc comment se partage la rente. Comme il se trouve que ce n'est pas uniquement par l'impôt que se fait la différence, il est difficile de parler d'impôt proprement dit.
La Norvège, la Grande-Bretagne et le Nigeria sont sûrement les trois pays où le niveau de l'impôt est le plus élevé. En Angola, il s'agit davantage d'un partage de production. A la limite, l'impôt moyen que nous payons dans les pays producteurs, qui se situe aux alentours de 60 %, correspond à l'impôt sur les sociétés. Il y a également tout ce que nous payons en plus, lié en particulier au partage de la rente, dont le coût est en réalité beaucoup plus élevé.
La Grande-Bretagne et la Norvège ayant des systèmes conformes à ceux de la France - il n'y a pas de contrat de partage de production, ce sont des concessions traditionnelles -, nous y sommes taxés par le biais de l'impôt, dont le taux oscille en Grande-Bretagne entre 62 % et 81 %. Il est désormais supérieur à celui de la Norvège, qui impose à 78 %. Et ils ne sont pas prêts à y renoncer !

Combien d'États et de territoires dans lesquels vous intervenez connaissent un impôt sur les sociétés dont le taux est inférieur à 18 % ? Quels sont-ils ? Quel est le montant des bénéfices qui y sont réalisés ?
Je les ai cités tout à l'heure. Ce sont les fameux trois pays où nous avons une vraie activité.
Absolument ! Il faut ajouter quelques autres où nos filiales exercent des activités opérationnelles.
Dans certains autres États, nous pourrions également payer moins d'impôts, mais nos comptes sont automatiquement redressés et taxés au taux de 36,10 % dans le cadre de l'article 209 B du code général des impôts. Il n'existe donc pas de pays dans lequel nos activités ne seraient pas d'ordre commercial et dont le taux d'imposition serait inférieur à celui de l'impôt français.

Quelle somme cela représente-t-il en valeur dans les trois pays en question ?
Pour Brunei, un peu plus, mais ce n'est pas grand-chose. Je pourrai vous faire parvenir les chiffres, monsieur le rapporteur.

Je pense que Total a un rôle particulier à jouer, probablement à la fois dans l'économie française et au regard de l'exemplarité qui doit être la sienne, en particulier dans la période que nous traversons.
J'ai senti, monsieur le président directeur général, que vous étiez plutôt sur la défensive au début de votre intervention. Il arrive en effet fréquemment que votre groupe soit fustigé ou attaqué dans la presse ou, tout simplement, par le commun des mortels.
Pourquoi ? La question doit être posée.
Selon moi, trois raisons peuvent être avancées.
Première raison, le citoyen lambda considère que la hausse de l'essence n'est pas tout à fait conforme à la réalité de la hausse du prix du pétrole, un certain délai les dissociant curieusement. Les prix à la pompe ne suivent pas de manière systématique l'évolution des cours.
La deuxième raison est liée à la pollution d'un certain nombre de côtes atlantiques. Toutefois, je ne m'étendrai pas sur ce point, ayant eu l'occasion d'intervenir à cet égard lors de votre audition par la commission de l'économie.
La troisième raison tient à la fiscalité. D'ailleurs, si je me suis levé très tôt, à quatre heures et demie, et si j'ai fait le déplacement depuis Saint-Nazaire, c'est pour vous interroger sur ce sujet.
La société que vous présidez a une particularité : elle émane à l'origine de fonds publics. C'est donc par le biais de ceux-ci qu'elle a réalisé l'ensemble de ses investissements, même si elle s'est considérablement développée par la suite.
Il s'agit, me semble-t-il, de la première capitalisation boursière en France, représentant plus de deux fois le budget de l'éducation nationale. Ce sont des montants importants, pour ne pas dire énormes.
La société est née de concessions d'exploitation offertes à un moment donné par l'État, ce qui impose selon moi, en termes de « civisme fiscal », des attitudes absolument exemplaires ; vous avez tenté de nous faire la démonstration, et je vous en remercie.
Je vous poserai quatre questions.
Premièrement, quel sera le niveau des investissements réalisés en 2012 par Total ? Quel sera, sur les bénéfices, le niveau de rémunération des actionnaires et celui de l'impôt, en particulier national ?
Deuxièmement, verriez-vous un inconvénient majeur à ce que le bénéfice mondial consolidé de l'entreprise Total soit divulgué à l'opinion publique, tout simplement par voie de presse, et à ce que la représentation parlementaire en soit tenue informée ? Pour ma part, je n'imagine pas que cela puisse faire difficulté.
En effet, dès lors que l'opinion et ses représentants ont le sentiment qu'on leur cache quelque chose, la situation devient, on le comprend bien, plus difficile. Or, dans le cadre du fonctionnement de notre démocratie, cela n'est pas bon.
Troisièmement, est-il arrivé que Total négocie une exonération pour ne pas payer d'impôts sur les profits à venir ? J'ai en effet eu l'occasion de lire un article sur ce sujet.
A ce stade, je ferai une remarque d'ordre plus général. Voilà quelques années, le responsable d'une très grande entreprise comme Total ne défendait d'autre logique que celle qui consiste à réaliser le maximum de bénéfices pour investir, rémunérer les actionnaires et payer les salariés. Dans la période présente, la logique est un peu différente. Chacun le sait, la plupart des États, dont la France, sont aujourd'hui très fortement endettés. En conséquence, la logique entrepreneuriale de gouvernance d'une grande entreprise comme Total peut et doit être elle-même un peu différente.
Du coup, j'en reviens à ce civisme fiscal qui m'apparaît absolument indispensable, non pas du fait des origines de Total - quoique ! -, mais parce que cela peut contribuer à la richesse économique d'un pays et, par voie de conséquence, au développement de l'entreprise que vous dirigez.
Il me semble donc que la logique qui était celle de différentes gouvernances voilà quelques années ne peut et ne doit plus être la même aujourd'hui. Sinon, nous courons à la catastrophe.
Quatrièmement, permettez-moi de vous interroger sur ce qui peut paraître un détail, mais le diable se cache parfois dans les détails. Vous avez parlé d'exemplarité, et je partage complètement cette exigence. Dans ce cadre, pouvez-vous indiquer, même si ce n'est pas cela qui permettra de combler les déficits budgétaires, l'écart de revenu, dans l'entreprise Total, entre le moins bien payé et le mieux payé ?
Je vous remercie, monsieur le sénateur, de toutes vos questions, qui constituent un excellent tremplin en ce qu'elles mêlent plusieurs sujets précis, dont les problèmes d'image et de gouvernance.
Je tiens à vous le dire, l'adjectif « défensif » que vous avez utilisé correspond assez peu à mon caractère, qui est plutôt « réactif ». Je me permets de faire cette petite correction, car mon exposé liminaire, certainement pas défensif, s'inscrivait en réaction à certains propos.
Très souvent, pour des raisons sur lesquelles je ne m'interroge plus parce que j'ai la réponse, on s'obstine à vouloir nous faire dire le contraire de ce que nous expliquons. C'est cette partie de votre intervention qui mérite d'être corrigée. J'y reviendrai en vous répondant plus globalement.
Nous pouvons répéter les informations cent fois, si personne n'a envie de les entendre, particulièrement ceux qui disposent du pouvoir de les transmettre, tout est plus difficile.
A cet égard, nous pouvons parler de ce qui se passe en ce moment autour de l'Erika, en particulier sur le plan juridique, bien que ce ne soit pas le sujet du jour. Ce fut évidemment un événement très important, mais il remonte à 1999, voilà maintenant treize ans. Chacun a pu constater la manière dont le groupe Total est traité à l'occasion d'un débat portant non sur le fond, mais sur la forme. Nous n'y sommes pour rien. Laissons à la justice de notre pays le soin de faire son travail. La justice n'est pas bonne quand elle vous donne raison et mauvaise quand elle vous donne tort. C'est tout ce que j'ai à dire à ce stade, d'autant que, je le répète, ce n'est pas le sujet du jour.
A entendre certains parler de l'Erika tous les matins, l'image du groupe ne va clairement pas s'améliorer, quoi que nous fassions. Ce n'est pas une augmentation d'impôt qui y changerait quoi que ce soit, vous le savez bien, monsieur le sénateur. Qu'il serait facile de pouvoir s'acheter ainsi une bonne conduite : fort heureusement, tel n'est pas le cas !
J'en viens à vos questions de fond, en commençant par le prix à la pompe. Nous nous sommes déjà expliqués cinquante fois. Point positif : il y a eu un retour.
Vous avez tout de même dit que le consommateur trouvait que Total ne répercutait pas correctement les évolutions de prix. Je pense que c'est faux. L'histoire du blocage des prix n'est plus d'actualité : ce n'était pas, selon moi, une bonne méthode, et je m'en suis déjà expliqué. De toute façon, le Parlement est souverain.
Veillons à ne pas faire passer de tels messages systématiques. Ceux-ci viennent très souvent de parlementaires, qui, d'office, quoi que nous fassions et disions, affirment que nous ne répercutons aucune évolution de prix. Même quand nous vous les donnons, les chiffres sont considérés comme faux. Cela fait bien de dire que Total ment. Puisque je dépose aujourd'hui sous serment, je peux vous jurer que ce que vous dites en la matière, de la part d'autres, est absolument faux.
Il est d'ailleurs tellement intéressant de faire de la distribution en France que toutes les grandes compagnies - les Exxon, Shell, BP - sont toutes parties récemment ! Sans doute n'aiment-elles pas les profits et gagnaient-elles trop d'argent dans notre pays...
Voilà pourquoi les seuls acteurs à continuer leur activité et à se développer sont les grandes surfaces : celles-ci utilisent le carburant comme un produit d'appel et gagnent leur argent ailleurs. Je comprends parfaitement que nous ne puissions pas vendre d'alcool sur nos centres de distribution, mais pourquoi les grandes surfaces en proposent-elles à vingt mètres de leurs stations-service, sans que les parlementaires y trouvent à redire ?
Je tenais à remettre tout cela en perspective, monsieur le sénateur. Vous le voyez bien, loin d'être sur la défensive, je suis plutôt porté sur l'attaque : si l'on veut agir, il faudra le faire à deux. Ne renvoyons pas simplement toute la faute sur l'entreprise Total, qui, toute seule, n'arrivera pas à améliorer son image tant qu'on ne lui donnera pas un coup de main. Et je pense que cela en vaut la peine.
J'en viens au sujet, dont il faut parler, de la fiscalité et des fonds publics. En plus, c'est celui que je connais le mieux.
En 1924, l'État français, récupérant les actifs de l'Allemagne, et de personne d'autre, mais n'ayant pas les moyens de les gérer, a décidé de créer une société, la Compagnie française des pétroles, la CFP, laquelle mit en place une filiale, la Compagnie française de raffinage. C'est cette dernière qui avait des obligations en termes d'approvisionnement du marché français.
En contrepartie de cet apport, la CFP, devenue Total, a depuis cette date payé jusqu'en 1994, si ma mémoire est bonne, des royalties au gouvernement français. Cela fait donc des années que nous lui avons remboursé notre dette, avec profit.
L'État a, par la suite, cédé sa participation en gagnant de l'argent. Il ne possède aujourd'hui plus rien, après avoir récupéré sa mise je ne sais combien de centaines de fois. Le contribuable français n'a rien perdu, bien au contraire, d'un tel transfert de l'État à Total. J'aurai le courage de dire que l'entreprise a été ainsi beaucoup mieux gérée.
Nous avons maintenant une belle société privée, indépendante, puisque l'État ne dispose plus de rien. Les droits que nous avons à son égard sont ceux que nous avons à l'égard de nos concitoyens : c'est notre responsabilité sociétale et civique, qui n'est absolument pas liée à 1924.
Je suis désolé de devoir le souligner, mais l'histoire est terrible sur ce point, et les chiffres sont parfaitement clairs : nous avons payé toute notre dette. Il est trop facile de prétendre que nous aurions une pseudo-dette morale : outre que ce n'est absolument pas quantifiable, cela ne veut rien dire.
Dans de nombreux autres pays, les choses se sont faites sous une forme beaucoup plus agressive, comme vous le savez, sans que les nouveaux propriétaires remboursent quoi que ce soit à leur État.
Donc, sur cette partie-là, j'estime que nous avons vraiment fait tout notre devoir. Pendant des années, le Gouvernement a nommé les patrons de Total et délégué des commissaires au conseil d'administration. Un jour, l'État a décidé de lui-même de sortir pour gagner de l'argent. Il ne peut pas agir de la sorte et prétendre ensuite continuer à exercer un droit sur la société : le droit, cela se mérite aussi !
Quant aux impôts acquittés en France, je précise que la répartition se fait d'abord globalement, au niveau international. Nous sommes cotés dans plusieurs pays. Aujourd'hui, grosso modo, sur les 12 milliards d'euros précités,...
Pour faire simple, l'actionnariat est, aux deux tiers européen, dont la moitié, soit un tiers du total, français. Notre pays étant de loin celui qui compte le plus grand nombre de nos actionnaires, il bénéficie des impôts correspondants, notamment sur les dividendes. Dans le deuxième tiers européen, on trouve surtout la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la Belgique, compte tenu des anciens rapports avec Petrofina.
Dans le dernier tiers figurent, pour les trois quarts, les États-Unis. Ce que l'on appelle le reste du monde détient 8 % : cela a créé un grand débat, au Parlement en particulier. J'ai moi-même beaucoup défendu l'entrée des fonds souverains au sein du capital des sociétés françaises. Si, désormais, tout le monde trouve cette idée géniale, car de nature à apporter de l'argent frais, à l'époque, certains nous mettaient en garde, craignant une prise de contrôle de Total. Or prendre le contrôle de Total qui détient ses actifs à travers le monde n'est pas très commode quand on est chinois.
Donc, 8 % seulement de notre actionnariat provient des pays du Golfe, Abou Dabi notamment, et de la Chine. Compte tenu du fait que ces territoires représentent à peu près 80 % de notre activité, vous voyez que le lien entre nos actionnaires et notre activité n'est pas très bon, d'où notre volonté de le rééquilibrer.
De surcroît, mais cela mériterait un autre débat, nos actionnaires se montrent de moins en moins intéressés par notre style de métiers, alors que les pays émergents le sont beaucoup plus.
Comment se répartissent les 12 milliards d'euros ? Il faudrait plutôt prendre en compte le cash-flow, qui est plus important par définition, mais restons-en au résultat. Sur ce total, 5 milliards d'euros vont à l'ensemble de nos actionnaires. C'est la quatrième année consécutive que nous n'augmentons pas le dividende, alors que les résultats ne sont pas si mauvais.
Bien évidemment, nous avons augmenté les salaires. Comme chacun le sait, nos salariés français bénéficient d'une revalorisation nettement supérieure à la moyenne nationale. Les chiffres sont connus. Il faudra donc penser, à un moment, à rehausser le dividende, d'autant que, faute d'augmentation, la prime pour dividende n'a pu être versée.
Après discussion avec les syndicats, Total a versé à ses salariés, mais pas à tous, une prime de 1 200 euros, venant s'ajouter aux hausses de salaire. C'est, par définition, un montant très nettement supérieur à celui de toutes les primes sur dividende qui ont pu être payées au niveau du CAC 40.
Les investissements du groupe représenteront, en 2012, 16 milliards d'euros, une somme tout à fait considérable, largement supérieure, bien évidemment, aux 5 milliards d'euros de dividende. Sur ces 16 milliards d'euros, 1,5 milliard bénéficie à la France, soit beaucoup plus que ce que nous observons en termes de profits, voire d'opérations.
Contrairement à ce qui est expliqué, Total est un groupe très nettement, pour utiliser un terme anglo-saxon, « leveragé ». Autrement dit, en proportion du niveau de notre activité, nous dépensons beaucoup plus d'argent et sommes bien plus présents dans ce pays. Nombre de sociétés françaises sont d'ailleurs dans ce cas. Cela fait partie de ces mélanges qui sont faits sur les impôts payés par les PME et par les autres. Là aussi, je trouve qu'un tel débat n'a pas lieu d'être, d'où, de temps en temps, une petite forme d'énervement lorsque l'on compare des éléments qui ne sont pas comparables.
Il faudrait rapprocher les résultats obtenus dans un pays du niveau des impôts payés plutôt que de comparer le montant des impôts tel quel. D'autres sociétés du CAC 40, que je ne nommerai pas, bien qu'apparaissant comme très françaises, exercent, contrairement à ce que l'on pense, plus de 90 % de leur activité en dehors des frontières.
Je le reconnais, monsieur le sénateur, Total a un devoir supplémentaire, que nous assumons. La bonne manière de le faire n'est pas en acquittant des impôts qui ne sont pas dus : je ne vois pas pourquoi j'irais demander à payer des sommes quand la loi ne nous l'impose pas.
En revanche, nous avons beaucoup d'activités en France. Lisez la plaquette sur l'activité de Total en France : elle présente tout le travail que nous faisons avec un grand nombre de municipalités et de PME. Ces entreprises n'arrêtent d'ailleurs pas de le reconnaître et de le rappeler. Des prix nous sont même décernés ! Pourquoi cela n'est-il pas « repris », si je puis me permettre ce mauvais jeu de mots ? Je ne sais pas. La société Total est classée comme celle qui est la plus « PME », aussi bien en France qu'à l'étranger. Voilà qui est attesté par Bercy et par beaucoup d'autres.
Nous avons beau le répéter tout le temps - il nous est reproché de mal communiquer, c'est possible - mais le fait que Total puisse aider les PME est, quelque part, impensable pour certains. Notre plaquette est conforme, valide. Si vous voulez la contester, vous avez le droit, mais contestez le papier, le contenu. Les gens préfèrent nier tout simplement les faits, et pas le papier.
Oui, Total apporte son aide aux collectivités en France. Vous n'imaginez pas le nombre de lettres que je reçois chaque jour pour demander de l'aide pour ceci ou cela. Nous y répondons, et c'est normal. Nous avons peut-être tort, monsieur sénateur, mais nous ne faisons pas autant de publicité que nous devrions sur toutes nos actions. Si je vous en dressais la liste, vous seriez très surpris. Savez-vous que nous avons la plus grosse fondation ? Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le, mais en citant des chiffres.
Les chiffres sont implacables. Le fonds Hirsch, c'est nous ; l'ADIE, c'est aussi nous. Nous avons avec leurs responsables des relations absolument extraordinaires et nous avons conjointement décidé de ne pas faire de publicité sur ces actions, pour leur conserver une certaine normalité.
Avons-nous tort de ne pas plus en parler ? La question mérite d'être posée, car beaucoup de gens nous le reprochent. Effectivement, quand on ne communique pas, les autres le font à votre place.
Sur le plan civique, j'y attache une importance tout à fait primordiale, Total fait beaucoup dans ce pays, que nous aimons. Nous préférerions agir avec des partenaires, comme dans le cadre de l'EITI, pour soutenir des objectifs auxquels nous croyons, et pas parce que nous y serions contraints par la loi. C'est en tout cas mon souhait.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai ajouté un petit argumentaire à mon discours : les personnes qui comptent et veulent nous attaquer en ont tout à fait le droit ; mais qu'elles ne viennent pas ensuite demander de l'argent ! C'est mon côté « direct », car il est trop facile de venir demander de l'argent et, après, de nous traiter, entre autres, de « machins », d'« escrocs », pour utiliser des mots qui ont été prononcés, je n'invente rien ! Une brillante candidate à la présidence de la République nous a même comparés à des fabricants de fausse monnaie et a prétendu que, dès qu'elle se levait le matin, j'empestais son atmosphère.
Non, mais ils ont été prononcés par une candidate à la présidence de la République, tout de même ! Quelle ne fut pas ma surprise de voir le débat atteindre ce niveau, d'autant que je n'ai pas entendu beaucoup de politiques s'y opposer...
J'ai parlé des impôts payés en France.
Pour ce qui est de la divulgation de nos comptes, nous sortons une grande quantité de documents : outre les nombreux communiqués, nous publions une revue spéciale à destination des parlementaires. Par définition, tous les comptes sont publiés. Je viens moi-même les expliquer quand on m'y invite, dans le cadre d'auditions organisées aussi bien à la Chambre qu'au Sénat. Je suis prêt à le refaire, en toute transparence.
Si je ne suis pas sûr que le grand public attende une explication globale sur nos comptes consolidés, j'estime que les représentants de la Nation ont le droit de l'avoir. Je suis non seulement prêt à la fournir, mais demandeur. Nous le faisons tous les ans devant nos actionnaires. Vous pouvez venir à nos assemblées, qui rassemblent plus de 3 000 personnes, à 99 % françaises.
J'ai été interrogé sur la gouvernance et le « civisme fiscal ». Je n'ai malheureusement pas de réponse précise à apporter, car je ne comprends pas très bien ce que cette dernière notion recouvre. Payer des impôts que l'on ne doit pas, en quoi est-ce du civisme ? Ce serait même un ABS, mais, là, je fais de la provocation !
Quant à la question de savoir si Total utilise des mécanismes pour ne pas payer les impôts futurs, je réponds « non » pour la France. Cela existe à l'étranger, sous le nom de tax holiday.
Cet outil était fort peu intéressant dans le cadre du bénéfice mondial consolidé : dans la mesure où celui-ci était retraité en France, le fait d'obtenir une tax holiday à l'étranger ne servait à rien. Maintenant que le BMC est supprimé, ce genre d'avantage contractuel devient plus attractif. C'est un mécanisme tout à fait légal, qui a surtout cours dans les pays du Golfe : pour lancer une activité très lourde en investissements, à hauteur de plusieurs milliards d'euros, mais dont les premiers résultats sont faibles, on vous donne la possibilité de différer vos paiements d'impôts à une échéance de cinq ou dix ans, avec effet permanent ou rétroactif ; tous les cas de figure existent. Bien évidemment, cela fait partie de la panoplie des avantages fiscaux susceptibles d'être octroyés par certains pays à Total.

Total a réalisé 12 milliards d'euros de bénéfices en 2011, dont 5 milliards consacrés à la rémunération des actionnaires. J'ai bien entendu votre propos sur les investissements. Mais quel est le montant de l'impôt sur les bénéfices en France : 1,5 milliard d'euros ?
Non, 300 millions d'euros.

Quel taux effectif d'impôt sur les sociétés ces 300 millions d'euros représentent-ils ?
Pour l'instant, Total enregistre un excédent net d'exploitation négatif. Le taux effectif est en fait de 36,10 %.
Monsieur Vaugrenard, nous en revenons à notre échange sur l'image. Nous parlons ici de sommes sur lesquelles nous avons payé de l'impôt ailleurs. En France, nous n'avons pas gagné d'argent. Pourtant, nous acceptons de continuer à y travailler, à y avoir notre personnel, nos sites, nos centres de recherche. Trouveriez-vous normal que Total paie en France un impôt sur de l'argent gagné en Grande-Bretagne ? Qu'en penserait le citoyen britannique ?
A quel niveau placez-vous les 50 % d'impôts prélevés sur le prix à la pompe ? Ceux-ci ne sont certes pas payés par Total, mais sont tout de même pris sur les produits pétroliers. Quid de la valeur ajoutée créée en France ? Et des 3,8 milliards d'euros de masse salariale que nous y payons ?

Nous pourrions avoir un échange là-dessus. Ce serait avec plaisir, mais là n'est pas le sujet.
C'est vous qui l'avez lancé. Je suis bien obligé de répondre, sans quoi l'image du groupe en pâtira.

Si je le fais à mon tour, nous allons y passer la matinée et une partie de l'après-midi. Or je souhaite que vous répondiez aux autres questions que je vous ai posées. Il était important d'obtenir des informations sur les 300 millions d'euros et les 12 milliards d'euros, pour que chacun puisse se faire sa propre opinion.
Ces montants vous étaient-ils inconnus ?

Vous les avez évoqués tout à l'heure, mais cela me semblait important de les souligner de nouveau.
Vous avez indiqué être favorable à une information complète par rapport au bénéfice mondial consolidé, y compris envers la presse, à condition, bien entendu, je vous entends, d'être suffisamment didactique pour être compris par tout le monde. Je le serai également.
Je vous ai posé deux autres questions précises. Est-il arrivé que Total négocie une exonération pour ne pas avoir à payer d'impôt sur les profits à venir ? Au titre de l'exemplarité, puisqu'il en a été beaucoup question, quel est l'écart de revenu, chez Total, entre celui qui touche le moins et celui qui touche le plus ?
Je commencerai par la seconde question, ô combien complexe, puisque mon salaire, c'est bien connu, est tenu secret... Voyez, cela fait partie des sujets que j'aime bien. Imaginez qu'il s'est même trouvé quelqu'un pour demander une résolution spéciale afin que soit publié, comme si c'était compliqué à calculer, le rapport entre le SMIC et mon salaire ! J'espère, monsieur le sénateur, que vous connaissez le montant du SMIC ; pour ce qui est de mon salaire, vous devez le connaître également.

Je pensais que votre convention collective prévoyait un salaire minimum supérieur au SMIC.
Absolument ! Mais je trouve cette question véritablement gratuite. Mon salaire est bien connu et très simple à calculer : j'ai touché, en 2011, 1,5 million d'euros de part fixe et 1,53 million d'euros de part variable, soit 3,03 millions d'euros, montant en baisse par rapport à 2010. Je vous communiquerai par écrit le salaire le plus bas de Total.
Je ne sais pas s'il faut parler d'exonérations, mais Total a, il est vrai, obtenu en France, comme de nombreuses autres sociétés, des subventions pour investissement, conformément au droit commun, et ce dans un certain nombre de domaines. Je pense en particulier à la raffinerie de Gonfreville.
Tout cela est bien connu et a été accepté par les différentes instances compétentes. Nous avons également bénéficié de déductions fiscales liées à nos dépenses de recherche. Nous n'avons rien négocié, nous nous sommes contentés d'appliquer le droit. A l'étranger, en revanche, la fiscalité fait partie intégrante des négociations contractuelles. Je citerai de nouveau la tax holiday.
Le groupe étant très grand, je me dois d'être précis dans les chiffres.
Pour la branche pétrole France, la négociation salariale a porté la rémunération minimale annuelle garantie en France à 22 900 euros, soit 37 % de plus que le SMIC. Je connais ces chiffres puisque je préside le CCE français et européen. Nous avons un grand débat parce que toutes les sociétés du groupe n'ont pas les mêmes conditions de travail ni les mêmes salaires.
C'est vrai que la branche pétrole est plus avantagée que les autres, compte tenu des revenus tirés de cette activité. Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, j'indique que, pour les personnels travaillant dans nos stations-service, lesquelles appartiennent à d'autres filiales du groupe, le rapport est moins en faveur des salariés, les salaires étant plus proches du SMIC.
Pour vous livrer une réponse précise, il faudrait que je vous donne les montants au niveau de ce que l'on appelle les US du groupe, les US étant les unités sociales.

Monsieur le président-directeur général, dans la mesure où la commission a toujours travaillé de manière résolue, mais très paisible, je souhaiterais que la discussion puisse continuer sur un ton calme et courtois, de part et d'autre.
J'ai relevé dans vos propos un élément qui me semble important. Il y aurait, quelque part, un malentendu ou un « pas entendu », en tout cas une incompréhension, entre ce que vous pensez être votre politique en matière d'impôt et de fiscalité et la perception qu'en ont un certain nombre de nos concitoyens, qui ne seraient peut-être pas assez informés.
Je confirme pour ma part que les parlementaires sont tout à fait informés. Nous recevons une littérature abondante de votre service communication, qui travaille très bien. Nous pouvons donc nous plonger dans les chiffres que l'on veut bien nous donner.
J'ai une question assez simple à vous poser, mais n'y voyez ni provocation ni malice de ma part.
Si vous deviez, pour l'avenir, modifier la géographie des implantations de vos filiales afin de la mettre en résonance avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la mauvaise perception, qu'en ont nos concitoyens, à tort ou à raison, quels seraient les pays ou les destinations que vous jugeriez emblématiques pour montrer, si, bien sûr, vous en aviez l'intention, que Total a saisi un certain message ?
Je vous poserai une seconde question, là aussi sans la moindre malice ni l'once d'une provocation - ce n'est pas du tout mon genre, mes collègues le savent bien. Quelles seraient, de votre point de vue, les mesures à prendre par Total si un réel civisme écologique devait être amené à se développer ? J'ai bien entendu tout ce que vous faites déjà avec les fondations, notamment vos actions en faveur de l'environnement, que je ne conteste à aucun moment. Convenez tout de même que cela n'efface pas l'Erika.
Telles sont les deux questions matérielles et factuelles que je vous pose.
D'abord, je tiens à dire que je ne me suis pas senti du tout attaqué. Il m'arrive, c'est vrai, de répondre de manière un peu directe. Certaines questions, je le comprends, dépassent forcément le cadre de la simple interrogation, puisqu'elles contiennent déjà une partie de la réponse. C'est pour cela que je me permets de parler plus franchement, mais n'y voyez aucune agressivité de ma part. J'y insiste, nous sommes là pour donner, dans la transparence, les explications nécessaires.
Nous savons que ce sujet des 300 millions d'euros versus 12 milliards peut nourrir un certain sentiment de complexité. Mais n'oublions pas un élément important. Moi qui suis connu pour parler assez librement et simplement avec beaucoup de monde, je suis toujours surpris par l'écart de perception que je constate entre, d'un côté, ce qu'il nous est très souvent présenté comme l'opinion publique, et, de l'autre, l'homme ou la femme de la rue.
Cela va peut-être vous paraître curieux - ou alors je ne rencontre que des gens particulièrement gentils... -, mais ceux à qui j'explique le pourquoi de ces 300 millions d'euros ou de mon salaire le comprennent assez bien. Je prends des exemples tout simples.
Je retire effectivement les 12 milliards d'euros pour éviter que cela ne fausse le débat et je parle beaucoup plus d'équilibres d'épicerie : voici ce que je gagne, voilà ce que je dépense, voilà comment je fais à la fin. Je vous assure que mes explications passent plutôt bien. Si le montant de l'impôt payé en France pose problème, c'est que les gens pensent que Total y gagne de l'argent. Le vrai sujet est là. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut le faire croire en évoquant des prix de transfert extraordinaires. Les Français croient ainsi que nous gagnons des fortunes à la pompe et ne comprennent donc pas pourquoi nous ne payons pas d'impôt.
A ce moment-là, ils ne devraient pas comprendre non plus pourquoi le fisc - disant cela, je mets les parlementaires et les responsables de ce pays en face de leurs responsabilités -, au lieu de nous laisser en butte à ces attaques et d'entrer dans un jeu à mon avis néfaste, n'explique pas que Total ne fait qu'appliquer le droit en vigueur. Personne n'a intérêt à ce que notre groupe ne soit pas bien vu par nos propres concitoyens. En tout cas, pas moi. Je ferai tout pour me battre sur ce point.
Le vrai sujet, ce n'est pas les 300 millions d'euros, c'est le fait que les gens pensent que nous ne disons pas la vérité, que nous gagnons beaucoup plus, qu'une bien plus grande part des 12 milliards d'euros nous revient. Il n'est pas normal de laisser continuer à le faire croire, alors que tel n'est pas le cas.
Je vais me battre différemment. Je ne parlerai plus du tout des 14 milliards d'euros, qui passent moyennement bien. J'expliquerai vraiment quels sont nos résultats en France et leur origine. Cela gênera plus de monde parce qu'il va falloir que l'on s'explique sur les raisons pour lesquelles Total ne peut pas gagner suffisamment d'argent en France pour payer des impôts.
Ma marque de civisme, ce sera d'expliquer que Total peut gagner de l'argent en France à condition qu'on le laisse en gagner, au lieu d'exiger que nous payions des impôts que nous ne devons pas. Voilà un débat qui s'annonce intéressant. Il faudra que notre service communication monte encore d'un cran en termes de capacité !
Mon propos n'était pas sans lien avec la question relative à l'implantation géographique, car le premier pays, à nos yeux, c'est la France. Est-il normal que Total y exerce une activité ? Ce n'est pas par hasard que je me suis ainsi exprimé.
Effectivement, compte tenu de la manière dont cela se passe en France, de nombreux actionnaires trouvent que nous y faisons trop de choses. C'est la première fois depuis quelques années que nous sommes fortement questionnés - je n'irai pas jusqu'à dire « attaqués » - par nos actionnaires étrangers. Globalement, dans la mesure où ils constatent que certains n'arrêtent pas de nous traiter de « voyous », de « machins », ils ne comprennent pas pourquoi nous continuons à investir sur le territoire national, alors que nous n'y gagnons pas d'argent.
Je suis amené à leur répondre que Total peut gagner de l'argent en France. Notre entreprise y compte d'excellents employés, y développe des technologies de première classe : nous avons pu, dans la douleur, engager les restructurations nécessaires ; cette condition étant réalisée, nous devrions être en mesure d'investir des sommes importantes.
Notre premier pays est donc bien la France, d'où mon explication initiale.
Par ailleurs, nous sommes forcément amenés, compte tenu de notre métier, à aller dans des pays qui ne sont pas considérés comme les plus démocratiques de la planète. En même temps, de temps en temps, nous y observons des avancées.
Je prendrai volontairement un exemple qui me fait plaisir, celui de la Birmanie. Total y a pris des risques importants, en montrant une capacité à rester travailler là-bas tout en respectant un code de conduite. La Lady, prix Nobel, que je connais, n'a jamais prononcé depuis des temps immémoriaux - 1997 - les propos qu'on lui a prêtés : non, on n'allait pas voir ce qu'on allait voir, elle n'allait pas demander à Total de partir lorsqu'elle serait aux responsabilités !
Non seulement nous sommes toujours présents en Birmanie, mais tout le monde y revient, les Anglo-Saxons en force, notamment les Américains. J'espère que la France aura le courage de ne pas simplement jouer les redresseurs de conscience pour assumer le rôle qui lui revient, travailler à l'international.
Je suis très fier que Total ait pu contribuer à une certaine forme d'apaisement dans un pays dont la situation, sur le plan politique, s'améliore mais reste compliquée. J'ai un petit scoop à livrer : je dois rencontrer la Lady bientôt, ce qui est un grand bonheur personnel.
Nous irons toujours dans les pays où il faut aller. Mais nous ne pouvons pas quitter les régions où nous sommes installés. Notre activité, faite de lourds investissements, ne se résume pas ainsi : « J'entre, puis je m'en vais. » Un exportateur ou un importateur a la possibilité d'arrêter ses relations commerciales avec tel ou tel pays. Total ne peut pas ainsi laisser une plateforme au milieu de la nature, en disant : nous reviendrons dans deux ou trois ans, lorsque l'opinion publique, pour reprendre cette expression à mon compte, l'aura décidé. Cela nous pose effectivement des problèmes importants. Malgré tout, in fine, si nous n'y arrivions pas, nous serions amenés à partir.
Le Yémen est aujourd'hui l'un des plus gros soucis de Total. Nous avons de très grosses opérations en cours là-bas. Vous savez ce qui s'y passe sur le plan physique : deux de nos employés ont été touchés, l'un tué, l'autre blessé. Nous sommes à la limite de l'acceptabilité.
Pour autant, le pétrole vient de là, tout comme le gaz. Je le dis avec beaucoup de conviction, n'y voyez pas l'indice d'un capitalisme mal éclairé : quitter de tels pays, c'est aussi les priver d'une partie de leurs possibilités d'accéder à terme à la démocratie.
Nous ferons en sorte de peser systématiquement le pour et le contre et d'expliquer les raisons pour lesquelles Total ne peut pas simplement partir. Pourtant, en termes de communication, il pourrait paraître parfois plus facile - cela arrangerait beaucoup de monde - de décider que, si tel pays n'est pas bien, nous le quittons. En plus, je le dis très honnêtement, compte tenu de nos résultats, nous pourrions souvent nous permettre de le faire pour nous simplifier la vie, sans que cela touche en rien nos résultats ou notre éthique.
Notre première manière d'agir, c'est de nous intéresser à différentes sortes d'énergies, pas simplement au pétrole ou au gaz.
A la plus grande surprise de certains, nous avons fait une grosse acquisition dans le solaire, aux États-Unis, mais nous travaillons un peu partout dans le monde, y compris en France. La tâche n'est pas facile, car le solaire va mal.
Le meilleur moyen pour nous d'être véritablement écologiques et efficaces n'est pas d'aller payer une taxe carbone ; c'est de réduire nos émissions. Nous prenons en compte, dans le cadre de tous nos investissements, les éléments susceptibles de nous permettre d'émettre moins. Surtout, nous allons chercher, y compris dans les métiers qui ne sont pas forcément les nôtres, des sources nouvelles, non seulement pour émettre moins de CO2, mais aussi pour alléger la pression sur les produits en carbone.
Aujourd'hui, le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas assez d'énergie pour faire face à la demande mondiale, et pas simplement en Europe. Le seul point où nous avons quelques petites divergences avec certains écologistes tient au rôle que l'Europe peut jouer : celle-ci n'a pas à porter tous les maux de la planète ; il y a effectivement une limite à ce que l'Europe et ses industries, pas seulement Total, peuvent supporter par rapport aux autres.
L'Europe ne doit pas oublier qu'elle est une toute petite partie du monde, même si c'est probablement celle qui a fait le plus en matière d'environnement.
Simplement, sans qu'il soit du tout question de mettre en avant nos « superprofits », il faut à un moment garder une certaine forme de concurrence pour pouvoir continuer à agir sur le marché.

Je reviendrai sur l'impôt national. Total compte en France, me semble-t-il, 2 000 chercheurs sur 7 centres de recherche. Votre entreprise a-t-elle bénéficié du crédit d'impôt recherche ? Si oui, avez-vous fait en sorte, dans la limite de ce que vous permettent les textes, d'en bénéficier au maximum ?
Vous nous avez dit avoir créé de nombreuses PME-PMI. Celles-ci incluent-elles des structures du type SAS, axées sur la recherche mais dont le but est surtout de payer moins d'impôts ? N'y voyez aucun reproche de ma part, puisque les textes le permettent, ce qui n'est d'ailleurs pas sans nous interroger. Cette recherche a-t-elle permis de développer des produits en France ou à l'étranger ?
Oui, nous avons bénéficié du crédit d'impôt recherche, pour un total de 66 millions d'euros. Je peux vous le dire, puisque j'ai décidé de parler tout à fait ouvertement : ma première réaction fut de ne pas utiliser cet argent ; du fait de ce fameux syndrome qui nous conduit à toujours peser nos actes, je craignais que l'on ne fasse reproche à Total de profiter de ces subventions. On imagine les questions : pourquoi de telles subventions ? Pourquoi à Total ?
Il m'a alors été demandé par plusieurs personnes responsables - je ne dirai pas lesquelles - de faire en sorte que Total montre l'exemple. Comme le mécanisme n'a pas bien fonctionné au départ, on nous a invités à revenir à la normalité et à utiliser ce crédit d'impôt de droit commun. C'était d'autant plus justifié que Total venait de sortir du dispositif du BMC.
Nous n'avons créé aucune société ad hoc à cette fin, nous contentant de ne participer qu'à des structures existantes. Nous avons suivi notre propre vocation, en accroissant, par exemple, notre effort de recherche dans le solaire, notamment au niveau de Tenesol. Nous avons investi dans de nombreuses start-up, ne recourant à aucun - je dis bien aucun - mécanisme particulier pour bénéficier de ce crédit d'impôt.
Bercy a même reconnu notre exemplarité en la matière, ce à quoi je tenais tout particulièrement. Franchement, je me suis posé beaucoup de questions ; je me doutais qu'il y aurait des commentaires. Total a touché de l'argent par ce biais, oui : c'est une société « normale ».
Le danger que je perçois bien, c'est justement qu'à la suite de ce genre de réactions extérieures nous avons nous-mêmes tendance à ne pas nous considérer comme une entreprise normale, finissant par renoncer à certaines actions par peur qu'on nous les reproche.
Il est heureux que nous ayons normalement utilisé le crédit d'impôt recherche, car cela a contribué à donner un élan, à entraîner beaucoup d'autres derrière nous.
Il nous avait été reproché de ne pas jouer de rôle de leader. Nous l'avons fait. C'était, je crois, nécessaire. Avec les 66 millions d'euros, nous sommes loin d'avoir épuisé le quota français. Le crédit d'impôt recherche est, selon moi, un mécanisme intelligent.
Je rappelle enfin ce que j'ai dit tout à l'heure : Total réalise à peu près la moitié de son effort de recherche en France, exploration mise à part, bien évidemment.

Monsieur de Margerie, j'aimerais revenir au coeur du sujet qui préoccupe la commission après les propos que vous avez tenus.
Si je comprends bien, l'abandon du mécanisme du bénéfice mondial consolidé, qui concernait six grandes sociétés nationales, a finalement occulté la possibilité, pour le fisc français, de contrôler ce qui se passe dans les filiales à l'international. Apparemment, tant qu'il y avait le BMC, Bercy pouvait avoir l'intégralité des comptes des sociétés, quelle que soit leur localisation, y compris quand elles étaient logées dans des paradis fiscaux.
Par ailleurs, j'ai bien noté que, même si Total utilise des structures de sociétés de ce style, pour telle ou telle opération internationale, le fisc est néanmoins informé par vos soins en vertu des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts, les bénéfices réalisés dans ces paradis fiscaux étant imposés à 36 %.
Si résultat il y a !

Autrement dit, vous continuez à agir à l'égard du fisc d'une manière à peu près équivalente à celle qui prévalait à l'époque du mécanisme du bénéfice mondial consolidé. C'étaient les précisions que je souhaitais avoir.
Rappeler cette réalité est très important. A l'évidence, nous ne sommes pas sortis du bénéfice mondial consolidé pour ne plus être transparents et en profiter pour retourner à l'âge de pierre !
Nous continuons, par définition, à respecter la loi. N'oublions pas le débat qui a eu lieu sur le BMC. D'aucuns, prétendant, à tort, que ce mécanisme faisait gagner des milliards à Total, ont affirmé que la meilleure manière d'agir était d'en sortir. Nous en sommes sortis. Les gens vont bien voir que cela ne va rien changer, ou très peu, en matière de résultats et d'impôts français.

L'un des défauts du BMC a été décrit par M. Vaugrenard : pour beaucoup, il semblait que c'était une transaction entre Bercy et la société concernée. Mais enfin, ne rouvrons pas le débat !
Rappelons tout de même qu'un tel mécanisme a été voté par le Parlement.

Nous ne pourrons pas évoquer ce matin tous les sujets figurant dans le questionnaire que nous vous avons adressé. Nous vous demandons donc de bien vouloir nous communiquer par écrit les réponses détaillées aux questions qui resteront en suspens.
Je terminerai en posant deux questions.
D'une part, considérez-vous que la création de valeur appréhendée par les fiscs étrangers dans les pays où vous intervenez correspond bien à la création de valeur économique du groupe ? Par exemple, la rente pétrolière est-elle, selon vous, correctement distribuée ?
D'autre part, quelle est la position de votre groupe sur le projet de directive communautaire proposée par notre commissaire Michel Barnier, dont l'objet est d'imposer un reporting pays par pays et projet par projet, aux industries extractives notamment ?
Nous répondrons évidemment à toutes les questions. J'ai tout de même l'impression que nous en avons déjà traité 90 %.
Le mode de répartition de la rente est un sujet très compliqué, parce qu'il faut engager la discussion pays par pays, les autorités locales réagissant différemment quant à la propriété du sol.
L'Irak propose des conditions contractuelles extrêmement agressives, que nous considérons comme insuffisantes pour nous développer. Tout le monde sait que j'ai demandé à ce que nous travaillions le moins possible en Irak tant que cette situation perdurerait : Total y gagne un peu plus de un dollar par baril, d'où des résultats très faibles. Je ne vois pas pourquoi nous ferions autant d'efforts pour rencontrer de telles difficultés, quand bien même l'Irak est un pays historique pour Total. En termes d'image, en particulier pour moi, l'impact n'a pas été très positif. Il faut donc savoir être clairs.
Le grand sujet aujourd'hui, c'est de quantifier ce que l'on doit recevoir par rapport à ce que l'on apporte, de définir le juste rapport entre la valeur ajoutée, comme vous dites, et le profit. Selon les pays et la culture, c'est très différent. Il faut tenir compte de ce que les pays veulent. Nous essayons de faire comprendre que l'intérêt est d'établir un partenariat sur le long terme. Notre politique est de nous conduire dans un pays comme une société non pas française, mais locale : le Parlement et les autorités locales deviennent alors responsables de nos activités. S'il n'y a plus de « supra-territorialisme » français dans ce domaine, pour autant, il faut pouvoir travailler dans un cadre satisfaisant.
Si certains veulent un plombier, pour reprendre un terme que j'ai utilisé à plusieurs reprises, qu'ils prennent un plombier ! Avec Total, ils avaient un investisseur, qui s'engageait dans la recherche, l'éducation. Nous nous occupons désormais de certaines écoles et pas simplement du seul volet financier. Nous nous sommes lancés dans un domaine tout à fait nouveau, ce qui n'a pas été facile. En France ou dans d'autres pays, que je ne nommerai pas, il arrive de temps en temps qu'une société privée s'entende dire : c'est bien que vous interveniez, mais, attention, vous n'êtes pas chez vous !
Le groupe Total a pu démontrer que, sans se substituer à l'éducation nationale, il pouvait, plutôt que de simplement donner de l'argent, participer véritablement à des développements complémentaires.
Pour cela, nous devons obtenir un profit qui couvre non pas simplement l'investissement, mais aussi l'exploration et les dépenses futures. Nous tâchons de négocier projet par projet, pour nous permettre de rester le plus longtemps possible sur place sans avoir à ouvrir de nouvelles négociations.
Cela ne fonctionne pas dans tous les pays. Chacun ayant sa propre culture, je ne peux pas faire de réponse générale.

L'État français intervient-il sur ce dossier de la rente pétrolière, notamment en Europe, puisque vous avez cité les chiffres pour le Royaume-Uni et la Norvège ?
Non ! Nous entrons là dans un domaine très spécifique et extrêmement technique. À l'époque des fameux contrats de partage de production, il n'y avait pas d'impôt en tant que tel : puisqu'il nous fallait effectivement des crédits d'impôt pour pouvoir faire fonctionner le système, nous avons dû discuter avec Bercy pour faire reconnaître le partage de production comme un équivalent d'impôt.
Il y a donc bien eu ce genre de discussions, mais au niveau de l'administration, pas de l'État. Pour le reste, ce sont des rapports d'État à État.
La politique joue-t-elle un rôle ? Oui. Lorsque le Président de la République se rend dans un pays et qu'il parle de Total, cela peut nous aider. Mais tous les présidents, de gauche comme de droite, ont agi de la sorte. Cela s'appelle du soutien aux entreprises. J'espère bien que nous continuerons à en recevoir, parce que les sociétés anglo-saxonnes ne se privent pas sur ce plan.
J'en viens, monsieur le rapporteur, à la proposition de directive du commissaire européen, dont je ne cite pas le nom à dessein.
A mon sens, cette proposition va trop loin. D'ailleurs, lui-même a dû le remarquer aussi, puisqu'il a fait évoluer son idée : il est désormais question de sortir du seul cadre des industries extractives pour englober l'ensemble des sociétés.
Même si je continue à ne pas trouver cette proposition très bonne, un tel élargissement permet d'éviter tout risque de stigmatisation. Nous nous sommes battus pour que les règles de transparence soient valables pour tous, pas uniquement pour les compagnies pétrolières.
Pour autant, je ne pense pas qu'il faille aller aussi loin. Le développement projet par projet est, pour moi, une hérésie. On est en train de fabriquer un monstre administratif épouvantable. A un moment où nombreuses sont les personnes qui se plaignent de Bruxelles, bravo !... Ce n'est pas ainsi que cela va marcher.
Il n'appartient pas à des technocrates, si brillants et compétents soient-ils, d'aller vérifier nos contrats, d'autant que ceux-ci intègrent une importante partie commerciale secrète. Il y a d'autres manières pour faire respecter le droit et la loi.
Il s'agit d'une forme de suspicion complète : dès lors que l'on nous demande à voir les contrats, c'est vraiment la preuve que plus personne ne nous croit. Dans ces conditions, soyons clairs : plus de commissaires aux comptes, plus d'audit, plus rien ; allonsy, étalons tous les comptes et demandons à des fonctionnaires à Bruxelles de vérifier leur légalité !
C'est aller beaucoup trop loin ; c'est de la démagogie, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Nous sommes favorables à plus de transparence, notamment dans le cadre de l'EITI. Nous sommes prêts à venir expliquer nos comptes aux parlementaires autant de fois que nécessaire, à les justifier à 100 %. Mais n'en arrivons pas à faire passer les contrats au crible de fonctionnaires à Bruxelles.

Monsieur le président-directeur général, il me reste à vous remercier de ces réponses aussi complètes que toniques !
Audition de Mm. Laurent Guillot directeur financier de la compagnie saint-gobain marc-antoine jamet secrétaire général de lvmh moët hennessy xavier de mézerac directeur financier d'auchan pierre-françois riolacci directeur financier de veolia environnement et dominique thormann membre du comité exécutif directeur financier de renault
Audition de Mm. Laurent Guillot directeur financier de la compagnie saint-gobain marc-antoine jamet secrétaire général de lvmh moët hennessy xavier de mézerac directeur financier d'auchan pierre-françois riolacci directeur financier de veolia environnement et dominique thormann membre du comité exécutif directeur financier de renault

Mes chers collègues, nous accueillons MM. Laurent Guillot, directeur financier de la Compagnie de Saint-Gobain, Marc-Antoine Jamet, secrétaire général de LVMH Moët Hennessy, Xavier de Mézerac, directeur financier d'Auchan, Pierre-François Riolacci, directeur financier de Veolia Environnement, et Dominique Thormann, membre du comité exécutif, directeur financier de Renault.
Messieurs, je vous rappelle que, conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
En conséquence, je vous demande de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites : « Je le jure ».
(MM. Laurent Guillot, Marc-Antoine Jamet, Xavier de Mézerac, Pierre-François Riolacci et Dominique Thormann prêtent serment.)
Je vous remercie.
Messieurs, je vous propose de commencer l'audition par un exposé liminaire dans lequel vous présenterez rapidement votre société par rapport au questionnaire qui vous a été adressé par le rapporteur, M. Éric Bocquet, puis de répondre aux nouvelles questions qu'il pourra vous poser et éventuellement à celles que vous soumettront les autres membres de la commission.
Monsieur Guillot, vous avez la parole.
Je commencerai mon intervention par une brève description du groupe Saint-Gobain parce qu'elle a un impact sur la problématique qui vous intéresse.
Aujourd'hui, le groupe Saint-Gobain a un chiffre d'affaires de 42 milliards d'euros. Nous produisons et distribuons des matériaux de construction dans soixante pays ; nous avons 200 000 collaborateurs. Notre stratégie est de concevoir, de produire et de vendre des produits à valeur ajoutée dans l'habitat. Pour cela, nous avons un portefeuille de produits que je vous décris brièvement : le produit emblématique est évidemment le verre, dans lequel nous oeuvrons depuis près de 350 ans, auquel il convient d'ajouter toute une série de produits d'isolation, les plaques de plâtre, les mortiers. Nous sommes également présents à travers des grandes marques que sont Placo pour la plaque de plâtre, Isover pour l'isolation. Nous sommes aussi présents dans la distribution de matériaux de construction, à savoir, en France, Point P ou Lapeyre.
J'insiste sur ce portefeuille et sur notre stratégie parce qu'il en découle l'une des deux caractéristiques principales du groupe sur le plan fiscal.
La première caractéristique, c'est que nous vendons et distribuons des produits généralement locaux : soit des produits pondéreux, soit des produits qui, du fait de leur faible coût par rapport aux coûts de transport éventuels, ne peuvent pas être distribués sur de très longues distances. Je citerai deux exemples : les mortiers, composés de sable et de ciment, qui remplacent le mélange réalisé sur site, ne se déplacent pas à plus de cinquante à soixante kilomètres ; les coûts de transport du verre plat, notre produit historique, deviennent prohibitifs au-delà de cinq cents kilomètres. Par conséquent, 85 % à 90 % du portefeuille de nos produits se transportent très mal au-delà de cinq cents kilomètres. Nous produisons localement pour vendre localement.
Vous nous avez interrogés notamment sur les transferts. Il en existe, puisque nous avons des usines en Allemagne et que nous ne nous privons pas de produire dans ce pays quand nous en avons la capacité pour livrer la France, et inversement. Cependant, les transferts sont limités à des pays de proximité et représentent une faible part de notre chiffre d'affaires. Nous estimons que 15 % à 16 % de notre chiffre d'affaires traverse une frontière, ce qui est peu important.
A l'inverse, comme je l'ai dit en introduction, nous sommes présents dans soixante pays, dans lesquels nous produisons localement pour vendre localement. Vous nous avez envoyé une liste de pays. Oui, nous avons des usines et des magasins en Suisse, où nous réalisons un milliard d'euros de chiffre d'affaires : le marché suisse est fantastique et nous n'allons pas nous en priver ! Nous sommes également présents au Chili, en Malaisie. Nous sommes même implantés en Uruguay, pays encore plus compliqué sur le plan fiscal, où nous détenons un dépôt de distribution. Nous possédons une très belle usine de verre plat en Argentine et, pour faciliter les transports, nous avons des activités en Uruguay. Cela ne veut pas dire que nous y réalisons de l'optimisation fiscale. Nous sommes présents dans de très nombreux pays sous forme d'établissement industriel et commercial.
Notre deuxième caractéristique, qui tient au système fiscal français, est que nous relevions du régime du bénéfice mondial consolidé jusqu'en 2006. Ce régime était favorable aux entreprises qui se développaient à l'étranger, puisqu'il permettait aux nouveaux établissements, qui perdent souvent de l'argent au début, d'obtenir des réductions d'impôts en France. Il fut extrêmement favorable au développement international du groupe. Nous étions implantés dans cinq à dix pays au début des années quatre-vingt, et ce n'est qu'à partir de cette date que nous avons opéré une importante extension géographique, très profitable à la stabilité du groupe et à celle de l'emploi en France.
En contrepartie, notre structure juridique n'a fait l'objet d'aucune optimisation locale, puisque celle-ci se serait retrouvée en négatif dans le bénéfice mondial consolidé. Nous avons encore aujourd'hui plus d'un millier de sociétés juridiques qui n'ont pas été consolidées pour profiter de la consolidation fiscale dans tel ou tel pays. Nos structures juridiques sont totalement liées non pas à des questions fiscales mais à la structure de management du groupe. Nos structures organisationnelles se définissent donc par métier et ne sont nullement liées à une quelconque optimisation fiscale. Cela ne signifie pas que nous n'en faisons pas. Depuis que nous sommes sortis du bénéfice mondial consolidé, ma première réaction, quand je suis arrivé au Brésil en 2007, a été de mettre sous un même chapeau toutes les entités juridiques pour bénéficier de la consolidation locale brésilienne.
Cette situation n'est pas sans conséquence sur notre organisation fiscale. Celle-ci est très décentralisée puisque notre équipe centrale, à Paris, compte moins d'une dizaine de personnes. Dans les délégations, nos équipes sont composées de une à trois personnes, parfois plus dans les pays où l'administration de la fiscalité est très lourde. Dans un pays comme le Brésil, où même l'expéditeur, dans une usine, est considéré comme traitant de questions fiscales, l'équipe peut être un peu plus importante. Le travail administratif, sur le plan fiscal, est plutôt réalisé par des comptables, dont l'objectif est de remplir correctement les liasses fiscales et de faire correctement leur travail sur le plan administratif.
Je ne dis pas que nous ne faisons pas d'optimisation. Par exemple, nous sommes en train de réaliser un important investissement en Colombie, pays dans lequel il existe des zones franches. Il est évident que nous avons un intérêt fiscal à utiliser ces zones franches pour notre investissement à destination du marché colombien. Clairement, notre organisation n'est pas en place pour faire plus que cela. Nous n'y avons pas intérêt compte tenu de la nature locale de nos métiers, et ce n'est pas notre objectif.
Telle est l'introduction que je souhaitais vous présenter, articulée autour des deux points que sont les métiers locaux et le bénéfice mondial consolidé.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs, dans la même optique que mon collègue, j'essaierai de répondre à quelques-unes des questions qui m'ont été posées dans le questionnaire et en même temps de dresser avec précision les contours actuels du périmètre du groupe afin que sa perception soit la plus exacte possible.
Nous sommes un groupe français, leader mondial du luxe, qui réalise environ 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires et un peu plus de 5 milliards d'euros de résultats. La réalité est cependant plus complexe.
Nous avons souvent été décrits comme un géant institutionnel centralisé, homogène et parisien, alors que, d'une certaine façon pour analyser nos résultats et notre stratégie, y compris notre stratégie fiscale, nous sommes plutôt une confédération d'entreprises de tailles moyenne, petite ou grande.
Nous sommes une création assez récente. Si les maisons sont anciennes, le groupe a une double naissance : en 1984, puis dans le milieu des années quatre-vingt-dix.
Nous sommes également en évolution constante de périmètre ou de produits, en voie continue de modernisation ou de professionnalisation.
Nous sommes moins parisiens qu'il n'y paraît : nous sommes provinciaux à travers le champagne, le cognac, notre réseau d'ateliers de fabrication de la mode et de la maroquinerie, notamment en Lozère, dans le Calvados, la Drome, sans oublier les parfums et les cosmétiques, qui sont concentrés dans le Loiret ou l'Eure-et-Loir. Le groupe est donc assez différent de la vision que l'on peut en avoir en lisant rapidement certains articles de presse.
Notre groupe paraît très monolithique alors qu'il est au contraire assez fluide. Je dirais, par analogie avec les collectivités locales, qu'il est, sinon décentralisé, en tout cas déconcentré à travers une soixantaine de marques, 600 sociétés et filiales, 3 000 magasins. Cela produit non pas une confusion ou une dissimulation, mais au contraire une vérité de gestion et une très grande transparence. C'est un instrument de gestion, un business model important pour nous, qui explique que la taille de la holding soit assez petite par rapport à la plupart de nos concurrents, rivaux et amis, beaucoup plus petite que ne le pensent la plupart des gens. Au sein de celle-ci, le staff fiscal ne dépasse pas une quinzaine de personnes, moins d'une dizaine pour l'Europe, cinq pour le continent américain, une pour l'Asie. Les structures sont donc assez réduites.
Pour ce qui est de la centralisation de la vision de l'impôt et des revenus, notre groupe est très marqué par sa diversité. Il est marqué par la diversité de ses métiers : les vins et les spiritueux représentent 15 % de ses activités, qui plus est avec une joint venture avec Diageo ; la mode et la maroquinerie 37 % ; les parfums et les cosmétiques 15 % ; les montres et la joaillerie 8 % - j'en dirai quelques mots à propos de la Suisse, comme l'a fait l'orateur précédent - et la distribution 25 %.
Notre groupe a une dimension internationale par ses marchés. Nous avons une présence internationale dans le plus grand nombre de marchés possible, là où se trouve la demande : 12 % en France - l'impôt payé en France est beaucoup plus élevé que la part de marché, voire la part de production et de profits qu'elle représente -, 21 % en Europe, 8 % au Japon, 27 % en Asie, 22 % aux États-Unis et 10 % dans les autres pays.
J'insiste également sur les ambiances, qui sont assez différentes suivant les secteurs du groupe : l'ambiance est plutôt artisanale dans les ateliers de mode ; nous sommes dans le monde agricole quand nous dialoguons avec les vignerons pour des marques de champagne ; nous sommes dans une ambiance industrielle, par rapport à la réglementation ou au statut des marques de cosmétiques - on cherche d'ailleurs souvent à nous confondre à tort avec la pharmacie et la chimie ; la distribution peut être relativement traditionnelle avec le Bon Marché, ou très contemporaine avec Sephora.
Nous sommes donc face à tous les systèmes d'impôts, à toutes les impositions par cette exposition au monde. Ce groupe, très français, est très exportateur : si 12 % du marché est français, 88 % est réalisé à l'exportation. Il est donc très internationalisé. Il a d'ailleurs la particularité de dépendre assez peu de l'État ou de la sphère publique pour ses contrats, ses ventes, si ce n'est pour la législation qu'il s'applique. Il joue un rôle considérable dans deux des trois premiers marchés figurant sur le podium du commerce extérieur français, à savoir, hormis l'aéronautique, l'agroalimentaire et les parfums et cosmétiques.
Il importe de souligner que nous participons en quelque sorte à un système de contre-mondialisation, puisque nous produisons en euros mais que seul un quart de la facturation de nos ventes s'effectue dans cette monnaie. Les trois quarts se réalisent dans d'autres devises, notamment 30 % en dollars, 10 % en yens.
Je voudrais enfin souligner un point important par rapport à ce que nous avons pu lire sur le site internet de la commission d'enquête à propos de la dimension française. Nous sommes un groupe français de dimension internationale qui possède des sociétés, des ramifications et des traditions différentes. Nous sommes un groupe italien à travers Berlutti, Pucci, Bulgari, Fendi, espagnol à travers Loëwe, écossais, voire britannique, avec Glenmorangie, anglais avec Thomas Pink, polonais, suisse à travers un grand nombre de sociétés. Nous fabriquons des montres et de la joaillerie. L'horlogerie est davantage fabriquée en Suisse qu'en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous y avons un certain nombre de sociétés. Notre groupe comprend également des sociétés américaines, avec Donna Karan, Marc Jacobs, Benefit, chinoise, avec Weng Jun, ou plus lointaines encore.
Dans ce contexte, notre groupe fabrique de la matière fiscale, puisqu'il crée de la croissance et de l'emploi. Nous comptons environ 100 000 salariés, ce qui ne correspond qu'à une faible partie des emplois créés par rapport à la galaxie des sous-traitants, des personnes qui travaillent avec nous et des emplois indirects. Nous créons ainsi de la matière fiscale à partir d'éléments peu délocalisables comme des vignobles, des parfums - j'ai du mal à imaginer le siège de Dior ailleurs qu'avenue Montaigne...
Sur l'impôt, on ne peut pas dire qu'il y a une stratégie fiscale du groupe LVMH. Il y a une donnée fiscale : payer l'impôt juste, l'impôt légal, ce qui est parfaitement normal et citoyen. En revanche, il existe une stratégie industrielle et commerciale, qui est de se développer et d'innover avec des produits, des équipes, des réseaux. Nous payions à peu près 800 millions d'euros d'impôt sur les sociétés voilà trois ou quatre ans, nous en payons aujourd'hui 1,5 milliard d'euros, « l'optimisation » va donc dans le sens du doublement de l'impôt acquitté... La moitié est perçue en France, où nous ne réalisons que 12 % de notre activité, le reste aux États-Unis, au Japon et en Italie. Nous représentons 2 % du total de l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas rien, et l'impôt correspond à 30 % de notre résultat.
En matière de prix de transferts, nous sommes dans une situation différente que celle décrite par l'intervenant précédent. Nous avons beaucoup de prix de transferts, avec des correspondants qui sont généralement dans des démocraties occidentales, dotées de systèmes fiscaux visibles et compréhensibles. Nous sommes dans une relation à deux, comprenant, d'un côté, la France et, de l'autre, le pays acheteur puis revendeur, ce qui est davantage une contrainte qu'un avantage. De ce point de vue, les évolutions évoquées à la fin du questionnaire peuvent nous inquiéter.
Des contentieux peuvent se produire, y compris entre la France et l'Allemagne, dans la répartition de l'assiette fiscale ou de la matière fiscale. Vous nous interrogez sur les contentieux : il s'agit plutôt de contentieux qui se règlent entre États au sujet de la répartition que de contentieux que nous provoquerions. Dans des pays plus lointains, la situation peut être complexe. Les douanes souhaitent obtenir un prix d'import élevé pour prélever le maximum de droits indirects ; à l'inverse, les contributions souhaitent que le prix soit faible afin que la partie créée dans le pays tiers soit plus importante. Il arrive donc que nous soyons confrontés à des querelles entre administrations.
J'aborderai un dernier point sur les prix de transferts : dans des pays émergents ou des pays puissants, où les systèmes fiscaux ne sont pas comparables aux nôtres, on perçoit la volonté très claire des administrations fiscales locales d'avoir plus que leur part. Le parfait respect des réglementations existe partout et la pression que peuvent exercer ces administrations pourrait conduire à une double imposition ou à une surimposition, au-delà des 100 % de l'imposition théorique. Ce constat nous amène à considérer que plus les conventions internationales régleront ces questions, plus les autorités arbitrales prévoiront une réglementation solide et stable, plus grand sera le facteur de sécurité pour un groupe.
Notre groupe n'est pas chargé de lutter contre le blanchiment, l'évasion fiscale et la fraude, bien qu'il en soit la victime indirecte, ces phénomènes venant nourrir et financer la contrefaçon. Il condamne évidemment toute forme d'évasion et de fraude, et se range parmi ceux qui considèrent - c'était, je crois, votre avant-dernière question - qu'il s'agit d'une menace.
Auchan est une société non cotée, contrairement aux autres groupes représentés aujourd'hui. Nous sommes le douzième groupe de distribution alimentaire mondial ; notre chiffre d'affaires en 2011 s'élève à 44,4 milliards d'euros, dont 45 % sont réalisés en France. Nous avons cinq métiers : les hypermarchés, les supermarchés, les galeries commerciales, la banque Accord dans le crédit et une branche que nous avons appelée « nouveaux concepts », regroupant l'e-commerce, le « Drive » et Alinéa. Nous sommes présents dans trois grandes zones. En Europe occidentale, nous sommes implantés en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Luxembourg. Nous sommes au Luxembourg d'abord pour des raisons opérationnelles, puisque nous y avons une activité et un magasin. Nous sommes présents en Europe centrale, notamment en Russie et en Ukraine, pays sur lesquels je reviendrai ultérieurement à propos des problématiques fiscales. Nous sommes également implantés en Asie depuis une dizaine d'années, essentiellement en Chine, où nous avons progressé très rapidement. Enfin, le groupe compte 269 000 collaborateurs.
Auchan est une entreprise un peu atypique, fondée sur une triple volonté de partage du pouvoir, du savoir et de l'avoir. Le partage du pouvoir, c'est la volonté de décentraliser les décisions au plus proche du terrain. Le directeur d'un magasin hypermarché chez Auchan a donc un fort pouvoir de décision. Le partage du savoir, c'est la formation. Le partage de l'avoir, c'est en particulier le fait que 152 000 collaborateurs d'Auchan détiennent 12 % du capital de l'entreprise. C'est d'ailleurs une caractéristique de l'entreprise dont nous sommes fiers. Nous avons également distribué 217 millions d'euros en 2011 aux collaborateurs français au titre de la participation et de l'intéressement, selon des programmes allant au-delà des simples prescriptions légales.
Nous ne nous contentons pas d'investir en Russie ou en Chine, nous continuons d'investir en France. Même si nous nous développons fortement à l'international, la France représente 45 % du chiffre d'affaires. Notre siège social est en France, notre comité exécutif est basé à Croix, à côté de Lille. Cela fait partie de nos caractéristiques. Nous réalisons d'importants investissements en France : l'activité hypermarché en France a investi 252 millions d'euros en 2011. Nous faisons travailler 17 000 PME, 8 000 fournisseurs, 6 500 producteurs agricoles. Nous avons donc des racines françaises très fortes dont nous sommes fiers.
J'en viens maintenant à la partie plus fiscale, c'est-à-dire au sujet de cette audition. Notre taux effectif d'impôt s'établit à 32,6 % en 2011, en tenant compte d'une opération exceptionnelle en Chine. Si l'on exclut cette opération, le taux d'impôt affiché sur notre rapport annuel est de 43 %. Pour la France, le taux effectif de l'impôt décaissé s'établit, pour les quatre dernières années, entre 31 % et 33 %, donc bien loin des pourcentages inférieurs à 10 % dont on a pu parler ici ou là.
Nous nous sommes livrés à un petit calcul : en additionnant l'impôt sur les sociétés et l'ensemble des taxes payées par le groupe Auchan en France - l'ex-taxe professionnelle, les impôts locaux, la taxe sur les surfaces commerciales - rapportés au résultat avant impôts, on atteint un taux effectif d'imposition de 59 %.
En termes d'organisation fiscale, nous ne sommes présents dans aucun État ou territoire non coopératif. Nous sommes implantés au Luxembourg car nous y détenons un magasin. Nous avons une centrale de référencement en Suisse, mais nous n'opérons aucune optimisation fiscale dans ce pays. Nous sommes d'ailleurs en train d'organiser son rapatriement en France, parce que ce sera désormais plus efficace d'un point de vue opérationnel. En Belgique, nous détenons une centrale de financement, avec un centre de compétences financières.
Notre politique fiscale, c'est le business avant l'optimisation fiscale. En Suisse, nous aurions pu faire de l'optimisation fiscale, mais nous avons préféré faire du business. Il convient de bien différencier l'évasion fiscale et le schéma artificiel, voire la fraude, et l'optimisation fiscale. Notre politique exclut l'évasion fiscale, les schémas artificiels opaques, etc. Nous sommes contrôlés en permanence par la DVNI, la direction des vérifications nationales et internationales, par la DIRCOFI, la direction de contrôle fiscal : nous avons actuellement dix contrôles en cours.
En termes d'effectifs, trois personnes sont affectées à la direction fiscale du groupe en France, et trois ou quatre personnes en Espagne, en Italie et en Russie.
Enfin, puisque vous nous y avez invités, je ferai quelques suggestions : la première, c'est que la France reste bien placée dans la concurrence fiscale au sein de la zone euro, qu'elle continue à développer des conventions fiscales avec Hong-Kong, l'Ukraine, la Russie. Aujourd'hui, la Russie nous refuse la déductibilité des facturations que le fisc français lui, exige de nous. Nous sommes dans une situation absurde que le Parlement pourrait nous aider à régler. La seconde, c'est d'éviter l'instabilité fiscale : le vote de cinq lois de finances pour 2011 ne nous aide pas à réduire nos coûts de contrôle fiscal et administratif.
Veolia Environnement est un groupe industriel de services à l'environnement, dont certains d'entre vous ont peut-être été les clients à travers leurs mandats. Nous avons aujourd'hui trois métiers principaux : la production, la distribution et l'assainissement d'eau ; la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ; les services à l'énergie à travers la filiale que nous partageons avec EDF, Dalkia. Nous nous désengageons aujourd'hui d'un quatrième métier résultant d'une association avec la Caisse des dépôts et consignations dans le secteur des transports publics, à travers Véolia Transdev.
Voici quelques ordres de grandeur : l'eau représente 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, la propreté environ 9 milliards, les services à l'énergie quelque 8 milliards et le transport, que nous ne consolidons plus en chiffre d'affaires, est de l'ordre de 8 milliards d'euros. L'entreprise représente donc, selon les normes comptables actuelles, 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
C'est aussi une entreprise regroupant 330 000 collaborateurs. Nous sommes une industrie de main-d'oeuvre, de cols bleus, et nous le revendiquons. Nous sommes l'un des plus grands employeurs de France, avec 100 000 salariés. Nous avons investi à peu près un milliard d'euros chaque année depuis trois ou quatre ans.
A l'évidence, la nature des services de Veolia est locale. On ne peut traiter de distribution d'eau, de déchets, de réseaux de chaleur que localement. Notre activité n'est donc, par construction, absolument pas délocalisable. C'est vrai des collectivités publiques, qui représentent 70 % de notre chiffre d'affaires, demain plutôt 60 % ; c'est vrai aussi de nos clients industriels, qui ont la même problématique. Quand on sert une usine ou un distributeur, on est nécessairement local. Les coûts des salariés, les coûts des matières sont locaux, l'essentiel de la sous-traitance est local, à travers l'irrigation d'un réseau de PME.
La conséquence, c'est le caractère très dispersé de nos activités, qui se retrouve juridiquement. Nous avons, en comptant le transport, 2 800 filiales consolidées, dans 77 pays, ce qui représente d'ailleurs un vrai sujet de gestion. Quand on a autant d'entités, il est extrêmement difficile de consolider l'information.
Nos clients veulent avoir des filiales, mais, là encore, pas du tout dans un but d'optimisation juridique ; vous connaissez sans doute certains d'entre eux et vous savez que, s'ils souhaitent absolument avoir une filiale, c'est parce qu'elle présente un caractère local et qu'elle est plus facile à appréhender ; en outre, le sentiment de transparence qu'elle suscite est plus grand. Cette demande nous est imposée par le business et nous pouvons difficilement revenir dessus.
La France, j'en ai parlé en termes d'emploi et d'investissement, représente aujourd'hui un peu moins de 40 % de notre activité, contre plus de 90 % à la fin des années quatre-vingt-dix. Notre groupe a donc connu en une dizaine d'années une véritable mutation : pratiquement franco-français au départ, Veolia est devenu beaucoup plus international, même si la France occupe toujours la première place.
Après cet exposé général du groupe, je dirai un mot sur sa stratégie et ses priorités.
Aujourd'hui, Veolia est une entreprise en pleine transformation, qui implique un recentrage, avec des cessions d'actifs très importantes, puisque nous nous sommes engagés à céder 5 milliards d'euros d'actifs sur les années 2012 et 2013. Le recentrage de Veolia sur ses principaux pays d'implantation, l'ajustement de son périmètre est l'une de nos principales priorités, plus que la stratégie fiscale ; j'en dirai un mot dans quelques instants.
Aujourd'hui, quatre États totalisent à peu près deux tiers de l'activité : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et enfin les États-Unis. Demain, c'est-à-dire en 2013-2014, ces pays-clés représenteront probablement 75 % de notre activité, avant d'être dilués par les pays à forte croissance.
Pour résumer, un mouvement de recentrage doit permettre la croissance. Un second mouvement vise la restauration du profit, car l'entreprise Veolia est confrontée à la baisse de ses profits depuis maintenant quatre ans et doit réagir face à cet événement.
La priorité principale de Veolia est la réduction des coûts afin d'atteindre son objectif : avoir un groupe qui gère ses coûts, se recentre et se désendette.
Dans ce cadre, nous sommes néanmoins présents dans un certain nombre de pays, notamment aux Bahamas, où nous effectuons et traitons la collecte des déchets, également en Belgique, où Veolia gère la station de retraitement des eaux usées, bien sûr à côté de ses autres activités.
Nous intervenons aussi à Monaco, puisque notre groupe est le propriétaire de la Société Monégasque des Eaux et que nous assumons la production et la distribution des eaux à Monaco depuis des dizaines d'années. Notre opérateur est présent là où les marchés sont disponibles, donc effectivement dans des pays qui ne sont pas forcément fiscalement très « purs ».
J'aborderai brièvement la stratégie fiscale du groupe.
Nous n'avons pas véritablement de stratégie fiscale, c'est-à-dire que nous ne choisissons pas nos pays d'implantation en fonction du taux de fiscalité. Nous n'organisons pas nos systèmes de production à travers la fiscalité, puisqu'ils sont systématiquement locaux et qu'ils nous sont imposés par la nature même de nos activités. Troisième point : nous ne tendons pas non plus à l'optimisation de bilan, c'est-à-dire que le niveau des dettes de Veolia, lequel vous est certainement familier, qui s'élève à une quinzaine de milliards d'euros, n'est pas forcément un choix d'optimisation bilancielle. C'est le résultat d'une situation qui a été créée voilà une dizaine d'années lors du transfert de l'ancienne entreprise Vivendi bien connue.
Donc, cette dette importante, nous l'avons toujours - c'est une quille ! -, et en conséquence, les marges d'optimisation sont relativement limitées.
Aujourd'hui, concernant la fiscalité, que voyons-nous et que découvrent nos investisseurs ? Une information totalement transparente.
En 2009, notre taux d'impôt apparent était de 21 %. En 2010, il était de 28 %, et en 2011, de 250 %. Pourquoi ? Parce qu'on enregistre des pertes, mais cela ne crée pas pour autant d'« anti-impôt » ou de capacité à limiter ces pertes. Nous payons tout de même de l'impôt dans un certain nombre d'opérations, ce qui produit un taux d'impôt complètement atypique. Même si nous retraitons des événements exceptionnels ou des éléments non récurrents, nous constatons une hausse tendancielle de notre taux d'impôt, qui passe de 31 % en 2009 à 37 % en 2011.
Notre efficacité fiscale, qui est aujourd'hui extrêmement médiocre, est liée au fait que certaines opérations se dégradent et que nous ne disposons pas en face du « coussin » fiscal. Nous payons de l'impôt dans des situations bénéficiaires, mais, pour des situations déficitaires, nous ne bénéficions pas du « coussin » fiscal, donc le taux d'impôt global se dégrade de manière assez significative.
Voilà la réalité brossée à grands traits.
Je voudrais ajouter un point qui est important : notre groupe est coté à New-York. Cela n'a pas beaucoup d'avantages, je ne vous le cacherai pas, hormis le fait que les chaînes de contrôle sont extrêmement denses, c'est-à-dire qu'une obligation personnelle très forte et pénalement sanctionnée aux États-Unis pèse sur les dirigeants de l'entreprise. Nous le savons, ce n'est pas une plaisanterie, et cette obligation nous oblige à un suivi, un contrôle assez fort de nos opérations.
Nous sommes soumis, par exemple, à un système de déclaration systématique des fraudes : celles-ci sont évidemment interdites, et dès qu'un employé en commet une, la personne qui en a connaissance doit aussitôt transmettre l'information au plus haut niveau du groupe. Je ne dis pas que nous sommes au courant de toutes les fraudes, parce que certains peuvent dissimuler leurs agissements, mais nous obéissons à un système de déclaration obligatoire, y compris pour l'absence de fraude. Nous devons déclarer que rien de tel n'a eu lieu, ce qui est tout de même difficile à faire si ce n'est pas le cas.
Par conséquent, ce système de contrôle est assez fort, et Veolia, dont 70 % des clients sont publics, ne peut pas se permettre d'être pris en train de dissimuler une fraude fiscale. Nous sommes particulièrement vigilants sur ces sujets, compte tenu des dégâts sur l'image du groupe que de telles opérations pourraient occasionner.
Nous avons mis en place des systèmes qui nous prémunissent contre ce genre de situations, bien entendu dans la limite du mensonge et de la dissimulation qui peuvent toujours arriver et que nous devons chasser au mieux.
M. le président. Je vous remercie de votre intervention. Avant de passer la parole à M. Thormann, pourriez-vous nous donner quelques informations supplémentaires concernant un aspect que vous venez d'aborder mais qui n'est pas directement inclus dans l'objet de la commission d'enquête : je pense au fait d'être coté à New-York. Voulez-vous dire que le contrôle de la bourse française n'est pas aussi rigoureux à l'égard des dirigeants d'entreprises ?
Il existe ce que l'on appelle les règles de contrôle interne. La France a adopté des dispositions en 2005, me semble-t-il, via la loi de sécurité financière, qui s'alignent, sur le fond, sur les règles américaines. En 2008, la Commission européenne a mis en place des directives qui tendent d'ailleurs à faire évoluer les réglementations nationales un peu dans le même sens que les mesures américaines.
Les États-Unis ont adopté, juste après la faillite d'Enron - vous vous souvenez peut-être de cette grande crise en 2002-2003 -, une loi visant à instaurer une responsabilité pénale pesant sur les dirigeants, qui doivent non seulement décrire leur système de contrôle interne, mais se prononcer sur la qualité de ce système et déclarer, sous peine de sanction pénale, qu'il ne présente pas de faille significative ou de faiblesse interne. Cette déclaration peut faire l'objet d'une incrimination pénale aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Europe, en tout cas en France.

La responsabilité individuelle est beaucoup plus forte aux États-Unis que sur les places financières européennes.
Sur le fond, elle est identique : la responsabilité oblige les dirigeants à faire preuve d'une diligence absolue.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, tout comme mes collègues qui m'ont précédé, permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à m'exprimer devant votre commission d'enquête au nom du groupe Renault. Je suis heureux de cette occasion qui m'est offerte d'éclairer la représentation nationale sur la situation de notre groupe et la manière dont il s'acquitte de ses devoirs à l'égard de l'État et de ses finances.
Je dirai quelques mots, en introduction, sur la situation de Renault.
Notre plan stratégique triennal, qui vise à la recherche de la croissance rentable, a été lancé en 2011. Ce plan est soutenu par deux leviers.
Le premier est le renforcement de l'empreinte industrielle de Renault en France.
Entre 2010 et 2013, 40 % des investissements du groupe, soit 2 milliards d'euros, seront réalisés en France, et 80 % des dépenses de recherche et développement ont lieu dans notre pays. Les véhicules à forte valeur ajoutée - les véhicules utilitaires, électriques ou le haut de gamme - sont fabriqués en France. Enfin, 25 % de notre production et de nos ventes en 2011 a été réalisé en France.
Ce dispositif a assuré l'emploi de 55 000 personnes en France, soit 43 % de l'effectif total du groupe et 61 % de la masse salariale.
Enfin, la France représente plus de la moitié de la valeur ajoutée du groupe, soit 54 %.
Le second levier est le développement à l'international. Il est important car, vous le savez, le marché automobile connaît une forte croissance, par exemple au Brésil ou en Russie. Y gagner des parts de marché est une condition sine qua non du maintien de notre base française, et les véhicules que nous y vendons ont été conçus pour répondre aux besoins locaux et assurent une partie de la valeur ajoutée réalisée en France. La gamme Entry, par exemple, y contribue à hauteur de 780 euros par véhicule vendu à l'international.
L'alliance avec Nissan, conclue en 1999 et étendue en 2010 à un partenariat avec Daimler, est également l'un des atouts-clés dans notre internationalisation et dans la meilleure couverture de tous les segments du marché automobile. L'alliance avec Nissan a démontré sa capacité à durer. Elle est aujourd'hui la seule alliance automobile de cette envergure dans le monde.
Grâce à cette stratégie, Renault a réalisé de bons résultats en 2011 dans un contexte économique contrasté, vous le savez, mais la situation reste tendue, particulièrement en ce début d'année 2012. En mars dernier, le marché automobile européen était au plus bas des quatorze dernières années, selon les chiffres publiés par l'ACEA.
Le groupe reste fragile avec une marge opérationnelle consolidée de 2,6 % en 2011, contre des marges allant de 5 % à 11 % pour les constructeurs allemands, coréens ou japonais.
Venons-en maintenant au sujet qui anime cette commission d'enquête.
J'évoquerai d'abord la politique fiscale du groupe, puis je préciserai la contribution actuelle de Renault au budget de l'État et de ses collectivités, sujet auquel, je le sais, vous êtes particulièrement attachés. Enfin, j'expliquerai pourquoi, depuis 2008, le groupe est fiscalement en perte en France.
Tout d'abord, Renault est soumis au régime de la territorialité, ayant quitté le bénéfice mondial consolidé en 2002, voilà dix ans. Le groupe ne dispose d'aucune filiale dans les paradis fiscaux ou États non coopératifs : comme l'un de mes collègues l'évoquait avant moi, nous disposons de quelques filiales commerciales dans des pays comme le Luxembourg où nous vendons des voitures.
De même, il n'existe aucune structure opaque de type trust ou fiducie au sein du groupe. Toutes nos entités à l'étranger sont dûment inscrites au registre du commerce et des sociétés et/ou des chambres de commerce locales.
Par ailleurs, le groupe Renault dispose d'une direction fiscale qui est constituée d'un nombre limité de professionnels et d'experts et compte 18 personnes au siège. Seules quelques filiales disposent de leurs propres ressources locales lorsque la taille de l'activité le justifie. Les fiscalistes du groupe sont chargés de sécuriser les opérations locales et internationales du groupe, au regard notamment de l'impôt sur les sociétés, de la TVA et des impôts locaux.
Enfin, en 2011, Renault SAS a alloué un budget de 450 000 euros au titre de conseils fiscaux extérieurs sollicités pour aider notre équipe restreinte à faire face aux exigences de respect et de conformité aux règles fiscales nationales et internationales.
Je résume : la stratégie fiscale du groupe est fondée sur la sécurisation des obligations du groupe en France et dans chaque pays où nous sommes présents sur le plan industriel et commercial.
Passons à la contribution annuelle, en France, de Renault au budget de l'État et des collectivités.
Bien que déficitaire fiscalement depuis 2005, Renault est une entreprise citoyenne qui contribue annuellement, en France, au budget de l'État et de ses collectivités territoriales. Sur les trois derniers exercices, hors droits de douanes et cotisations sociales patronales, Renault a versé en France entre 306 millions et 314 millions d'euros à l'État et aux collectivités territoriales, au titre des taxes dites d'exploitation, d'abord par des impôts directs : la taxe professionnelle, qui a été en grande partie substituée par la cotisation économique territoriale, et a représenté pour Renault 114 millions d'euros en 2011 ; la taxe foncière pour 44 millions d'euros ; la taxe annuelle sur les bureaux pour un montant de 4 millions d'euros.
Ensuite, nous payons les autres impôts, taxes, droits et redevances : les taxes assises sur les salaires relatives à la formation et à l'apprentissage, qui ont représenté 68 millions d'euros en 2011 ; la contribution sociale de solidarité des sociétés, pour 46 millions d'euros, ou encore la taxe sur les voitures de société pour 6 millions d'euros.
On peut noter que, selon nos études et notre expérience, aucun autre pays membre de l'OCDE ne connaît un tel niveau de taxes, hors impôt sur les sociétés, prélevées sur l'activité industrielle et commerciale. Le seul pays comparable en la matière est le Brésil.
Aucun État parmi nos principaux concurrents ne fait supporter à ses entreprises de tels niveaux d'impôts non assis sur les bénéfices, ce qui constitue pour eux un avantage compétitif : aux États-Unis, en Corée du Sud, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, au Japon, là où se trouvent les principaux constructeurs automobiles mondiaux, les taxes dites d'exploitation sont égales à zéro.
En Allemagne, la taxe professionnelle est l'une des deux composantes de la taxe sur les bénéfices aboutissant à un prélèvement d'impôt global sur les bénéfices d'environ 30 % à 35 % annuellement.
Bénéficiaire systématique jusqu'en 2005, Renault est, malheureusement depuis, fiscalement passé en pertes en France. La situation a été amplifiée pendant la crise de 2008, au cours de laquelle nous avons connu des pertes importantes. Ces pertes fiscales sont essentiellement imputables, depuis 2008, à un environnement macroéconomique défavorable à l'activité automobile en Europe. Elles résultent de pertes industrielles réalisées par Renault depuis le début de la crise : la marge opérationnelle de la branche automobile a été divisée par trois.
Malgré ces pertes, Renault déclare tous les ans environ 50 millions d'euros d'impôts sur les bénéfices au Trésor public. Fort heureusement, Renault est bénéficiaire dans les pays émergents, et son activité de financement des ventes, RCI Banque, l'est également. Renault acquitte l'impôt sur les sociétés dans les pays à fort succès commercial comme le Brésil, la Turquie, la Roumanie, la Russie ou encore la Chine.
La filiale de financement des ventes de Renault, RCI Banque, connaît une activité financière très rentable, y compris en France. Ses bénéfices compensent nos pertes réalisées dans la branche automobile via l'intégration fiscale en France. Hors de France, notamment dans les pays émergents, RCI est également très profitable, ce qui l'a conduit par exemple à verser un impôt sur les sociétés au Brésil ou en Corée.
Quant au taux effectif d'impôt consolidé du groupe, il était de 45 % en 2011, ce qui est relativement haut. Sa forte augmentation par rapport à 2010 s'explique principalement par la dégradation des perspectives de résultat de notre filiale coréenne, ainsi que par le ralentissement de la récupération des déficits fiscaux en France liée à l'introduction du dispositif limitant l'imputation des déficits fiscaux.
En conclusion, je dirai que le plan triennal de Renault vise à assurer la croissance de nos ventes ainsi que la génération d'un free cash flow opérationnel récurrent, seul garant de la pérennité de l'entreprise. Ce sur quoi nous sommes tous d'accord, c'est que, pour payer de l'impôt, il faut commencer par faire des profits. C'est tout l'objectif de notre plan.

Messieurs, je vous remercie de vos exposés respectifs.
Je donne maintenant la parole à M. le rapporteur.

Je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants.
Avant d'aborder les quelques questions qui s'ajouteront aux interrogations figurant dans le questionnaire qui vous a été adressé, messieurs, je voudrais vous dire tout d'abord dans quel état d'esprit nous nous trouvons et vous expliquer pourquoi vous avez été invités à être auditionnés devant la commission d'enquête sur l'évasion fiscale.
Il est naturel que notre commission d'enquête s'intéresse aux pratiques fiscales des grands groupes que vous représentez. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires sur la fiscalité des entreprises dont vous avez certainement eu connaissance est bien sûr parvenu jusqu'aux parlementaires en son temps, et le questionnaire qui vous a été transmis le sera aussi à l'ensemble des groupes du CAC 40, également concernés par le sujet.
Cependant, nous avons pensé qu'un échange oral était irremplaçable, beaucoup plus fructueux, et pourrait compléter certains des propos qui seraient tenus à tel ou tel moment. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé au bureau de la commission d'organiser votre audition de cette manière.
Ce sont donc des considérations pratiques qui l'ont emporté, puisqu'il n'est bien évidemment pas possible, dans le délai de six mois imparti pour cette commission d'enquête, de vous auditionner tous. Nous avons « sélectionné » certains groupes, les vôtres ; soyez remerciés d'avoir accepté de vous prêter à cette démarche.
Je poserai ensuite quelques questions complémentaires au gré de ce que j'ai pu entendre ici ou là.
Je commencerai par une question très générale à M. Jamet.
Vous avez parlé d'« impôt juste ». Comment le définissez-vous ?
Pour être bref, je dirai que, pour nous, c'est le produit absolu et total des réglementations en court, celui qui est dû car il a été voté et décidé par la représentation parlementaire, puis acquitté par les entreprises situées en France.

C'est celui qui est légal. Vous ne parliez donc pas de « justice » au sens philosophique ?
Je ne faisais par référence à une autre utilisation de l'adjectif « juste » en des discours récents... L'impôt juste, c'est celui qui est à la fois précis et normal.

Je poserai maintenant une question à M. de Mézerac.
Monsieur, vous avez évoqué la Suisse dans votre propos et vous avez dit que vous auriez pu faire de l'optimisation fiscale. Pourriez-vous expliciter ce point ?
Une vingtaine de personnes proposent des services à de grands fournisseurs internationaux, comme par exemple le lancement d'un nouveau produit ou d'une nouvelle eau dans tous les pays à la fois, lesquels donnent lieu à des rémunérations par les fournisseurs, puisqu'il s'agit de véritables services ou d'études marketing au niveau international. Donc, cette entité en Suisse va facturer aux grands fournisseurs ces services.
Quand j'ai dit que nous n'avons pas fait d'optimisation fiscale, c'est parce que nous aurions pu décider, au moment de facturer ces services, de garder en Suisse les bénéfices qui en découlaient, dans la mesure où le taux d'imposition y est légèrement plus faible qu'en France. Mais nous ne l'avons pas fait et je vais vous dire pourquoi.
C'est tout simple : les services fournis aux différents pays, par exemple par Auchan France à Nestlé ou à Procter & Gamble résultent finalement du travail et des ventes d'Auchan France grâce auxquels ces services sont rendus possibles. C'est pourquoi les équipes en France demandent la restitution de la totalité de leur facturation. En définitive, la société en Suisse ne fait pas de bénéfices puisqu'elle facture 100 aux fournisseurs et que les entités dans les différents pays concernés comme Auchan France ou Auchan Italie vont ensuite facturer 95 au titre des services qu'elles rendent effectivement dans leurs pays. Il ne restera donc que 5 pour payer les collaborateurs à Genève. En outre, je vous l'ai dit, nous avons décidé de rapatrier cette équipe en France pour être encore plus opérationnels aujourd'hui, ce qui n'était pas possible voilà quelques années.

S'agissant toujours d'Auchan, qui est mon voisin - vous avez dit que votre siège était à Croix, une ville que je connais puisque je suis sénateur du Nord -, pouvez-vous nous dire si des réflexions sont en cours sur une éventuelle délocalisation du siège du comité exécutif de l'entreprise ?
Aucune réflexion dont je serais au courant n'est en cours. D'abord, je suis membre du comité exécutif et, si celui-ci devait être délocalisé, je pense que je le saurais. Quant à nos actionnaires, monsieur le rapporteur, vous connaissez leur attachement aux terres du Nord ; la probabilité que ceux-ci envisagent une délocalisation, même en région parisienne, me paraît plus que faible !

Les actionnaires dont vous parlez ont pourtant choisi de résider en Belgique pour des raisons fiscales, comme vous le savez. Ce n'est pas l'entreprise qui est en cause, ce sont les personnes physiques...
Si je peux me permettre, monsieur le rapporteur, notre président fondateur, Gérard Mulliez, vit en France ; il n'est pas parti en Belgique, non plus que notre président actuel, Vianney Mulliez, ni le président de Auchan France, Arnaud Mulliez.

Puis-je me permettre de poser la même question à vos collègues auditionnés en même temps que vous ? Des réflexions ont-elles été engagées concernant la délocalisation des sièges de l'entreprise ou de ses comités exécutifs ?
Non, absolument pas !
A Aubervilliers, mais cela reste raisonnable !

Je voudrais obtenir une information complémentaire de la part du groupe Renault.
J'aimerais que vous nous expliquiez, monsieur Thormann, si vous le pouvez, la décision historique - prise sans doute avant que vous ne preniez vos fonctions - de la création d'une holding entre Nissan et Renault en Hollande, visant bien sûr à bénéficier de la fiscalité hollandaise. Cette décision avait été prise par M. Schweitzer il y a je ne sais combien de temps, une dizaine d'années, voire un peu plus. Quelles en avaient été les motivations, quelle était la compétitivité fiscale de cette localisation s'agissant d'une entreprise dans laquelle l'État, me semble-t-il, avait encore beaucoup de poids ? Pourquoi êtes-vous toujours en Hollande ? Ces questions sont un peu complémentaires de celles de M. le rapporteur.
Je vais tenter de vous apporter des éclaircissements, mais ces décisions remontent effectivement à bien des années.
Pour comprendre ma démonstration, il faut savoir que l'alliance entre Renault et Nissan unit deux constructeurs, l'un français, l'autre japonais. Comme le principe fondateur de l'alliance est le respect de l'identité des marques et de la culture des entreprises, il s'agit non pas d'une fusion mais bien d'une alliance.
Comment faire fonctionner une alliance où la participation est croisée, puisque Renault détient 43,4 % de Nissan, qui détient 15 % de Renault ? La participation entre les deux sociétés est bien croisée, mais chacune a son bilan, son compte de résultat. Elles entretiennent entre elles des échanges : par exemple nous construisons des moteurs pour Nissan et Nissan fabrique des organes mécaniques pour Renault. Mais il n'y a pas de fusion entre les deux sociétés.
Par conséquent, les deux sociétés ont leur place de cotation : Renault est cotée à Paris, et Nissan à Tokyo. Il y a deux comités exécutifs, deux conseils d'administration et deux bases d'actionnaires, qui, pour la partie flottante, sont assez distinctes.
J'en viens à la question suivante : quel est ce Renault-Nissan BV, ce RNBV ? Puisque, dans l'industrie automobile, la nationalité des constructeurs est souvent une question assez émotionnelle et qui fait couler beaucoup d'encre, il fallait un territoire neutre où pourrait être située une société de management. En effet, RNBV n'est pas une société d'exploitation ; elle n'a pas de résultat, aucun actif, c'est uniquement un endroit où l'on peut réunir des moyens humains.
Sont membres d'un comité de l'alliance les membres respectifs de chaque comité exécutif, et nous nous rencontrons une fois par mois. Le service des comités exécutifs de chaque entreprise comprend un petit staff d'une vingtaine de personnes, guère plus, qui a vocation à aider les deux entreprises à travailler ensemble et à réaliser des opérations au bénéfice, soit de Renault, soit de Nissan.
Mais cette société hollandaise ne fait rien ; elle n'a pas de chiffre d'affaires ni de résultat.
C'est un outil, une société de management qui a d'ailleurs été déposée à l'AMF et expliquée à l'époque. Rien n'a bougé depuis.

Je voudrais connaître votre avis, messieurs, sur le projet de directive Barnier, qui suggérerait la création d'un reporting pays par pays, projet par projet. Nous avons soumis cette question à M. de Margerie. Il trouve que cela va trop loin et parle d'hérésie. Quel est votre sentiment à ce sujet dans vos différents groupes ?
Dans le même ordre d'idées, à l'échelon européen, vous avez certainement entendu parler du projet de création d'une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, l'ACCIS. Quel est votre point de vue sur ce point ? Voulez-vous formuler des propositions ?
Comment dois-je interpréter ce silence ?

Autre question plus générale : vous intéressez vous à la conformité fiscale de vos concurrents dans vos activités respectives ? Est-ce un sujet d'inquiétude pour vous, une préoccupation dans ce contexte de concurrence effrénée ?
Ce sujet nous concerne évidemment. Nous examinons les comptes de nos concurrents lorsqu'ils sont publiés ainsi que leur taux effectif d'impôt.
Je vous citerai un exemple pour illustrer mon propos : nous avons fini par acheter en Angleterre, en 2005, l'un de nos partenaires concurrents, BPB, avec une OPA longtemps hostile, qui est devenue amicale à la fin. Quand nous avons acheté cette société par le biais d'une OPA, nous n'avons bien évidemment pas pu réaliser d'audit sur les méthodes fiscales employées, et il nous a fallu quelques années pour revenir aux principes fiscaux du groupe. Le fisc anglais, qui supervisait cette société en Angleterre, applique un dispositif qui n'est d'ailleurs pas inintéressant, selon lequel les sociétés contrôlées sont notées de 1 à 4, 1 pour les sociétés réputées très agressives fiscalement, et 4 pour celles qui sont considérées comme étant de bons citoyens fiscaux. Lors du rachat de BPB, nous avons appris, après un audit, que cette société était notée 1 sur 4. Or, aujourd'hui, sa note est de 4 sur 4. La transition s'est forcément déroulée de façon lente. La situation donnait clairement un avantage comparatif à notre concurrent. Mais ce n'était pas une raison pour que nous l'entérinions.
Si vous me le permettez, monsieur le rapporteur, j'ajouterai que, lorsque je parlais tout à l'heure d'impôt « juste », je voulais dire « loyal ». En décrivant le phénomène des prix de transfert, j'ai indiqué pourquoi, d'une certaine façon, ce jeu - si tant est que ce soit un jeu - était à somme nulle, car il s'agit de répartir une assiette fiscale en décidant qu'elle ne peut pas être à 95 % dans un pays et à 5 % dans un autre, mais on sent bien que, d'État à État, la question posée est de savoir si c'est 60/40 ou 50/50 dans un sens ou dans l'autre.
La situation est plus simple quand une sorte de liaison est créée entre le pays producteur et vendeur, et le pays acheteur et revendeur, ce qui n'est pas toujours le cas : si les prix de transfert, chez LVMH, sont établis à partir d'une analyse fonctionnelle prenant en compte les coûts, les fonctions et les actifs dans leur totalité, cette analyse incorpore bien évidemment les marques et les actifs incorporels. Donc, d'une certaine façon, le prix de transfert est calculé en fonction de la redevance à la marque, qui est évidemment attachée à la France et qui, de ce fait, dans la répartition 60/40, comporte la totalité du prix de transfert.
On a pu observer chez d'autres que ce jeu était plus compliqué et que l'analyse fonctionnelle n'opposait que les coûts de distribution, de marchandisation dans le pays lointain et les coûts de production et d'innovation dans le pays producteur, mais que la marque et les actifs incorporels étaient placés dans une autre entité ou un État différent et que la notion de redevance, qui était versée ailleurs pour payer les actifs incorporels ou la marque, venait parasiter ce système. Donc, de ce point de vue, des progrès peuvent être accomplis.
Un schéma simple - d'un côté, celui qui produit, de l'autre, celui qui achète, donc une répartition assez claire de la fiscalité -, a généralement cours dans les démocraties occidentales. Mais il existe des situations plus complexes, lorsque la redevance à la marque et les actifs incorporels sont situés dans un autre pays, où la répartition est moins facile que celle que j'évoquais.
A l'égard de nos concurrents - sociétés cotées - un peu similaires, nous analysons, comme notre collègue de Saint-Gobain l'a indiqué, leur taux d'impôt et essayons de repérer d'éventuels écarts significatifs. Objectivement, ils ne sont pas importants et nous comprenons assez bien les tendances, car elles sont proches.
Pour autant, je partage la même expérience dans la mesure où nous incorporons beaucoup de PME, dont le niveau de conformité fiscale n'est pas tout à fait identique à celui des grandes entreprises. Mais les risques ne sont peut-être pas les mêmes pour eux que pour nous... Nous découvrons parfois, au sein de certaines sociétés que nous intégrons, des pratiques étonnantes, et même très perturbantes. Il nous faut les remettre dans le droit chemin très vite, au bout d'un an d'exploitation, pour ne pas nous retrouver dans une situation un peu compliquée.
La seconde distorsion de concurrence à laquelle nous sommes confrontés, qui est très forte, tient au fait que certains de nos concurrents sont des régies, qui bénéficient de régimes fiscaux extrêmement favorables, complètement dérogatoires. Mais c'est un autre sujet...
Monsieur le rapporteur, je vous l'ai dit, dans l'industrie automobile, l'indicateur de suivi pour comparer la performance des constructeurs entre eux et juger de la bonne santé ou non des entreprises, est la marge opérationnelle. Étant en France, une part importante de notre marge opérationnelle acquitte les impôts et les taxes dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents. Donc, toutes choses égales par ailleurs, un concurrent comme Volkswagen-BMW montrera un taux de marge supérieur au nôtre, puisque ses impôts viennent plus bas dans le compte de résultat au moment de constater les bénéfices, ce qui n'est pas le cas chez nous. C'est vrai de tous les pays qui comptent des constructeurs automobiles, à l'exception du Brésil. Nous, Français, sommes assujettis plus haut dans notre compte de résultat que nos concurrents.
J'ajouterai que, dans la concurrence avec les grands groupes internationaux, comme pour Veolia, la dimension fiscale n'est pas un élément majeur. En revanche, lorsque nous sommes en concurrence avec des acteurs locaux dans les pays émergents, c'est un véritable élément de différence : certains pays de l'Est, par exemple, font preuve de moins de rigueur sur la collecte fiscale, notamment sur les marchés locaux avec lesquels un hypermarché comme le nôtre est en concurrence. À cet égard, je peux vous dire qu'un hypermarché va collecter correctement la TVA sur les marchés locaux ; pour les États des pays concernés, c'est beaucoup plus difficile.
Nous faisons donc face, bien souvent, à une forme de concurrence déloyale à cause de la fiscalité, ou plus exactement du non-respect des lois fiscales par des concurrents locaux.

La présente question s'adresse à vous tous, dans la mesure où vous êtes concernés : dans quels territoires ou pays sont localisées les structures qui gèrent les droits incorporels dans vos différents groupes ?
Sur la holding en France.
Toutes nos marques sont en France.
S'agissant des brevets, une grande partie est située en France, dans l'endroit où ils ont été conçus. Si c'est un centre de recherche américain qui conçoit la R&D, ce sera localisé aux États-Unis ; si c'est un centre de recherche français, ce sera en France.
Veuillez m'excuser, monsieur le rapporteur, j'ai dit « en France », parce que nous n'avons délocalisé aucune marque hors de France. Mais, comme Saint-Gobain, si la marque a été créée en Chine, nous la garderons là-bas.

Vous êtes directeurs financiers de vos groupes respectifs, la présence de nombreuses filiales bancaires dans des territoires offshore, pour employer un terme général, est-elle un sujet d'étonnement pour vous ?
Par ailleurs, pourriez-vous indiquer votre taux d'imposition effectif en France, comme certains d'entre vous l'ont fait, et également à l'étranger dans les différents pays où vous êtes implantés ?
Je peux vous donner les chiffres bruts concernant la France et l'étranger.
En 2010, le résultat fiscal a été de 70 millions d'euros en France et de 1,1 milliard d'euros à l'étranger ; l'impôt était de 109 millions d'euros en France et de 227 millions d'euros à l'étranger. Les désoptimisations fiscales en France sont assez importantes.
Pour 2011, en France, le résultat fiscal est de moins 180 millions d'euros en résultat et, à l'étranger, de plus de 400 millions d'euros ; l'impôt est de 145 millions d'euros en France et de 393 millions d'euros à l'étranger.
Si je reprends l'ensemble des impôts et taxes que nous avons payés l'année dernière, à savoir 250 millions d'euros, à l'intérieur de ce montant, l'impôt sur les sociétés était nul. Nous avions l'« habitude » de payer entre 100 millions et 200 millions d'euros d'impôt sur les sociétés avant la crise de 2009, mais, compte tenu de l'évolution de nos résultats après 2009 et la chute consécutive de notre chiffre d'affaires en France, nous n'en payons plus.
Tout à l'heure, j'ai oublié d'indiquer, comme l'ont fait utilement certains de mes collègues, que, si nous payons à peu près 770 millions d'euros d'impôt sur les sociétés en France, nous acquittons au total 1,2 milliard d'euros d'impôts et de taxes. Le taux effectif d'impôt en France, si je me souviens bien, est à peu près de 34,5 % ou 35 %.

Si vous n'avez pas d'avis sur la présence de filiales bancaires, vous pourrez sans doute répondre à cette question : vos groupes détiennent-ils des comptes offshore ?

Une dernière question : combien de personnes, dans vos groupes, s'occupent de la gestion des coûts fiscaux ?
Une cinquantaine de personnes chez Veolia : sept au siège, et d'autres délocalisées soit au sein de nos divisions, soit dans les pays où, tout cela étant très local, nous avons besoin de fiscalistes.
Dix-huit personnes travaillent à nos sièges, et il doit y en avoir une demi-douzaine à l'étranger, notamment au Brésil.
J'ai dit que nous avions trois fiscalistes au siège en France et trois à quatre en Espagne, en Italie et au Portugal. Après, ce sont les services comptables qui assurent le travail fiscal.
J'ai cité tout à l'heure le chiffre de quinze, dont une dizaine en France.
Si vous me le permettez, monsieur le rapporteur, pour répondre à vos deux dernières questions sur la coexistence, dans un certain nombre d'États, de marques de notre groupe et de comptes de banques, je dirai que le meilleur exemple que l'on puisse donner est le territoire du Nevada, car il peut poser problème. Je citerai également Las Vegas, ce qui n'empêche pas que nous disposions dans cette ville de six boutiques Vuitton et d'une vingtaine d'autres magasins.
On peut établir une différence, s'agissant des entreprises, entre une présence que je qualifierai non pas de passive, mais de commerciale, dans un endroit où sont présents à la fois des marchés et des clients, et l'existence d'un certain nombre de réseaux et de pratiques qui, dans un monde comme celui-ci, sont totalement étanches et bien évidemment inconnus de nous. La présence sur des marchés ou auprès de clientèles n'est pas une présence fortuite. Mais la connaissance de comptes ou de banques ne nous conduit pas pour autant à avoir une opinion particulière sur ce sujet.
S'agissant de nos effectifs, j'ai indiqué que neuf personnes au siège du groupe s'occupaient du traitement à la fois des questions mondiales mais aussi des missions locales en France, où nous effectuons tout de même un quart de nos activités.
Puis, nous avons entre un et trois représentants dans chacune de la dizaine des grandes délégations dans le monde. Quant à la question que vous avez posée sur les banques, monsieur le rapporteur, à vrai dire, nous entretenons des relations avec les représentants français des banques établis à Paris, de temps en temps avec les correspondants aux États-Unis ou à Londres, mais jamais avec les structures que vous évoquez, dont nous n'avons pas connaissance.

Je voudrais obtenir deux précisions avant de conclure.
Tout à l'heure, monsieur Thormann, vous avez détaillé avec soin les taxes locales diverses : taxes sur les bureaux, taxes foncières... Le total des taxes locales par rapport à l'impôt sur les sociétés est-il établi dans chacun des groupes ?
Vous avez dit, en outre, que la France était l'un des seuls pays à opérer une distinction, dans le cumul des charges de l'entreprise, entre les taxes locales et l'impôt sur les sociétés, alors que vos concurrents, si j'ai bien compris, hormis le Brésil, déduisaient de l'impôt sur les sociétés la totalité des taxes locales. Est-ce bien cela ? Vous êtes tous des industriels, y compris Auchan. Dans tous vos groupes, procédez-vous au calcul de la totalité des taxes au profit des collectivités territoriales ? Le faites-vous régulièrement ou pas ?
Nous avons tous cité, me semble-t-il, à la fois le chiffre national de l'impôt sur les sociétés et celui des taxes locales. Nous avons tous la capacité d'additionner l'ensemble des éléments fiscaux.

Donc, globalement, l'impôt sur les sociétés est multiplié par deux sur le territoire national, si je prends en compte les taux que vous avez évoqués, car il s'agit des taux d'imposition de groupes.
Pour votre groupe, monsieur Thormann, c'est 48 %.

En réalité, pour vos cinq groupes, le taux global d'imposition est près du double de celui de l'impôt sur les sociétés.
Le taux de 45 %, c'est l'impôt sur les bénéfices. À cela, il faut ajouter tous les impôts et taxes...

En tout cas, en Europe, nous sommes les seuls à procéder de la sorte en termes de fiscalité.

Ma dernière question portera sur les prix de transfert qui ont été évoqués : combien d'accords ont été obtenus en France et à l'étranger sur ce sujet ?
Avec nos filiales ou avec des administrations ?
Aucun.
Aucun.
Je voudrais rebondir sur les propos de M. Jamet concernant les prix de transfert. A cet égard, le risque pour nous aujourd'hui, est plus la double imposition que l'évasion ou l'optimisation fiscale. Nous nous trouvons en fait actuellement, dans chacun des pays visés, face à des administrations relativement agressives, qui veulent collecter l'impôt, ce qui est normal.
La question de la fixation du prix de transfert est complexe, pas du tout univoque, et tient compte du prix total payé et du coût de fabrication.
Je citerai un exemple : du verre fabriqué dans une usine, en Pologne, est exporté vers l'Allemagne. Le coût complet de production est de 150, et le coût marginal de 100. Si le prix en Allemagne est de 150 ou 200, il n'y a aucun problème. En revanche, si ce prix se met à baisser brutalement et passe en-dessous du coût complet de production, c'est-à-dire à 125, l'entreprise enregistrera des pertes comptables, ce qui ne plaira pas au fisc polonais, mais la filiale aura intérêt à vendre à ce prix pour engranger du résultat, du bénéfice et du cash supplémentaire.
Il y a là une source de discussion avec les administrations fiscales polonaise et allemande qui est extrêmement facile pour le contrôleur. Il nous arrive d'avoir des discussions sur le même prix, le même transfert, alors que les taux d'imposition ne sont finalement pas très différents. Pour nous, les discussions que nous avons des deux côtés ont parfois une incidence nulle. Cela implique un investissement de formalisation et de mise en place du dossier extrêmement lourd. Tel est, à mon avis, le problème qui aujourd'hui pèse plus sur les prix de transfert qu'une optimisation de la part des entreprises.

Pour terminer, je souhaiterais poser une question à M. Riolacci, sur un aspect que la commission n'a pas encore évoqué pour l'instant, mais je ne sais pas s'il pourra me répondre.
Monsieur, concernant votre filiale de transport, dont je sais qu'elle ne représente plus un axe de développement stratégique pour votre groupe, disposez-vous d'informations sur les pavillons de complaisance ? Les activités maritimes de la France sont en effet souvent contestées ou en tout cas combattues sur le plan économique par les pavillons de complaisance. Vous avez peut-être un peu d'expérience dans ce domaine.
Mon expérience porte essentiellement sur l'activité de la Société nationale Corse Méditerranée, la SNCM, qui a été évoquée.
Aujourd'hui, il est tout de même difficile d'exploiter une activité commerciale en battant pavillon français, en raison de la concurrence avec des sociétés qui ne battent pas pavillon français sur des lignes totalement identiques ou voisines : lorsqu'une ville se trouve à cinquante kilomètres, cela ne fait pas une grande différence ! Nous nous retrouvons dans des situations structurellement très difficiles à combattre, compte tenu de l'avantage en termes de flexibilité de la main-d'oeuvre, de cotisations, et surtout de régimes de rémunérations différées. Je pense notamment à la prévoyance ou aux régimes de retraite. En l'occurrence, le surcoût est considérable et, quand on l'impose à une activité de pavillon français alors qu'elle est en compétition avec des sociétés ouvertes, on crée à mes yeux une situation qui ne peut pas être durable.
Je ne suis pas suffisamment expert en la matière, mais je pourrais vous apporter ultérieurement de plus amples informations en interrogeant nos propres services. C'est très significatif.

Messieurs, je vous remercie de votre participation aux travaux de la commission d'enquête du Sénat, qui a pris la forme d'une discussion à bâtons rompus mais très intéressante.

Mes chers collègues, nous accueillons M. Yves Nicolas, vice-président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Je vous rappelle, monsieur le président, que, conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
En conséquence, je vais vous demander de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Levez la main droite et dites : « Je le jure ».
(M. Yves Nicolas prête serment.)
Je vous remercie, monsieur le président.
Je vous propose de commencer l'audition par un exposé liminaire, puis de répondre aux questions de notre rapporteur, M. Éric Bocquet, ainsi qu'à celles des membres de la commission d'enquête.
Vous avez la parole.
Avant toute chose, je souhaite, monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs, me présenter. Je suis vice-président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, ainsi que président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles, dans les Yvelines.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dont je vais vous exposer le rôle, organise la profession autour des compagnies régionales de commissaires aux comptes, les CRCC, qui sont du ressort des cours d'appel. Il y a autant de compagnies régionales que de cours d'appel.
Je suis diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris et j'exerce la profession de commissaire aux comptes depuis plus de trente ans. Même si je suis également expert-comptable, j'exerce plus particulièrement la fonction de commissaire aux comptes dans un cabinet assez important, dont je suis le directeur général, à Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Ce cabinet est membre d'un réseau international.
Permettez-moi de vous expliquer le rôle et la fonction actuelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
On dénombre à la date du 1er janvier 2012, 19 052 commissaires aux comptes, dont 73 % de personnes physiques et 27 % de personnes morales.
A l'instar de nombreuses autres professions, celle de commissaire aux comptes se féminise de plus en plus. Aujourd'hui, la profession compte 19 % de femmes - c'est peu, mais, lorsque j'ai commencé, la proportion était bien moindre -, contre 81 % d'hommes.
Nous exerçons des mandats au sein de diverses formes de sociétés dans la mesure où la loi définit l'obligation pour certaines sociétés d'avoir un audit légal, et donc un commissaire aux comptes.
Les sociétés par actions simplifiées, les SAS, représentent presque 50 % de notre activité, contre 19,3 % pour les sociétés anonymes, les seules qui aient obligation, quelle que soit leur taille, d'avoir recours à un commissaire aux comptes, 8 % pour les sociétés à responsabilité limitée, les SARL, 11,8 % pour les associations et 11 % pour toutes les autres formes juridiques, souvent des organismes proches de l'État ou des collectivités locales.
Au total, cela représente 224 733 mandats. Vous vous en doutez, nous travaillons pour de toutes petites entreprises comme pour de très grandes, cotées au CAC 40.
Nos effectifs sont répartis de cette manière : les cabinets comptant plus de 50 salariés ne représentent que 15 % du total, alors que plus de la moitié d'entre eux ont moins de 10 salariés. Coexistent donc des cabinets de commissaires aux comptes qui peuvent compter jusqu'à 2 000 collaborateurs et des commissaires aux comptes qui exercent seuls.
Notre mission principale est de certifier les comptes de ces entités. A ce titre, nous émettons chaque année 224 733 rapports. Pour 97 % d'entre eux, il faut bien le dire, il s'agit d'une certification pure et simple - nous ne faisons ni observation ni réserve ; dans 2 % des cas, nous émettons des réserves et, dans 0,5 % des cas, ce qui a correspondu, l'année dernière, à 1 084 rapports, nous refusons de certifier les comptes.
Cette proportion peut vous sembler faible, mais il faut bien comprendre que, avant d'émettre notre rapport définitif, nous expliquons à l'entreprise que nous allons refuser de certifier ses comptes au motif qu'il y a des problèmes. Dans la majorité des cas, le conseil d'administration procède à des rectifications, car un refus de certification peut avoir un impact très important pour l'entreprise et pour son environnement.
Le commissaire aux comptes existe depuis longtemps. En effet, la fonction de réviseur des comptes a été créée pendant la révolution industrielle par la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés commerciales. Le métier a progressé avec la création, en 1969, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la CNCC. Se sont ensuivies deux phases d'évolution extrêmement importantes, avec la loi relative aux nouvelles régulations économiques, qui a unifié, en 2001, le statut du commissaire aux comptes et, dernièrement, la loi de sécurité financière, qui a instauré la séparation des fonctions d'audit et de conseil et qui a créé notre instance de supervision, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, que nous appelons dans notre jargon abréviatif, le H3C.
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes constitue l'instance représentative des 15 000 commissaires aux comptes personnes physiques en France. Elle vise à défendre les intérêts des professionnels auprès des pouvoirs publics. Elle rend compte aux régulateurs et au ministère de la justice, le ministère de tutelle.
Elle joue un double rôle d'autorité technique, morale et institutionnelle et d'animation du réseau régional, qui comprend, je l'ai évoqué précédemment, 33 compagnies régionales des commissaires aux comptes.
Notre organisation est assez simple.
Le Conseil national, qui est l'organe décisionnaire de la profession, est composé de 91 commissaires aux comptes. Il est représentatif de toutes les compagnies régionales. En fonction de leur importance, les conseillers régionaux sont élus conseillers nationaux. Il s'agit donc d'une organisation à deux étages : les commissaires aux comptes élisent les conseillers régionaux, dont certains deviennent conseillers nationaux.
Le Bureau national, organe exécutif, est élu par le Conseil national. Il est composé de 13 membres : le président de la CNCC, actuellement Claude Cazes, qui regrette de ne pas pouvoir être présent aujourd'hui,...
Je vous remercie !
... trois vice-présidents, dont moi-même, deux représentants du département des marchés financiers - une mesure instaurée par la loi de sécurité financière -, l'animateur de la réunion des présidents de CRCC et six autres membres.
Permettez-moi de revenir quelques instants sur la présence des représentants du département des marchés financiers.
Un certain nombre d'entités sont définies par la loi, ainsi que, dorénavant, par la directive « Audit » de la Commission européenne, comme étant des entités d'intérêt public. Certaines d'entre elles sont considérées comme étant plus importantes que d'autres en termes de poids économique ; je pense notamment aux sociétés cotées. Les commissaires aux comptes ayant des mandats dans les sociétés cotées font partie d'un département spécifique à l'intérieur de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, le département des marchés financiers, placé sous la cotutelle du ministère de la justice, du H3C et bien sûr de l'AMF, l'Autorité des marchés financiers.
Aux termes des articles L. 822-9 à L. 822-12 du code de commerce, les missions du commissaire aux comptes sont les suivantes.
La plus connue d'entre elles est la certification des comptes annuels et consolidés. C'est une mission légale d'intérêt général qui consiste à exprimer une opinion sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels des sociétés et à vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations financières fournies à l'assemblée générale - en dehors des comptes, de nombreuses autres informations sont données à l'assemblée générale. On retrouve souvent ces deux missions dans les autres pays européens.
En revanche, une particularité est purement française : le commissaire aux comptes doit prévenir les difficultés dans le cadre de la procédure d'alerte. Celui-ci ne vient pas seulement une fois par an examiner les comptes des entreprises, il doit observer ce qui s'y passe et, lorsque des situations difficiles apparaissent, il a l'obligation d'engager une procédure d'alerte auprès du président du conseil d'administration, puis, après un certain laps de temps, auprès du président du tribunal de commerce.
Il est important de savoir qu'une mission d'audit repose sur des contrôles effectués par sondages sur la base de l'évaluation des systèmes comptables et du contrôle interne de l'entreprise. Le commissaire aux comptes donne donc son opinion à partir d'un seuil de significativité ; il ne peut dire que les comptes sont justes à l'euro près. Tout est fonction de la taille de l'entreprise et de la significativité d'une erreur sur l'image fidèle des comptes.
Par ailleurs, le commissaire aux comptes a pour mission de vérifier les informations de nature comptable et financière données par l'entreprise ; de contrôler le respect de l'égalité entre les actionnaires, afin que certains n'aient pas des informations privilégiées par rapport à d'autres ; de communiquer les irrégularités et inexactitudes au conseil d'administration ; de prévenir, ainsi que je l'ai déjà souligné, en engageant une procédure d'alerte, qu'une entreprise va rapidement rencontrer des difficultés, des difficultés de trésorerie, par exemple ; de procéder à la révélation des faits délictueux auprès du procureur de la République, une mission d'ordre général qui n'implique de ne donner ni significativité ni contenu à ces faits ; enfin, de déclarer tout soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auprès de TRACFIN, le traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
Vous le voyez, le panel de nos missions est assez large.
Pour ce faire, nous disposons de normes d'exercice professionnel, les NEP, que le commissaire aux comptes doit respecter. Ces normes sont au nombre de quarante-quatre, ce qui représente un vrai petit fascicule ! Autre particularité française, elles sont élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui les transmet au garde des sceaux pour homologation après avis du H3C.
Au-delà de ces normes, il existe des normes d'audit international, les International Standards on Auditing, les normes ISA, souvent élaborées en anglais, qui sont plus ou moins appliquées dans tous les pays du monde. Pour ce qui nous concerne, nous devons non seulement observer ces normes, mais les transcrire dans le contexte français et les faire homologuer par le garde des sceaux, contrairement à d'autres pays européens qui les appliquent directement.
La valeur des NEP est, à nos yeux, importante, dans la mesure où elles ont un statut d'arrêté ministériel ; elles ont donc un caractère public qui les rend opposables aux tiers et institutionnalise plus encore le rôle normalisateur de la Compagnie nationale.
Elles ont pour objet de définir la démarche d'audit du commissaire aux comptes - comment il doit s'y prendre pour comprendre l'entreprise, son environnement de contrôle - et d'organiser les travaux de celui-ci. Mais il existe surtout - c'est très important dans le monde où nous vivons -, un code d'éthique et de comportement professionnel beaucoup plus sévère que le code international d'éthique en vigueur au niveau mondial, qui est émis par l'IFAC, l'International Federation of Accountants, une institution dont vous avez peut-être entendu parler, qui rassemble, au niveau mondial, toutes les organisations professionnelles de comptables, dont, bien sûr, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
Voilà le portrait que je voulais dresser. Je ne sais si j'ai été trop long ou trop bref...
Avant de répondre à vos questions, permettez-moi d'évoquer la manière dont nous appliquons les procédures de déclaration à TRACFIN et de révélation au procureur de la République, car il s'agit, me semble-t-il, d'un sujet éminemment important pour votre commission.
Le champ d'intervention du commissaire aux comptes se limite aux missions précédemment exposées. Comme je l'ai dit, nous avons une obligation non pas de résultat, mais de moyens : nous donnons une opinion sur les comptes de l'entreprise et, d'une certaine manière, sur son devenir au travers des difficultés qu'elle est susceptible de rencontrer. En matière de fiscalité, notre mission n'est pas active : nous n'avons pas à rechercher des erreurs ou des fraudes fiscales.
Cependant, au cours de nos travaux, nous pouvons être confrontés à une situation de fraude fiscale. Dans ce cas, le commissaire aux comptes doit déclencher deux procédures parallèles : la révélation de faits délictueux auprès du procureur de la République et la déclaration à TRACFIN en cas de suspicion de blanchiment d'argent.
Nous disposons aujourd'hui de certaines statistiques dans la mesure où le commissaire aux comptes établit une fois par an une déclaration d'activité. Il doit auprès de la compagnie régionale à laquelle il est inscrit, laquelle consolidera les données auprès de la Compagnie nationale, déclarer non seulement ses mandats et le contenu de ses rapports - s'il a procédé à une certification pure et simple ou avec réserves -, mais également les révélations qu'il a été conduit à faire.
En 2009, sur un total de 223 388 mandats, 1 075 révélations ont été faites, ce qui représente 0,5 % des rapports. En 2010, il n'y a eu que 886 déclarations - franchement, je n'ai pas d'éléments à vous donner pour expliquer cette baisse - sur 223 570 mandats, soit seulement 0,4 %. Je ne pense pas que l'on puisse en déduire que les sociétés que nous contrôlons ont été beaucoup plus attentives à ces problèmes. Cette proportion est surtout liée au fait que nous soyons ou non confrontés aux fraudes fiscales.
Je souligne que nous ne vérifions les comptes que d'une minorité d'entreprises françaises. Certes, nous intervenons de façon obligatoire dans les grandes entreprises, mais, en dessous d'une certaine taille, le commissaire aux comptes n'intervient pas.
Dans le droit positif français, l'article L. 823-12 du code de commerce prévoit l'obligation de révélation et l'article L. 820-7 du code précité est relatif à la sanction de non révélation.
Aux termes de l'article L. 823-12, « les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission ». Tous les actionnaires sont donc au courant. « Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance ». Souvent, l'opération se fait en deux temps : le commissaire aux comptes explique oralement au procureur de la République ou à l'un de ses substituts le problème qu'il rencontre et, ensuite, il envoie un courrier confirmant les faits. Vous vous en doutez bien, il arrive que le commissaire aux comptes n'ait aucune certitude : il constate des faits qui l'inquiètent et qui l'obligent à mener des investigations un peu plus poussées, mais il n'a évidemment pas les moyens de la police ou du procureur de la République pour aller beaucoup plus loin.
Pour ce qui est des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, elles sont définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
La définition de « faits délictueux » retenue par la loi est la suivante : des faits ou irrégularités susceptibles de recevoir des tribunaux une qualification pénale et des faits susceptibles de présenter un caractère suspect au regard de la loi pénale. Il s'agit d'une définition pénale assez large. C'est la raison pour laquelle nous avons souvent un échange oral avec le substitut du procureur dans la mesure où la qualification pénale n'est pas toujours évidente pour nous.
Que faisons-nous lorsque nous sommes confrontés à une telle problématique ?
La base de notre métier, c'est le scepticisme et le jugement professionnel. Notre code de déontologie nous pousse à être le plus indépendant possible à l'égard de l'entreprise. Nous ne pouvons avoir personnellement des prêts, des emprunts, des contrats d'assurance, des liens personnels avec le chef d'entreprise. Tout cela est bien défini et contrôlé par le H3C, qui a aussi, j'ai oublié de vous le dire, un rôle important en matière de contrôle qualité : il contrôle nos cabinets, pour certains tous les ans et pour d'autres tous les trois ou six ans, afin de s'assurer de la bonne application de ces normes d'indépendance.
Comme je l'ai dit, les missions de conseil sont, pour la plupart, interdites, et le code de déontologie français est le plus strict qui soit ; on s'en enorgueillit même dans le monde entier. Il a d'ailleurs inspiré - peut-être en avez-vous entendu parler ? - le Livre vert qui a été dernièrement publié, sur l'initiative de Michel Barnier, commissaire européen, pour tenter d'homogénéiser notre profession au niveau européen.
Lorsque nous sommes confrontés à des faits qui nous semblent bizarres, nous devons conduire de plus amples investigations. Toutefois, nous n'avons pas à mener de recherche active des faits délictueux : notre travail ne consiste pas, je le répète, à rechercher une fraude fiscale ou des faits délictueux.
Au demeurant, s'il ne révélait pas de tels faits ou s'il les révélait de façon tardive, le commissaire aux comptes pourrait bien sûr être poursuivi pénalement. Il encourt également un risque disciplinaire - avertissement, blâme, interdiction temporaire, voire radiation de la liste - dans la mesure où il peut être poursuivi devant la chambre de discipline de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, qui est pilotée par des magistrats du ressort des cours d'appel. Heureusement, ces poursuites ne sont pas très courantes !
Pour ce qui concerne la déclaration à TRACFIN en cas de suspicion ou de blanchiment de capitaux, prévue à l'article L. 823-12 du code de commerce, nous avons une NEP spécifique, une « norme d'exercice professionnel relative aux obligations du commissaire aux comptes relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ». Cela montre qu'il s'agit non pas d'une question subsidiaire, mais d'une diligence normale du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des Sceaux.
Pour accomplir notre mission, nous devons nous acquitter d'un certain nombre de tâches obligatoires.
Tout d'abord, nous devons bien identifier l'entité : nous assurer que la société que nous auditons est évidemment inscrite au registre du commerce, identifier ses actionnaires et ses dirigeants, leur nationalité et, en cas de nationalité étrangère, nous renseigner sur leur lieu de résidence et sur les liens qu'ils peuvent avoir avec d'autres entreprises ou avec lesquelles leur propre entreprise peut avoir des liens commerciaux ou juridiques.
Ensuite, nous examinons les opérations réalisées par l'entité et vérifions la cohérence de celles-ci avec la connaissance que nous avons de l'entité. Toutes les transactions ou opérations exceptionnelles, qui ne relèvent pas de l'activité habituelle de la société, attirent évidemment notre regard et sont de nature à nous conduire à des investigations plus poussées.
Il nous est également demandé, ce qui n'est pas chose aisée, de rechercher le bénéficiaire effectif d'une transaction exceptionnelle, ainsi que l'actionnaire majoritaire ou l'actionnaire qui dirige cette entreprise.
Or nous pouvons être confrontés à des cascades de sociétés : l'actionnaire majoritaire peut être une société inscrite à l'étranger, qui est elle-même détenue par une autre. Vous voyez les difficultés que nous pouvons rencontrer. Pourtant, nous devons tout faire pour identifier le bénéficiaire effectif ultime.
J'en viens à la nature des opérations à déclarer à TRACFIN.
D'une part, nous devons déclarer les opérations portant sur des sommes dont nous soupçonnons, ou avons de bonnes raisons de soupçonner, qu'elles proviennent d'une infraction, hors fraude fiscale, passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou qu'elles participent au financement du terrorisme.
D'autre part, nous devons déclarer les sommes ou opérations dont nous soupçonnons, ou avons de bonnes raisons de soupçonner, qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, uniquement lorsque nous sommes en présence d'au moins un critère défini par le décret du 16 juillet 2009.
Je résume : nous avons donc une obligation de révélation au procureur de la République de façon urgente. Il existe un délai de tolérance du parquet d'un mois environ, pour la bonne raison que nous devons poursuivre nos investigations avant de procéder à la révélation des faits afin d'être le plus précis possible.
Il faut savoir qu'il n'y a aucun niveau de significativité dans la déclaration des faits délictueux : nous devons déclarer tous les faits délictueux que nous rencontrons quel que soit le montant ou l'importance de ceux-ci. Nous devons même déclarer si le fait délictueux a été corrigé ou s'il a déjà été déclaré par l'entreprise, ce qui arrive souvent. En effet, les faits délictueux concernent non pas seulement le chef d'entreprise, mais également les employés de l'entreprise.
En la matière, nous avons une pratique assez ancienne, et nous avons d'ailleurs un dialogue continu avec chaque procureur de la République du ressort de la CRCC.
Concernant TRACFIN, cette procédure est plus récente. Nous avons eu des discussions avec les responsables de cette cellule. Ils veulent que nous soyons beaucoup plus rapides dans nos déclarations de soupçon. Toutefois, cette problématique ne faisant pas partie de nos objectifs, il est clair que c'est plutôt par hasard que nous tombons sur de tels faits. Nous devons alors examiner plus précisément la situation pour voir si les sommes d'argent visées font vraiment l'objet d'une transaction frauduleuse. Sinon, nous abreuverions TRACFIN de déclarations inutiles !
Telles sont les obligations extrêmement importantes auxquelles nous sommes soumis et sur lesquelles nous sensibilisons beaucoup nos confrères.

Je vous remercie de votre présentation, monsieur le président.
J'ai bien noté que vous rendiez un avis favorable dans 97 % des cas. Aussi, je m'intéresserai plus particulièrement au 0,5 % des cas qui ont fait l'objet d'un refus de certification - on s'intéresse toujours au train qui arrive en retard, et jamais à ceux, bien plus nombreux, qui sont à l'heure !
Ces cas sont-ils liés à des problèmes de fraude ou d'évasion fiscale ? Si oui, pourriez-vous nous donner quelques illustrations concrètes ?
Franchement, je ne peux vous en donner que très peu !
Les réserves que nous émettons sont plutôt liées à une absence d'informations - la société ne donne pas les bonnes informations à ses actionnaires -, à une mauvaise interprétation des méthodes comptables, ce qui a évidemment un impact sur l'image des comptes, ou bien encore à des incertitudes absolues sur certains actifs ou sur certains passifs, absolument colossaux, qui présentent un risque latent. En général, ces risques ne sont d'ailleurs pas de nature fiscale.
Il peut arriver que nous formulions des réserves parce que nous avons détecté un risque fiscal latent, qui n'a pas été appréhendé par l'entreprise. Le dirigeant peut nous rétorquer qu'il ne s'agit pas d'un risque absolu - des avocats vont l'aider à se défendre et à convaincre l'administration fiscale du bien-fondé de ce qu'il pense - ou que le risque n'est pas avéré et qu'il n'y a donc pas de raison de le provisionner. Dans ce cas, il revient au commissaire aux comptes de trancher la question.

Si je comprends bien, il s'agit, la plupart du temps, d'un désaccord sur le provisionnement d'un risque ?
Exactement !
Absolument !
Notre vision peut être différente dans la mesure où l'avocat fiscaliste a indiqué au chef d'entreprise que le risque est de tant, alors que les experts qui travaillent dans nos cabinets ont une appréhension quelque peu différente. Le commissaire aux comptes peut être conduit sinon à refuser de certifier les comptes en cas d'écarts d'évaluation gigantesques, du moins à émettre des réserves dans son rapport.

L'administration fiscale a-t-elle collaboré avec vous pour édicter en l'espèce des normes ?
Non.
Il faut bien comprendre que nous sommes des commissaires aux comptes et non pas des experts-comptables de l'entreprise. L'expert-comptable est, lui, un conseil de l'entreprise. Il lui revient donc de conseiller le chef d'entreprise sur ces questions.

Certes, mais vous exercez les deux métiers. Vous pouvez même parfois être commissaire aux comptes dans une entreprise et expert-comptable dans une autre. Vous avez donc les connaissances d'un expert-comptable.
Il est exact que la plupart des commissaires aux comptes sont experts-comptables ; c'est d'ailleurs le même diplôme. Mais notre code de déontologie est extrêmement strict : on ne peut pas être à la fois expert-comptable et commissaire aux comptes dans la même entreprise.
Les deux métiers sont complètement différents : l'expert-comptable est là pour assister le chef d'entreprise, le conseiller pour régler une problématique fiscale tandis qu'il revient au commissaire aux comptes de dire si cette question a été correctement traitée. Cela signifie que nous avons une certaine connaissance du sujet dans la mesure où nous avons pu le pratiquer dans une autre entreprise.

Vous avez indiqué qu'un code éthique comprenant des normes et des principes guide votre action. Apparemment, il est plus sévère en France que dans les autres pays européens.
Effectivement.

Toutefois, sans mettre en doute l'intégrité et le sérieux du travail des commissaires aux comptes, reste inévitablement posée la question de l'indépendance de ces derniers dans la mesure où ils sont rémunérés par leurs clients.
Oui.

Cela crée de fait, une dépendance. Vous avez dit que vous étiez le plus indépendant possible ; cela laisse une marge, sur laquelle on peut s'interroger.
Nous avons eu il y a quelque temps connaissance d'un licenciement d'auditeurs, mais je ne sais plus où exactement. Pouvez-vous nous indiquer quelles mesures et quelles dispositions ont été prises pour parvenir à résoudre cette question de l'indépendance totale et absolue du commissaire aux comptes par rapport à l'entreprise qu'il audite ?
J'ai commis une erreur de langage en disant que nous étions indépendants le plus possible. La question ne se pose pas : nous sommes indépendants, et cette indépendance est d'ailleurs vérifiée au travers du contrôle qualité effectué par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, qui est complètement indépendant de la profession dans la mesure où il est présidé par un haut magistrat.
Je tiens à mentionner que nous sommes nommés pour une durée de six ans. Même si nous sommes rémunérés par l'entreprise, notre mission nous est confiée par l'assemblée générale pour six années, et les honoraires sont, en général, définis dès le départ au moyen, la plupart du temps, d'un appel d'offres. Les choses sont donc absolument transparentes. Il existe, par ailleurs, de nombreuses mesures de nature à garantir cette indépendance.
J'évoquerai tout d'abord la rotation des signataires.
S'agissant des sociétés faisant appel public à l'épargne, ce ne sera pas le même associé signataire qui interviendra si le mandat est renouvelé. C'est un autre associé du cabinet, indépendant, qui assurera ce nouveau mandat, sauf à prendre le risque de subir éventuellement les foudres d'une sanction pénale, civile, réglementaire, voire disciplinaire.
En effet, même si nous n'aimons pas trop parler de cet aspect des choses, notre profession est très surveillée par le H3C et par les magistrats. Nous cumulons les risques car, en tant que signataires à titre personnel ou au nom d'une personne morale, nous avons à faire face à d'éventuelles poursuites pénales, civiles, en réparation, réglementaires pour ce qui concerne l'AMF s'il s'agit d'une société cotée, et disciplinaires. Nous sommes donc très encadrés.
Il est, par exemple, absolument interdit de certifier les comptes d'une entreprise dont le dirigeant serait un parent ou d'accepter un prêt d'une entreprise dont on est le commissaire aux comptes ; ce serait la meilleure façon d'être définitivement radié ! Je mets bien en exergue le fait que nous sommes l'une des professions libérales les plus réglementées et les plus contrôlées qui soient.
Au demeurant, il existe bien d'autres mesures encore. Ainsi, dans le cadre des comptes consolidés d'un groupe de sociétés, intervient - nous sommes quasiment le seul pays au monde où cela existe de façon obligatoire - le co-commissariat aux comptes : deux commissaires aux comptes signent le même rapport. Imaginez que l'un d'entre eux accepte tout à coup les faveurs d'une société, l'autre serait évidemment là pour l'en empêcher, voire, le cas échéant, émettre un rapport différent du sien ; la visibilité du problème serait alors flagrante.
Je ne vous dis pas que tout est parfait dans le meilleur des mondes, car il y a toujours des complications, mais, du fait de ces réglementations, notamment de la loi de sécurité financière que j'ai évoquée tout à l'heure, qui a été adoptée à la suite des scandales américains Enron ou WorldCom, dont vous vous souvenez certainement, notre profession est très encadrée et très surveillée.

De quels outils efficaces disposez-vous pour détecter les anomalies que vous avez énoncées tout à l'heure, concernant, par exemple, les prix de transfert ou le recours à des montages ou à des refuges fiscaux opaques ? Avez-vous alors accès à l'ensemble des documents de l'entreprise concernée ? Quels sont vos moyens d'investigation ?
Monsieur le rapporteur, vous posez de bonnes questions.
Tout dépend du contexte. S'il s'agit d'une entreprise française, avec des actionnaires français, les choses peuvent être assez simples. Bien sûr, le commissaire aux comptes a le droit d'obtenir toutes les informations qu'il demande ; dans le cas contraire, ce serait considéré comme un obstacle à sa mission, et il pourrait, à ce titre, dénoncer cette situation auprès du procureur de la République. S'il s'agit d'une société française, je dirai donc qu'il dispose de tous les moyens pour mener ses investigations. Il ne rencontre dans ces conditions pas beaucoup de problèmes, sauf s'il a affaire à des chefs d'entreprise qui veulent lui cacher des choses.
En dehors de son investigation personnelle, il peut aussi avoir recours à des spécialistes de son cabinet ou à des sous-traitants pour ce qui concerne les risques fiscaux ou les manipulations informatiques. Tout dépend de la taille du cabinet : les grands cabinets comptent évidemment des spécialistes de ces questions, qui peuvent contrôler les procédures informatiques ou les déclarations fiscales ; les plus petits cabinets, eux, peuvent parfaitement demander à un sous-traitant de les aider à traiter un point particulier.
La situation est plus complexe lorsqu'il s'agit d'une filiale d'un groupe étranger car la problématique du prix de transfert que vous avez évoquée n'est pas facile à examiner dans la mesure où elle est gérée au niveau du siège social. Le commissaire aux comptes français peut demander un certain nombre d'informations, mais il peut ne pas les obtenir et ne sera donc pas en mesure de savoir ce qui se passe au siège social situé à l'étranger.
Le problème est donc plus complexe lorsque nous auditons une filiale d'un groupe au sein duquel nous n'avons pas de liens directs. Il arrive même quelquefois que le conseil d'administration de la société française comprenne de nombreux membres de nationalité étrangère, qui ne sont pas domiciliés en France. Vous voyez toute la difficulté pour nous d'obtenir des informations !
Si le groupe est sérieux - et la plupart des groupes étrangers qui travaillent en France le sont ! -, l'auditeur de la société mère, qui a une vision globale du groupe et qui doit, eu égard aux normes de travail internationales, examiner la question des prix de transfert, demandera un certain nombre d'informations au commissaire aux comptes français pour qu'il puisse donner une opinion sur les comptes consolidés. Mais le commissaire aux comptes français peut, lui aussi, bien sûr demander un certain nombre d'informations à son confrère étranger qui contrôle le groupe.
Les choses sont plus faciles si le commissaire aux comptes français est membre du même réseau international. Vous le savez, pour auditer les groupes français, mais aussi les filiales de groupes étrangers, notre profession est de plus en plus organisée en réseau : même si chaque commissaire aux comptes est bien sûr indépendant localement, il fait partie d'un réseau international qui permet d'assurer une meilleure communication. Nous avons des méthodes de travail communes, avec des demandes et des retours d'informations.

Cela signifie-t-il que vous seriez favorable à la généralisation du reporting pays par pays ? Ce système, qui est dans l'air du temps, n'est-il pas de nature à répondre aux difficultés que vous rencontrez pour mener à bien votre action dans les grands groupes ?
Ce matin, cette question a été posée à un représentant d'une grande entreprise française, qui a estimé que cela allait trop loin et que c'était une hérésie. Qu'en pensez-vous ?
Il y a peut-être des problèmes de faisabilité, mais je ne suis pas spécialiste en la matière pour vous répondre. Les transactions d'un groupe sont de plus en plus imbriquées dans les différentes filiales de celui-ci. La situation fiscale du groupe est telle qu'il me paraît compliqué d'en venir à une vision pays par pays.
Il est évident qu'il serait intéressant pour le commissaire aux comptes français de pouvoir disposer, pour les transactions françaises, d'informations pertinentes sur l'impact des décisions fiscales à l'étranger. Mais, comme je vous l'ai dit, je crois plus au fait que l'auditeur de la maison mère communique mieux avec l'auditeur de ses filiales.

Concernant les signalements à TRACFIN ou au procureur de la République, avez-vous un bilan chiffré et qualitatif de l'application de ce dispositif dans le domaine plus spécifique de la fraude fiscale ?
Non. Pour les révélations des faits délictueux, nous n'avons que les chiffres globaux que je vous ai communiqués tout à l'heure ; je ne peux pas vous dire quels sont les faits liés à la fraude fiscale. Il en est de même pour TRACFIN. Je n'ai pour le moment que des informations globales.

Vous avez évoqué la responsabilité des commissaires aux comptes en cas de non-signalement d'une situation douteuse, « bizarre », pour reprendre votre terme. Mais, en cas de redressement fiscal d'une entreprise dont les comptes ont été certifiés par un commissaire, la responsabilité de celui-ci peut-elle être, de la même manière, engagée ?
Selon la jurisprudence, le commissaire aux comptes a une obligation de moyens et pas de résultat. Sa responsabilité pourrait être engagée si l'on pouvait prouver que ses diligences étaient insuffisantes et qu'il n'a pas fait le travail de qualité qu'il aurait dû faire et qui lui aurait permis de détecter le problème.
Comme je vous l'ai dit, nos contrôles sont effectués par sondages et nous donnons une opinion à partir d'un seuil de significativité. Tout dépend du niveau de la fraude fiscale. Si celle-ci était vraiment monumentale, et donc visible, les tribunaux pourraient, me semble-t-il, soulever la question de la responsabilité du commissaire aux comptes.

Certes, elle est parfois visible, mais on peut aussi imaginer qu'il y ait justement des territoires ou des dispositifs opaques ; je pense aux trusts ou aux prête-noms. Avez-vous déjà été confronté à de telles situations ? Si oui, comment procédez-vous pour mener vos investigations ?
Je n'ai pas été personnellement confronté à cette situation.
Si une société a cet objectif, elle se donnera en France - c'est parfaitement possible - une personnalité juridique qui ne prévoit pas la présence d'un commissaire aux comptes. Dès lors que vous savez que tel ou tel régime juridique entraîne la présence obligatoire d'un commissaire aux comptes qui va vous contrôler, pourquoi le choisir ?

Je pense à la plus grande banque française, voire européenne, qui dispose d'entités dans des paradis fiscaux. Comment peut-on, d'une part, accéder à toutes les informations et, d'autre part, certifier les comptes de cet établissement bancaire, qui, à l'évidence, dissimule certains actifs ?
Je ne peux pas vraiment répondre à votre question, car je ne connais pas le dossier que vous évoquez.
En règle générale, si un commissaire aux comptes d'un groupe français constate que certaines filiales sont situées dans des paradis fiscaux, il mène évidemment des investigations pour connaître la raison de cette implantation et l'objectif poursuivi par le groupe. Mais encore faut-il que ces filiales aient une importance significative. En effet, il peut y avoir dans certains paradis fiscaux de toutes petites filiales, qui ne sont pas dans le périmètre de consolidation, et sur lesquelles le commissaire aux comptes n'intervient pas forcément.

Y a-t-il des commissaires aux comptes aux Îles Vierges britanniques, par exemple ?
Il y a, localement, des auditeurs.
Ils sont soumis aux règles locales, que je ne connais pas exactement.
Je puis toutefois vous dire que les auditeurs locaux membres de réseaux internationaux ont l'obligation de respecter les normes d'audit international, les normes ISA que j'ai évoquées tout à l'heure dans mon propos liminaire.

Vous avez indiqué que vous meniez des investigations lorsque vous êtes confronté à des écritures comptables traduisant un montage juridique à haut risque qui peut aller, par ordre de graduation, de l'optimisation fiscale à peu près certaine sur le plan de la régularité juridique à l'acte anormal de gestion, à l'abus de droit, voire à la fraude.
Imaginons que vous n'arriviez pas à vous sortir de la tête l'impression qu'une opération est douteuse. Ouvrez-vous alors le parapluie, comme on dit ? En termes plus juridiques, faites-vous un signalement automatiquement ou invitez-vous l'entreprise à corriger son montage ?
Je veux préciser un point que j'ai omis de rappeler dans ma présentation : nous ne devons pas nous immiscer dans la gestion. La direction d'une société fait les montages qu'elle souhaite. Nous n'avons pas à dire si c'est bien ou mal.
En revanche, lorsque les montages sont quelque peu compliqués, il est de notre devoir, surtout si les montants sont significatifs, de regarder s'ils n'aboutissent pas à des risques fiscaux. C'est là une question de jugement professionnel.
Il revient au commissaire aux comptes d'estimer si un délit est constitué. Dans ce cas, il saisira le procureur de la République.
Concernant une opération particulière, il m'est difficile de vous répondre par l'affirmative ou par la négative sur la décision à prendre, car nous sommes toujours confrontés à un cas d'espèce. Le commissaire aux comptes émet un jugement professionnel en fonction d'une situation donnée. En général, il consulte soit ses associés, s'ils sont plusieurs dans le cabinet, soit le président de la compagnie régionale - cela m'est arrivé - pour déterminer s'il y a un vrai problème.
En général, les commissaires aux comptes sont des gens raisonnables : dès lors qu'ils ont vraiment un doute, la plupart du temps ils en discutent avec la Direction de l'entreprise et éventuellement appellent le procureur de la République pour lui exposer l'affaire. Celui-ci peut accepter, dans un premier temps, de donner un avis. Cela aboutira à un courrier, et donc à une procédure de dénonciation, en cas de problèmes importants avérés.
Les rapports des commissaires aux comptes sont déposés au greffe du tribunal de commerce.

Tout le monde peut y avoir accès ? Y compris l'administration, en usant de son droit de communication ?
Absolument !
Franchement, je réfléchis, mais je ne trouve pas d'exemple, je crains d'avoir à vous dire qu'elle ne le fait pas très souvent. Toutefois, elle peut le faire d'elle-même sans passer par le commissaire aux comptes. Il faudrait plutôt que vous posiez la question aux greffiers.

Il s'agit d'une excellente question, non pas parce qu'elle vous gêne ou que vous n'y répondez pas,...
Elle ne me gêne pas !

mais parce qu'il serait bon de savoir si l'administration fiscale va vraiment un peu plus loin.
Pour ma part, je reviendrai sur la question de l'homogénéisation des normes sur le territoire européen. Vous avez indiqué que vous rencontriez plus de difficultés dans certains pays que dans d'autres. Lesquels ? Existe-t-il un lien particulier avec la gestion supposée bonne ou mauvaise de ces pays ?
Par ailleurs, vous dites ne pas avoir connaissance du nombre de faits délictueux soumis au procureur de la République en matière de fraude fiscale ou à TRACFIN en matière de blanchiment de capitaux. Je suppose que vous ne connaissez pas non plus le montant que cela pourrait représenter.
Je n'en ai aucune idée !

Est-ce difficile de le savoir ? Nous essayons de trouver des pistes visant à améliorer l'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale. Or je me rends compte que tout cela semble assez compliqué pour vous, soit parce que les moyens dont vous disposez pour agir sont insuffisants, soit parce que vous avez un objectif de moyens et non de résultat.
Est-ce que le fait d'aller vers un objectif de résultat serait une solution parmi d'autres de nature à garantir une meilleure efficacité ? Cela supposerait-il beaucoup plus de moyens pour les commissaires aux comptes ? Pardonnez le caractère quelque peu béotien de ma question, mais j'essaie de voir comment les commissaires aux comptes pourraient régler cette problématique de manière optimale.
L'homogénéisation européenne est un énorme chantier, qui est loin d'être achevé.
Je vous ai parlé d'homogénéisation non pas tellement par rapport à la lutte contre la fraude fiscale, mais plutôt par rapport au statut de l'auditeur ou du commissaire aux comptes, qui est très différent d'un pays à l'autre. Je l'ai dit, en France, les normes de travail sont homologuées par le garde des Sceaux, après avis du H3C. Nous sommes le seul pays européen où de nombreuses personnes extérieures à notre profession examinent notre manière de travailler. Ailleurs, c'est le commissaire aux comptes lui-même ou son institution qui définit ses normes de travail.
Pour ce qui est de l'indépendance du commissaire aux comptes, notre code de déontologie est beaucoup plus sévère que celui qui est en vigueur à Londres ou à Berlin par exemple. C'est d'ailleurs l'un des sujets de réflexion de la Commission européenne, qui a pour objectif de réformer notre profession en l'homogénéisant à partir de la situation française.
Je le répète, notre mission est non pas de rechercher la fraude fiscale, mais bel et bien de donner une opinion sur des comptes. Si les comptes que nous examinons sont entachés de risques fiscaux importants, cela nous intéresse bien évidemment et notre rapport en fait état, mais il peut tout aussi bien s'agir de risques environnementaux ou autres, qui nécessitent d'être provisionnés ou solutionnés. Eu égard au travail que nous faisons, nous évaluons la situation de l'entreprise pour savoir si ces risques sont réels. Dans l'affirmative, nous vérifions que l'entreprise a prévu les provisions suffisantes pour y faire face. Mais tant que le risque n'est pas vu, soupçonné ou avéré, nous n'avons pas à le prendre en compte.

Dans d'autres pays, les commissaires aux comptes ont-ils un rôle plus particulier par rapport à la fraude fiscale ?
Pas du tout ! Je ne l'ai peut-être pas assez dit.
Absolument ! La France est l'un des seuls pays au monde à avoir prévu une procédure de révélation au procureur de la République. D'ailleurs, dans les autres pays, le métier d'auditeur n'est pas le même que le nôtre : il s'agit en général d'un rôle contractuel et non pas légal.
Ainsi, dans la plupart des pays anglo-saxons, l'auditeur est nommé pour un an par le management, et non pas par l'assemblée générale. Il a une lettre de mission, qui est acceptée par l'entreprise, afin qu'il exprime une opinion sur les comptes. On n'est pas du tout dans le même contexte.

Enfin, lorsque vous constatez dans la trésorerie d'une entreprise de très importants mouvements de liquidités, qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement normal de celle-ci, que faites-vous concrètement ? Quel est votre rôle ?
Tout d'abord, le commissaire aux comptes demande des explications au comptable, au directeur financier ou au directeur général, en fonction du régime juridique de l'entreprise, ainsi qu'à des tiers pour avoir confirmation et explication de ce qui s'est passé ; je pense notamment à la banque. S'il y a eu des transferts d'argent, le banquier en a eu a priori connaissance. Ensuite, on recherche des pièces justificatives pour comprendre la réalité de la transaction.
Dès lors qu'un commissaire aux comptes a identifié ce type de risque, il va, me semble-t-il, jusqu'au bout. Toutefois, il faut bien comprendre que, dans certaines grandes entreprises notamment, les transactions quotidiennes se comptent par milliers. Il est donc difficile de toutes les vérifier.
Je répondrai à votre dernière question en disant que, si nous avions une obligation de résultat, il nous faudrait, dans certaines entreprises, multiplier nos honoraires par dix ou par vingt. Je pense que c'est complètement irréaliste !

Le secteur bancaire a été particulièrement chahuté ces dernières années, notamment au plus fort de la crise financière. Des commissaires aux comptes avaient-ils été amenés à formuler des remarques ou des réserves sur l'activité de certains établissements en amont de ce que la crise a pu révéler ?
Oui, par le biais du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes remis à l'assemblée générale, dont nous avons beaucoup parlé. Mais les établissements financiers importants disposent de nombreux autres rapports, qui sont examinés avec la direction de l'entreprise et les comités d'audit. Ceux-ci font état des diligences effectuées par le commissaire aux comptes, des risques qu'il a vus, des problèmes qu'il a rencontrés, des solutions qu'il faudrait apporter, et mentionnent même des recommandations.
En effet, si le commissaire aux comptes ne peut pas donner de conseils, il peut faire des recommandations, en soulignant que telle problématique comptable devrait être traitée différemment.
Si vous demandiez à une banque tous les rapports émis par les commissaires aux comptes - et pas seulement celui sur les comptes annuels -, vous verriez qu'ils traitent beaucoup de choses. Je ne puis vous en parler précisément car je n'ai pas été confronté à ce problème dans mes dossiers, mais vous constateriez sûrement qu'ils pointaient des problèmes à traiter et mettaient en exergue des risques qui devraient peut-être apparaître un jour de façon plus visible. Mais on aborde là un sujet très passionnant, celui du rôle préventif du commissaire aux comptes.
Notre mission actuelle consiste à donner une opinion sur les comptes qui ont été arrêtés. En revanche, il serait intéressant - mais c'est un débat un peu plus général - de nous confier également un rôle un peu plus préventif, à l'instar de ce que nous faisons lorsque l'entreprise est en difficulté.
En effet, connaissant bien les rouages de l'entreprise en général et l'activité concernée, le commissaire aux comptes est à même d'avoir une opinion sur l'état des risques et l'éventualité que ceux-ci se réalisent. Le Livre vert de Michel Barnier - c'est d'actualité dans notre profession - a d'ailleurs pour origine la crise bancaire : qu'ont fait les auditeurs ? Avaient-ils repéré les problèmes ? Ne faudrait-il pas élargir leur mission ? C'est une question passionnante dont nous sommes prêts à discuter, mais je déborde là du sujet de votre commission.

Pas tout à fait ! De quelle façon pourrait-on élargir votre mission pour éviter que cette situation ne se reproduise à l'avenir ?
Pour le moment, il n'y a rien d'établi. Mais, dès lors que le commissaire aux comptes est un tiers indépendant ayant une vision sur les risques de l'entreprise, ne pourrait-il pas faire un rapport sur ces risques ? Les comptes de l'entreprise sont certes certifiés, mais celle-ci encourt un certain nombre de risques : des risques environnementaux, des risques liés à son activité, laquelle peut être difficile à mener ou en pleine évolution, des risques liés à son organisation interne ou à son système informatique, qui n'est peut-être pas efficient, ainsi que, bien sûr, des risques fiscaux, juridiques, contractuels, etc. Un chef d'entreprise est malheureusement « cerné » par des risques de tous ordres.

Dans les nombreux dossiers que vous avez traités, avez-vous constaté des délocalisations d'actifs immatériels dans des territoires à fiscalité privilégiée, comme les Bermudes ? Je pense notamment à la gestion des brevets.
Personnellement, non. Certes, nous voyons bien que des entreprises ferment une usine pour délocaliser, mais, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, nous ne nous immisçons pas dans la gestion. Si elles le font, nous vérifions qu'elles respectent les lois et les règlements de la République française.

Concernant les prix de transfert, diriez-vous qu'ils sont correctement contrôlés dans les grandes entreprises ?
Au vu de mon expérience personnelle, notamment à l'égard de groupes français, je dirai oui, et de mieux en mieux.
En général, les groupes français se sont outillés de spécialistes, qui ont mis en place des procédures. Ils savent très bien qu'ils sont surveillés par l'administration fiscale : c'est un sujet assez systématique.

Que pensez-vous du projet de mettre en place en Europe une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, l'ACCIS ? J'imagine que vous en avez entendu abondamment parler. Auriez-vous des propositions à formuler à ce sujet ?
Tout ce qui peut aboutir à plus de clarté au niveau européen me semble une bonne chose. Il s'agit là d'une très bonne question. Mais nous n'avons pas d'opinion précise sur la manière de procéder. Tout ce que je puis vous dire, c'est que cela va dans le bon sens, vers la clarification et la transparence.
Pas par les commissaires aux comptes.

Je poserai une question très simple : un commissaire aux comptes a-t-il les moyens de détecter une fraude fiscale dans la mesure où il vérifie la sincérité des comptes de l'entreprise ? Par ailleurs, a-t-il les moyens d'analyser, à l'intérieur de l'entreprise, des faits qui auraient pu - j'emploie le conditionnel à dessein - être délictueux ?
Je l'ai dit, le commissaire aux comptes a une mission de vérification des comptes. Lorsqu'il voit des montages ou des opérations financières, il doit se poser la question de l'impact fiscal dans la mesure où il audite le résultat net après fiscalité. Bien sûr, je ne vous dirai pas qu'il a les moyens de tout voir et de tout vérifier puisqu'il a une obligation de moyens et non de résultat. Mais si vous voulez parler de ses compétences, il a, par essence, des compétences fiscales et, comme je l'ai déjà dit, s'il s'agit d'un point extrêmement complexe, il peut faire appel à des spécialistes de son cabinet ou à l'extérieur.

Dans son Livre vert, M. Barnier fait des propositions en matière d'harmonisation européenne, mais, en réalité, il va falloir convaincre nos partenaires. Si l'harmonisation se fait a minima, cela peut se retourner contre votre profession...
Vous avez indiqué que la France est l'un des seuls pays où il existe, en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, un co-commissariat aux comptes.
Oui, pour les comptes consolidés des groupes.

Une harmonisation européenne pourrait être de nature à nous faire revenir en arrière, avec un seul commissaire aux comptes.
Vous avez raison, monsieur le président, et c'est pourquoi nous sommes extrêmement vigilants.

Même si la France est le pays le plus intransigeant en matière de normes et de contrôles, elle n'a pas encore convaincu ses partenaires de l'efficacité de son système.
Vous avez parfaitement raison, monsieur le président. Nous sommes très attentifs à ce que l'homogénéisation ne se fasse pas par le bas, en supprimant, au niveau européen, des règles que la France applique déjà.
Pour ce qui est du co-commissariat aux comptes ou, pour utiliser le terme international, du joint audit, la Commission européenne a heureusement prévu cette possibilité en option. Cela reste donc possible en France.

A priori, nous conserverons nos règles spécifiques. Toutefois, si je vous ai bien compris, vous pensez qu'il serait souhaitable, au regard de la compétitivité à laquelle sont confrontées nos entreprises, tout au moins pour ce qui concerne nos grands voisins, que cette harmonisation s'inspire de notre système. Mais encore faut-il convaincre de l'efficacité de celui-ci.
C'est parfaitement vrai.

Par ailleurs, je voudrais que vous nous parliez de l'ambiance actuelle, parce que c'est ce qui nous intéresse, nous, membres de la commission d'enquête sur l'évasion des capitaux. Avez-vous le sentiment que l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, voire la fraude ont été, ces dernières années, au coeur des préoccupations des dirigeants d'entreprises françaises ou pensez-vous, au contraire, qu'ils ne subissent pas de pression en la matière et ne s'interrogent pas sur la stratégie fiscale qu'ils doivent avoir ?
Est-ce un sentiment qui se développe tout simplement parce que les entreprises, même de taille moyenne, sont de mieux en mieux informées sur la question de la concurrence fiscale en raison de la pression de plus en plus forte qui pèse sur elles ? Ou pensez-vous, au contraire, que cette problématique a toujours existé ? Certaines entreprises ont toujours eu tendance à franchir la ligne jaune, mais ce n'est pas le plus grand nombre.
J'ai le sentiment que l'optimisation fiscale a été une préoccupation permanente des entreprises et qu'elle le demeure. Je n'ai pas de raison de penser qu'il s'agit actuellement d'une préoccupation plus particulière.
Oui. Je pense que beaucoup d'entreprises ont réfléchi à cette problématique depuis longtemps et l'ont mise en place. Cette préoccupation n'est pas plus prononcée aujourd'hui.

Je vous poserai encore deux petites questions.
Le CPO, le Conseil des prélèvements obligatoires, avait rendu un rapport il y a quelques années mettant en évidence le fait que les grands groupes du CAC 40 paient un impôt sur les sociétés à hauteur de 8 %, contre 33 % pour les autres. Ce débat est récurrent, mais il est, à mon avis, très légitime. Quelle approche avez-vous de cette situation ?
L'auditeur vérifie la charge d'impôt globale du groupe, s'assure que le calcul est correct et que le groupe a respecté la réglementation française.

Dans quel pays l'IASB, l'organisme qui définit les normes comptables, a-t-il son siège ?
Il est à New York.
C'est plus compliqué que cela. L'IASB définit certes les normes comptables internationales, mais il est très influencé par l'Europe dans la mesure où l'Union européenne a été la première à demander que ces normes s'imposent.
La problématique actuelle est la suivante. L'autre série de normes mondialement reconnues, ce sont les normes américaines. Pendant plusieurs années, on a cherché à rapprocher les deux types de normes pour qu'il n'y ait plus que des normes admises au niveau mondial. Or on constate aujourd'hui qu'il s'agit plutôt d'un échec, car les Américains continuent de suivre leurs normes particulières, tout en étant membres de l'IASB et en y ayant une grande influence. Cela aboutit évidemment à des discussions assez âpres.
Au demeurant, c'est Michel Prada qui a été nommé président des trustees de la Fondation IFRS, dont fait partie l'IASB. On voit bien que l'influence européenne est assez forte par rapport au passé.
Toutefois, vous avez raison, dès lors que des normes internationales sont élaborées, elles s'appliquent forcément aux grands groupes, notamment aux grands groupes français, et peuvent donc avoir un impact très important sur l'image fidèle des comptes de ces entreprises.

Pour aller dans le même sens que M. le rapporteur, je vous demanderai s'il existe une vraie disparité en matière de fiscalité entre les très grandes entreprises et les PME ? En tant que praticien, quel est votre avis sur ce point ? Cette question revient régulièrement au cours des auditions. Y a-t-il une vraie différence entre une grande entreprise internationale et une PME régionale ? C'est la question que posait en réalité M. le rapporteur.

Il est facile de dire que votre mission ne consiste qu'à vérifier que l'entreprise a acquitté ses impôts. Je comprends bien que ce soit la loi. Mais, au regard de la fiscalité, avez-vous le sentiment qu'une entreprise régionale, une PME, a les mêmes chances d'évolution qu'un grand groupe ?
J'estime que tout le monde a la même chance. Certes, les armes dont disposent les entreprises ne sont pas forcément les mêmes, mais la taille de celles-ci diffère aussi.
Contrairement à un grand groupe international, un dirigeant d'une PME n'a évidemment pas les moyens de compter dans ses effectifs des fiscalistes. Il fera alors appel à un expert-comptable, lequel lui donnera a priori de bons conseils...
pour optimiser ce qui peut l'être dans le cadre de la loi. On ne peut pas dire que les uns soient plus avantagés que les autres, car les problématiques à traiter sont forcément différentes du fait de la taille de l'entreprise - elles sont moins complexes pour une PME - et du volume des transactions.

Je vous remercie, monsieur Nicolas, de votre exposé complet, qui, je l'espère, a éclairé les membres de notre commission.
Audition de Mm. Jean-Marc Tassetto directeur général de google france olivier esper directeur des relations institutionnelles de google france et marc mossé directeur des affaires publiques et juridiques de microsoft france
Audition de Mm. Jean-Marc Tassetto directeur général de google france olivier esper directeur des relations institutionnelles de google france et marc mossé directeur des affaires publiques et juridiques de microsoft france

Mes chers collègues, nous accueillons MM. Jean-Marc Tassetto et Olivier Esper, respectivement directeur général et directeur des relations institutionnelles de Google France, ainsi que M. Marc Mossé, directeur des affaires publiques et juridiques de Microsoft France.
Monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, je vous rappelle, que, conformément aux termes de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, votre audition doit se tenir sous serment et que tout faux témoignage est passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du code pénal.
En conséquence, je vais vous demander de prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
Levez la main droite et dites : « Je le jure ».
(MM. Jean-Marc Tassetto, Olivier Esper et Marc Mossé prêtent successivement serment.)
Je vous remercie.
Avant de répondre aux questions de M. le rapporteur Éric Bocquet, ainsi que des autres membres de la commission, je vous propose de commencer l'audition par un exposé liminaire. Mais je vois que vous avez d'ores et déjà affiché à l'écran une page de recherche...
Monsieur le rapporteur, nous avons voulu vous faire un petit clin d'oeil en affichant à l'écran une recherche web sur la commune de Marquillies.
Nous n'avons pas ouvert cette page web par hasard !

Nous allons apprendre des choses sur la commune de Marquillies, qui profite ainsi d'une publicité nationale !
Vous avez la parole, monsieur Tassetto.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs, nous vous remercions de nous avoir invités à participer à cette commission d'enquête. Nous allons ainsi pouvoir vous exposer plus clairement et précisément la situation de Google France, en particulier sa raison d'être par rapport à l'organisation globale de Google.
C'est la troisième fois, je dois le dire, que nous intervenons sur des sujets proches. Nous sommes évidemment bien conscients de la nécessité d'échanger le plus d'informations possible sur les enjeux liés aux impacts de la révolution digitale, qui présente la double particularité d'être extrêmement rapide et d'avoir de multiples impacts. Il s'agit donc d'une révolution structurante.
J'ai souhaité que Olivier Esper, directeur des relations institutionnelles de Google France, m'accompagne afin que nous puissions répondre aussi précisément que possible à vos questions ; nous le ferons dans la mesure de nos compétences et de nos responsabilités au sein de Google France.
Nous avons bien noté que le thème de votre commission d'enquête est la lutte contre l'évasion des capitaux et des actifs hors de France et ses incidences fiscales. Nous traiterons cette question sous l'angle d'une filiale d'un groupe international qui dirige des opérations en France, en évoquant nos enjeux de compétitivité, enjeux techniques, commerciaux et industriels.
Les conférences auxquelles j'ai participé montrent que le fonctionnement de Google est très bien connu des utilisateurs. Aussi ne prendrai-je que cinq minutes pour vous l'expliquer.
Nous sommes une toute jeune entreprise - la révolution digitale, c'est aussi la révolution de la vitesse ! - : créée, en 1998, en Californie, par deux étudiants de Stanford, elle est issue d'un brevet, qui est la propriété de l'université de Stanford. Elle a pour mission de proposer aux internautes via son moteur de recherche les résultats les plus pertinents et les plus précis possibles.
Cette entreprise californienne a pour vocation de construire des produits et des plateformes globales adressant des milliards d'internautes dans le monde et de chercher à élaborer un dispositif industriel le plus efficient possible.
Le moteur de recherche de Google a entraîné une révolution non seulement technologique - j'y reviendrai ultérieurement avec la requête concernant les chambres d'hôtes à Marquillies, dont les résultats sont affichés à l'écran -, mais également économique en ce que nous avons changé le modèle publicitaire.
Auparavant, lorsque vous étiez commerçant ou grand distributeur, vous deviez payer, a priori, une publicité à la radio ou dans la presse quotidienne régionale quel que soit l'impact de celle-ci. Le modèle publicitaire de Google est inverse : vous ne payez qu'au clic, c'est-à-dire uniquement lorsqu'un prospect est entré dans votre magasin. Imaginez la novation si le même commerçant ou le même distributeur ne payait ses spots radiophoniques ou ses affichages qu'à partir du moment où un client est entré dans son magasin !
Là est l'autre révolution du modèle Google - il y a chaque jour plusieurs dizaines de millions de requêtes en France et des milliards dans le monde -, que nous avons voulu illustrer en affichant cette page web, monsieur le rapporteur.
Nous avons fait ici une requête sur les chambres d'hôtes à Marquillies. Vous voyez s'afficher en haut de la page trois emplacements privilégiés, avec des liens en vert vers des sites web de personnes qui possèdent des chambres d'hôtes, telles que La petite Cense ou L'Hancarderie, avec des numéros de téléphone et, à droite de la page, vous pouvez voir onze emplacements de même nature.
Si l'on veut faire une comparaison avec un magasin physique, les trois emplacements sont les gondoles des allées centrales, - l'emplacement premium -, alors que l'on trouve à droite de la page les têtes de gondoles.
Nous vendons donc ce que nous appelons des liens sponsorisés : les annonceurs ont la possibilité de répondre via leur site web à la question : « Je cherche une chambre d'hôtes à Marquillies ».
Il s'agit d'une révolution considérable dans la mesure où, je le répète, le paiement se fait au clic, et non a priori. Le budget est donc totalement maîtrisé. Dès cet après-midi, vous pouvez créer une campagne pour un euro en vous inscrivant en ligne au moyen d'une carte bancaire, et ce sans condition de sortie. Si vous n'avez qu'un euro à investir, vous n'investissez que cette somme et, j'y insiste, vous pouvez sortir à tout moment.
Lorsque j'ai rejoint le groupe Google il y a un an et demi, après avoir travaillé dans de grands groupes industriels français, j'ai été surpris de constater que nous étions en grande partie en relation avec des PME, des artisans, des commerçants, qui découvrent là un modèle de coût publicitaire variable : je ne paie que lorsque je gagne. Ainsi, dans le cas qui nous occupe, si je sais que j'ai une réservation de chambre tous les cent clics et que ma marge est, par exemple, de vingt euros, je peux définir mon budget en conséquence.
C'est la seconde révolution du modèle Google.
Pour servir ce modèle global, qui offre des produits gratuits pour l'utilisateur, tels que les moteurs de recherche Gmail, Google Earth ou encore Google Maps, nous faisons financer ces produits par la publicité, selon le modèle que je viens de vous décrire.
J'en viens au schéma industriel de Google.
Les produits globaux sont conçus par des ingénieurs, essentiellement en Californie, et pensés pour l'ensemble des internautes. Le dispositif industriel a son centre de gravité à Dublin où travaillent un peu plus de 2 000 collaborateurs qui servent des annonceurs allant de la Russie à l'Afrique du Sud. J'insiste sur ce point, l'implantation industrielle à Dublin répond à des critères évidemment techniques, avec des plateformes que l'on cherche à rendre les plus efficientes possibles, mais elle s'explique aussi par l'attractivité du pays et la possibilité de servir à l'échelle les annonceurs. Ce sont de jeunes diplômés d'écoles de commerce ou d'universités - les meilleurs d'Europe - qui traitent en ligne les annonceurs.
Eu égard au fait que cette révolution est très technique et que nos produits sont assez compliqués, nous avons dans les principaux grands pays - une quarantaine pour Google - des équipes locales de support, dont j'assure la direction, en matière pédagogique, didactique et de marketing. Vous avez pu voir à la télévision, par exemple, la publicité pour notre produit Chrome.
Ces équipes locales, qui traitent, en France, environ 500 groupes, sont organisées en neuf secteurs industriels. Elles sont chargées d'« évangéliser » et d'accompagner les grands groupes industriels de l'automobile, de la finance, des télécoms, de la grande distribution, de la grande consommation.
Je souhaitais en quelques minutes vous décrire ce schéma industriel, qui comporte évidemment un volet fiscal. Toutefois, notre implantation en Irlande, à Dublin, n'est qu'un des éléments du choix du dispositif industriel de Google.
L'organisation que vient de décrire Jean-MarcTassetto répond à un enjeu de concurrence très fort sur Internet et de compétitivité entre les différents pays. Sur Internet, on a coutume de dire que la concurrence est à un clic, puisqu'il suffit d'un clic pour changer de site. C'est un environnement très ouvert, où Facebook, Microsoft, Amazon et Apple sont autant de concurrents potentiels de Google dans ses différentes activités. Google se doit donc d'être vigilant dans tous les domaines, y compris le domaine fiscal.
Sur ce plan, Google respecte naturellement les règles françaises et européennes, mais veille tout aussi naturellement à être compétitif, afin de dégager les mêmes ressources d'investissement dans la recherche et le développement, la R&D, dans l'innovation, pour proposer de nouveaux produits et de nouvelles applications au fil du temps.
Le groupe consacre une part importante de ses ressources à la R&D, avec 5,1 milliards de dollars en 2011 sur le plan mondial. Or une part significative de cet investissement est réalisée en France, en particulier depuis deux ans.
Un centre de recherche et développement regroupant des ingénieurs a été créé à Paris, ainsi qu'un institut culturel à vocation mondiale : une équipe d'ingénieurs travaille sur des projets culturels, visant, grâce aux technologies du numérique et de l'internet, à promouvoir et valoriser le patrimoine culturel français, européen et mondial. L'une des réalisations est, par exemple, le Art Project, qui permet aux internautes de visiter à distance les musées les plus prestigieux du monde, dont, pour la France, le château de Versailles, le musée d'Orsay, le musée du quai Branly, le château de Fontainebleau et le château de Chantilly.
Dans le domaine de la recherche universitaire, Google procède également à des investissements importants. En 2011, un partenariat a été noué avec cinq laboratoires du CNRS à travers la France, pour travailler sur l'optimisation mathématique. Nous oeuvrons également dans des domaines non scientifiques : nous avons récemment mis en place avec HEC une chaire universitaire dédiée aux métiers de l'internet.
Enfin, le soutien aux start-up et aux entrepreneurs constitue notre troisième champ d'investissements. Google a contribué au lancement du premier accélérateur de start-up internet en France, situé à Paris, baptisé Le Camping : porté par l'association Silicon Sentier, c'est un programme de coaching permettant à des promotions d'entrepreneurs de l'internet de passer six mois à développer leurs projets.
Il est important de le souligner, ces investissements de Google interviennent à un moment-clé du développement du secteur internet français et de l'économie numérique nationale.
En 2011, le cabinet McKinsey a publié une étude relative à l'impact de l'internet sur l'économie française. Il apparaît qu'Internet représentait, en 2009, 3,2 % du PIB et que, sur les quinze dernières années, ce secteur avait créé 700 000 emplois nets. Surtout, on souligne dans cette étude que la France était à un tournant dans ce domaine, dans la mesure où internet devrait représenter, d'ici à 2015, 5,5 % du PIB et avoir créé 450 000 emplois supplémentaires nets.
Au total, bien que l'entreprise Google ne soit pas née en France, ce que nous ne pouvons que regretter, elle contribue significativement à l'essor d'un écosystème numérique français, créateur de valeur nette pour l'ensemble de l'économie, en termes de croissance et d'emploi.
Dans d'autres pays, l'apport de l'internet à l'économie est plus important. Au Royaume-Uni, par exemple, il compte pour 7 % du PIB, contre 3,2 % pour la France. Cela témoigne des perspectives offertes en la matière en termes de croissance et d'emploi et plaide en faveur d'une politique du numérique volontariste.
De ce point de vue, l'ouverture et la transversalité des travaux de votre commission sont très importantes. À cette occasion, vous le voyez, nous avons souhaité mettre l'accent sur l'impact d'internet sur l'économie française, et partager ainsi avec vous notre conviction, comme nous l'avions fait lorsqu'il avait été question, à la fin de 2010, d'instaurer une taxe sur la publicité sur Internet.
Selon nous, il serait injustifié et néfaste de singulariser le secteur internet. Néfaste, parce que cela risquerait d'impacter la compétitivité et l'attractivité de la France pour les entrepreneurs et les investissements d'entreprises telles que Google. Injustifié, parce que les questions de fiscalité ne sont certainement pas propres au secteur de l'internet.
Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, messieurs les sénateurs, je vous remercie de me permettre de m'exprimer aujourd'hui, espérant vous apporter les éclairages que vous souhaitez. Je serai ensuite à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions posées, dans la mesure de mes compétences.
Vous constaterez rapidement un certain nombre de similitudes entre mes propos et ceux des représentants de Google.
Je souhaite simplement rappeler que Microsoft est en France depuis bientôt trente ans, puisque c'est en 1983 que Microsoft France a été créée.
Au niveau mondial, depuis 1975.
Depuis cette époque, nous nous sommes engagés à travailler au renforcement de l'industrie logicielle française et à son écosystème, notre premier métier étant l'édition de logiciels, qu'il s'agisse non seulement de logiciels grand public ou destinés aux professionnels, de jeux vidéo, autrement dit de logiciels de loisirs, mais aussi d'activités internet, lesquelles s'appuient sur des algorithmes relevant également, à certains égards, du logiciel.
Notre présence en France traduit un ancrage pour une démarche partenariale de long terme. J'insiste sur cette dimension, qui explique l'organisation juridique et fiscale à travers laquelle nous sommes présents dans ce pays.
Permettez-moi de vous livrer quelques chiffres assez éclairants. Microsoft en France, aujourd'hui, c'est à peu près 1 700 collaborateurs, employés par Microsoft France, l'entité agissant en tant qu'agent commissionné présent sur le territoire, par Microsoft France R&D, créé en 2009, par Musiwave, PME française acquise et intégrée dans le groupe Microsoft, et par le siège international de Microsoft, qui exerce une fonction de support, l'ensemble étant situé à Issy-les-Moulineaux.
Microsoft fonctionne dans le cadre d'un écosystème, facteur très important dans le domaine du numérique. À cet égard, une des études régulièrement produites par le cabinet indépendant IDC montre que l'écosystème Microsoft suscite environ 75 000 emplois indirects. Il s'agit non seulement d'intégrateurs, de sociétés de service, de revendeurs, mais également d'éditeurs de logiciels, qui développent des solutions à partir de nos plateformes technologiques. Cet élément tout à fait important représente à peu près 11 500 partenaires.
Autre aspect essentiel, nous avons mis en place, en 2005, il y a donc bien longtemps, un mécanisme d'aide et de soutien aux start-up, qui se nomme BizSpark, l'« étincelle du business ». Il a permis d'aider 1 090 start-up, de la TPE à la PME de 200 à 250 salariés, lesquelles ont créé peu ou prou 7 000 emplois indirects.
Permettez-moi d'en citer quelques-unes. Criteo fait partie des grandes start-up, leader mondial en méthodologie de la publicité sur Internet ; Kobojo, fondée en 2008, est leader européen du jeu social en ligne ; Commerce Guys est spécialiste du e-commerce en open source, sa solution étant utilisée par plus de 10 000 sites dans le monde ; xBrainSoft est créateur de l'application « Angie », développée au sein d'Euratech, avec des partenaires historiques de Microsoft.
On pourrait multiplier de tels exemples pris dans les 1 090 start-up, qui révèlent un élément tout à fait essentiel, à savoir la force de l'écosystème français du numérique. Tout l'enjeu sur lequel nous sommes engagés, c'est de faire en sorte qu'il puisse se développer, et ce de façon durable.
J'ai cité Kobojo. Avant même de figurer dans le programme BizSpark, cette start up figurait au sein d'un autre programme, Imagine Cup, compétition mondiale des écoles développant des solutions susceptibles de résoudre des problèmes de société. Cette année, le projet CapStreet, porté par cinq écoles de la région toulousaine, développe un logiciel destiné aux personnes handicapées. Celles-ci pourront désormais définir les parcours en ville les mieux adaptés à leur handicap, visiter des sites, certains musées, avec les meilleures possibilités d'accessibilité.
Depuis sa création en 2003, Imagine Cup a accueilli plus de 100 000 étudiants. Avec 23 médailles, dont 9 d'or, les écoles françaises sont celles qui se sont les plus distinguées, devant leurs homologues chinoises. On pense souvent que c'est ailleurs que se passe le développement logiciel. Non ! Ce sont de jeunes Français qui gagnent à chaque fois. Or Kobojo est né d'Imagine Cup.
Le partenariat que nous avons créé en 2005 avec l'INRIA, que vous connaissez bien, puisque c'est un établissement public de recherche fondamentale, constitue un autre exemple de notre activité en la matière. Ce partenariat, dont les équipes sont implantées sur le plateau de Saclay, est dédié à quatre enjeux de l'industrie numérique et aux progrès scientifiques : sécurité et fiabilité des logiciels, intelligence artificielle, visualisation des données et traitement d'images et de vidéo, ainsi que le fameux cloud computing, l'informatique en nuage.
Ce laboratoire de recherche fondamentale comporte cinquante chercheurs. Aujourd'hui, c'est l'un des laboratoires les plus réputés dans le monde sur ces sujets. Ses chercheurs publient dans toutes les grandes revues et sont présents dans tous les grands colloques.
Je précise également - nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler - que les résultats des travaux de recherche sont, dans le cadre de ce partenariat, sous licence ouverte. Autrement dit, tous les résultats issus de ces travaux sont sous une licence CeCILL-B, conçue par trois établissements publics français, le CNRS, l'INRIA et le CEA. Par conséquent, si des résultats peuvent être exploités, un tel dispositif peut notamment permettre à l'INRIA de créer une start up.
Les résultats ne sont donc en aucune façon la propriété exclusive de Microsoft. Ainsi, via ce laboratoire, des actifs pourront demeurer en France et bénéficieront peut-être de certains développements. En 2009, nous avons renouvelé ce partenariat pour quatre ans. Pour dire les choses très simplement, depuis la création du laboratoire commun, nous versons 1,25 million d'euros par an.
J'achèverai ce premier tour d'horizon de notre organisation en évoquant Musiwave, PME française de 170 personnes acquise par Microsoft et travaillant dans la mobilité technologique. Avant cette acquisition, elle bénéficiait du crédit d'impôt recherche, ce qui nous a incités à la conserver en France et à continuer de la développer.
Cela étant, je dois dire que, depuis son intégration, nous n'avons pas présenté de nouveau dossier de CIR. Pourtant, cet élément déterminant dans la création et le développement de l'entreprise avait, à l'époque, attiré notre attention. Depuis lors, nous avons concentré notre effort sur la réussite de l'intégration, en continuant à recruter des ingénieurs de très haut niveau. Cette structure localisée en France développe pour le monde entier, au sein de Microsoft Corporation, des pans importants de notre plateforme de divertissement.
Je me permets d'indiquer que, s'agissant de recherche fondamentale, les travaux du laboratoire commun avec l'INRIA sont eux aussi éligibles au CIR, conformément aux dispositions de l'article 49 septies F de l'annexe 3 du code général des impôts. Comme je vous l'ai dit, nous abondons ce laboratoire commun depuis 2005. A ce jour, nous n'avons pourtant présenté qu'un seul dossier au titre du CIR, en 2011, pour un montant qui pourrait, si le dossier était avalisé, représenter 540 000 euros. Cette somme doit être rapportée à celle de 1,25 million d'euros par an que nous versons via Microsoft France R&D.
Je le répète, ce ne sont pas des raisons fiscales ou d'optimisation indue qui ont dicté cette demande. Il s'agit simplement des résultats scientifiques d'un comité scientifique. Dans ce laboratoire commun travaillent en effet des chercheurs de l'INRIA, de Microsoft Research Cambridge et de Microsoft France R&D.
Ces quelques exemples me permettent d'ailleurs d'affirmer que le crédit d'impôt recherche est un véritable outil d'attractivité pour la France, à condition qu'il soit utilisé à bon escient et pour des réalisations véritables.
Notre organisation juridique et fiscale tient bien évidemment compte d'une telle réalité. La société Microsoft France, pour sa partie consacrée à la promotion des ventes, est devenue une SAS en 1983. Elle est l'agent commercial commissionné en France de Microsoft Ireland Operations Limited, MIOL, acteur de centralisation des opérations, implanté en Irlande. Nous réalisons des actions de promotion des ventes, des opérations d'information sur les nouveaux produits, des offres auprès des grossistes et des partenaires ou encore des activités de consulting de SSII ou de maintenance.
MIOL centralise pour toute l'Europe les activités de production. Cette structure est également copropriétaire des droits de propriété intellectuelle sur le développement des logiciels. Pour le dire autrement, du point de vue du cadre juridique et fiscal, c'est MIOL qui prend les risques afférents au marché et ceux qui sont liés au développement. Sur ce point, permettez-moi de donner deux exemples. L'un d'eux fera sans doute discussion par la suite.
Le premier est celui de la console de jeux Xbox. En 2001, Microsoft Corporation prend la décision stratégique d'entrer sur ce segment de marché, occupé par Sony et Nintendo, estimant que la console de jeux pourrait tenir lieu, demain, dans chaque salon, de véritable ordinateur domestique.
Ainsi, pendant des années, Microsoft a développé sur ce terrain, à perte, puisqu'il s'agissait d'une activité non profitable. Pour autant, Microsoft France, agent commissionné ne supportant aucun risque de marché - ce sont en effet Microsoft Corporation et MIOL qui assument un tel risque -, paye, au titre de la commission, des impôts sur une activité déficitaire.
Le second exemple est celui de nos activités en ligne. Tout à l'heure, Jean-Marc Tassetto nous citait gentiment parmi les moteurs de recherche. Je dois lui avouer, je ne sais pas si cela lui fera plaisir, que nous n'avons dans ce secteur qu'entre 2 % et 3 % de parts de marché. Nous sommes bien petits à côté de l'acteur dominant ! Il est de notoriété publique que cette activité est déficitaire au niveau mondial. Elle nous permet cependant, du fait de notre statut d'agent commissionné, de payer des impôts en France. Le fait que Microsoft France ne prenne pas de risque nous permet finalement d'assurer un minimum de rentrées fiscales.
Pour parler tout à fait librement, je confirme que nous avons fait l'objet, depuis 1996, de contrôles fiscaux par l'administration française. Alors que toutes les administrations fiscales des différents pays européens ont validé le prix de transfert que nous avons mis en place, la mission française continue. Toutefois, la cour administrative d'appel de Versailles a validé, le 16 février dernier, notre méthode de calcul.
Cela étant, nous menons un dialogue ouvert avec l'administration fiscale française sur ce terrain-là, au point que celui-ci n'ignore plus rien de notre organisation, un peu comme Héloïse et Claire, les héroïnes de Jean-Jacques Rousseau, dont les coeurs étaient transparents l'une à l'autre ! Il n'y a plus de secret ni pour eux ni pour nous et nous entretenons un dialogue fondé sur une réalité de marché organisé, qui reflète l'importance que nous accordons à l'écosystème français, dans un cadre juridique et fiscal correspondant à l'organisation de l'entreprise en France, en Europe et dans le monde.

Monsieur Mossé, je commencerai par votre propos de conclusion.
Je crois savoir que votre entreprise a récemment gagné un procès qui l'opposait à l'administration fiscale française. Pouvez-vous nous indiquer de quel litige il s'agissait exactement ?
Il s'agissait tout simplement de la méthode de calcul du prix de transfert. La cour administrative d'appel, confirmant le tribunal administratif de Paris, a estimé que notre méthode de calcul était la bonne.

Sur un plan plus général, pourriez-vous présenter votre implantation à l'échelle internationale, selon les pays et territoires, les activités que vous y menez, le nombre de salariés que vous employez, votre chiffre d'affaires, en bref dresser une sorte d'état des lieux de chacun de vos deux groupes ?
Le chiffre d'affaires global de Google atteint un peu moins de 40 milliards de dollars. Nous employons 33 000 collaborateurs, dont une très forte proportion d'ingénieurs installés en Californie.
En Europe, nous possédons quelques centres de recherche et développement. Nous avons une grosse implantation à Zurich, avec à peu près 1 000 ingénieurs, et quelques implantations significatives, notamment à Londres, et Paris, qui devient, comme M. Esper l'a souligné, un centre de recherche et développement. Cela nous permet d'y fixer des ingénieurs français, puisqu'il y a chez Google une brillante filière d'ingénieurs français, une véritable « french connection » en la matière. Nous attirons également à Paris des ingénieurs étrangers qui travaillent sur des sujets globaux : l'Android operating system, Chrome, la plateforme YouTube, l'amélioration de la visualisation des données, autant de sujets réclamant des compétences mathématiques de très haut niveau.
Par exception, Google a des équipes support dans certains pays, notamment d'Europe de l'Ouest et d'Europe continentale jusqu'à la Russie. Ce n'est pas le modèle dominant, puisqu'il y a moins de pays avec des équipes support que de pays travaillant globalement avec Google.
En France, au sein de Google France SARL, qui agit en support de l'activité commerciale de Google Ireland, nous avons un peu plus de 150 collaborateurs. Par ailleurs, Paris accueille un peu plus de 400 collaborateurs Google, dont une partie est liée à l'institut culturel, qui devient d'ailleurs un institut mondial, nos ingénieurs venant d'achever notamment la digitalisation des archives de Nelson Mandela. Nous travaillons donc sur de grands projets mondiaux. Paris est le seul endroit au monde où Google a un institut culturel, ce qui est une chance.
A Paris, nous intervenons en support de 500 groupes industriels environ, sachant que Dublin traite pour la France à peu près 60 000 annonceurs, des plus importants, à savoir les grands groupes industriels que j'ai cités tout à l'heure, au plus petit blogueur, qui achète pour quelques euros de la visibilité sur Internet.
Le modèle est donc à Dublin. Il s'agit d'une implantation d'un peu plus de 2 000 collaborateurs de toutes nationalités. Je vous invite d'ailleurs, monsieur le président, monsieur le rapporteur, à venir visiter, comme l'ont fait certains de vos collègues sénateurs, notre plateforme sur place. Dans un souci d'information sur notre schéma industriel et de transparence, vous êtes évidemment les bienvenus.
En 2004, Google France SARL et Google Ireland ont signé un accord nous attribuant les activités de support, de marketing, de pédagogie, d'« évangélisation » du marché français.

Pourquoi ce choix de l'Irlande pour l'implantation du siège ? Quelles en étaient les motivations initiales ?
Les choix d'implantation des plateformes relèvent souvent, comme vous le savez, de critères multiples : un gouvernement stable - ce point n'est pas discriminant pour ce qui concerne l'Irlande - un environnement, notamment économique, et un écosystème importants. La présence de Microsoft et de grands groupes bancaires, pharmaceutiques et de télécoms dans l'écosystème irlandais a contribué à donner un caractère rassurant à l'implantation d'une plateforme technique/technologique. N'oublions pas non plus la capacité du lieu à attirer 2 000 collaborateurs, âgés, en moyenne, de 28 à 30 ans, et donc en situation le plus souvent de fonder une famille.
Nos collaborateurs viennent de tous les pays, de la Russie à l'Afrique du Sud. Quand vous êtes sur des plateaux qui traitent en ligne les annonceurs, vous avez devant vous - c'est spectaculaire -, comme une tour de Babel couronnée de drapeaux, français, polonais, portugais, irlandais, roumain ou sud-africain. Les Français ne représentent donc qu'une partie de ces 2 000 collaborateurs.
Le choix de l'Irlande répond bien évidemment aussi à une préoccupation fiscale, liée en particulier à l'impôt sur les sociétés, puisque c'est l'activité d'entreprise à entreprise qui domine dans notre cas. Nous n'étions donc pas, jusqu'à présent, concernés par les sujets de TVA. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris peut-être un peu trop de temps pour décrire notre schéma industriel.
Je le répète, l'implantation de Google à Dublin correspond à des critères multichoix, dont la fiscalité fait partie.
Au niveau mondial, Microsoft réalise un chiffre d'affaires de 60 milliards de dollars et emploie plus de 90 000 salariés, parmi lesquels, il n'est pas indifférent de le rappeler, 36 000 développeurs. Notre modèle industriel se fonde en effet sur l'innovation, la recherche et le développement : 15 % du chiffre d'affaires mondial est consacré à la R&D. Voilà trois ans, en termes de dépenses en ce domaine, je crois me rappeler que notre groupe était classé, tous secteurs confondus, au premier rang.
J'ai évoqué rapidement, dans mon intervention liminaire, notre organisation par région, construite autour de trois pôles de centralisation pour la production et la contractualisation : Singapour pour l'Asie-Pacifique, les États-Unis pour l'ensemble du continent américain, MIOL pour la zone EMEA, regroupant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique.
A cet égard, Microsoft France ainsi que les autres filiales de la zone EMEA sont des agents commissionnés de MIOL, appliquant des mécanismes similaires validés partout.
C'est donc avec MIOL que nos clients français, au nombre de 29 713 en 2009, contractent, Microsoft France n'ayant qu'une activité de promotion, de présentation des offres, de maintenance, de support technique, conformément à ce qui a été défini dans le cadre de notre relation avec MIOL.
Pour les activités de R&D, je le répète, il a été créé une structure ad hoc, Microsoft France R&D, pour permettre de développer les investissements évoqués.

Messieurs Tassetto et Esper, la presse s'est fait récemment l'écho de l'existence d'une entité de Google aux Bermudes. Confirmez-vous cette information ? Si oui, quelle est son activité et qu'est-ce qui a motivé une telle implantation ?
Il nous est difficile de confirmer ou d'infirmer cette information. Dans le cadre de l'organisation décrite par Jean-Marc Tassetto, Google France est en contact soit avec Google Irlande, soit avec la maison mère, située en Californie, dans la Silicon Valley, pour tout ce qui est conception et développement de nouveaux produits.

J'évoquerai maintenant la fiscalité du commerce électronique, sujet qui est revenu souvent devant la commission du fait des incidences de cette évolution nouvelle des échanges commerciaux.
Quelle analyse faites-vous du processus de réforme de la TVA et de l'imposition des bénéfices au niveau européen et international ? Quelles incidences concrètes anticipez-vous pour votre secteur d'activité et vos entreprises respectives ?
Je répondrai en dernier, en proportionnant mon temps de parole aux 2 % de Microsoft !
Nous restons vigilants : Microsoft n'a peut-être aujourd'hui que 2 % des parts de marché, mais les choses vont tellement vite.
Même si la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a publié des chiffres récents montrant une progression de plus de 27 % du e-commerce, ce secteur ne représente encore que 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, à comparer aux 100 milliards d'euros constatés en Allemagne et au Royaume-Uni.
L'un des enjeux auxquels nos équipes support ont à faire face est de permettre, dans le cadre de cet écosystème, aux e-marchands « purs » de se développer encore plus rapidement. Je pense à Spartoo, qui a créé une soixantaine d'emplois à Grenoble, à Sarenza, propriétaire d'une plateforme logistique à Beauvais.
La France doit rattraper son retard par rapport aux pays du nord de l'Europe, lesquels nous montrent en quelque sorte la voie à suivre dans le domaine de l'économie digitale et du e-commerce. Considérons l'avenir de manière positive : il y a tout un tas de bonnes nouvelles à attendre en la matière, s'agissant notamment de l'impact économique en termes de TVA collectée, d'autant que 450 000 emplois nets sont encore à créer.
Je ferai une incidente sur les emplois considérés. Il s'agit de postes non pas seulement d'ingénieurs ou de techniciens de haut niveau, mais également de manutentionnaires chargés, au sein des plateformes logistiques, d'empaqueter les produits à livrer.
Il convient de mettre en place un cadre fiscal et juridique propre à libérer toutes ces énergies, au service de la croissance.
J'irai un peu plus loin sur le e-commerce pour évoquer une dimension à ne pas négliger, essentielle pour le développement, en France, de l'économie numérique et de l'économie tout court. Je veux parler du cloud computing, l'informatique en nuage.
Voilà une opportunité pour nombre d'entreprises, quelles qu'elles soient. Les entreprises du numérique pourront ainsi accroître leur puissance de calcul et se développer ; celles qui n'appartiennent pas du tout à ce secteur auront la possibilité d'accéder aux marchés, y compris à l'international, et ce à des coûts bien moins élevés : elles n'auront plus à investir dans des équipements propres puisqu'elles pourront utiliser les serveurs et infrastructures d'un certain nombre de prestataires extérieurs.
Ce modèle représente un accélérateur de croissance et de création d'emplois. Il s'agit d'un élément essentiel, qu'il ne faut surtout pas pénaliser dans le cadre d'une réflexion globale sur la fiscalité du numérique. Il convient de prendre en compte toutes les dimensions et de ne pas nous limiter au e-commerce, partie certes importante. Au-delà, émergent toute une série de nouvelles possibilités de création de plateformes technologiques, à partir desquelles on peut soit développer des start-up, à l'instar du programme BizSpark créé en 2005, soit permettre à des PME françaises, en général sous-équipées en matière d'accès au net, de favoriser leur développement sur le marché international.
Cela fait un moment qu'un certain nombre de parlementaires s'interrogent, légitimement d'ailleurs. En la matière, la réponse revient au Parlement et au Gouvernement. Si une harmonisation fiscale européenne est nécessaire, elle se fera, et nous n'aurons évidemment aucune difficulté à entrer dans ce nouveau cadre.
Encore une fois, j'y insiste, Microsoft a pour l'essentiel une activité de production via l'édition de logiciels, sur laquelle nous payons des impôts même si nous enregistrons un déficit global.

A ce propos, dans les différents pays où vous êtes implantés, l'évolution de la fiscalité pourrait se traduire par un alourdissement de la charge fiscale. Le cas de l'Irlande, qui connaît une situation économique très difficile, est parfois évoqué. Nous avons déjà une idée de ce qu'il va se passer. Une telle évolution serait-elle de nature à entraîner une réorganisation territoriale complète au sein de vos deux groupes ?
Dans la mesure où nos choix sont dictés par une recherche permanente de compétitivité et où la révolution digitale se fait à un rythme extrêmement rapide, il est évidemment de la responsabilité de Google Inc. de s'adapter et de saisir, en cas de changement des dispositifs, les opportunités industrielles, techniques, commerciales et fiscales.
Je rejoins ce que vous avez vous-même souligné, monsieur le rapporteur, le coeur du sujet porte sur l'harmonisation fiscale européenne. A l'inverse, localement, que la compétitivité de la France ne soit pas dégradée à l'aune de ces enjeux d'implantation est pour nous extrêmement important.
Nous aurions pu rêver de voir notre plateforme accueillant 2 000 collaborateurs installée en France plutôt qu'à Dublin. Parmi les critères que j'ai cités, un certain nombre correspondait parfaitement à l'écosystème français, mais malheureusement pas le critère fiscal.

Quel montant le crédit d'impôt recherche a-t-il représenté pour vos deux groupes ?
Aujourd'hui, zéro ! La première demande a été formulée pour l'année 2011 par Microsoft France R&D pour ce qui concerne les travaux de recherche fondamentale effectués au sein du laboratoire commun. Jusqu'à présent, aucun versement n'a été effectué. Le dossier est en cours.
Je rebondirai sur ce que vient de dire M. Tassetto, car le crédit d'impôt recherche est tout à fait essentiel. Je citerai de nouveau Musiwave et tous les investissements que nous attirons chaque année sur le laboratoire commun de Microsoft Corporation. Le crédit d'impôt recherche a véritablement joué un rôle : mécanisme ancien, remontant à 1983, il a connu des évolutions et, à l'évidence, doit être utilisé à bon escient et ne pas servir à de l'optimisation indue.
Bien utilisé, le crédit d'impôt recherche est un facteur important, permettant à la fois à des PME, à l'instar de Musiwave, de se créer et de se développer, et à des investisseurs internationaux ou de grands groupes d'avoir un regard différent sur le territoire français.
Sans dévoiler aucun secret particulier, je précise que, avant de décider d'investir dans un pays, on établit une check-list de tous les éléments à vérifier : la fiscalité, la qualité des services publics, celle de l'enseignement, le niveau d'employabilité des personnes sur le territoire. Le crédit d'impôt recherche est clairement un élément qui compte pour favoriser un certain nombre d'investissements.
Nous avons un message commun à faire passer en cet instant : la France est sans doute une terre du numérique, plus encore que ce que l'on imagine ; elle doit juste ne pas rater les rendez-vous qui l'attendent. La France a une vraie école mathématique et d'ingénierie, elle dispose d'une grande créativité.
Dans les outils logiciels, les algorithmes, qu'ils s'appliquent aux moteurs de recherche, aux jeux vidéo, aux systèmes d'exploitation, à la mobilité, on trouve à la fois de la science et de la créativité. Certains développeurs sont de véritables stars, au même titre que des joueurs de football. Il faut être capable de les faire naître. J'ai cité Imagine Cup, ce concours que nous avons monté en 2003, voilà maintenant presque dix ans.
Nous savons que la France est toujours en tête des différents classements publiés à cet égard. Ne ratons pas les nombreux rendez-vous à venir, ne sombrons évidemment pas dans des logiques d'optimisation fiscale, n'oublions pas non plus le développement d'outils incitatifs, à condition, je le répète, qu'ils ne servent pas à de l'optimisation indue.

L'université de Valenciennes est très en pointe sur tout ce qui a trait au numérique, avec un pôle très actif et extrêmement productif : voilà un bel exemple à suivre !
Nous partageons totalement cette conviction et cet enthousiasme.
En ce qui concerne le plan d'investissement de Google France autour du centre de R&D, nous n'avons pas fait appel au crédit d'impôt recherche.

Je reviens aux petits litiges qui peuvent subvenir avec l'administration fiscale concernant les prix de transfert. J'ai bien compris que Microsoft avait un point de désaccord sur ce point. Qu'en est-il de Google ? Avez-vous eu des problèmes du même genre ?
Nous avons un dialogue avec l'administration fiscale. Celle-ci a effectué un premier contrôle, dont les conclusions, connues en 2010, ont validé notre organisation. Un deuxième contrôle est en cours.
Pour Microsoft France, je précise juste, monsieur le rapporteur, que notre méthode de calcul a été validée par le juge administratif, après l'avoir été dans tous les autres pays européens. C'était le seul point qui faisait encore débat avec la France.

En tant que parlementaires, nous sommes attachés à défendre les intérêts de la France en général et le développement du numérique sur notre territoire en particulier. Il faut trouver toutes les bonnes pistes en la matière.
J'ai commencé ma carrière comme ingénieur informatique au sein du groupe Paribas et beaucoup travaillé sur le développement d'outils informatiques : à l'époque, nous avions d'excellents traitements de texte. Microsoft a pu s'imposer au niveau international avec des produits d'une qualité bien inférieure comparés aux nôtres. La norme américaine a pris le devant, pour des raisons tenant purement et simplement à des territoires de consommation, en méconnaissance du génie de nos propres ingénieurs.
Ce ne sont pas toujours les meilleurs qui gagnent. Désormais, nous voilà pris dans la « boucle » Microsoft.
Ma première remarque concerne Google. Vous estimez, monsieur Esper, que taxer la publicité serait une erreur. Pour votre part, monsieur Tassetto, vous nous présentez vos pages internet en parlant, pour ce qui est des publicités, de merchandising et de têtes de gondoles.
J'y vois très clair : Google est dans la situation d'un grand distributeur, qui installe dans son magasin de manière réfléchie différents produits et services en faisant payer les producteurs pour que les leurs apparaissent en tête de gondoles. Vous-mêmes nous avez parlé de chambres d'hôtes. De quoi s'agit-il, sinon d'abord et avant tout de présenter un produit, comme le fait une agence de voyages ?
Outre le fait que vous êtes diffuseurs de publicité, vous vous inscrivez véritablement dans un acte de distribution, avec une valeur ajoutée. Vous mettez en scène des produits que vous vendez, en les positionnant de telle ou telle façon pour un public extrêmement nombreux et de plus en plus utilisateur d'Internet. Par définition, vous êtes un acteur, non plus de la publicité, mais bien de la vente. A ce titre, vous devriez entrer dans le cadre des règles fiscales de droit commun, qui s'appliquent à n'importe quel magasin.
Je suis victime de ma tentative pédagogique ratée ! Notre statut juridique est très clair : nous sommes une plateforme.
Un distributeur dont l'activité consiste essentiellement en l'achat et la revente, achète un produit pour faire une marge sur sa revente. Ce n'est absolument pas notre cas. Ni sur la vente d'espadrilles, ni sur la vente de nuitées, ni sur la vente d'automobiles, nous ne prétendons à la moindre marge commerciale.
Nous créons, via un clic, une relation entre un industriel, qui peut être lui-même distributeur, et un internaute, qui a effectué une requête. À aucun moment nous ne nous percevons comme un distributeur.
Nous sommes davantage un support publicitaire, sur lequel les annonceurs choisissent de s'afficher. Sans revenir sur ce que Jean-Marc Tassetto a expliqué, ceux-ci paient, non pas pour s'afficher, mais lorsqu'un internaute arrive sur leur site.
Je précise que tous les sites qui apparaissent au milieu de notre page de résultats, eux, ne paient pas pour figurer à cet endroit. Leur indexation dépend de ce que l'on appelle un résultat de recherche naturelle, selon l'algorithme défini par notre moteur de recherche.

Je réaffirme ce que j'ai dit. La page de Google est un rayonnage : vous faites payer la présence sur ce rayonnage. C'est une forme de distribution comme une autre.
J'ai moi-même été utilisateur, à titre personnel, et acheteur des premières lignes de résultats sur mon propre nom. Auparavant, celui qui faisait une recherche sur mon nom tombait sur une attaque injurieuse dont j'avais fait l'objet par un site des Bahamas, contre lequel je ne pouvais rien faire.
Pour éviter que mon nom ne soit sali par ce site et me protéger, j'ai été contraint d'acheter vos premières lignes, ce qui est totalement paradoxal. Je continue d'ailleurs à payer. Se pose donc aussi un problème de moralité.
Les difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre d'Internet naissent du caractère transfrontalier des multiples outils à notre disposition, qui dépassent complètement parfois le cadre de la moralité. Il reste encore beaucoup de progrès à faire en la matière. Vous qui êtes un acteur dominant sur le marché, vous avez des clés extrêmement importantes à mettre en oeuvre.
Google propose des outils pour gérer ce genre de situations, notamment lorsque figurent dans la page de résultats des informations illégales.
Ainsi, la semaine dernière, dans le domaine de la protection du droit d'auteur, nous avons publiéle nombre de liens retirés quotidiennement et mensuellement à la demande des ayants droit,. Mais il convient de respecter le cadre juridique pour ne pas tomber dans un autre extrême.
Sur la fiscalité, notre message n'est pas de dire que notre activité doit échapper à toute fiscalité. Il est cependant à nos yeux risqué de créer une taxe spécifique propre à Internet, qui le singularise.

La taxe sur la publicité sur Internet existe-t-elle ailleurs en Europe ? D'autres parlements ont-ils eu cette bonne idée ?
A notre connaissance, l'instaurer en France serait une première européenne, et même mondiale.

A quand remontent les chiffres que vous avez cités tout à l'heure, sur le développement du e-commerce en France, en Allemagne et au Royaume-Uni ?

Faut-il considérer que la France est réellement en retard ou l'évolution dans notre pays correspond-elle à un plan stratégique de développement de votre part ? S'agit-il d'un phénomène général ?
De ce point de vue, il n'est pas étonnant que notre pays soit traversé par le 45e parallèle ! Avant le choc majeur de la crise, pour 2011, l'impact d'Internet sur le PIB représentait, en Espagne et en l'Italie, entre 2,2 % et 2,3 %, contre 3,5 % en France et déjà 5,5 % au Royaume-Uni. Le phénomène est donc beaucoup plus massif en Europe du Nord qu'en Europe du Sud.
Il existe une espèce de paradoxe français. Nos concitoyens sont extrêmement technophiles, très en avance en termes d'équipements à l'internet. Ce sont les entreprises et les corporations qui accusent un retard.
Parmi les 27 pays de l'OCDE, la France occupe la 21e place pour ce qui est de l'équipement des PME en site web. Or ne pas disposer d'un site aujourd'hui revient à faire du commerce sans boutique ni vitrine.
Une vision positive de cet écosystème permet de faire apparaître le formidable potentiel de croissance, en particulier dans nos PME et chez nos artisans et commerçants. Nous avons signé, il y a un mois, un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence et son dynamique président, Jacques Pfister, pour aider ces mêmes professionnels à venir en ligne. Sur le terrain, douze coachs ont fait du porte-à-porte, passant du temps avec eux pour leur expliquer tout l'intérêt de la démarche.
Dans un tel environnement, compte tenu de l'écosystème existant, il y a un très gros effort de pédagogie à faire, car l'enjeu est là : tirer parti de ce fort poumon de développement.

Monsieur Mossé, la France a du potentiel et fait preuve de créativité. Pourquoi cela ne se traduit-il pas en termes de chiffre d'affaires et d'efficacité commerciale, donc fiscale, pour l'aspect qui nous intéresse ?
Je tiens d'abord à dire, contrairement au sentiment qui se développe depuis quelque temps, que le numérique ne se limite pas, en France, au e-commerce. Notre industrie numérique et notre économie digitale ne se réduisent pas au développement de plateformes de vente.
Le e-commerce a un rôle très important, essentiel, à jouer. Mais, dès lors qu'il est question de filières industrielles d'excellence, n'oublions pas les acteurs au coeur du système, notamment les éditeurs de logiciels. Derrière tout ce que nous venons d'évoquer, on trouve de l'écriture de code et du développement industriel.
Nous sommes en présence de deux modèles économiques. Le modèle du e-commerce et du moteur de recherche est fondamentalement tourné vers la publicité. Celui de l'édition logicielle s'appuie sur la R&D, l'innovation, avec des risques de marché très importants : la France a des champions mondiaux dans cet univers, Dassault Systèmes et Cegid, entre autres.
Il ne faut surtout pas pénaliser le e-commerce français ; ce serait bien dommage. Pour autant, dans un tel écosystème, ne considérons pas que le développement du numérique ne repose que sur le e-commerce. Ne négligeons pas l'industrie logicielle. Je parlais tout à l'heure du parc Euratech situé à Lille. Nous avons également pu conclure des partenariats avec Lyon et Paris pour tirer des start-up vers le haut.
Il est tout à fait envisageable d'avoir en France le Microsoft, le Facebook, le Google, le Apple de demain, dès lors que l'on veut bien faire en sorte de s'intéresser à ces filières d'excellence et de les développer.
Quittons un instant, si je puis me permettre, le terrain de la fiscalité pour celui de la politique industrielle et du redressement productif, même si ces domaines ne sont qu'à moitié éloignés.
Il ne s'agit pas simplement d'imposer par le haut une vision mettant en avant telle ou telle filière. Il est essentiel de faire monter en puissance des projets depuis la base, depuis ces PME, ces start-up, y compris en développant un partenariat avec les collectivités locales et les grands groupes.
Je reprendrai l'exemple du programme BizSpark, que nous avons mis en place en 2005 : nous travaillons avec des incubateurs locaux, des collectivités, en nous appuyant éventuellement sur les mécanismes incitatifs comme le crédit d'impôt recherche, mais, je le répète, en évitant les utilisations déviantes qui ont pu être constatées. L'objectif est de valoriser les pépites par le biais de plateformes de développement, car, dans le monde du numérique, l'impulsion ne peut plus venir uniquement d'en haut.
J'insiste sur l'excellence française en ce domaine, que l'on nous envie. Ce n'est pas simplement une question de taille - Israël est un grand pays de l'édition numérique et logicielle - c'est la manière dont on se projette sur l'international qui est essentielle.
Dans le cadre de BizSpark, Microsoft aide des start-up à s'engager à l'étranger. Le marché français est trop étroit. L'heure est à la logique partenariale, dans laquelle nous nous inscrivons : les grands groupes, les PME, les collectivités locales, la puissance publique nationale sont ainsi en mesure de travailler ensemble pour développer un écosystème. C'est en ouvrant le marché que cela pourra fonctionner, pas en le fermant.

Monsieur Mossé, vous avez évoqué les utilisations déviantes du crédit d'impôt recherche. Quelles sont-elles ?
Celles que j'ai découvertes dans les rapports parlementaires !

Vous êtes bien informé !
Revenons, très concrètement, à la fiscalité. J'imagine qu'un achat de 10 euros effectué par le biais du e-commerce ou dans les circuits habituels n'est pas traité fiscalement de la même manière.
En termes de TVA, il n'y a pas de différence entre l'achat de publicité par un annonceur sur des pages de recherche de Google ou sur un autre support, dans la mesure où il s'agit d'une relation entre professionnels : c'est ce que l'on appelle du « B to B », du business to business. Google ne facture pas la TVA irlandaise à l'annonceur, lequel, dans le cadre de son autoliquidation de TVA, applique le taux français.

Nous avons bien compris que la fiscalité était un critère de compétitivité pour les entreprises. Qu'en est-il s'agissant des personnes physiques ? Compte tenu du bouillonnement actuel de la recherche, la fiscalité est-elle aussi une préoccupation dans l'optique du recrutement des chercheurs ?
Convaincre un ingénieur basé à Zurich de venir travailler à Paris est un vrai sujet et nécessite de présenter quelques calculs...
J'étais vendredi dernier à Sophia-Antipolis, à l'invitation de votre ancien collègue sénateur Pierre Laffitte. Un constat s'impose : le génie est là - les ingénieurs français conjuguent imagination foisonnante et richesse créative -, le capital-développement est là ; c'est le capital d'amorçage qui fait défaut. Si trouver 5 millions d'euros est facile, en trouver 50 000 est extrêmement compliqué.
Non, pas pour l'instant, mais ce qui vient d'être dit est exact. Il faut nous atteler à favoriser la capacité de développement. Les programmes que nous avons montés visent à permettre à un certain nombre de start-up d'entrer en relation avec des capitaux-risqueurs, qui sont, chacun le sait, moins nombreux en France. Il est d'ailleurs révélateur de parler de « capitaux-risqueurs » dans notre pays quand les mêmes personnes sont qualifiées de « capitalistes d'aventure » aux États-Unis !
Le faible nombre de capitaux-risqueurs est une vraie difficulté, sans doute pénalisante.
J'ajouterai un point essentiel, pour les start-up notamment. Allons au-delà de l'image du chercheur qui cherche.
Boris Vian disait cela très bien : « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche » !
La stabilité et la sécurité du cadre juridique et fiscal, la prévisibilité sont des éléments tout à fait essentiels pour toute start-up appelée à élaborer un business plan, se projeter, attirer des capitaux, organiser des tours de table. Subir un changement permanent de l'environnement légal et réglementaire est pénalisant : il faut l'avoir à l'esprit.

Quel est le taux effectif d'imposition de vos deux groupes en France et dans les pays étrangers ? Il a été question de l'Irlande, mais pas forcément des autres États. Avez-vous des éléments chiffrés précis à nous communiquer ?
Google France SARL a payé un peu moins de 30 millions d'euros de taxes et d'impôts en 2011, pour un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros. Le groupe Google Inc. est, lui, imposé au taux de 21 %.
Je vous communiquerai par écrit les chiffres exacts consolidés de toutes les taxes et impôts payés. Pour l'essentiel, ils sont supérieurs à ce nous venons d'entendre.
Pour ne parler que du l'IS, il s'est élevé à 21 678 455 euros pour 2001, contre 14 millions d'euros pour 2010. La masse salariale incluant la participation est de 141 millions d'euros.
Notre modèle de commissionnement, où la prise en charge du coût est couplée à un pourcentage des ventes réalisées par MIOL en France, atteint l'un des niveaux les plus élevés que nous connaissons.

Sur les 30 millions d'euros payés par Google en impôts et taxes, combien représente l'impôt sur les sociétés ?
La somme de 8 millions d'euros.

Vous payez beaucoup d'impôts pour un chiffre d'affaires de 68 millions d'euros !
Nous englobons toutes les taxes afférentes aux rémunérations et à la partie sociale. Le taux de 21 % auquel est assujetti Google Inc. est tiré des documents remis à la SEC.

La presse a évoqué les démarches entreprises par l'administration fiscale à l'encontre de Google et l'hypothèse d'un redressement fiscal de plusieurs dizaines de millions d'euros.
De façon générale, sur quelles bases juridiques ou factuelles une entreprise multinationale peut-elle contester l'existence en France d'un établissement stable et la réalisation d'un « cycle commercial complet » ?
Je dois avouer que cette question dépasse mes compétences dans le domaine de la fiscalité. Je peux en revanche vous confirmer qu'il n'y a pas eu de redressement fiscal pour Google en France.
Je l'ai dit, un contrôle est en cours.

Monsieur Tassetto, l'une de vos réflexions a plus particulièrement attiré mon attention. Selon vous, le problème serait de trouver non pas 5 millions d'euros, mais 50 000.
Que faudrait-il faire en France, sur le plan législatif, pour encourager les capitaux-risqueurs à venir en aide aux TPE ?
C'est mon expérience d'homme de terrain fréquentant les incubateurs, les start-up, les fonds d'investissement qui m'a amené à faire ce commentaire. Il convient en effet de prendre des dispositions pour encourager l'investissement, pour qu'il soit considéré comme une aventure positive, non comme un risque. Je n'irai pas plus loin, car le sujet dépasse mes compétences.
Nous avons eu la visite, il y a deux mois, du premier investisseur dans Google, celui qui a mis les 50 000 premiers dollars. A posteriori, nous aurions été plusieurs à vouloir le faire...Voilà le vrai sujet.
Dans le cadre des clubs technologiques auxquels nous participons, nous entendons toujours la même antienne : « Le capital-développement est là, on me propose maintenant des millions d'euros. Mais j'en avais besoin de beaucoup moins au tout début ! »
Sur la base du projet « État Lab », nous créons une compétition, à l'instar de ce que fait Microsoft, pour permettre à des développeurs de mettre à profit les données publiques à leur disposition pour, je l'espère, s'enrichir. C'est aussi le message que ces derniers nous envoient. Je suis désolé de ne pas pouvoir apporter de contribution plus importante.

Il me reste, messieurs, à vous remercier de votre contribution aux travaux de notre commission et de votre éclairage sur l'activité numérique et ses perspectives.