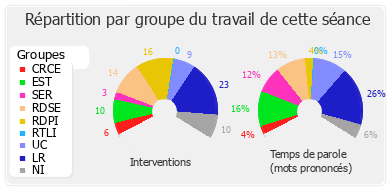Séance en hémicycle du 12 mai 2015 à 14h30
Sommaire
- Souhaits de bienvenue à deux nouveaux sénateurs
- Croissance activité et égalité des chances économiques (voir le dossier)
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'une proposition de loi organique
- Débat sur l'avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence (voir le dossier)
- Candidatures à des commissions
- Risques inhérents à l'exploitation de l'huître triploïde (voir le dossier)
- Nomination de membres de commissions
La séance
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

M. le président. Mes chers collègues, nous accueillons aujourd’hui dans l’hémicycle nos deux nouveaux collègues sénateurs de Polynésie française, Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey. Je leur souhaite, au nom du Sénat tout entier, la bienvenue, ainsi qu’un excellent mandat.
Applaudissements.

L’ordre du jour appelle les explications de vote et le vote par scrutin public sur le projet de loi, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale en application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (projet n° 300, texte de la commission n° 371, rapport n° 370, tomes I, II et III).
Avant de passer au vote, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits pour expliquer leur vote.
Je vous inviterai ensuite, mes chers collègues, à vous rendre en salle des conférences pour voter et suspendrai la séance pendant la durée du scrutin, prévue pour une demi-heure.
Je proclamerai enfin le résultat à l’issue du dépouillement, aux alentours de quinze heures quarante-cinq, puis je donnerai la parole au Gouvernement.

J’indique au Sénat que la conférence des présidents a fixé, à raison d’un orateur par groupe, à sept minutes le temps attribué à chaque groupe politique, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe disposant de trois minutes.
La parole est à M. Bruno Retailleau, pour le groupe UMP.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant tout, permettez-moi de remercier ceux qui, outre vous-même, bien sûr, monsieur le ministre, ont accompli, à l’occasion du débat en séance publique sur ce projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, un énorme travail : chacun en conviendra, rester 135 heures au banc de la commission, c’est tout de même très long !
(Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du RDSE, du groupe écologiste et du groupe socialiste .) Les méritent tout autant les trois corapporteurs, Catherine Deroche, Dominique Estrosi-Sassone et François Pillet.
Mêmes mouvements.

À cet égard, Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale, mérite tout particulièrement vos applaudissements, mes chers collègues. §
Pour donner une juste mesure de leur travail, rappelons que nos collègues députés avaient, eux, confié ce texte à neuf rapporteurs. Entre le Sénat et l’Assemblée nationale, le rapport est donc de 1 à 3 : voilà qui illustre la force de travail dont notre institution peut faire preuve !
Sourires.

Monsieur le ministre, non seulement votre projet de loi est copieux, mais il renferme des dispositions très diverses ; son caractère éclectique n’a échappé à personne.
Le texte sur lequel nous allons nous prononcer est donc le fruit d’un gros travail, mais aussi d’un beau travail, en ce sens qu’il est utile, pour les Français et pour la France.
Il y a quelques semaines, le Sénat a reçu un texte que l’Assemblée nationale avait affadi et qui, de surcroît, restait assez emblématique de la méthode habituellement suivie par le Gouvernement : celle des petits pas, des tout petits pas, pour ne pas dire des petits pas de côté, voire des petits pas en arrière.
Sourires sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Pour notre part, nous avons souhaité rendre du souffle à ce projet de loi, lui donner un élan réformateur, à l’heure où la France doit affronter une situation économique très difficile.
Nous avons tenu à agir de manière constructive, en écartant les postures politiciennes ou idéologiques, …
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

… en repoussant aussi la tentation de nous arrimer à un certain nombre de marqueurs.
Notre seule ligne, notre seul horizon, mes chers collègues, c’est l’intérêt supérieur du pays, c’est de réformer la France !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Pas plus que vous, cher collègue !
Nous avons suivi nos convictions, et personne ne peut nous reprocher d’y être fidèles.

De plus, nous avons systématiquement cherché les points d’équilibre. Nous avons voté les mesures dont nous avions dit que nous les approuvions et nous avons rejeté celles qui nous paraissaient contre-productives.
De ce point de vue, je songe à la réforme par ordonnance de l’inspection du travail – sans doute un gage donné aux « frondeurs…
Je pense également aux dispositions qui visaient à étendre les attributions de l’Autorité de la concurrence. Ainsi, cette instance était censée améliorer la répartition territoriale des professions réglementées. Qui, dans cet hémicycle, peut croire sérieusement qu’en remettant notre pouvoir à l’Autorité de la concurrence nous pourrions prévenir l’apparition de déserts juridiques, comme nous avons déjà des déserts médicaux ? Grâce à François Pillet, nous avons avancé sur ce sujet et nous avons atteint un point d’équilibre qui n’est pas réductible à un statu quo.
En limitant aux entreprises de plus de 250 salariés le transfert des dossiers aux tribunaux de commerce spécialisés, nous avons, je le crois, également atteint un juste équilibre.
Parallèlement, nous avons conforté tout ce qui allait dans le bon sens. Car, pourquoi ne pas l’admettre, le projet de loi tel qu’il nous a été transmis était porteur d’heureuses initiatives : je pense à la libéralisation du transport par autocar, au financement interentreprises ou encore à diverses mesures de simplification. L’idée d’attribuer à chaque entreprise une carte d’identité numérique valant devant toutes les administrations est positive.
Monsieur le ministre, dans certains cas, nos volontés se sont même rejointes, par exemple pour réduire la facture numérique.

Il est tout naturel que cet enjeu obsède le Sénat : nous ne connaissons que trop les difficultés auxquelles les carences des réseaux, notamment des réseaux de téléphonie mobile, exposent nos territoires.
De même, au sujet du suramortissement, nous avons voté l’amendement que vous avez déposé. Au reste, voilà quelques mois, nous avions nous-mêmes proposé, dans le cadre du projet de loi de finances, puis du projet de loi de finances rectificative, des mécanismes permettant de faciliter l’amortissement et, ainsi, l’investissement des entreprises. Car il n’y a pas de reprise durable sans investissement !
En règle générale, au-delà des dispositions que nous avons pu conforter, nous nous sommes efforcés de muscler ce texte pour en faire un accélérateur de croissance. Nous avons tâché d’apporter à l’économie française ce qui lui fait le plus cruellement défaut : de la souplesse et de la simplification.
La souplesse, nous l’avons accrue en adaptant les accords défensifs, qui permettent notamment de sortir des 35 heures, mais aussi en créant des accords offensifs. Nous nous sommes penchés sur les contrats de travail et, en particulier, nous avons institué les contrats de mission. En outre, nous avons plafonné les indemnités de licenciement.
Il est un chiffre, mes chers collègues, qui vous a peut-être échappé : savez-vous quel est, en France, le délai moyen avant que l’emploi s’adapte à l’activité réelle de l’économie ? Vingt-quatre trimestres, soit six années ! En Allemagne, il n’est que de cinq trimestres et, en Italie comme en Grande-Bretagne, de deux trimestres ! De tels chiffres montrent l’écart abyssal qui sépare, en la matière, notre pays de ses voisins.

Ils permettent aussi de prendre la mesure des réformes qu’il nous faut mener !
Avec M. le président de la commission spéciale et nos trois corapporteurs, nous avons en outre introduit dans le présent texte des mesures de simplification, s’agissant par exemple du compte pénibilité. Dans le même esprit, nous avons voté le doublement des seuils sociaux, les portant de dix à vingt et de cinquante à cent salariés. Car c’est cela qui, aujourd’hui, entrave les embauches dans nos PMI et nos ETI.

De même, nous avons souhaité modifier le dispositif de la loi Hamon, qui bloque actuellement la transmission d’entreprises dans notre pays.
Ainsi, nous nous sommes efforcés d’être constructifs. À mes yeux, le texte auquel nous avons abouti est véritablement réformateur.
Désormais, monsieur le ministre, vous êtes face à un choix, le choix entre l’audace et la prudence.
Si vous optez pour le chemin de l’audace, vous aurez à vos côtés des sénatrices et des sénateurs de bonne volonté, qui, en commission mixte paritaire, vous tendront la main pour que ces réformes aboutissent.
L’autre choix vous est beaucoup plus politicien. C’est un choix de calcul.

M. Bruno Retailleau. Il consiste tout simplement à ménager les « frondeurs », dans la perspective du congrès de Poitiers !
Vives protestations sur les travées du groupe socialiste. – Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

M. Bruno Retailleau. À cet égard, je ne formulerai qu’un seul conseil : quitte à recourir au « 49.3 », autant l’utiliser pour quelque chose !
Nouvelles protestations sur les travées du groupe socialiste.

Je conclurai en citant notre excellent collègue député Bruno Le Roux, qui a, comme moi, l’honneur de présider un groupe parlementaire fort d’un grand nombre d’élus. Il y a quelques jours, M. Le Roux a souligné, dans un tweet absolument génial, que le courage de réformer pouvait de révéler payant. Oui, cela a payé en Allemagne, avec Mme Merkel, et cela a payé en Grande-Bretagne, avec M. Cameron.

M. Bruno Retailleau. Monsieur le ministre, je vous en prie, ayez la hauteur de vue qu’exige aujourd’hui la transformation de l’économie française !
Bravo ! et vifs applaudissements sur les travées de l'UMP. – Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à mon tour, je tiens à ouvrir mon propos par des remerciements, destinés à toutes celles et tous ceux qui ont pris part à ces discussions, et en particulier au président et aux corapporteurs de la commission spéciale : au cours de ces longs débats, ils ont, sans relâche, défendu les positions de la commission spéciale et du Sénat.
La Haute Assemblée peut légitimement être fière du travail accompli…
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Au terme d’un débat nourri, c’est un texte sensiblement amélioré qui va être mis aux voix. Accessoirement – mais c’est, pour nous, un point essentiel –, un tel travail démontre la vigueur du bicamérisme et l’utilité du Sénat.
Monsieur le ministre, avant d’évoquer le contenu du présent texte, je tiens à dire quelques mots de sa forme.
Ce projet de loi, comme d’autres avant lui – je songe par exemple à la loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, la loi ALUR –, est à l’évidence beaucoup trop long. Il s’est, de ce fait, éloigné de ses objectifs initiaux, étant donné que ses principales mesures ont été diluées parmi des dizaines d’articles supplémentaires.
Cette réforme regroupait trop de thématiques différentes. Avec des textes plus courts, la loi gagnerait en efficacité et en lisibilité.

J’ajoute qu’en procédant ainsi on faciliterait les navettes entre les deux chambres. Nous avons, en l’occurrence, un bel exemple de l’enrichissement mutuel des débats qu’assure le dialogue entre les deux assemblées.
Aussi, j’ai peine à comprendre pourquoi le Président de la République, François Hollande, a critiqué, le 19 avril dernier, « la lenteur des débats parlementaires ». Personne n’a jamais pu prouver que la précipitation était l’alliée du législateur. En l’espèce, pour des mesures qui vont toucher la vie quotidienne de nos concitoyens et transformer les conditions d’exercice de nombreuses professions, un total de cinq mois de débats ne me semble pas du tout excessif.
Disons-le nettement : si le Gouvernement était plus clair dans ses axes de réforme, nous ne serions pas contraints d’examiner des textes si longs et si complexes.

Le Sénat est en train de réformer ses méthodes de travail, et c’est bien, mais l’exécutif pourrait faire de même, car le Gouvernement est le premier responsable des longueurs que déplore le Président de la République.
J’en viens maintenant au fond de ce projet de loi.
Nous partageons, monsieur le ministre, le constat que vous avez dressé sur l’économie française. La France souffre, selon vous, de trois maux : la défiance, la complexité et le corporatisme. Ces trois sources de difficultés sont connues, et il est grand temps de s’y attaquer.
La confiance des Français s’est profondément détériorée. Nous vivons dans un désagréable climat de défiance à l’égard de nos institutions, de ce que l’on appelle la « classe politique » et, plus généralement, de notre modèle social et économique. Si la confiance est si difficile à retrouver, c’est parce que notre pays fonctionne au ralenti depuis plusieurs années.

En effet, le retour de la compétitivité, tant espéré, se fait attendre, encore et toujours. Le Gouvernement peine à trouver des réponses à une crise qui n’a que trop duré. Il n’a, selon nous, jamais su prendre de véritables mesures d’envergure, ambitieuses et visionnaires.
Cela a été souvent dit à cette tribune : seules des réformes structurelles permettront à la France de se relever et de retrouver son attractivité.
Or, monsieur le ministre, je n’ai vu dans ce texte aucune réforme systémique de notre fiscalité assourdissante. Je n’y ai pas vu non plus de modernisation de la fonction publique, pour libérer des emplois, pas plus que de réformes des retraites ou d’allégement substantiel du droit du travail.

qui verrouillent tout esprit de réforme et d’entreprise dans notre pays.
Face à tous ces doutes, le Sénat a travaillé et propose aujourd’hui un texte différent, plus riche et plus ambitieux…

… pour notre pays, qui permettra de répondre aux trois grands objectifs que vous aviez énoncés dans votre exposé préalable.
Je ne peux pas citer l’ensemble des avancées réalisées au cours des dernières semaines, mais je rappellerai les plus significatives.
En matière de mobilité, l’ouverture à la concurrence des TER dès le 1er janvier 2019 s’articule parfaitement avec la clarification des compétences recherchée par tous.
Nous avons également confirmé le doublement du montant du plafond de la réduction ISF-PME.
S’agissant de la réforme des professions juridiques et judiciaires réglementées, notre approche a été raisonnable et constructive. Nous avons réaffirmé la spécificité de la prestation juridique et créé un code de l’accès au droit et de l’exercice du droit.
Dans le domaine du droit du travail, soulignons les simplifications bienvenues du compte pénibilité, avec la suppression de la fiche individuelle et la limitation du nombre de facteurs mesurés pour évaluer la pénibilité.
Nous avons également revu le cadre des accords possibles en entreprise sur les 35 heures. Il me semble d’ailleurs, monsieur le ministre, que vous partagez notre point de vue sur ce sujet. Nous allons ainsi passer d’accords défensifs à des accords offensifs, en conférant aux entreprises la souplesse nécessaire.
Dans ce même domaine, le lissage des effets de franchissement des seuils sociaux était attendu depuis longtemps.
Concernant le travail dominical, nous avons su préserver l’équilibre entre zones touristiques et commerciales et zones moins concernées comme entre petits commerces et grandes surfaces.
Dernier point, mais qui n’est pas le moins important, le Sénat a adopté en début de semaine l’amendement du Gouvernement permettant de soutenir à hauteur de 2, 5 milliards d’euros les entreprises qui réaliseront des investissements entre avril 2015 et avril 2016. J’hésite à vous dire, monsieur le ministre, car je ne souhaite pas vous compliquer la tâche, notre satisfaction – je ne parlerai pas de victoire –, au sein du groupe UDI-UC comme de l’ensemble de la majorité sénatoriale. Cet amendement s’inscrit en effet dans la filiation de celui que nous avions présenté à l’occasion du débat budgétaire de l’automne dernier.
Il s’agit surtout d’une bonne nouvelle pour les entreprises françaises, en dépit du temps perdu, car cette disposition aurait pu et aurait dû être votée depuis longtemps. Il est donc essentiel qu’elle soit maintenue.
Vous partiez, en août dernier, d’une démarche assez idéologique, que vous aviez essayé de traduire dans un texte présentable, qui faisait toutefois de plusieurs professions les comptables et les boucs émissaires des échecs de la politique économique du Gouvernement.
Nous avons finalement vu arriver un texte plus mesuré, il est vrai, mais très incomplet, et surtout très confus. Je crois pouvoir dire aujourd’hui que ce texte, complètement remanié, répond aux attentes de nos concitoyens, des professionnels, des entreprises, et donc de la majorité sénatoriale.
Dès lors, c’est tout naturellement que le groupe UDI-UC votera ce projet de loi, en encourageant le Gouvernement à préserver, au-delà de nos travaux, les acquis du débat sénatorial !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour le groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, un texte d’une telle ampleur emporte forcément une certaine dramaturgie. Nous avons connu des temps forts, des temps plats, des moments de surplace, des tunnels, de brusques accélérations, et aussi, il faut le dire, des mouvements d’humeur !
M. Jacques Mézard opine.

(Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.) Les gouvernements successifs étaient restés les bras croisés !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

C’était long, le président François Zocchetto l’a dit, mais c’est parce qu’il y avait une certaine urgence, d’autant que rien n’avait été fait auparavant. §
Nous étions, hier, heureux d’en avoir fini…

… et nous nous sommes congratulés. Nous étions surtout heureux d’avoir su travailler en nous respectant les uns les autres. Aujourd’hui, vient le moment du choix politique.
Tous, nous avons salué l’engagement total du ministre
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Isabelle Debré applaudit également.

La majorité de la commission spéciale, son président et ses corapporteurs, dont il faut saluer la constance et la présence continue, avaient arrêté une stratégie avec la majorité sénatoriale : pas de confrontation systématique, mais des réécritures. Nous avons pourtant pu constater que, parfois, ces réécritures valaient suppression de l’esprit général du texte.
Il revenait au groupe socialiste de tenir la ligne de soutien à notre gouvernement.
Chaque fois, en particulier, qu’il s’est agi de défendre et de maintenir des dispositifs de négociations et de dialogue social contre des décisions unilatérales des employeurs, comme cela a été malheureusement le cas pour le travail du dimanche, nous sommes restés fidèles à nos principes : pas d’accord, pas d’ouverture !
Chaque fois que nous avons dû défendre notre conception de l’entreprise, au cours de plusieurs débats presque philosophiques, en tout cas très politiques, nous nous sommes engagés : une entreprise n’est pas seulement une société de droit, c’est aussi et surtout une communauté d’intérêts, dans laquelle les salariés doivent être traités en parties prenantes.
Ce fut notamment le cas lorsqu’il s’est agi du droit d’information des salariés. Je veux vous dire, monsieur le président Retailleau, que nous n’avons vraiment pas apprécié votre manière de le qualifier. J’ai cru, un moment, que vous aviez commis une erreur de langage ; cela peut arriver !
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Sourires sur les travées de l'UMP.

Mme Nicole Bricq. Mais, en relisant les débats, il m’est bien apparu que vous aviez utilisé le qualificatif de « toxique » à propos de ce dispositif. À mes yeux, vous avez commis là une mauvaise action et prononcé une mauvaise parole.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Il y eut des temps forts et productifs. J’en retiendrai trois.
Ce fut d’abord la matinée consacrée à la couverture des zones blanches et au déploiement de la fibre, qui a abouti à un amendement du Gouvernement adopté à l’unanimité. Vous avez, monsieur le ministre, immédiatement convoqué les opérateurs pour qu’ils s’engagent aux côtés des collectivités territoriales.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

C’est un honneur pour nous d’avoir voté cette mesure ici.
C’est également le Sénat qui aura voté le mécanisme de surinvestissement pour les entreprises.

J’y vois une marque de reconnaissance à l’endroit de cette institution de la part du Gouvernement, et je l’en remercie.
Beau travail, également, que celui qui a conduit à un accord sur le crédit interentreprises, lequel libère les entreprises de banques, toujours frileuses quand il s’agit de les financer.
Il y eut aussi des temps plats, durant lesquels nous avons fait du surplace : impossible de s’entendre, par exemple, sur la spécialisation de certains tribunaux de commerce.
À la vérité, à la décharge de la commission spéciale, je dois dire que nous avions passé la matinée à écouter le corapporteur s’efforcer de convaincre sa majorité, très rebelle à cette idée, de ne pas voter la suppression. On peut comprendre qu’après cela vous n’ayez plus voulu céder sur rien, monsieur le corapporteur !
La commission spéciale a parfois rencontré des difficultés à contenir sa majorité, mais elle a aussi prêté la main à quelques débordements. J’ai compté dix épisodes, dont aucun n’était majeur, qui vous ont conduits à céder sur votre stratégie ! §Je les ai comptés !

Malgré les objurgations du président Capo-Canellas, vous n’avez pu empêcher votre majorité d’en rajouter dans les exonérations sociales et fiscales non justifiées.

Mme Nicole Bricq. J’ai fait un décompte rapide : il est tout de même étonnant que ceux qui nous réclament plus de 100 milliards d’euros d’économies au dehors de cet hémicycle aient ainsi ajouté près de 300 millions d’euros de dépenses !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Hermeline Malherbe applaudit également.

Enfin, la majorité sénatoriale a voulu placer dans ce texte quelques marqueurs politiciens, et c’est de bon cœur que la commission spéciale a suivi sa majorité, dès lors qu’il s’agissait du social et du travail.
On retiendra, entre autres, les agressions contre le compte pénibilité et les seuils sociaux.
Sourires sur les travées de l'UMP.

C’est décidément faire peu de cas des partenaires sociaux !
De même, le renversement des accords de maintien de l’emploi défensifs, transformés en accords offensifs, alors même que vous savez parfaitement que le Gouvernement doit très prochainement s’en entretenir avec les partenaires sociaux pour prendre une décision qui sera traduite dans la navette parlementaire, est une mauvaise manière faite au Gouvernement et un mauvais coup porté au dialogue social.

Si nous avons pu aboutir sur la réforme prud’homale, nous avons échoué à faire évoluer significativement les professions du droit, car la majorité sénatoriale s’est montrée franchement conservatrice à ce sujet.
À l’heure des comptes et du choix, le groupe socialiste a considéré que le texte pouvait assurer sa bonne fin dans la navette parlementaire, au service de l’économie, de la croissance et de l’emploi pour la France et les Français.

Mme Nicole Bricq. … mais elles n’ont reçu aucun aval du Gouvernement que nous soutenons et, fort heureusement, elles ne survivront pas à la navette !
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

En conséquence, la réforme l’emportera sur la régression et l’immobilisme, et cela motive notre abstention finale !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Hermeline Malherbe applaudit également.

Après quinze jours de débats, le Sénat a achevé l’examen de l’un des plus longs textes que notre assemblée ait eu à étudier.
Sur la forme, j’ai eu l’occasion hier de souligner le bon climat des débats, grâce à l’écoute constructive dont ont fait montre le ministre, les corapporteurs et le président de la commission spéciale.
Sur le fond, dans sa philosophie générale, le projet de loi tend à déverrouiller un certain nombre de secteurs, dans l’objectif affiché de créer de l’activité et de la croissance. Ouvertures de lignes privées d’autocar, liberté d’installation et regroupement des professions réglementées, simplification du droit de l’environnement, ouverture facilitée des commerces le dimanche et la nuit : telles sont certaines des propositions qui nous sont faites.
Tout d’abord, monsieur le ministre, nous sommes réservés quant au potentiel de croissance que vous pensez obtenir grâce à ces mesures de dérégulation.
Ensuite, en vertu de votre volonté de produire toujours plus, vous considérez comme autant d’obstacles des règles qui tendent à préserver notre patrimoine ou notre environnement ; obstacles aussi des règles qui garantissent le droit des salariés à disposer de temps libre ; obstacles encore des règles qui garantissent l’éthique des professions réglementées.
Cependant, afin de limiter l’impact négatif de certaines mesures, vous avez prévu des contreparties. Ces contreparties permettent à votre réforme d’atteindre un point d’équilibre que l’on peut qualifier de « social-libéral ».
Mais qu’adviendra-t-il si une nouvelle majorité est aux commandes
Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.

… et si un nouveau ministre de l’économie occupe votre poste ?
Le projet de loi ouvre des brèches qui peuvent être exploitées dans une logique tout autre que celle de l’actuel gouvernement.
Marques d’approbation sur les travées du groupe CRC.

Le projet social-libéral peut très facilement devenir libéral tout court. C’est précisément ce qui s’est d’ores et déjà produit lors de l’examen du texte au Sénat. La majorité de droite…
Protestations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

… ou la majorité sénatoriale, pour ne pas vous vexer, chers collègues, a profité de votre projet de loi, monsieur le ministre, pour y apposer sa marque et rompre l’équilibre que vous proposez.

Sur le travail dominical et nocturne, les entreprises auront la possibilité de déroger très largement aux contreparties en s’affranchissant du dialogue social.

À l’occasion de la libéralisation du transport par autocar, la majorité sénatoriale a adopté un amendement visant à l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional.
Et puisque l’on traite largement du droit du travail, pourquoi s’arrêter ? Pourquoi ne pas instaurer trois jours de carence dans la fonction publique hospitalière et territoriale, relever les seuils sociaux et permettre de déroger aux 35 heures ?
Marques d’approbation ironiques sur les travées de l'UMP et applaudissements sur les travées de l’UDI-UC.

Le risque d’une dérive libérale n’est donc pas hypothétique : le texte qu’il nous est proposé aujourd’hui de voter nous en apporte la preuve.
Nous déplorons aussi très vivement l’adoption, à cinq heures du matin, juste avant l’interruption de nos travaux pendant deux semaines, de l’amendement qui vise à permettre le stockage de déchets radioactifs à Bure, dit « amendement Cigéo », qui avait même été appelé par priorité afin de s’assurer qu’il serait voté avant la fin de la séance !
Pour être objectif, il faut cependant prendre acte du travail du Sénat sur plusieurs points. §La limite kilométrique de déclaration des lignes d’autocar à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été relevée pour ne pas concurrencer les lignes publiques. L’article 29, qui empêchait la démolition de bâtiments soumis à recours contentieux, a été supprimé. Enfin, le Sénat a adopté une position équilibrée au sujet des professions réglementées en redonnant la main au ministère de la justice sur les installations et en encadrant les remises.

Toutefois, ces quelques avancées ne changent en rien notre analyse globale.

Nous refusons la logique de ce texte, selon laquelle la croissance sera au rendez-vous de la dérégulation. Nous ne pensons pas qu’il faille de la dérégulation pour créer de la croissance. Nous craignons aussi, comme je l’ai déjà dit, qu’une autre majorité ne s’engouffre dans la brèche ouverte et n’impose toujours plus de dérégulation au nom d’une hypothétique croissance. Cette nouvelle majorité, monsieur le ministre, n’aura pas les limites que vous vous êtes imposées dans ce texte.
Les écologistes voteront par conséquent contre ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC. – Marques de déception feintes sur les travées du groupe UMP.

Avant de donner l’appréciation globale du groupe communiste républicain et citoyen sur le fond de ce projet de loi, je voudrais m’arrêter quelques instants sur la forme de ce débat parlementaire.
En trois semaines, nous avons dû examiner en séance publique un véritable monstre juridique. Ces sables mouvants législatifs ont gêné l’appréhension de ce texte par les parlementaires, mais aussi par les citoyens.
Comme nous l’avons indiqué en défendant notre motion d’irrecevabilité, la loi doit être intelligible, compréhensible pour tous. Votre texte l’est-il, monsieur le ministre ? Hors de ces murs, a-t-il permis un véritable débat dans le pays sur le choix de société que vous portez, à savoir le libéralisme ?
Cette question de forme n’est pas un détail. A l’heure où le Sénat annonce vouloir se réformer, on s’interroge : une démocratie parlementaire peut-elle fonctionner en étant soumise à une telle inflation législative ? Ce texte regroupait l’équivalent d’au moins quinze projets de loi !
Par ailleurs, au regard de la masse de ses dispositions, il est inadmissible d’imposer la procédure accélérée. Alors que 600 amendements, au moins, ont été adoptés au Sénat, est-il acceptable que l’Assemblée nationale ne se ressaisisse pas de ce texte ? Rappelons qu’elle ne l’a pas adopté en tant que tel puisque, faute de majorité de gauche pour vous soutenir, monsieur le ministre, M. le Premier ministre a dû dégainer brutalement le « 49.3 » !
Un accord en commission mixte paritaire paraît invraisemblable tant les amendements de la droite sénatoriale poussent les feux du libéralisme à leur paroxysme.
Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.

Un tel accord serait une violence inadmissible faite à la majorité de l’Assemblée nationale et à ces dizaines de sénateurs de gauche, socialistes en particulier, qui avaient déjà refusé la dérive libérale du texte initial.
Monsieur le ministre, c’est une question grave. Je sais votre intention d’aller vite dans ce débat. Vous êtes en effet inquiet des effets dévastateurs que pourrait avoir dans l’opinion, et dans l’électorat de gauche, la divulgation des multiples capitulations devant le marché que recèle ce texte.
Votre projet, monsieur le ministre, comme nous l’avons dit et répété tout au long de ce débat, a une cohérence, celle d’un libéralisme assumé, d’un libéralisme qui envahit tous les aspects de la vie publique et privée, un libéralisme que vous assumez pleinement. Pourtant, le 6 mai 2012, les électeurs ont voulu mettre un terme, et pour une bonne part d’entre eux radicalement, sans compromis, à la dérive libérale des années de présidence de M. Nicolas Sarkozy.
Votre projet, monsieur le ministre, consiste en une dérégulation à tout va. Vous ouvrez massivement les lignes de transport routier de voyageurs, au détriment de la sécurité et de l’écologie, quitte à affaiblir l’un des atouts majeurs de notre pays : le transport ferroviaire.
La concurrence est votre maître mot : « mettre en concurrence », « faire jouer la concurrence », « la compétition »… Pourquoi pas « le combat » ? Les idéaux de fraternité, d’égalité et de liberté – celle de bien vivre et de s’épanouir, non celle de vendre, d’acheter et d’exploiter – sont noyés dans votre océan normatif.
Dérégulation et concurrence sont aussi les points clefs des dispositifs de privatisation adoptés par le biais de ce projet. Monsieur le ministre, vous nous refaites le coup des autoroutes avec les aéroports ! La collectivité a investi pour de grandes infrastructures très rentables ; vous les cédez au privé, aux actionnaires. Comment s’étonner que, dès à présent, l’ombre du Qatar plane sur les aéroports concernés, à Lyon et à Nice ?
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

L’industrie de défense elle-même est soumise à la pression du privé : vous instituez un partenariat surprenant avec un géant historique de l’armement allemand, au risque de perdre le lien nécessaire entre armement et diplomatie nationale.
Même le secteur du logement n’a pas trouvé grâce à vos yeux, puisque vous privilégiez le logement intermédiaire en remettant en cause l’effort réel pour le logement social engagé par Mme Duflot.
M. Roger Karoutchi s’exclame.

Discrètement, vous multipliez les dispositions en faveur de l’actionnariat. Actionnariat salarié, dites-vous ; mais, comme nous l’avons démontré, le dispositif des actions gratuites de l’article 34 fait des cadres dirigeants les principaux bénéficiaires de ces nouveaux cadeaux.
Jamais, dans votre texte, il n’est question de faire participer à l’effort de croissance les banques et les détenteurs de capitaux !
Enfin, le volet social de votre texte est truffé de régressions majeures : extension du travail dominical à douze dimanches par an, avec une généralisation en perspective ; remise en cause des prud’hommes et de l’inspection du travail ; instauration d’une procédure civile qui placera le salarié devant les avocats tout puissants du patronat.
Ces quelques mots ne permettent pas de traduire l’ampleur des transformations que vous proposez.
Pour conclure, je veux m’arrêter sur les conséquences des mesures sénatoriales adoptées avec votre assentiment.
La droite vous a manifesté un soutien constant durant ce débat, vous applaudissant à maintes reprises.
Protestations sur les travées de l’UMP.

La droite a donné son approbation aux grands axes que je viens d’évoquer, à l’exception remarquée des articles relatifs aux professions juridiques. Elle va même plus loin, et trop souvent avec votre assentiment, monsieur le ministre.
Parmi ces mesures se trouve l’extension du travail dominical, qui, dans les entreprises de moins de 11 salariés s’effectuera sans contreparties. Les enseignes culturelles pourront ouvrir le dimanche, car la culture, même le dimanche, cela consiste sans doute à vendre et consommer… Les accords « offensifs » de maintien de l’emploi apportent de nouvelles dérogations aux 35 heures et font régresser les droits des salariés. Leur droit à l’information est lui aussi limité, et la loi Hamon est battue en brèche. Les seuils sociaux augmentent pour mieux diminuer les droits collectifs des salariés.
Je citerai enfin la destruction du compte pénibilité et la mise en place, à la demande du groupe UMP – et avec votre accord, monsieur le ministre : c’est dans le Journal officiel – d’une commission chargée d’écrire un nouveau code du travail simplifié. M. Gattaz a dû bien dormir le soir du vote de cet amendement !
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Et que dire de la privatisation des trains régionaux, autorisée par la majorité sénatoriale ?
Votre texte, monsieur le ministre, est un formidable réceptacle pour toutes les régressions sociales. Il ouvre la boîte de Pandore en brisant les digues construites en France durant des décennies par les luttes des salariés, les luttes du peuple que symbolise le programme des « Jours heureux » du Conseil national de la Résistance.
Pour vous, le droit du travail est un frein à l’expansion du marché. Vous avez bien raison : là où il a sombré, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, les inégalités ont crû, la pauvreté s’est développée.
Nous refusons votre modèle de société, que beaucoup, à la droite de cet hémicycle, approuvent.
Nous savons qu’à gauche, nous ne sommes pas seuls. Nous agirons pour rappeler que la gauche a d’autres valeurs, celles de l’humain, de l’égalité et du partage, et qu’elle porte des propositions alternatives, comme nous l’avons démontré tout au long des débats.
Le groupe communiste républicain et citoyen votera donc contre ce projet, encore aggravé, si cela était possible, par la droite sénatoriale.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours de trois semaines de débats sur ce projet de loi, notre Haute Assemblée a adopté en séance publique pas moins de 280 amendements, qui se sont ajoutés aux modifications apportées par la commission spéciale, dont je salue le travail, en même temps que son président et ses corapporteurs. Le texte a ainsi substantiellement évolué par rapport à la version que nous avait transmise l’Assemblée nationale.
En commission spéciale comme en séance publique, le groupe RDSE a apporté sa contribution à un texte ambitieux – probablement trop d’ailleurs – pour l’avenir de notre pays.
Tant par la diversité des sujets abordés que par son impact sur l’état d’esprit général, mais aussi et surtout sur des aspects très concrets de la vie de nos concitoyens, ce projet de loi restera un texte hors norme, ayant permis de battre une série de records !
Sourires.

À l’issue de ce travail, qu’on peut qualifier de marathon législatif tant les organismes ont été mis à rude épreuve – jusqu’au bout de la nuit, parfois –, nous estimons que le texte sur lequel nous allons nous prononcer aujourd’hui est, dans l’ensemble, meilleur – ou moins mauvais
Nouveaux sourires.

Certes, ce projet de loi ne nous donne pas pleine et entière satisfaction, et nous maintenons d’importantes réserves sur bien des points. Cependant, qui peut être entièrement satisfait par un texte contenant autant d’articles et embrassant autant de sujets ? À l’inverse, qui peut prétendre que ce texte ne comporte aucune disposition intéressante, que ce soit dans sa version initiale ou dans les versions adoptées successivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ? Si, dans le « Macron », hélas, tout n’est pas bon, tout n’est pas mauvais non plus !
Rires.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la majorité des membres de notre groupe a adopté sans grande difficulté les articles concernant la question du travail dominical, qui n’est pas la plus importante à nos yeux. Je ne reviendrai donc pas en détail sur une réforme qui a pourtant beaucoup retenu l’attention des médias.
Nous sommes également favorables aux dispositions relatives à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.
En revanche, d’autres domaines constituent une priorité pour nous, comme le logement, la vie des entreprises, le droit du travail et, bien sûr, les professions réglementées, thème sur lequel le président de notre groupe, Jacques Mézard, s’est beaucoup investi.

Si nous déplorons le fait que certaines mesures figurant dans le texte n’aient pas été suffisamment amendées dans le sens de nos convictions et de notre conception de l’intérêt général, nous nous réjouissons d’être parvenus à convaincre la Haute Assemblée sur d’autres sujets.
Tout d’abord, dans le domaine du logement, l’adoption de nos amendements favorisera la mise en œuvre de dispositions utiles en matière de simplification, de facilitation et de réduction des délais, notamment dans le domaine de la construction de logements sociaux, et encouragera le développement de l’habitat participatif.
En outre, l’élargissement de la composition de la commission nationale de l’aménagement, de l’urbanisme et du foncier à une représentation des professionnels de l’aménagement introduira davantage d’efficacité et de pluralisme dans ce secteur.
Ensuite, s’agissant des experts-comptables, c’est sur notre initiative que le Sénat a supprimé la possibilité d’instaurer une rémunération au succès pour les activités exercées à titre accessoire, évitant ainsi les dérives bien connues que l’on constate dans les pays anglo-saxons.
Enfin, dans le domaine de la justice commerciale, notre ténacité a également payé : nous avons fait adopter une mesure instaurant la présence de droit des présidents de tribunaux de commerce au sein des formations de jugement des tribunaux spécialisés. Cette mesure apportera une expertise et une connaissance du terrain supplémentaires. Nous préservons par là même un principe de proximité dans la gestion des affaires.
À cet égard, monsieur le ministre, votre projet de loi n’était pas, d’une façon générale, suffisamment marqué par l’empreinte du terrain, des territoires et de la réalité vécue par les Français. C’est cette marque que le RDSE et, plus largement, le Sénat auront permis d’inscrire dans ce texte.
Oui, le Sénat est utile !

M. Jean-Claude Requier. Ces trois semaines de débat en fournissent une nouvelle démonstration ! Quelque chose me dit que vous y êtes sensible, monsieur le ministre, pour ne pas dire que vous en êtes convaincu !
Sourires.

Cela dit, quelques sujets d’insatisfaction et de préoccupation demeurent pour tout ou partie des membres de mon groupe.
En premier lieu, nous déplorons que les enjeux spécifiques aux territoires ruraux n’aient pas davantage été pris en compte en matière de mobilité et de libéralisation des services de transport. Nous considérons qu’il n’est pas de bonne politique de remettre en cause la pérennité du réseau ferroviaire secondaire, seul garant de l’équilibre entre les territoires, au profit du transport routier. Loin d’encourager l’égalité des chances, le texte risque d’aggraver les inégalités territoriales en favorisant ceux qui, sur le plan économique et territorial, disposent déjà de plus d’atouts.
En deuxième lieu, la volonté, affichée dans le cadre la réforme de la justice prud’homale, de réduire les délais de jugement est certes louable, mais elle risque, dans la rédaction actuelle du texte, d’aboutir à une justice au rabais, voire de complexifier les procédures. Plus que jamais, si l’on veut développer une véritable culture de la conciliation, il faut avoir le courage de mobiliser des moyens pour former les conseillers prud’homaux à celle-ci.
En troisième lieu, nous nous inquiétons de l’adoption d’une mesure visant à supprimer la fiche individuelle du compte pénibilité. Bien que nous soyons en principe favorables à un assouplissement, nous ne voudrions pas que les mesures de simplification soient prises au détriment des salariés les plus vulnérables.
En quatrième et dernier lieu, la réforme des professions réglementées reste, à nos yeux, la partie la plus discutable du projet de loi. Nous regrettons les mesures adoptées sur la liberté d’installation des avocats : elles risquent de renforcer les déserts juridiques et d’entraîner une perte de « matière grise », notamment dans des territoires ruraux qui seront une nouvelle fois les premières victimes. À cet égard, nous regrettons la remise en cause de la postulation des jeunes avocats aux tribunaux de grande instance, qui préservait cet équilibre. Mes chers collègues, le Sénat aura le devoir de revenir à terme sur ce dispositif.
De manière plus globale, nous restons opposés à la vision trop technocratique et parisienne qui se dégage, selon nous, des articles concernant les avocats, les notaires, les huissiers et les commissaires-priseurs. Ces dispositions nous semblent encore trop déconnectées des réalités locales et du terrain. Monsieur le ministre, soyez un ministre de terrain, venez à la rencontre des territoires et des Français !
Lors de nos riches échanges sur la couverture de la téléphonie mobile, qui ont duré toute une matinée, vous avez montré votre intérêt pour la ruralité. Puisque votre agenda est désormais quelque peu allégé
Sourires.

(Bravo ! et applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées de l'UDI-UC et de l'UMP.) Venez donc dans le Lot déguster au passage une bécasse !
Rires et exclamations.

M. Jean-Claude Requier. Pour cela, prenez plutôt le train ! À moins que vous ne préfériez l’autocar !
Mêmes mouvements.

Bien entendu, notre sens bien connu de la responsabilité et de la mesure nous incite à reconnaître de réelles améliorations. Nous saluons ainsi les progrès réalisés, sur l’initiative du corapporteur François Pillet, concernant les avocats aux conseils. Bien que les modifications apportées ne nous paraissent pas suffisantes, l’article adopté par le Sénat est préférable à celui qu’avait introduit à l’Assemblée nationale, dans les conditions qu’a rappelées Jacques Mézard lors de son intervention en discussion générale.

J’en termine, monsieur le président.
Notre groupe porte un jugement nuancé sur ce projet de loi tel qu’amendé par la Haute Assemblée. Nous constatons une indéniable amélioration par rapport au texte issu de l’Assemblée nationale. Toutefois, il nous est impossible de le soutenir pleinement, aussi bien dans sa version initiale que dans sa version issue des travaux du Sénat.

M. Jean-Claude Requier. C’est la raison pour laquelle la majorité des membres du groupe RDSE fera le choix de s’abstenir, un choix qui sera exprimé librement et en responsabilité, comme il est d’usage dans notre groupe.
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et de l’UDI-UC.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, il va être procédé dans les conditions prévues par l’article 56 du règlement au scrutin public sur l’ensemble du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
Ce scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Je vous rappelle qu’il aura lieu en salle des Conférences, conformément aux dispositions du chapitre 15 bis de l’instruction générale du bureau.
Une seule délégation de vote est admise par sénateur.
Mmes et MM. les secrétaires du Sénat superviseront les opérations de vote.
Je déclare le scrutin ouvert pour une demi-heure et je vais suspendre la séance jusqu’à quinze heures cinquante, heure à laquelle je proclamerai le résultat.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures vingt, est reprise à quinze heures cinquante.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 179 :
Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés229Pour l’adoption185Contre44Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Je tiens à remercier M. le ministre de l’économie, qui a occupé pendant de très longues heures le banc du Gouvernement. Pour votre grande première devant le Sénat, monsieur le ministre, vous vous êtes parfaitement accoutumé au style de notre assemblée, à sa manière de travailler et à sa volonté d’être constructive !
Je remercie également, au nom de tous les membres de notre assemblée, M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale, dont nous avons pu apprécier le travail remarquable et les qualités de chef d’équipe.
Applaudissements.

Je remercie enfin nos trois corapporteurs, Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et François Pillet, qui n’ont guère quitté le banc des commissions – nombre d’entre nous peuvent en témoigner – et ont donné au projet de loi adopté par le Sénat ses arcs-boutants et ses lignes de force.
Nouveaux applaudissements .
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, au texte que la Haute Assemblée vient d’adopter, qui n’est ni celui du Gouvernement ni celui de l’Assemblée nationale, peut-on reprocher de ne pas être ce qu’il n’est pas ? Ce projet de loi n’est pas, il est vrai, une réforme fiscale : un pacte de responsabilité et de solidarité a été instauré. Il n’est pas non plus une réforme des retraites : une telle réforme a été adoptée et d’autres le seront. Ne sombrons donc pas dans le bovarysme parlementaire, en reprochant à un texte déjà trop long de ne pas traiter de tout !
On lui reproche parfois de venir trop tard ; j’accepte nombre de reproches, mais convenez que je ne pouvais pas faire plus vite.
On lui reproche parfois d’être trop long. De fait, certains ont calculé que le total des heures pendant desquelles nous avons débattu au cours des dernières semaines représente quinze fois la durée moyenne d’examen d’un texte de loi. Pourtant, je pense que cette odyssée valait la peine d’être accomplie, parce que ce texte long a permis de porter sur nombre de questions un regard neuf.
Plusieurs ont qualifié le projet de loi de « libéral ». Peut-être a-t-il, en sortant du Sénat, une couleur autre que celle qu’il avait en y entrant : question de dosage ! Je crois surtout que son esprit consiste à réformer un grand nombre de secteurs de manière cohérente.
Si cette entreprise est nécessaire, c’est parce que, dans notre pays, nous avons trop souvent accepté que certains domaines ne fassent pas l’objet de réformes, que des dysfonctionnements s’installent et que certaines activités soient réglementées exclusivement pour celles et ceux qui en vivent, et parfois même par eux. Puis, quand des inégalités ou des difficultés survenaient, les gouvernements, de droite et de gauche, les corrigeaient a posteriori, généralement à coups de dépenses publiques.
La démarche qui fonde ce projet de loi consiste à revisiter, secteur par secteur, nombre de réglementations, de revoir beaucoup de droits installés, d’habitudes qui ont été prises, afin d’instaurer de nouveaux équilibres et de donner des droits à celles et ceux qui n’en ont pas, qui sont en dehors, qui n’ont pas accès à certaines opportunités. Il s’agit de reconnaître que, dans différents secteurs de notre économie et de notre société, l’accumulation de normes n’est pas toujours protectrice, ou du moins qu’elle protège certains en accroissant les barrières qui maintiennent d’autres dehors. Telle est la philosophie de ce texte.
On peut évidemment considérer que, dès lors que des règles sont supprimées, on agit en libéral. Peut-être… Reste que, lorsqu’une règle ne protège pas les plus faibles, mais empêche certaines initiatives, on a le devoir de s’interroger sur son bien-fondé.
Pour autant, je ne considère pas que toutes les règles soient inutiles. Je suis d’ailleurs en désaccord avec la suppression par le Sénat de certaines règles qui ont une portée régulatrice et une vertu sociale ; je souscris, sur ce point, aux propos de Jean Desessard. Il y a de bonnes règles, et c’est lorsqu’on les supprime que l’on passe de l’autre côté de la limite.
Supprimer les mauvaises règles et conserver les bonnes : c’est l’ambition de ce projet de loi, qui n’a pas encore atteint son état définitif.
Je crois que la méthode consistant à passer en revue, l’un après l’autre, les domaines de notre économie et de notre société nous a permis de ne pas être les otages des intérêts en présence, voire des ministères qui les défendent parfois, des habitudes administratives et politiques. Nous avons donc pu envisager certaines réalités d’une manière différente.
Il n’y a pas des secteurs qu’il faudrait réformer systématiquement et d’autres auxquels on n’aurait pas le droit de toucher. Sans doute y a-t-il là l’un de nos sujets de désaccord, car je considère que l’on peut et que l’on doit aller plus loin en ce qui concerne les professions réglementées ou la réforme du permis de conduire, plus loin encore s’agissant de la réforme des transports, comme le Sénat a décidé d’aller plus loin sur certaines réformes sociales.
Pour chaque réforme, nous devons nous poser cette question : jusqu’où faut-il aller pour accroître l’activité, pour engendrer de la croissance, tout en protégeant celles et ceux qui ont moins d’opportunités que les autres ? C’est en suivant cette démarche équilibrée que nous pourrons progressivement reconstruire le pays. Tel est l’esprit qui anime le projet de loi et dans lequel il a été examiné.
Au terme d’un débat au cours duquel nous avons abordé de nombreuses questions, nous avons des sujets d’accord et des sujets de désaccord. Si ce projet de loi était un tissu, ce ne serait pas le velours rouge sur lequel nous sommes assis, mais plutôt une moire, où chacun voit briller les couleurs qui lui conviennent. Une chose est sûre, en tout cas : il ne s’agit pas d’un tissu terne, et les débats l’ont montré !
De manière évidente, les équilibres du texte adopté par le Sénat ne sont pas ceux qui constitueront le texte final. Néanmoins, à n’en point douter, la version définitive du projet de loi, qu’elle résulte de la commission mixte paritaire ou des discussions parlementaires qui suivront, devra prendre en compte les débats qui se sont tenus au Sénat et les sensibilités qui s’y sont exprimées.
Marques de satisfaction et applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et de l'UDI-UC.
Ainsi que plusieurs des intervenants l’ont justement souligné, s’agissant des territoires, par exemple en matière d’équipement et de couverture mobile, le Sénat a apposé une vraie marque sur ce projet de loi, notamment par l’ajout d’un certain nombre de dispositions. Vous avez su, grâce à une sensibilité différente, en apportant un éclairage spécifique, doter ce texte d’une tonalité nouvelle.
En revanche, sur d’autres points, vous l’avez profondément modifié. Je ne m’en suis jamais caché, le Gouvernement reviendra sur ces points avec sa propre sensibilité et selon son propre agenda.
En effet, l’agenda des réformes ne s’arrêtera pas avec l’adoption de ce projet de loi.
Dans les prochaines semaines, avec François Rebsamen, nous réunirons les partenaires sociaux afin de faire le bilan de la loi relative à la sécurisation de l’emploi. Celle-ci prévoit des avancées en matière sociale, dans un esprit d’équilibre : meilleure représentation des salariés au conseil d’administration et, en même temps, plus de flexibilité à travers les accords défensifs de maintien de l’emploi.
Au début du mois de juin, le Président de la République et le Premier ministre vont organiser une conférence économique et sociale sur les PME et les TPE, à la suite de laquelle de nombreuses mesures seront annoncées.
C’est ainsi que, loin de marquer le pas, les réformes se poursuivront.
Nos débats laisseront, je le pense, une trace importante. Ils ont nourri ce projet de loi, ils en ont clarifié les enjeux et les perspectives, ils ont permis de le faire exister, ici, bien sûr, mais aussi à l’extérieur de la Haute Assemblée.
Au terme de ces quatre semaines de compagnonnage, je veux adresser des remerciements, et d’abord à vous, monsieur le président, ainsi qu’à celles et ceux qui se sont succédé pour conduire nos travaux en faisant toujours prévaloir un esprit de respect, d’écoute et de partage.
Je tiens à remercier également M. le président de la commission spéciale ainsi que Mmes et M. les corapporteurs de tout le travail de préparation qu’ils ont accompli, de leur dévouement, de leur présence – ils n’ont pas compté leurs heures ! – et de leurs réponses précises. Nous avons eu des passes d’armes, mais aussi des accords, accords que, pour ma part, j’ai toujours assumés.
Bien entendu, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont représenté les différents groupes parlementaires. Je sais le temps que vous avez passé sur ce projet de loi, l’énergie et la conviction que vous y avez mises, y compris nuitamment. Sans vous, le débat n’aurait pas été possible. Il n’est, en tout cas, concevable qu’avec des femmes et des hommes de bonne volonté : cela correspond tout à fait à l’esprit que j’ai trouvé au sein de cette Haute Assemblée.
Permettez-moi enfin, monsieur le président, de remercier les collaborateurs des sénatrices et sénateurs, ainsi que l’ensemble des agents du Sénat, au premier chef ceux des comptes rendus, qui ont fait preuve d’une grande patience, sans compter leurs heures, eux non plus, alors que les travaux se sont parfois poursuivis jusqu’au petit matin. Je salue en particulier l’expertise des administratrices et des administrateurs du Sénat, qui nous ont permis d’apporter maintes améliorations techniques à ce projet de loi.
C’est bien, à l’issue de ce vote, l’ensemble du Sénat qui doit être remercié !
Applaudissements.

M. le président. Vous l’aurez noté, monsieur le ministre, ici, nous accueillons et, nous aussi, nous assumons !
Sourires.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen de la proposition de loi organique relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, déposée sur le bureau du Sénat le 7 mai 2015.

L’ordre du jour appelle le débat sur l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence, organisé à la demande du groupe CRC.
La parole est à Mme Michelle Demessine, oratrice du groupe auteur de la demande.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je ne peux entamer ce débat sur l’avenir de notre industrie aéronautique sans évoquer le dramatique accident dont a été victime, à Séville, l’équipage d’un avion de transport militaire A400M, qui effectuait un vol d’essai.
Au-delà de l’émotion légitime, il ne faudrait pas, bien sûr, dans l’attente des résultats de l’enquête sur cet accident, que cet événement fragilise le groupe Airbus et remette en cause la poursuite de la construction de cet appareil, qui reste très performant.
À cet égard, je voudrais saluer la décision du ministre de la défense de poursuivre les vols prioritaires en opération, ainsi que la reprise, aujourd’hui même, des vols d’essai à Toulouse.
J’en viens à notre débat de ce jour. Les sénatrices et sénateurs du groupe CRC ont souhaité inscrire à l’ordre du jour de leur espace réservé ce débat sur l’avenir de l’industrie aéronautique et spatiale, car cet avenir se joue en ce moment, loin des projecteurs médiatiques et malheureusement en l’absence de tout débat démocratique.
En effet, pour le volet spatial, un changement de modèle d’organisation du secteur, aujourd’hui piloté par les États au travers du Centre national d’études spatiales, le CNES, de l’Agence spatiale européenne et d’Arianespace est en train de se produire. Le rapprochement des activités liées aux lanceurs de Safran et d’Airbus Group, orchestré par l’État, va entraîner une véritable restructuration de la filière, qui aura des impacts au niveau tant national qu’européen.
C’est le casse du siècle – pour reprendre un titre provocateur, mais très juste – organisé par Airbus dans le domaine des lanceurs et des missiles.
Le secteur aérospatial est très diversifié, puisqu’il réunit aussi bien les aéronefs, de toute nature, les hélicoptères, le transport spatial et les satellites. Ce secteur englobe aussi les activités militaires, comme les missiles tactiques et stratégiques, ainsi que les activités liées aux drones.
S’agissant du volet spatial, sur lequel j’insisterai plus particulièrement, la France, du fait d’une volonté historique de maîtrise de l’espace, est le seul pays européen possédant l’ensemble des technologies spatiales, et cela des lanceurs à toute la gamme des satellites. Elle compte aussi, avec 12 000 salariés, plus du tiers des effectifs européens du secteur.
Cette réussite spatiale nationale a reposé sur une stratégie de maîtrise publique de l’accès à l’espace et a permis à son tour le développement d’une stratégie européenne.
Cette réussite du secteur spatial européen tient à la place et au rôle déterminant des États dans un pilotage maîtrisé de bout en bout. La puissance publique, avec un ensemble d’entreprises et de centres de recherche placés sous sa responsabilité, a su insuffler une véritable dynamique de l’innovation et relever des défis technologiques majeurs.
En effet, tout le monde sait qu’aucune industrie spatiale dans le monde n’est indépendante des financements publics. C’est vrai aujourd’hui et ce n’est pas près de s’arrêter. Cette stratégie de maîtrise publique fonctionne, et elle seule a permis de placer l’Europe au tout premier rang des acteurs mondiaux.
De plus, cette excellence repose sur une architecture subtile et équilibrée. Ainsi, sans entrer dans le détail, l’Agence spatiale européenne assure la direction de l’ensemble du programme Ariane ; le CNES agit lui en maître d’ouvrage en ce qui concerne la recherche et le développement pour la préparation de l’avenir et en assistant l’Agence spatiale européenne pour les lanceurs en service ou en développement.
Ces deux agences s’appuient sur plusieurs industriels, notamment Airbus Group et Safran. Il y a également un architecte, Arianespace, défini comme opérateur de systèmes de lancement. C’est une société française qui est chargée de la commercialisation et de l’exploitation des systèmes de lancement spatiaux, à savoir les familles de lanceurs Ariane et Vega, ainsi que du lancement de Soyouz.
Or c’est cet équilibre qui est aujourd’hui remis en cause. Arguant de la concurrence de SpaceX, le projet du Gouvernement vise à la construction d’une coentreprise entre Safran et Airbus Group maîtrisant l’ensemble du processus de production des lanceurs, de la conception au lancement et à la commercialisation. C’est donc là une remise en cause fondamentale du rôle du CNES et d’Arianespace, pourtant garant d’une politique industrielle européenne et nationale, et de grands programmes de recherche scientifique.
L’arrivée sur le marché mondial de la fusée Falcon 9 de SpaceX, qui casse les prix de lancement, offre une formidable aubaine pour briser un schéma européen qui a fait ses preuves, derrière une rhétorique d’obsolescence et de manque de compétitivité.
Il n’aura fallu que quelques mois pour que le lobbying industriel d’Airbus Group et de Safran convainque les États d’opérer un changement profond de gouvernance.
C’est bien l’un des enjeux centraux du rapprochement entre Airbus Group et Safran, aux termes duquel la maîtrise d’œuvre, le pilotage, la programmatique et la commercialisation ne seraient plus sous maîtrise publique.
Ces groupes revendiquent toutefois le maintien des aides publiques indispensables pour lancer des projets innovants.
Ainsi, ces industriels vont bénéficier des aides publiques pour les programmes Ariane 6 et Vega-C et pour le soutien à l’exploitation d’Ariane 5 ECA, le budget prévisionnel étant de 8 milliards d’euros sur dix ans, mais sans réel suivi technique, et surtout sans qu’ils en supportent véritablement les risques. Rien de bien nouveau, en somme !
Dès lors, de nombreuses initiatives ont été prises par les salariés de la filière pour exprimer leur malaise et leur incompréhension face à l’État, qui, sans aucun débat national public, laisse « toutes les clés de cette filière à Airbus Space Systems et Safran, sans aucun contre-pouvoir », mais aussi pour souligner les menaces qui pèsent sur la capacité de la puissance publique à contrôler efficacement les programmes spatiaux et sur la souveraineté nationale, voire européenne.
En effet, cette restructuration se situe à un moment charnière de la filière des lanceurs, où se jouent actuellement la définition et les études de futurs lanceurs.
Tout est encore en débat : la capacité de satellisation, mais aussi les choix technologiques, notamment pour les moteurs – à propulsion liquide ou solide. Ceux-ci sont déterminants pour la pérennité de l’activité d’établissements, dont certains sont stratégiques, en France et en Allemagne, mais aussi dans d’autres États européens, comme l’Italie.
Par ailleurs, toute restructuration nécessite une expertise d’impact sur les emplois, les activités, les territoires. Alors que le secteur « défense et espace » d’Airbus Group est déjà sous le coup d’un plan drastique de suppression d’emplois – une réduction de 10 % des effectifs –, jusqu’à présent, aucun élément n’a été rendu public.
Les deux industriels avancent leur projet selon un calendrier très serré, sans perspective claire de développement industriel et d’emplois.
Les salariés d’Arianespace ignorent tout de leur avenir, alors que les comptables ont commencé leur ouvrage de valorisation des actifs au bénéfice de la joint-venture Airbus Safran Launchers.
Enfin, derrière ce projet de rapprochement de leurs activités de lanceurs spatiaux et de missiles nucléaires stratégiques porté par Airbus et Safran, c’est toute l’organisation de l’industrie spatiale européenne qui en jeu, avec en perspective le rachat d’Avio, maître d’œuvre du lanceur VEGA, pour constituer un monopole européen dans le domaine.
Or cet abandon au secteur privé du rôle de maître d’œuvre des pouvoirs publics se fait dans le plus grand secret. Ce n’est pas acceptable ! La maîtrise et les compétences acquises par des décennies d’efforts d’investissements publics sont des biens communs que l’on ne peut voir cédés sur l’autel d’intérêts financiers immédiats.
Alors que l’accès à l’espace est un axe stratégique majeur pour l’action des États, en termes à la fois de sécurité, de souveraineté et de capacité d’innovation, il serait aujourd’hui placé dans le champ de la compétitivité et de la rentabilité.
Trop nombreuses sont les questions sans réponse.
Qui, dans ce nouveau modèle, contrôlera les fonds publics et assurera les risques industriels ? Comment le CNES pourra-t-il conserver son rôle d’agence spatiale et son expertise s’il n’est plus considéré comme maître d’œuvre des programmes spatiaux ? Quid des actions d’Arianespace détenues par le CNES ? Seront-elles vendues au consortium Airbus Safran ? À quel prix ? Comment assurer l’indépendance de l’opérateur de lancement vis-à-vis de ses clients satellites ? Pourquoi, moins de trois mois après la réunion ministérielle de décembre 2014, qui a fixé les contours de cet accord, la facture augmente-t-elle de 800 millions d’euros ?
Ce dont il s’agit aujourd’hui, c’est l’avenir des lanceurs civils, mais aussi militaires. Ce dont il s’agit, c’est aussi la force de dissuasion française.
Il est inconcevable qu’une telle restructuration se réalise sans un véritable débat national et européen sur l’ensemble des enjeux. Il y a un besoin impératif de définir sur quelle politique et sur quelle stratégie spatiale s’articule un tel projet.
Par ce débat qui a lieu aujourd’hui, nous invitons le Gouvernement à lever l’opacité dans laquelle est conçu ce projet, qui porte pourtant sur un enjeu majeur de souveraineté nationale et européenne de défense et de sécurité. Nous espérons qu’il répondra à notre souhait.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, alors que la morosité économique actuelle nous conduit parfois à l’autoflagellation, il y a de véritables succès qu’il faut savoir saluer. Or, comme l’a rappelé notre collègue Michelle Demessine, l’industrie aéronautique et spatiale en est assurément un.
Vous le savez, son dynamisme est fulgurant. En 2013, le secteur employait en France quelque 177 000 personnes, avec 6 000 emplois nets créés. Le chiffre d’affaires de la profession était de près de 48 milliards d’euros, dont une grande partie réalisée à l’export, contribuant ainsi au redressement de notre balance commerciale, comme en témoigne la vente récente de nos excellents Rafale à l’Égypte, à l’Inde et au Qatar.
Il s’agit d’une filière d’excellence, à la pointe des technologies, de l’innovation et de la recherche, avec près de 15 % du chiffre d’affaires consacré à la recherche et au développement, avec de multiples retombés dans les domaines militaire et civil.
C’est aussi une filière d’avenir : en témoigne le carnet de commandes du groupe Airbus. Nous devons d'ailleurs surmonter ensemble le tragique événement qui vient de se produire, sans nous décourager, car l’A400M est un très bon avion.
J’insiste sur cette notion de filière, car la France a la chance de posséder sur son territoire une filière aéronautique et spatiale complète, avec de grands constructeurs – Airbus, qui est une chance, Dassault –, des équipementiers – Thales, Safran –, mais également un vaste tissu de PME maîtrisant les savoir-faire les plus complexes.
J’ai assumé avec mon agglomération la présidence tournante de la communauté des villes Ariane, qui regroupe, en France et en Europe, les villes accueillant sur leur territoire des industries liées à Ariane, et j’ai pu mesurer à quel point cette industrie de pointe irriguait l’activité de nos territoires – à l’image de Clemessy, en Alsace.
Au-delà de cette dimension économique, il convient de garder à l’esprit que l’industrie aéronautique et spatiale n’est pas une industrie comme les autres. Maîtriser le ciel et l’espace n’est pas anodin ! Il y a là une dimension stratégique essentielle pour les États, étroitement liée aux enjeux de souveraineté – la sécurité, par exemple.
Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous devons être fiers de la réussite de notre filière aéronautique et spatiale. Cela ne doit cependant pas nous empêcher d’être lucides pour appréhender les réalités de demain. Alors que le contexte international est de plus en plus concurrentiel, l’industrie aéronautique et spatiale française et européenne devra inévitablement relever de nombreux défis pour se maintenir au sommet. En voici quelques-uns.
Historiquement, le succès de la filière repose d’abord sur un partenariat très fort entre l’État et les industriels. L’État a toujours joué un rôle prépondérant dans le lancement de grands programmes – A-380, Ariane, Rafale, etc. –, notamment via le mécanisme des avances remboursables. Or, dans un climat de restrictions budgétaires, d’aucuns s’interrogent sur le risque de désengagement de l’État, qui aurait des conséquences dramatiques sur le secteur.
J’émets à ce titre des réserves sur la politique de cessions d’actifs conduite par l’État. Si je comprends la logique budgétaire, est-ce bien raisonnable de brader ainsi les « joyaux de la couronne » ? N’y a-t-il pas un risque de perdre notre capacité décisionnelle au sein d’entreprises stratégiques en accroissant la part de l’actionnariat flottant, qui représente par exemple 70 % chez Airbus ? À tout le moins, soyons prudents.
La formation représente un autre défi. Alors que l’industrie aéronautique et spatiale tourne à plein régime, les entreprises peinent à recruter des techniciens et ouvriers qualifiés. Quel paradoxe dans un pays comme le nôtre !
Comment le Gouvernement entend-il renforcer la formation dans ce secteur, afin de permettre à nos jeunes d’acquérir les compétences recherchées ? Comment faire tomber les barrières entre écoles et entreprises ? Quid du projet de centre de formation sur la base de Dugny-Le Bourget ?
Ces questions sont d’autant plus importantes que les marges de manœuvre du secteur ne cessent de se réduire. L’industrie aéronautique et spatiale est confrontée à une concurrence accrue des pays émergents et des États-Unis, qui n’hésitent pas à subventionner massivement certains programmes, à l’image du Boeing 777X, concurrent de l’A380 et de l’A350.
N’oublions pas, enfin, que la concurrence peut être intraeuropéenne. Je pense en particulier à la politique spatiale européenne, qui a conduit depuis quelques années à l’apparition d’une multiplicité d’acteurs. Ne serait-il pas souhaitable, pour le secteur spatial, de favoriser une rationalisation des savoir-faire en Europe ?
Dans ce contexte tendu, le défi pour la filière sera de poursuivre son développement, en renforçant sa compétitivité. Des mécanismes de soutien financier existent déjà – vous les connaissez, mes chers collègues –, ainsi que des plateformes de dialogue entre l’État et les industriels. C’est très bien !
Je sais que les industriels attendaient aussi beaucoup du pacte de compétitivité pour améliorer leurs capacités de production en France. Êtes-vous en mesure, monsieur le secrétaire d’État, d’en dresser un premier bilan ?
Certes, les marchés nationaux constituent une formidable vitrine, mais du fait de la baisse des commandes publiques, notamment en matière de défense, la croissance de la filière se jouera aussi à l’export.
Certains grands groupes ont commencé à mettre en place des partenariats locaux pour des activités de montage et de maintenance. De tels projets ne doivent pas voir le jour au prix de transferts de valeur ajoutée trop importants.
Il y a là, toujours, une recherche d’équilibre assez difficile. Ces transferts, en effet, constituent parfois la clef du marché. Ce n’est pas toujours le cas, comme on l’a vu récemment, mais la question est toujours susceptible de revenir sur la table, avec, par exemple, un pays comme l’Inde. Il importe donc de fixer des limites au regard de notre savoir-faire, mais aussi des problématiques de préservation de l’emploi et d’accompagnement de nos PME, qui peinent encore à s’implanter sur les marchés.
J’ai néanmoins conscience que le sujet est d’importance, mais que l’art est difficile !
Depuis cinquante ans, l’industrie aéronautique et spatiale a réalisé des progrès considérables. Toutefois, face à la concurrence qui s’annonce, il faut garder une longueur d’avance.
L’innovation doit par conséquent être au cœur du développement de la filière, notamment eu égard aux enjeux environnementaux, qui offrent de formidables perspectives d’innovations, à l’image du projet d’avion électrique.
Plus généralement, dans un monde en pleine mutation – le secteur aéronautique et spatial n’échappe pas à ce phénomène –, les enjeux environnementaux, comme les enjeux technologiques vont s’imposer chaque jour davantage. Ni nous ni nos entreprises ne devons les voir comme des freins. Au contraire, il faut les considérer comme de nouvelles chances. Dans ce cadre, il sera également déterminant de disposer d’une longueur d’avance s’agissant de règles et de normes qui s’installeront progressivement au niveau international, y compris dans des domaines aussi pointus que ceux qui nous intéressent aujourd'hui.
Sur cet aspect, comme sur d’autres, la France ne peut agir seule, et c’est à l’échelle européenne qu’il faut amplifier nos efforts. La décision de développer le lanceur Ariane 6 afin de contrecarrer l’offensive de la société américaine SpaceX est, à ce titre, une bonne nouvelle. Le projet est crucial pour l’avenir du leadership européen en matière spatiale. Des initiatives similaires pour d’autres types de matériel, comme les satellites militaires, devraient être encouragées.
Certes notre filière aéronautique et spatiale se porte bien, mais le principal danger serait de nous reposer sur ses acquis ! Pour affronter les défis à venir, nous devons renouer avec une véritable politique industrielle volontariste, la renforcer ou l’amplifier, avec, à la clef, des emplois, de la croissance, une place de leader dans un secteur hautement stratégique et, bien évidemment, toutes les retombées que l’on peut imaginer et que l’on engrange déjà actuellement.
En tout cas, monsieur le secrétaire d’État, vous pouvez compter sur les sénateurs centristes pour soutenir tous vos efforts en ce sens !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – Mme Françoise Laborde et M. Jean-Louis Carrère applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me félicite de ce débat et remercie le groupe CRC de cette initiative, qui nous permet d’aborder, ensemble, des sujets fondamentaux pour l’industrie française.
En tant que parlementaires, nous devons en effet être conscients que l’avenir de cette filière, dont l’histoire est en réalité une véritable épopée, représente un enjeu majeur pour notre pays. Les enfants que nous étions ont grandi au rythme de la conquête spatiale ! Les derniers retentissements des connexions de la sonde Rosetta avec l’atterrisseur Philae nous rappellent que cette aventure, mondiale et européenne, ne peut être délaissée, même si les budgets nationaux sont en baisse.
L’agence spatiale américaine, la NASA, fut un marqueur incroyable de la puissance des États-Unis. Néanmoins, l’Europe, rappelons-le, n’est pas en reste. Depuis cinquante ans, elle est impliquée dans cette conquête, dont les retombées industrielles, économiques et scientifiques sont vitales pour toutes les filières civiles et militaires.
L’année dernière, l’Agence spatiale européenne, l’ASE, a fêté un demi-siècle d’existence. Les États membres financent 50 % des dépenses spatiales publiques en Europe, et nous gagnons des parts de marché dans les services liés aux lancements, aux satellites et aux télécommunications. La communauté scientifique européenne bénéficie d’une renommée mondiale et attire la coopération internationale. Les centres de recherche et d’innovation détiennent une crédibilité internationale indiscutable. Enfin, les opérateurs européens du secteur spatial comme de l’aéronautique affichent une belle réussite.
Pourtant, la concurrence est rude, nous le savons, et, en dépit des apparences, elle n’est pas nouvelle. Après une période d’assoupissement dans le domaine commercial, les États-Unis reviennent en force avec SpaceX, une entreprise soutenue par des commandes institutionnelles qui permettent d’offrir un véritable rapport qualité-prix. Les prix proposés dans ce cadre, précisément, rythmeront les deux décennies à venir et nous ont déjà obligés à réagir au niveau du secteur spatial européen. J’y reviendrai ultérieurement.
Après ce bref tour d’horizon international, je voudrais être plus concret et évoquer la dimension nationale. En effet, le secteur de l’aéronautique et du spatial est l’un des éléments de notre puissance.
Cette industrie duale constitue un moteur et un vecteur extraordinaire de croissance, que nous devons soutenir en dépit des restrictions budgétaires. Comme vous le savez, mes chers collègues, le secteur de la défense en est l’un des premiers investisseurs, comme partout ailleurs dans le monde. Nous savons parfaitement qu’Ariane n’aurait pas vu le jour sans les missiles balistiques. Les investissements militaires sont à l’origine des avancées technologiques et font souvent office d’aiguillon dans le domaine civil.
En 2014, le chiffre d’affaires total de l’industrie s’élève à 50, 7 milliards d’euros, dont près d’un tiers dans le domaine militaire. Le secteur est le premier contributeur de notre balance commerciale, avec 33, 1 milliards d’euros d’exportations et un niveau de commandes de 73 milliards d’euros, soit six années de production. Voilà un made in France qui fonctionne !
Ce savoir-faire est inestimable, et les bureaux d’études – on n’insistera jamais assez sur leur importance - doivent être alimentés. Il faut donc que la commande publique, notamment en matière de défense, soit au rendez-vous pour sauvegarder ces emplois hautement qualifiés, présents sur notre sol, le tout reposant sur un réseau de formation technologique et universitaire que nous devons absolument maintenir et faire fructifier.
S’agissant du domaine de la défense, il faut saluer les succès du Rafale à l’export, mais nous devons aussi préparer l’avenir et investir dans des projets innovants, comme l’avion du futur – le FCAS, pour Future combat aircraft system – et le drone de combat – Unmanned combat aerial vehicle, ou UCAV - avec les Britanniques. Nous devons aussi travailler avec les Allemands et les Italiens sur le drone de moyenne altitude et longue endurance, dit « drone MALE », européen, ainsi que sur les satellites optiques, radars et électromagnétiques.
Dans le domaine civil aéronautique et spatial, l’installation du siège d’Airbus à Toulouse et l’inauguration des nouveaux sites de Turbomeca et Thales en Aquitaine sont des gages contre la fracture technologique territoriale.
Le carnet de commandes d’Ariane 5, en attendant Ariane 6, le succès du dernier né d’Airbus, l’A-350, ou les commandes du nouvel avion d’affaires de Dassault, le Falcon 8X, montrent que nous restons parmi les leaders dans un secteur extrêmement concurrentiel.
En ce qui concerne Ariane 6 - sujet précédemment abordé - pour faire face à la concurrence de SpaceX et à ses prix d’appel, Airbus Defence and Space et Safran viennent de créer Airbus Safran Launchers. Les deux entreprises proposent, par ce biais, de s’engager industriellement et commercialement sur le développement d’Ariane 6 et d’assumer la responsabilité de l’ensemble du programme.
C’est certainement un « plus » indéniable, mais il faudra veiller, monsieur le secrétaire d’État, à ce que les capacités d’études et d’analyses du Centre national d’études spatiales, le CNES, ne soient pas diluées et perdues pour autant. En effet, cet institut est le pivot du secteur national de l’espace et le garant de son existence. De même, l’État doit réfléchir à la place qu’il entend donner à Arianespace dans cette nouvelle organisation.
Pour la défense, la recherche et développement en matière d’équipements est indispensable, et nous devons faire un effort supplémentaire. J’ai défendu cette position lors de l’étude et du vote de la dernière loi de programmation militaire ; je la défendrai encore en juin prochain, à l’occasion de son actualisation.
Aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous pouvons être fiers de ce qui est réalisé dans le domaine aéronautique et spatial. Nous devons investir dans l’intelligence pour préparer le futur et faire en sorte que, demain, la France et l’Europe conservent leur place dans ce domaine essentiel.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, de l'UDI-UC et du RDSE. – M. Jean-Louis Carrère applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ma très courte intervention de ce jour fait suite au rapport que j’ai produit en 2013, dans le cadre de OPECST, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, intitulé Les Perspectives d’évolution de l’aviation civile à l’horizon de 2040 : préserver l’avance de la France et de l’Europe.

Merci, mon cher collègue.
Voilà effectivement l’une des rares industries où notre pays est un acteur de rang mondial. Et ce rang mondial, obtenu par l’aéronautique, est le fruit de politiques publiques menées, avec constance, depuis un demi-siècle.
Il n’est peut-être pas inutile de rappeler qu’au cours des trente prochaines années, l’aviation civile comme le secteur spatial seront confrontés à des défis technologiques de grande ampleur. Des mutations importantes auront lieu, c’est certain, et il faut s’attendre à de fortes ruptures technologiques en matière d’architecture des avions et de motorisation.
N’oublions pas non plus qu’un programme industriel aéronautique ou spatial pour les vingt ou trente prochaines années doit se concevoir dès aujourd'hui !
Comme chacun le sait, l’aviation civile est une activité industrielle essentielle pour notre pays, en elle-même d’abord, mais également du fait du pouvoir de diffusion d’innovations à l’ensemble du tissu industriel que recèle l’aéronautique. Les investissements d’aujourd’hui conditionnent, dans ce secteur notamment, la préservation de l’avance de la France et de l’Europe. C’est pourquoi il faut maintenir à long terme les soutiens publics à la recherche aéronautique.
À cet égard, je rappellerai une fois de plus l’importance du maintien dans la durée du niveau des crédits alloués à l’Office national d’études et de recherches aérospatiales, l’ONERA. L’activité de cet organisme est essentielle, car elle porte, en matière aéronautique, sur les briques technologiques qui devront générer des applications à long terme.
Face à une concurrence qui n’en finit pas de s’accroître, il est essentiel de soutenir la filière, pour préparer l’avenir. Or les soutiens institutionnels sont en diminution depuis 2010, alors que, dans le même temps, les États-Unis et la Chine déploient des programmes importants de financements publics. Quant à notre partenaire dans Airbus, l’Allemagne, ses crédits de soutien doublent depuis 2012. Dès lors, celle-ci ne finira-t-elle pas par revendiquer de nouveaux arbitrages dans la répartition de la chaîne de valeur des Airbus ?
En décembre 2013, j’avais été alerté sur la situation préoccupante de l’ONERA. Aujourd’hui, sa reconstruction institutionnelle s’accompagne certes de l’élaboration d’un plan stratégique scientifique, mais sa situation financière est toujours alarmante et met en péril son devenir. Nous comptons donc sur vous, monsieur le secrétaire d’État, pour que des mesures d’urgence soient prises.
De même, le financement des projets du Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, reste d’une brulante actualité, du fait de ses programmes sur l’usine aéronautique du futur, les systèmes embarqués, les nouvelles fonctionnalités avancées ou encore les nouvelles configurations d’aéronefs.
Est-il nécessaire d’insister sur le fait que ces programmes ont pour but, tout à la fois, de donner des objectifs à la recherche aéronautique sur les thématiques essentielles et de préparer la continuité innovante pour les ruptures technologiques de l’aviation de 2040 ? Y a-t-il meilleur chemin pour préserver l’avance de la France et de l’Europe en ce domaine ?
Faute de temps, je ne m’étendrai pas sur deux des points que j’avais également traités dans mon rapport rédigé au nom de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques. Je veux parler de la double nécessité d’anticiper le développement du marché des drones et de suivre les progrès des filières de biokérosène.
Je dirai un dernier mot concernant la formation. Cela a déjà été dit, elle est d’importance dans une activité industrielle soumise en permanence à la poussée des innovations.
Trois domaines sont essentiels : les besoins en formations spécifiques au secteur de la construction aéronautique, avec l’adéquation des formations à la demande industrielle, mais aussi la nécessité d’anticiper le choc de l’introduction de la numérisation dans le système de navigation aérienne tout en tirant les conséquences de la numérisation de l’économie, car l’aéronautique aura de plus en plus besoin de spécialistes des logiciels embarqués.
Compte tenu du temps qui m’est imparti, je n’évoquerai pas l’importance de l’établissement des normes pour la rénovation de la navigation aérienne, avec le programme SESAR – en anglais Single European Sky ATM Research – pour l’Europe, et NextGen – The Next Generation Air Transportation System – pour les États-Unis. C’est dommage, mais c’est un autre problème.
Pour conclure, oui, la France et l’Europe ont l’impérieux devoir de préserver leur avance, à vue de plus d’une génération, dans le champ industriel directeur de ce secteur d’activité, sachant que l’avenir de l’un des secteurs de pointe de notre industrie se décide aujourd’hui.
Enfin, monsieur le secrétaire d’État, je vous poserai une question qui nous vient de notre collègue Georges Labazée : quelles sont les perspectives pour une collaboration possible autour du futur avion électrique, entre Hydro-Québec qui va s’installer sur le complexe de Lacq pour la production de piles et Airbus qui va s’implanter près de l’aéroport de Pau ?
Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie par avance des précisions que vous voudrez bien nous apporter.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais à mon tour remercier nos collègues du groupe CRC d’avoir provoqué la tenue de ce débat en séance, qui nous permet de nous exprimer sur ce sujet d’importance.
La France et l’Europe possèdent un tissu industriel aéronautique et spatial extrêmement développé, emmené par des groupes comme Airbus, Thales, Dassault aviation, ATR, Eurocopter, Arianespace, Astrium, Safran... Ces entreprises couvrent l’ensemble de la filière, depuis les avions gros porteurs jusqu’à la construction et l’envoi de satellites géostationnaires, sans oublier la défense.
Dans le domaine spatial, Arianespace a remporté 60 % des contrats de lancement de satellites géostationnaires en 2013. La concurrence américaine de SpaceX, qui a déjà été évoquée, et celle des Chinois, avec les fusées Longue Marche, nous poussent donc à envisager le futur en prenant la décision ferme, et cela depuis le mois de décembre dernier, de développer Ariane 6.
Le défi est de taille : il faut un lanceur qui puisse remplacer Ariane 5 en termes de fiabilité et de puissance, tout en gagnant en compétitivité et en modularité. C’est en réussissant ce défi technique que nous pourrons conserver notre place de leader mondial des lancements de satellites.
Si les Américains cherchent avec SpaceX à renouveler le genre des lanceurs réutilisables, il est aujourd’hui peu probable que, à brève échéance, la remise en service des moteurs ayant déjà subi un vol soit rentable et fiable. Quant à la récupération des étages inférieurs et des propulseurs d’appoint, elle apparaît utile, mais à condition de les recycler. Nous avons mis à profit les innovations développées avec le lanceur Vega, afin d’améliorer le coût des lanceurs et d’en alléger la structure.
Il est également crucial, à l’heure actuelle, de limiter le nombre de débris spatiaux causés par les activités humaines en orbite, au risque de se priver à brève échéance d’un accès à l’espace qui soit sûr et fiable.
Le plus grand problème est posé par les débris de taille moyenne – entre un et dix centimètres – estimés aujourd’hui à environ 200 000, qui ne sont pas catalogués alors qu’ils présentent un risque très important et, surtout, pour lesquels il n’existe pas de protection.
Parmi les innovations en gestation dans le secteur aéronautique, l’une d’elles a retenu mon attention : il s’agit du retour des aérostats, plus communément appelés dirigeables.
Un peu à la manière des tramways du début du XXe siècle que l’on a abandonnés au profit de la voiture pour finalement y revenir au XXIe siècle, le dirigeable, que l’on avait abandonné au profit de l’avion, beaucoup plus rapide, se prépare un retour serein dans le domaine du transport aérien. Quelques vieilles images persistent dans l’imaginaire collectif, notamment celle de l’incendie du zeppelin Hindenburg. Pourtant, aujourd’hui, on gonfle les dirigeables à l’hélium, qui, lui, est totalement ininflammable.
Les dirigeables présentent de nombreuses qualités. Ce mode de transport économique bénéficie du meilleur rapport « masse transportée-coût kilométrique » après le transport fluvial : il permet de véhiculer par les airs de très lourdes charges ; les défaillances des moteurs sont moins critiques que pour un avion ; les dirigeables modernes peuvent atterrir pratiquement n’importe où et ont la capacité de rester dans le ciel très longtemps et silencieusement.
Seule ombre au tableau des dirigeables, l’hélium, qui est le deuxième élément le plus abondant de l’univers après l’hydrogène, est, ironiquement, assez rare sur la Terre. De plus, les gisements actuels sont en cours d’épuisement à moyen terme, ce qui impose la prudence.
Certaines entreprises sont en train de développer des modèles hybrides, dont la sustentation n’est que partiellement assurée par le ballon, le reste étant fourni par l’aérodynamisme, la forme de l’engin et sa vitesse comme pour un avion.
À titre d’exemple, le Stratobus du groupe Thales est un ballon dirigeable à propulsion électrique capable de rester en vol stationnaire dans la stratosphère, à plus de vingt kilomètres d’altitude. Le ballon, dont la mise sur le marché est prévue en 2022, doit remplir des missions simples : être un relais pour les télécommunications et servir de poste d’observation. Il pourra servir autant à l’observation militaire des mers au large de la Somalie, par exemple, qu’à envoyer de la 4G à des millions d’utilisateurs d’Internet.
À l’heure où l’on constate que le secteur du transport aérien produit une part non négligeable des émissions de CO2 mondiales, les acteurs du secteur ont consenti des efforts pour réduire leurs émissions. La contribution de l’aviation aux émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine est actuellement seulement de 2 % à 3 %. L’enjeu consiste à stabiliser, puis à diminuer ce taux.
Un transport aérien durable et responsable doit permettre de réduire les émissions de C02, d’améliorer les effets produits sur la qualité de l’air et de réduire le bruit perçu.
La France, à travers son soutien constant à l’innovation, sera, nous n’en doutons pas, un acteur clef de l’évolution de cette filière, pour répondre aux enjeux du XXIe siècle.
En conclusion, j’ai entendu les réserves de notre collègue Michelle Demessine sur une forme de libéralisation de ce secteur. Il est nécessaire de mettre en œuvre ces politiques, qui doivent être publiques étant donné les stratégies de sécurité et de souveraineté, tant nationales que, plus encore, européennes. L’avenir est là !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce débat consacré à l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale, proposé par le groupe CRC, est au cœur de problématiques cruciales pour l’avenir de notre pays. Toutes les interventions précédentes l’ont encore démontré.
Au mois de mars dernier, par exemple, le ministre de l’économie et des finances a examiné, avec le secrétaire d’État chargé des transports, les plans industriels qui avaient été développés par son prédécesseur, Arnaud Montebourg.
Ces plans ont été sérieusement revus à la baisse. Quelque temps auparavant, nous apprenions ainsi que, à la suite d’une décision du Gouvernement, l’État actionnaire s’apprêtait à vendre, pour plus d’un milliard d’euros, près de 4 % de ses participations dans le groupe d’aéronautique et de défense Safran.
Une même logique et une même cohérence inspirent les décisions prises dans ces deux cas. Nous en avons largement parlé lors de la discussion du projet de loi Macron ces trois dernières semaines. Il s’agit de faire des économies à tout prix, d’obtenir rapidement des rentrées d’argent, pour répondre aux exigences de la Commission de Bruxelles, satisfaire les marchés financiers et respecter ainsi le dogme intangible des 3 % de déficit public promis pour 2017.
C’est une stratégie de court terme, qui est aveugle sur les conséquences économiques et sociales négatives qui en découlent.
C’est ainsi que l’industrie aéronautique et la filière spatiale, en particulier, sont, à l’instar de nombreux secteurs industriels, financiarisées à outrance et percutées de plein fouet par la dictature du bas coût présentée comme la seule solution pour résister à la concurrence exacerbée.
À cet égard, le cas de la filière spatiale, avec les lanceurs de satellites, est tout à fait représentatif de cette politique, ainsi que l’a montré Michelle Demessine.
L’affaire remonte en réalité au mois de juin 2014, lorsque les dirigeants des grandes entreprises de ce secteur ont directement rencontré le Président de la République pour lui proposer une profonde réorganisation de la filière.
Quelques mois plus tard, en décembre 2014, lors d’une réunion interministérielle des pays membres de l’Agence spatiale européenne, notre pays a décidé de confier aux entreprises Airbus et Safran la maîtrise d’œuvre des lanceurs de type Ariane et leur commercialisation par la société Arianespace. Il s’agissait là d’appliquer de nouvelles orientations à ce secteur industriel.
Un tel changement de politique est significatif d’une perte de la maîtrise de l’État dans ce domaine, au seul profit du secteur privé.
Cette perte de contrôle sur les orientations à mettre en œuvre coïncide paradoxalement avec un très important financement sur fonds publics, puisque celui-ci représentera 8 milliards d’euros sur dix ans, et ce sans contrepartie.
Il est tout à fait légitime que ces dirigeants d’entreprise aient souhaité alerter au plus haut niveau de l’État sur les défis qu’ils doivent relever et sur les difficultés liées à la concurrence. Toutefois, prennent-ils les bonnes décisions pour préserver les intérêts de notre pays dans les dix ans qui viennent ?
La méthode employée et l’opacité entourant les solutions qui ont été proposées au chef de l’État au cours de cette réunion permettent d’en douter. Nous estimons que les enjeux, les décisions et les mesures à prendre pour restructurer un secteur aussi stratégique pour l’avenir de notre pays devraient être discutés publiquement. C’est là, je crois, le rôle de ce débat parlementaire souhaité par notre groupe.
Ce débat est également nécessaire, car les organisations syndicales des salariés des entreprises du secteur, évidemment concernés au premier chef, sont tenues dans l’ignorance de la nouvelle gouvernance adoptée et des décisions qui ont été prises.
Ces organisations déplorent de ne pas disposer d’éléments d’information suffisants pour apprécier la situation en toute connaissance de cause et pouvoir ainsi en contester éventuellement le bien-fondé. Elles sont évidemment prêtes à entendre qu’une évolution de l’organisation industrielle de la filière aéronautique et spatiale est nécessaire pour s’adapter à un environnement qui a changé.
Toutefois, les modalités de cette restructuration, telles qu’elles apparaissent, posent de graves questions et suscitent de légitimes inquiétudes, concernant en particulier l’emploi et l’indépendance de notre pays.
Instruits de douloureuses expériences précédentes dans ce secteur – je pense, en particulier, à la fusion en cours entre les filiales du groupe Safran SPS et SME –, les syndicalistes savent que ce type d’opération est réalisé, en règle générale, au détriment des emplois, des conditions de travail et du maintien des compétences dans les entreprises.
Ce modèle de rapprochement sur des activités de fabrications duales, civiles et militaires, que sont les lanceurs spatiaux et les missiles nucléaires stratégiques est-il vraiment une solution pertinente du point de vue de l’économie et des intérêts fondamentaux de notre pays ?
Dans ces conditions, est-il réellement judicieux, s'agissant du domaine hautement stratégique des programmes européens d’accès à l’espace, de remplacer le pilotage public actuel des acteurs institutionnels que sont l’Agence spatiale européenne et le CNES, le Centre national d’études spatiales, tous deux privilégiant l’intérêt général, par un donneur d’ordre privé, en l’occurrence Airbus regroupé avec Safran, dont l’objectif premier de réduction des coûts est révélateur d’une logique essentiellement commerciale et financière ?
C’est donc sur ces questions de fond que notre groupe souhaite obtenir du Gouvernement des éclaircissements s'agissant des nouvelles orientations qu’il entend imprimer à la filière spatiale.
Dans notre débat de cette après-midi, la démocratie, ainsi mise au service du développement économique et de l’avenir du pays, ne peut qu’y gagner.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant de commencer, je tiens, au nom des sénateurs du RDSE, à saluer la mémoire des 150 victimes du crash aérien survenu le 24 mars dernier, date à laquelle devait initialement se tenir ce débat.
Un nouveau drame impliquant un appareil militaire s’est malheureusement déroulé à Séville, samedi dernier, faisant de nouvelles victimes. Nos pensées vont vers toutes les familles endeuillées.
Les deux industries, aéronautique et spatiale, qui font l’objet de notre débat, ce jour, ont en commun d’être deux filières d’excellence, dans lesquelles la France, notamment au travers de projets européens, jouit d’un leadership et d’une expertise certaine. Les deux connaissent également un développement exponentiel. Ainsi, le trafic aérien a doublé depuis quinze ans et doublera encore d’ici à 2030.
L’espace, surtout l’aéronautique, concerne non seulement quelques grands groupes, mais également tout un tissu d’entreprises de taille intermédiaire et de PME, équipementiers et sous-traitants.
Dans certaines régions, je pense naturellement à l’Aerospace Valley, entre Aquitaine et Midi-Pyrénées, ces industries sont un moteur du développement. La métropole toulousaine fait figure de capitale de l’air et de l’espace, mais je n’oublie pas qu’en Ariège, par exemple, ces secteurs emploient plus de 3 000 personnes.
Par essence, les deux filières sont soumises à la concurrence internationale. Ces dernières années, cependant, de nouveaux acteurs sont apparus, issus principalement des pays émergents.
Dans le peu de temps dont je dispose, mes chers collègues, j’ai choisi d’attirer votre attention sur trois enjeux actuels, dont l’impact ne saurait être négligé.
Le premier concerne le secteur aéronautique civil. Dans le transport aérien, la croissance des compagnies à bas coûts a bouleversé le marché. De même, l’émergence de compagnies issues des pays du Golfe inquiète, notamment à cause des subventions déguisées que celles-ci reçoivent de leurs États.
Monsieur le secrétaire d’État, à l’occasion du débat qui s’est tenu ici même, le 5 février dernier, sur le thème de la transparence dans le transport aérien, vous avez réaffirmé que les autorités françaises n’accordaient plus aucun droit de trafic à ces compagnies. Le 13 mars, lors d’un conseil des ministres des transports de l’Union européenne, les représentants de l’Allemagne, qui a cependant passé des accords « ciel ouvert », et de la France ont demandé la mise en place d’une stratégie commune, proposant de soumettre toute ouverture de droits de trafic au contrôle de ces entreprises.
Sans méconnaître les pratiques de ces compagnies ni remettre en cause l’ambition d’instaurer une concurrence non faussée dans le secteur du transport aérien, nous nous interrogeons sur l’efficacité d’une telle stratégie, d’autant qu’elle s’applique aussi à d’autres compagnies hors Union européenne.
Au niveau communautaire, si certains pays se retrouvent sur notre ligne, d’autres, notamment le Royaume-Uni, ont une politique plus conciliante. En accordant plus de droits de trafic, ils bénéficient d’une fréquentation accrue, avec des effets en termes d’affluence touristique et de développement des structures aéroportuaires.
Plus grave encore, ces compagnies, dont la croissance est rapide, procèdent à de nombreux achats d’appareils. Dans ce contexte, et connaissant les subtilités des marchés de l’aviation civile, il serait préjudiciable que les entreprises françaises et européennes pâtissent de cette politique intransigeante et perdent d’importants marchés au profit d’autres groupes, américains par exemple.
Le deuxième enjeu concerne le secteur spatial, qui est également soumis à une reconfiguration d’acteurs. Sont en effet apparus, depuis moins de dix ans, des lanceurs à faible coût pouvant mettre sur orbite des satellites à prix cassés. C’est le cas aux États-Unis, qui renouent avec une politique spatiale ambitieuse, comme en témoigne le développement de la société SpaceX, ou dans des puissances comme la Chine, avec son lanceur « Longue Marche », l’Inde ou encore la Russie. En réaction, les membres de l’Agence spatiale européenne ont décidé, à la fin de 2014, d’acter le programme Ariane 6, pour conforter la position de leader de l’Europe en matière de lanceurs commerciaux.
En conséquence, monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous indiquer quelle sera la feuille de route du Comité de concertation État-industrie sur l’espace, et comment cette entité entend favoriser la coopération entre les trois grands groupes français du secteur que sont Thalès Alenia Space, Safran et Airbus Defence and Space, notamment depuis la joint-venture entre les deux derniers ?
Enfin, et c’est le troisième enjeu que je souhaite aborder, il est évident que l’avenir industriel de ces deux filières passe par une politique de recherche et de développement ambitieuse et soutenue. À ce titre, les 34 programmes de la Nouvelle France industrielle, dont certains touchent l’aéronautique et l’espace, constituent l’un des leviers privilégiés de cette politique, en associant les grands groupes, les ETI et les PME.
C’est dans ce cadre qu’a été développé le prototype de l’avion électrique E-Fan par Airbus Group en Charente Maritime. Cet aéronef traversera la Manche, en juin prochain, plus de cent ans après Louis Blériot.
Cependant, alors que le Président de la République a annoncé une nouvelle levée de fonds pour le grand emprunt, le ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique et le Commissariat général à l’investissement s’apprêtent à faire un tri au sein des différents programmes. Aussi, monsieur le secrétaire d’État, concernant les secteurs industriels en débat cet après-midi, pouvez-vous nous indiquer les orientations qui seront privilégiées dans le choix de ces programmes ?
Nous pouvons également citer, parmi les efforts d’innovation dans le domaine aéronautique, les projets du Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC. Pour rappel, parmi ces derniers figurent des axes de recherche et de développement à court et moyen termes : systèmes embarqués dans les cockpits, satellites à propulsion électrique ou augmentation des matériaux composites dans les avions, afin de les rendre plus légers et plus sobres énergétiquement.
La course à l’innovation ne connaissant pas de pause, la France, si elle veut continuer à être à la pointe des techniques et du savoir-faire, doit donc investir massivement. Elle ne pourra le faire que sous l’impulsion et avec la coordination d’un État stratège.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, que d’évolutions dans le domaine spatial depuis l’automne 2012, quand Bruno Sido, que je salue ici, et moi-même avons remis au nom de l’OPECST notre rapport sur l’avenir de la politique spatiale ! Ces évolutions ont concerné les lanceurs, les satellites et, surtout, la concurrence des low cost.
À l’époque, en matière de lanceurs, l’Europe et, au premier chef, la France hésitaient entre Ariane 5 ME et Ariane 6. Le premier projet, fortement soutenu par les industriels allemands et français, se proposait de faire évoluer notre actuelle fusée pour en faire un lanceur plus puissant et plus « versatile » grâce à un étage supérieur rallumable.
Le CNES militait, lui, pour un lanceur de nouvelle génération, modulable, qui pourrait régler le problème principal, à savoir l’obligation d’appairage de deux satellites à chaque lancement. Or, compte tenu du poids de ces derniers, qui a doublé en 20 ans, trouver deux opérateurs dont les satellites sont compatibles avec la capacité de la coiffe et le calendrier devient très difficile et, surtout, a un coût : quelque 120 millions d’euros par an !
Même si nous ne doutions pas de la volonté de l’Europe de garder cette autonomie d’accès à l’espace qu’avait voulue le général de Gaulle, nous étions moins sûrs qu’elle veuille et puisse financièrement continuer à soutenir deux projets concurrents en période de crise, tout en maintenant une lourde subvention d’exploitation.
Dix-huit mois après la difficile conférence ministérielle de l’European space agency, l’ESA, à Naples, les conclusions de celle de Luxembourg confirment que l’Europe ne peut pas courir après deux lièvres à la fois.
Sans devenir une fusée low cost, Ariane 6 doit s’en rapprocher si elle veut conserver une part importante du marché commercial des satellites. Je ne puis m’empêcher de regretter que les inquiétudes que Bruno Sido et moi-même avions soulevées quant à la part que pourrait prendre le nouvel intervenant américain SpaceX n’aient à l’époque pas été prises au sérieux. La condescendance à l’égard d’un modèle de fusée considéré comme simpliste a sans doute retardé la prise de conscience que le prix d’un lancement serait bientôt plus important pour un opérateur que la technologie utilisée.
La première version d’Ariane 6 était fondée sur deux étages à poudre. La version retenue à Luxembourg possède un moteur d’étage principal cryogénique, pour satisfaire les industriels. Est-ce vraiment pour se rapprocher de ces objectifs low cost que le système de propulsion est si différent de celui qui avait été présenté comme intangible par le CNES et l’ESA, ou est-ce le poids des industriels, dorénavant réunis dans la joint-venture, qui a fait plier la direction des lanceurs du CNES ?

Merci, mon cher collègue.
En tout cas, l’avenir de la direction des lanceurs du CNES et de l’ESA doit rapidement être clarifié, tout comme le conflit d’intérêts qui pourrait survenir si Airbus devenait propriétaire du système de lancement européen.
Monsieur le secrétaire d’État, j’ai plusieurs autres interrogations.
Tout d'abord, si la recherche de la compétitivité est un facteur essentiel pour sauvegarder notre industrie spatiale, je crains les choix financiers et voudrais avoir la certitude que le budget d’Ariane 6 est bien sanctuarisé, en espérant qu’un jour l’Union européenne introduise, sur le modèle du Buy american act, une préférence européenne pour ses satellites institutionnels ; mais j’ai bien peur que cela ne reste qu’un rêve…
En attendant, le carnet de commandes de notre bonne vieille Ariane 5, qui doit toujours emporter deux satcoms, pourra-t-il être rempli jusqu’en 2020, malgré le dumping américain qu’ont évoqué mes collègues et la volonté affichée du président Obama de revenir sur le marché commercial mondial ?
L’industrie spatiale, ce sont aussi les satellites et, là encore, quelle évolution ! Voilà trente mois, on nous expliquait que les satellites à propulsion électrique avaient certes un avenir, mais lointain, et que les opérateurs commerciaux n’accepteraient jamais d’attendre huit mois pour atteindre la mise en poste, car le temps, c’est de l’argent. Néanmoins, comme chaque kilogramme coûte 20 000 euros et comme la propulsion électrique représente la moitié du poids du satellite, là aussi, le calcul financier s’est imposé : un quart des satellites seraient électriques en 2020.
Puisque le thème de ce jour est l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence, je voudrais être certaine que cette évolution est préparée chez les industriels.
Je sais qu’Airbus Defence and Space a réussi à diminuer le temps de latence à quatre mois pour la mise en orbite et que M. le ministre de l’économie, qui vient juste de quitter le Sénat, a annoncé une aide de 73 millions d’euros à cette filière. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d’État, me donner des précisions sur les futurs bénéficiaires et les conditions d’octroi de cette aide ?
Enfin, j’aimerais savoir où en est le développement des services des programmes européens Copernicus et Galileo. S’agissant de ce dernier, pouvez-vous me dire si son financement est bien confirmé, mais, surtout, ce qui est prévu pour que nos GPS actuels, configurés sur les satellites américains, puissent capter les signaux de notre constellation européenne ? L’avenir de la filière spatiale européenne dépendra en effet aussi de la capacité de l’Europe à développer ses propres services spatiaux.
Pour conclure, je remercie le groupe CRC d’avoir contribué à rappeler l’intérêt que porte le Sénat à cette filière essentielle en sollicitant l’organisation de ce débat.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens, moi aussi, à remercier le groupe CRC d’avoir demandé l’organisation de ce débat.
Mon intervention portera sur la contribution des territoires ruraux au développement de l’industrie aéronautique, et mon point de vue sera développé à partir des réalités de mon département, le Gers, dont quinze PME, employant 1 600 salariés, font, entre autres entreprises, partie de la chaîne des fournisseurs d’Airbus. Ils ont pour noms Latécoère, Lauak, Cousso, etc.
Ce constat, qui vaut non seulement pour le Gers, mais aussi pour d’autres départements de Midi-Pyrénées, permet de mesurer combien est importante la manière dont Airbus et l’aéronautique en général irriguent l’ensemble des territoires ruraux de cette région.
Cette situation est aussi emblématique des coopérations à caractère économique qui peuvent être instaurées entre la métropole et les territoires ruraux qui lui sont associés. Autrement dit, l’aéronautique démontre en Midi-Pyrénées, avec Airbus, que la dynamique industrielle localisée sur la métropole sert le développement économique, social et territorial du reste de la région.
Cette réalité procède d’une logique économique qui sert également l’industrie mère. Cela s’explique par plusieurs facteurs, que je veux ici évoquer.
Tout d’abord, du point de vue de l’entrepreneur, il y a de réels avantages comparatifs : le coût de l’immobilier d’entreprise est très sensiblement inférieur dans les départements ruraux à ce qu’il est en métropole ; la productivité du salariat est liée à la qualité de vie en milieu rural ; le turn-over des personnels est sensiblement inférieur à celui des entreprises de la métropole, ce qui entraîne une plus grande fidélisation et facilite le management.
Ensuite, du point de vue du salarié, on relève un coût de la vie en zone rurale très sensiblement inférieur à ce qu’il est en métropole et une qualité de vie n’ayant rien à envier à celle des métropolitains.
Tous ces éléments contribuent à la performance de la chaîne des fournisseurs et servent la compétitivité de l’ensemble de la filière.
À partir de ce constat, plusieurs questions doivent être posées et traitées. À quelles conditions peut-on garder ces entreprises sur ces territoires ruraux et les voir se développer encore davantage ? Quelles sont les conditions à remplir ou les processus à engager pour en accueillir d’autres, dans le contexte annoncé de forte croissance d’activité, estimée au niveau mondial à 5 % par an pendant les dix ans à venir ?
Sans prétendre à l’exhaustivité, je soumets à notre débat quelques pistes d’amélioration.
En ce qui concerne les entreprises elles-mêmes, il faut aider leur structuration, parfois leur rapprochement, pour les faire accéder à des tailles critiques suffisantes de type ETI, permettant de fiabiliser la production en qualité et en délais, d’accéder plus facilement au financement des stocks de matière première, du besoin en fonds de roulement, ou BFR – celui-ci augmente, on le sait, avec le volume des commandes – et des investissements de production.
Aujourd’hui, je le rappelle, l’investissement moyen par machine dans ce secteur d’activité est de l’ordre de 1, 3 million d’euros. Au passage, je me demande si notre pays n’est pas en train de prendre un retard préjudiciable dans le domaine de l’impression en trois dimensions, ou 3D, qui va constituer, en soi, une révolution technologique.
C’est dans les moments favorables du cycle économique – nous y sommes ! – que l’avenir se prépare. L’État stratège que nous appelons de nos vœux doit aussi faciliter l’accès au crédit bancaire des PME et des ETI sous-traitantes localisées en milieu rural.
En résumé, sur ce point, la question du financement de leur bas de bilan est aujourd’hui problématique dans la perspective des programmes A320 et A350 qui seront à honorer dans les années prochaines. C’est une réelle difficulté pour nos PME, et je souhaiterais que vous nous indiquiez, monsieur le secrétaire d’État, la position du Gouvernement.
En ce qui concerne les personnels, les pistes de progrès pourraient consister à renforcer l’attractivité de ces métiers pour les jeunes, à traiter l’accueil des stagiaires, qui pose, entre autres, la question de l’habitat, à adapter la formation aux techniques émergentes par la formation continue, notamment, comme par la voie de l’apprentissage qu’il faut développer jusqu’au plus haut niveau de qualification – on le sait, c’est un point faible de notre pays.
Pour conclure provisoirement sur ce thème, dans cette filière européenne, Airbus est une fierté et une chance pour la France, pour la métropole de la région Midi-Pyrénées, mais aussi pour ses territoires ruraux. Comme le dit à juste titre un responsable d’Airbus, « il ne faut pas voir les territoires ruraux comme des lieux de low cost, mais bien plutôt de best cost ».
Depuis de nombreuses décennies, la très forte productivité agricole affecte profondément la démographie des territoires ruraux, créant les difficultés que l’on sait pour maintenir les services publics, et la vie tout court, sur ces territoires. La sous-traitance aéronautique peut leur permettre d’opérer une transition vers le secteur industriel, créateur d’emplois et producteur de valeur ajoutée. Il ne s’agit pas de jouer l’un ou l’autre, l’industrie ou l’agriculture, mais bien entendu l’un avec l’autre, au bénéfice des deux et de tout le territoire, sans dégradation aucune de l’environnement et en concourant aux objectifs de transition énergétique et de croissance verte que notre pays s’est fixés.
À la lumière de l’expérience, gersoise par exemple, voyons l’avenir positivement ! La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République nous donnent le cadre institutionnel et les outils pour penser l’aménagement économique des territoires ruraux. L’élaboration prochaine des schémas régionaux de développement économique devra se faire avec tous nos partenaires industriels, Airbus en premier lieu, et les sous-traitants de nos territoires.
Aucune fatalité ne condamne les territoires ruraux à vivre de plus en plus, le temps passant, sous perfusion de métropoles qui concentrent toujours plus la croissance économique de notre pays ; Airbus et sa sous-traitance aéronautique en font la démonstration. Sachons donc, avec nos partenaires industriels, l’État et les collectivités locales, saisir les occasions de développement qui se présentent à nous !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce débat proposé par le groupe CRC sur « l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale française face à la concurrence » est tout à fait d’actualité.
Le Président de la République a d’ailleurs récemment déclaré : « L’industrie aéronautique appartient à une histoire, à une tradition. [...] Nous avons besoin en France de grandes filières industrielles et […] l’aéronautique en est une des plus brillantes. »
C’est particulièrement vrai en ce moment : l’industrie aéronautique et spatiale française est un pôle d’excellence dans de nombreux domaines. Elle est regroupée au sein du GIFAS, le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales, qui compte 348 entreprises, dont environ 300 équipementiers et sous-traitants, en majorité des PME.
Elle dispose d’acteurs de premier rang pour tous les types de produits aéronautiques, tels qu’Airbus pour les avions de transport, concurrent direct de Boeing ; Safran pour les réacteurs ; Thales pour les systèmes de navigation, comme les radars et les systèmes de contre-mesures électroniques ; Eurocopter pour les hélicoptères ; Dassault Aviation pour les avions d’affaires et militaires.
Ces entreprises s’appuient sur plusieurs centaines de sous-traitants, reconnus pour leurs savoir-faire indispensables et leurs excellents ingénieurs. Toutes ces activités donnent à la France une position dominante, qui se traduit par des exportations dans le monde entier, tout particulièrement en ce moment.
Dans le domaine des avions de transport, la société Airbus a porté son carnet de commandes à un niveau historique, et le chiffre d’affaires des avions Falcon se développe. Notre industrie aéronautique et spatiale a représenté plus de 50 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2014. Elle reste le premier contributeur de notre balance commerciale, avec 24 milliards d’euros d’excédents commerciaux, et cela va augmenter.
Le succès de notre industrie repose sur un partenariat solide avec l’État. Ce partenariat se traduit par la participation des acteurs de la filière aux travaux des comités de concertation entre l’État et l’industrie, tels que le Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, ou le COSPACE, son équivalent pour le secteur spatial. Il se traduit surtout par un co-investissement indispensable. Dans ce cadre, la filière compte sur les plans d’investissements d’avenir, les PIA, pour préparer les avions, les drones et les satellites du futur.
Le succès de cette industrie repose avant tout sur les 180 000 hommes et femmes de la filière, opérateurs qualifiés, techniciens et ingénieurs. Il faut agir pour maintenir le très haut niveau de qualité et d’excellence de ces personnels, facteur discriminant de la compétitivité future de cette industrie.
La France bénéficie d’excellentes écoles d’ingénieurs, comme l’École polytechnique, l’École nationale supérieure de l’aéronautique et de l’espace, l’École supérieure d’électricité ou l’École nationale supérieure d’arts et métiers, indispensables à leurs formations.
Les formations en alternance et l’apprentissage constituent également une excellente méthode d’enseignement des jeunes dans ces métiers. Il convient de les développer et d’encourager les entreprises à les accueillir, même si cela pose un problème.

Enfin, pour assurer la pérennité de ses activités, notre filière doit également rester mobilisée.
Ainsi, et pour faire face à la concurrence commerciale internationale particulièrement forte, notre industrie spatiale a convaincu l’ensemble de nos partenaires européens de choisir une nouvelle configuration pour le futur lanceur Ariane 6 et a décidé de créer un nouvel acteur industriel majeur, la joint-venture Airbus-Safran, dénommée ASL.
Ces efforts doivent bien évidemment être poursuivis, sinon notre industrie aéronautique et spatiale s’exposera au risque d’un déclassement, mais il faut surtout renforcer simultanément la compétitivité de nos entreprises.
Pour y parvenir, il faut répondre à plusieurs nécessités.
En premier lieu, il faut investir dans l’innovation, par un soutien continu à la recherche. Dans ce domaine, l’industrie aéronautique ne faiblit pas. Elle consacre 14 % de son chiffre d’affaires à la recherche et au développement.
En second lieu, il convient de mettre en place, pour l’industrie, une fiscalité incitative. Le crédit d’impôt recherche est un excellent exemple d’instrument d’incitation à la recherche, notamment dans les secteurs de l’aéronautique et du spatial. Il est indispensable de le préserver en l’état pour tous les acteurs, les grands groupes comme les PME.
En France, les bénéfices sont trop imposés, avec un taux à 33 %, alors que l’Angleterre est à 28 % et l’Irlande à 12, 5 %. Réduire directement l’impôt sur les bénéfices des entreprises permettrait de stimuler immédiatement la recherche par autofinancement pour préparer l’avenir, et pas seulement d’enrichir les actionnaires, mes chers collègues !
La mise en place de l’usine du futur, qui se prépare dès aujourd’hui, permettra également de réduire les temps et les coûts de développement et de fabrication, en anticipant toutes les contraintes industrielles – c’est ce que nous faisons déjà.
Il faut souligner que le numérique est l’instrument même de cette mutation. Il devient un facteur clef de la performance à chaque étape : de la conception – avec des systèmes de maquettes numériques déjà utilisées chez Boeing et Airbus, sous contrôle de Dassault Systèmes –, jusqu’à la relation client, pour accompagner les objets connectés et les nouvelles procédures d’enregistrement, en passant par la maintenance : le numérique est partout !
Enfin, je terminerai en rappelant que tous nos succès à l’exportation dépendent essentiellement de l’appui du Gouvernement. Dans ce domaine, les industriels français peuvent compter sur le soutien permanent du Président de la République, associé aux ministres Le Drian et Fabius, qui font ensemble un remarquable travail. C’est ce qui fait le succès actuel de ce secteur, et il faut le souligner, car rien ne se fait par hasard.

La mise en place d’une préférence communautaire, qui n’existe pas, serait indispensable pour développer nos ventes à l’étranger. Il est en effet absolument anormal que la Belgique, la Pologne, les Pays-Bas, la Suède ou d’autres choisissent des avions de combat américains pour s’équiper, alors que nous sommes sur le même terrain !
Je vous rappelle enfin, mes chers collègues, que le prochain salon international de l’aéronautique et de l’espace aura lieu du 15 au 21 juin prochain au Bourget. Si vous souhaitez y participer, je vous invite à prendre contact avec le responsable du GIFAS pour organiser votre visite. Si vous avez faim et si vous passez devant notre chalet, peut-être pourrons-nous vous accueillir pour le déjeuner !
Sourires. – Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je salue à mon tour l’initiative du groupe CRC.
La filière aéronautique est aujourd’hui l’une des industries les plus créatrices d’emplois et de richesses sur notre territoire. Pour la région Midi-Pyrénées, près de 100 000 emplois dépendent de son avenir. Cette formidable réussite est notamment le fruit d’un dialogue permanent mené depuis près de quarante ans, au sein du GIFAS, entre l’ensemble des entreprises de la filière et l’État.
L’État stratège a su, grâce à l’action de la direction générale de l’aviation civile, mener une politique industrielle pertinente et réactive. Récemment, grâce encore une fois à la mobilisation collective de la filière et à la feuille de route technologique du Conseil pour la recherche aéronautique civile, l’État, dans le cadre du premier plan d’investissement d’avenir, a su apporter les bons outils, au bon moment.
Cependant, aujourd’hui, une possible réduction du pilotage politique de soutien à la filière amène légitimement l’industrie aéronautique et les élus de la région Midi-Pyrénées à s’interroger. À l’heure où l’État fédéral américain accorde plus de 8 milliards de dollars d’avantages fiscaux au projet 777X, il reste plus que jamais vital pour nos industries qu’un pilotage politique solide de l’ensemble de la filière soit poursuivi.
J’évoquerai deux sujets pour illustrer mon propos : tout d’abord, l’engagement du deuxième programme d’investissements d’avenir, ou PIA 2, pour deux démonstrateurs technologiques supplémentaires ; ensuite, la confusion parfois entretenue entre la compétitivité d’Air France et les droits de trafic supplémentaires pour des compagnies aériennes non européennes ; ma collègue Françoise Laborde a déjà évoqué ce sujet.
J’en viens, en premier lieu, à l’engagement du PIA 2. La filière a défini, collectivement encore une fois, face à la montée des compétiteurs et aux efforts importants réalisés dans les autres pays européens, deux priorités absolues : un démonstrateur appelé SEFA, pour systèmes embarqués et fonctions avancées, qui vise à préparer et développer des fonctions et systèmes innovants pour les cockpits des aéronefs à venir, et une autre plateforme technologique appelée « usine aéronautique du futur ». Engageons les crédits prévus sans tarder !
Enfin, on doit encourager le groupe Airbus Industries à lancer de nouveaux programmes de développement afin de préparer l’avenir, tout en maintenant les capacités actuelles des bureaux d’études. Le lancement de l’A380 NEO et du nouveau Beluga va d’ailleurs dans ce sens.
Le second sujet est plus délicat. Le Gouvernement se mobilise, et c’est heureux, pour défendre notre compagnie nationale et l’accompagne dans la reconquête de sa compétitivité, face à la concurrence internationale, en particulier celle des compagnies des pays du Golfe. De ce point de vue, l’exonération des passagers en correspondance du paiement de la taxe de l’aviation civile est un premier pas significatif.
J’ai également bien entendu que la commissaire européenne, Mme Violeta Bulc, allait faire des propositions pour créer les conditions d’une concurrence loyale au niveau international.
Dans l’immédiat, force est de constater que, si le trafic a connu une augmentation de 6 % en 2014, cette augmentation n’a que marginalement profité à Air France. En effet, cette entreprise connaît une concurrence accrue et, pour la protéger, la tentation est grande de limiter l’accès des aéroports nationaux aux compagnies étrangères.
Pourtant, cette position semble intenable sur le long terme, tant pour Air France que pour l’ensemble de la filière aéronautique.
En effet, dans cette stratégie, notre compagnie nationale se voit alors privée, en vertu du principe de réciprocité, de nouveaux débouchés. Quant à l’ensemble de la filière, l’achat de nouveaux appareils est souvent conditionné, de façon plus ou moins explicite, à l’obtention de droits de trafic. Ces derniers contribuent, quant à eux, par l’intermédiaire du développement de nos plateformes aéroportuaires régionales, à l’attractivité tant économique que touristique de nos territoires.
Enfin, je souhaiterais conclure sur l’entretien et de la réparation des avions. Air France Industrie en est aujourd'hui, avec ses trois bases à Orly, Roissy et Toulouse, l’un des leaders européens. Pourtant, face à la concurrence internationale, il est nécessaire que son développement soit soutenu pour pérenniser ses emplois, ainsi que ses savoir-faire essentiels pour l’ensemble de la filière. Et là aussi, il appartient à l’État et à l’ensemble des acteurs de soutenir cette activité, afin d’éviter, notamment, la délocalisation vers des pays low cost.
Dans ce cadre, l’activité de Toulouse, qui ne porte ni sur l’entretien « moteur » ni sur les équipements, doit requérir l’attention de tous. On comprend mieux dès lors l’importance d’un stratège pour trouver le bon équilibre général, afin de pérenniser l’ensemble de ses activités.
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de l’attention que vous y portez et continuerez d’y porter dans les mois et années qui viennent !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et du RDSE.
Mme Françoise Cartron remplace M. Jean-Pierre Caffet au fauteuil de la présidence.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie le groupe CRC d’avoir pris l’initiative d’organiser ce débat sur l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence.
Ce sujet pouvait entraîner certains à dépasser le terrain industriel pour évoquer la concurrence elle-même, un débat que nous avons déjà eu. Vous voudrez donc m’excuser de ne pas embrasser l’ensemble des questions qui sont venues à l’esprit des orateurs et de m’en tenir au cœur du sujet d’aujourd'hui.
La filière aéronautique et spatiale est stratégique pour notre pays. Elle est un vecteur de souveraineté pour la France, avec un poids économique et social majeur. Elle a suscité en 2013 un chiffre d’affaires de 38 milliards d'euros, en forte croissance, et un excédent commercial de 23 milliards d'euros.
Ce secteur représente quelque 180 000 emplois directs hautement qualifiés et autant d’emplois indirects liés à cette industrie. Son dynamisme est remarquable : de 2006 à 2013, près de 100 000 embauches ont été réalisées, dont 15 000 par an ces dernières années. Quelque 84 % des recrutements sont en contrat à durée indéterminée.
Plus de 20 % des recrutements ont concerné des jeunes diplômés. Par ailleurs, un effort particulier a été réalisé en matière de formation en alternance, avec plus de 5 000 jeunes employés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation.
Je réponds sur ce point à M. Bockel, qui a légitimement souligné qu’un grand groupe industriel a signalé l’absence de réponse à ses 2 000 offres d’emplois de techniciens. Une situation quelque peu étonnante dans un pays qui connaît un tel chômage ! Je pense que la question de la gestion prévisionnelle de l’emploi doit naturellement être posée. C’est ce que nous ferons le 22 mai prochain, au cours d’une réunion du GIFAS et du CSFA aéronautique, que je copréside avec Emmanuel Macron. Nous aborderons alors ce sujet de la formation, que vous avez eu raison d’évoquer.
S’agissant tout d’abord de la construction aéronautique civile, la dynamique globale de création nette d’emplois devrait se poursuivre. En effet, selon le consensus des analystes, la croissance du trafic aérien mondial va continuer.
De cette augmentation du trafic aérien découlera un accroissement de la flotte, évaluée à environ 30 000 appareils sur cette période, qui profitera très majoritairement au duopole Airbus-Boeing, au moins jusqu’en 2030, compte tenu de la faible maturité de la concurrence émergente.
Pour la France, disposer sur son territoire de l’un des deux seuls acteurs mondiaux du secteur est une véritable chance. Servir le marché mondial permet de capter de manière directe et durable les effets de la croissance économique des zones les plus dynamiques pour en faire bénéficier des implantations industrielles situées sur notre territoire national.
Au-delà de cette conjoncture durablement favorable, la France peut être fière d’être le seul pays au monde, avec les États-Unis, à disposer sur son territoire d’une filière aéronautique complète, riche de très grands constructeurs comme Airbus ou Dassault, bien sûr, mais également d’un ensemble d’équipementiers et grands groupes, comme Zodiac, Safran ou Thales, pour ne citer que ceux-ci, ainsi que d’entreprises de taille intermédiaire et de PME, qui maîtrisent l’ensemble des compétences nécessaires à la définition et à la construction d’un aéronef.
L’aéronautique reste une industrie essentiellement technologique. Dans un avion, le moindre élément structural et la moindre fixation sont poussés à la limite de la technologie. L’exigence d’innovation y est totale, comme celle de qualité et de fiabilité des productions. C’est cette exigence technologique qui est aujourd'hui le meilleur remède aux tentatives de délocalisation. La France propose à toute sa filière, et particulièrement aux PME, l’accompagnement adapté leur permettant de progresser.
S’il convient de rester extrêmement vigilant sur les transferts d’activité, il faut souligner que certains d’entre eux répondent à une véritable logique stratégique. L’exemple du partenariat qu’Airbus a bâti avec la Chine montre à cet égard que des schémas véritablement « gagnant-gagnant » peuvent être bâtis avec des pays majeurs, représentant les principaux marchés de demain.
Grâce à sa coopération avec la Chine, notamment grâce à l’installation d’une chaîne d’assemblage d’A-320 à Tianjin, en 2008, la part de marché d’Airbus en Chine est rapidement passée de 25 % à 50 %, ce qui veut dire que 70 % des avions vendus en Chine ces dernières années ont été des Airbus. Airbus réalise désormais en Chine plus de 20 % de ses ventes totales – quelque 133 avions ont été livrés en 2013 en Chine, sur un total de 626 au niveau mondial.
L’industrie spatiale française, quant à elle, est au meilleur niveau européen et mondial grâce aux efforts consentis par l’État depuis les années soixante, ce soutien ne s’étant jamais démenti depuis lors. Notre industrie spatiale est forte des trois grands groupes que sont Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space et Safran, auxquels s’ajoute un tissu de PME et d’entreprises de taille intermédiaire.
La viabilité financière de l’ensemble repose sur un équilibre. La moitié de l’activité de l’industrie spatiale européenne provient des contrats avec des sociétés privées et de l’export.
Au contraire des États-Unis, le marché institutionnel national ou européen ne peut à lui seul assurer à la fois les développements nécessaires, le maintien des compétences clefs et les cadences de production indispensables au maintien des coûts et de la qualité. C’est vrai pour les lanceurs comme pour les systèmes orbitaux.
Dans l’ensemble de la filière aéronautique et spatiale, la décennie en cours doit voir le renouvellement de produits absolument stratégiques pour chacune des gammes des industriels français.
Ces programmes constitueront le moteur de l’activité de toute la filière aéronautique : Airbus A-350, Airbus A-320neo remotorisé, hélicoptères X4 et X6 pour Airbus Helicopters, moteur LEAP-X pour Snecma, évolution de la gamme Falcon de Dassault Aviation. Ces programmes jouent le rôle de locomotives, qui entraînent in fine la majeure partie de l’activité de la filière.
Concernant le spatial, les marchés à l’export sont indispensables à l’équilibre de l’ensemble du secteur européen, tant pour les lanceurs que pour les systèmes orbitaux.
La compétitivité de notre industrie sur la scène internationale est donc un enjeu central, à la fois pour l’existence même de cette industrie et pour la souveraineté de l’Europe dans ce domaine. Or la concurrence internationale a amorcé ces dernières années une très forte évolution, avec l’arrivée de nouveaux acteurs et de nouveaux modèles économiques.
Ces nouveaux acteurs, issus de l’économie numérique, sont SpaceX et des sociétés comme Google et Apple, qui disposent de capacités massives d’investissement du fait de niveaux de capitalisation et de trésorerie exceptionnels, très supérieurs au reste de l’industrie, ainsi que d’une culture de rupture dans les technologies et dans les modèles économiques.
Ils commencent aujourd'hui à investir dans les services de lancement, de communication internet par satellite, d’observation de la Terre avec des projets qui se démarquent fortement par rapport à l’existant – simplification radicale du lanceur pour SpaceX, constellation d’un millier de petits satellites pour Google-SpaceX et OneWeb-Virgin. Ils ont le soutien de la NASA et de la défense américaine.
Face à cette forte rupture contextuelle, le maintien du statu quo dans le modèle national conduirait rapidement notre industrie à s’étioler, puis à disparaître.
Nous devons rester à la pointe de l’innovation dans les satellites. Dans le domaine des télécoms, le PIA a permis de développer très rapidement de nouvelles plateformes de satellites à propulsion électrique, qui remportent déjà des succès à l’export.
En observation de la Terre à haute et très haute résolution, les développements entrepris depuis des années, grâce aux financements de la défense et du CNES, ont permis à notre industrie d’emporter des marchés très compétitifs aux Émirats Arabes Unis, par exemple.
S’agissant des lanceurs, il est nécessaire de faire évoluer la fusée Ariane elle-même pour l’adapter au marché et la rendre plus compétitive, mais aussi le modèle industriel et de gouvernance, afin de diminuer les coûts de production et gagner en réactivité.
Ariane 5 est un lanceur d’une fiabilité inégalée, mais d’une grande complexité technologique et limité au lancement double. L’enjeu est donc de le simplifier et d’augmenter sa flexibilité.
Après concertation entre les acteurs, le choix d’une nouvelle configuration pour Ariane 6, validé lors de la réunion ministérielle de Luxembourg, s’est porté sur un concept flexible comprenant deux versions à deux ou quatre boosters. Cette configuration répond aux besoins de lancement et permet une diminution du coût de production, tout en préservant l’essentiel des acquis industriels en France, en Italie et en Allemagne.
Le modèle industriel et la gouvernance d’Ariane sont aujourd’hui handicapés par un éclatement des sites de production et par une très longue chaîne d’approvisionnement et d’intégration. De plus, la forte imbrication des centres de décision et des responsabilités entre acteurs étatiques – ESA et CNES –, industriels de production et Arianespace ajoute de la lourdeur au processus.
L’évolution de la filière doit donc être double : tout d’abord, la création de la joint-venture Airbus Safran Launchers, ASL, annoncée en juin 2014, supprimera de nombreuses interfaces et permettra des synergies industrielles. Ensuite, la clarification des relations entre acteurs institutionnels et industrie pour le développement d’Ariane 6, avec les agences clairement positionnées en maîtrise d’ouvrage et les industriels en maîtrise d’œuvre, doit assurer une plus grande réactivité dans les développements. Elle permet aussi un meilleur levier sur la capacité d’investissement privé : ASL investira dans le développement d’Ariane 6, à l’inverse de ce qui s’est passé pour les précédents lanceurs.
Cette évolution des relations entre acteurs de la filière est une décision de l’ensemble des États membres de l’ESA, qui ont adopté une résolution en ce sens en décembre 2014.
C’est une évolution réelle, mais il ne s’agit ni d’un désengagement des États – ceux-ci investissent ensemble quelque 4 milliards d'euros pour ce nouveau lanceur – ni d’un affaiblissement du rôle des agences ou du contrôle des fonds publics : l’ESA, en s’appuyant sur le CNES, assurera la maîtrise d’ouvrage et le contrôle du programme.
Les paiements se feront par ailleurs à livraison et non plus sur développement, comme c’était le cas jusqu’à présent. Il ne s’agit pas non plus d’une remise en cause de l’importance d’Arianespace pour assurer la commercialisation d’Ariane et l’équité de traitement entre ses différents clients – c’est un rôle que nul, ni l’État ni ASL, n’a intérêt à minimiser.
Nous devons nous appuyer sur nos atouts pour être plus réactifs et plus forts encore demain : l’enjeu est majeur pour l’avenir de la filière, compte tenu des prix pratiqués par son concurrent, SpaceX. Bien sûr, ce dernier bénéficie d’aides massives du gouvernement américain. Toutefois, cette société a aussi su innover en faisant porter son effort sur la réduction des coûts de production, et elle continue de le faire en tentant de réutiliser les premiers étages des engins.
En ce qui concerne les lanceurs réutilisables, la réflexion est en cours au CNES, à l’ESA et dans l’industrie spatiale en France et en Europe.
Dans le passé, aucun lanceur réutilisable n’a été un succès technique et économique : la navette en est un exemple. Il apparaît, d’ores et déjà, que la piste d’un système de lancement totalement réutilisable n’est pas la bonne. En revanche, la question reste ouverte pour le premier étage.
Les efforts actuels de SpaceX sont suivis de près, et des études sont menées au CNES et chez Airbus Defence and Space sur un concept original de premier étage réutilisable.
J’en viens aux dirigeables. L’étude d’applications nouvelles pour les dirigeables fait l’objet, comme d’ailleurs les drones, d’un projet dans le cadre de la Nouvelle France industrielle. Ce plan est conduit par le pôle de compétitivité Pégase en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Deux projets sont engagés : le premier pour transporter des charges lourdes, jusqu’à soixante tonnes, le second pour développer un dirigeable stratosphérique dans le cadre de missions civiles et militaires de télécommunications et d’observation, en complément des satellites.
S’agissant de l’hélium, utilisé pour pressuriser les étages des lanceurs, on peut convenir qu’il est un gaz rare, certes, mais pas encore au point de constituer un problème d’approvisionnement pour la filière Ariane à court ou moyen terme.
Économiquement, l’hélium est un produit annexe de l’extraction du gaz naturel. À titre d’exemple, il existe au Qatar une usine qui produit 10 tonnes d’hélium par jour. Un lanceur Ariane en consomme 145 kilogrammes. Autrement dit, l’ordre de grandeur de la consommation annuelle est la tonne, soit 10 % de la production quotidienne de l’usine qatarie.
L’État est pleinement conscient que l’industrie aéronautique et spatiale réalise des investissements considérables dans le domaine de la recherche et développement. L’effort réalisé dépasse 15 % du chiffre d’affaires pour les entreprises aéronautiques, ce qui est extrêmement élevé. Il est fait, par ailleurs, sur des cycles très longs, car le point de rentabilité financière de certains programmes peut n’intervenir que vingt à vingt-cinq ans après les premiers investissements.
Ce contexte spécifique de l’innovation rend absolument nécessaire l’intervention publique pour compléter l’investissement industriel.
C’est d’autant plus indispensable que, dans le même temps, la concurrence se renforce. L’octroi récent à Boeing par l’État de Washington de la plus large exemption fiscale de l’histoire des États-Unis montre toute la volonté de ce pays d’aider massivement son industrie. La Chine, la Russie et, à un degré moindre, le Canada et le Brésil, pays émergents dans le domaine des avions de plus de cent places, subventionnent leur industrie de manière similaire.
Le système de soutien français repose en premier lieu sur des aides sectorielles à la recherche et développement. La filière aéronautique, particulièrement structurée, dispose, pour construire son dialogue avec les pouvoirs publics et bâtir ses projets, du Conseil pour la recherche aéronautique civile, le CORAC, que je préside personnellement.
Un comité de concertation État-Industrie pour le spatial, le COSPACE, a aussi été mis en place à la fin de 2013 par la ministre chargée de l’espace, Mme Fioraso, avec les ministres de la défense et de l’industrie. À l’instar du CORAC, ce comité rassemble les acteurs publics et privés du secteur pour partager une vision commune sur les grands enjeux. La création du COSPACE était d’ailleurs une recommandation du rapport de Mme Procaccia et de M. Sido.
En maintenant depuis 2012 en valeur, malgré le contexte de maîtrise budgétaire, la capacité d’intervention financière propre de la DGAC, la Direction générale de l'aviation civile, et en mettant en place des actions dédiées à l’aéronautique dans les deux programmes d’investissement d’avenir, ou PIA, le Gouvernement a décidé d’augmenter le soutien global au secteur. L’action aéronautique des PIA a été dotée d’un total de 2, 9 milliards d’euros depuis 2010.
Cet effort permet un soutien déterminant aux projets de recherche du CORAC : très concrètement, le lancement du long courrier A-350 d’Airbus ou des hélicoptères X4 et X6 d’Airbus Helicopters. Il s’agit aussi, à plus long terme, de concevoir les aéronefs des futures générations, plus silencieux et plus économes en carburant, de développer de nouvelles méthodes de production et d’assemblage dans les usines et d’inventer de nouveaux systèmes de pilotage, qui permettront, à terme, aux compagnies aériennes d’accroître les capacités opérationnelles de leurs avions.
Je précise, puisque M. Courteau m’a posé la question pour le compte de M. Labazée, que l’installation d’Hydro-Québec sur le site de Lacq n’est pas directement liée à l’imposition forfaitaire annuelle, l’IFA, mais celle-ci crée les conditions d’un partenariat. C’est en tout cas ainsi qu’elle est reçue par les industriels.
L’État, au travers des subventions qui transitent par le CNES, l’ESA et la DGA, consacre aussi des sommes importantes à la recherche spatiale, au développement et à la production de nouveaux produits à vocation commerciale, scientifique ou de défense, ou encore au soutien à l’exploitation.
C’est ainsi que sont nés les lanceurs de la famille Ariane, les satellites de télécommunications modernisés – notamment ceux à propulsion électrique, grâce à l’un des 34 plans de la Nouvelle France industrielle, doté de 50 millions d’euros – et les satellites d’observation de la terre, qui remportent aussi de nombreux succès à l’export et sont indispensables à notre défense.
Cet effort de l’État dans le domaine spatial avoisine les 2 milliards d’euros chaque année et n’a pas faibli malgré nos contraintes financières.
Le soutien du Gouvernement, tant financier que politique, prend d’autres formes, notamment au travers des pôles de compétitivité, dont l’action est essentielle pour le transfert des recherches du secteur public à la filière industrielle et à ses petites et moyennes entreprises. La France dispose également d’incitations fiscales à l’innovation, au premier rang desquels figure le crédit d’impôt recherche, le CIR.
Avant de conclure, je tiens à retourner à M. Dassault les remerciements qu’il a adressés au Gouvernement, et que je transmettrai aux ministres concernés, MM. Fabius et Le Drian. Je le remercie, également de son invitation collective au Salon du Bourget !
Sourires.
La France a un partenariat ancien et profond avec son industrie aéronautique et spatiale. Elle dispose d’une batterie complète d’outils publics et d’actions politiques pour développer ce partenariat et conforter son rang de deuxième puissance aéronautique et spatiale mondiale et de premier État aéronautique européen.
Applaudissements.

Nous en avons terminé avec le débat sur l’avenir industriel de la filière aéronautique et spatiale face à la concurrence.

J’informe le Sénat que le groupe UDI-UC a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu’il propose pour siéger à la commission des finances et à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Ces candidatures ont été publiées et les nominations auront lieu conformément à l’article 8 du règlement.

L’ordre du jour appelle la discussion de la question orale avec débat n° 10 de M. Joël Labbé à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les risques inhérents à l’exploitation de l’huître triploïde.
La parole est à M. Joël Labbé, auteur de la question.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au nom du groupe écologiste, j’ai souhaité la tenue au sein de notre assemblée de ce débat concernant la crise de notre secteur ostréicole et les mutations de cette filière au cours des vingt dernières années, notamment du fait de l’arrivée des biotechnologies.
Je suis vraiment heureux que ce débat puisse avoir lieu aujourd’hui sur ce sujet très sensible du point de vue tant socio-économique qu’environnemental.
La crise de ce secteur n’est pas nouvelle, et il est aujourd’hui grand temps que l’on y apporte des réponses politiques. Rappelons que la production ostréicole française constitue de loin la première production communautaire – plus de 90 % de ladite production – et la quatrième au niveau mondial.
Nous avons eu, le 11 septembre 2013, un premier débat en séance lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, à la suite d’un amendement que j’avais déposé au nom du groupe écologiste et qui visait à étiqueter les huîtres en fonction de leur origine, qu’elles soient naturelles, nées en mer ou triploïdes. Les échanges avaient duré près d’une heure, bien après minuit !
Cet amendement n’avait pas été adopté, au motif du respect de la réglementation européenne en vigueur, mais il avait permis l’amorce d’un premier vrai débat sur la question. Je vous avais alors annoncé que je « remettrai le couvert » dès que possible. Depuis lors, la situation s’est encore dégradée, au point de devenir très préoccupante pour l’ensemble de la profession, mais aussi pour le milieu naturel.
L’huître, être vivant mystérieux et fermé, constitue un véritable mets d’exception apprécié par l’homme depuis des milliers d’années.

M. Joël Labbé. Elle a même l’extraordinaire faculté, dans les mers chaudes, de produire des pierres, ces précieuses perles de nacre que les Grecs appelaient « les larmes d’Aphrodite ».
Exclamations admiratives.

Au fil des siècles, la culture de l’huître n’a cessé de s’améliorer, grâce au savoir-faire et au sens de l’observation de générations d’ostréiculteurs, véritables paysans de la mer. Diverses techniques ont été éprouvées au fil des temps : élevage sur table, en poches, à plat sur le sol de l’estran, ou en eau profonde.
Coquillage filtreur, microphage et omnivore, l’huître joue un rôle essentiel sur le littoral. Elle pompe l’eau de mer afin d’en capter les particules nécessaires à son alimentation et l’oxygène pour sa respiration. Elle se nourrit de microalgues, d’organismes microscopiques et aussi de débris divers : un milieu sain et équilibré lui est nécessaire.
Véritable miroir de la biodiversité, sentinelle de l’environnement littoral, l’huître reflète l’état des écosystèmes marins.
La saison de reproduction s’étend de juin à septembre. Pendant cette période, les huîtres sont « laiteuses ». Cet aspect laiteux de l’huître naturelle lui confère un goût particulier et une texture différente de celle qui est la sienne durant les autres périodes de l’année. Les consommateurs avertis privilégient ainsi les fameux mois « en r » pour leur dégustation.
Depuis toujours, l’huître naît en mer et, par une opération de captage, les ostréiculteurs récupèrent le naissain constitué de larves issues de la reproduction des huîtres adultes dans le milieu naturel, afin d’en assurer la culture.
Entre la naissance d’une huître naturelle et le moment où elle peut être consommée, il s’écoule au moins trois ans, trois années de culture et de soins apportés par les ostréiculteurs, qui lui donneront sa chair épaisse et son goût particulier en fonction du terroir.
Organisme vivant particulièrement fragile, l’huître a connu des épizooties régulières. En 1920 et 1921, l’huître plate a été décimée. En 1972 et 1973, ce fut le tour de l’huître creuse, dite « portugaise », remplacée par l’huître creuse « japonaise », la crassostrea gigas, cultivée encore aujourd’hui en France et partout dans le monde.
En termes de génétique, l’huître est naturellement diploïde : elle possède dix lots de deux chromosomes, tout comme les humains et la plupart des êtres vivants.
Depuis le début des années deux mille, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, l’IFREMER, a mis au point et développé la production d’huîtres dites « triploïdes », dans l’intention de rendre la production plus intensive. La particularité de ces huîtres tient à une modification en laboratoire de leur nombre de chromosomes, lequel est passé de dix lots de deux chromosomes à dix lots de trois chromosomes.
Pour l’IFREMER, cette innovation est passée par le rachat d’un brevet américain en 2004, le brevet Rutgers, puis par le dépôt d’un nouveau brevet en nom propre en 2008. Différentes méthodes furent alors expérimentées au fil des années, fondées sur des chocs chimiques et thermiques permettant d’obtenir une huître censée être stérile, donc non laiteuse.
Le procédé retenu par l’IFREMER depuis 2008, et qui prédomine aujourd’hui, consiste à développer des « super-géniteurs », des tétraploïdes, dotés de dix lots de quatre chromosomes, dont les services sont vendus aux écloseries, lesquelles les croisent avec des huîtres diploïdes, afin d’obtenir cette fameuse huître triploïde.
Au-delà de cette différence chromosomique par rapport aux huîtres nées en mer, les huîtres triploïdes sont donc exclusivement produites en écloserie.
D’emblée, ces innovations avaient de quoi séduire la profession. En évitant à l’huître son cycle de reproduction, on empêche sa période de laitance, pendant laquelle elle est moins attractive pour le consommateur. Cela permet de commercialiser un produit standardisé toute l’année, notamment lors de la saison touristique.
Rapidement nommée « huître des quatre saisons » pour séduire le consommateur, l’huître triploïde a envahi les étals. Les professionnels y ont vu un moyen d’augmenter leurs débouchés et de lisser les coûts par l’étalement des ventes sur l’année.
L’huître triploïde présente également l’avantage de grossir plus vite, puisqu’elle ne perd pas son énergie à se reproduire. Sa période de production est donc réduite de trois à deux ans – ce n’est pas rien ! –, ce qui la rend très concurrentielle par rapport à l’huître née en mer.
Le scénario industriel était idéal : une huître qui pousse en deux ans au lieu de trois, qui peut être consommée toute l’année... La profession, dans sa grande majorité, s’y est engouffrée. Croissance et compétitivité étaient au rendez-vous avec ce pur produit de la recherche biotechnologique et de l’innovation.
Aujourd’hui, l’heure est plutôt au désenchantement. La filière conchylicole traverse une crise majeure qui perdure depuis plusieurs années et qui menace la survie de nombreuses entreprises ostréicoles.
Depuis 2008, des surmortalités du naissain et des huîtres juvéniles affectent les stocks d’huîtres creuses de l’ensemble des bassins de production en France. Elles ont déjà provoqué une baisse de plus de 40 % du tonnage français.
Ces mortalités continuent de sévir et ne sont pas circonscrites. Cette hécatombe est largement imputable à un variant de l’herpès virus de l’huître, appelé OsHV-1, qui n’a cessé de se développer. Elle coïncide, comme le font remarquer certains scientifiques, avec l’introduction massive des triploïdes dans le milieu...
Les huîtres adultes sont elles aussi touchées par une bactérie au nom barbare – vibrio aestuarianus –, identifiée par les scientifiques. Les mortalités ont un impact sur les stocks marchands, en particulier ceux d’huîtres triploïdes. Celles-ci, extrêmement fragiles, supportent mal les opérations d’élevage ou d’expédition et sont particulièrement vulnérables aux agressions bactériennes.
Un comble : les « huîtres des quatre saisons » meurent au moment où le marché estival les attend. Le taux de mortalité est passé de 10 % au départ à 25 % en 2012, pour atteindre jusqu’à 80 % selon les bassins en 2013.

La crise entamée en 2008 se poursuit selon un scénario encore plus catastrophique, laissant la filière dans une impasse. Dans le département du Morbihan – dont vous êtes également les élus, chers Odette Herviaux et Michel Le Scouarnec –, premier département français en termes de surfaces concédées, 40 entreprises ont mis la clef sous la porte depuis 2006.
Face aux surmortalités des juvéniles, la profession n’a eu d’autre choix que d’intensifier encore la production : multiplication des collecteurs de naissains, multiplication du naissain d’écloserie, mise en élevage de lots de plus en plus nombreux d’huîtres triploïdes, surcharge des parcs. On aboutit actuellement à une surproduction – un paradoxe ! –, pourtant bien inférieure à la production d’avant 2008, et donc à une baisse dramatique des cours, qui sont soumis aux diktats de la grande distribution.
Nous assistons notamment à un engorgement des stocks d’huîtres de gros calibre, qui sont difficilement commercialisables, et déséquilibrent le marché, principalement en raison des huîtres triploïdes non vendues pendant l’été.
Au-delà des problèmes de production et de commercialisation, les ostréiculteurs deviennent de plus en plus dépendants des écloseries, à l’image des agriculteurs au regard des semenciers. La production de triploïdes relève bien de cette logique de privatisation du vivant, maintes fois abordée dans cet hémicycle.
Quant aux ostréiculteurs ayant choisi de poursuivre la culture de l’huître traditionnelle – il y en a ! –, s’ils sont moins affectés par la crise des mortalités, ils subissent à la fois la concurrence déloyale due à la commercialisation plus rapide des huîtres triploïdes et l’effondrement des cours.
D’un point de vue purement socio-économique, nous voyons bien que la profession paie aujourd’hui un lourd tribut à cette révolution biotechnologique, dont les conséquences n’ont pas été anticipées ou ont été pour le moins sous-évaluées.
J’en viens aux conséquences environnementales de l’exploitation des huîtres triploïdes. Celles-ci devraient retenir toute notre attention à quelques semaines de l’examen dans notre hémicycle du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Les huîtres triploïdes ne sont pas des OGM, des organismes génétiquement modifiés : ce sont des OVM, des organismes vivants modifiés.
Jean-Patrick Le Duc, délégué aux relations internationales du Muséum national d’histoire naturelle, s’exprimait en ces termes dans une interview accordée à l’hebdomadaire Le Point en 2012 : « Aujourd’hui, [les OVM] ne sont pas assez évalués ni encadrés alors que l’on n’a aucun recul. Les cas des huîtres triploïdes ou du saumon transgénique [...] sont emblématiques : on les a introduits massivement au risque de déséquilibrer complètement les écosystèmes, sans appliquer le principe de précaution. [...] l’huître triploïde constitue un danger pour la biodiversité et l’hécatombe ostréicole qui sévit depuis 2008 pose la question de la fragilité de ces organismes modifiés. » Tout est dit, ou presque...
La généralisation de ces mollusques stériles entraîne un risque non négligeable d’affaiblissement du patrimoine génétique des huîtres et ainsi de leur résistance aux bactéries et aux virus, du fait des sélections intensives qui sont réalisées.
Quant aux risques de contamination du milieu, ils ont longtemps été occultés, mais ils sont réels. Les huîtres triploïdes sont en théorie stériles. En pratique, qu’en est-il ? La fertilité des triploïdes de seconde génération, huîtres issues du croisement entre des géniteurs tétraploïdes mâles et des femelles diploïdes, a tout de même été estimée à 13, 4 % par l’IFREMER !
Face à l’inquiétude grandissante de la profession sur ces questions, l’État a désigné en 2009 un groupe d’experts pour examiner cette question de l’impact écologique. Dans son rapport, M. Chevassus-au-Louis relativisait le risque, mais appelait à la biovigilance.
Qu’en est-il aujourd’hui de cette biovigilance ? Les conditions de sécurité sont-elles optimales ? Un contrôle efficace et rigoureux est-il réalisé à chaque rouage de la filière ? Autant de questions que l’on doit se poser !
J’aborderai très rapidement la question de l’usage des antibiotiques. Un reportage récemment diffusé sur France 5 révèle que les antibiotiques sont encore utilisés par les écloseries, dans un manque total de transparence vis-à-vis des ostréiculteurs.

Là encore, quels sont les incidences sur le milieu ? Quels contrôles sont-ils opérés ?
Nous voyons bien que le manque de transparence sur le sujet, l’omnipotence de l’IFREMER
M. Roland Courteau s’exclame.

Je conclurai mon propos en évoquant la question de l’information du consommateur. Celui-ci est en droit de savoir d’où proviennent les huîtres qu’il déguste. À l’heure où la transparence est de rigueur, il n’existe aucun cadre réglementaire quant à la traçabilité sur l’origine et le mode de production des huîtres.
L’huître triploïde échappe à la réglementation des OGM. Elle n’est pas non plus considérée comme un « nouveau produit alimentaire » par l’Union européenne. Aucun étiquetage spécifique ne lui est donc imposé.
Pourtant, au début des années deux mille, le Comité national de la conchyliculture ainsi que les fédérations de consommateurs avaient émis le souhait que l’huître triploïde soit clairement identifiée à tous les stades de la filière, de manière que la traçabilité du produit soit totale : élevage, expédition, vente au consommateur. Le Conseil national de la consommation avait approuvé au mois de décembre 2002 le principe de l’étiquetage, transmettant le dossier au ministère du budget pour rédaction et publication du décret rendant obligatoire la mention « huîtres triploïdes » sur les bourriches. C’était aussi simple que cela. Pourtant, ce projet de décret n’a jamais abouti...
Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je reviendrai tout à l’heure sur la problématique de l’étiquetage au moment de clore ce débat. Pour l’heure, je me réjouis d’entendre les différentes prises de position qui s’exprimeront et je précise que Marie-Christine Blandin interviendra au nom du groupe écologiste.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Je demande à tous les orateurs de respecter, à l’instar de M. Joël Labbé, le temps de parole qui leur est imparti.
La parole est à M. Daniel Laurent.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, depuis plusieurs années, les ostréiculteurs de mon département de la Charente-Maritime, où se trouve le bassin de Marennes-Oléron, l’un des plus grands centres d’élevage d’huîtres en France, doivent faire face à une hausse sans précédent de la mortalité des huîtres. Comme vient de le rappeler Joël Labbé, cette situation met en péril de nombreuses entreprises, c'est-à-dire tout un pan de cette économie.
J’associe à cette intervention ma collègue de Gironde, Marie-Hélène Des Esgaulx, qui ne peut être parmi nous aujourd’hui, mais qui suit bien évidemment avec une vigilance accrue la problématique du bassin d’Arcachon.
En préambule, je tiens à souligner le rôle que joue notre conseil départemental de la Charente-Maritime pour soutenir les secteurs et les filières en difficulté, telles l’ostréiculture ou la mytiliculture également durement touchée.
Le département de la Charente-Maritime a ainsi adopté un programme exceptionnel d’aides et de soutien au profit des ostréiculteurs et des mytiliculteurs touchés par la mortalité importante des huîtres et des moules. Il s’agit notamment d’exonérer les professionnels du paiement des redevances d’occupation temporaire du domaine public portuaire.
C’est donc dans un contexte de crise majeure que s’inscrit la question des huîtres triploïdes.
Les huîtres triploïdes ont été créées par manipulation biologique par l’IFREMER, qui a contribué à son lancement dans les années deux mille. Elles contiennent trois chromosomes, au lieu de deux pour les diploïdes, qui les empêchent de se reproduire, mais diminuent leur cycle d’une année. Il importe de préciser que les huîtres triploïdes ne sont pas des OGM, puisque leur patrimoine génétique n’est pas affecté. Elles sont obtenues par un croisement avec des souches d’ADN de diploïdes.
En 2007, un brevet dénommé « Obtention de mollusques bivalves tétraploïdes à partir de géniteurs diploïdes » a été déposé par l’IFREMER. Aujourd’hui, la grande majorité des ostréiculteurs élèvent ou achètent de l’huître triploïde.
Que les huîtres soient nées en mer et en écloserie, des interrogations demeurent en matière de traçabilité, d’information du consommateur ou d’impact environnemental.
Au début de l’année 2015, le Comité national de la conchyliculture a décidé de relancer la réflexion collective sur l’opportunité de procéder à un étiquetage des huîtres en fonction de leur nature : captage en mer, issues d’écloseries, triploïdes, etc. Les sept comités régionaux de la conchyliculture ont été sollicités pour organiser à l’échelon de chaque bassin de production un débat sur cette question. Les assemblées plénières de conseils de comités régionaux de Poitou-Charentes, d’Arcachon et de la Méditerranée se sont réunies voilà quelques mois et les quatre autres comités doivent faire de même, si ce n’est déjà le cas.
Force est de reconnaître que, pour l’heure, aucune position n’est arrêtée par l’interprofession. Toutefois, il ressort des premiers débats qu’un consensus se dégage sur la nécessité de donner aux ostréiculteurs qui pratiquent le captage en mer toute possibilité et liberté de valoriser cette pratique auprès des consommateurs par un étiquetage spécifique.
Pour le reste, il convient d’attendre la fin de la consultation en cours pour avoir une idée plus précise des orientations définitives souhaitées par la profession. Monsieur le secrétaire d'État, quelle est la position du Gouvernement sur l’organisation de ces filières, sur la question de l’étiquetage des huîtres selon leur nature qui permettra au consommateur de connaître l’origine de ces productions ?
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France est au premier rang des pays producteurs d’huîtres en Europe et au quatrième rang à l’échelle mondiale. Toutefois, de nombreux indicateurs, comme la baisse de 17 % du nombre de conchyliculteurs en Bretagne Sud entre 2007 et 2010, attestent les fragilités structurelles de la filière, comme le rappellera tout à l’heure mon collègue Yannick Vaugrenard.
Pour ma part, j’ai toujours été particulièrement attentive à l’exploitation écoresponsable de nos ressources et de nos écosystèmes marins. Aussi me paraît-il indispensable de veiller scrupuleusement à nous prémunir contre toutes les caricatures, les facilités de langage et les approches manichéennes qui contribuent à diviser notre société. À cet égard, je remercie notre collègue Joël Labbé de nous avoir parfaitement éclairé sur ce que sont et ce que deviennent les huîtres triploïdes.

Cette huître ne se trouve pas à l’état naturel dans le milieu. Elle est obtenue par un croisement naturel entre un individu diploïde et un individu tétraploïde. Ses gènes ne sont donc pas modifiés. De nombreux aliments que nous consommons régulièrement possèdent eux aussi plusieurs génomes de base.
Concernant les risques de contamination de l’environnement, je souhaite revenir sur quelques réalités scientifiquement reconnues.
La triploïdie perturbant fortement la formation des cellules sexuelles, elle entraîne une réduction de la fertilité. Et s’il est attesté depuis plusieurs années que les huîtres triploïdes peuvent parfois produire des gamètes en très faible quantité, rien ne permet à ce jour d’établir une reproduction dans le milieu naturel, comme l’a indiqué Bernard Chevassus-au-Louis dans son rapport en mai 2009.
Ces éléments viennent confirmer les conclusions du précédent rapport de M. Chevassus-au-Louis daté de 1998 et sont de nature à rassurer les plus sceptiques. Il considérait à l’époque qu’un échappement accidentel, même massif, serait insuffisant pour entraîner l’éventuel développement d’une population de tétraploïdes et que la mise en place d’une biovigilance était suffisante pour le détecter et mettre fin si nécessaire à l’utilisation de tétraploïdes par les écloseries.
De surcroît, les quelques centaines de reproducteurs tétraploïdes fournis par l’IFREMER aux écloseries sont anecdotiques par rapport au stock de reproducteurs diploïdes présent dans les bassins de production.
Les recherches qui y ont été effectuées ont toujours montré l’absence de reproduction de l’huître triploïde et d’individus triploïdes ou tétraploïdes dans le milieu naturel. À cet égard, le rapport du réseau Biovigilance réalisé à la suite de la campagne scientifique de 2012 visant à mesurer le niveau de ploïdie des naissains d’huîtres creuses captés dans les pertuis charentais, le bassin d’Arcachon et la baie de Bourgneuf confirme que, comme pour les autres années, « les analyses ne mettent pas en évidence la présence d’animaux polyploïdes, triploïdes, et a fortiori tétraploïdes, dans les naissains issus du captage naturel ».
Le bon sens commanderait peut-être de ne consommer que des produits de saison, mais il serait vain de vouloir empêcher nos concitoyens, qui en général n’aiment pas les huîtres dites « grasses », de déguster des huîtres toute l’année. Préférons-nous donc importer plus de produits étrangers ou maintenir des activités productives et des emplois sur nos façades littorales ? Cette question ne peut être balayée d’un revers de la main. Pour rappel, les importations d’huîtres ont enregistré une progression croissante de 168 % entre 2006 et 2010.
Pour autant, et je suis d’accord avec ce qui a été dit tout à l’heure, il serait dangereux d’ignorer les attentes citoyennes en matière de traçabilité, ainsi que les exigences des consommateurs sur la provenance et la qualité des produits alimentaires qu’ils consomment.
Il n’est ainsi pas compréhensible qu’il ait fallu attendre 2010 pour contrôler les écloseries afin de prévenir la diffusion des agents pathogènes. Cependant, il est bon de rappeler que l’IFREMER n’avait pas en charge la politique des écloseries, ni celle du contrôle sanitaire, et encore moins le pouvoir de contrôler les politiques de vente de naissains, même si le rapport d’expertise judiciaire d’avril 2014 de Jean-Dominique Puyt pointe de sa part des « défauts de surveillance, de prophylaxie sanitaire et d’informations apportées à la profession ostréicole ». L’évaluation de l’IFREMER par l’AERES, l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, en août 2009 a également mis en lumière un défaut de travaux dans le domaine de l’épidémiologie, notamment en ce qui concerne les infections virales herpétiques.
J’ai souvent tiré la sonnette d’alarme, monsieur le secrétaire d’État, en particulier lors des débats budgétaires, sur les moyens et la stratégie de l’État en matière de connaissance des milieux marins et de prévention des risques. Ces constats inquiétants doivent conduire à revoir les priorités et à allouer les ressources nécessaires au bon fonctionnement de services essentiels pour l’emploi et pour l’environnement. Une forme de transparence devra aussi être trouvée sur les transferts interbassins et interzones afin de faciliter à l’avenir l’identification rapide de tout nouvel agent pathogène. J’en veux pour preuve l’article paru dans le dernier numéro de l’hebdomadaire Le Marin.
Nous devons apporter des réponses concrètes à ces problèmes, car l’ostréiculture demeure extrêmement vulnérable face à l’émergence de pathogènes nouveaux.
Comme d’autres, M. Chevassus-au-Louis rappelle ainsi l’étroite corrélation « entre les paramètres climatiques endurés par les huîtres au cours de l’hiver de l’année n-1 et les mortalités subies à l’année n », des évolutions auxquelles il faut associer l’acidification des océans. La richesse trophique des milieux et la reconquête de la qualité des eaux demeurent aussi une exigence et une urgence de premier ordre, tant les pollutions chimiques ou microbiologiques favoriseraient l’hypodiploïdie.
Il nous faut aussi favoriser la pérennité des exploitations et encourager les signes de qualité, dont les avantages comparatifs doivent faire l’objet d’une communication spécifique et d’une pédagogie appropriée.
Monsieur le secrétaire d’État, je crois beaucoup plus aux messages positifs et à la force de l’exemple qu’à la stigmatisation, d’autant que les professionnels ne souhaitent pas de moratoire, car il pourrait fortement compromettre la viabilité de la filière en la déstabilisant brutalement. Au contraire, il nous paraît essentiel d’encourager le développement de signes officiels de qualité dans le cadre d’une démarche volontaire afin de permettre aux professionnels de répondre efficacement aux attentes des consommateurs.
Nous disposons d’outils concrets pour y parvenir et structurer une offre hautement qualitative et écoresponsable, notamment dans le cadre du FEAMP, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.
Malgré tout, monsieur le secrétaire d’État, je conclurai mon intervention sur une note plus optimiste en saluant un certain nombre d’expérimentations en cours sur l’ensemble de notre territoire visant à valoriser la filière et à réduire les mortalités. Nous voulons et nous devons encore croire en l’avenir de l’ostréiculture !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe écologiste se concentrera sur les choix de l’IFREMER face à la crise que traverse actuellement le secteur ostréicole.
Les pressions en termes de rentabilité qui pèsent sur la recherche publique ne doivent pas la pousser à agir en oubliant le principe de responsabilité.
L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer a été créé en 1984 sous la tutelle de trois ministères : la recherche, la pêche et l’environnement. Il s’est agi là d’un bon investissement, qui nous permet de disposer d’un potentiel de recherche et d’expertise de grande ampleur afin de mieux connaître, suivre et exploiter la mer et ses ressources.
Cet institut est financé dans le cadre du programme 187. Toutefois, en tant qu’établissement public à caractère industriel et commercial – EPIC –, il doit trouver une part significative de ses ressources sous forme de contrats privés.
Il fait avancer les connaissances fondamentales et appliquées. C’est un acteur de surveillance du milieu marin et du contrôle de la qualité des produits de la mer. C’est également un acteur commercial.
Au début des années 2000, face à la mortalité dans les parcs, dont les causes ont été insuffisamment explorées, l’IFREMER a choisi la modification génétique et la production d’huîtres triploïdes, l’objectif étant de rendre les souches résistantes et d’assurer le développement économique de la filière ostréicole grâce à l’innovation.
À cette fin, il a acheté en 2004 un brevet américain, conjointement avec l’écloserie privée Grainocéan, avec laquelle il a établi un partenariat commercial pour la diffusion d’huîtres triploïdes, obtenues à partir de chocs chimiques ou thermiques. Cette biotechnologie fleure aussi bon la précision et la science que les électrochocs en psychiatrie du siècle dernier ! §Ce brevet, qui date de 1991, devrait tomber dans le domaine public cette année.
Rappelons que, entre 2000 et 2007, et peut-être est-ce encore le cas aujourd’hui, ce brevet a entraîné la production d’huîtres, qui, selon les termes mêmes du brevet déposé par l’IFREMER en 2008, feraient « courir un risque de stérilisation progressive du milieu et de contamination des stocks d’huîtres diploïdes autochtones ». L’IFREMER a donc fait un choix risqué pour la biodiversité.
En 2008, cet institut a déposé seul un nouveau brevet français et européen sur l’obtention de mollusques bivalves tétraploïdes – on n’arrête pas le progrès ! – à partir de géniteurs diploïdes. Depuis, il gère et vend aux écloseries en exclusivité des géniteurs tétraploïdes pour croisement.
Malgré la grande qualité de ses travaux de recherche, reconnus à l’échelon international, l’IFREMER est pointé du doigt depuis plusieurs années par une grande partie de la profession ostréicole, qui lui reproche de jouer à l’apprenti sorcier en utilisant des biotechnologies et d’être à la fois juge et partie dans la gestion de la crise des mortalités. En effet, la robustesse de tout système de sécurité sanitaire repose normalement sur la séparation de la mise sur le marché et de l’expertise. Peut-on parler ici d’indépendance alors que l’expert qui évalue les effets sur l’écosystème de l’huître triploïde est aussi celui qui détient le brevet et bénéficie de la diffusion de ces huîtres ?
Les instances professionnelles mettent en cause l’inertie des pouvoirs publics et des experts scientifiques.
De nombreuses zones d’ombre subsistent sur la fertilité de ces huîtres censées être stériles, sur le lien avec les surmortalités des dernières années, sur le suivi et le contrôle des lots produits en écloserie, et sur la non-sanctuarisation des bassins naisseurs.
Selon le rapport d’expertise judiciaire rendu en 2014, aux termes de quatre années d’une procédure engagée devant le tribunal administratif de Rennes, cinq fautes ont été pointées qui peuvent mettre en cause la responsabilité de l’EPIC s’agissant du virus : absence d’approche médicale et de diagnostic de l’infection herpétique ; défaut de surveillance ; défaut de conseils de prophylaxie sanitaire ; défaut d’informations apportées à la profession ostréicole sur les risques et absence de proposition de mesures préventives ; absence de contrôle sanitaire de l’herpès virus du naissain de triploïdes dans les écloseries.
Le COMEPRA, le Comité consultatif commun d’éthique pour la recherche agronomique, a dès 2004 rendu un avis sur l’ostréiculture et les biotechnologies. Il disait alors : « Les chercheurs sont-ils en mesure d’offrir les moyens de maîtriser les conséquences de leurs travaux ? », « La profession conchylicole est-elle en mesure de prendre en charge l’innovation qui en résulte ? » À ces questions, il n’a pas été apporté de réponse.
Les répercussions sans doute irréversibles de l’introduction de ce type d’huîtres sur la profession ostréicole illustrent la difficile équation entre innovation et principe de précaution.
Chers collègues et consommateurs, nous aimons tous les produits de la mer, ainsi que les gens qui les élaborent pour nous. Nous pouvons tous rêver d’avoir des œufs cubiques, car ils seraient plus faciles à ranger, mais nous résistons à la tentation !
Sourires.

Nous pouvons donc tous faire l’effort de manger des huîtres laiteuses en été et de cesser de prendre des risques pour la biodiversité.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avant d’évoquer le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je tiens à remercier notre collègue Joël Labbé – les Morbihannais sont tous présents aujourd'hui ! – d’avoir pris l’initiative de provoquer un débat sur cette question si pertinente pour notre territoire littoral. Je le remercie également de la leçon de sciences naturelles qu’il nous a donnée tout à l’heure sur la naissance et la croissance des huîtres, leur alimentation à base de phytoplancton et leur mode de reproduction. Même si j’ai déjà évoqué ce sujet dans le passé, j’avoue que j’en avais un peu oublié certains aspects.
Notre débat aujourd'hui est totalement justifié, tant le mot « hécatombe » nous semble être le plus approprié pour décrire la situation de la production conchylicole en Bretagne – mes collègues des autres régions, en particulier de la Charente-Maritime, voudront bien me pardonner d’évoquer surtout son cas –, laquelle est en recul de près d’un quart depuis plusieurs années. Ainsi, 56 % de la production de l’huître creuse a disparu de la Bretagne, et ce n’est pas fini puisque le virus de la famille de l’herpès, l’OsHV-1, qui a déjà ravagé 70 % des naissains depuis 2007, se voit malheureusement concurrencer par une nouvelle bactérie plus forte encore.
Avec près de 8 200 hectares de concessions, la Bretagne représente 41 % des surfaces conchylicoles et 37 % des surfaces exploitées. La Bretagne Sud totalise 61 % des surfaces et compte 388 entreprises, principalement situées dans le Morbihan. C’est dire l’importance et la prévalence de ce secteur d’activité pour notre département, qui emploie 4 000 personnes, dont 2 000 à temps complet.
Avec raison, notre collègue Joël Labbé demande que des mesures soient prises afin de préserver la diversité génétique des huîtres nées en mer et de permettre une meilleure information des consommateurs.
Les erreurs commises à l’encontre des agriculteurs avec les semenciers ne doivent pas être répétées pour l’un des fleurons de notre gastronomie, l’huître.
Certes, face au virus, il faut trouver des parades. Un ingénieur de l’IFREMER, que j’ai rencontré récemment, m’a indiqué que cette huître triploïde avait été développée et brevetée en 1997 et commercialisée en 2000. Elle possède non pas 2n chromosomes, mais 3n chromosomes.
La première conséquence de ces modifications est la stérilité des huîtres. Les ostréiculteurs sont donc dans l’obligation de passer par des écloseries pour renouveler leurs parcs. À terme, ne risquent-ils pas de devenir dépendants des écloseries, tels que le sont les agriculteurs avec les semenciers ?
Seconde conséquence, leur stérilité implique que ces huîtres ne dépensent pas d’énergie pour la reproduction et poussent donc plus vite que les autres.
Cependant, ces avantages semblent relatifs. Ainsi, de nombreux lots d’huîtres triploïdes entreraient en reproduction, c’est-à-dire en lactance. Ce phénomène avait déjà été noté lors de l’été 2003, selon l’INRA. De plus, l’infection bactérienne de cet été a touché de façon similaire les huîtres diploïdes et les huîtres triploïdes, sans que l’on constate une meilleure résistance chez les huîtres triploïdes.
Autre point d’interrogation, l’INRA précise dans un avis de 2004 que si quelques huîtres tétraploïdes s’échappaient des écloseries, cela entraînerait « en une dizaine de générations le basculement vers une population exclusivement tétraploïde ».
Ces risques sont bien réels, mais les données les concernant sont lacunaires. Comment comptez-vous les évaluer concrètement, monsieur le secrétaire d’État ?
En 2001, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments, l’AFSSA, a regretté dans un avis que les études de l’IFREMER ne soient pas publiées. Alors que les craintes sur ce type d’huîtres sont de plus en plus prégnantes, comptez-vous remédier à cette situation ? Quels moyens de contrôle sanitaire sur les zones de production des huîtres triploïdes souhaitez-vous mettre en place ?
Toutefois, comment procéder à de tels contrôles et à une telle surveillance quand les moyens accordés aux institutions œuvrant dans ce domaine, comme l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, se réduisent année après année ?
Au bout de cette chaîne, les consommateurs ne sont pas suffisamment informés de la nature ou de la traçabilité de l’huître qu’ils consomment.
Selon le Comité national de la conchyliculture, l’absence de réglementation spécifique aux huîtres triploïdes est logique, car elles ne sont pas considérées comme un « nouveau produit ». Ainsi, il n’y a pas d’obligation d’étiquetage particulier.
De même, la qualité d’huître triploïde n’a pas à être précisée, puisque, selon la Commission européenne, ces huîtres peuvent exister en infime quantité à l’état naturel.
Et si la SATMAR indique bien, sur les lots de naissains qu’elle vend, le caractère triploïde ou non, cette information disparaît une fois les huîtres sur les étals des commerçants.
Quels engagements concrets pouvez-vous prendre aujourd’hui pour favoriser la mise en place rapide d’un étiquetage particulier pour les huîtres triploïdes ?
Si ce type d’huîtres a permis aux ostréiculteurs de sortir la tête de l’eau – mais pas les huîtres, naturellement ! –, le principe de précaution doit prévaloir. Cela nécessite davantage d’études d’impacts sanitaires et environnementaux.
Rappelons-nous le bon sens des anciens, qui préconisaient de ne pas consommer ces mollusques bivalves les mois sans « r », et n’oublions pas qu’il existe huit mois qui comprennent cette lettre ! En ayant perdu ce bon sens au profit de la croissance économique, l’homme a engendré des naissains de laboratoire, non adaptés aux conditions exceptionnelles que présente parfois la nature.
Pendant très longtemps, j’ai ignoré ces problèmes d’huîtres diploïdes ou triploïdes, pensant qu’avec un verre de muscadet bien frais et une tartine de pain noir au beurre breton, elles étaient toutes délicieuses !
Mais attention, il faut rester vigilant pour ne pas noyer cette image d’Épinal de vacances au bord de mer, qui ne doit pas être ternie par la colonisation du milieu maritime par cette espèce animale non naturelle. C’est toute une filière qui attend des mesures pertinentes et précises. Soyons vigilants les uns et les autres !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe écologiste.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sur l’initiative du groupe écologiste, nous sommes aujourd’hui amenés à débattre des risques inhérents à l’exploitation de l’huître triploïde.
Il s’agit en effet d’un problème très technique qui aurait pu à mon avis bénéficier d’une saisine de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques afin d’avoir une approche mieux renseignée sur le plan épidémiologique et scientifique. Car, pour le moment, nous ne disposons pas d’expertises suffisantes pour formuler des certitudes sur les éventuelles incidences sanitaires ou environnementales de l’huître dite « des quatre saisons ». Toutefois, puisque le débat a été inscrit à l’ordre jour, le RDSE y prend part.
L’huître triploïde est issue d’une modification visant à doter sa cellule de trois jeux de chromosomes au lieu de deux. Cette modification est obtenue par deux méthodes différentes, dont la plus utilisée est la fécondation d’un ovule à trois jeux de chromosomes. L’huître a d’ailleurs de tout temps été largement utilisée en génétique expérimentale. Il n’est dans l’esprit de personne de nier les énormes progrès de la manipulation génétique dans tous les secteurs, y compris dans le domaine humain, et des espoirs liés à ces possibilités de traitement de certaines maladies rares. L’ostréiculture a elle-même bénéficié de ces progrès en créant ces fameuses huîtres triploïdes, dont la stérilité présente un double intérêt. D’une part, cela permet de ramener leur cycle de production à deux ans au lieu de trois. D’autre part, cette huître, moins laiteuse, est commercialisable en été, et donc plus intéressante pour alimenter le marché tout au long de l’année.
Pour ces raisons, l’huître triploïde connaît un certain succès puisqu’elle représenterait actuellement entre 30 % et 40 % des huîtres consommées en France.
Toutefois, depuis quelques années, le camp des « anti-triploïde » – si l’on peut dire – s’est mobilisé, avec parfois devant ou derrière lui des ONG – organisations non gouvernementales – dont la véritable cible est encore une fois les biotechnologies et la recherche scientifique. Il est essentiel de rappeler que mêler ce problème aux OGM est un abus de langage douteux. Un OGM est l’ajout d’un élément cellulaire d’un être différent. Je suppose que les auteurs de la question respectent cette distinction capitale. Cette précision étant posée, quels sont les enjeux liés au développement de cet organisme vivant modifié ou OVM ?
Il y a tout d’abord un enjeu sanitaire. On ne peut pas ignorer cette dimension. Cependant, en 2001, l’AFSSA a conclu que « le caractère polyploïde des huîtres ne paraît pas constituer en lui-même un facteur de risque sanitaire au regard de l’existence de ce phénomène, à l’état naturel, dans les règnes animal et végétal ». J’ajouterai que l’AFSSA n’a pas rapporté d’incidents liés à la consommation d’huîtres triploïdes.
Bien sûr, ce constat ne doit pas exonérer les pouvoirs publics d’exercer toute la vigilance qui s’impose.
Le second point, qui inquiète particulièrement les ostréiculteurs traditionnels, est celui du risque de dissémination, un risque dont on a déjà parlé ici s’agissant des OGM. Si l’on peut être favorable à la production des huîtres triploïdes, on doit cependant s’assurer que celle-ci n’aboutisse pas à la disparition de l’huître naturelle. Les écloseries sont censées être très sécurisées. Le sont-elles vraiment ? En théorie oui, mais l’on peut bien évidemment avoir des exigences en matière de surveillance des installations, avec les contrôles nécessaires.
Je voulais évoquer aussi le problème de la surmortalité des coquillages constatée depuis 2008.
On le sait, cette surmortalité est liée à des virus et des bactéries bien identifiés. La question est de savoir pourquoi ces infections se sont développées. Nous n’avons pas de réponse pour l’instant.
Pour les ostréiculteurs traditionalistes, la domestication de l’espèce par la manipulation génétique est en cause. Or rien n’est prouvé à ce jour, et l’histoire de l’huître rappelle que des variétés ont déjà été décimées avant 1994, date de la mise au point par IFREMER de ces manipulations génétiques.
Dans les années 1920, l’huître plate décimée a été remplacée par l’huître portugaise. À son tour, cette espèce connaît dans les années 1970 une épizootie et est remplacée par l’huître creuse japonaise. C’est pourquoi, aujourd’hui, au regard de ces exemples, on ne peut pas établir de lien entre l’huître triploïde et la surmortalité observée ces dernières années.
Enfin, la question orale de notre collègue Joël Labbé s’attarde également sur l’étiquetage. Je partage en général le principe de transparence que l’on doit avoir à l’égard des consommateurs. Mais, s’agissant de l’huître triploïde, comme vous le savez, dans la réglementation européenne en vigueur, est proposé un étiquetage sur la base du volontariat, car il ne s’agit pas d’OGM, mais d’OVM.
Mes chers collègues, pour conclure, je rappellerai que derrière ce débat, il y a la question sous-jacente du principe de précaution. Pour le RDSE, d’une façon générale, nous ne sommes pas pour une lecture extensive de ce principe, qui aurait pour effet d’entraver la recherche et l’innovation, et donc la notion même de progrès. Comme je l’ai dit, rien n’indique aujourd’hui que l’huître triploïde est un mauvais produit. Mais que cela n’empêche pas, monsieur le secrétaire d’État, les pouvoirs publics d’assumer pleinement leurs responsabilités en mettant en œuvre les outils d’expertise, de surveillance et de contrôle qui s’imposent pour informer et éventuellement protéger consommateurs et producteurs.
Mme Marie-Annick Duchêne applaudit

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le questionnement sur les risques inhérents à la production d’huîtres dites « triploïdes » a déjà fait l’objet d’un débat dans cet hémicycle, à l’occasion de l’examen d’un de vos amendements, cher collègue Joël Labbé.
Considérées par certains comme une avancée technique permettant la régulation de la production, ces huîtres sont aussi considérées par d’autres comme plus fragiles en raison d’une croissance rapide, facteur d’une mortalité croissante favorisant le risque de contamination et d’appauvrissement des huîtres.
Je voudrais me livrer à un petit rappel englobant les problématiques de l’ensemble de la filière ostréicole.
Répartie sur sept bassins du littoral, la production d’huîtres s’élève à environ 80 000 tonnes, engendrant un chiffre d’affaires de l’ordre de 345 millions d’euros.
La conchyliculture, à laquelle appartient la filière ostréicole, emploie 18 000 personnes, soit 6 000 équivalents temps plein, auxquels s’ajoutent près de 3 000 chefs d’exploitation et conjoints.
Ce secteur présente de fortes spécificités : forte saisonnalité, caractère à la fois maritime et agricole, importance du travail non salarié, territoires et bassins à fortes spécificités. Le département de la Vendée, dont je suis élue, représente près de 10 % de la production ostréicole. Il est caractérisé par la présence des écloseries les plus importantes du territoire national – quatre sur la dizaine d’écloseries que compte la France, dont le leader national.
La production ostréicole subit des phénomènes de mortalité depuis 2008 qui impactent fortement la production et les ressources des ostréiculteurs, inquiètent le consommateur et concourent de facto à la diminution de la demande.
Des études sur l’origine de ces phénomènes sont réalisées, particulièrement par IFREMER et des comités départementaux de suivi de l’ostréiculture, sous l’égide des directions départementales des territoires et de la mer, les DDTM, et en lien avec les organisations professionnelles, qui assurent également une veille.
Les causes apparaissent multifactorielles – virales, bactériennes, milieu aquatique, variation de la température des eaux – et ne sont pas nécessairement attestées. Les mêmes variations et incertitudes affectent les huîtres à tous les stades de leur développement, et ce quelle que soit leur provenance, captage naturel ou écloseries.
Malgré le florilège d’études et de rapports, la situation reste fragile et la profession est légitimement inquiète pour sa survie.
En effet, quel que soit le stade de production où intervient la mortalité, il engendre une perte de production, donc une perte de ressources.
Je poursuis avec les huîtres issues de milieu naturel ou d’écloseries. La production est quasi équivalente selon les origines et, actuellement, près de 80 % des producteurs font appel aux produits issus d’écloseries.
L’élevage des huîtres depuis la création du naissain jusqu’à la mise sur le marché se pratique de manière différente selon les bassins et les acteurs du métier. Certains procèdent au captage en milieu naturel puis assurent l’élevage dans le même milieu.
En revanche, il n’est pas rare, quelle que soit l’origine du captage, que le naissain soit envoyé en pré-grossissement dans un autre bassin, en France ou à l’étranger, revienne chez un autre éleveur pour atteindre la taille marchande et termine son périple dans un dernier bassin où, après trois mois d’immersion, les huîtres seront vendues sous l’appellation de ce dernier bassin ou de la marque que lui apposera le dernier éleveur.
Pour les huîtres diploïdes d’écloserie, les fonctions de reproduction sont assurées dans les écloseries, qui vendront ensuite les naissains. C’est en relation avec ce milieu que l’IFREMER travaille notamment au renforcement des capacités de résistance de sujets pour faire face aux difficultés que je viens d’évoquer. C’est pour cette raison que la filière dite traditionnelle exprime ses craintes quant à l’utilisation de produits antibactériens et au rejet d’effluents. La réglementation existante, les contrôles et les certifications devraient lever ces inquiétudes.
S’agissant des huîtres triploïdes d’écloserie, je tiens à rappeler que ces organismes vivants ne sont pas des OGM. Les craintes manifestées par la profession et reformulées par les initiateurs de notre débat, si elles sont légitimes au regard des risques supputés, ne trouvent pas à ce jour de confirmation dans les différents rapports d’étude. À la fin de l’année 2014, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES, a confirmé l’innocuité de ces huîtres pour le consommateur et l’absence de risque pour l’environnement.
J’en viens à la question de l’étiquetage. En s’appuyant sur les dispositions de la loi n° 2014–344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et sur la suggestion de certains ostréiculteurs, il a été demandé d’imposer un étiquetage différenciant les huîtres issues de captage et d’élevage naturel des huîtres issues d’écloseries, et surtout des huîtres triploïdes. Les débats ont cependant fait ressortir que, les huîtres triploïdes n’étant pas classées parmi les OGM, cette demande n’était pas recevable. Notons également que le Comité national de la conchyliculture, le CNC, n’est favorable ni à une labellisation ni à un étiquetage réglementé.
À ce jour, rien n’oblige les ostréiculteurs à indiquer l’origine, le bassin de production ou la marque de leurs produits, mais rien non plus ne leur interdit de le faire selon leur gré, sous quelques réserves. Outre que les appellations « diploïde » ou « triploïde » ne me paraissent pas incitatives à la consommation, elles imposeraient des contrôles très difficiles à définir et à appliquer. Aujourd’hui, rien ne peut garantir qu’un ostréiculteur dit traditionnel ne détient pas dans son cheptel des huîtres triploïdes, ne serait-ce qu’en quantité minime. De fait, la nature crée – en quantité infime, bien sûr – des huîtres triploïdes ; c’est sans doute une anomalie, mais sa réalité est incontestable. Dès lors, quel contrôle effectuer et quelle sanction appliquer en cas de manquement ?
Il me semble que la profession a toutes les capacités pour gérer ces problèmes de conditionnement en préservant l’intérêt du consommateur. Demeure cependant le problème des brevets d’exploitation. Le brevet, américain à l’origine, dont l’IFREMER détenait l’exclusivité d’exploitation pour l’Europe est tombé dans le domaine public le 15 janvier dernier. Par ailleurs, l’IFREMER a déposé en 2007 un nouveau brevet pour une nouvelle technique de production des géniteurs. Enfin, il a été porté à notre connaissance que l’IFREMER souhaitait cesser son activité de production de géniteurs, car sa vocation première est la recherche. Il serait donc disposé à vendre son brevet.
Cette hypothèse n’est pas sans poser des problèmes d’ordre déontologique à la profession. Il ne paraît pas souhaitable qu’un acquéreur puisse s’approprier un monopole dont les incidences pourraient peser fortement sur l’ensemble de la filière ostréicole. Un cahier des charges est à établir pour définir les conditions d’exploitation du brevet par l’entité chargée de détenir et de produire les géniteurs. Cela implique une étroite collaboration entre le ministère de l’agriculture et la profession. Certains acteurs suggèrent de s’appuyer, pour la partie réglementaire, sur les textes régissant les installations classées pour la protection de l’environnement, afin d’encadrer les risques.
Il y a tout de même un souci : c’est le temps. Un brevet est dans le domaine public ; l’autre est en vente. La filière ostréicole est fragilisée et inquiète à cause de tous les éléments que je viens d’évoquer. Monsieur le secrétaire d'État, j’aimerais connaître les dispositions que vos services ont prises ou vont prendre et savoir dans quels délais les problèmes inhérents à la détention et à la gestion des brevets pourraient être résolus. S’il faut s’en remettre à la profession pour réguler, il est important d’organiser le cadre réglementaire et les dispositions de contrôle par les instances adéquates pour sécuriser la production.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, en Normandie, territoire largement ouvert sur la mer avec ses 600 kilomètres de côtes, on pratique la pêche depuis toujours. Cette économie ancestrale s’est enrichie depuis un demi-siècle d’une activité ostréicole en pleine expansion.
La région, qui commercialisait en 1970 un millier de tonnes d’huîtres, soit 3 % de la production nationale, est passée dès 1976 à 10 000 tonnes. Pour la campagne 2010–2011, la production normande est estimée à 16 200 tonnes, pour un total de 84 000 tonnes produites en France. La Normandie est ainsi devenue une région leader. Sur un territoire de 1 100 hectares, l’ostréiculture emploie entre 1 500 et 2 000 personnes, selon les saisons, dans près de 250 entreprises. Ces entreprises sont souvent « mixtes », c’est-à-dire qu’elles cultivent à la fois des huîtres diploïdes, dites naturelles, et des huîtres triploïdes.
Le brassage des eaux et le renouvellement permanent du plancton apportent aux huîtres des qualités gustatives fortes. Les producteurs se sont engagés dans des démarches de qualité, sanctionnées par la dénomination générale « Huîtres de Normandie » et le label « Gourmandie ». Pour bénéficier de cette signature, les producteurs doivent respecter un cahier des charges strict, fondé sur l’origine du produit, sa qualité et sa saveur. En 2011, ils ont mis en place un organisme de défense et de gestion, première étape vers l’obtention d’une indication géographique protégée, ou IGP ; le dossier est en cours d’instruction.
Moins connues que leurs homologues de Charente-Maritime ou du bassin d’Arcachon, les huîtres normandes ont su gagner leurs lettres de noblesse, preuve de la ténacité et du savoir-faire de leurs producteurs. Certaines ont même été récompensées cette année par une médaille d’or au Salon de l’agriculture.
La question qui nous est soumise aujourd’hui s’invite dans une période troublée pour les producteurs. Je me ferai le porte-voix des conchyliculteurs normands, qui viennent de débattre de l’étiquetage. En effet, depuis un an et demi, ils font face à une surmortalité des huîtres, qu’elles soient juvéniles ou adultes. Cette surmortalité, qui est due à un virus, touche l’ensemble de la chaîne de production, fragilisant ainsi les exploitations pour plusieurs années.
En outre, – je le rappelle pour mémoire – les producteurs ne bénéficient pas de soutien financier au titre des calamités agricoles, les épizooties n’entrant pas dans le champ de la prise en charge. Ils subissent donc une perte sèche. Cette année, et pour la première fois, les producteurs d’Isigny-sur-Mer se trouvent dans une situation de très grande difficulté, malgré le soutien gouvernemental, qui s’est traduit par une remise gracieuse des redevances domaniales et un soutien du Fonds d’allégement des charges. La priorité actuelle des producteurs est de sauvegarder leurs productions et leurs exploitations et d’enrayer cette crise sanitaire, avec l’aide des services de l’État.
La question permet aussi de s’interroger sur le rôle de l’IFREMER. À la fin des années 1980, il a cherché à améliorer les souches d’huîtres françaises en créant une huître plus résistante. Il a développé et commercialisé un brevet de production d’huîtres tétraploïdes, qui permettent la production d’huîtres triploïdes. Certaines associations de conchyliculteurs, notamment normandes, s’interrogent sur la double casquette de l’IFREMER, qui est à la fois juge et partie. Il souhaiterait aujourd'hui transférer son brevet à la profession ou le rendre au domaine public. Il considère que la profession doit être elle-même organisatrice.
Enfin, concernant l’opportunité de l’étiquetage, la profession est consciente du besoin légitime de connaissance et d’information des consommateurs. Elle s’interroge depuis plusieurs années sur l’impact de l’étiquetage pour les producteurs et sur les mentions qu’il faudrait apposer sur les étiquettes. Elle s’interroge aussi sur les modalités d’établissement de l’étiquetage : par qui et comment ?
Conscients du besoin de connaissance des consommateurs, certains membres du comité régional de la conchyliculture Normandie Mer du Nord n’avaient pas hésité à proposer dès 2013 une délibération pour l’instauration d’un moratoire. Ils étaient inquiets des effets de l’élevage d’huîtres triploïdes sur le milieu naturel, tout en souhaitant maintenir un marché équilibré, où demande et offre sont ajustées. Nous constatons donc un grand esprit de responsabilité parmi les éleveurs.
À la fin du mois d’avril, la profession a pris une position, sur la base d’un questionnaire adressé à l’ensemble de ses membres. Près de 60 % des ostréiculteurs normands y ont répondu, ce qui signifie que le sujet ne laisse pas indifférent. La majorité s’est prononcée contre l’étiquetage, sans doute parce qu’elle est davantage préoccupée par les difficultés actuelles. Les éleveurs favorables à l’étiquetage regrettent cette décision mais se rangent derrière la majorité. Ils rappellent toutefois que le fait d’anticiper la mesure avant qu’elle devienne obligatoire permettrait une meilleure appréhension par la profession.
Les éleveurs sont donc particulièrement avertis sur le sujet de l’étiquetage, et ils en connaissent les enjeux. Faisons-leur confiance pour prendre les mesures nécessaires au moment idoine.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, comme l’a fort opportunément rappelé Odette Herviaux, la production ostréicole est l’une de nos fiertés nationales. C’est aussi, malheureusement, une filière qui connaît régulièrement de grandes difficultés, et sur laquelle nous devons veiller avec une attention toute particulière.
De 1996 à 2007, la production nationale se chiffrait entre 130 000 et 140 000 tonnes par an. En 2008, elle a chuté à 80 000 tonnes, du fait de l’apparition d’un variant de l’herpès virus de l’huître s’attaquant aux coquillages juvéniles puis d’une bactérie décimant les huîtres creuses adultes. En 2012, pour la première fois depuis cette crise, les résultats nationaux ont repassé la barre des 100 000 tonnes ; cette tendance s’est confirmée en 2013.
Pourtant, selon le Comité national de la conchyliculture, cette embellie est trompeuse car, si les ostréiculteurs se sont adaptés pour tenter de stabiliser la situation, leurs stocks sont à zéro et des risques pèsent sur leur trésorerie et leurs investissements. L’État n’a pas abandonné les ostréiculteurs, puisque l’exonération des redevances domaniales est en place depuis plusieurs années, et que le Fonds d’allégement des charges, dont la dotation a été augmentée, a vu ses missions renforcées.
L’IFREMER s’est saisi du problème. L’une de ses missions est en effet d’améliorer les souches d’huîtres françaises et de trouver des souches d’huîtres résistantes aux maladies. Il a ainsi mis au point en 1997 une huître possédant non pas deux chromosomes, comme l’huître diploïde, dont chaque chromosome est apparié avec son homologue, mais trois chromosomes. Cette huître est donc appelée triploïde. Il n’est pas inutile de rappeler, comme l’ont fait d’autres orateurs, qu’elle n’est pas un organisme génétiquement modifié.
En France, les huîtres triploïdes sont commercialisées depuis quinze ans, et elles représentent actuellement environ 30 % des huîtres vendues. Elles présentent essentiellement deux intérêts majeurs, l’un pour les consommateurs et l’autre pour les producteurs. La principale différence entre les huîtres diploïdes et les huîtres triploïdes est la stérilité des huîtres triploïdes. De ce fait, elles ne sont pas laiteuses – ni donc boudées par les consommateurs – en été, au moment de la production de gamètes. Leur second intérêt est également une conséquence de leur stérilité. Dans la mesure où elles ne dépensent pas d’énergie pour la reproduction, elles poussent donc plus vite que les autres : leur cycle de production est de deux ans au lieu de trois.
Enfin, les huîtres triploïdes seraient plus résistantes, selon les données fournies par l’IFREMER : en moyenne, la mortalité de mai à juillet se situe entre 50 % et 70 % dans les élevages d’huîtres diploïdes, alors que, dans les mêmes conditions d’élevage en milieu naturel, les huîtres triploïdes présentent une mortalité globale de l’ordre de 10 %.
Malgré ces avancées, qui semblent positives pour la profession, l’huître triploïde a des détracteurs. L’un des éléments de discorde est la modification de l’huître en laboratoire. Je tiens à rassurer les consommateurs sur ce point : dès la commercialisation de l’huître triploïde, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments a conclu, dans un avis rendu en 2001, que, concernant les risques potentiels de ce nouveau produit, « le caractère polyploïde des huîtres ne [paraissait] pas constituer en lui-même un facteur de risque sanitaire au regard de l’existence de ce phénomène à l’état naturel dans les règnes animal et végétal ». Elle ajoutait que « les huîtres triploïdes [étaient] consommées depuis de nombreuses années sans qu’aient été rapportés d’incidents liés à leur consommation ».
Pour autant, afin d’assurer l’entière information des consommateurs, je me permets d’évoquer le souhait d’un étiquetage des huîtres exprimé par de nombreux comités régionaux de la conchyliculture. Selon le Comité national de la conchyliculture, l’absence de réglementation spécifique aux huîtres triploïdes est logique, car elles ne sont pas considérées comme un « nouveau produit ». Cependant, si la Société atlantique de mariculture indique bien, sur les lots de naissains qu’elle vend, le caractère triploïde ou non des huîtres, cette information est absente des étals des commerçants. Il serait donc souhaitable de préciser aux consommateurs si les huîtres sont nées en mer ou en écloserie.
La demande d’étiquetage est formulée depuis de nombreuses années par l’association « Ostréiculteur traditionnel », qui défend l’huître née en mer. Toutefois, plutôt qu’une obligation, l’encouragement à l’étiquetage, en vue d’une généralisation, qui serait moins lourd à mettre en œuvre, peut assurer un haut niveau d’information aux consommateurs. C’est vers cette idée que je me dirigerai.
Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite par ailleurs connaître votre position face à la polémique qui agite les producteurs ostréicoles ces derniers temps, tout particulièrement depuis que cette association a saisi, en octobre dernier, le tribunal administratif de Rennes.
Ladite association accuse l’IFREMER d’avoir découvert le virus en écloserie en 1991 et de n’avoir rien fait pour en stopper la progression.
Il est donc indispensable d’y voir plus clair sur ce sujet. À cette fin, pouvez-vous nous détailler l’ensemble des missions menées par l’IFREMER, afin d’éteindre, si possible, cette polémique ?
Enfin, mes chers collègues, je tiens à insister sur l’importance du secteur ostréicole pour notre économie, en particulier pour nos territoires littoraux.
Depuis 2008, la mortalité des huîtres de moins d’un an affecte 60 % à 90 % de la production dans la plupart des sites ostréicoles français.
Des recherches ont démontré que cette hécatombe n’était pas entièrement due au variant de l’herpès virus de l’huître, que j’ai évoqué au début de mon intervention. Ces mêmes recherches indiquent que ce phénomène a pu être accentué par des facteurs environnementaux, comme la pollution et l’utilisation de produits chimiques, l’élévation de la température de l’eau de mer ou des concentrations plus fortes des jeunes huîtres dans les parcs. L’ensemble de ces facteurs ont pu concourir à affaiblir les huîtres du milieu naturel.
Nous devons rassurer la profession et garantir le maintien de la compétitivité des entreprises françaises ostréicoles, dont la production figure au premier rang européen.
Cette action doit se traduire par le soutien aux investissements productifs, la promotion de l’innovation et le renforcement de la qualité des produits.
Notre collègue Joël Labbé a posé, à très juste titre, un ensemble d’interrogations.
Monsieur le secrétaire d’État, vous devez apporter les explications qui s’imposent, rassurer et convaincre à la fois les producteurs et les consommateurs, dans un esprit avant tout rationnel et empreint d’objectivité. Je sais pouvoir compter sur vous pour le faire.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Christine Prunaud et M. Michel Le Scouarnec applaudissement également.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis des années, le milieu conchylicole se perd en débats sémantiques et génétiques au sujet de l’huître triploïde.
Stérile, cette huître consacre l’essentiel de son métabolisme à sa croissance et possède, de ce fait, une double qualité. Tout d’abord, – les précédents orateurs l’ont indiqué – au cours de la saison de reproduction, elle ne présente aucun aspect laiteux : elle peut donc être commercialisée plus facilement, et tout au long de l’année. Ensuite, cerise sur le gâteau, sa croissance est accrue de 30 % à 40 %.
En contrepartie, l’huître triploïde peut difficilement être considérée comme l’un des derniers produits alimentaires 100 % naturels, à l’instar de certains autres coquillages et crustacés.
Outre la loi d’orientation agricole qui, depuis 1999, confie la police du marché au Comité national de la conchyliculture, le CNC, un règlement européen adopté en 1997, sur fond de polémique relative aux organismes génétiquement modifiés, les OGM, impose aux États membres de mettre en œuvre un dispositif d’étiquetage circonstancié. S’y ajoute une directive sur les produits de la mer qui, depuis le 1er janvier 2002, renforce les obligations d’information relatives aux conditions d’élevage et de pêche.
À défaut d’être des organismes génétiquement modifiés, les huîtres triploïdes ne seraient-elles pas, au minimum, biotechnologiquement manipulées ? Si tel était le cas, ces dernières relèveraient de la réglementation relative aux nouveaux produits alimentaires, les novel foods, dont la mise sur le marché relève de procédures spécifiques.
Bruxelles a répondu à cette question par le biais d’une directive dès 2002 : « Les huîtres triploïdes peuvent se trouver à l’état naturel. Il n’y a pas de justification à des mentions obligatoires particulières. Toutefois, les producteurs, sur une base volontaire, peuvent informer les consommateurs sur leurs caractéristiques. »
La direction générale de l’alimentation du ministère français de l’agriculture n’est, elle non plus, pas favorable à l’étiquetage obligatoire.
Le débat semble porter moins sur des questions sanitaires – la triploïde est en effectivement sans danger pour le consommateur – ou environnementales – seule la tétraploïde de l’IFREMER, fertile, risque en effet éventuellement de se propager dans les parcs – que sur la transparence et l’information sur le produit commercialisé.
Pourtant, les méthodes de production de ce secteur exigent une clarification.
Afin d’éviter tout risque d’ordre pathologique, génétique ou écologique, les huîtres d’écloserie polyploïdes mises en élevage dans les bassins de production devraient être issues de techniques agréées par l’administration et ayant fait l’objet d’une validation scientifique. Les professionnels pourraient engager des démarches en ce sens auprès des services administratifs compétents.
Parallèlement, l’on pourrait envisager la mise en œuvre d’un schéma de gestion collective de la production d’huîtres polyploïdes. Ce dispositif mobiliserait l’ensemble des professionnels du secteur.
Ce schéma pourrait avantageusement se décliner en divers volets : tout d’abord, un programme pluriannuel de suivi des méthodes d’obtention des mollusques polyploïdes, notamment fondé sur l’étude de l’opportunité des brevets de l’IFREMER ; ensuite, un programme à court terme, c’est-à-dire pour les années 2017 à 2020, d’organisation des stocks en élevage d’huîtres tétraploïdes, en lien avec le CNC ; en outre, un programme détaillant les moyens d’amélioration des prescriptions techniques et les cahiers des charges permettant de développer les garanties pour la biosécurité et la biovigilance ; enfin, un programme de transfert à moyen terme à l’organisation interprofessionnelle des missions actuellement assumées par l’IFREMER pour l’hébergement, la production et la fourniture d’huîtres tétraploïdes.
J’en viens à la question spécifique de l’étiquetage.
La demande d’une plus grande transparence quant aux méthodes de production apparaît, à la réflexion, comme une fausse bonne idée. En effet, les professionnels français sont dépendants d’un double approvisionnement en naissains. Ils estiment que, s’ils n’avaient recouru qu’à un seul d’entre eux, ils auraient largement compromis les ventes d’huîtres au cours des dernières années, sauf à proposer ces produits à un prix inabordable.
En conséquence, il convient de conserver les deux systèmes, à savoir le captage naturel, lorsque ce dernier est disponible, et l’approvisionnement par écloserie.
La distinction entre diploïdes et triploïdes pour les huîtres issues d’écloseries pourrait conduire le consommateur à boycotter ces produits et, partant, condamner toute une profession.
D’ailleurs, dans le domaine agricole, de nombreux fruits et légumes – bananes, tomates, pommes de terre, etc. – sont triploïdes, et, malgré cela, aucun étiquetage spécifique n’a jamais été envisagé. Par exemple, la clémentine est une mandarine triploïde, sans pépins, donc stérile.
Pourquoi réclamer des informations de cette nature pour les huîtres alors qu’elles ne sont pas exigées dans les autres secteurs agricoles ? Procéder ainsi reviendrait, somme toute, à faire deux poids deux mesures.
Cela étant, si un étiquetage devait être décidé, je lancerais un appel à la raison. À mon sens, il faudrait, en pareil cas, ménager les intérêts de l’ensemble de la filière conchylicole en privilégiant les mentions « huîtres issues de captage naturel » pour des huîtres qui seraient nécessairement diploïdes, et « huîtres issues d’écloserie » pour des huîtres qui pourront être diploïdes ou triploïdes.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. – M. Jean-Claude Luche applaudit également.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, avant tout, je tiens à remercier M. Joël Labbé d’avoir posé cette question orale avec débat, portant sur un sujet important pour le secteur conchylicole français.
Cette discussion nous permet d’échanger, de débattre de cette filière ostréicole, qui est une richesse pour notre territoire. Les divers orateurs ont tous rappelé l’importance, dans notre pays, du secteur ostréicole. Ce dernier se place au premier rang européen avec environ 80 000 tonnes de production et 2 500 entreprises, pour un chiffre d’affaires total de 400 millions d’euros.
Les interventions qui se sont succédé, très riches et documentées, permettent de poser les termes du débat. Pour ma part, je commencerai par confirmer certains faits qui viennent d’être rappelés.
Les huîtres triploïdes ont trois paires de chromosomes. Elles sont obtenues par croisement entre des huîtres diploïdes, qui ont deux paires de chromosomes – c’est la situation naturelle – et des huîtres tétraploïdes, dont le nombre de paires de chromosomes a été doublé par des procédés brevetés. Il ne s’agit donc pas d’organismes génétiquement modifiés, car le patrimoine génétique n’est pas modifié.
M. Jean-Pierre Bosino manifeste sa circonspection.
En outre, il existe de nombreux autres organismes triploïdes, dans les céréales, les cultures maraîchères ou fruitières. §Chez certains organismes, comme les fruits rouges sauvages, la polyploïdie peut même être naturelle.
La question de la production des huîtres triploïdes est débattue de longue date au sein de la profession, qui a toujours abordé ce dossier en prenant en compte toute la complexité des différents enjeux, économiques, environnementaux et sanitaires.
Ce constat a déjà été rappelé : les huîtres adultes, que nous consommons, sont produites à partir de naissains issus de deux sources d’approvisionnement : premièrement, le captage naturel de naissains, c’est-à-dire d’huîtres juvéniles, avec une reproduction naturelle des huîtres présentes dans le milieu ; deuxièmement, la production de naissains par les écloseries, constituée de naissains d’huîtres triploïdes, mais aussi de naissains d’huîtres diploïdes produits à partir de géniteurs prélevés en mer et sélectionnés pour leurs caractéristiques.
La production d’huîtres triploïdes représente, en moyenne, environ 30 % de la production totale d’huîtres creuses en France. Elle a donc un poids économique non négligeable.
Toute réflexion sur ce sujet mérite d’être solidement documentée et développée avec les acteurs de la filière. C’est la démarche que je souhaite défendre, celle d’un dialogue constant entre toutes les parties prenantes. Monsieur Joël Labbé, je sais que vous approuvez cette méthode.
M. Joël Labbé le confirme.
Jusqu’à présent, la production d’huîtres triploïdes et la production d’huîtres diploïdes ont été complémentaires. On l’observe à plusieurs égards.
Tout d’abord, une part importante de producteurs élève à la fois des huîtres triploïdes et des huîtres diploïdes.
Ensuite, le développement de la production d’huîtres triploïdes, après leur mise au point par l’IFREMER dans les années quatre-vingt-dix, a répondu à une demande des producteurs, désireux d’atténuer les effets de la saisonnalité de la vente des d’huîtres.
En effet, compte tenu de leurs caractéristiques physiologiques, comprenant, notamment, l’absence de laitance, les huîtres triploïdes permettent d’assurer une vente tout au long de l’année, et notamment pendant la période touristique estivale, qui apporte un supplément de revenu aux ostréiculteurs. En outre, divers orateurs l’ont déjà indiqué, ces huîtres bénéficient d’une croissance plus rapide.
De surcroît, le maintien de différents modes de production permet de diversifier les approvisionnements et peut contribuer à la capacité de résilience du secteur en cas de crise. Ainsi, lorsque, en 2008 et au cours des années suivantes, on a observé un phénomène de surmortalité ostréicole, la production de naissains diploïdes et triploïdes des écloseries a permis aux producteurs, en complément des naissains naturels, d’assurer un niveau viable de production – Mme Herviaux l’a rappelé au cours de cette discussion.
La production d’huîtres d’écloserie a été à la base des plans de sauvegarde soutenus financièrement par l’État qui ont consisté à fournir aux producteurs des huîtres issues de sélection et présentant une résistance améliorée aux surmortalités.
La production d’huîtres triploïdes fait également l’objet d’évaluations scientifiques indépendantes et est soumise à un suivi régulier.
Madame Blandin, vous avez fait référence à l’avis rendu en 2004 par le comité d’éthique et de précaution pour les applications et la recherche, instance commune à l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, et à l’IFREMER.
Cet avis portait sur l’utilisation des biotechnologies dans l’ostréiculture. Il insistait sur la nécessité de « la mise en œuvre d’un suivi technique, de manière qu’un contrôle efficace et rigoureux puisse être réalisé à chaque rouage de la filière qui mène des chercheurs aux professionnels ». Ces recommandations ont été suivies, notamment via des mesures de précautions figurant dans les conventions conclues entre l’IFREMER et les écloseries produisant des huîtres triploïdes.
Parallèlement, l’analyse des conséquences environnementales de la production d’huîtres tétraploïdes s’est appuyée sur deux missions d’expertise scientifique, menées, l’une, en 1998 et, l’autre, en 2008.
Mesdames, messieurs les sénateurs, plusieurs d’entre vous ont fait référence au rapport de la mission conduite, en 2008, par M. Chevassus-au-Louis. Cette mission a réuni plusieurs experts, dont l’actuel président du Muséum national d’histoire naturelle, M. Gilles Boeuf.
Ces études ont conclu à un risque environnemental faible, même en adoptant comme hypothèse de travail un scénario défavorable. Toutefois, conformément aux recommandations formulées par leur biais, un réseau de biovigilance a été mis en place pour surveiller le milieu naturel et détecter d’éventuelles variations anormales. Les recherches effectuées dans plusieurs bassins de production ont toujours montré l’absence de signes de colonisation de l’huître triploïde par reproduction dans le milieu naturel.
Afin d’apporter toute la transparence nécessaire sur cette question, je trouverais intéressant que les parlementaires s’en saisissent, eux aussi.
Sans empiéter sur les prérogatives du Parlement, je ne verrais que des avantages à ce que le bureau du Sénat, ou la commission chargée du développement durable, saisisse l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ou OPECST. L’indépendance de l’expertise de cette délégation des deux assemblées, garantie par son statut, nous permettrait de disposer d’une analyse complète de cette question, sur la base des travaux les plus récents, et d’apporter dans la transparence et la rigueur scientifique les réponses attendues par l’ensemble des parties intéressées, notamment les professionnels de la conchyliculture et les consommateurs.
Je crois savoir que l’OPECST va entreprendre une étude sur les enjeux économiques et environnementaux des biotechnologies, la question des huîtres triploïdes pourrait, me semble-t-il, être utilement examinée dans ce cadre.
Par ailleurs et d’une façon générale, l’État continue de soutenir l’effort de recherche dans le domaine ostréicole, notamment au travers de la convention annuelle entre mon ministère et l’IFREMER.
Les travaux d’innovation et de recherche dans le secteur ostréicole sont essentiels, dans le contexte des mortalités d’huîtres. À cet égard, le programme ambitieux de recherche SCORE témoigne de l’engagement de l’État, aux côtés des collectivités et de la profession, pour améliorer la résistance des huîtres au phénomène des mortalités. Plus globalement, le ministère finance une convention aquacole spécifique avec l’IFREMER, dont une large partie est consacrée aux mortalités ostréicoles.
Beaucoup d’entre vous ont évoqué les questions sanitaires liées aux mortalités. C’est un sujet important que nous devons aborder conjointement avec le ministère de l’agriculture, compétent en la matière, à la suite de la diffusion d’un rapport commandé par la direction générale de l’alimentation sur l’amélioration de la situation zoosanitaire dans la conchyliculture, le rapport Vannier.
Nous devons faire face aujourd’hui à l’échéance des brevets de l’IFREMER. La production d’huîtres tétraploïdes est aujourd’hui, en France, exclusivement réalisée par l’IFREMER.
Toutefois, un brevet qui n’est plus utilisé depuis des années est tombé dans le domaine public cette année et le contrat d’objectifs de l’établissement prévoit le transfert complet de la technologie à la profession à l’horizon 2017.
Soyons clairs : il existe deux brevets, dont l’un est tombé dans le domaine public depuis quelques années, mais n’est pas utilisé dans la réalité. La question concerne le second brevet, qui est encore aujourd’hui détenu par l’IFREMER. Nous devons nous en saisir.
Je souhaite que nous puissions l’aborder avec calme et sérénité. La prudence s’impose face à certaines accusations vis-à-vis de l’IFREMER, qui est un établissement public mondialement reconnu. J’ai eu l’occasion récemment d’en discuter avec son P-DG, François Jacq.
Le contrat d’objectifs État-IFREMER pour 2014–2017 prévoit le transfert de l’activité de production des tétraploïdes. Ce transfert doit être préparé et accompagné, il n’est pas question de laisser cette technologie sans un encadrement adapté.
En effet, la production d’huîtres tétraploïdes par des opérateurs privés en vue de la commercialisation de naissains d’huîtres triploïdes justifie un encadrement réglementaire rigoureux. Cet encadrement est en cours d’élaboration, c’est une priorité forte de mon ministère. Nous y travaillons pour parvenir à une mise en œuvre effective au début de l’année 2016.
Cet encadrement réglementaire doit permettre d’assurer un niveau optimal de sécurité environnementale, c’est essentiel. Il relève des prérogatives de l’État de l’élaborer et d’en assurer l’effectivité. La mise en place de ce cadre sécurisé répond en outre aux recommandations du comité d’éthique et de précaution pour la recherche de l’IFREMER.
L’objectif de protection de l’environnement et le souci de ne pas créer un dispositif réglementaire ad hoc pour un nombre réduit d’opérateurs orientent notre réflexion vers le régime des installations classées pour la protection de l’environnement, les ICPE. Les services du ministère, en relation avec l’IFREMER et la profession, travaillent actuellement à l’élaboration de ce cadre.
La mise en place de ce cadre réglementaire a été reconnue comme un préalable incontournable à un transfert complet de la production des huîtres triploïdes de l’IFREMER vers d’autres opérateurs. Le rôle des structures professionnelles est par ailleurs essentiel, des réflexions sont en cours au sein du Comité national de la conchyliculture sur la mise en place d’un « centre technique national » géré par l’interprofession.
Dans le même temps, monsieur Joël Labbé, je partage votre ambition d’une information adéquate et renforcée du consommateur. Sur ce point, la profession conchylicole a fait un important effort de développement des signes officiels de qualité afin de répondre aux exigences de transparence provenant des consommateurs : label rouge, indications géographiques protégées, appellations d’origine protégées, ou AOP.
Dans ce même objectif de réponse aux besoins d’information des consommateurs, la question des huîtres triploïdes est amplement débattue. Ces débats semblent se concentrer plus particulièrement sur l’ostréiculture, alors que, comme je l’ai souligné précédemment, de nombreuses autres filières, animales et végétales, ont recours à des espèces polyploïdes sans qu’il y ait d’exigences d’étiquetage et sans que de tels débats apparaissent.
Promouvoir un étiquetage de l’origine du naissain pour distinguer celui qui est issu du captage naturel me semble, en tout état de cause, une idée intéressante, qui mérite d’être encouragée ; j’y suis tout à fait favorable. Un tel étiquetage devra être accompagné d’une véritable traçabilité à l’élevage, pour permettre le contrôle de l’origine du naissain.
Enfin, la question de la production des huîtres triploïdes doit être abordée dans le cadre plus global d’un projet de filière.
Le secteur ostréicole doit faire face depuis 2008, année de survenue des surmortalités, à un questionnement global sur le ou les modèles de production, qui dépasse la seule question des huîtres triploïdes.
Comme l’a souligné M. Vaugrenard, l’État s’est fortement engagé, et plus de 150 millions d’euros ont été mobilisés depuis 2008 en soutien direct des entreprises. L’accompagnement de la filière conchylicole sera poursuivi dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, le FEAMP, car le secteur de l’aquaculture en est une partie essentielle. Plusieurs mesures seront d’ailleurs gérées directement par les Régions, au plus proche des territoires.
Au-delà, les questions de régulation de la production, de gouvernance, de gestion des ressources génétiques, de pratiques culturales et de régulation du marché sont des problématiques englobantes qui nécessitent une mobilisation des structures professionnelles sur un projet de filière, dans une logique de partenariat avec l’État et les collectivités territoriales.
J’ai réuni il y a peu de temps l’ensemble des comités régionaux et le Comité national de la conchyliculture pour échanger sur ces enjeux d’avenir. Je leur ferai également part des principales conclusions et idées de ce débat très intéressant.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. Gilbert Barbier applaudit également.

M. Joël Labbé. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je vous remercie. J’ai souhaité ce débat au nom du groupe écologiste. S’il est loin d’être achevé, il est bien amorcé. Vous y avez pris des engagements, si je vous ai bien compris, monsieur le secrétaire d’État
M. le secrétaire d’État opine.

Il est important de dire aujourd’hui qu’il faut prendre cette question à bras-le-corps. Trop longtemps, le silence et l’omerta ont régné sur ce sujet. Il ne fallait pas en parler !
Sourires.

On nous disait : « Vous allez faire couler l’ensemble de la profession ! » Il faut pourtant regarder le problème en face, sans accuser personne. Des procédures existent pour cela, qui ne sont pas de notre ressort. En revanche, il nous revient de soulever la question et de rendre le débat public, afin de parvenir à des décisions politiques. Ainsi, nous sommes dans notre rôle.
Nous n’entendons ni stigmatiser une profession ni griller les étapes pour prendre des décisions à la volée. Ce que nous voulons, c’est que les choses soient dites et que nous parvenions à travailler avec la profession. Celle-ci ne peut pas décider seule et attendre que les politiques suivent : nous devons travailler ensemble. La profession réunit des acteurs divers : les écloseurs, l’IFREMER, les ostréiculteurs, dont certains revendiquent de travailler de manière traditionnelle et sont regroupés au sein de l’Association Ostréiculteur traditionnel, et le Comité national de la conchyliculture, qui représente l’ensemble de l’ostréiculture. Beaucoup d’ostréiculteurs travaillent à la fois avec des naissains naturels et des naissains d’écloserie.
Une des bases de ces travaux devrait être la transparence vis-à-vis des consommateurs. On ne peut plus dire : « Après tout, les consommateurs n’ont pas besoin de savoir car ces produits ne les rendront pas malades. » Le consommateur est de plus en plus exigeant, et c’est une bonne chose.
On m’objectera que si le consommateur a envie de manger des huîtres l’été, on ne l’en empêchera pas. Il faut pourtant que le consommateur sache que la production d’huîtres connaît une saisonnalité, tout comme d’autres productions, d’ailleurs. S’il ne mange pas d’huîtres l’été, il pourra toujours manger autre chose, y compris certains fruits de mer consommables en cette saison.
Un aspect extrêmement important de ce problème est la volonté de chacun de privilégier la compétitivité et la croissance, et de poursuivre l’impératif absolu du développement, quels que soient les dégâts collatéraux. Sans accuser personne, de tels dégâts ont déjà eu lieu dans le secteur conchylicole : certaines écloseries ayant dû fermer leurs portes, nombre de personnes se sont retrouvées durablement au chômage, ce qui est fort regrettable.
On nous pose une autre question sur les conséquences de l’introduction dans le milieu d’huîtres triploïdes plus vulnérables à la bactérie en cause que les huîtres naturelles : cette introduction favorise-t-elle la contamination des autres huîtres adultes par cette bactérie ? La réponse dépend sans doute d’un rapport de force, mais n’étant pas scientifique, je ne me lancerai pas dans une explication scientifique.
En revanche, j’ai tenu à entendre des experts pour mieux comprendre les mécanismes à l’œuvre. À les écouter, la question est très complexe : à dire vrai, les scientifiques eux-mêmes n’ont pas de réponse toute faite. Le problème majeur, comme il a été dit à plusieurs reprises, et encore dans mon propos initial, est le manque d’évaluations de l’impact sur le milieu naturel à moyen terme et long termes. Ces études n’ont pas été faites parce que, là encore, on n’a pas pris le temps, obsédé qu’on était par le progrès et la croissance : on verra bien plus tard, on se débrouillera…
Il est temps aussi d’en finir avec cette mentalité. Je suis un élu généralement impatient, vous l’aurez compris. Quand on m’interpelle en me demandant : « Qu’attendez-vous donc ? », je me pose la même question.
Heureusement, nous jouissons de l’initiative parlementaire par le biais de propositions de loi, mais aussi de la possibilité d’organiser des colloques, qui sont autant de temps forts pour faire entendre les gens qui ont à s’exprimer.
Je vous donne rendez-vous, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 10 juin, pour un colloque organisé au Sénat. Nombre d’acteurs du débat interviendront à la table : les ostréiculteurs traditionnels, qui sont demandeurs d’étiquetage ; le Comité national de la conchyliculture, qui représente la profession ; l’IFREMER ; les écloseurs ; les scientifiques, qu’ils soient spécialistes du milieu naturel littoral ou de l’huître elle-même ; enfin, les consommateurs, lesquels, comme je le disais, ont eux aussi leur mot à dire.
Je n’ai pas encore décidé comment au mieux prolonger ce débat : ce pourrait être par une proposition de loi, par une résolution européenne, qui pourrait s’avérer nécessaire sur la question de l’étiquetage, ou encore par des amendements au projet de loi relatif à la biodiversité. Il faudra en tout cas prendre le chemin de la clarification et de la réduction des risques : on n’a pas le droit de faire prendre des risques aux milieux naturels. Tout le monde y gagnera, la profession en premier.
Pour conclure, je veux vous remercier de la tenue de ce débat et vous donner des rendez-vous successifs. En effet, monsieur le secrétaire d’État, vous avez donné la balle aux parlementaires. Eh bien, que l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques se saisisse aussi de la question, c’est une très bonne chose. Ainsi, nous pourrons avancer en toute transparence dans le bon sens.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC. – M. Gérard Bailly applaudit également.

Nous en avons terminé avec cette question orale avec débat sur les risques inhérents à l’exploitation de l’huître triploïde.

Je rappelle au Sénat que le groupe Union des Démocrates et Indépendants – UC a présenté des candidatures pour la commission des finances et pour la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Le délai prévu par l’article 8 du règlement est expiré.
La présidence n’a reçu aucune opposition.
En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame :
- M. Nuihau Laurey membre de la commission des finances ;
- et Mme Lana Tetuanui membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.