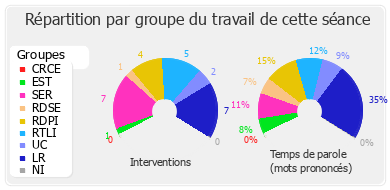Séance en hémicycle du 31 janvier 2018 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-sept heures trente-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

La séance est reprise.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie à dix-neuf heures vous ont été adressées par courriel et sont consultables sur le site du Sénat.
Elles seront considérées comme adoptées en l’absence d’observations d’ici à la fin de la séance de ce soir.
SEMAINE SÉNATORIALE
Jeudi 1er février 2018
À 10 h 30
- Deuxième lecture du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (texte de la commission, n° 248, 2017-2018) (demande du Gouvernement).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 31 janvier matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 31 janvier à 15 heures.
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 1er février à 11 heures.
De 16 h 15 à 20 h 15
(Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)
- Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, présentée par Mme Nicole Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain (texte de la commission, n° 237, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 31 janvier matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 31 janvier à 15 heures.
- Proposition de loi relative à la réforme de la caisse des Français de l’étranger, présentée par MM. Jean-Yves Leconte, Richard Yung, Mmes Claudine Lepage et Hélène Conway-Mouret (texte de la commission, n° 239, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 31 janvier matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 31 janvier à 15 heures.
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 6 février 2018
À 14 h 30
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (texte de la commission, n° 263, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois avec des saisines pour avis de la commission des affaires économiques, de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 31 janvier matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 6 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 5 février à 15 heures.
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 6 février à 12 h 30.
À 17 h 45 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (texte de la commission, n° 263, 2017-2018).
Mercredi 7 février 2018
À 14 h 30 et le soir
- Nomination des vingt-et-un membres de la commission d’enquête sur l’organisation et les moyens des services de l’État pour faire face à l’évolution de la menace terroriste après la chute de l’État Islamique.
• Délai limite de remise, au secrétariat de la direction de la législation et du contrôle, des candidatures pour cette commission d’enquête : mardi 6 février à 16 heures.
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 (texte de la commission, n° 263, 2017-2018).
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (texte de la commission, n° 242, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication avec une saisine pour avis de la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 1er février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 7 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 6 février à 15 heures.
Jeudi 8 février 2018
À 10 h 30, 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Dépôt du rapport annuel de la Cour des comptes par M. Didier Migaud, Premier président de la Cour des comptes.
• Temps attribué à la commission des finances : 10 minutes.
• Temps attribué à la commission des affaires sociales : 10 minutes.
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants (texte de la commission, n° 242, 2017-2018).
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 13 février 2018
À 9 h 30
- Vingt-six questions orales.
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 0149 de Mme Nelly Tocqueville à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
(Part d’énergie nucléaire dans le mix énergétique à l’horizon 2025)
• n° 0152 de M. Bernard Delcros à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
(Installation d’officines de pharmacie et seuil minimal de population dans les communes rurales)
• n° 0155 de Mme Mireille Jouve à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
(Aide financière de l’État au centre hospitalier universitaire de Marseille)
• n° 0156 de Mme Martine Berthet à M. le ministre de l’économie et des finances.
(Finances des territoires touristiques de montagne)
• n° 0158 de M. Édouard Courtial à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.
(Barreau ferroviaire Roissy-Picardie)
• n° 0160 de M. Daniel Gremillet à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
(Engorgement des services de l’état civil des communes sièges d’un tribunal d’instance)
• n° 0162 de M. Didier Mandelli à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
(Choix de la ville de la nouvelle prison de Vendée)
• n° 0163 de Mme Christine Herzog à Mme la ministre, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, chargée des affaires européennes.
(Élus locaux travailleurs frontaliers)
• n° 0167 de Mme Victoire Jasmin à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
(Protection de l’enfance et contrats locaux de sécurité)
• n° 0168 de M. Jean-Raymond Hugonet à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.
(Situation de l’autoroute A10 en Île-de-France)
• n° 0169 de M. Patrick Chaize à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
(Insuffisance en moyens humains du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse)
• n° 0170 de M. Pascal Savoldelli à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.
(Réalisation du quatrième plan autisme)
• n° 0174 de M. Gilbert-Luc Devinaz à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
(Situation au Togo)
• n° 0177 de M. Vincent Delahaye à M. le ministre de l’économie et des finances.
(Situation des greffiers des tribunaux de commerce)
• n° 0178 de M. Jean-Yves Roux à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.
(Desserte de Digne-les-Bains par la nationale 85)
• n° 0179 de Mme Gisèle Jourda à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.
(Conséquences de la perte de la compétence eau-assainissement dans l’Aude)
• n° 0181 de M. Alain Marc à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.
(Systèmes participatifs de garantie en agriculture biologique)
• n° 0182 de M. Max Brisson à M. le ministre de l’économie et des finances.
(Utilisation de l’Eusko par la ville de Bayonne)
• n° 0186 de Mme Nadine Grelet-Certenais à Mme la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.
(Nuisances provoquées par la ligne à grande vitesse Bretagne-Pays-de-la-Loire)
• n° 0187 de Mme Pascale Gruny à Mme la ministre des solidarités et de la santé.
(Lutte contre la désertification médicale dans l’Aisne)
• n° 0188 de M. Marc-Philippe Daubresse à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.
(Retour en France des djihadistes de nationalité française)
• n° 0190 de Mme Maryvonne Blondin à Mme la ministre de la culture.
(Difficultés des correctrices et correcteurs d’édition)
• n° 0191 de M. Daniel Chasseing à M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de la cohésion des territoires.
(Situation du logement social)
• n° 0192 de M. Richard Yung à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
(Enfants franco-japonais au centre d’un conflit parental)
• n° 0194 de M. Olivier Cigolotti à M. le ministre de l’économie et des finances.
(Démarchage téléphonique)
• n° 0198 de M. Christophe Priou à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.
(Situation du tribunal de Saint-Nazaire)
À 14 h 30 et le soir
- Projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 12 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 13 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 12 février à 15 heures.
Mercredi 14 février 2018
À 14 h 30 et le soir
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social (texte de la commission n° 265, 2017-2018).
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 13 février à 15 heures.
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 13 février à 15 heures.
- Suite du projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
Jeudi 15 février 2018
À 10 h 30
- Quatre conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation de l’amendement au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (n° 186, 2017-2018).
=> Projet de loi autorisant l’approbation du protocole additionnel à l’accord du 9 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne relatif à la coopération dans leurs zones frontalières entre les autorités de police et les autorités douanières concernant l’emploi transfrontalier d’aéronefs (n° 62, 2017-2018).
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part (n° 187, 2017-2018).
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant l’approbation du protocole annexe à la convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale du 1er octobre 1980 relatif aux soins de santé programmés dispensés en France aux ressortissants algériens assurés sociaux et démunis non assurés sociaux résidant en Algérie (n° 188, 2017-2018).
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 13 février à 15 heures.
- Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l’évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement (texte de la commission, n° 199, 2017-2018).
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 février à 15 heures.
- Suite du projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 15 février à 11 heures.
À 16 h 15 et, éventuellement, le soir
- Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 14 février à 15 heures.
- Suite du projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
SEMAINE DE CONTRÔLE
Mardi 20 février 2018
De 15 heures à 16 heures
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 19 février à 15 heures.
De 16 heures à 16 h 30 :
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
À 16 h 30
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi organique relatif à l’organisation de la consultation sur l’accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie (procédure accélérée) (n° 152, 2017-2018).
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 20 février à 12 h 30.
À 17 h 45
- Débat sur les conclusions du rapport d’information « Femmes et agriculture : pour l’égalité dans les territoires » (demande de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes).
• Temps attribué à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 10 minutes (y compris la réplique), puis réponse du Gouvernement.
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de vingt et une questions-réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 19 février à 15 heures.
À 21 h 30
- Débat sur l’avenir de l’audiovisuel public (demande de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et du groupe Les Républicains).
• Temps attribué à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication : 10 minutes (y compris la réplique).
• Temps attribué au groupe Les Républicains : 10 minutes (y compris la réplique).
• Réponse du Gouvernement.
• Après la réponse du Gouvernement, séquence de vingt et une questions-réponses : 2 minutes maximum par orateur (y compris la réplique) avec possibilité d’une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 19 février à 15 heures.
Mercredi 21 février 2018
De 14 h 30 à 18 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe Union Centriste)
- Proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat, présentée par Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues (n° 589, 2016-2017).
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 2 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 15 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 21 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 20 février à 15 heures.
À 21 h 30
- Proposition de résolution au nom de la commission des affaires européennes, en application de l’article 73 quater du règlement, sur les directives de négociation en vue d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Australie, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, présentée par MM. Pascal Allizard et Didier Marie (n° 229, 2017-2018) (demande de la commission des affaires économiques, de la commission des affaires européennes et de la commission des affaires étrangères).
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 21 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 20 février à 15 heures.
Jeudi 22 février 2018
De 14 h 30 à 18 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe du RDSE)
- Proposition de loi visant à renforcer la prévention des conflits d’intérêts liés à la mobilité des hauts fonctionnaires, présentée par M. Jean-Claude Requier et plusieurs de ses collègues (n° 205, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 21 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 21 février à 15 heures.
- Proposition de loi sur le régime de l’exécution des peines des auteurs de violences conjugales, présentée par Mme Françoise Laborde et plusieurs de ses collègues (n° 621, 2016-2017).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 21 février matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 21 février à 15 heures.
Suspension des travaux en séance plénière : du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018.
SEMAINE SÉNATORIALE
Mardi 6 mars 2018
À 9 h 30
- Questions orales.
À 14 h 30 et le soir
- Proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit, présentée par M. Patrick Chaize et plusieurs de ses collègues (n° 83, 2017-2018) (demande du groupe Les Républicains).
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 6 mars en début d’après-midi.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 5 mars à 15 heures.
Mercredi 7 mars 2018
De 14 h 30 à 18 h 30
(Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)
- Proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d’impact des projets de loi, présentée par M. Franck Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 610 rectifié, 2016-2017).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 7 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 6 mars à 15 heures.
- Proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d’évaluation des politiques publiques et du bien-être, présentée par M. Franck Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 611 rectifié, 2016-2017).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 7 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 6 mars à 15 heures.
De 18 h 30 à 20 h 30 et de 22 h 00 à minuit
(Ordre du jour réservé au groupe CRCE)
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraites agricoles en France continentale et dans les outre-mer (n° 368, 2016-2017).
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires sociales.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 19 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 février matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 7 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 6 mars à 15 heures.
Jeudi 8 mars 2018
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 8 mars à 11 heures.
De 16 h 15 à 20 h 15
(Ordre du jour réservé au groupe La République En Marche)
- Proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce, présentée par M. Thani Mohamed Soilihi (texte de la commission, n° 658, 2015-2016).
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 5 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 7 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 7 mars à 15 heures.
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 13 mars 2018
À 14 h 30
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
Ce texte a été envoyé à une commission spéciale.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : vendredi 16 février à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 21 février après-midi.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 8 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 13 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 12 mars à 15 heures.
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 13 mars à 12 h 30.
À 17 h 45 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
Mercredi 14 mars 2018
À 14 h 30 et le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
Jeudi 15 mars 2018
À 10 h 30, à 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
Mardi 20 mars 2018
À 9 h 30
- Questions orales.
De 15 heures à 16 heures
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 19 mars à 15 heures.
De 16 heures à 16 h 30
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
À 16 h 30
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour un État au service d’une société de confiance (n° 259, 2017-2018).
À 16 h 45 et le soir
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la protection des données personnelles (procédure accélérée) (A.N., n° 490).
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 12 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 14 mars matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 19 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 20 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 19 mars à 15 heures.
Mercredi 21 mars 2018
À 14 h 30 et, éventuellement, le soir
- Débat préalable à la réunion du Conseil européen des 22 et 23 mars.
• Intervention liminaire du Gouvernement : 10 minutes.
• 8 minutes attribuées à chaque groupe politique et 5 minutes aux sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 20 mars à 15 heures.
• 8 minutes attribuées respectivement à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, à la commission des affaires européennes et à la commission des finances.
• Après la réponse du Gouvernement, débat spontané et interactif de 1 heure : 2 minutes maximum par sénateur avec possibilité d’une réponse du Gouvernement ou de la commission des affaires européennes.
- Sous réserve de sa transmission, suite du projet de loi relatif à la protection des données personnelles (procédure accélérée) (A.N., n° 490).
Jeudi 22 mars 2018
À 10 h 30
- Trois conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi autorisant la ratification de l’accord instituant la Fondation internationale UE-ALC (n° 249, 2017-2018).
=> Sous réserve de sa transmission, projet de loi autorisant la ratification du protocole n° 16 à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (A.N., n° 510).
=> Projet de loi autorisant la ratification de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) (n° 582, 2016-2017).
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 20 mars à 15 heures.
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (procédure accélérée) (A.N., n° 368).
Ce texte sera envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 5 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 7 mars matin.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 15 mars à 12 heures.
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 21 mars matin.
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure.
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 21 mars à 15 heures.
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement.
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 22 mars à 11 heures.
À 16 h 15
- Éventuellement, suite du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (procédure accélérée) (A.N., n° 368).
Prochaine réunion de la conférence des présidents : mardi 6 février 2018, à 16 heures 20.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public, présentée par MM. Bruno Retailleau et Michel Savin et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 439 [2016-2017], texte de la commission n° 246, rapport n° 245).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau, auteur de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord saluer l’excellent travail accompli sur ce texte par M. le rapporteur.
Permettez-moi d’exposer très rapidement les problèmes qui sont à l’origine de l’élaboration de cette proposition de loi et les solutions que nous avons envisagées pour y remédier.
Le régime de responsabilité actuel pour les propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public où sont pratiqués des sports et loisirs de nature est celui de la responsabilité sans faute. Cela résulte de l’article 1242 du code civil, aux termes duquel « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
La jurisprudence récente a ajouté une force supplémentaire à l’interprétation rigoureuse de la responsabilité du fait des choses : dans une décision de 2010 concernant une piste de karting, la Cour de cassation a réaffirmé que l’acceptation, par la victime d’un accident, des risques liés à cette activité n’exonérait en rien l’exploitant de la structure de sa responsabilité sans faute.
Ce raisonnement a été transposé, plus récemment encore, à une affaire où deux grimpeurs ont été blessés en escaladant une falaise dans les Pyrénées-Orientales. Cela a abouti à la condamnation de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, qui était gestionnaire du site.
Ce régime de responsabilité se révèle donc manifestement inadapté à la pratique actuelle de nombreuses activités de plein air : escalade, trail, rafting, jeux de piste, etc. Ces activités se déroulent souvent sans supervision directe, voire sans connaissance du propriétaire ou du gestionnaire des sites. Il y a donc là un contentieux potentiel d’une ampleur assez considérable.
Surtout, il y a une réelle asymétrie de la responsabilité, les propriétaires et gestionnaires supportant une responsabilité disproportionnée par rapport à leur capacité réelle à fournir les équipements ou l’encadrement de sécurité adaptés aux sites dont ils ont la garde.
Ainsi, dans de nombreux cas, il paraît difficilement justifiable d’engager cette responsabilité sans faute. En poussant le raisonnement, pourquoi le propriétaire serait-il responsable de la blessure d’un randonneur imprudent qui aurait pénétré à son insu sur un site naturel ?
Il existe une deuxième asymétrie, entre propriétaires privés et gestionnaires de sites, dont la responsabilité sans faute est engagée presque systématiquement en cas de dommages, et propriétaires publics de sites comparables, la responsabilité de ces derniers étant appréciée « au regard des risques inhérents à la circulation dans les espaces naturels », ce qui l’atténue significativement.
Il y a dès lors un effet désincitatif à la pratique authentique de ces activités en plein air. Soit les propriétaires et gestionnaires préfèrent ne prendre aucun risque et ferment les sites aux pratiquants de ces activités, soit les sites demeurent ouverts mais sont soumis à un certain nombre de contraintes, notamment un alourdissement de leurs aménagements de sécurité et de leur fonctionnement.
J’en viens à la teneur de cette proposition de loi et aux changements que nous souhaitons apporter.
Cette proposition de loi vise à remédier à l’asymétrie que j’évoquais à l’instant en procédant à un rééquilibrage de la responsabilité en faveur des propriétaires et gestionnaires des sites, afin de leur permettre d’offrir des conditions saines de pratique des sports et activités de pleine nature.
Cette idée n’est pas entièrement nouvelle. En effet, l’article L. 365-1 du code de l’environnement marque déjà un infléchissement en faveur des propriétaires et gestionnaires publics de certains terrains de pleine nature, tels que les parcs naturels ou les sentiers de promenade et de randonnée.
Aujourd’hui, l’important développement des activités de pleine nature doit inciter le législateur à prévenir plutôt qu’à guérir. Notre intervention dans ce domaine est donc parfaitement légitime et utile.
Qui plus est, il y a ici une possibilité pour le Sénat d’agir comme force de proposition et d’entamer une réflexion qui s’inscrira dans la préparation de la prochaine réforme du droit de la responsabilité civile. Mais de cette réforme, j’entends parler depuis une dizaine d’années, et c’est d’ailleurs parce qu’elle devait intervenir que l’on ne souhaitait pas modifier le code civil à la suite de la jurisprudence de l’Erika. Heureusement, madame la secrétaire d’État, le préjudice écologique est désormais entré dans le code civil, le Sénat ayant défriché le terrain.
Cette proposition de loi crée, par son article 1er, un régime dérogatoire du droit commun de la responsabilité sans faute au bénéfice de tous les propriétaires et gestionnaires de sites naturels. Ce faisant, elle remet à jour la théorie de l’acceptation des risques – c’est en fait une théorie de la responsabilisation –, suivant laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risques accepte aussi d’en supporter les conséquences. Cela me paraît tout naturel.

Le dispositif que nous proposons est équilibré. Il permettra de mieux protéger les propriétaires contre la mise en cause de leur responsabilité pour des dommages sur lesquels ils n’ont que peu ou pas du tout de prise.
Cette dérogation ne concerne que les dommages nés de la pratique d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs, et n’affecte donc pas de manière générale et absolue leur responsabilité sans faute ni leur responsabilité pour faute, qui pourront toujours être engagées.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, chers collègues, selon le baromètre des sports et loisirs de nature en France paru en 2016, trois Français sur quatre de plus de 15 ans, soit plus de 34, 5 millions de personnes au total, déclarent pratiquer régulièrement un sport ou une activité de loisirs de nature.
Toujours selon cette enquête, ces activités ont un impact socio-économique non négligeable, puisque les sports et loisirs de nature généreraient près de 6 milliards d’euros de dépenses par an.
La proposition de loi que nous examinons vise à favoriser le développement de ces activités qui s’exercent dans des sites peu aménagés, propriétés de personnes privées ou relevant du domaine privé des personnes publiques, car elles constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales.
Or ce développement serait entravé par une application stricte du droit commun de la responsabilité civile. En effet, ces espaces sont soumis au régime de la responsabilité du fait des choses, régi par le premier alinéa de l’article 1242 du code civil, ancien article 1384, comme le savent les très vieux juristes comme moi…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale. N’exagérons rien !
Sourires.

J’avais appris cela en première année de droit ; cela remonte à très loin !
En application de ce principe très général, le propriétaire d’un site naturel – ou son gestionnaire s’il avait transféré à celui-ci sa garde juridique par convention – peut voir sa responsabilité civile engagée pour des branches qui tombent ou des pierres qui roulent, dès lors que la victime démontre que la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, alors même que le gardien n’a commis aucune faute. Il ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité, sauf à prouver l’existence d’un cas de force majeure – notion appréciée très strictement par les juges – ou d’une faute de la victime.
L’article unique de la proposition de loi prévoyait donc de compléter l’article L. 365-1 du code de l’environnement, pour basculer d’un régime de responsabilité du fait des choses vers un régime de responsabilité pour faute du gestionnaire ou du propriétaire du site naturel.
Bien que partageant l’objectif des auteurs de la proposition de loi, la commission a estimé que ce texte suscitait certaines interrogations, auxquelles il était nécessaire d’apporter des réponses précises.
Une première interrogation porte sur l’opportunité même d’une intervention du législateur.
Le contentieux de la responsabilité civile des gestionnaires et des propriétaires du fait de dommages causés sur des sites naturels est peu abondant, voire inexistant, ces dernières années pour les personnes publiques. Le dépôt de la proposition de loi fait suite à un jugement isolé de première instance rendu à Toulouse, contre lequel un appel a été interjeté. Dès lors, fallait-il légiférer ?
C’est la première question que j’ai posée en ma qualité de rapporteur. La commission a estimé que la quasi-absence de contentieux en matière de responsabilité civile des gestionnaires et propriétaires de sites naturels n’est pas un argument en faveur du statu quo. Elle est surtout révélatrice de la très grande attention portée, nous dit-on, par les fédérations, en particulier à la sécurité des pratiquants de sports de nature.
La commission a donc considéré que l’important développement de ces pratiques de plein air justifiait pleinement d’anticiper les difficultés à venir et les éventuels tâtonnements jurisprudentiels par la fixation de règles précises.
Fallait-il ensuite s’opposer à la création d’un nouveau régime spécial, alors même qu’une grande réforme de la responsabilité civile est annoncée par la Chancellerie ?
Le président Retailleau l’a dit, les réticences qui ont été exprimées sont parfaitement compréhensibles. Cependant, il me semble utile de rappeler que, faute d’évolutions législatives depuis 1804, la responsabilité du fait des choses est devenue une construction jurisprudentielle, engagée à la fin du XIXe siècle pour prendre en considération des problématiques qui n’existaient pas lors de l’élaboration du code civil.
Comme il l’a déjà fait pour certaines situations spécifiques, le législateur est donc, à notre avis, tout à fait légitime à intervenir pour créer un régime adapté aux contraintes particulières inhérentes à ces sites naturels. Fallait-il alors attendre le grand projet de réforme de la responsabilité civile annoncé par le ministère de la justice pour intervenir ?
La commission des lois a estimé, au contraire, que la proposition de loi constituait une belle occasion pour le Sénat d’engager la réflexion sur ce sujet, voire d’être à l’initiative de dispositions utiles et attendues, comme ce fut le cas pour la consécration de la réparation du préjudice écologique.
S’agissant du dispositif de la proposition de loi lui-même, la commission a considéré qu’il soulevait des difficultés d’articulation avec le reste de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, d’une part, et des difficultés d’application en raison de l’imprécision des notions utilisées, d’autre part.
À titre d’exemple, l’utilisation de la notion de « responsabilité civile » posait question. Si elle couvrait, certes, la responsabilité délictuelle, elle englobait également la responsabilité contractuelle du propriétaire ou du gestionnaire, ce qui n’était pas, je pense, l’objectif des auteurs du texte. Le dispositif aurait permis une exonération totale de responsabilité de ces personnes, hors les cas où elles ont commis une faute.
Ainsi, un manquement non fautif à l’obligation de sécurité mise par la jurisprudence à la charge de l’exploitant d’un site payant n’aurait plus permis d’engager la responsabilité de cet exploitant à l’égard de la victime du dommage. Il en aurait résulté un transfert du risque pesant actuellement sur l’exploitant, d’une station de ski par exemple, souvent professionnel et bien assuré, vers son client, seulement couvert – et encore, ce n’est pas toujours le cas – par une assurance de dommages personnels.
Autant dire qu’il n’était pas possible d’en rester à la notion de responsabilité civile simple. Il fallait scinder très clairement les notions de responsabilité délictuelle et de responsabilité contractuelle.
Quant au champ des personnes bénéficiaires de cette exonération, la référence aux « propriétaires et gestionnaires de sites » ne permettait pas de couvrir l’ensemble des gardiens potentiels de la chose. Quid du locataire si l’on ne vise dans la loi que le propriétaire ou le gestionnaire du site ?
Enfin, l’utilisation de la notion de « circulation du public » était également problématique, car elle pouvait renvoyer à la circulation d’engins motorisés relevant du régime spécial de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la commission a adopté une nouvelle rédaction complète de l’article unique du texte, mais exclusivement afin d’apporter les précisions indispensables à la sécurité juridique du dispositif. Les auditions d’hommes de loi que nous avons menées sur le sujet ont achevé d’éclairer le rapporteur que je suis.
La rédaction retenue écarte explicitement le jeu de la responsabilité du fait des choses des gardiens des sites dans lesquels s’exercent les sports de nature ou les activités de loisirs, en cas de dommages subis par les pratiquants de ces sports et activités. Puisque le régime de responsabilité de plein droit ne pourrait plus s’appliquer, la responsabilité du gardien du site dans lequel a eu lieu le dommage devrait être recherchée sur le fondement de la faute, comme le souhaitent les auteurs du texte.
Cette solution repose sur la théorie de l’acceptation des risques, bien connue dans le domaine sportif, en vertu de laquelle celui qui accepte de participer à une activité à risque en supporte les conséquences, ce qui revient à alléger ou supprimer la responsabilité de l’auteur ou du responsable du dommage.
Cette théorie a été progressivement délaissée par la jurisprudence pour faire bénéficier les victimes du régime plus favorable de la responsabilité de plein droit du fait des choses. Le développement des assurances dans le domaine du sport n’a sans doute pas été étranger à cette évolution.
En restaurant ladite théorie, la commission vous propose de revenir, dans le domaine des sports de nature et des activités de loisirs, à une conception plus limitée de la responsabilité sans faute, qui a seulement pour objet de protéger la victime contre des risques créés par autrui, et non contre des risques auxquels elle participe volontairement par son activité.
Il en résulte une solution équilibrée de partage de responsabilité entre le propriétaire ou le gestionnaire du terrain, qui doit mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour assurer des conditions de sécurité optimales à l’exercice des sports et des activités de loisirs de nature, et les pratiquants, à la recherche d’une nature intacte, qui doivent prendre conscience que, malgré toutes les diligences entreprises par le propriétaire ou le gestionnaire du site – le gardien –, le « risque zéro » n’existe pas quand on pratique l’escalade, l’alpinisme, le vélo ou la randonnée dans des sites naturels peu ou pas aménagés.
La commission a ensuite choisi d’introduire ce dispositif dans le code du sport, au sein des dispositions relatives aux sports de nature, plutôt que dans le code de l’environnement, puisqu’il concerne la pratique de ces sports et les activités de loisirs de plein air qui s’en approchent.
La commission a estimé enfin que, puisque le jeu de la responsabilité du fait des choses était désormais écarté, les indications données au juge pour apprécier cette responsabilité, prévues à l’article L. 365-1 du code de l’environnement, n’avaient plus lieu d’être. Dès lors, elle a complété la proposition de loi par un article 2 qui a pour objet d’abroger cet article.
Mes chers collègues, la commission vous propose d’adopter la proposition de loi ainsi modifiée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi qui vient aujourd’hui en discussion a pour objectif, en modifiant le régime de responsabilité auquel sont soumis les gardiens de sites naturels ouverts au public, d’encourager le développement des sports de nature, qui, comme cela a été rappelé, constituent un atout touristique important pour de nombreuses collectivités territoriales.
Le Gouvernement ne peut que souscrire à un tel objectif, auquel vous me permettrez d’ajouter, plus largement, celui de favoriser la plus large ouverture au public, y compris aux simples promeneurs, des espaces naturels de notre pays, dans des conditions compatibles avec les nécessités de leur conservation. Les préoccupations des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, qui ne doivent pas être dissuadés d’ouvrir ces espaces au public en raison d’un risque excessif de mise en cause de leur responsabilité, sont à cet égard légitimes.
Si la proposition de loi suscite des réserves, c’est donc non pas en raison des objectifs qu’elle poursuit et des préoccupations auxquelles elle entend répondre, mais plutôt des moyens qu’elle emploie.
En l’état actuel du droit, une adaptation du régime de responsabilité des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels est déjà prévue à l’article L. 365-1 du code de l’environnement.
Cette disposition a été introduite en 2006 à l’occasion du vote d’une loi relative aux parcs nationaux et parcs naturels. Elle ne modifie pas le régime de responsabilité applicable, mais, en cas d’accident, elle invite le juge à apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de certains espaces naturels, en tenant compte des caractéristiques particulières de ces espaces, qui, pour des raisons de conservation des milieux, ne peuvent faire l’objet que d’aménagements limités.
La présente proposition de loi va plus loin : dans sa version issue des débats en commission, elle prévoit, au nom de la théorie de l’acceptation des risques, de substituer au régime de responsabilité actuellement applicable devant le juge civil, qui est le régime de responsabilité objective du fait des choses, un régime de responsabilité pour faute, inscrit désormais non plus dans le code de l’environnement, mais dans le code du sport.
Or une telle évolution nous paraît prématurée, et ce pour plusieurs raisons.
En premier lieu, il serait excessif de décrire l’état du droit actuel comme permettant l’engagement automatique de la responsabilité des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels en cas d’accident.
Certes, le régime de « responsabilité du fait des choses » que les juridictions civiles appliquent aux propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels est un régime de responsabilité sans faute. Toutefois, les juridictions, lorsqu’elles sont saisies d’actions en responsabilité, procèdent à une appréciation circonstanciée des faits de l’espèce. Elles recherchent notamment la réalité du rôle causal de la chose et tiennent compte du comportement de la victime pour, le cas échéant, exonérer le gardien de sa responsabilité ou atténuer celle-ci.
À cet égard, comme cela a été rappelé lors des travaux en commission, il faut relativiser la portée du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse de 2016 – M. le président de la commission des lois et M. le rapporteur y ont fait référence –, mentionné dans l’exposé des motifs de la proposition de loi, qui a condamné la Fédération française de la montagne et de l’escalade, en sa qualité de gestionnaire d’une falaise, à indemniser les victimes d’un accident d’escalade.
Il convient tout d’abord de rappeler qu’il a été fait appel de cette décision, qui n’est donc pas définitive. En outre, elle apparaît assez isolée, dans un paysage jurisprudentiel d’ailleurs marqué par un contentieux très faible, alors que, pour ne citer que les parcs nationaux, les réserves naturelles ou les sites du Conservatoire du littoral, la fréquentation cumulée est de 54 millions de visiteurs par an.
De ce point de vue, la nécessité d’une intervention du législateur n’apparaît donc pas avec évidence.
Par ailleurs, je rappelle que, comme votre commission en est parfaitement consciente, le ministère de la justice travaille actuellement à un vaste projet de réforme de la responsabilité civile. Je sais, monsieur le président de la commission, que l’on en entend parler depuis longtemps, mais vous savez aussi que ce gouvernement a pour habitude de faire ce qu’il dit.
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
C’est en tout cas ce qu’il a fait jusqu’à présent !
Ce projet sera l’occasion de faire évoluer certains régimes de responsabilité particuliers – je suis certaine que vous y travaillerez de concert avec nous, puisque ce sujet vous tient à cœur –, dans un cadre permettant de s’assurer de la pertinence de ces évolutions au regard du droit commun de la responsabilité civile.
Je pense notamment à l’article L. 321-3-1 du code du sport, introduit en 2012, après l’abandon par la Cour de cassation de la théorie de l’acceptation des risques en matière sportive, pour écarter l’application du régime de responsabilité du fait des choses dans certains cas de dommages matériels causés par un pratiquant sportif à un autre pratiquant.
Dans ce contexte, introduire aujourd’hui dans le droit positif une nouvelle disposition dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile paraît prématuré. J’ai d’ailleurs cru comprendre, au travers de vos débats en commission, que nombre d’entre vous n’étaient pas insensibles à la nécessité d’une réflexion élargie à l’ensemble du droit de la responsabilité civile.
J’en viens à la troisième raison qui motive notre avis : la rédaction de la proposition de loi issue des travaux en commission, si elle résout certaines difficultés soulevées par la rédaction initiale du texte, paraît problématique à d’autres égards.
Ainsi, cette rédaction ne fait pas référence à la responsabilité administrative, au contraire de l’actuel article L. 365-1 du code de l’environnement, qui invite également le juge administratif, lorsque le litige relève de sa compétence, à tenir compte des contraintes tenant aux nécessités de la préservation des espaces naturels. Cela pourrait conduire à des conditions d’indemnisation différentes selon le juge compétent, alors que, en l’état, dans des cadres théoriques certes distincts, le juge judiciaire et le juge administratif parviennent généralement à des résultats très similaires.
Par ailleurs, les notions d’« espace », de « site » ou d’« itinéraire » retenues par la commission pour définir le champ d’application du texte mériteraient d’être précisées. Il semble en effet nécessaire de limiter expressément ce champ d’application aux seuls espaces « naturels », dès lors que les activités de loisirs peuvent également être pratiquées en dehors de tels espaces, notamment en milieu urbain.
Enfin, et surtout, votre commission propose, en contrepartie de la création d’un nouvel article dans le code du sport, d’abroger purement et simplement l’article L. 365-1 du code de l’environnement. Or le nouveau dispositif ne couvre pas la totalité des champs traités par cet article : en particulier, il ne traite pas de la circulation des piétons. Ce faisant, la proposition de loi laisse sans réponse les préoccupations, à cet égard, des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, lesquelles sont pourtant au cœur de votre travail.
Cette difficulté ne saurait d’ailleurs se régler par un simple élargissement du champ d’application du texte de la commission ; en effet, si l’on peut trouver légitime d’opposer l’acceptation du risque à un sportif qui pratique en toute connaissance de cause une activité risquée, il en va différemment en ce qui concerne le simple promeneur, et le Gouvernement ne saurait souscrire à un texte qui conduirait à un affaiblissement du droit des victimes.
À cet égard, l’équilibre trouvé par l’actuel article L. 365-1 du code de l’environnement paraît devoir être préservé, et l’abrogation de cette disposition n’est pas opportune.
Dans ces conditions, le Gouvernement pourrait souscrire à un texte qui, sans modifier le régime de responsabilité applicable, viendrait étendre le champ d’application, actuellement trop restrictif, de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, initialement visé par la proposition de loi.
C’est pourquoi vous est soumise par voie d’amendement une proposition de réécriture de cet article, afin d’élargir son champ d’application à l’ensemble des personnes propriétaires ou gestionnaires, ainsi qu’à l’ensemble des « espaces naturels ».
La liste des personnes publiques dressée par l’actuel dispositif, qui ne mentionne que l’État et la commune, est en effet trop restrictive. Celle des espaces concernés l’est également, puisque seuls sont visés certains espaces particulièrement protégés.
C’est ainsi que, dans le cas jugé par le tribunal de grande instance de Toulouse, l’article L. 365-1 du code de l’environnement ne pouvait trouver à s’appliquer, le lieu de l’accident ne figurant pas sur cette liste. Or les enjeux de la conciliation entre ouverture au public et préservation du caractère naturel des lieux s’étendent au-delà des seuls espaces naturels protégés.
La réécriture qui vous est proposée en tire les conséquences. Elle ne préjuge pas de la nécessité éventuelle d’une évolution ultérieure du régime de responsabilité spécifiquement applicable en matière sportive : comme je l’ai indiqué, c’est une réflexion qui aura toute sa place dans le cadre de la réforme globale du droit de la responsabilité civile qui a été engagée par le Gouvernement.
Néanmoins, en l’état, il importe, tout en adaptant son champ d’application, de conserver l’économie générale d’un dispositif qui permet de concilier le droit commun de la responsabilité tant civile qu’administrative et la prise en compte des contraintes spécifiques des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, tout en garantissant une protection satisfaisante du droit des victimes.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la période contemporaine est marquée par un attrait croissant pour les sports et activités de pleine nature. Il faut se féliciter de ce phénomène, qui favorise le développement touristique, donc économique, de nos territoires et valorise des espaces naturels.
Le département dont je suis l’élu, la Haute-Savoie, est particulièrement concerné par ce phénomène. Je ne vais pas vous citer ici l’ensemble des activités extérieures qui sont pratiquées chez nous tout au long de l’année, mais simplement vous rappeler quelques disciplines montagnardes emblématiques comme l’escalade, l’alpinisme, le ski, le parapente et, plus récemment, le trail.
Ces activités, comme la plupart des activités de nature, sont par essence à risque, et les pratiquants de ces sports le savent. Ce constat doit nous amener à remarquer une forme de paradoxe : le développement d’activités à risque dans une société dont l’aversion aux risques est de plus en plus grande. Notre époque est en effet marquée par la volonté de limiter le risque, de l’encadrer, de s’assurer contre celui-ci.
Le texte que nous proposent aujourd’hui nos collègues a suscité une double réaction au sein de notre groupe.
Première réaction, partagée par les précédents orateurs : appliquer de manière brutale la responsabilité du fait des choses au propriétaire ou au gestionnaire de sites pour des dommages causés lors d’une pratique sportive sur des sites naturels pose problème. En effet, cela va provoquer un découragement, donc probablement un désengagement, des fédérations sportives, voire des collectivités qui s’étaient organisées pour accompagner et développer ces activités. On comprend alors aisément les répercussions immédiates en matière d’attractivité touristique que cela pourrait engendrer dans nombre de territoires.
Deuxième réaction : le problème de droit qui nous est soumis est réel, mais il ne résulte, a priori – M. le rapporteur nous l’a confirmé –, que d’une décision de justice de première instance. L’affaire est actuellement devant la cour d’appel, dont on ne sait quelle sera son interprétation. Et ne parlons même pas de l’éventualité d’un pourvoi en cassation.
Se pose alors une question de principe : peut-on, doit-on, légiférer maintenant ? Au-delà du fait que ce soit une décision judiciaire isolée, on pourrait aussi se dire qu’il serait préférable d’attendre les travaux de notre Haute Assemblée sur le projet de réforme du droit de la responsabilité qui devrait s’amorcer à la fin de l’année. Mais, là encore, est-ce une raison pour nous empêcher de travailler dès maintenant ?

Notre présence en nombre ce soir montre combien cette question nous intéresse.
Après une réflexion alimentée par les travaux approfondis de notre rapporteur et de la commission des lois, nous avons estimé qu’il était nécessaire que le Sénat s’attaque, dès aujourd’hui, au problème juridique soulevé par nos collègues du groupe Les Républicains.
Le Sénat a intérêt à statuer sur cet aspect particulier de la responsabilité du fait des choses, quitte à ce que ce travail soit un jour intégré à une réforme plus vaste de la responsabilité civile.
En commission, notre rapporteur nous a proposé d’intégrer le nouveau dispositif prévu dans la proposition de loi non pas dans le code de l’environnement, mais dans le code du sport.
Nous souscrivons à cette modification, d’autant plus que ce code prévoit déjà, dans son article L. 321-1-3, une exonération, pour les pratiquants d’une activité sportive, de la responsabilité sans faute pour les dommages matériels à l’encontre d’autres pratiquants du fait des choses sous leur garde. Rappelons au passage que cette évolution de 2012 était, elle aussi, issue d’une initiative parlementaire.
Sur le plan juridique, l’évolution de la matière qui nous occupe aujourd’hui a été largement bouleversée par un revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en 2010 et réduisant le champ d’application de la théorie des risques acceptés. Depuis ce revirement, la responsabilité du fait des choses a désormais vocation à s’appliquer à l’ensemble des dommages causés par le fait d’une chose, quelle que soit la nature de celle-ci, quel que soit le dommage causé et quelle que soit l’activité qui en a été l’occasion.
Les effets de cette décision se sont rapidement fait sentir avec une forte augmentation des primes d’assurance de certaines fédérations, notamment en matière de sport mécanique.
Force est de constater que la problématique que nous examinons ce soir est très spécifique, puisque les « choses » dont nous parlons aujourd’hui ne sont pas des matériels de sport : il ne s’agit pas de la responsabilité des dommages causés par une raquette de tennis ou une moto de compétition… Ces hypothèses, plus classiques, ont déjà donné lieu à de très nombreuses décisions judiciaires.
Ici, il est en fait question, au travers de la notion juridique de « chose », d’éléments qui composent l’environnement naturel d’une pratique sportive, en l’occurrence un rocher sur une paroi d’escalade. On comprend bien que le débat n’est pas tout à fait de même nature.
On comprend surtout qu’en désignant comme juridiquement responsable une fédération sportive pour des dommages qu’elle ne pouvait ni prévoir ni éviter, on la place dans une situation intenable.
L’objectif de cette proposition de loi est très simple, mes chers collègues : trouver le bon aménagement juridique permettant de sauvegarder et de permettre le développement d’activités sportives et de nature. Vous avez ainsi évoqué, madame la secrétaire d’État, le nombre de pratiquants dans notre pays de ce type d’activités.
Je tiens à remercier notre rapporteur de la qualité de son travail, la finesse de son analyse juridique et l’intelligence des apports faits à la proposition de loi initiale. Il nous propose aujourd’hui un dispositif qui pourra sans doute encore être amélioré au cours de la navette parlementaire, mais qui lance le débat et souligne l’implication du Sénat sur cette problématique très importante pour le développement économique et touristique de nos territoires. J’ai, là encore, une pensée pour mon département qui vit de cette activité.
Vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

La parole est à M. Jérôme Durain, pour le groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, comme j’ai eu l’occasion de vous l’indiquer en commission, j’aime les premiers de cordée. Non pas dans l’acception macroniste de la formule, …
Sourires.

M. Jérôme Durain. … mais au sens littéral du terme. Je suis moi-même grimpeur, mais comme cela n’emporte pas d’obligation de déport ou de conflit d’intérêts, je poursuis mon propos.
Nouveaux sourires.

Pour poser les termes du débat qui nous intéresse aujourd’hui, j’ai choisi de partir du nom qu’on donne en escalade à celui qui se trouve à l’autre bout de la corde, tout en bas : il s’agit de l’assureur. Ce terme résume à lui seul toutes les interrogations auxquelles cette proposition de loi veut apporter des réponses, soit la prise de risque, la responsabilité qui y est liée et le financement des dommages en cas d’accident. Autrement dit, qui pratique, qui sécurise et qui paye ?
Ce texte trouve notamment son origine dans un accident d’escalade à Vingrau et dans une décision de justice s’y rapportant. Mais les questions posées intéressent tous les pratiquants de sport de pleine nature, l’ensemble des fédérations qui en régissent la pratique, les propriétaires de sites naturels et les collectivités territoriales qui en assurent le développement et la promotion.
Plusieurs questions philosophiques sous-tendent nos débats aujourd’hui. Quelle place accordons-nous à la prise de risque dans notre société, notamment dans les espaces naturels ?
Quelle part d’acceptation du risque de la part des pratiquants eux-mêmes ? Sur ces sujets, qu’est-ce qui doit relever de la responsabilité individuelle ou de l’assurance d’un tiers ?
Jusqu’où les fédérations et les collectivités doivent-elles être responsables des pratiques individuelles ? Quel est le juste coût des assurances que doivent prendre en charge les pratiquants ?
La première des questions que nous nous sommes posées en commission était : devons-nous légiférer sur la base d’un cas précis et d’une décision de justice, toujours en appel ? Autrement dit, faut-il attendre la Chancellerie et la prochaine réforme du droit de la responsabilité ? Nous avons répondu positivement.
Au-delà du seul cas de Vingrau, c’est tout le développement des sports de pleine nature qui est suspendu aux incertitudes juridiques. Le régime de la responsabilité civile est, me dit-on, intouchable. Pourtant, les textes de 1804, comme la construction jurisprudentielle qui les accompagne, ne sont plus à même de répondre à la complexité des situations auxquelles nous devons faire face aujourd’hui.
Vous avez sans doute lu le récit dans la presse cette semaine du sauvetage héroïque d’Élisabeth Revol. Son histoire a bien commencé, quand elle est devenue la première femme à réussir l’ascension hivernale du Nanga Parbat, en compagnie d’un alpiniste polonais. Le risque fut payant. Puis l’histoire s’est ternie dans la descente, durant laquelle Mme Revol n’a pu s’engager que seule, quand son compagnon de cordée a dû rester au sommet, à l’agonie. Elle a été rejointe par d’autres ressortissants polonais venus à sa rescousse de nuit, à la lampe frontale, dans des conditions dantesques.
Cette histoire, terrible, ne nous intéresse pas aujourd’hui que par son contexte : les montagnes françaises ne sont pas l’Himalaya et l’initiative législative du jour n’aurait que peu d’impact au Pakistan. Elle nous interpelle par les messages qu’elle porte. Nul n’imaginait qu’une opération de sauvetage dans l’Himalaya puisse être payée grâce à un appel au financement participatif, à hauteur de 50 000 dollars, en temps réel, au moment même du drame vécu par Élisabeth Revol sur le Nanga Parbat.
Les pratiques sportives actuelles, dans l’environnement juridique contemporain, requièrent des réponses nouvelles. J’ai le sentiment que cette proposition de loi nous les apporte. Je crois également que le travail de précision juridique, apporté avec beaucoup de minutie par notre rapporteur, va dans le bon sens.
Le grand grimpeur et alpiniste italien Reinhold Messner nous dit que « la montagne n’est ni juste, ni injuste, elle est dangereuse ». Sur la question du risque lié à la pratique des sports de pleine nature, nos efforts doivent précisément porter sur la juste responsabilité de chacun des acteurs concernés. Cela vaut pour les risques ordinaires comme pour les risques exceptionnels.
Pour la clarté de la démonstration, je veux dresser le tableau noir, dans le champ de l’escalade, des conséquences possibles d’une situation où le régime de la responsabilité sans faute continuerait à prévaloir : une fédération, la Fédération française de la montagne et de l’escalade, qui suspend tout ou partie des 800 conventionnements qui la lient à des propriétaires partout en France ; des propriétaires qui interdisent l’accès à leurs sites ; un niveau d’équipement et de sécurisation des sites qui diminue ; des pratiques sauvages ou clandestines qui prospèrent ; des collectivités qui mettent la pédale douce sur la promotion de l’escalade – Loïc Hervé a insisté sur l’intérêt touristique du développement des sports de pleine nature – ou qui, à l’inverse, surinvestissent dans un équipement déraisonnable visant à « bétonner », dans tous les sens du terme, les sites.
Au-delà des risques en matière d’accidentologie, ou des crispations possibles entre propriétaires et pratiquants, il faut considérer sérieusement cette perte de ressource réelle de développement local pour des communes, intercommunalités ou départements qui auraient été prêts, littéralement, à « investir dans la pierre ».
Vous aurez compris que je prône au nom de mon groupe – c’est de circonstance s’agissant d’escalade
Sourires.

On peut considérer à l’échelle nationale que la moitié de la population française pratique la marche ou la randonnée. Trois Français de plus de quinze ans sur quatre déclarent, en 2016, pratiquer un sport de nature, soit 34, 5 millions de personnes.
La contrepartie de ce libre accès et de cette gratuité doit sans doute être recherchée dans l’acceptation sociale d’un risque raisonnable. Cela renvoie à la nécessité, dans le cadre de pratiques non encadrées, d’avoir des pratiquants conscients, formés, assurés. Dans le modèle qui nous intéresse, le rôle des fédérations est central sur ces trois points. Car des pratiquants mieux formés, davantage responsabilisés, cela signifie moins de risque d’accident.
Vous aurez donc compris que tout le monde est concerné par ce texte : l’alpiniste chevronné, le randonneur occasionnel, le « VTTiste » du dimanche. Je souhaite que l’on puisse continuer à emprunter un sentier de grande randonnée, pour aller à Compostelle ou ailleurs, sans devoir se détourner d’un chemin qu’un propriétaire inquiet aurait interdit d’emprunter…

… et que l’on puisse initier des enfants à l’escalade sans analyse juridique préalable.
Au nom de mon groupe, j’apporte mon soutien à cette proposition de loi de M. Retailleau, …

M. Jérôme Durain. … le président d’un groupe avec lequel je suis souvent en désaccord, mais avec lequel il m’arrive aussi de tomber d’accord sur des sujets de niche, comme cette proposition de loi ou l’importance du jeu vidéo !
Sourires et a pplaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Les amendements adoptés en commission me satisfont. Le rapporteur a fait le choix de définir la notion de faute dans un sens plus restrictif qu’initialement prévu, ce qui semble adapté à l’activité visée.
En ce qui concerne l’articulation avec l’actuel article L. 365-1 du code de l’environnement, on comprend que la cohabitation de deux dispositifs risquerait de créer des règles contradictoires.
Je suis plutôt partisan d’en rester à la rédaction adoptée en commission. Et il me tarde d’entendre l’avis de nos collègues de l’Assemblée nationale, dont je ne doute pas qu’ils se saisiront de l’occasion qui leur est offerte de donner de l’écho aux premiers de cordée, aux assureurs, aux randonneurs et à tous ceux qui font des espaces naturels leur terrain de jeu privilégié.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

La parole est à M. Jérôme Bignon, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c’est avec une certaine perplexité que j’aborde cette discussion générale, car si j’ai entendu des propos assez pertinents de la part des orateurs qui sont intervenus précédemment, je n’ai pas le sentiment que l’explication résultant de leur synthèse soit d’une clarté absolue.
Le problème du droit, c’est que les choses peuvent paraître simples lorsqu’une seule solution est offerte, mais qu’elles commencent à devenir compliquées lorsqu’il y en a trois ou quatre… Quand on fait référence à plusieurs codes et à différents sujets en même temps, on entre dans les véritables difficultés.
Un élément nous unit avec certitude – je l’ai senti au travers des applaudissements –, c’est qu’il faut régler le problème. C’était d’ailleurs le sens de la proposition de loi, que j’avais cosignée à l’époque, déposée par Bruno Retailleau avec un certain nombre de membres du groupe Les Républicains, dont d’ailleurs le rapporteur, lequel propose aujourd’hui une autre solution.
Cela montre bien que la situation n’est pas si simple : on propose à un moment donné une solution qui, avec le temps et la réflexion, peut évoluer. C’est pour cette raison que nous avons des débats dans les deux chambres, à la fois en commission et en séance. Je veux d’ailleurs rendre hommage à la réflexion menée par André Reichardt avec les membres de la commission des lois, sous l’égide de son président.
Nous devons répondre à des évolutions sociétales complexes, qui se font jour sur les espaces naturels, et à une forte artificialisation d’un certain nombre de ces espaces qui amoindrit les espaces de nature. Nous assistons à des demandes de plus en plus nombreuses de manifestations sportives, souvent axées sur la performance.
En même temps, nous constatons un grand attachement de nos concitoyens à la nature et aux espaces naturels. On a déjà aussi évoqué l’intérêt touristique pour l’attractivité des territoires de ces espaces naturels. Une valorisation du réseau des sites naturels protégés est une source de bonne santé et de bien-être, avec des aménagements limités pour laisser l’émotion gagner et conserver l’esprit des sites.
On comprend bien tous ces arguments, mais on constate en même temps – c’est un problème – une judiciarisation générale de la société. Dès que l’on reçoit un gravier sur le coin de la tête, on se demande comment faire réparer le préjudice de cette atteinte à son intégrité physique…
Les contentieux en responsabilité exposent les propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, malgré toute l’information fournie et les précautions prises. Si cette tendance se confirmait, certains propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels risqueraient de faire le choix, à terme plus ou moins rapproché, de fermer des portions significatives de ces espaces naturels, ce qui n’est évidemment pas l’objectif.
En effet, en préservant ces espaces, l’objectif est de les rendre accessibles à tous nos compatriotes et à nos amis étrangers qui viennent visiter notre pays. C’est la raison pour laquelle le choix fait par la commission des lois, que je peux comprendre et qui a une pertinence juridique indiscutable, me paraît, et je le regrette, limiter la couverture de responsabilité.
Ce n’était pas, selon moi, l’objectif du texte que nous avions déposé. Au contraire, il s’agissait de répondre le plus largement possible aux risques d’accident encourus par les promeneurs, les sportifs, et de favoriser également la sécurité des gardiens de ces sites, qui ne pouvaient pas voir leur responsabilité engagée à tout propos dès lors qu’ils ouvraient très largement ces espaces et que le public, toujours plus nombreux, les fréquentait.
Ma première réflexion sur ce texte fut, compte tenu du travail accompli, de ne pas proposer d’amendement de suppression de l’introduction du dispositif dans le code du sport, car cette mesure a son mérite.
En toute honnêteté, je me suis dit – je vous le raconte comme je l’ai vécu, puisque j’ai encore une ou deux minutes pour le faire – qu’il fallait peut-être concilier l’article du code de l’environnement, qui n’est pas clair et qu’il est nécessaire de modifier – Mme la secrétaire d’État a bien voulu apporter des précisions sur le sujet, en indiquant que c’était probablement une bonne idée –, avec l’introduction d’un article dans le code du sport, afin de prévoir une large couverture.
On aurait à la fois l’introduction d’un article dans le code du sport, ce qui répond à un certain nombre de problèmes, et le maintien de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, en y apportant des précisions. C’est ce que j’ai fait, puisque je n’ai pas proposé la suppression de l’article dans les amendements que j’ai déposés. En revanche, j’ai proposé des amendements de substitution : un amendement principal et un amendement de repli, les deux visant à apporter des précisions, mais rédigés de façon différente.
À cet instant, je suis embarrassé, parce que le Gouvernement a déposé un amendement dont les dispositions posent une difficulté, car elles prévoient la suppression de l’introduction du dispositif dans le code du sport.
Voici ma position, à l’instant où je vous parle et dans les douze secondes de temps de parole qui me restent : en l’état de notre discussion, mais nous verrons comment évolue le débat au fur et à mesure de l’examen des amendements, je suis favorable à l’amendement proposé par M. le rapporteur et voté par la commission des lois, visant à rétablir l’article L. 365-1. Et je souhaite y ajouter, pour défendre le point de vue que je soutiens, l’amendement n° 2 déposé par les membres de mon groupe.
Tel est, mes chers collègues, l’état d’esprit dans lequel je suis à ce stade de la discussion, étant entendu que, s’agissant d’un texte qui poursuit un objectif d’intérêt général évident, je suis favorable à la recherche d’une solution de compromis.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

La parole est à M. Éric Gold, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons ce soir nous place devant la question de la prise en charge des risques individuels par la société, sous l’angle spécifique de la pratique des sports de nature.
De nos jours, ces activités progressent en nombre et rassemblent beaucoup d’adeptes, y compris sur ces travées. À titre d’exemple, la Fédération française de randonnée pédestre compte 242 000 adhérents et la Fédération française de la montagne et de l’escalade quelque 96 000. Plus de trois Français sur quatre de plus de quinze ans déclarent pratiquer régulièrement une activité de pleine nature.
Les auteurs de la proposition de loi l’ont souligné, il s’agit également d’un facteur majeur d’attractivité, encouragé par la loi, pour bon nombre de nos territoires. Sur les territoires de montagne en particulier, la loi du 9 janvier 1985 permet de limiter le droit de propriété au nom de l’activité sportive, l’objectif étant de favoriser le développement du tourisme.
Cependant, le développement de ces activités n’est pas sans causer certaines difficultés.
En premier lieu, et c’est l’objet de cette proposition de loi, il existe une difficulté juridique liée à la mise en cause de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels en cas d’accidents.
La pluralité des situations juridiques s’appliquant à la pratique des sports de nature ne facilite pas l’analyse, selon qu’il s’agisse de pratiques encadrées par une association ou une entreprise ou d’une pratique « sauvage » et selon l’état des relations entre le propriétaire du site naturel, public ou privé, et son gestionnaire.
Lorsque ces activités sont dangereuses, elles devraient faire l’objet d’un encadrement minimal, ce qui n’est d’ailleurs pas contraire à l’objectif de dynamiser le tissu économique rural. En conséquence, les activités sportives « sauvages » pratiquées hors des périmètres balisés par le propriétaire ou le gestionnaire des sites régulièrement désigné par le propriétaire devraient plutôt engager la responsabilité des sportifs concernés.
Si je prends l’exemple du département que je connais le mieux, celui du Puy-de-Dôme, où les volcans de la chaîne des Puys sont dans leur quasi-totalité des espaces privés, comment des propriétaires pourraient-ils courir un risque juridique démesuré alors qu’ils offrent leurs parcelles aux activités de nature, sans que la fréquentation soit réellement maîtrisable ? L’engouement pour les sports de nature accroît considérablement la pression sur eux qui, dans nombre de cas, n’ont parfois pas consenti à y accueillir du public.
Le régime actuel de responsabilité sans faute pourrait, en outre, se révéler très coûteux pour les gardiens de sites naturels, comme dans le cas de l’exemple retenu par Bruno Retailleau et ses collègues, si leur responsabilité devait être systématiquement recherchée devant les tribunaux après chaque accident.
C’est pourquoi il est utile aujourd’hui de s’interroger sur une évolution du régime de responsabilité. Comme l’ont déjà souligné certains membres de la commission des lois, il s’agit d’ailleurs plus d’une conséquence de l’aversion au risque de notre société et de logiques assurantielles sous-jacentes que de la volonté des pratiquants de ces sports extrêmes, familiers de la prise de risque.
Il est donc nécessaire de parvenir à une rédaction équilibrée, qui ne limite pas la pratique des sports de nature, pas plus qu’elle ne déresponsabilise les propriétaires ou gestionnaires de sites naturels, ni les pratiquants de telles activités sportives. Utiliser un espace à des fins de loisirs est un droit qui doit s’accompagner de devoirs, le premier étant de respecter la propriété d’autrui, en étant responsable de ses actes et en faisant preuve de prudence. De ce point de vue, la rédaction proposée par le Gouvernement offre un bon compromis, que nous soutiendrons.
En second lieu, cette discussion ne doit pas occulter une autre responsabilité collective liée à la pratique des sports de nature et des activités de plein air. L’adaptation du droit de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires de sites ouverts au public ne doit pas s’appréhender aux dépens de la nécessaire préservation de ces espaces, déjà fragiles par nature et parfois mis à rude épreuve par les pratiques sportives. Sur ce sujet, la responsabilité des gestionnaires de sites ne doit pas être totalement exonérée. Il y va de la pérennité de ces espaces et de notre capacité à les transmettre aux générations futures. Un meilleur partage des responsabilités doit être trouvé.
Enfin, un partenariat avec les propriétaires est nécessaire pour permettre une meilleure signalétique et une meilleure information des usagers. Le soutien à l’attractivité des territoires et au développement de cette économie touristique passe par l’accompagnement des gardiens de sites naturels.
Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, le groupe du RDSE votera en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Les Républicains. – M. Jérôme Bignon applaudit également.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour le groupe La République En Marche.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous nous apprêtons à examiner une proposition de loi émanant du président Bruno Retailleau et de ses collègues et visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Aujourd’hui, les propriétaires fonciers qui laissent libre accès à leur domaine, sans toutefois l’autoriser, peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle dans les conditions de droit commun, dans l’hypothèse où des sportifs ou des promeneurs viendraient à se blesser sur leur terrain. Leur responsabilité peut ainsi être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, relatif au régime de responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde.
Il résulte, à ce titre, d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le gardien est celui qui en a l’usage, le contrôle et la direction au moment du fait dommageable, et que le propriétaire est présumé gardien. La seule manière alors pour ce dernier de s’exonérer totalement de sa responsabilité est de prouver un cas de force majeure, ou, à tout le moins, de s’en exonérer partiellement en démontrant que la victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
Il existe actuellement une exception à ce principe général de responsabilité civile à l’article L. 365-1 du code de l’environnement, lequel prévoit un régime dérogatoire de responsabilité civile des propriétaires ou gestionnaires de certains types d’espaces, tels que les parcs nationaux ou les réserves naturelles.
Rappelons pour mémoire qu’un article L. 160-7 alinéa 4 du code de l’urbanisme, abrogé depuis lors par une ordonnance du 23 octobre 2015, prévoyait que la responsabilité civile des propriétaires des terrains, voies et chemins grevés par les servitudes de passage des piétons sur le littoral, définies aux articles L. 160-6 et L. 160-6-1 du même code, ne pouvait être engagée au titre des dommages causés ou subis par les bénéficiaires de ces servitudes.
En tout état de cause, cet aménagement de la responsabilité des propriétaires étant limité, il est actuellement recommandé aux propriétaires de souscrire une assurance de responsabilité civile pour leur éviter de supporter les conséquences dommageables en cas de préjudice.
Poursuivant un objectif louable, celui de favoriser le développement des sports et activités de nature qui représentent un attrait touristique majeur pour de nombreuses collectivités territoriales, la proposition de loi prévoyait initialement dans un article unique d’étendre l’exception prévue à l’article L. 365-1 du code de l’environnement aux propriétaires et gestionnaires de sites naturels pour les dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisir ou de sports de nature.
La commission des lois a souhaité retenir une autre rédaction et exclure la mise en cause au titre de leur responsabilité sans faute, fondée sur le premier alinéa de l’actuel article 1242 du code civil, de ces propriétaires et gestionnaires de sites naturels ouverts au public et dans lesquels s’exercent les sports de nature ou les activités de loisir, en cas de dommages subis par leurs pratiquants.
La commission a préféré l’application du régime de la responsabilité pour faute. Il a également été décidé d’introduire ce dispositif dans le code du sport.
Si le groupe La République En Marche reconnaît l’intérêt évident d’une telle proposition, nous pensons néanmoins que son insertion dans un processus plus global de réforme de l’ensemble des règles régissant la responsabilité civile, portée prochainement par Mme la garde des sceaux, aurait plus de sens.
Aussi, et parce que vous le reconnaissez vous-même monsieur le rapporteur, ce contentieux est peu abondant, en attendant le jugement en appel, voire en cassation, du cas d’espèce ayant motivé la proposition de loi, nous choisissons de réserver notre position.

La parole est à M. Guillaume Gontard, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, la question soulevée ce soir n’est pas nouvelle.
Le régime de responsabilité des propriétaires de sites naturels avait déjà été débattu en 1984 lors de la discussion du projet de loi relatif à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en 2005 dans le cadre du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux et, plus récemment en 2006, lors de l’examen du projet de loi relatif aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux.
Toutefois, cette proposition de loi a le mérite d’aborder le paradoxe entre la demande croissante d’accès à des sites naturels préservés d’un point de vue écologique et paysager, et une moindre acceptation, supposée, des risques que cela comporte.
Du fait de leur faible aménagement, voire de l’absence de tout aménagement, ces sites comportent des risques naturels qui leur sont inhérents : chutes de pierres, affaissements de terrain, circulation d’animaux sauvages, tous ces risques sont propres à la vie d’un site naturel.
Or le propriétaire ou le gestionnaire d’un site naturel ouvert au public peut être reconnu responsable, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil, si un dommage est causé lors de la circulation du public sur sa propriété, qu’il l’ait ou non autorisée, s’il n’a pas explicitement défendu l’accès à son terrain.
Cette responsabilité de l’article 1242, alinéa 1, du code civil est une responsabilité sans faute, dite « responsabilité objective ». Du seul fait de son caractère de gardien de la chose, le propriétaire pourra être reconnu responsable d’un dommage.
C’est sur le fondement de cet article, dans un jugement datant de 2016, que le tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré la Fédération française de la montagne et de l’escalade entièrement responsable d’un accident grave causé par la chute d’un bloc rocheux sur un site naturel d’escalade survenu en 2010 et l’a condamnée solidairement avec la compagnie d’assurance à verser aux victimes une somme de 1, 2 million d’euros à titre de dommages et intérêts.
Cette jurisprudence a suscité un émoi certain dans mon département. Si elle devait être confirmée, elle porterait en germe le risque d’une interdiction d’accès à de nombreux sites naturels. C’est pourquoi il nous est proposé de préserver l’accès à ces sites naturels au travers d’une modification, un allégement du régime de responsabilité que peuvent encourir leurs propriétaires ou gestionnaires.
Si nous partageons les craintes du rapporteur, il faut noter que cette jurisprudence n’est pas stabilisée, puisqu’il s’agit d’un jugement de première instance. D’ailleurs, le 2 février 2017, dans une autre affaire où la responsabilité de l’Office national des forêts était recherchée sur le même fondement de la responsabilité sans faute, à la suite d’un accident dont fut victime un adolescent alors qu’il pratiquait le VTT sur un circuit « sauvage » dans une forêt domaniale, la cour d’appel de Versailles a, au contraire, confirmé le jugement en première instance déboutant la victime et ses parents.
Dès lors, l’examen de cette proposition de loi peut sembler prématuré, car il y a très peu de contentieux et de condamnations sur le fondement de l’article 1242. En outre, cet article n’implique pas une responsabilité automatique du propriétaire ou du gestionnaire, car le juge va se livrer à un examen approfondi des circonstances dans lesquelles s’est produit l’accident, pour décider si le propriétaire est ou non civilement responsable.
Ainsi, si elle semble extrêmement extensive, la responsabilité du fait des choses est toutefois encadrée par le juge, comme le souligne un rapport un groupe de travail de la commission des lois du Sénat sur la responsabilité civile : « Les juridictions ne font pas un usage abusif de la responsabilité du fait des choses, qui reste encadrée par certains garde-fous. »
De plus, nous ne pouvons éluder la question de l’opportunité de légiférer pour infléchir un jugement de première instance, qui n’est donc pas définitif. Certes, le rapporteur précise qu’il s’agit d’anticiper de futurs problèmes. Toutefois, cela peut sembler précipité, car lorsque le législateur intervient pour remettre en cause une politique jurisprudentielle, il s’agit généralement d’une jurisprudence confirmée en cassation.
Enfin, il est très difficile d’appréhender la réaction des assureurs face à une responsabilité fondée sur la faute. À l’opposé de l’objectif, ne risque-t-on pas de voir se multiplier des mouvements de sécurisation des sites naturels pour éviter une telle responsabilité ? De même, pour reprendre les mots de chercheurs sur la question, « la notion de faute est par ailleurs évolutive dans le temps et l’espace : elle ne peut ainsi être engoncée dans un texte trop précis, sa silhouette se dessinant au gré des décisions de justice et des évolutions sociétales ».
Ainsi, de nombreuses interrogations demeurent même après le passage en commission. Toutefois, la question de la confiance des propriétaires et de l’accès aux sites naturels est une véritable problématique des zones de montagne et la crainte des propriétaires et des gestionnaires après la condamnation de la FFME en première instance est réelle et peut renforcer les difficultés déjà existantes d’accès aux sites naturels privés.
Pour ces raisons, l’amendement du Gouvernement nous paraît un bon compromis. Cependant, dans l’intérêt général, et malgré ces nombreuses interrogations, nous voterons cette proposition de loi réécrite par la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Duranton, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, beaucoup de choses ont déjà été dites. Je soutiens bien sûr la présente proposition de loi, déposée par mes collègues Bruno Retailleau et Michel Savin, visant à adapter le droit de responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Nous n’avons effectivement pas besoin d’attendre la réforme de la responsabilité civile annoncée par le Gouvernement pour lancer la réflexion sur la responsabilité du fait des choses. Cette proposition de loi est une occasion pour le Sénat de se saisir de la question. En effet, il n’est pas normal que les propriétaires ou gestionnaires de ces terrains engagent leur responsabilité sans faute pour des faits qui ne relèvent pas de leur volonté, sachant de surcroît qu’ils n’ont pas les moyens de contrôler efficacement les accès et les activités s’y déroulant, coupables de n’avoir pas pu prévoir les aléas de la nature.
Cela peut conduire au jugement que vous connaissez et sur lequel je ne m’attarderai pas, lorsque le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné le 14 avril 2016, la Fédération de la montagne et de l’escalade, gestionnaire d’un site naturel pour le compte d’une commune, à indemniser à hauteur d’un million d’euros la victime malheureuse d’un accident d’escalade causé par le détachement d’un bloc de pierre de la paroi sur laquelle il progressait.
Les sites naturels ouverts au public devraient pouvoir continuer de l’être sans faire peser une épée de Damoclès d’ordre juridique et financier sur la tête de ceux qui en sont les gardiens. Il faut renouer avec la vision selon laquelle, dans le monde du sport et, en particulier, du sport de nature, le devoir de protection porte sur les risques créés par autrui, non sur ceux qui sont liés aux activités auxquelles l’individu participerait volontairement.
Quand on pratique ce genre de sports ou de loisirs, on est conscient que l’environnement dans lequel on évolue est périlleux. Un simple promeneur est d’ailleurs lui aussi vigilant quand il s’aventure sur ces sites naturels. Si vous choisissez de marcher en forêt, vous savez pertinemment que vous devrez regarder où vous mettez les pieds. Comme le rappelait en commission, notre collègue Jérôme Durain, même Reinhold Messner, premier alpiniste à avoir gravi les quatorze sommets culminant à plus de 8 000 mètres d’altitude, disait que « la montagne n’est ni juste ni injuste, elle est dangereuse ».
Une dérive de la législation actuelle est la déresponsabilisation des usagers. Si dans l’esprit de tous un randonneur venait à devenir un simple consommateur de sport sur un terrain qui lui serait en quelque sorte mis à disposition, comme un tennisman pourrait se plaindre du mauvais état du cours pour lequel il paie, il ne prendrait alors plus en considération les possibles risques liés à l’environnement naturel dans lequel il se trouve, s’attendant à ce que tout soit entièrement organisé.
Ayant l’habitude d’être « surencadré » dans un terrain naturel aménagé dans lequel il se comporte comme un consommateur, il peut être tenté de manière tout à fait inconsciente d’avoir la même attitude en s’aventurant dans les espaces naturels non aménagés. Combien de skieurs se mettent-ils en danger chaque année en hors-piste ?
Par conséquent, la lourde responsabilité sans faute des propriétaires et gestionnaires les incite à entreprendre un aménagement excessif visant à sécuriser les sites et ayant pour conséquence une dénaturation regrettable de ceux qui sont censés rester des espaces naturels. Il y va de l’avenir de nos beaux paysages français. Nul besoin d’aller loin de Paris, imaginez-vous la forêt de Fontainebleau défigurée par une série de filets, de barrières, de rambardes et de signalisations de couleur en tous genres…
D’autres, au contraire, préfèrent tout simplement fermer l’accès de ces sites au public, freinant ainsi le développement des sports de nature et des activités de loisirs en plein air en évolution perpétuelle, alors que notre immense patrimoine naturel nous offre tant de possibilités.
Mes chers collègues, connectez-vous au site internet de l’office de tourisme du département dont je suis élue, l’Eure ; vous y découvrirez un magnifique département, et vous constaterez que, parmi les premières choses que l’on vous propose, figurent ces sports de nature et ces activités en plein air, heureusement encore nombreuses.
Ces activités constituent un atout touristique majeur, comme dans beaucoup de collectivités territoriales. Le temps libre s’accroît, les techniques et le matériel progressent, les connaissances se diffusent et, par conséquent, le niveau de pratique augmente. Il est de notre devoir de protéger ces sites encore ouverts au public, ainsi que leurs propriétaires, leurs gestionnaires, les activités de sports et de loisirs qui y sont proposées, les emplois qui y sont associés et la dynamique touristique qui y est liée. C’est pourquoi il semble nécessaire d’apporter au plus vite une solution à la faiblesse du dispositif légal actuel.
Je voterai donc en faveur de la présente proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 3, présenté par M. Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs.
« La responsabilité administrative des propriétaires de terrains, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion d’un espace naturel, à l’occasion d’accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve naturelle nationale ou régionale, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, sur les espaces naturels sensibles des départements, sur tout autre espace de nature ou sur les voies et chemins mentionnés à l’article L. 361-1, à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à la circulation dans ces espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités afin de garantir la conservation des milieux et, compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique.
« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires des espaces naturels ouverts au public ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs. »
La parole est à M. Jérôme Bignon.

Cet amendement tend à compléter la rédaction du nouvel alinéa que la proposition de loi insérait, dans sa version initiale, à l’article L. 365-1 du code de l’environnement. Il vise à réintroduire cette disposition dans ledit code, tout en répondant aux inquiétudes exprimées par le rapporteur, lors de la réunion de la commission des lois, quant au caractère trop vague de la rédaction initiale.
Cette nouvelle rédaction permettrait de concilier, au sein de la proposition de loi, avec le même objectif, une modification du code de l’environnement et une modification du code des sports.

L’amendement n° 2, présenté par M. Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les espaces naturels ouverts au public et sur les voies et chemins mentionnés à l’article L. 361-1, la responsabilité civile ou administrative des propriétaires, de la commune, de l’État ou de l’organe de gestion de ces sites ne saurait être engagée au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs.
« Le premier alinéa est également applicable aux accidents survenus dans le cœur d’un parc national, dans une réserve nationale ou régionale, un espace naturel sensible départemental, sur un domaine relevant du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ou sur les voies et chemins mentionnés à l’article L. 361-1, ou tout autre espace de nature ayant fait l’objet d’aménagements limités, afin d’y garantir la conservation de la biodiversité et des paysages, et pour lesquels des mesures d’information ont été prises, dans le cadre de la police de la circulation par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »
La parole est à M. Jérôme Bignon.

Cet amendement a également pour objet de compléter la rédaction du nouvel alinéa inséré à l’article L. 365-1 du code de l’environnement. Il vise à réintroduire cette disposition, toujours en répondant, mais sous une forme différente, aux inquiétudes du rapporteur.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 3.

L’amendement n° 1, présenté par M. Bignon et les membres du groupe Les Indépendants – République et Territoires, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le premier alinéa de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La responsabilité civile des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ne saurait être engagée, au titre de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, qu’en raison de leurs actes fautifs. »
La parole est à M. Jérôme Bignon.

Cet amendement vise à réintroduire la modification de l’article L. 365-1 du code de l’environnement.
Il s’agit de préserver l’esprit originel de la proposition de loi, notamment son caractère global, en instaurant une disposition excluant la mise en cause des propriétaires et des gestionnaires de sites naturels au titre de leur responsabilité sans faute pour des dommages causés ou subis à l’occasion de la circulation du public ou de la pratique d’activités de loisirs ou de sports de nature, tout en respectant le choix de la commission des lois d’introduire une disposition identique à l’article L. 311-1 du code des sports.
Je le disais au cours de la discussion générale, les dispositions que je propose au travers des trois amendements que je viens de présenter ne suppriment pas la rédaction actuelle de la proposition de loi. Elles complètent celle-ci.

Je veux tout d’abord rendre hommage à Jérôme Bignon, pour sa volonté de trouver une solution à une situation qui, il le rappelait tout à l’heure dans la discussion générale, est complexe.
Toutefois, je veux aussi le rassurer tout de suite en lui indiquant que, très clairement, l’objectif que ses cosignataires et lui-même visent, au travers de ces amendements, est satisfait par le texte de la commission des lois. Je vais tâcher de lui expliquer en quoi.
Le premier alinéa de l’amendement n° 3 – mes chers collègues, je vous prie de m’excuser par avance si je suis un peu long – tend à rétablir la proposition de loi dans sa version initiale. La commission n’est pas favorable au rétablissement de l’article unique de la proposition de loi, pour les raisons qui l’ont conduite à en proposer une nouvelle rédaction.
Le troisième alinéa de cet amendement vise à dupliquer cette rédaction, en remplaçant les termes « sites naturels » par les termes « espaces naturels ouverts au public ». La commission a considéré que ce troisième alinéa, dupliquant le premier, encourait les mêmes critiques, et elle n’y est donc pas favorable.
Quant au deuxième alinéa, il tend à rétablir le texte de l’actuel article L. 365-1 du code de l’environnement, mais seulement pour la responsabilité administrative.
Cette disposition invite ainsi le juge administratif à prendre en compte les particularités des espaces naturels énumérés pour apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de ceux-ci. Elle est donc dénuée de portée normative réelle, puisqu’il ne s’agit, cher Jérôme Bignon, que d’une invitation adressée au juge. Or c’est bien le rôle du juge que d’apprécier, pour chaque contentieux, les circonstances de l’espèce ; le législateur n’a pas besoin de l’inviter à le faire…
Par ailleurs, ce troisième alinéa n’est pas adapté à la responsabilité administrative, qui obéit à des règles particulières. Initialement, cette disposition du code de l’environnement avait été créée pour atténuer la rigueur du régime de responsabilité civile du fait des choses ; puisque ce régime de responsabilité sera écarté, cette disposition n’aura plus lieu d’être.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 2, qui tend à introduire dans le code de l’environnement des dispositions un peu différentes de celles qui étaient prévues par la proposition de loi dans sa version initiale. Cette fois, le dispositif de responsabilité pour faute, introduit au début de l’article L. 365-1, concernerait, de manière générale, non seulement les espaces naturels ouverts au public, mais encore une liste de sites particuliers, énumérés pour la plupart dans l’actuel article L. 365-1 du code de l’environnement.
Cette rédaction pose plusieurs difficultés. En premier lieu, les deux alinéas du dispositif proposé s’articulent mal entre eux ; ils répètent la même chose, avec des termes un peu différents, ce qui rend le dispositif peu compréhensible. Ils me semblent donc contraires aux objectifs de clarté et d’intelligibilité de la loi.
En second lieu, cette rédaction, par l’imprécision des termes utilisés, encourt les mêmes critiques que celles qui ont été formulées à l’encontre de la proposition de loi dans sa rédaction initiale.
Par ailleurs, cette rédaction va bien plus loin que l’objectif des auteurs de la proposition de loi – favoriser le développement des sports de nature et des activités de loisirs de plein air qui se déroulent dans le domaine privé des personnes publiques ou privées –, puisqu’elle pose un principe général d’exonération de responsabilité civile et administrative des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, hors les cas d’une faute.
J’insiste sur les mots « et administrative », car cette disposition engloberait les accidents survenus dans le domaine public des personnes publiques, qui sont actuellement soumis au droit administratif. Cela entraînerait donc un transfert, à mon sens excessif, de la charge de la responsabilité de la personne publique vers la victime, laquelle bénéficie aujourd’hui, dans ces hypothèses, de certaines présomptions, comme celle du défaut d’entretien normal de l’espace public par la personne publique.
Pour ces raisons, cher Jérôme Bignon, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement ; sinon, je serais amené à formuler un avis défavorable.
Enfin, l’amendement n° 1 vise simplement à rétablir le texte de la proposition de loi dans sa version initiale. Pour les raisons très juridiques que j’ai déjà évoquées, la commission a proposé une nouvelle rédaction du texte. Celle-ci porte sur le régime de responsabilité civile, sur les espaces naturels, dont la liste n’est pas donnée, ou encore sur la notion de propriétaire et de gestionnaire, qui écartait les locataires – nous avons donc préféré le terme de gardien.
Là encore, la commission demande le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Ces trois amendements ont pour objet d’exclure l’engagement de la responsabilité civile des propriétaires ou gestionnaires de sites naturels en l’absence de faute de leur part.
Je l’ai déjà indiqué, il nous paraît prématuré de modifier le régime de responsabilité applicable. En revanche, cette réflexion aura toute sa place lors de l’examen du projet de réforme globale du droit de la responsabilité civile, qui sera promu par ma collègue Nicole Belloubet.
Par ailleurs, sur le fond, les dispositions proposées excluent involontairement l’application du régime de responsabilité du fait des choses, même pour les simples promeneurs. Cela revient à opposer à ceux-ci la théorie de l’acceptation du risque, ce qui semble excessif et pourrait empêcher que les victimes soient suffisamment indemnisées.
En outre, ces amendements pourraient être source d’une complexité excessive. C’est notamment le cas des amendements n° 1 et 3, qui tendent à distinguer, selon le juge compétent, les conditions d’engagement de la responsabilité des propriétaires et des gestionnaires d’espaces naturels. Cette complexité est encore renforcée par le fait que ces nouvelles dispositions auraient vocation à coexister avec le nouvel article introduit par la présente proposition de loi dans le code du sport.
Aussi, dans ce contexte et eu égard aux changements à venir sur le droit de la responsabilité civile, je ne peux malheureusement qu’émettre un avis défavorable sur ces trois amendements.

J’ai pris bonne note de la proposition de Mme la secrétaire d’État de travailler à un nouveau régime de la responsabilité civile sur ces sujets ; je participerai à cette réflexion.
En attendant, je retire ces trois amendements, monsieur le président.
Après l’article L. 311-1 du code du sport, il est inséré un article L. 311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -1 -1. – Les dommages causés à l’occasion d’un sport de nature ou d’une activité de loisirs ne peuvent engager la responsabilité du gardien de l’espace, du site ou de l’itinéraire dans lequel s’exerce cette pratique pour le fait d’une chose qu’il a sous sa garde, au sens du premier alinéa de l’article 1242 du code civil. »

L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 365-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. – La responsabilité civile ou administrative des propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, à raison d’accidents survenus à l’occasion de la circulation des piétons ou de la pratique d’un sport de nature ou d’activités de loisirs, est appréciée au regard des risques inhérents à l’évolution dans ces espaces naturels n’ayant pas fait l’objet d’aménagements ou ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Nous sommes attentifs aux préoccupations exprimées par les auteurs de la proposition de loi et par M. le rapporteur. Le Gouvernement, je l’évoquais dans mon propos introductif, a donc souhaité formuler, dans le cadre d’une évolution de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, une proposition de substitution.
En effet, l’économie générale de cet article nous paraît satisfaisante, puisqu’elle permet la conciliation des contraintes des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels, d’une part, avec les droits des victimes d’accidents survenus dans ces espaces, d’autre part. Cet article présente d’ailleurs le mérite de traiter des accidents survenus tant dans le cadre de la pratique d’un sport ou d’une activité de loisirs qu’à l’occasion de la simple circulation des piétons.
Ainsi, sans préjudice d’une modification ultérieure du régime de responsabilité spécifique applicable aux activités sportives, l’article L. 365-1 du code de l’environnement pourrait donc être, selon nous, maintenu.
Néanmoins, au regard des préoccupations exprimées, il nous semble tout de même opportun d’en élargir le champ.
C’est pourquoi nous proposons de supprimer, d’une part, l’énumération sous forme de liste des collectivités, organes et organismes concernés par cette disposition, de façon à englober l’ensemble des personnes publiques ou privées propriétaires ou gestionnaires d’espaces naturels, et, d’autre part, l’énumération sous forme de liste des espaces concernés par cette disposition, au profit d’une référence à la notion, plus large, d’espace naturel.
Enfin, cette nouvelle rédaction prendrait en compte les espaces restés vierges de tout aménagement dans un objectif de préservation du caractère naturel de l’espace. En effet, la disposition existante ne concerne expressément que les espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements, ce qui peut susciter des difficultés d’interprétation.

Au cours des travaux préparatoires à la réunion de la commission des lois, j’avais aussi réfléchi à l’hypothèse qui est aujourd’hui la vôtre, madame la secrétaire d’État. Cela consistait à conserver l’article L. 365-1 dans sa rédaction actuelle, en en élargissant le périmètre. L’autre hypothèse consistait simplement à remplacer le régime de responsabilité du fait des choses par celui de la responsabilité pour faute, dont il est question dans cette proposition de loi.
À l’issue de mes travaux, j’ai choisi de proposer à la commission d’en rester, sous une forme modifiée, à la proposition de loi de M. Retailleau et de ses collègues.
Dès lors, madame la secrétaire d’État, l’amendement que vous proposez est contraire à la position de la commission, puisqu’il vise à rétablir la rédaction actuelle de l’article L. 365-1 du code de l’environnement, en élargissant son application à l’ensemble des espaces naturels. J’indique, pour rappel, que cet article invite seulement le juge à prendre en compte les particularités du milieu naturel pour contextualiser et apprécier la responsabilité des propriétaires et gestionnaires d’espaces naturels.
Selon cet article, cette responsabilité doit être appréciée « au regard des risques inhérents à la circulation dans des espaces naturels ayant fait l’objet d’aménagements limités dans le but de conservation des milieux, et compte tenu des mesures d’information prises, dans le cadre de la police de la circulation, par les autorités chargées d’assurer la sécurité publique ».
Ce dispositif a une portée normative limitée, puisqu’il pointe seulement les éléments factuels que le juge doit prendre en considération pour se prononcer. Or c’est bien le rôle du juge que d’apprécier, pour chaque contentieux, les circonstances de l’espèce. Le législateur n’a, je le répète, pas besoin de l’inviter à le faire.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois a souhaité aller plus loin que cette hypothèse-là, et aller jusqu’au remplacement de la responsabilité du fait des choses par la responsabilité pour faute. Cet amendement ne permet pas d’atteindre l’objectif des auteurs de la proposition de loi et de la commission des lois, à savoir le fait d’écarter l’application des règles de la responsabilité de plein droit du fait des choses, en exigeant une faute pour engager la responsabilité des propriétaires et gestionnaires de ces espaces naturels.
Ainsi, à moins que, convaincue par mes arguments, vous souhaitiez retirer cet amendement, madame la secrétaire d’État, j’émettrai, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Compte tenu de vos arguments, monsieur le rapporteur, … je maintiens l’amendement du Gouvernement !
Sourires.

M. Thani Mohamed Soilihi. Il est vrai que cet amendement arrive quelque peu en bout de course, si j’ose dire, après la position adoptée par la commission des lois. Cette dernière rechigne donc à revenir sur ses positions.
M. Jackie Pierre proteste.

Il n’en demeure pas moins que cet amendement vise à prévoir une solution sage, qui permettrait de ne pas se précipiter. Rappelons-le, l’affaire qui a en partie motivé la proposition de loi que nous examinons n’est qu’un cas d’espèce, qui est actuellement soumis à la juridiction d’appel. Celle-ci est amenée à statuer – nous ne savons pas dans quel sens elle le fera –, et la décision de la cour d’appel pourra encore être soumise à la Cour de cassation. C’est donc seulement au stade de la cassation que nous pourrons commencer à parler de jurisprudence.
Pour toutes ces raisons, en plus de celles que j’ai évoquées lors de la discussion générale, je soutiens cet amendement.

Madame la secrétaire d’État, je ne peux pas suivre votre proposition, parce qu’elle dénature complètement la proposition initiale elle-même. Celle-ci visait effectivement l’article L. 365-1 du code de l’environnement, mais en introduisant spécifiquement l’existence d’une faute et le refus du principe de la garde.
La commission des lois et son rapporteur ont, dans leur sagesse, simplement proposé que l’on rejette le principe de la garde ; ainsi, celui qui pratique un sport ne bénéficiera pas de la mise en cause de la responsabilité du gardien. C’est fondamental ! C’est d’ailleurs le seul argument que l’on puisse présenter à ce stade.
Cela donnera lieu à des débats, dans le cadre de l’examen du futur texte, sur les domaines dans lesquels il faut envisager que la responsabilité du fait des choses, la responsabilité du gardien, qui est de plein droit, ne bénéficie pas, en raison des circonstances, à telle ou telle victime. Avec votre rédaction, madame la secrétaire d’État, on entre dans un débat juridique d’une grande complexité sur la responsabilité, qui retire tout intérêt au débat que nous avons depuis la reprise de la séance.
Le groupe socialiste et républicain ne peut donc pas vous suivre ; il ne peut que se ranger, comme il l’a fait au sein de la commission des lois, à l’avis de M. le rapporteur.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 1 er est adopté.
Le chapitre V du titre VI du livre III du code de l’environnement est abrogé.

L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Mme Brune Poirson, secrétaire d ’ État. Compte tenu de l’avis très étonnamment défavorable de la commission sur le précédent amendement du Gouvernement, après un grand suspens, je retire le présent amendement, monsieur le président.
Exclamations amusées et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.
L ’ article 2 est adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public.

Je n’ai été saisi d’aucune observation sur les conclusions de la conférence des présidents.
Elles sont adoptées.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 1er février 2018 :
À dix heures trente :
Deuxième lecture du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (n° 154, 2017-2018) ;
Rapport de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (n° 247, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 248, 2017-2018).
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures quinze à vingt heures quinze :
Ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain

Proposition de loi portant création d’un fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques (n° 792, 2015-2016) ;
Rapport de M. Bernard Jomier, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 236, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 237, 2017-2018).
Proposition de loi relative à la réforme de la caisse des Français de l’étranger (n° 553, 2016-2017) ;
Rapport de M. Yves Daudigny, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 238, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 239, 2017-2018).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinq .
La liste des candidats établie par la commission des lois a été publiée conformément à l ’ article 12 du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu par l ’ article 9 du règlement, cette liste est ratifiée.
Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sur le projet de loi portant diverses dispositions d ’ adaptation au droit de l ’ Union européenne dans le domaine de la sécurité sont :
Titulaires : MM. Philippe Bas, Philippe Bonnecarrère, Christophe-André Frassa, Mmes Brigitte Lherbier, Laurence Harribey, MM. Simon Sutour, Alain Richard ;
Suppléants : Mmes Esther Benbassa, Maryse Carrère, Jacqueline Eustache ‑ Brinio, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Jean-Yves Leconte, Henri Leroy.