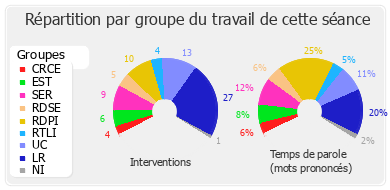Séance en hémicycle du 8 décembre 2022 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires (proposition n° 32, texte de la commission n° 156, rapport n° 155).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Monsieur le président, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite tout d’abord remercier le groupe RDPI, notamment le sénateur Martin Lévrier, d’avoir inscrit l’examen de cette proposition de loi à son ordre du jour réservé.
Je tiens également à saluer le travail effectué par Catherine Fabre : elle s’était saisie avec détermination de cette question au cours du quinquennat précédent et avait déposé une proposition de loi, qui a constitué le socle sur lequel le présent texte a été bâti.
Je suis donc très heureuse, en tant que ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation professionnels, de soutenir aujourd’hui cette proposition de loi.
Lutter contre les abus et la fraude au compte personnel de formation (CPF) est un objectif qui doit tous nous réunir. C’est dans cette perspective que les députés ont adopté ce texte à l’unanimité, avec le soutien du Gouvernement. Je suis certaine qu’il suscitera de nouveau un très large consensus sur les travées de cette assemblée.
Je reviendrai tout d’abord sur le contexte d’examen de cette proposition de loi, qui est une réponse ferme aux détournements du compte personnel de formation.
Le CPF fête cette année ses trois ans : ce dispositif a rencontré un succès populaire incontestable auprès des Français. Près de 95 % des actifs connaissent cet outil et environ 20 % d’entre eux ont ouvert leurs droits depuis sa création en 2019. Autant mobilisé par les femmes que par les hommes, il est davantage utilisé par les employés et les ouvriers que par les cadres. Indéniablement, le CPF a véritablement facilité et démocratisé l’accès à la formation.
Le CPF est à tous les carrefours de la vie professionnelle des Françaises et des Français. Il est l’outil qu’ils peuvent mobiliser dans tous les moments charnières de leur vie : pour préparer leur parcours professionnel, se former à la création d’entreprise ou encore faire un bilan de compétences, etc.
Cependant, le succès massif du CPF a également ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives, voire abusives. Ces dérives consistent souvent à forcer les individus à acheter des formations contre leur gré ou de manière insuffisamment réfléchie. Elles se traduisent par des appels, l’envoi de SMS ou de courriels intempestifs de la part de centres d’appels ou d’organismes de formation. Ces arnaques véhiculent bien souvent des informations erronées sur les droits de l’individu et sur l’objectif réel de l’organisme.
Les fautes graves, telles que l’usurpation d’identité ou le détournement des droits du compte personnel de formation, font l’objet d’un contrôle accru par la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
Le préjudice financier lié aux pratiques abusives ou frauduleuses est évalué à 43 millions d’euros en 2021, une somme qui a été multipliée par cinq en un an.
Outre le préjudice financier qu’il entraîne, ce démarchage agressif entame la confiance des utilisateurs et nuit à l’image de l’outil. Il appelle donc une réponse ferme. Le Gouvernement a agi pour mettre un terme à ces pratiques, qui mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif.
Un renforcement du niveau de sécurité de la plateforme « Mon compte formation » a d’abord été mis en place le 25 octobre dernier. Tout achat de formation est désormais sécurisé via le nouveau service « FranceConnect+ ». Ce service propose une authentification renforcée, via l’application d’identification numérique de La Poste.
Cette authentification renforcée permet de limiter les risques d’usurpation d’identité. Il s’agit d’un changement notable en termes d’usage pour les Français. Le réseau de La Poste et les maisons France Services sont mobilisés pour accompagner les Français dans ces démarches.
Avant même cette nouvelle phase de sécurisation technique, des actions de contrôle accru avaient déjà été menées pour améliorer la qualité de l’offre de formation.
Le Gouvernement a en effet engagé des mesures de régulation du secteur pour faire monter en qualité l’offre accessible sur la plateforme Mon compte formation. Je pense notamment à l’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier, du label Qualiopi visant à renforcer l’exigence de qualité pour les organismes de formation, qui sont aujourd’hui près de 17 000 sur la plateforme, contre 24 000 environ auparavant.
Un travail particulièrement exigeant a également été mené sur le renouvellement du répertoire spécifique (RS), qui a conduit à éliminer deux tiers des certifications, dont l’intérêt pour l’évolution professionnelle des actifs n’était plus démontré.
Enfin, il y a quelques mois, à la demande de l’État, c’est l’intégralité de l’offre portant sur la création et la reprise d’entreprise qui a été revue par la Caisse des dépôts et consignations : près de 60 % des offres ont ainsi été déréférencées, car elles étaient apparues non conformes.
Aujourd’hui, plus personne ne peut dire que le compte personnel de formation rime avec formation de loisir. Nous nous sommes donné les moyens de proposer un catalogue de formations utiles pour l’emploi, la professionnalisation et la montée en compétences des actifs de notre pays.
Il nous faut donc à présent œuvrer pour éradiquer de la plateforme la fraude et le démarchage abusif.
Cette proposition de loi vient donc renforcer plus encore l’arsenal de régulation.
Son article 3 prévoit ainsi une procédure de vérification des organismes de formation qui demandent à être enregistrés sur la plateforme. L’objectif est de garantir aux titulaires de compte que les organismes et la formation suivie remplissent bien tous les deux les critères d’éligibilité au compte personnel de formation. Cette procédure permettra en outre de garantir la qualité et l’honorabilité des organismes de formation inscrits sur la plateforme, qui devront être à jour de leurs obligations sociales et fiscales.
L’article 4 de la proposition de loi, introduit à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, prévoit quant à lui une étape supplémentaire afin que les sous-traitants soient eux aussi soumis aux mêmes exigences que l’organisme de formation donneur d’ordre.
Soyons clairs sur ce sujet : il ne s’agit pas d’interdire la sous-traitance ni d’entraver la liberté de commerce ; mais nous constatons aujourd’hui que certains organismes de formation, pourtant référencés sur la plateforme, proposent seulement ce que l’on appelle « un portage Qualiopi ».
Je le dis clairement : ces organismes de formation agissent comme de véritables sociétés écrans. Ils savent que la Caisse des dépôts et consignations ne peut ni identifier ni contrôler les sous-traitants. Cet angle mort est donc un nid à fraudes potentiel. Pareille pratique n’est plus admissible et doit être régulée.
Cette étape a ainsi pour objectif d’assainir toute la chaîne de valeur, en rendant les organismes de formation transparents et responsables à l’égard de leurs sous-traitants.
L’article 4 prévoit qu’un décret sera pris, en concertation avec les représentants du secteur de la formation professionnelle, pour préciser les modalités d’application de la disposition. Cette concertation a déjà démarré, sous l’égide de mon cabinet, depuis plusieurs semaines maintenant.
Je tiens ici à rassurer les professionnels du secteur de la formation, en particulier les formateurs indépendants. Une attention toute particulière sera portée aux formateurs individuels, acteurs essentiels de la formation professionnelle. En effet, nous ne pouvons décemment pas leur imposer les mêmes exigences qu’aux organismes de formation, qui occupent l’ensemble de la chaîne de la formation et qui dégagent un chiffre d’affaires important.
Notre objectif est de protéger les citoyens qui souhaitent souscrire à une formation via leur compte personnel de formation, en leur permettant de vérifier à qui ils ont affaire et de s’assurer de la qualité de l’organisme formateur.
Je veux redire ici toute la détermination du Gouvernement à empêcher tout détournement du droit fondamental d’accès à la formation.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui nous donnera des leviers efficaces pour mieux lutter contre les abus et les fraudes au CPF, pour mieux les prévenir et les sanctionner. Elle va en effet permettre d’interdire le démarchage abusif et de sanctionner plus efficacement ceux qui le pratiquent, y compris sur les réseaux sociaux.
Nous ne pourrons que nous satisfaire de voir disparaître de tels abus : il n’y aura plus d’influenceurs promettant monts et merveilles, tablettes et smartphones ; plus de messages inacceptables incitant au recours au CPF pour mieux le détourner de sa fonction initiale et l’instrumentaliser. Les amendes seront en effet très dissuasives : elles pourront atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
À la suite de publications illicites par plusieurs influenceurs concernant des offres au titre du CPF, la Caisse des dépôts et consignations a également saisi un cabinet d’avocat pour adresser des mises en demeure aux individus concernés.
Un bon nombre d’entre eux y a d’ores et déjà répondu en s’engageant sur trois points : l’arrêt de toute publicité en lien avec le CPF ; la mise à disposition de documents des sociétés avec qui ils étaient en lien, afin de permettre des enquêtes et, le cas échéant, le dépôt de plainte ; la publication sur leurs réseaux sociaux d’un message rectificatif.
La proposition de loi, à son article 2, va également donner les moyens aux services de partager les informations dont ils disposent pour mieux conduire la lutte contre la fraude.
J’insiste sur la nécessaire coordination entre les services de l’État et les opérateurs : elle est absolument indispensable pour resserrer les mailles du filet, vérifier les identités des suspects, contrôler les habilitations à former, traquer les fausses domiciliations, etc. Nous devons en effet impérativement croiser les fichiers et les informations pour lutter efficacement contre les fraudeurs, les traquer et les arrêter.
Ce texte a pour objet de donner aux services de l’État, à la Caisse des dépôts et consignations ou encore à Tracfin plus de moyens pour identifier les fraudeurs et ne laisser aucun délit impuni.
L’article 2 bis vise à renforcer les pouvoirs de la Caisse des dépôts et consignations, en lui accordant la capacité de recouvrer plus rapidement les sommes indûment perçues. Ce pouvoir d’intervention directe et rapide, sans saisine préalable de la juridiction administrative, améliorera l’efficacité de la lutte contre l’évasion des fonds en cas de fraude.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, nous pouvons nous satisfaire du travail collectivement réalisé sur ce sujet transpartisan et véritablement d’intérêt général.
Notre responsabilité est de protéger le CPF pour le bien de nos concitoyens. Protéger le CPF, c’est protéger la capacité des Français à se former ; c’est protéger une application qui fait désormais partie de leur vie quotidienne ; c’est protéger un droit qu’ils se sont approprié massivement, grâce à la désintermédiation permise par cette application.
Le CPF, rappelons-le, a rendu plus réelle et plus tangible la liberté de chacune et de chacun de choisir son avenir professionnel et de maîtriser son parcours de vie.
En interdisant le démarchage abusif et en luttant mieux contre les fraudes, nous redonnerons toutes ses marges de manœuvre au CPF et nous permettrons à tous les actifs d’être en mesure de réussir leurs transitions professionnelles.
Nous devrons prochainement mettre en œuvre de nouvelles mesures de régulation afin que le CPF soit mieux ciblé sur les besoins réels de l’économie, c’est-à-dire sur les métiers en tension ou les métiers d’avenir. Je mènerai une réflexion sur ce sujet en concertation avec les partenaires sociaux, que je reçois aujourd’hui, afin qu’ils nous présentent, à Olivier Dussopt et moi, la synthèse de leurs travaux paritaires.
Je tiens encore une fois à remercier l’ensemble des parlementaires qui se sont saisis de cette proposition de loi pour donner corps à la protection du droit à la formation.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE.
Applaudissements sur les travées d es groupe s RDPI, INDEP et RDSE .

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a introduit une réforme audacieuse du compte personnel de formation, qui a permis une démocratisation de l’accès à la formation professionnelle au bénéfice de chaque actif.
La monétisation du CPF et le lancement du service dématérialisé Mon compte formation lui ont donné une nouvelle dimension : environ 2, 1 millions de dossiers de formation ont ainsi été financés en 2021, contre près de 1 million en 2020 et 500 000 en 2019, soit un doublement chaque année. Grâce à un mode d’alimentation favorable aux temps partiels, la réforme a également permis un rééquilibrage du recours au CPF entre les hommes et les femmes. Les actifs âgés de moins de 40 ans et les publics peu diplômés sont également plus représentés parmi ses bénéficiaires.
Toutefois, cette réforme a aussi une face sombre : avec 19 millions de profils activés sur Mon compte formation, elle a ouvert une brèche dans laquelle divers acteurs peu scrupuleux se sont engouffrés pour se livrer à des pratiques frauduleuses.
La fraude au CPF prend des formes diverses, qui vont de pratiques commerciales agressives à la validation d’entrées en formation fictives ou inéligibles à un financement par le dispositif. Les titulaires de compte sont, selon les cas, victimes ou complices de ces abus.
La Caisse des dépôts et consignations (CDC) évalue à 40 millions d’euros au bas mot le préjudice financier lié à ces pratiques. Ce montant reste peu élevé au regard des dépenses totales occasionnées par le dispositif, qui se sont élevées à 2, 85 milliards d’euros en 2021. La situation pourrait néanmoins s’aggraver en l’absence d’actions rapides et fermes pour faire cesser ces agissements. De plus, au-delà de leur impact financier, ces pratiques nuisent à l’image du CPF et, plus généralement, à celle de l’ensemble des acteurs de la formation professionnelle.
La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui, déposée par les députés Bruno Fuchs, Sylvain Maillard et Thomas Mesnier, et adoptée par l’Assemblée nationale le 6 octobre dernier, vise donc à rendre plus efficaces les efforts déployés pour lutter contre ces abus. Je salue à cette occasion Catherine Fabre, qui était à l’initiative de la première proposition de loi en ce sens, et je la remercie de sa présence en tribune aujourd’hui.
Depuis le lancement de Mon compte formation en novembre 2019, la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), France Compétences et la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du CPF, coopèrent en matière de lutte contre la fraude. Leurs efforts se sont amplifiés depuis 2021 en raison de l’aggravation du phénomène.
Ainsi, des mesures fortes ont récemment été prises dans le but de tarir les sources de la fraude. Depuis le 25 octobre dernier, afin de prévenir les usurpations d’identité et les utilisations frauduleuses de comptes, l’accès des utilisateurs à la plateforme a été sécurisé par la mise en place de la solution FranceConnect+.
En alourdissant le processus de connexion, cette mesure a eu des effets immédiats, même s’il convient de veiller à ce qu’elle ne conduise pas à exclure les personnes en difficulté avec le numérique.
Le volet contentieux de l’action de la Caisse des dépôts et consignations commence lui aussi à porter ses fruits : une première condamnation pour fraude au CPF d’un organisme qui avait organisé de fausses sessions de formation a été prononcée le 20 septembre dernier à Saint-Omer. Il reste néanmoins des obstacles législatifs à lever pour permettre à ces actions de produire tous leurs effets.
En matière de démarchage téléphonique, la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a mis en place un régime d’opposition en prévoyant la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste Bloctel. Ce régime a été renforcé par la loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, qui a rendu obligatoire la consultation par les centres d’appels de la liste d’opposition et alourdi les sanctions applicables. Pour les courriers électroniques et les SMS, un régime de consentement préalable et explicite s’applique.
Ces dispositifs n’ont pas empêché la prolifération de pratiques agressives de démarchage relatif au CPF. Le téléphone est le principal vecteur de prise de contact entre les organismes de formation et les titulaires de compte, mais ce n’est pas le seul.
Face à ce constat, l’article 1er de la proposition de loi prévoit l’interdiction de la prospection commerciale des titulaires d’un CPF par téléphone, par SMS, par courriel ou sur les réseaux sociaux, visant à collecter leurs données à caractère personnel ou à conclure des contrats portant sur des actions de formation, sauf si la sollicitation intervient dans le cadre d’une action de formation en cours et présentant un lien direct avec son objet.
Afin de contrôler le respect de ces dispositions, l’article 1er habilite les agents de la DGCCRF à rechercher et à constater ces infractions et prévoit des sanctions administratives d’un montant maximal de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros pour une personne morale.
Cette mesure stricte n’empêchera pas les organismes de formation de communiquer, mais elle permettra de faire cesser le démarchage abusif en clarifiant les règles. Elle aidera également les actifs à prendre des décisions réfléchies sur l’utilisation de leur CPF et sur leur avenir professionnel.
La proposition de loi vise par ailleurs à renforcer les moyens d’action de la Caisse des dépôts et consignations face à la fraude. À cette fin, elle donne une base légale à la communication d’informations entre les acteurs concernés.
L’article 2 prévoit ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, France Compétences, les services de l’État chargés de la répression des fraudes et les services chargés des contrôles de la formation professionnelle, mais aussi les organismes financeurs, les organismes délivrant la certification Qualiopi et les ministères ou organismes propriétaires de certifications professionnelles peuvent échanger tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur accomplissement.
Cet article autorise également la cellule de renseignement financier nationale Tracfin à transmettre des informations à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’à l’Agence de services et de paiement. La sécurisation juridique de ces échanges d’informations permettra de faire gagner un temps précieux à la CDC pour l’accomplissement de sa mission de lutte contre la fraude.
L’article 2 bis, inséré à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, donne à la Caisse des dépôts et consignations les moyens de mettre en œuvre un recouvrement forcé des sommes indûment versées à un organisme de formation. À cet effet, le directeur général de la CDC pourra délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire devant la juridiction compétente, comportera tous les effets d’un jugement. En outre, lorsqu’elle constatera la mobilisation par le titulaire d’un CPF de droits indus ou une utilisation contraire à la réglementation, la Caisse des dépôts et consignations pourra procéder au recouvrement de l’indu par retenue sur les droits inscrits ou sur les droits futurs du titulaire.
Comme le prévoit l’article 2, les agents de la CDC pourront obtenir de l’administration fiscale les informations contenues dans le fichier des comptes bancaires, le Ficoba. En outre, la Caisse pourra recevoir de l’administration fiscale communication de tous les documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues, ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du CPF.
L’article 3 inscrit dans la loi les conditions du référencement des organismes de formation sur Mon compte formation, ce qui permettra de fonder le refus par la CDC de référencer un organisme qui ne remplirait pas ces conditions. Il sera notamment vérifié que l’organisme propose des formations éligibles à un financement au titre du CPF, qu’il dispose de la certification qualité Qualiopi, qu’il respecte les prescriptions de la législation fiscale et sociale et qu’il satisfait aux conditions générales d’utilisation.
La Caisse des dépôts et consignations pourrait procéder à la même vérification pour les organismes de formation déjà référencés sur la plateforme avant la promulgation de la loi. Afin d’assurer l’opérationnalité de la mesure, des échanges de données pourraient être organisés entre la CDC, les Urssaf et l’administration fiscale.
Afin de mettre fin à certaines dérives de nature à tromper les titulaires de CPF, l’article 4 encadre le recours à des sous-traitants en soumettant ces derniers aux mêmes obligations que les donneurs d’ordre.
Cette dernière mesure appelle une vigilance particulière. Appliquée indistinctement à tous les sous-traitants, notamment aux travailleurs indépendants et aux microentrepreneurs, elle pourrait mettre en péril une partie du secteur. Le décret en Conseil d’État devra bien préciser la portée de ces obligations selon le degré d’implication dans l’exécution des actions de formation et la nature du prestataire concerné.
Madame la ministre, nous comptons sur vous pour faire appliquer ces dispositions avec discernement et en bonne intelligence avec les représentants du secteur de la formation professionnelle. Votre propos liminaire démontre votre volonté d’aller dans ce sens.
Mes chers collègues, l’adoption de cette proposition de loi à l’Assemblée nationale a déjà eu un effet psychologique. Il s’agit aujourd’hui de ne pas laisser cet effet se dissiper et de ne pas retarder l’entrée en vigueur de ce texte utile et attendu.
Je vous invite donc, au nom de la commission des affaires sociales, à adopter sans modification cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, ainsi que sur des travées du groupe UC. – Mme Marie-Pierre Richer applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nos concitoyens subissent depuis des mois des campagnes massives de démarchage téléphonique concernant le compte personnel de formation. Ces appels incessants ont pour objectif, tantôt de s’enquérir du solde de leur compte, tantôt de les inciter lourdement à souscrire à des formations plus ou moins sérieuses, pour ne pas dire douteuses.
Le compte personnel de formation est un formidable outil au service de nos concitoyens, de leurs compétences et de leur productivité. Depuis 2015, il permet aux Français qui le souhaitent de financer des formations continues, grâce à leurs cotisations. Que ce soit pour se perfectionner dans leur emploi actuel ou pour se reconvertir dans une autre voie professionnelle, les Français s’en sont largement emparés.
Rançon du succès, à mesure que le nombre de formations continues dispensées augmentait, le nombre de fraudes s’est, lui, multiplié. Dans le flot de sollicitations que nos concitoyens reçoivent, de nombreuses offres ne sont pas légitimes. Poussés à conclure des contrats de formation, beaucoup ont constaté que la qualité n’était pas au rendez-vous. Pis, certaines formations ne sont tout simplement pas dispensées, les fraudeurs se contentant d’encaisser l’argent.
Dans un secteur qui est en train de devenir un véritable Far West, il nous faut donc légiférer. C’est tout l’objet de la proposition de loi portée par notre collègue Martin Lévrier.
Voté à l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, ce texte prévoit plusieurs mesures de bon sens.
Il pose tout d’abord le principe de l’interdiction de tout démarchage relatif au compte personnel de formation. J’étais ce matin au téléphone avec un élu local, le maire de Nozay, qui me disait que toute son équipe municipale, sans exception, avait été appelée et incitée à s’inscrire à une formation qui n’avait pas de sens.
Bien entendu, cette interdiction ne s’oppose pas à ce que le bénéficiaire d’une formation souscrite soit contacté par l’organisme pour les besoins de cette formation.
Ensuite, cette proposition de loi met fin à une pratique problématique à bien des égards. Le portage Qualiopi pouvait s’apparenter à un détournement de certification qualité. Une société certifiée pouvait permettre à une société qui n’en était pas une de bénéficier de sa certification. Désormais, sous-traitants ou non, les organismes de formation auront l’obligation d’être référencés auprès de la plateforme Mon compte formation.
En plus de cette obligation, les organismes de formation devront produire des justificatifs attestant du sérieux et de la qualité des formations dispensées.
Enfin, les instances chargées de la lutte contre la fraude voient leurs capacités de coopération renforcées. En échangeant leurs informations, elles seront plus efficaces dans leur mission. Nos concitoyens ne seront plus importunés et auront accès à des formations de qualité. Le renforcement du contrôle du compte personnel de formation permettra de mettre un coup d’arrêt à la fraude qui se développe.
Un consensus se dessine sur ce texte. Nous souhaitons que cette proposition de loi équilibrée soit adoptée le plus rapidement possible afin que nos concitoyens puissent bénéficier au plus tôt de ses effets.
L’ensemble du groupe Les Indépendants votera donc en faveur de cette excellente proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE. – Mme Nadia Sollogoub applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les Françaises et les Français reçoivent en moyenne cinq appels non désirés chaque semaine.
Le dernier rapport de Tracfin fait état d’une augmentation des fraudes téléphoniques détectées d’environ 450 % en un an, cette hausse étant en grande partie due aux fraudes au compte personnel de formation.
C’est évidemment insupportable : personne ne veut recevoir des appels et des SMS de manière intempestive, dont la plupart sont des arnaques. Cette situation a conduit à l’émergence d’un consensus transpartisan pour lutter contre ces fraudes.
Le problème, ce sont évidemment les arnaques – le groupe écologiste votera évidemment cette proposition de loi –, mais il ne faut pas oublier l’environnement qui les fait prospérer. La monétarisation du CPF, la conversion des heures en euros ainsi que la désintermédiation via Mon compte formation ont favorisé le développement d’un marché mal régulé et le montage de fraudes contre lesquelles nous travaillons aujourd’hui.
Les écologistes se sont toujours opposés aux modifications qui produisent ce genre d’effets délétères. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il faut aller plus loin et regarder l’environnement général qui rend les abus possibles.
Interdire les fraudes et le démarchage abusif sur un seul sujet à la fois ne change pas le problème de fond, puisque le problème se pose chaque fois qu’un nouveau marché se saisit de la possibilité de frauder. Les outils proposés par l’État, comme Bloctel, sont malheureusement peu efficaces.
En réalité, le démarchage téléphonique abusif est en général la forme la plus visible des conséquences de la vente de nos données personnelles et du manque de contrôle de la publicité.
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), en vigueur depuis 2018, n’impose le consentement préalable de la citoyenne et du citoyen que pour la prospection commerciale automatisée, c’est-à-dire via les courriels, les SMS ou les télécopies. Les appels téléphoniques sont donc rendus possibles par cette faille, alors même qu’ils peuvent être autant, voire plus intrusifs encore qu’un SMS.
Alors, que faire ?
Comme souvent, nous pourrions nous inspirer de nos voisins européens. L’Allemagne, l’Autriche, la Lituanie et la République tchèque ont fait le choix du opt-in pour les appels commerciaux : le démarchage commercial par téléphone n’est autorisé que si la personne a explicitement donné son accord. On inverse donc le principe actuel et on épargne les nuisances à des millions de personnes.
Dans cette lignée, je défendrai deux amendements visant à interdire le démarchage téléphonique commercial non consenti dans tous les domaines de prospection commerciale, pas seulement pour le CPF, et à mettre en place un registre d’autorisation des appels afin d’inverser la charge de la preuve, si je puis dire.
Je conclurai en rappelant que cette proposition de loi ne doit pas nous faire perdre de vue non seulement l’indispensable protection de nos données personnelles, mais également la nécessaire transformation du droit à la formation. Il s’agit d’adapter le monde du travail à l’inévitable tournant écologique.
Le Gouvernement prend un virage antisocial en prévoyant d’allonger la durée de cotisation pour obtenir une retraite décente, en rabotant le revenu de solidarité active (RSA), etc.
Le mot d’ordre, c’est travailler plus, précariser pour obliger chacune et chacun à prendre n’importe quel emploi, quitte à être en moins bonne santé. Travailler plus pour toujours produire plus, en pleine catastrophe écologique, n’est pourtant pas logique !
Nous, écologistes, pensons que la formation doit être un outil pensé au service de la transformation écologique de notre économie. Il faudrait donc instaurer un droit à la formation pour se reconvertir, intégré au compte professionnel de la prévention (C2P) et spécifiquement dédié aux métiers en transition.
Il faudrait aussi que le droit à la formation tienne compte de l’importance de former les individus tout au long de leur vie, pas seulement dans une optique de professionnalisation au sens strict du terme, mais pour permettre à chacune et à chacun d’apprendre, de s’enrichir de connaissances sur différents sujets d’intérêt général, de progresser dans la compréhension du monde, même si ce n’est pas formellement rattaché à un élément de carrière quantifiable à un instant T.
Tout cela participe de la construction d’une société plus ouverte, plus riche, plus intelligente, et dans laquelle je crois qu’il ferait meilleur vivre.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE. – M. Joël Guerriau et Mme Nadia Sollogoub applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la fraude au compte personnel de formation (CPF) a très fortement augmenté en 2021.
En un an, le nombre de notes transmises à l’autorité judiciaire par Tracfin a triplé et le montant total des enjeux financiers correspondants a quintuplé pour atteindre plus de 43 millions d’euros.
Afin de mieux lutter contre ces pratiques commerciales, plusieurs initiatives parlementaires ont été prises ces derniers mois. La proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui, et qui est en passe d’aboutir, ce qui est une excellente nouvelle, a été déposée par les groupes MoDem, Renaissance et Horizons.
Elle reprend les dispositions du texte de l’ancienne députée de Gironde, Mme Catherine Fabre, présente ce matin en tribune et que je salue. Les trois auteurs, nos collègues députés Bruno Fuchs, Sylvain Maillard et Thomas Mesnier rappellent à juste titre dans l’exposé des motifs que, si le CPF rencontre un succès remarquable, celui-ci s’accompagne de pratiques commerciales agressives, parfois abusives, visant à pousser les individus à acheter des formations contre leur gré : c’est inacceptable.
Ces agissements, que nous sommes très nombreux à subir, parfois quasi quotidiennement, prennent la forme d’appels, de SMS, de courriels, de la part de centres d’appels ou d’organismes de formation. À cette occasion sont souvent diffusées des informations erronées non seulement sur les droits à la formation de l’individu, mais aussi sur l’objet réel recherché par l’organisme. Le temps de la régulation est donc bienvenu.
La semaine dernière, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté à l’unanimité et sans modification cette proposition de loi. Cette validation fait suite à celle des députés, début octobre, là encore à l’unanimité.
Nous devons adopter définitivement ce texte, car ce phénomène regrettable, qui touche des milliers d’entre nous, rend plus que nécessaire le renforcement des dispositions en vigueur. C’est la raison pour laquelle notre groupe a souhaité inscrire cette proposition de loi dans son espace réservé de fin d’année.
Notre rapporteur, Martin Lévrier, qui est intervenu à plusieurs reprises sur ce sujet, l’a justement rappelé : lutte contre la fraude et amélioration de la qualité de la formation professionnelle forment un continuum. Si ce texte n’épuise pas le sujet des ajustements à apporter au CPF, il s’agit d’une première réponse importante.
Le dispositif que nous nous apprêtons à voter vise tout d’abord à interdire le démarchage par téléphone, par SMS et par courriel des organismes de formation en vue de lutter contre la fraude au CPF. Pour ce faire, les auteurs de cette proposition de loi proposent d’inscrire cette interdiction et dans le code de la consommation, sur le modèle du dispositif MaPrimeRénov’, et dans le code du travail, dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation.
Ils entendent également renforcer les capacités d’action de la Caisse des dépôts et consignations en matière de lutte contre les fraudes et en facilitant les possibilités de recouvrement des sommes indûment perçues.
Ce dispositif tend également à encadrer le recours à la sous-traitance par les organismes de formation intervenant sur la plateforme Mon compte formation.
Sur ce dernier point, monsieur le rapporteur, en réponse à l’inquiétude d’une partie des acteurs du marché de la formation, vous avez alerté le Gouvernement sur la situation des personnes ayant le statut d’autoentrepreneurs, qui auront toutes les difficultés à remplir les critères de la certification qualité Qualiopi. C’est pourquoi il est prévu que la déclinaison de cette disposition soit prise par décret, ce qui permettra une meilleure adaptation aux spécificités de chacun.
Si ce texte est adopté sans modification, sa promulgation devra intervenir rapidement pour qu’il puisse entrer en application dès le début de l’année 2023. Nous sommes, je le crois, très attendus sur ce point.
Madame la ministre, vous avez justement rappelé qu’« il est de notre devoir de dépolluer les pratiques illégales qui créent indûment de la dépense, ternissent l’image du compte personnel de formation et dépossèdent le titulaire de son libre arbitre ». Nous voterons cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP et RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour mémoire, le compte personnel de formation a été créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il est entré en vigueur en 2015, en remplacement du droit individuel à la formation.
L’objet du CPF était de rendre son efficacité à l’appareil de formation professionnelle initialement organisé par la loi Delors de 1971, qui a institué la possibilité pour le salarié de bénéficier, sur son initiative, d’un congé de formation rémunéré. Il s’agissait également d’obliger les entreprises de plus de dix salariés à participer au financement des actions de formation.
S’inscrivant dans cette continuité, la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, votée sous majorité socialiste en 2014, a donc permis de jeter les bases d’une véritable sécurité sociale professionnelle.
Elle a en effet mis en place le compte personnel d’activité, qui regroupe les droits du salarié avec le compte personnel de formation, le compte de prévention de la pénibilité et le compte engagement citoyen.
On sait le sort réservé par l’actuel gouvernement à ces acquis sociaux, alors que nous avions, par la loi de 2014, renforcé la place des partenaires sociaux en faisant de la formation professionnelle un élément central du dialogue social. Nous rappelions également notre attachement au mouvement de décentralisation de la formation professionnelle vers les régions.
En 2018, lors des discussions engagées ici même sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, nous dénoncions un texte qui allait fragiliser l’édifice que nous avions construit. Le projet de loi présenté par la ministre du travail d’alors devait en effet prétendument constituer un volet « sécurité des transitions professionnelles » en contrepartie des ordonnances Travail visant à « fluidifier » le marché du travail, auxquelles nous étions et demeurons foncièrement opposés.
En tout état de cause, le compte n’y était pas. Nous n’avons pu que constater qu’il s’agissait de la première réforme de la formation professionnelle qui ne fasse pas consensus depuis 1971. Elle a abouti à une véritable recentralisation.
Dans une logique qui porte la marque de fabrique de l’actuel Président de la République et de ses ministres, le Gouvernement s’est en effet assis sur la démocratie sociale en instaurant la monétisation du compte personnel de formation, en dépit du rejet unanime de cette évolution par les partenaires sociaux.
En monétisant le CPF, en supprimant les intermédiaires et en imposant le recours à une plateforme numérique, la majorité disait vouloir libérer les salariés et leur offrir plus de droits. Nous nous inquiétions de la pérennité des financements du CPF et des risques induits par la désintermédiation et la monétisation : il semble que nous ayons eu raison !
Concernant les enjeux du financement, le rapport d’information relatif à France Compétences publié en juin 2022 par trois sénateurs, dont notre collègue Corinne Féret, corapporteure de la mission à l’origine de ce document, souligne que les besoins de financement n’ont pas été anticipés. Ainsi, France Compétences, établissement public chargé du financement et de la régulation de la formation professionnelle, pourrait afficher un déficit de 5, 9 milliards d’euros en 2022 !
Le problème de la fraude au CPF, sujet de la présente proposition de loi, était également en germe dans la loi de 2018. Le résultat est connu : entre le premier semestre 2021 et le premier semestre 2022, les signalements de SMS indésirables ont été multipliés par quatorze ; les déclarations de soupçon liées à une potentielle fraude au CPF ont été multipliées par onze ; 32 400 signalements ont été effectués auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire du dispositif, au premier semestre 2022. Le préjudice estimé dans le cadre des plaintes pénales déposées par la CDC entre mars 2020 et mai 2022 s’élève à 27 millions d’euros. Les fraudes détectées par Tracfin sont passées de 8 millions d’euros en 2020 à 43 millions d’euros en 2021, soit une augmentation de l’ordre de 450 % !
Les propositions portées par le présent texte sont nécessaires et consensuelles ; nous y souscrivons, bien sûr.
L’article 1er interdit toute prospection commerciale des titulaires d’un CPF par voie téléphonique, par SMS, mais aussi par courrier électronique ou en ligne sur un service de réseaux sociaux.
Dans le but de permettre le contrôle effectif de l’interdiction du démarchage des titulaires du CPF, l’article 2 étend les pouvoirs des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour les habiliter à rechercher et à constater les infractions ou les manquements à cette interdiction.
L’article 2 bis, introduit en séance publique à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, met de nouveaux outils à disposition de la CDC pour faciliter le recouvrement des fonds versés de manière indue ou à la suite d’une fraude du titulaire du CPF.
L’article 3 prévoit d’imposer aux organismes de formation d’adresser à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur la plateforme Mon compte formation.
L’article 4, également introduit en séance publique à l’Assemblée nationale sur l’initiative du Gouvernement, tend à étendre aux sous-traitants certaines des obligations liées au référencement des organismes de formation sur la plateforme Mon compte formation. Actuellement, lorsqu’un organisme de formation a recours à un sous-traitant pour effectuer les actions de formation proposées sur son catalogue, ce dernier n’est pas soumis aux conditions générales d’utilisation.
Nous souscrivons à ces nécessaires corrections. Toutefois, à l’instar de l’ensemble des concitoyens de notre pays, nous sommes fatigués de naviguer d’usines à gaz en usines à gaz. Le démantèlement de la démocratie sociale par le Gouvernement et les choix dommageables qu’il opère en matière de droit du travail ont des conséquences que nous commençons à peine à réparer.
En raison de son caractère bien particulier, nous voterons en faveur de ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires a été adoptée à l’unanimité le 6 octobre 2022, en première lecture, à l’Assemblée nationale. Elle vise à mettre fin au démarchage incessant et intempestif émanant d’organismes parfois fictifs.
La création du compte personnel de formation, couplée à la monétisation des heures de formation, a entraîné l’émergence d’un démarchage agressif, avec son lot de fraudes. Pas un jour ne passe sans sa cohorte de SMS, d’appels ou de mails invitant à utiliser son crédit CPF.
Cette situation insupportable pour nos concitoyens s’explique évidemment par la loi Pénicaud de 2018, qui a transformé un dispositif comptabilisant des heures de formation en un montant financier à utiliser. Il est d’ailleurs difficilement acceptable que l’ancienne ministre du travail, à l’origine du big-bang de la formation professionnelle de 2018, s’apprête à entrer au conseil d’administration de Galileo Global Education, énorme groupe d’enseignement supérieur privé et acteur majeur de la formation initiale et continue.
Toujours est-il que l’interdiction de la prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, assortie de sanctions pour les entreprises contrevenantes, est une bonne nouvelle.
Il est regrettable qu’il ait fallu attendre quatre ans pour s’attaquer à ce fléau et doter de prérogatives de contrôle les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
La montée en puissance du CPF s’est accompagnée d’une hausse massive des fraudes et des tentatives de fraude. Entre 2020 et 2021, le nombre de déclarations de soupçon liées à une fraude potentielle au CPF a été multiplié par onze et celui des dossiers transmis à la justice par Tracfin, par trois.
Nous avons, d’un côté, des organismes fictifs, qui ont des pratiques frauduleuses, de l’autre, des organismes réels, qui effectuent du démarchage agressif. L’opprobre est jeté sur l’ensemble des organismes de formation, y compris ceux qui ne sont pas dans l’illégalité. Espérons que le référencement des organismes de formation sur le portail numérique Mon compte formation permettra de faire le tri entre les organismes sérieux et les autres.
Je voudrais profiter de mon intervention pour alerter sur la présence d’organismes de formation aux pratiques sectaires, qui piègent des salariés utilisant leur compte personnel de formation. Dans son dernier rapport d’activité, la Miviludes (mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) fait état d’une augmentation globale des dérives sectaires, avec un record de 4 020 saisines en 2021 et une hausse de 86 % entre 2015 et 2021.
Les formations de coaching, de techniques de vente, de développement personnel ou de techniques de soins non reconnues font l’objet d’un nombre très important de signalements. Face à ses dérives, il nous faut renforcer la formation permanente des agents chargés du contrôle.
Enfin, je voudrais souligner que l’examen de cette proposition de loi se fait dans un contexte de restriction de l’accès à la formation professionnelle après que le Gouvernement a instauré un reste à charge.
En effet, le projet de loi de finances pour 2023, que nous avons adopté mardi dernier en première lecture, va contraindre les salariés à prendre en charge 20 % à 30 % du coût de leur formation. Cette remise en cause du droit à la formation, qui pénalisera en premier lieu les salariés les plus modestes et les privés d’emplois, est évidemment inacceptable. Nous défendons une formation professionnelle accessible tout au long de la vie aux travailleurs et aux privés d’emplois, intégralement financée par les entreprises.
Nonobstant cette disposition, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER.
Mmes Véronique Guillotin et Marie-Pierre Richer applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé le compte personnel de formation, créé en 2014. Le principe d’un droit à la formation comptabilisé en heures a ainsi été remplacé par une monétisation en euros.
Sur le site du ministère de l’économie et des finances, des chiffres s’affichent en gros caractères : au 30 septembre 2021, 38, 8 millions de titulaires d’un compte personnel de formation ; montant moyen de 1 500 euros par CPF ; 2, 86 millions de dossiers acceptés entre novembre 2019 et fin septembre 2021… N’importe quel malfaisant pas très malin a alors vite fait de comprendre, par une soustraction et une multiplication, qu’environ 36 millions de salariés n’ont pas mobilisé leurs 1 500 euros de CPF et qu’il y avait là une source gigantesque d’arnaque… ce qui n’a pas manqué pas de se produire ! Ce sont même des malfaisants très malins qui ont sauté sur l’aubaine.
Les premières fraudes furent relativement simples : fausses formations, fausses identités… Malgré le renforcement des dispositifs de contrôle, Tracfin a constaté en 2021 une persistance, voire un renforcement, de la fraude, qui s’adapte au fur et à mesure des tentatives de sécurisation.
Désormais, on constate des inscriptions fictives à des formations non suivies, un démarchage agressif et même des incitations aux inscriptions au travers d’offres de cadeaux. Derrière ces pratiques se cachent des réseaux de criminalité organisée, dont des affairistes déjà connus dans le cadre de fraudes aux certificats d’économies d’énergie et qui ont mis la main sur le dispositif.
Plusieurs dossiers ont donné lieu à des saisies pénales effectives pour un total de 3, 5 millions d’euros. Parmi les vingt dossiers transmis, dix mettent en lumière des réseaux de fraudeurs particulièrement structurés et rattachés à des groupes criminels organisés.
Voici un exemple réel. La société A, spécialisée dans la formation continue d’adultes, créée en septembre 2020 par M. X, qui la dirige, n’emploie aucun salarié et reçoit plus de 8 millions d’euros de la Caisse des dépôts et consignations au titre du CPF sur la base de fausses attestations de stagiaires. Une part importante de ces sommes est transférée à des personnes physiques et morales liées à M. X, dont des sociétés actives dans le secteur du BTP ou celui du conseil, pour 1 million d’euros, à une association présidée par le frère de M. X, pour 3 millions d’euros, et à deux membres de la famille de M. X pour 200 000 euros. Une partie des fonds versés sur le compte de l’association est notamment utilisée pour l’achat de véhicules ou de montres de luxe par le frère de M. X. Enfin, 300 000 euros ont été transférés à des personnes physiques enregistrées comme stagiaires de la société A ayant initialement sollicité le paiement du CPF.
Au cours de l’année 2021, la Caisse des dépôts et consignations a mis fin aux versements à la société A en raison de graves soupçons de fraude. Plus de 2 millions d’euros d’avoirs ont finalement pu être saisis et confisqués par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), mais 6 millions se sont potentiellement évadés !
C’est pourquoi, sans hésiter et sans état d’âme, et afin de rendre impossibles ces pratiques de démarchage dans les meilleurs délais, nous voterons conforme le texte qui nous est proposé aujourd’hui.
Il faut que cette situation cesse au plus vite : il s’agit non pas de mettre en place des procédures dématérialisées plus complexes, mais de réussir à bloquer l’accès aux numéros des bénéficiaires. En effet, ce sont non pas les personnes déjà éloignées du numérique qu’il faut écarter, mais bien les bandits financiers.
Devant ce constat de fraude exponentielle, l’article 1er du texte tend à interdire la prospection commerciale des titulaires de CPF, sauf sollicitation explicite dans le cadre d’une action de formation en cours.
Voilà qui est très bien, mais la vraie question est de savoir comment les acteurs du grand banditisme ont libre accès à ces fichiers. Face à la circulation de nos informations personnelles dans tous les clouds du monde, reste-t-il une possibilité de verrouillage ? Car, faute d’agir sur la sécurité des fichiers, après s’être fait arnaquer hier sur les dossiers d’isolation, aujourd’hui sur les dossiers de formation, l’État et les citoyens se feront arnaquer demain sur d’autres dossiers. Et ce sera toujours plus juteux, plus organisé, plus efficace et de plus grande ampleur !
L’article 2 prône le contrôle par l’échange et le croisement d’informations entre les services, ce qui semble de pur bon sens, sinon élémentaire. C’est du fonctionnement des services en silo que naissent et prospèrent les supercheries les plus énormes. Les outils informatiques auraient dû permettre depuis longtemps le recoupement systématique des données – et dans tant de domaines ! Ce dispositif mériterait d’être généralisé.
Vous aurez compris que cette proposition de loi va dans le bon sens, mais qu’elle intervient – comme toujours, hélas ! – a posteriori, alors que l’on a été débordé et que le torrent semble bien difficile à contenir.
Je pose à cette occasion la question des moyens du contrôle et de son coût. J’imagine et j’espère que tout est calibré à la hauteur de l’enjeu. Mais ne répondez pas ici, des oreilles malhonnêtes pourraient écouter…
Sourires.

Voilà quelques mois, lors de l’examen de la proposition de loi visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, nous avions décidé de ne pas aller au-delà du dispositif Bloctel, qui permet théoriquement de se protéger, afin de respecter des milliers d’emplois de salariés honnêtes. Nous sommes aujourd’hui dans un autre cas de figure : l’interdiction du démarchage au compte CPF ne contrariera que des opérations frauduleuses. Alors, allons-y !
Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. le rapporteur applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le compte personnel de formation a fait l’objet d’une réforme en 2018, dans le cadre de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L’objectif, que nous partagions, était de rendre les droits à la formation plus lisibles et plus accessibles, en créant notamment une plateforme internet sur laquelle chaque personne pourrait connaître le montant de ses droits – désormais visibles en euros –, choisir et payer directement sa formation, sans intermédiation.
Lancée à la fin de 2019, la plateforme Mon compte formation a permis l’activation de 19 millions de profils et l’augmentation très nette du nombre d’entrants en formation dans toutes les catégories professionnelles, ce qui est à souligner. Les femmes, plus souvent à temps partiel, bénéficient de l’alignement des droits, avec un compte alimenté de 500 euros par an pour tous les salariés effectuant au moins un mi-temps, et 800 euros pour les moins qualifiés ou en situation en handicap.
Cette réforme, que nous jugions souhaitable à l’époque et dont nous constatons aujourd’hui le succès, a rendu les Français plus libres d’évoluer professionnellement. Nous savons à quel point la question de la formation est centrale dans la recherche de l’adéquation entre les profils des demandeurs d’emploi et les offres présentes sur le marché du travail.
Mais tout changement entraîne des effets de bord et nous sommes en plein dedans : la montée en puissance du CPF s’est en effet accompagnée d’une hausse massive des fraudes, des tentatives de fraude, ainsi que d’un harcèlement par appels téléphoniques, par SMS, par courriels ou par démarchages sur les réseaux sociaux, comme l’ont souligné les orateurs précédents.
Le phénomène a pris une ampleur considérable depuis plusieurs mois – je crois que beaucoup d’entre nous peuvent le confirmer pour l’avoir également subi. Au-delà des pratiques commerciales agressives, voire abusives, des informations erronées sont véhiculées, induisant en erreur les titulaires des comptes ou les poussant à acheter des formations contre leur gré.
C’est aujourd’hui une nuisance réelle, qui a envahi le quotidien des Français et qui met en péril la crédibilité du dispositif et du secteur de la formation professionnelle.
Tracfin évalue la fraude à 43 millions d’euros en 2021. Nous devons y mettre un terme au plus vite. Cette proposition de loi, nécessaire et bienvenue, vise à rappeler que le CPF est un outil destiné à ceux qui le détiennent et non aux organismes de formation. Les Français doivent impérativement garder la main sur leurs droits.
Les dispositifs jusqu’ici mis en place pour contrôler la qualité des formations et sanctionner les manquements et les fraudes n’ont malheureusement pas permis de lever toutes les difficultés. Il s’agit donc de mettre en place des barrages filtrants, afin de compliquer les contournements du dispositif, à défaut de pouvoir totalement les supprimer.
Pour ce faire, cinq solutions concrètes ont été retenues.
Premièrement : l’interdiction, avec amendes dissuasives, comme vous l’avez rappelé, madame la ministre, de toute prospection commerciale visant les titulaires d’un CPF, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de prestations en cours.
Deuxièmement : la sécurisation de l’échange d’informations entre les acteurs mobilisés dans la lutte contre la fraude au CPF.
Troisièmement : le renforcement des pouvoirs de recouvrement des indus de la Caisse des dépôts et consignations.
Quatrièmement : le renforcement des modalités de contrôle du référencement des organismes de formation sur Mon compte formation.
Cinquièmement, enfin : l’encadrement du recours à la sous-traitance des organismes de formation pour imposer aux sous-traitants les mêmes exigences et donner à la Caisse des dépôts et consignations les moyens de contrôle, de vérification et d’intervention adéquats.
Des ajustements sont nécessaires et les solutions proposées ici semblent consensuelles. Cette proposition de loi a été adoptée voilà quelques semaines à l’Assemblée nationale ; si nous l’adoptons à notre tour sans modification – et nous avons bien entendu le message
Sourires.

–, elle pourra s’appliquer sans délai. Pour cette raison, pour que ces nuisances cessent au plus vite, le groupe du RDSE votera en faveur de ce texte sans modification.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et RDPI. – Mme Marie-Pierre Richer applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, utilisable par tous, tout au long de la vie active, y compris en période de chômage, le compte personnel de formation est au moins un succès quantitatif avec un doublement des effectifs chaque année, 500 000 formations demandées en 2019, plus de 1 million en 2020 et plus de 2 millions en 2021.
Toutefois, si la monétisation du CPF a favorisé sa démocratisation, elle a également eu des effets pervers avec une fraude en tout genre et des démarchages abusifs.
Dans le sillage du CPF, un lot de pratiques douteuses, incontrôlables et incontrôlées sont apparues : usurpations d’identité et détournements des droits, nuisances par des appels et sollicitations intempestives.
Le CPF, qui pèse pour 2, 7 milliards d’euros de dépenses, soit un cinquième du budget de France Compétences, attire désormais une délinquance économique organisée, comme le démontrent les 440 enquêtes ouvertes par le service central de renseignement criminel de la gendarmerie.
La recrudescence atteint même des sommets : selon la cellule de renseignement financier nationale Tracfin, l’année 2021 a été marquée par la plus forte hausse de faux organismes détectés avec un préjudice cumulé de 43, 2 millions d’euros après démarchage téléphonique ou en ligne, soit une multiplication par six de la fraude en seulement un an.
Force est donc de constater que le récent guide de prévention contre les arnaques publié par le ministère de l’économie et des finances n’aura pas été efficace, non plus que les timides campagnes de sensibilisation. L’action du Parlement est donc pleinement nécessaire pour endiguer ce phénomène.
Pourtant, dès 2018, le Sénat avait à la fois mis en garde et exprimé des réserves sur la monétisation et la désintermédiation du CPF.
Le Gouvernement avait déclaré qu’il s’agissait d’un « pari ». Si celui-ci a permis à un plus large public d’accéder à la formation, il a aussi occasionné des dérives que l’on s’efforce de traiter au travers du présent texte.
Cette proposition de loi est donc la bienvenue afin de contrer des pratiques qui siphonnent des crédits destinés à la formation professionnelle, un programme déjà difficilement pilotable compte tenu des rallonges budgétaires répétées et votées à France Compétences en lois de finances. Le CPF n’a par conséquent pas un seul euro à perdre !
Face à la fraude, les pouvoirs publics ne sont pourtant pas restés inactifs. Je tiens à saluer plus particulièrement le travail des forces de l’ordre, qui, grâce à des enquêtes minutieuses et complexes, ont réussi à démanteler plusieurs réseaux de faux organismes au cours des dernières semaines, dont un dans les Alpes-Maritimes, à Cannes-Mandelieu, pour un préjudice de 8, 2 millions d’euros.
Cette proposition de loi permettra non seulement d’en finir avec ces escroqueries, mais aussi de restaurer l’image dégradée du CPF, lequel, faute de réponse adaptée, perd en visibilité.
En effet, bon nombre de Français ne prennent plus les appels ou textos au sérieux, risquant ainsi de se détourner de leur CPF, pourtant essentiel au cours de leur carrière professionnelle.
À l’avenir, la question du financement des formations sera aussi un enjeu de nature à réduire la fraude, tout particulièrement celle qui est consentie par des actifs dans le cadre de la revente de codes d’accès CPF.
Comme l’a proposé et voté le Sénat le 28 novembre dernier, dans le cadre de l’examen des crédits de la mission « Travail et emploi » du projet de loi de finances pour 2023, instaurer un plafonnement de prise en charge par le CPF du coût de certaines formations serait de nature à sécuriser le CPF au travers d’un mécanisme de régulation.
J’espère ainsi que l’amendement adopté au Sénat, accueilli par un avis de sagesse du Gouvernement, obtiendra votre soutien, madame la ministre, une fois le 49.3 de nouveau dégainé à l’Assemblée nationale.
Ce qui est vrai pour le budget de la sécurité sociale l’est aussi pour la formation : ce qui est gratuit n’a pas de valeur. Si nous voulons que les salariés participent plus activement non seulement à la lutte contre la fraude, mais aussi à leur parcours professionnel, sans se contenter de répondre à un appel ou à un message leur signalant qu’ils ont du crédit sur leur CPF, il faudra en passer par un reste à charge encadré, sans pour autant en faire une barrière tarifaire.
Cette piste avait d’ailleurs été mise en lumière par l’excellent rapport de Mmes Frédérique Puissat, Corinne Féret et vous-même, monsieur le rapporteur.
Enfin, en matière de prévention contre la fraude, l’arsenal de la Caisse des dépôts et consignations contient les « conditions générales d’utilisation » (CGU), auxquelles doivent se conformer les 44 000 organismes de formation, dont certaines start-up innovantes, essentiellement digitales. Plusieurs de ces organismes qui ont dynamisé le secteur m’ont fait part d’une rigidité dans la mise à jour des conditions générales d’utilisation et de délais très courts pour s’y conformer, avec un risque juridique contractuel pour les formations proposées.
Cette question ne relevant pas du domaine de la loi, je n’ai finalement pas déposé d’amendement visant à laisser aux organismes un délai minimal de mise à jour des CGU. Toutefois, je tiens à vous signaler, madame la ministre, que bon nombre d’entre eux sont inquiets.
De l’aveu même du rapport de la commission des affaires sociales, les CGU ont été modifiées à plusieurs reprises, mais la mise à jour demande un important travail juridique que ces organismes ne sont pas tous en mesure de fournir, puisque ce n’est pas leur cœur de métier.
À ce titre, l’article 3 inscrit dans la loi les conditions du référencement des formations sur Mon compte formation et établit un contrôle des formations éligibles au financement CPF, au travers de la certification qualité Qualiopi, de la législation fiscale, de la sécurité sociale, mais aussi de la satisfaction aux CGU établies par la Caisse des dépôts et consignations. Pouvez-vous rassurer ces organismes sur ce point précis ?
Il serait regrettable qu’un excès de règles contraignantes succède à un excès de simplification. Ces organismes souhaiteraient donc que la Caisse des dépôts et consignations fasse preuve de plus de souplesse.
Pour conclure, le groupe Les Républicains votera ce texte en l’état, les dispositifs proposés permettant de rendre plus efficaces les efforts déployés pour lutter contre les abus de fraude au CPF.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. le rapporteur et M. François Patriat applaudissent également.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Non modifié)
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° Après le 30° de l’article L. 511-7, il est inséré un 31° ainsi rédigé :
« 31° De l’article L. 6323-8-1 du code du travail. »
II. – Après l’article L. 6323-8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323 -8 -1. – Est interdite toute prospection commerciale des titulaires d’un compte personnel de formation, par voie téléphonique, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne visant à :
« 1° Collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant des droits inscrits sur le compte mentionné au premier alinéa du présent article et leurs données d’identification permettant d’accéder au service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 ;
« 2° Conclure des contrats portant sur des actions mentionnées à l’article L. 6323-6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une action en cours et présentant un lien direct avec l’objet de celle-ci.
« Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »

J’interviendrai rapidement, comme je l’ai fait la semaine dernière en commission.
Ce texte constitue une avancée importante pour lutter contre les arnaques en lien avec le compte personnel de formation. J’ai bien compris, comme nombre d’entre nous, l’importance d’adopter ce texte conforme, et c’est la raison pour laquelle je n’ai pas déposé d’amendement.
Le démarchage abusif lié au CPF peut concerner non seulement le téléphone et les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes internet, par deux biais : les publicités entre les vidéos et à l’intérieur des vidéos elles-mêmes, qui font parfois la promotion de formations susceptibles d’être financées par le CPF, et les influenceurs, qui font croire que, avec telle ou telle formation, vous deviendrez un expert en placements financiers et gagnerez beaucoup d’argent. Je caricature à peine !
Je souhaitais donc simplement alerter sur ce point. Bien évidemment, cette proposition de loi est bienvenue et je la voterai évidemment comme l’ensemble de mon groupe. Toutefois, je ne voudrais pas que le texte présente des failles. Après le vote de ce texte et la publication des décrets d’application, il conviendra de rester très vigilant, pour éviter que certains escrocs ne profitent de certaines brèches, failles et autres trous dans la raquette.
Madame la sénatrice, nous partageons la même détermination à lutter également contre ce type de dérives.
Permettez-moi de rappeler ce que j’évoquais dans le cadre de la discussion générale voilà quelques instants. La Caisse des dépôts et consignations, opérateur du CPF, a adressé des mises en demeure par voie d’avocat, auxquelles un bon nombre de destinataires ont répondu.
Ces mises en demeure concernent trois axes : premièrement, l’arrêt de toute publicité en lien avec le CPF, que nous avons déjà pu constater assez largement ; deuxièmement, la mise à disposition de documents émanant de ces sociétés, pour poursuivre des enquêtes et effectuer, le cas échéant, des dépôts de plainte ; troisièmement, la diffusion de messages rectificatifs sur les réseaux sociaux des personnes concernées, afin d’informer sur la quasi-illégalité de la pratique.
La Caisse des dépôts et consignations a également mené plusieurs actions pour faire cesser ces pratiques commerciales trompeuses. Elle s’est rapprochée de Meta France pour tenter d’obtenir non seulement la suppression a posteriori des publications dont elle a connaissance, mais aussi la mise en place d’un mécanisme de filtrage a priori des contenus illégaux.
Par ailleurs, elle s’est rapprochée des grandes agences d’influenceurs pour les alerter sur le sujet. Cette démarche a eu un effet positif, puisque les influenceurs de ces agences ont diffusé, dès le dimanche 13 novembre, un message attirant l’attention des followers sur les arnaques au CPF.
Bien évidemment, nous poursuivrons les échanges avec ces acteurs, parce que nous sommes, comme vous, convaincus que ce type de pratiques doit absolument cesser.
Nous chercherons à poursuivre nos travaux avec Meta France, afin de fermer complètement les comptes proposant des offres illicites.
Je le rappelle, le Gouvernement doit rencontrer demain les différents acteurs, afin de renforcer le message concernant notre détermination à lutter contre ce type d’usage.

Cette proposition de loi destinée à lutter contre les fraudes au compte personnel de formation est très attendue, car elle porte sur un sujet d’une actualité accrue et qui a pris une dimension internationale.
J’ai été sensibilisé à un aspect particulier de ces escroqueries par un conseiller des Français établis aux Émirats arabes unis, qui m’a recommandé de prendre attache avec Mme Christelle Coiffier, que je tiens à saluer ici pour son action de lanceuse d’alerte.
Conseillère à Pôle emploi, en lien avec la Caisse des dépôts et consignations, elle s’est rendu compte de ce que font certains influenceurs, partis à Dubaï pour tirer profit de l’image positive de cet émirat, afin, littéralement, de vendre du rêve. Argent facilement gagné et soleil toute l’année, ils représentent, pour de nombreuses personnes, un modèle, ce qui leur permet de faire la promotion de formations « bidon ». Certains font même la promotion de formations éphémères pour devenir influenceurs !
Confrontée à la détresse de chercheurs d’emploi dont le crédit de formation était épuisé à force d’avoir couru après ces mirages, Mme Coiffier a décidé d’alerter, en prenant sur son temps libre, sur les arnaques au CPF montées par ces influenceurs. Elle a reçu le soutien de Stéphane Vojetta, député de la 5e circonscription des Français établis hors de France.
La proposition de loi qui nous est présentée doit être accompagnée d’une prise de conscience de cette dimension internationale, car elle va malheureusement de pair avec l’impunité des escrocs.
Bruno Le Maire, qui a souvent mis en garde les influenceurs sur leur mode opératoire, a annoncé une table ronde dans quelques jours pour réguler ces pratiques. Cela va dans le bon sens, tout comme cette initiative parlementaire que je soutiens.
Mmes Nadia Sollogoub et Colette Mélot applaudissent.
L ’ article 1 er est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -16. – La prospection commerciale par voie téléphonique n’est autorisée que dans le cadre des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours ou si le professionnel a reçu le consentement du consommateur au sens du 11 de l’article 4 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, et dans les conditions mentionnées à l’article 7 du même règlement. »
2° Les articles L. 223-1 à L. 223-7 sont abrogés.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Cet amendement, dont l’objet est simple, vise à compléter le dispositif prévu par le texte, pour instaurer un principe général d’interdiction du démarchage téléphonique commercial non consenti.
La loi du 24 juillet 2020 visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux a interdit le démarchage téléphonique commercial pour l’isolation des logements et les travaux d’installation de production d’énergie renouvelable. Un an plus tard, la loi du 8 avril 2021 relative à la réforme du courtage de l’assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement a procédé à une régulation de ces mêmes pratiques pour les seuls distributeurs d’assurance.
En réalité, le démarchage commercial non consenti saoule tout le monde, quel que soit le sujet ! Nous proposons donc de l’interdire en général.

L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes M. Vogel et Poncet Monge, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -16. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 221-12, le professionnel qui contacte un consommateur inscrit sur la liste d’autorisation mentionnée à l’article L. 223-4 par téléphone en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service indique au début de la conversation, de manière claire, précise et compréhensible, son identité, le cas échéant l’identité de la personne pour le compte de laquelle il effectue cet appel et la nature commerciale de celui-ci.
« À la suite d’un démarchage par téléphone, le professionnel adresse au consommateur, sur papier ou sur support durable, une confirmation de l’offre qu’il a faite et reprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
« Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après l’avoir signée et acceptée sur support durable. » ;
2° À l’intitulé du chapitre III du titre II du livre II, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot « Autorisation » ;
3° L’article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -1. – La prospection commerciale de consommateurs par voie téléphonique est interdite à l’exception des sollicitations effectuées auprès des personnes inscrites gratuitement à une liste d’autorisation au démarchage téléphonique ou lorsque la sollicitation intervient dans le cadre d’une relation contractuelle existante à la date de l’appel et dont le sujet a un lien direct avec l’objet du contrat souscrit.
« Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du deuxième alinéa du présent article.
« L’alinéa précédent s’applique également aux sollicitations adressées aux personnes inscrites sur la liste d’autorisation au démarchage téléphonique.
« Tout professionnel saisit, directement ou par le biais d’un tiers agissant pour son compte, l’organisme mentionné à l’article L. 223-4 aux fins de s’assurer de la conformité de ses fichiers de prospection commerciale avec la liste d’autorisation au démarchage téléphonique :
« 1° Au moins une fois par mois s’il exerce à titre habituel une activité de démarchage téléphonique ;
« 2° Avant toute campagne de démarchage téléphonique dans les autres cas.
« Un décret, pris après avis du Conseil national de la consommation, détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique peut avoir lieu, lorsqu’elle est autorisée en application du premier alinéa du présent article.
« Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique. Ce code de bonnes pratiques, rendu public, est élaboré par les professionnels opérant dans le secteur de la prospection commerciale par voie téléphonique. Il est, en tant que de besoin, précisé par décret.
« Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation.
« Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul.
« Tout recueil du consentement à être démarché par voie téléphonique lors de la conclusion d’un contrat est nul. » ;
4° L’article L. 223-2 est abrogé ;
5° À l’article L. 223-3, les mots : « inscrits sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique » sont remplacés par les mots : « non-inscrits sur la liste d’autorisation au démarchage téléphonique ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2024.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Il existe actuellement une présomption de consentement au démarchage commercial. Mais on peut s’inscrire sur une liste pour refuser ce démarchage.
Par cet amendement, il s’agit de passer à une logique inverse, en instaurant une présomption de non-consentement au démarchage commercial, tout en prévoyant la possibilité de s’inscrire dans un registre pour signifier son accord au démarchage. Sinon, il ne serait pas possible d’être démarché.
Il convient donc d’inverser la logique. Plusieurs pays européens l’ont fait, c’est ce qu’on appelle l’opt-in. Cela fonctionne bien et soulage des millions de personnes.

Ces deux amendements concernent l’encadrement légal du démarchage téléphonique en général. En conséquence, leur portée dépasse de très loin le simple sujet du CPF, que nous étudions aujourd’hui.
Ces amendements visent à remplacer l’actuel régime d’opposition au démarchage téléphonique, matérialisé par le dispositif Bloctel, par un régime d’autorisation préalable.
L’amendement n° 1 prévoit qu’un professionnel doit avoir obtenu le consentement exprès du prospect avant de pouvoir le démarcher par téléphone.
Quant à l’amendement n° 2 rectifié, il prévoit que seules sont autorisées les sollicitations effectuées auprès des personnes inscrites sur la liste d’autorisation du démarchage téléphonique.
Je le rappelle, l’encadrement du démarchage téléphonique a déjà été renforcé, voilà deux ans, par la loi du 24 juillet 2020, qui a complété le régime d’opposition au démarchage téléphonique, en imposant notamment aux professionnels qui contactent un consommateur par téléphone de lui indiquer qu’il peut s’inscrire gratuitement sur Bloctel.
Par ailleurs, avant toute opération de démarchage téléphonique, l’entreprise doit s’assurer auprès de Bloctel que les consommateurs qu’elle entend prospecter ne sont pas inscrits sur la liste d’opposition. La loi a ainsi alourdi les sanctions applicables en cas d’abus.
En outre, certaines dispositions de cette loi ne sont pas encore entrées en application, comme la limitation du démarchage téléphonique à certaines plages horaires.
Je propose donc de nous en tenir à un dispositif ciblé sur le démarchage lié au CPF, qui pourra ainsi entrer en application immédiatement. Il conviendra de faire, le moment venu, un bilan plus général des effets de la loi de 2020, afin d’y apporter d’éventuelles modifications.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
I. – La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333 -7 -1. – La Caisse des dépôts et consignations, les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux chargés des contrôles de la formation professionnelle mentionnés au chapitre Ier du titre VI du présent livre, les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316-1, les organismes certificateurs et les instances de labellisation mentionnés à l’article L. 6316-2, les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 et France compétences peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice. »
II. – Après le 6° de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier, sont insérés des 6° bis et 6° ter ainsi rédigés :
« 6° bis À la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;
« 6° ter À l’Agence de services et de paiement ; ».
III. – Après l’article L. 8271-5-1 du code du travail, il est inséré un article L. 8271-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 8271 -5 -2. – Les agents de contrôle mentionnés au 1° de l’article L. 8271-1-2 peuvent transmettre aux agents de la Caisse des dépôts et consignations tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement par ces derniers des missions prévues à l’article L. 6323-9 confiées à cet organisme.
« Les agents de la Caisse des dépôts et consignations peuvent transmettre aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. »
IV. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZO ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZO. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 6131-4 et L. 6333-6 du code du travail et à l’article L. 1621-4 du code général des collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations peut, sur sa demande, recevoir de l’administration fiscale les informations, contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 A du code général des impôts et nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées.
« II. – La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir de l’administration fiscale, spontanément ou sur demande, communication de tous documents ou renseignements nécessaires aux contrôles préalables au paiement des sommes dues ainsi qu’à la reprise et au recouvrement des sommes indûment versées au titre du compte personnel de formation. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complété par des sections 7 et 8 ainsi rédigées :
« Section 7
« Modalités de remboursement des sommes indues
« Art. L. 6323 -44. – Pour le remboursement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
« Art. L. 6323 -45. – Lorsqu’elle constate la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou une mobilisation par celui-ci des droits en violation de la réglementation ou des conditions générales d’utilisation du service dématérialisé, la Caisse des dépôts et consignations peut procéder au recouvrement de l’indu par retenue sur les droits inscrits ou sur ceux faisant l’objet d’une inscription ultérieure sur le compte.
« Section 8
« Dispositions d’application
« Art. L. 6323 -46. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. » –
Adopté.
(Non modifié)
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323 -9 -1. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9.
« Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition :
« 1° D’être enregistrés dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre V du présent livre et de justifier du respect des obligations mentionnées aux articles L. 6352-1, L. 6352-2, L. 6352-6 et L. 6352-11 ;
« 2° De satisfaire aux conditions d’exercice dans le cadre du service dématérialisé, notamment à celles liées à l’éligibilité des actions prévues à l’article L. 6323-6 et à celles liées à la détention des autorisations et certifications nécessaires, dont celles mentionnées à l’article L. 6316-1 du présent code et à l’article L. 1221-3 du code général des collectivités territoriales, ainsi que des habilitations délivrées par les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l’article L. 6113-2 du présent code ;
« 3° De respecter les prescriptions de la législation fiscale et de sécurité sociale ;
« 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ;
« 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9.
« La Caisse des dépôts et consignations peut refuser de référencer le prestataire qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une sanction du fait d’un manquement à ses obligations contractuelles prévues par ces conditions générales d’utilisation.
« Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire.
« Pour l’application du 3° du présent article, des traitements automatisés de données peuvent être organisés entre la Caisse des dépôts et consignations, les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale et l’administration fiscale.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
II. – Le neuvième alinéa de l’article L. 6323-9-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique aux prestataires déjà référencés sur le service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323-8 du code du travail à la date de publication de la présente loi. –
Adopté.
(Non modifié)
La section 1 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323 -9 -2. – Le prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 peut confier à un sous-traitant, par contrat et sous sa responsabilité, l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6323-6, dans des conditions définies par voie réglementaire. Le sous-traitant doit avoir préalablement procédé à la déclaration prévue à l’article L. 6351-1 et justifier du respect des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l’article L. 6323-9-1.
« Lorsqu’une ou plusieurs des conditions mentionnées aux 1° à 3° et 5° de l’article L. 6323-9-1 cessent d’être remplies par le sous-traitant, la Caisse des dépôts et consignations, après avoir mis en demeure le prestataire mentionné au premier alinéa du présent article selon des modalités fixées par voie réglementaire, procède au déréférencement du prestataire.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. » –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires.
La proposition de loi est adoptée définitivement.

M. le président. Je constate que cette proposition de loi a été adoptée à l’unanimité des présents.
Applaudissements.

Acte vous est donné de cette mise au point, mon cher collègue. Elle sera publiée au Journal officiel et figurera dans l’analyse politique du scrutin.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante-cinq, est reprise à onze heures quarante-six.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, de la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits de l’enfant, présentée par M. Xavier Iacovelli et plusieurs de ses collègues (proposition n° 870 rectifié [2021-2022], résultat des travaux de la commission n° 152, rapport n° 151).
Dans la discussion générale, la parole est à Xavier Iacovelli, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au moment où nous entamons en séance l’examen de cette proposition de loi visant à créer, dans notre assemblée, une délégation aux droits de l’enfant, je reconnais bien volontiers une certaine émotion.
En effet, pendant trop longtemps, nous avons cessé, collectivement, de voir les enfants comme des sujets de droit à part entière. Nous avons refusé d’admettre que les problématiques qui les touchaient étaient diverses et englobaient, finalement, l’ensemble de nos politiques publiques.
En outre, je sais que cette délégation aux droits de l’enfant est attendue de longue date – plus de vingt ans ! – par l’ensemble des acteurs.
À cet égard, permettez-moi de remercier les associations, collectifs et toutes les personnalités engagées qui nous regardent aujourd’hui et qui œuvrent sans relâche pour que les droits des enfants soient davantage reconnus et protégés et qui, publiquement, ont fait le choix de soutenir cette proposition de loi.
Le constat est simple : de nombreux défis doivent être relevés pour assurer le respect des droits de l’enfant.
Si je me félicite de la récente création d’une délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale, il n’est pas question pour nous de jouer sur le mimétisme.
Depuis 2018, avec un certain nombre d’entre vous, sur toutes les travées, nous avons décidé la création d’un groupe informel pour travailler sur la question de la protection de l’enfance, le Sénat se devant d’avoir une entité dédiée aux questions de l’enfance.
J’avais également demandé, en 2020, la création d’un groupe d’études au sein de la commission des affaires sociales auprès de sa présidente. Malheureusement, nous avons, une nouvelle fois, essuyé un refus.
Soyons tout à fait honnêtes, notre détermination à travailler sur les questions liées à l’enfance ne date pas de cette proposition de loi. Déjà, en février 2003, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’unanimité, une proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants, présentée par le président du groupe UMP de l’époque, Jacques Barrot. Or ce texte n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour du Sénat.
En 2009, notre collègue du groupe LR, Joëlle Garriaud-Maylam, avait déposé au Sénat cette même proposition de loi tendant à la création de délégations aux droits de l’enfant.
Notre rapporteure générale du budget de la sécurité sociale, Élisabeth Doineau, avait également proposé la création de cette délégation. Plus récemment, Mme Assassi et le groupe CRCE ont déposé, en 2019, un texte en vue de la création d’une telle délégation.
Vous le voyez donc, chers collègues la question de l’enfance rassemble, au-delà de nos étiquettes, et traverse même le temps.
Le texte que je vous présente aujourd’hui le démontre une fois encore. Fait suffisamment rare pour être souligné, il est cosigné par plusieurs sénatrices et sénateurs, de tous les groupes : des LR au CRCE, en passant par le RDSE et les groupes centriste, écologiste et socialiste. Toutes les sensibilités de notre chambre sont représentées.
Nous aurions pu penser que cet arc républicain suffirait à assurer le succès de cette proposition de loi. Toutefois, nous le savons, ce n’est jamais aussi simple au Sénat !
J’entends les réticences de Mme la rapporteure concernant la multiplication des délégations ou des groupes d’études, étant d’ailleurs moi-même pour la rationalisation. Je les entends d’ailleurs d’autant plus que ce sont les mêmes depuis vingt ans.
Ce sont les mêmes arguments qui ont justifié en 2003, en 2009, en 2019 et en 2022 le refus de créer de nouvelles délégations et de nouveaux groupes d’études.
Pourtant, mes chers collègues, je me suis penché sur les délégations dont nous disposons à l’heure actuelle. Si nous mettons de côté l’Opecst, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, créé en 1983 par la loi, ou la délégation aux droits des femmes, créée en 1999, également par la loi, nous avons, depuis 2007, créé cinq délégations : en 2007, la délégation au renseignement ; en 2009, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation ; encore en 2009, la délégation à la prospective ; en 2011, la délégation aux outre-mer ; en 2014, la dernière mais pas la moindre, la délégation aux entreprises, créée par le bureau du Sénat.
En vingt ans, il n’a jamais été le moment de créer une délégation aux droits de l’enfant. Pourtant, notre chambre a continué à créer légitimement un certain nombre de délégations utiles au travail parlementaire.
Mais la question de l’enfance n’est pas une question annexe. L’enfance, par sa diversité, par l’éventail des thématiques qu’elle regroupe, est en elle-même un sujet majeur. Oui, mes chers collègues, les droits de l’enfant ne sont pas un sujet mineur.
Sommes-nous capables de considérer les droits des enfants comme une priorité de nos politiques publiques et, donc, par définition, comme un sujet transversal dans notre institution ?
Madame la rapporteure nous indiquera sans nul doute tous les travaux que notre chambre a menés sur le sujet de l’enfance. Elle aura raison, nous avons beaucoup travaillé sur l’enfance.
Toutefois, selon moi, nos travaux sur l’enfance doivent non plus fonctionner en silo, mais de façon transversale auprès des commissions permanentes.
Il ne s’agit pas, comme certains le dénoncent, d’une proposition exclusivement symbolique. Certes, il existe une dimension symbolique, puisque la création d’une délégation aux droits de l’enfant enverrait un signal fort au monde de l’enfance, qui demande cette création depuis plus de vingt ans. À l’inverse, le refus de créer cette délégation enverrait à l’opinion publique un message catastrophique sur la chambre haute.
Au-delà de cette portée symbolique, il y a un enjeu beaucoup plus fort. Les délégations ont le temps de travailler sur le fond, d’alimenter, par des auditions, par des rapports, les travaux des parlementaires et des commissions, en vue de mieux légiférer sur la base de rapports d’expertise.
Par ailleurs, outre les dimensions symbolique et utile d’une telle délégation, il faut rappeler que, pour ce qui concerne l’enfance, les départements sont chefs de file, dans le cadre d’une politique décentralisée.
Il est souhaitable que le Sénat, chambre des territoires et représentant des collectivités, s’intéresse à ce sujet et s’empare fortement de cette politique.
Je souhaiterais d’ailleurs prendre l’exemple de la délégation aux droits des femmes, qui effectue un travail remarquable, à l’image de son dernier rapport sur la pornographie.

Cette délégation fonctionne bien, grâce à l’apport de réflexions et de travaux. Finalement, elle alimente la réflexion du Parlement et de l’exécutif pour mieux légiférer.
Voilà trente-trois ans, mes chers collègues, la France ratifiait la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui nous obligeait à placer l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de nos politiques publiques.
Car les enfants ne sont pas seulement de petits êtres qu’il nous faut protéger. Ce sont des sujets de droit à part entière. Certes, depuis 1990, de nombreuses réformes législatives ont été adoptées en vue de mettre notre droit en conformité avec cette convention. Parmi ces réformes figurent, notamment, la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale, la loi de Philippe Bas du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, la loi du 14 mars 2016 de Laurence Rossignol, qui s’appuyait sur les travaux de Michelle Meunier, ou encore la loi du 10 juillet 2019 relative à l’interdiction des violences éducatives ordinaires et, pour finir, la loi portée par le gouvernement actuel en février 2022.
Beaucoup a été fait, mais le constat actuel reste alarmant. Un enfant sur cinq vit sous le seuil de pauvreté ; 25 % des SDF de moins de 25 ans ont connu un parcours à l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; 70 % des jeunes de l’ASE n’obtiennent aucun diplôme.
Les enfants sont les victimes directes ou indirectes des violences intrafamiliales ou encore de l’inceste, ce qui témoigne du lien entre violence et santé. Par ailleurs, 500 enfants de moins de 6 mois sont victimes chaque année du syndrome du bébé secoué, par manque de prévention auprès des parents ou des tiers gardiens ; 75 % des survivants ont des séquelles physiques ou mentales irréversibles.
En outre, 50 000 enfants sont victimes, chaque année, de violences physiques et psychologiques, et près de 100 000 enfants ne sont pas scolarisés. En France, 15 % des jeunes connaissent un épisode dépressif caractérisé entre 16 et 25 ans. Ces envies suicidaires, qui malheureusement se concrétisent parfois, ont augmenté de 20 % depuis la crise sanitaire. Le suicide est d’ailleurs la deuxième cause de mortalité pour les 10-25 ans
S’agissant des violences numériques, les enfants sont souvent la proie d’agresseurs ultraprésents sur les réseaux sociaux, ce qui pose la question sous-jacente du harcèlement.
Je pense également aux problèmes de malnutrition ou d’obésité. Et 400 000 enfants porteurs de handicap sont scolarisés, avec le défi de l’inclusion ; ce dernier n’est jamais un long fleuve tranquille mais il peut, malgré tout, permettre de vraies réussites
Je pense aussi aux inégalités sur le plan de la scolarité, du sport et de la culture, en particulier pour ceux qui sont en situation de handicap.
Nous pouvons également évoquer les enlèvements parentaux à l’étranger. Je le sais, nous sommes nombreux dans cet hémicycle à être sollicités et interpellés par les parents victimes restés en France.
Il y a aussi le sujet des mineurs non accompagnés et l’impact sur les départements de leur augmentation ces dernières années.
Permettez-moi également de rappeler un chiffre glaçant, mentionné en commission des affaires sociales, alors même – preuve de la transversalité de la question de l’enfance – que le sujet concernerait davantage la commission des lois : tous les cinq jours, un enfant est tué par l’un de ses parents, selon le dernier rapport de l’Unicef.
Mes chers collègues, il existe bien d’autres sujets relatifs à l’enfance, car la question des droits de l’enfant est intrinsèque. Pourtant, ces sujets sont traités indépendamment dans les différentes commissions qui composent le Sénat.
Donnons un cadre institutionnel aux parlementaires engagés sur cette cause. Comme je vous le disais, il s’agit d’un moment important, car attendu.
Il est attendu depuis vingt ans par les associations, par les parlementaires, par les professionnels, par les enfants eux-mêmes et par l’opinion publique.
La place de l’enfant doit être au cœur de notre société, parce que le Sénat ne peut pas se détourner d’un travail de fond qui touche directement nos territoires. Je sais que nous avons tous envie de rentrer, ce soir, dans nos circonscriptions respectives avec la satisfaction d’avoir été utiles pour notre pays.
Mes chers collègues, je connais tous vos engagements en faveur des droits de l’enfant, que ce soit ici, à Paris, dans vos territoires, en Europe ou à l’international, au sein de la Haute Assemblée ou à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe.
C’est pourquoi, aujourd’hui, faisons ensemble le choix de nous tenir du côté de l’amélioration de la condition des enfants. Parce que les droits de l’enfant ne sont pas de droits mineurs, je vous invite, mes chers collègues, à soutenir la création de ces délégations aux droits des enfants.
Applaudissements sur toutes les travées, à l ’ exception de celles du groupe Les Républicains

Juin 2022 : rapport d’information sur la lutte contre l’obésité.
Octobre 2021 : audition de M. Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église ; proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu ; projet de loi relatif à la protection des enfants.
Septembre 2021 : audition de M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé chargé de l’enfance et des familles.
Mai 2021 : proposition de loi tendant à protéger les mineurs des usages dangereux du protoxyde d’azote.
Décembre 2020 : audition de M. Adrien Taquet.
5 février 2020 : stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance et audition de M. Adrien Taquet.
Février 2022 : rapport d’information établissant le bilan des mesures éducatives du quinquennat ; proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire.
Juin 2020 : proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.
Juillet 2022 : audition de Mme Claire Hédon.
Février 2022 : proposition de loi relative au choix du nom issu de la filiation.
Janvier 2022 : proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire
Octobre 2021 : proposition de loi visant à réformer l’adoption.
Mars 2021 : audition de Mme Claire Hédon.
Janvier 2021 : projet de loi ratifiant l’ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de justice pénale des mineurs ; proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste.
Juin 2020 : audition de M. Jacques Toubon, Défenseur des droits ; proposition de loi visant à protéger les victimes des violences conjugales.
Avril 2020 : audition de M. Jacques Toubon.
Janvier et février 2020 : cycle d’auditions sur le nouveau code de justice pénale des mineurs.
Janvier 2022 : proposition de loi visant à encourager l’usage du contrôle parental sur certains équipements et services vendus en France et permettant d’accéder à internet.
Voilà pour les travaux des commissions des affaires sociales, des lois et des affaires économiques.
J’en viens maintenant aux travaux de la délégation aux droits des femmes.
Septembre 2022 : rapport d’information sur l’industrie de la pornographie.
Juin 2022 : table ronde sur la régulation de l’accès aux contenus pornographiques en ligne.
Avril 2022 : table ronde sur la protection des mineurs face aux contenus pornographiques.
Décembre 2021 : audition de M. Adrien Taquet.
Novembre 2021 : table ronde sur la situation des femmes et des filles en Afghanistan ; audition de Mme Catherine Champrenault et de M. Gilles Charbonnier, magistrats.
Avril et novembre 2020 : audition de M. Adrien Taquet
Juillet 2020 : rapport d’information sur le bilan de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants au sein de la famille.
Je terminerai par les travaux communs des commissions permanentes
Septembre 2022 : rapport d’information Prévenir la délinquance des mineurs - Éviter la récidive.
Septembre 2021 : rapport d’information Mineurs non accompagnés, jeunes en errance
Février 2020 : rapport d’information Sur l ’ obligation de signalement par les professionnels astreints à un secret des violences commises sur les mineurs.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà une liste sans doute fastidieuse, mais non exhaustive, des travaux que les sénateurs ont menés depuis trois ans sur la situation des enfants.
Pourquoi avoir retenu cette durée de trois ans ? Parce que, voilà trois ans, notre collègue Éliane Assassi déposait une proposition de loi rédigée dans des termes similaires à celle que nous examinons aujourd’hui et visant à créer une délégation aux droits des enfants.
Ce texte, dont j’étais déjà le rapporteur, avait été rejeté par le Sénat, sur proposition de la commission des lois.
Pourquoi cette énumération ? Parce que – chacun l’aura compris aux propos de notre collègue Xavier Iacovelli, qui présente aujourd’hui une proposition de loi similaire – l’avis de la commission des lois a été de nouveau défavorable.
Et je ne voudrais pas que cet avis défavorable soit interprété comme un signal défavorable quant à l’intérêt du Sénat pour cette question des droits de l’enfant.

Je crois avoir démontré, par cette énumération, que les sénateurs travaillent fréquemment sur ce sujet de la situation des enfants. Malgré l’absence de délégation, nous y travaillons souvent de façon transversale, et nous allons continuer de le faire : bientôt, pour ne citer que cet exemple, une étude va être menée par les délégations aux droits des femmes et aux outre-mer sur la parentalité outre-mer.
Je n’adhère certes pas au propos de Clemenceau en vertu duquel pour enterrer un problème il faut créer une commission. Reste que la création d’une telle délégation ne résoudra aucun problème, nous le savons – vous ne dites d’ailleurs pas le contraire, mes chers collègues –, ne serait-ce que parce que, contrairement aux commissions législatives, les délégations n’ont pas de pouvoir législatif.

Si cette proposition de loi n’a pas pour objet de faire travailler les sénateurs sur la situation des enfants, puisque nous le faisons déjà ; si elle n’a pas pour objet de nous faire travailler de façon transversale, puisque nous le faisons déjà ; et si elle n’a pas pour objet de résoudre une quelconque difficulté, puisque la délégation ainsi créée ne posséderait pas de pouvoir législatif, alors à quoi sert-elle ?

Elle sert tout simplement à proposer une organisation différente du travail du Sénat.
Nous l’avions déjà établi voilà trois ans, lorsque nous avions examiné la proposition de loi d’Éliane Assassi, et personne ne s’y était trompé. La représentante du Gouvernement avait d’ailleurs, à l’époque, émis un avis très clair : « La décision de créer une délégation parlementaire étant un sujet éminemment parlementaire, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. » Et je vois mal quelle autre position pourrait adopter le Gouvernement sur une telle affaire…

Il s’agit donc d’un sujet relatif à l’organisation de nos travaux. Or, en la matière, nous pouvons nous appuyer sur des précédents et, en particulier, sur un rapport de 2015, établi par Roger Karoutchi et Alain Richard, sur les méthodes de travail du Sénat. Parmi les propositions formulées dans ce rapport, on trouve, précisément, l’arrêt de la polysynodie, c’est-à-dire de la multiplication des instances parlementaires, qui apporte plus de dispersion que d’efficacité.

Ce rapport avait été déposé devant le bureau du Sénat, car, en réalité, l’organe chargé de l’organisation des travaux parlementaires, c’est le bureau. D’ailleurs, l’Assemblée nationale, qui vient de créer une délégation aux droits des enfants, l’a fait non pas dans l’hémicycle, mais par une décision de la conférence des présidents, qui est l’organe d’organisation des travaux de l’Assemblée nationale.

Cette jurisprudence, qui est constante depuis 2015, n’a pas été remise en cause par le bureau ; j’invite donc ceux de nos collègues qui jugeraient nécessaire la création d’une telle délégation à en référer au bureau…

… afin, le cas échéant, de renverser cette position qui, je l’ai dit, fut adoptée unanimement en 2015 et n’a pas été modifiée depuis lors.
Demander au bureau d’examiner cette proposition de création d’une délégation, laquelle serait un nouvel organe de travail parlementaire, permettrait, me semble-t-il, de remettre à sa place ce débat, …

En quoi serait-il plus démocratique de passer par le bureau ? Je ne comprends pas…

Mme Muriel Jourda, rapporteur. … car, ne nous y trompons pas, nous parlons bien là d’organisation du travail et non de la situation des enfants ni de l’intérêt que porte le Sénat à ladite situation. Pour ce qui est de l’intérêt du Sénat, en effet – l’énumération à laquelle j’ai procédé le démontre –, il a toujours été indéfectible.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Mme Charlotte Caubel, secrétaire d ’ État auprès de la Première ministre, chargée de l ’ enfance. Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, avant toute chose, je tiens à remercier le sénateur Xavier Iacovelli pour son engagement sans faille sur les sujets de l’enfance.
M. Michel Dagbert applaudit.
Beaucoup a été fait au cours du précédent quinquennat, avec en point d’orgue la loi du 7 février 2022. Je tiens ici à saluer le travail du Sénat sur ce texte, ainsi que tous les travaux que vous avez rappelés, madame la rapporteure.
Beaucoup a été fait, disais-je, mais il reste beaucoup à faire, et les chiffres que vous avez cités, monsieur le sénateur, nous rappellent une triste réalité. Je n’en retiens qu’un : un enfant meurt tous les cinq jours dans le cadre familial, sous les coups de ses parents ou de proches. Ce chiffre doit évidemment nous interpeller. Ce chiffre, et tous les autres, est terrible.
Malgré les moyens humains et financiers mobilisés en faveur de la politique de l’enfance, malgré les très nombreux acteurs engagés sur le terrain – départements, associations, professionnels de tous horizons –, les droits fondamentaux de nos enfants sont encore fragiles : leur droit à la sécurité, leur droit à la santé, leur droit au bien-être, au logement ou encore à l’éducation ne sont toujours pas garantis dans notre pays.
Face à ce constat, nous devons inlassablement débattre, échanger, réfléchir, agir, quelles que soient nos appartenances partisanes, quels que soient nos champs de compétences.
À chaque politique publique menée, à chaque texte voté, nous, femmes et hommes politiques adultes, devons faire l’effort d’intégrer cette dimension : les droits de l’enfant, de nos enfants, sont-ils pris en compte ?
L’année prochaine, l’Organisation des Nations unies évaluera la France au regard des exigences de la Convention internationale des droits de l’enfant. Nous devrons être à la hauteur : le pays des droits de l’homme et des droits de la femme doit démontrer qu’il est aussi celui des droits de l’enfant !
La mobilisation de tous est donc une nécessité et, dirai-je même, une urgence.
Vous le savez, l’engagement du Gouvernement est très fort ; le Président de la République a souhaité faire de l’enfance et de sa protection des sujets prioritaires de ce quinquennat.
Cette priorité a été récemment au cœur du premier comité interministériel à l’enfance, au lendemain de la Journée internationale des droits de l’enfant.
Avec la Première ministre et les nombreux ministres concernés, nous avons déterminé cinq chantiers prioritaires et une quarantaine de mesures dont il m’appartiendra de coordonner la mise en œuvre. Je tiens ici à vous en présenter quelques-unes.
La première des priorités, c’est bien sûr la lutte contre les violences faites aux enfants. Dès l’année prochaine, le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, créera un office de police judiciaire spécialisé. Cette création sera assortie de la publication par le garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, d’une circulaire de politique pénale.
Le deuxième chantier prioritaire est celui de la santé, y compris la santé mentale, de nos enfants. Il s’agit, sur le terrain – vous le savez –, d’un sujet de grande préoccupation, qui apparaît dans chacun de mes échanges, avec les présidents des départements notamment. Le ministre de la santé, François Braun, a lancé, hier, les très attendues Assises de la pédiatrie et de la santé de l’enfant, qui permettront, au printemps, de définir des orientations.
Troisième priorité : le numérique. Partout où sont nos enfants, nous devons les protéger, notamment, donc, sur internet. La loi Studer visant à renforcer le contrôle parental sur les moyens d’accès à internet entrera en vigueur dans les prochaines semaines. À cette occasion, nous lancerons, avec Jean-Noël Barrot, une campagne de communication pour accompagner les parents dans cette si complexe parentalité numérique.
Au-delà de l’engagement de tous les ministres – je sais que vous y serez sensibles, mesdames, messieurs les sénateurs –, il nous faut renforcer notre action aux côtés des départements pour que soit facilité l’accès à tous les dispositifs de droit commun pour les enfants les plus fragiles, notamment les enfants en situation de handicap et ceux de la protection de l’enfance.
L’État doit en effet être plus fort aux côtés des départements et des acteurs de terrain : il doit les accompagner financièrement par le biais des contractualisations, mais aussi renforcer, via les préfets, la coordination de l’ensemble des administrations et des services de l’État sur les sujets de l’enfance.
La loi du 7 février 2022 a donné aux départements la possibilité d’expérimenter l’institution d’un comité départemental pour la protection de l’enfance, qui, sous l’égide du préfet et du président du conseil départemental, peut réunir l’ensemble des acteurs engagés, la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), l’éducation nationale, la santé, les directions territoriales de la protection judiciaire de la jeunesse, en présence de l’autorité judiciaire.
Je crois beaucoup à la mise en place de ces comités départementaux, qui correspondent à un réel besoin de terrain, pour améliorer la stratégie de l’offre, les contrôles et, évidemment – tel est l’enjeu –, la qualité des parcours des enfants, notamment ceux dont la situation est la plus complexe.
Ce constat est largement confirmé par mes échanges avec les élus et les acteurs locaux. Je tiens donc à lancer cette expérimentation dès le mois de janvier prochain.
Je souhaite par ailleurs souligner combien les parlementaires sont, eux aussi, très engagés sur les sujets de l’enfance ; ce débat en est une manifestation évidente, je l’ai dit. Depuis ma prise de fonction, voilà six mois, j’ai pu le constater à maintes reprises, lors des débats parlementaires, au Sénat comme à l’Assemblée nationale – ainsi, récemment, lors de l’examen du projet de loi de finances –, mais également à l’occasion des nombreux rendez-vous que j’ai avec vous et de mes déplacements sur le terrain.
L’Assemblée nationale a fait le choix de créer, en septembre, une délégation parlementaire aux droits des enfants.
Comme vous le savez, j’ai salué la création de cette délégation : si aucun ministre n’a le monopole de l’enfance, et pas plus moi qu’un autre, il en est de même des commissions parlementaires. Le sujet de l’enfance peut et même doit en effet être abordé dans plusieurs commissions : la commission des affaires sociales, naturellement, mais aussi la commission des lois, ou encore la commission des affaires culturelles et de l’éducation. Les droits de l’enfant sont partout ; mener la transition énergétique, n’est-ce pas, avant tout, préparer l’avenir de nos enfants ?
Ce sujet, faire des droits de l’enfant l’affaire de tous, mettre toutes les politiques à hauteur d’enfant, me tient pleinement à cœur ; je veille, tant au sein du Gouvernement que sur le terrain, à favoriser les échanges entre les acteurs dans un souci permanent de partage de l’information et d’efficacité. Au sein du Sénat, la délégation aux droits des femmes, dont je salue la présidente et les membres, joue par exemple un rôle précieux en ce sens. Son rapport récent sur la pornographie l’a fortement démontré, et je m’appuie régulièrement sur ses travaux.
Toutefois, je l’ai d’ailleurs dit aussi à l’Assemblée nationale, et je le répète au Sénat, la création d’une délégation relève de l’organisation interne du Parlement. Je ne peux donc que m’en remettre, quant à cette initiative, à la sagesse de la Haute Assemblée.
Je veux profiter de l’occasion qui m’est ici donnée pour exprimer à nouveau ma volonté de travailler avec vous toutes et vous tous, et ce quelle que soit la décision que vous prendrez à l’issue de l’examen de ce texte. Je sais que, quel que soit votre vote, chacune de vos commissions sera d’autant plus attentive à intégrer à ses travaux la question des droits des enfants que ce débat aura eu lieu.
En cette matière, je le sais, nous sommes toutes et tous pleinement engagés ; s’il est un sujet qui doit nous rassembler, c’est bien celui de l’avenir de nos enfants !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et CRCE. – Mmes Colette Mélot et Laurence Rossignol applaudissent également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la question à laquelle nous devons répondre aujourd’hui est assez simple : un grand nombre de sénateurs et de sénatrices de tous les groupes, ou presque, souhaiteraient, comme les députés, travailler sur la question des droits de l’enfant au sein d’une délégation dédiée.
Qui juge utile la création d’une telle instance votera pour cette proposition de loi ; qui pense que cela ne sert à rien votera contre.
Mme Corinne Imbert et M. Bernard Bonne s ’ exclament.

Je vais tenter de vous expliquer pourquoi l’existence d’une telle délégation serait utile et pourquoi les écologistes voteront – évidemment – ce texte.
La demande de création d’une délégation sénatoriale aux droits de l’enfant est une demande de longue date des associations qui, dans ce pays, travaillent sur la question de l’enfance, et fait l’objet d’un soutien transpartisan au Sénat.
Pourquoi ?
Parce que la situation des droits de l’enfant, en France, n’est pas glorieuse…
Inceste, pédocriminalité, violences, santé physique et mentale, pauvreté, alimentation, sport, handicap et inclusion, éducation, questions pénales : il y a tant de sujets qui doivent être examinés du point de vue spécifique des enfants !
Je voudrais prendre un exemple, celui de l’inceste. Les victimes sont au nombre de 160 000 chaque année, soit en moyenne deux enfants par classe. L’inceste est un phénomène massif auquel, à ce jour, aucune politique publique n’a su répondre. Il faut regarder les choses en face : on ne sait pas gérer, on ne sait pas faire. Le nombre d’incestes, en France, ne diminue pas.
Et si l’on ne sait pas faire, c’est en partie parce qu’on ne part jamais du point de vue des enfants victimes.
On dit, par exemple, qu’il faut que les enfants parlent, mais on ne prend pas en compte le contexte qui fait que les enfants ne parlent pas, le système qu’est l’inceste, ses logiques propres et les logiques qui président à son omerta sociale, ni les conséquences qu’emporte le fait de parler, pour les enfants ou pour les adultes.
Et on insiste sur la réponse pénale.
Le problème, et c’est terrible, c’est que la perspective de la prison n’empêche pas les incestes et que la prison n’empêche pas les récidives – on aimerait tellement que ce soit si simple…
Aussi, faute de partir du point de vue des enfants concernés, on construit des politiques publiques qui gèrent l’existant : des victimes brisées, d’un côté, et des violeurs, de l’autre ; on fait parler les uns et on emprisonne – parfois – les autres. Mais on ne fait pas baisser le nombre d’incestes en France.
Ma conviction est que l’on ne pourra jamais construire une politique publique satisfaisante si l’on ne part pas du point de vue des enfants chaque fois qu’ils sont concernés.
Et c’est précisément ce qu’une délégation permet.
La création d’une délégation parlementaire spécifiquement chargée d’un sujet permet de se concentrer sur un point de vue qui, à défaut, parce qu’il est noyé parmi d’autres, n’est au fond jamais pris en compte.
Une telle instance permet de creuser des sujets spécifiques, via un travail d’information, d’enquête et de recherche, au-delà du travail législatif ; l’activité des délégations déjà existantes en témoigne.
Toutes les raisons semblent donc réunies pour nous prononcer favorablement sur cette proposition de loi. Pourtant, la commission des lois s’y oppose, au motif que le sujet dont il est question est déjà traité ailleurs, notamment par la délégation aux droits des femmes.
Mais, précisément, c’est un problème ! Beaucoup d’enfants ne sont pas de futures femmes et il n’y a pas que les femmes qui ont des enfants… On s’accordera donc à dire qu’il n’y a pas nécessairement un grand lien entre ces deux sujets.
Par ailleurs, nous dit-on, un travail de commission continuera bien sûr d’être effectué sur les sujets de l’enfance par les commissions des affaires sociales, des lois, de la culture, de l’éducation et de la communication. Mais tant que ce travail reste éparpillé ici et là, nous manquons d’un espace politique de travail dont la perspective première soit l’intérêt de l’enfant et dont l’objet soit de réfléchir depuis ce point de vue aux différentes politiques publiques.
Un autre argument nous est opposé : il ne faut pas multiplier les délégations. Admettons… Mais le Sénat n’a-t-il pas créé en 2014 une délégation aux entreprises ? C’est très bien : je n’ai rien contre cette délégation, je suis sûre que le travail qu’elle abat est d’une grande importance. Doit-on comprendre, néanmoins, que ce qui est vrai pour les entreprises – il faut les étudier de manière transversale, en dehors des commissions permanentes, sous peine qu’elles soient l’angle mort des politiques publiques – ne le serait pas pour les enfants ? Cela n’est pas très sérieux…
Applaudissements sur les travées du groupe GEST. – MM. François Patriat et Michel Dagbert applaudissent également.

Alors que nos collègues de l’Assemblée nationale se sont dotés d’une délégation aux droits des enfants, l’adoption de cette proposition de loi participerait à montrer que la volonté du Sénat n’est pas de perpétuellement s’opposer à toutes les avancées sociales.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Xavier Iacovelli prévoit d’inscrire dans la loi la création de délégations parlementaires aux droits de l’enfant à l’Assemblée nationale et au Sénat.
Ses signataires font le constat, largement partagé sur nos travées comme dans la société civile, que de nombreux défis restent à relever pour assurer le respect des droits de l’enfant dans notre pays.
Ce n’est pas la première fois que des initiatives législatives sont prises en ce sens. En 2003, l’Assemblée nationale se saisissait déjà de cette question en adoptant, sans toutefois qu’elle prospère, une proposition de loi de Jacques Barrot et de Dominique Paillé.
Plus récemment, en 2019, une proposition de loi du groupe CRCE était rejetée par le Sénat qui, suivant l’avis de la commission des lois, avait estimé que notre chambre se saisissait déjà pleinement de ces sujets et était en mesure de veiller efficacement au respect des droits de l’enfant.
Si, depuis lors, la position de la commission n’a pas changé, comme l’atteste l’avis défavorable émis par la rapporteure, le contexte politique, lui, n’est plus tout à fait le même.
Je ne reviendrai pas sur les mesures qui ont été prises par l’actuelle majorité, et encore tout récemment par la Première ministre – vous venez de les évoquer, madame la secrétaire d’État.
Je rappellerai seulement, faisant mien l’un des constats d’Unicef France, que la persistance d’inégalités tant sociales que territoriales, dont pâtissent en particulier les quartiers prioritaires de la ville et les territoires d’outre-mer, empêche un trop grand nombre d’enfants d’avoir accès à l’école et aux services de santé ou de protection.
Vous savez, mes chers collègues, mon attachement à ce sujet.
Les arguments qui plaident en faveur de la création de délégations parlementaires aux droits de l’enfant sont nombreux.
Créer une délégation, c’est créer un cadre pour des travaux approfondis et transversaux sur des questions jusqu’alors inexplorées ou abordées de façon parcellaire. Je pense notamment, en l’espèce, à la santé mentale des enfants ou à la pauvreté infantile, sujets sur lesquels il nous faut avancer.
C’est aussi offrir une visibilité supplémentaire aux travaux du Sénat. L’écho médiatique dont ont récemment bénéficié les rapports de la délégation aux droits des femmes est là pour le prouver.
La création d’une délégation aux droits de l’enfant au Sénat faciliterait par ailleurs les échanges avec l’Assemblée nationale et avec le Parlement européen, et permettrait un meilleur suivi de l’application des lois.
Un tel organe alimenterait enfin la réflexion du Gouvernement – dans le respect, bien sûr, de la séparation des pouvoirs –, en vue, notamment, de la transmission du rapport périodique de la France au Comité des droits de l’enfant des Nations unies.
Ce sont ces arguments, et ceux qui ont été avancés par notre collègue Xavier Iacovelli, qui ont présidé à la création, en septembre dernier, d’une délégation aux droits des enfants à l’Assemblée nationale.
Les auteurs de ce texte proposent au Sénat d’imiter l’Assemblée via l’inscription dans la loi de cette initiative parlementaire. Naturellement, le groupe RDPI votera pour.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mmes Cathy Apourceau-Poly, Laurence Cohen, Michelle Meunier, Maryse Carrère et Véronique Guillotin applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Esther Benbassa et M. Xavier Iacovelli applaudissent également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je vais vous lire quelques phrases ; je ne vous dirai qu’ensuite de quoi elles sont issues : « L’article 43 de la Constitution établit au demeurant la compétence des commissions pour l’examen des projets et propositions de loi. Cependant, la fragmentation des compétences illustre le caractère transversal de la question de l’égalité des droits. Elle peut entraîner un défaut préjudiciable de vision globale et constituer un obstacle […]. L’examen de textes successifs par différentes commissions peut ne pas pleinement permettre d’intégrer l’objectif d’égalité entre les sexes. »
Madame Jourda, l’extrait dont je viens de donner lecture est issu du rapport fait en 1999 par la commission des lois du Sénat sur un texte qui n’était certes pas une décision du bureau, mais bien une proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des femmes, laquelle fut adoptée par notre assemblée. Il semble que parfois la commission des lois varie…
Vous avez, madame la rapporteure, égrené les différents travaux législatifs du Sénat qui ont concerné les enfants. En réalité, je n’ai pas compris ce que vous vouliez démontrer : que le Sénat examine les textes relatifs aux enfants déposés sur son bureau ? Mais c’est bien le moins ! Que parfois le Sénat va même jusqu’à proposer des évolutions législatives ? Derechef, c’est bien le moins : c’est notre travail !
Vous avez abondamment cité les rapports de la délégation aux droits des femmes. Je n’en espérais pas tant ! Justement, la délégation aux droits des femmes, à laquelle je participe depuis que je suis sénatrice, aimerait bien ne plus être chargée aussi de la question des enfants ! Voyez-vous, l’égalité entre les femmes et les hommes signifie aussi émanciper les femmes de la charge mentale qui consiste pour elles à s’occuper seules des enfants ; et cela vaut aussi pour les délégations parlementaires.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE, GEST et RDPI. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Nous ne voulons plus de ça !
Voilà exactement quatre-vingt-dix-huit ans, la Société des Nations adoptait la Déclaration de Genève sur les droits de l’enfant. J’imagine que, si leurs auteurs assistaient à nos travaux aujourd’hui, ils seraient stupéfaits d’observer que l’idée d’une délégation aux droits de l’enfant, au Sénat, en 2022, rencontre toujours autant d’opposition et d’incompréhension – j’ai presque envie de parler d’ignorance.
Mmes Victoire Jasmin, Michelle Meunier, Émilienne Poumirol et Esther Benbassa applaudissent.

Votre propos, madame la rapporteure, n’est pas un simple propos de forme. Je ne suis pas une petite poulette de l’année
Sourires.

: voilà longtemps que j’ai compris que les débats de forme cachent des oppositions de fond !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDPI. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

La question n’est pas celle de l’organisation de nos travaux ; elle est de savoir si vous êtes ou non d’accord pour que le sujet des droits de l’enfant soit traité de manière permanente par notre assemblée.
Mon sentiment est que vous ne savez pas ce que c’est que les droits de l’enfant, en réalité : les droits de l’enfant, ce sont avant tout les besoins de l’enfant, dans leurs multiples dimensions, et les politiques publiques qui vont garantir son bon développement, tant sur le plan social que sur le plan individuel, tout en lui permettant de vivre pleinement ce temps privilégié qu’est le temps de l’enfance.
Créer une délégation aux droits de l’enfant, c’est affirmer la cohérence d’une stratégie globale pour l’enfance, une stratégie décloisonnée, dont l’objectif est la mise en œuvre de politiques publiques favorables au développement de l’enfant dans ses cinq dimensions – développement physique, développement affectif, développement intellectuel, développement moteur, développement social – et dans le respect de ses droits. Les droits de l’enfant découlent de ses besoins fondamentaux.
Créer une délégation aux droits de l’enfant, ici, au Sénat, c’est nous doter d’une capacité d’expertise et ainsi nous donner les moyens d’agir au plus près des réalités que vivent les enfants et leurs familles. Et c’est anticiper, pour nous y adapter, les transformations familiales.
Je sais que les transformations familiales ont un peu tendance à électriser cette assemblée et à créer des réactions pour le moins tendues. Pour autant, elles existent, et ce n’est pas ici que l’on décide des transformations familiales : ici, on ne fait que les accompagner et garantir qu’elles respectent le principe d’égalité entre les membres de la famille ainsi que les droits de l’enfant. C’est cela, notre travail : ce n’est pas de nous opposer aux transformations familiales, sociétales, économiques, qui sont à l’œuvre.
Créer une délégation aux droits de l’enfant, c’est aussi décloisonner les politiques publiques. À l’heure actuelle, les politiques de l’enfance sont sectionnées : éducation, politique familiale, sport, santé. Or, justement, compte tenu du caractère multidimensionnel de son développement, les besoins et les droits de l’enfant nécessitent une approche panoramique. Un enfant, c’est la combinaison de différentes sphères de vie.
Je sais que, là encore, je vais choquer : on aimerait tellement que l’enfant ne soit que l’objet de sa famille, que seuls la famille et les parents puissent avoir la main sur le développement d’un enfant. Mais tel n’est pas le cas ! Un enfant est la combinaison de multiples dimensions : relations aux parents, vie à la maison, dans la ville, dans la nature, loisirs, sport, culture, citoyenneté, protection contre les violences sexistes et sexuelles, contre les écrans, contre la pauvreté. C’est tout cela, la politique des droits de l’enfant !
Et c’est tout cela dont nous voulons traiter, nous, sénatrices et sénateurs modernes, accompagnant un mouvement lancé voilà cent ans à la Société des Nations. Nous voulons pouvoir apporter notre capacité d’expertise : nous sommes, nous, parlementaires, le chaînon manquant entre les associations et les politiques publiques.
C’est la première fois que je vous entends, mes chers collègues, dire qu’en fin de compte le Parlement doit se dessaisir d’un sujet ou d’une compétence en le laissant soit à la société civile soit au Gouvernement. Non : nous voulons une délégation aux droits de l’enfant !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE, GEST et RDPI. – Mmes Esther Benbassa et Colette Mélot applaudissent également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « [l]’enfant a le droit au respect de sa dignité et de son amour-propre […], [a]u respect pour chaque minute qui passe », comme l’écrivait le célèbre pédiatre polonais Janusz Korczak, inspirateur et précurseur de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le groupe CRCE, par son engagement constant en faveur des droits de l’enfant, s’inscrit dans une telle conception. Rappelons qu’en France c’est par la loi du 9 avril 1996 que le Parlement français décide de faire du 20 novembre la Journée nationale des droits de l’enfant, initiative issue d’une proposition de loi des sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen adoptée à l’unanimité le 14 octobre 1995.
Aussi soutenons-nous la proposition de loi de notre collègue Xavier Iacovelli visant à créer une délégation parlementaire aux droits de l’enfant
M. Michel Dagbert applaudit.

Pourquoi examiner à nouveau une telle proposition de loi ? Tout simplement parce que, trente-trois ans après l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant, ceux-ci ne sont pas toujours respectés en France. Dans notre pays, un enfant sur cinq – soit près de 3 millions d’enfants – vit sous le seuil de pauvreté. En vingt ans, la proportion des enfants de moins de 18 ans vivant sous le seuil de pauvreté est passée de 16 % à 20 %. Des dizaines de milliers d’entre eux vivent et dorment dans la rue.
Nous ne pouvons ignorer non plus les inégalités en matière de santé, de logement, d’accès à l’éducation ou aux loisirs, qui demeurent considérables. Je ne peux ici qu’exprimer mon inquiétude et celle de mon groupe concernant des enfants étrangers, nés en France ou arrivés, seuls ou avec leurs parents, en provenance de l’étranger, qui vivent des situations particulièrement difficiles, contraints à une vie précaire, placés en centre de rétention, expulsés avec leurs parents.
Je tiens d’ailleurs à dénoncer le manque d’action de l’État face à la situation de ces mineurs qui, vivant dans un campement à Ivry-sur-Seine, sont installés depuis quelques jours devant le Conseil d’État. Le fait qu’ils soient étrangers ne peut en aucune façon expliquer ou, pis, justifier cette situation intolérable et profondément inhumaine. Nous ne sommes pas dans la France de Zola ; nous sommes au XXIe siècle, mes chers collègues : réveillons-nous, c’est inhumain !
En matière de justice, on assiste à un durcissement pénal depuis l’entrée en vigueur, le 30 septembre 2021, du nouveau code de la justice pénale des mineurs, qui remet profondément en cause l’ordonnance de 1945 et la primauté des mesures éducatives – un enfant est un enfant.
Pour toutes ces raisons, nous devons agir. Le Parlement doit être à l’initiative d’une veille et d’un contrôle plus assidus en ce qui concerne le respect des droits des enfants.
À l’heure des scandales qui éclatent sur les violences intrafamiliales, les agressions sexuelles, les incestes, nous devons ici, au Sénat, montrer une détermination sans faille afin de créer les conditions d’un travail rigoureux sur les droits des enfants. C’est ce qu’ont fait, fort à propos, nos collègues de l’Assemblée nationale le 13 septembre 2022.
Examiner des propositions de loi ou des projets de loi en bénéficiant du travail spécifique d’une délégation ne peut que constituer un plus. Je le mesure clairement avec la délégation aux droits des femmes, laquelle apporte une plus-value et une expertise, sans empiéter sur le travail des commissions saisies au fond. Le propre d’une délégation n’est-il pas, précisément, de traiter de sujets transversaux ?
Je ne partage donc pas les arguments de Mme la rapporteure sur la rationalisation des structures ou sur le renvoi de la décision au bureau du Sénat. C’est fuir ses responsabilités et c’est donner une image rétrograde de notre assemblée !
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et RDPI.

La France, pays des droits de l’homme, doit se montrer exemplaire en matière d’effectivité des droits des enfants et de leur enrichissement. La protection de l’enfance est un enjeu primordial que nous partageons sur toutes les travées, ainsi qu’avec le Gouvernement. Une délégation aux droits de l’enfant serait un signal fort envoyé aux associations, aux enfants de l’aide sociale à l’enfance (ASE), à toutes les actrices et à tous les acteurs impliqués sur cette question et qui veulent être entendus. Nous voterons donc cette proposition de loi. J’espère que nos collègues hésitants nous suivront !
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et RDPI.

M. Philippe Bonnecarrère . Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, certaines interventions passionnées, voire enflammées, nous font revivre les rédactions de notre enfance sur le thème du cœur et de la raison. Nous venons d’entendre les voix du cœur, mais il existe aussi la voix de la raison.
Protestations sur les travées du groupe SER.

Nous avons bien compris, depuis l’intervention de Mme la rapporteure, que les voix de la raison sont moins appréciées que celles du cœur…
De quoi s’agit-il aujourd’hui ? Bien évidemment, les droits de l’enfant ne font pas débat dans cet hémicycle.

M. Philippe Bonnecarrère. Quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, notre préoccupation unanime est la même à l’égard des droits des enfants. Pour le dire franchement, il n’y aurait pas, d’un côté, les conservateurs et, de l’autre, les modernistes.
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Pierre Louault applaudit également.

Reste la question de savoir comment traiter les sujets pour que l’action publique soit la plus efficace possible. Deux options s’offrent à nous en ce qui concerne les travaux parlementaires : soit on les flèche vers une délégation spécifique au-delà des groupes d’études éventuels ; soit l’on considère que l’organisation parlementaire grâce à sa structure et à l’existence de commissions susceptibles de traiter du sujet a déjà son efficacité. Les deux positions peuvent effectivement se valoir.
Mme Vogel a parlé d’éparpillement ; pour ma part, je parlerai plutôt d’émiettement. Afin de ne pas éparpiller, nous disait-elle, le sujet entre les différentes commissions, nous avons besoin d’une délégation. Mais il y a un revers à chaque médaille : en créant une délégation sur tous les sujets transversaux, nous tombons cette fois dans l’émiettement puisque nous émiettons l’action parlementaire entre les différentes structures.
Mes chers collègues, nous pouvons nous parler en vérité : vous savez parfaitement qu’entre les débats dans l’hémicycle et le travail en commission ou en délégation, nous courons tous après notre agenda. Je ne suis donc pas certain que la multiplication des délégations soit une bonne réponse : il y a des limites à l’exercice…

Plus particulièrement, j’ai tendance à me méfier – je l’assume complètement – des effets d’affichage.
Mme Cohen a terminé son propos en disant qu’il fallait envoyer des signaux. Cette idée que la vie publique passerait par l’envoi de signaux ou l’organisation de journées mondiales de ceci ou de cela ne me semble pas pertinente !
C’est une logique d’émotion ou de communication. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si nous avons ce débat au moment où il est question d’inscrire toutes les normes juridiques dans notre Constitution. À quel moment est-on dans l’action publique ? À quel moment est-on dans l’affichage ? Faisons attention à ne pas tomber dans l’abus…
C’est la raison pour laquelle la majorité du groupe Union Centriste ne soutiendra pas la création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant, même si certains parmi nous en approuvent depuis le début l’idée.

M. Philippe Bonnecarrère. Les propos de Mme Jourda ou les miens plaidant en faveur d’une méthode de travail efficace et rationnelle ne devraient pas poser trop de difficultés au sein de notre assemblée. Le rapport fait au nom de la commission des lois ne fait-il pas état d’une note du bureau nous demandant, sur la base d’un rapport d’Alain Richard, notre actuel président de séance, d’« éviter la dispersion des sénateurs et donc la multiplication, la polysynodie des structures » ? Quoi qu’il en soit, au-delà des débats au sujet de la polysynodie au début de la Régence de Louis XV, je ne suis pas certain que l’usage d’un tel lexique soit suffisant à répondre à nos préoccupations…
Sourires.

Plus sérieusement, notre assemblée mène de nombreux travaux et assure un contrôle soutenu sur les sujets les plus variés. Je ne comprends donc pas les critiques émises par plusieurs intervenants. M. Théophile a indiqué il y a quelques minutes que nous devrions avoir un meilleur suivi de l’application des lois dans le domaine des droits des enfants. Vous savez bien, mes chers collègues, qu’il s’agit là d’une de nos préoccupations majeures : cela vaut pour la question des droits des enfants comme pour tous les autres sujets !
Je ne crois pas que notre assemblée ait à rougir de son travail continu – dont la meilleure preuve est la multiplicité des travaux réalisés – ni de sa capacité à assurer la transversalité. Au bout du bout, chacun prendra, bien sûr, ses responsabilités.

M. Philippe Bonnecarrère. Effectivement, je vous prie de bien vouloir m’en excuser, j’arrête donc là mes remarques…
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant se heurte une nouvelle fois au refus d’un grand nombre de nos collègues de la commission des lois.
Les raisons que celle-ci invoque, vous m’excuserez, sont peu argumentées. Comme en 2019, vous justifiez le rejet de ce texte par des considérations relatives à la méthode du travail parlementaire.
Nous avons été élus pour porter la voix de nos concitoyens et de nos collectivités. Les services de l’aide sociale à l’enfance sont saturés et manquent de moyens pour agir.
Par exemple, en novembre 2021, un nourrisson âgé de seulement 13 mois est décédé, battu à mort par ses parents alors même qu’il faisait l’objet d’un signalement et qu’il bénéficiait d’une mesure de protection de l’enfance. Ce drame aurait pu être évité.
Je pourrais vous citer tellement de tragédies liées à l’inceste et à la maltraitance qui se finissent ou par un suicide ou par un coup mortel. En l’occurrence, la responsabilité de l’État est immense.
Le rapport de l’inspection générale des affaires sociales (Igas) met en évidence un enchaînement de circonstances défavorables et de défaillances profondes dans le système de l’ASE.
En plus de son dernier rapport accablant, la Défenseure des droits, Mme Claire Hédon, s’est saisie, le 15 novembre dernier, de la situation alarmante et préoccupante des mineurs placés dans le Nord et la Somme. Les juges des enfants de ces départements ont alerté sur le manque de places en foyer, les placements non exécutés et les mesures d’assistance éducative non prises en charge, avec des délais excédant les six mois. Une véritable rupture s’opère entre les enfants laissés pour compte et l’État largement désengagé.
La Défenseure des droits l’affirme : la protection de l’enfance n’est plus dûment assurée dans certains territoires. Selon la Fondation Abbé Pierre, un quart des personnes sans domicile fixe (SDF) aujourd’hui sont d’anciens enfants placés.
Vous voudriez alors nous faire croire qu’il n’est ni légitime, ni efficace, ni cohérent de créer cette délégation parlementaire aux droits de l’enfant ? Que ce soit dans les domaines de l’éducation, de la santé, notamment depuis l’épisode de covid, de la justice et de la protection de l’environnement, les enfants ont une place à part entière dans nos politiques publiques !
Engageons-nous réellement dans cette cause et créons enfin cette délégation, qui serait une fenêtre ouverte du Parlement pour y faire entrer l’enfant, un organe d’action et de propositions. Je voterai cette proposition de loi et je remercie son auteur, M. Iacovelli.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et RDPI. – Mme Laurence Cohen applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il y a quelques jours, lors de l’examen du budget, j’ai eu l’occasion de mettre l’accent sur certaines difficultés auxquelles étaient confrontés les services gravitant autour de l’accompagnement de l’enfance : surcharge de travail, manque de moyen et de personnel, engagement de plus en plus important face à des situations de plus en plus complexes et douloureuses.
La protection de l’enfance demande autant de persévérance que de patience. Qu’il me soit donc permis de rendre hommage à ceux qui s’y dévouent, souvent pour des salaires modestes et des emplois du temps éreintants.
Je remercie Xavier Iacovelli de son initiative. Elle doit nous maintenir en alerte. On pourrait considérer que, sur la forme, cette proposition de loi soulève une difficulté, d’autant que notre groupe n’est pas toujours favorable à l’inflation législative.
Certes, comme à l’Assemblée nationale, l’objectif visé au travers de ce texte pourrait être atteint autrement que par une loi. Notre conférence des présidents pourrait se charger elle-même de la création d’une délégation aux droits des enfants. Mais, à défaut, il fallait trouver un moyen de l’alerter. C’est ce que permet cette proposition de loi.
S’agissant du fond maintenant, il est légitime de s’interroger sur la nécessité d’une telle délégation.
Qui, dans cet hémicycle, ne serait pas favorable à ce que nous portions une attention particulière à la question des droits de l’enfant ? Évidemment, personne !
Loin de nous l’idée de renier tout le travail qui a été réalisé ces dernières années. Il va de soi que la définition de l’intérêt de l’enfant peut varier d’un esprit à l’autre, mais sur les sujets les plus fondamentaux, nous savons être unanimes.
Je pense, par exemple, à la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, portée par notre collègue Annick Billon. Chacun se souvient d’ailleurs de l’injuste traitement médiatique dont ce texte avait fait l’objet. Il est pourtant clair aujourd’hui que le Sénat avait été à l’origine d’une avancée significative dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants, même s’il reste encore des progrès à accomplir.
Pour revenir au texte du jour, notre rapporteure l’a souligné, le Sénat défend déjà, et ce depuis longtemps, les droits et l’intégrité des enfants, comme nos nombreux travaux en témoignent – notre rapporteure a dressé une liste non exhaustive des rapports et auditions de ces dernières années. Ce point ne fait l’objet d’aucun débat : c’est un sujet sur lequel nous travaillons.
Toutefois, malgré ces éléments, je n’irai pas dans le sens de notre commission. D’ailleurs, quelques membres du groupe RDSE ont également cosigné cette proposition de loi.
En effet, puisque c’est un sujet majeur, plutôt que de multiplier les initiatives et d’éparpiller nos réflexions, pourquoi ne pas structurer cet ensemble au sein d’une même instance, à savoir une délégation aux droits des enfants ?
Personne ici ne dira que les autres délégations déjà instituées manquent d’utilité et de légitimité.

Mme Maryse Carrère. Elles permettent d’offrir des réponses et des analyses transversales, marquées par la spécialité et l’expertise sur une thématique, qu’il s’agisse de la décentralisation, de l’égalité des chances, des entreprises ou de l’outre-mer. Elles sont aussi des lieux de dialogue et d’analyses prospectives de grande qualité, qui viennent nourrir nos travaux législatifs. Pourquoi alors ne pas créer une délégation aux droits des enfants ? Je n’ai aucun doute sur le fait que cette nouvelle délégation trouverait ici toute sa place. Aussi, notre groupe votera en faveur de cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI, SER et CRCE, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’occasion de la Journée nationale des droits de l’enfant le 20 novembre dernier, le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) a publié des chiffres alarmants : en France, un enfant est tué par l’un de ses parents tous les cinq jours en moyenne.
L’association l’Enfant Bleu a, pour sa part, constaté une augmentation de 45 % des appels de victimes ou de témoins de maltraitances sur des enfants entre 2019 et 2022.
Ainsi, force est de constater que, si la France progresse en matière de protection des enfants, elle n’a pas encore réussi à éradiquer les violences faites à leur encontre ni à faire respecter leurs droits.
Quelque 3 millions d’enfants vivent en France sous le seuil de pauvreté, et les inégalités en matière de santé, de logement, d’accès à l’éducation ou aux loisirs demeurent bien trop importantes.
S’ajoutent à cela de nouvelles formes de violences, physiques, mais aussi morales, telles que le harcèlement, la maltraitance, la pédophilie, l’exploitation sexuelle, dans le cadre familial bien souvent, mais aussi – et de plus en plus – dans le cadre scolaire ou médico-social.
La situation est encore bien plus dramatique dans le monde : la guerre, la misère et la pauvreté, les inégalités et le changement climatique mettent en péril la vie de millions d’enfants.
Ayons, mes chers collègues, en tête ces données très préoccupantes alors que nous examinons aujourd’hui la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits des enfants.
Plusieurs collègues l’ont rappelé, c’est la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) adoptée par les Nations unies le 20 novembre 1989 et que la France a ratifiée en août 1990 qui garantit les droits interdépendants et inaliénables des enfants.
Le texte vise la protection spécifique de l’enfant en tant que sujet de droit à part entière. Sont ainsi pris en considération le caractère vulnérable et la nécessité de développement de l’enfant. Il a ainsi droit à une identité, à la santé, à l’éducation, à une vie de famille, à un niveau de vie suffisant. Il a le droit d’être protégé de la violence, de s’exprimer, d’être protégé de la guerre, d’être protégé de l’exploitation. Il a le droit de jouer et d’avoir des loisirs.
Trois protocoles facultatifs entrés en vigueur en 2014 et en 2022 ont complété cet instrument. Ils concernent notamment l’implication des enfants dans les conflits armés et mettent l’accent sur la nécessité de les protéger contre leur recrutement. Ils visent également à lutter contre la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie les mettant en scène.
Pour en revenir au texte que nous examinons aujourd’hui, je rappellerai tout d’abord que ce n’est pas la première fois qu’une telle proposition de loi est déposée sur le bureau des assemblées, et parfois examinée. En 2003 déjà, un texte similaire avait été adopté à l’Assemblée nationale, mais il n’avait jamais été examiné au Sénat.
La proposition de loi que présente notre collègue Xavier Iacovelli reprend le texte d’une proposition de loi déposée en 2018 par notre collègue Éliane Assassi, qui avait été examinée et rejetée en séance le 20 novembre 2019. La rapporteure en était déjà notre collègue Muriel Jourda. Je regrette qu’une concertation au sein de la commission des affaires sociales n’ait pas eu lieu avant le dépôt de cette proposition de loi, …

… d’autant que nous pouvons légitimement nous interroger sur la nécessité de passer par un texte de loi.
En effet, la création de délégations touche à l’organisation interne des travaux dans chaque assemblée. Il n’est donc pas nécessaire de légiférer sur de telles dispositions. Laissons les membres du bureau décider de la création ou non de cette délégation : c’est leur rôle.
Il est vrai que la question des droits de l’enfant est un sujet transversal, qui concerne de nombreux domaines tels que l’éducation, la santé, la justice, la gouvernance.
Vous le savez, j’ai été l’an passé rapporteur de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants. Nous avions constaté le manque d’efficience de cette politique de protection au regard des moyens qui lui sont consacrés et nous avions fait des propositions très concrètes.
Certes, cette loi porte sur la protection des enfants relevant de l’aide sociale à l’enfance, mais au cours des nombreuses auditions que nous avons conduites, tous les acteurs rencontrés, particulièrement ceux qui agissent auprès des enfants, ont souligné leur attachement à la mise en place d’une veille pérenne et indépendante sur la question de l’élaboration, de l’évaluation et du suivi des politiques publiques en faveur des droits des enfants.
Je comprends qu’après la création au sein de l’Assemblée nationale d’une délégation aux droits des enfants ces associations demandent que le Sénat en fasse de même. En effet, une délégation aux droits de l’enfant a été créée à l’Assemblée nationale le 13 septembre dernier sur décision de la conférence des présidents.
Néanmoins, force est de constater que les sujets sur lesquels cette délégation souhaite se pencher ont largement été traités par le Sénat. Je ne les listerai pas tous ici. Certains ont été examinés par la commission des affaires sociales, d’autres par la commission de la culture, la commission des lois, la commission des affaires économiques, mais aussi par la délégation aux droits des femmes.
Ainsi, dans le droit fil de la révision constitutionnelle de 2008, c’est bien via ses commissions permanentes que le Sénat exerce son pouvoir de contrôle et d’évaluation des politiques publiques. Il n’est peut-être pas utile de multiplier les structures – le travail parlementaire ne s’en trouvera pas plus efficace –, mais il convient que nos commissions, particulièrement la commission des affaires sociales, continuent de se saisir de ces questions.
En effet, de nouvelles formes de violences concomitantes avec les usages de nos sociétés apparaissent. Mme la Défenseure des droits et la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) ont récemment souligné l’urgence qu’il y avait à protéger les enfants des dangers du numérique.
Je souhaite également que nous puissions, peut-être via la création d’une mission d’information, étudier la réalité de l’application des lois de 2007, de 2016 et de 2022 relatives à la protection de l’enfant, qui ne sont pas également mises en œuvre sur l’ensemble du territoire. Or je sais, madame la secrétaire d’État, que vous y êtes très attachée.
Mme Laurence Rossignol signale que le temps de parole de l ’ orateur est écoulé.

Mes chers collègues, une société qui ne sait pas protéger ses enfants dans un monde apaisé et rassurant est une société qui transige avec ses valeurs les plus fondamentales.
Mme Corinne Imbert applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Xavier Iacovelli applaudit également.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, au sein de cet hémicycle, notre intérêt pour les droits de l’enfant est unanime.
Notre volonté d’offrir à tous les enfants les moyens de construire leur avenir demeure inaltérable et notre devoir d’éradiquer le fléau des violences qui leur sont faites, quelles que soient les formes qu’elles peuvent revêtir, est indéfectible.
Pourtant, en France et dans le monde, les problématiques liées à l’enfance sont toujours d’une actualité brûlante, et nombreux sont les défis qui restent à relever, comme l’amélioration de la situation des enfants atteints d’un handicap ou du sort des enfants migrants.
Aussi, parce que la protection de l’enfant et son intérêt supérieur doivent être une préoccupation permanente du législateur, l’initiative de notre collègue Xavier Iacovelli mérite d’être saluée. Je félicite le groupe RDPI d’avoir inscrit cette proposition de loi à l’ordre du jour.

Comme son titre l’indique, ce texte a pour objectif de constituer une délégation parlementaire aux droits de l’enfant.
L’article unique vise à instituer, en premier lieu, dans chaque assemblée, une délégation parlementaire aux droits de l’enfant de trente-six membres, choisis à la représentation proportionnelle des groupes.
En deuxième lieu, il vise à charger ces délégations d’assurer le suivi de la politique des droits de l’enfant et tend à leur permettre d’être saisies de projets ou de propositions de loi sur demande du bureau, d’une commission, d’un président de groupe ou de leur propre initiative.
En troisième lieu, il vise à prévoir la remise d’un rapport d’activité annuel comprenant, le cas échéant, des « propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation ».
Enfin, il tend à donner la possibilité à la délégation de l’Assemblée nationale et à celle du Sénat de décider de tenir des réunions communes.
Une proposition de loi identique avait déjà été examinée au Sénat une première fois, en 2019, et avait été repoussée. Or, depuis le 13 septembre dernier, l’Assemblée nationale s’est dotée d’une délégation aux droits des enfants composée de trente-six députés. Cet élément nouveau nous incite à revoir notre position de 2019.
La création d’un équivalent au Sénat permettrait, au cours de réunions menées conjointement, de faire bénéficier la question des droits de l’enfant de l’expertise des sénateurs, notamment à la lumière du rôle majeur que les collectivités territoriales jouent en faveur de l’enfance. Je pense, notamment, au département, chef de file des politiques sociales et de la protection de l’enfance.
Mme Victoire Jasmin applaudit.

Par ailleurs, une délégation aux droits de l’enfant pourrait avoir un angle d’approche différent de celui des commissions permanentes, qui effectuent un remarquable travail légistique.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la création d’une délégation parlementaire aux droits de l’enfant faciliterait une démarche plus transversale pour traiter efficacement les multiples problématiques.
Elle aurait aussi le mérite d’améliorer la connaissance des droits de l’enfant par les pouvoirs publics tout en donnant davantage de visibilité à ces droits.
Pour toutes ces raisons, la majorité du groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travée s des groupes INDEP, RDPI, RDSE et SER . – Mme Laurence Cohen applaudit également.

M. Laurent Burgoa . Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous le savons, l’enfer peut être pavé de bonnes intentions.
Mme Laurence Rossignol s ’ exclame.

Aussi, je crois utile de rappeler que la création d’une délégation relève usuellement d’une simple décision du bureau. Je crois également bon de souligner que la loi du 15 juin 2009 – ce n’est si lointain – avait supprimé pas moins de cinq délégations dans un souci de rationalisation des travaux parlementaires.

À vrai dire, cette proposition est surtout révélatrice de ce que pourrait devenir notre vie parlementaire.

Disons-le, nous ne manquons pas d’outils pour nous emparer des enjeux de notre société. Il y a, bien sûr, les propositions de loi et les amendements, mais il y a aussi les commissions d’enquête et les rapports d’information.
Plutôt que de nous saisir de l’un de ces instruments, nous discutons aujourd’hui, à cette heure, de la création d’une délégation. Ne vaudrait-il pas mieux débattre de solutions concrètes à des difficultés précises ?
Protestations à gauche.

J’ai bien conscience que cette proposition de loi vise, d’une certaine manière, à se donner le beau rôle. Mais n’oublions pas, par exemple, que la commission des lois et la commission des affaires sociales, à travers un rapport d’information conjoint dont j’étais le corapporteur, ont déjà pu pleinement s’investir sur le sort des mineurs non accompagnés et formuler de nombreuses propositions. C’est la preuve que le travail transversal sur des problématiques précises existe déjà, fort heureusement ! ( Mme Laurence Rossignol s ’ exclame.)
En somme, je ne crois pas qu’émietter le travail parlementaire le rendra plus pertinent. Je ne suis d’ailleurs pas le seul à le penser puisque le groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat avait recommandé, en 2015, d’éviter une division trop importante de notre champ de travail.
En créant cette délégation, on se ferait plaisir, on communiquerait, mais concrètement rien ne changerait. Or, c’est tout l’objet de mon propos, le Parlement – au vu du niveau d’abstention lors des dernières élections – est attendu sur cette question de la traduction de son travail dans le quotidien des Français.
Le travail parlementaire est reconnu pour sa qualité – c’est à mon sens indéniable –, mais les Français, comme l’auteur de cette proposition peut-être, sont las de voir nos rapports ne pas être pris en considération par un pouvoir exécutif qui pense être le seul à avoir les solutions aux problèmes et qui croit connaître tout sur tout !
Admettons-le, c’est difficile à vivre lorsque l’on est dans l’opposition, mais je ne doute pas que le Gouvernement entende parfois raison sur des dispositifs que nous l’encouragerions à mettre en place.
Je milite donc pour un Sénat qui persiste à être véritablement force de proposition plutôt que pour un Sénat qui se renfermerait sur lui-même
M. Xavier Iacovelli proteste.

Pour ces raisons, mes chers collègues, comme une grande majorité du groupe Les Républicains, je ne voterai pas cette proposition de loi.

Ce vote, madame Rossignol, n’est pas dirigé contre le droit de l’enfant. Je souhaiterais que certains dans cet hémicycle ne le réduisent pas à une position caricaturale : comme nos travaux sénatoriaux le démontrent, nous défendons au contraire tous les jours les droits des enfants ! (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi initiale.
L’article 6 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rétabli :
« Art. 6 quater. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits de l’enfant. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.
« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.
« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.
« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux droits de l’enfant ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits de l’enfant. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.
« En outre, les délégations parlementaires aux droits de l’enfant peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :
« 1° Le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.
« Enfin, les délégations peuvent être saisies par les commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution.
« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.
« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.
« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée. La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.
« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Avant de mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Si j’ai bien suivi les débats, il existe une délégation aux droits des femmes, une délégation aux entreprises, une délégation aux collectivités territoriales, et d’autres encore. Cela signifie que le bureau du Sénat a jugé, à un moment donné, que ces délégations étaient utiles pour mener des réflexions sur ces sujets.
Les droits de l’enfant, quant à eux, ne méritent-ils pas une délégation ? N’y a-t-il pas urgence à agir dans ce domaine et à s’emparer de ces problématiques ?
La liste des nombreux travaux égrenés par la rapporteure montre qu’il existe un intérêt du Sénat pour ces sujets. L’excellent plaidoyer de Bernard Bonne en faveur des droits de l’enfant en témoigne également.
Si cette proposition de loi peut être le véhicule permettant de lever les freins posés par le bureau du Sénat pour ce qui concerne les droits de l’enfant, alors je voterai ce texte, et j’incite tous ceux qui veulent s’emparer de sujets sociétaux au sein de cet hémicycle à faire de même.
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI, GEST, SER et CRCE, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je prends la parole pour répéter quelques éléments que j’ai déjà exposés en commission des lois.
À chaque fois qu’un débat a eu lieu dans notre pays au cours des derniers mois ou des dernières années, qu’il porte sur le mariage pour tous, sur l’adoption ou sur la procréation médicalement assistée (PMA), les représentants de la majorité sénatoriale ont systématiquement mis en avant l’intérêt supérieur de l’enfant.
Tout d’abord, je tiens à regretter l’absence aujourd’hui dans l’hémicycle de nos collègues de la majorité sénatoriale, alors même que nous débattons, au travers de cette proposition de loi, de l’intérêt supérieur de l’enfant !
Ensuite, je rappelle qu’il y a au sein de notre Haute Assemblée des délégations, notamment aux entreprises et à la prospective, et que ce serait faire injure à la commission des affaires économiques de laisser à penser qu’avant la création de ces délégations, personne ne travaillait ici sur les entreprises ou sur la prospective !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et RDPI.

Je ne partage donc pas du tout l’argument défendu par Mme la rapporteure. Le fait que les commissions permanentes travaillent sur un sujet n’interdit en aucune façon au Sénat de créer une délégation spécifique !
Enfin, rendez-vous est pris. Dans quelques mois ou quelques années, une ou un membre de la majorité sénatoriale déposera peut-être une proposition de loi similaire à celle qui est aujourd’hui discutée, en la reprenant à son compte… Les conditions seront alors réunies pour réparer l’erreur que nous allons commettre aujourd’hui si la majorité d’entre nous vote contre ce texte de Xavier Iacovelli, que je remercie d’avoir pris cette initiative.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE, GEST et RDPI, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.

Je voterai avec enthousiasme, cette proposition de loi ! J’ajouterai un point aux propos qui viennent d’être tenus.
Dans nos territoires, à la fin des inaugurations ou des rencontres autour de l’enfance ou de la petite enfance, on entend souvent citer ce proverbe africain : « Il faut tout un village pour élever un enfant. » Ces mots saluent et soulignent le partenariat, la coopération, le travail en commun et les regards croisés des différents acteurs qui interviennent sur le terrain.
Aussi, je ne comprends pas, et ne trouve pas digne de sa part, que notre Haute Assemblée rate le rendez-vous proposé aujourd’hui au travers du texte de Xavier Iacovelli. Je le regrette et le déplore !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et RDPI.

Alors que je venais d’être nouvellement élu au Sénat, je me souviens d’avoir interrogé en 2015 la secrétaire d’État chargée de la famille d’alors, notre collègue Laurence Rossignol. Le petit Bastien venait de mourir, après avoir été mis dans le lave-linge par son père, sur le mode « essorage ». Comme nous toutes et nous tous, j’avais été profondément bouleversé par ce drame, qui mettait en lumière les carences d’un système ayant failli à sauver un enfant d’une mort atroce.
Je sais, comme vous, qu’il existe beaucoup d’autres Bastien et que nous peinons à recenser tous ces infanticides, car il faudrait autopsier tous les bébés morts prématurément de façon inexpliquée.
La maltraitance des enfants ne s’arrête pas à nos frontières. À l’étranger, les familles françaises échappent parfois à la protection de l’enfance. Certains enfants perdent quelquefois tout contact avec l’un de leurs parents, comme nous l’avons souvent observé au Japon par exemple, grâce au travail de notre ancien collègue Richard Yung.
Les consulats ne peuvent évidemment pas, faute de moyens et de formation, être le prolongement de l’aide sociale à l’enfance. L’aide aux victimes de violences, notamment familiales, se développe néanmoins petit à petit.
C’est à sa capacité à protéger les plus faibles que l’on reconnaît une société civilisée. Avant d’agir, il faut connaître et mesurer l’ampleur du problème, et le système mis en place pour y faire face.
La création d’une délégation aux droits de l’enfant, qui consacrera ses travaux à améliorer la protection des enfants, me semble impérieuse. Je salue cette initiative de notre collègue Xavier Iacovelli, que je remercie d’avoir cité la précédente proposition de loi sur le sujet, présentée par Joëlle Garriaud-Maylam, laquelle représente comme moi les Français établis hors de France.
Je voterai donc cette proposition de loi avec le même enthousiasme que certains de nos collègues.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, GEST, SER et CRCE, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je remercie tous ceux qui ont pris la parole pour soutenir cette proposition de loi, et reprends à mon compte les propos d’Hussein Bourgi, de Michelle Meunier et d’Olivier Cadic, auxquels je souscris complètement.
Pardonnez-moi d’évoquer ce point alors que la discussion est relativement cordiale, mais je veux revenir sur le mépris que certains orateurs ont manifesté en parlant d’« affichage » ou de « proposition du cœur »…
Or il s’agit, au contraire, d’une proposition de loi de raison. Je le dis en m’appuyant sur l’argumentaire de la rapporteure, qui a dressé la liste des travaux sur le sujet, qu’il s’agisse d’auditions et de rapports, lesquels – je le rappelle – n’ont pas valeur de loi. Le nombre de ces travaux montre que nous avons besoin de réfléchir de façon coordonnée et transversale.
Point n’est donc besoin de faire preuve de mépris…

… et de dénaturer les travaux et les initiatives parlementaires. Mais peut-être est-ce de votre part, mes chers collègues, une façon d’afficher votre malaise, ce que je peux comprendre…
J’ai aussi entendu évoquer, dans cet hémicycle et dans les couloirs du Sénat, l’argument de la temporalité, sous la forme suivante : « On ne va tout de même pas créer une délégation à neuf mois du renouvellement sénatorial… »

Car figurez-vous que l’on pourrait s’en servir alors même qu’elle est portée par l’opposition sénatoriale !
Pourquoi ne pas prendre ici l’engagement de créer cette délégation, même si cela ne doit prendre effet qu’en septembre ou octobre 2023 ? Je n’y vois, pour ma part, aucun inconvénient tant que je suis assuré que cette création sera effective. Mais nous ne devons pas être freinés par un problème de calendrier : nous parlons là de droits de l’enfant et non pas d’une question électorale et partisane !
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, SER et CRCE.

Notre collègue Bernard Bonne, qui a malheureusement quitté l’hémicycle, disait lors de son intervention que l’on pourrait créer un groupe d’études dans le cadre de la commission des affaires sociales. Très bien ! Mais j’avais fait cette demande en 2020, et cela m’avait été refusé !
On peut toujours avoir ce débat de façon répétée, mais si chacune de nos propositions se heurte à un refus, il ne faut pas s’étonner que l’on recoure ensuite à la voie législative pour tenter de les faire aboutir.
J’espère que les consignes de vote seront respectées, car j’ai reçu de nombreuses marques de soutien, en provenance de tous les groupes – y compris ceux de la majorité sénatoriale –, et je remercie ceux qui me les ont adressées. Je comprends qu’il soit difficile pour certains d’entre nous d’être présents dans l’hémicycle, mais j’insiste sur le fait que nombre de nos collègues soutiennent la proposition de loi.
J’invite donc tous les sénateurs présents et tous ceux qui ont reçu des délégations à voter pour cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE, GEST, SER et CRCE, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et UC.

Mme la rapporteure et les représentants du groupe Les Républicains nous ont invités à parler non pas des droits de l’enfant, mais du fonctionnement du Sénat. C’est donc de ce sujet que je vais vous parler, m’étant suffisamment exprimée sur la proposition de création d’une délégation aux droits de l’enfant.
À la fin de la discussion générale sur ce texte, nous étions trente-quatre sénateurs en séance. Sur ce nombre, vingt-neuf sont favorables à cette proposition de loi, et trois ou quatre y sont hostiles.
Sur les huit groupes du Sénat, six sont favorables à cette proposition de loi, un groupe est partagé, et un groupe y est majoritairement défavorable.
Or, du fait des modalités du vote par scrutin public, et en dépit des chiffres que je viens de donner, il est possible que cette proposition de loi soit rejetée dans quelques instants !
Puisque vous voulez parler du fonctionnement du Sénat, je vous suggère de réfléchir à ce beau sujet : le respect du vote au Sénat !
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE, GEST et RDPI.

Je voterai pour cette proposition de loi, à laquelle je suis très favorable.
En effet, les départements eux-mêmes attendent que nous travaillions sur ce sujet.
À La Réunion, l’université vient d’organiser, en collaboration avec le conseil départemental et des représentants des associations de la zone de l’océan Indien, notamment de Mayotte, un grand colloque sur les droits de l’enfant, lors duquel des chiffres très alarmants – en particulier sur la scolarité des enfants, sur les méconnaissances des mères et sur les grossesses précoces – ont été communiqués. Vous comprendrez donc que je sois favorable, à titre personnel, à ce texte.
Mais, pour avoir parlé avec bon nombre de mes collègues du groupe centriste, je veux dire à mon ami Xavier Iacovelli qu’il n’y a pas de mépris de leur part. Ce qu’ils critiquent dans ce texte, lorsqu’ils ont prévu de voter contre ou de s’abstenir, c’est sa forme plus que le fond. Je tenais à me faire l’écho de ces échanges.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et RDSE. – Mme Laurence Cohen applaudit également.

Je remercie Mme Dindar, dont le propos correspond à peu près à ce que je voulais dire.
Lorsque l’on parle de mépris manifesté par la majorité sénatoriale…

C’est ce que vous avez dit ! Or, cela, on ne peut pas l’entendre, pas plus que l’argument selon lequel, la forme cachant le fond, nous nous désintéresserions de la protection des enfants…
Mme le rapporteur proteste.

Je n’étais pas présent dans l’hémicycle en début de séance, et je m’en excuse. Mais il a été dit, ici, que la forme cachait le fond…

… et on a laissé entendre par ailleurs que les sénateurs de la majorité sénatoriale se fichaient – pour faire court – de l’intérêt des enfants.

Or le nombre de travaux consacrés par le Sénat à ce sujet a été rappelé. Le dernier d’entre eux, relatif aux agressions sexuelles sur mineurs, a fait l’objet d’un travail très important de la commission des lois, laquelle a réfléchi à l’amélioration des droits de la défense des enfants, ce qui est une bonne chose.

M. François-Noël Buffet, président de la commission des lois . … mais je n’aime pas les procès d’intention !
M. Laurent Burgoa acquiesce.

On peut avoir des divergences, mais les procès d’intention sont selon moi inacceptables ; c’était simplement ce que je voulais vous dire. Cela vaut pour ce débat comme pour d’autres.
Ce texte n’est peut-être pas le bon véhicule législatif, l’on peut en discuter, mais la discussion est ouverte sur le fond.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’article unique constituant de la proposition de loi tendant à la création de délégations parlementaires aux droits de l’enfant.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable et que le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 97 :
Nombre de votants345Nombre de suffrages exprimés331Pour l’adoption153Contre 178Le Sénat n’a pas adopté.
Les sénateurs des groupes RDPI, SER et CRCE protestent, car les résultats annoncés oralement par le président de séance ne sont pas ceux qui sont affichés sur les écrans situés dans l ’ hémicycle.

Mes chers collègues, concernant les résultats du scrutin, ce sont ceux que je viens d’annoncer qui font foi !
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à seize heures, sous la présidence de Mme Laurence Rossignol.