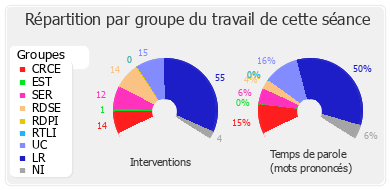Séance en hémicycle du 29 janvier 2013 à 14h45
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quatorze heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Raffarin.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, présentée par Mme Jacqueline Gourault et M. Jean-Pierre Sueur (proposition n° 120, texte de la commission n° 281, rapport n° 280).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Jacqueline Gourault, coauteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous avons eu hier une discussion très intéressante et très constructive sur la proposition de loi visant à créer un conseil national d’évaluation des normes, que Jean-Pierre Sueur et moi-même avions déposée. Le débat a été serein, et je tiens à en remercier tous nos collègues qui y ont participé, ainsi que le rapporteur du texte, Alain Richard, qui a su faire preuve, comme à l’accoutumée, de beaucoup de doigté et de compétence. J’espère que nous examinerons la présente proposition de loi dans le même esprit.
Les deux propositions de loi font suite aux états généraux de la démocratie territoriale. Le président du Sénat nous a en effet confié, à Jean-Pierre Sueur, en tant que président de la commission des lois, et à moi-même, en tant que présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, la mission de travailler sur ces questions.
Nous savons tous, puisque nous sommes, pour la plupart d’entre nous, des élus locaux, qu’il y a des améliorations à apporter au statut de l’élu local. Certes, il existe déjà des garanties, mais elles sont insuffisantes. En témoignent plusieurs rapports faits au nom de la délégation que je préside, notamment ceux rédigés l’an dernier par Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet, sur le statut de l’élu, et par Antoine Lefèvre, sur la formation des responsables locaux. Je me limite à l’année 2012, mais on pourrait remonter plus loin, car cela fait longtemps que le sujet nous préoccupe.
Je tiens à mentionner également la proposition de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local, rédigée par Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx, qui contenait un certain nombre d’éléments intéressants ; elle avait été votée à l’unanimité au Sénat, mais n’avait malheureusement pas prospéré à l’Assemblée nationale.
Le texte que nous examinons aujourd'hui constitue une synthèse des différents éléments mis en avant dans ces rapports et dans cette proposition de loi. Nous ne faisons rien de révolutionnaire, nous apportons seulement une pierre à l’édifice du statut de l’élu.
Certains pensent que nous n’allons pas assez loin. J’aurais tendance à leur répondre : chi va piano va sano…

… et tout changement qui va dans le bon sens doit être adopté.
Ces critiques contiennent une question sous-jacente : la fonction d’élu est-elle un métier ? C’est là qu’est le nœud du problème. Il est clair que la proposition de loi n’opère pas de révolution dans la tradition française du bénévolat des élus locaux. Le principe du bénévolat est même inscrit dans le code général des collectivités territoriales. Plusieurs de nos collègues avaient d'ailleurs présenté des amendements pour supprimer la gratuité des fonctions d’élu local, dans la mesure où celles-ci peuvent être exercées dans de grandes collectivités territoriales.
Je comprends bien cette demande. Le statut des élus locaux est pris en tenaille entre le principe du bénévolat et la nécessité où se trouvent certains élus d’êtres disponibles à plein temps pour exercer leur fonction.

Nous ne sommes pas loin, ici, du problème du cumul des mandats.
Cela étant, dans la structuration actuelle de notre pays, qui compte 36 000 communes, je ne vois pas comment on pourrait professionnaliser la fonction d’élu. En effet, 36 000 communes, cela signifie des centaines de milliers de conseillers municipaux travaillant bénévolement dans des communes de toutes tailles. C'est la raison pour laquelle, dans notre proposition de loi, nous avons écarté l’idée d’une carrière professionnelle de l’élu et conservé le principe du bénévolat. Je rappelle toutefois que ce principe n’exclut pas les indemnités de fonction, qui permettent de dédommager les élus.
Je n’entrerai pas dans le détail de la proposition de loi, car notre rapporteur le fera. Je tiens cependant à dire que, selon moi, quand on aborde le droit d’absence, le droit à la suspension du contrat de travail, l’allongement de l’allocation différentielle de fin de mandat, quand on protège les élus, quand on facilite l’indemnisation des maires des petites communes, quand on unifie le cadre intercommunal, quand on encourage la formation des élus, on fait beaucoup de choses pour la démocratie locale et on va dans le bon sens.
Reste que le débat ne sera pas clos par l’adoption de cette proposition de loi. Nous n’avons pas la prétention, Jean-Pierre Sueur et moi-même, de tout régler, mais nous voulons faciliter l’exercice des mandats locaux, en particulier pour les salariés du secteur privé, car il existe actuellement une grande inégalité entre ces salariés et les fonctionnaires.
J’espère que cette proposition de loi sera, comme celle d’hier, adoptée à l’unanimité, ou presque puisqu’il n’y avait eu qu’une seule abstention.
Applaudissements sur plusieurs travées.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, coauteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est, comme celle que nous avons examinée hier, issue des états généraux de la démocratie territoriale, qui ont été organisés par le Sénat sur l’initiative de son président et qui ont rassemblé de nombreux élus dans la quasi-totalité des départements de France et à l’échelle nationale.
Comme l’a excellemment dit Jacqueline Gourault, avec laquelle j’ai élaboré cette proposition de loi, il s'agit de faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Le terme « faciliter » est important. Cela fait si longtemps que nous entendons tous parler du « véritable » statut des élus, comme si l’on pensait qu’un jour, ou plutôt un soir, qui serait un Grand Soir
Exclamations ironiques sur les travées de l’UMP.

L’histoire ne fonctionne pas ainsi, mes chers collègues ; vous le savez tous.

Peut-être qu’il en ira différemment quand ce sera l’heure du changement !

Monsieur Collombat, je voudrais vous rappeler que, il y a plus de vingt ans, en 1992, j’ai eu l’occasion de présenter, en ma qualité de secrétaire d’État aux collectivités locales, un premier projet de loi relatif aux mandats locaux.

On m’avait alors dit qu’un statut de l’élu local était enfin créé. J’avais répondu qu’il ne s’agissait pas encore d’un statut, mais seulement de quelques pas.

Ces quelques pas n’étaient pas négligeables, monsieur Collombat. Pour la première fois, la nécessité d’une formation des élus locaux était prise en compte. J’avais même plaidé pour que cette formation fût assurée par les universités ou les groupements d’établissements publics d’enseignement, les GRETA, mais je m’étais heurté à beaucoup d’élus qui pensaient qu’il était préférable qu’elle fût effectuée par des organismes que nos différentes formations politiques n’ont pas manqué de créer.
Dans ce même projet de loi, a été instaurée pour la première fois une retraite pour les élus. Pour ma part, j’avais plaidé, mais je me suis retrouvé en position minoritaire – cela peut arriver, monsieur Doligé –, …

En effet !
… pour un régime de retraite par répartition. Cependant, dans leur sagesse, les élus ont cru utile de créer un régime de retraite par capitalisation ; ce régime existe, et il constitue un progrès. À la même époque, nous avons également réfléchi à la question des indemnités, qui est toujours d’actualité.
Vous le voyez, mes chers collègues, il y a une avancée progressive, selon une philosophie réformiste. Je ne sais pas si cette philosophie vous convient, monsieur Collombat, mais je l’assume, car elle nous permet d’avancer.

Nous nous sommes efforcés – je crois qu’il s’agit d’une procédure légitime et honnête – de rassembler les propositions qui avaient donné lieu à un consensus lors des états généraux de la démocratie territoriale, après avoir vérifié qu’elles correspondaient aussi aux souhaits des différentes associations d’élus, notamment de l’Association des maires de France, l’AMF.
Nous avons donc fait un travail scrupuleux pour prendre en compte ce qui a été dit par nos collègues élus. À mon sens, il s’agit d’une bonne réponse à ceux qui estimaient que les états généraux de la démocratie territoriale seraient une grande manifestation de plus, s’interrogeant tout haut : « Qu’en sortira-t-il ? »

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur Collombat – notez que je vous cite pour la quatrième fois, donc vous voyez que je fais beaucoup d’efforts
Sourires.

Tout d’abord, j’aborderai la question des petites communes.
Mes chers collègues, je ne sais pas si vous connaissez le montant de l’indemnité prévue par la loi pour les maires des communes de moins de 500 habitants : elle est inférieure au tiers du SMIC.

M. Jean-Pierre Sueur. C’est vrai, mais le SMIC a été récemment relevé, cela ne vous a pas échappé.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

Mes chers collègues, vous le savez, dans nos villages, dans nos petites communes, le maire est constamment sollicité. L’exercice de cette fonction représente un véritable dévouement, car les services de ces collectivités sont très limités – c’est un tiers de secrétaire de mairie dans bien des cas – et l’on vient frapper à la porte du maire à toutes les heures de la journée, pour tous les problèmes pouvant se poser. Par conséquent, l’idée même, contenue à l’article 1er de la proposition de loi, que tous les maires des communes de moins de 3 500 habitants percevront automatiquement l’indemnité prévue par la loi au taux maximal n’est que justice.
Vous connaissez tous, dans vos départements, des maires qui n’osent pas solliciter le conseil municipal pour demander l’indemnité, de peur qu’on ne leur reproche de peser de manière excessive sur les finances communales. Il y a là quelque chose d’anormal et d’injuste. C’est pourquoi nous avons proposé cette mesure de justice, demandée lors des états généraux de la démocratie territoriale et défendue depuis très longtemps par l’Association des maires de France.
Ensuite, par une série d’autres mesures, nous avons souhaité favoriser l’égal accès de tous les citoyens aux fonctions électives. Vous savez bien qu’il est plus difficile pour des salariés du privé, des professionnels libéraux, des commerçants, des artisans ou des agriculteurs d’exercer un mandat électif que pour des citoyens qui travaillent dans d’autres secteurs.
Nous le constatons tous, il y a des conseils municipaux composés de beaucoup de retraités. Or, même si nous avons pour eux un infini respect, il me paraît légitime et nécessaire de faire en sorte que ces assemblées délibérantes soient composées d’hommes et de femmes représentant tous les secteurs d’activité et toutes les générations.
Je pense ici à ce jeune salarié, rencontré dans mon département, qui m’expliquait qu’en tant qu’élu municipal il ne pouvait pas aller aux réunions à la sous-préfecture ou à la préfecture, organisées par exemple à dix heures du matin, ou participer à toutes les commissions auxquelles nous sommes constamment invités. En réalité, si nous n’y prenons garde, nous assisterons à une professionnalisation de l’exercice des mandats locaux.
Lorsque nous proposons de prolonger le délai pendant lequel l’élu qui a suspendu son contrat de travail bénéficiera du droit de réintégration dans un emploi, d’élargir les conditions de versement de l’allocation différentielle à la fin du mandat, de favoriser la formation, indispensable pour faire face à des problèmes d’urbanisme ou de finances locales ou de prendre en compte le travail d’élu pour la validation des acquis de l’expérience pour un certain nombre de diplômes, nous promouvons des mesures de nature à favoriser l’exercice des mandats locaux par toutes et tous, quel que soit le domaine d’activité ou le statut professionnel, salarié, libéral ou indépendant.
Avec Jacqueline Gourault, nous avions proposé six mesures ; la commission des lois, sur l’initiative de M. le rapporteur, Bernard Saugey, à qui je tiens à rendre hommage pour la qualité de son travail, a proposé de retenir autant de mesures supplémentaires, qu’il va vous présenter dans quelques instants.
Nous avons écouté nos collègues élus, et nous proposons des avancées. On pourra toujours nous dire qu’elles sont insuffisantes, mais personne n’est dispensé d’apporter sa pierre à l’édifice. En tout cas, nous considérons qu’un pas en avant a été fait. Après le but marqué hier – nous avons en effet beaucoup parlé de sport –, j’espère que nous pourrons en marquer un second à l’issue de notre débat, en bonne entente avec vous, madame la ministre, afin de faire avancer les conditions d’exercice des mandats locaux.
Applaudissements sur plusieurs travées.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la question du statut de l’élu est, depuis longtemps, le serpent de mer de la vie publique. Pourtant, force est de constater que, au fil du temps, et singulièrement ces vingt dernières années, le législateur a progressivement construit un ensemble de garanties constitutives d’un tel régime. Cependant, celui-ci ne répond pas, loin s’en faut, aux attentes des élus locaux. La proposition de loi, adoptée le 30 juin 2011 à l’unanimité par le Sénat – je la connais bien, puisque j’en étais le coauteur avec Marie-Hélène Des Esgaulx –, mais qui n’a jamais été examinée par l’Assemblée nationale, visait à répondre à ces questions.
Postérieurement, la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat a conduit une réflexion sur le statut de l’élu.
La dernière retouche à ce dispositif vient d’intervenir : c’est l’amélioration, dans la dernière loi de financement de la sécurité sociale, du régime de protection des élus locaux.
Pour nos collègues Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, ainsi qu’ils viennent de le rappeler, il s’agit, dans la mesure du possible, de prolonger raisonnablement le régime en vigueur en ciblant les dispositions les plus nécessaires pour endiguer le déclin des candidatures aux responsabilités locales et maintenir la vitalité et la diversité de la démocratie locale.
Le mandat électif ne constitue pas un métier, non plus que l’exercice de certaines fonctions exécutives une activité salariée. Ils ne relèvent donc pas du même régime de protection. Cependant, il est rapidement apparu nécessaire de tenir compte des conséquences, pour leur activité professionnelle, des contraintes auxquelles sont soumis ceux qui ont choisi de servir l’intérêt général par leur appartenance aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales. Cela relève d’ailleurs d’un impératif démocratique de permettre à chacun, quels que soient ses revenus, de déclarer sa candidature aux élections locales.
Si le principe de gratuité des fonctions électives demeure affirmé par la loi, il a été aménagé par l’effet de la démocratisation du système électif. Aujourd’hui, la loi reconnaît aux élus le droit d’être remboursés des frais résultant de l’exercice du mandat et leur ouvre la perception d’une indemnité correspondant à l’exercice effectif d’une fonction locale.
Le cadre financier d’exercice des mandats locaux réside tout à la fois dans la mise en place de garanties financières et le bénéfice d’une protection sociale. La dernière loi de financement de la sécurité sociale est intervenue pour prévoir l’affiliation des élus locaux percevant une indemnité de fonction au régime général de la sécurité sociale et l’assujettissement des indemnités de fonction à cotisation sociale, sous condition de seuil.
Parallèlement à ces garanties, le législateur a mis en place des mécanismes destinés à concilier mandat électif et activité professionnelle. Ces aménagements sont de deux ordres : des droits d’absence, tels que le congé électif, l’autorisation d’absence ou le crédit d’heures ; le droit à la suspension de l’activité professionnelle ouvert à certains titulaires de fonctions exécutives, complété, à l’expiration du mandat, par un droit à réintégration professionnelle dans le précédent emploi ou un emploi analogue, ou, après plusieurs mandats, une priorité de réembauche, pendant un an, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
Trois dispositifs visent à sécuriser la sortie du mandat : le droit à un stage de remise à niveau lors du retour dans l’entreprise ; le droit à une formation professionnelle et à un bilan de compétences ; l’allocation différentielle de fin de mandat pour ceux qui ont suspendu leur activité professionnelle pour exercer leurs fonctions. Le montant mensuel de l’allocation, qui est versée pendant six mois maximum et ne peut l’être qu’au titre d’un seul ancien mandat, est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle versée pour l’exercice effectif des fonctions électives et l’ensemble des ressources perçues à l’issue du mandat.
Les dispositions contenues dans cette proposition de loi sont ciblées et certaines figuraient déjà dans la proposition de loi de 2011, dont je vous ai déjà parlé.
La commission des lois a adopté, en la prolongeant, la démarche proposée par les deux auteurs de la proposition de loi, nos collègues et amis Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur. Celle-ci lui a paru de nature à traiter les causes d’une désaffection, déjà constatée, pour les fonctions électives : complexité croissante de la gestion locale, difficulté à concilier activité professionnelle et mandat électif, incertitude de l’avenir pour ceux qui ont abandonné leur métier pour mieux se consacrer à leur fonction publique.
C’est pourquoi, dans l’esprit qui a conduit à l’adoption de la proposition de loi de 2011 visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local, la commission des lois a adhéré aux mesures raisonnables et réalistes préconisées par les coauteurs de la proposition de loi. Ces dispositions pratiques visent essentiellement à tenir compte de la complexité croissante de la gestion locale et à favoriser l’entrée et le maintien au sein des assemblées délibérantes des élus salariés, trop souvent tiraillés entre leurs responsabilités locales et leurs obligations professionnelles.
Les améliorations proposées sont consensuelles. Je le répète, plusieurs d’entre elles ont été unanimement adoptées en 2011 ; d’autres ont été avancées par nos collègues Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet à l’issue de la réflexion qu’ils ont menée au sein de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
La commission des lois a cependant complété le dispositif proposé, d’une part, pour mieux protéger les élus et, d’autre part, pour élargir les modalités de leur formation.
Elle a tout d’abord complété le régime de formation des élus locaux, dont Antoine Lefèvre s’était occupé en son temps. Dans ce cadre, la commission a institué l’obligation, pour les membres des assemblées délibérantes ayant reçu délégation, de suivre une formation au cours de la première année de leur mandat. Cette mesure est destinée à faciliter l’exercice des responsabilités au sein de leur collectivité, alors que la gestion locale se caractérise par une complexité croissante.
Par ailleurs, les élus locaux auront la faculté de bénéficier d’un droit individuel à la formation, d’une durée annuelle de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Les droits ainsi constitués pourront aussi contribuer à la réinsertion professionnelle de l’élu à la fin de son mandat.
La commission a ensuite abaissé de 3 % à 2 % du montant total des indemnités de fonction le plancher du montant prévisionnel des dépenses de formation des élus, ce qui est vraiment raisonnable. Cette enveloppe lui est en effet apparue plus conforme aux contraintes budgétaires des collectivités locales, sans toutefois préjudicier à la nécessité de former les titulaires d’un mandat local et d’assurer l’effectivité du droit à la formation.
La commission a également accru les facilités offertes pour concilier exercice du mandat et activité professionnelle. À cette fin, elle a adopté plusieurs mesures destinées à renforcer les garanties existantes : elle a ainsi étendu le champ du bénéfice du congé électif aux candidats salariés des communes de 1 000 habitants au moins ; elle a institué un crédit d’heures pour les conseillers municipaux des communes dont la population est comprise entre 1 000 et 3 500 habitants ; elle a étendu le statut de salarié protégé aux maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, ainsi qu’aux présidents de conseil général et régional et à leurs vice-présidents ayant reçu délégation ; elle a complété les cas de suspension du décompte de la période de validité de la liste des lauréats à un concours de la fonction publique territoriale pour y intégrer les élus, le temps de leur mandat.
Enfin, la commission a souhaité clarifier le régime indemnitaire. C’est pourquoi elle a institué, au profit du budget de la collectivité à laquelle appartient l’élu concerné, le reversement de la part écrêtée au-delà du plafond fixé par la loi, en cas de cumul de rémunérations et d’indemnités.
Ce texte se résume à une série de petits pas, me direz-vous. Oui, il ne provoquera pas la révolution dans le Landerneau des élus, mais, progressivement, nous avançons, et c’est bien là l’essentiel !
Applaudissements sur de nombreuses travées.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, après avoir travaillé ensemble hier sur un sujet voisin, nous sommes appelés aujourd’hui à discuter de la deuxième proposition de loi directement issue des travaux des états généraux de la démocratie territoriale, texte qui est relatif aux conditions d’exercice des mandats locaux, manière pudique d’évoquer le « statut de l’élu ».
L’adoption de cette proposition de loi est une des conditions nécessaires de la vitalité démocratique de notre pays et du renforcement de l’engagement de ses citoyens. En prenant la parole sur ce texte au nom du Gouvernement, j’exprime le respect dû par l’État à ceux qui, chaque jour, consacrent leur énergie au service de l’intérêt général. Votre initiative, mesdames, messieurs les sénateurs, constitue également un bel hommage.
Qu’il s’agisse de services à la personne, d’équipements, de crèches, d’écoles, de routes, d’eau, d’énergie, de sports, de culture, du moindre feu rouge ou des plus petits travaux urbains, il n’est pas une parcelle de notre territoire qui n’ait en partie été façonnée par l’action patiente et souvent passionnée de nos élus locaux. Cette mission exige un sens de la proximité, au moment où le contact et le lien social font toute la différence entre une société impersonnelle et dématérialisée et celle où nous vivons.
Les fonctions d’élu demandent de la patience, des talents d’écoute et de conviction, ainsi que du courage, souvent, pour affronter les mécontentements – nous en parlons parfois entre nous. Elles demandent également de la ténacité pour supporter les contraintes d’un environnement normatif toujours plus complexe, situation que vous avez tenté d’améliorer, hier, en adoptant la proposition de loi portant création d’un conseil national chargé du contrôle et de la régulation des normes applicables aux collectivités locales.
Ces fonctions demandent aussi du temps et de l’énergie. Être élu, c’est en effet consacrer une partie de son temps et de sa volonté au service des autres. C’est un engagement total, parfois dévorant, une responsabilité lourde et que l’on paie souvent au prix fort, non seulement dans sa vie professionnelle, mais aussi personnelle, familiale et affective.
Ce choix, beaucoup de citoyens le font en conscience, par devoir, par conviction, par défi parfois, mais toujours sans savoir quelle récompense la démocratie réserve à leurs efforts. Car vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, la République, en la matière, n’est pas équitable et ne reconnaît pas à leur juste valeur la contribution et le mérite de ses serviteurs. Dans nombre de petites communes, les élus sont même bénévoles, au service des habitants jour et nuit, quels que soient les aléas de la vie de la collectivité. On a souvent cité en exemple le courage et le dévouement des élus locaux qui organisèrent les premiers secours au lendemain de la tempête de 1999 et, plus récemment, après le passage de Xynthia ou pendant les inondations dans le Sud-Est l’année dernière ? Or 80 % de ces élus ne perçoivent aujourd’hui aucune indemnité. Je ne parle pas non plus de l’absence, parfois totale, de formation ou de validation des acquis de l’expérience, comme l’a souligné à l’instant M. le rapporteur après les deux coauteurs de la proposition de loi. Et pourtant, ils ont accumulé une riche expérience !
Loin des clichés populistes, nous avons le devoir de dire à l’opinion publique que la précarité existe aussi chez les élus et qu’il n’est pas digne d’une République de faire preuve de si peu d’équité dans le traitement qu’elle accorde à ceux qui la servent. Nous avons le devoir de dire que la vie de l’élu n’est pas facile, qu’elle suppose des sacrifices, qu’elle ignore la sécurité ; aujourd’hui, seuls les plus favorisés de nos concitoyens peuvent se permettre d’affronter une telle situation sereinement.
Or le paradoxe est bien là ! Parmi nos élus, les plus nombreux sont aussi les plus mal protégés, ceux qui perdent des revenus en devenant maire de leur commune, ceux qui – permettez-moi cette expression populaire – « en sont de leur poche » ou ceux qui, n’étant pas fonctionnaires ou travaillant dans un secteur exposé, n’ont pas la garantie de retrouver leur emploi après leur mandat. Ils prennent malgré tout ce risque par engagement au service de la collectivité et parce qu’ils sont souvent motivés par une utopie personnelle, un rêve qu’ils veulent faire partager.
C’est cette forme d’engagement qu’il nous revient aujourd’hui de défendre, non pas pour lui attribuer un prix ou une récompense, mais simplement parce que la justice même nous y oblige, vous avez eu raison de le souligner.
Bien sûr, nous risquons toujours de nous heurter, dans cette entreprise, à une forme de scepticisme de l’opinion. Une enquête récente, qui vous a sans doute tous choqués, montre que les personnes interrogées considèrent, à hauteur de 82 %, que les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour leurs intérêts personnels et, à hauteur de 62 %, que « la plupart d’entre eux sont corrompus ». À nous de combattre ce genre d’opinion partagée !
Premiers témoins des dérèglements d’une société en proie à la montée des individualismes et des communautarismes, les élus, parce qu’ils incarnent l’autorité publique, sont aussi les premières cibles de la défiance de nos concitoyens. Dans une telle situation, quelle doit être notre ligne de conduite ?
Le Gouvernement a fait un choix clair : c’est à une refondation profonde de notre vie publique que les Français nous appellent. Parité, limitation du cumul des mandats, réforme territoriale, réforme du statut de l’élu : tous les projets du Gouvernement visent précisément à faire en sorte que le fait d’être élu ne soit plus ni un sacerdoce ni un métier – comme l’a dit avec raison Mme Gourault – et que cette mission soit plus facile d’accès pour les Français jeunes et les salariés.
Nous devons aux Français le changement ; vous aviez ouvert ce chantier il y a quelques années, monsieur le président de la commission des lois. M. le rapporteur en avait fait autant en déposant une proposition de loi. À partir de vos travaux et des positions que vous partagez avec vos collègues sénatrices et sénateurs, vous avez élaboré le texte actuel.
Nous devons aux Français l’exemplarité. Pour cela, nous devons nous acquitter d’un devoir d’explication et de pédagogie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez choisi d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat avant que ne soient discutées les autres réformes, portant sur la limitation du cumul des mandats – dont je sais qu’elle fait forcément l’unanimité… – ou encore sur la déontologie. Le Gouvernement respecte ce choix et, pour autant, il souhaite réaffirmer que toute avancée sur les conditions d’exercice des mandats ne peut se concevoir que comme le corollaire d’autres engagements pris devant nos concitoyens.
Tel est le sens du message que le Président de la République a adressé lors des états généraux de la démocratie territoriale : « […], c’est parce que l’exercice d’un mandat est une tâche noble et exigeante que les élus doivent avoir les moyens de remplir sereinement leur mission. C’est le sens du statut de l’élu. » Après avoir évoqué la limitation du cumul des mandats, il ajoutait : « J’estime qu’il s’agit d’une condition indispensable pour faciliter l’accès aux responsabilités locales des salariés du secteur privé et des jeunes. J’assume donc le renforcement des droits sociaux des élus et des moyens qui leur sont dévolus pour leur permettre de concilier vie professionnelle et exercice d’un mandat. Faute de quoi, on court le risque de connaître un affaiblissement de notre démocratie locale et un appauvrissement, s’il en était encore besoin, de la diversité de la représentation du pays. »
Le texte que vous proposez aujourd’hui à la discussion est le fruit des travaux conjoints du président de la commission des lois et de la présidente de la délégation aux collectivités territoriales. Je tiens à saluer la rapidité avec laquelle ils ont donné suite à la demande qui leur avait été adressée, à l’issue des états généraux de la démocratie territoriale, par le président du Sénat, Jean-Pierre Bel. Je salue également la célérité du rapporteur, et je vous prie de bien vouloir m’excuser, mesdames, messieurs les sénateurs, d’avoir déposé un peu tard les amendements du Gouvernement ; j’en suis la seule responsable.
Nous avons tous noté qu’une version assez proche de cette proposition de loi avait été votée en juin 2011 par votre assemblée, sur votre initiative, monsieur le rapporteur. Merci d’avoir bien voulu reprendre le flambeau que vous aviez été obligé de déposer à l’époque !
Nous avons pris connaissance des propositions de loi de MM. Peyronnet et Povinelli ainsi que celles des parlementaires de l’opposition ; elles contribueront sans nul doute à enrichir la discussion de ce jour.
Nous avons également lu le rapport de Jean-Claude Peyronnet et de Philippe Dallier paru il y a tout juste un an. En dignes héritiers de Marcel Debarge, ils ont aussi jeté les bases de ce travail collectif, ce dont je les remercie bien évidemment. Après un premier rapport en 1982, puis un second en 1988, la loi relative aux conditions d’exercice des mandats locaux du 3 février 1992 avait vu le jour. Aujourd’hui, vous franchissez un pas supplémentaire.
Largement amendé, puis voté à l’unanimité par la commission des lois la semaine dernière, le texte qui vous est soumis apporte des avancées fondamentales et innovantes. Je pense notamment à la suppression de la délibération visant à fixer l’indemnité pour les maires des communes de moins de 3 500 habitants. Il s’agit d’un vrai combat, car c’est de ce type de délibération que certains de nos collègues ont le plus souffert : victimes de campagnes de presse, ils ont parfois fini par renoncer à leur mandat – je parle sous le contrôle d’Odette Herviaux, qui a connu un tel cas. Nous devons à ces élus de rendre automatique la fixation de l’indemnité, mais je ne vois pas pourquoi nous devrions nous arrêter à 3 500 habitants. Il me semble en effet qu’il vaudrait mieux élargir cette innovation à l’ensemble des maires et faire en sorte que la délibération ne soit nécessaire qu’en cas de diminution de cette indemnité.
Vous avez voté la fin du reversement discrétionnaire de l’écrêtement ; c’est une mesure importante pour l’exigence d’exemplarité et de transparence qui nous anime tous. Voilà encore une scorie dont nous nous débarrasserons avec une satisfaction non dissimulée !
Vous avez aussi amélioré les conditions du droit au retour à l’emploi, le droit individuel à la formation, la formation obligatoire dans la première année de mandat et introduit le statut de salarié protégé. Ces améliorations sont considérables, même si je dois avouer qu’un droit de retour dans l’entreprise après deux mandats, soit douze ans d’absence, peut être difficile à mettre en œuvre dans les faits. Je rappelle cependant à ceux d’entre vous qui s’en inquiéteraient que des dispositions similaires existent en cas de longue maladie et que nous avons toujours trouvé collectivement des réponses à ces situations difficiles.
Le principe de la gratuité des fonctions électives sera maintenu, car l’indemnité compense les contraintes d’un engagement citoyen, il ne s’agit donc pas d’un salaire.
Désormais, les conditions d’accès à une retraite décente sont à portée de main. La retraite par rente a été ouverte à tous les élus lors du vote de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; le Gouvernement propose qu’elle devienne obligatoire pour tous. Cette mesure représente certes un coût pour les collectivités territoriales, mais, comme l’a rappelé le Président de la République devant les maires, il faut assumer ces dépenses, car elles sont nécessaires et justes. Il y va de la vitalité de notre démocratie !
Les élus reçoivent en ce moment leurs feuilles d’indemnités. Ils protestent – je le sais, je le lis, je l’entends, car ma messagerie est saturée ! – contre une baisse de revenu, consécutive aux dispositions votées dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013. C’est pourquoi le Gouvernement propose, dans l’attente d’une refonte complète des plafonds qui interviendra dans le prolongement de la fin du cumul des mandats, d’augmenter de 10 % les indemnités des maires des communes de 10 000 habitants à 100 000 habitants. Cette possibilité est offerte, nous verrons ce qui ressortira de la discussion.
Nous savons que le débat d’aujourd’hui n’est qu’une étape et que la navette parlementaire pourra fournir l’occasion de renforcer encore les dispositions de responsabilisation et de protection. Nous nous en tiendrons donc à un texte à parfaire, mais c’est déjà beaucoup, et c’est un beau signal.
Sécurisés par un accompagnement et un encadrement plus stricts, dégagés des risques juridiques auxquels ils sont trop souvent exposés, les élus pourront, grâce à votre texte, retrouver l’essentiel : la libre faculté de se consacrer à leur mandat et à leur mission.
La France a besoin d’élus libres et compétents, d’hommes et de femmes de tous horizons, animés par la passion du bien public et capables de créativité et d’initiatives. J’y vois l’une des clés de notre redressement. Il exige, au-delà du rassemblement de toutes les bonnes volontés, la mobilisation de toutes les compétences.
Demain plus qu’hier, il faudra attirer des entreprises, susciter leur création, leur faciliter la vie, porter la croissance, créer des emplois nouveaux. Les entreprises devront trouver une oreille attentive auprès de leurs élus locaux. Il faudra donc qu’ils aient du temps.
Demain plus qu’hier, il faudra innover dans l’accompagnement social des individus, à tous les moments de la vie, non seulement parce que c’est un devoir, mais aussi parce que c’est une source de richesse et de développement humain.
Demain plus qu’hier, nous aurons besoin d’élus animateurs, capables de faire vivre le « collectif » dans nos territoires, capables d’organiser des collaborations nouvelles entre tous les acteurs du service public.
Nous aurons besoin de territoires innovants et créatifs pour redonner toute sa place à la France. Cela supposera de reconnaître cette diversité de potentiels, de donner aux élus locaux les moyens de leur innovation. Tel sera l’objet du projet de loi de décentralisation et de rénovation de l’action publique que je prépare avec Anne-Marie Escoffier, mais rien ne se fera sans des élus motivés.
Au-delà des structures, nous aurons encore à parler vie professionnelle, vie familiale, vie, tout simplement. Faisons en sorte que, demain, les élus de notre République puissent accomplir la belle mission d’être élu local. Et vous avez raison, pour accomplir une belle mission, il faut la vivre dans la sérénité !
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, l’état d’esprit dans lequel le Gouvernement souhaite ouvrir cette discussion, en vous remerciant d’affronter les discours parfois trop faciles sur des élus qui ne seraient pas au service de l’intérêt général. Je veux également vous remercier pour les salariés du privé, pour les femmes et les hommes seuls qui élèvent des enfants, qui voudraient bien être élus, mais qui se posent la question de la fragilité à laquelle ils exposeraient leur famille en acceptant un mandat. Je vous remercie de leur dire qu’eux, comme les autres, ont le droit de servir l’intérêt général, d’être au service des autres.
Il y a déjà trente-deux ans, j’ai eu la grande chance, avec Alain Richard et d’autres, de rédiger un rapport pour ouvrir à tous la fonction d’élu local. Je pensais alors que ce ne serait jamais possible si le fait d’être élu signifiait la remise en cause de la sérénité personnelle ou de la vie familiale. Je vous remercie donc pour toutes celles et tous ceux qui pourront enfin se présenter aux élections locales, peut-être dès 2014.
Applaudissements.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, beaucoup de choses viennent d’être dites. J’en ai notamment entendu une essentielle, à savoir que les états généraux de la démocratie territoriale ont confirmé deux grandes attentes des élus locaux : réduire les normes, tâche à laquelle nous nous sommes attelés hier, et faciliter l’exercice du mandat local, ce à quoi nous nous employons aujourd'hui.
Je voudrais à mon tour féliciter les auteurs des propositions de loi, Jacqueline Gourault et Jean-Pierre Sueur, d’avoir travaillé aussi rapidement et aussi bien. Je remercie également Bernard Saugey de les avoir relayés efficacement.
Au fond, il y a un paradoxe du statut de l’élu local. La raison en est simple : ce statut existe. Il figure même dans le code général des collectivités territoriales. Sa création remonte à plus de vingt ans, à la loi de 1992. Renforcé en 1999, ce statut a été affermi en 2002. Ces textes couvrent à peu près tous les aspects de la vie d’un élu : avant l’élection, avec le congé électif, pendant l’exercice du mandat, notamment avec le crédit d’heures, et après le mandat pour accompagner une réinsertion professionnelle.
Pourtant, le paradoxe, c’est que ce statut semble être une sorte de fantôme : à chaque débat, il vient frapper à notre porte pour nous demander de l’aider à prendre un autre corps, une autre dimension, désireux d’exister davantage. Nous en connaissons la raison : les intéressés ont le sentiment qu’il n’existe pas de véritable statut de l’élu local. Ils nous répètent que si, leur mandat d’élu local est passionnant, il est également ingrat.
En fait, ce paradoxe cache une véritable crise de l’élu local, qui a de multiples causes. Celle-ci va bien au-delà des aspects matériels dont nous nous préoccupons aujourd'hui et se cristallise certainement dans le peu de reconnaissance dont l’élu local fait l’objet. Je voudrais donc à mon tour, après Mme la ministre, en dire un mot.
Je crois que la difficulté est existentielle : nos concitoyens ne prennent pas toute la mesure de la charge qui pèse sur un élu et celle-ci est d’autant plus lourde que la commune est petite. Pourtant, quand une catastrophe surgit, qui est présent sur le terrain ? Ce sont les élus ! Je peux en témoigner pour avoir vécu la tempête Klaus en Gironde ou comme rapporteur de la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia.
Quand une famille recherche un emploi, un logement, une aide ou parfois simplement de l’écoute, qui trouve-t-on auprès d’elle ? Eh bien, nous le savons tous : les élus ! Quand les quartiers s’embrasent, qui intervient comme médiateurs ? Ce sont également les élus !
Pourtant, ces élus, si sollicités, sont accusés tous les jours d’être trop nombreux, de coûter trop cher, de dépenser inutilement ou, pis, de s’arroger des privilèges, voire, parfois, de se livrer à la corruption ou à la concussion. Il suffit de lire les vagues de mails ou d’aller sur internet pour prendre toute la mesure des attaques.
Face à cette vague de démagogie ou d’ignorance dans notre pays, nous devons faire preuve de fermeté. Pour l’instant, nous, élus, de gauche, de droite ou du centre, nous restons trop passifs. Nous devons inlassablement expliquer, justifier, répéter. Bien entendu, nous ne pourrons le faire avec conviction et succès que si nous acceptons la transparence et le débat.
Devant ce déferlement d’erreurs ou de calomnies, j’ai envie de rédiger un opuscule qui s’intitulerait Défense et illustration des élus de la République. Dans cet ouvrage, je rappellerais que ces 500 000 élus locaux, ce demi-million d’élus, constituent le plus vaste service public dont bénéficie notre République ; un service public qui est présent jour et nuit sur tout le territoire, urbain comme rural, et ce pour un coût d’indemnités – je peux le dire pour l’avoir calculé – inférieur à 1, 2 % du budget de fonctionnement des collectivités. Ce coût, il est vrai, varie selon la nature de la collectivité.
Nous battre pour rétablir un certain nombre de vérités fait aussi partie de la défense de l’élu !
Le malaise a également des causes plus concrètes. Les élus souffrent depuis des années et des années de la faiblesse des moyens mis à leur disposition pour exercer les compétences qui leur ont été transférées.

Cela va mieux aujourd’hui, mais quel retard ! Qui a cassé le service public ? Nous en connaissons les auteurs !
Les lois de décentralisation ont permis à notre pays d’être mieux géré. C’est désormais sur les épaules des élus locaux que repose l’essentiel de l’investissement et de la solidarité. Ils l’assument, mais ils souhaiteraient que l’on en tire les conséquences en matière d’organisation territoriale, de financement public, de fonction publique, de simplification. Pour tout dire, ils demandent que l’État décentralise, sans remords législatif, sans regret financier, sans suspicion afin de mieux se concentrer sur ses fonctions régaliennes et l’aménagement du territoire.
Je crois que nous sommes prêts à renforcer la démocratie territoriale. Madame la ministre, nous savons le rôle qui est le vôtre dans ce travail.
Le Président de la République, lors de ses vœux aux parlementaires, …

… a rappelé qu’il proposerait une loi sur le cumul des mandats qui serait accompagnée d’un statut de l’élu local. En éclaireurs, Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault nous proposent aujourd’hui huit mesures d’amélioration immédiate.
À titre d’exemple, l’article 1er de la proposition de loi va permettre aux élus des plus petites communes – vous voulez étendre cette mesure, madame la ministre – de disposer d’indemnités sans qu’il y ait lieu à délibération.
Soyons sûrs de deux choses : la première, c’est que nous allons être critiqués, parce que l’automaticité des indemnités sera encore pointée comme une forme de copinage entre les parlementaires et les élus locaux ; la seconde, c’est que nous devons tenir bon, parce que, sur le fond, nous avons raison.
Dans les plus petites communes, certains maires – le chiffre avancé est de 20 %, soit un cinquième des maires, ce qui n’est pas rien ! – renoncent à leur indemnité, non pas, comme cela a été dit, parce que leur charge de travail est moindre ou parce qu’ils sont plus riches que d’autres, mais parce qu’ils ne s’imaginent pas prélever une indemnité sur le budget de leur commune. C’est donc au législateur qu’il revient de fixer les droits et les devoirs des élus locaux. C’est à nous d’assumer cette responsabilité.
De même, comment expliquer que, si vous êtes délégué dans une communauté urbaine ou une communauté d’agglomération, vous percevez une indemnité, laquelle vous est refusée si vous êtes délégué dans une communauté de communes ? La justice exige que nous alignions les dépenses des communautés de communes sur celles des autres collectivités. Encore faut-il préciser – le mot « dépenses » n’était pas très juste dans ma bouche – que nous allons le faire à enveloppe constante, c’est-à-dire sans dépense supplémentaire.
Ce même souci d’équité a conduit le groupe socialiste à proposer que les droits d’absence pendant la campagne électorale ou le crédit d’heures pour exercer un mandat bénéficient désormais aux élus des communes de 1 000 habitants au moins.
À l’inverse, j’ai proposé – je remercie la commission de l’avoir accepté – que l’on supprime ce pouvoir donné à certains parlementaires de redistribuer la partie d’indemnité qu’ils ne peuvent pas encaisser, c’est-à-dire le surplus de l’écrêtement.

Disons-le franchement, ce mécanisme archaïque me paraît étrange, voire choquant.

En effet, ladite somme n’appartient pas à l’individu qui ne la perçoit pas. Elle n’est pas entrée dans son patrimoine, elle doit donc être reversée au budget de la collectivité ou de l’institution.

Les élus locaux réclament davantage de soutien. Je voudrais quand même souligner que ce soutien existe parfois, mais qu’il n’est pas utilisé. Ainsi, l’allocation différentielle de fin de mandat, par exemple, permet à un élu de percevoir pendant six mois – la commission a porté ce délai à un an – une indemnité égale à 80 % de la différence entre le montant de son indemnité et le montant de ses nouvelles ressources. Observons – ce sont les dernières statistiques – que, de 2006 à 2010, cette allocation n’a bénéficié qu’à 117 élus, dont 80 ou 90 – j’ai oublié le chiffre exact – étaient des conseillers municipaux. Un effort d’information est donc nécessaire pour porter à la connaissance de nos élus les droits qui sont les leurs.
Il arrive cependant que des élus soient informés de leurs droits, mais ne les utilisent pas ; je pense notamment aux élus qui ont une activité salariée.
Il n’est pas toujours facile d’être à la fois élu local et salarié d’une entreprise. L’élu peut se voir exposé à des pressions pour le dissuader de prendre son congé électif ou son crédit d’heures afin d’exercer son mandat. Il peut même faire l’objet d’un licenciement. La solution à laquelle nous avons recouru, la généralisation du statut de salarié protégé à l’ensemble des élus, me paraît excellente. Cela signifie que, en cas de licenciement, l’employeur devra saisir l’inspection du travail, ainsi que le comité d’entreprise. Dans les faits, les élus auront davantage de droits.
Dans un arrêt du 4 avril 2012, rendu à l’occasion d’une procédure de licenciement, la Cour de cassation a précisé que le salarié protégé, et donc demain l’élu, doit pouvoir disposer d’un matériel téléphonique excluant l’interception de ses communications et l’identification de ses correspondants.
Par le biais de la notion de salarié protégé, c’est donc bien la vie personnelle de l’élu au sein de l’entreprise qui sera, demain, mieux protégée.
Je ne développerai pas de nouveau ce que vous avez dit excellemment, madame la ministre, sur les conséquences de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, laquelle aura effectivement un impact. D’un côté, la couverture sociale sera élargie, mais, de l’autre, corrélativement et automatiquement, les cotisations supplémentaires pèseront sur le pouvoir d’achat des élus, réduisant les indemnités à hauteur de 9 %, selon certaines estimations. Vous avez, sur ce point, d’ores et déjà apporté des réponses.
Je dirai, pour conclure, et cela fait l’objet d’un vaste débat entre nous, que nous ne pouvons pas réclamer des droits sans assumer en même temps des devoirs. Parmi ceux-ci, j’en citerai au moins deux.
Je crois que nous n’avons pas été assez loin dans la réflexion sur la notion de prévention des conflits d’intérêts, qui est pourtant essentielle si nous voulons assurer notre crédibilité auprès de l’opinion. Nous devons nous engager pour établir celle des élus locaux. Il s’agit d’un point tout à fait majeur.
Dès l’instant où nos concitoyens ont l’impression qu’il existe une sorte de confusion entre les activités et les intérêts, nous perdons toute crédibilité. Il nous faudra donc que nous nous engagions fermement à travailler sur cette question.
Le dernier point porte sur la compétence. Un fait m’a toujours étonné : si vous êtes, entre autres professions, médecin, expert-comptable, avocat ou artisan, vous avez une obligation de formation permanente. Si vous êtes élu, en revanche, par l’onction du suffrage universel, vous êtes réputé omniscient.

Du jour au lendemain, vous pouvez donc traiter d’urbanisme, de finances, de gestion du personnel, et j’en passe !

Je considère, pour ma part, que l’onction du suffrage universel n’est pas suffisante et qu’il convient de prévoir également une formation.

Je le dis avec d’autant plus de force que les statistiques publiées dans le rapport de Bernard Saugey font apparaître une réalité inquiétante : les dépenses de formation ont diminué depuis 2009 et sont aujourd’hui inférieures à 0, 7 % du montant des indemnités dans les communes.

Pourtant, la formation va de pair avec la décentralisation, et vice versa. C’est très important ! J’ai bien entendu votre remarque, monsieur Collombat ; or, sans formation, vous vous retrouvez en position d’infériorité face à vos propres services, aux services de l’État et à ceux des autres collectivités.

Sans formation, vous ne pouvez évidemment pas avoir les compétences suffisantes pour négocier et pour accomplir pleinement votre travail.

La proposition de Jean-Pierre Sueur visant à fixer un plancher de dépenses de formation, réduit de 3 % à 2 % par la commission, est excellente. Il me semble également nécessaire de prévoir une obligation pour la collectivité, dans les communes de plus de 3 500 habitants, d’assurer la formation des élus ayant reçu une délégation lors de la première année de mandat.
Madame la ministre, mes chers collègues, cela a été dit, ce texte ne constitue pas une révolution. On ne livrera jamais un « kit »du statut de l’élu, définitif et complet. Il se construit avec patience, même si nous souhaiterions que les choses aillent plus rapidement.

M. Alain Anziani. Il se construit en tenant compte de la décentralisation, des nouvelles générations de responsables politiques, de notre volonté d’assumer le coût de la démocratie, et donc du dialogue que nous devons entretenir avec l’opinion.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chacun en convient, les 550 000 élus locaux que compte notre pays sont un atout formidable pour notre démocratie, pour le lien social et pour le maintien d’un aménagement concerté du territoire. Aussi notre groupe, comme l’ensemble de la gauche, s’est-il toujours fixé l’objectif de mettre en place un statut de l’élu, afin de faire entrer dans notre droit positif un ensemble de mesures permettant la mise en œuvre de l’article 1er de notre Constitution, aux termes duquel la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.
Ce débat est particulièrement ouvert depuis les premières lois de décentralisation. On considérait alors que le statut de l’élu était un pilier indispensable à la mise en œuvre de ces lois et constituait une exigence démocratique. Or, trente ans après, il faut bien reconnaître que nos assemblées locales, communales, départementales et régionales sont loin d’être à l’image de notre société. Femmes, jeunes, citoyens issus de l’immigration, salariés du privé, ouvriers et employés sont, chacun le reconnaît, insuffisamment représentés. Quant au pluralisme, il est trop souvent absent.
Pour remédier à ces situations, il faut sans aucun doute revivifier le débat politique local et revoir nos modes de scrutin pour que chaque citoyen soit représenté dans toutes les assemblées de notre République.
Il faut aussi que nos élus soient respectés dans leur mission, qu’ils ne voient pas leurs compétences constamment rognées et leurs capacités d’interventions diminuées par des moyens financiers qui se dégradent d’année en année. Aussi, à la veille d’un nouvel acte de décentralisation, ouvrir le débat sur le statut de l’élu nous semble nécessaire. C’est pourquoi, lorsque le président Bel, au lendemain des états généraux de la démocratie territoriale, a fait part de sa volonté de faire adopter rapidement par le Sénat un texte sur le statut de l’élu, nous lui avons exprimé notre soutien.
Nous regrettons cependant, malgré l’intérêt des débats qui ont eu lieu en commission sur les amendements, que les groupes n’aient pas été réellement associés à la définition des objectifs d’un tel texte et que ses auteurs ne se soient pas davantage appuyés sur la commission et la délégation dont ils sont membres pour le rédiger. Cela étant dit, nous comprenons qu’ils se soient limités à quelques dimensions de la question, qu’ils aient cherché à régler des difficultés d’application de mesures déjà prises et à en élargir le champ d’affectation. Les conditions d’examen des propositions de loi ne permettent pas, on le sait, de faire des réformes de grande ampleur.
Aussi, avec ce texte, même limité, il nous semble que nous faisons œuvre utile. Nous ne devons pas refermer, pour autant, le dossier du statut de l’élu. Au contraire, à partir de la présente proposition de loi et des premiers débats qu’elle a suscités en commission, et compte tenu de l’actualité législative des prochains mois – je pense, en particulier, à la perspective de la nouvelle loi de décentralisation –, tout nous incite à aborder l’ensemble des problématiques qu’il nous faudra bien mettre à plat pour écrire un véritable statut de l’élu codifiant ses droits et ses devoirs.
Il ne s’agira pas, alors, de dresser seulement la liste des mesures qui permettront de faciliter l’exercice d’un mandat. Même si celles-ci devront y être introduites, l’objectif d’un tel statut sera avant tout de favoriser l’investissement de tous les citoyens au service de la collectivité, de sécuriser leur engagement, d’assurer la sauvegarde de leur vie personnelle, familiale et professionnelle, de conforter leur mission, de respecter leur mandat. Il faudra également redonner confiance à tous nos concitoyens en la loyauté des élus qui les représentent.
Pour permettre de telles avancées, ce statut, que nous appelons de nos vœux, devra non pas seulement concerner les membres des exécutifs, comme c’est souvent le cas actuellement, mais s’adresser également à tous les élus qui font, disons-le, la vraie richesse de notre démocratie.
Dans son rapport, notre collègue Saugey a rappelé, à grands traits, les différentes étapes des mesures prises pour faciliter l’exercice d’un mandat local. Avec pertinence, il a noté la concomitance de celles-ci avec des lois approfondissant les libertés locales et avec l’accroissement des compétences décentralisées.
Nous ne doutons pas, madame la ministre, qu’un chapitre de votre projet de loi de décentralisation sera consacré à ce sujet. Dans cette attente, soulignons les avancées et aussi les limites – il faut bien le reconnaître ! – du texte qui nous est soumis.
Comme le souligne le rapport de la commission, l’objectif des auteurs de la proposition de loi était de favoriser la mise en œuvre rapide de préconisations ciblées visant à améliorer les mesures qui permettent, aujourd’hui, de faciliter l’exercice d’un mandat local. Nous partageons leurs préoccupations. Aussi soutenons-nous les mesures qui tendent à harmoniser le niveau d’indemnisation des maires en le fixant de manière automatique dans l’ensemble des communes, quelle que soit leur taille. De même, nous approuvons l’attribution d’une indemnité de fonction aux membres de l’organe délibérant des communautés de communes ayant reçu délégation du président, comme cela était déjà le cas pour les communautés d’agglomération, les communautés urbaines et les métropoles.
Ces restrictions spécifiques appliquées aux plus petites communes ou aux formes d’intercommunalité les moins intégrées étaient, il faut bien le dire, pour le moins discriminantes. Cette harmonisation est donc la bienvenue. Nous apprécions, par ailleurs, la clarification portant sur la nature fiscale de l’indemnisation des frais d’emploi.
Le deuxième axe de cette proposition de loi vise à faciliter l’exercice d’un mandat par des salariés.
Nous ne pouvons que soutenir toute amélioration dans ce domaine, car les difficultés rencontrées par ces citoyens freinent fortement, et de façon certaine, leur engagement dans un mandat électif. Nous nous félicitons donc des propositions de la commission, qui a élargi le champ des mesures applicables dans ce domaine.
Cependant, chacun le sait, ces mesures sont d’une application souvent difficile.
Tout d’abord, cela tient au fait que de telles dispositions législatives relèvent pour l’essentiel du code général des collectivités territoriales, alors qu’il conviendrait qu’elles soient codifiées aussi dans le code du travail, qui est la seule référence juridique régissant les relations entre un salarié et son entreprise.
L’amendement que nous avons déposé sur cette question tend à introduire dans ce code, en l’élargissant, l’une des mesures proposées par la commission. Il s’agit aussi d’un amendement d’appel visant à obtenir du Gouvernement qu’il retienne un projet prévoyant systématiquement une double inscription de chacune des dispositions relatives au statut de l’élu salarié, à la fois dans le code général des collectivités territoriales et dans le code du travail.
Ensuite, nous le savons tous, si le code dit le droit, son application et son respect relèvent bien souvent des tribunaux. Il faut donc prendre toutes les mesures possibles visant au respect de l’engagement citoyen, afin que la République ne s’arrête plus à la porte des entreprises, comme c’est encore trop souvent le cas.
Enfin, pour ce qui concerne la formation des élus, si nous ne pouvons que souscrire à la mise en place d’un plancher prévisionnel de dépenses, nous ne comprenons pas pourquoi notre commission a réduit son montant de 3 % à 2 %. La proposition figurant dans le texte initial n’était pourtant pas excessive ; il ne s’agissait d’ailleurs que d’une prévision, et non d’une dépense obligatoire.
Cette proposition de diminution est à notre avis un mauvais signal, qui réduit l’importance de l’essor, pourtant nécessaire, qu’il conviendrait de donner à la formation des élus. Nous proposerons donc de rétablir la proposition initiale des auteurs du texte.
Sur cette question, vous me permettrez d’ouvrir un débat sur l’effectivité de ce droit à la formation des élus.
Compte tenu du coût des stages de formation et des moyens financiers limités dont disposent un grand nombre de nos communes, il est souvent difficile aux élus de solliciter une prise en charge. Ne faudrait-il pas réfléchir à une forme de mutualisation des dépenses de formation, afin de permettre à tout élu, quelles que soient la taille et la richesse de sa commune, d’avoir accès à une formation de qualité ?
Ce sujet mériterait une réflexion plus poussée, qui ne se limiterait ni à la fixation d’un plancher de dépenses ni même à celle d’un plafond, lequel, du fait de la modicité des indemnités versées, ne permet pas vraiment de mettre en œuvre cet effort de formation, dont nous sommes tous conscients qu’il est nécessaire.
Cette question est d’autant plus d’actualité que la commission a ajouté dans le texte un article 6 bis, que nous soutenons, visant à rendre obligatoire une offre de formation au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu délégation. Or cette mesure entraînera des dépenses, sans que soient assurées les ressources nécessaires dans nombre de communes. Sauf à considérer qu’une dotation spéciale sera versée aux communes pour faire face à cette obligation... Je crains que l’air du temps, qui est plutôt à la baisse des dotations, ne le permette pas !
Dans ce domaine, comme dans d’autres, l’effectivité de ce droit reste encore à construire.
La même question se pose à propos d’un autre droit, et fait l’objet de l’un de nos amendements. Il s’agit du droit à remboursement de frais engagés du fait de l’exercice d’un mandat électif. Il conviendrait à notre avis, sur ce point, d’adopter la même démarche que les auteurs du texte à propos de l’article 1er.
En effet, il est parfois difficile pour un élu salarié de demander à sa collectivité le remboursement d’heures durant lesquelles il a non pas travaillé, mais participé à une mission relevant de son mandat. Tel autre élu aura du mal à solliciter la prise en charge des heures de garde pour un parent malade dont il a la charge ou pour la nourrice s’occupant de ses enfants. Le code général des collectivités territoriales est pourtant clair : il peut demander le remboursement de ces frais. Or combien le font ? Et combien de communes disposent-elles des moyens financiers pour faire face à ce type de dépenses ?
Dans ce domaine, là encore, la question de la mutualisation des dépenses se pose, tout comme celle de son automaticité, et donc de l’effectivité de ce droit ouvert à tous les élus. Avancer dans ce sens permettrait, sans nul doute, de faciliter grandement l’exercice d’un mandat local.
En conclusion, si nous ne pouvons qu’exprimer notre accord avec l’ensemble des mesures contenues dans ce texte, nous regrettons tout de même la modicité de son objectif et craignons même qu’il puisse être interprété comme un ensemble d’avantages supplémentaires octroyés aux élus.
Les années de campagnes démagogiques visant à mettre en cause la compétence des élus, leur loyauté à l’égard de l’intérêt général et même leur honnêteté ont laissé des traces dans l’opinion publique, qui est aujourd’hui encore très inquiète.
Conduire une réforme globale et instituer un véritable statut de l’élu est plus que jamais nécessaire pour que chacun retrouve confiance.
Nous partageons cette préoccupation et espérons que cette nécessité sera prise en compte dans les futurs textes que nous soumettra le Gouvernement. Tel est le vœu que nous formulerons en adoptant cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC, du groupe socialiste et du groupe écologiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, simplification des normes et statut de l’élu : tels sont les deux sujets qui ont émergé des états généraux de la démocratie territoriale que nous avons organisés voilà quelques mois. Dans les deux cas, il faut bien l’avouer, il s’agit de problématiques récurrentes. Le nombre d’initiatives législatives qui ont été prises sur ces deux sujets démontre, s’il en était besoin, leur importance et leur persistance.
Pour ne parler que du statut de l’élu qui nous occupe aujourd’hui, le Sénat, représentant des collectivités territoriales, a toujours été porteur de projets de réformes importantes. Je citerai à mon tour, sans en rappeler le détail, l’excellente proposition de loi de nos collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx, que nous avons adoptée et dans laquelle figuraient des dispositions importantes.
Les travaux du Sénat avaient cependant commencé bien avant. Sans remonter plus loin, dès 2000, Michel Mercier présentait un rapport d’information sur les améliorations de nature à faciliter l’exercice des compétences locales. En 2001, sur proposition du rapporteur de la commission des lois, Jean-Paul Delevoye, le Sénat avait adopté une proposition de loi relative à la démocratie locale qui réformait en profondeur le statut de l’élu. La question n’est donc pas nouvelle !
Pour les deux propositions de loi que je viens d’évoquer, le résultat fut, hélas ! toujours le même : votées par le Sénat, elles n’ont jamais été inscrites à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Cette difficulté a été longuement évoquée en commission des lois mercredi dernier.
Alors que nous commençons nos travaux en séance publique, je souhaite que le président du Sénat, parce que le texte que nous examinons résulte des états généraux dont il a pris l’initiative, puisse s’assurer que cette proposition de loi sera examinée rapidement par nos collègues députés.

Mes chers collègues, le président Sueur s’est engagé devant la commission des lois à alerter le président Bel, et peut-être aussi son homologue de l'Assemblée nationale, à ce sujet ; je tenais à vous en faire part dans cet hémicycle au nom de mon groupe et, sans doute, de la plupart d'entre vous.

Toutefois, il faut bien le dire, une difficulté persiste : il faudrait un jour s’atteler à effectuer un travail véritablement complet. Je ne sous-estime pas le travail accompli par Bernard Saugey, Jacqueline Gourault, Jean-Pierre Sueur, Marie-Hélène Des Esgaulx et par de nombreux autres sénateurs de tous les groupes sur la question du statut de l'élu. Je veux simplement dire qu’il faudrait rassembler toutes les dispositions y afférentes, celles qui figurent dans le code général des collectivités territoriales et celles qui n’y sont pas, pour avoir une vision générale du sujet.
J'ai bien compris que telle n'était pas la méthode que l’on nous proposait aujourd'hui. Les deux auteurs de la proposition de loi n'ont pas l'ambition d’effectuer ce grand travail. Ce qu’ils nous proposent, c’est simplement, si j’ose dire, d'adopter des mesures consensuelles, des « petites » mesures – ce terme n’a rien de péjoratif – utiles et très attendues. Pour autant, ces dernières ne peuvent se substituer à la réforme globale et ambitieuse que de nombreux élus attendent.
Je me félicite que figurent dans le texte, à l’article 9 bis, des mesures concernant l'indemnité des maires des petites communes, issues d'une proposition de loi que Jacqueline Gourault et moi-même avions déposée il y a quelque temps.
Il en va de même pour les dispositions relatives à l'écrêtement. Chacun d’entre nous reconnaîtra que le mécanisme actuel de répartition de l'écrêtement n'est pas au-dessus de tout soupçon ; nos concitoyens ont du mal à le comprendre et à l’admettre.
Je me félicite aussi que diverses mesures concernent la formation des élus.
Soyons-en convaincus, nous n’aurons pas fait le tour de la question avec ce texte. C'est un lieu commun de le dire, le fossé se creuse entre les élus que nous sommes et nos concitoyens.
Ce fossé existait auparavant entre les élus nationaux et les citoyens. Nous estimions que cela n'était pas très grave, car il en allait ainsi depuis deux cents ans, et nous y étions habitués. Il y avait des hauts et des bas, mais, au moins, les maires étaient aimés et appréciés. Aujourd'hui, force est de constater que même ceux-ci, qui sont censés être les élus les plus proches de nos concitoyens, voient leurs compétences et leur autorité contestées ou incomprises.
Je ne prétends pas connaître toutes les raisons qui expliquent ce phénomène, mais je vais m’attacher, mes chers collègues, à vous en énumérer quelques-unes.
Je pense d’abord à la multiplicité des collectivités, pour ne pas dire à leur multiplication ! Lorsque nous avons créé les pays, par exemple, nous n’avons fait qu’ajouter davantage de confusion.
Je pense ensuite au manque de lisibilité du système pour nos concitoyens ainsi qu’à la difficulté d’identifier qui détient les compétences et quels sont le rôle et les responsabilités de chacun.
Je pense aussi à la concurrence exercée par d'autres modes d'expression de la démocratie, comme la presse ou les associations.
Je pense également à la multiplication des recours en justice, qu’ils soient introduits par des citoyens isolés ou par des associations créées pour les besoins de la cause. Vous le savez, les recours devant les juridictions administratives se multiplient. Des actions sont même engagées devant les tribunaux judiciaires, bien souvent à tort. Face à ces attitudes, le Conseil d'État, pour ne parler que de lui, serait bien inspiré de définir le cadre d’exercice de la démocratie locale en redonnant une définition claire et précise de la notion d'intérêt général, notamment pour rappeler que l’intérêt général n'est pas uniquement l’addition d'intérêts particuliers.
Je pense enfin à la question du recrutement. Il faut le dire clairement – certains l’ont d’ailleurs fait avant moi à cette tribune –, le vivier de candidats se rétrécit d'élection en élection. Il n'y aura bientôt plus que des fonctionnaires, d’anciens fonctionnaires ou des retraités et cette nouvelle espèce que l'on voit se développer – ce n’est pas une critique, il suffit de regarder les nouveaux députés issus du dernier renouvellement de l'Assemblée nationale –, je veux parler des anciens collaborateurs d'élus ou de cabinets, ainsi que des permanents des partis politiques. Le fossé entre les élus et nos concitoyens risque de se creuser encore un peu plus !
Je ne souhaite pas que, à l'occasion d'un éventuel élargissement du scrutin proportionnel au Sénat, le même phénomène observé lors des dernières élections législatives se reproduise ici.

Tous nos efforts de retouche législative, même s’ils sont aussi louables que ceux que nous faisons aujourd'hui, seront vains tant que nous n'aborderons pas les véritables questions : la pertinence du nombre de strates administratives, les compétences de chacune des collectivités et les responsabilités de chacun des élus, le nombre d'élus dans chaque strate, sans épargner le Parlement, …

… et, bien évidemment – ce n'est pas moi qui aborde cette question en premier –, le cumul des mandats.
Cet ensemble de questions forme un tout indissociable. Tant que nous n'aurons pas consacré suffisamment de temps à prendre les décisions qui s'imposent en matière de statut de l'élu, nous n'aurons pas vraiment fait avancer les choses.
Pour autant, il faut rester modeste et accepter d'apporter une petite pierre à l'édifice. La proposition de loi dont nous abordons l’examen est une heureuse synthèse de propositions formulées depuis longtemps par le Sénat. Le groupe UDI-UC la votera donc.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe du RDSE votera cette proposition de loi, émanant de sénateurs de diverses sensibilités, et pas seulement de gauche, parce qu'elle constitue un léger progrès. Or, comme l'a rappelé à juste titre Jacqueline Gourault, tout changement qui va dans le bon sens doit être adopté !

Ce texte constitue une avancée, mais il ne résout aucunement les problèmes fondamentaux que rencontrent les élus locaux, et nous sommes nombreux ici à l’être également. Ces derniers veulent que l’on simplifie et sécurise leur travail.
Mes chers collègues, il ne faudrait pas que cette proposition de loi ne soit qu’un faux nez, un mauvais alibi pour tenter de faire avaler le détestable projet du non-cumul des mandats
Rires sur les travées du RDSE, de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président de la commission des lois, je vous recommande, dans le numéro du 24 janvier 2013 de la revue Acteurs publics, la lecture de l’article intitulé « Un statut en échange du non-cumul des mandats ? »

Tout cela n'est pas innocent, cher Jean-Pierre Sueur. Vous l’avez rappelé, il y a une vingtaine d’années, vous présentiez déjà un texte sur le statut des élus. Vous êtes un zélateur du non-cumul, mais pas du non-renouvellement indéfini du même mandat…
Je vous le dis très amicalement, le présent texte me semble présenter une certaine onction jésuitique qui perturbe le radical que je suis.
Rires sur les travées du RDSE, de l’UMP et de l'UDI-UC.

Je crains que la discussion en séance publique de cette proposition de loi ne s’inscrive dans une programmation préméditée, qui ne nous trompe pas, destinée à nous faire « avaler » le non-cumul !

M. Jacques Mézard. Ce matin, sur RMC, vous déclariez d'ailleurs que le faible nombre de sénateurs présents en séance publique vendredi dernier était la conséquence du cumul des mandats, ce qui est faux. La preuve : j’y étais, et je suis resté jusqu'au bout !
Sourires sur les travées du RDSE.

M. Jacques Mézard. C’est l'ordre du jour qui en était la cause, et non le cumul des mandats !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées de l'UMP.

Cette proposition de loi, que vous nous présentez comme étant de nature à faire échec à la professionnalisation de la fonction d'élu, n'y changera pas grand-chose. C’est au contraire le non-cumul des mandats qui risque d’accélérer de manière dramatique le professionnalisme du Parlement, les fonctions de parlementaire étant progressivement réservées, par votre propre fait, à des apparatchiks formés et choisis par les appareils des partis !
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

Ce texte répond à une commande : c’était une nécessité politique que les états généraux de la démocratie territoriale débouchent sur un minimum de mesures concrètes. Pourtant, il ne satisfait pas les principales préoccupations exprimées par les élus locaux en réponse au très intéressant questionnaire qui nous avait été adressé.
J’en viens au contenu du texte.
Je note qu'il s'agit d'une proposition de loi. Elle ne tend donc pas à prévoir de dépenses nouvelles pour l'État. À défaut, l'article 40 aurait pu lui être opposé. Cela limite de manière drastique la façon dont est traitée la question du statut de l'élu.
S’agissant de la fixation au taux maximal de l'indemnité allouée aux maires de communes de moins de 3 500 habitants, vous savez que cette disposition ne reçoit pas l'assentiment de nombreux élus directement concernés. Une grande majorité des élus ayant répondu à l’enquête menée dans le cadre des états généraux de la démocratie territoriale ont répondu que c’est par civisme qu’ils ont choisi de se présenter au suffrage de leurs électeurs. Il ne faut pas l’oublier !

Ce n’est pas parce que l’on touche une indemnité que l’on est incivique !

Les autres dispositions de la proposition de loi reçoivent notre assentiment, mais elles ne changent pas fondamentalement la situation de nos élus. À cet égard, nous regrettons que vous ayez balayé d’un revers de main les justes propositions de notre collègue Pierre-Yves Collombat. Ce n’est pas avec un tel texte qu’il y aura moins de retraités et moins de fonctionnaires élus dans nos collectivités.
Nos élus locaux, que nous représentons, je le rappelle, en application de l’article 24 de la Constitution – tant que nous pourrons cumuler… –, méritent d’être protégés vis-à-vis de tant de recours, de tant de menaces judiciaires. Surtout, ils n’en peuvent plus de l’excès de bureaucratie, de la multiplication des circulaires, des arrêtés, des décrets et des lois.

Ils veulent pouvoir s’occuper de leurs concitoyens, de leurs projets d’avenir pour leur territoire, avec moins d’entraves, avec plus de confiance.
Mes chers collègues, tel est le message qu’il nous appartient de leur délivrer !
Applaudissements sur les travées du RDSE et de l’UMP, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons décidément des textes à hauts risques politiques en ce moment.
Entre le projet de loi relatif aux modes de scrutin dont nous avons discuté il y a quinze jours et l’examen du texte sur le statut de l’élu, il va falloir faire œuvre et surtout preuve de pédagogie afin que les citoyens comprennent la réalité du travail que nous effectuons. Au reste, c’est le seul moyen de déminer le « prêt-à-penser » actuel, lequel se traduit par la litanie des « tous pourris » et des « élus qui s’en mettent plein les poches », comme je l’ai encore entendu dans un taxi tout à l'heure.
De la même manière que l’on nous reproche de tripatouiller les modes de scrutin et les découpages électoraux, chaque fois que l’on touche au statut de l’élu, qu’il s’agisse de sa rémunération ou de sa protection sociale, nous sommes accusés de favoriser notre propre situation, à une époque où de nombreux citoyens de notre pays se trouvent dans une situation sociale et économique très difficile.
Mes chers collègues, j’espère que vous conviendrez avec moi que notre situation de sénateur ou de sénatrice n’est pas mauvaise. On pourrait même avouer que notre rémunération est confortable, surtout qu’une partie échappe à l’imposition de droit commun – il faudra d’ailleurs y revenir. Au demeurant, le cumul non seulement de mandats, mais aussi de fonctions et de rémunérations publiques permet d’obtenir, à la fin du mois, un « reste à vivre » plus que généreux.
Malheureusement, il n’en est pas de même pour l’ensemble de nos concitoyens et concitoyennes, ni pour la plupart des élus de France – ceux des petites communes –, qui ne touchent aucune rémunération.

De plus, pour ceux qui touchent un petit quelque chose, la notion d’indemnité non soumise à cotisation sociale créait une forte distorsion, en termes d’égalité, entre les petits et les grands élus.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a permis l’assujettissement aux cotisations sociales de l’ensemble des élus indemnisés, y compris pour le volet relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ce qui est logique, puisqu’un élu au service de sa commune peut, malheureusement, comme tout le monde, être victime d’un accident dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il doit donc bénéficier d’une couverture sociale complète. Le seuil retenu est pertinent, puisque, de fait, il exonère de cotisations les maires des petites communes, tout en leur offrant une couverture sociale complète, à l’instar de celle dont bénéficie n’importe quel salarié de notre pays.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui est issue des états généraux de la démocratie territoriale, et donc – normalement – de la base. Enfin, « issue » est vite dit, car nos élus des petites communes qui maillent le territoire de la République demandent certainement moins que ce que ce texte prévoit de leur attribuer. En effet, ils ne veulent pas apparaître comme intéressés, eux qui – comme nous d'ailleurs – œuvrent pour le bien de tous. Ils ne veulent pas grever les finances de leurs communes, que l’indemnité d’élu pourrait déséquilibrer. Ils réclament plus d’information, plus de formation, ce que la loi peut leur assurer, mais aussi plus de considération et de reconnaissance, ce que la République doit leur assurer, mais dont nos concitoyens et concitoyennes sont souvent avares.
Au-delà des avancées indemnitaires certaines, l’objectif des auteurs de la proposition de loi est de faciliter les passerelles entre les activités d’élu et les autres activités publiques ou privées. Eh oui, l’instauration d’un statut de l’élu local qui assure une protection sociale facilitant l’entrée et la sortie du mandat est un corollaire indispensable du non-cumul des mandats et des fonctions, aussi bien du cumul « instantané » que du cumul dans le temps.
En cela, nous, écologistes, apporterons un soutien fort et constructif à notre Président et à son gouvernement, afin de les aider à établir des règles claires et ambitieuses de nature à permettre un renouvellement plus rapide et plus fluide de nos élus.
De plus, nous devons faciliter l’accès de nos concitoyens aux fonctions électives et à la connaissance de la réalité de ces dernières, afin qu’ils ne soient pas obligés d’hypothéquer leur avenir professionnel ou personnel. De telles mesures permettront de lutter contre la professionnalisation de la politique et de favoriser l’appropriation par les citoyens des structures institutionnelles.
En outre, à observer la composition de nos assemblées parlementaires, on se rend compte qu’un mandat de député ou de sénateur constitue souvent l’aboutissement d’une carrière des honneurs digne de la République romaine.
Nous constatons une surreprésentation des fonctionnaires et des professions libérales…

… – j’exerce moi-même une profession libérale –, qui ne traduit pas la composition de la population française. C’est là un problème majeur pour notre démocratie, qui, finalement, n’est pas si représentative que cela.
Les écologistes vous proposeront donc un certain nombre d’amendements auxquels vous ne pourrez qu’être sensibles.
Aujourd'hui, nous vous épargnerons les impératifs de parité et leur traduction dans les lois que nous rédigeons : nous avons déjà longuement débattu hier de ce problème, sans obtenir de résultats. Pourtant, les sénatrices étaient nombreuses en séance ! À ce sujet, je tiens à rappeler que la commission des lois produira prochainement une réflexion de fond sur la féminisation du langage juridique.
Je ne voudrais pas verser dans la flagornerie, mais j’estime que les maires des petites communes sont les élus qui travaillent le plus, car ils n’ont à leur disposition que de petits services municipaux – quand ils en ont. La charge de travail qu’ils assument, tant en matière d’organisation que sur le terrain, exige qu’ils soient indemnisés, y compris dans le cas où le conseil municipal serait tenté de faire pression sur eux pour qu’ils y renoncent ou dans celui où ils se contraindraient à y renoncer de leur propre chef. À cet égard, espérons que l’utilisation du présent de l’indicatif dans la rédaction de notre texte – comme il se doit – soit bien comprise par tous comme étant l’indication d’un impératif ! En effet, l’élection ne doit pas être un sacerdoce.
Certains de nos amendements n’ont malheureusement pas passé le filtre de l’article 40 de la Constitution, ce que je regrette. Au reste, à partir du moment où la proposition de loi est indéfiniment gagée sur le tabac – vaste détournement de l’article 40 s’il en est ! – et où les amendements ne touchent pas à ce dernier article, il est difficile de comprendre pourquoi l’article 40 serait un couperet a priori, avant même que le Gouvernement ait levé le gage... Mais les subtilités de la loi originelle de la Ve République ont peut-être vocation à brider l’imagination des parlementaires et, par là même, à leur donner envie de cumuler leur mandat avec un mandat local, pour lequel le couperet digne de Guillotin de l’article 40 ne constitue pas une épée de Damoclès…
Sourires.

Dans ces conditions, nous n’avons pas pu discuter de l’indemnisation des élus qui bénéficient de crédits d’heures, non payés par leur entreprise, pour exercer leur mandat.
Il faudra un jour mener une réflexion de fond sur l’application de l’article 40 de la Constitution, lequel est, certes, un garde-fou nécessaire mais dont l’application semble parfois discrétionnaire. Ainsi, il serait souhaitable que chaque amendement non examiné en séance soit publié sur le site du Sénat, accompagné des explications concernant son irrecevabilité. C’est une exigence de transparence et de lisibilité de l’action parlementaire que nous devons à nos concitoyens.
Bref, cette proposition de loi n’est qu’un début. Nous devons continuer le combat pour un véritable statut de l’élu, notamment un statut de l’élu de l’opposition.
Gageons que le Gouvernement nous entende et qu’il propose lui-même certaines dispositions que nous n’avons pu introduire !
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste . – M. le président de la commission des lois applaudit également.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les 4 et 5 octobre dernier, nous avons accueilli, ici même et à la Sorbonne, les états généraux de la démocratie territoriale, auxquels nous avons participé et pour lesquels nous nous sommes tous mobilisés, dans nos départements respectifs.

Lors de cette rencontre avec les élus locaux, un atelier était consacré à l’approfondissement de la démocratie territoriale. Il a été l’occasion d’évoquer des thèmes relatifs aux conditions d’exercice du mandat local, notamment la question du statut de l’élu. Ce sujet, nous nous en étions saisis dès le début de l’année, dans le cadre du rapport de nos collègues Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet intitulé Faciliter l’exercice des mandats locaux : réflexions autour du statut de l’élu.
Lors des états généraux, les échanges ont mis en lumière l’importance des préoccupations relatives à la formation des élus locaux. Oui, nos élus ont un grand besoin de formation, et ils l’ont exprimé très clairement, que ce soit lors des rencontres départementales ou au Sénat ! C’est donc sur ce volet de la proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui que j’insisterai tout d’abord.
En effet, chargé par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation d’un rapport sur la formation des responsables locaux, je me réjouis que certaines des recommandations que j’ai présentées à ce titre en octobre dernier aient été reprises par notre rapporteur.
Plus largement, c’est la formation de tous les responsables publics – non seulement des élus, mais aussi des fonctionnaires territoriaux – qui est aujourd’hui un enjeu majeur dans nos territoires, nos concitoyens devenant de plus en plus exigeants sur les compétences que ces acteurs doivent posséder dans l’exercice de leurs missions.
La démocratie représentative implique que chaque citoyen puisse, à travers des élections libres, être élu.
Toutefois, cet idéal démocratique ne doit pas occulter le fait que la conduite des affaires publiques nécessite aujourd’hui de larges compétences. Vous le constatez tous les jours dans vos territoires, la gestion d’une collectivité territoriale ne s’improvise pas. Ainsi que Jean-Pierre Sueur l’a rappelé, l’exercice d’un mandat, dans une commune, une intercommunalité, un département ou une région requiert bien des compétences, et des connaissances de plus en plus pointues.
Le mandat local s’est complexifié, car les compétences des collectivités territoriales s’inscrivent elles-mêmes dans un environnement juridique et technique extrêmement complexe. Désormais, les élus locaux doivent disposer des connaissances suffisantes pour leur permettre de prendre les bonnes décisions et, s’ils exerçaient initialement une fonction représentative, ils deviennent désormais de véritables gestionnaires.
Au-delà, le « droit à la formation » est une condition de la démocratisation de l’accès aux fonctions politiques. En effet, en compensant les inégalités de formation initiale, la formation permet de ne pas laisser aux « clercs » et aux savants professionnels des affaires publiques le monopole des mandats électifs.

En se formant, d’autres catégories socioprofessionnelles peuvent s’imposer dans la compétition électorale. Ainsi, la mise en place d’un véritable statut de l’élu doit notamment permettre d’éviter que certaines professions ne monopolisent les fonctions électives.
Aujourd’hui, le droit individuel à la formation des élus est reconnu par la loi. Le droit à la formation est validé si la formation que souhaite suivre l’élu est dispensée par un organisme agréé. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité locale, laquelle doit avoir expressément délibéré sur le montant de la ligne budgétaire concernée.
Lors des auditions que j’ai menées dans le cadre de mon rapport, j’ai pu constater qu’il n’était pas rare que des élus minoritaires aient du mal à obtenir les crédits relatifs au droit à la formation et qu’ils soient même obligés de prendre à leur charge personnelle les frais de formation. Cela n’est pas acceptable.
La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a renforcé ce droit à la formation, puisqu’une délibération des assemblées locales devient obligatoire en début de mandature afin de fixer les orientations de la formation et de déterminer l’utilisation des crédits. Malheureusement, ce droit reste encore trop peu mis en œuvre par les élus.
Le montant maximum des dépenses de formation votées au budget de la collectivité ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction que peuvent percevoir les élus de cette collectivité. En réalité, on observe, là encore, une sous-consommation des crédits potentiellement disponibles.
C’est pourquoi l’instauration d’un plancher minimum de crédits budgétaires consacrés à la formation des élus locaux, égal à 2 % du montant des indemnités pouvant être allouées aux élus de la collectivité, accompagné de la mise en place d’un dispositif de report des crédits de formation non dépensés d’un exercice budgétaire à un autre jusqu’à la fin du mandat en cours, satisfait les propositions que j’ai formulées au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Le texte va même plus loin, en prévoyant une augmentation du pourcentage minimum de dépenses consacrées à la formation, que j’avais proposé de fixer à 1 % et que le rapporteur, Bernard Saugey, a évoqué avec précision tout à l'heure.
Ainsi, dans les petites communes, où les sommes consacrées à la formation sont souvent modestes, leur addition sur plusieurs années permettrait de financer une action de formation pour l’ensemble des élus. La limite du mandat en cours permet de ne pas engager l’assemblée délibérante issue des élections suivantes.
Je me félicite aussi du contenu de l’article 5, relatif à la valorisation des acquis de l’expérience professionnelle.
Bien sûr, rien n’interdit aux élus locaux qui le souhaitent de valoriser l’expérience acquise au cours de leur mandat ou encore d’établir un bilan de compétences. Mais il s’agit d’initiatives personnelles, engagées dans la perspective d’un projet professionnel et ne pouvant être prises en charge par le budget de la collectivité puisqu’elles ne sont pas en lien direct avec l’exercice du mandat local.
Vous le savez, la question de l’après-mandat est une préoccupation récurrente des élus locaux. À l’évidence, la réinsertion professionnelle des élus sur le marché du travail est inextricablement liée à la formation. Des formations diplômantes existent aujourd’hui, qui constituent une solution à privilégier pour favoriser la sortie du mandat. Elles méritent d’être développées et mieux appréhendées par les élus locaux.
C'est pourquoi j'ai proposé la création d'un organisme collecteur national, au travers duquel les élus pourraient financer directement leurs formations diplômantes dans le cadre d'un « droit individuel à la formation », sur le modèle de celui qui existe pour les salariés du privé. Il s’agirait de créer un « 1 % formation », alimenté par une cotisation obligatoire des élus et exclusivement destiné à financer des formations en vue de la réinsertion professionnelle.
Cette mesure présenterait l'avantage, d'une part, d’instaurer une mutualisation entre élus – quel que soit le nombre de mandats – et, d'autre part, de bien distinguer ce qui relève de la formation dans le cadre de l'exercice du mandat et ce qui relève de la formation personnelle de l'élu pour sa réinsertion professionnelle.
Cette recommandation de mon rapport, que j'ai soumise à la commission des lois via un amendement, a été retenue puis intégrée au rapport de notre collègue Saugey ; je tiens à l’en remercier.
Aujourd'hui, le droit à la formation s'exerce spontanément, sur la base du volontariat, le principe étant la liberté de choix pour l'élu local.
Parfois, j'entends parler d'« obligation de formation ». Pour ma part, je reste convaincu qu'il convient, en la matière, de préserver la liberté de l'élu local, ce qui va à l’encontre de ce que propose notre collègue Alain Anziani, qui préconise, lui, de rendre cette formation obligatoire.
Si la formation des élus locaux doit reposer sur le principe du volontariat, en revanche, pour que la demande potentielle soit clairement cernée, il faut que l’on dispose d’informations sur le niveau actuel de formation des élus locaux. Or aucune étude précise ne permet aujourd'hui d'évaluer le « profil sociologique » des titulaires de mandats locaux, qu’il s’agisse de leurs diplômes, des formations qu’ils ont pu suivre ou des acquis de leur expérience professionnelle. De telles statistiques seraient pourtant précieuses, car elles permettraient de mieux identifier les besoins et, ainsi, de mieux structurer l'offre de formation.
C'est ce qui m’avait conduit à proposer de missionner le ministère de l'intérieur pour constituer un groupe de travail – éventuellement piloté par le CNFEL, le Conseil national de la formation des élus locaux – qui serait chargé de conduire une étude sur le profil sociologique des élus locaux. Mais cet amendement, considéré comme superflu, n'a pas été retenu, ce que je regrette.
J'en viens à la couverture sociale des maires. Des amendements que j’avais déposés sur ce point ont été déclarés irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution : ainsi, je n’ai pas été en mesure de proposer d’améliorer le régime de retraite des élus locaux ayant cessé leur activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leur mandat. Certains de mes collègues qui avaient rédigé des amendements similaires ont, semble-t-il, subi la même sanction…
Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a apporté des améliorations à cet égard, tous les élus ne peuvent pas encore acquérir de droits à pension auprès du régime de retraite par rente spécialement constitué en faveur des conseillers municipaux, généraux et régionaux – il s’agit des dispositifs FONPEL, le fonds de pension des élus locaux, et CAREL, la caisse de retraite des élus locaux. Or cette exclusion est d'autant plus injuste qu'elle s'applique à des élus ayant consenti d'importants sacrifices en se consacrant entièrement à leur mandat et en se dévouant ainsi au service de leurs concitoyens.
De plus, ces élus sont pénalisés en matière de retraite par le niveau généralement modeste des pensions servies, au titre de leur mandat, par le régime général de sécurité sociale – retraite de base – et par l'IRCANTEC.
Outre le respect de la plus élémentaire équité, la mesure que j'avais proposée présentait un double avantage. D’une part, elle améliorait le statut des élus locaux et contribuait ainsi à lutter contre la « crise des vocations » constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes. D’autre part, en affiliant des assurés supplémentaires au régime de retraite par rente des élus locaux, elle apportait à celui-ci de nouvelles recettes et confortait, par là même, sa situation financière.
Toutefois, je reste confiant, pensant que je pourrai un jour – peut-être lors du débat sur le prochain projet de loi sur les retraites – aborder à nouveau cet aspect de la retraite des élus locaux.
Pour l’heure, j’estime que la présente proposition de loi va dans le bon sens et je la voterai avec conviction, en attendant qu’elle soit utilement complétée. §
Nouveaux sourires.

Il arrive, malgré tout, que le fait de dire la vérité produise quelques effets…
Monsieur le président, je souhaite seulement informer mes collègues de la commission des lois, de manière qu’ils puissent prendre leurs dispositions, que je solliciterai une suspension de séance à la fin de la discussion générale, afin que nous nous réunissions pour examiner les amendements du Gouvernement.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Éric Doligé.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, je ferai d’abord remarquer que les deux coauteurs de la présente proposition de loi forment un vrai « binôme », tel qu’on les aime ! C’est même presque un couple infernal…

J’avais préparé une intervention, mais M. Mézard m’a soufflé à peu près tous mes arguments, si bien qu’il me faut la reprendre, au moins en partie.
Chacun sait que nous sommes réunis pour parler du statut de l’élu. J’avais donc prévu de retracer tout l’historique de cette problématique au cours des vingt dernières années, et même au-delà puisque la loi de 1982 relative aux droits et libertés des communes faisait déjà mention du statut de l’élu.
On l’a dit, la loi de 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a abordé les grandes questions dont nous discutons aujourd'hui.
Ce fut ensuite le texte élaboré par Bernard Saugey et de Marie-Hélène Des Esgaulx, qui visait « à renforcer l'attractivité et à faciliter l'exercice du mandat local ». Je vous rappelle que, avec cette proposition de loi, l’ambition était de sécuriser les parcours professionnels des élus locaux de proximité, de faciliter l'accès à la vie publique locale, d’accompagner le retour à une vie professionnelle « ordinaire ».
Un peu plus récemment encore, le rapport d'information de nos collègues Philippe Dallier et Jean-Claude Peyronnet abordait la facilitation de l’accès aux mandats électifs, le retour à l'emploi, le régime indemnitaire et de protection sociale des élus locaux.
À l’évidence, nous nous situons dans une continuité. C’est pourquoi je suis toujours assez surpris quand on m’explique que l’été dernier a vu la fin d’un ancien monde et que nous avons assisté, avec les états généraux de la démocratie territoriale, à l’avènement d’un nouveau… Ces états généraux marqueraient le début d’une nouvelle ère et ils nous auraient, par exemple, permis d’aborder hier quasiment pour la première fois la question des normes… Or nous en avions tout de même un peu débattu avant !

Il est vrai que, avant, nous avons été freinés dans notre élan lorsqu’il s’est agi de voter !
De même, le thème du statut de l’élu aurait éclos d’un seul coup à la suite des états généraux…
Je vous le dis amicalement, chers collègues de la partie gauche de l’hémicycle : vous l’avez bien senti, l’opposition est sincèrement prête à voter le texte – du moins suffira-t-il de peu pour qu’elle le fasse –, alors, s’il vous plaît, n’essayez pas de nous provoquer en nous disant qu’avant il n’y avait rien !

Autrement, nous pourrions manquer d’allant pour voter le texte.
Nous respectons toujours la majorité et, quand un texte est bon, nous savons le reconnaître. Bien sûr, quand un texte est moins bon, nous savons aussi le dire.
On a parlé également de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui contenait une disposition concernant les élus. J’aimerais toutefois qu’on s’explique un peu plus avant sur cette disposition, car j’entends beaucoup de responsables de collectivités se plaindre de ce qu’elle crée une surcharge considérable dont le financement n’était pas prévu dans leurs budgets.
Ainsi, pour la collectivité que je préside, 400 000 euros qui n’étaient pas prévus à l’origine sont à inscrire au budget, ce qui pose tout de même un certain nombre de problèmes. Et je ne suis pas certain que cette cotisation procure en contrepartie tant d’avantages que cela...
Bien entendu, le groupe UMP ne peut que se montrer favorable à une proposition de loi qui reprend, pour une large part, les grandes lignes des textes que j’ai cités toute à l’heure.
Notre seule réserve porte davantage sur la forme que sur le fond. En effet, nous regrettons que ce texte ne puisse pas s'inscrire dans une réflexion plus globale qui nous aurait conduits à nous pencher aussi sur le cumul des mandats ou sur les conflits d'intérêts, deux sujets dont la confrontation est d’ailleurs susceptible de donner lieu à une intéressante discussion : on peut en effet se demander s’il ne vaut pas mieux parler de l’un que de l’autre… Il me semble que, en définitive, la question du cumul des mandats pose plus de problèmes à gauche qu’à droite…
Quoi qu’il en soit, tous ces éléments auraient pu être introduits dans ce texte.
J’en arrive aux principales avancées de ce texte, qui ciblent les élus des petites collectivités.
L’article 1er prévoit ainsi la fixation à un taux maximal de l'indemnité allouée aux maires des communes de moins de 3 500 habitants.
L’article 2 s'inscrit dans la même logique puisqu'il révise favorablement les critères de définition des revenus pris en compte pour le versement d'une prestation sociale.
Toutes ces dispositions financières ne sont pas négligeables, mais elles ne constituent pas, à elles seules, le cœur du présent texte.
En effet, les changements les plus remarquables concernent la sécurisation économique et sociale des parcours de ces élus locaux – sécurisation évidemment relative. Plus précisément, il s'agit d'intégrer l'exercice de mandats locaux dans des parcours professionnels qui, de fait, sont segmentés par la prise de risque que constitue l'engagement politique local.
En d'autres termes, ces dispositions doivent permettre de lutter contre une trop grande professionnalisation des élus locaux.
À ce propos, il faudra que nous arrivions, dans un débat ultérieur, à savoir ce que recouvre cette expression de « professionnalisation des élus locaux ».

Je pense que chacun a, sur ce point complexe, sa propre analyse.
Ce texte procède d’une double démarche : il tend à faciliter à la fois l'entrée dans la vie publique en limitant les risques professionnels afférents à l'obtention d’un mandat et la sortie de la vie publique en assurant les reconversions.
Cette double exigence se matérialise avec les dispositions de l'article 3, qui abaisse de 20 000 à 10 000 habitants le seuil démographique des communes et communautés de communes concernées.
À cela doit être ajouté que le droit à réintégration professionnelle des élus bénéficiaires est maintenu jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs. De cette manière, le risque économique et social qui pesait sur ces élus de terrain se trouve amoindri.
Toutes ces mesures sont donc de nature à faciliter l'accès à la vie publique locale.
Personnellement, je pense qu’elles sont bienvenues. Mais je ne voudrais pas non plus qu’elles soient un leurre. Aujourd'hui, de moins en moins de membres de professions libérales, de chefs de petites entreprises, d’artisans et d’agriculteurs se lancent dans la politique et dans la gestion locale en raison des contraintes qu’elle entraîne, et nous voyons combien les fonctionnaires et les retraités sont nombreux dans nos structures locales, ce qui pose un véritable problème.
Ces dispositions ont été complétées par l'obligation de formation au cours de la première année de mandat, par l'extension du bénéfice du crédit d'heures et par l'extension du congé électif pour les salariés candidats dans les communes de plus de 1 000 habitants.
S’agissant du taux applicable pour la formation et du report sur cinq années, je m’interroge : ici encore, il faudra bien un jour définir ce qu’on entend par « formation des élus » et dire précisément à quoi doivent servir les moyens financiers qu’on y consacre, surtout s’il est possible de les reporter sur cinq ans.
En vérité, j’ai parfois le sentiment que la « formation des élus » ne sert pas toujours à la formation des élus !

Il est clair que, si l’on peut reporter les montants alloués pendant cinq ans, on finira par cumuler des sommes importantes qui permettront de financer autre chose que de la formation des élus… C’est donc une question à examiner de très près.

Je vous demanderai de conclure, mon cher collègue : vous avez déjà dépassé votre temps de parole de 50 % !

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, comme beaucoup d’entre nous, je me réjouis que notre assemblée examine aujourd’hui cette proposition de loi visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Jean-Pierre Sueur, Alain Anziani et Jacqueline Gourault l’ont rappelé à plusieurs reprises, ce texte a, dès sa conception, fait l’objet d’un large consensus, au moins dans son principe. Il est issu des attentes formulées lors des états généraux de la démocratie territoriale et, surtout, il s’inscrit dans la lente construction d’un édifice législatif destiné à bâtir un véritable statut de l’élu local. Il est donc une des étapes de cette construction.
Nous avançons pas à pas, a-t-on dit, depuis l’acte I de la décentralisation, depuis que les éléments modestes et disparates qui tenaient lieu de statut avant 1982 n’ont plus satisfait aux exigences nouvelles posées par les multiples et divers transferts de compétences.
À vrai dire, la feuille de route était fixée dès le rapport de Marcel Debarge, qui remonte à janvier 1982.

Néanmoins, il aura fallu attendre dix ans pour que cette ambition soit traduite juridiquement, avec la loi du 3 février 1992, relative aux conditions d’exercice des mandats locaux. Puis les lois du 12 juillet 1999 et du 27 février 2002, complétées par d’autres lois dans les dix dernières années, sont venues renforcer le dispositif et permettre l’exercice d’un mandat local dans un contexte plus favorable.
Cela constitue-t-il un véritable statut de l’élu ? Objectivement, la réponse est oui, mais, en même temps, cette notion est un mythe qui suscite beaucoup de fantasmes. On n’aura jamais un statut achevé qui pourra satisfaire tout le monde ; je souscris tout à fait aux propos d’Alain Anziani lorsqu’il a souligné ce paradoxe.
Mieux vaut donc se résoudre à accepter que cette notion est évolutive et qu’elle doit tenir compte de l’état de l’économie et des finances, ainsi que de l’état de l’opinion, toujours prête à stigmatiser les élus et leurs avantages prétendus.
Un grand pas serait franchi si nous réussissions à convaincre nos concitoyens que la démocratie a un coût. Nous avons là une démonstration courageuse à porter devant l’opinion.
Il ne s’agit pas seulement de répondre à des préoccupations matérielles – indemnités, couverture sociale, etc. Il s’agit de donner à la fonction d’élu toute l’attractivité qu’elle mérite en renforçant les garanties qui l’entourent. C’est par cette voie ambitieuse que nous ouvrirons vraiment l’exercice des mandats au renouvellement du personnel politique.
Comme l’a souligné M. le rapporteur, Philippe Dallier et moi-même avons été, au début de l’année 2012, les auteurs d’un rapport sur ce sujet, au nom de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Nous avons proposé divers aménagements, que j’évoquerai tout à l’heure. Dès l’introduction, nous posions une série de questions : je souhaite sincèrement qu’elles soient abordées au cours de la présente discussion.
Si, malgré les avancées législatives qui ont été opérées – et c’en est une nouvelle qui nous est proposée aujourd’hui –, persiste le sentiment d’un statut de l’élu inachevé, si, bien que nombre de sujets mis en exergue par Marcel Debarge aient reçu des réponses et que toutes les catégories d’élus locaux aient été concernées, demeure une insatisfaction, peut-être est-ce parce que la logique du statut ébauché depuis 1992 n’est plus susceptible de produire des effets. Peut-être est-ce d’un « changement de référentiel », comme on dit aujourd'hui, dans la manière d’aborder la problématique du statut de l’élu que notre démocratie a vraiment besoin.
C’est pourquoi, en dépit des craintes et des obstacles, dans la mesure où les attentes des élus locaux sont de plus en plus importantes, tout comme le sont les charges et responsabilités qui pèsent sur eux, imaginer un nouveau cadre pour le statut de l’élu devient indispensable, afin de leur permettre d’exercer dans les meilleures conditions leur mandat local.
Et nombre de questions se posent auxquelles il faudra bien répondre un jour. Faut-il maintenir le principe de la gratuité des mandats locaux ? Cela mérite d’être débattu. Doit-on préciser la définition juridique de l’indemnité ? Comment sécuriser le retour à l’emploi ? Comment améliorer le régime indemnitaire des élus locaux ? Doit-on faire d’un mandat un métier ? Nous sommes une large majorité, ici, à penser que non, mais au moins faudrait-il que nous en parlions.
Beaucoup de points restent donc à approfondir.
En attendant, le texte que nous examinons aujourd’hui prévoit des avancées : valorisation de l’indemnité de l’élu, droit à la suspension du contrat de travail et extension du droit à la réintégration professionnelle, perception de l’allocation différentielle de fin de mandat, formation et validation des acquis de l’expérience, etc.
Certaines de ces mesures ont été présentées dans le rapport que je viens de mentionner, et je tiens à remercier M. Sueur et Mme Gourault d’y avoir prêté attention.
Il s’agit notamment d’attribuer automatiquement et au taux maximal l’indemnité allouée aux maires dans les communes de moins de 3 500 habitants, d’exclure la fraction représentative des frais d’emploi des indemnités de fonction perçues par les élus locaux des revenus pris en compte pour le versement d’une prestation sociale sous conditions de ressources, d’accorder le bénéfice du crédit d’heures aux conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, d’abaisser de 20 000 à 10 000 habitants le seuil démographique des communes et communautés de communes à partir duquel les maires, les adjoints aux maires et les vice-présidents des intercommunalités bénéficient du droit à suspension du contrat de travail.

Dans le rapport précité, nous avons évoqué un autre sujet, tout aussi important : l’amélioration de l’assurance vieillesse des élus locaux. J’avais imaginé de déposer un amendement à ce sujet, mais j’y ai renoncé, car j’ai bien conscience que l’augmentation des cotisations, même si elle a pour objectif d’améliorer le futur montant des pensions, représente aujourd’hui une somme trop importante non seulement pour l’élu, mais également pour la collectivité.
On ne peut cependant occulter cette question, car le montant des pensions aujourd’hui perçues par les élus locaux au titre de leur mandat est souvent mis en avant pour dénoncer les insuffisances de la protection offerte par le statut, insuffisances soulignées par de nombreuses questions écrites au Gouvernement et par des propositions de loi ; j’en ai moi-même déposé une, au nom du groupe socialiste. Il faudra revenir sur cette question.
Avec le régime indemnitaire, la protection sociale constitue l’élément principal de la protection matérielle dont doivent bénéficier les élus locaux. Notre action en tant que législateur vise à faire en sorte que l’exercice d’un mandat local s’accompagne d’une protection suffisamment cohérente pour qu’elle ne se traduise pas par une dégradation de la situation des intéressés en matière d’assurance sociale.

Un pas significatif a été franchi grâce à la loi de financement de la sécurité sociale, avec les possibilités d’affiliation au régime général des élus indemnisés et l’ouverture de la retraite par rente en faveur de ces mêmes élus. Il est vrai que ces mesures ont un coût ; il est vrai aussi qu’elles représentent une garantie à la fois dans l’immédiat, pour la couverture sociale, et dans l’avenir, s'agissant des rentes : les élus devraient donc y adhérer.
J’avais souhaité déposer un certain nombre d’amendements qui avaient pour but de compléter cette disposition. Il s’agissait, d’une part, de rendre obligatoire l’adhésion au régime de retraite par rente pour les élus qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle et, d’autre part, de permettre aux élus qui cessent leur activité professionnelle d’adhérer au régime de retraite par rente, en sus du régime général et du régime complémentaire.
J’y ai renoncé, conscient du coût d’un tel prélèvement pour l’élu et pour la collectivité. Il faudra cependant, là aussi, que nous revenions sur cette question pour la faire avancer.

M. Jean-Claude Peyronnet. Mes chers collègues, depuis les états généraux de la démocratie territoriale, une expression a été employée à plusieurs reprises, celle de la « stratégie des petits pas » pour illustrer les différentes avancées législatives en matière de statut de l’élu. Le texte que nous sommes en train d’examiner en relève. Quand nous l’aurons voté, je l’espère, à une large majorité, et s’il prospère, comme je l’espère aussi, nous pourrons finalement dire que nous avons effectué un grand pas depuis 1992, constitué de la somme des petits pas successifs réalisés ces vingt dernières années.
Applaudissements sur diverses travées.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, aujourd'hui est presque un anniversaire puisque, le 18 janvier 2001, le Sénat adoptait un texte formidable, rapporté par Jean-Paul Delevoye, relatif au statut de l’élu. Hélas ! ce texte s’est perdu quelque part boulevard Saint-Germain… En tout cas, il n’est jamais revenu de l’Assemblée nationale ; mais on ne sait même pas s’il y est jamais arrivé ! C’est dommage, car il s’agissait d’un texte précis, clair, adapté, dont celui qui nous est proposé aujourd’hui n’est qu’une déclinaison.

Qu’on me permette de dire que Daniel Goulet, avec l’appui de Jean Arthuis, avait fait adopter en séance le rappel du principe du bénévolat de la fonction d’élu local. Il avait ensuite fait adopter un amendement tendant à calquer la protection des candidats aux élections locales sur celle des salariés protégés. C’est un point dont nous reparlerons plus tard.
Ce petit rappel historico-familial est la preuve qu’en douze ans nous avons progressé de façon morcelée – je n’irai pas jusqu’à dire, monsieur le rapporteur, que nous n’avons pas progressé.
Dans mon département, avec l’accord des deux députés socialistes et de l’excellent président du conseil général, Alain Lambert, nous n’avons pas organisé d’états généraux. Pourquoi ? Parce que les questions, nous les connaissons et que les réponses, nous ne les avions pas !
Alors, entre le texte sur la simplification des normes voté il y a quelques semaines à l’initiative de notre collègue Éric Doligé et le texte voté hier à l’initiative de Jacqueline Gourault et de l’excellent président Jean-Pierre Sueur, nous sommes incontestablement sur le bon chemin.
Je précise que la présente proposition de loi, très judicieusement, mentionne l’exercice, par les élus locaux, de « leur mandat », au singulier, ce qui est tout de même une excellente nouvelle !
Faciliter le mandat des élus locaux relève du même exploit que celui que nous avons commencé à réaliser hier s’agissant de la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales. Monstre du Loch Ness, Arlésienne ou serpent de mer, ces textes attendus se sont perdus dans des navettes improbables.
Alors que le millefeuille territorial comporte tant d’élus, nous n’avons toujours pas élaboré un vrai statut, domaine de prédilection d’un autre véhicule, d’un texte qui va venir… Bref, ce statut n’est toujours pas là et il est à craindre que nous ne soyons confrontés à une pénurie de candidats aux prochaines élections municipales.
Nous sommes, consciemment ou non, dans une spirale de professionnalisation. Ne nous complaisons-nous pas dans une sorte d’hypocrisie en continuant à proclamer le bénévolat quand des indices lourds et concordants donnent à penser qu’il y a bien une tendance à la professionnalisation des élus ? Sommes-nous les uns et les autres très honnêtes quand tel président de conseil général, par ailleurs sénateur, défend à cette tribune son quota de conseillers généraux et admet bien volontiers dans les couloirs qu’il en a dix de trop ?
Essayons donc d’être un peu réalistes !
Alors que la complexité ne fait que croître dans un mandat de plus en plus chronophage, beaucoup d’élus municipaux annoncent dès à présent qu’ils ne se représenteront pas en 2014. Dans les territoires ruraux, les élus suivent la courbe démographique de la population, qui vieillit. Il y a trop d’administrations et de moins en moins de marge de manœuvre dans les communes phagocytées par des intercommunalités où la gouvernance est plus ou moins démocratique.
Je voudrais profiter de cette intervention pour vous dire que la mise en place des nouvelles intercommunalités, parfois contre l’avis des élus, est un mauvais signal pour les élus locaux, même si chacun a conscience de la nécessité de rationaliser les périmètres.
J’ai déposé une proposition de loi tendant à donner plus de pouvoirs aux préfets pour régler les conflits au niveau des intercommunalités. C’est un texte modeste.
Monsieur le président de la commission des lois, nous avions évoqué à plusieurs reprises, lors de l’examen du texte qui a enterré – à bon escient – le conseiller territorial, …

… la création d’une structure qui devait régler les problèmes dans les intercommunalités. Alain Richard, en tant que rapporteur, en était convenu. Pour maintenir le moral de nos élus, il est extrêmement important, les EPCI n’étant pas des collectivités territoriales, que nous donnions au préfet les outils nécessaires pour régler les conflits.
Je crois, madame le ministre, mes chers collègues, que l’argent n’est pas la motivation de nos élus territoriaux. Ce qu’il leur faut, c’est de la considération !

Mme Nathalie Goulet. Les élus locaux ne doivent pas se sentir menacés par un parent d’élève mécontent, une responsabilité pénale écrasante, des contraintes de temps de plus en plus lourdes, une réduction de leur marge d’action faute de budget, des déboires et des conflits absolument kafkaïens au sujet des permis de construire dans les communes rurales.
M. Robert Tropeano acquiesce.

Croyez-vous raisonnable d’instaurer une obligation de formation dans les petites communes ? Ce sera une contrainte de plus, dont l’utilité reste à prouver et qui pourrait être interprétée comme un signe de défiance à l’égard des élus locaux.
Reste les questions du cumul des mandats, des rémunérations, de l’écrêtement et de la responsabilité. Le statut de l’élu est à construire, et nous le faisons aujourd’hui pas à pas.
Nos territoires sont animés par des élus généreux et talentueux. Ils ont besoin de trouver un nouveau souffle et les élus doivent se sentir défendus, au Sénat plus qu’ailleurs. Nous n’avons pas le droit de les décevoir. Ils n’ont que trop attendu un vrai statut, et nous le leur devons. Selon la formule consacrée, madame la ministre, vous n’aurez pas trop de quatre ans pour mettre en place ce statut et vous aurez, dans cette tâche, mon entier soutien !
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et du RDSE, ainsi que sur quelques travées de l'UMP, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant la discussion générale, j’avais un doute quant à l’interprétation qu’il convenait de faire du dépôt de cette proposition de loi et de son inscription, à cette date, à l’ordre du jour de nos travaux.
Ce texte constituait-il une mise en bouche avant le projet de loi créant le statut de l’élu local, unanimement réclamé lors des états généraux de la démocratie territoriale et annoncé par le Président de la République – l’expression figure bien dans ses déclarations – pour le printemps 2013 ?
Mais alors, pourquoi ce texte a minima, dont les dispositions auraient pu sans peine trouver leur place dans le futur projet gouvernemental censé venir prochainement, du moins l’espérais-je, en discussion ? Ce que j’ai entendu jusqu’à présent m’a permis de comprendre : la présente proposition de loi n’est en rien un préliminaire, c’est le texte tant attendu et si précisément annoncé… Il fallait oser ; c’est fait !
Les premiers concernés, les élus des petites collectivités – les autres vivent très bien sans –, n’auront pas besoin d’un tableau pour s’apercevoir que « ceci n’est pas un statut de l’élu », qu’il s’agit seulement de l’ixième retouche du dispositif pratique mis en place au fil du temps pour faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, comme l’indique clairement le titre de la proposition de loi. Certes, ces mesures sont utiles et le texte fera, à n’en pas douter, l’objet d’un vote consensuel, mais il ne met pas en place un statut de l’élu territorial.
Présente dans le rapport du sénateur Debarge, quelques semaines avant la publication de la loi fondatrice de la nouvelle décentralisation de mars 1982, l’idée de statut de l’élu territorial continue de faire peur et le mot demeure un gros mot, y compris dans cette enceinte.
C’est ainsi que, depuis trente ans, on tourne autour et on atermoie.
Permettez-moi de vous citer un morceau choisi que j’affectionne particulièrement. Il s’agit d’une déclaration d’un ancien président de l’Association des maires de France, par ailleurs alors président de la région Île-de-France, Michel Giraud : « Je ne suis pas convaincu que le terme de statut de l’élu local soit le bon. Qui dit statut, dit fonctionnarisation. Or je considère comme essentiel que l’on préserve la gratuité, ce qui contribue pour une large part à la grandeur du mandat électif local. C’est pour cela que je parle de règle du jeu. En dehors des grandes villes, je suis contre le statut de l’élu local à temps complet. Il faut qu’il y ait une part de disponibilité, de générosité, de gratuité. Et le terme de statut me gêne. »
Il est vrai que, lorsqu’il évoquait la « grandeur du mandat électif local», l’intéressé savait de quoi il parlait !
Pour le reste, si j’en crois ce que j’ai entendu, il semblerait qu’il ne soit pas le seul à être « contre le statut de l’élu local à temps complet ».
Vingt ans plus tard, le code général des collectivités territoriales ne contient toujours qu’un ensemble de « dispositions relatives aux conditions d’exercice » des divers mandats locaux, et la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise vise simplement à « faciliter » l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat.
Visiblement, couvrir les élus locaux de fleurs – on en a eu de multiples exemples – tiendra visiblement lieu de statut !
Pourquoi est-ce insuffisant ? Pourquoi faut-il enfin franchir le pas et oser créer un authentique statut de l’élu territorial, comme nous le proposons ?
D’abord, parce que ce serait prendre – enfin ! – notre Constitution au sérieux, puisque celle-ci donne un fondement politique aux institutions locales. Je rappelle que, selon ses termes, l’« organisation » de la France est « décentralisée », que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon », qu’elles « s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».
Les collectivités territoriales sont donc loin d’être des institutions destinées à donner un vernis démocratique à une administration d’État centralisée et à offrir un passe-temps à des notables trouvant là des occasions de mériter leurs décorations.
Prendre au sérieux l’idée de décentralisation, c’est tout d’abord reconnaître symboliquement l’importance de la mission de ceux qui lui donnent vie.
Nous sommes loin, contrairement à ce que prévoit l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, de fonctions gratuites. Le moment est donc venu d’en finir avec cet article et de sortir du dilemme qui fait des indemnités de fonction soit le salaire d’une fonction publique croupion – le rapport Mauroy de 2000 fait des élus des « agents civils territoriaux » pouvant être rémunérés –, soit une forme de dédommagement, facultatif, mais soumis à impôt et à cotisations sociales, ce qui n’est pas banal pour un dédommagement. Et ce dédommagement – on ne sait d’ailleurs de quoi : perte de revenu ou frais divers ? – cohabite avec la compensation de frais annexes, tels les frais de représentation !
La seule chose qui est certaine, c’est qu’on ne sait pas ce qu’est l’indemnité de fonction. Selon la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, par exemple, ce n’est ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération quelconque.
Voilà donc une première raison de créer un authentique statut de l’élu territorial.
La seconde raison est, pour moi, plus essentielle encore : il faut rompre avec la fiction selon laquelle, dans l’exercice de ses fonctions – fonctions exercées au nom de la collectivité et dans l’intérêt général –, l’élu est un simple citoyen ou un professionnel.
Si la longue liste des responsabilités des élus n’a rien à voir avec celle du citoyen lambda ou même d’un chef d’entreprise, d’un médecin ou d’un avocat, il en va différemment de sa responsabilité pénale. Au mieux, elle est la même ; souvent, elle est plus lourde, au motif que l’intéressé est « investi d’un mandat électif public », d’un pouvoir général de police ou « dépositaire de l’autorité publique ».
Le code pénal est muni d’un cliquet : le fait d’être élu donne seulement des devoirs et des charges, et non des droits. C’est vrai pour les délits non intentionnels comme la mise en danger d’autrui et, évidemment, pour les manquements au devoir de probité, les délits de prise illégale d’intérêt ou de favoritisme, dont nous reparlerons. C’est vrai pour les réponses généralement admises aux provocations et aux incivilités, même si le jugement de la cour d’appel de Douai dans la récente affaire du maire de Cousolre, qui avait giflé un adolescent, marque un véritable changement de perspective.
Camille et Jean de Maillard résument bien la situation présente : « On n’est plus citoyen que pour s’abstenir d’agir, à moins de vouloir assumer une responsabilité dont on devient l’infamant débiteur. »
Tant qu’on refusera d’articuler principe d’égalité devant la loi et réalité de l’inégalité devant les charges, responsabilités et obligations, ce qui devrait être au cœur d’un authentique statut de l’élu territorial, même en ayant la conscience tranquille, les élus auront du mal à dormir en paix !
Un statut de l’élu doit être autre chose qu’un catalogue d’avantages et d’obligations : il doit définir et articuler des droits et des devoirs. Les amendements visant à insérer des articles additionnels avant l’article 1er que nous avons déposés vont dans ce sens. Je fais remarquer au passage que nos propositions sont directement puisées dans le rapport de MM. Peyronnet et Dallier, fait, il est vrai, à une époque où les intéressés ne fantasmaient pas sur le statut de l’élu.
En juin 2011, lors de l’examen d’une précédente proposition de loi de Bernard Saugey consacrée à ce sujet, j’avais rappelé les étapes franchies depuis 1982 en direction d’un statut de l’élu territorial : après 1982, 1992 et 2002, logiquement, il devrait se passer quelque chose en 2012. J’avais alors été applaudi par le groupe socialiste. Or rien ne s’est produit en 2012 ! Sera-ce pour 2013 ? Plus le temps passe, plus j’en doute : force m’est de constater qu’il ne se passera rien non plus en 2013, ni même probablement avant la fin du quinquennat.
Toutes les grandes avancées en matière de conditions d’exercice des mandats locaux, en 1982, en 1992 et en 2002, ont été le fait de la gauche. Comme Diogène cherchait un homme avec une lanterne en plein jour, je continue de chercher la gauche dans cette proposition de loi. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, beaucoup a déjà été dit. J’interviens en effet à cette tribune après nombre de mes collègues, notamment Jean-Claude Peyronnet, avec qui j’avais travaillé sur cette question. Les auteurs de cette proposition de loi ont bien voulu reprendre un certain nombre des suggestions que nous avions formulées. J’en suis heureux. Pour ma part, je pense que je voterai ce texte.
Cela étant dit, il arrive un peu tard. Cela fait en effet des années que l’on parle d’un statut de l’élu. Bernard Saugey me disait tout à l’heure que, sur ce sujet, il ne pouvait y avoir de Grand Soir, qu’il fallait y aller par petites touches et améliorer les choses au fur et à mesure. Certes ! Je crois néanmoins que nous ne sommes pas parvenus au bout du chemin et que beaucoup restera à faire.

Je suis donc un peu déçu.
Mais ce texte arrive peut-être aussi un peu trop tôt !
Mes chers collègues, nous avons récemment examiné le projet de loi relatif à l’élection des conseillers départementaux, lequel a connu ici un sort funeste. Je vous rappelle, chers collègues de la majorité, qu’en divisant le nombre de cantons par deux vous allez diviser d’autant le nombre de villes chefs-lieux de canton. Or une partie des indemnités des maires peut être indexée ou en tout cas majorée simplement parce que leur ville est chef-lieu de canton. Il nous faudra d’ailleurs revenir sur les indemnités des élus, dont on ne parle pas assez.
Quoi qu'il en soit, le projet de loi que j’évoquais aura donc, s’il est adopté par l’Assemblée nationale, un impact sur les indemnités des maires des villes qui ne seront plus chefs-lieux de canton.
En outre, j’aurais préféré que l’on traite du statut de l’élu après avoir légiféré sur le non-cumul des mandats. Cela nous aurait certainement permis d’aller plus loin.
J’espère donc que la présente proposition de loi ne relève pas, comme cela a été dit à cette tribune, d’une espèce de troc avec le Parlement : une petite amélioration du statut de l’élu contre le vote du non-cumul des mandats.

Je ne sais plus qui a dit cela, mais je ne peux même pas envisager que cela puisse être vrai. Je suis donc très heureux, monsieur Sueur, que vous démentiez cette affirmation.
Je dirai maintenant un mot de la gratuité des fonctions de l’élu, sur laquelle je partage plutôt l’avis de notre collègue Pierre-Yves Collombat : nous faisons preuve sur ce sujet de la plus grande hypocrisie, madame la ministre.
Au début de la IIIe République, il avait été question, dans cet hémicycle, de l’indemnisation des parlementaires. Un grand débat avait alors opposé ceux qui pensaient que la fonction devait être gratuite et ceux qui pensaient le contraire. Clemenceau s’était exclamé : « Fonction gratuite ? Ce sera beaucoup trop cher ! » §La formule ne manquait pas de bon sens, et il faut s’en souvenir.
Il est bien évident, en effet, que, pour être mis à l’abri d’un certain nombre de tentations, les élus devaient être indemnisés, sauf à se résigner à ne voir élus que des crédits-rentiers !
En tout cas, le principe de la gratuité, qui est tout de même une bizarrerie, a été conservé. Il faut dire que, sur cette question, les Français souhaitent des choses assez contradictoires. Ils veulent des élus jeunes, se consacrant à plein-temps à leur mandat. Lorsque l’on devient maire à 32 ans, comme ce fut mon cas, en ayant la chance d’être dans le même temps salarié d’une grande entreprise, cela ne pose pas trop de difficultés. Bien sûr, votre employeur est obligé de vous libérer du temps. Mais les Français doivent tout de même être conscients que celui ou celle qui devient maire, même dans les conditions qui ont été les miennes, sacrifie sa carrière professionnelle.

Il est bien évident que l’employeur ne regarde ensuite plus l’intéressé de la même manière.
Une fois devenu maire, je n’ai plus jamais exercé les responsabilités qui étaient les miennes avant d’être élu. J’ai toujours été regardé comme quelqu’un qui pouvait, du jour au lendemain, devenir conseiller général, ce qui est d’ailleurs arrivé. Je suis alors resté dans l’entreprise, mais je l’ai finalement quittée lorsque je suis devenu parlementaire.
Si la loi protège les salariés élus, et c’est heureux, il n’en demeure pas moins que ceux qui font le choix de s’engager dans la vie publique sacrifient leur carrière professionnelle. §
Les Français, mais également certains de nos collègues élus, nous traitent parfois de carriéristes en politique. Mais ont-ils seulement conscience que nous avons déjà sacrifié notre carrière professionnelle ?

Pour les fonctionnaires – et il ne s’agit nullement pour moi de les critiquer –, la situation est plus simple.

Pardonnez-moi, madame, c’était strictement par hasard si je vous regardais en disant cela : je m’adressais naturellement à tout l’hémicycle.
Je disais donc que les choses sont beaucoup plus simples si l’on est fonctionnaire ou si l’on exerce une profession libérale que si l’on est salarié. Cela, les Français n’en ont pas conscience. Il faut donc le répéter : être élu, c’est faire un choix.
Cela me donne l’occasion de dire que, si on limitait à deux le nombre de mandats successifs, comme le proposent certains ici, dans mon cas, ayant été élu maire à 32 ans, j’aurais été renvoyé dans mon entreprise à 44 ans ! Laissez-moi vous livrer le fond de ma pensée à ce sujet : lorsqu’on est un bon maire, on peut bien faire cinq mandats, lorsqu’on est un mauvais maire, un seul suffit ! Après tout, c’est bien aux électeurs d’en juger.
Très bien ! sur les travées de l’UMP.

J’espère, monsieur le président, que vous me permettrez de dépasser un peu le temps qui m’est imparti, …

… car je voudrais dire un mot sur les indemnités des élus.
Sur ce sujet également règne la plus grande hypocrisie. La première raison à cela est que nous, les élus, avons toujours peur du qu’en-dira-t-on, des réactions de la presse, ou encore des sondages qui nous montrent du doigt. Dès lors, le sujet n’est jamais véritablement mis sur la table.
Mes chers collègues, je vais dire à la tribune une chose qui n’a, me semble-t-il, jamais été dite. Les indemnités des élus sont déterminées par référence aux grilles indiciaires de la fonction publique. Leur montant n’est ainsi revalorisé qu’en fonction de la majoration de la valeur du point de la fonction publique.

Mes chers collègues, vous êtes-vous penchés sur l’évolution des indemnités de fonction que ce système a entraînée au cours des dix dernières années ?

Mais, madame, n’oubliez pas que, pour les élus, il n’y a pas de « glissement vieillesse technicité », et cela fait une grande différence !

Les effets conjugués de la valeur du point et du GVT permettent de maintenir à peu près constant le pouvoir d’achat des fonctionnaires. Sur ce sujet, d’ailleurs, nous verrons ce que vous ferez !

Les indemnités des élus, elles, ne sont indexées que sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Au cours des dix dernières années, l’inflation a été de 20 % environ, quand la valeur du point d’indice, elle, n’a connu une augmentation que de 6 % à 7 %. Cela signifie que, en dix ans, les indemnités des élus ont perdu de leur pouvoir d’achat. Or nous n’osons pas le dire. Nous n’osons rien réclamer, et notamment pas l’indexation de nos indemnités sur l’inflation.
Cependant, mes chers collègues, le problème est sérieux. En effet, cette situation nous conduit à utiliser des moyens que je qualifierai de… particuliers. Je pense notamment à la possibilité de majorer les indemnités des élus d’un chef-lieu de canton. Un chef-lieu de canton a-t-il encore un sens aujourd’hui, au XXIe siècle, notamment en zone dense francilienne ? Qu’est-ce que cela change, finalement, que l’on soit maire d’un chef-lieu de canton ou d’une autre ville ?

Il y a quelques années, il a été décidé de majorer les indemnités des élus d’une ville percevant la dotation de solidarité urbaine, la DSU. J’ai d’ailleurs déposé un amendement tendant à supprimer cette majoration ; nous aurons l’occasion d’en reparler. Ces dispositions ont été introduites parce que l’on n’a pas osé repenser de fond en comble – je dirai même refonder – le système de l’indemnisation des élus, en posant le problème de son indexation. Comme on n’osait pas le faire ouvertement, on a mis en place des dispositifs qui ont permis de le faire un peu, sans le dire.
À mon sens, ces expédients ne sont pas bons pour la démocratie, pour les élus locaux, pour les parlementaires. Il faudra y revenir. Je regrette que ce texte ne nous en donne pas l’occasion. Certes, je le voterai, mais j’attends encore le Grand Soir !

M. Philippe Dallier. Oui, mes chers collègues, j’attends encore le moment où nous mettrons tous les sujets sur la table, sans nous contenter de procéder par petites retouches successives.
Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’UDI-UC . – M. Pierre-Yves Collombat applaudit également.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, voilà deux heures et demie que je tente de compter – en vain, je dois le confesser ! – le nombre de fois où les mots « statut de l’élu » ont été prononcés, alors même qu’ils n’apparaissent nulle part dans le texte soumis à notre examen, et croyez bien que je les y ai cherchés !
Cher collègue Pierre-Yves Collombat, je vais tenter de vous rassurer : non, le « statut » de l’élu local n’est pas un gros mot, en tout cas à mes yeux.
Les élus locaux ne constituent pas, d’ailleurs, la seule catégorie de Français désirant obtenir un statut. Leur demande, en outre, n’est pas illégitime. Leurs missions, tâches ou fonctions, qui n’ont rien à voir avec la pratique de loisirs ou un désir de se cultiver, relèvent certes de leur choix – et de celui des citoyens –, mais donnent également lieu à un versement d’indemnités, ainsi qu’au paiement de charges fiscales et sociales. Elles entraînent la responsabilité de ceux qui les exercent. Elles imposent une obligation de présence, d’intervention, de décision. Elles requièrent la possession de compétences techniques, acquises grâce à une formation. Elles donnent éventuellement lieu au renouvellement de l’engagement pris si l’on considère que l’intéressé a fait ses preuves, comme pour un salarié en CDD.
C’est un peu comme le Canada Dry : cela ressemble à un métier, mais ce n’est pas un métier ! En fait, exercer un mandat, c’est exercer plusieurs métiers, tant est grande la diversité des missions, actions et engagements des élus locaux.
Alain Anziani l’a dit : en la matière, il ne faut faire preuve ni de démagogie ni d’angélisme. Les élus locaux sont issus de la société, ce qu’on a coutume d’appeler la « société civile ». Ils sont à son image. Ils sont très souvent investis dans leurs missions, convaincus de l’intérêt général, qui ne sera jamais, cela a été dit, la somme des intérêts privés, aussi complète que soit cette somme.
Mais les élus locaux peuvent aussi se tromper, consciemment ou non, volontairement ou non. Eux aussi peuvent déraper.
L’exercice du pouvoir s’accompagne pourtant d’un premier devoir : celui de l’exemplarité. On peut favoriser cette exemplarité par des mesures dont certaines figurent dans le texte qui nous est présenté aujourd’hui. Je pense, notamment, aux dispositions relatives aux salariés protégés. À mon sens, c’est une excellente chose que le maire d’une petite commune, s’il est toujours salarié d’une entreprise, puisse être considéré comme un salarié protégé. Cela permettra d’éviter les pressions pouvant s’exercer sur lui pour l’obtention d’un permis de construire ou d’une autorisation administrative, par exemple.
Il me semble donc que le statut – Zut, j’ai dit un gros mot ! Mais je n’en trouve pas d’autre ! – de salarié protégé sera d’une grande utilité, en particulier pour les maires des plus petites communes.
Je pense également à l’obligation, pour les membres des assemblées délibérantes ayant reçu délégation, de suivre une formation au cours de la première année de leur mandat. En tout cas, il est obligatoire de leur en proposer une. C’est, là encore, une excellente chose, car l’acquisition de compétences leur permettra de ne pas se tromper et de mieux résister à certaines pressions.
Le contrôle visant à éviter les dérapages ou, le cas échéant, à les réprimer, doit se faire sans excessive sévérité, mais sans complaisance non plus. Sur ce point, la présente proposition de loi ne va sans doute pas assez loin. Beaucoup reste à faire pour apporter une solution satisfaisante aux problèmes posés par les conflits d’intérêts ou les malversations. La publicité des condamnations ainsi que celle de la durée de l’inéligibilité qu’elles entraînent sont d’autres points sur lesquels il conviendrait de se pencher.
En somme, c’est bien sur l’image des élus en général et des élus locaux en particulier, dont l’exemplarité, je l’ai dit, doit être le premier devoir, qu’il faut encore agir. C’est un travail de longue haleine, et je gage que nous aurons encore beaucoup d’heures à y consacrer.
S’agissant des droits des élus locaux – c’est volontairement que j’ai commencé par évoquer leurs devoirs –, le présent texte les améliore indiscutablement.
Il me semble néanmoins opportun que l’État impose le niveau maximal des indemnités auxquelles ils ont droit et que l’élu qui le désire puisse ensuite décider d’en diminuer le montant.
Le texte améliore également les dispositions relatives à la protection sociale et à la retraite des élus, s’inscrivant ainsi dans la lignée, notamment, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013.
Pour autant, je pense que nous n’allons pas assez loin. L’amendement que j’avais déposé et qui visait à faire avancer les choses, a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40. Eh oui, celui-ci a encore frappé ! Le dépôt de cet amendement avait été motivé par une considération de santé publique. En effet, il ne me paraît pas normal que le maire, qui est aussi un employeur, n’ait pas à se soumettre à une visite médicale annuelle ou bisannuelle tendant à vérifier son aptitude physique, tout simplement parce qu’il ne dispose pas d’un statut qui le requiert. Il serait pourtant important de vérifier qu’il n’est pas tuberculeux, qu’il ne risque pas de contaminer ses employés communaux, ou encore qu’il a bien l’aptitude psychique et morale pour remplir les tâches qui lui ont été confiées à travers l’élection. Les débuts des maladies neuro-dégénératives sont parfois très insidieux ; ils rendent pourtant un élu local incapable d’assumer la fonction pour laquelle il a été désigné par ses concitoyens. En matière de médecine du travail, vous le voyez, mes chers collègues, il y a des choses à faire.
La protection en cas d’accident survenu dans l’exercice des missions d’élus qui restent salariés de leur entreprise est un point sur lequel il conviendrait également de se pencher. Voilà moins d’une semaine, un accident a impliqué des conseillers municipaux de ma commune qui sont encore salariés de leur entreprise. Par chance, ils ont seulement été placés en observation à l’hôpital pendant quelques heures. Mais si cela avait été plus grave, si l’accident avait entraîné une invalidité partielle permanente, s’ils avaient perdu leur travail, qui aurait compensé – et comment ? – les charges de famille ? Un vrai chantier est à engager sur ce sujet, madame la ministre !
Mme la ministre acquiesce.

Je voudrais terminer mon intervention par un exemple concret. Les orateurs qui m’ont précédée ont utilisé beaucoup de mots, de concepts pour décrire l’investissement, le dévouement et la disponibilité de l’élu. En revanche, peu de choses ont été dites sur le quotidien d’un maire d’une petite ville.
Certains d’entre vous, mes chers collègues, ont peut-être connu l’ordinaire d’un chef de l’exécutif d’une petite collectivité territoriale. J’espère que vous ne l’avez pas oublié ; il est important de le garder à l’esprit quand on siège au Parlement. Pour moi, qui le vis encore, je m’y efforce, et je continuerai si je suis amenée à rester parlementaire dans les années à venir.
Ce quotidien est extrêmement différent de celui d’un élu d’une grande collectivité territoriale, grande ville, conseil général ou régional. Il est fait du contrôle, aussi bien dans la forme que sur le fond, des procédures du code des marchés publics, qui est de plus en plus ardu et difficile à manier. Je connais des maires qui ont dû vérifier la régularité de marchés publics de voirie, très techniques, sur lesquels pesaient des suspicions de malversations, sans recevoir l’aide d’aucun service compétent. La responsabilité repose pourtant sur leurs épaules. !
Le maire d’une petite commune doit s’imprégner de tous les documents d’urbanisme supra-communaux : le schéma de cohérence territoriale, le plan de prévention des risques d’inondations, voire le plan de prévention des risques technologiques, ou encore le programme local de l’habitat. Il doit les mettre en cohérence avec son propre plan local d’urbanisme.
Il doit jongler avec différents outils pour essayer d’obtenir des financements, faire en sorte que les opérateurs privés paient la part qui leur revient dans le financement des aménagements publics. Les outils mis à sa disposition pour ce faire changent d’ailleurs sans cesse : un jour, ils s’appellent PUP – je ne sais même plus ce que cela veut dire ! –, le lendemain PVNR.
Tout cela pèse sur les épaules d’une seule personne, le maire de petite commune, qui n’a pas les services nécessaires pour mener à bien ce travail.
En matière de pollution, il aura affaire à la police de l’eau et devra assumer ses responsabilités pour une vanne qui n’a pas fonctionné et dont il ignorait même l’existence, ou bien parce qu’une entreprise est légèrement sortie du cadre fixé par un contrat passé avec sa commune.
Il pourra également passer son dimanche matin en compagnie des gendarmes, à répandre de l’absorbant sur une route départementale qui, parce qu’elle traverse sa commune, n’est pas du ressort du département.

Je l’ai fait récemment !
Gendarmes et pompiers sont ses interlocuteurs réguliers pour les ouvertures de porte, les suicides ou encore les accidents qui se produisent sur le territoire sa commune. Dans ces circonstances douloureuses, il est même le premier lien avec la famille. Et on sera bien content qu’il soit là !
C’est à lui qu’il reviendra de trouver un logement d’urgence au milieu de la nuit pour une femme retrouvée avec sa petite fille de dix ans dans les bras, ne sachant plus quoi faire ni que dire.
C’est également lui qui, au quotidien, s’occupera de la carte d’identité électronique, …

… du droit des ressortissants étrangers, parfois des sorties des détenus de la prison d’une grande ville proche.
L’exercice de toutes ces missions, reconnaissons-le, fait de la fonction d’élu local non pas un métier, mais une multitude de métiers. C’est un engagement qui mérite la considération, qui mérite que nous nous attelions à la grande réforme qui tendrait à doter les élus locaux d’un véritable statut. Il est nécessaire, mes chers collègues, que la candidature à l’exercice de fonctions locales, notamment dans les petites villes, reste un choix, guidé par le seul goût de l’engagement public. §
M. Jean-Patrick Courtois remplace M. Jean-Pierre Raffarin au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la présente proposition de loi vise à « faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat ». Le titre est d’autant plus prometteur que l’attente des élus, écrasés par les lourdes tâches qui leur incombent, est immense.
Mais nous n’avons pas attendu les fameux états généraux de la démocratie territoriale pour appréhender ce sujet. Cela a été dit, le législateur avait déjà accordé des garanties aux élus avec la loi du 3 février 1992, relative aux conditions d’exercice des mandats locaux, …

… et la loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité.
Cela dit, ces garanties ne suffisent plus aujourd’hui. Comme on l’a souligné à de nombreuses reprises, le mandat d’élu local exige beaucoup de force de caractère et d’abnégation pour assumer les contraintes spécifiques à nos différentes collectivités. En effet, les responsabilités n’ont eu de cesse de s’alourdir, avec à la clé une forte augmentation des contentieux, y compris parfois au pénal, en tout cas pour les maires. Par exemple, dans mon département, deux maires ont été condamnés.
Pour accomplir leur mission d’intérêt général – et j’insiste sur cette notion –, les élus sont confrontés à une multiplication et à une complexification des textes. Or ils n’ont pas toujours les outils logistiques et techniques pour y faire face. Je pense notamment aux maires ruraux, qui sont parfois jour et nuit au service de leurs concitoyens, mais ne disposent pas des moyens adaptés.
L’adoption de la proposition de loi de notre collègue Éric Doligé, relative au contrôle des normes applicables aux collectivités territoriales et à la simplification de leur fonctionnement, dont l’Assemblée nationale n’a pas encore discuté, devrait, je l’espère, desserrer les contraintes et alléger les coûts.
Aujourd'hui, il est temps de se poser les vraies questions. Nous devons instituer un véritable statut de l’élu qui soit en adéquation avec les exigences de notre démocratie moderne, en particulier la transparence et l’efficacité.
Le texte que nous examinons aujourd'hui reprend, pour partie, la proposition de loi de nos collègues Bernard Saugey et Marie-Hélène Des Esgaulx, qui n’a toujours pas été examinée par les députés.
L’article 1er, qui prévoit la fixation au taux maximal de l’indemnité allouée au maire dans les communes de moins de 3 500 habitants, est une bonne mesure. Toutefois, je crains que cela ne limite l’autonomie financière des communes.
L’article 1er bis porte sur le reversement à la collectivité de la part écrêtée des indemnités. L’adoption d’une telle disposition aurait utilement pu attendre l’examen du texte sur le cumul des mandats. Cela aurait permis d’appréhender le sujet de manière plus concrète.
L’article 5, qui porte sur la durée de perception de l’allocation différentielle de fin de mandat de six mois à une année, ne pourra que satisfaire certains élus. En effet, ainsi que Philippe Dallier l’a signalé tout à l’heure, après avoir abandonné leur métier au bénéfice de leur commune, des élus sont confrontés à une réinsertion dans le monde du travail de plus en plus difficile, a fortiori s’ils ont exercé successivement deux ou trois mandats.
L’article 6 instaure un plancher pour les dépenses de formation des élus. Cette mesure, pour sympathique qu’elle soit, impose une contrainte financière et peut se révéler inopérante si le budget de la formation n’est pas consommé. J’ai donc cosigné l’amendement de notre collègue Christophe Béchu tendant à supprimer ce dispositif.
En outre, quitte à vous surprendre, je remarque que la proposition de loi se désintéresse des élus minoritaires, en tout cas dans les communes. Je pense que leur rôle, souvent ingrat, mérite pourtant d’être salué. Les élus concernés contrôlent l’action municipale avec des moyens parfois personnels. À mon sens, il serait envisageable de créer un véritable statut de l’opposition, avec un régime d’autorisation d’absence et des indemnités. Aujourd'hui, on ne peut bénéficier d’un tel régime que si l’on a obtenu une délégation.
J’en viens au délicat problème du crédit d’heures forfaitaire et trimestriel accordé aux maires, aux adjoints et aux conseillers municipaux prévu à l’article L. 2123-2 du code général des collectivités territoriales. Ne pourrait-on envisager la possibilité de reporter les heures non utilisées pour une plus grande flexibilité – le terme est à la mode –, de façon que l’employé soit moins pénalisé ? En effet, les heures d’absence ne sont aujourd'hui pas payées par l’employeur ; c’est l’élu qui, en vertu de son dévouement, les prend lui-même en charge. Et ne parlons pas des congés que les salariés élus sont obligés de poser auprès de leur employeur pour pouvoir représenter leur commune lors de manifestations !
Il faudra, un jour, permettre à tout citoyen d’exercer dans des conditions optimales un mandat, aussi bien national que local. En effet, « faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat », c’est aussi rendre leur statut plus lisible pour nos concitoyens.
Il n’est pas rare de constater que nos concitoyens sont sujets à méprise, à méconnaissance, quand il ne s’agit pas de désinformation, quant au rôle des élus locaux et à leur prétendue rémunération. Dans l’esprit de bon nombre de nos concitoyens, plusieurs mandats – c’est à dessein que je n’emploie pas l’expression « cumul des mandats » –, cela signifie plusieurs indemnités !

Les indemnités des députés et des sénateurs qui exercent d’autres mandats sont évidemment plafonnées, mais cela, nos concitoyens ne le savent pas ; ils ne l’imaginent même pas !

Combien de fois ai-je entendu mes concitoyens me dire : « Mais enfin, vous êtes parlementaire, vous êtes maire et présidente d’une communauté d’agglomération, ce doit être la belle vie pour vous ! » La plupart de nos concitoyens, voyant que nous exerçons plusieurs fonctions, ne songent pas une seconde que nous ne percevons finalement qu’une seule vraie rémunération.
C’est la réalité que vit concrètement l’élu local : une méconnaissance de son rôle et beaucoup de fantasmes quant aux indemnités qu’il perçoit.
Mes chers collègues, il reste donc encore bien des étapes à franchir, même si nous avons progressé, pour arriver à un vrai statut de l’élu local, permettant de sécuriser les élus quand ils se lancent dans la vie locale et quand ils la quittent, que ce soit par choix ou par nécessité, mais également de rendre la fonction et les rétributions correspondantes plus transparentes, donc de démystifier le sujet.
À titre personnel, je regrette que cette proposition de loi ne s’apparente pas davantage à une véritable réforme du statut de l’élu, qui ferait évoluer notre pays vers une démocratie moderne.
Malgré ces quelques réserves, vous l’aurez compris, je voterai ce texte, qui apporte des garanties supplémentaires aux élus locaux et qui marque des avancées certaines. J’en profite pour saluer l’excellent travail de notre rapporteur, Bernard Saugey.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le Parlement a voté deux lois majeures, l’une en 1992 et l’autre en 2002, pour reconnaître des garanties aux élus.
Mais ces dispositions semblent de moins en moins suffisantes face aux contraintes que représente l’exercice d’un mandat électif durant le parcours professionnel et citoyen d’un Français.
En effet, et chacun d’entre nous le sait bien, le bonheur d’être élu par ses concitoyens est un privilège que nous nous devons d’honorer en mettant toute notre énergie au service de nos administrés.
Pour autant, il ne faut pas oublier que les élus sont, malgré tout, des citoyens comme les autres. Ils ou elles ont des familles à charge, des crédits à rembourser, des enfants dont il faut financer les études et des inquiétudes pour l’avenir.
Aujourd'hui, bien plus que par le passé, un citoyen qui souhaite s’investir dans sa collectivité en tant qu’élu prend un grand risque, tant professionnel que financier, non seulement pour lui, mais également pour sa famille.
Auparavant, il était facile de se mettre au service de sa collectivité pour quelques années, puis de revenir dans le monde professionnel ; c’était même valorisant eu égard aux compétences acquises. Mais, désormais, en période de grave crise économique, le fait de quitter un emploi stable constitue à la fois un réel déchirement et un vrai pari sur l’avenir. C’est la raison pour laquelle nombre des candidats potentiels se désistent.
C’est aussi pour cela que seuls les ressortissants de quelques catégories socioprofessionnelles peuvent aujourd'hui se permettre d’envisager sereinement un investissement à temps complet ou partiel dans des fonctions d’élu local. Je pense aux retraités, aux salariés de très grandes entreprises et, plus encore, aux fonctionnaires, qui peuvent bénéficier sur leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit durant la durée de leur mandat, aux termes d’un décret du 13 janvier 1986. Et s’ils ne souhaitent pas se représenter ou ne sont pas réélus par la suite, ils peuvent sans difficulté rejoindre leur corps d’origine.
Il n’est pas aisé d’obtenir des chiffres précis sur la répartition socioprofessionnelle des élus locaux. Mais l’exemple national qu’est le Sénat, émanation des élus locaux et assemblée représentative des élus locaux puisque la plupart d’entre nous le sont également, révèle une tendance. Avant le dernier renouvellement de notre assemblée, le 25 septembre 2011, près de 41 % des sénateurs étaient issus du secteur public alors que, selon l’INSEE, les fonctionnaires représentaient en moyenne 18, 57 % des actifs. Or, depuis le dernier renouvellement, les sénateurs issus du fonctionnariat représentent près de 43 % de notre effectif total.
Loin de moi l’idée de stigmatiser un secteur professionnel, d’autant que, ancien professeur d’université, j’en ai moi-même fait partie. Il reste qu’une telle évolution est emblématique et traduit la diminution du nombre d’élus issus du secteur privé.
Je suis inquiet quant au risque qui pèse sur la représentation politique des Français pour l’avenir. On peut craindre de ne plus trouver de volontaires pour se présenter aux élections locales, sinon parmi les retraités et, pour ce qui est des actifs, parmi les fonctionnaires ou les salariés de très grandes entreprises. Comment une assemblée locale pourra-t-elle être représentative si la quasi-totalité de ses membres proviennent des mêmes secteurs d’activité ?
En ces temps de crise, nous ne pouvons pas nous passer de personnes compétentes et motivées qui souhaiteraient se présenter à des fonctions électives, mais qui y renoncent de peur de ne pas retrouver de travail par la suite.
Il est nécessaire que les assemblées élues soient vraiment représentatives de la population, tant par âge que par sexe ou par catégorie socioprofessionnelle.
À cette fin, nous devons sécuriser le parcours de l’élu – c’est ce que l’on appelle le statut – pour permettre à toutes les forces vives de la nation de s’investir dans la représentation locale et nationale.
La présente proposition de loi nous permet de faire un pas dans la bonne direction, mais le parcours risque d’être encore long !
Applaudissements sur les travées de l'UMP . – Mme Jacqueline Gourault applaudit également.
Je me félicite de la qualité des propos qui ont été tenus au cours de ce débat. Je salue tout particulièrement les interventions de MM. Jean-Claude Peyronnet et Philippe Dallier, qui ont remis un rapport sur l’exercice des mandats locaux et connaissent parfaitement le sujet.
Nombre d’intervenants ont exprimé des désaccords ponctuels et annoncé le dépôt d’amendements sur les sujets concernés. Je préfère donc attendre la discussion des articles pour leur apporter des éléments de réponse précis.
À ce stade, je souhaite simplement formuler une observation sur l’expression « statut de l’élu ». En effet, et il faudra que nous y réfléchissions tout au long de nos débats, qui dit « statut » dit aussi « protection ». C’est d’ailleurs l’objet de ce texte, qui fait suite à d’autres. Mais, outre la protection, il faut aussi envisager une forme de « contrat » pour définir les missions de l’élu local. C’est sur ce point qu’il y a des difficultés. J’aurai l’occasion d’y revenir.
Quoi qu’il en soit, je n’ai pas d’états d’âme à ce sujet : il me paraît important que nos élus disposent d’un statut. Et même si le terme n’est peut-être pas adapté juridiquement, il l’est politiquement !

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission.

Monsieur le président, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, je sollicite une suspension de séance d’une vingtaine minutes, afin que les membres de la commission des lois puissent se réunir pour examiner les amendements du Gouvernement.

Nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures quarante-cinq, est reprise à dix-huit heures vingt.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 2 rectifié bis est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Fortassin, Hue, Plancade, Requier et Tropeano.
L'amendement n° 40 est présenté par Mme Lipietz et les membres du groupe écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Statut de l'élu municipal »
II. - L'intitulé du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code est ainsi rédigé :
« Statut de l'élu départemental »
III. - L'intitulé du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie du même code est ainsi rédigé :
« Statut de l'élu régional »
IV. - L'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du même code est ainsi rédigé :
« Statut du délégué intercommunal »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 2 rectifié bis.

Nous présentons plusieurs amendements avant l’article 1er.
Il s’agit, ici, d’inscrire dans le texte – j’allais dire dans le marbre de la loi ! – l’idée d’un statut de l’élu en modifiant le code général des collectivités territoriales.
On me dira qu’il s’agit d’une démarche symbolique. Précisément ! L’élu remplit une fonction civique qui est aussi politique. Le pouvoir qu’il détient trouve son fondement dans le mandat que les citoyens lui confient pour agir en leur nom, dans le sens de l’intérêt général, et pas en son nom propre, pour créer de la plus-value ou faire des bénéfices. Et cela change tout, notamment quant à la responsabilité pénale, dont nous parlerons dans quelques instants.
Au surplus, par miracle, cet amendement échappe au couperet de l’article 40 !
Quoi qu’il en soit, nous tenons beaucoup à la reconnaissance d’un statut de l’élu.

Je n’ai rien à ajouter aux propos de notre collègue qui vient de défendre un amendement identique, sinon pour dire, puisqu’il a évoqué l’application de l’article 40 de la Constitution, que nous avons quelques interrogations à ce sujet.
D’abord, je voudrais savoir si nous pourrons nous exprimer sur les amendements qui ont été déclarés irrecevables ou si cette irrecevabilité interdit d’évoquer les sujets qu’ils abordent.
Ensuite, je m’étonne que l’article 40 soit invoqué sur des plafonnements de taux maximaux inscrits dans la loi. Mais c’est là un débat théorique que nous aurons sans doute à un autre moment…

Ces deux amendements identiques visent à modifier, pour chaque niveau de collectivités – communes, départements, régions, EPCI – l’intitulé du chapitre contenant les « garanties accordées aux titulaires de mandats », pour y substituer celui de « statut de l’élu ».
La portée de ces amendements est essentiellement symbolique, comme l’a fort bien souligné Pierre-Yves Collombat.
Cependant, avant de procéder à un tel changement, ne conviendrait-il pas de recenser l’ensemble des dispositions correspondantes, de manière à viser des références aux garanties contenues dans d’autres textes ? Je pense au code de la sécurité sociale, au code pénal, etc. Ce travail permettrait d’élaborer un cadre plus complet.
Pour l’instant, la commission émet un avis défavorable.
J’approuve l’exposé des motifs de l’amendement n° 2 rectifié bis.
Il serait courageux d’inscrire dans la loi un statut de l’élu, mais il faudrait prendre d’autres dispositions. Là, il s’agit de diverses protections, de retour au travail, de sécurité sociale, voire de retraite, mais pas des conditions d’exercice de la fonction : il n’est pas question de contrat, d’heures travaillées, d’heures de présence, de jours, etc.
J’approuve cet amendement sur le principe, mais je ne peux émettre un avis favorable aujourd’hui. Néanmoins, et je m’y engage, je demanderai à mon administration de travailler sur l’idée de statut de l’élu et de voir tout ce qui serait nécessaire pour créer un tel statut.
Sur différentes travées, certains d’entre vous ont souligné à juste titre que l’on parle parfois de conditions d’exercice pour éviter un débat, non pas de fond, mais en quelque sorte « de presse ». Les auteurs de la proposition de loi ont eu raison de chercher, avec le rapporteur, à améliorer un texte existant sur les conditions d’exercice du mandat.
Je m’engage à explorer toutes les pistes pour définir un statut, y compris en termes de fonctions, de manière de travailler, d’heures de présence, etc.
Il est toujours difficile d’être défavorable à un amendement tout en étant favorable à son principe. C’est là une illustration de la position délicate que j’aurai à exprimer à de nombreuses reprises au cours de la soirée.

Je ne peux qu’apprécier l’ouverture d’esprit de Mme la ministre. Néanmoins, on me répond encore une fois qu’il est trop tôt, que ce n’est pas le moment, qu’il faut réfléchir davantage, etc. J’ai l’habitude !
C’est un problème de sémantique, mais la sémantique emporte tout !
Actuellement, le code général des collectivités territoriales traite des conditions matérielles d’exercice du mandat, mais rien n’empêchera par la suite d’améliorer le dispositif – j’y reviendrai dans un instant–, notamment en matière de responsabilité en général et de responsabilité pénale en particulier.
Bien sûr, on pourrait me faire valoir que ce texte est un petit pas transitoire, un préalable à la création du statut de l’élu promis par le Président de la République, à la suite des états généraux ; je pourrais alors me résoudre à attendre un peu : cela fait tellement longtemps qu’on attend, on peut patienter encore quelques jours ! Cependant, comme j’ai l’impression qu’il ne se passera rien d’ici à la fin du quinquennat, cela risque d’être un peu long ! §
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 rectifié est présenté par MM. Dallier et Lefèvre.
L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Fortassin, Hue, Plancade, Requier et Tropeano.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.

Mes chers collègues, il s'agit ici de nouveau de la question de la gratuité, car l’article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales que nous proposons d’abroger précise que les fonctions électives sont gratuites. Cet amendement, dont je doute qu’il connaisse un sort favorable, a pour objet de rouvrir le débat sur ce sujet, de manière que, un beau jour, nous sortions de l’ambiguïté.
En effet, cette formule, à mon sens, ne veut plus rien dire du tout. Lorsque certains de nos concitoyens lisent que les fonctions électives sont gratuites, ils ont du mal, et on peut les comprendre, à admettre que les élus sont indemnisés, que l’on se préoccupe de leur retraite et de leur couverture maladie. Tout cela n’a pas beaucoup de sens. Je vous ai dit ce que j’en pensais dans la discussion générale.
D'ailleurs, à la suite de mon intervention, j’ai reçu deux tweets – Tweeter est désormais un moyen assez usuel pour communiquer, même entre les parlementaires et ceux qui les écoutent –, dont j’aimerais vous faire part.
M. Philippe Dallier se saisit de son téléphone portable.

Alors que je parlais de la gratuité, j’ai reçu un premier tweet disant : « Cela doit être fait bénévolement » – admettons ! –, puis un second affirmant : « Le cumul des mandats, on s’en fiche, c’est le cumul des revenus qui est intolérable ».
Exclamations.

En même temps, s’il n’y a pas de cumul des mandats, il n’y a pas de cumul des revenus !

Malheureusement, c’est ce que l’on entend, même si les journalistes et ceux qui évoquent ces sujets dans les médias en parlent rarement. Telle est l’ambiance qui entoure notre débat.
Tant que nous resterons dans l’ambiguïté, nous prêterons donc le flanc à ce genre de critique. Je crois que, un jour, il faudra avoir le courage d’affirmer que les fonctions électives ne sont plus gratuites. Peut-être faut-il faire des élus des agents publics, comme cela avait été proposé jadis. Je ne sais pas vraiment quelle est la bonne formule, mais je suis convaincu qu’il faut sortir de cette ambigüité.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter l'amendement n° 43 rectifié.

– à moins de vouloir assumer une responsabilité dont on devient l’infamant débiteur ». Mes chers collègues, nous sommes les infamants débiteurs de nos responsabilités !

Il faut tout de même rappeler que les Français savent désormais à l’euro près ce que gagnent leurs élus. La plus grande transparence est aujourd'hui de mise, me semble-t-il !
Pour en venir à ces deux amendements identiques, le principe dont ont parlé nos collègues ne correspond plus aujourd'hui au régime qui s’est progressivement constitué au bénéfice des élus, c’est vrai. Toutefois, la suppression proposée, qui l’a déjà été à plusieurs reprises, a toujours été repoussée afin d’éviter de nous engager dans la voie d’une professionnalisation des élus.
L’ensemble de ces éléments me paraissent aujourd'hui pertinents, mais l’existence de cette disposition, qui est symbolique, je le répète, n’a pas interdit au législateur d’adopter un ensemble de mesures destinées à faciliter le mandat local.
La commission a donc très nettement émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Les principes et les mots du droit sont parfois délicats à manier, et il faut y être très attentif.
Le principe de gratuité, parce que la fonction n’est pas encadrée – j’en parlais tout à l'heure à propos du statut – par un nombre d’heures travaillées, des pauses, des heures de sortie, des jours de congés, etc., nous permet, en particulier pour ceux qui n’ont pas d’indemnités ou en ont très peu – il ne faut pas les oublier – de créer des indemnités et des régimes indemnitaires, notamment pour les délégués, de couvrir des frais de déplacement, de rembourser des avances, par exemple. Une kyrielle de dispositions est liée à ce principe de droit qu’est la gratuité.
Il faudrait revoir le principe de gratuité qui ouvre, par exemple pour les responsables associatifs, pour des élus syndicaux, pour un certain nombre de personnes qui exercent d’autres types de fonction, des droits compte tenu de la gratuité des exercices. Soyons donc attentifs à cette règle de droit !
Si, dans l’élaboration du code, nous devons respecter le droit, en revanche rien n’empêche que, dans notre discours, nous parlions d’élus rémunérés et d’autres qui ne le sont pas, ainsi que de plafonnement, comme l’a dit Mme Cayeux tout à l’heure, y compris pour le cumul des exécutifs locaux.
Ce sont des sujets qu’il nous faudra évoquer – M. Collombat en a parlé –, mais le principe de gratuité ouvre des possibilités dont vous regretteriez la disparition, mesdames, messieurs les sénateurs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Je soutiens la position du rapporteur et m’inscris en faux contre les propos de nos collègues, en particulier de M. Collombat, dont je connais depuis longtemps le sens aigu de l’ironie : ils peuvent certes répéter à l’envi qu’il n’y a rien dans ce texte, qu’il ne contient pas le statut mirifique attendu. Pour ma part, je veux soutenir ici le point de vue contraire.
J’ai moi-même présenté une loi, non pas en 1991 mais en 1992, qui permettait d’importantes avancées. Si la présente proposition de loi est votée et si sont retenus les amendements qui ont été adoptés par la commission, cela fera douze mesures concrètes supplémentaires au bénéfice des élus locaux de ce pays.

Certains diront que, parce que ce texte ne va pas assez loin, il ne vaut rien. Mais on peut dire cela de manière récurrente à propos de presque toutes choses.
Le texte que vous proposez d’abroger date de 1831. Il s’inscrit dans une tradition ancienne, antérieure à la IIIe et même à la IIe République, en vertu de laquelle on considère que l’exercice des mandats locaux ne donne pas lieu à un salaire. Ceux-ci sont assurés de manière civique et gratuite, et l’indemnité est une compensation.
Il y a là un principe républicain fondamental, que je défends ici, de même que je soutiens que les dispositions que nous sommes en train d’adopter, avec l’aide de tous – les amendements qui ont été retenus par la commission et les articles de la proposition de loi émanent de tous les groupes – constituent des avancées.
Certes, on peut toujours faire preuve d’ironie et mépriser les avancées. Pour ma part, je suis de ceux qui se réjouiront que l’on fasse de tels pas en avant.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le président de la commission des lois, je sais que vous avez une grande capacité à vous réjouir. Il y a douze mesures dans ce texte, très bien ! Pourquoi pas une treizième ? Seriez-vous superstitieux ?
Sourires.

Ce principe remonte à 1831. Toutefois, vous vous apprêtez à changer des principes qui remontent à beaucoup plus loin. Cet argument ne tient pas, cela n’est pas sérieux !
Le vrai problème, c’est qu’il faut rompre avec une hypocrisie – je crois que c’est Philippe Dallier qui a utilisé le mot tout à l’heure –, car, mystérieusement, ce principe ne concerne que les élus communaux. Pour autant que je sache, dans le CGCT, il ne s’applique ni aux élus départementaux ni aux élus régionaux.
M. Jean-Jacques Hyest acquiesce.

Dès lors, pourquoi ne pas lever ce verrou ? Cela ne changerait rien aux conditions effectives, qu’il s’agisse du montant des indemnités ou des contreparties. Lever ce verrou permettrait d’aller véritablement plus loin et de se débarrasser de cette clause qui remonte à 1831, une époque où, comme je le disais tout à l’heure, les fonctions électives étaient essentiellement décoratives – beaucoup de gens étaient alors nommés – et permettaient de justifier les décorations dont on gratifiait les notables locaux.
Nous ne sommes plus du tout dans cette configuration, surtout depuis 1982. Il faut tout de même être un peu cohérent !
J’ajoute que 300 000 élus en France, soit près de 60 % d’entre eux, ne reçoivent aucune indemnité. Le principe de gratuité permet à toutes les collectivités territoriales de rembourser aux élus leurs dépenses, notamment, pour certains, les frais de garde d’enfants, de couvrir entièrement les sommes qu’ils engagent pour la collectivité.
En supprimant pour ces 300 000 élus le principe de gratuité, vous leur enlevez la possibilité d’être indemnisés et remboursés de leurs frais. Il s'agit d’un véritable problème.

M. Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois. Je n’accepte pas, Pierre-Yves Collombat, que vous disiez que mon argumentation n’a aucun sens.
Exclamations sur diverses travées.

Je tiens à être précis sur ce principe de la gratuité, qui a existé sous plusieurs républiques et même avant. Comme l’a souligné Mme la ministre, il y a beaucoup de sens à maintenir ce principe dans notre loi par respect pour les élus locaux.
Sur les 550 000 élus de France, sans doute près de 450 000 ne touchent aucune indemnité. Ces « hussards noirs de la République », pour reprendre une formule de Charles Péguy, se dévouent inlassablement et se battent tous les jours pour faire vivre nos communes. Ils connaissent chaque route, chaque chemin, chaque maison, chaque commerce, chaque entreprise ; ils connaissent la réalité, et la moindre des choses est de maintenir le principe en vertu duquel ils exercent leur mandat gratuitement. Je le dis avec gravité, car je pense que l’on ne peut pas tout traiter sur le mode de l’ironie.

Ce serait à mon sens une erreur de supprimer le principe de gratuité. En effet, cela impliquerait – vous l’avez dit, madame la ministre – de salarier les élus pour atténuer le poids des frais.
Le principe de gratuité permet les indemnisations. D'ailleurs, je regrette que vous ayez employé l’expression d’« élu rémunéré », qui fait référence à un salaire, car je ne souhaite pas que l’on s’engage dans cette voie, madame la ministre.

J’avoue mon étonnement. On parle de professionnalisation, de salaire, qu’il faut éviter dans les fonctions électives, de gratuité et d’action volontaire. Une distinction est nécessaire. Les sapeurs-pompiers volontaires, par exemple, ont des possibilités d’indemnisation ; leur action n’est ni gratuite ni bénévole.
Ce qui m’étonne surtout, madame la ministre, c’est que, à l’occasion de l’examen, voilà quelques semaines, du projet de loi de finances pour 2013, il a été prévu que les élus, donc les collectivités, seraient, au-delà d’une certaine rémunération, assujettis aux cotisations pour les risques liés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Cette mesure a pour seul but de ponctionner les collectivités locales. Par exemple, elle va coûter 400 000 euros au département de la Marne ! Et on continue à parler de gratuité.
D’un côté, on impose aux collectivités de nouvelles cotisations et, de l’autre, on soutient que les élus exercent leurs fonctions gratuitement. Il y a là une véritable contradiction !

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, ce débat sémantique ne fait guère avancer les choses !

M. François Fortassin. Si vous expliquez à l'homme de la rue, qui au passage est aussi un électeur, que les fonctions sont gratuites mais que les élus perçoivent malgré tout de l'argent, il aura le sentiment profond – et je feutre le langage ! – qu'on le roule dans la farine !
Sourires.

Il suffit de dire que les fonctions ne donnent pas droit à rémunération, mais peuvent être indemnisées.

Très bien ! M. Fortassin a trouvé la synthèse entre Pierre-Yves Collombat et moi.
Sourires.

Comme vous, monsieur le président de la commission des lois, je suis convaincu que les petits pas permettent d'avancer.
La question du statut de l'élu local se pose depuis des dizaines d'années, et c'est par petites touches et retouches que nous ferons progresser l'idée que les élus qui se consacrent à la gestion de leur territoire peuvent recevoir une indemnité.
En revanche, j'ai été surpris par l'argument que vous avez avancé. J’y répondrai avec précaution, car vous avez tout à l'heure reproché à vos collègues de ne pas comprendre le sens de vos propos.
Vous vous référez à 1831, aux débuts de la monarchie de Juillet.

Faisons un peu d’histoire. Ceux qui dirigeaient la France alors n'avaient qu'une obsession : écarter des postes électifs ceux qui ne le méritaient pas, ...

... c'est-à-dire ceux qui travaillaient : ouvriers, employés, etc. En posant le principe de la gratuité, il s’agissait de réserver ces postes à ceux qui avaient les moyens d'agir sans être indemnisés.

M. Jean-Claude Lenoir. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers mes collègues Philippe Dallier et Pierre-Yves Collombat pour leur dire qu'ils ont tout à fait raison. Corrigeons ce texte qui remonte à 1831 et qui a tout simplement donné naissance à l'aristocratie républicaine.
Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.
Dans cette assemblée, on a l'habitude, et je le salue, d'être extrêmement raisonnable.
Le régime indemnitaire n’a pu être ouvert, y compris pour les parlementaires, que parce que la gratuité de la fonction a été établie.
Si l’on suit votre logique jusqu'au bout et que l'on rémunère cette fonction au lieu de l'indemniser, elle deviendra alors, comme tout salaire, imposable à 100 %. Choisir la rémunération revient à donc à remettre en cause le principe du régime indemnitaire des élus.
Au détour d’une loi qui entend améliorer le statut de l'élu, recommencer tous les travaux qui ont été menés pour l’ensemble des régimes indemnitaires, ceux des parlementaires comme ceux des autres élus de France, c’est possible, mais il faut dans ce cas demander une suspension de séance ! Nous devrions en effet examiner toutes les conséquences que cela emporte en termes de cotisations sociales, d'impôt sur le revenu, de statut de la rémunération, de contrôle de son utilisation, et le faire jusqu’au bout.
Mme Marylise Lebranchu, ministre. Je n’avais pas l’intention de convoquer cet argument, mais, au bout d'une demi-heure, j’y suis contrainte : le régime indemnitaire permet aux élus d'avoir un statut protégé et de qualité.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.

Ce débat est passionnant, parce que nous posons une question de principe qui est à mon avis essentielle. L’élu doit-il être désormais considéré comme salarié par sa collectivité ? Au contraire, son mandat est-il gratuit ? Dans ce dernier cas, dès lors que, en général, l’exercice de ses fonctions entraîne et une perte de rémunération et des frais, il lui faut en quelque sorte une indemnité compensatrice à la fois de ce manque à gagner et des dépenses qu'il engage, ne serait-ce que les frais de déplacement, qui sont parfois très importants pour les élus.
En ce qui me concerne, je préfère cette dernière philosophie ; elle est noble.

Je n'ai pas peur d'être taxé d'hypocrisie en affirmant que nos concitoyens, que j’ai aussi l'occasion de rencontrer, ont suffisamment de discernement pour comprendre la valeur de ce principe.
Par conséquent, nous ne devons pas supprimer l'article du code qui affirme que les fonctions électives sont gratuites. Quel que soit le mandat que nous exerçons, nous ne sommes pas les salariés de nos collectivités.
Très bien ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Je m’inscris dans la même tendance que mes collègues Fortassin et Bas et que Mme la ministre !

M. François Grosdidier. Je suis bien embarrassé : je voulais dire ce que notre collègue Fortassin a exprimé mieux que moi, et avec l'accent !
Sourires.

Pour nos concitoyens, il est incompréhensible qu'une activité qui, par principe, doit être exercée gratuitement puisse donner lieu à une contrepartie financière ne se limitant pas à la stricte indemnisation des frais qui auraient été engagés.
Pour autant, le débat juridique est posé. Le fait qu'une activité ne soit pas nécessairement gratuite signifie-t-il que celle-ci ne peut être rémunérée que sous la forme d'un salaire ? Cela me semble contestable et je ne partage pas ce point de vue, mais une telle question ne doit pas être prise à la légère. On a évoqué les sapeurs-pompiers volontaires et cité d'autres formes de contrepartie financière pour des activités exercées au profit de la collectivité.
Madame la ministre, je m'inscris en faux contre vos propos, sauf si l'on me prouve le contraire. Vous affirmez que ce dispositif ouvre de larges possibilités d'indemnisation réelle des frais engagés par des conseillers ou des élus municipaux.

Dans ce cas, il faudrait en transmettre le décompte aux autorités de tutelle et aux préfectures.
Il n’est qu’à voir, par exemple, les difficultés que rencontrent les pères pour se faire rembourser leurs frais de garde d’enfants ; nous y reviendrons lors de l'examen de l'article 2. Aujourd'hui, pour un grand nombre d'élus, non seulement le mandat électif n'a pas de contrepartie financière, mais il entraîne souvent un coût largement supérieur au montant des indemnités perçues, et bien sûr un coût certain lorsqu'il n'est pas indemnisé du tout.
Certes, le principe d’une non-indemnisation des conseillers municipaux peut continuer à coexister avec un régime d'élus indemnisés. En revanche, poser le principe de la gratuité pour tous, sauf pour certains, délégitime aux yeux de l'opinion publique le principe même de l'indemnité…

Nous ne réglerons sans doute pas ce problème ce soir, car nous n'en mesurons pas encore toutes les conséquences, mais le sujet mérite qu’on le retravaille avant la fin du quinquennat.

M. Jean-Claude Peyronnet. Mme la ministre a sorti l'arme nucléaire ; pour ma part, je me contenterai d'une arme de poing, ou à peine.
Sourires.

Je l’ai dit lors de la discussion générale : dans ce domaine, je suis partisan de la politique des petits pas. Tout ce qui peut améliorer le statut des élus est positif.
De façon tout à fait modeste, ce texte apporte une petite avancée, mais une avancée tout de même. Et depuis 1992, finalement, le pas que nous avons franchi est assez important.
On peut parler de la gratuité. J’ai moi-même appelé de mes vœux cette discussion. Pour autant, il faut bien avoir à l’esprit que, si nous votons ces amendements identiques, c'est une autre logique qui s'imposera.

Aussi, tout ce qui concerne le statut actuel de l'élu tombera et il n'y aura plus lieu de poursuivre la discussion de ce texte qui me semble assez consensuel.
C'est pourquoi il serait bienvenu que les auteurs de ces amendements identiques les retirent.

Les fonctions électives sont gratuites... C'est beau comme l'antique ! Certes, cela remonte à 1831, une période où le suffrage était censitaire, ...

... et où les élus étaient désignés et avaient les moyens d'assumer leurs fonctions et de trouver ailleurs des revenus. Nous n'en sommes plus là.
Un autre point me gêne dans l'argumentaire des détracteurs de cet amendement : l’opposition gratuité versus professionnalisation. Je ne sais même pas ce que ce dernier terme recouvre : nous ne sommes pas titulaires d'un CDI !

M. Philippe Dallier. Au terme de notre mandat, les électeurs jugent notre compétence et nous reconduisent ou non dans nos fonctions. De quoi parlons-nous au juste ? La compétence des élus, c'est un autre débat !
Mme Jacqueline Gourault acquiesce.

Comme un certain nombre de mes collègues, madame la ministre, vous affirmez que supprimer le principe de la gratuité ferait tomber tout le reste et nous empêcherait d'indemniser les élus ou de les défrayer.

Pour ma part, je n'en suis absolument pas certain.
La suppression d’un article du code qui prévoit que certaines fonctions électives sont gratuites nous empêche-t-elle vraiment de continuer à affirmer que les élus peuvent être indemnisés ou défrayés de certaines dépenses qu'ils auraient engagées ?
Dans la mesure où le doute existe, je retire l’amendement n° 18 rectifié qui, de toute façon, était un amendement d’appel. Cela étant, madame la ministre, j’aimerais tout de même être convaincu.

L'amendement n° 18 rectifié est retiré.
La parole est à M. le président de la commission.

Ce débat n'est pas inutile.
À la suite des propos de Jean-Claude Lenoir et de Philippe Dallier, je tiens à rappeler que l'indemnité des parlementaires, comme celle des élus locaux, est le fruit d’un combat mené et soutenu par ceux qui voulaient que tous les citoyens – ouvriers, paysans, employés, tout le monde ! –, et pas seulement les rentiers, puissent accéder aux fonctions électives. Sous la monarchie de Juillet, le régime était censitaire.
Toutefois, comme certains d'entre vous l’ont dit avec beaucoup de clarté – trois phrases ont suffi à François Fortassin pour nous soumettre une belle synthèse, …

… tandis que Philippe Bas a très bien exposé les enjeux, à l’instar de Mme la ministre et de Jean-Claude Peyronnet –, nous sommes dans une logique où les indemnités servent à compenser les frais engagés, le temps que nous consacrons à l’exercice de nos fonctions et la perte de revenus qui en découle.
C'est une logique claire, et je crois sage que nous en restions là pour ce soir.
J'espère que l'avis du président de la commission des lois sera suivi.
Puisque l’on m’a directement interrogée, je réponds. C'est grâce au principe de gratuité que nous avons pu prévoir un régime indemnitaire. Mme l'auteure de la proposition de loi a tenu à rappeler qu'il s'agissait bien d'une indemnité.
L’indemnité n’a rien à voir avec le salaire, ni avec l'achat d'une prestation de services. Ce sont trois possibilités différentes parmi lesquelles il faut choisir. Soit on verse un salaire, soit on achète une prestation de services, soit, quand on refuse ces deux modes, on crée une indemnité, qui compense un renoncement à un métier et couvre un certain nombre de frais. C'est la raison pour laquelle les indemnités n’ont pas le même statut que le salaire et, par exemple, ne sont pas soumises au même régime au titre de l’IRPP. Soyons donc bien attentifs à ce que nous faisons.
Pour ma part, je suis d'accord avec vous pour mener de façon approfondie une recherche juridique sur l'abandon de la gratuité. Néanmoins, au moment où je vous parle, pour maintenir les indemnités, donc des régimes indemnitaires ou des compensations de frais, nous n’avons d’autre solution que de garder le principe de gratuité.
Je l'ai dit tout à l'heure, certaines associations qui ont, par exemple des délégations de service public demandent, pour un certain nombre de fonctions, à pouvoir poser le principe de la gratuité accompagnée d'un régime indemnitaire. Nous sommes dans la même situation, mais, aujourd'hui, je n'ai pas la solution en droit.
En adoptant l'amendement n° 43 rectifié, vous feriez donc une erreur, me semble-t-il.

La parole est à M. Jean Boyer, pour explication de vote sur l'amendement n° 43 rectifié.

Ce débat me rappelle quelques souvenirs. Voilà quarante-sept ans, j’ai pour la première fois été élu maire d’une commune de 250 habitants. J’ai passé la main en 1995, mais cette expérience me permet de porter un jugement sur le passé et le présent, mais aussi de tracer des pistes pour l’avenir.
Qui faisait le travail en 1965 ? Mes amis secrétaires de mairie… À l’époque, nous n’avions pas de marchés à passer. Dans les communes rurales, la tâche incombait aux agriculteurs : ils représentaient 80 % de la population et n’hésitaient pas à faire les corvées dans les chemins ! Nous n’avions pas de négociations à mener, pas de normes sanitaires à respecter ; la responsabilité du maire était très limitée.
Aujourd’hui, je peux vous dire, par expérience personnelle, qu’un maire est un responsable. Pourtant, parmi les élus, c’est peut-être celui qui doute le plus de sa raison d’être.
Je m’explique : les communautés de communes ont hérité, à juste titre, des responsabilités d’investissement, dépossédant progressivement les communes rurales de cette compétence. Or, sans que cela soit une question d’orgueil, assurer un mandat dans une commune, c’est aussi vouloir, avec le conseil municipal, laisser une trace de son passage. Si, demain, le maire d’une commune rurale se contente d’un rôle de président d’association, d’officier d’état civil ou de garde-champêtre, il ne sera pas très motivé pour être maire.
Très simplement, madame la ministre, nous devons, à travers cette proposition de loi, convaincre les maires qu’on veut les comprendre et les aider.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d'une discussion commune.
L’amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Barbier, Fortassin, Hue, Plancade, Requier et Tropeano, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 432-12, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général » ;
2° L'article 432-14 est ainsi modifié :
a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le mot : « 75 000 euros »
b) Après le mot : « susmentionnés », la fin de cet article est ainsi rédigée : « de contrevenir aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public, en vue de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié. »
3° Au second alinéa de l’article 122-4, après le mot : « légitime », sont insérés les mots : « ou par l’autorité de sa fonction, à condition d’être mesuré et adapté aux circonstances, »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

M. Pierre-Yves Collombat. Je serai assez bref, car je constate que ce n’est manifestement pas ici le lieu de discuter.
Sourires sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de l'UMP.

Ainsi, nous parlerions de rémunération alors qu’il faudrait parler d’indemnité. C’est un premier faux procès : tout le monde parle d’indemnité !
Toutefois, lorsque vous parlez d’indemnité, de quoi parlez-vous au juste ? De la contrepartie d’un manque à gagner ? Mais de quoi s’agit-il, par exemple, pour les nombreux maires qui sont aussi retraités ? Par ailleurs, que vous fassiez quelque chose ou que vous ne fassiez rien, votre indemnité n’est pas modulée, que je sache !
Nous parlons donc bien d’indemnité, mais nous estimons que cette indemnité ne compense rien du tout. Nous jugeons simplement que, si nous voulons avoir des élus performants, qui consacrent du temps à leur mandat, nous devons nécessairement les indemniser.
Deuxième faux procès : sauf erreur de ma part, l’article dont nous débattons concerne la fonction municipale.

Pour les autres mandats, on ne se pose pas autant de problèmes métaphysiques et juridiques. Peut-être devrait-on, d’ailleurs… Ces faux procès montrent tout simplement que vous n’avez pas véritablement envie de créer un statut de l’élu.
Telle était donc la première motivation des amendements que nous avons déposés. Au-delà, un statut de l’élu nous semble également indispensable pour des motifs de responsabilité, notamment pénale.
Le problème est que le code pénal fonctionne avec un effet de cliquet : le fait d’être élu est toujours une circonstance aggravante, jamais une circonstance atténuante. Le Sénat s’en est ému et, par deux fois, notamment sur l’initiative de notre collègue Bernard Saugey, a voté à l’unanimité de ses membres un texte qui sécurise les élus en matière de prise illégale d’intérêts et qui précise, en matière d’atteintes à la probité dans les marchés publics, que le délit de favoritisme n’est constitué qu’en cas d’intention de favoriser.
Le troisième élément sur lequel je souhaite insister est plus récent. Mes chers collègues, vous avez dû suivre les aventures du maire de Cousolre, dans le département du Nord. Celui-ci avait giflé un adolescent qui se livrait à quelques dégradations et incivilités. Il a été condamné en première instance – tout est normal ! – au motif que sa qualité de dépositaire de l’autorité constituait une circonstance aggravante. Puis, ô miracle, la cour d’appel de Douai, non seulement ne l’a condamné à aucune peine – même son avocat demandait une sanction ! –, mais a reconnu qu’il avait eu raison.
Ce jugement mérite d’être retenu, la cour ayant posé que « le geste du maire, mesuré et adapté aux circonstances de fait de l’espèce, même s’il l’a lui-même regretté, était justifié en ce qu’il s’est avéré inoffensif et était une réponse adaptée à l’atteinte inacceptable portée publiquement à l’autorité de sa fonction » – j’insiste sur ces derniers termes, mes chers collègues.
Nous reconnaîtrions donc, après la cour d’appel de Douai, l’autorité de la fonction, et poserions que l’on ne peut pas injurier un maire impunément. Voilà pourquoi, même si c’est symbolique, instaurer un statut de l’élu, avec des devoirs mais aussi des droits, et progressivement le nourrir, y compris sur le plan de la responsabilité des maires, me paraît essentiel.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Pillet, Mme Troendle, MM. Courtois, Reichardt et Lefèvre, Mlle Joissains, MM. Hyest, Frassa et Fleming et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 432-12 du code pénal, les mots : « un intérêt quelconque » sont remplacés par les mots : « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ».
La parole est à M. François Pillet.

M. François Pillet. Cet amendement vise à reprendre partiellement les amendements à ogives multiples qu’avait préparés notre collègue Pierre-Yves Collombat.
Sourires.

Personne ne contestera que cette disposition s’insère parfaitement dans les objectifs de la proposition de loi. C’est par ailleurs un amendement dont la légitimité et la précision juridiques ont déjà fait l’objet d’un vote unanime de l’ensemble du Sénat.
Face à l’imprécision de la notion de gestion de fait, et face surtout à l’imprécision des conséquences civiles ou pénales de ce délit, la juridiction administrative a parcouru un chemin qui n’est plus tout à fait cohérent avec la portée accordée par la chambre criminelle de la Cour de cassation aux dispositions de l’article 432-12 du code pénal. Cet amendement vise donc simplement à préciser ce texte, en garantissant aux élus d’être pénalement traités par des dispositions aussi précises que l’exigent les principes généraux du droit et la Constitution, ainsi qu’on nous l’a rappelé voilà peu à propos d’une autre incrimination.
En effet, à l’heure actuelle, aux termes de l’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2008, l’infraction, pour être constituée, ne nécessite pas que les coupables aient retiré de l’opération prohibée un quelconque profit, ni que la collectivité ait souffert un quelconque préjudice.
Par ailleurs, un arrêt, rendu me semble-t-il par la cour d’appel de Grenoble, a reconnu qu’un seul intérêt moral pourrait suffire à constituer l’infraction, même si, en l’occurrence, l’élu en cause n’a pas été condamné.
Or, pour un élu qui est président d’une association recevant des subventions, l’intérêt moral, ce peut être simplement le plaisir d’être président !
On ne peut pas laisser ce texte pénal avec une imprécision rédactionnelle telle que la jurisprudence de la Cour de cassation permette ainsi d’élargir cette infraction dans des conditions qui, encore une fois, ne me semblent pas compatibles avec les principes généraux du droit.

Je constate que la conférence des présidents a bien fait de prévoir, non seulement la soirée, mais aussi la nuit pour l’examen de ce texte. Je suis toutefois curieux de savoir combien nous serons encore dans l’hémicycle à une heure du matin…

Dans l’amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat, il y a en réalité trois dispositions.
Je ne puis que souscrire à la première, dont nous sommes conjointement les pères putatifs, puisque nous avions tous deux travaillé sur la prise illégale d’intérêts. L’amendement n° 1 rectifié, présenté par François Pillet, ne reprend que cette disposition, ce qui me conduira bien évidemment à lui donner un avis favorable, au nom de la commission.
En revanche, les deux autres dispositions posent davantage de problèmes.
En particulier, le 3° de l’amendement n° 44 rectifié prévoit de donner une portée législative à la jurisprudence de la cour d’appel de Douai, qui a relaxé un maire ayant giflé un adolescent.
J’observe que l’objet de cette disposition est d’ores et déjà satisfait par cette jurisprudence, qu’il convient également de compléter par celle qui porte sur l’état de nécessité résultant de la légitime défense.
J’émettrai donc un avis défavorable sur l’amendement n° 44 rectifié.
En revanche, sur la prise illégale d’intérêts, nous sommes tous d’accord : c’est pourquoi j’émets un avis favorable sur l’amendement n° 1rectifié.
Sur ces deux amendements tendant à réviser le code pénal au détour d’une proposition de loi, je ne puis qu’émettre un avis défavorable. Une telle révision exigerait en effet un travail important de concertation avec la Chancellerie.
Le problème de la prise illégale d’intérêts n’est pas si simple. Nous avons bien dit que l’élu serait amené à se demander, au cas par cas, si son intérêt personnel était en lien ou non avec un intérêt général. Face à une question aussi complexe, je préfère que l’on s’abstienne de toute modification du code au détour de cette proposition.
En conséquence, l’avis du Gouvernement est défavorable sur les deux amendements.

Je redoute toujours que l’on ne cherche à bricoler le code pénal. Toute modification de ce texte exige une réflexion approfondie, et c’est pourquoi je ne voterai pas l’amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat.
En revanche, madame la ministre, nous avons déjà délibéré très longuement sur la modification de l’article 432-12 dudit code. Nous l’avons fait au travers d’un texte exclusivement consacré à cette question, en présence du garde des sceaux de l’époque, qui n’avait alors manifesté aucune opposition.
Il se trouve que cette proposition de loi, déposée sur l’initiative de notre collègue Bernard Saugey, a été votée unanimement par le Sénat, mais n’a jamais été examinée par l’Assemblée nationale.
Je n’aime pas beaucoup, moi non plus, que l’on modifie sans cesse le code pénal, mais, en l’occurrence, je pense que nous avons fait le travail de réflexion nécessaire.
Cela me rappelle les débats sur la loi Fauchon. Certes, les élus locaux étaient rarement condamnés, mais ils étaient souvent poursuivis, donc toujours menacés. Il en va de même du délit de prise illégale d’intérêts : il y a peu de condamnations, mais beaucoup de poursuites, ce qui est insupportable pour les élus locaux.
À mon avis, ce sujet trouve donc parfaitement sa place dans cette proposition de loi. Et l’on peut espérer que, cette fois, l’Assemblée nationale acceptera de se pencher sur la question, au travers d’un texte qui contient plusieurs autres dispositions.
Vous avez émis un avis défavorable sur ces amendements, madame la ministre. Veuillez m’excuser mais, si nous reprenons l’historique des événements, il me semble que nous avons murement réfléchi avant de nous prononcer sur ce sujet.
J’entends votre propos, monsieur le sénateur, et l’on me souffle même qu’Anne-Marie Escoffier était rapporteur du texte que vous avez mentionné.
Je vais être très franche avec vous : vous me proposez de toucher au code pénal, dans un domaine où il existe une jurisprudence de la Cour de cassation.
Or je n’ai même pas fait de réunion interministérielle sur le sujet, et vous connaissez notre prudence dès lors qu’il s’agit de toucher au code pénal. Je regrette de ne pas avoir organisé une telle réunion et je m’engage à lancer une réflexion avec nos directions sur cette question. Toutefois, vous comprendrez aisément que je ne puisse pas m’engager pour le moment.
Je maintiens donc un avis défavorable, tout en entendant que j’ai un travail à faire, y compris dans la perspective du projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement.
Sourires.

À titre personnel, je ne voterai aucun de ces deux amendements.
Tout d’abord, monsieur Hyest, et je rejoins en cela le raisonnement de Mme la ministre, je crois qu’il est toujours très délicat, en dépit de toutes les réflexions qui ont déjà pu être menées, d’amender un texte de droit pénal sans avoir pu tenir une concertation très large avec les professionnels concernés.
Comment peut-on modifier un tel texte sans avoir demandé aux magistrats de la Cour de cassation en charge de ce type d’affaires – je sais qu’ils sont mis en cause, mais justement ! – quelle est leur position et quelles seront les conséquences d’une telle modification ? Il me semble que procéder ainsi n’est pas de bonne administration.
Ensuite, je vois un effet certain de cette mesure : nous allons ouvrir un débat fracassant avec l’opinion, qui nous reprochera de nouveau de ne tempérer la législation pénale que pour nos propres intérêts.
J’insiste sur ce point. Je l’ai souligné en début d’après-midi, ce texte va faire l’objet de critiques, que nous devrons assumer et face auxquelles il nous faudra tenir bon. Toutefois, n’en rajoutons pas ! Or avec cette disposition pénale, nous en rajouterions justement. Et tout cela pour rien, à mon avis, je regrette de le dire aux auteurs des amendements. Car quand on remplace « intérêt quelconque » par « intérêt personnel distinct de l’intérêt général », où est la révolution ?
Protestations sur les travées de l'UMP.

On ne change strictement rien !
François Pillet nous explique que la notion d’intérêt moral suffit aujourd’hui pour faire condamner quelqu’un au titre de la prise illégale d’intérêts. Eh bien, demain, un intérêt personnel distinct de l’intérêt général pourrait être constitué également, par un intérêt moral. Tout cela ne change donc strictement rien.
Nous allons faire beaucoup de bruit pour, in fine, ne rien modifier. Nous devrons faire face aux mêmes condamnations que celles qui sont rendues aujourd’hui. Si je déplore que les tribunaux aient parfois la main trop lourde, ce n’est pas de cette façon-là que nous aboutirons à un meilleur résultat.

Nous voterons l’amendement présenté par François Pillet, pour deux raisons très simples.
Tout d'abord, ce texte n’est pas frappé par la procédure accélérée. La navette nous donnera l’occasion d’ajuster ce dispositif et de nous concerter avec les services du garde des sceaux.
Ensuite, le Sénat a déjà voté cette disposition…

… à l’unanimité, qui plus est. Il s’agit d’un ajustement jurisprudentiel qui, en toute hypothèse, n’entrera pas en vigueur avant la fin de cette navette. Rien ne nous empêche d’avancer sur ce dossier.
Nous voterons donc l’amendement n° 1 rectifié.

Je pense qu’il faut effectivement profiter de la navette pour travailler encore ce texte et permettre à Mme la ministre d’en affiner la portée avec ses services.
Quant à savoir si nous nous fracasserions contre l’opinion publique, mon excellent contradicteur, M. Anziani, qui est un non moins excellent juriste, sait très bien que nous ne proposons pas d’exonérer les élus ni, pour le dire clairement, d’amnistier d’une quelconque façon ceux qui se seraient rendus coupables de gestion de fait.
Nous ne faisons qu’apporter une précision, afin de savoir exactement quand une gestion de fait peut être poursuivie devant un tribunal correctionnel ou une cour d’appel. Encore une fois, je ne pense pas – je n’ai pas vérifié– que ce texte ait jamais été frappé d’une question prioritaire de constitutionnalité. Un « intérêt quelconque » ? Trouvez-vous vraiment qu’il s’agit là d’une rédaction à la hauteur d’un texte pénal ? Celle que nous proposons a au moins l’avantage d’avoir été éclairée par les débats parlementaires.

M. Pierre-Yves Collombat. Tout d’abord, cela a été dit, la rédaction que François Pillet et moi-même proposons a tout de même été votée deux fois à l’unanimité au Sénat. Certes, nous en sommes restés là, mais vous sembliez plus enthousiaste à l’époque, monsieur Anziani.
Sourires.

Comme l’a rappelé le président Hyest, le représentant du Gouvernement n’avait pas émis à l’époque de critiques particulières à son encontre.
S’agissant de la disposition relative au favoritisme, si ma mémoire est bonne, elle a également été votée une fois au Sénat. Ce n’est tout de même pas rien.
Quant au troisième point de mon amendement, relatif à l’article 122-4 du code pénal, il s’agit simplement d’expliciter cette disposition et de permettre aux maires de faire valoir l’autorité de leurs fonctions pour ne pas recevoir trop de horions de la part de leurs administrés. Quelle révolution !
Sourires.

Enfin, on me dit qu’il ne faut pas bricoler le code pénal. Très bien, madame la ministre, mais que ne nous proposez-vous alors un texte global sur le statut de l’élu, qui nous permette de discuter, en prenant le temps nécessaire, de toutes ces questions ? Or, si j’ai bien compris, nous n’aurons pas un tel texte !
Dès lors, nous en sommes réduits à utiliser le peu de pouvoirs dont nous disposons pour tenter de vous aiguillonner vers tel ou tel problème qui nous semble important. Cela ne va pas plus loin que ça. Proposez-nous un véritable statut de l’élu, qui puisse régler ce problème, et nous vous suivrons.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l'article 1er.
I. –
Non modifié
« Dans les communes de moins de 3 500 habitants, sous réserve de l’application des II et III de l’article L. 2123-20 et sans préjudice de l’application de l’article L. 2123-22, l’indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal prévu par l’article L. 2123-23. »
II. – Au premier alinéa de l’article L. 5214-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « et L. 2123-18-4 » sont insérés les mots : «, ainsi que le II de l’article L. 2123-24-1 ».

À rebours des propos qui ont été tenus tout à l'heure, je débuterai mon intervention en applaudissant l’arrivée, dans notre assemblée, de ce texte que j’oserai qualifier d’ambitieux et de courageux à la fois.
Dans la suite logique et directe des États généraux de la démocratie territoriale, organisés par le président du Sénat en octobre dernier, cette proposition de loi, au même titre que celle qui a été examinée hier, marque une réelle avancée pour la vie politique de notre pays.
Après une discussion générale riche d’arguments, nous entrons dans le vif du débat avec l’examen de l’article 1er de ce texte, qui a été nourri par les réflexions des membres de la commission des lois.
Les propositions émises dans cet article relèvent de la nécessité et de la justice : en décidant l’attribution automatique de l’indemnité allouée aux maires des petites communes au taux maximal, ce texte témoigne de notre reconnaissance pour le travail des élus locaux, au premier rang desquels se trouvent les maires.
L’exemple du département de l’Aisne mérite d’être évoqué : sur 816 communes, 92 dépassent le seuil des 1 000 habitants, soit à peine 11 %. Sur ces 92 communes, 13 comptent plus de 3 500 habitants, ce qui représente à peine 2 % du nombre total des communes axonnaises. Les plus petits villages comptent moins de 20 habitants.
Élu de la ruralité, je mesure quotidiennement la difficulté des défis à relever et j’entends les demandes légitimes des élus locaux.
Cette proposition de loi, particulièrement dans les dispositions énoncées à son article 1er, répond à ces demandes. Beaucoup de maires, dans l’Aisne et partout ailleurs dans notre pays, exercent leur mandat sur leur temps libre. Un grand nombre d’entre vous, mes chers collègues, qui ont été, sont ou seront maires, connaissent ou connaîtront ces contraintes de toute nature, savent ou sauront combien cette charge est rendue encore plus lourde par la complexité administrative qui s’impose à toutes les communes.
L’exercice d’un mandat local demande du temps, de l’énergie, de l’écoute, souvent aussi de la patience. Les maires sont les premiers acteurs de la proximité dans nos territoires, les premiers relais de notre République. Leurs tâches multiples, leurs compétences nombreuses, généralement acquises par la pratique, fondent notre cohésion sociale, bâtissent le premier niveau de citoyenneté, donnent réalité au vivre ensemble, ciment de notre société.
En décidant de fixer l’indemnité qui leur est allouée au taux maximal prévu à l’article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales sans autre décision du conseil municipal, nous revaloriserions la fonction de maire.
Les initiatives parlementaires en faveur d’une telle automaticité sont déjà nombreuses. De nombreux élus de petites communes refusent de percevoir, ou plutôt n’osent pas percevoir, l’indemnité qui leur est due, de peur d’alourdir un budget communal déjà bien souvent amaigri, ou l’utilisent pour offrir, par exemple, un repas aux personnes âgées de la commune.
C’est donc bien au Parlement, à commencer par le Sénat, qui « assure la représentation des collectivités territoriales » selon les termes de l’article 24 de la Constitution, de remédier à cette difficulté en créant un cadre pérenne d’indemnisation des maires, dont la fonction est tout aussi difficile, cela a déjà été dit, quelle que soit la taille de leur commune.
Ce faisant, la Haute Assemblée prouve son attachement à l’échelon communal et son investissement dans la sécurisation du parcours de l’élu. §

J’informe le Sénat que le projet de loi (n° 260, 2012-2013) portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports (engagement de la procédure accélérée), dont la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, compétente en matière d’impact environnemental de la politique énergétique, est saisie au fond, est renvoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.