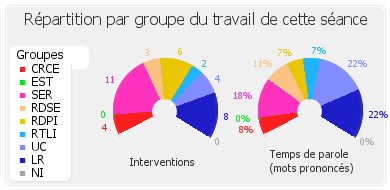Séance en hémicycle du 31 juillet 2018 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Catherine Troendlé.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d’orientation et de programmation renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (texte de la commission n° 687, rapport n° 686).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cette séance est l’aboutissement de plus de six mois de travail collectif.
Le groupe de travail pluraliste de la commission des lois sur les infractions sexuelles commises à l’encontre des mineurs, dont j’ai eu l’honneur d’être rapporteur, a tout d’abord travaillé en étroite collaboration avec la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Ces travaux de réflexion ont ensuite abouti à l’examen d’un texte législatif que le Sénat a adopté de son propre chef.
Enfin, nous avons discuté de votre projet de loi, madame la secrétaire d’État.
Votre texte a pour objet louable de mieux lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Nous partageons, en effet, le constat que les violences sexuelles et sexistes sont un fléau, qu’il faut dénoncer et combattre. L’actualité des derniers jours le démontre encore.
Je souhaite revenir sur l’historique de notre accord aujourd’hui. Car bien des revirements ont finalement débouché sur un texte utile, qui porte la marque du travail approfondi effectué par le Sénat.
Concernant la répression des viols commis à l’encontre des mineurs, rappelons que la proposition initiale du Gouvernement était inopérante, car contraire aux principes fondamentaux qui régissent notre droit. Elle instaurait une présomption irréfragable de culpabilité pour l’adulte qui aurait commis un acte sexuel avec pénétration sur un mineur. C’était donc une responsabilité automatique que le Conseil constitutionnel n’aurait pas manqué de censurer.
Alerté par le Conseil d’État, le Gouvernement a alors formulé une proposition alternative, qui consistait à ne rien changer pour les mineurs de plus de quinze ans et à prévoir, pour les mineurs de moins de quinze ans, que la contrainte morale, nécessaire à la qualification de viol, soit caractérisée par le simple abus qui a été fait de la vulnérabilité de la victime. Il s’agissait là d’une mesure incitative pour le magistrat, déjà utilisée d’ailleurs par celui-ci.
Vous proposiez également de créer une circonstance aggravante au délit d’atteinte sexuelle qui risquait de multiplier les correctionnalisations, ce que les associations ont, à juste titre, pointé du doigt.
Cette proposition, avouons-le, n’avait d’autre objectif que de répondre à des impératifs politiques, voire médiatiques. Afficher un seuil d’âge aurait été sans conséquence sur la réalité de la protection de l’ensemble des mineurs.
Le Sénat a choisi d’aller plus loin, en protégeant tous les mineurs victimes de viols, pas seulement ceux de moins de quinze ans, comme vous le proposiez, madame la secrétaire d’État, et pas uniquement ceux de moins de treize ans, comme l’a proposé, ensuite, la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes du Sénat.
Sur la base de ce principe fondamental, ma collègue rapporteure de l’Assemblée nationale et moi-même avons réussi à établir le texte que nous vous soumettons, mes chers collègues, compromis conciliant l’exigence de répression et de prévention des infractions sexuelles et sexistes et la nécessaire préservation des droits et libertés fondamentaux.
Cette solution de compromis, que certains d’entre vous trouveront peut-être timorée, mais que nous estimons conforme à notre État de droit, porte sur la caractérisation de la contrainte ou de la surprise pour les faits d’agression sexuelle commis sur mineurs.
Il était, selon moi, essentiel de mieux définir les circonstances permettant au juge de retenir l’existence d’une contrainte ou d’une surprise, en prenant en compte la différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur des faits, ainsi que l’a toujours souhaité le Sénat, mais aussi « l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire » dans le cas spécifique des mineurs de moins de quinze ans, comme l’avait proposé l’Assemblée nationale.
Il s’agit, vous l’aurez compris, mes chers collègues, d’un « dispositif à deux étages », comme l’a défini le président Philippe Bas, qui concernera tous les mineurs et s’appliquera aux agressions sexuelles comme aux viols.
Je manquerais à mes devoirs si je ne mentionnais pas non plus les importantes évolutions adoptées par le Sénat.
Je pense à la modification de la définition du délit de non-dénonciation de mauvais traitements, afin d’en faire un délit continu, mais aussi à la suppression de l’aggravation des peines en cas d’atteinte sexuelle avec acte de pénétration, ainsi qu’aux garanties apportées à la question subsidiaire systématique, sans oublier la définition du délit et des circonstances aggravantes en cas d’administration d’une substance visant à altérer le discernement d’une victime d’agression sexuelle.
Je pense également à l’aggravation des peines prévues pour toutes les agressions sexuelles lorsqu’elles sont commises sur une personne vulnérable en raison de sa situation économique et en cas d’agression sexuelle autre que le viol lorsque celle-ci a entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, ou encore à l’enrichissement des circonstances aggravantes des violences commises en présence d’un mineur et à la création d’un nouveau délit d’atteinte à la vie privée afin de réprimer « le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne ».
Plusieurs articles reprennent également la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles que nous avions adoptée le 28 mars dernier : je songe aux dispositions concernant le délai de prescription des viols commis à l’encontre des mineurs, la répression du délit de non-assistance à personne en danger, ou encore l’extension de la surqualification pénale d’inceste.
J’ai bien conscience que le travail n’est pas fini, et je suis déterminée à rester attentive et mobilisée.
Nous devons convaincre, encore, que le sujet mérite un large consensus autour de mesures fortes et toujours plus efficaces visant à lutter contre toute forme d’agression sexuelle, en particulier celles qui sont commises à l’encontre de mineurs.
Il est de notre responsabilité de protéger les enfants des prédateurs et des outils de communication qui peuvent les mettre en danger. C’est un enjeu crucial pour aujourd’hui et pour demain.
Nous avons aussi l’obligation morale de nous occuper des plus faibles et des plus démunis. C’est même le ciment de notre vouloir-vivre ensemble. C’est une chance qu’il ne faut pas gâcher.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Madame la présidente, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 25 novembre dernier, le Président de la République déclarait l’égalité entre les femmes et les hommes grande cause nationale de son quinquennat.
Moins d’un an après, c’est un plaisir et un honneur d’être aujourd’hui devant vous pour conclure ensemble l’élaboration du projet de loi constituant l’une des pierres angulaires de cette démarche. La promesse faite à l’occasion de la dernière Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes est tenue, et nous pouvons activement nous en féliciter.
Le texte que vous vous apprêtez à voter en lecture définitive est le fruit d’un long travail, engagé depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, bien avant l’élection présidentielle.
Une fois adopté, le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes sera ainsi la première grande loi citoyenne du quinquennat, grâce à la mobilisation des 55 000 participantes et participants au tour de France de l’égalité femmes-hommes, ce qui en fait la plus grande consultation gouvernementale jamais organisée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, beaucoup d’entre vous y ont largement contribué, et je veux vous en remercier.
Lors de ces rencontres, partout en France, nos concitoyennes et nos concitoyens nous ont dit l’urgence d’agir pour faire reculer les violences subies quotidiennement par des millions de femmes dans notre pays. Ces échanges ont montré la nécessité de répondre à un triple objectif : mieux prévenir les violences, mieux accompagner les victimes, mieux sanctionner les agresseurs. Telle est l’ambition qui a guidé le Gouvernement tout au long de l’élaboration de ce projet de loi, qui marque des avancées majeures, lesquelles traduisent concrètement des engagements de campagne du Président de la République.
L’allongement à trente ans du délai de prescription applicable aux crimes sexuels commis sur mineurs permettra une meilleure prise en compte des phénomènes d’amnésie traumatique et de la difficulté des victimes à parler des violences subies, particulièrement dans l’enfance.
La caractérisation de la contrainte facilitée pour les agressions sexuelles et les viols commis sur des mineurs de moins de quinze ans est tout aussi importante. Affirmer qu’un mineur, en dessous d’un certain âge, n’est pas consentant à un acte sexuel avec un majeur constitue, à nos yeux, un véritable enjeu de civilisation. Cet objectif se trouve aujourd’hui renforcé par la disposition soutenue par votre assemblée, qui permettra de mieux prendre en compte également la différence d’âge entre la victime et l’agresseur, pour protéger l’ensemble des mineurs et mieux condamner les auteurs des violences qui sont infligées aux mineurs.
La lutte contre le cyberharcèlement en meute, c’est-à-dire les « raids numériques », permettra aussi de garantir ce respect mutuel entre les femmes et les hommes sur internet. Ces comportements, aussi destructeurs dans le monde virtuel que dans le monde réel, se manifestent trop souvent à l’encontre des femmes.
La verbalisation du harcèlement de rue permettra de lutter contre ces comportements trop souvent tolérés. Aujourd’hui, en France, selon une étude menée par l’IFOP et la Fondation Jean-Jaurès, huit jeunes femmes sur dix déclarent craindre pour leur sécurité quand elles sortent seules dans l’espace public.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, nous en avons eu une illustration récente dans l’actualité, puisque, la semaine dernière, une jeune femme a eu à subir ce phénomène de harcèlement de rue, qui s’est même poursuivi par des violences et une agression. Cet événement nous montre le continuum des violences sexistes et sexuelles, qui peuvent commencer par des bruits, des mots dégradants, puis se prolonger par des cris, des insultes et se terminer, dans ce cas précis, par un jet de cendrier au visage et un coup extrêmement violent porté à la jeune fille en question, dont le seul tort était de marcher dans la rue et de refuser d’être insultée.
La question de la lutte contre le harcèlement de rue est donc un enjeu de civilisation. Il s’agit de respecter les valeurs fondamentales de la République française, la liberté des femmes d’aller et venir comme bon leur semble et l’égalité entre les femmes et les hommes face à la question de l’occupation de l’espace public.
L’enjeu est grave, et l’indignation qui a suivi la révélation de cette affaire montre que notre société ne tolère plus ces violences.
Ces faits ont également permis à chacune et à chacun de se rendre compte de la réalité du harcèlement de rue que les femmes subissent depuis des générations. Trop souvent, on a considéré que la lutte contre ce harcèlement était un enjeu dérisoire, accessoire, qui n’était ni primordial ni important, ce harcèlement relevant d’une forme de fatalité : cela a toujours été ainsi et le restera…
Aujourd’hui, nous refusons cette fatalité et nous posons, avec le présent texte, un interdit social clair face au harcèlement quotidien que vit encore un trop grand nombre de femmes.
Au-delà de ces avancées majeures, le Gouvernement a souhaité réaffirmer sa volonté d’adapter l’arsenal répressif aux nouvelles formes de violences sexistes et sexuelles. Je pense notamment à l’inscription dans la loi de l’interdiction d’utiliser une substance, drogue du viol notamment, visant à altérer le discernement et de l’interdiction de ce que l’on a appelé le upskirting, en d’autres termes le voyeurisme, dont sont victimes de trop nombreuses femmes.
Avec le présent texte, nous envoyons un message clair : nous ne tolérons plus ces agissements ! Quelle que soit la manière dont elles sont exercées, toutes ces violences sexistes et sexuelles bouleversent la vie des victimes. Cela va de l’angoisse éprouvée quotidiennement dans une rue déserte sur le chemin du travail jusqu’à des psycho-traumatismes sévères. L’égalité réelle sera impossible tant que la société tolérera que s’exercent de manière aussi massive des violences à l’encontre de toute une partie de la population, c’est-à-dire des femmes.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous avons débattu, amélioré par les deux chambres, et adopté en commission mixte paritaire, est, je le crois, équilibré et assurément bien plus protecteur que le droit actuel.
Je sais que toutes et tous vous partagez cette ambition, et je veux saluer l’engagement constant des deux chambres sur cette question, comme le montrent les travaux qui ont été conduits au sein des commissions des lois, mais aussi des délégations aux droits des femmes. Je crois que les enjeux portés par les textes amènent à construire des convergences. C’est ainsi que la commission mixte paritaire réunie la semaine dernière a permis d’établir un consensus là où certains auraient voulu créer des clivages. Je tiens donc à vous en remercier. Face à l’importance de l’enjeu, vous avez su trouver un terrain d’entente pour faire en sorte que le présent projet de loi, une fois adopté et promulgué, permette de mieux condamner les auteurs de violences et de mieux protéger les victimes. Vous n’avez eu que cet objectif en tête, et de cela je vous en sais gré.
Je suis ravie de constater que la sagesse et l’esprit de responsabilité l’ont emporté sur des positions partisanes. Vous avez su montrer que, au-delà des oppositions, les parlementaires travaillent ensemble, toujours avec le soutien du Gouvernement, et sont résolument mobilisés dans la lutte contre toutes les formes de violences sexistes et sexuelles.
Certains nous avaient annoncé une loi clivante ; c’est, au contraire, une loi consensuelle qui sera votée aujourd’hui. Elle n’en est pas moins forte et ambitieuse. Le travail réalisé a été rendu possible uniquement parce que, indépendamment de la commission mixte paritaire conclusive, les parlementaires se sont saisis de ce texte et l’ont considérablement enrichi par de nombreuses contributions pour renforcer l’arsenal protecteur que nous sommes en train de construire ensemble.
Il s’agit là non pas d’une conclusion, mais bien d’un commencement. La grande cause nationale du quinquennat déterminée par le Président de la République, à savoir l’égalité entre les femmes et les hommes, va continuer à se déployer dans de nombreux domaines. Nous avons encore quatre ans pour mener à bien ce combat culturel engagé par le Président de la République : atteindre enfin l’égalité entre les femmes et les hommes, avec l’appui, je n’en doute pas, de l’ensemble des parlementaires.
Le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes vient aujourd’hui compléter l’édifice que nous sommes en train de bâtir pour changer le quotidien de toutes et tous. D’ores et déjà, les mesures que nous prenons contre ces violences permettent de mieux accompagner les victimes.
Ainsi, dès la rentrée, nous mettrons en place des contrats locaux de lutte contre les violences, notamment intrafamiliales, qui assureront un meilleur repérage des victimes par un travail en réseau des professionnels de santé, de la justice, des forces de l’ordre et du tissu associatif.
Le ministère de l’intérieur ouvrira en septembre prochain une plateforme de signalement, gérée par des policiers spécifiquement formés par la mission interministérielle pour la protection des femmes, pour informer et orienter les victimes de violences sexistes et sexuelles.
J’ajoute que dix centres de prise en charge des psycho-traumatismes seront ouverts dans les territoires d’ici à la fin de l’année.
Enfin, la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail est également une priorité. J’en veux pour preuve les dispositions du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel qui renforcent considérablement les moyens et les résultats exigés en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au travail
M. Fabien Gay fait une moue dubitative.
Vous le constatez, la politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c’est un ensemble : la loi n’est qu’un pilier parmi d’autres, indispensable, mais pas exclusif. La question de l’égalité est en jeu, partout, tout le temps, dans toutes les sphères de la société, et s’inscrit dans le plan global défendu par le Gouvernement.
La rentrée sera l’occasion de faire de nouvelles annonces fortes, qui viendront compléter ce dispositif. Vous le savez, nous portons une attention toute particulière aux plus jeunes, comme le montre le travail que mon collègue ministre de l’éducation nationale et moi-même avons engagé, pour les sensibiliser, dès le plus jeune âge, pour mieux protéger les enfants en leur inculquant notamment le respect d’autrui, le respect de son corps, la notion de consentement. Ainsi, un référent égalité sera nommé dans chaque établissement scolaire, afin d’accompagner les élèves. Par ailleurs, les séances d’éducation à la vie affective et sexuelle, prévues depuis la loi de 2001, seront obligatoires sur tout le territoire. Enfin, la mallette des parents intégrera des outils relatifs à la lutte contre l’exposition précoce à la pornographie, notamment.
Dans la continuité, nous lancerons une grande campagne de communication à partir de la rentrée, avec des spots diffusés à la télévision, à destination des témoins. En effet, s’il est une leçon à retenir de la vidéo que j’évoquais tout à l’heure, c’est que les témoins peuvent avoir un rôle important à jouer en la matière. Les violences envers les femmes ne doivent plus être une question privée : c’est un enjeu de société, qui concerne toutes et tous.
Quand un voisin est en train de frapper son épouse, chez lui, dans son appartement, à l’abri derrière ses murs, ce n’est pas une affaire privée, c’est une question de société, et il faut le dénoncer. Nous devons arriver à construire cette société de la vigilance, que le Président de la République a appelée de ses vœux quand il a lancé la grande cause nationale du quinquennat. Lorsqu’une femme est suivie, invectivée, entravée dans sa liberté, menacée dans la rue, dans l’espace public, il faut que les témoins interviennent. Quand on est témoin d’agressions sexuelles, de viols, d’agressions physiques, d’agressions sexistes, d’injures publiques envers les femmes, il faut aller déposer des plaintes, des mains courantes, et témoigner. C’est uniquement grâce à l’intervention des témoins que nous pourrons faire en sorte que la loi qui va être adoptée soit une loi efficace et appliquée.
Tel est l’objectif de la campagne de communication que nous lançons et qui vise ce changement culturel et un abaissement du seuil de tolérance de notre société face aux violences sexistes et sexuelles pour sortir de cette fatalité. Et l’investissement financier est très important, puisque 3 millions à 4 millions d’euros seront engagés.
Il s’agit là du premier axe de la grande cause du quinquennat, mais il nous faut également avoir à l’esprit que notre vie professionnelle est, elle aussi, perturbée par ces inégalités. Nous tiendrons donc également nos engagements en matière d’égalité salariale avec le projet de loi que j’évoquais précédemment.
Enfin, la question de l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, autre enjeu majeur, viendra s’adosser à la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles qui reste bien évidemment une priorité.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement œuvre à renforcer la protection des victimes, à mieux sanctionner les agresseurs. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, qui ont trop souvent été tues ou « invisibilisées », est l’engagement du Président de la République que l’action de l’ensemble du Gouvernement traduit en actes, et que votre assemblée inscrit aujourd’hui dans la loi.
Je connais votre engagement, sur l’ensemble de ces travées, en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Je ne doute pas de votre implication. Je crois que, partout dans vos territoires, vous êtes les véritables garants, en tant qu’élus de la République, de cette égalité.
J’espère que vous relaierez avec fierté auprès des citoyens ces avancées majeures que nous avons construites ensemble, en réponse aux attentes fortes exprimées par les femmes et par les hommes. Soyez en tout cas assurés de mon plein engagement à vos côtés.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste. – M. Daniel Chasseing applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, nous sommes fiers et heureux de voir aboutir, après une commission mixte paritaire conclusive, ce texte que Mme la secrétaire d’État a défendu avec beaucoup d’énergie, de détermination, de talent.
Le présent projet de loi aborde un enjeu profondément humain : le respect de l’intégrité et de la dignité de chacun, des femmes et plus particulièrement des enfants.
Le constat est partagé par tous : il est nécessaire de renforcer la protection des mineurs contre les infractions sexuelles et de réprimer le harcèlement de rue.
L’actualité nous le rappelle régulièrement. Il y a eu l’affaire de Pontoise, ou encore l’agression dont a été victime Mme Marie Laguerre vendredi dernier : chaque jour charrie son lot de drames contre lesquels nous devons lutter.
Au cours de l’examen de ce texte en première lecture, la majorité sénatoriale est revenue sur deux dispositions phares : la réécriture de la définition du viol et la suppression du caractère contraventionnel de l’outrage sexiste au profit du caractère délictuel. Mon groupe s’est alors opposé à ces modifications et se réjouit de l’accord trouvé en commission mixte paritaire qui permet de revenir aux aspirations du texte initialement proposé par le Gouvernement.
Cet accord symbolise une volonté commune forte en faveur du renforcement de l’arsenal juridique et de la fixation d’interdits sociaux clairs dans la loi. À cet égard, je tiens à saluer le travail des rapporteurs des deux chambres, des députés et des sénateurs qui a permis, malgré les divergences initiales, d’aboutir à un texte équilibré.
Tout d’abord, la réécriture de l’article 2 facilite la caractérisation de la contrainte morale et de la surprise lorsqu’un acte de pénétration est commis par un majeur sur un mineur.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où la qualification de viol serait contestée, le président de la cour d’assises devra systématiquement poser une question subsidiaire sur la qualification d’atteinte sexuelle. Ainsi, l’auteur d’une infraction sexuelle ne restera pas impuni.
Nous nous réjouissons aussi du rétablissement du caractère contraventionnel de l’outrage sexiste. Les forces de police pourront verbaliser immédiatement des comportements facilement identifiables, qui n’ont rien de la drague ou du compliment, par une amende qui pourra aller de 90 à 750 euros. Cette nouvelle rédaction permet d’assurer une répression immédiate des comportements abusifs.
L’actualité nous ramène au harcèlement de rue que subissent régulièrement les femmes dans notre pays. Vendredi dernier, Mme Marie Laguerre a été victime d’un homme qui a incontestablement porté atteinte à sa dignité avant de la violenter. Elle a porté plainte contre cet homme, dont les actes seront certainement punis, conformément au dispositif juridique actuel.
Alors, à quoi bon créer une amende pour outrage sexiste, me direz-vous ? À apporter une réponse immédiate si l’agresseur est pris en flagrant délit. On ne peut plus considérer comme dérisoires ces faits, qui sont malheureusement trop courants.
Je tiens aussi, madame la secrétaire d’État, à saluer l’avancée proposée par le Sénat qui fait de l’orientation sexuelle de la victime une circonstance aggravante de l’outrage sexiste.
Je me félicite également des dispositions qui ont été conservées : l’allongement du délai de prescription de vingt à trente ans pour les crimes commis sur mineurs ; la création d’une circonstance aggravante lorsqu’une infraction sexuelle est commise sur une personne vulnérable en raison de sa situation économique ou lorsqu’elle a entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; la création d’une nouvelle circonstance aggravante lorsque les victimes d’infractions sexuelles se sont vu administrer des substances nuisant à leur intégrité physique ou psychique ; la création d’un délit de captation d’images impudiques pour sanctionner les personnes filmant les femmes à leur insu dans les transports en commun ou ailleurs.
La définition du harcèlement sexuel a également été enrichie par la réintégration de la notion de propos sexistes, et nous nous en félicitons.
Le texte final, fruit d’un accord transpartisan, jouera un rôle majeur pour une meilleure protection de nos enfants et contribuera à reconnaître et à réprimer le fléau qu’est le harcèlement de rue.
Pour ces raisons, madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe La République En Marche votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous voici donc au terme d’un débat ô combien médiatique, dont nous avons été saisis plusieurs fois ces derniers mois : d’abord à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de M. Bas, à la suite de la mission d’information conduite par Mme Mercier, puis par le Gouvernement, qui nous a présenté le mois dernier un projet de loi largement revu après l’avis du Conseil d’État.
Réunie au Sénat lundi dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord, en reprenant largement les dispositions adoptées par la Haute Assemblée. Pour ce qui est du contenu du texte, nous sommes plutôt satisfaits, celui-ci ayant été, selon nous, amélioré par le Sénat.
En effet, même si le texte final ne retient pas la promesse initiale du Gouvernement qui établissait un seuil de non-consentement à un acte sexuel pour les mineurs de moins de quinze ans, il ne reprend pas non plus le très polémique délit d’atteinte sexuelle avec pénétration qui pouvait laisser craindre que l’on ne minore les faits de viol. Cette disposition a été supprimée dès la discussion générale au Sénat par Mme la secrétaire d’État.
La commission des lois et la majorité sénatoriale ont cependant clarifié la définition du viol en ajoutant une notion de présomption de contrainte qui tient compte de la différence d’âge entre le mineur et le majeur, ainsi que de la vulnérabilité et du discernement du mineur. Cette mesure a été préférée à la création d’un crime de violence sexuelle sur enfant soutenue par la délégation aux droits des femmes du Sénat et plusieurs sénatrices du groupe CRCE.
Si l’ensemble de mon groupe ne partageait pas forcément toutes les demandes des associations sur le sujet, en particulier l’aggravation des peines, nous sommes unanimes sur un point : ce texte amélioré par le Sénat reste bien en deçà de ce que la lutte contre ce fléau exige.
Alors que le Gouvernement a fait de l’égalité entre les femmes et les hommes la grande cause nationale de cette année, cette cause recouvrant la lutte contre violences faites aux femmes, il a pour le moins manqué d’ambition – n’est-ce pas Mme la secrétaire d’État ? – en présentant au Parlement un tel projet de loi, qui n’aborde le sujet que sous le seul angle répressif.
De manière générale, le Gouvernement, comme la majorité des parlementaires, s’est employé à aggraver les peines en matière de délits et crimes sur mineurs, ne portant que très peu d’intérêt à la prévention et à l’éducation.
Or le sujet de l’égalité entre les femmes et les hommes, tout comme celui de la protection des mineurs, ne saurait être circonscrit au seul angle répressif. Les volets préventif et éducatif doivent être exploités bien davantage. Ils sont la clé du mieux vivre ensemble et de l’évolution des mœurs.
En ce sens, nous nous félicitons de l’adoption de quelques-uns de nos amendements. Je pense en particulier à celui qui tendait à renforcer l’article L. 312-16 du code de l’éducation, lequel dispose que trois séances d’éducation à la sexualité doivent être dispensées chaque année dans les écoles, les collèges et les lycées.
L’éducation à la sexualité constitue un levier de lutte contre les discriminations. Elle doit être non pas réduite aux seules dimensions physiques et biologiques, mais appréhendée de manière globale.
L’éducation doit contribuer, dès le plus jeune âge, à détruire stéréotypes et préjugés, mais nous sommes aujourd’hui encore loin du compte. Aussi, s’il est besoin de légiférer, c’est selon nous essentiellement en ce sens.
Toujours plus de répression ne réglera rien au fléau des violences faites aux femmes ou aux enfants si le problème n’est pas pris dans son ensemble. Or cela ne pourra prendre forme qu’avec la discussion d’un projet de loi-cadre sur le sujet, dessein que nous soutenons depuis un certain nombre d’années avec les associations féministes, notamment le Conseil national pour le droit des femmes.
Enfin, alors qu’une importante réforme de la justice sera discutée – en tout cas nous l’espérons – dès cet automne, j’alerte l’ensemble de nos concitoyens sur cette conception du droit pénal, qu’il s’agirait de modifier sans cesse au gré des faits divers pour aggraver les sanctions, sans tenir compte ni du sens ni de l’échelle des peines. C’est pourquoi les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’abstiendront sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, depuis maintenant un an, à l’échelon tant international que national, le tabou des violences sexuelles faites aux femmes est tombé, permettant une prise de conscience de l’ensemble de notre société.
Cette prise de conscience est d’ailleurs remontée jusqu’au sommet de l’État, puisque le Président de la République a fait de ce combat une grande cause nationale du quinquennat.
Je me réjouis que la CMP sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ait été conclusive. J’aimerais plus particulièrement souligner l’engagement de Mme la rapporteur, Marie Mercier, et du président Philippe Bas, qui avait déjà impulsé ce débat grâce à une proposition de loi adoptée par notre assemblée, à une large majorité, au début de l’année.
Je souhaite également souligner le travail important engagé par la délégation aux droits des femmes, sous l’égide de sa présidente, Annick Billon, et, enfin, saluer votre implication, madame la secrétaire d’État, sur un sujet, qui, je le sais, vous tient à cœur.
Quels sont, après cette commission mixte paritaire, les points importants à retenir ?
À titre personnel, je regrette que la proposition faite par la délégation aux droits des femmes concernant la création d’un crime de pénétration sexuelle sur mineur de moins de treize ans par un adulte n’ait pas été retenue. De même, il est regrettable que l’inversion de la charge de la preuve, proposée par la commission des lois du Sénat, ait été rejetée. Le texte se limite, pour les mineurs de moins de quinze ans, à préciser que la contrainte et la surprise seront caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. C’est déjà ça !
Pour autant, il nous faudra continuer à travailler sur les questions de présomption et de consentement des mineurs dans le cadre des crimes sexuels, afin de parvenir à une protection totale de nos enfants, comme ont pu le faire certains de nos voisins européens.
Cependant, ce texte comporte de réelles avancées, comme l’allongement de la prescription des crimes sexuels à trente ans à compter de la majorité de la victime. Cette mesure était d’ailleurs l’un de vos engagements, madame la secrétaire d’État. Grâce à elle, des actes de violence sexuelle ne resteront pas impunis. En effet, nous le savons, les victimes ont besoin de temps pour saisir la justice en raison du traumatisme causé par ces agissements, d’autant plus lorsque les faits ont lieu durant l’enfance.
De plus, toujours en matière de prescription, j’ai bien noté l’engagement pris par Mme la ministre de la justice de publier une circulaire pour que, sur l’ensemble du territoire, les procureurs puissent ouvrir une enquête, malgré la prescription des faits. Ce dispositif permettra de vérifier que l’auteur présumé n’a pas commis d’autres infractions sexuelles, qui, elles, ne seraient pas prescrites. Ainsi, ces actes ne resteraient pas impunis.
Autre point important : l’abandon de la création d’un délit d’atteinte sexuelle avec pénétration qui risquait de favoriser la correctionnalisation des viols relevant normalement de la cour d’assises. En effet, ce point avait suscité une grande inquiétude chez les associations et les représentants des victimes, qui craignaient que ce dispositif ne soit utilisé à mauvais escient, rendant plus complexe la caractérisation d’un viol.
Soulignons aussi la pénalisation de l’administration de substances afin d’altérer le discernement et le contrôle d’une personne, pratique malheureusement répandue chez les prédateurs sexuels, ou encore la prise en compte de la situation de détresse économique comme circonstance aggravante, introduite par notre collègue Laure Darcos. Cette mesure permettra de renforcer la protection des femmes sans domicile fixe, ces dernières étant la cible d’agressions sexuelles multiples en raison de leur vulnérabilité.
Le texte permet également de définir un cadre juridique précis en matière de harcèlement sexuel et moral, en tenant compte, notamment, des nouvelles formes de violences numériques, qui, nous le savons, sont particulièrement répandues chez les plus jeunes.
Relevons encore l’ajout des violences intrafamiliales en circonstance aggravante pour un certain nombre d’infractions, ainsi que la sensibilisation des enfants à ces violences, par le biais de l’éducation nationale, car il faut un lieu où l’on puisse apprendre que parfois, ce que font papa et maman à la maison n’est pas toujours une pratique normale.
La création d’une infraction pour outrage sexiste afin de punir également les comportements que subissent les femmes quotidiennement, notamment les diverses formes de voyeurisme, est une avancée majeure. À partir de ce jour, il est illégal d’aller regarder sous les jupes des filles.
Enfin, notons l’inscription dans la loi de la lutte contre les mutilations sexuelles, suivant les recommandations du rapport réalisé par Maryvonne Blondin et Marta de Cidrac. Il est en effet intolérable qu’encore aujourd’hui une femme soit excisée toutes les quinze secondes dans le monde, et que cette pratique ait aussi lieu sur notre territoire.
En conclusion, un regret, des satisfactions, mais vous l’aurez compris, le groupe Union Centriste votera le présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Mes chers collègues, permettez-moi de saluer la présence en tribune, sur l’invitation de Mme Jocelyne Guidez, d’une délégation du service militaire volontaire de Brétigny-sur-Orge.
Au nom du Sénat, je vous souhaite la bienvenue.
Applaudissements.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, mes chers collègues, en première lecture, nous nous étions interrogés sur l’ambition réelle du Président de la République concernant la lutte contre les violences faites aux femmes, mais surtout s’agissant de l’égalité entre les femmes et les hommes, d’autant que nous étions dans une période très troublée à cet égard : affaire Weinstein ; mouvement #MeToo ; séquences judiciaires qui avaient d’ailleurs suscité, sur l’initiative du groupe socialiste et républicain et du président de la commission des lois, six mois de travail très riche sur la question de la lutte contre les violences sexuelles sur les femmes et les enfants.
Quelle était donc l’ambition du chef de l’État, à la suite de son discours, qui se voulait fondateur, au mois de novembre dernier, dans lequel il avait indiqué qu’il fallait fixer un âge minimal de consentement pour une relation sexuelle entre un mineur et un adulte, retenant l’hypothèse, que vous partagiez, madame la secrétaire d’État, de l’âge de quinze ans ?
Les travaux ont commencé, et, comme nous avons eu l’occasion de le dire en première lecture, le texte que vous présentez comme une avancée de civilisation s’avère finalement assez décevant, car il ne porte pas l’ambition que nous attendions.
Il avait et il a toujours des points positifs, comme l’allongement du délai de prescription concernant ces infractions ou la création de l’outrage sexiste. Cette question a été remise dans l’actualité – j’ai envie de dire « tant mieux ! » pour ceux qui n’ont pas encore compris de quoi nous parlions – avec ce fait divers du week-end qui a permis à chacun de voir en vidéo ce qu’était le sort des femmes dans la rue lorsqu’elles s’avisaient de se rebeller contre une forme de provocation masculine. Nous espérons que l’instauration de cette infraction, même si certains sont sceptiques, aura des résultats positifs.
Je salue également la modification, puis le retrait par vos soins, au début du débat au Sénat, du fameux article 2, qui avait beaucoup ému, car d’aucuns craignaient, sans doute à juste titre, que l’infraction de viol ne soit finalement poursuivie par le biais d’une procédure non plus criminelle, mais correctionnelle.
Par ailleurs, le travail de la commission mixte paritaire a montré, aux yeux du groupe socialiste et républicain, quelques qualités et quelques défauts.
La CMP a eu la bonne idée de retirer la notion, qui était extrêmement dangereuse, de maturité sexuelle suffisante. Cette notion nous paraissait très problématique. La commission mixte paritaire a maintenu un certain nombre d’avancées, tous les groupes ayant travaillé pour enrichir le texte. Tout le monde partageait sur ces travées le souhait d’améliorer les dispositifs. Ont été retenues, notamment, les propositions socialistes concernant le cyberharcèlement.
En revanche, certaines dispositions, qui nous semblaient importantes, et qui avaient été adoptées par le Sénat, ont finalement été retirées. C’est, par exemple, le cas de l’obligation de signalement de mauvais traitements sur enfants, au-delà de ce qui existe déjà. Il s’agit pour nous d’un vrai recul. C’est dommage, parce que je reste persuadée, même si je ne suis pas médecin, au contraire de Mme la rapporteur, que c’est par ce biais que nous pourrons lutter de manière efficace contre les mauvais traitements sur les enfants.
Enfin, le groupe socialiste et républicain regrette que la CMP – en toute logique, puisque ni le Sénat ni l’Assemblée nationale ne l’avaient voté – n’ait pas suivi la proposition d’incrimination des relations sexuelles d’un adulte avec un mineur de treize ans avec pénétration, ce qui nous semblait être le moyen à la fois de respecter l’engagement du Président de la République et de poser définitivement un interdit sur la relation sexuelle avec un enfant.
Vous l’avez compris, nous avons un regard mitigé, déçu, et nous pourrions dire que ce texte, au fond, ne mérite ni l’excès d’honneur que le Gouvernement lui accorde ni l’excès d’indignité qui nous dissuaderait de le voter. Le groupe socialiste et républicain, comme en première lecture, s’abstiendra sur ce projet de loi.
Nous espérons que votre ambition incontestable, madame la secrétaire d’État, se concrétisera lors de textes à venir. Nous ne mettons pas en doute votre volonté de lutter contre des comportements qui portent préjudice de manière dramatique et aux enfants et aux femmes. Nous serons à vos côtés si vous avancez, mais nous serons aussi des aiguillons, des stimulants si nous constatons que votre volonté politique fait défaut.
Avant d’en terminer, je veux saluer une instance du Sénat qui a fait un travail formidable. Je veux parler de la délégation aux droits des femmes, qui a, de façon transpartisane, comme notre groupe de travail de la commission des lois, contribué à sa manière, avec un succès inégal, à notre action. Madame la secrétaire d’État, soyez assurée que vous avez, de ce côté-là, un point d’appui robuste.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, le Président de la République a fait de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une cause nationale – c’est un engagement fort et nécessaire de la République – pour laquelle, nous le savons, vous vous impliquez particulièrement, madame la secrétaire d’État.
Au sein de notre assemblée, la commission des lois a apporté une contribution décisive au débat relatif au projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travers, d’une part, d’un rapport d’information intitulé Protéger les mineurs victimes d ’ infractions sexuelles, présenté en février dernier par notre collègue Marie Mercier, aujourd’hui rapporteur, et, d’autre part, de la proposition de loi d’orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d’infractions sexuelles. Ces deux contributions furent le fruit d’un groupe de travail pluraliste, dont je tiens à saluer la qualité des réflexions.
Réunie le 23 juillet dernier, la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du présent projet de loi est parvenue à un accord, ce dont je me réjouis d’autant que le texte résultant de cette CMP reprend largement les dispositions adoptées par le Sénat lors de ses travaux – j’adresse mes félicitations à Mme la rapporteur, aux membres de la commission des lois et à Mme la secrétaire d’État. Je pense en particulier à l’exigence de protection de tous les enfants, quel que soit leur âge, contre le viol, mais également à la plupart des propositions issues du groupe de travail, telles que l’allongement à trente ans du délai de prescription des crimes sexuels sur mineurs et le renforcement des peines encourues pour atteinte sexuelle. Je me félicite que de tels apports du Sénat aient été retenus.
Concernant la lutte contre le cyberharcèlement plus précisément, l’article 3 adapte opportunément notre droit pénal aux évolutions technologiques, en complétant la définition du harcèlement pour prendre en compte les « raids numériques », c’est-à-dire la publication par plusieurs auteurs de propos sexistes et violents proférés une seule fois à l’encontre d’une même cible.
Des faits récents ont montré que la lutte contre le cyberharcèlement constitue un véritable enjeu en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces agressions ne sont en rien virtuelles. Bien au contraire, elles se révèlent tout aussi graves que des violences physiques et présentent des spécificités qui les rendent encore plus nuisibles pour les victimes, comme la difficulté à identifier des agresseurs protégés par leur anonymat et le potentiel de diffusion élargi des contenus.
Or la définition actuelle du harcèlement, qui suppose la répétition, ne permet pas de réprimer de tels agissements, puisque les auteurs des « raids » réitèrent rarement les mêmes propos, mais se coordonnent afin de cibler, de manière collective, la même personne.
Il était donc important de combler ce vide juridique pour sanctionner des agissements pouvant se révéler d’une extrême violence. Le groupe Les Indépendants – République et Territoires souscrit pleinement aux objectifs poursuivis, dont personne ne peut contester la légitimité. Nous sommes tous convaincus, au sein de cet hémicycle, de la nécessité de donner un coup d’arrêt à un certain nombre de violences, confinant parfois à l’inhumain, et qui continuent à se produire.
Qu’elles concernent les mineurs ou les majeurs, qu’elles se déroulent sur internet, au travail, en public ou dans la rue, toutes les violences sexuelles et sexistes doivent être dénoncées et combattues avec fermeté. Aussi, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc des commissions.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, madame la rapporteur, vous l’avez rappelé, mes chers collègues, l’actualité nous a démontré l’importance des violences sexuelles et sexistes et plus précisément du harcèlement de rue.
Si le témoignage de Marie, agressée pour avoir osé répondre à un comportement inqualifiable, doit nous révolter, nous inquiéter, il doit surtout nous alerter sur toutes ces femmes, victimes chaque jour de ces agressions et qui se taisent, par honte, par dégoût et, parfois même, par crainte de ne pas être prises au sérieux.
À l’heure où 80 % des victimes des violences sexuelles sont des femmes, le projet de loi qui nous est présenté nous oblige à la gravité et nous conduit à réfléchir aux solutions à trouver pour mettre fin à ces agissements.
L’ensemble des membres de cet hémicycle a partagé avec vous, madame la secrétaire d’État, le même objectif : mieux protéger les victimes et condamner plus fermement les auteurs d’infractions sexuelles et sexistes.
Je me réjouis d’abord que nous soyons tombés d’accord sur l’allongement du délai de prescription de l’action publique pour les crimes et délits d’agressions sexuelles qui passe de vingt à trente ans. Cette mesure est, à mes yeux, la principale avancée de ce projet de loi, sûrement la plus significative.
Il est aujourd’hui nécessaire de prendre en compte la difficulté que peuvent rencontrer les victimes à parler tout de suite, car nombre d’entre elles enfouissent leur traumatisme durant des années.
Je formulerai deux regrets.
Mon premier regret concerne la suppression de la présomption de contrainte conduisant à qualifier une relation sexuelle de viol dans deux cas : lorsqu’il y a un manque de discernement de l’éventuelle victime et dans le cas d’une différence d’âge significative entre l’auteur majeur et le mineur. Si cette mesure risquait certes d’être frappée d’inconstitutionnalité, elle prouvait, me semble-t-il, la gravité de ces crimes.
Mon second regret a trait à la suppression de l’article 1er A annexant au projet de loi le rapport sur les orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Cette disposition que l’on devait à notre rapporteur, Marie Mercier, enrichie par la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat, donnait, à mon sens, davantage de corps et de profondeur au présent texte, notamment parce que le rapport posait un cadre pour la prévention et une meilleure prise en compte de l’accueil des victimes.
Le choix qui a été fait de définir plus précisément les circonstances aggravantes, notamment par la prise en considération, comme le souhaitait le Sénat, de la différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur, est sans doute le bon, mais son application devra être surveillée.
Concernant l’article 2, je me réjouis que vous nous ayez entendus, madame la secrétaire d’État. La création d’un délit d’atteinte sexuelle avec pénétration, si elle partait d’une bonne intention, laissait planer le risque de la correctionnalisation. À ce titre, nous ne devions prendre aucun risque.
Quant à l’article 2 bis C, nous restons pleinement en phase avec les dispositions tendant à alourdir les peines en cas de non-assistance et de non-dénonciation des crimes et délits commis contre l’intégrité corporelle des mineurs de quinze ans. Ces mesures reprennent là aussi nos travaux réalisés en mars dernier.
Une partie des membres de mon groupe regrette toutefois la suppression de l’obligation pour les médecins de signaler les violences sexuelles. Aujourd’hui encore, on sous-estime le rôle de ces derniers dans la dénonciation de ces infractions, alors même qu’ils sont des professionnels de confiance et des interlocuteurs privilégiés.
S’agissant des dispositions relatives au harcèlement sexuel et au harcèlement moral, je tiens à rappeler notre soutien aux mesures visant à condamner les raids numériques. Sera désormais réprimé le comportement de plusieurs individus harcelant de manière unique, mais collective, une victime. C’est, par exemple, souvent le cas sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter.
Concernant la définition du harcèlement sexuel, si certains d’entre nous sont favorables à l’élargissement proposé par l’Assemblée nationale, d’autres continuent de craindre que cette extension ne vienne créer la confusion avec le délit d’outrage sexiste prévu par l’article 4.
Par ailleurs, s’agissant de l’outrage sexiste, si nous sommes totalement d’accord avec l’objectif de faire cesser ces comportements intolérables, nous sommes plus partagés quant aux réponses à donner à ces agissements. La réponse législative que nous apportons paraît difficilement applicable, car elle repose en grande partie sur le flagrant délit. L’essentiel est, à mon sens, ailleurs : dans l’éducation et la sensibilisation, et ce dès le plus jeune âge. Cette prévention est d’autant plus primordiale dans un contexte où la moitié des infractions sexuelles sur mineurs sont commises par des mineurs.
Il faut également lutter de toutes nos forces contre la pédophilie et la pédopornographie. Si des initiatives existent à l’échelle mondiale – je pense à la base de données internationale sur l’exploitation sexuelle des enfants d’Interpol –, l’idée de créer une structure française ad hoc de prévention et de lutte contre la pédophilie – elle a fait l’objet d’une question au gouvernement de ma collègue Françoise Laborde – mériterait d’être étudiée avec plus d’intérêt.
Pour ce qui concerne le viol enfin, il faut insister sur l’accompagnement des victimes, et ce dès le départ, avec la généralisation des salles Mélanie, davantage de moyens et de publicité pour les associations spécialisées.
Il faut également aller plus loin dans la libération de la parole ! Si le nombre de signalements est en augmentation, nous ne pouvons nous en réjouir. Ces chiffres nous donnent le nombre d’auteurs, mais ne nous informeront jamais sur le nombre de victimes, car, aujourd’hui encore, beaucoup d’entre elles se taisent.
Vous l’aurez compris, il nous reste encore beaucoup à faire pour que cessent les violences sexuelles et sexistes. L’adoption de ce projet de loi, à la suite de la réussite de la commission mixte paritaire, doit être considérée non pas comme une fin, mais comme un moyen, une arme supplémentaire dans l’arsenal législatif pour lutter contre ces comportements.
Dans sa grande majorité, le groupe du RDSE votera ce texte, qui constitue un progrès pour ce qui concerne la protection des victimes de violences sexuelles et sexistes, même s’il regrette qu’il ait été quelque peu affaibli au gré des deux lectures.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et sur des travées du groupe Union Centriste, ainsi qu ’ au banc des commissions. – MM. François Patriat et Daniel Chasseing applaudissent également.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
TITRE IER
DISPOSITIONS RENFORÇANT LA PROTECTION DES MINEURS CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES
Chapitre IER A
Dispositions relatives aux orientations de la politique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
Chapitre IER
Dispositions relatives à la prescription
I. – L’article 7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706-47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code pénal ».
II. – L’article 9-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code pénal ».
II bis. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° L’article 706-47 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : «, précédés ou accompagnés d’un viol, de tortures ou d’actes de barbarie, » sont supprimés ;
b) Le 2° est complété par les mots : « et crimes de violences sur un mineur de quinze ans ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente prévus à l’article 222-10 dudit code » ;
c) Au 3°, le mot : « dudit » est remplacé par les mots : « du même ».
III. – Le premier alinéa de l’article 434-3 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le mot : « eu » est supprimé ;
2° Après le mot : « administratives », sont insérés les mots : « ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n’ont pas cessé, ».
(Supprimés)
Chapitre II
Dispositions relatives à la répression des infractions sexuelles sur les mineurs
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 222-22-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur majeur.
« Lorsque les faits sont commis sur la personne d’un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. » ;
2° L’article 222-23 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou sur la personne de l’auteur » ;
b)
Supprimé
3° et 4°
Supprimés
5° Le paragraphe 3 de la section 3 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « commis sur les mineurs » sont supprimés ;
b) L’article 222-31-1 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « sur la personne d’un mineur » sont supprimés ;
– au 3°, les mots : « le mineur » sont remplacés par les mots : « la victime ».
I bis. – L’article 227-25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227 -25. – Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait, par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. »
II et II bis. –
Supprimés
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 351 est ainsi rédigé :
« Art. 351. – S’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président pose une ou plusieurs questions subsidiaires.
« Lorsque l’accusé majeur est mis en accusation du chef de viol aggravé par la minorité de quinze ans de la victime, le président pose la question subsidiaire de la qualification d’atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans si l’existence de violences ou d’une contrainte, menace ou surprise a été contestée au cours des débats. » ;
2° Après le même article 351, il est inséré un article 351-1 ainsi rédigé :
« Art. 351 -1. – Le président ne peut poser une ou plusieurs questions prévues aux articles 350 ou 351 que s’il en a préalablement informé les parties au cours des débats et au plus tard avant le réquisitoire, afin de permettre à l’accusé et à son avocat de faire valoir toutes les observations utiles à sa défense. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 706-53 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être accompagné, dans les mêmes conditions, par un représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. »
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 222-24 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
2° L’article 222-28 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
3° L’article 222-30 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. » ;
4° Après le même article 222-30, il est inséré un article 222-30-1 ainsi rédigé :
« Art. 222 -30 -1. – Le fait d’administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. » ;
5° À l’article 222-31, la référence : « 222-30 » est remplacée par la référence : « 222-30-1 ».
(Supprimé)
Le k de l’article L. 114-3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« k) Des actions de sensibilisation, de prévention et de formation concernant les violences, notamment sexuelles, à destination des professionnels et des personnes en situation de handicap ainsi que de leurs aidants. »
(Supprimé)
(Supprimés)
Le dernier alinéa de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « maires », sont insérés les mots : «, les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale » ;
2°
Supprimé
La section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l’article 222-24, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ; »
2° À l’article 222-29, après le mot : « grossesse », sont insérés les mots : « ou résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale ».
Après le troisième alinéa de l’article L. 1434-2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce schéma régional de santé comprend un programme relatif à la prévention des violences sexuelles et à l’accès aux soins des victimes de ces violences. »
(Supprimé)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les dispositifs locaux d’aide aux victimes d’agressions sexuelles, permettant à ces victimes d’être accompagnées et de réaliser les démarches judiciaires au sein même des centres hospitaliers universitaires.
La dernière phrase de l’article L. 121-1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « ainsi qu’une obligation de sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement. »
(Supprimé)
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉLITS DE HARCÈLEMENT SEXUEL ET DE HARCÈLEMENT MORAL
I. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 222-33 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « ou sexiste » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction est également constituée :
« 1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« 2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
1° bis Le III du même article 222-33 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article 222-33-2-2, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’infraction est également constituée :
« a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
« b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. » ;
3° Le 4° du même article 222-33-2-2 est complété par les mots : « ou par le biais d’un support numérique ou électronique » ;
4° Aux deuxième et dernier alinéas du même article 222-33-2-2, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier à quatrième alinéas ».
II. – Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les mots : « faites aux femmes » sont remplacés par les mots : « sexuelles et sexistes » et, après le mot : « articles », est insérée la référence : « 222-33, ».
L’article L. 312-9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette formation comporte également une sensibilisation sur l’interdiction du harcèlement commis dans l’espace numérique, la manière de s’en protéger et les sanctions encourues en la matière. »
Le code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 132-80 est complété par les mots : «, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas » ;
2° Le chapitre II du titre II du livre II est ainsi modifié :
a) Le paragraphe 2 de la section 1 est ainsi modifié :
– l’avant-dernier alinéa de l’article 222-8 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à trente ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise :
« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
– l’avant-dernier alinéa de l’article 222-10 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-9 est commise :
« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
– après le 15° de l’article 222-12, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise :
« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
– la première phrase de l’avant-dernier alinéa du même article 222-12 est supprimée ;
– après le mot : « infractions », la fin du dernier alinéa dudit article 222-12 est ainsi rédigée : « prévues au présent article lorsqu’elles sont punies de dix ans d’emprisonnement. » ;
– après le 15° de l’article 222-13, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa est commise :
« a) Sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ;
« b) Alors qu’un mineur assiste aux faits et que ceux-ci sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ou, si la victime est mineure, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur victime. » ;
– la première phrase du dernier alinéa du même article 222-13 est supprimée ;
b) La section 3 est ainsi modifiée :
– l’article 222-24 est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; »
– l’article 222-28 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ; »
– le III de l’article 222-33 est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
« 8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. » ;
c) La section 3 bis est ainsi modifiée :
– le premier alinéa de l’article 222-33-2-1 est complété par les mots : « ou ont été commis alors qu’un mineur était présent et y a assisté » ;
– après le 4° de l’article 222-33-2-2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté. » ;
– à la fin du dernier alinéa du même article 222-33-2-2, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° ».
Après le mot : « blessure », la fin du 1° de l’article 222-28 du code pénal est ainsi rédigée : «, une lésion ou une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; ».
TITRE III
DISPOSITIONS RÉPRIMANT L’OUTRAGE SEXISTE
I. – Le livre VI du code pénal est ainsi modifié :
1° Le titre unique devient le titre Ier ;
2° Il est ajouté un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DE L’OUTRAGE SEXISTE
« Art. 621 -1. – I. – Constitue un outrage sexiste le fait, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
« II. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette contravention peut faire l’objet des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’amende forfaitaire, y compris celles concernant l’amende forfaitaire minorée.
« III. – L’outrage sexiste est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsqu’il est commis :
« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Sur un mineur de quinze ans ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 6° Dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 7° En raison de l’orientation sexuelle, vraie ou supposée, de la victime.
« La récidive de la contravention prévue au présent III est réprimée conformément au premier alinéa de l’article 132-11.
« IV. – Les personnes coupables des contraventions prévues aux II et III du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ;
« 2° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de citoyenneté ;
« 3° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de sensibilisation à la lutte contre l’achat d’actes sexuels ;
« 4° L’obligation d’accomplir, le cas échéant à leurs frais, un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et les violences sexistes ;
« 5° Dans le cas prévu au III, un travail d’intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »
II. – Après le 9° bis de l’article 131-16 du code pénal, il est inséré un 9° ter ainsi rédigé :
« 9° ter L’obligation d’accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes ; ».
III. – La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
1° Au 2° de l’article 41-1, après le mot : « sexistes », sont insérés les mots : «, d’un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes » ;
2° Après le 18° de l’article 41-2, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes. »
IV. – L’avant-dernier alinéa de l’article 21 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ainsi que les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ».
V. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2241-1 du code des transports, après le mot : « titre », sont insérés les mots : «, les contraventions prévues à l’article 621-1 du code pénal ».
Après l’article 226-3 du code pénal, il est inséré un article 226-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 226 -3 -1. – Le fait d’user de tout moyen afin d’apercevoir les parties intimes d’une personne que celle-ci, du fait de son habillement ou de sa présence dans un lieu clos, a caché à la vue des tiers, lorsqu’il est commis à l’insu ou sans le consentement de la personne, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis sur un mineur ;
« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Lorsqu’ils sont commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
« 6° Lorsque des images ont été fixées, enregistrées ou transmises. »
(Supprimé)
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Veiller au repérage et à l’orientation des mineurs victimes ou menacés de violences sexuelles, notamment des mineures victimes de mutilations sexuelles ; ».
(Supprimé)
L’article 1676 du code civil est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « aussi » est supprimé.
(Supprimé)
TITRE III bis A
DISPOSITIONS DIVERSES
(Division et intitulé supprimés)
(Supprimé)
TITRE III bis
ÉVALUATION
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l’année, un rapport sur la politique publique de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dont sont victimes les enfants, les femmes et les hommes. Cette annexe générale :
1° Récapitule, par ministère et pour le dernier exercice connu, l’ensemble des crédits affectés à cette politique publique ;
2° Évalue, au regard des crédits affectés, la pertinence des dispositifs de prévention et de répression de ces violences ;
3° Comporte une présentation stratégique assortie d’objectifs et d’indicateurs de performance, une présentation des actions ainsi que des dépenses et des emplois, avec une justification au premier euro. Elle comporte, pour chaque objectif et indicateur, une analyse entre les résultats attendus et obtenus ainsi qu’une analyse des coûts associés ;
4° Prend en compte la poursuite de la mise en œuvre des plans interministériels de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants et les moyens nécessaires à cet effet.
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER
I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
II. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711 -1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Annexe
RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES
(Division et intitulé supprimés)

Nous allons maintenant examiner l’amendement déposé par le Gouvernement.

Sur les articles 1er A à 2 bis D, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« 3° bis Lorsqu’il est commis sur une personne …
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel de coordination.
L ’ amendement est adopté.

Sur les articles 2 bis EB à 5, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Françoise Laborde, pour explication de vote.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, Maryse Carrère a indiqué que la majorité des membres du groupe du RDSE voterait en faveur de ce texte. L’interrogation porte sur mon vote.
Je déplore certains manques dans ce texte, mais je dois reconnaître un mieux, madame la secrétaire d’État. Je ne manquerai pas de revenir à la charge lors des chantiers de la justice sur un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur : la pédophilie, le renforcement des mesures concernant les cas d’inceste. À cet égard, on m’avait opposé une question prioritaire de constitutionnalité de 2011, mais j’ai travaillé cette question : la loi du 14 avril 2016 a réintroduit l’inceste dans le code pénal. Aussi, je ne manquerai pas de revenir sur ce point.
J’évoquerai enfin la disparition d’une implication plus importante dans la loi des signalements des enfants victimes par les médecins. Même si cela figure dans le code de déontologie, seuls 3 % des médecins procèdent à ces signalements.
En dépit de ces observations, je reconnais que le présent texte représente un mieux. Aussi, je le voterai.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l’amendement du Gouvernement, l’ensemble du projet de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe La République En Marche.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 230 :
Nombre de votants342Nombre de suffrages exprimés252Pour l’adoption252Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (texte n° 697, résultat des travaux de la commission n° 701, rapport n° 700).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre d’État, ministre de l’intérieur, qui m’a demandé de le représenter aujourd’hui en raison de sa présence à l’Assemblée nationale, aux côtés du Premier ministre, pour le débat sur les motions de censure. Chacun comprendra que sa présence à l’Assemblée nationale était indispensable.
Après l’échec de la commission mixte paritaire, qui, le 4 juillet dernier, n’est pas parvenue à un accord, l’Assemblée nationale a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Elle a adopté jeudi dernier une version rétablissant les grands équilibres auxquels elle était parvenue en avril dernier, mais prenant également en compte un certain nombre d’apports issus de l’examen du texte par la Haute Assemblée en première lecture.
Conformément au dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution, il appartient désormais au Sénat de se prononcer en nouvelle lecture dans des délais que je sais particulièrement contraints, mais qui découlent de la volonté du Gouvernement d’achever l’examen parlementaire de ce texte avant l’été, afin que les mesures qu’il contient puissent rapidement entrer en vigueur.
Au cours de sa réunion de ce matin, votre commission des lois, tirant les conséquences de l’échec de la commission mixte paritaire, a décidé de proposer au Sénat l’adoption d’une motion tendant à opposer la question préalable. Le Gouvernement prend acte de cette décision et ne pourra que se plier à la décision que la Haute Assemblée rendra tout à l’heure.
Je veux dire solennellement que le Gouvernement aurait largement préféré que les assemblées parviennent à un accord. Je sais, mesdames, messieurs les sénateurs, que vous y avez travaillé dans le cadre d’un dialogue constructif avec les députés, la majorité de l’Assemblée nationale ayant notamment proposé un certain nombre de compromis. Toutefois, concernant certains grands choix politiques défendus par le Sénat, qu’il s’agisse de l’instauration de quotas ou du remplacement de l’aide médicale de l’État par une aide médicale d’urgence, le Gouvernement et sa majorité ne pouvaient y souscrire. Dès lors, face à une telle situation de blocage, la commission mixte paritaire n’a pu que tirer les conséquences de ces désaccords, nous le regrettons… peut-être tous d’ailleurs ! Il est désormais temps d’avancer.
Cela fait près d’un an que les grandes options retenues par le Gouvernement en matière d’asile et d’immigration font l’objet de débats, depuis la présentation par le Premier ministre, le 12 juillet 2017, du plan d’action intitulé Garantir le droit d ’ asile, mieux maîtriser les flux migratoires.
Depuis la fin de l’année 2017, le Gouvernement a lancé les concertations pour la préparation du projet de loi avec plus de trente associations engagées dans l’hébergement d’urgence et l’accueil des demandeurs d’asile. Le ministre d’État et moi-même avons, du reste, longuement consulté et écouté le milieu associatif au cours de cette période.
Le projet de loi est, quant à lui, connu depuis le 21 février dernier, date de son passage en conseil des ministres. Il a fait l’objet de débats intenses et nourris en commission et en séance publique, aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat. Il a été largement amendé, précisé et enrichi ; et je dois dire que la version qui vous est aujourd’hui soumise est le fruit des travaux parlementaires.
Après le temps de la discussion parlementaire, le Gouvernement considère qu’il faut désormais passer au temps de l’action. Car s’il est un enjeu au cœur des préoccupations des Français sur lequel il est indispensable d’apporter des solutions, c’est bien celui de l’asile et de l’immigration.
Cela a souvent été rappelé lors des débats, alors que le nombre des demandeurs d’asile a diminué de moitié en Europe entre 2016 et 2017, passant de 1, 2 million à 600 000 personnes, il a cependant continué à augmenter en France, avec 100 000 demandeurs en 2017, ce qui représente une croissance de 17 % en un an.
Les conséquences de cette évolution, les Français les vivent au quotidien parce que le parc d’hébergement des demandeurs d’asile est saturé, que celui de l’hébergement d’urgence l’est tout autant et que se développent dans le cœur de nos villes des campements dont chacun sur ces travées s’accorde à dire qu’ils sont indignes de notre République. Pour faire face à cette situation de plus en plus intenable, le Président de la République et le Gouvernement interviennent sur tous les fronts.
Nous agissons à l’échelon international pour contribuer à la stabilisation de la rive sud de la Méditerranée et pour faire en sorte, au travers de l’aide au développement, que la jeunesse des pays africains puisse trouver un avenir. En outre, par une coopération étroite avec les États africains, nous pourrons mieux lutter contre les filières de passeurs qui font trafic d’êtres humains.
Nous agissons également au plan européen pour rapprocher les législations des États membres, pour consolider le régime d’asile européen commun, pour renforcer les frontières de l’espace Schengen et pour faire en sorte que les pays qui bénéficient d’une exemption de visas ne voient pas un certain nombre de leurs ressortissants détourner cette disposition en déposant des demandes d’asile abusives. Ces mesures sont indispensables, car c’est évidemment à l’échelon européen qu’il faut concevoir les réponses à apporter aux défis migratoires – chacun a pu voir à quel point la question migratoire était de nature à mettre profondément en question les relations entre les États au sein de l’Union européenne.
Toutefois, il est aussi indispensable que nous revoyions nos propres politiques qui ne fonctionnent plus.
La France doit continuer à être une terre d’accueil pour toutes celles et tous ceux qui fuient la guerre et les persécutions ; mais nous devons aussi éloigner de notre territoire celles et ceux qui n’ont pas de droit au séjour.
L’objectif principal du Gouvernement, avec les actions qu’il met en œuvre, est, comme vous le savez, la réduction du délai d’instruction de la demande d’asile à six mois. Ainsi, ceux qui ont vocation à obtenir une protection pourront commencer plus rapidement leur parcours d’intégration, tandis que ceux qui, au contraire, seront déboutés pourront regagner leur pays sans que les liens familiaux et sociaux avec leur pays d’origine se soient distendus.
Réduire les délais d’instruction de la demande d’asile, c’est ce que vise ce projet de loi, et c’est aussi ce que nous avons commencé à réaliser dans les faits. Pour ne prendre qu’un exemple, le temps nécessaire pour obtenir un premier rendez-vous en préfecture est ainsi passé en quelques mois de vingt et un jours à moins de quatre jours seulement. De plus, les renforcements d’effectifs dans les services étrangers des préfectures, avec 150 équivalents temps plein, permettront de progresser encore sur cette voie.
Il fallait aussi gagner en efficacité pour ce qui concerne nos politiques d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Vous le savez, grâce à la mobilisation des préfets et de l’ensemble des services, le nombre de personnes ayant quitté le territoire a augmenté de 21, 6 % en un an.
Enfin, dans le cadre de la loi de finances pour 2018, nous avons mobilisé les moyens budgétaires qui vont nous permettre à la fois d’héberger dans des conditions dignes les demandeurs d’asile et de mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à rester sur notre sol au travers, notamment, du renforcement des cours de Français.
Nous en sommes persuadés, avec ce projet de loi, nous apportons la bonne réponse, une réponse qui ne nie pas les problèmes que nous connaissons en matière d’asile et d’immigration, mais entend leur apporter des solutions équilibrées.
Nous avons largement débattu du contenu de ce texte. Aussi ne reviendrai-je pas en détail sur les différentes mesures que comporte celui-ci.
Si l’Assemblée nationale a, en nouvelle lecture, rétabli en très grande partie les dispositions qu’elle avait adoptées le 22 avril dernier, elle a retenu plusieurs modifications du texte adoptées par le Sénat.
À ce titre, j’observe que le projet de loi voté par les députés comporte l’article 4 A relatif à l’intégration des aspects liés à l’identité de genre dans les motifs de persécution, au sens de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Y figurent également l’obligation pour l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de refuser ou de mettre fin au statut de réfugié en cas de condamnations pour des faits graves, notamment de terrorisme, prononcées dans un autre pays de l’Union européenne, ainsi que l’obligation pour l’Office de statuer en procédure accélérée quand le demandeur constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État.
On retrouve aussi l’article 5 bis qui consacre dans la loi les opérations de réinstallation dans les pays tiers, organisées par les autorités en charge de la politique de l’asile.
Parmi les mesures votées par le Sénat, on compte en outre le maintien à trente jours du délai de recours devant la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile, maintien assorti d’une évolution des délais de l’aide juridictionnelle, comme votre assemblée nous avait invités à le faire, et la mise en place d’une commission de concertation ad hoc composée de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de l’éducation nationale, de gestionnaires de lieux d’hébergement et d’associations de défense des droits des demandeurs d’asile, commission qui émettra un avis sur les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile et d’intégration des réfugiés.
Par ailleurs, je note la reprise des articles 9 ter et 9 quater issus de la proposition de loi déposée par M. Thani Mohamed Soilihi, qui a pour objet d’adapter l’application du droit du sol à Mayotte, compte tenu de l’ampleur de l’enjeu migratoire dans l’archipel. Le Gouvernement étant très attentif à la situation mahoraise et déterminé à apporter des solutions pragmatiques à cette problématique migratoire spécifique, nous avons, dans le droit fil des propos tenus par le chef de l’État, décidé de soutenir ces dispositions.
Enfin, il faut mentionner l’article 26 sexies autorisant la constitution d’un traitement de données comprenant les empreintes digitales et la photographie des personnes se présentant comme des mineurs non accompagnés, dans le double objectif d’assurer la protection de l’enfance et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers.
Il me semblait important de rappeler ces apports voulus par le Sénat, qui a été entendu sur tous ces points.
S’agissant du placement en rétention des familles accompagnées de mineurs, sujet délicat qui touche chacune et chacun d’entre nous, le Gouvernement a pris bonne note de la solution retenue par la commission des lois de l’Assemblée nationale. Si votre Haute Assemblée avait décidé de limiter à cinq jours le placement en rétention des mineurs accompagnés de leurs parents, le Gouvernement avait fait valoir les difficultés opérationnelles qui pouvaient s’opposer à une telle limitation. Je crois d’ailleurs que celles-ci avaient été entendues.
Je rappelle d’abord que la procédure de placement en rétention des familles doit toujours demeurer exceptionnelle, car l’intérêt de l’enfant doit évidemment primer. C’est la raison pour laquelle cette procédure est strictement encadrée et que l’on ne doit y recourir que lorsque la famille s’est déjà soustraite à une procédure d’éloignement.
Il est toutefois nécessaire de la prévoir, car c’est le seul moyen pour faire appliquer le droit dans certaines situations. Bien entendu, dans ces cas, nous veillerons à ce que celle-ci s’effectue dans des locaux adaptés, uniquement destinés à l’accueil des familles, et à ce qu’elle soit toujours la plus brève possible.
Sur ce sujet, le Gouvernement a entendu les préoccupations exprimées par les députés et les sénateurs et demeurera attentif, dans le cadre d’initiatives législatives qui pourraient intervenir prochainement, aux équilibres entre ces différentes exigences.
Je veux, pour terminer, souligner que l’Assemblée nationale a rétabli l’article 19 ter du projet de loi relatif au prétendu « délit de solidarité », article qui avait été supprimé par le Sénat. Les députés étaient d’autant plus fondés à le faire qu’il était nécessaire de tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet dernier.
En effet, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions existantes, au motif que l’exemption pénale actuellement prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’aide accordée aux personnes en situation irrégulière ne s’étendait pas à l’aide à la circulation. Il a rappelé bien sûr que cette exemption ne doit s’appliquer que si l’aide poursuit un but humanitaire.
Or tel était précisément l’objet principal de l’article 19 ter voulu par les députés qui ont, de surcroît, adopté un amendement en séance publique, qui tire les conséquences de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur le fait que tout acte en relation avec une aide au séjour ou à la circulation, apportée dans un but humanitaire, ne saurait faire l’objet de poursuites pénales.
Le Gouvernement relève enfin que la décision du Conseil constitutionnel rappelle bien que « l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle » et que, à ce titre, l’aide à l’entrée, et donc au franchissement de la frontière, doit demeurer pénalement répréhensible.
Voilà ce que je souhaitais faire valoir en introduction de ce débat. Je relève que, malgré les points de convergence auxquels nous sommes parvenus, les désaccords entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale, dont certains membres me semblent étrangers à l’efficacité des politiques publiques, ont prévalu.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche. – M. Jean-François Longeot applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais formuler quelques observations à l’issue de la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, qui s’est tenue le 4 juillet dernier.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre le Sénat et l’Assemblée nationale, et le texte qui nous revient aujourd’hui est celui de l’Assemblée nationale.
Je tiens à rappeler que, en première lecture, nous avions largement réécrit ce texte en élaborant, si ce n’est un contre-projet, en tout cas un nouveau projet qui nous paraissait plus cohérent, plus ferme et plus réaliste pour notre politique migratoire.
Ce texte tendait notamment à renforcer les peines complémentaires d’interdiction du territoire, à réduire le nombre de visas accordés aux pays les moins coopératifs, qui font échec aux procédures d’éloignement de leurs ressortissants en refusant de délivrer les laissez-passer consulaires, à réintroduire la visite médicale des étudiants étrangers, afin de répondre à un grave enjeu de santé publique, à réorganiser la durée de la rétention administrative, à interdire le placement en rétention des mineurs isolés et, enfin, à encadrer rigoureusement celui des mineurs accompagnant leur famille.
La réduction de trente à quinze jours du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, prévue par le Gouvernement, mais que nous avons considérée comme étant attentatoire aux droits des demandeurs d’asile et inefficace, avait été supprimée.
En outre, un effort particulier avait été consenti en faveur de l’intégration des étrangers en situation régulière, avec un investissement renforcé dans les cours de français et l’appui de Pôle emploi pour améliorer les dispositifs d’insertion sur le marché de l’emploi.
Enfin, le Sénat avait souhaité soutenir et accompagner les collectivités territoriales en proposant l’insertion des places d’hébergement des demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux prévu par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, et la création d’un fichier national biométrique des étrangers déclarés majeurs à l’issue de leur évaluation par un département. Cette mesure qui ne figurait ni dans le projet de loi initial ni dans le texte issu de l’Assemblée nationale était souhaitée par le Sénat et était très attendue par l’ensemble des départements français.
Malgré un dialogue constructif engagé avec l’Assemblée nationale – il faut le reconnaître –, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à un accord, les concessions nécessaires pour trouver un compromis semblant trop importantes.
La commission des lois du Sénat et moi-même regrettons que le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture ne prenne finalement que très marginalement en compte les préoccupations majeures exprimées par la Haute Assemblée.
Cependant, je note quelques points d’accord entre les deux chambres. Il faut insister sur le fait que l’Assemblée nationale a conservé le délai de trente jours pour interjeter appel des décisions de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile – c’est un point auquel nous étions attachés –, ainsi que l’adaptation du droit du sol à Mayotte.
De même, il faut se féliciter de la création d’un fichier comportant les empreintes digitales et une photographie des étrangers se présentant comme des mineurs non accompagnés, même si cette initiative n’est pas tout à fait la même que celle que nous avions adoptée. Il n’en demeure pas moins qu’elle constitue une première étape.
Je voudrais également souligner que la disposition prévoyant l’évolution du droit du sol à Mayotte, adoptée sur l’initiative de notre collègue Thani Mohamed Soilihi et largement soutenue par le Sénat, a été conservée.
J’ajoute que les désaccords entre l’Assemblée nationale et le Sénat sont malgré tout restés extrêmement nombreux.
Le texte transmis aujourd’hui constitue une véritable occasion manquée – je le dis – en matière de lutte contre l’immigration irrégulière tout particulièrement : il ne prévoit ni stratégie migratoire ni aucune des mesures de rigueur proposées par le Sénat. Je pense notamment à un meilleur encadrement de l’immigration familiale et à une plus grande efficacité des procédures dites « Dublin ». Il y a évidemment bien d’autres mesures dans ce domaine qui nous auraient permis de nous montrer beaucoup plus fermes.
De même, les politiques d’intégration demeurent le parent pauvre de ce texte, alors que l’Assemblée nationale aurait pu utilement s’inspirer des mesures de bon sens proposées par le Sénat, comme la certification du niveau de langue des étrangers primo-arrivants, une meilleure insertion dans l’emploi, la prise en compte de leur connaissance des questions de civisme et des règles de notre République. C’est avec la volonté d’engager une démarche qualitative et le souhait de former, en s’en donnant les moyens, les étrangers primo-arrivants sur notre territoire que nous avions introduit de telles mesures dans le texte. Ces dernières ont malheureusement disparu.
Des désaccords majeurs persistent également sur les modalités d’organisation de la rétention.
Le séquençage adopté par l’Assemblée nationale est finalement à la fois peu protecteur pour les étrangers et trop contraignant pour l’autorité administrative et les tribunaux. Combien de fois nos services nous ont-ils dit qu’une réforme impliquant une intervention du juge des libertés et de la détention au cinquième jour de rétention ne laisserait pas de côté les droits du demandeur et permettrait à l’administration de mieux se défendre devant les tribunaux, notamment parce que les décisions d’annulation de mesures de rétention sont en grande partie motivées par des problèmes de forme plutôt que par des problèmes de fond ? Nous aurions gagné en termes d’efficacité dans la lutte que nous menons contre l’immigration irrégulière.
Mes chers collègues, nous avons interdit la rétention des mineurs isolés. Nous l’avons exprimé clairement, et cet engagement a été conservé dans le texte de l’Assemblée nationale.
En revanche, pour les mineurs accompagnants, nous avions estimé que le délai de cinq jours était un délai maximum, qui ne pouvait être dépassé. Or cette disposition n’a pas été retenue par l’Assemblée nationale, avec la conséquence pratique que des mineurs accompagnants pourraient rester jusqu’à quatre-vingt-dix jours en rétention, puisqu’il s’agit du nouveau délai fixé par le texte.
Nous avons également relevé un certain manque de considération pour l’action des collectivités territoriales en faveur de l’accueil des demandeurs d’asile, alors que le Sénat avait adopté plusieurs mesures visant à les soutenir, comme l’inclusion des dispositifs d’hébergement des demandeurs d’asile dans le décompte de logements sociaux – j’en ai déjà parlé – ou l’introduction de représentants des collectivités territoriales au sein du conseil d’administration de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII. Plus aucune de ces mesures ne figure dans le texte.
Enfin, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture deux mesures clairement contraires à la règle dite de « l’entonnoir », qui résulte de l’article 45 de la Constitution : la suppression du rôle de coordination des centres provisoires d’hébergement en matière d’intégration des réfugiés, et une mesure plus « exotique » – si vous me permettez cette expression à la tribune –, l’habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer le contentieux des étrangers devant les juridictions administratives et créer des procédures d’urgence devant la CNDA.
Il s’agit d’un sujet pourtant très important à tout point de vue, qui échappera de fait aux assemblées et, singulièrement, au Sénat. Cette question avait fait l’objet d’une discussion ici même, lors d’une séance qui avait vu le Gouvernement revenir sur ses intentions initiales. C’est une difficulté qu’il faut souligner.
À l’issue de ses travaux, la commission des lois a décidé de ne pas adopter le texte issu de l’Assemblée nationale et de déposer une motion tendant à opposer la question préalable au présent projet de loi, en application de l’article 44, alinéa 3, du règlement du Sénat. La commission souhaite naturellement que cette motion soit examinée à l’issue de la discussion générale avant une éventuelle discussion des articles.
Il y aurait encore beaucoup à dire, mais, comme mon temps de parole touche à sa fin, je terminerai mon propos en remerciant l’ensemble des collègues qui ont travaillé sur ce texte et ont contribué à l’améliorer, ainsi que les services de la commission, qui ont effectué un travail considérable !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur les travées du groupe La République En Marche.
M. Julien Bargeton applaudit.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à l’occasion de l’examen en nouvelle lecture de ce projet de loi, notre groupe exprime de nouveau une position politique globalement favorable au texte issu de l’Assemblée nationale, lequel reste en cohérence avec la proposition initiale du Gouvernement, c’est-à-dire la volonté de faciliter l’accueil des réfugiés, tout en mettant en place et en renforçant les procédures qui permettent de renvoyer effectivement les personnes dépourvues de droit au séjour.
Notre approche politique est différente de celle du rapporteur et de la majorité sénatoriale qui, à l’occasion de l’examen de ce texte, ont voulu élaborer un contre-projet, comme l’a dit M. Buffet en commission ce matin, bien qu’il ait un peu adouci la formule il y a un instant en parlant d’un nouveau projet…

… qui, s’appuyant sur divers arguments, s’oppose à la cohérence du projet gouvernemental.
J’en profite d’ailleurs pour reconnaître, comme je l’avais déjà fait, les apports constructifs et très bien conçus de la commission sur un certain nombre de sujets concrets, donnant lieu à une forme de convergence avec le Gouvernement.
Je voulais surtout souligner qu’un nombre important d’apports du Sénat ont été retenus par l’Assemblée nationale. Là encore, je donnerai un éclairage un peu différent de celui du rapporteur, même si la liste des mesures est comparable. Je mettrai simplement un peu plus en lumière les mêmes concessions.
Il y a tout d’abord l’extension du droit d’asile aux personnes victimes ou menacées par des persécutions à caractère sexuel. On trouve également dans le texte une précision sur la capacité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à accueillir dans des pays tiers des candidats au titre de réfugié.
Par ailleurs, le projet de loi maintient à trente jours le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, avec une évolution du délai de l’aide juridictionnelle, et comporte encore d’autres mesures importantes, comme la concertation organisée avec les collectivités territoriales sur les schémas régionaux d’accueil des demandeurs d’asile, le droit du sol encadré à Mayotte et l’établissement d’une carte de séjour pour les jeunes au pair.
Nous considérons donc que le bicamérisme a joué son rôle positif, malgré l’absence d’accord global en commission mixte paritaire. Je crois que c’est de bonne foi que la majorité des députés, favorable à ce texte, a englobé une partie significative des apports du Sénat.
Chacun sait que, chaque année, au moment du bilan de l’application des lois, nous faisons une statistique sur la proportion des textes adoptés ayant repris des dispositions du Sénat. Celles que je viens de mentionner figureront en conséquence dans la colonne positive.
En revanche, il est exact de dire que le texte issu de l’Assemblée nationale s’inscrit dans la logique politique de la majorité de l’Assemblée nationale et du Gouvernement. Cela signifie que certains apports emblématiques de l’opposition, représentée ici par la majorité sénatoriale, n’ont pas été pris en compte, comme la transformation de l’aide médicale de l’État, le refus automatique du statut de réfugié en cas de motif d’ordre public, ou encore une disposition, en l’occurrence non normative, obligeant le Gouvernement à refuser des visas, alors qu’il s’agit d’une prérogative purement gouvernementale.
Nous pouvons conclure que le dialogue entre les deux assemblées s’est déroulé positivement, normalement, et qu’il est tout à fait compréhensible, à la date à laquelle je parle, et compte tenu de l’ampleur prise par le débat, que la majorité de la commission dépose une motion tendant à opposer la question préalable.
Simplement, gardons le sens des lignes politiques. L’adoption de cette motion peut avoir deux sens : soit un refus global de la logique du texte – c’est la position du rapporteur et d’une partie de la majorité sénatoriale –, soit le constat pragmatique que le contenu du projet de loi est stabilisé…

M. Alain Richard. … et qu’un examen en nouvelle lecture n’a pas énormément d’intérêt – c’est notre position.
M. Roger Karoutchi rit.

Par conséquent, comme il ne nous paraît pas cohérent que les adversaires et les partisans d’un texte se retrouvent dans un même vote, …

M. Alain Richard. … nous nous abstiendrons sur la motion et laisserons la responsabilité à la majorité sénatoriale, en tout cas à ceux de cette majorité qui en font le choix, d’adopter cette motion.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, alors que plusieurs mouvements populistes, voire néofascistes, creusent leur sillon au cœur de l’Europe, le dossier des migrants s’est installé ces derniers mois comme une thématique d’actualité importante et révélatrice d’une profonde crise au sein de l’Union européenne.
Avec – certainement – en ligne de mire l’échéance électorale à venir et – justement – le scrutin européen de mai prochain, le Gouvernement et sa majorité En Marche défendent depuis avril un texte traitant à la fois du droit d’asile et du droit des étrangers, en s’attaquant aux droits fondamentaux et à la dignité humaine.
Madame la ministre, je vous le dis d’emblée, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste s’opposeront de nouveau très fermement à ce projet de loi, qui tend à refermer le pays des droits de l’homme sur lui-même, et ce dans un double objectif.
D’abord, il vise à montrer aux migrants qu’il ne faut surtout pas demander l’asile en France ; ensuite, il tend à rassurer les électeurs ou les sympathisants d’extrême droite
M. Roger Karoutchi s ’ esclaffe.

Sans viser le même objectif précis, mais en tout cas en respectant les mêmes finalités générales, la majorité sénatoriale a fait adopter un certain nombre de mesures qui ont durci le texte et qui ont d’ailleurs fait échouer la commission mixte paritaire : l’introduction d’un vote parlementaire sur le nombre d’étrangers admis au séjour, par catégories, pour les trois ans à venir, la suppression de l’article 1er relatif à la délivrance de titres pluriannuels aux apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, le durcissement des conditions de réunification et de regroupement familial, ou encore la suppression de l’aide médicale de l’État.
Cependant, s’agissant de l’économie générale du texte, il n’existe pas, selon nous, de profonde divergence entre les deux majorités parlementaires et, donc, entre la droite et le Gouvernement. Je rappelle que l’une des mesures les plus préoccupantes que le Sénat ait introduites a été adoptée in extenso par les députés du groupe La République en Marche : la limitation du droit du sol à Mayotte qui rend obligatoire, pour les enfants nés à Mayotte, la présence de manière régulière sur le territoire national de l’un de leurs parents depuis plus de trois mois au jour de leur naissance.
Une brèche est ainsi ouverte dans le droit du sol, et l’amendement proposé par le député Guillaume Larrivé, qui a défendu l’extension de cette restriction à l’ensemble du territoire « au nom de l’unité du droit de la nationalité », ne fait que confirmer notre inquiétude !
Ainsi, l’équilibre revendiqué par la majorité à l’Assemblée nationale ne nous satisfait pas davantage et représente au contraire, pour nous, un leurre. Finalement, nous n’approuvons pas le texte, que ce soit dans sa version sénatoriale « aggravée » ou dans sa version initiale, quelque peu amendée par l’Assemblée nationale, qui portait déjà gravement atteinte au droit d’asile et aux droits des étrangers. Il y a peu, Gérard Collomb, qui souhaitait voir la loi adoptée avant le mois de septembre, indiquait que « l’aile gauche [n’était] pas représentative de la majorité ».
Le mois dernier, lors du long débat qui a eu lieu sur ce texte au Sénat, nous avons eu l’occasion d’exprimer l’ensemble des positions de notre groupe, que ce soit à travers la motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité que nous avons déposée, ou à travers la centaine d’interventions que nous avons effectuées. Aussi vais-je me borner à l’essentiel.
La grande majorité de nos amendements a été rejetée : ils n’exprimaient pourtant pas une idée très révolutionnaire de notre politique migratoire. Il s’agissait simplement d’améliorer les conditions de vie et d’accueil des personnes, en respectant l’intérêt supérieur de l’enfant, en veillant notamment aux droits fondamentaux : un toit, la santé, les besoins alimentaires ainsi que, éventuellement, les mêmes droits de recours que pour tout justiciable et un accès facilité au travail…
En outre, ces amendements veillaient à garantir le respect des principes fondamentaux auxquels notre pays a souscrit dans sa Constitution et dans ses engagements internationaux, considérant que, dans une Europe en proie à la montée des nationalismes, la France devait prendre ses responsabilités et réaffirmer les valeurs qu’elle a toujours défendues, et qui sont au fondement de notre République.
Je le répète, car cela est suffisamment grave pour être répété autant que de besoin, on estime à 148 millions le nombre des réfugiés climatiques à l’horizon de 2050, dont 5 millions pourraient venir en Europe.
Mes chers collègues, je vous pose la question : qu’en ferons-nous ?
Une chose est sûre : ce projet de loi et les postures politiciennes adoptées par les uns et les autres ne proposent aucune issue à ce défi humanitaire et sont loin d’être à la hauteur. Croyez bien que nous le regrettons et continuerons à faire entendre notre voix en ce sens.
( M. Roger Karoutchi s ’ exclame.) Eh oui, il y a tout de même une bonne nouvelle, mon cher collègue !
Sourires.

Enfin, je finirai mon intervention par la seule bonne nouvelle de ces dernières semaines. §

La fraternité devra désormais être respectée comme principe constitutionnel. Le Sénat s’honorerait à respecter la décision des sages en abrogeant totalement le délit de solidarité, qui n’est pas digne de notre devise républicaine.
« Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils sont frères ! » écrivait Voltaire dans son Traité sur la tolérance. Mes chers collègues, face à l’obscurantisme de certains, puisse le siècle des Lumières continuer à nous éclairer !
M. Pascal Savoldelli applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la motion tendant à opposer la question préalable sera à l’évidence adoptée. La plupart des membres du groupe Union Centriste ne participeront pas au vote ou ne la voteront pas, même si une partie non négligeable du groupe doit voter en sa faveur.
Nous souhaitions un accord en commission mixte paritaire, une position commune du Parlement sur un sujet aussi important. Nous reconnaissons volontiers, madame la ministre, que le texte proposé constituait une amélioration, oscillant entre humanité et protection du droit existant, en particulier avec certains apports du Sénat.
Nous n’étions pas dans l’idée de proposer un contre-projet. Notre analyse repose sur l’idée que l’échec des formations dites de gouvernement – ou de responsabilité – à trouver des accords sur ce type de sujet ne sert aucune d’entre elles, même quand elles sont dans l’opposition, et sert uniquement les extrêmes.
À cet égard, je souhaite vous faire part de nos insatisfactions, de nos convictions et, pour conclure, formuler une proposition.
Dans un premier temps, je tiens à exprimer nos insatisfactions. Nous n’avons pas pu échapper à une vision en noir et blanc, à forte dimension affective ou morale, probablement en raison de la procédure accélérée – vous le savez, mes chers collègues, elle n’est pas pertinente quand il s’agit d’examiner des sujets de société – et, peut-être aussi, en raison de l’instabilité législative. Nous sommes en effet saisis de la vingt-neuvième réforme en matière de droit des étrangers depuis 1980.
Il est en réalité difficile de mesurer ou d’analyser ce qui pourrait être efficace à court, moyen ou long terme dans le texte issu de l’Assemblée nationale. Maîtriser l’immigration est, à notre sens, la tâche d’une génération et relève, donc, d’une logique qui doit être étudiée dans une perspective de long terme.
Ce texte peine aussi à offrir une vision globale. Et pour cause !
Nous sommes devant des problèmes complexes, interdépendants, multifactoriels, avec des pays de départ, des pays de transit et des pays d’arrivée. La difficulté, pour l’exécutif comme pour le Parlement, est de travailler sur l’ensemble du dispositif : le traitement des migrations le plus en amont possible, l’aide au développement, le renforcement des frontières extérieures de l’Union européenne, les accords entre États pour éviter les mouvements secondaires, l’hébergement, les délais d’accès, les délais d’instruction, la reconduction de ceux qui ne bénéficient pas du statut de réfugié et l’intégration de ceux qui en bénéficient.
Oui, mes chers collègues, ce manque de stratégie globale, à l’échelle tant de la France que de l’Union européenne, explique l’insatisfaction de notre groupe, toutefois conscient que cette situation reflète les tensions parcourant la société civile française et européenne sur ces sujets.
J’en viens à nos convictions.
Depuis le début de nos débats, nous sommes convaincus que, pour être efficace, la politique de l’asile et de l’immigration doit être envisagée à l’échelle européenne.
Nous ne méconnaissons pas la souveraineté et l’identité des nations. Nous n’entendons pas nous défausser, sur le niveau européen, de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis de nos concitoyens ou de notre devoir d’efficacité à leur égard – sur cette question, comme sur toute autre. Loin de nous, également, l’idée ravageuse d’« opposer les élites et les peuples », pour reprendre une formule trop souvent employée.
Notre conviction est celle d’une souveraineté partagée. Il n’y a pas un volet communautaire, un volet intergouvernemental et, enfin, un volet franco-français. Pour nous, tout est lié. La souveraineté partagée sous-tend le renforcement de notre identité nationale comme de notre souveraineté d’État. Ce sont des éléments consubstantiels.
Dans le prolongement de l’affirmation de nos convictions, je voudrais insister sur deux points qui nous apparaissent comme des priorités.
La première priorité concerne la reconnaissance mutuelle, au moins entre une majorité de pays européens, des décisions en matière de droit d’asile, pour éviter le dépôt dans un pays donné d’une demande qu’un autre pays aurait refusée. Parmi les problèmes que nous avons à traiter, la question des mouvements secondaires, souvent évoquée par notre rapporteur François-Noël Buffet, est très importante.
La deuxième priorité concerne une correction du règlement dit « Dublin III ». Si des migrants entrant dans un pays européen laissent leurs seules empreintes, sans déposer de demande d’asile, et qu’ils rejoignent ensuite un pays voisin, ils ne peuvent pas y demander l’asile avant un délai d’un an et demi. Selon les praticiens, c’est une véritable incitation à la clandestinité, car les intéressés vont attendre, dans des conditions extrêmement négatives pour la société, l’expiration de ce délai pour faire une demande.
Ce sont deux sujets sur lesquels, madame la ministre, nous vous demandons de vous faire notre interprète afin que les dispositifs évoluent.
La proposition de mon groupe – et j’en terminerai là – est d’envisager l’étude d’une modalité de suivi conjoint entre le Parlement et l’exécutif. J’allais presque dire que le suivi du texte est aussi important que le texte lui-même, et je ne parle pas là, seulement, de l’évaluation correspondant à l’une des missions importantes du Parlement…
Dans ce domaine, nous faisons face à des phénomènes continus d’avancée et de recul, de stop and go. Il est probable qu’une trentième réforme sera assez vite envisagée, ne serait-ce que pour respecter les accords trouvés en Conseil européen. La création de plateformes régionales de débarquement en dehors de l’Union européenne ou de centres dits « contrôlés » sur base volontaire au sein de l’Union européenne pour séparer les réfugiés considérés comme éligibles à la protection et les migrants économiques supposerait, bien sûr, de nouvelles dispositions législatives.
Ce qui me semble important, madame la ministre, au risque d’insister une dernière fois, c’est que nous puissions avoir, sur cette problématique, non pas une vision technique – article par article, sujet par sujet –, mais une vision globale de l’ensemble de la question migratoire et du droit d’asile. D’ailleurs, je suis plutôt convaincu qu’il aurait mieux valu commencer par traiter du droit d’asile.
Mais, au point où en sont les choses, il faut un traitement global, inscrit dans des logiques de long terme. Pour cela, il faut aussi intégrer, dans nos débats, le suivi des discussions européennes, car les premiers et les secondes sont liés.
C’est pourquoi nous nous permettons d’insister sur une logique de groupe ou de comité de suivi, selon une modalité à déterminer – et il appartient, bien sûr, à l’exécutif de voir comment celui-ci pourrait fonctionner. En tout cas, cela nous permettrait d’envisager d’être opérationnels dans la durée, ne serait-ce, aussi, que par souci d’efficacité si une trentième réforme dans ce domaine se présentait à nous.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe La République En Marche.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, voilà probablement l’un des sujets qui heurtent ou interrogent le plus notre responsabilité politique, notre conception de l’action politique : l’asile et les migrations – migrations qui sont aussi vieilles que l’Humanité et, oserai-je même dire, en sont une partie constitutive.
Or que constate-t-on aujourd’hui en France, en Europe et même au-delà ? Un risque de convergence entre deux types d’attitudes.
Il y a d’abord ceux qui, par conviction ou par calcul, accompagnent et exacerbent les peurs de certains citoyens français ou européens, les manipulent pour parvenir au pouvoir et mener des politiques profondément inhumaines. Il y a ensuite ceux qui, percevant les peurs exprimées dans la société, tentent d’y répondre, quitte à remettre à plus tard les vraies solutions, susceptibles de fournir des réponses de long terme.
La convergence entre ces deux attitudes politiques constitue aujourd’hui un danger majeur !
Tout au long de ce débat, j’ai peu entendu relever ce qui, pourtant, est une constante s’agissant de mobilité et de migrations. De tout temps, celles-ci ont favorisé l’activité économique, la connaissance et les échanges ! Dans la situation actuelle de la planète, il ne serait pas inutile de poursuivre une telle démarche !
Bien entendu, cela ne signifie pas qu’il faut faire tout et n’importe quoi, et sans ordre. Mais considérer que l’immigration est un élément négatif ou laisser croire, de par ses attitudes, qu’elle est intrinsèquement mauvaise, c’est engendrer une spirale qui nous conduira à notre perte !

Autre élément majeur, pour répondre aux inquiétudes et aux peurs, en particulier sur le dumping social, il faut un droit du travail robuste, garantissant à toutes et à tous une protection identique. Dès lors, il sera possible de répondre aux craintes de ceux qui croient que d’autres peuvent leur prendre leur travail !
Aujourd’hui, alors que l’Europe est loin d’être la première destination des migrations actuelles, elle est prisonnière de ses peurs et complètement handicapée par celles-ci. Elle est affaiblie. Face à ses voisins et à ses partenaires, elle semble prête à renoncer aux principes qu’elle prétend fondateurs pour pouvoir se défendre contre une invasion supposée. Ce n’est pas raisonnable !
Entendre un certain nombre de « responsables », dans cet hémicycle et ailleurs, prétendre qu’il faudrait faire de la politique des laissez-passer consulaires l’alpha et l’oméga de nos relations bilatérales avec certains de nos partenaires est irresponsable. On ne peut pas ne pas parler de sécurité avec certains de nos voisins ! On ne peut pas vouloir résoudre à long terme la question des migrations sans parler de développement ! On ne peut pas lutter à long terme contre l’immigration illégale sans accepter une certaine dose d’échanges intellectuels, familiaux, commerciaux, permettant de diminuer ces différences de potentiel qui, aujourd’hui, posent énormément de problèmes.
En définitive, c’est en empêchant les mouvements légaux qu’on multipliera les mouvements illégaux.
Il faut donc organiser la légalité – une légalité réaliste – et c’est tout le contraire que l’on nous propose aujourd’hui, en particulier avec cette mesure visant à lier laissez-passer consulaires et délivrances de visas.
Si l’on veut lutter contre les départs vers l’Europe de la jeunesse de certains pays, il faut casser les mythes ! Celui qui part, par exemple, de Guinée vers la France ne doit pas pouvoir, systématiquement, raconter le film d’une réussite qui n’est pas réelle. Il faut faire en sorte que des gens puissent se rendre compte que ce n’est pas vrai, plutôt que de laisser ainsi des mythes se construire, chaque fois plus forts. Alors, chacun racontera son propre film, et ceux qui seront restés sur place auront encore plus envie de venir en Europe. Ce n’est pas ainsi que le problème se résoudra !
Y a-t-il une opposition entre l’Assemblée nationale et le Sénat ? Non ! Des décalages existent, effectivement, mais pas d’opposition !
On constate un certain nombre d’aggravations dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.
Je citerai d’abord le retour de l’orientation directive sans hébergement garanti pour les demandeurs d’asile – une aberration absolue ! Comment peut-on obliger les gens à aller dans une région sans leur garantir d’hébergement ?
J’y ajouterai le refus de l’encadrement et de la limitation dans le temps de la rétention des enfants, pourtant proposés par notre rapporteur ; le refus, en dépit de la particularité de ces territoires, d’une prise en compte de la situation de l’outre-mer au conseil d’administration de l’OFII ; le refus d’accélérer certaines procédures administratives avec, en miroir, la réduction des délais imposée pour certaines démarches des demandeurs d’asile. Je fais référence, ici, au fait que l’Assemblée nationale a refusé d’encadrer les délais de délivrance des cartes de séjour après décision favorable, alors que les demandeurs d’asile se sont vu imposer, à de multiples reprises, une réduction des délais qu’ils doivent respecter.
Enfin, l’Assemblée nationale – et là, pour le coup, c’est heureux – est revenue sur la volonté du Sénat de réduire l’attractivité de notre pays pour les étudiants étrangers.
Mais c’est une petite évolution, alors que les convergences entre les deux assemblées sont, elles, nombreuses : pas de prise en compte réelle et sérieuse du principe de fraternité rappelé par le Conseil constitutionnel ; acceptation de la compétence liée de l’OFPRA pour les remises en cause de statuts en cas de menace – nous sommes opposés, non pas à la possibilité d’une telle remise en cause, mais à l’instauration de la compétence liée – ; acceptation d’une notification par tous moyens ; lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité – nous n’aurions rien contre, si un tel système n’était pas susceptible d’empêcher de vrais pères de reconnaître leur enfant, ce qui me semble beaucoup plus grave.
En outre, alors que l’effet suspensif des recours devant la CNDA avait été généralisé par la loi Cazeneuve de 2015 – à la suite d’un certain nombre de condamnations de la Cour de justice de l’Union européenne –, le Sénat et l’Assemblée nationale se sont entendus pour revenir à un recours non suspensif, avec la création d’une véritable usine à gaz.
De la même manière, les deux chambres ont acté le principe d’une durée de rétention passant de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours. Or, on le sait, c’est dans les vingt premiers jours de rétention que l’on arrive à éloigner les personnes en situation irrégulière. Les comparatifs européens démontrent également que le « tout rétention » n’est pas la meilleure solution en termes d’éloignement et ne vaut pas les solutions alternatives. Ainsi, mes chers collègues, je vous invite à comparer le nombre de personnes éloignées en Allemagne et le nombre de places dans les centres de rétention de ce pays. Vous verrez que ce n’est pas par une politique de « tout rétention » que l’on peut éloigner rapidement.
Avant de conclure, je veux évoquer le scandale de Mayotte.
Mme Marie-Noëlle Lienemann acquiesce.

On remet en cause les principes du droit à la nationalité, qui s’appliquent à tous sur le territoire de la République, en ouvrant trois boîtes de Pandore.
Premièrement, on fait croire que c’est le droit du sol qui s’applique en France. Or ce n’est pas vrai ; notre droit de la nationalité est plus complexe que cela !

Et on ajoute : « Ce ne sera plus le cas à Mayotte, mais ce le sera ailleurs ! »
Deuxièmement, mes chers collègues, et je vous le dis en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, ayant connaissance de nombreux dossiers de demandes de nationalité, en provenance, notamment, d’Algérie, vous allez rendre ingérable, pendant cinquante ou cent ans, la question des certificats de nationalité des personnes nées à Mayotte ! Les Mahorais vont maudire, pendant un siècle, tous ceux qui auront voté cet amendement, tellement il complexifiera leur droit à la nationalité et leur capacité à obtenir des certificats de nationalité.

Troisièmement, par rapport à la situation de Mayotte en droit international, c’est un peu, me semble-t-il, comme si on s’insérait dans les résolutions des Nations unies, lesquelles rappelaient la souveraineté des Comores sur Mayotte.
Ce sont donc trois boîtes de Pandore que l’on ouvrirait, pour pas grand-chose, et ce alors même que le projet de loi continue à considérer Mayotte comme un centre de rétention à ciel ouvert.
Car, mes chers collègues, un étranger en situation régulière à Mayotte n’a pas le droit de venir dans l’Hexagone ! Pourquoi ? Cela a été refusé à l’Assemblée nationale ! Cela a été refusé au Sénat ! Or nos collègues de Mayotte avaient déposé des amendements sur ce point…
Donc, d’un côté, on estime qu’il faut protéger l’Hexagone et que chacun doit rester à Mayotte ; de l’autre, jugeant la situation à Mayotte insupportable, on remet en cause le principe de la nationalité. C’est intolérable !

Je m’achemine vers ma conclusion, madame la présidente, mais je tenais à insister sur le cas de Mayotte : le traitement de ce sujet, au Sénat et, en nouvelle lecture, à l’Assemblée nationale, n’est pas acceptable !
Face à tout cela, nous ne pouvons pas partir tranquillement en vacances en votant une motion tendant à opposer la question préalable. C’est pourquoi le groupe socialiste et républicain a déposé des amendements. Nous considérons qu’il faut continuer le combat : il y a encore beaucoup à empêcher, à préciser, avant de clore le sujet !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, éminemment sensible pour les Français, la question migratoire est devenue un enjeu de souveraineté nationale et de cohésion sociale. Illustration de cette importance, nos débats sur ces questions ont été longs, difficiles, passionnés, à la hauteur d’un enjeu fort pour nos concitoyens.
Mais cet enjeu est également un enjeu pour l’Europe, nous avons eu l’occasion d’en débattre la semaine dernière à propos de l’accord de réadmission franco-autrichien. C’est l’avenir du « Vieux continent face à la jeune Afrique », comme je l’ai lu, qui est en jeu, un avenir qui ne doit pas verser dans la confrontation.
L’Afrique subsaharienne compte déjà plus d’un milliard d’habitants, dont 70 % ont moins de trente ans. En 2100, trois bébés sur quatre qui viendront au monde naîtront au sud du Sahara. Comment, dans ces conditions, éviter une « ruée vers l’Europe », pour reprendre le titre de l’ouvrage récent de Stephen Smith, qui documente précisément cet enjeu ?
Le vrai défi est là : réussir le développement d’un continent jeune et pauvre, séparé par un bras de mer d’un continent plus vieux et plus riche.
Dans ces conditions, l’irénisme humanitaire me semble aussi dangereux que l’égoïsme national. Une approche équilibrée, globale et collective est nécessaire, sans verser dans l’outrance des parangons de vertu ou de ceux qui, comme dans la fable d’Ésope, crient tant au loup qu’on ne les écoute plus.
Cette nécessité de l’équilibre en matière de politique migratoire se retrouve dans une tradition républicaine, qui remonte au moins à la Libération. Depuis la signature de l’ordonnance du 2 novembre 1945 par le général de Gaulle, il existe une continuité politique qui tente de concilier les impératifs proches, mais différents de la gestion de l’immigration, de l’intégration et du droit d’asile.
En matière d’asile d’abord, la tradition républicaine repose sur une logique éthique que nous ne devons pas renier. Néanmoins, et c’est l’un des enjeux de ce texte, les procédures doivent être modernisées et les critères clarifiés pour éviter de laisser se développer des attentes infondées ou des situations indignes de notre pays.
Je veux parler, par exemple, des conditions difficiles de travail à la Cour nationale du droit d’asile ou à l’OFPRA, des inefficacités de nos procédures de traitement et de la saturation de nos dispositifs d’hébergement, particulièrement en Île-de-France, dans les Alpes-Maritimes et dans le Pas-de-Calais.
Quant à la question de l’intégration des étrangers dans notre pays, leur insertion linguistique, économique et sociale est particulièrement insuffisante en comparaison de certaines réussites chez nos partenaires, en Allemagne notamment. Dans un bel article de 1943 intitulé « Nous autres réfugiés », Hannah Arendt décrivait la situation la plus douloureuse pour le réfugié en terre d’accueil : l’exclusion, le rejet, l’anonymat. « Et personne ici ne sait qui je suis ! », disait-elle.
Nous devons faire en sorte que la promesse de l’accueil, une fois ses critères clarifiés, ne soit pas qu’une promesse procédurale ; qu’elle soit bien celle d’une insertion réelle. Nous avons déjà pu évoquer lors des précédents débats l’importance, dans ce cadre, du droit au travail.
Sur le sujet de la maîtrise de l’immigration, le Sénat a proposé un texte qui est très éloigné de la version initiale du Gouvernement.
Modifier ce texte n’était pas en soi une erreur, car on peut faire mieux que ce qui nous est proposé en matière d’exécution des décisions, de regroupement familial, de traitement des mineurs ou encore d’intégration.
Je crois que nous sommes d’accord pour estimer que ce énième texte sur l’asile et l’immigration constitue un aménagement technique de notre droit qui ne résoudra pas la dimension structurelle du problème des migrations. Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas important : au contraire, il pourrait contribuer à changer en profondeur le quotidien des migrants et des agents de l’asile, dont l’engagement doit être salué.
Sur ces questions particulièrement politiques, l’équilibre n’est pas simple à trouver entre, d’un côté, la nécessité d’humanisme, héritée de la tradition française des Lumières, qui demande d’accélérer les procédures et de moderniser le droit des étrangers et, de l’autre, la fermeté indispensable pour rendre les mesures d’éloignement plus réelles pour les déboutés.
Tout au long de la discussion de ce projet de loi, nous avons souhaité conserver une approche mesurée, raisonnable. Nous voulons rappeler que la question migratoire doit être abordée en France, c’est l’objet de ce texte, mais aussi au niveau européen, sans lequel rien ne sera possible, et au sein des pays sources, tant le développement de ces derniers est une clef déterminante dans la résolution de ce sujet.
Madame la ministre, mes chers collègues, nous devons en avoir conscience, la crise migratoire est encore devant nous, pour de nombreuses années. Et ce n’est qu’avec une réponse coordonnée à ces trois échelons que nous pourrons apporter une réponse empreinte d’humanité et de fermeté, lorsque cela est nécessaire, à la crise que nous connaissons.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Union Centriste.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la question migratoire est devenue l’une des principales variables des relations internationales. Pas plus tard que la semaine dernière, nous débattions, ici même, de l’opportunité de la ratification d’un accord entre la France et l’Autriche relatif à la réadmission des personnes étrangères.
Cette question est aujourd’hui instrumentalisée comme un puissant levier diplomatique par les pays bénéficiant de grandes diasporas ou stratégiquement placés sur les routes de l’exil.
En Méditerranée, les flux migratoires conditionnent désormais les relations entre l’Union européenne et les pays du contour sud, à tel point que certains chercheurs, comme Henry Laurens et Manon-Nour Tannous considèrent que le pacte euro-méditerranéen n’est plus « qu’une triple mise à distance des États à qui l’on refuse l’adhésion, des migrants et des potentiels terroristes ».
Cette importance croissante des migrations dans le monde nous impose de repenser en profondeur nos politiques étrangères de développement et de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi, et surtout, notre politique intérieure d’accueil et d’intégration des personnes étrangères, qu’elles sollicitent l’asile ou des titres de séjour de droit commun.
Sur ce deuxième point, l’œuvre de l’Union européenne est balbutiante, et l’on en constate tous les jours les limites. Dans nos centres de rétention administrative, les déficiences du système de Dublin sont encore plus palpables pour les agents chargés d’organiser les flux des reconduites à la frontière.
À ceux qui sont exposés aux regards hagards et aux questions lancinantes d’individus perdus dans le labyrinthe administratif dublinois, comment expliquer les dysfonctionnements de procédures qu’ils ont pourtant la tâche d’exécuter ?
Personne n’ignore ici l’impossibilité de rendre effectives toutes les reconduites à la frontière prononcées, tant que nos partenaires continueront de filtrer les retours par le biais des laissez-passer consulaires. Il est au demeurant peu probable qu’ils y renoncent, puisqu’ils manifestent ainsi leur souveraineté et le contrôle de leurs frontières.
Madame la ministre, monsieur le rapporteur, au sein du groupe du RDSE, nous sommes comme vous attachés aux lois de la République, et nous sommes donc les partisans d’une exécution ferme des décisions administratives prises sur leur fondement.
Ce que nous critiquions en première lecture, et ce que nous continuons de critiquer à ce stade des discussions, c’est la fragilisation de l’État de droit qui découlera nécessairement du renforcement des mesures dérogatoires figurant dans le texte issu des travaux de la commission des lois.
Comme je le disais en première lecture, la dégradation des conditions d’accès à la justice des personnes étrangères les concerne en premier lieu, au mépris de leur incontestable vulnérabilité. Mais elle pourrait aussi menacer indirectement le justiciable français, si les expériences conduites en matière de droit des étrangers étaient généralisées devant nos juridictions. Nous craignons en particulier la généralisation du recours à la vidéo-audience, ce qui serait une transformation sans précédent du service public de la justice.
Fidèle à sa tradition, notre Haute Assemblée avait sur ce sujet introduit quelques dispositions protectrices utiles, comme l’encadrement du placement en rétention administrative des mineurs accompagnés et le rétablissement du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile à sa durée actuelle de trente jours.
La navette a eu quelques vertus. Le maintien de cette deuxième disposition par nos collègues députés est une maigre consolation au regard des propositions de notre groupe et de nombreux collègues pour mieux protéger les enfants étrangers. Selon nous, le recours systématique à l’assignation à résidence était le meilleur compromis entre la protection de la minorité et la nécessité de mettre en œuvre les procédures de reconduite à la frontière.
Nous accueillons favorablement l’encadrement du « délit de solidarité », encore modifié par nos collègues députés en deuxième lecture, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel consacrant la valeur constitutionnelle du principe de fraternité. À ce stade, nous ne pouvons mesurer tous les effets contentieux que produira cette décision audacieuse, mais cela devrait nous conforter, en tant que membres du Parlement, dans l’idée qu’il ne faut pas renoncer au progrès des droits du citoyen en faisant preuve d’une autocensure excessive.
Enfin, si l’atténuation brutale de l’afflux migratoire est peu probable et l’amélioration des reconduites aux frontières impossible, alors l’accueil et l’intégration deviennent incontournables. Ainsi, un usage plus constructif de l’aide au retour volontaire pourrait être fait, en ne l’appliquant qu’à moyen terme, afin de responsabiliser davantage les étrangers souhaitant rejoindre la France pour s’y former et y acquérir des compétences d’avenir.
Cette relation de confiance, établie sur des règles claires, pourrait constituer le ciment d’un développement plus équilibré à travers le monde et favoriser un rayonnement singulier et positif de la France sur la scène internationale.
Au contraire, ce projet de loi nous paraît complexifier un peu plus le droit des étrangers en France, et rester à la surface des enjeux migratoires. C’est pourquoi, comme lors de la première lecture, les membres du groupe du RDSE voteront contre ce texte, dans sa version modifiée par la commission des lois du Sénat.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, messieurs les excellents président et rapporteur de la commission des lois, mes chers collègues, je ne vais pas recommencer mon propos d’il y a un mois, parce que je sais que la motion tendant à opposer la question préalable va passer. Je veux simplement vous dire qu’on se bat pour des bouts de chandelles : dans moins d’un an, tout cela risque bien d’avoir disparu comme entité législative. J’entendais hier l’inénarrable Premier ministre hongrois déclarer : « Vous êtes tous bien gentils, mais, pour moi, l’alpha et l’oméga des élections européennes, ce seront les phénomènes migratoires. » Immédiatement, de peur d’être en retard, le Chancelier autrichien a dit : « Moi aussi, j’arrive ! » ; le Premier ministre italien : « Et moi donc ! » ; le gouvernement néerlandais : « Vous avez raison ! » ; et le gouvernement danois : « C’est jamais assez ! »
Puisque, on le voit bien dans nos débats, l’essentiel des règles en matière migratoire ou concernant le droit d’asile correspondent en réalité à des règles européennes, tout ça va en prendre un sacré coup. Combien d’États en Europe sont aujourd’hui sur la ligne française ? Combien d’États disent aujourd’hui qu’il faut absolument respecter le droit d’asile et définir une politique migratoire « humaine » ? Bientôt, on va finir à quatre ou cinq…

Je n’ai interrompu personne !
J’ai bien peur que, après les élections européennes, la loi que vous allez faire passer, madame la ministre, apparaisse complètement décalée par rapport à ce que certains États européens vont demander ou demandent déjà.
La vérité, et personne ne peut s’en glorifier, c’est que les gouvernements, de gauche comme de droite, n’ont pas fait suffisamment en matière d’intégration : ils n’ont pas mis assez de moyens. Le résultat, c’est que, même avant les grosses vagues migratoires de ces quatre à cinq dernières années, on a laissé se créer dans le pays le sentiment confus, désagréable, qu’il n’y avait pas d’intégration ni d’insertion. Je le répète, toutes tendances confondues – je ne fais aucun commentaire politique –, on n’a pas construit assez de centres d’accueil de demandeurs d’asile, on n’a pas réformé assez vite l’allocation pour demandeur d’asile, on n’a pas imposé la connaissance du français, des règles civiques, de la société française. On a laissé tout ça se marginaliser.
Il y a une chose qui me reste en travers de la gorge depuis le début, le rapporteur le sait, c’est que ce soit le même texte pour le droit d’asile et les mouvements migratoires. Ce n’est pas du tout la même chose !

Quand j’entends certains dire qu’il faut respecter la tradition française du droit d’asile, j’ai envie de leur répondre, et je le répète, que ce n’est pas du tout la même chose que la politique migratoire.

Nous sommes tous ici, gauche, droite – ou nouveau monde –, sur la même ligne : il faut respecter le droit d’asile et refuser que ce droit soit contourné au profit d’une immigration économique. Mais comment redéfinir un droit d’asile cohérent, digne de ce que nous sommes et de l’histoire de notre pays ? Songez – là encore, je n’accuse personne, car tout le monde est responsable – à la manière dont on a traité ceux qui obtenaient le statut de réfugié ou le droit d’asile. Ils ne sont toujours pas bien traités par la République, alors qu’ils devraient être au cœur de notre volonté d’intégration.
On nous dit qu’il faut s’ouvrir aux vagues migratoires. Soit ! Mais, comme je l’ai dit le mois dernier, nous n’avons plus les mêmes moyens qu’il y a vingt ou trente ans. Nous ne sommes plus capables de dire à ceux qui sont l’essence même du droit d’asile et obtiennent le statut de réfugié que nous allons les traiter correctement.
La vérité, c’est qu’il faut tout remettre à plat. Les amendements que j’ai fait adopter sont sûrement très intéressants, mais ce n’est pas eux qui réformeront la politique en la matière. Que fait-on avec l’OFPRA et l’OFII ? Quelles nouvelles missions leur confie-t-on ? Comment se doter d’une politique migratoire et d’une politique du droit d’asile cohérentes, dignes de nous et qui, dans le même temps, correspondent aux moyens matériels et financiers dont nous disposons ?
C’est facile de dire qu’il faut laisser entrer les migrants, mais, comme le disait un orateur, on voit ce qui se passe dans nos grandes villes : des camps se développent. Et qu’est-ce qu’on fait de ces camps ? On l’a encore vu récemment à Paris et en région parisienne : on les déplace, on met trois mois les personnes dans un gymnase, puis, comme la ville finit par hurler, on les déplace dans un gymnase d’une autre ville, qui va accepter de les accueillir si ça ne dure pas plus de trois mois, à l’issue desquels on les déplacera à nouveau. Est-ce que c’est digne ? Non !
Je regrette que le débat au Parlement sur l’orientation de la politique migratoire ne puisse pas avoir lieu ; l’Assemblée nationale n’en a pas voulu. Nous souhaitions que le Parlement ait un droit de regard sur ce qui est digne, correct, cohérent, et sur ce qui ne l’est pas, parce que, comme je l’ai dit la dernière fois, il n’y a pas, d’un côté, ceux qui sont extrêmement généreux et, de l’autre, ceux qui sont extrêmement égoïstes. Il y a simplement à se demander ce que nous sommes capables de faire.
Quand allons-nous dire que les personnes admises sur le territoire avec le statut de réfugié et qui, à terme, vont devenir des Français, doivent être traitées correctement ? Quand allons-nous dire que la manière dont on les traite aujourd’hui est indigne ? Indigne ! C’est précisément parce qu’elle est indigne que nous ne pouvons pas accueillir tous les migrants qui souhaiteraient venir. Bien sûr, si nous étions surpuissants, si nous avions plein de logements vides, plein d’emplois à offrir, nous pourrions être plus généreux. Mais ce n’est pas le cas. Par conséquent, la priorité des priorités, ce sont les demandeurs d’asile, parce que ce sont eux qui fuient la guerre, les persécutions et les massacres. Je ne dis pas que la souffrance économique ne compte pas, mais ce n’est pas pareil.
Faisons au mieux, réformons, mettons les choses sur la table. En effet, dans un an, madame la ministre, après les élections européennes, si l’évolution se poursuit ainsi dans toute l’Europe, vous reviendrez devant nous avec un nouveau texte, parce que notre position ne correspondra plus à la vision européenne et que nous n’aurons pas eu le courage – tous gouvernements confondus –, depuis vingt-cinq ans, de faire face à nos responsabilités.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Je suis saisie, par M. Buffet, au nom de la commission, d’une motion n° 1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée en nouvelle lecture, pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie (n° 697, 2017-2018).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour dix minutes, un orateur d’opinion contraire, pour dix minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, la commission des lois réunie ce matin a décidé, en application de l’article 44, alinéa 3, de notre règlement, de déposer une motion tendant à opposer la question préalable. Le fondement de cette motion repose principalement sur quatre points que je me dois d’évoquer, même si mon propos risque d’être répétitif par rapport ce que j’ai pu dire au cours de la discussion générale.
En premier lieu, le texte adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture n’a pris que très marginalement en compte les préoccupations majeures qui avaient été exprimées par la Haute Assemblée, …

… comme l’a d’ailleurs reconnu – j’allais dire presque loyalement – notre collègue rapporteur, Élise Fajgeles, à l’Assemblée nationale.
À l’exception de l’accord trouvé sur le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le fameux délai d’un mois, et l’adaptation du droit du sol à Mayotte, les propositions essentielles du Sénat ont été purement et simplement supprimées : l’organisation d’un débat annuel sur la politique migratoire, la visite médicale des étudiants étrangers, l’inclusion, pour soutenir nos territoires, des lieux d’hébergement des demandeurs d’asile dans le décompte des logements sociaux. Je pourrais également ajouter, entre autres propositions, la transformation de l’aide médicale de l’État en aide médicale d’urgence.
En deuxième lieu, le projet de loi constituait une véritable occasion pour lutter contre l’immigration irrégulière, et nous regrettons que cette opportunité n’ait pas été saisie. Sans aucune stratégie, je l’ai rappelé précédemment, le texte tel qu’il nous revient de l’Assemblée nationale ne comprend aucune des mesures de rigueur que nous avions proposées. Je pense notamment à un meilleur encadrement de l’immigration familiale ou à la réduction du nombre de visas accordés aux pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires. J’en profite pour dire à notre collègue Leconte que ce n’est évidemment pas l’alpha et l’oméga de toute politique migratoire ; c’est un élément parmi d’autres. Nous n’oublions pas tout le travail diplomatique qui doit être mené par les affaires étrangères avec les pays sources. Ne cristallisons pas notre débat uniquement sur ce point.
Je citerai aussi l’interdiction juridique du territoire national en cas de condamnation ou le retour en arrière concernant ceux qu’on appelle les « dublinés ». Le texte voté à l’identique par l’Assemblée nationale et le Sénat au mois d’avril dernier a été en partie détricoté des avantages apportés par le Sénat. C’est une vraie difficulté.
De même, les politiques d’intégration demeurent le parent pauvre de ce texte, alors que l’Assemblée nationale aurait pu utilement reprendre des mesures que nous avions proposées, telles que l’évaluation de la formation en français et l’augmentation du nombre d’heures de cours, car il n’y a pas de politique migratoire réussie sans une intégration réussie. Au demeurant, réussir une intégration, c’est se donner les moyens de cette réussite, ce qui passe notamment, mais pas uniquement, par l’apprentissage de la langue. Nous avions également formulé des propositions intéressantes sur l’amélioration du contrat d’intégration, avec une meilleure connaissance du fonctionnement de notre République. Enfin, une évaluation par des cabinets extérieurs aurait été utile.
En troisième lieu, l’Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture deux nouvelles mesures qui constituent une entorse à la règle de l’entonnoir, qui résulte de l’article 45 de la Constitution : la suppression du rôle de coordination des centres provisoires d’hébergement en matière d’intégration des réfugiés, à l’article 9 bis du projet de loi, et une habilitation à légiférer par ordonnances pour réformer le contentieux des étrangers devant les juridictions administratives et créer des procédures d’urgence devant la CNDA, à l’article 27 du projet de loi.
Enfin, en quatrième lieu, un désaccord profond demeure entre la majorité du Sénat et celle de l’Assemblée nationale sur l’organisation de la durée de rétention, plus communément appelée le « séquençage ». Le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne paraît satisfaisant pour personne, ni pour l’étranger ni évidemment pour notre administration.
Autre point important : la limitation de la durée de rétention des mineurs accompagnants. La durée maximale de cinq jours a été supprimée par l’Assemblée nationale.
C’est pour l’ensemble de ces raisons – il en existe bien d’autres, mais ce sont les principales – que la commission des lois a décidé ce matin d’opposer à ce texte la question préalable.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je tiens à dire ici, très calmement, qu’il s’agit d’une question préalable de confort.
Monsieur le rapporteur, je vous ai écouté avec soin, et vous avez défendu votre position avec clarté. Vous auriez cependant pu conclure votre discours en disant non pas « c’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il faut adopter la question préalable », mais « c’est pour l’ensemble de ces raisons que je vais vous proposer, mes chers collègues, un certain nombre d’amendements ».
Mes chers collègues, il n’aura échappé à personne que, pour que la question préalable soit adoptée, il faut que certains la votent – chacun peut encore réfléchir – et que d’autres s’abstiennent. Or tous ont des positions très différentes, voire contradictoires. C’est avéré ! Il suffit d’avoir écouté les uns et les autres, dont les positions sont très respectables, pour le constater.
Madame la ministre, vous pourriez m’objecter que, lorsque vous étiez venue présenter ce texte, j’avais moi-même défendu une motion tendant à opposer la question préalable. Toutefois, il s’agissait alors de dire que ce texte était inutile et qu’il valait mieux ne pas se lancer dans son examen. Là, c’est tout à fait différent : il y a un texte issu de l’Assemblée nationale qui, si nous ne faisons rien, sera demain la loi.
J’avais soulevé à l’époque des points de réflexion qui méritent encore d’être entendus, par exemple le fait que le Conseil d’État avait estimé que ce texte était inutile, en faisant valoir que ni les effets de la loi de 2015 ni les effets de celle de 2016 n’avaient été évalués. On n’évalue les effets d’aucune loi, on ne dispose d’aucun élément, mais on en fait une nouvelle… Peut-être est-ce pour rassurer, ou tenter de rassurer, une partie de l’opinion… Dites-vous bien que, sur ce chemin, d’autres seront malheureusement toujours plus forts que vous, et que nous, hélas !
M. Jean-Yves Leconte l’a très bien dit, et je l’en remercie : face aux questions de fond qui se posent, on a besoin d’un grand texte sur les migrations, c’est-à-dire sur le droit d’asile, auquel nous sommes très attachés, sur les migrations économiques et ce qu’elles impliquent en termes de travail au niveau de l’Europe et de rapports entre l’Europe et l’Afrique, et sur les migrations climatiques, qui arriveront, comme plusieurs d’entre vous l’ont souligné.
M. Karoutchi a eu raison de regretter qu’il y ait eu un seul texte pour l’asile et l’immigration.

Je souscris tout à fait à cela. L’asile est un droit prévu par une convention de Genève qui engage la France, la République. Pour l’immigration, il y a des politiques, c’est tout à fait différent.
Ce texte, cela a été dit et redit, ne parle pas de l’Europe, ou si peu. Or le problème est déjà européen. La Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert : des milliers de personnes y meurent. L’Europe et la France doivent effectivement jouer un rôle majeur à cet égard et lutter fortement contre les passeurs.
Je sais la difficulté en Libye, y compris par rapport à cette île proche de la Tunisie, au large de Sfax. Un travail énorme doit donc être réalisé, parce que certains profitent de la misère humaine. Des villages entiers se cotisent pour que des personnes trouvent une place, s’entassent, dans ces embarcations de fortune qui feront naufrage, pour le plus grand profit de tous ces passeurs.
Compte tenu de tous ces problèmes, une politique d’intégration est nécessaire, cela a été fort bien dit. Toutefois, les mesures que vous annoncez, madame la ministre, ne permettront pas d’augmenter sensiblement le nombre d’obligations de quitter le territoire français véritablement réalisées ou celui des déboutés du droit d’asile qui seront reconduits à la frontière. Par conséquent, on a le sentiment que ce texte concentre beaucoup de critiques.
J’en reviens à la question préalable.
Mes chers collègues, je suis en désaccord avec la façon dont nous fonctionnons par rapport à des textes comme celui-là.
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte. Je ne comprends pas que l’on y recoure aussi facilement. Depuis un an, le gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, a présenté un seul texte, je dis bien un seul, selon la procédure normale : la réforme constitutionnelle.

Et pour cause ! S’il avait choisi d’engager la procédure accélérée, le résultat eût été acquis d’avance, si je puis dire. Pourquoi cette volonté constante de précipitation ?

Mon cher François Patriat, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je me souviens d’une période, pas si lointaine, où, dans cette assemblée, pour des projets aussi importants que les quatre textes dont nous avons été saisis au cours de ce mois de juillet, deux semaines étaient prévues par projet, et la procédure accélérée n’était pas engagée, car il est important de bien légiférer. Ce n’est pas en entassant les textes que l’on travaille correctement.
Comme je l’ai dit, et je maintiens cette expression, il s’agit d’une question préalable de confort. Pour notre part, nous avons déposé vingt-neuf amendements – nous avons choisi ceux qui sont pour nous principaux –, et nous sommes prêts à en débattre maintenant, demain, après-demain, compte tenu de l’importance des sujets. On nous dit que ce n’est pas la peine, puisque, de toute façon, l’Assemblée nationale reprendra son texte tel quel.
Mes chers collègues, intégrer un tel raisonnement est assez dramatique eu égard à la conception que nous avons du débat parlementaire. Je me souviens de dernières lectures où, conformément à ce qui est écrit dans la Constitution, l’Assemblée nationale a retenu la rédaction du Sénat. D’ailleurs, en ultime lecture, l’Assemblée nationale peut retenir des amendements du Gouvernement, en général techniques, et des formulations du Sénat.
Si vous adoptez cette motion tendant à opposer la question préalable, vous présupposez qu’il n’est pas utile de débattre, car l’Assemblée nationale restera statique et, donc, que tout est acquis. Or souvenez-vous de ce que nous avons dit ici même, avec le président Larcher, dans de très nombreux groupes de travail sur la réforme de la Constitution et de la grande attention qui est la nôtre par rapport à certaines propositions du Gouvernement pour réduire le rôle du Sénat après la CMP.
Nous sommes aujourd’hui après la CMP. Or le projet de réforme constitutionnelle, qui va à l’encontre du bicamérisme, monsieur le président de la commission des lois, prévoirait en quelque sorte que le Sénat n’ait plus droit à la parole après la commission mixte paritaire. Si nous renonçons nous-mêmes à ce droit à la parole, nous ne fortifions pas les arguments qui sont les nôtres pour maintenir ce droit du Sénat dans le cadre du bicamérisme.
Voilà les raisons pour lesquelles notre groupe votera contre la motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

J’ai bien entendu les avis et les positions des uns et des autres, y compris les qualificatifs utilisés pour désigner cette question préalable. Je me bornerai à dire que le Gouvernement prendra acte du vote du Sénat.

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l’adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 231 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le projet de loi est rejeté.

En application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des lois a émis un avis favorable – 12 voix pour, 1 bulletin blanc – à la nomination de M. Jean-Raphaël Alventosa aux fonctions de médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.

Madame la ministre, mes chers collègues, je constate que le Sénat a épuisé son ordre du jour pour la session extraordinaire.
M. le président du Sénat prendra acte de la clôture de cette session lorsque nous aurons reçu le décret de M. le Président de la République portant clôture de la session extraordinaire du Parlement.
Cette information sera publiée au Journal officiel et sur le site internet de notre assemblée.
Sous réserve de la publication du décret de M. le Président de la République portant convocation du Parlement en session extraordinaire et de la communication de la lettre d’ordre du jour du Gouvernement, la prochaine séance devrait avoir lieu le mardi 25 septembre, à quinze heures et le soir, avec l’ordre du jour suivant :
À quinze heures :
Ouverture de la seconde session extraordinaire 2017-2018.
Sous réserve de sa transmission, nouvelle lecture du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (A.N., n° 1135).
À seize heures trente :
Questions d’actualité au Gouvernement.
À dix-sept heures quarante-cinq et le soir : sous réserve de sa transmission, suite de la nouvelle lecture du projet de loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (A.N., n° 1135).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures quinze.