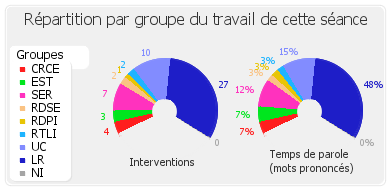Séance en hémicycle du 6 mai 2021 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Moyens d'alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (voir le dossier)
- Demande d'étude d'impact « nuisances et sécurité » de la salle de shoot du xe arrondissement de paris (voir le dossier)
- Dépenses liées aux documents d'urbanisme et fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (voir le dossier)
- Suppression de la taxe d'habitation et conséquences sur les politiques locales en matière de logement social (voir le dossier)
- Versement des subventions communales à des cinémas non ouverts au public dans le cadre de la loi sueur (voir le dossier)
- Plafonnement des frais pédagogiques pris en charge pour la formation des élus locaux (voir le dossier)
- Difficultés pour les collectivités de contrôler la conformité des collectes et des reversements de taxe de séjour (voir le dossier)
- Enjeux liés à la création d'une régie publique de l'eau dans neuf communes du val-de-marne (voir le dossier)
- Direction des établissements accueillant des jeunes enfants et politique en faveur de la petite enfance (voir le dossier)
- Moratoire sur la fermeture de classes maternelles et élémentaires dans les communes audoises (voir le dossier)
- Inégalités entre les étudiants dans l'accès au dispositif de deux repas par jour à 1 euro (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à M. Stéphane Piednoir, auteur de la question n° 1560, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur les moyens d’alerte des services de secours dans les établissements recevant du public (ERP).
Bien qu’ils soient très peu utilisés depuis plus d’un an en raison du contexte sanitaire que nous connaissons, les salles des fêtes et les autres lieux de socialisation, présents dans de très nombreux villages, sont particulièrement importants pour le dynamisme et la vitalité des territoires.
Selon la catégorie à laquelle ils appartiennent, ces établissements doivent se soumettre à un certain nombre d’obligations en termes de sécurité. Ils doivent notamment garantir l’existence d’une ligne téléphonique sans discontinuité de service pour l’alerte des services de secours.
Pour se conformer à cette obligation, il est prévu que l’alerte soit assurée par un téléphone fixe. Le recours au téléphone analogique ne pouvant plus être systématique en raison de l’abandon programmé du réseau téléphonique commuté, ou « cuivré », comme on dit, les établissements recevant du public doivent se doter d’une box pour bénéficier d’un téléphone fixe.
Cette installation est à la fois particulièrement onéreuse et peu judicieuse pour les établissements de taille moyenne lorsque ceux-ci n’accueillent aucune administration, aucun guichet, et n’ont donc pas besoin d’un accès au wifi.
La téléphonie mobile pourrait constituer une solution plus abordable, qui permettrait également de respecter les objectifs en vigueur en matière de sécurité, puisqu’il est possible, même sans forfait, d’appeler les numéros d’urgence.
Cependant, en l’état actuel de la réglementation, l’alerte des services de secours par téléphonie mobile n’est pas autorisée dans les ERP de la première à la quatrième catégorie, sauf pour les établissements sportifs couverts autres que les patinoires et les piscines.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement envisage-t-il de faire évoluer cette réglementation en autorisant le recours à la téléphonie mobile dans les ERP ?
Monsieur le sénateur Stéphane Piednoir, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence de la téléphonie et de l’évolution des technologies, l’opérateur historique a choisi d’abandonner progressivement la boucle locale cuivre faisant référence au réseau téléphonique commuté (RTC), dont les coûts d’entretien sont élevés.
Votre question renvoie à l’article MS 70 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980.
L’application de ces dispositions générales destinées à garantir une alerte et une intervention précoces des services de secours est ensuite déclinée selon des dispositions spécifiques à certains ERP, en fonction de la nature de l’exploitation et de l’effectif admissible, lesquels peuvent restreindre le choix laissé à l’exploitant.
Afin de prendre en compte la disparition du réseau RTC, la note d’information du 27 janvier 2017 a donné des indications sur la lecture qu’il fallait faire de l’article MS 70. Pour les établissements du premier groupe, c’est-à-dire les plus grands, elle admet la possibilité de recourir à des box, sous réserve de la continuité du service téléphonique en cas de coupure d’électricité. Cette note admet par ailleurs l’usage du téléphone mobile dans les ERP les plus petits, qui sont classés en cinquième catégorie.
Dès lors, il appartient aux exploitants des ERP auxquels vous avez fait référence, et à supposer qu’ils relèvent bien du premier groupe, de s’assurer qu’ils disposent d’un système d’alerte adapté, qui ne saurait se limiter à un dispositif reposant sur les seuls réseaux de téléphonie mobile. Nous parlons en effet ici d’établissements représentant un enjeu de sécurité réel pour le public, ce qui justifie d’ailleurs leur suivi par l’autorité de police et les commissions de sécurité.
Enfin, j’ajoute que, si un exploitant souhaite prévoir des adaptations aux règles de sécurité, il doit en faire la demande argumentée auprès de l’autorité de police. Préalablement à sa décision, cette dernière sollicitera la commission de sécurité compétente, conformément à l’article R. 123-13 du code de la construction et de l’habitation et à l’article GN 4 du règlement de sécurité.

La parole est à Mme Catherine Dumas, auteure de la question n° 1611, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite interpeller les ministres de l’intérieur et de la santé sur le projet de la maire de Paris de créer deux nouvelles salles de shoot, ou salles de consommation à moindre risque (SCMR), dans les Ier et XVIIIe arrondissements de la capitale.
La création de ces salles de shoot est encadrée par la loi, qui prévoit notamment la remise d’un rapport annuel sur le déroulement de l’expérimentation au directeur général de l’agence régionale de santé, au maire de la commune et au ministre de la santé.
Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement doit adresser au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation portant notamment sur son impact sur la santé publique et sur la réduction des nuisances dans l’espace public.
À ma connaissance, aucun audit annuel n’a été rendu public depuis la création controversée de la salle de shoot dans le Xe arrondissement en 2016. J’ai donc réclamé la publication d’un audit au ministère de la santé. Je souhaite également qu’il soit complété par une étude d’impact « nuisances et sécurité », que pourrait rendre le ministère de l’intérieur.
En effet, cela fait quatre ans que les riverains sont désemparés et exaspérés par les nuisances dues à l’ouverture de cette salle. Comme me l’a signalé Bertil Fort, élu du Xe arrondissement, des personnes s’injectent de la drogue sur la voie publique, l’insécurité règne, des seringues jonchent le sol et des toxicomanes hurlent dans les rues. Cet environnement constitue une source de préoccupation majeure en matière sociale, mais aussi en termes de sécurité et de santé publique.
La réalisation d’une étude d’impact nous permettrait d’évaluer les effets de l’implantation de ce type d’établissement dans un quartier.
Madame la sénatrice Catherine Dumas, la salle de consommation à moindre risque du Xe arrondissement de Paris, implantée dans le quartier de la gare du Nord et de l’hôpital Lariboisière, est située dans une zone de sécurité prioritaire et fait l’objet, depuis son ouverture en octobre 2016, d’une surveillance particulière et adaptée de la part de nos services de police.
Les nuisances subies par les riverains, qui sont liées à la présence de toxicomanes usagers de la SCMR, dont une partie était déjà historiquement présente dans le quartier, n’ont pas disparu après l’ouverture de la salle. Les riverains dénoncent d’ailleurs très régulièrement la divagation de toxicomanes sur la voie publique, en particulier aux heures précédant l’ouverture et suivant la fermeture de ladite SCMR.
Ce secteur fait donc l’objet d’un suivi renforcé du commissariat du Xe arrondissement, des patrouilles étant très régulièrement organisées. Les policiers vérifient systématiquement chaque signalement porté à leur connaissance.
Ainsi, des policiers en uniforme assurent une sécurisation en matinée, puis sont relayés l’après-midi par la brigade territoriale de contact composée de policiers des Xe et XVIIIe arrondissements. En complément, le service local des transmissions du commissariat du Xe arrondissement réalise des vidéopatrouilles aux abords de la SCMR via les caméras du plan de vidéoprotection de la préfecture de police, très précisément rue Saint-Vincent-de-Paul. De plus, des opérations ponctuelles conjointes associent les services de police et les services municipaux.
Sur le plan judiciaire, l’usage de stupéfiants hors de la salle donne lieu à des interpellations et des placements en garde à vue. Les détenteurs de ces substances sont également interpellés dès lors qu’ils ne respectent pas le périmètre de tolérance délimité par le parquet ou qu’ils possèdent des produits stupéfiants en quantité supérieure à celle qui est tolérée par le parquet.
La publication de l’étude d’impact « nuisances et sécurité » que vous appelez de vos vœux, même si j’en comprends parfaitement l’objet et que je suis sensible aux questions que vous soulevez en tant qu’ancienne députée de Paris, n’est pas prévue par la loi et ne présenterait à ce stade qu’un intérêt assez limité.
En effet, la situation du quartier dans lequel est implantée cette salle est particulièrement bien connue et prise en compte quotidiennement, aussi bien dans les dispositifs de surveillance du secteur que dans les dispositifs de lutte contre la consommation de drogues.
J’ajoute que la préfecture de police en fait état annuellement au comité de voisinage organisé par la mairie d’arrondissement. Elle ne manquera pas de partager son diagnostic au moment de la rédaction du rapport d’évaluation que le Gouvernement adressera au Parlement dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation.

Merci beaucoup pour votre réponse, madame la secrétaire d’État : elle montre que vous connaissez bien la situation à Paris.
Au nom de mes collègues Marie Toubiana et Rudolph Granier, élus respectivement des XIXe et XVIIIe arrondissements, je tiens aussi à évoquer l’actualité du quartier de Stalingrad, qui est très touché par le fléau de la drogue.
Madame la secrétaire d’État, au lendemain de l’événement dramatique d’Avignon, il est temps de tirer les conclusions des solutions passées et d’essayer de les adapter ou, mieux encore, de les remplacer si nécessaire.

La parole est à Mme Sabine Van Heghe, auteure de la question n° 1648, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention et celle de M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance sur la situation de l’usine PSA, aujourd’hui Stellantis, située à Douvrin dans les Hauts-de-France.
Fleuron régional de l’industrie automobile, cette entreprise produit le moteur EP qui équipe les modèles hybrides rechargeables haut de gamme. Cette génération de moteurs est vouée à disparaître au profit d’un moteur respectant la norme Euro 7, l’EP Gen 3, qui devait être fabriqué en Hongrie, bien que l’usine française dispose des capacités humaines et techniques de le produire.
Heureusement, l’importante et récente mobilisation des élus, des salariés et des syndicats a finalement abouti au maintien de cette production sur le site de Douvrin.
Cette bonne nouvelle ne rassure pourtant pas totalement les salariés, qui ont besoin d’une vision à long terme sur leur avenir et celui de leur usine.
Madame la secrétaire d’État, comment le Gouvernement entend-il assurer la pérennité de l’usine PSA de Douvrin, alors que la région des Hauts-de-France a déjà payé un lourd tribut à la désindustrialisation galopante ?
Madame la sénatrice Van Heghe, les inquiétudes des salariés de l’usine PSA de Douvrin sont justifiées et légitimes : comme vous le savez, l’industrie automobile est confrontée à une transformation technologique radicale et doit réaliser sa transition à marche forcée.
Nous savons que, d’ici à 2030, près de 50 000 emplois pourraient disparaître, notamment dans la sous-traitance. C’est pourquoi notre mobilisation est sans faille depuis maintenant quatre ans pour préparer et surtout garantir la reconversion.
C’est également tout le sens du plan de 8 milliards d’euros annoncé par le Président de la République l’été dernier. Celui-ci repose sur quatre piliers : les primes d’achat, les aides aux industriels en échange d’engagements en matière de relocalisation, le soutien à l’innovation et l’anticipation de la transition via des aides financières à la formation et à l’accompagnement des salariés.
Concernant le volet spécifique de la relocalisation, vous avez raison de souligner la bonne nouvelle que constitue la production de la nouvelle génération de moteurs EP, l’EP Gen 3, sur le site de Douvrin. Le Gouvernement, et plus particulièrement Bruno Le Maire, est résolu à accompagner la transformation de notre secteur automobile.
Les annonces du 26 avril 2021 relatives au contrat stratégique de la filière automobile et du plan d’action en faveur de la filière fonderie automobile le prouvent encore.
Le Gouvernement a toute confiance dans la capacité de la filière automobile à relever ce défi. Sachez, madame la sénatrice, que nous suivons avec beaucoup d’attention la situation de l’usine PSA de Douvrin.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Si je vous ai posé cette question, c’est que nous ne cessons de subir les effets de l’abandon de notre industrie, des délocalisations à but économique d’entreprises pourtant florissantes et des fermetures de grands sites. Le dernier exemple en date, et non des moindres, est la fermeture du site de Bridgestone à Béthune.
Les projecteurs sont désormais braqués sur le Gouvernement : il doit montrer sa volonté de poser un garrot afin de mettre fin à l’hémorragie industrielle dont souffre notre pays, particulièrement la région des Hauts-de-France.

La parole est à Mme Nadège Havet, auteure de la question n° 1566, adressée à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance et de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la transition numérique et des communications électroniques.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur le programme « New Deal mobile » et, plus largement, sur les difficultés d’implantation d’antennes sur le littoral.
En janvier 2018, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et le Gouvernement ont annoncé les différents engagements des opérateurs afin d’accélérer la couverture mobile des territoires.
Afin de répondre de manière adaptée à l’ensemble des attentes des citoyens et des territoires en matière de connectivité mobile, un dispositif de couverture ciblée a ainsi été mis en place.
C’est dans ce cadre que plusieurs collectivités, notamment dans le Finistère, ont été retenues pour l’implantation d’antennes de téléphonie.
Jusqu’à il y a peu, ces pylônes édifiés en discontinuité de l’urbanisation étaient autorisés : on considérait qu’il s’agissait d’installations techniques non constitutives d’une extension de l’urbanisation.
Le juge a cependant une vision de plus en plus restrictive sur ce point. C’est ainsi qu’il a annulé le 11 décembre 2019 un projet de téléphonie mobile, après avoir considéré que l’installation de cette antenne s’apparentait à une opération de construction isolée et qu’elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Compte tenu de ce jugement, il semble désormais difficile d’autoriser de tels projets en discontinuité de l’urbanisation en zone littorale. Cette situation paradoxale rend incompatibles les deux objectifs que sont la couverture en téléphonie mobile de l’ensemble du territoire et le respect de la loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dite loi Littoral. Comment donc concilier protection environnementale et désenclavement territorial ?
En 2018, lors de l’examen de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ÉLAN, l’article L. 122-3 du code de l’urbanisme a été modifié. Désormais, les implantations d’antennes peuvent déroger au principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne.
Par cohérence avec cette disposition de la loi ÉLAN, il conviendrait d’appliquer également cette dérogation dans les zones littorales. Un article pourrait ainsi être inséré après l’article L. 121-5-1 du code de l’urbanisme, qui reprendrait les termes de l’article L. 122-3 du même code.
Le Gouvernement a fait de l’aménagement du territoire et de l’accès au numérique des enjeux prioritaires. Madame la secrétaire d’État, quelle est votre position sur cette proposition législative ?
Madame la sénatrice Havet, je partage le constat précis que vous venez de dresser. La loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral impose en effet des contraintes fortes en ce qui concerne l’implantation de pylônes de téléphonie mobile.
Lors des débats sur la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, le sujet avait été soulevé : dans le contexte d’accélération et de densification de la couverture mobile demandée aux opérateurs par les pouvoirs publics, l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation restreint la possibilité d’implanter des sites mobiles dans les communes littorales.
Des propositions similaires à la vôtre ont déjà été examinées. À titre d’exemple, le député Éric Bothorel avait proposé que les constructions destinées aux communications électroniques puissent déroger aux règles actuelles du code de l’urbanisme. La majorité des parlementaires avait toutefois considéré qu’il n’était pas opportun de remettre en cause cette règle de construction en continuité de l’urbanisation en zone littorale, si bien que tous les amendements de même nature avaient été rejetés.
Compte tenu de la réelle sensibilité de cette question et du fait que la majorité des parlementaires s’est prononcée clairement sur le sujet, le Gouvernement considère qu’il n’est pas opportun aujourd’hui de modifier l’équilibre trouvé dans la loi ÉLAN.

La parole est à Mme Annie Le Houerou, auteure de la question n° 1561, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises.

Madame la secrétaire d’État, depuis plus d’un an, les discothèques sont fermées. Leur réouverture en 2021 est incertaine pour l’instant.
D’après le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, près d’un quart des boîtes de nuit serait en train de disparaître. Le monde de la nuit représente à ce jour l’un des secteurs d’activité commerciale les plus touchés par les conséquences économiques de la pandémie.
Les chefs d’entreprise du secteur ont bénéficié de compensations financières en juillet 2020. Toutefois, ils n’ont pas pu compter sur toutes les mesures de soutien durant certaines périodes, ce qui a pénalisé les exploitants contraints d’honorer leurs charges fixes.
L’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie, qui est la première organisation professionnelle des cafés, hôtels, restaurants et établissements de nuit indépendants en France, a relayé l’inquiétude de ces chefs d’entreprise pour leur avenir, ainsi que l’urgence d’une prise en considération de leur situation face à la crise.
En décembre 2020, l’application aux discothèques des mesures de soutien économique dont bénéficient déjà les cafés et les restaurants n’a pas suffi à apporter une solution durable et adaptée à ce secteur spécifique.
En effet, les aides sont adaptées aux courtes situations d’urgence, mais elles ne conviennent pas aux établissements de nuit, qui sont actuellement totalement fermés pour une durée particulièrement longue. Ainsi, plus le temps passe, moins la clientèle se renouvelle et plus les habitudes de consommation changent.
Le Gouvernement a annoncé un plan de transformation des discothèques afin de les aider à réorienter leurs activités. Plusieurs unions représentatives du secteur demandent une indemnisation des fonds de commerce en raison de la perte de clientèle subie pendant et après la crise sanitaire.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement envisage-t-il une indemnisation des fonds de commerce des exploitants de boîtes de nuit s’ils la demandent, en complément des mesures déjà en vigueur ? Comment le Gouvernement entend-il soutenir un monde de la nuit durement et durablement affecté par la pandémie ?
Plus largement, la ministre Élisabeth Borne a indiqué que les entreprises employant des travailleurs saisonniers récurrents pourront recourir au chômage partiel afin de les encourager à embaucher dès la reprise. Compte tenu des incertitudes liées au niveau d’activité des établissements de nuit, mais également des cafés, des hôtels et des restaurants, lequel est imprévisible, tous ces professionnels s’inquiètent du caractère très restrictif de l’application de cette mesure. Qu’en est-il ?
Madame la sénatrice Annie Le Houerou, vous posez une question très importante, sur laquelle le Gouvernement est mobilisé, comme l’ensemble des parlementaires. Vous faites bien de rappeler à quel point les discothèques contribuent à la joie de vivre dans notre pays. Je comprends l’abattement actuel des professionnels du secteur : c’est pourquoi je vous remercie de mettre en avant un sujet qui me préoccupe beaucoup à titre personnel.
Les 1 600 établissements concernés ont en effet cessé toute activité depuis le premier confinement en mars 2020, il y a désormais plus d’un an. Afin d’assurer leur survie, le Gouvernement a permis dès juin 2020 aux exploitants de discothèques d’accéder au volet 2 du fonds de solidarité dans des conditions plus favorables que celles du droit commun, la prise en charge des charges fixes pouvant atteindre 15 000 euros par mois.
Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2020, le fonds de solidarité a été renforcé pour soutenir les secteurs les plus exposés, comme celui des discothèques. L’aide mensuelle couvrant la perte de chiffre d’affaires constatée peut, au choix de l’exploitant, correspondre à une compensation de la perte du chiffre d’affaires jusqu’à 10 000 euros ou à une aide représentant 20 % du chiffre d’affaires de référence, plafonnée à 200 000 euros par mois et par groupe.
En outre, le 14 janvier 2021, une nouvelle aide a été créée : elle s’ajoute au fonds de solidarité et permet la prise en charge jusqu’à 70 % des coûts fixes des entreprises fermées administrativement et qui réalisent plus d’un million d’euros de chiffre d’affaires mensuel.
Enfin, les exploitants des discothèques peuvent bénéficier de l’aide exceptionnelle au titre des congés payés pris par leurs salariés entre le 1er janvier et le 7 mars 2021.
Toutes ces mesures permettent de compléter le dispositif global de soutien aux entreprises dont ont déjà fort légitimement bénéficié ces établissements. Je pense notamment aux prêts garantis par l’État, aux mesures de soutien à l’activité partielle ou aux exonérations de cotisations sociales.
Au-delà de ce soutien absolument nécessaire, plusieurs réflexions sont actuellement en cours : elles portent sur le protocole sanitaire, la modernisation des équipements, l’accès aux crédits, ou bien encore l’application de la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Toutefois, à ce jour – je dis bien : à ce jour –, aucun mécanisme de soutien ne retient le fonds de commerce comme valeur à indemniser. D’une part, les réflexions se concentrent sur les indemnisations des pertes d’exploitation ; d’autre part, les fonds de commerce devraient à terme retrouver leur valeur normale.
Sachez en tout cas, madame la sénatrice, que le Gouvernement reste entièrement mobilisé pour accompagner ce secteur particulièrement touché.

La parole est à Mme Marie-Arlette Carlotti, auteure de la question n° 1649, adressée à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance.

Madame la secrétaire d’État, si la période est extrêmement difficile pour les entreprises, et ce dans tous les secteurs, la crise que traverse le transport aérien est sans précédent.
C’est dans ce contexte que nous avons appris, par la presse de surcroît, l’intention de la compagnie aérienne Air France de fermer ses trois bases en province à Nice, à Toulouse et à Marseille.
Cette décision, prise sans aucune concertation, donne le sentiment qu’Air France profite de cette période difficile, qui serait un effet d’aubaine en quelque sorte, pour procéder à des fermetures, lesquelles vont entraîner le transfert de centaines de personnels navigants commerciaux et de leurs familles vers Paris, avec les conséquences sociales et humaines que l’on sait. En outre, de telles fermetures auraient de lourdes répercussions économiques sur les nombreux sous-traitants de nos régions respectives.
Pourtant, l’annonce de l’arrivée de ces bases en 2012 nous avait tous satisfaits, car elles apportaient un plus en matière touristique et économique.
Madame la secrétaire d’État, le Gouvernement se félicite d’avoir obtenu de Bruxelles l’autorisation de recapitaliser Air France. L’État a d’ailleurs repris des parts dans le capital de cette entreprise prestigieuse qui, de surcroît, porte les couleurs de la France. L’aide accordée à Air France s’élève aujourd’hui à plusieurs milliards d’euros. En conséquence, nous pensons que vous êtes en droit d’intervenir pour sauvegarder les trois bases de Nice, Toulouse et Marseille.
Madame la secrétaire d’État, nous comptons vraiment sur votre aide !
Madame la sénatrice Carlotti, je vous remercie de votre question, qui me permet de vous faire savoir qu’à cette heure aucune décision ferme n’a été prise concernant la fermeture des bases d’Air France, que ce soit à Nice, à Toulouse ou à Marseille. Je suis très claire à ce sujet.
Comme vous l’avez dit, ces questions sont dans l’air, si vous me permettez cette expression. Toutefois, même si le sujet a été évoqué et fait l’objet de discussions avec les partenaires sociaux, je le répète : aucune décision n’a été prise à cette heure.
Ouvrir ou fermer une base aérienne ne signifie pas qu’Air France se désengage de son rôle de desserte du territoire. Dans le cas très particulier de ces bases, qui sont assez récentes, puisqu’elles ont été ouvertes en 2012, il s’agit de réfléchir aux modalités d’organisation des différentes plateformes et de répartition des salariés.
Ces modalités tiennent notamment compte d’événements extérieurs, comme la création de liaisons ferroviaires ou les mesures visant à limiter les émissions de CO2 du transport aérien qui figurent dans le projet de loi Climat et résilience, lequel sera bientôt examiné dans cet hémicycle.
Par ailleurs, le groupe Air France-KLM a été fortement affecté par la crise sanitaire. Il doit faire face à une baisse durable de son activité, l’Association internationale du transport aérien ne prévoyant un retour du trafic au niveau d’avant la crise qu’à l’horizon 2024.
Dans ce contexte particulièrement difficile, Bruno Le Maire a annoncé un prêt spécifique de 7 milliards d’euros en 2020. De plus, comme vous l’avez souligné, l’État a confirmé sa participation au plan de recapitalisation annoncé par Air France-KLM, pour un montant pouvant atteindre 4 milliards d’euros.
Le Gouvernement veillera particulièrement à ce que l’entreprise se positionne sur les meilleurs standards mondiaux et garantisse sa soutenabilité économique et financière à moyen et à long terme. De même, il veillera à ce que les plans de compétitivité soient menés en pleine concertation avec les organisations syndicales, les élus locaux et nationaux, et à ce que les décisions soient prises dans la transparence.
Je tenais à vous rassurer et à vous dire que le Gouvernement est attentif et qu’il se tient à votre disposition pour assurer avec vous un suivi attentif de ce dossier important.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d’État. Vous avez parlé de vigilance : c’est précisément cette vigilance et votre soutien que je demande.
Au moment où les élus locaux réclament davantage de décentralisation, où ils préparent et affinent leurs projets économiques pour les régions ; au moment où ceux-ci ont particulièrement besoin qu’on les respecte, car ils sont au front dans la lutte contre l’épidémie de covid-19, relocaliser ces bases aériennes près de Paris, alors qu’elles garantissent une véritable dynamique économique dans les régions où elles se situent – celle-ci reste minime, mais elle est primordiale –, ne constituerait pas un bon signe.
Aujourd’hui, je suis seule à poser cette question, mais je devrais dire « nous », car je m’exprime au nom de tous les élus locaux concernés, notamment ceux des Bouches-du-Rhône.
Madame la secrétaire d’État, nous serons particulièrement vigilants sur ce dossier et nous vous solliciterons de nouveau afin de maintenir ces trois bases là où elles sont implantées actuellement.

La parole est à M. Yves Bouloux, auteur de la question n° 1612, transmise à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur la demande formulée par les entreprises des secteurs de la restauration, de l’hôtellerie et des loisirs nocturnes d’une annulation, à titre exceptionnel, de la contribution à l’audiovisuel public au titre de l’année 2021.
Pour faire face à la crise sanitaire, le Gouvernement a mis en place plusieurs dispositifs exceptionnels visant à soutenir les entreprises durement touchées.
En raison des restrictions sanitaires, les cafés-restaurants sont à ce jour fermés depuis six mois et ont souffert d’une sous-activité durant les cinq autres mois. Les discothèques sont, quant à elles, toujours fermées, sans aucune perspective de réouverture. Enfin, les rares hôtels-restaurants qui ont pu ouvrir ont affiché un taux moyen d’occupation de 15 %.
En avril, ces professionnels devaient en principe s’acquitter de la contribution à l’audiovisuel public, qui représente parfois plusieurs milliers d’euros – à titre d’exemple, 1 490 euros pour un café pourvu de trois téléviseurs, ou encore 3 877 euros pour un hôtel de quarante chambres.
Le 14 avril dernier, Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont annoncé le report de trois mois de l’échéance déclarative et du paiement de cette contribution pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie, des cafés et des restaurants. Ce report permettra de ménager leur trésorerie quelques semaines de plus, mais les petites et moyennes entreprises concernées n’auront toujours pas, dans trois mois, les disponibilités suffisantes pour honorer le paiement de cette taxe.
Compte tenu du contexte très particulier et des difficultés de trésorerie de la grande majorité de ces PME, la contribution à l’audiovisuel public pour 2021 ne pourrait-elle pas, à titre exceptionnel, être annulée pour ces entreprises ?
Si cette annulation n’est pas retenue, ne peut-on pas faire bénéficier l’ensemble de ces entreprises de l’abattement de 25 % aujourd’hui réservé aux seuls hôtels touristiques ? C’est bien l’activité de l’ensemble des entreprises de ces secteurs qui est actuellement saisonnière.
La crise sanitaire s’inscrivant dans la durée, ne faut-il pas réfléchir à modifier, temporairement, le financement de l’audiovisuel public ?
Je vous remercie de cette question sur la contribution à l’audiovisuel public appelée en 2021, monsieur le sénateur Bouloux.
Comme vous l’avez souligné très clairement, nous œuvrons depuis le début de la crise pour soutenir la trésorerie des entreprises, une préoccupation également au cœur de l’attention des parlementaires.
Dans le contexte actuel, il peut être extrêmement difficile de s’acquitter de la contribution à l’audiovisuel public pour les entreprises du secteur de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, ainsi que pour les salles de sport. C’est pourquoi Bruno Le Maire et Olivier Dussopt ont annoncé, le 15 avril dernier, le report de trois mois de l’échéance déclarative et du paiement de cette contribution, due au mois d’avril.
Pour en bénéficier, les entreprises relevant du régime réel normal devront déclarer et payer la contribution à l’audiovisuel public à l’appui de la déclaration mensuelle ou trimestrielle qu’elles déposeront en juillet 2021. Les entreprises relevant du régime simplifié d’imposition devront la déclarer et la payer à l’appui d’une déclaration annuelle complémentaire mentionnant uniquement cette contribution à l’audiovisuel public en juillet 2021.
Par ailleurs, les entreprises du secteur des hôtels de tourisme et assimilés dont la période d’activité annuelle n’a pas excédé neuf mois en 2020 ont la faculté d’appliquer directement, lors du calcul de la contribution à l’audiovisuel public, la minoration de 25 % prévue en cas d’activité partielle.
Pour être encore plus complète, je précise que ce dispositif s’applique également aux auberges collectives, aux résidences de tourisme, aux villages résidentiels de tourisme, aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes, aux villages de vacances, aux refuges de montagne, aux habitations légères, aux résidences mobiles de loisirs et aux terrains aménagés comme les campings, les caravanages, les parcs résidentiels de loisirs.
Il s’agit donc d’une réponse immédiate, et tout de même relativement efficace, à l’inquiétude grandissante de nos entreprises.
Un dernier mot : je comprends le sens et la pertinence de votre question ; je sais aussi le souci d’adaptation permanente de Bruno Le Maire et Olivier Dussopt.
Nous aurons le plaisir, dans les prochains mois et, de manière certaine, au moment de l’examen du projet de loi de finances, de revenir sur ces sujets. S’il fallait envisager une nouvelle adaptation, si une véritable difficulté était constatée dans les prochains mois, je veux ici affirmer clairement que la position du Gouvernement – ce n’est pas une posture – est bien celle de l’adaptation permanente. Nous sommes à l’écoute, nous nous adaptons, nous essayons d’être agiles.
Je vous remercie de nouveau pour cette question pertinente, soulevant un vrai sujet pour de nombreux acteurs des secteurs du tourisme, mais aussi du sport et de la restauration.

La parole est à Mme Marie Mercier, auteur de la question n° 1527, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Madame la secrétaire d’État, je voudrais évoquer les mesures du plan de relance à destination des collectivités territoriales et les difficultés que rencontrent les maires des communes rurales.
En décembre 2020, le Gouvernement leur a transmis un guide pour expliquer les axes de ce plan. En Saône-et-Loire, j’ai échangé avec un grand nombre d’élus volontaires, qui se sont d’abord réjouis d’apprendre qu’une partie des fonds allait bénéficier à leur commune. Néanmoins, je dois vous le dire, la désillusion est vite arrivée, tant la mise en œuvre du plan est inadaptée à la réalité de nos territoires ruraux.
D’abord, l’abondement de la seule dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) suscite les interrogations des élus, puisqu’elle est orientée vers des priorités décidées par l’État. Or la détérioration de la capacité d’investissement des communes les a contraintes à retarder des projets trop coûteux pour elles. À cet égard, il est dommage que la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) n’ait pas bénéficié du même régime d’augmentation que la DSIL.
Ensuite, le pilotage est trop complexe. L’absence d’un guichet unique en préfecture apporte plus de confusion que de clarté – à tel point que les élus de mon territoire m’ont dit que le plan de relance devrait peut-être d’abord relancer la préfecture ! On peut le regretter, au moment où le Premier ministre annonçait vouloir redonner ses lettres de noblesse au couple maire-préfet, ce qui est une très bonne chose.
Enfin, les programmes développés sont multiples et marqués par des critères qui deviennent vite restrictifs. Ils traduisent une absence de souplesse, dont les élus de terrain ont pourtant désespérément besoin.
J’ai été sollicitée par plusieurs maires qui espéraient voir leur projet soutenu par le plan de relance. Tous m’ont expliqué avoir été redirigés vers la DETR, pourtant en baisse de 110 000 euros pour 2021 en Saône-et-Loire !
Madame la secrétaire d’État, pourquoi ne pas avoir prévu une augmentation substantielle de la DETR, avec une possibilité de bonification des subventions pour les projets qui auraient répondu aux exigences fixées par le Gouvernement ? Cela aurait été pragmatique, efficace et simple. Vous avez choisi une piste brouillée, alambiquée et rigide. Pourquoi ?
Vous interrogez le Gouvernement, madame la sénatrice Mercier, sur le soutien de l’État à l’investissement des communes, notamment dans le cadre du plan de relance.
Je vais tout de même vous rappeler d’où nous partons. La dotation globale de fonctionnement (DGF) avait baissé de 10 milliards d’euros en 2017, avec en contrepartie des augmentations ponctuelles des fonds d’investissement. Nous avons décidé non seulement de mettre un terme à cette baisse dès 2017, mais aussi de pérenniser des crédits à l’origine exceptionnels.
Quand on parle de soutien à l’investissement local, soyons très concrets : en 2014, la Saône-et-Loire bénéficiait d’une DETR de 8, 7 millions d’euros, et rien d’autre ; l’année dernière, le montant de cette DETR s’élevait à 14, 2 millions d’euros et celui de la DSIL à 5, 8 millions d’euros.
Ce soutien, nous avons décidé de l’accroître encore dans le contexte de la relance, premièrement en majorant de 950 millions d’euros la DSIL pour financer des projets s’inscrivant dans la transition écologique, l’accompagnement sanitaire et la préservation du patrimoine ; deuxièmement, en créant, en miroir du montant de la DSIL, une enveloppe de 950 millions d’euros supplémentaires pour financer des travaux de rénovation énergétique des bâtiments des collectivités, dont 650 millions d’euros pour le bloc communal, gérée de manière analogue à la DSIL.
Nous avons donc choisi d’avoir recours à un outil qui, me semble-t-il, est parfaitement connu et utilisé par les acteurs locaux. Il permet en outre de cibler la ruralité, mais aussi des villes de taille plus importante, ce qui aurait été impossible avec la DETR.
Cela ne signifie pas pour autant que les collectivités rurales n’ont pas accès à ces financements. Bien au contraire, le Gouvernement, par la voix de Jacqueline Gourault, a demandé aux préfets d’être vigilants à l’équilibre territorial des subventions accordées, par exemple en adaptant les délais de dépôt des dossiers pour tenir compte des spécificités des collectivités rurales.
On voit d’ailleurs, en pratique, que les territoires ruraux bénéficient de la majeure partie des subventions au titre de la DSIL. Je peux citer un exemple, me semble-t-il parlant : en Saône-et-Loire, 25 projets communaux ont d’ores et déjà été financés avec la DSIL exceptionnelle pour l’année 2020, dont 14 concernent des communes rurales.
Plus généralement, je ne pense pas que l’on puisse opposer, d’un côté, une DETR adaptée aux besoins des territoires et, de l’autre, une DSIL déconnectée des projets locaux. Comme vous le savez, tous les crédits sont déconcentrés et financent des opérations présentées par les élus.
Pour conclure, il ne me paraît pas choquant que l’État fixe de grandes orientations pour l’emploi de fonds qui, après tout, sont des crédits mobilisés par l’État sur son budget, sous le contrôle du Parlement, c’est-à-dire des Français.
En tout état de cause, madame la sénatrice Mercier, soyez assurée de l’engagement du Gouvernement.

Les maires sont les garants de la paix sociale. Ils sont là pour aménager leur territoire et favoriser la démocratie de proximité, une démocratie dont notre pays a besoin. Aidez-les en simplifiant les choses ! Ne les découragez pas !

La parole est à M. Olivier Cigolotti, auteur de la question n° 1567, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Ma question s’adresse à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Dans le cadre de la loi du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, le législateur avait rendu éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les dépenses réalisées par les collectivités locales concernant les frais d’études, d’élaboration, de modification et de révision des documents d’urbanisme. Or la loi de finances pour 2021 a mis fin à cette possibilité, à compter de l’exercice budgétaire en cours, à travers l’automatisation du FCTVA.
Les frais d’études, d’élaboration, de modification et de révision de ces documents d’urbanisme sont obligatoirement amortis sur une durée de dix ans, et les amortissements qui en découlent pèsent lourdement sur les dépenses des collectivités. L’éligibilité au FCTVA permettait jusqu’à présent d’atténuer significativement cette charge financière.
L’incidence de ces pertes d’éligibilité au FCTVA sera désormais extrêmement dommageable pour le bloc communal, tant sur les documents d’urbanisme indispensables au développement des territoires que sur l’aménagement des terrains, notamment des terrains consacrés au sport.
Cette situation inquiète les acteurs locaux, d’autant plus à la veille de l’examen du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dont certaines dispositions visent à rendre obligatoire la modification des documents de planification et d’urbanisme pour intégrer l’objectif de lutte contre l’artificialisation des sols.
Les élus locaux s’inquiètent également des conséquences de l’automatisation du FCTVA sur l’aménagement des terrains, plus particulièrement des terrains de sport.
Madame la secrétaire d’État, quelles mesures entendez-vous prendre pour rétablir l’éligibilité au FCTVA des documents d’urbanisme et rassurer les élus sur ses conséquences en matière d’aménagement des terrains, notamment, j’y insiste, des terrains de sport ?
Monsieur le sénateur Cigolotti, la loi de finances pour 2021 automatise la gestion du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, pour les dépenses exécutées à partir du 1er janvier 2021.
La logique antérieure d’éligibilité, qui reposait sur des critères juridiques, est remplacée par une logique comptable. Dorénavant, une dépense sera éligible à partir du moment où elle est imputée sur un compte éligible, dans le respect des règles d’imputation comptable.
Par construction, cette évolution implique une évolution du périmètre des dépenses éligibles.
Le Gouvernement s’est attaché à modifier l’assiette le moins possible, en concertation étroite et soutenue avec les élus locaux.
Vous l’avez clairement noté, monsieur le sénateur, certaines dépenses ne sont plus éligibles. C’est effectivement le cas des documents d’urbanisme, appartenant au compte 202, « Frais liés à la réalisation des documents d’urbanisme et à la numérisation du cadastre des documents d’urbanisme », qui n’a pas été retenu dans l’assiette automatisée. Il s’agit toutefois de montants modestes, voire très modestes – moins de 20 millions d’euros par an pour les documents d’urbanisme, c’est-à-dire 0, 3 % du fonds, qui s’élève à plus de 6 milliards d’euros.
D’autres dépenses, en revanche, deviennent plus largement éligibles, comme les dépenses relatives à des biens que les collectivités confient à des tiers inéligibles au FCTVA et qu’elles n’utilisent pas pour leur usage propre.
La réforme est toutefois favorable aux collectivités : non seulement les élargissements et restrictions d’assiette ont été conçus pour s’équilibrer, mais le gain de la réforme pour les collectivités pourrait aussi aller jusqu’à 235 millions d’euros selon les années considérées du cycle électoral.
Par ailleurs, la nouvelle procédure fera gagner du temps et de l’argent aux collectivités locales, qui seront remboursées directement au lieu d’avoir à envoyer des dossiers papier à la préfecture.
Une vue d’ensemble sur la nouvelle assiette permet donc d’apprécier la portée exacte de la réforme, et la mise en œuvre progressive de cette dernière offrira la possibilité de procéder à une telle évaluation dans les prochains mois. Je ne doute pas, monsieur le sénateur Cigolotti, que vous serez au rendez-vous.

Avec l’automatisation du FCTVA, les élus s’attendaient encore une fois à une mesure de simplification – ce qui me ramène, d’ailleurs, aux propos précédents de ma collègue Marie Mercier. Cette réforme est effectivement perçue aujourd’hui comme une sanction. Pour un certain nombre de communes, c’est même la double peine, leur DGF ayant subi une diminution difficilement explicable.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, auteure de la question n° 1601, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

La suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales affecte les conditions de financement des collectivités, par la réduction de l’assiette de leur prérogative d’imposition directe.
On commence à constater un effet pervers de la réforme sur le terrain, dans nos communes. Il s’agit d’une conséquence négative indirecte sur les politiques locales en matière d’accueil de logements sociaux.
En effet, pour les maires assujettis aux obligations de l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, l’implantation d’une proportion de logements conventionnés est non pas une option, mais une obligation légale. La particularité fiscale du secteur du logement social réside dans les exonérations de fiscalité foncière locale dont il bénéficie, et ce pour une période allant jusqu’à trente ans, et que l’État ne compense quasiment pas.
Avec la fin de la taxe d’habitation, les futures constructions de logements sociaux ne produiront donc quasiment plus de ressources fiscales pour les communes d’accueil. Ces dernières vivront donc un étonnant paradoxe : davantage de charges liées à la prise en compte éducative et sociale d’un public fragile et une privation de ressources liée aux exonérations de foncier bâti, cumulées à la disparition de la taxe d’habitation.
Enfin, dans les départements ruraux, moins denses, le logement social fait l’objet d’un surfinancement par les collectivités locales, car le plus souvent, en plus des subventions qu’elles allouent aux organismes au titre de leur politique locale de l’habitat, les communes fournissent le foncier, les dessertes, la viabilisation, l’entretien des espaces attenants, etc.
En définitive, les coûts assumés par les communes ou leurs groupements pour l’accueil du logement social s’avèrent essentiels au mode de financement du secteur. La réforme de la taxe d’habitation, si elle n’est pas corrigée sur ce point, risque de donner un véritable coup d’arrêt à la politique de construction d’un secteur déjà bien à la peine, après la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, la loi ÉLAN, et les ponctions financières qui l’ont suivie.
Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de m’indiquer les modifications susceptibles d’être proposées pour corriger cette situation.
Le sujet que vous évoquez est complexe, madame la sénatrice Varaillas. Il fait intervenir deux facteurs : d’une part, la taxe d’habitation sur les résidences principales a été supprimée, ce qui fait – je ne vous apprends rien – que les logements sociaux, comme les logements privés ne produiront plus de recettes à ce titre à compter de 2021 ; d’autre part, grâce au nouveau schéma de financement entré en vigueur cette année, chaque collectivité a bénéficié de la compensation intégrale de sa perte de taxe d’habitation ou de taxe foncière, par l’intermédiaire d’un mécanisme fiscal pérenne et dynamique.
En matière de logements sociaux, précisément, il convient de distinguer ceux qui sont déjà construits – le stock – de ceux qui le seront prochainement – le flux.
Pour les logements sociaux déjà construits, la refonte de la fiscalité ne pénalise pas les communes. Comme je l’ai indiqué, celles-ci bénéficieront d’une compensation intégrale des pertes de taxe d’habitation liée à ces logements, grâce à un dispositif pérenne et dynamique.
Pour les futures constructions de logements sociaux, la loi de finances pour 2020 prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement en 2023. Il s’agira d’examiner un point particulier : la crainte, soulevée par certains observateurs, que les maires ne soient plus incités à construire ces logements sociaux au motif qu’ils ne percevront plus de taxe d’habitation, en plus de l’exonération de taxe foncière de longue durée dont bénéficient déjà les bailleurs sociaux.
Or la situation en matière de taxe d’habitation est la même pour toutes les catégories de logements et, pour la taxe foncière, l’exonération de longue durée existait déjà avant la refonte de la fiscalité locale et n’a pas été modifiée.
La difficulté provient davantage du caractère partiel de la compensation de cette exonération de taxe foncière pour les communes, question nécessitant une analyse approfondie et devant s’inscrire dans un cadre global.
On doit préciser, en premier lieu, que l’idée simple d’une meilleure compensation sur le foncier aurait un coût budgétaire certain pour l’État, pour un résultat incertain.
Dès lors, d’autres éléments doivent être pris en compte.
Il est désormais rare que les programmes immobiliers ne visent à construire que des logements sociaux. Généralement, ils intègrent logements sociaux et logements privés, et ces derniers produiront bien une recette de taxe foncière pour la commune.
Par ailleurs, si l’exonération de taxe foncière sur les logements sociaux est de longue durée, elle reste temporaire. Les logements sociaux construits créeront bien, à terme, une recette de taxe foncière pérenne.
Enfin, madame la sénatrice, la part de logements sociaux continue de jouer pour toute une série de dotations de l’État, notamment de péréquation, qui favorisent les communes accueillant des logements sociaux – dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), dotation politique de la ville (DPV) – ou celles qui accueillent de nouveaux habitants – DGF.

On aurait pu, me semble-t-il, prendre une mesure pour répondre à cette préoccupation, en prévoyant un plancher de taxe d’habitation imputé à chaque logement bénéficiant de l’exonération du foncier bâti, durant la période où cette exonération s’applique.

La parole est à Mme Sylviane Noël, auteure de la question n° 1604, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

En l’état actuel du droit, une salle de cinéma bénéficie de certains aménagements juridiques et fiscaux autorisant les municipalités à lui apporter une aide financière directe ou indirecte.
La loi du 13 juillet 1992 relative à l’action des collectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles de spectacles cinématographiques, dite loi Sueur, autorise ainsi les collectivités locales à contribuer au fonctionnement ou aux investissements des salles de cinéma, étant entendu que le montant de subvention accordé, par année, ne peut excéder 30 % du chiffre d’affaires de l’établissement ou 30 % du coût du projet, si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à l’octroi d’un soutien financier.
Mais qu’en est-il pour les exploitants de cinéma qui n’ont pas encore pu ouvrir leur cinéma et qui n’ont donc aucune antériorité d’exploitation, se retrouvant dans l’impossibilité de présenter des comptes d’exploitation ?
Dans la pratique, certaines communes qui souhaitent subventionner l’exploitant de leur cinéma, alors que celui-ci n’est pas encore ouvert, se sont vu refuser le versement de ces subventions par le contrôle de légalité sur la base de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales.
Pourtant, au regard du respect de la liberté du commerce et de l’industrie, leur intervention économique semble pleinement justifiée, conformément à la jurisprudence administrative actuelle qui fait prévaloir la double condition qu’il existe un intérêt public local – en l’occurrence, la revitalisation du centre-ville et le développement du lien social et de l’offre culturelle – et une carence de l’initiative privée.
C’était le cas, en l’espèce, pour les communes concernées.
Le secteur du cinéma, dont l’activité est suspendue depuis des mois, est tout particulièrement touché par la crise sanitaire inédite que nous traversons. Ces nouveaux établissements s’apprêtent donc à démarrer leur activité dans un contexte de crise très délicat. Empêcher les communes de leur apporter cette aide reviendrait à les condamner définitivement.
Je souhaiterais donc savoir si le Gouvernement est prêt à envisager une solution dérogatoire pour ce cas d’espèce particulier.
Les cinémas – faut-il le rappeler ? – sont au cœur de la vitalité culturelle, mais aussi sociale et économique de nos communes.
Même si la crise actuelle rend cette réalité d’autant plus visible, la loi donne déjà un cadre favorable à l’intervention des communes en faveur des exploitants de cinéma.
Premièrement, depuis la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les communes ont les moyens de préserver les petites salles indépendantes menacées de disparition. Ainsi, selon la loi, la commune peut aider des cinémas existants réalisant moins de 7 500 entrées par an ou classés « art et essai ».
Le Conseil d’État, dans un arrêt Société Le Royal Cinéma, en date du 10 mars 2021, a rappelé le périmètre de ces subventions, en précisant que celles-ci sont réservées aux entreprises existantes pour des cinémas existants. Il s’est appuyé dans sa décision sur les débats parlementaires de l’époque, qui visaient bien la préservation de petits cinémas menacés de fermeture, et non une politique de développement du cinéma municipal. C’est la raison pour laquelle le préfet a bloqué la délibération.
Pour aller plus loin dans le contexte actuel et soutenir la création de nouveaux cinémas, le projet de loi « 4D » prévoira une nouvelle possibilité de soutien, en autorisant expressément les collectivités à attribuer des subventions à des entreprises existantes pour le financement de nouveaux cinémas.
Deuxièmement, à court terme, les communes ou leurs groupements peuvent aussi favoriser la création de salles de cinéma en se fondant sur d’autres bases juridiques. Je pense notamment à l’article L. 2251–3 du code général des collectivités territoriales, qui permet de créer ou de maintenir un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en cas de carence de l’initiative privée. Cette faculté peut être utilisée dans les communes situées en quartiers prioritaires de la politique de la ville ou en milieu rural.
Je signale aussi que certaines dispositions de droit commun permettent au bloc communal d’intervenir, à savoir l’article L. 1511-3 du code général des collectivités territoriales pour les aides à l’immobilier et l’article L. 1511-2 du même code pour les aides de droit commun, en passant une convention avec la région.
Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice Noël, et dans le même état d’esprit que lors de ma réponse à la question sur les discothèques, je tiens à vous dire que je prends la pleine mesure – pour des raisons très personnelles, d’ailleurs – des problématiques qui se posent pour les cinémas. Je me mets donc, ainsi que les services concernés, à votre disposition pour examiner le dossier qui vous a été signalé et voir s’il entre dans l’un ou l’autre des cas de figure évoqués.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État. J’en prends acte et je vous transmettrai personnellement le dossier de la commune concernée, laquelle a réalisé des efforts importants pour l’implantation de ce cinéma. Franchement, cette aide est aujourd’hui indispensable pour permettre la survie de l’établissement.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 1632, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

J’ai souhaité interroger Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les nouvelles modalités de formation des élus locaux.
Deux ordonnances prises en janvier dernier viennent, à la fois, combler certaines failles que présentait le droit individuel à la formation des élus (DIFE) et créer de nouveaux problèmes, alors que la complexité grandissante des normes rend encore plus indispensable cette formation.
Les élus locaux, qui bénéficiaient jusqu’alors de 20 heures de formation renouvelables et cumulables chaque année, doivent maintenant composer avec une enveloppe annuelle de 700 euros, sans possibilité de cumul d’une année sur l’autre en cas de non-utilisation.
Pis, l’arrêté du 16 février 2021 abaisse à 80 euros par heure et par élu le plafond des frais pédagogiques pouvant être engagés.
Pour moi, comme pour beaucoup d’élus, ces nouvelles restrictions limitent dangereusement la qualité des formations qui pourront être proposées.
En l’état, cette réglementation risque de dissuader les organismes agréés de proposer des formations individuelles de qualité personnalisées, faute de pouvoir rémunérer correctement leurs intervenants.
Dans ces conditions, madame la secrétaire d’État, le Gouvernement entend-il soutenir, à l’Assemblée nationale, la position du Sénat ? En effet, lors de l’examen du projet de loi de ratification de ces ordonnances, celui-ci avait réintroduit la possibilité de cumul. Comment comptez-vous permettre à nos élus d’accéder à davantage de formations avec toujours moins de moyens ?
Madame la sénatrice Procaccia, je vous remercie de votre question sur un sujet qui a fait l’objet d’un important travail au Sénat, à l’occasion de l’examen du projet de loi de ratification des ordonnances portant réforme de la formation des élus locaux.
Vous le savez, ce texte a été adopté à l’unanimité des suffrages exprimés le 8 avril dernier, après avoir été utilement enrichi par votre assemblée.
La formation des élus locaux est structurée autour de deux sources de financement : les crédits des collectivités locales pour former leurs propres élus à l’exercice de leur mandat, d’une part, et le droit individuel à la formation des élus locaux, d’autre part. Ce DIFE est financé par les élus et son utilisation relève de leur initiative personnelle.
Les collectivités locales sont donc pleinement responsables de la formation de leurs élus.
S’agissant plus particulièrement du DIFE, ce dernier a fait face à d’importantes difficultés financières au cours des derniers mois. Certains organismes ont en effet fortement augmenté le coût de leurs formations, jusqu’à 450 euros par heure dans certains cas. En formant à des prix très élevés un nombre très réduit d’élus, ces pratiques assèchent les financements du fonds.
C’est précisément pour permettre à davantage d’élus de se former que le Gouvernement, après avoir consulté les associations d’élus et les organismes de formation, a créé un plafond de coût par heure de formation, d’abord fixée à 100 euros, puis à 80 euros par participant.
Ces mesures sont distinctes des ordonnances réformant la formation des élus locaux, mais resteront en vigueur à l’avenir. Il me semble qu’un montant de 80 euros par heure et par participant reste une rémunération raisonnable, indépendamment de la formation organisée.
S’agissant du remboursement des frais de déplacement ou de séjour des élus, les associations d’élus ont exprimé la volonté qu’ils continuent d’être pris en charge par le DIFE. Nous avons entendu cette demande et, donc, maintenu cette possibilité.
Par ailleurs, les ordonnances réformant la formation des élus visent un objectif beaucoup plus large. Elles prévoient en particulier la rénovation complète du DIFE, avec la création d’une plateforme numérique intégrée dans moncompteformation.gouv.fr, la plateforme qui gère le compte personnel de formation. C’est un gage d’accélération des démarches pour les élus.
Vous l’indiquez enfin, madame la sénatrice, les élus bénéficieront dorénavant de droits libellés en euros, et non plus en heures, ce qui leur permettra de se former plus longuement s’ils choisissent une formation moins coûteuse.
Ils pourront continuer à accumuler des droits d’une année sur l’autre, dans la limite d’un plafond. Le montant précis de ces droits n’a pas encore été fixé. Il sera déterminé dans la concertation, après consultation du Conseil national de la formation des élus locaux.
Plus généralement, cette réforme d’ensemble consolide la formation des élus et apporte, me semble-t-il, les garanties nouvelles qui permettront aux élus locaux de se former en plus grand nombre et dans des conditions permettant la transparence de l’activité de formation.

Effectivement, il était devenu indispensable de réformer la formation des élus locaux ; pour autant, le fait que certains organismes aient pu abuser ne justifie pas que l’on pénalise tous les autres.
J’espère en tout cas, comme vous l’affirmez, que la fixation d’un coût plafond par heure de formation permettra malgré tout à de nombreux élus de se former. En revanche, lors des débats au Sénat – peut-être y assistiez-vous ou en avez-vous lu le compte rendu –, la quasi-totalité des intervenants ont souligné les frais excessifs que perçoit la Caisse des dépôts et consignations, à savoir 25 % du coût de la formation, qui viennent amputer le crédit formation des élus.
J’ai cru comprendre – et j’espère avoir bien compris – que l’amendement adopté par le Sénat avait reçu l’assentiment du Gouvernement. C’est déjà un gros progrès, et je vous en remercie. Toujours est-il que j’espère qu’il sera possible d’aller plus loin, en particulier au regard de ces frais de gestion.

La parole est à M. Éric Gold, auteur de la question n° 1646, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Le syndicat mixte de gestion forestière est un syndicat mixte ouvert qui permet de regrouper la gestion de forêts communales et sectionales, notamment dans les territoires du Massif central, caractérisés par un morcellement important de la forêt publique. Ces syndicats assurent la gestion courante des forêts sans transfert de propriété, ainsi qu’une gestion durable et multifonctionnelle des forêts publiques.
Je suis sollicité par l’Association des communes forestières du Puy-de-Dôme, qui est en désaccord avec la préfecture sur l’application des textes.
Les services de l’État dans le département demandent dorénavant que seuls des conseillers municipaux siègent au syndicat mixte de gestion forestière en tant que délégués des sections sans commission syndicale.
Pour l’association, cette interprétation des textes va au-delà des objectifs législatifs initiaux.
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique ne prévoyant pas le cas des sections de commune, les services de l’État dans le département du Puy-de-Dôme demandent ainsi d’appliquer, par défaut, les règles valables pour les communes.
Cet état de fait soulève, selon les communes forestières, plusieurs questions, notamment sur l’intérêt qu’y trouverait un syndicat dont l’organe délibérant ne représente finalement qu’un seul des membres, la commune en l’occurrence, puisque tous les délégués sont issus du conseil municipal.
Un tel fonctionnement menacerait, selon elles, la gestion mutualisée centrée sur la valorisation des biens forestiers communaux et sectionaux comme la production de bois.
Outre la consigne des services préfectoraux en elle-même, l’Association des communes forestières du Puy-de-Dôme regrette également l’absence d’échange sur cette problématique.
La règle appliquée par les services préfectoraux, à savoir une gouvernance des syndicats mixtes de gestion forestière entièrement confiée aux élus municipaux, est-elle selon vous la bonne interprétation ?
Monsieur le sénateur Gold, vous interrogez le Gouvernement sur la représentation, par les conseillers municipaux, des sections sans commission syndicale au sein d’un syndicat mixte de gestion forestière.
Cette question recouvre en réalité des enjeux essentiels de gouvernance et démocratie.
Le Conseil constitutionnel a rappelé, dans sa décision de mai 2019, qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, et de celle du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune que le législateur a de manière constante entendu renforcer le lien qui unit les sections à leur commune pour favoriser une gestion des biens des sections compatible avec les intérêts de la commune.
Le législateur de 1985, au même titre que celui de 2013, a donc toujours tenu compte des réalités sociologiques locales et a prévu les cas dans lesquels une commission syndicale n’est pas constituée.
Lorsqu’il n’y a pas lieu à constitution de la commission syndicale, le principe est le suivant : ses prérogatives sont exercées par le conseil municipal. Ainsi, toutes les compétences attribuées à la commission syndicale par l’article L. 2411-6 du code général des collectivités territoriales sont exercées par le conseil municipal ; cela concerne notamment la désignation des délégués représentant la section de commune.
En effet, la désignation par le conseil municipal de ses délégués représentant la section de commune n’est pas régie par des dispositions spécifiques qui seraient dérogatoires au droit commun. Dans une telle hypothèse, la loi du 27 décembre 2019 prévoit que, pour l’élection des délégués des communes, des départements et des régions au comité de syndicat mixte, le choix de l’organe délibérant peut porter uniquement sur l’un de ses membres.
Cette règle, qui s’applique à l’ensemble des syndicats mixtes ouverts ou fermés, tient à la volonté du législateur de renforcer la légitimité démocratique au sein de ces syndicats en permettant aux seuls élus d’y siéger. Dès lors, il revient au conseil municipal de désigner en son sein les délégués représentant la commune, ainsi que les délégués représentant les sections de commune.
Enfin, le conseil municipal ne peut désigner des délégués que parmi les membres du conseil municipal. Il est à noter que les membres de la section demeurent associés en cas de changement d’usage ou de vente de tout ou partie des biens de la section.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. On le voit bien, dans certains cas spécifiques, il y a encore place à interprétation. Afin que celle-ci ne crée aucune frustration au sein des organes de gouvernance, l’État doit accompagner et conseiller les communes forestières et l’ensemble des acteurs, qui ne sont pas obligatoirement des élus municipaux.

La parole est à M. Max Brisson, auteur de la question n° 1476, transmise à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Depuis le 1er janvier 2019, l’obligation de collecte de la taxe de séjour relève de la responsabilité de plateformes numériques, afin de prendre en compte les nouvelles spécificités de l’activité de location de courte durée.
De plus, le code général des collectivités territoriales impose aux plateformes l’obligation de transmettre, au moment du reversement de la taxe, un état déclaratif aux collectivités.
Madame la secrétaire d’État, si ces mesures vont dans le bon sens, elles n’apparaissent cependant ni suffisantes ni pleinement satisfaisantes pour des collectivités qui font état d’un certain nombre de difficultés.
Tout d’abord, en raison d’une normalisation insuffisante des états déclaratifs, les collectivités observent de nombreux manquements à ces obligations et de grandes disparités entre les états déclaratifs transmis, parfois peu exploitables et souvent erronés et incomplets.
Dans ce cas de figure, les plateformes ont tendance à se décharger de leur responsabilité sur les loueurs. Si la loi prévoit la possibilité de leur appliquer des amendes en cas d’omission ou d’inexactitude, il demeure un flou juridique à ce sujet, qui nécessite d’être clarifié.
Finalement, les plateformes échappent aux obligations auxquelles sont soumis les autres professionnels ou autres loueurs indépendants, qui, eux, dans un cas de figure similaire, sont susceptibles de se voir appliquer des sanctions. Il y a là une inégalité inacceptable.
Enfin, si le calendrier de reversement de la taxe de séjour est fixé par la loi, ce n’est le cas ni des conditions ni des modalités de transmission de l’état déclaratif. Celles-ci sont régies uniquement par la libre décision des plateformes. Résultat : les collectivités réceptionnent des documents via des canaux divers dans des délais non uniformisés et dans des formats différents. S’ensuit pour elles une problématique de recherche et de croisement des données qui complique lourdement l’exercice de leur mission.
Aussi, madame la secrétaire d’État, pour pallier les problèmes constatés tant sur la collecte que sur les états déclaratifs, le Gouvernement compte-t-il entamer une réflexion avec les acteurs concernés pour préciser un cadre réglementaire aujourd’hui insuffisant vis-à-vis des plateformes numériques ?
Monsieur le sénateur Brisson, la taxe de séjour a connu de nombreuses évolutions législatives et réglementaires depuis 2015. Ces dernières années, chaque loi de finances a apporté son lot d’évolutions et, pourrait-on dire, de réjouissances…
Ainsi, la loi de finances rectificative pour 2017 a notamment introduit deux modifications majeures, applicables depuis 2019 : d’une part, pour les hébergements sans classement ou en attente de classement, la taxation proportionnelle au coût par personne de la nuitée, les autres hébergements restant assujettis à un tarif conforme au barème fixé par le législateur ; d’autre part, l’obligation de collecte imposée aux plateformes, celles-ci agissant en effet en qualité d’intermédiaire de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.
Cette dernière obligation a constitué une avancée considérable pour les collectivités locales, qui ont pu récupérer des montants de taxe de séjour qui n’étaient en réalité pas collectés auparavant.
C’est ainsi que le produit de la taxe de séjour a progressé de 18 % en 2019 par rapport à 2018. Cette collecte obligatoire de la taxe de séjour a été accompagnée dans la loi de finances pour 2019 de nouvelles précisions sur les états déclaratifs que doivent communiquer les plateformes aux collectivités locales au moment du reversement de la taxe.
Par ailleurs, d’autres simplifications ont été adoptées récemment.
Premièrement, la loi de finances pour 2020 a modifié la périodicité de reversement de la taxe collectée par les plateformes. Elles doivent désormais la reverser avant le 30 juin, puis avant le 31 décembre. Cette même loi a supprimé la possibilité d’appliquer le régime forfaitaire aux hébergements non classés.
Deuxièmement, la loi de finances pour 2021 a avancé la date limite de délibération, précisément pour que l’administration fiscale soit en mesure de fournir plus rapidement les tarifs aux plateformes, afin que celles-ci puissent verser des montants de taxe de séjour plus réguliers aux collectivités locales.
À ces simplifications, qui sont autant de garanties techniques pour les collectivités, s’ajoutera une forme de garantie financière puisque le rendement de la taxe sera augmenté avec la modification du plafonnement applicable aux hébergements non classés, mesure adoptée dans la dernière loi de finances.
Par ailleurs, monsieur le sénateur Brisson, si certaines pratiques peuvent – je n’en doute pas – être encore améliorées – je pense par exemple à la transmission effective par les collecteurs de la taxe de toutes les informations prévues par la loi –, il semble au Gouvernement que la taxe de séjour a également besoin d’un cadre juridique stable pour donner de la visibilité à tous les acteurs.
C’est donc à l’aune de cet impératif que le Gouvernement examinera très favorablement toute nouvelle évolution en matière de taxe de séjour cette année.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse. Je sais que le sujet est complexe, tout comme je sais la volonté de tous de réduire les distorsions avec les hébergeurs professionnels, ainsi que les progrès enregistrés et les efforts du Gouvernement. Pour autant, j’appelle de nouveau son attention sur le fait que les plateformes s’insèrent dans tous les interstices que la réglementation leur offre. Un cadre plus strict concernant les états déclaratifs – c’était le sens de ma question – réduirait les effets d’aubaine, qui créent des distorsions insupportables pour les hébergeurs professionnels.
Au-delà de la simple question de la taxe de séjour, il reste du travail à faire sur ces états déclaratifs insuffisamment normalisés.

La parole est à M. Édouard Courtial, auteur de la question n° 1576, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Il y a urgence, plus particulièrement dans les territoires ruraux, à inverser cette tendance dangereuse du désengagement physique de l’État, que les élus locaux ne cessent de dénoncer. Car l’accès à un service public de proximité et de qualité est un prérequis indispensable pour donner un avenir à nos campagnes.
Pour répondre à cet enjeu majeur, qui, faute de solution, remettrait en cause la liberté de choix de nos concitoyens de vivre à la ville ou en dehors, le Gouvernement promet le déploiement de 2 000 maisons France Services, une par canton, d’ici à 2022.
Mais, si nous pouvons partager approuver le développement de ce guichet unique, sa réussite repose sur trois conditions, qui, à l’heure actuelle, ne semblent pas remplies.
Tout d’abord, il faut choisir un maillage territorial efficace. Or l’échelle retenue est celle des cantons, tels que les définit la loi du 17 mai 2013. Ainsi, de très grands cantons, où les problématiques de mobilité sont amplifiées, qui, auparavant, étaient dissociées en unités plus petites, ne disposeront que d’un seul point, là ou des cantons plus petits ou urbains en auront un également.
Il serait bien plus pertinent de s’appuyer sur la répartition des anciens cantons pour s’assurer de l’efficacité du dispositif, faute de quoi, dans bien des cas, les services décentralisés seront lacunaires.
Deuxième condition : il faut un budget suffisant. Or l’État ne participe qu’à hauteur de 30 000 euros par an, soit le coût d’un seul agent. Cette dotation apparaît largement insuffisante pour répondre aux attentes et faire face aux besoins.
Ainsi, ce qui représente une plus-value pour les administrés ne doit pas, pour autant, engendrer une nouvelle prise en charge par les collectivités territoriales des missions incombant à l’État.
Cette inquiétude est aujourd’hui légitimement exprimée par les élus locaux : il faut donc, sans attendre, que le Gouvernement s’engage dans la durée et d’une manière plus significative.
Troisième et dernière condition : que le dispositif s’insère dans un plan global. Les maisons France Services ne peuvent être ni la réponse unique de l’État pour renforcer sa présence dans les territoires ni un jeu à somme nulle où l’on déshabille Paul pour habiller Jacques et qui justifierait la fermeture d’autres structures déconcentrées de l’État.
Madame la secrétaire d’État, il vous faut prendre garde de faire des maisons France Services un outil de communication politique, alors que le sentiment d’abandon dans nos territoires ruraux ne fait que croître.
Monsieur le sénateur Courtial, depuis l’annonce de sa mise en place par le Président de la République en avril 2019, le réseau France Services se déploie sur l’ensemble du territoire. D’importants moyens sont et seront engagés pour en assurer la pérennité.
Pour vous répondre, je me permets de soumettre à votre sagacité quelques éclaircissements.
D’abord, l’État et ses opérateurs accordent à chaque espace France Services un montant annuel de 30 000 euros pour contribuer aux dépenses de fonctionnement. En 2021, le montant total de ces contributions s’élève à plus de 61 millions d’euros ; il était de 40 millions d’euros en 2019 et de 46 millions en 2020.
À cette dotation de fonctionnement, il faut par ailleurs ajouter le financement de la formation des agents des maisons France Services et l’animation du réseau.
De plus, pour encourager la création de structures itinérantes et accompagner au mieux les porteurs de projets, l’État et la Banque des territoires ont également pris en charge, dans le cadre de deux appels à manifestation d’intérêt, 80 projets de France Services mobiles, dont un situé dans l’Oise, à hauteur de 60 000 euros en investissement pour chacun d’entre eux, soit un investissement total de 4, 8 millions d’euros en 2020.
L’avancée du déploiement témoigne d’abord de l’engouement des porteurs de projets ainsi que des usagers pour France Services. À ce jour, 1 304 maisons France Services sont déployées en France métropolitaine et outre-mer, particulièrement dans des territoires désignés comme prioritaires que sont les zones de revitalisation rurale (ZRR) et les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
De janvier à avril 2021, monsieur le sénateur Courtial, ces structures ont réalisé près de 860 000 accompagnements d’usager, dont plus de 8 000 dans le département qui vous est cher. Ces données ne pourront que s’amplifier avec le déploiement des maisons France Services, qui se poursuit.
À la fin de 2022, d’après les projections transmises par les préfectures, la cible des 2 500 maisons France Services sera bel et bien atteinte.
Concernant très précisément le département de l’Oise, le déploiement de France Services et les concertations avec les acteurs locaux se poursuivent pour atteindre les objectifs fixés pour 2022. Le département dispose à ce jour de 12 maisons France Services, l’objectif étant d’en déployer 31. C’est la cible fixée pour chaque département par la circulaire du 8 juin 2020.
La préfecture prévoit déjà de labelliser 8 structures d’ici à la fin de 2021, et une d’ici à la fin de 2022, ce qui fera un total de 21 maisons France Services à la fin de 2022. Dix projets devront donc encore émerger pour atteindre la cible assignée.
Le travail se poursuit, en lien avec la préfecture, pour développer des projets sur les territoires aujourd’hui sans solution. Une attention toute particulière sera portée aux territoires les plus en retard.
Monsieur le sénateur Courtial, je demeure à votre disposition pour de plus amples informations sur ce sujet majeur.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, auteure de la question n° 1564, adressée à Mme la ministre de la transition écologique.

La production et la distribution d’eau potable sont lourdes d’enjeux majeurs en matière de qualité de l’eau, de coût pour les usagers, de sécurité sanitaire et d’environnement. De tels enjeux relèvent de l’intérêt général et doivent être soustraits aux intérêts privés et à la logique de profit.
Un retour en régie publique de la distribution d’eau potable est de nature à permettre la mise en place d’une tarification sociale de l’eau et une réappropriation par les habitants de cette ressource essentielle.
Dans le Val-de-Marne, les maires d’Arcueil, de Cachan, de Chevilly-Larue, de Fresnes, de Gentilly, d’Ivry-sur-Seine, du Kremlin-Bicêtre, d’Orly et de Vitry-sur-Seine s’engagent depuis plusieurs mois pour évaluer les possibilités de gestion publique de la distribution d’eau potable sur leur territoire.
Pour ce faire, ils ont sollicité du Syndicat des eaux d’Île-de-France (Sedif), lui-même lié à Veolia par une délégation de service public, une reconduction pour une année supplémentaire de leur convention provisoire, afin d’engager une concertation avec leurs habitants. Après quelques difficultés, ils ont réussi à l’obtenir.
Dans la démarche qu’ils ont enclenchée pour la création d’une structure publique ad hoc, adossée aux compétences de leur établissement public territorial, le Sedif fait peser une pression inacceptable sur ces communes en refusant de travailler à une déconnexion virtuelle des réseaux, préférant imposer une solution lourde de travaux qui fera peser des coûts supplémentaires exorbitants et inutiles sur les usagers.
Or, dans un rapport remis en 2016, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) a affirmé sa volonté que les collectivités locales privilégient un retour en régie publique de l’eau. En outre, il affirme que le service public de l’eau doit pouvoir s’appuyer sur les infrastructures existantes, sans que des travaux lourds, tant économiquement que techniquement, aient à être envisagés pour éviter les surcoûts résultant d’investissements inutiles.
Ces travaux de mise en œuvre d’une déconnexion physique des réseaux pèseraient lourdement sur la vie quotidienne des habitants, pendant de nombreuses années, et les coûts engendrés se chiffreraient en millions d’euros.
De plus, les infrastructures existantes ont été financées par les collectivités ou par les usagers eux-mêmes, selon le principe « l’eau paie l’eau ».
Madame la secrétaire d’État, quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet de la rétrocession des biens aux collectivités territoriales dans le cas d’une sortie des collectivités du syndicat de distribution et de la création d’une entité indépendante ? Quelle est la position du ministère sur la technique de déconnexion virtuelle, qui permettrait de recourir à la régie publique en épargnant des coûts exorbitants aux habitants ?
Madame la sénatrice, vous interrogez le Gouvernement sur l’opportunité du retour en régie des neuf communes du Val-de-Marne qui ne souhaitent plus adhérer au Syndicat des eaux d’Île-de-France.
Je vais vous apporter quelques éléments juridiques et ferai quelques commentaires, sans toutefois vouloir m’immiscer dans des décisions dont l’opportunité relève directement de l’appréciation des communes et de leurs groupements.
Le principe de subsidiarité régit le choix du mode de gestion du service public de distribution d’eau potable, et aucun obstacle juridique ne s’oppose à la création d’une régie si elle est décidée par délibération de l’autorité compétente.
Il faut veiller, comme l’indiquait le CGEDD dans son rapport Eau potable et assainissement : à quel prix ? publié en 2016, à ce que « la recomposition des nouvelles autorités organisatrices évite des coûts inutiles de restructuration de réseaux ou de comptages entre nouvelles autorités ».
Cette recomposition, madame la sénatrice, doit donc favoriser les interconnexions et les mutualisations d’ouvrages. Ainsi, les collectivités exerçant cette mission de service public doivent-elles être garantes d’un usage rationnel de la redevance perçue auprès de l’usager de l’eau pour financer ce service.
S’agissant de la rétrocession des biens, le code général des collectivités territoriales en organise les modalités. Ainsi, son article L. 5211-25-1 dispose bien que « les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence […] et le syndicat de communes ».
Quant aux biens nécessaires au fonctionnement du service public, ce sont des biens de retour qui peuvent revenir gratuitement en fin de contrat à l’autorité délégante, avec une possibilité d’indemnisation du délégataire pour les biens non amortis, sur la base de leur valeur nette comptable.
Enfin, madame la sénatrice, le préfet de la région d’Île-de-France est bien informé de la situation que vous avez évoquée et il veillera à accompagner les collectivités locales, comme leurs syndicats, dans la démarche en cours et à faciliter aussi le bon déroulement de ces changements importants de gouvernance, dans le respect des principes et des dispositions rappelés précédemment, ainsi que, bien évidemment, dans le respect des intérêts des usagers de l’eau du territoire.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, auteure de la question n° 1581, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargée de l’autonomie.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, auteure de la question n° 1581, adressée à Mme la secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées.

Je souhaite attirer l’attention de M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles, sur le report de la réforme Grand Âge et autonomie.
Comme le rapport Libault l’avait démontré en 2019, les structures d’accompagnement des personnes âgées en situation de dépendance, celles qui pourvoient en aides à domicile, mais aussi les Ehpad, manquent tragiquement de moyens financiers et de personnel.
En effet, je suis inquiète, aujourd’hui, quant au fonctionnement des Ehpad ou des établissements accueillant des personnes handicapées. Un directeur pour diriger trois établissements, c’est peu ! Difficile de savoir ce qui s’y passe quand on n’y est pas ! Les directeurs deviennent hors sol et les chefs de service, des chefs d’établissement. Il n’y a plus de coordination hiérarchique.
Les familles me font part de ce problème régulièrement. Les professionnels de ce secteur travaillent dans des conditions critiques, alors que le nombre de seniors en perte d’autonomie va doubler d’ici à 2050.
Si je me félicite que le Gouvernement ait annoncé une loi Grand Âge et autonomie, le 13 janvier 2021, son porte-parole a précisé que cette réforme serait reportée à la fin de la crise sanitaire.
Alors que cette loi doit aussi permettre un meilleur financement de la cinquième branche de l’assurance maladie consacrée au risque de la perte d’autonomie, je vous demande de nous préciser ce que vous comptez faire pour garantir à nos aînés en situation de dépendance le droit à une fin de vie décente.
Madame la sénatrice Jocelyne Guidez, vous l’avez évoqué dans votre question, notre pays va faire face à un choc démographique important et le Gouvernement l’y prépare.
Vous mentionnez le rapport Libault, que nous avions commandé pour dresser un état des lieux précis à cet égard. Avec d’autres travaux de haut niveau du même ordre, il sert de base à l’action conduite, à titre principal, par la ministre Brigitte Bourguignon.
Depuis sa nomination, cette dernière s’attache à renforcer l’attractivité des métiers du secteur de l’autonomie et du grand âge. Parallèlement à la création de cette cinquième branche, que vous évoquiez, et au lancement du Ségur de la santé, sous l’impulsion d’Olivier Véran et après des décennies de manques, les premiers résultats sont là, unanimement salués, me semble-t-il.
Aux termes du Ségur de la santé, l’État finance une revalorisation historique des salaires des professionnels exerçant dans les Ehpad ainsi que dans les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad). Cela représente, vous le savez, madame la sénatrice, entre 160 et 183 euros net par mois pour ces professionnels, financés par l’assurance maladie.
L’avenant 43 permettra également aux aides à domicile de retrouver leur attractivité en les hissant au niveau de rémunération des autres branches.
Cette revalorisation salariale est historique à deux titres.
D’une part, par son montant. L’État débloquera 200 millions d’euros pour aider les départements à financer des augmentations qui peuvent aller jusqu’à 15 % des salaires des aides à domicile du secteur associatif, lequel représente près des deux tiers du secteur.
D’autre part, parce que dans la main tendue aux conseils départementaux pour les aider à assumer cette belle compétence du soutien à domicile de nos concitoyens, qui souhaitent unanimement pouvoir vieillir chez eux, les structures ne sont pas en reste. En effet, le plan d’investissement du Ségur de la santé mobilise 1, 5 milliard d’euros sur cinq ans pour les Ehpad de demain, des Ehpad plus ouverts, des Ehpad plus sûrs, des Ehpad plus adaptés.
Sur le plan financier, la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie a déjà permis de dégager des moyens importants, avec une montée en charge progressive. L’évolution des enjeux financiers fait évidemment l’objet d’un suivi particulièrement attentif.
Pour conclure, madame la sénatrice, vous savez que le Gouvernement saisit tous les moyens possibles pour susciter des vocations, attirer des jeunes vers ces emplois pérennes et non délocalisables par ailleurs. Ce n’est qu’une juste reconnaissance de leur engagement, grâce auquel il a été possible, pendant la crise sanitaire, d’éviter les situations d’isolement de nos aînés.
Nous continuerons dans cette voie, notamment via le chantier législatif en développement que vous évoquiez et que la ministre Brigitte Bourguignon vous présentera dès que les conditions le permettront.

Je vous remercie de votre réponse, qui, malgré tout, ne me satisfait pas entièrement, dans la mesure où vous n’avez pas réagi au fait qu’on compte aujourd’hui un directeur pour trois établissements, ce qui est très problématique.

La parole est à M. Patrick Boré, auteur de la question n° 1570, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur les dérogations prévues par le code de la santé publique en matière de qualification des personnes dirigeant une crèche.
Ledit code retient trois cas de figure en fonction de la capacité d’accueil de l’établissement : les établissements d’une capacité supérieure à 40 places ; les établissements d’une capacité de 21 à 40 places ; enfin, les établissements d’une capacité inférieure ou égale à 20 places.
Pour chaque situation, des qualifications précises ont été retenues, mais pour les cas particuliers des personnes titulaires du diplôme d’État de sage-femme ou d’infirmier, la dérogation est possible seulement pour les crèches d’une capacité inférieure ou égale à 20 places et pour celles d’une capacité supérieure à 40 places.
Dans le cas des structures d’une capacité de 21 à 40 places, cette dérogation au profit des sages-femmes ou des infirmiers diplômés d’État n’est pas explicitement mentionnée, ce qui laisse accroire que ces professionnels ne sont pas qualifiés pour les crèches qui accueillent entre 21 et 40 enfants.
C’est sur ce critère que certains services départementaux de protection maternelle et infantile émettent un avis défavorable à la création et au fonctionnement d’une crèche.
Monsieur le secrétaire d’État, face aux carences généralisées de places en crèche, dans les Bouches-du-Rhône notamment, et face à la difficulté pour les employeurs de trouver un directeur d’établissement, une interprétation large de cet article du code de la santé publique devrait être de mise. Qui peut le plus peut le moins !
Pourriez-vous, je vous prie, rappeler les recommandations du ministère sur ce sujet précis, ainsi que les politiques mises en œuvre en faveur de la petite enfance pour répondre à la problématique de l’accueil des enfants ?
Monsieur le sénateur Patrick Boré, je vous remercie de votre question sur une thématique qui, pour le coup, se situe au cœur de l’action qui est la mienne.
Cette problématique des carences de places en crèche est malheureusement bien connue, et ce n’est pas un phénomène nouveau. Depuis de nombreuses années, plusieurs plans successifs ont été établis pour relancer notamment la construction de nouvelles places, mais aussi pour valoriser et préserver l’existant, pour simplifier le travail des professionnels de la petite enfance et rendre les professions concernées plus attractives.
Le Gouvernement est à pied d’œuvre sur tous ces sujets. Vous n’êtes pas sans savoir, pour l’avoir débattue et votée, que la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite ASAP, habilitait, par son article 99, le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires de clarification, d’harmonisation et de simplification du droit applicable aux services aux familles, en particulier aux modes d’accueil du jeune enfant, qu’il s’agisse des établissements comme les crèches, des assistants maternels ou des gardes d’enfants à domicile.
Les textes qui régissent les modes d’accueil du jeune enfant étaient en effet complexes, sources d’incompréhension, de difficultés d’application tant pour les parents que pour les professionnels. Ils contribuaient à freiner la création de nouvelles solutions de garde.
La méthode de travail que nous avions retenue – Christelle Dubos occupait alors mes fonctions – a consisté à prendre le temps d’un dialogue ouvert, approfondi, avec l’ensemble des parties prenantes pour essayer de trouver un compromis le plus large possible.
Nous avons mené deux ans d’échanges préparatoires et huit mois de concertations, contrairement à ce que certains acteurs ont pu prétendre ces derniers temps, rassemblant institutions nationales, collectivités territoriales et, évidemment, représentants des professionnels. Désormais, une réforme ambitieuse est sur le point de se concrétiser, via un projet d’ordonnance, un projet de décret et des projets d’arrêtés qui ont tous été ou seront soumis à la relecture des participants à la concertation : le processus arrive à son terme.
Ces textes vont notamment simplifier les règles d’accès aux fonctions de direction en supprimant l’empilement des conditionnalités et des dérogations actuelles. L’expérience acquise et la qualification professionnelle seront, demain, mieux prises en compte et c’est bien normal.
Cette action nécessaire se double d’autres initiatives : je pense en particulier au soutien accru de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), décidé il y a peu en faveur des projets de création ou de pérennisation des places de crèche. Il s’agit du fameux plan Rebond petite enfance de 200 millions d’euros, que le conseil d’administration de la CNAF a voté tout récemment et qui est en cours de déploiement.
Enfin, sachez que, cet après-midi, je lancerai officiellement le plan de formation des 600 000 professionnels de la petite enfance prévu par la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Monsieur le sénateur, vous pouvez constater que le Gouvernement est au travail !

La parole est à Mme Brigitte Lherbier, auteur de la question n° 1619, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, les écoles viennent de rouvrir, mais la circulation du virus et de nombreux variants arrivant de toutes parts continue d’inquiéter beaucoup de Français.
Quant aux parents d’élèves, ils sont en partie soulagés de pouvoir retrouver une vie professionnelle, mais la situation épidémique de notre pays les amène à s’interroger.
En février dernier, alors que la circulation du covid-19 s’intensifiait, le choix avait été fait de tester presque systématiquement les enfants dès lors qu’ils étaient cas contacts ou qu’ils présentaient des symptômes.
Toutefois, la plupart du temps, il s’agissait d’un test nasal, traumatisant pour les petits, et beaucoup de parents s’y opposaient. Une évolution vers le test salivaire, plus simple et plus acceptable pour les élèves des écoles maternelles, est souhaitable. Les plus jeunes garderont cependant un traumatisme de cette crise sanitaire.
En tant que secrétaire d’État chargé de l’enfance et des familles, vous êtes le garant de toutes les protections physiques et morales des plus petits. Le ministère de l’éducation nationale a indiqué qu’il fermerait immédiatement toute classe où un cas de covid a été diagnostiqué, ou au plus tard le lendemain de sa détection.
Ma question porte sur les mesures mises en place dans les écoles pour lutter contre l’épidémie. Pourriez-vous nous faire un point précis sur l’organisation des tests dans les écoles de notre pays ? Tous les enfants seront-ils systématiquement testés, à quelle fréquence et surtout avec quel type de test ?
Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, je vous remercie de votre question, qui me permet d’exposer la logique globale de l’action que nous menons pour protéger les enfants face au coronavirus.
Vous le savez : dès le 1er février dernier, le protocole « tester, alerter, protéger » a été renforcé, notamment dans les écoles, pour prévenir toute circulation du virus. En outre, comme vous l’avez rappelé, pour le retour des élèves en classe à compter du 26 avril, le protocole sanitaire a continué à s’appliquer avec une vigilance particulière pour l’aération des pièces et la limitation des brassages. Le plan de contact tracing a été maintenu et même renforcé. Désormais, un cas positif entraîne la fermeture de la classe.
Pour mettre en œuvre ce protocole, des milliers de médecins et d’infirmières scolaires ont été mobilisés : je tiens à saluer leur travail et leur investissement. Une politique ambitieuse de tests en milieu scolaire a également été déployée depuis la rentrée pour renforcer notre stratégie, qui vise à casser le plus rapidement possible les chaînes de contamination.
Une campagne de déploiement d’autotests vient ainsi compléter les tests déjà proposés aux enfants, en particulier aux élèves du premier degré et du collège. Les tests salivaires se déploient de plus en plus largement depuis la fin des vacances de février. Vous vous en souvenez : le ministre de l’éducation nationale avait fixé l’objectif d’en effectuer, à terme, 600 000 par semaine.
À compter du 10 mai prochain, les lycéens pourront réaliser, avec accord parental, un autotest par semaine dans leur établissement, sous la supervision des personnels de santé de l’éducation nationale volontaires et avec l’appui de médiateurs supplémentaires, dits « lutte anti-covid », qui s’ajouteront aux 1 700 médiateurs déjà recrutés.
Les professeurs volontaires pourront également prendre part à cet encadrement. La semaine de rentrée, qui est en train de se clore, a d’ailleurs été consacrée à cette organisation : le ministère de l’éducation nationale a notamment diffusé des documents d’information et des tutoriels à l’intention des élèves.
En effet, nous faisons nôtre cette préoccupation : ne pas imposer aux enfants des tests trop systématiques et, surtout, leur éviter des gestes qui peuvent être douloureux – certains d’entre nous en ont fait l’expérience. C’est bien pourquoi d’autres dispositifs que les tests PCR se sont développés pour les plus jeunes ; et c’est dans ce sens que, le 26 avril dernier, la Haute Autorité de santé (HAS) s’est prononcée en faveur d’une levée de la limite d’âge pour l’utilisation des tests antigéniques sur prélèvement nasal. Le Gouvernement a suivi cette recommandation en prenant, comme toujours, le soin d’en expliquer les tenants et les aboutissants.
Telle est la logique que nous continuerons de suivre tout au long de cette crise sanitaire !

Monsieur le secrétaire d’État, merci de votre réponse rassurante. Je tiens à vous rappeler que vous êtes le garant de la protection de l’enfance. Je pense à toutes les démarches sanitaires qui concernent les petits, mais aussi aux cas de maltraitance familiale, qui se multiplient en cette période de crise sanitaire. Il ne faudrait pas que les départements fassent des économies sur le dos des jeunes enfants. Je suis particulièrement attentive à l’action que vous déployez en ce sens et je compte sur vous !

La parole est à Mme Cécile Cukierman, auteure de la question n° 1621, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, depuis de nombreuses années, je suis, comme beaucoup d’autres, interpellée dans mon département par des maires désabusés de voir les services publics se retirer un à un de leur commune ; par des maires inquiets de devoir faire toujours mieux avec moins de moyens ; par des maires accablés de voir, année après année, des médecins partir à la retraite sans être jamais remplacés.
Les déserts médicaux se font de plus en plus nombreux et, au cours de mes visites communales, les élus me font part de leur désarroi quant au manque de médecins dans leur commune.
Aujourd’hui, le constat est clair : 41 % des communes de mon département, soit 134 d’entre elles, sont dans un désert médical.
Aujourd’hui, de nombreux Ligériens n’ont plus de médecin référent, les médecins en place n’acceptant plus de patients supplémentaires.
Aujourd’hui, je vous interpelle plus particulièrement au nom de Martial Fauchet, maire de Saint-Martin-la-Plaine, et de tant d’autres, rencontrés notamment après les élections municipales. Qu’ils soient nouvellement élus ou qu’ils aient été reconduits dans leurs fonctions, ces maires sont de plus en plus inquiets du remplacement des médecins qui font valoir bien légitimement leurs droits à la retraite, mais qui ne trouvent aucun successeur.
Dans la commune de Saint-Martin-la-Plaine, ce non-remplacement risque de déséquilibrer profondément l’accès aux soins. C’est même toute cette partie de la vallée du Gier qui est concernée : dans la ville voisine de Rive-de-Gier, six départs de médecins sont attendus dans les prochains mois et les prochaines années.
Pourtant, depuis 2018, la commune bénéficie d’un classement en zone de vigilance, reconnaissant un risque de désert médical à moyen terme. Nous y sommes déjà !
Cette commune, comme tant d’autres, est prête à s’investir y compris financièrement. Elle a fait appel à l’agence régionale de santé (ARS) afin d’être aidée dans cette démarche, mais sa demande reste sans réponse à ce jour.
Monsieur le secrétaire d’État, face à ce défi, nous devons faire preuve de détermination et travailler avec l’ensemble des acteurs locaux.
Ma question est simple : quelles solutions le Gouvernement entend-il apporter afin que l’État garantisse à chaque Français un accès aux soins digne de ce nom ?
Madame la sénatrice Cécile Cukierman, le ministère des solidarités et de la santé est bien entendu particulièrement attentif aux enjeux de maillage territorial dans leur ensemble et, avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, nous suivons avec attention la situation du département de la Loire.
Le zonage arrêté en 2018 confirme malheureusement les chiffres, qui traduisent une faible densité médicale. C’est pourquoi, en lien avec l’assurance maladie, l’ARS travaille à la structuration des soins de premiers recours : la jeune génération de professionnels de santé veut avant tout un exercice coordonné, ce qui suppose notamment de travailler en pluriprofessionnalité. En ce sens, elles se distinguent des anciennes générations.
C’est la raison pour laquelle, depuis plusieurs années, l’ARS accompagne différents projets de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et de centres de santé. Elle est soucieuse de proposer aux jeunes générations de soignants une offre diversifiée et plus attractive qu’un exercice en cabinet individuel.
Il en résulte que le département de la Loire compte aujourd’hui près de quarante MSP et centres de santé. Malgré le contexte, deux nouvelles MSP et deux communautés professionnelles territoriales de santé, dont l’ARS accompagne le déploiement, y ont vu le jour en 2020. D’autres structures sont en projet, pour apporter aux habitants l’offre médicale et paramédicale la plus complète possible. À cet égard, on veille à garantir des passerelles entre la médecine de ville et l’hôpital.
De plus, depuis plusieurs années, l’ARS a su travailler au développement de la maîtrise de stages, pour faire découvrir le département aux futurs médecins généralistes et leur permettre de nouer les contacts à même de faciliter, plus tard, leur installation.
Nous en sommes convaincus : la connaissance du territoire et la pratique professionnelle diversifiée que peut offrir un département semi-rural comme la Loire restent des leviers d’action pour de nouvelles installations.
L’ARS accompagne aussi financièrement les primo-installations des médecins généralistes dans les zones sous-dotées, en signant des contrats de praticien territorial en médecine générale ou de praticien territorial en médecine ambulatoire. Comme vous le savez peut-être, ces contrats assurent un certain chiffre d’affaires aux praticiens, le temps de la montée en charge de leur patientèle. Dans le département de la Loire, plusieurs dizaines d’entre eux ont déjà été signés et plusieurs dizaines d’autres le seront bientôt.
Enfin, le développement de la télémédecine est à même de renforcer l’offre de soins dans les territoires fragiles. L’ARS a ainsi fortement déployé la télémédecine dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Elle a piloté des appels à projets régionaux à cette fin et le taux d’appropriation par les généralistes est très bon.
Voilà l’ensemble des efforts que nous faisons ; je transmettrai à l’ARS la demande du maire de Saint-Martin-la-Plaine et nous y donnerons suite !

Monsieur le secrétaire d’État, on peut faire toutes les maisons de santé que l’on veut : sans le personnel nécessaire pour accueillir et soigner la population, les bâtiments resteront vides et se dégraderont peu à peu.
La question est urgente. Je vous le répète : aujourd’hui, dans mon département comme dans beaucoup d’autres, des milliers de personnes n’ont plus de médecin référent. C’est l’accès aux soins qui est mis en cause !

La parole est à M. Bernard Bonne, auteur de la question n° 1622, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.
Sourires.

Monsieur le secrétaire d’État, vous prévoyez une baisse tarifaire des prestations effectuées par les prestataires de santé à domicile, alors même qu’un rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), publié en juillet dernier, soulignait leur rôle croissant.
Je rappelle que ces professionnels accompagnent quotidiennement, sur l’ensemble du territoire, plus de 2 millions de patients atteints de pathologies chroniques et aiguës, mais aussi des malades sous perfusion.
Ce faisant, les PSAD favorisent l’observance et la prévention et participent au maintien de l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap à leur domicile. Ils sont donc, à plus d’un titre, des acteurs essentiels du virage ambulatoire. Grâce à cette augmentation de la prise en charge à domicile, le système de santé évite des hospitalisations, lesquelles seraient plus coûteuses, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité des soins auxquels nos concitoyens aspirent.
Pourtant, le Gouvernement refuse toute augmentation de la dépense induite mécaniquement, en contradiction avec les objectifs de prévention et de suivi. Ainsi, il semble vouloir étendre la politique de gestion comptable appliquée à l’hôpital – on en connaît les résultats … – au secteur de la santé à domicile. Aux mêmes causes, les mêmes effets !
Les acteurs des services de santé à domicile demandent, en conséquence, un moratoire sur les baisses de prix actuellement envisagées. Quelle est la position du Gouvernement ?
Monsieur le sénateur Bernard Bonne, vous m’interrogez au sujet des projets de baisses tarifaires dont font l’objet les prestataires de services et distributeurs de matériel (PSDM). Ces projets sont en train d’être négociés par le comité économique des produits de santé (CEPS).
Vous êtes bien placé pour le savoir : le montant des économies à réaliser, notamment, sur le secteur des produits de santé est débattu et fixé annuellement dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Chaque année, le comité fixe des montants d’économies par secteur en fonction de ce que les parlementaires ont acté. Ces montants dépendent notamment du niveau de croissance observé au cours des années précédentes dans l’ensemble des secteurs des produits de santé. Il paraîtrait en effet incohérent de faire reposer l’effort sur des secteurs en décroissance ou stables, qui plus est en cette période de crise sanitaire, qui a pour conséquence d’amplifier certaines baisses de chiffre d’affaires.
Il est important de le rappeler : le secteur des produits et prestations connaît habituellement une évolution assez dynamique – sa croissance annuelle est de 4 % à 5 % et la dépense remboursée était de quelque 9 milliards d’euros pour l’année 2020. En outre, la dépense afférente aux PSDM contribue pour plus de la moitié du total et constitue le principal poste de croissance. C’est donc à juste titre que ces secteurs sont inclus dans le plan d’économies.
Vous évoquez le rapport que l’IGAS a consacré à la question en 2019. J’en retiens tout d’abord qu’il justifie que les économies portent sur certains secteurs où l’on peut encore attendre d’importantes économies d’échelles. J’en retiens aussi, comme vous, qu’il souligne le rôle croissant des prestataires.
Cela étant, ce rapport pointe également une forte hétérogénéité de la qualité des pratiques. C’est ce qui a conduit le Gouvernement à proposer, au titre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, la mise en place d’une certification de la qualité des pratiques professionnelles. J’ajoute que la Haute Assemblée a voté cette mesure.
Nous avons un devoir commun envers nos concitoyens : assurer une équitable répartition des finances publiques. Cet effort passe notamment par la démonstration rigoureuse de la plus-value de tel ou tel secteur ou activité.
Je peux l’affirmer : à cet égard, le dialogue est constant avec les représentants des PSAD. Un moratoire sur les baisses de prix est une revendication annuelle de ces prestataires. Le plan d’économies a d’ores et déjà été revu en 2019 et suspendu en 2020 en raison de la crise sanitaire. Nous ne menons pas une gestion comptable, mais un encadrement qui me semble responsable, au plein bénéfice des patients, des professionnels et de la collectivité, qui finance leur activité !

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Les prestataires insistent sur ce point : avec la crise du covid, le maintien à domicile d’un certain nombre de personnes, dont les pathologies exigent tout un appareillage, est plus important que jamais.
Nous débattions tout à l’heure des moyens de remédier à la perte d’autonomie, en évoquant le projet de loi Grand Âge. À mon sens, c’est un des éléments qui permettront de maintenir les personnes à domicile le plus longtemps possible. Il faut absolument avoir pour objectif d’éviter, autant que faire se peut, l’entrée en Ehpad.
En conséquence, il faut garantir une concertation permanente avec les prestataires de santé à domicile. Il faut effectivement garantir l’homogénéité de leurs interventions dans tous les départements. Surtout, il faut assurer le maintien à domicile le plus longtemps possible !

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteure de la question n° 1634, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Monsieur le secrétaire d’État, j’attire votre attention sur les difficultés d’accès aux traitements innovants pour les patientes souffrant de cancers du sein résistant aux chimiothérapies classiques.
Le « triple négatif » est l’une des formes les plus agressives de cancer du sein. Il touche chaque année plus de 10 000 femmes, souvent jeunes et sans antécédents. Lorsque les premières métastases sont décelées, leur espérance de vie ne dépasse pas quinze mois.
Jusqu’à présent, aucune chimiothérapie classique ne permet un traitement efficace : la plupart de ces patientes terminent leur parcours en soins palliatifs faute d’autre solution thérapeutique. Aujourd’hui, des cliniques privées allemandes leur redonnent espoir, mais le traitement qu’elles proposent coûte plus de 100 000 euros et il n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Il repose sur un vaccin conçu individuellement, à partir des cellules des malades, couplé à une thérapie ciblée. À ma connaissance, cette option n’a pas été agréée en France, mais elle soulève le problème de l’inégalité d’accès à des traitements novateurs.
Un autre médicament existe. Ses effets sur le cancer triple négatif métastatique sont confirmés et il vient d’arriver en France. Il s’agit du Trodelvy, issu d’un laboratoire américain et délivré dans le cadre d’une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) nominative, donc au cas par cas, à la demande du médecin prescripteur.
Malheureusement, ce médicament connaît des difficultés d’approvisionnement, qui limitent aujourd’hui sa prescription. Or, pour de nombreuses patientes, il représente une dernière chance.
Qu’envisagez-vous pour rendre accessibles ces nouvelles thérapies du cancer du sein en France et élargir l’ATU à l’ensemble des patientes pour qui le temps est compté ?
Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, avant tout, soyez convaincue que l’ensemble du Gouvernement, à commencer par le ministre des solidarités et de la santé, éprouve la préoccupation que vous exprimez. Moi-même, j’ai été récemment saisi de ce dossier et je souhaite, comme vous, assurer les meilleurs traitements pour le cancer du sein dit « triple négatif ».
Vous l’avez rappelé : ces cancers touchent environ 10 000 personnes par an et sont difficiles à traiter par chimiothérapie ou par hormonothérapie. Ils nécessitent donc des réponses innovantes.
Vous formulez deux propositions : élargir l’accès à l’ATU pour le Trodelvy et permettre l’accès à des immunothérapies ciblées de façon précoce.
Le dispositif d’ATU est en cours de réforme, en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021. Actuellement soumis à la concertation, les textes devraient être publiés d’ici à l’été.
J’en viens plus spécifiquement au Trodelvy, traitement de la biotech Immunomedics. Je rappelle qu’il est disponible depuis novembre dernier, via une ATU nominative : comme vous l’indiquez, le médecin doit valider et proposer le traitement pour un patient identifié.
À la fin de l’année 2020, à la suite du rachat d’Immunomedics par Gilead, la production de cette spécialité est devenue temporairement insuffisante pour couvrir les besoins globaux : vous l’avez également évoqué. Le laboratoire Gilead a donc informé l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) qu’il ne pouvait plus fournir d’ATU nominative en France et qu’il réservait sa production aux patientes résidant aux États-Unis, jusqu’à ce que ses capacités de production soient suffisantes pour permettre de nouveau un accès en France.
L’ANSM a dû prendre la décision de réserver les unités disponibles aux patientes qui en bénéficient déjà, afin de ne pas provoquer de rupture de traitement.
Le laboratoire Gilead a déposé une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) en procédure accélérée auprès de l’Agence européenne du médicament le 4 mars dernier. Le dossier est en cours d’évaluation. En réponse à un courrier signé par Olivier Véran, le laboratoire a assuré mettre tout en œuvre pour augmenter la capacité de production du Trodelvy en vue d’une mise à disposition précoce du produit dans notre pays. C’est indispensable pour éviter aux patientes une perte de chance.
Pour conclure, je vous répondrai brièvement au sujet de l’accès à des immunothérapies ciblées dans des cliniques allemandes. Un certain nombre de praticiens ont souligné les difficultés éthiques que soulèvent de telles pratiques, aux coûts particulièrement élevés. La France est attachée au principe d’évaluation de l’efficacité et de la sécurité des traitements. L’objectif de la réforme des ATU est bien d’inciter les laboratoires à permettre l’accès aux traitements innovants efficaces le plus rapidement possible, sans faire courir de risques trop élevés aux patients.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse. Vous l’avez compris : il est urgent d’agir. Aujourd’hui, un certain nombre de patientes sont dans une situation désespérée. Je vous remercie par avance de bien vouloir hâter la marche de l’administration !

La parole est à Mme Brigitte Micouleau, auteure de la question n° 1647, adressée à M. le ministre des solidarités et de la santé.

Depuis mars 2020, la crise sanitaire a dramatiquement aggravé la précarité alimentaire de nombre de nos concitoyens.
Ainsi, le nombre de bénéficiaires de la banque alimentaire de Toulouse et de sa région a augmenté de 60 % : il s’agit là d’une hausse durable et inédite. Avec ses 100 associations partenaires, l’équivalent de 6 600 000 repas a été distribué en 2020.
Le Président de la République souhaite appliquer la proposition de la Convention citoyenne pour le climat portant sur les chèques alimentaires destinés aux plus fragiles. Or les modalités de ce projet interpellent les acteurs associatifs de l’aide alimentaire. Ces derniers sont même très inquiets.
L’expérience des associations a démontré l’importance fondamentale d’un accompagnement de l’aide alimentaire. Ainsi, la mission des banques alimentaires implique non seulement une aide alimentaire d’urgence, mais aussi un accès à une alimentation équilibrée et de qualité.
De nombreux autres appuis, souvent psychologiques, sont accordés par les associations de proximité, qui connaissent bien leurs bénéficiaires et les accompagnent dans leurs différentes problématiques.
Il s’agit de s’assurer que des populations fragilisées emploient ces chèques pour une alimentation saine. De surcroît, une aide strictement monétaire risquerait d’éloigner les bénéficiaires de toutes les formes d’aides complémentaires indispensables.
Forte de son expertise, la banque alimentaire est à même de recueillir les besoins des associations, de procéder à des commandes et à des achats adaptés, de gérer les flux et de distribuer des produits locaux de qualité, soutenant ainsi l’économie régionale et locale.
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous nous confirmer que les banques alimentaires, notamment celle de Toulouse et de sa région, ainsi que les autres associations qui œuvrent sans relâche depuis le début de la crise sanitaire, seront inscrites au cœur du dispositif d’aide des chèques alimentaires ?
Madame la sénatrice Brigitte Micouleau, vous avez raison de le rappeler : la crise sanitaire et sociale que nous traversons a malheureusement fragilisé un certain nombre de foyers, au point de les exposer à la précarité alimentaire.
En outre, vous indiquez à juste titre que, face à cette situation difficile, de nombreuses voix se sont légitimement élevées pour que se concrétise l’une des recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, reprise par le Président de la République : la mise en œuvre des chèques alimentaires.
À ce titre, différentes options restent envisagées. Elles font l’objet d’une instruction approfondie de la part des services de l’État, car il convient de surmonter un certain nombre de contraintes financières, juridiques et opérationnelles.
Quoi qu’il advienne, quelle que soit l’option retenue, les associations dont vous portez la voix dans cet hémicycle, notamment la banque alimentaire de Toulouse, ont raison de le souligner : la notion d’accompagnement est centrale. Elle sera évidemment au cœur du dispositif déployé.
Par ailleurs, en 2018, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite loi Égalim, a apporté cette clarification : la lutte contre la précarité alimentaire vise non seulement à favoriser l’accès à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, mais elle participe également à la reconnaissance et au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes, dans leur environnement.
Vous avez donc raison : le déploiement d’un dispositif comme le chèque alimentaire doit répondre à ces enjeux, ce qui passe, très concrètement, par la possibilité d’effectuer des achats dans les commerces de proximité. Cet acte peut être perçu comme moins stigmatisant pour les personnes en situation de précarité que le fait de se rendre dans des lieux de distribution alimentaire spécifiques.
Je précise que le Gouvernement n’a pas misé sur ce seul dispositif pour répondre aux enjeux que soulève la crise sanitaire depuis maintenant plus d’un an. Nous avons mobilisé des moyens inédits pour faire face à l’urgence, soutenir les personnes ayant recours à l’aide alimentaire ainsi que les associations qui les accompagnent. Au total, près de 144 millions d’euros ont été consacrés au soutien de l’aide alimentaire, sans compter les 100 millions d’euros du plan France Relance pour le soutien aux associations de lutte contre la pauvreté.
En parallèle, nous avons renforcé notre rôle de coordination des différents acteurs et dispositifs, dès le mois de mars 2020. Les montants des fonds européens consacrés à l’aide alimentaire ont été récemment sanctuarisés, puis renforcés.
Madame la sénatrice, vous pouvez donc constater toute notre détermination. J’indique enfin que, grâce à l’opération Urgence premiers pas, que nous avons mise en place, les parents en difficulté ou en situation de précarité reçoivent des kits à destination des nourrissons, …
… comprenant des couches, des boîtes de lait maternisé et des petits pots !

La parole est à Mme Anne Ventalon, auteure de la question n° 1574, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports.

Classée grande liaison d’aménagement du territoire en 2003, la route nationale 102 traverse le département de l’Ardèche d’ouest en est. Elle en est au demeurant le seul axe structurant : de nombreux Ardéchois en dépendent pour tous leurs déplacements, notamment professionnels.
Or cette voie n’a pas le gabarit que son rôle devrait lui conférer. Pis, la RN 102 se distingue par de nombreux points très accidentogènes, connus et recensés par vos propres services.
Ce sont, par exemple, le carrefour de La Fayette à Coucouron ; la côte de Ville et le carrefour de Bernardy à Aubenas ; le virage de La Teyre à Thueyts, où un poids lourd et un véhicule léger ne peuvent se croiser – il s’agit pourtant, je le rappelle, d’une route nationale. Ce sont aussi des entrées et des traversées de villages – je pense à Lalevade, à Pont-de-Labeaume et à bien d’autres localités.
Malgré cela, vous avez répondu au député Fabrice Brun, très impliqué sur le sujet, que vous n’envisagiez pas l’installation de créneaux de dépassement, pourtant indispensables.
Je rappelle que, grâce à un amendement adopté sur l’initiative de mon collègue Mathieu Darnaud et de mon prédécesseur Jacques Genest, la loi d’orientation des mobilités dispose qu’« un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à deux fois deux voies ».
La RN 102 répond en tout point à ces critères. À présent, il faut donc appliquer la loi. Il faut que l’État s’implique financièrement et considère réellement cette route comme une priorité. Le plan de relance est une occasion historique : pourquoi ne pas la saisir ?
Le contrat de plan État-région (CPER) 2021-2026 sera prochainement négocié et la région Auvergne-Rhône-Alpes s’est dite prête à y prendre toute sa part ; l’État jouera-t-il son rôle ?
Madame la sénatrice Anne Ventalon, vous interrogez le ministre délégué chargé des transports à propos de la modernisation de la route nationale 102 qui traverse notamment votre département de l’Ardèche. Mon collègue ne peut être présent : il vous prie de l’excuser et m’a chargé de vous répondre en son nom et de vous assurer que la sécurisation et la modernisation de la RN 102 en Ardèche mobilisent activement l’administration de l’État et de son ministère ainsi que son budget.
Plusieurs aménagements situés entre Aubenas et le département de la Haute-Loire, ainsi que le contournement nord du Teil, sont étudiés ou en cours de réalisation.
S’agissant des quatorze aménagements que vous citez, certains d’entre eux sont déjà réalisés ou sont étudiés par les services de l’État ; c’est le cas du carrefour de La Fayette, dont les travaux sont programmés cet été, et de celui de Bernardy, à l’entrée d’Aubenas, dont les études se poursuivent en 2021 avec la commune.
Les travaux d’aménagement de ce carrefour ont vocation à être financés par le budget d’entretien du réseau routier national, avec l’appui des collectivités intéressées ; c’est également le cas de la rectification du virage de La Teyre, qui permettra le croisement des poids lourds et dont l’étude a été actualisée en fin d’année 2020 en vue de son inscription éventuelle dans la prochaine contractualisation sur les infrastructures à compter de 2023.
En plus de ces aménagements, une démarche relative à la sécurité des usagers sur les routes existantes, approuvée en septembre 2019, a identifié le traitement d’autres points accidentogènes, comme la sécurisation de la côte de Ville entre Aubenas et Lavilledieu, dont les études se poursuivront en 2021 ; différents aménagements ou équipements de sécurité sont également financés par l’État en 2021 pour assurer la sécurité des piétons, le traitement d’obstacles latéraux, le balisage de virages, la sécurisation d’accotements et la mise en conformité de la signalisation horizontale sur l’itinéraire.
Compte tenu de ces différents projets en cours pour l’aménagement de la RN 102 en Ardèche, une étude visant à identifier de nouveaux créneaux de dépassement pourrait être envisagée dans le cadre de la prochaine contractualisation entre l’État et les collectivités portant sur les infrastructures.

Monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas la première fois que la question de la modernisation de la route nationale 102 résonne dans cet hémicycle. Avec la généralisation discutable des quatre-vingts kilomètres par heure, le Gouvernement entendait faire baisser l’insécurité routière. Soit. Qu’il donne, dès lors, aux collectivités les moyens pour agir là où celles-ci déplorent des accidents et des drames humains !

La parole est à M. Daniel Salmon, auteur de la question n° 1618, transmise à M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur le projet de contournement routier de Vitré, en Ille-et-Vilaine, qui suscite de nombreuses inquiétudes.
Ce projet, d’une emprise foncière de quarante hectares, dont douze hectares de zones humides, entre en contradiction avec l’objectif « zéro artificialisation nette », une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, mais aussi avec les instructions gouvernementales aux services déconcentrés de l’État appelant à une vigilance accrue sur la consommation foncière.
S’agissant de la protection de la ressource en eau, ce projet risque d’impacter des captages d’eau potable, pourtant inscrits comme prioritaires dans le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage). Je rappelle que ces captages sont essentiels pour l’alimentation en eau potable de la population ainsi que pour l’économie locale, dont les besoins vont croître de 25 % dans les quatre années à venir.
J’ajoute que l’efficacité de ce contournement est contestable au regard des objectifs affichés : les modélisations du trafic routier sont largement surestimées, et la croissance démographique est estimée à 1, 25 % par an alors que ce chiffre n’est qu’un objectif fixé par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et non une réalité statistique, comme le laissent pourtant penser les études.
Une chose, en revanche, est certaine : ce projet va entraîner une hausse de 15 % des émissions de gaz à effet de serre, qui entre en contradiction totale avec l’objectif de réduction de 25 % de ces émissions d’ici à 2030, pourtant fixé par le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de Vitré Communauté.
Monsieur le secrétaire d’État, un projet alternatif moins impactant et moins coûteux existe ; il a pourtant été balayé. Je souhaite donc savoir comment ce type de projet peut encore être justifié au regard de ses nombreux aspects négatifs et alors que le Gouvernement se donne pour objectif de faire face à la crise climatique.
Monsieur le sénateur Daniel Salmon, je vous prie d’accepter les excuses du ministre délégué chargé des transports et d’accueillir ma réponse en son nom. Le projet que vous évoquez a fait l’objet de plusieurs concertations entre 2018 et 2020.
S’agissant d’un projet relevant de la maîtrise d’ouvrage d’une collectivité territoriale, en vertu du principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales, il n’appartient pas à l’État de se prononcer, au stade des études d’opportunité, sur la réalisation du contournement. Il est bien évidemment indispensable que le projet satisfasse aux exigences réglementaires pour chacune de ses phases d’études, en particulier en ce qui concerne la participation du public.
À cet égard, les concertations organisées par le département d’Ille-et-Vilaine doivent respecter les dispositions du code de l’environnement et du code de l’urbanisme en matière d’information et de participation des citoyens. L’ensemble des solutions de rechange possibles sont bien évidemment à prendre en compte dans ce cadre.
S’agissant des impacts environnementaux du projet, si celui-ci était confirmé aux dépens des alternatives, l’État veillera à leur prise en compte exhaustive et au respect des procédures afin qu’aucune autorisation ne soit délivrée sans que l’ensemble des mesures et solutions suffisantes ait été prévu pour éviter, pour réduire ou pour compenser les impacts environnementaux, paysagers et sur le milieu humain. À ce titre, l’enjeu lié aux espèces protégées fera l’objet d’une attention particulière de la part des services de l’État.
Enfin, l’utilité publique est fondée sur l’analyse des avantages et des inconvénients d’un projet au titre de la théorie du bilan ; la lutte contre le changement climatique ne conduit donc pas, à elle seule, à interdire la poursuite de tout projet routier sans considération pour les besoins et les enjeux d’aménagement locaux auxquels celui-ci est censé répondre.
Il appartient donc au débat local d’apporter tout l’éclairage nécessaire sur ce projet, une éventuelle déclaration d’utilité publique ne pouvant intervenir qu’à l’issue d’une enquête publique. L’État fera preuve, quant à lui, de la plus grande vigilance lorsqu’il sera appelé à se prononcer sur les autorisations que pourraient solliciter les porteurs du projet que vous évoquez.

Merci de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État, j’entends bien que l’État sera vigilant et je compte sur lui pour faire appliquer la réglementation.
Nous ne sommes plus aujourd’hui dans les années 1970, quand il fallait adapter la ville à la voiture, nous sommes dans un moment crucial où il faut vraiment veiller à respecter nos engagements en matière de biodiversité et de préservation du climat.
Le tout routier a fait son temps, il faut aujourd’hui travailler à des alternatives : celles-ci existent. Il ne s’agit pas de tout figer dans le marbre et de ne plus rien faire, mais de trouver les projets les moins impactants, qui permettent la poursuite de ces mobilités dont nous avons besoin au quotidien grâce à des solutions alternatives et qui ne contredisent pas tous les engagements de la France.

La parole est à Mme Gisèle Jourda, auteure de la question n° 1578, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

En février dernier, plusieurs maires de l’Aude apprenaient de manière intempestive la fermeture de treize classes majoritairement situées en milieu rural.
Élus, parents, enseignants, nous considérons que ces annonces sont particulièrement inappropriées au regard, d’abord, des annonces récentes du ministre en faveur du renforcement des moyens pour l’enseignement primaire. Supprimer des classes reviendrait à prendre des mesures allant à l’encontre de ces objectifs.
Ensuite, dans le contexte sanitaire actuel, il est surprenant d’envisager une fermeture de classe avant de connaître l’évolution de la pandémie et ses conséquences à court, moyen et long terme.
De plus, les communes ont réalisé des investissements financiers pour assurer l’entretien, la modernisation des établissements scolaires et l’amélioration des conditions de travail pour les enfants et les enseignants.
Enfin, de nombreux enfants, notamment des enfants en situation de handicap assistés par les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) rencontrent des difficultés, comme c’est le cas à l’école élémentaire Jean Jaurès de Carcassonne, où sept élèves ne bénéficient de l’accompagnement d’un AESH que deux heures par jour. C’est pitoyable et insuffisant !
La mobilisation audoise a permis, par la pression, d’obtenir quelques maintiens, mais trop peu. La problématique doit être considérée dans sa globalité ; je demande que soit décidé un moratoire sur ces fermetures de classe et que celles-ci soient conditionnées à l’accord des maires des communes concernées, comme c’est le cas pour les fermetures d’écoles.
À Salsigne, à Villasavary, le maintien de la classe dépend de l’arrivée de nouveaux enfants grâce aux programmes immobiliers en cours et est donc soumis aux aléas des chantiers. Ce n’est pas admissible !
Alors, monsieur le secrétaire d’État, quelle est la position du Gouvernement ? Maintiendrez-vous ces classes ouvertes ? Accepterez-vous d’observer un tel moratoire ?
Madame la sénatrice Jourda, veuillez excuser l’absence de Jean-Michel Blanquer, qui s’est rendu dans l’Allier pour une cérémonie d’hommage à Samuel Paty.
L’école primaire est, vous le savez, une des priorités du Gouvernement. Entre les rentrées 2017 et 2020, nous avons créé 11 900 postes dans un contexte de forte baisse démographique dans le premier degré ; nous avons aussi dédoublé les classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire et nous avons amorcé cette année le dédoublement des classes de grande section de maternelle.
Notre réforme est en cours pour plafonner les effectifs des classes de grande section, de CP et de CE1 à 24 élèves sur l’ensemble du territoire ; elle permet de consolider les apprentissages des savoirs fondamentaux que sont lire, écrire et compter.
À titre d’exemple, à la rentrée 2020, le nombre d’élèves par classe dans l’Aude atteint 21, 5, contre 22, 1 à la rentrée précédente. Dans ce département, comme dans tous les autres, le nombre de professeurs pour 100 élèves connaît aussi une amélioration significative, passant de 5, 58 à la rentrée 2017 à 5, 92 à la rentrée 2020, au-delà de la moyenne nationale qui s’établit à 5, 74. La prochaine rentrée devrait voir ce nombre dépasser la barre des 6 professeurs pour 100 élèves.
La rentrée scolaire 2021 dans l’Aude se prépare donc dans un contexte de fléchissement des effectifs, d’une augmentation du schéma annuel d’emploi et d’une amélioration des taux d’encadrement. La rentrée verra aussi l’ouverture prévisionnelle d’une unité locale d’inclusion scolaire et la création d’un poste d’enseignant référent pour la scolarisation des élèves en situation de handicap.
L’évolution de la carte scolaire dans l’Aude, madame la sénatrice, répond aux besoins des territoires avec une préoccupation centrale : maintenir, dans les territoires isolés ou dans les territoires les plus fragiles, une école de proximité.
Vous connaissez l’engagement du Président de la République : aucune fermeture d’école en milieu rural sans l’accord du maire. Dans l’Aude, aucune classe ni aucune école n’a fermé en 2020 en milieu rural.
Le travail de préparation de la carte scolaire pour la rentrée 2021 ne laisse pour l’instant prévoir aucune fermeture d’école en milieu rural ; la concertation avec les élus se poursuivra jusqu’à la rentrée, afin de tenir compte des spécificités de chaque territoire et de chaque école.

Monsieur le secrétaire d’État, je ne peux entendre de tels propos ! Vous me répondez par des statistiques quand je vous parle d’une couverture territoriale, là où des maires se sont engagés dans des regroupements pédagogiques, surtout en milieu rural. Lorsque l’on applique une règle mathématique, on se retrouve avec un contre-effet qui, par les fermetures annoncées dans les zones rurales, coupe la dynamique souhaitée par le ministre de l’éducation nationale : un cours préparatoire privilégiant la prise en compte des élèves au plus près.
Nous subissons des fermetures en milieu rural remettant en cause les investissements des communes qui ont voulu ces écoles, alors que les ouvertures de classes se font exclusivement dans le milieu urbain de mon département. Il faut revoir cela en privilégiant l’équité !

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante-deux, est reprise à onze heures quarante-cinq.

La parole est à M. Guillaume Chevrollier, auteur de la question n° 1625, adressée à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Madame la ministre, la précarité des jeunes, en particulier des étudiants, en milieu rural est une réalité qui a pris de l’ampleur avec la crise sanitaire, entre les cours à distance, la perte des emplois étudiants, les difficultés à trouver un stage de fin d’études, l’augmentation des dépenses et une baisse des ressources pour la majorité des jeunes.
Toutes ces difficultés ont inévitablement conduit à la détérioration de leur santé psychologique et à l’augmentation de leur précarité économique. J’ai été très marqué par le nombre de jeunes qui fréquentent les épiceries sociales dans mon département de la Mayenne et que j’ai rencontrés sur le terrain.
Ces étudiants en zone rurale sont confrontés à un sentiment d’abandon, bien que l’État ait mis en place un certain nombre d’aides et de mesures d’accompagnement. Comme les deux repas par jour à un euro, ces aides sont conditionnées et ciblées. De nombreux services ont été offerts aux étudiants des métropoles, excluant ceux qui se trouvent en zone rurale et dans les petites villes, je pense notamment à la ville de Mayenne, avec ses 380 étudiants.
Les inégalités territoriales et sociales se creusent, accélérant ainsi le sentiment d’exclusion chez nombre d’entre eux. Les collectivités territoriales se sont mobilisées pour assurer le relais de l’État. Les villes de Mayenne et de Laval ont déployé de nombreuses initiatives, une aide alimentaire d’urgence a été mise en place avec le concours de la Croix-Rouge, de la banque alimentaire et avec le soutien essentiel du conseil départemental de la Mayenne.
Des espaces de coworking ont également été créés pour permettre aux étudiants de bénéficier d’une connexion fibrée ; la maison des adolescents et le centre médico-psychologique œuvrent aussi pour leur offrir un soutien psychologique ; enfin, les centres communaux d’action sociale interviennent dans l’orientation et dans l’aide au quotidien.
Madame la ministre, il n’est pas normal que les étudiants en zone rurale soient exclus des aides déployées par le Gouvernement. Quelles sont les mesures compensatoires que vous comptez mettre en place pour les soutenir et les accompagner ?
Monsieur le sénateur Chevrollier, vous attirez mon attention sur la situation des étudiants qui poursuivent leur scolarité dans l’enseignement supérieur dans des lieux qui ne disposent pas de restaurant universitaire ou de cafétéria, essentiellement en milieu rural. Ces étudiants ne peuvent donc accéder au repas à un euro qui a été mis en place.
Je voudrais tout d’abord réaffirmer que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous) disposent de plus de 700 implantations de restauration, réparties dans plus de 221 villes du territoire, un maillage territorial essentiel qui permet d’offrir une réponse aux besoins de la très grande majorité des étudiants.
Bien que le système actuel ait démontré ses capacités d’adaptation et de modernisation, bien que, depuis le mois de janvier, plus de 7, 6 millions de repas à un euro aient été servis, vous avez raison, il y a encore des lieux où l’on rencontre des difficultés. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, en lien avec les collectivités, a proposé d’autres types de solutions.
Nous finançons les associations étudiantes qui participent à ces épiceries sociales et solidaires que vous mentionnez ; ensuite, les étudiants en brevet de technicien supérieur (BTS) ou dans les formations offertes par les classes préparatoires aux grandes écoles, peuvent bénéficier du repas à un euro, s’il existe des restaurants gérés par le Crous dans leur environnement. Malheureusement, ils ne le peuvent pas dans la structure de restauration de leur lycée, laquelle relève, pour son fonctionnement, de la compétence de la région et non de celle de l’État.
C’est pourquoi nous avons travaillé avec les collectivités territoriales ou avec les lycées : nous avons parfois passé des conventions afin que nous puissions accompagner localement ces étudiants et répondre à leurs difficultés financières.
Pour aller plus loin encore dans ce traitement équitable des étudiants dans les établissements relevant de la compétence de l’État, un effort particulier se porte sur les étudiants des formations délocalisées qui maillent les villes d’équilibre, je pense notamment à certaines formations des instituts universitaires de technologie (IUT). De plus, pour permettre à tous d’accéder à des lieux où les études sont facilitées, près de 90 campus connectés et plus de 55 implantations du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) « cœur de ville » qui sont aujourd’hui proposés à l’ensemble des étudiants partout sur notre territoire et nous irons plus loin.

Merci, madame la ministre, de votre réponse. Les élus locaux sont, eux, engagés partout sur le territoire pour soutenir les étudiants quel que soit le lieu de leurs études et ils mobilisent des actions très concrètes.
À mon sens, l’État devrait être davantage engagé aux côtés des élus, notre jeunesse mérite d’être soutenue, les apprentis comme les étudiants.

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi, auteur de la question n° 1557, adressée à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Madame la ministre, aux quatre coins de la France, le même constat vaut depuis des années : il est de plus en plus difficile pour nos concitoyens de trouver un praticien. C’est pourquoi le Gouvernement a entrepris de réformer les études de santé au moyen de la loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé. Tous ici, nous saluons cet objectif, car il y avait véritablement urgence.
Pour autant, malgré la fin du numerus clausus et son remplacement par le numerus apertus, l’inversion de la courbe des médecins dans notre pays ne se fera pas sentir avant plusieurs années. Cependant, près de deux ans après le vote de cette loi, un constat peut déjà être fait : la réforme semble avoir été mal préparée, mal expliquée, et donc mal comprise par les étudiants.
Certes, l’année universitaire 2020-2021 est une année de transition où l’ancien système cohabite avec le nouveau, mais la situation n’est aujourd’hui plus tenable. En plus de la difficulté que constituent les cours en distanciel, les étudiants en médecine sont dans le flou le plus total. Les primants cohabitent avec les redoublants, alors qu’ils n’auront pas la possibilité de redoubler.
Il est normal, par équité, que la dernière promotion de première année commune aux études de santé (Paces) dispose du même nombre de places que les années précédentes. Par équité, toujours, il serait donc normal que les étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) et en licence accès santé (LAS) aient proportionnellement le même nombre de places. C’est ce point que beaucoup ne comprennent pas !
J’ai reçu les témoignages de nombreux étudiants des universités de Toulouse et même de Montpellier, qui m’ont fait part de leur désarroi, et de leurs craintes devant cette réforme. Leur détresse m’a fortement touché. Vous le savez, madame la ministre, s’engager dans des études de santé, épouser une carrière médicale, c’est une vocation, un objectif de long terme ; c’est un objectif de vie.
Pourtant, sans possibilité de redoublement et avec un nombre de places limité, ce sont autant de rêves qui s’écrouleront pour les étudiants qui resteront sur le carreau. Face à cette situation, beaucoup d’entre eux, leurs parents, et même des médecins, se mobilisent depuis plusieurs semaines pour critiquer cette réforme.
Le 28 avril dernier a eu lieu un coup de théâtre : le Conseil d’État a suspendu l’exécution de l’arrêté du 25 janvier 2021 fixant à 6 509 le nombre d’étudiants de Paces autorisés à poursuivre leurs études en médecines, odontologie, pharmacie et maïeutique pour la rentrée 2021. Cette décision du Conseil d’État est un coup dur pour cette réforme, de plus en plus contestée sur le terrain.
Il y a urgence à trouver une solution acceptable pour tous, d’autant plus que les étudiants ont déjà passé leurs examens les 19, 20 et 21 avril dernier. Il serait tout à l’honneur de votre ministère de réajuster cette réforme, et ce serait une bouffée d’oxygène pour ces milliers d’étudiants au bord de la crise de nerfs.
Votre ministère trouvera de nombreuses pistes d’ajustements et de solutions dans les conclusions de la mission d’information que notre collège Sonia de La Provôté rendra la semaine prochaine. Je vous remercie par avance au nom de tous ces étudiants en détresse.
Monsieur le sénateur Levi, merci beaucoup de cette question, qui va me permettre, d’abord, de réaffirmer que cette réforme des études de santé répond à une volonté très forte et très partagée de diversifier les voies d’accès et les profils des étudiants tout en mettant fin à un système de sélection rigoureux fondé sur le numerus clausus.
Vous m’interrogez, plus spécifiquement, sur la notion de deuxième chance. Il s’agit de l’un des fondements de cette réforme. Jusqu’à présent, les étudiants étaient sélectionnés sur la base d’un échec : lorsqu’ils ne réussissaient pas le concours, ils devaient redoubler, alors que, parfois, leur moyenne était supérieure à 10 sur 20.
C’est cette injustice qui est aujourd’hui combattue, puisque, contrairement à la situation précédente, dans laquelle, au-delà du rang utile, on était exclu des études de santé, on permet aujourd’hui à tous les étudiants qui obtiennent la moyenne de continuer dans une filière qui leur permettra, à l’issue de la deuxième année ou, s’ils le souhaitent, de la troisième, de bénéficier d’une deuxième tentative. Ils seront donc dans un parcours de réussite et auront néanmoins deux tentatives possibles pour accéder aux études de santé.
Au-delà de cela, nous avons aussi tenu les engagements pris quant au nombre de places. Le numerus clausus, qui correspond à une situation transitoire, parce que nous devions tenir compte des étudiants redoublants dans l’ancienne version, atteint environ 6 000 places et c’est plus de 16 700 places qui sont offertes à l’ensemble des étudiants. Vous voyez donc que le nombre de places offertes aux primo-accédants, à ceux qui sont dans la première année de cette réforme, est bien supérieur au nombre de places qui leur étaient offertes les années précédentes : c’est quasiment 1 800 places de plus, 2 000, si l’on compte les études de kinésithérapie. Il s’agit d’une augmentation de plus de 12 %, ce qui ne s’est jamais vu.
Vous avez raison, il faut expliquer encore et rassurer, c’est pourquoi, mon collègue ministre de la santé et moi-même allons publier un arrêté qui permettra de sécuriser l’ensemble des étudiants et de leurs familles.

La parole est à Mme Florence Lassarade, auteure de la question n° 1571, adressée à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Madame la ministre, ma question porte également sur la réforme des études de médecine. En 2018, dans un rapport remis à la commission des affaires sociales, la Cour des comptes avait déjà révélé que la répartition des places dans les études de santé était inégale selon les territoires, et que tous les étudiants n’avaient pas la même chance d’accéder à la deuxième année selon leur lieu d’origine. Ce rapport soulignait des disparités importantes en termes de numerus clausus de médecine pour 100 000 habitants : en Aquitaine, à Bordeaux, le ratio était de 17 pour 100 000 habitants, là où, en Limousin, il était de 31 pour 100 000 habitants.
La réforme des études de santé a aggravé cette disparité chronique, en raison notamment du nombre d’étudiants autorisés à redoubler. Avec la réforme, ce sont les universités, en concertation avec les agences régionales de santé, qui proposent un nombre de places aux étudiants actuellement en parcours accès santé spécifique (PASS) et en licence accès santé (LAS).
Or cette année est une année de transition, durant laquelle les étudiants en PASS et en LAS doivent partager la capacité d’accueil avec les derniers redoublants de Paces, sans que celle-ci ait été significativement augmentée dans la majorité des universités.
Cette année, les étudiants en PASS ont l’obligation de suivre un double cursus avec une majeure de santé, qui correspond à l’ancien programme de la Paces allégé et une mineure d’une autre licence comme droit, sciences, etc. En cas d’échec à l’examen, ils ont interdiction de redoubler.
À l’université de Bordeaux, les modalités de contrôle des connaissances sont particulièrement dures pour la validation du PASS : il est ainsi impératif de valider toutes les unités d’enseignement (UE) santé, une par une, et sans compensation possible, avec la note plancher éliminatoire de 10 sur 20.
À titre de comparaison, les modalités de contrôle des connaissances des PASS des universités d’Aix-Marseille, de Nice, d’Amiens, de Rouen ou de Toulouse, permettent une compensation entre UE d’un même semestre ou d’un même bloc et, à Toulouse, la note plancher est à 8 sur 20.
En outre, le Conseil d’État vient de suspendre l’arrêté fixant le nombre d’étudiants admis à poursuivre en deuxième année de médecine, considérant que celui-ci « a pour effet de laisser un nombre de places résiduel » aux étudiants actuellement en PASS. Des mesures particulières auraient dû être mises en place pour accompagner cette année de transition afin de rétablir l’égalité des chances !
Madame la ministre, je souhaiterais savoir comment le Gouvernement envisage désormais de pallier ces inégalités, notamment à Bordeaux.
Madame la sénatrice Lassarade, l’objet de cette réforme – je tiens à le souligner – est de faire en sorte que des professionnels de santé soient présents dans tous les territoires.
Vous mentionnez les inégalités qui existaient auparavant. Effectivement, les étudiants ne pouvaient alors démarrer, poursuivre et terminer leurs études de santé que dans des villes dotées d’un centre hospitalier universitaire (CHU). Compte tenu des différences d’attractivité entre les différentes villes et les différents CHU, la répartition des étudiants était totalement concentrée dans les métropoles.
Depuis la rentrée 2020, l’accès aux études de santé s’effectue au travers des 35 parcours accès santé spécifique, mais aussi des 457 licences avec option accès santé réparties sur tout le territoire. Autrement dit, aujourd’hui un étudiant peut démarrer ses études de santé partout sur le territoire.
De plus, la réforme des deuxième et troisième cycles permettra d’augmenter le nombre des maîtres de stage susceptibles d’accueillir les externes et les internes partout sur le territoire.
Ainsi, les jeunes qui souhaitent devenir spécialistes ne devront plus passer douze à quatorze ans à proximité d’un CHU ; nous leur permettons désormais de garder des attaches dans leur territoire en y démarrant leurs études, pour les poursuivre ensuite après une phase de formation.
Les études de santé sont par définition extrêmement exigeantes. Je vous confirme que la sélection à l’entrée demeure très forte, et c’est bien normal, car c’est la santé de l’ensemble de nos concitoyens qui est en jeu.
J’en viens aux mesures qui ont été prises, madame la sénatrice. À ce jour, 16 700 places sont offertes pour accéder à la deuxième année d’études de santé. C’est du jamais vu ! Ces 16 700 places – soit presque 2 000 de plus que l’an dernier – ont été réparties sur le territoire en fonction des besoins arrêtés par les ARS et les facultés de médecine en lien avec les collectivités locales.

Celui qui est victime des statistiques échoue, et cet échec est définitif. Je suis triste pour ces jeunes qui étaient pleins d’espoir à l’annonce de la suppression du numerus clausus et auxquels on a coupé les ailes.

La parole est à Mme Nadia Sollogoub, auteur de la question n° 1654, adressée à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Madame la ministre, en juillet dernier, votre ministère, en concertation avec le ministère des solidarités et de la santé, a annoncé que, au vu des résultats au baccalauréat, du nombre des candidatures et des besoins en professionnels de santé, le plan de relance comporterait un volet relatif à la création de places dans les formations du supérieur.
Un appel à candidatures a été lancé, en particulier pour les formations d’orthoptie. Seize places supplémentaires en formation d’orthoptie ont été créées – dix à Limoges et six à Nevers – pour des étudiants dépendant de l’université de Paris et réalisant un cursus délocalisé dans ces deux villes de province. Un financement de 6 000 euros par place a été annoncé pour la durée de la formation.
Ainsi, depuis septembre, six étudiants effectuent à Nevers leur formation dans des conditions optimales. Les cours à distance sont assurés avec l’encadrement de notre excellent campus numérique, grâce à la plateforme nationale d’enseignement d’orthoptie développée par le professeur d’ophtalmologie Dominique Brémond-Gignac.
Ces étudiants font leur stage en milieu hospitalier privé, chez des orthoptistes et ophtalmologistes qui les accueillent deux par deux, alors qu’il semblerait que, en région parisienne, jusqu’à vingt étudiants soient parfois accueillis pour ce stage.
Le seul bémol, madame la ministre, est qu’à ce jour le financement de ces places supplémentaires de formation, d’un montant de 96 000 euros, n’a pas été débloqué. Où en sommes-nous, madame la ministre ?
Madame la sénatrice Sollogoub, à l’issue de la campagne Parcoursup 2020, un nombre important de candidatures pour les formations nouvellement intégrées aux diplômes d’orthophoniste, d’orthoptiste et d’audioprothésiste a été constaté. C’est la raison pour laquelle mon ministère a souhaité élargir le vivier d’étudiants dans ces trois formations.
Dans le cadre du plan de relance, le financement de capacités d’accueil supplémentaires à la rentrée 2020 a ainsi été acté. Les places supplémentaires ont été intégrées à Parcoursup, et l’arrêté fixant le nombre d’étudiants à admettre en première année de ces formations a été modifié en conséquence. De plus, les financements prévus portent sur la durée globale de formation de chaque place nouvellement créée. Nous avons ainsi augmenté de 5 % le nombre de places en orthophonie, de 6 % en orthoptie de 3, 5 % en audioprothèse. Le financement afférent alloué s’élève à 6 000 euros par étudiant, soit un montant total de 522 000 euros.
Je vous confirme que l’université de Paris bénéficiera en 2021 d’une subvention supplémentaire de 96 000 euros pour la création de ces places en orthoptie. Je souhaite d’ailleurs remercier l’université de Paris d’avoir pensé ces parcours de façon délocalisée. Comme vous l’avez indiqué, cela démontre que l’on est parfaitement capable de dispenser des formations en santé partout sur notre territoire, et dans des conditions d’encadrement parfois meilleures que dans les métropoles.
Cet engagement a été confirmé au mois d’avril à l’université de Paris. Les crédits versés au titre du plan de relance sont en cours de notification et seront reçus prochainement par l’université. Comme vous, j’estime qu’il est très important que l’État tienne ses engagements et, une fois de plus, il les tiendra.

Mme Nadia Sollogoub. Je vous remercie, madame la ministre, de cette réponse dont vous vous doutez qu’elle me réjouit. Vous avez évoqué l’année 2021, mais il s’agit bien de formations qui ont commencé en septembre 2020. En sommes-nous d’accord ?
Mme la ministre acquiesce.

J’espère que nous aurons le plaisir de vous recevoir à Nevers pour vous présenter cette formation et vous montrer qu’il s’agit réellement d’un modèle « gagnant-gagnant », qui nous permet de proposer aux étudiants des terrains de stage d’excellence dans des territoires sous-dotés.
Je me permets d’ailleurs de vous suggérer de généraliser ce système à d’autres formations et, surtout, de le pérenniser à Nevers. Je vous demande donc de nouveau des fonds, cette fois pour demain et après-demain, car il serait vraiment dommage que cette expérience s’arrête en cours de route.

La parole est à M. Pierre-Jean Verzelen, auteur de la question n° 1563, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Madame la ministre, ma question porte sur les contrôles effectués pour le versement des primes de la politique agricole commune (PAC) liées aux surfaces.
Un acompte de 70 % de la prime PAC des agriculteurs est versé au mois d’octobre. Dans certains territoires, des contrôles sont réalisés chaque année, et cela est bien normal. Toutefois, ces contrôles sont effectués au prisme de la présomption de culpabilité. Ainsi, dès lors qu’une ferme est contrôlée, le versement de l’acompte à hauteur de 70 % de la prime est gelé jusqu’à la fin du contrôle.
Un premier contrôle aérien est effectué autour du mois d’octobre. Si tout va bien, les agriculteurs contrôlés percevront l’acompte en fin d’année. En revanche, si le moindre problème est relevé, tout est bloqué : un contrôle physique est alors effectué, et l’agriculteur ne percevra ses primes PAC qu’à l’issue de l’instruction qui peut durer des mois, voire davantage.
Je souhaite que nous sortions de ce régime de présomption de culpabilité, et que le gel d’une partie des primes PAC soit uniquement lié aux lieux qui sont identifiés comme posant certaines difficultés. En effet, de nombreux agriculteurs doivent acquitter des annuités de remboursement, payer des salaires et des charges et s’approvisionner, notamment en matières premières. Beaucoup se retrouvent ainsi dans des situations très compliquées. Pourrait-on entamer des discussions avec les instances européennes afin de changer ce système ?
Par ailleurs, des améliorations pourraient être apportées quant à l’organisation des contrôles physiques effectués dans un second temps, qu’il s’agisse des délais ou de la méthode employée. Plutôt qu’une administration de la méfiance, offrons du conseil et de la bienveillance à nos agriculteurs !
Monsieur le sénateur, vous interrogez le ministre de l’agriculture et de l’alimentation, Julien Denormandie, qui vous prie d’excuser son absence, sur la possibilité de payer un dossier d’aide PAC avant la finalisation des contrôles qui sont requis.
Le ministre de l’agriculture souhaiterait pouvoir vous donner satisfaction, mais il rappelle que c’est, hélas ! strictement interdit par la réglementation, qui impose la finalisation des contrôles avant le paiement de l’aide. Cette disposition permet d’assurer la bonne gestion des aides de la PAC, et donc, in fine, des impôts de l’ensemble de nos concitoyens ; il s’agit d’un gage de légitimité de la PAC vis-à-vis du citoyen, et donc, finalement, d’une disposition qui protège la PAC.
Pour autant, les services instructeurs français, les directions départementales des territoires (DDT), l’Agence de services et de paiement et les services centraux du ministère de l’agriculture sont pleinement mobilisés chaque année pour payer le plus rapidement possible le maximum d’agriculteurs. Ce fut d’ailleurs le cas également en 2020, malgré la crise du covid-19 : nous pouvons tous les remercier de cette implication.
Dès les premiers jours de décembre 2020, soit dès la date de paiement permise par la réglementation européenne, 99 % des agriculteurs ont reçu les principaux paiements découplés – le paiement de base, le paiement redistributif – et plus de 97, 5 % avaient également reçu leur « paiement vert », sans compter l’indemnité compensatoire de handicaps naturels (ICHN) qu’une même proportion éligible avait également perçue.
Toutes les marges de manœuvre de la réglementation sont mobilisées au bénéfice des agriculteurs pour hâter les paiements. La France est ainsi l’un des États membres qui paie le plus rapidement les aides de la PAC aux agriculteurs.
Le ministre de l’agriculture militera dans la prochaine PAC pour la reconnaissance du droit à l’erreur et, plus généralement, pour la simplification de la PAC, parce qu’une PAC plus simple et plus juste permettra de faire mieux encore pour les agriculteurs qu’à l’heure actuelle.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Il est tout à fait logique que le versement des aides de la PAC soit contrôlé, puisque ces aides sont de l’argent public. En revanche, il ne paraît pas opportun de bloquer tout paiement pendant plusieurs mois pour un unique problème. Vous m’avez indiqué que nous étions tenus par la réglementation. Je l’entends, mais j’estime que le bon sens – qui serait par ailleurs susceptible de rapprocher les citoyens de l’Europe – voudrait que l’on fasse évoluer cette réglementation.

La parole est à Mme Chantal Deseyne, auteur de la question n° 1597, transmise à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Madame la ministre, les articles 125 et 86 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire ont invité le Gouvernement à agir par voie réglementaire afin d’arrêter les nouveaux référentiels applicables aux boues d’épuration en vue de leur usage au sol, d’une part, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles les boues pourront être compostées par ajout d’un coproduit structurant, notamment de type « déchets verts ».
Les options de traitement de la boue d’épuration en vue de son hygiénisation dépendent pour les territoires de considérations géographiques, techniques, historiques et financières diverses qu’une modification brutale et uniforme pourrait gravement fragiliser.
Les inquiétudes relatives à cette nouvelle réglementation sont très diverses. Il ressort notamment que les exigences de siccité sont susceptibles de rendre les boues impropres à l’usage agricole en deçà d’un certain seuil, qu’il sera nécessaire d’adapter la capacité de traitement des stations d’épuration ou encore que les exigences liées au seuil de structurants – les déchets verts – dans le cadre des procédés de compostage seront relevées.
Madame la ministre, comment le Gouvernement entend-il faire face aux difficultés concrètes qui ne manqueront pas de résulter de la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation et qui, à juste titre, préoccupent de nombreux élus locaux ?
Madame la sénatrice, l’article 125 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite loi AGEC, a habilité le Gouvernement à transposer par ordonnance des directives européennes relatives aux déchets.
Ainsi, l’article 14 de l’ordonnance du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des déchets a complété le code rural et de la pêche maritime d’un article qui précise : « Un décret pris après consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fixe les critères de qualité agronomique et d’innocuité selon les conditions d’usage pour les matières fertilisantes et les supports de culture, afin de s’assurer que leur mise sur le marché et leur utilisation ne porte pas atteinte à la santé publique, à la santé animale et à l’environnement. » Ce décret dit « socle commun des matières fertilisantes et supports de culture » prendra en compte toutes les matières fertilisantes mises sur le marché ou utilisées en France, dont les boues d’épuration.
L’article 86 de la loi AGEC précise que les référentiels réglementaires sur l’innocuité environnementale et sanitaire applicables aux boues d’épuration en vue de leur retour au sol doivent être révisés au plus tard le 1er juillet 2021. À compter de cette date, l’usage au sol de ces boues, seules ou en mélange, brutes ou transformées, est interdit dès lors qu’elles ne respectent pas les normes ainsi définies.
Une période de transition est prévue entre le 1er juillet 2021 et l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Durant cette période, les dispositions des arrêtés du 8 janvier 1998 et du 2 février 1998 resteront applicables aux boues.
Les mesures exceptionnelles concernant les boues d’épuration adoptées dans le contexte de l’épidémie de covid-19 ne sont pas liées à la future réglementation mentionnée ci-dessus. Il n’est en effet pas prévu que celle-ci rende obligatoire l’hygiénisation des boues d’épuration avant leur épandage.
Le décret « socle commun des matières fertilisantes et supports de culture » devra répondre au double objectif de protéger les terres agricoles et de faire progresser l’économie circulaire. Les nouvelles dispositions relatives à l’innocuité comme à l’efficacité des matières fertilisantes seront mises en place progressivement, en fonction notamment des données scientifiques disponibles, de la nature de ces matières fertilisantes, des risques qu’elles peuvent présenter, des moyens existants pour les maîtriser et des délais d’adaptation pour les acteurs.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. J’ai bien compris que nous étions contraints de transposer une norme européenne. Pour autant, ces nouvelles mises aux normes qui s’imposeront très vite, dès 2021, seront à l’origine, pour les collectivités en charge des stations d’épuration, de coûts élevés qui seront reportés sur les usagers. Si la qualité des boues d’épuration n’est pas satisfaisante, celles-ci finiront dans des centres d’incinération, ce qui n’est ni économique ni écologique.

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.