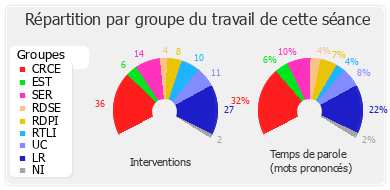Séance en hémicycle du 18 octobre 2022 à 22h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de M. Alain Richard.

La séance est reprise.

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, le Gouvernement demande d’avancer le début de l’examen du projet de loi relatif à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, initialement prévu le jeudi 3 novembre, au mercredi 2 novembre, à l’issue de l’examen du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.
Acte est donné de cette demande.
Nous pourrions fixer le délai limite d’inscription des orateurs dans la discussion générale sur ce texte au lundi 31 octobre à quinze heures.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé.

L’ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, présentée par Mme Éliane Assassi, M. Arnaud Bazin et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 720 [2021-2022], texte de la commission n° 39, rapport n° 38).

Monsieur le ministre, mes chers collègues, au vu de l’heure de reprise de nos travaux, et en accord avec la commission et le Gouvernement, je vous propose d’ouvrir la nuit afin d’achever l’examen de cette proposition de loi.
Y a-t-il des observations ?…
Il en est ainsi décidé. Chacun en tirera la conséquence et veillera à exprimer ses opinions et ses réflexions avec le maximum d’intensité.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Éliane Assassi, auteure de la proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Jérôme Bascher et Mme Valérie Boyer applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai l’honneur de vous présenter notre proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Ce texte est le résultat du travail rigoureux de la commission d’enquête du Sénat, créée sur l’initiative du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Il est le fruit de quatre mois d’investigation, de 40 auditions et de l’analyse de 7 300 documents.
Nous avons trois objectifs : en finir avec l’opacité des prestations de conseil ; mieux encadrer celles-ci ; renforcer les exigences déontologiques des consultants. Il s’agit non pas d’interdire, par principe, le recours aux cabinets de conseil, mais de fixer un cadre clair pour mettre fin aux dérives constatées par la commission d’enquête.
Cette démarche est transpartisane ; tous les groupes politiques de notre assemblée y ont été associés. À cet égard, je tiens ici à remercier l’ensemble des membres de la commission d’enquête de leur soutien, ainsi que la commission des lois et sa rapporteure, Mme Cécile Cukierman, pour les améliorations apportées au texte.
C’est le pluralisme sénatorial qui s’exprime aujourd’hui. Nous pouvons en être fiers, sur toutes les travées de notre hémicycle.

Je remercie également très sincèrement Arnaud Bazin, président de la commission d’enquête, avec lequel je travaille de concert depuis le premier jour.
La commission d’enquête a mis au jour un phénomène tentaculaire : l’influence croissante des consultants privés sur des pans entiers des politiques publiques.
La crise sanitaire, la stratégie nationale de santé, l’avenir du métier d’enseignant, la mise en œuvre de la réforme des aides personnelles au logement (APL), les États généraux de la justice : la liste des missions déléguées à des cabinets privés est tellement foisonnante qu’elle en donne le tournis, au point que l’on peut se demander s’il y a un pilote dans l’avion.
En 2021, la facture des consultants s’élève au moins à 1 milliard d’euros pour l’État et ses opérateurs ; elle a plus que doublé depuis 2018.
En pratique, les cabinets de conseil n’ont pas de problème de pouvoir d’achat : une journée de consultant coûte en moyenne 1 500 euros à l’État, ce chiffre ayant atteint 2 168 euros pendant la crise sanitaire. Malgré ce niveau de rémunération, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous.
Ainsi, Capgemini a, par exemple, reçu 280 200 euros pour une mission sur le handicap, alors que l’évaluation parle d’une « valeur ajoutée quasi-nulle, contre-productive parfois ».
BCG (Boston Consulting Group) et Ernst & Young ont reçu 558 900 euros pour organiser au mois de décembre 2018 une convention des managers de l’État, qui n’aura finalement jamais lieu.
McKinsey a, en novembre 2019, reçu 957 000 euros pour une mission commandée par la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) et visant « à aider la Caisse à se transformer en vue de la réforme des retraites », alors que ladite réforme – tout le monde s’en souvient – a été abandonnée…
De telles dérives sont inacceptables, surtout lorsqu’il s’agit d’argent public, et surtout dans le contexte actuel.
Au quotidien, l’opacité règne sur les prestations des cabinets de conseil, qui souhaitent rester – veuillez excuser l’anglicisme – « behind the scene », pour reprendre leur expression.
À titre d’exemple, la commission Cyrulnik sur les 1 000 premiers jours de l’enfant n’était pas au courant que l’État avait missionné, en parallèle de ses travaux, le cabinet Roland Berger. Ce cabinet a touché plus de 425 000 euros, pour un travail qui n’était « pas à la hauteur d’un cabinet de stratégie », selon l’évaluation de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP). Dans le même temps, les membres de la commission Cyrulnik, médecins et experts de haut niveau, étaient bénévoles et avaient du mal à se faire rembourser leurs frais de déplacement pour se rendre aux réunions. Deux poids, deux mesures !
Si notre commission d’enquête a été un exercice de transparence démocratique, on constate, depuis lors, un retour à l’opacité. Au-delà de l’exercice de communication, le « jaune » que le Gouvernement a publié la semaine dernière est lacunaire et – je dois le dire – très décevant.
Lacunaire, car il exclut le conseil en informatique et ne couvre que la moitié du périmètre de la commission d’enquête. Il ne concerne que 470 millions d’euros de prestations, contre 894 millions dans nos travaux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes !
Décevant, car le Gouvernement se refuse à publier la liste des prestations de conseil dont il a bénéficié, alors qu’il s’agit d’une information essentielle, que nos concitoyens sont en droit de connaître.
En pratique, les ministères traînent des pieds pour répondre aux demandes des journalistes, entretenant ainsi un climat d’opacité. Pour gagner du temps, l’État refuse toujours de communiquer des documents, malgré les avis favorables de la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada).
Le 21 janvier dernier, un journaliste de Next INpact demandait au ministère de l’éducation nationale une copie du rapport de McKinsey sur l’avenir du métier d’enseignant, facturé la somme exorbitante de 496 800 euros. Dix mois plus tard, il attend toujours… Et le 12 octobre, le journal Le Monde annonçait sa volonté de saisir la justice face à l’absence de réponses de l’Élysée, de Matignon et de la plupart des ministères.
Le Gouvernement ne doit pas avoir peur de la transparence, bien au contraire ! C’est pourquoi notre proposition de loi prévoit d’imposer la publication de la liste des prestations de conseil de l’État et de ses opérateurs, ainsi que des bons de commande et des évaluations des prestations. Ces informations figureront dans le rapport social unique (RSU), pour que les fonctionnaires puissent en débattre. Les agents publics ressentent en effet un profond malaise lorsque des consultants viennent leur expliquer leur métier à coups de post-it, de jeux de rôle ou encore de paper boards.
C’est le cas à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), où les consultants de Wavestone chassent ce qu’ils appellent des « irritants » pour réduire le délai de traitement des demandes d’asile. Autre exemple : pendant la campagne de vaccination, McKinsey utilisait le logo de l’administration pour rédiger ses livrables.
Et M. Véran, ancien ministre de la santé, d’affirmer devant notre commission d’enquête : « Si vous aviez voulu [les] documents estampillés McKinsey présents dans le dossier, vous auriez trouvé une feuille blanche. » C’est étrange pour une prestation facturée plus de 12 millions d’euros…
C’est pourquoi nous souhaitons éviter toute confusion entre les fonctionnaires et les cabinets de conseil, lesquels ne pourront plus utiliser les signes distinctifs de l’administration.
Sur l’initiative de Mickaël Vallet, nous proposons de bannir les expressions anglo-saxonnes d’inspiration managériale, comme benchmark, lean management ou encore key learning. Conformément à l’article 2 de la Constitution, la langue de la République est le français, y compris pour les consultants.
Certains ont résumé notre texte en le surnommant « proposition de loi McKinsey ». Certes, les pratiques de ce cabinet ont choqué nos compatriotes, en particulier sur le plan fiscal : il a payé zéro euro d’impôt sur les sociétés pendant dix ans, alors que son chiffre d’affaires atteint 450 millions d’euros par an ! Comble de l’ironie, le 11 juillet dernier, sur BFM Business, la directrice générale de McKinsey rejetait la faute sur le coût du travail en France, qui reste trop élevé à son goût…
En réalité, McKinsey peut remercier le mécanisme des prix de transfert et le paradis fiscal du Delaware. Ce cabinet continue d’ailleurs de candidater aux marchés publics : il a été désigné titulaire de second rang du marché de l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), attribué en plein été.
Mais notre proposition de loi va bien au-delà de ce seul cabinet : le recours aux consultants est devenu un réflexe pour l’administration, alors qu’elle dispose des compétences en interne. On a parfois l’impression que l’État se fie davantage aux powerpoints de ses consultants qu’au travail de ses agents. Au fond, le recours croissant aux cabinets de conseil illustre une certaine vision de l’État, un « État en mode start-up », pour reprendre le titre d’un ouvrage évoqué pendant l’audition de McKinsey.
En déléguant ses missions stratégiques à des cabinets privés, l’État risque toutefois de perdre en souveraineté, au bénéfice des multinationales du conseil. Nous serons tous d’accord pour éviter un tel risque…
Le Gouvernement lui-même a d’ores et déjà pris des mesures, la plupart du temps en réaction à nos travaux. Nous gardons ainsi à l’esprit la circulaire signée le 19 janvier dernier, le jour même de l’audition d’Amélie de Montchalin par notre commission d’enquête. Le hasard fait parfois bien les choses…
Monsieur le ministre, le Gouvernement a besoin de notre proposition de loi pour mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil. Vous le savez, car nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises sur le sujet, de manière franche et directe. C’est pourquoi nous vous demandons solennellement d’inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, sans en réduire l’ambition.
Nous avons un devoir de responsabilité à l’égard des Français, qui se sont emparés du sujet et souhaitent que les choses changent.
L’enjeu dépasse même notre pays : le 30 septembre dernier, Radio-Canada annonçait que McKinsey avait été payé 35 000 dollars par jour pendant la crise sanitaire au Québec, dans l’opacité la plus totale.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons ensemble le devoir de fixer des règles plus claires pour les consultants, dans l’intérêt de l’État et de nos politiques publiques ! Il ne s’agit pas seulement d’un souhait des parlementaires que nous sommes, dans notre diversité ; c’est une exigence devenue populaire au fil des travaux de notre commission.
Notre débat d’aujourd’hui est attendu et je fais confiance à notre Haute Assemblée pour être à la hauteur de cette exigence.
Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi de nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin est ambitieuse et profondément novatrice. Elle a été nourrie par les travaux que la commission d’enquête a conduits pendant plusieurs mois sur l’influence croissante des cabinets de conseil sur les politiques publiques.
Ces travaux ont suscité de nombreuses réactions de la part du Gouvernement, de l’administration et des consultants : circulaire de la Première ministre ; refonte de l’accord-cadre de la direction interministérielle de la transformation publique, dont l’équipe de conseil interne doit être renforcée ; rédaction par l’organisation professionnelle Syntec Conseil d’une charte de déontologie spécifique pour « les interventions de conseil auprès du secteur public » ; et, très récemment, publication par le Gouvernement d’une annexe au projet de loi de finances pour 2023 – vous me permettrez, monsieur le ministre, de ne pas utiliser l’expression « jaune budgétaire » ; mais nous y reviendrons.
Si ces initiatives vont dans la bonne direction, elles restent insuffisantes, car elles n’ont pas le caractère général et pérenne souhaité.
La commission des lois estime par conséquent qu’une loi instituant un cadre unifié, contrôlé et sanctionné est aujourd’hui nécessaire.
Le texte proposé par nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin répond à quatre enjeux, tous essentiels dans le cadre d’une démocratie que l’on souhaite mature : un enjeu de transparence, envers les parlementaires, mais surtout à destination des citoyens ; un enjeu de maîtrise de la dépense publique ; un enjeu de souveraineté, au travers de l’action de l’État ; enfin, un enjeu de probité.
Cosigné par la quasi-intégralité des membres de la commission d’enquête, ce texte est le fruit d’un travail transpartisan. La commission des lois a tenu à conserver cet équilibre, tout en l’ajustant pour lui apporter une pleine effectivité. Dans cet esprit, elle a sécurisé le périmètre de la proposition de loi en choisissant une rédaction plus précise juridiquement, préférant la catégorie des établissements publics de l’État à celle des opérateurs, et en évitant les chevauchements de compétences avec les conseils de discipline des professions réglementées du droit.
La commission a également renforcé l’exigence de transparence et clarifié le partage des responsabilités entre administration et consultants. Elle a aussi rendu plus dissuasive l’amende administrative qui serait exigée des personnes morales ne respectant pas les nouvelles obligations mises en place, en la portant à un montant proportionnel à leur chiffre d’affaires mondial. Elle a enfin apporté des garanties à la procédure de vérification sur place et créé un mécanisme de régularisation en cas d’exclusion des procédures de passation des marchés publics.
Cela étant, j’ai bien conscience que le texte adopté par la commission n’est qu’un point d’étape et non pas un aboutissement. Certains sujets importants restent en effet en débat. Ils nécessitent le temps de la réflexion que permettent la navette et la discussion parlementaires. Il en va ainsi du champ d’application de la proposition de loi, concernant aussi bien les administrations bénéficiaires que les prestations de conseil concernées.
Par ailleurs, la question de l’inclusion ou non des collectivités territoriales dans la liste des administrations bénéficiaires se pose, c’est indéniable. Loin de nous l’idée d’opposer un État friand de prestations de conseil à des collectivités territoriales qui n’y recourraient jamais ! Toutefois, cette question ne saurait être réglée sans consulter les associations d’élus locaux et sans comprendre les conséquences d’une telle décision sur le fonctionnement desdites collectivités territoriales. Nous n’allons pas le faire au détour d’un amendement de séance : ce serait affaiblir le texte et ses objectifs.
De même, la question des seuils est récurrente, y compris pour les établissements publics de l’État que nous avons intégrés dans le champ d’application de la proposition de loi. Cependant, en l’absence d’informations permettant d’établir la liste précise des établissements publics concernés par tel ou tel seuil, il nous semble pour l’heure prématuré d’en fixer un.
Dans le même ordre d’idée, la liste des prestations de conseil entrant dans le champ de la proposition de loi mériterait sans doute d’être affinée ultérieurement.
À ce stade, le Gouvernement et quelques-uns de nos collègues ont formulé un certain nombre de propositions.
Une partie d’entre elles remettent en cause l’architecture du texte, en particulier le rôle accordé à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) et le recours à des sanctions administratives, ou reviennent sur la substance des obligations mises à la charge de l’État, en particulier en matière de transparence. C’est pourquoi la commission s’y opposera.
D’autres visent à suggérer des modifications plus restreintes. Nous ne les avons pas retenues à ce stade pour nous concentrer sur le cadre général. Nous pourrons, pour certaines, y revenir dans la suite de la navette.
Enfin, certains auraient souhaité saisir l’occasion de ce texte pour renforcer le cadre législatif s’appliquant aux représentants d’intérêts. Ils en ont été empêchés par l’application de l’article 45 de la Constitution et surtout, là encore, par la volonté de préserver l’équilibre de cette proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête.
Ce sujet est cependant important et mériterait un texte à part. Notre comité de déontologie mène d’ailleurs une réflexion sur les règles applicables aux représentants d’intérêts au Sénat.
Ce soir, nous fixons un cadre et nous coulons, en quelque sorte, les fondations. Mais tout ne sera pas terminé après l’examen du texte au Sénat. Il faudra poursuivre le dialogue et améliorer cette proposition de loi pour la rendre applicable et effective.
Notre rôle ici n’est certainement pas d’affaiblir l’État et, à travers lui, notre République. Il est au contraire de chercher à prendre les meilleures décisions pour modifier des pratiques qui ont conduit, progressivement, à externaliser une partie de la prise de décision vers le secteur privé.
Nous sommes là non pas pour tout renverser, mais bien pour remplir pleinement notre mission de parlementaire, c’est-à-dire pour effectuer le travail de contrôle et d’initiative législative. Nous ne doutons pas que l’Assemblée nationale fera de même, qu’elle inscrira à son tour ce texte à son ordre du jour et qu’elle l’examinera dans les semaines ou les mois à venir.
Pour conclure, la commission vous invite à adopter son texte enrichi de quelques amendements pour poser, comme je l’ai dit, les premiers grands jalons de l’encadrement de l’activité des cabinets de conseil privés auprès de l’État et de ses administrations, et ce dans un délai contraint. Nous aurions certainement pu mener davantage d’auditions si le temps dont nous avions disposé avait été plus long… Pour autant, les travaux de la commission d’enquête ont permis de préserver l’équilibre souhaité par les différents auteurs de cette proposition de loi.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter ce texte.
Applaudissements.
Monsieur le président, madame la présidente Assassi, monsieur le président Bazin, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le sujet qui nous occupe aujourd’hui – je veux le dire clairement – est stratégique.
Il s’agit de la capacité de la puissance publique à répondre efficacement aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Nous choisissons ensemble ce soir – c’est là où nous nous rejoignons, et je veux vous en remercier – d’aborder ce sujet dans l’objectif de renforcer la puissance publique, sans jamais laisser ce sujet aux populistes.
Les populistes ne cherchent qu’une seule chose : créer la polémique pour affaiblir le Gouvernement et, ce faisant, l’État. Et quand nous aurons proposé des solutions, ils passeront à la prochaine polémique… Tel n’est ni l’esprit dans lequel vous avez mené vos travaux ni celui qui présidera à nos échanges ce soir.
Je souhaite que nous examinions ce texte dans l’esprit qui vous a animé, de façon transpartisane – vous l’avez rappelé, madame la présidente –, ou plutôt en étant rassemblés dans un seul camp : celui de ceux qui souhaitent renforcer l’État.
Sur ce sujet, la philosophie du Gouvernement est claire.
L’État doit-il pouvoir faire appel à des compétences dont il ne dispose pas en interne ? La réponse est oui.
L’État doit-il se réarmer, développer ses compétences, se doter d’un cadre renforcé pour recourir à des prestations de conseil externes ? Je réponds également de façon positive à ces questions.
Au moment d’entamer notre discussion, je tiens à saluer l’engagement du Sénat et de la commission d’enquête transpartisane créée sur l’initiative – cela a été rappelé – du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et présidée par M. Bazin, dont Mme la présidente Assassi était rapporteure.
Vous avez mené un travail en profondeur, précis, sérieux, et avancé des propositions concrètes. Les membres de la commission ont estimé que ces propositions nécessitaient une traduction législative. Le Gouvernement en prend acte et se penche sur ce texte de façon tout aussi attentive et exigeante.
Je me présente ce soir devant vous avec la volonté d’avancer sur ces sujets. À l’appui de ces affirmations, je tiens à dire que nous avons agi concrètement pour encadrer le recours aux prestations de conseil.
Premièrement, nous avons agi – vous l’avez dit – au travers de la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022, laquelle a fixé à la fois des modalités de contrôle interne et un cap en matière de réduction des dépenses de conseil à court terme – nous sommes dans la bonne voie pour tenir ce dernier objectif.
Pour ce qui concerne les modalités de contrôle, je le dis devant la chambre haute, une mission inter-inspections, portée par la Première ministre, sera menée d’ici à la fin de l’année pour vérifier la bonne application du contrôle interne et faire le point sur ce qu’il nous reste à faire.
Deuxièmement, dès ma nomination, j’ai mis en place un nouveau cadre clair et renforcé sur le recours aux prestations de conseil. Il s’agit de l’accord-cadre interministériel de la DITP, qui entrera en vigueur en janvier 2023 et sera d’utilisation exclusive pour les services de l’État. Cet accord intègre pleinement les recommandations de la commission d’enquête en matière de déontologie, de transparence, de protection des données de l’État ou de prévention contre les risques de dépendance des administrations à l’égard des prestataires.
Troisièmement, afin de réarmer concrètement l’État, j’ai aussi décidé de renforcer nos moyens humains – vous l’avez souligné, madame la rapporteure –, en créant 15 postes dédiés au sein de la DITP, pour une administration qui compte aujourd’hui une centaine de fonctionnaires. Vous pourrez le constater dans les engagements budgétaires dont vous aurez à débattre lors de l’examen du projet de loi de finances.
Enfin, très concrètement, nous avons effectué cette année une synthèse de l’ensemble des dépenses de conseil de l’État. J’ai tenu à ce que ce document vous soit transmis avant l’examen de la présente proposition de loi. Ce document est annexé au projet de loi de finances pour 2023.
Je prends aujourd’hui deux engagements devant vous concernant ledit document.
Premier engagement : je défendrai à l’Assemblée nationale, dès la discussion du projet de loi de finances pour 2023, un amendement visant à graver ce document dans le marbre et à en faire un « jaune » budgétaire pour de bon, madame la rapporteure, c’est-à-dire une annexe pérenne dans le cadre de l’examen annuel du projet de loi de finances.
Deuxième engagement, sur lequel j’aurai l’occasion de revenir au cours de ce débat : je renforcerai le volume, la précision et la granularité des informations qui seront portées à votre connaissance dans ce « jaune » budgétaire.
Vous le voyez, nous avançons, nous agissons et nous prenons des dispositions pour renforcer l’État, en tenant compte des recommandations du Sénat.
C’est dans cet état d’esprit constructif, sincère et exigeant que j’aborderai l’examen de la présente proposition de loi : sincère sur les finalités du texte, exigeant sur l’effectivité et la proportionnalité des dispositions proposées.
Je partage les objectifs premiers de ce texte : une meilleure maîtrise par la puissance publique des moyens qu’elle mobilise et la neutralité des prestations de conseil sur la décision publique, laquelle doit rester pleine et entière. Et je réaffirme tout l’intérêt de disposer d’un cadre légal clair et stable en la matière.
J’en viens à un point de méthode pour la discussion qui va s’ouvrir : avant de vous présenter les axes de travail que j’identifie pour renforcer le texte, je prends l’engagement de toujours vous indiquer, de manière transparente, les mesures qui me semblent soit inopérantes, soit disproportionnées, et de toujours faire des propositions ; je ne présenterai aucun amendement de suppression sans vous soumettre de contre-proposition.
Les trois axes que j’identifie sont les suivants.
Le premier axe a trait au périmètre de la proposition de loi établi par l’article 1er, que vous avez évoqué, madame la rapporteure.
J’ai beaucoup parlé de puissance publique, et je l’ai fait à dessein, car il nous semble essentiel que le cadre proposé dans cet article s’applique également aux collectivités territoriales, qui ont aussi recours aux cabinets de conseil. Nous aurons l’occasion d’en discuter, des amendements sur ce sujet ayant été déposés par différents groupes du Sénat.
Le deuxième axe concerne la transparence sur les prestations fournies, ainsi que sur les compétences de l’État.
Le Gouvernement a déposé des amendements afin de rassembler en un article unique les dispositions prévues aux articles 3, 4 et 8. J’aurai l’occasion de vous présenter cette proposition qui a l’avantage de rendre plus claires, plus lisibles et donc plus exploitables les informations transmises par le Gouvernement sur le recours aux prestations de conseil.
Enfin, le troisième axe concerne le mécanisme de contrôle déontologique et de sanctions. Je souhaite que le contrôle exercé soit proportionnel à l’objectif fixé, car je pense très sincèrement que c’est une condition d’effectivité des mécanismes proposés. Nous aurons cette discussion sur les dispositifs qui concernent les déclarations d’intérêts exigés pour les consultants, sur les mécanismes de contrôle de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et sur la question de la régulation des mouvements entre secteur public et secteur du conseil.
Tels sont les trois champs dans lesquels je formulerai des propositions, sur lesquelles je souhaite que nous ayons un véritable débat de fond afin de nous assurer de la bonne effectivité de la loi.
Madame la présidente Assassi, vous m’interrogez sur l’avenir de cette proposition de loi. Ma volonté est que le texte chemine : je l’ai dit publiquement et je le réaffirme ici devant vous. La proposition de loi pourra être examinée soit dans le cadre d’une niche parlementaire, dont la programmation est à la main de chaque groupe, soit sur le temps réservé au Gouvernement.
Je le redis, il est important pour le Gouvernement que la proposition de loi soit examinée. Nous verrons quel sera le texte adopté par la Haute Assemblée ce soir à l’issue de nos travaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je souhaite maintenant que nous puissions entrer dans le débat au fond, comme – je crois – nous l’attendons tous.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Françoise Gatel applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je commencerai par vous dire, monsieur Guerini, que vous êtes incorrigible ! La discussion générale n’a pas débuté que vous agitez déjà le chiffon rouge, véritable point Godwin, du « il ne faut pas faire le jeu du populisme », ce qui traduit une certaine fébrilité, un manque de sérénité, du Gouvernement. Or, que cela vous plaise ou non, ce texte doit marquer la fin de très mauvaises habitudes.
Pour l’État ou une collectivité territoriale, faire appel à un cabinet de conseil pour un soutien technique ou un état des lieux ponctuel, c’est légitime. Y avoir recours de manière systématique et en devenir dépendant, c’est inacceptable !
Or le Sénat a relevé un phénomène tentaculaire, pour un montant de 1 milliard d’euros en 2021 pour l’État et ses opérateurs !
Ce sont non seulement les proportions, mais également les méthodes qui suscitent des interrogations. Nous comprenons désormais parfaitement ce qu’est la start-up nation : un État colonisé par les cabinets, souvent étrangers, comme les Américains McKinsey ou Accenture, qui ont pour seul but de gagner de l’argent. Ils sont loin de se préoccuper de l’intérêt général, encore moins de l’intérêt national.
La start-up nation, c’est l’externalisation des missions régaliennes au profit des grands cabinets de conseil et la captation de notre souveraineté par le secteur privé, et pas n’importe lequel : celui des plus fortunés, des puissances étrangères et des grands lobbies financiers qui n’ont qu’une patrie, le profit.
Il est évidemment vital de mener une réflexion sur l’efficacité de nos administrations. Alors que les effectifs du ministère de la santé s’élèvent à plus de 11 000 personnes, il a fallu que le Gouvernement mobilise plus de 11 000 jours de consultants pour gérer la crise sanitaire… C’est insupportable !
Cela étant, ce n’est pas moi qui me plaindrai de ne pas avoir disposé en interne des porte-flingues zélés de l’Ausweis sanitaire et vaccinal.
Protestations sur diverses travées.

Ce sont les cabinets qui proposent ces solutions numériques de facilité : ils parlent en termes d’efficacité, pas de libertés publiques. À trop les écouter, les décisionnaires publics finissent par oublier les principes qui fondent notre État.
Par ailleurs, les cabinets conseillent parfois simultanément plusieurs clients. Ils servent les intérêts des plus offrants et renvoient l’ascenseur à ceux qui leur ouvrent des portes. Le directeur de l’innovation de Pfizer a passé vingt-cinq ans chez McKinsey, cabinet chargé de la stratégie vaccinale en France. Cette porosité entre intérêts privés pose gravement problème.
Parmi les ex-McKinsey, on compte un préfet, le fils du président du Conseil constitutionnel, une vice-présidente de la région Île-de-France, le directeur de cabinet d’un ministre, le directeur général d’En Marche, et j’en passe. Vingt associés ont par ailleurs fait la campagne du candidat Macron en 2017. Cette porosité public-privé-politique est très problématique et suscite défiance et suspicion !
Avec le développement de structures comme le conseil de défense, aujourd’hui sanitaire et militaire, et bientôt environnemental et migratoire, nous sommes sommés de prendre l’habitude des huis clos, sans même un contrôle parlementaire.
Nous ne devons pas nous accoutumer à ces manières d’agir de l’exécutif. Il convient de rétablir les mécanismes de responsabilité et de légitimité propres à un système démocratique. Il y va de la confiance des Français envers la politique, laquelle est fortement éprouvée.
Avec vous, mes chers collègues, je soutiendrai, sans naïveté, une avancée en ce sens.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons tous en tête l’extrait largement médiatisé d’une audition de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques.
Notre collègue rapporteure Éliane Assassi y interrogeait l’un des dirigeants de McKinsey France sur un contrat d’un montant de près d’un demi-million d’euros pour évaluer « les évolutions du métier d’enseignant » et « accompagner » la direction interministérielle de la transformation publique dans ses réflexions sur le métier d’enseignant. Un échange lunaire du point de vue tant des montants évoqués que des réponses de la personne auditionnée !
Alors, je peux le dire sans détour, toute critique que je pourrais faire sur ce texte ne serait qu’accessoire et marginale au regard de la grande qualité et de l’intérêt supérieur des travaux qui ont été menés par notre assemblée sur un sujet essentiel : la privatisation, volontaire, de la décision publique au profit de cabinets de conseil.
Les travaux de la commission d’enquête nous conduisent à nous interroger sur la vision que nous avons de l’État et de sa souveraineté face aux cabinets privés, d’une part ; sur la bonne utilisation des deniers publics, d’autre part.
À l’aune de notre attachement profond à un État fort et garant de l’intérêt général, toutes les mesures de cette proposition de loi vont dans la bonne direction, qu’il s’agisse de la publication – enfin ! – de la liste des prestations de conseil effectuées pour l’État et ses opérateurs, de l’encadrement plus contraignant du recours aux consultants ou encore du renforcement des règles déontologiques des cabinets de conseil et des prérogatives de la HATVP.
Bien sûr, un tel texte, parce qu’il s’attaque à un sujet d’ampleur et complexe, soulève des difficultés. Je pense, en particulier, à la définition d’une « prestation de conseil ». L’article 1er de la proposition de loi comprend une liste synthétique des principes et des exceptions, qu’il serait tentant d’allonger de façon détaillée.
Notre collègue Jean-Pierre Corbisez avait d’ailleurs déposé un amendement en ce sens en commission visant à exclure du régime de contrôle les prestations des entreprises d’ingénierie, réalisées au titre d’une expertise technique. Cette précision n’était pas apparue superflue.
Mais nous comprenons aussi qu’elle n’ait pas été retenue. Les auteurs de la proposition de loi et notre commission ont fait le choix contraire de rester relativement souples. Dresser une liste exhaustive leur a paru impossible. Nous nous rangeons à leur avis pour donner à ce texte les chances d’une application rapide. Finalement, c’est le lot de toutes les qualifications juridiques que de comprendre des zones grises. Il revient aux acteurs, voire aux juges, de les analyser et de trancher au cas par cas.
Toutefois, il reste un sujet qui pose une réelle difficulté. Nous nous plaisons à rappeler que notre assemblée représente les territoires, conformément à l’article 24 de la Constitution.
Vous savez déjà, mes chers collègues, où je veux en venir. J’ai consulté quelques articles de presse sur l’examen de cette proposition de loi. Je n’en citerai qu’un : Le Sénat oublie ses électeurs. La critique est évidente, mais elle est surtout fondée, à une époque où la confiance dans les institutions politiques tend à s’étioler.
Je comprends évidemment les arguments qui ont conduit à exclure les collectivités locales du périmètre de ce texte pour ne retenir que l’État et ses administrations, mais ils donnent l’impression d’un refus d’obstacle.
Notre président Jean-Claude Requier a déposé un amendement visant à corriger cet écueil. Il tend à inclure dans le périmètre du texte les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des petites communes, ainsi que les intercommunalités, à l’exception des communautés de communes.
Nous en débattrons tout à l’heure, mais j’espère que nous ne nous cacherons pas derrière de faux problèmes légistiques, d’opérationnalité des seuils ou de mécanique juridique pour refuser cet aménagement.
Nos collectivités, elles aussi, méritent d’être protégées de l’intrusion excessive des cabinets de conseil et des consultants dans l’élaboration de leurs politiques publiques.
Chacun sait ici l’importance des décisions politiques prises sur nos territoires. Le renforcement de la décentralisation a conduit à donner un pouvoir considérable aux collectivités dans notre pays. Nous ne pouvons pas les exclure des réflexions sur la bonne utilisation des deniers publics.
Mme Nathalie Goulet s ’ exclame.

Souvenons-nous du fameux précédent des emprunts toxiques, dont beaucoup de collectivités ont été les victimes. Elles en paient encore parfois le prix… Les responsabilités étaient multiples, mais c’est aussi parce que des élus étaient mal protégés contre l’avidité de certains cabinets de conseil ou établissements bancaires qu’ils n’ont pas pu prendre les bonnes décisions.
Toutefois, je veux aussi le redire, le débat sur l’inclusion des collectivités n’enlève rien à l’intérêt et à la grande qualité du texte. S’il faut l’adopter sans que celles-ci y soient incluses, nous le ferons. Dans cette perspective, j’invite notre assemblée à poursuivre ses travaux en s’engageant dans l’élaboration d’un régime encadrant également les collectivités.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Mickaël Vallet applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme Éliane Assassi, je commencerai par remercier l’ensemble des membres de notre commission d’enquête, que j’ai eu l’honneur de présider.
Que de chemin parcouru depuis la réunion constitutive du 25 novembre 2021, il y a bientôt un an ! Notre rapport était transpartisan, tout comme cette proposition de loi. C’est un gage à la fois de sérieux et d’équilibre.
Je salue également le travail de la commission des lois, qui a amélioré le texte, ainsi que la rapporteure pour son écoute et sa connaissance du sujet.
Que les choses soient claires : nous légiférons non pas contre les cabinets de conseil, dont nous ne remettons pas en cause le professionnalisme, mais pour mieux encadrer leurs prestations et en finir avec l’opacité déplorée par la commission d’enquête.
J’appelle donc le Gouvernement à inscrire notre proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Nos concitoyens ne comprendraient pas que ce texte se trouve bloqué dans la navette parlementaire. Cela ne serait pas à la hauteur des enjeux soulevés par la commission d’enquête.
Je concentrerai mon intervention sur les aspects déontologiques, ce qui ne vous surprendra pas.
La commission d’enquête a mis en lumière trois risques : les conflits d’intérêts, les cabinets de conseil conseillant simultanément plusieurs clients dont les intérêts peuvent diverger ; la porosité, lorsque les cabinets recrutent d’anciens responsables publics – c’est ce que l’on appelle le « pantouflage » – ; enfin, le « pied dans la porte », lorsque les consultants interviennent gratuitement, pro bono, pour l’administration.
Ce sont par exemple les cabinets McKinsey et Boston Consulting Group qui ont organisé les sommets Tech for Good et Choose France à l’Élysée. Ces prestations étaient même devenues banales, alors qu’elles servaient en réalité la stratégie commerciale des consultants.
Avec cette proposition de loi, nous faisons le choix de la clarté : nous interdisons purement et simplement le pro bono, ce que le Gouvernement n’a jamais fait. Seul resterait le mécénat, dans des secteurs bien circonscrits comme l’humanitaire, la culture ou l’éducation.
Pour plus de transparence, le mécénat ferait l’objet d’une déclaration à la HATVP, tout comme les actions de démarchage ou de prospection commerciale des cabinets de conseil.
Dans la même logique, nous souhaitons que les cabinets de conseil et les consultants remplissent des déclarations d’intérêts, sous le contrôle de la HATVP. L’État est en droit de connaître les autres clients de ses consultants afin de mieux prévenir les conflits d’intérêts et, surtout, d’y mettre fin.
Un État aveugle sur le plan déontologique est un État en danger. L’enjeu n’est pas mince au regard des récentes interventions des consultants sur la crise sanitaire ou sur l’évaluation de la stratégie nationale de santé.
Des consultants ont fait part de leurs inquiétudes dans la presse : les déclarations d’intérêts seraient trop lourdes et les forceraient à s’éloigner du secteur public. Qu’ils se rassurent : en tant que parlementaires, nous remplissons de telles déclarations depuis 2013 ! La première prend un peu de temps, puis il suffit de l’actualiser : je pense que des bacs+10 y parviendront sans difficulté… §Tout cela est loin d’être insurmontable : comme mes collègues, vous pourrez certainement le confirmer, monsieur le ministre.
Il en est de même pour le pantouflage : nous n’empêchons pas les consultants de travailler pour l’administration et vice-versa. En revanche, nous souhaitons que l’avis de la HATVP soit systématique et que l’intéressé lui rende compte de son activité à intervalles réguliers, pour vérifier que les exigences de la Haute Autorité sont bel et bien respectées. Il n’y a là encore rien d’insurmontable.
Cela évitera par exemple qu’un consultant de Capgemini soit embauché au service des correspondances de l’Élysée et recrute ce même cabinet pour moderniser le service… Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé n’est bien sûr pas fortuite !
M. Éric Bocquet s ’ esclaffe.

Dans un souci d’efficacité, nous souhaitons renforcer les moyens d’investigation et de sanction de la HATVP. Cette dernière doit pouvoir prononcer des sanctions administratives en cas de manquement déontologique des consultants, ce qui évitera d’engorger les tribunaux. Elle pourra aussi les exclure de la commande publique, ce qui nous semble logique et conforme au droit européen.

Vous le voyez, mes chers collègues, nous proposons un dispositif déontologique à la fois complet et cohérent et mettons en œuvre les recommandations de la commission d’enquête.
Vous conviendrez que la confiance de l’administration envers ses consultants n’exclut pas le contrôle, ce qui justifie notre proposition de loi.
Pour finir, j’évoquerai les représentants d’intérêts.
Ce sujet n’entre pas dans le périmètre de notre texte, comme l’a justement rappelé la commission des lois. Je n’ignore toutefois pas son importance ni la nécessité de faire évoluer le droit en vigueur.
C’est dans cet esprit que le Comité de déontologie du Sénat présentera des propositions sur les représentants d’intérêts d’ici à la fin de l’année, après avoir entendu les professionnels du secteur, comme nous avons commencé à le faire depuis bientôt un an, et les associations. C’est un engagement que nous avons pris auprès du Bureau du Sénat et que nous tiendrons.
Mes chers collègues, je vous remercie pour votre soutien à notre proposition de loi.
Vifs applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, SER et CRCE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui une proposition de loi issue des travaux de la commission d’enquête menés par Mme la présidente Assassi.
Cette commission d’enquête trouve son origine dans une polémique, née à l’occasion de l’élection présidentielle
Non ! sur diverses travées .

Certains de nos concitoyens ont en effet été interpellés par le fait que l’État ait recours à des cabinets privés pour l’aider à définir sa stratégie, comme cela a été évoqué par Arnaud Bazin. Aussi divers que soient ses services, l’administration n’a pas, et ne peut pas, avoir en interne les compétences requises pour faire face aux situations qu’elle doit gérer.
Le recours à ces cabinets permet d’apporter une expertise et de proposer des solutions. C’est ainsi que 72 % des près de 900 millions d’euros dépensés par l’État en conseil durant l’année 2021…

… concernent des prestations informatiques.
On le sait, tous les responsables politiques ont eu recours aux prestations de conseil ou y auront recours un jour. Et nos concitoyens préfèrent sans doute que l’État prenne des décisions éclairées.
La proposition de loi que nous examinons vise à imposer des obligations de transparence aux prestataires de conseil…

… lorsqu’ils travaillent pour l’État et ses établissements, afin de prévenir les conflits d’intérêts, mais aussi d’éviter les allers-retours entre ces cabinets et l’administration.
Pour cela, le texte étend le pouvoir de la HATVP, qui est déjà chargée du contrôle des principaux responsables et agents publics, ainsi que des lobbies.
L’État n’est évidemment pas le seul à recourir aux prestations de conseil ; nos régions, nos départements et nos communes le font aussi très régulièrement. Pour des raisons de périmètre d’enquête, cette proposition de loi ne vise cependant pas les collectivités territoriales.
Certains d’entre nous s’interrogent sur la nécessité d’inclure les plus importantes d’entre elles dans le dispositif. En vérité, notre groupe s’interroge plus largement sur l’opportunité d’une telle proposition de loi.
Exclamations sur plusieurs travées.

Nous comprenons parfaitement les inquiétudes que l’activité de conseil a pu susciter, mais nous doutons que les moyens proposés soient efficaces et adaptés.
L’administration fait appel à de nombreux acteurs afin d’avoir un œil extérieur pour l’aider à résoudre les difficultés auxquelles elle est confrontée. Nous pensons, mais nous sommes manifestement minoritaires, qu’il n’est pas malsain que public et privé puissent échanger des idées et des personnes.
Marques d ’ ironie sur plusieurs travées. – M. Stéphane Ravier s ’ exclame.

Par ailleurs, quels que soient les conseils, c’est toujours le responsable politique qui décide…

Nous ne sommes donc pas favorables à la création de régimes spécifiques dont l’application est confiée à des autorités spécifiques, qui disposent de pouvoirs d’enquête et de sanction spécifiques.
Enfin, nous craignons que cette proposition de loi ne renforce des maux très français : bureaucratie
Marques d ’ ironie sur les travées des groupes SER et CRC E.
Mêmes mouvements .

Mes chers collègues, il serait bon que tous les avis puissent s’exprimer !

M. Emmanuel Capus. … et mécaniquement augmentation du nombre de fonctionnaires
Exclamations ironiques sur les travées des groupes SER et CRCE, ainsi que sur des travées du groupe UC .

Nous sommes convaincus que notre pays a au contraire besoin de souplesse et de simplicité. Les échanges entre le public et le privé sont monnaie courante dans beaucoup de pays, particulièrement dans ceux du nord de l’Europe. Et ils ne s’en portent pas plus mal ! Ces fertilisations croisées sont créatrices de synergies qui améliorent l’efficacité de l’action publique.
Nous devons bien sûr être très attentifs aux ressources de l’administration : elles proviennent de l’argent des Français et doivent donc être employées à bon escient et sans abus – cela va sans dire. Mais nous pensons qu’il faut également veiller à préserver leur efficacité si nous ne voulons pas travailler nous-mêmes à l’impuissance de l’administration.
Le Gouvernement a annoncé son intention d’encadrer davantage le recours aux prestations de conseil par les administrations publiques, et c’est une bonne chose.
L’une des manières de réduire ce recours, la plus efficace pour les libéraux que nous sommes, est certainement de réduire le périmètre d’action de l’État
Exclamations sur les travées du groupe CRCE. – Mme Françoise Gatel et M. Stéphane Ravier s ’ exclament également .

Vous l’aurez compris, dans sa majorité, le groupe Les lndépendants votera non pas comme M. Ravier…
Exclamations sur les travées du groupe CRCE .
Nombreuses marques d ’ ironie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la fin du pantouflage et des allers-retours trop opaques entre les hautes sphères de l’État et les cabinets privés avait clairement été érigée en objectif par Emmanuel Macron. Comme nous en avons l’habitude, nous avons été quelque peu déçus de ce point de vue. Nos concitoyens espéraient pourtant que le devoir d’exemplarité serait réellement pris en compte.
Mais, à l’instar d’autres décisions, « ce n’est pas un échec, ça n’a pas marché », pour reprendre une expression souvent employée par le Président de la République, notamment à propos du sujet qui nous occupe.
Cette proposition de loi nous est soumise après les récentes révélations journalistiques sur l’augmentation notable des dépenses liées aux cabinets de conseil depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron.
Le groupe CRCE avait alors demandé l’ouverture d’une enquête sur l’influence de ces cabinets. Ce texte s’appuie, monsieur le ministre, sur les conclusions de la commission d’enquête transpartisane du Sénat, rendues au printemps dernier.
Pourquoi le recours à des cabinets de conseil privés suscite-t-il des reproches ? Surtout, que prévoit la présente proposition de loi pour faire face à l’explosion de l’intervention de ces cabinets ?
Tout d’abord, c’est non pas le recours même à une expertise extérieure qui est mis en cause, mais bien l’absence de transparence – or la transparence est nécessaire – sur les contrats et les montants qu’ils représentent, pour des résultats parfois plus que discutables.
Le désinvestissement dans la fonction publique, qui – il faut le reconnaître – résulte non seulement de l’action de ce président, mais aussi de celle de ses prédécesseurs, explique le recours massif à ces cabinets.
Les sociétés de conseil sont souvent perçues comme un moyen simple et agile, dans les moments de surcharge ponctuelle, de pallier le problème que posent les plafonds d’emploi. Cela entraîne des pertes de compétences au sein de l’administration ou des limitations de la montée en compétences – comme on le voit, par exemple, dans le domaine informatique.
Certains y voient l’action de pompiers pyromanes qui ne donnent pas les moyens à l’administration de rester compétente dans ses prérogatives afin de justifier les recours coûteux à une poignée de grosses entreprises de conseil. Pourtant, une large majorité des entreprises de conseil de moindre importance restent loin du pouvoir et des pratiques de ces grands groupes.
Le recours décuplé aux cabinets de conseil est aussi critiqué en raison du manque de transparence sur les résultats d’études coûteuses – Mme Éliane Assassi les a évoquées –, non publiées, notamment dans l’éducation nationale, mais aussi du doublon des missions entre privé et public – elle en a également parlé –, par exemple dans le secteur de la petite enfance.
L’opacité qui règne sur le recours aux cabinets de conseil, sur la définition du besoin réel ou sur l’effectivité des rendus, est source de défiance de nos concitoyens à l’égard de notre système démocratique.
Au terme des travaux de la commission d’enquête sénatoriale, qui a soulevé de nombreuses problématiques, relevé des dérives, mais aussi formulé 19 recommandations, notre collègue Éliane Assassi a souhaité déposer la proposition de loi qui nous est aujourd’hui soumise.
Si nous apprécions ce texte, nous pensons que certains points méritent si ce n’est une amélioration, au moins une discussion.
Nous regrettons ainsi que certains de nos amendements aient été déclarés irrecevables alors qu’ils portaient explicitement sur les « pouvoirs de contrôle et de sanction conférés à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) en vue de faire respecter ces obligations par les prestataires de conseil et les consultants ». En cela, ils étaient conformes aux règles relatives à l’application de l’article 45 de la Constitution indiquées dans le document de la commission des lois.
L’un de ces amendements ayant été déclaré irrecevable – nous le regrettons vivement – s’inscrivait dans la lignée de la proposition n° 42 de la mission d’évaluation de la loi Sapin II, menée en 2021 par les députés Olivier Marleix, du groupe Les Républicains, et Raphaël Gauvain, de La République En Marche.
Cet amendement visait en outre à répondre à une demande explicite de la HATVP elle-même, qui, dans son rapport d’octobre 2021, proposait – c’était sa proposition n° 10 – de « doter la Haute Autorité d’un pouvoir propre de sanction administrative en cas de manquement à l’obligation de dépôt […] d’une déclaration d’activités […], la sanction étant proportionnée à la gravité du manquement et à la situation de la personne poursuivie ».
Ce périmètre nous apparaissait déjà particulièrement restreint, car il ne permettait pas une discussion globale sur les lobbies et les liens d’intérêts entre secteur public et secteur privé. Notre groupe est certes minoritaire, et nos positions, hélas ! parfois aussi. Mais le refus de discussion dont témoignent des décisions irrévocables d’irrecevabilité pénalise l’exercice démocratique qui est le nôtre.
Cela étant, nous sommes globalement favorables au texte et à ses mesures novatrices. La plupart des dispositions de cette proposition de loi sont d’ordre normatif, mais certaines d’entre elles revêtent un caractère réglementaire : elles ont donc pour objectif d’inciter le Gouvernement à modifier les règles déontologiques. C’est bien là que le bât blesse. Car, comme lors de la création de la HATVP, ce sont parfois les décrets qui ne suivent pas !
C’est pourquoi nous aurons à cœur de discuter du texte. Nous attendons du Gouvernement qu’il s’engage à réduire le recours excessif aux cabinets de conseil et à permettre à la HATVP de fonctionner correctement.
Notre groupe votera cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les pouvoirs publics ont toujours eu besoin de s’appuyer sur des compétences extérieures. C’est une réalité ancienne, qui ne date pas uniquement de l’élection présidentielle de 2017 : elle existe depuis de nombreux quinquennats et s’est accélérée depuis 2007.
Ressources humaines, informatique, gestion de données massives, communication, analyse comparative : les besoins sont en réalité nombreux. Pourquoi ? D’abord, parce que certains champs d’expertise très spécialisés nécessitent un recours à des cabinets de conseil. Ensuite, parce qu’un arbitrage apaisé appelle parfois un regard extérieur. Enfin, parce que l’urgence ou le lancement d’un projet impliquent l’action rapide et coordonnée d’un grand nombre de consultants, agissant uniquement dans un laps de temps déterminé, ce qui se prête mal au processus de recrutement de fonctionnaires.
Pour autant, le besoin ne sera pas toujours aussi important que durant la crise du covid-19. D’une part, nous avons vécu ces dernières années une accumulation de crises globales tout à fait inédite. D’autre part, chaque administration travaille son attractivité afin d’engager en interne les compétences dont elle a besoin.
Je tenais également à souligner que nous ne sommes pas les plus mauvais élèves en Europe. En 2018, un rapport relevait qu’en comparaison avec les autres pays européens, le conseil au secteur public apparaissait limité en France, les chiffres étant cinq fois plus élevés en Allemagne et quatre fois plus au Royaume-Uni.
La résolution n° 111 a été enregistrée à la présidence du Sénat le 27 octobre 2021. Une commission d’enquête a ensuite été constituée. Cette commission, dont j’étais membre, a entendu pendant quatre mois 47 personnes sous serment, lu les réponses à 131 questionnaires, et analysé 7 300 documents, comme mes collègues l’ont déjà souligné.
Le rapport a été rendu le 16 mars dernier, et je salue le fait que le Gouvernement ait pris en considération ses recommandations lors de l’élaboration du nouvel accord-cadre plafonnant les dépenses de conseil, renforçant la transparence et améliorant l’évaluation.
Par ailleurs, le Gouvernement a d’ores et déjà publié un « jaune budgétaire » annexé au projet de loi de finances pour 2023, intitulé Recours aux conseils extérieurs. Il s’agit là d’un pas supplémentaire vers plus de transparence.
Compétence, souveraineté, démocratie et légitimité de la décision : tels sont les enjeux que cette pratique implique et qu’il convient de sécuriser. Le Premier ministre avait déjà publié le 19 janvier dernier une circulaire fixant l’objectif ambitieux de diminuer de 15 % le volume des prestations de conseil en stratégie en 2022. Toutefois, les dispositions concernant la transparence méritent d’entrer dans le champ législatif.
Je salue le travail préalable, en 2014 et 2015, des rapporteurs de la commission des finances sur la communication de la Cour de Comptes. Le mercredi 12 octobre dernier, la commission des lois a adopté à l’unanimité la proposition de loi encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Tous les amendements de la rapporteure ont également été adoptés.
Cette proposition de loi vise à traduire dans la loi les préconisations de la commission d’enquête. Il s’agit d’assurer la traçabilité de la participation de ces cabinets et de garantir une meilleure information des citoyens, mais en aucun cas de « supprimer » le conseil.

Notre groupe, le RDPI, souhaite apporter quelques modifications au texte et a déposé cinq amendements à cet effet.
Notre premier amendement tend à préciser, à l’article 1er, le seuil des établissements publics concernés par le champ de la proposition de loi. En effet, il est essentiel d’éviter de faire peser une charge déraisonnable sur des structures de taille réduite. Le seuil de 60 millions d’euros de dépenses est déjà bien connu des acteurs concernés, car il correspond au seuil des avances obligatoires versées aux PME dans le cadre d’un marché public.
Le deuxième amendement vise à exclure les prestations de conseils internes à l’administration, pour éviter une surinterprétation par le juge.
Le troisième a pour objet de réaffirmer l’exclusion des prestations de gestion des ressources humaines et d’expertise informatique.
À l’article 11, nous défendrons un amendement visant à prévoir la définition par décret des modalités d’enregistrement des actions de démarchage, l’objectif étant d’aligner le dispositif sur les règles de droit commun.
Enfin, à l’article 18, notre amendement tend à limiter les obligations d’audit, souvent très coûteuses, aux marchés les plus sensibles qui le nécessitent.
En commission, d’aucuns ont envisagé d’appliquer le dispositif aux collectivités territoriales. En effet, les régions, les départements, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et certaines villes font aussi appel au conseil. Cela s’inscrit dans la suite logique des choses.
Toutefois, cette extension du champ de la loi doit passer par la fixation d’un seuil. Le Gouvernement et plusieurs collègues de différents groupes ont déposé des amendements tendant à porter ce seuil à 100 000 habitants. Ce nombre semble tout à fait adapté.
Je sais que M. le ministre aura à cœur de ne pas dévitaliser le texte de la commission. Il convient de rendre visible l’action de chaque acteur des politiques publiques, d’empêcher toute dérive, mais aussi de ne pas tomber dans la surenchère législative, de ne pas ajouter aux différents niveaux une surcharge de travail et des règles confuses.
Le groupe RDPI est favorable sur le principe à cette proposition de loi. Ses membres seront très attentifs au vote des différents amendements.
Le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission est équilibré et s’inscrit dans la continuité des travaux de la commission d’enquête. Il faudra veiller à ce que le dispositif puisse facilement être mis en place par l’administration, en l’alignant le plus possible sur ce qui existe déjà pour les représentants d’intérêts.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Marie-Claude Varaillas applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens d’abord, au nom du groupe socialiste, à remercier très sincèrement nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin d’avoir mené, avec les membres de la commission d’enquête, un travail tout à fait remarquable, qui illustre une fois encore combien le Parlement, et particulièrement le Sénat, peut être utile et efficace lorsqu’il exerce pleinement la mission de contrôle qui lui est dévolue par la Constitution.

Ce travail a notamment permis l’ouverture d’une enquête judiciaire à la suite de la découverte du non-paiement de l’impôt sur les sociétés entre 2011 et 2020 par le cabinet McKinsey, alors que cette firme réalise en France un chiffre d’affaires annuel de plusieurs centaines de millions d’euros. C’est inacceptable ! Il est impossible que cela continue ainsi.
Grâce à la commission d’enquête, nous avons également appris que l’État avait dépensé en 2021 plus d’un milliard d’euros en prestations de conseil de cabinets privés, soit 45 % de plus qu’en 2018. Nous avons découvert que, lors de la crise sanitaire, il avait largement fait appel à ces cabinets. Pourtant, mes chers collègues, les services de l’État disposent de compétences considérables. Il est donc parfois regrettable de faire appel à des instances privées.

M. Jean-Pierre Sueur. Un jour, j’ai appris qu’un ministre avait fait appel à un cabinet de conseil pour rédiger l’exposé des motifs d’un projet de loi. C’est absolument insupportable !
Mme Nathalie Goulet approuve.

Ne mélangeons pas tout. Il est vrai que dans certains domaines il est utile de faire appel à des compétences extérieures à l’administration ; personne ne le conteste. Mais encore faut-il que cela soit fait en toute transparence.
Mes chers collègues, nous avons nous aussi déposé quelques amendements pour élargir le champ du texte. Madame la rapporteure, vous nous avez dit qu’il vous était apparu plus sage de vous en tenir strictement au champ de la commission d’enquête. J’entends cet argument, mais rien n’empêche le législateur d’aller plus loin ! Si les principes sont bons, au terme des travaux de la commission d’enquête, pourquoi ne pas élargir le champ du texte aux collectivités locales d’une certaine importance – de plus de 100 000 habitants –, à la Caisse des dépôts et consignations, ainsi qu’aux assemblées parlementaires ?
Ne serait-il pas logique de nous appliquer à nous-mêmes les excellentes recommandations formulées dans le rapport ? Nous avons déposé un amendement en ce sens, en veillant à ce que sa rédaction préserve intégralement l’autonomie des assemblées parlementaires. C’est le bureau de chaque assemblée qui décidera des modalités de leur mise en œuvre.
Le but, c’est la transparence, même si diverses méthodes sont possibles pour l’atteindre. Nous avons grand intérêt, dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, à jouer la carte de la totale transparence à l’égard de nos concitoyens.
Il est un livre très ancien, qui a connu quelque succès, dans lequel on peut lire cette phrase : « La vérité vous rendra libres. »
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les cabinets de conseil privés, acteurs de l’ombre, omniprésents pourtant, « tentaculaires », selon la commission d’enquête sénatoriale, ont été démasqués, dévoilés, mis au grand jour.
Les parlementaires du groupe CRCE, qui sont à l’origine de la création de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, ont conduit, sous la présidence d’Arnaud Bazin et avec Éliane Assassi, rapporteure, une investigation dont les résultats nous ont dépassés.
Ainsi, les travaux de la commission ont connu un fort retentissement dans l’opinion publique. Les cabinets de conseil constituent désormais un objet politique identifié et controversé. Nous devons collectivement nous en féliciter.
Ensuite, au terme de ces travaux, il est apparu nécessaire de légiférer rapidement, comme nous le faisons ce soir, pour traduire en actes les constats partagés à l’unanimité par les membres de la commission d’enquête.
Si le recours aux cabinets de conseil est ancien, l’ampleur du phénomène est inédite : ils représentent pour l’État un coût de 1 milliard d’euros en 2021. Mais ce qui change par rapport à hier, c’est la croyance toujours plus affirmée depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron qu’il existe une différence entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, les « sachants » appartenant aux cabinets de conseil, les autres étant dans l’administration.
Le monopole de la vérité objective et rationnelle incomberait à des cabinets connus pour appliquer les mêmes recettes à des problèmes différents, économies d’échelles obligent…
Nous nous souvenons des mots de Nicolas Sarkozy, ancien Président de la République, le 12 décembre 2007, lors de la présentation de la fameuse révision générale des politiques publiques (RGPP) : « La réforme de l’État, je l’ai promise, je la ferai. Je la ferai parce que nos finances publiques doivent être redressées ». Ces mots, qui se sont traduits par le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux, ont porté un coup important à la capacité de la fonction publique de mener à bien ses missions.
Chacun reconnaît aujourd’hui que l’on est allé beaucoup trop loin. Il faut consacrer le retour du politique comme maître de l’action publique.
Lors de la révision de la loi organique relative aux lois de finances (Lolf) et de l’examen de la loi du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, nous fûmes bien les seuls à proposer la suppression de la « fongibilité asymétrique », terme barbare qui permet de redéployer le budget du personnel vers des dépenses différentes comme l’investissement, l’intervention ou le « consulting » – permettez-moi cet anglicisme –, mais qui interdit le mouvement inverse.
Cette logique libérale est mortifère. §Je souhaite que tous nos concitoyens et toutes nos concitoyennes défient ces mécanismes libéraux de réduction de l’emploi public au prétexte d’une prétendue « obésité » de l’État.
Le collectif « Nos services publics » explique cet effet pervers : « Plutôt que de diminuer le coût du service tout en maintenant sa qualité, on en réduit la qualité tout en dégradant les finances publiques », notamment en raison des rémunérations beaucoup plus élevées versées aux cabinets de conseil.
Feignant de soutenir la proposition de loi transpartisane du Sénat, le Gouvernement et ses alliés révèlent leur volonté de miner le texte à grands coups d’exclusions et de suppressions.
On ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil et « en même temps » leur faire béatement confiance. On ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil et « en même temps » exclure des consultants en raison de leur statut. On ne peut pas prétendre encadrer le recours aux cabinets de conseil et « en même temps » saper les obligations déontologiques prévues dans cette proposition de loi.
Pardonnez-moi, monsieur le ministre, mais votre « en même temps » n’est pas l’équilibre, c’est le laxisme. C’est la poursuite de la connivence entre les cabinets de conseil et le Gouvernement.
Les contrats massifs passés durant l’été et en ce début d’automne montrent que vous n’avez tiré jusqu’ici aucune leçon des travaux de la commission d’enquête et que vous entendez bien vous limiter à des déclarations d’intention.
Tout au long du processus, vous n’avez eu de cesse de miner les travaux de la Haute Assemblée, sentant que la situation vous échappait quelque peu : publication d’un rapport à l’Assemblée nationale, d’une circulaire opportune la veille d’une audition de ministre, conférence de presse de ministre en pleine campagne présidentielle et publication d’un « jaune budgétaire » incomplet avant même le vote de la proposition de loi.
Les mots du président alors candidat sont teintés de vérité : « Sur McKinsey, on est mauvais comme des cochons, les enfants ! ».
Permettez-moi de m’arrêter un instant sur un point, car vous connaissez mon appétence en matière de lutte contre la fraude fiscale et toutes les formes d’optimisation intolérables.

M. Éric Bocquet. La commission d’enquête a prouvé que McKinsey ne payait pas d’impôt sur les sociétés depuis dix ans, alors même que celle qu’on appelle « la Firme » réalisait plusieurs centaines de millions d’euros de chiffres d’affaires chaque année et captait de l’argent public. Merveilleux Delaware, qui compte 970 000 habitants et 1 600 000 sociétés enregistrées !
Sourires sur les travées du groupe CRCE.

Mes chers collègues, nous sommes fiers de ce texte et de l’esprit de construction transpartisane qui nous a animés. Il constitue un point de départ bienvenu pour celles et ceux qui pensent encore que l’État peut et doit garantir l’intérêt général.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à ce stade de la discussion générale – je suis la neuvième à m’exprimer –, beaucoup a déjà été dit.
Je regrette de ne pas avoir eu moi-même l’idée de cette commission d’enquête – j’en éprouve une certaine frustration ! – et je remercie Mme Assassi et son groupe de l’avoir eue… §Je m’étais limitée lors d’un rappel au règlement à suggérer l’organisation d’un débat sur le sujet, et voilà que la commission d’enquête est arrivée !
Les travaux de la commission d’enquête, dont j’ai eu l’honneur d’être vice-présidente, témoignent de l’importance de ce sujet, sur lequel il était justifié de se pencher.
Ce sujet est important d’un point de vue financier : la part du privé dans la décision publique, les conditions du recours aux cabinets de conseil et les garanties offertes ne sont pas que des sujets philosophiques, notre société étant ouverte aux conflits d’intérêts, qui sont, à mon sens, le pire cancer de la politique.
Encore une fois, il n’a jamais été question d’interdire le recours aux cabinets de conseil ; il s’agit d’encadrer cette pratique pour la rendre plus transparente et être sûr qu’elle apporte une réelle plus-value.
On peut toutefois s’interroger sur le fait que l’État ait de plus en plus recours à ces cabinets, y compris pour les politiques publiques les plus sensibles. Cette tendance à ubériser le pouvoir régalien est, de mon point de vue, assez inquiétante.
Certains, dont je fais partie, acceptent difficilement cette philosophie : placardiser la haute fonction publique en lui préférant à prix d’or des cabinets extérieurs privés revient à dévaloriser et à paupériser tant la haute fonction publique que les inspections générales, qui regorgent de compétences souvent et rarement écoutées ou entendues.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – MM. Mickaël Vallet et Patrice Joly applaudissent également.

Ainsi, Martin Hirsch, dont les propos sont cités page 39 du rapport de la commission d’enquête, évoque le malaise ressenti par les agents : « Autant le fait de travailler, y compris dans le corps médical, sur un projet donné avec un regard extérieur ne pose aucun problème, autant le fait d’avoir une sorte d’abonnement auprès de grands cabinets de consultants et de personnes pour lesquelles l’hôpital n’est qu’un client n’était pas perçu positivement. »
De même, les agents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), dont les propos sont retranscrits page 38 du même rapport, avouent avoir l’impression d’être « régulièrement infantilisés ». Je rappelle que le cabinet de conseil ayant fourni une prestation afin de réduire les délais de traitement des demandes d’asile, lesquels n’ont toujours pas été réduits, a perçu 485 818 euros ! Or la valeur ajoutée de son travail n’est pas perceptible dans l’immédiat…
Moderniser, ce n’est pas paupériser ! Moderniser, ce n’est pas supprimer le corps diplomatique un lundi de Pâques au matin ! Moderniser, ce n’est pas davantage supprimer l’École nationale d’administration (ENA) ou le corps préfectoral au 1er janvier 2023.
Mme Marie-Noëlle Lienemann, MM. Pierre Laurent et Mickaël Vallet applaudissent.

Le sujet dont nous débattons, sur lequel le groupe CRCE a eu raison de se pencher, n’est pas que technique, il est aussi politique.
Le Gouvernement a d’ailleurs été contraint de réagir à la suite des travaux menés en toute transparence par la commission. Les auditions, qui étaient ouvertes au public, sont d’ailleurs toujours disponibles en ligne.
Le 19 janvier 2022, à la rubrique « Il faut sauver le soldat Montchalin », …

… une circulaire a été publiée le matin même de l’audition de la ministre pour limiter le recours des ministères aux cabinets de conseil. Même si elle était insuffisante, elle attestait de la gêne du Gouvernement face aux effets de nos auditions publiques.
Je dirai à présent un mot sur le périmètre du texte. Sur ce sujet, je suis prise d’une double sincérité franchement centriste.
Sourires sur les travées du groupe CRCE.

Il est évident que la question des collectivités locales se pose. Il n’y a pas de volonté de notre part de l’éviter. Mais pour les régions, les départements, les grandes métropoles et les intercommunalités, le recours à des cabinets de conseil est un sujet à part entière. Or il n’a pas été traité par la commission d’enquête – pas une seule audition n’a porté sur cette question – et les associations d’élus n’ont pas été consultées. De notre point de vue, il est inacceptable d’intégrer les collectivités locales dans ce dispositif sans qu’elles aient été entendues. C’est pourquoi notre groupe s’abstiendra sur les amendements ayant pour objet d’étendre le périmètre du texte aux collectivités.
Notre commission d’enquête a clairement défini le périmètre de ses travaux, sur lequel la proposition de loi est calquée. Monsieur le ministre, mes chers collègues, les collectivités locales constituent un véritable sujet, je vous l’accorde. Monsieur le ministre, peut-être pourriez-vous charger quelques parlementaires d’une mission flash sur ce sujet ? On pourrait également se pencher sur la question importante des centrales d’achat.
J’évoquerai à présent le recours à des cabinets d’avocats pour des prestations de conseil. Le Conseil national des barreaux s’est vanté sur les réseaux sociaux d’avoir obtenu d’être exclu du périmètre de contrôle. Voici leur tweet mortifère : « Nous venons de faire modifier la proposition de loi sur l’encadrement des cabinets dits “de conseil”. Cette proposition sénatoriale prévoyait d’englober dans son périmètre les prestations de conseil juridique. »
Monsieur le ministre, nous avons eu le même type d’irritants lors de la discussion de directives européennes. Alors que les cabinets d’avocats montent des pyramides pour faire de l’optimisation, voire de la fraude fiscale, sujet cher à mes collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, particulièrement à Éric Bocquet, il est évident qu’il faut les faire entrer dans les dispositifs légaux.
Mme Éliane Assassi et M. Éric Bocquet approuvent.

Sur ce sujet, il faut travailler avec les bâtonniers, il faut intervenir dans le domaine réglementaire, afin d’accroître la transparence.
Ainsi, on ne peut pas consulter un cabinet d’avocat sur le projet de loi d’orientation des mobilités en ignorant totalement quels intérêts il défend par ailleurs, ceux de Vélib’ ou d’une autre société par exemple, au risque de faire face à une situation de conflit d’intérêts. Ce sujet est extrêmement important et il faut le traiter : comme je l’ai dit, le conflit d’intérêts est le pire cancer de la vie publique.
L’article 8 accorde de nouveaux pouvoirs à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et va à mon avis provoquer quelques remous. Pour ma part, je considère qu’il s’agit d’une bonne disposition.
Un autre problème a également été soulevé au cours des travaux de la commission d’enquête : toutes ces prestations de conseil ne sont absolument pas coordonnées ni par France stratégie ni par le Haut-Commissariat au plan. Ce défaut d’articulation nous a laissés un tantinet songeurs…
Le rapport s’appuie sur 7 300 documents et fourmille de chiffres : 41 millions d’euros ont été versés à McKinsey pour 68 commandes lors de la crise sanitaire ; 485 000 euros pour effectuer une étude, je l’ai évoquée, sur la réduction du délai de traitement des demandes d’asile – on sait que cela n’a pas du tout fonctionné ! –, 169 440 euros pour la mise à disposition d’un agent de liaison entre l’État et Santé publique France et cinq mois d’études. Tout cela n’est pas du tout raisonnable !
Cette commission d’enquête apporte une grande plus-value au travail parlementaire et républicain qu’effectue la Haute Assemblée.
Applaudissements.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

M. Jérôme Bascher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, lorsque la commission d’enquête a été créée, puis lorsqu’elle a rendu ses conclusions, le Gouvernement s’est montré « aussi suffisant qu’insuffisant », pour reprendre les mots de Talleyrand.
M. Éric Bocquet sourit.

À l’époque, monsieur le ministre, votre prédécesseure avait fait fi de nos remarques. Je me souviens aussi d’avoir entendu à la radio un jeune et sémillant porte-parole du Gouvernement estimer que cette enquête avait été conduite par une rapporteure « communiste » !

Il oubliait que ce rapport avait été adopté à l’unanimité par le Sénat et donc par des collègues siégeant sur toutes les travées.

Ce n’est pas grave, ce n’était qu’une erreur de plus…
Cette erreur, vous n’avez cessé de tenter de la corriger, comme mes collègues l’ont rappelé : publication d’une circulaire le jour de l’audition de la ministre par la commission d’enquête, d’un rapport et maintenant d’un « jaune budgétaire »… Vous courez après tout cela sans paraître très à l’aise.
Rassurez-vous, monsieur le ministre : nous sommes là non pour accuser les uns ou les autres, mais pour faire notre travail de parlementaires, en lien tant avec l’exécutif qu’avec l’administration, qui va donc devoir se priver un petit peu des cabinets de conseil.
Rassurez-vous, le Sénat n’est absolument pas contre le recours à des cabinets de conseil, notamment dans le secteur informatique, car c’est un domaine dans lequel on apprend en conduisant de nombreux projets. La conduite d’un seul projet informatique important dans une administration ne permet pas un tel apprentissage. En revanche, dans d’autres secteurs, mes chers collègues, nous disposons de la haute fonction publique.
Nicole Duranton a indiqué que les Allemands ont davantage recours que nous aux cabinets de conseil, mais il faut prendre en compte le fait que la haute fonction publique allemande n’est pas du tout la même que la haute fonction publique française !

Manquons-nous, en France, de hauts fonctionnaires de qualité ? Je ne le pense pas ! Combien d’anciens préfets s’ennuient-ils aujourd’hui au Conseil supérieur de l’appui territorial et de l’évaluation (CSATE) ? Combien de personnes recycle-t-on à l’inspection générale des affaires sociales (Igas) ou à l’inspection générale des finances (IGF), dont des anciens ministres très compétents ?
Le Président de la République lui-même a supprimé l’ENA en expliquant qu’il serait bien que des gens d’expérience travaillent dans les corps d’inspection. Cela tombe bien, nous en avons ! Mais on ne les utilise pas…
Lors de la RGPP, nous avons beaucoup eu recours à tous les corps d’inspection, qui n’ont peut-être jamais eu autant de travail. Il a bien fallu alors bénéficier de temps en temps de l’expérience des cabinets de conseil ! Mais oui, il faut utiliser les hauts fonctionnaires.
Certes, je comprends que le rapport ne plaise pas tellement à la DITP, qui se trouve dans la même situation qu’une préfecture.
Les préfets représentent l’État dans les territoires, mais ne s’occupent ni de l’éducation nationale, ni des agences régionales de santé (ARS), ni du ministère des finances et des directions départementales des finances publiques (DDFiP). Pour la DITP, c’est la même chose : elle croit centraliser, mais des dépenses sont faites partout, comme la commission d’enquête l’a révélé.
On le voit, beaucoup reste à faire, monsieur le ministre, mais je ne doute pas de votre bonne volonté. Vous l’avez compris, nous sommes là non pour vous embêter, mais pour mieux faire fonctionner l’administration française.
Certains collègues ont parlé des collectivités locales. Il ne faut tout de même pas exagérer : eu égard à l’état des finances locales, je ne suis pas sûr qu’il y soit fait beaucoup appel à des cabinets de conseil pratiquant de tels honoraires !
Monsieur le ministre, ma mère me disait de ranger ma chambre avant de dire que celle de mon frère était mal rangée. Avant de donner des conseils aux collectivités locales, occupez-vous donc de l’administration centrale. Commencez par ranger votre chambre avant d’aller voir chez les autres ! Cela me paraît de bonne politique.
La question de la souveraineté et des données est un sujet très important pour moi. Si les conseillers de McKinsey se font payer si cher, c’est parce qu’ils ont des bases de données incroyables qu’ils mettent à disposition de leurs clients – cela n’empêche pas le cabinet d’« oublier » de payer ses impôts. Or ces données sont stockées aux États-Unis.

Les lois américaines s’appliquent donc sur des données françaises qui peuvent être sensibles, mais que l’on ne peut plus surveiller.
En conclusion, je pense que, avec cette proposition de loi, comme dirait le Président de la République, l’abondance est terminée pour les cabinets de conseil !
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et SER. – Mme Éliane Assassi applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon camarade Jean-Pierre Sueur vous ayant exposé la position du groupe socialiste sur les grandes lignes du texte, je me concentrerai pour ma part sur l’article 7, qui impose aux cabinets de conseil travaillant pour l’État de bien vouloir, s’il vous plaît, employer la langue française dans leurs échanges avec l’administration et dans leurs documents.
Cet article est la traduction de l’une des recommandations de cette commission d’enquête, à laquelle j’ai participé avec plaisir. Grâce à elle, nous avons pu mesurer ce qui se passe dans les coulisses de ces marchés publics où, diapositive après diapositive, les cabinets offrent des solutions adéquates que les administrations ne sauraient trouver par elles-mêmes.
Pour mieux me faire comprendre par l’écosystème qui nous occupe et qui nous écoute peut-être, j’aurais pu dire que j’ai fait partie du board de la commission qui a mesuré, behind the scene, comment slide après slide les consultants juniors et seniors d’un même practice font des « propales » pour offrir les bons feedbacks et les key learnings à leurs prospects publics.
Mes chers collègues, si comme moi vous n’entendez rien à ce sabir, rassurez-vous : la commission d’enquête a annexé à son rapport un glossaire du vocabulaire dont les cabinets de conseil inondent leurs clients – j’en remercie d’ailleurs la présidente Éliane Assassi. En revanche, inquiétez-vous de la situation qui a rendu ce glossaire malheureusement indispensable.
Lors de son audition, le PDG de La Poste a indiqué que le recours trop systématique aux cabinets de conseil faisait courir le risque d’un « nouveau conformisme », passant par la langue et conduisant à un appauvrissement de la pensée. Ce « globish », qui n’est même pas de l’anglais, est en réalité un instrument de formatage. Nombreux sont les fonctionnaires et les citoyens à en concevoir une souffrance certaine.
La France a un rapport à la puissance publique et à l’administration qui lui est propre ; Villers-Cotterêts n’est pas Wall Street. Or ce rapport ne peut être appréhendé par ces cadres de pensée d’outre-Atlantique. Ceux-ci correspondent parfaitement à la culture anglo-saxonne ; c’est une grande culture, mais ce n’est pas la nôtre et elle ne nous permet pas de développer souverainement notre propre vision de l’action publique.
La légère modification de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite Toubon, proposée dans ce texte ne saurait être résumée à une approche passéiste consistant à regretter le bon vieux temps de l’imparfait du subjonctif ou de la marine à voile.
Ce n’est pas non plus la recherche d’une langue pure, car une langue figée est une langue finie, fantasme morbide que je laisse aux réactionnaires. On doit accepter, avec gourmandise, l’intégration des mots étrangers ou nouveaux, lorsqu’ils recouvrent mieux que n’importe quel autre terme une réalité que notre langue ne décrit pas.
En revanche, lorsque le mot existe en français et, surtout – j’arrive au point essentiel –, lorsqu’il est parfaitement entendu de tous les citoyens, il doit être employé, afin que les gens se comprennent entre eux. C’est un impératif démocratique tout autant qu’un refus de l’entre soi.
Une récente étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) sur le sujet rappelle l’« attachement manifeste à la langue, qui se décline à travers l’expression de la nécessité de services publics exemplaires sur le sujet ».
C’est ce qui est exprimé dans l’article 7 de la présente proposition de loi, dans un contexte dans lequel les gouvernements ne respectent, et de longue date, ni la loi Toubon, ni les dispositions réglementaires prises en application de celle-ci, ni les circulaires primo-ministérielles, qui s’imposent pourtant à l’administration. Les « Choose France », « French Tech », « Business France », « France Connect », « French Impact », start-up nation, bottom-up et autres clusters sont autant d’agressions, qui creusent le fossé entre le peuple et ses représentants ; il faut en avoir conscience. Quand on est payé par le contribuable, on le sert dans sa langue et cela vaut tant pour l’administration que pour ses dirigeants et ses prestataires !
En février dernier, l’Académie française a publié un rapport sous-titré Pour que les institutions françaises parlent français ; nous en sommes rendus là… En juin dernier, le ministre québécois de la langue française en visite à Paris nous invitait avec émotion à ne pas laisser son gouvernement seul dans cette bataille ; nous devons l’entendre !
Nous avons ici une occasion, rare, de renforcer utilement la loi Toubon : saisissons-la, monsieur le ministre !
D’aucuns inscriraient sur leur slide de conclusion que c’est now or never qu’il faut réaffirmer ces principes linguistiques, mais, avec l’audace dont nous savons faire preuve au Sénat, sur toutes les travées, nous pouvons dire, beaucoup plus clairement, que c’est maintenant ou jamais !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens d’abord à saluer l’initiative des auteurs de cette proposition de loi, Éliane Assassi et Arnaud Bazin. On a pu en mesurer la nécessité lors des travaux de la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, à laquelle j’ai eu l’honneur de participer.
C’est donc avec la conviction de la nécessité de cet encadrement que j’ai cosigné cette proposition de loi. Je tiens également à saluer le travail de la rapporteure du texte, Cécile Cukierman.
Je ne développerai pas les risques que l’emprise des cabinets de conseil peut faire peser sur la démocratie et sur la légitimité des responsables publics ; chacun les connaît désormais. Au moment de fatigue démocratique forte que connaît notre pays et où le lien de confiance entre les pouvoirs publics et nos concitoyens est pour le moins distendu, il convient de compléter notre arsenal législatif pour encadrer ces pratiques, en définir le périmètre, en piloter l’intervention, les rendre transparentes et protéger les données de l’administration.
Je me bornerai, dans le temps qui m’est imparti, à aborder deux aspects de ce texte : l’interdiction des prestations réalisées à titre gratuit, déjà abordée par Arnaud Bazin, et la protection des données.
J’ai beaucoup insisté, lors des auditions de la commission d’enquête et lors de la réunion d’examen de son rapport, sur le problème majeur que constituent les interventions dites pro bono. Ces prestations, dénuées de tout fondement juridique, peuvent correspondre à une stratégie de « pied dans la porte », en vue de développer un réseau d’influence auprès des décideurs politiques et de l’administration, voire d’orienter des politiques publiques.
Je me réjouis donc que le texte pose le principe de l’interdiction des prestations à titre gratuit. L’équilibre proposé, par lequel on autorise des missions réalisées dans la cadre du mécénat d’entreprise au profit de certains organismes ou œuvres d’intérêt général, me semble bon. Il conviendra bien entendu d’en évaluer la mise en œuvre et la portée, afin de s’assurer qu’il n’y a pas de dérives et que ces organismes d’intérêt général ne sont pas privés par ailleurs de cette ressource.
Le deuxième sujet sur lequel je veux insister est la protection des données de l’administration. S’il est essentiel d’éviter toute confusion entre le consultant et l’administration dans l’action publique, comme le prévoit le texte, il est également crucial de s’assurer que les données de l’administration utilisées par les cabinets de conseil sont protégées. Je parle bien sûr des utilisations ayant une finalité autre que l’exécution de la mission.
Il me paraît équilibré de confier le contrôle de la suppression de toutes ces données à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), sans obligation d’aviser le prestataire avant une éventuelle vérification sur place. Ce recours à la Cnil, sous le contrôle éventuel du juge des libertés et de la détention, me semble relever, comme le recours à la HATVP, mobilisée pour éviter tout conflit d’intérêts, du bon usage de nos autorités indépendantes.
Cette proposition de loi est exemplaire, comme le montrent les nombreuses réactions du Gouvernement aux travaux de la commission d’enquête, en particulier la publication, déjà évoquée, de la circulaire insuffisante de janvier 2022. Elle comprend bien d’autres volets qui feront avancer nos pratiques démocratiques, grâce à l’action du Parlement. L’examen détaillé du texte permettra de souligner chacune de ces avancées, dont je me réjouis par avance, notamment en matière de transparence et de proportionnalité.
Éclairer les décisions, oui, car, plus que jamais, nous avons besoin de dialogue et d’expertise pour nous accorder sur le diagnostic avant d’engager une action ; mais orienter les décisions par des scénarios priorisés et bâtis par les cabinets sur des chemins « prébalisés », non ! Nous non plus ne devons pas être dépossédés, comme certains dans notre société actuelle.
Je vous invite donc, mes chers collègues, à adopter cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, CRCE et SER.

La discussion générale est close.
Nous passons à l’examen du texte de la commission.
Chapitre IER
Définir les prestations de conseil
I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :
1° L’État et ses établissements publics ;
2° Les autorités administratives et publiques indépendantes ;
3° Les établissements publics de santé.
II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :
1° Le conseil en stratégie ;
2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;
3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations de programmation et de maintenance ;
4° Le conseil en communication ;
5° Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;
6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts-comptables et par les commissaires aux comptes.
III. – Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous-traitants.
IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s’engagent à titre individuel avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.
V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.
Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier mes collègues pour le travail remarquable et inédit qu’ils ont accompli ; la commission d’enquête du Sénat sur ce sujet a permis de révéler l’omniprésence des cabinets de conseil au cœur de l’État et leur influence sur des décisions stratégiques, notamment dans des domaines régaliens.
J’avais déposé des amendements visant à exclure du champ des prestations de conseil la dimension stratégique de l’État, afin de prévenir l’affaiblissement de celui-ci, l’abandon de sa souveraineté et de ses compétences. J’ai bien conscience des difficultés rédactionnelles et techniques que posent mes amendements, aussi ai-je accepté de les retirer.
Néanmoins, il faut le souligner, la vie quotidienne des Français est de plus en plus envahie par des recommandations de cabinets internationaux de conseil, qui préconisent des stratégies uniformes partout dans le monde, dans des domaines aussi importants que la santé, l’éducation, la justice ou l’énergie.
À titre d’exemple, l’omniprésence du cabinet McKinsey pendant la crise sanitaire illustre les dérives que cette proposition de loi doit encadrer. Qu’il s’agisse du confinement, des tests PCR, des campagnes vaccinales ou encore des aides « covid », McKinsey a piloté toutes les étapes de la stratégie sanitaire. D’autres pays ont décliné les mêmes politiques et ont appliqué les mêmes scénarios, tirés des recommandations de ce cabinet.
Il est urgent de mettre fin à la stratégie du copier-coller, qui nous entraîne finalement de crise en crise ; il est urgent de mettre fin à la déresponsabilisation des décideurs ; il est urgent, enfin, de retrouver une stratégie relevant du courage politique et protégeant les intérêts de notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

L’amendement n° 19, présenté par Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Nicole Duranton.

Cet amendement a pour objet d’instaurer un seuil à partir duquel les établissements publics de l’État entrent dans le champ d’application de la proposition de loi.
Il est nécessaire de ne pas faire peser une charge déraisonnable sur les entités de taille réduite, pour lesquelles, du reste, les enjeux sont limités. Parmi ces entités figurent notamment les chambres départementales d’agriculture, la majorité des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (Crous), certaines écoles de formation de la fonction publique, certains musées de taille réduite et certains établissements publics fonciers.
Concrètement, nous proposons de limiter le champ d’application de la présente proposition de loi aux établissements publics nationaux dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an, seuil qui correspond à celui des avances obligatoires versées aux PME dans le cadre d’un marché public par certains établissements publics de l’État.
Avec ce seuil, seuls les plus gros établissements publics de l’État entreraient dans le champ d’application de la proposition de loi ; je pense notamment à la Caisse nationale de l’assurance maladie (Cnam), à Voies navigables de France, à l’Union des groupements d’achats publics (Ugap) ou encore à Météo-France.
Notre amendement tend également à supprimer l’alinéa 4, qui est redondant avec l’alinéa 2, puisque les établissements publics de santé sont une catégorie d’établissements publics de l’État.

Ainsi que je l’ai laissé entendre dans mon propos liminaire, j’émets un avis défavorable sur cet amendement, non pas parce que la question du seuil doit être balayée du revers de la main, mais parce que nous ne disposons pas des éléments nécessaires pour déterminer précisément quels établissements, parmi ceux que vous citez, seraient concernés par le seuil de 60 millions que vous proposez.
Par ailleurs, si ce seuil de 60 millions d’euros est effectivement connu, il conviendrait d’en étudier plus avant la pertinence.
Cet amendement comporte deux dispositions.
Je ne m’attarde pas sur la seconde, qui a une dimension essentiellement légistique, les établissements publics de santé étant effectivement déjà inclus dans la catégorie des établissements publics de l’État.
J’insisterai davantage sur le I de l’amendement, qui vise à fixer un seuil. Cette disposition va dans le bon sens, puisqu’elle favorise l’effectivité et la proportionnalité du texte, en concentrant l’application de la proposition de loi sur les établissements qui sont, non seulement les plus exposés au risque que l’on cherche à éviter et sur lesquels doit porter notre effort de prévention, mais également les plus capables d’intégrer la contrainte administrative qu’engendrera ce texte.
Cette mesure ne soustraira pas du champ de la proposition de loi les établissements visés par les auteurs de celle-ci – je pense notamment à l’Ugap, à Pôle emploi, aux universités ou aux gros établissements publics de santé. Elle permettra d’inclure les 500 plus gros établissements publics de l’État, ce qui correspond bien à la visée de la proposition de loi.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. Arnaud Bazin. La déontologie n’est pas affaire de chiffre d’affaires !
Mme Nathalie Goulet applaudit.

Un établissement, qu’il brasse des sommes considérables ou qu’il soit plus modeste, doit absolument se garder de tout conflit d’intérêts !

Je ne vois pas ce que la notion de chiffre d’affaires ou de budget de fonctionnement vient faire là-dedans.
La rédaction adoptée par la commission me paraît raisonnable. Ensuite, nous verrons comment tout cela fonctionne.
Je le répète, ce n’est pas du tout une affaire de recettes et de dépenses de fonctionnement ; il s’agit de déontologie et de prévention des conflits d’intérêts, qui sont, Nathalie Goulet le rappelait, le cancer de la vie publique.
Nous devons être intransigeants ; nous ne pouvons pas, d’emblée, dès le premier amendement examiné, réduire la portée et l’ambition de cette proposition de loi. Je ne voterai pas donc cet amendement.
Je serai bref, car nous voulons tous avancer et ne pas engager un débat trop long dès l’examen du premier amendement.
Le Gouvernement ne souhaite pas épargner à certains établissements publics une contrainte déontologique ; il s’agit simplement d’être extrêmement réaliste. En effet, la proposition de loi impose un certain nombre de contraintes administratives, tout à fait fondées et que je soutiens pour l’immense majorité. Or, pour que le texte soit effectif, il doit prévoir une certaine proportionnalité par rapport aux contraintes que peuvent absorber les établissements publics.
Mme la sénatrice Duranton mentionnait certains établissements publics qui seraient en grande difficulté opérationnelle pour appliquer ce qui est proposé dans la proposition de loi.
Cet amendement ne vise pas à amoindrir pas la portée de la proposition de loi ; au contraire, il tend à la renforcer.
Je tenais à clarifier cette position.

J’entends bien l’objectif de notre collègue – elle était d’ailleurs membre de la commission d’enquête et elle a validé notre rapport –, mais la disposition que tend à introduire son amendement, si elle était adoptée, réduirait la portée, donc l’ambition, de notre proposition de loi.
En outre, le seuil de 60 millions d’euros n’a aucune pertinence en la matière. Il figure dans le code de la commande publique, mais pour tout à fait autre chose, pour le versement des avances aux PME.
Enfin, sur le fond, cela a été dit, on ne connaît pas la liste des établissements publics qui seraient ainsi exclus, mais on peut déjà citer l’Institut national du service public – l’ex-École nationale d’administration –, l’École nationale de la magistrature, certaines agences de l’eau et certaines agences régionales de santé.
Nous préférons la clarté du texte de la commission. La proposition de loi doit concerner tous les établissements publics de l’État, afin d’éviter les effets de seuil.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 27 rectifié, présenté par MM. Sueur, M. Vallet, P. Joly, Montaugé et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La Caisse des dépôts et consignations ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement a pour objet de préciser le périmètre d’application de la proposition de loi, en y incluant explicitement la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est, vous le savez, ni un établissement public de l’État ni une autorité administrative ou publique indépendante.

La Caisse des dépôts et consignations n’est en effet ni un établissement public de l’État ni une autorité administrative indépendante. Cependant, elle est faisait partie du périmètre des travaux de la commission d’enquête. La commission a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
La Caisse des dépôts et consignations est effectivement un établissement à part.
Elle fait déjà l’objet d’un contrôle parlementaire, puisque sa commission de surveillance est présidée par un parlementaire. On pourrait donc considérer que son contrôle existe déjà. Néanmoins, je conçois que la Haute Assemblée veuille l’inclure dans le champ de la proposition de loi.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Le dispositif de l’amendement mentionne la « Caisse des dépôts et consignations ». Or les textes qui régissent cet établissement mentionnent désormais « la Caisse des dépôts et consignations et ses filiales ».
La Poste, par exemple, dont nous avons entendu en audition le PDG, Philippe Wahl, est dorénavant une filiale, avec contrôle exclusif, de la Caisse. Inclure la Caisse des dépôts et consignations dans le texte, c’est bien, mais il faudrait plutôt parler de « groupe de la Caisse des dépôts et consignations » ou de « Caisse des dépôts et consignations et ses filiales ».
Cela pourra sans doute être corrigé lors de la navette parlementaire, car, vous ne manquerez pas d’inscrire ce texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, monsieur le ministre…
Sourires.
L ’ amendement est adopté.

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 10 000 habitants ;
…°Les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception des communautés de communes.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Jean-Yves Roux l’a souligné lors de la discussion générale, cette proposition de loi est la bienvenue. Ses apports sont, j’y insiste avec force, indéniables.
Il reste néanmoins un écueil, auquel je vous propose de remédier sans attendre la suite de la navette : une partie de l’administration publique a été oubliée.
En effet, comme l’État, nos collectivités prennent des décisions politiques qui affectent la vie de nos concitoyens et, comme lui, elles sont susceptibles de faire appel à des consultants, engageant ainsi les finances publiques.
Aussi, il ne paraît pas absurde de mieux encadrer ces recours, même si nous savons qu’il existe déjà des mécanismes d’encadrement, via les chambres régionales des comptes ou le contrôle de l’opposition locale, car ces mécanismes n’ont pas suffi, hélas ! à endiguer les phénomènes parfois désastreux, tels les recours aux emprunts toxiques.
Il faut donc renforcer la transparence et le contrôle jusques et y compris dans l’administration décentralisée. C’est la responsabilité du Sénat que de répondre aux problèmes des territoires.
Dans ce contexte, cet amendement vise à inclure dans le périmètre de la proposition de loi les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 10 000 habitants, et les intercommunalités, à l’exception des communautés de communes.
Ces seuils sont peut-être trop bas, aussi avons-nous déposé un amendement de repli, l’amendement n° 45, qui tend à fixer le seuil des collectivités visées à 100 000 habitants, tout en incluant les intercommunalités, exception faite des communautés de communes.

L’amendement n° 24 rectifié, présenté par MM. Sueur, P. Joly, Montaugé, M. Vallet et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
… Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 100 000 habitants ;
… Les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 100 000 habitants.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Au préalable, je veux préciser un point. Certains semblent penser que la proposition de loi doit correspondre exactement au périmètre de la commission d’enquête et affirment que l’on ne saurait aller au-delà. Je ne comprends pas pourquoi. Nous sommes le législateur, nous pouvons déposer des amendements et, si nous pensons qu’il faut élargir le champ du texte, je ne vois pas pourquoi nous ne le ferions pas.
Au travers de cet amendement, nous proposons d’étendre les bienfaits de cette proposition de loi aux collectivités territoriales. Notre proposition comporte un seuil différent de l’amendement n° 1 rectifié de notre collègue et ami Jean-Claude Requier, mais identique à celui de son amendement de repli, car il nous paraît sage d’exclure les communes de moins de 100 000 habitants, mais d’appliquer les dispositions du texte aux autres communes, ainsi qu’aux autres collectivités locales et aux intercommunalités de plus de 100 000 habitants.

L’amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…°Les collectivités territoriales et leurs établissements publics, à l’exception des communes de moins de 100 000 habitants ;
…°Les établissements publics de coopération intercommunale, à l’exception des communautés de communes.
Cet amendement a déjà été défendu.
L’amendement n° 44, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 100 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et la métropole de Lyon ;
La parole est à M. le ministre.
Mon argumentation sera assez similaire à celles de MM. Sueur et Requier.
La question est, au fond, celle de l’appréciation que l’on a de la proposition de loi. Soit on considère que celle-ci doit être punitive pour la puissance publique – ce n’est ni mon cas ni, je crois, le vôtre –, soit on considère qu’elle renforce les acteurs publics concernés, auquel cas je ne vois pas de bonne raison pour exclure les collectivités territoriales du bénéfice de ces dispositions.
Ces collectivités, personne n’en disconviendra ce soir, ont recours aux organismes de conseil. Il peut s’agir, pour une région, de bâtir une politique stratégique d’attractivité économique, moyennant quelques centaines de milliers d’euros. Il peut s’agir aussi, pour un département, de concevoir un schéma directeur en matière de politique sociale, moyennant quelques dizaines de milliers d’euros. Il peut s’agir encore, pour une métropole, de réorganiser des services. Voilà quelques exemples concrets, tirés de la vie réelle des collectivités.
Or je considère, comme les auteurs des autres amendements en discussion commune, qui émanent de diverses travées de la Haute Assemblée, que l’intégration des collectivités, loin d’être punitive pour celles-ci, leur permettrait de bénéficier de la proposition de loi.
En outre, l’objectif de proportionnalité – vous m’entendrez beaucoup en parler ce soir – me semble respecté si l’on considère que les collectivités de plus de 100 000 habitants, c’est-à-dire les régions, les départements et les 42 communes les plus importantes du pays, doivent être concernées par le texte. En effet, ces collectivités ont la capacité d’intégrer les contraintes administratives que j’évoquais précédemment et de se mettre en conformité avec les dispositions de la proposition de loi. De plus, elles doivent être prioritairement protégées du risque de conflit d’intérêts.
Tel est l’objet de cet amendement, qui tend à instituer un seuil de 100 000 habitants. Ma rédaction diffère légèrement de celle des trois autres amendements, car je ne vise les établissements publics de coopération intercommunale que s’ils comptent plus de 100 000 habitants.

Le débat sur l’inclusion des collectivités dans le champ du texte est légitime ; il n’est pas question de l’expédier sans autre forme de procès.
Personne ne prétend, monsieur Sueur, que la loi ne peut aller plus loin que la commission d’enquête. Simplement, en concertation avec les auteurs du texte, j’ai proposé à la commission des lois un équilibre politique respectant le consensus, le point d’équilibre, obtenu par la commission d’enquête. La rédaction qui en résulte permet de ne pas élargir le champ d’application à des secteurs qui n’ont été examinés ni par la commission d’enquête ni – je le dis humblement – par la rapporteure de la commission des lois.
En outre, les quatre amendements ont des rédactions et des seuils différents et ne visent pas les mêmes collectivités. C’est bien la preuve qu’il faut un peu de temps et d’expertise pour viser juste.
Par ailleurs, puisque nous sommes au Sénat, j’appelle l’attention des auteurs de ces amendements sur le fait que, à l’heure où l’on plaide pour la concertation, pour la prise en compte de la réalité territoriale, vécue par les élus locaux, il serait malvenu et surtout peu efficace d’inclure les collectivités territoriales dans le champ de la proposition de loi via de tels amendements.
De plus, les auteurs de ces amendements ne tirent pas les conséquences sur les autres articles du texte des dispositions qu’ils proposent, ce qui rend celles-ci non effectives.
La commission propose plutôt de travailler en profondeur, avec les élus locaux et les associations de collectivités, la question du recours excessif aux cabinets de conseil dans les collectivités territoriales et celle des règles de déontologie qu’elles doivent respecter, lesquelles seront inévitablement différentes de celles qui s’imposent aux administrations de l’État.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces quatre amendements.
Madame la rapporteure, vous développez deux arguments : vous indiquez, d’une part, qu’il faudrait approfondir la réflexion pour parfaire les dispositions de la proposition de loi et, d’autre part, que l’on mesure mal l’impact réglementaire et financier sur les collectivités des dispositions proposées.
Je développerai donc, pour vous répondre, deux contre-arguments.
D’abord, vos réserves tirées de l’impact de ces dispositions pour les collectivités, vous ne les avez pas eues pour les établissements publics de santé.
Ainsi, 220 hôpitaux locaux et, de mémoire, 3 300 établissements publics de santé sont concernés par le texte. Je ne crois pas que la commission d’enquête sénatoriale sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques se soit penchée sur les conséquences d’une telle disposition, bien que vous ayez auditionné Martin Hirsch sur ce sujet. Et aujourd’hui, vous reprenez cet argument pour justifier le fait que le texte ne s’intéresse pas aux collectivités !
Vous l’avez dit vous-même, madame la rapporteure, ce texte est non un point d’arrivée, mais un point de départ, puisqu’il y aura une navette parlementaire. Je souhaite que cette proposition de loi puisse cheminer et il est tout à fait possible de travailler dans le temps de cette navette. À cet égard, je suis extrêmement ouvert sur la forme. Vous avez évoqué la nomination de parlementaires en mission : je suis prêt à le faire et à donner les moyens nécessaires au Parlement, dans le cadre de la navette, pour parfaire le texte et en envisager les conséquences concrètes. Ma position est très sincère : je souhaite intégrer les collectivités à ce stade du texte, car il s’agit bien d’un point de départ.
Par conséquent, pour les raisons que je viens d’évoquer, je demande le retrait des deux amendements similaires en termes de seuil à l’amendement n° 44 du Gouvernement, par cohérence avec la situation des EPCI.

En commission des lois, je me suis ému de l’absence des collectivités locales dans le périmètre d’intervention de ce texte.
Je me suis interrogé sur la possibilité de présenter un amendement. Après y avoir un peu travaillé, je suis resté « sec » devant ma feuille blanche. Je l’avoue, mon entrée en matière était celle retenue pour la rédaction de votre amendement, monsieur le ministre, même si je n’ai pas pensé à la Guyane… J’aurais pu penser à l’Alsace, plus proche de moi, région que j’aimerais retrouver bientôt, à la place du Grand Est – mais c’est un autre débat…
Sourires.

L’autre entrée en matière était bien évidemment celle du seuil. Je prie mon collègue Jean-Claude Requier de m’excuser, mais j’observe qu’il remplace le seuil de 10 000 habitants par celui de 100 000 habitants, en passant de l’amendement n° 1 rectifié à l’amendement n° 45 rectifié, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. Cela aurait pu être 20 000 habitants ou 50 000 ! Le moins que l’on puisse dire, c’est que les conséquences sont relativement lourdes pour les collectivités concernées.
J’ai été convaincu par les explications de Mme la rapporteure en commission et répétées ce soir. Il faut vraiment mener un travail approfondi sur ce dossier et engager une indispensable concertation.
Par ailleurs, je suis très sensible à l’observation formulée voilà quelques instants par le président de la commission d’enquête, M. Arnaud Bazin. Selon moi, la question de la déontologie l’emporte sur celle du seuil. Nous avons tous en tête des cas d’espèce qu’il vaut mieux ne pas citer et qui nous conduisent à nous poser des questions de déontologie.
Je voterai contre l’extension proposée par ces amendements. Toutefois, je le répète, nous devrons prendre le temps de mener ce travail.

En effet, monsieur le ministre, la question est légitime. C’est d’ailleurs l’une des toutes premières que nous nous sommes posées avec Éliane Assassi, après la fin des travaux de la commission d’enquête, pour déterminer ce que nous allions retenir dans la proposition de loi dont nous débattons ce soir.
Il nous est assez vite apparu qu’il ne fallait pas inclure les collectivités territoriales, pour les raisons rappelées par Mme la rapporteure. Toutefois, je voudrais insister sur deux points tout à fait déterminants.
Premièrement, l’influence des cabinets de conseil sur l’État concerne à l’évidence des sujets beaucoup plus vastes, y compris dans le domaine de la défense nationale ou dans le domaine sanitaire, qui intéressent toute la Nation. Les décisions prises dans un département ou une région, si elles ne sont pas négligeables, ont tout de même des conséquences beaucoup plus limitées.
Deuxièmement, pourquoi sommes-nous ici ce soir ? Parce que nous avons constaté qu’il est nécessaire de renforcer la transparence, le contrôle du recours et la déontologie. En ce qui concerne la transparence, il nous a fallu tous les outils d’une commission d’enquête, avec tous ses pouvoirs, qui ne sont pas minces – auditions sous serment, communication obligatoire des documents, vérifications sur place et sur pièces –, pour savoir ce que l’État dépensait en matière de recours aux cabinets de conseil.
Notre contrôle de l’action du Gouvernement a donc nécessité tous ces moyens, raison pour laquelle nous les avons intégrés dans le texte.
Dans les collectivités territoriales, il y a des assemblées délibérantes, des oppositions et des communications obligatoires de documents. Quand j’étais président du département du Val-d’Oise, j’ai fourni à mon opposition tout un ensemble de documents – comptes administratifs, comptes de gestion… Sans oublier l’encadrement des services de l’État et de la trésorerie, qui vérifient que les décisions sont conformes à ce qui a été voté.
Ainsi, tout un contre-pouvoir est déjà en place dans les collectivités locales, ce qui ne nous empêchera pas de nous pencher sur le sujet. Les choses ne sont donc absolument pas symétriques. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de ne pas retenir les collectivités territoriales dans le champ de ce texte.

Dans le cadre de la commission d’enquête, nous avons documenté l’influence des cabinets de conseil sur les décisions de l’État, de ses établissements publics et des hôpitaux, que nous avons intégrés dans nos travaux.
Si je comprends le sens des amendements déposés par nos collègues, j’estime qu’il ne faut pas être sur la défensive en la matière. Il convient en effet d’aborder le sujet frontalement. C’est l’une des raisons pour lesquelles plusieurs d’entre nous ont émis l’idée d’un échange approfondi, qui pourrait faire l’objet d’un rapport, entre M. le ministre et les associations d’élus. Mme Goulet proposait une mission flash ; des parlementaires pourraient aussi demander une mission d’information ou une commission d’enquête.
Il s’agit d’un vrai sujet : des collectivités, parmi les plus importantes, ont recours à des cabinets privés. Or nous ne disposons d’aucune donnée consolidée sur le niveau des dépenses de conseil des collectivités territoriales.
Veuillez m’excuser, monsieur le ministre, mais il est tout de même paradoxal de vous voir tout à fait disposé à étendre la proposition de loi aux collectivités, alors que vous avez déposé plusieurs amendements visant à réduire l’ambition de notre texte sur vos propres services.

À mon tour, je veux me réjouir du travail conduit par Mme Éliane Assassi et M. Arnaud Bazin qui illustre parfaitement la capacité du Sénat à dépasser les clivages, à prendre le temps de travailler sur de vraies questions et des sujets importants.
Monsieur le ministre, je comprends la nécessité, pour l’État comme pour les collectivités, de recourir à des expertises extérieures. Il n’est pas dans l’intention du groupe centriste de pratiquer une sorte de chasse aux sorcières.
Pour autant, nous sommes tous d’accord sur l’impératif d’une plus grande transparence, d’une plus grande exigence et d’un plus grand contrôle.
Vous avez raison, la question des collectivités se pose. Il ne faudrait pas que ceux qui nous écoutent ce soir aient l’impression que nous nous dérobons et que nous voulons échapper à la transparence. Ce n’est pas le genre de la Haute Assemblée !
Monsieur le ministre, vous avez salué la qualité et la rigueur du travail mené, qui nous conduisent, en nous fondant sur notre expertise, à formuler des propositions. La commission d’enquête a écarté de son champ de travail les collectivités. Pourtant, nous disons tous qu’il y a là un champ à investiguer. Pardonnez-nous, mais nous n’allons pas décider à la hussarde, à minuit passé, de ce qui arrivera aux collectivités, alors même que nous ne les avons pas entendues et que nous ne cessons, avec le Président de la République, de déplorer les décisions prises sur un coin de table, dont on s’aperçoit ensuite qu’elles ne fonctionnent pas.
Si je puis me permettre, monsieur le ministre, je me demande pourquoi les métropoles de Marseille et de Paris, qui ont un statut particulier, sont absentes du dispositif de votre amendement. Mais peut-être l’ai-je mal lu…
Nous sommes là face à un éventail de propositions, qui nécessitent des investigations sérieuses et exigeantes. Ce soir, vous seriez le premier à regretter ce que nous pourrions faire, l’enfer étant pavé de bonnes intentions. La commission d’enquête peut se poursuivre au Sénat ou l’Assemblée nationale peut se saisir du sujet, mais nous ne pouvons décider quoi que ce soit ce soir, sans en avoir parlé au préalable aux associations d’élus.

J’ai été maire, président d’une intercommunalité, président d’un syndicat mixte et président d’un département. J’ai pu constater des dérives en matière de recours à des cabinets de conseil. Je ne parle pas des enjeux déontologiques, mais plutôt du contenu de ces recours. En effet, la loi suscite ce recours aux cabinets de conseil, au travers d’exigences telles que l’élaboration d’un certain nombre de documents stratégiques de développement ou de documents d’urbanisme, ce qui peut avoir des conséquences particulières.
On observe ainsi une standardisation de la manière d’aborder les sujets, qu’elle soit matérielle, par le biais de copier-coller, ou intellectuelle, alors même qu’il nous faut repenser l’ensemble de nos concepts et compromis sur les différents enjeux de société.
Une absence ou une insuffisance de maîtrise des travaux par les fonctionnaires de la collectivité territoriale ou les élus sont souvent évoquées pour justifier le recours à une forme de « délégation de pouvoir », dans le cadre des documents ou des schémas exigés.
Il s’agit, au travers de ce regard sur l’intervention des cabinets de conseil, de s’assurer que le recours à ces derniers ne constitue pas une facilité, mais correspond à une nécessité d’expertises techniques particulières, pour mener et définir les politiques locales.

Permettez-moi de compléter les propos tout à fait légitimes de ma collègue Françoise Gatel, dans le droit fil d’une double sincérité très centriste.
Notre groupe s’abstiendra sur l’ensemble de ces amendements. En effet, le sujet existe, et il n’est donc pas question de voter contre. Parallèlement, le périmètre de la commission d’enquête et la nécessité d’auditionner et de travailler fait que nous ne pourrons pas voter pour.

Les discussions que nous avons, qui sont très intéressantes, démontrent que ce texte est extrêmement complexe.
D’un côté, on dit que la notion de déontologie n’est pas liée au chiffre d’affaires ou au budget de fonctionnement. On ne peut donc pas limiter son application aux seuls établissements publics administratifs de plus de 60 millions d’euros de budget.
D’un autre côté, on ne souhaite pas appliquer cet article aux collectivités territoriales de plus de 100 000 habitants, dont le budget de fonctionnement est d’au moins 500 000 euros.

On a dit également que le conflit d’intérêts constituait le cancer de nos institutions. Nous rencontrons donc une difficulté pour établir le périmètre de cet article. Il me semble que ce texte n’est pas prêt, raison pour laquelle je m’abstiendrai.

Jusqu’à ce point, chacun s’est abstenu de caricaturer le propos des autres, et il est important que nous puissions continuer d’avancer ainsi. Aucun d’entre nous n’a dit que les collectivités territoriales ne constituaient pas un sujet.
Notre collègue Arnaud Bazin l’a rappelé, les mécanismes de contrôle, de régulation, de transparence et d’information des collectivités territoriales diffèrent de ceux de la plupart des administrations de l’État.
Par ailleurs, comme Mmes Gatel et Assassi l’ont souligné, nous ne voulons pas que la question des collectivités territoriales se résume à une simple référence au code général des collectivités territoriales. Nous voulons mener un travail d’expertise et, surtout, une réflexion avec les élus locaux, qui administrent ces collectivités.
Je le redis, si cette proposition de loi prenait en compte les collectivités territoriales, elle deviendrait en partie incompréhensible. Que deviendrait, par exemple, l’article 8 ? Mais je sais, monsieur le ministre, que vous allez me répondre qu’il faut, de toute façon, réécrire cet article.
Nous devons veiller à préserver la cohérence trouvée par la commission. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces quatre amendements.
Je veux rebondir sur le dernier point évoqué : que faisons-nous pour les établissements publics, pour lesquels vous n’avez fait référence à aucun seuil, dans le cadre d’un certain nombre de mesures, à commencer par celles de l’article 8 ?
S’agissant des seuils, je comprends bien le syndrome de la page blanche, monsieur Reichardt. Simplement, la rédaction que nous avons choisie est celle qui a été adoptée par votre assemblée dans le cadre de la loi de 2013 relative à la transparence de la vie publique. J’espère que ce rappel lèvera vos appréhensions en la matière.
Monsieur Bazin, l’un de vos arguments me paraît quelque peu circulaire : selon vous, il faut laisser de côté les collectivités territoriales, faute d’une bonne connaissance de leur recours aux services des cabinets de conseil. Mais les articles 3, 4 et 8 de la proposition de loi permettront justement une meilleure transparence, en listant le recours aux prestations des cabinets de conseil.
Enfin, d’après vous, les enjeux déontologiques de l’État, dont le champ d’action est plus large, diffèrent de ceux d’un certain nombre de collectivités. Je ne peux partager un tel argument : les collectivités territoriales agissent sur la vie quotidienne des Français, qu’il s’agisse du logement, de l’action sociale ou du transport. En la matière, les enjeux de déontologie sont tout aussi présents que pour ce qui relève de l’action de l’État.
Je persiste à émettre un avis favorable sur ces amendements.

Mes chers collègues, dans la mesure où nous sommes d’accord pour finir ce texte cette nuit, je vous rappelle que nous avons pris trois quarts d’heure pour examiner six amendements.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour explication de vote.

Le seuil de 10 000 habitants correspond à un premier jet. Puis, l’ayant estimé trop bas, nous l’avons fixé à 100 000 habitants.
Je retire les amendements n° 1 rectifié et 45 rectifié au profit de l’amendement n° 44.

Les amendements n° 1 rectifié et 45 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l’amendement n° 24 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 2 rectifié, présenté par Mmes Muller-Bronn et Bonfanti-Dossat, MM. Guerriau, Meurant, Bonneau, Belin, Charon, Bouchet et Chauvet, Mme Dumont, MM. Houpert et Joyandet, Mmes Goy-Chavent et Noël et M. H. Leroy, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

L’amendement n° 2 rectifié est retiré.
L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Belin et Bonneau, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet, Chauvet, Charon et Chasseing, Mme Dumont, MM. Guerriau, Houpert et Joyandet, Mme Goy-Chavent, MM. Meurant et H. Leroy et Mme Noël, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le conseil pour le pilotage des décisions prises au préalable par l’État et les autorités publiques ;
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

L’amendement n° 3 rectifié est retiré.
L’amendement n° 20, présenté par Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
et en gestion des ressources humaines
La parole est à Mme Nicole Duranton.

Cet amendement a pour objet d’exclure du champ d’application de la loi les prestations de conseil en gestion des ressources humaines.
Nous considérons que ces prestations, à l’instar de l’aide au recrutement, ne relèvent pas du conseil stratégique, mais visent essentiellement à répondre aux besoins pratiques des administrations.

La commission est défavorable à cet amendement.
Les projets de restructuration et de transformation peuvent comprendre un volet relatif aux ressources humaines. Ainsi, l’adoption de cet amendement conduirait à affaiblir la portée de la loi.

L’adoption de cet amendement conduirait à déplumer considérablement le texte. Les recours aux cabinets de conseil sont très nombreux pour tout ce qui concerne les recrutements, les évaluations et les ressources humaines au sens large.
Il est essentiel que tout cela reste dans le périmètre de la proposition de loi.

Pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous renvoyer, mes chers collègues, à la page 244 du rapport de la commission d’enquête, qui décrit une prestation de Citwell, en accompagnement aux ressources humaines : « Aide au recrutement d’un analyste opérationnel à Santé publique France, SPF, qui entrera en fonction le 23 septembre 2020 : identification de profils, recueil de CV, prise de contact et proposition de profils à SPF ; réalisation des entretiens avec SPF ; matrice de synthèse des candidats short listés. »
Il s’agit donc de sujets délicats et pointus engageant des politiques régaliennes de l’État, ce qui n’est pas du tout neutre.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 29 est présenté par M. Segouin.
L’amendement n° 30 rectifié est présenté par MM. Longuet et Capus.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Ils ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Anglars et Bonneau, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Belin, Bouchet, Charon et Chauvet, Mmes Dumont et Goy-Chavent, MM. Houpert, Joyandet et Meurant, Mme Noël et MM. H. Leroy et Guerriau, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Le conseil pour le déploiement opérationnel d’outils de communication ;
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

L’amendement n° 4 rectifié est retiré.
L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, MM. Bonneau et Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bouchet et Chasseing, Mme Dumont, MM. Charon, Chauvet et Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Houpert, Joyandet, H. Leroy et Meurant et Mme Noël, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
5° Le conseil pour l’application et l’exécution opérationnelle des politiques décidées par l’État et les autorités publiques ;
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

L’amendement n° 5 rectifié est retiré.
L’amendement n° 6 rectifié, présenté par Mme Muller-Bronn, M. Belin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonneau, Bouchet, Chasseing, Charon et Chauvet, Mmes Dumont et Goy-Chavent, MM. Guerriau, Houpert, Joyandet, H. Leroy et Meurant et Mme Noël, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, une prestation de conseil s’inscrivant dans un périmètre d’exécution et de déploiement des stratégies préalablement décidées par l’État et les autorités publiques
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

L’amendement n° 6 rectifié est retiré.
L’amendement n° 21, présenté par Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Remplacer les mots :
à titre individuel
par les mots :
en qualité d’indépendant
La parole est à Mme Nicole Duranton.

Cet amendement vise à préciser la définition des consultants au sens de la loi.
L’article 1er prévoit l’inclusion, dans la catégorie des consultants, des « personnes physiques qui s’engagent à titre individuel avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ».
Si les termes « qui s’engagent » renvoient assurément aux personnes physiques ayant passé un contrat avec l’administration bénéficiaire, les termes « à titre individuel » sont beaucoup plus ambigus et sources de difficultés d’interprétation. Une lecture extensive de ces termes pourrait, par exemple, conduire à inclure, dans la définition des consultants, les agents contractuels de droit public ou les vacataires recrutés pour assurer des tâches ponctuelles relevant des prestations de conseil.
De tels agents sont en effet des personnes physiques, qui s’engagent à titre individuel avec leur administration d’emploi. Or il convient de ne pas inclure les ressources humaines internes à l’administration dans le champ d’application.
Dans un souci de clarté et d’intelligibilité, nous proposons de substituer aux termes « à titre individuel » les termes « en qualité d’indépendant ». Les agents de l’administration recrutés par contrat seraient ainsi clairement exclus du champ d’application de la loi, alors que les personnes physiques exerçant des activités de consultance au profit d’une administration, sans être employées ni par celle-ci ni par un cabinet de conseil, seraient soumises au respect de la loi.

Dans le cadre de cet article, les termes « à titre individuel » s’entendent par contraste avec les personnes qui interviennent au travers d’une personne morale. Nous souhaitons donc en rester à la rédaction proposée par la commission : avis défavorable.
Il me semble que la visée de l’amendement n’est pas dénaturée par l’expression « à titre indépendant ».
En revanche, l’expression « à titre individuel » est particulièrement ambiguë. Il serait tout de même extrêmement dommageable que les agents contractuels entrent dans la définition de la proposition de loi.
Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par Mmes Muller-Bronn et Bonfanti-Dossat, MM. Bonneau, Belin, Bouchet, Charon et Chauvet, Mme Dumont, MM. Guerriau, Joyandet et H. Leroy, Mme Goy-Chavent, M. Meurant, Mme Noël et M. Houpert, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ni stratégique
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 8 rectifié, présenté par Mmes Muller-Bronn et Bonfanti-Dossat, MM. Bonneau, Belin, Bouchet, Charon et Chauvet, Mme Dumont, M. Guerriau, Mme Goy-Chavent, MM. Houpert, Joyandet, H. Leroy et Meurant, Mme Noël et M. Chasseing, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Remplacer les mots :
aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées
par les mots :
et projections fondés sur des données chiffrées et sourcées ainsi que sur des estimations factuelles
La parole est à Mme Laurence Muller-Bronn.

Cet amendement a pour objet de s’assurer que l’expertise sous-traitée par l’État aux cabinets de conseil repose sur de réelles compétences.
Le rapport de la commission du Sénat, ainsi que l’enquête publiée par deux journalistes, intitulée Les infiltrés, ont révélé le manque de rigueur et le caractère parfois désinvolte et inutile des travaux et livrables rendus par les consultants.
Ainsi, dans le cadre des recommandations de McKinsey pour la campagne sur la quatrième dose de vaccination, l’unique scénario portait sur 100 % d’adhésion. Quant au scénario de réduction des coûts sociaux avec la baisse de 5 euros de l’APL, l’aide personnalisée au logement, on voit ce qu’il en reste aujourd’hui. Autre exemple, l’invention des masques grand public a été une décision publicitaire et non une décision émanant d’une autorité sanitaire.

Je remercie notre collègue Laurence Muller-Bronn d’avoir retiré un certain nombre d’amendements. En effet, même si nous avions salué l’état d’esprit qui avait présidé à leur rédaction, ils allaient presque à l’encontre du but recherché.
La commission est défavorable à l’amendement n° 8 rectifié, qui relève d’un degré de précision qui ne semble pas utile.
L’ensemble des prestations de conseil ne repose pas forcément et systématiquement sur des données chiffrées. L’adoption de cet amendement poserait donc un problème d’application : avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 16, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les cabinets de conseil indiquent aux administrations les différents scénarios de projet qu’ils ont décidé d’exclure et expliquent les raisons pour lesquelles ces scénarios de projet n’ont pas été retenus.
La parole est à M. Guy Benarroche.

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre l’influence indue des cabinets de conseil sur les décisions publiques.
Il semble important que ces cabinets indiquent aux administrations les nombreuses pistes envisagées lors de la construction d’un projet, afin que les consultants n’aient pas de marge de manœuvre disproportionnée dans le choix du scénario proposé.
Ainsi, les auteurs du présent amendement demandent que les prestataires et consultants soient par principe obligés de proposer l’ensemble des scénarios envisagés et de motiver leur décision d’abandon de l’un ou l’autre de ces mêmes scénarios, ce qui paraît constituer une garantie supplémentaire.

Même si nous en mesurons le sens, l’adoption de cet amendement rendrait complètement inopérant l’application de l’article 1er.
En effet, la liste des scénarios non retenus pourrait devenir illimitée. Si la volonté des auteurs de l’amendement est d’aller vers plus de transparence et une meilleure justification de ce qui est retenu par rapport à ce qui ne l’est pas, les dispositions proposées risqueraient davantage de bloquer les processus que d’assurer une plus grande transparence.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 28, présenté par Mme M. Vogel, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Ils n’effectuent pas d’action de représentation d’intérêts, au sens de l’article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, au nom de tiers, au sens de l’article 18-3 de la même loi.
La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Cet amendement vise à créer une incompatibilité légale formelle entre les cabinets de conseil, qui contractualisent avec l’État, et les cabinets d’affaires publiques, qui contractualisent auprès de clients privés pour exercer en leur nom des activités de représentation d’intérêts auprès des décideurs publics.
La commission d’enquête parlementaire – je pense notamment à l’audition du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique – a bien démontré que les cabinets de conseil intervenant auprès de l’État, n’étant pas des représentants d’intérêts au sens propre, n’étaient pas inscrits au répertoire de la HATVP, sauf rare exception.
Le risque, à défaut de garanties légales réaffirmées, serait évidemment qu’un cabinet de conseil se prévale de sa mission auprès de l’État pour vendre à ses clients privés une influence supposée ou réelle, ce qui serait constitutif d’un avantage indu et même, dans certains cas, d’un délit pénal de trafic d’influence.
Il apparaît donc nécessaire et utile d’établir légalement que les cabinets de conseil qui contractualisent avec l’État ont l’interdiction d’effectuer auprès des pouvoirs publics toute action de représentation d’intérêts au nom de tiers.
Je précise bien évidemment que cette interdiction n’exclurait pas du tout la possibilité que ces cabinets effectuent des actions de représentation d’intérêts en leur nom propre ou via leurs associations professionnelles.

La question de la représentation d’intérêts, que vous soulevez, peut être réglée dans le cadre créé par la proposition de loi en matière de conflit d’intérêts des cabinets de conseil.
Un prestataire qui utiliserait la mission de conseil qu’il effectue auprès d’une administration pour faire de la représentation au profit d’un autre client serait de fait en situation de conflit d’intérêts, donc punissable par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.
Il ne nous semble donc pas opportun d’introduire dans le texte la précision d’une incompatibilité générale entre ces professions : avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Sueur, M. Vallet, P. Joly, Montaugé et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux prestations de conseil réalisées à son bénéfice par les prestataires et consultants mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces règles sont rendues publiques.
L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les prestataires et les consultants. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.
Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au prestataire ou consultant concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Dès lors que la série de mesures contenue dans ce texte apparaît bénéfique pour l’ensemble des services de l’État, il est logique qu’elle s’applique aussi aux assemblées parlementaires. Je ne vois pas pourquoi il en irait autrement.
Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause l’indépendance des assemblées parlementaires. De même que la loi qui a établi un cadre pour les activités de représentation d’intérêts s’applique au Sénat dans les conditions fixées en toute indépendance par le bureau du Sénat, nous souhaitons que les dispositions de la présente proposition de loi s’appliquent au Sénat comme à l’Assemblée nationale selon les modalités qui seront définies et mises en œuvre par le bureau de chaque assemblée, dont, précisément, il s’agit de préserver l’indépendance.

En l’état, rien n’empêche le bureau de chaque assemblée parlementaire de mettre en place ses propres règles en l’absence de base légale. Il nous semble un peu prématuré d’imposer par amendement une telle extension de la présente proposition de loi aux chambres parlementaires : avis défavorable.
Au nom de la séparation des pouvoirs, avis de sagesse, monsieur le président.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire.
II. – Le prestataire et les consultants ont l’interdiction d’utiliser tout signe distinctif de l’administration bénéficiaire ou des tiers mentionnés au I dans leurs relations avec ceux-ci et sur les documents qu’ils produisent pour le compte de l’administration bénéficiaire.
III. – Lorsqu’un document a été rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants, l’administration bénéficiaire y mentionne cette information, précise la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel dans lequel s’inscrit ladite prestation.
(Supprimé) –
Adopté.
IV. – §
Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.
Il comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq dernières années, à titre onéreux ou dans le cadre d’actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information :
1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;
2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;
3° L’intitulé et la référence de l’accord-cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;
4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord-cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;
5° L’objet résumé de la prestation ;
6° Le montant de la prestation ;
7° Le nom et le numéro de système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous-traitants ;
8° Le groupe de marchandise auquel se rattache la prestation au sens de la nomenclature des achats de l’État.

On ne saurait sous-estimer l’importance de l’amendement déposé par le Gouvernement à cet article : il acte le recul du Gouvernement quant à la transparence des prestations de conseil. Il faut d’ailleurs le replacer dans son contexte, qui a été évoqué lors de la discussion générale : nous sommes dans une situation où, par exemple, un journal, Le Monde, est obligé d’aller devant le tribunal administratif pour obtenir des informations…
En pratique, les ministères ne répondent pas aux sollicitations des journalistes : ils refusent de communiquer les documents demandés. Ils perdent devant la Commission d’accès aux documents administratifs (Cada), mais jouent la montre – ils savent que les procédures judiciaires engagées prennent des mois, voire des années, et qu’ils seront « tranquilles » dans l’intervalle… C’est ainsi que les choses se passent, notamment pour le rapport McKinsey sur l’avenir du métier d’enseignant, que le Gouvernement refuse toujours de publier.
D’une manière générale, nous assistons à un retour de l’opacité depuis que la commission d’enquête a achevé ses travaux. L’amendement présenté par le Gouvernement vise, sous des airs techniques, à supprimer au moins quatre garanties de transparence prévues par notre texte.
Première garantie : la publication des bons de commande. Ces documents sont bel et bien communicables, en vertu d’un principe rappelé par la Cada ; pour qu’ils puissent être transmis, il suffira de biffer le nom du fonctionnaire en charge, ce qui ne me semble pas insurmontable à l’heure du numérique…
Nous demandons aussi, deuxièmement, l’établissement d’une cartographie des ressources humaines (RH) des ministères, afin que l’État puisse mieux mobiliser ses compétences internes et moins recourir aux consultants extérieurs, ainsi que, troisièmement, l’inclusion des informations relatives aux prestations de conseil dans le rapport social unique des administrations concernées, document transmis aux représentants du personnel, afin que ces derniers puissent en débattre.
Nous souhaitons, quatrièmement, que les données rendues publiques fassent l’objet d’une consolidation sur cinq ans. Le Gouvernement, quant à lui, propose que cette durée soit réduite à deux ans et que l’information ainsi retracée soit décentralisée au niveau de chaque établissement public, ce qui reviendrait à la rendre éparse. Les établissements publics sont certes autonomes sur le plan administratif, mais ils sont rattachés à l’État via leur ministère de tutelle.
Le Gouvernement propose également d’ajouter des exceptions à la transparence afin d’éviter la publication de certains documents – je n’y reviens pas dans le détail, il y a déjà été fait référence. Les informations basiques – objet résumé des prestations de conseil, montant – dont nous demandons la communication ne sont pas couvertes par le secret des affaires. Au regard des règles de la commande publique, elles devraient d’ailleurs déjà faire l’objet d’une publication. Elles recoupent la liste dont la commission d’enquête a préconisé la publication sans que cela soulève de difficultés.
Le Gouvernement ne saurait donc se cacher derrière le secret des affaires pour refuser cette publication : une telle position serait à la fois juridiquement infondée et démocratiquement contestable.

Je m’associe à tous ceux de nos collègues qui sont intervenus précédemment pour rendre hommage au travail de grande qualité effectué par la commission d’enquête sur l’influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, qui aboutit à la présente proposition de loi de nos collègues Éliane Assassi et Arnaud Bazin.
L’article 3 prévoit la création d’un document budgétaire où seraient recensées les prestations de conseil réalisées au profit des administrations publiques – État, établissements publics, hôpitaux. En effet, les travaux de la commission d’enquête ont mis en évidence les difficultés que rencontrait l’État lui-même pour chiffrer l’étendue du recours auxdites prestations. Le rapport fait état de sommes considérables et croissantes : 900 millions d’euros environ en 2021, comme l’ont rappelé différents intervenants.
Il s’agirait d’annexer un tel document au projet de loi de finances pour créer un véritable jaune budgétaire, au nom de la transparence et de la lisibilité des données. La commission des lois a approuvé cette mesure, tout en la redéfinissant, afin de garantir le respect du domaine exclusif des lois de finances.
Je me rallierai donc, pour ce qui est de cet article 3, à l’avis de Mme la rapporteure et des collègues de la commission, qui se sont investis sur ces sujets.

L’amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.
Il comprend pour chaque ministère :
- une description de la stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;
- les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne ;
- la liste des prestations de conseil réalisées au cours des deux exercices précédents, à titre onéreux ou relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.
Pour chacune de ces prestations, la liste indique :
- le montant par ministère, mission et programme des autorisations d’engagement et crédits de paiement consacré aux dépenses de conseil extérieur et la part de ces dépenses sur le total des crédits alloués au ministère, à la mission et au programme ;
- l’objet résumé de la prestation, son montant, sa date de notification, sa période d’exécution, l’organisme bénéficiaire au sein du ministère et le prestataire.
Ces informations sont publiées dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information, du secret des affaires et à l’exclusion des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique et de ceux que le ministre concerné estime nécessaire de ne pas diffuser dans le cadre de la protection du patrimoine scientifique et technique de la Nation.
Les administrations, autres que l’État, mentionnées à l’article 1er de la présente loi publient annuellement les mêmes éléments que ceux définis aux alinéas précédents.
La parole est à M. le ministre.
Par souci de cohérence et afin que nos débats avancent au rythme souhaité en cette heure tardive, je présenterai d’un même mouvement l’amendement n° 32 et les amendements n° 33 et 34 respectivement déposés par le Gouvernement aux articles 3, 4 et 8 de ce texte. La proposition que je souhaite vous soumettre consiste en effet à fusionner ces articles.
Je procéderai en deux temps : après vous avoir dit les réserves que m’inspire la lecture du texte issu des travaux de la commission, je vous exposerai la proposition du Gouvernement, que j’ai déjà évoquée lors de la discussion générale. Cette proposition n’affaiblit en aucun cas le dispositif ; elle a vocation, au contraire, à le rendre plus opérant et plus efficace, c’est-à-dire tout simplement effectif.
Tout d’abord, la dispersion des informations dans différents documents obéissant à différentes temporalités souhaitée par la représentation nationale ne me semble pas de nature à rendre effectives les mesures envisagées. Certaines informations seront retracées dans un rapport remis au Parlement, dit jaune budgétaire, d’autres figureront dans le rapport social unique, d’autres encore, relatives aux bons de commande, seront publiées au fil de l’eau sans que leur « réceptacle » soit très bien défini dans la proposition de loi. Quant à la question des compétences, elle fera l’objet d’un second rapport au Parlement…
Cette dispersion, je l’ai dit, mesdames, messieurs les sénateurs, ne me paraît pas conforme à votre objectif.
Je dirai un mot du rapport social unique, visé à l’article 4, alors qu’il n’a pas vocation à retracer les informations dont il est question ce soir. L’objet de ce document est en effet défini très précisément par la loi et par le décret, autour de dix rubriques : l’emploi, le recrutement, les parcours professionnels, la formation, les rémunérations, la santé et la sécurité au travail, l’organisation du travail et la qualité de vie au travail, l’action sociale et la protection sociale, le dialogue social, la discipline. Son objet n’est donc pas, je le répète, le recours aux prestations de conseil. Le rapport social unique est d’ailleurs rédigé par les services des ressources humaines des ministères et non par les agents administratifs qui auraient la charge d’examiner ces prestations.
J’attire vraiment votre attention sur ce point : y faire figurer les informations relatives aux prestations de conseil dont l’administration concernée a bénéficié serait un dévoiement de l’objet de ce document très utile, à partir duquel sont établies notamment les lignes directrices de gestion.
Je mentionnais un autre point, celui des diverses temporalités auxquelles obéissent respectivement les différentes informations dont on demande la publication : coexisteraient une annexe budgétaire, c’est-à-dire un rapport annuel, et un rapport fait tous les cinq ans sur la question des compétences, sans parler des bons de commande intégralement publiés au fil de l’eau. Là encore, une telle hétérogénéité n’est pas de nature à rendre ce dispositif effectif et utilisable, donc à satisfaire l’objectif visé.
Puisque j’évoque les bons de commande, je dois vous dire mes réserves quant à l’idée de leur publication exhaustive. Non que je souhaite affaiblir les mesures de transparence proposées – je m’apprête à faire des propositions nettes et précises sur cette question –, mais il faut bien comprendre ce que signifierait, opérationnellement parlant, une telle publication.
En 2021 ont été passées 4 854 commandes au sens du code de la commande publique. Le travail de biffage ou de caviardage d’un certain nombre d’informations, par exemple du nom des agents publics, dont vous ne remettez pas en cause le principe, prend du temps : au bas mot, à peu près cinq heures par prestation de conseil. Cela reviendrait à consacrer 25 000 heures de travail à la simple publication de l’intégralité des bons de commande. La proportionnalité d’une telle mesure pose question.
Au chapitre des éléments qui ne me paraissent pas de bonne législation dans le texte ainsi rédigé, je citerai par ailleurs un point qui pourrait mettre en cause, en cas d’erreur, la responsabilité, y compris devant la loi, des agents qui auraient à mener ce travail assez monumental – nous pouvons en convenir – de préparation ou de caviardage des bons de commande.
Quelle est la proposition du Gouvernement ?
Il s’agit de faire figurer l’ensemble des informations utiles au sein d’un document unique. M’exprimant à la tribune, j’ai pris l’engagement que ce document devienne une annexe permanente, gravée dans le marbre, de nos textes budgétaires, mis chaque année à la disposition des assemblées.
Figureraient dans ce rapport la liste exhaustive des commandes de prestations de conseil passées par l’État et, pour chaque prestation, l’intitulé, l’administration bénéficiaire, le montant, ainsi qu’une description de la stratégie menée, ministère par ministère, pour contrôler le recours auxdites prestations. Ce document, qui sera peut-être imparfait dans un premier temps, aura vocation à être enrichi et précisera par ailleurs quels transferts de compétences auront été réalisés au bénéfice de l’administration, indiquant, en d’autres termes, quelle stratégie de réinternalisation des compétences aura été mise en œuvre.
Je m’arrête un instant sur ce point, dont vous avez raison de souligner le caractère décisif. Il me semble que c’est là l’enjeu essentiel du texte : quels moyens l’État se donne-t-il pour réinternaliser un certain nombre de compétences ? Cette fusée comprend trois étages : premièrement, les compétences réinternalisées au sein de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) – j’ai annoncé la création de quinze postes et je compte continuer cet effort de réinternalisation ; deuxièmement, la mobilisation de fonctionnaires tout à fait capables, car formés, via le travail de formation effectué avec la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (Diese) – nous vous en livrerons le bilan année après année ; troisièmement, la mobilisation de nos corps d’inspection – il arrive en effet, je vous en donne crédit, qu’il existe des redondances entre des missions menées par des cabinets de conseil et le travail accompli par les corps d’inspection.
Je prends devant vous l’engagement de faire figurer l’ensemble des informations afférentes à cet effort de réinternalisation des compétences dans ce jaune budgétaire.
J’assume, madame Assassi, qu’il puisse être fait exception au principe de la publication des bons de commande, et ce pour des raisons qui ne tiennent pas simplement au secret des affaires. Je vous en donne un ou deux exemples très précis, afin de faire réfléchir votre assemblée sur la nature des informations dont vous vous apprêtez à autoriser la publication.
Songez au travail que réalise le fisc pour optimiser sa stratégie de lutte contre la fraude fiscale en s’appuyant sur un cabinet de conseil spécialisé dans l’intelligence artificielle.
Rires ironiques sur les travées du groupe CRCE. – Mme Nathalie Goulet se gausse également.
J’assume qu’en l’espèce nous ne fassions pas publicité de notre stratégie d’optimisation de la lutte contre la fraude fiscale – et j’espère convaincre les sénateurs communistes du bien-fondé de cette position. Cet exemple n’a rien de théorique : vous n’êtes pas sans savoir que nous nous sommes appuyés sur un cabinet de conseil pour mener une mission visant à mieux repérer et traquer les propriétaires de piscines non déclarées.
Je prends un autre exemple emblématique : des cabinets de conseil nous aident à travailler sur des stratégies telles que la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène, sujet sur lequel la France est en compétition avec d’autres pays. J’assume, en l’occurrence, de ne pas laisser des puissances étrangères lire à livre ouvert l’intégralité du bon de commande relatif aux missions afférentes.
Je vous l’ai dit : la règle que je me suis fixée consiste à vous faire des contre-propositions. Tel que nous l’envisageons, ce jaune budgétaire serait régi par un principe de justification par les ministères de la non-publication éventuelle, la nature de la raison invoquée devant être communiquée. Toutes les demandes formulées par votre assemblée au travers de cette proposition de loi seraient donc satisfaites, me semble-t-il, par la publication d’un tel document unifié.
Pardon d’avoir été un peu long, monsieur le président, mais cette présentation valait argumentation pour les amendements aux articles 3, 4 et 8.

Mme Cécile Cukierman, rapporteure. « Document unique pérenne », jusque-là, nous nous retrouvons, monsieur le ministre !
Sourires.

Vous me permettrez malgré tout de noter que l’adoption de vos amendements – réécriture de l’article 3, suppression des articles 4 et 8 – aurait pour conséquence d’appauvrir le texte de la commission.
La suppression de l’article 8, par exemple, nous priverait d’un élément essentiel du document dont nous souhaitons la publication, à savoir la cartographie des ressources humaines dont disposent les ministères en matière de conseil. Or, comme l’ont rappelé plusieurs intervenants en discussion générale, une telle cartographie est plus que jamais nécessaire.
De surcroît, la liste des prestations serait amputée des données relatives à l’accord-cadre auquel se rattache la prestation de conseil, ainsi que des données relatives au marché, au lot et au bon de commande afférents. Ces données participent pourtant pleinement de l’objectif de traçabilité que souhaitent promouvoir les auteurs de cette proposition de loi.
Votre réécriture de l’article 3 revient par ailleurs à élargir le champ des exceptions au principe de la publication des données. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement n° 32.
Sur l’amendement de suppression de l’article 4 – je me permets, comme M. le ministre, d’anticiper sur la suite de la discussion –, la commission a également émis un avis défavorable. La publication en données ouvertes des informations relatives aux prestations de conseil et des bons de commande représenterait à nos yeux l’aboutissement du mouvement de transparence engagé. La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique prévoit d’ailleurs que l’ouverture des données publiques est la règle et que « la mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État. »
Je suis déjà intervenue sur la proposition de suppression de l’article 8 ; je n’y reviens pas.
Avis défavorable, donc, aux amendements n° 32, 33 et 34 du Gouvernement.

Je ne suivrai le Gouvernement sur aucun de ces trois articles, 3, 4 et 8.
En matière de fraude fiscale, et notamment de fraude à la TVA, nous avons eu énormément de difficultés à obtenir le moindre conseil extérieur. On nous a expliqué en long, en large et en technicolor que les ressources internes étaient suffisantes. Pour quel résultat ? Nous sommes le dernier pays d’Europe pour ce qui est de lutter contre la fraude à la TVA !
Mme Parly, lors de son audition par notre commission d’enquête, s’était engagée à nous donner le résultat de ses consultations privées sur le projet de logiciel Louvois, dont on sait le succès foudroyant…
Sourires.

Je me fie au travail de notre commission et ne voterai pas les amendements du Gouvernement.

Monsieur le ministre, merci et de vos explications et des deux exemples précis que vous nous avez donnés.
En matière de stratégie industrielle, l’honnêteté oblige à dire que des questions se posent… Vous avez parlé de l’hydrogène. Vous auriez aussi pu évoquer la question spatiale, la question énergétique, celle des télécommunications. Toutes valent bien un débat au Parlement sur les filières industrielles qu’il nous faut protéger d’intérêts étrangers.
En revanche, je vous prie de nous excuser d’avoir souri à l’évocation de l’évasion fiscale. Nous voudrions bien savoir quel cabinet aide le ministère de l’économie et des finances sur cette question…

Espérons qu’il ne s’agit pas de McKinsey ! Si tel était le cas, il faudrait que le cabinet inscrive son propre nom tout en haut de la liste, lui-même pratiquant « plein pot » l’optimisation fiscale, n’ayant pas payé d’impôts pendant dix ans…
Nous voulons donc bien savoir quel cabinet vous aide et quelles sont ses pratiques en matière fiscale : sont-elles au moins en adéquation avec l’objet de la mission que vous lui confiez ?
Le deuxième exemple que vous avez invoqué, nous l’entendons. Quant au premier exemple, s’agissant d’une question régalienne – Mme Goulet ne nous détrompera pas – et complexe, il faut des fonctionnaires en nombre suffisant pour s’en acquitter correctement. Les membres de notre groupe n’ont cessé d’alerter le Gouvernement quant à la réduction du nombre de fonctionnaires affectés à la lutte contre la fraude fiscale et contre l’optimisation fiscale, phénomènes qui pèsent lourdement dans le déficit de l’État.
Très respectueux de cette proposition de loi – vous avez pu le constater –, j’essaie d’argumenter à l’appui de mes positions en donnant des exemples concrets. Un tel effort n’empêche pas de faire preuve d’un peu de malice… J’ai choisi, en connaissance de cause, un exemple qui vous ferait réagir.
Nous sommes tout autant que vous attachés à la lutte contre la fraude fiscale. Je n’ai pas pris cet exemple en l’air : j’ai fait référence à un vrai projet, qui a trait à la capacité du fisc à mieux traquer les fraudeurs, et notamment les possesseurs de piscines. Ce projet, qui a abouti et même donné lieu à des articles de presse, a été mené par mon administration avec l’appui d’un cabinet. Je souhaite vous rassurer : il ne s’agit pas de McKinsey.
Je réitère néanmoins mon affirmation : dès lors que la non-publication des informations relatives à l’intitulé de la commande, à son montant et à l’identité du ministère concerné fait l’objet d’une justification dans le jaune budgétaire, dès lors également, Mme la rapporteure, que la question des transferts de compétences reste bien intégrée au document budgétaire unique qui serait soumis à votre analyse, ma conviction sincère est qu’il n’y a là nul recul.
Certains sujets, à l’image des sujets industriels – vous avez eu l’amabilité de les mentionner, monsieur le sénateur –, font l’objet de travaux et de bons de commande dont nous assumons la non-publication.

M. Éric Bocquet. Pardonnez-moi, monsieur le ministre, de rebondir sur la traque des piscines non déclarées, exemple savoureux s’il en est. Google devait 7 milliards d’euros à la France. On a discuté, transigé, et le chèque n’est plus que de 1, 7 milliard d’euros… Google, en guise de « remerciements », va donc aider le Gouvernement à repérer les piscines non déclarées ? Cette affaire devient complètement cocasse…
Mme Marie-Noëlle Lienemann applaudit.

Le Gouvernement est-il prêt, monsieur le ministre, à publier le document que McKinsey a produit sur le métier d’enseignant, rapport cité à de nombreuses reprises dans nos échanges comme dans le rapport de la commission d’enquête ?
À propos du travail considérable qu’exige de la part du Gouvernement et de chaque administration la publication, ministère par ministère, de l’intégralité des documents sur lesquels la Cada a émis un avis favorable de publication, je vous réponds très clairement : ce travail est en cours, coordonné par le secrétariat général du Gouvernement.
Le ministère de la transformation et de la fonction publiques a communiqué à la Cada l’intégralité des bons de commande demandés par les journalistes. Et ce travail se poursuit : les documents dont la publication a fait l’objet d’un avis favorable de la Cada seront tous transmis aux journalistes qui les ont demandés.
Exclamations sur les travées du groupe CRCE.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.
I. – Les informations mentionnées dans le rapport prévu à l’article 3 respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics.
Ces mêmes informations :
1° Sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;
2° Figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231-1 du code général de la fonction publique.
II. – Lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord-cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
Il est interdit de proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.

L’amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi de proposer, de réaliser ou d’accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ou en cas de circonstances exceptionnelles compromettant la vie ou la santé de la population.
La parole est à M. le ministre.
Que cela soit dit extrêmement clairement : je partage la finalité de l’article 5, qui est de mettre fin aux missions pro bono, pour les raisons exactes qui ont été indiquées.
Je propose deux modifications.
L’une est de pure légistique : il s’agit de préciser la mention dont vous avez vous-mêmes souhaité l’ajout à l’article 238 bis du code général des impôts et, toujours au chapitre des modifications rédactionnelles, de permettre, par exception, la réalisation à titre gracieux de prestations de conseil entre administrations. La rédaction actuelle du texte ne le permet pas, rendant par exemple impossible la réalisation par une université d’une mission gratuite au bénéfice d’une administration. Je propose donc de faire droit à cette exception.
L’autre est d’établir une seule exception à l’interdiction des missions pro bono, sur les situations les plus exceptionnelles. Nous avons, à dessein, rédigé cette disposition en des termes extrêmement stricts, précisant qu’elle vaudrait seulement « en cas de circonstances exceptionnelles compromettant la vie ou la santé de la population », c’est-à-dire une guerre ou une pandémie. Dans ces moments, les temps d’urgence ne correspondent pas toujours au temps des démarches administratives, par exemple pour passer des commandes.

Si l’article 5 ne précise pas explicitement que les prestataires et les consultants sont visés par l’interdiction posée, le champ d’application de la proposition de loi est défini à l’article 1er. Dès lors, nous pouvons déduire de cet article que l’interdiction des prestations de conseil réalisées à titre gratuit vaut pour les prestataires et les consultants.
Par ailleurs, en ce qui concerne la dérogation en cas de circonstance exceptionnelle compromettant la vie ou la santé de la population, le code de la commande publique dispose : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. »
Surtout, il revient à d’éventuelles lois d’urgence de revenir, en cas de circonstances compromettant la vie ou la santé de la population, sur ce principe d’interdiction générale.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 17, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Durant les cinq années qui précèdent une action de mécénat, il est interdit aux prestataires et consultants de réaliser, proposer ou d’accepter une prestation de conseil à destination de leurs bénéficiaires d’actions de mécénat mentionnés à l’article 238 bis du code général des impôts.
La parole est à M. Guy Benarroche.

Cet amendement vise à compléter l’article 5 en interdisant aux prestataires et consultants de fournir des prestations de conseil à un client ayant bénéficié d’actions de mécénat de leur part dans les cinq années précédentes, afin de prévenir et d’empêcher l’instrumentalisation du mécénat à des fins commerciales.

Les articles 5 et 11 de la proposition de loi nous semblent déjà constituer un cadre solide et équilibré pour les prestations de conseil réalisées au titre du mécénat. Nous ne voyons pas de raisons particulières d’encadrer davantage encore ces prestations : avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 est adopté.

L’amendement n° 11, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et pour la rédaction de l’exposé des motifs des projets de loi.
La parole est à M. Guy Benarroche.

Je tiens à préciser que l’amendement précédent avait été rédigé en concertation avec l’association Sherpa, qui travaille beaucoup sur ce sujet.
L’amendement n° 11 vise à interdire le recours aux prestataires et consultants privés pour la rédaction des études d’impact et de l’exposé des motifs des projets de loi.
Comme certains de nos collègues l’ont déjà souligné, cet exercice doit être exclusivement réservé aux services de l’État. Il s’agit d’éviter toute dépossession de leur rôle en matière d’orientation des politiques publiques.
En 2018, par exemple, le gouvernement d’Édouard Philippe avait décidé de lancer un appel d’offres pour sous-traiter à une entreprise l’exposé des motifs ainsi que l’étude d’impact de sa future loi sur les transports, moyennant 30 000 euros hors taxes, ce qui paraît tout de même un peu surprenant… Cette affaire avait d’ailleurs alerté l’opinion publique sur les problèmes d’externalisation du processus de rédaction des lois.

Comme mes collègues, j’estime anormal que l’État ne rédige pas lui-même les études d’impact et les exposés des motifs de ses projets de loi.
Cela étant, je rappelle que le III de l’article 2 de la proposition de loi crée une obligation de transparence quant à la participation de cabinets de conseil à la rédaction de documents pour le compte de l’administration, ce qui inclut bien évidemment les études d’impact et les exposés des motifs des projets de loi.
Cette obligation de transparence devrait permettre de freiner cette pratique, fortement réprouvée et qui a pu heurter nos concitoyens. Cet amendement me semble donc superfétatoire.
J’insiste sur le fait que nous devons croire à l’effectivité de cette proposition de loi qui entraînera tout le monde, je n’en doute pas, à travailler et à agir différemment.
M. Benarroche a précisé avoir travaillé avec l’association Sherpa sur son amendement : voilà une dizaine d’années, bien peu de parlementaires citaient les associations ou organismes avec lesquels ils avaient rédigé leurs amendements. Aujourd’hui, c’est monnaie courante, quels que soient les groupes. Cela démontre bien que, avec de la volonté et le soutien de la loi, les choses peuvent changer.
La commission est défavorable à cet amendement.
Vous avez raison, madame la rapporteure : « la vérité vous rendra libres », pour reprendre les citations bibliques de M. Sueur.
Le Gouvernement était pleinement favorable aux mesures inscrites dans les premiers articles, notamment à la fin des « marques blanches », ces situations dans lesquelles on ne sait pas très bien qui du cabinet de conseil, du ministre ou de l’administration tient le stylo.
Le Gouvernement soutient sans réserve ces avancées, qui répondent en grande partie aux attentes des auteurs de cet amendement : avis défavorable.

En ce qui concerne l’exposé des motifs, monsieur Benarroche, vous avez mille fois raison : il suffit que le ministre l’écrive.
M. Montaugé et moi-même avons déposé une proposition de loi sur la question des études d’impact. Je ne sais pas s’il vous arrive d’en lire, mais c’est très ennuyeux et donne même envie de dormir. Les études d’impact sont rédigées par les services du ministre qui présente le projet de loi. C’est donc bien l’État qui est à la plume. Or jamais aucun ministre ne publiera une étude d’impact critiquant son projet, bien au contraire. Cette littérature un peu compassée n’est pas intéressante.
Ce n’est pas non plus à McKinsey ou à d’autres cabinets de conseil qu’il faut confier les études d’impact. Pour ma part, je ferais plutôt confiance à des organismes scientifiques – universités, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)… –, qui ne diront pas nécessairement du bien du travail des fonctionnaires du ministère.
Nous devons réfléchir à cette question, car les études d’impact, telles qu’elles sont réalisées aujourd’hui, sont une fausse bonne idée.
Mme la rapporteure approuve.

M. le président. Il s’agit tout de même une obligation constitutionnelle…
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – Toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :
1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants, ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;
2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ;
3° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ;
4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique.
II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.
Elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Cet article constitue un pilier essentiel de la proposition de loi pour mettre fin à l’opacité dont le Gouvernement fait preuve, aujourd’hui encore.
En effet, le document sur le détail des missions et leur prix, tant attendu par le Sénat et obtenu début octobre, laisse perplexe. Les dépenses sont toujours très élevées : leur coût total dépassera en 2022 son niveau d’avant la crise sanitaire, soit environ 230 millions d’euros.
Ce coût pose question sur le maintien de certaines missions, dont le caractère superflu, voire inutile, avait pourtant été largement documenté, tant par le Sénat que par les enquêtes journalistiques.
Enfin, le contenu du document reste trop évasif pour contrôler les objectifs de ces prestations. Nous y apprenons, par exemple, que le cabinet espagnol Tecnoambiente a réalisé six missions pour le ministère de la transition écologique pour un montant de 25, 3 millions d’euros. Il s’agit, selon le document, d’études géophysiques pour l’implantation d’un parc éolien au large de la Bretagne. Nous y lisons que « le prestataire a mis à disposition un navire et un équipage pour étudier les zones d’implantation, réaliser des tests de forage en pleine mer, etc. » Ce « etc. », vous en conviendrez, semble un peu léger pour comprendre et justifier une telle dépense.
C’est pourquoi il faut impérativement inscrire dans la loi le contenu, l’évaluation et les conséquences concrètes des prestations fournies.

L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
Sous réserve des secrets protégés par la loi et à la condition qu’elles ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, les évaluations sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
La parole est à M. le ministre.
Je partage la finalité de l’article 6, qui vise à renforcer le principe d’évaluation des prestations de conseil. Je ferai d’ailleurs remarquer que ce principe figurait dans la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022 et a été intégré dans l’accord-cadre renouvelé de la direction interministérielle de la transformation publique (DITP) que j’ai présenté voilà quelques instants.
La DITP a établi un modèle type, que je tiens à votre disposition, pour encadrer et « normer » la façon dont on évalue les prestations de conseil.
L’amendement que je présente concerne deux mises en cohérence.
La première rejoint le débat que nous venons d’avoir. Il s’agit de soustraire à la publication des évaluations des prestations de conseil les informations couvertes par un secret protégé par la loi.
La deuxième est une mise en cohérence avec la loi de 1978, qui s’intéressait déjà aux documents publiables par l’administration. Elle avait ainsi introduit un article L. 311-2 dans le code des relations entre le public et l’administration selon lequel seules les évaluations portant sur des décisions prises par l’autorité et la puissance publique pouvaient être publiées, ce qui entraînait une exception pour les évaluations des décisions portant sur des avis que l’État n’a pas encore rendus.
Je propose donc au Sénat de se mettre en conformité avec la volonté du législateur de 1978.

M. le président. Subsiste ici un survivant de cette époque : c’était mon premier texte !
Sourires.

Par cet amendement, le Gouvernement cherche à exclure l’obligation de publication des évaluations des prestations de conseil qui porteraient atteinte à l’ensemble des secrets protégés par la loi, ainsi que les évaluations des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration.
La rédaction de cet amendement semble un peu trop large : elle englobe le secret des affaires et risque de priver de leur portée une grande partie des dispositions prévues à l’article 6. Un certain nombre de protections ont déjà été prévues, notamment pour les décisions administratives en cours.
Il s’agit d’un vrai sujet. En l’état, la commission est défavorable à cet amendement, mais souligne sa volonté de trouver une rédaction à même de répondre aux impératifs de protection.
Ce serait affaiblir le texte que de ne pas intégrer cette modification pour permettre une mise en cohérence avec la loi de 1978.
Dès lors que la décision publique a été rendue, cette exception tombe et l’évaluation est publiée de façon pleine et entière.

Monsieur le ministre, en introduisant subrepticement le secret des affaires dans le texte, vous ajoutez un élément qui peut être lourd de conséquences et risque même de faire exploser tout l’intérêt de la proposition de loi.
Les cabinets de conseil pourraient ainsi exciper à tout moment du secret des affaires. Je crains l’effet déflagrateur de votre proposition par rapport à notre exigence de transparence.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 6 est adopté.
Après l’article 5 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :
« Art. 5 -1. – I. – Les consultants mentionnés à l’article 1er de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques emploient la langue française dans leurs échanges avec l’administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.
« Ils ne peuvent utiliser ni expression ni terme étranger lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.
« II. – Outre la rédaction en langue française, les documents auxquels les consultants participent peuvent comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère. »

Je profite de cette explication de vote pour préciser et éclaircir les choses. J’aimerais, monsieur le ministre, vous entendre sur cet article et savoir ce que vous en pensez sur le fond.
En France, il n’y a pas de police de la langue. Nous devons démystifier cette idée et ne pas tomber dans la caricature. Dans le privé, sur les réseaux sociaux, les gens parlent entre eux comme ils l’entendent – et c’est heureux. Mais plus on entre dans les interactions sociales, à commencer par le monde du travail, plus les règles se précisent.
Nous parlons dans cet article des pouvoirs publics. Le Premier ministre, chef de l’administration, et les ministres sont là pour faire appliquer un droit, qui découle de certaines normes telles que la Constitution et la loi Toubon, par exemple. L’administration doit aussi suivre les circulaires primo-ministérielles, notamment sur la féminisation des titres. On doit dire aujourd’hui « Mme la préfète » et pas autrement. Si des préfètes, dans certains départements, continuent de se faire appeler « Mme le préfet », elles sont en contradiction avec ce que dit leur administration.
De la même façon, quand Édouard Philippe, par circulaire, demande à son administration de s’exprimer d’une certaine façon, et pas d’une autre, sur la question du point médian, et non sur celle de l’écriture inclusive, objet de tous les fantasmes, il en a parfaitement le droit.
Cet article précise la loi Toubon et souligne que l’administration a l’obligation de travailler et de s’exprimer en français, mais aussi qu’elle doit exiger de ceux qu’elle paye pour lui rendre des documents qu’ils s’expriment également en français.
Nous ne pourrons malheureusement pas étendre cette disposition aux grandes entreprises, y compris celles qui sont issues de grands monopoles d’État et qui ont une belle histoire publique – je pense notamment à La Poste, qui parvient à pondre des idées aussi idiotes que « Ma French Bank ». Peut-être cela viendra-t-il un jour, mais ce texte n’est pas le bon véhicule législatif. Nous en restons à l’obligation faite à l’administration de s’exprimer en français.
La question de la bonne application de cette disposition relève presque uniquement de l’administration et de ceux qui la dirigent. Vous pourrez compter sur le Parlement pour la contrôler.
Monsieur le ministre, je suis curieux de connaître votre position sur cet article.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.
Je suis tout à fait favorable à cet article. Je salue le travail de la commission des lois et de son président qui lui ont donné une base solide avec cette référence à la loi Toubon.

Comme l’ensemble de mes collègues, je partage l’objectif de cet article.
Toutefois, comme la présidente Assassi l’a souligné en discussion générale, l’article 2 de la Constitution définit déjà le français comme langue de la République. Il me semble donc que cet article est satisfait.
Il l’est même depuis l’édit de Villers-Cotterêts de 1539 – peut-être Mme Assassi l’a-t-elle oublié, car antérieur à la Révolution française. Toujours d’application, il précise que la langue de l’administration est le français. Il ne peut donc s’agir d’une autre langue. À l’époque, la concurrente était le latin, désormais c’est l’anglais.
Je ne suis pas opposé au principe, mais cet article est peut-être inutile, surtout si nous voulons éviter d’avoir des lois bavardes…
L ’ article 7 est adopté.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les cinq ans, le ministre chargé de la fonction publique remet, au nom du Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant pour chaque ministère :
1° La cartographie des ressources humaines dont le ministère dispose en matière de conseil, en interne et dans le cadre interministériel ;
2° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne ;
3° Les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 18, présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La cartographie précise le libellé des postes occupés, les compétences attachées aux fiches de poste, ainsi que les compétences hors fiches de poste dont les employés disposent ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Pour chaque recours à un prestataire ou consultant, les raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir à un prestataire ou consultant externe.
La parole est à M. Guy Benarroche.

Les auteurs de cet amendement souhaitent que le libellé des postes occupés et les compétences attachées aux fiches de poste des fonctionnaires soient précisés dans le rapport présenté au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique.
Nous demandons également au Gouvernement de motiver, dans ce même rapport, ses recours à un prestataire ou consultant externe.
Il s’agit de définir les postes, de connaître les compétences requises pour les occuper et de comprendre les raisons du recours du Gouvernement à un prestataire en fonction de ces données.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 8 est adopté.

Chapitre IV
Renforcer les exigences déontologiques
Section 1
Mieux lutter contre les conflits d’intérêts
I. – Le prestataire et les consultants réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.
Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, défini comme une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mission.
II. – Avant chaque prestation de conseil, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter.
III. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique répond aux demandes d’avis de l’administration bénéficiaire, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.
L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.
IV. – Après le 7° du I de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Elle contribue au contrôle déontologique des prestations de conseil, dans les conditions fixées par la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » –
Adopté.
I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.
En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;
3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :
1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;
3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;
5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;
7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.
V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Nous abordons un chapitre essentiel de la proposition de loi consacré aux obligations déontologiques des cabinets de conseil et des consultants.
Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, nous assistons, depuis quelques années, à un renforcement bienvenu des règles dans toutes les sphères de la société.
Le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique déclarait, le 26 janvier dernier, devant la commission d’enquête que « L’intervention des cabinets de conseil peut […] légitimement susciter des inquiétudes en matière de déontologie. »
Nous avons documenté ces risques dans le cadre de la commission d’enquête et ils ne sont pas virtuels.
Dans son édition du jour, le journal Le Monde publie un article sur le risque de conflits d’intérêts dans la gestion du plan de relance européen. L’État a le droit, et même le devoir, de connaître les autres clients de ces cabinets de conseil qui ne doivent pas pouvoir servir deux intérêts divergents en même temps.
C’est la raison pour laquelle nous sommes très circonspects face aux six prochains amendements qui seront présentés par M. le ministre. En matière de déontologie, les reculs souhaités par le Gouvernement sont en effet nombreux : sur le périmètre des déclarations d’intérêts, qui ne concerneraient plus que les dirigeants des cabinets de conseil ; sur les moyens de contrôle de la Haute Autorité qui ne pourrait plus faire de contrôle sur place, alors que la majorité des autorités indépendantes le peuvent ; sur la saisine de la HATVP par les représentants des fonctionnaires ; sur les amendes administratives, qui seraient remplacées par des sanctions pénales beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre ; sur le contrôle du pantouflage lorsqu’un consultant intègre l’administration et réciproquement ; enfin, sur les modalités d’entrée en vigueur : vous ne souhaitez pas que notre proposition de loi ait des effets rétroactifs, ce qui voudrait dire que ces nouvelles règles ne s’appliqueraient ni à l’accord-cadre de l’Union des groupements d’achats publics (Ugap), conclu l’été dernier, ni à l’accord-cadre de la DITP qui sera conclu en fin d’année.
J’ose espérer qu’il s’agit d’une erreur matérielle et que cela ne reflète pas la volonté du Gouvernement. Vous comprendrez donc, monsieur le ministre, que nous ne pourrons être favorables à vos prochains amendements.
La navette permettra d’améliorer encore le texte. Nous ne souhaitons pas revoir son ambition à la baisse, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les conflits d’intérêts.

L’amendement n° 36, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
1° Remplacer les mots :
Avant chaque prestation de conseil
par les mots :
Avant la première prestation de conseil réalisée au profit d’une administration bénéficiaire dans un des secteurs mentionnés au II de l’article 1er de la présente loi
2° Remplacer les mots :
les consultants
par les mots :
ses dirigeants
3° Remplacer les mots :
à l’administration
par les mots :
au référent déontologue de l’administration
4° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Cette déclaration est valable pour une durée d’un an à compter de sa remise au référent déontologue de l’administration bénéficiaire. Toutefois, si le même prestataire de conseil réalise une prestation dans un autre secteur mentionné au II de l’article 1 au profit de la même administration, il est tenu de lui adresser une nouvelle déclaration selon les mêmes modalités.
II. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
les consultants
par les mots :
ses dirigeants
III. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
les consultants
par les mots :
les dirigeants du prestataire
IV. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
VI. – Chaque consultant exécutant une prestation de conseil remplit une attestation sur l’honneur, répondant à un modèle fixé par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par laquelle il justifie ne pas être dans une situation de conflits d’intérêts. Lors de la remise du dernier document de la prestation, celui-ci est accompagné par l’ensemble des attestations sur l’honneur.
En cas de doute sur la sincérité d’une attestation sur l’honneur, l’administration bénéficiaire saisit la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle.
La parole est à M. le ministre.
Je veux tout d’abord souligner que le Gouvernement partage l’objectif de renforcement de la déontologie, qui est une finalité de ce texte. J’en profite pour dire notre soutien à l’article 9, que nous venons d’adopter et qui renforce ces aspects déontologiques.
Par ailleurs, et dans la circulaire du Premier ministre du 19 janvier 2022 et dans l’accord-cadre renouvelé de la DITP, nous avons intégré des mesures renforçant le contrôle déontologique, notamment les déclarations sur l’honneur des consultants.
En ce qui concerne ces mêmes déclarations, mon argument porte sur des questions à la fois de proportionnalité et d’effectivité des finalités recherchées par la loi.
Ce texte vise à instaurer une publication exhaustive pour l’ensemble des consultants. Or ce terme de consultant engloberait l’ensemble des salariés des cabinets de conseil, soit environ 120 000 personnes, dont 15 % travaillent avec l’État. Cela veut dire que des dizaines de milliers de personnes seraient concernées par les mêmes déclarations d’intérêt exhaustives que celles demandées aux parlementaires et ministres, tout comme leurs conjoints.
Le moindre consultant junior qui démarrerait sur une mission serait donc soumis, ainsi que sa conjointe ou son conjoint, à une déclaration exhaustive sur ses activités professionnelles…
De surcroît, vous avez ajouté en commission une possibilité de contrôle sur place, par la HATVP, qui ne s’applique pas aux parlementaires et ministres. J’insiste sur cet argument de proportionnalité : la proposition de loi, telle qu’elle est actuellement rédigée, fait peser sur des consultants juniors, voire sur des employés administratifs des cabinets de conseil, des dispositions plus exigeantes que celles qui s’appliquent aux responsables publics.
En l’état, la rédaction de l’article présente un risque constitutionnel. Je crois très sincèrement qu’il ne passerait pas sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel. Une question analogue a déjà été posée lors de l’examen de la loi relative à la transparence de la vie publique : le Conseil constitutionnel avait alors estimé que le recours élargi à une telle obligation de déclaration pour les conjoints entraînait une atteinte disproportionnée au droit constitutionnellement garanti à la préservation de la vie privée.
J’essaye sincèrement de vous convaincre de la bonne foi du Gouvernement sur cette question de proportionnalité.
J’insiste aussi sur la question de l’effectivité.
Quel serait le résultat concret du texte tel qu’il nous est soumis aujourd’hui ? Des dizaines de milliers de déclarations exhaustives d’intérêt arriveraient entre les mains non pas des référents déontologues des administrations, mais probablement des acheteurs. Qu’en feraient-ils et comment les administrations pourraient-elles les prendre en charge ?
Cela poserait un réel problème d’effectivité, qui pourrait mettre en danger la responsabilité même des agents publics. En effet, si, par la suite, on se trouvait face à un conflit d’intérêts, on ne manquerait pas de se demander si l’administration a bien joué son rôle, alors que l’acheteur, contrairement aux membres de la HATVP, n’est pas spécialisé dans l’analyse des déclarations d’intérêt – à moins que vous ne vouliez que l’intégralité des déclarations d’intérêts remonte à la HATVP, au risque de provoquer son embolisation.
J’émets donc des réserves sincères et motivées sur la rédaction de cet article.
Pour autant, le Gouvernement n’est pas sans contre-proposition : l’amendement n° 36 vise à centrer les déclarations exhaustives d’intérêt sur les dirigeants, ainsi que sur les cabinets de conseil, ce qui permettrait de répondre à la question soulevée.
À juste titre, vous avez affirmé vouloir connaître les autres clients des cabinets de conseil, ce que permet la rédaction proposée par le Gouvernement.
Centrons les déclarations exhaustives d’intérêt sur les dirigeants et sur les cabinets de conseil et demandons à tous les consultants de fournir, mission par mission, une déclaration sur l’honneur de non-conflit d’intérêts pour la mission sur laquelle ils sont appelés à intervenir. J’insiste sur le fait que ce document serait juridiquement et pénalement opposable si un conflit d’intérêts était avéré.
La proposition du Gouvernement ne constitue donc absolument pas un affaiblissement en matière de déontologie, mais vise au contraire à rendre cette proposition de loi plus effective.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons qu’a exposées Arnaud Bazin et que je ne rappelle pas.
Le Conseil constitutionnel a censuré l’élargissement de la déclaration aux parents et aux enfants ; or cet article le circonscrit au conjoint.
Par ailleurs, à la différence de ce qui se passe pour les élus, dont la déclaration est rendue publique, la déclaration sera remise à l’administration et contrôlée sur demande par la HATVP. Le respect de la vie privée n’est donc pas remis en cause : je le précise, puisque cette question suscite une grande inquiétude du côté des cabinets de conseil.
Je me souviens des débats que nous avons eus ici même lors de l’examen du projet de loi relatif à la transparence de la vie publique, y compris dans les couloirs : quelle que soit notre appartenance politique, nous avions tous peur du déballage de notre vie privée que cela provoquerait. Les murs garderont le secret des plaisanteries et boutades qui ont émaillé nos conversations en dehors de l’hémicycle.
Aujourd’hui, cette mesure peut encore être vécue comme une contrainte ; pour autant, dans leur très grande majorité, les élus s’y plient. Le caractère public de la déclaration et la possibilité pour le citoyen de la consulter en préfecture – ce qui est sans doute perfectible – sont acceptés et la presse ne commente pas la déclaration de chaque nouveau ministre.
C’est en la généralisant que nous désacraliserons la transparence et rassurerons ceux qui ont peur d’en être les victimes, alors qu’il s’agit de les aider.

Nous ne demandons pas la publication de la déclaration d’intérêt du conjoint, nous souhaitons en revanche que soit précisée sa profession.
D’ailleurs, monsieur le ministre, c’est ce que vous avez fait vous-même dans le cadre de l’accord-cadre de la DITP. Cette mesure ne doit donc pas soulever de difficultés particulières. Nous avons besoin de connaître les intérêts de ceux qui interviennent.

En outre, si l’acheteur qui sera le destinataire de cette déclaration d’intérêt ne s’estime pas suffisamment armé pour en juger, il pourra se retourner vers la HATVP : c’est prévu, même si je doute que les cas soient très nombreux.
Nous souhaitons donc maintenir le dispositif tel qu’il a été proposé.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 10 est adopté.
I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice :
1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er ;
2° Les actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a mobilisées et les contreparties qu’il a reçues.
II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique détermine, pour la mise en œuvre du I :
1° Le modèle, le contenu, les modalités et le rythme des déclarations ;
2° Les modalités de publication des informations correspondantes, sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

L’amendement n° 22, présenté par Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :
1° Le rythme et les modalités des communications prévues au I du présent article, ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;
2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.
La parole est à Mme Nicole Duranton.

Cet amendement a pour objet de renvoyer à un décret en Conseil d’État pris après avis public de la HATVP la définition des modalités de publication des informations relatives aux actions de démarchage, de prospection et de mécénat.
Le dispositif que nous proposons d’adopter s’inspire de celui qui a été prévu par la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
J’insiste à mon tour sur le fait que ce décret d’application sera rendu après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Un travail conjoint sera donc mené pour en élaborer la rédaction.

Nous avons confiance dans le Gouvernement, mais prévoir un décret d’application présente toujours un risque.
Il n’est qu’à raviver ce souvenir un peu délicat : le président de la HATVP rappelle souvent que, si la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite Sapin 2, est bien écrite, le décret qui a été pris en application l’a complètement dévitalisée. Ce problème persiste depuis plus de cinq ans.
Il serait bon d’éviter de reproduire les mêmes erreurs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 11 est adopté.
I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des règles déontologiques fixées par la présente section et par les articles 2 et 5.
La Haute Autorité peut se saisir d’office ou être saisie par :
1° L’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;
2° Une organisation syndicale de fonctionnaires ;
3° Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;
4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.
La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant qui peut se faire assister d’un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information.
III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées par la présente section ou par les articles 2 ou 5, elle :
1° Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure, qu’elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations ;
2° Avise l’administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.

L’amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Le prestataire de conseil ;
II. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement a deux objets.
D’une part, il s’agit de supprimer la possibilité de saisine de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique par une organisation syndicale. Cette disposition prévue dans le texte me gêne, parce qu’en l’état du droit aucune organisation syndicale ne peut saisir une autorité administrative indépendante. Ce texte créerait donc un précédent. J’ai un respect absolu pour les organisations syndicales, mais je ne crois pas qu’il revienne aux représentants syndicaux de saisir la HATVP sur les cabinets de conseil. Les organisations syndicales ont pour mission de protéger les agents de la fonction publique, de défendre leurs droits et leurs intérêts. Cette possibilité de saisine reviendrait à dévoyer leur rôle.
D’autre part, il s’agit d’écarter la mise en place d’un pouvoir de contrôle sur place de l’ensemble des salariés des cabinets de conseil qui serait accordé à la HATVP. Là encore, cette disposition créerait un précédent et une inégalité devant la loi, puisque ce pouvoir de contrôle n’existe ni pour les ministres ni pour les parlementaires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 25 rectifié, présenté par MM. Sueur, M. Vallet, P. Joly, Montaugé et Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Leconte, Marie et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En cas d’opposition et après mise en demeure préalable, le président de la Haute Autorité peut saisir la commission des sanctions qui statue sur le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le secret de la défense nationale est invoqué, celle-ci saisit pour avis la commission du secret de la défense nationale dans le cadre de l’article L. 2312-1 du code de la défense.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

En cas de refus à la suite d’une demande de communication de pièce ou de documents de la HATVP, il est proposé que cette instance puisse saisir la commission des sanctions, qui a notamment été mise en place à cette fin.
Je remercie Mme la rapporteure d’avoir formulé des suggestions très judicieuses pour améliorer cet amendement dont la rédaction était à l’origine imparfaite.
M. Stanislas Guerini, ministre. Défavorable, par cohérence avec la position du Gouvernement.
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 12 est adopté.
I. – Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :
1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;
2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ;
3° De ne pas adresser la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;
4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat, mentionnées à l’article 11 ;
5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.
Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.
II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :
1° Rendre publiques les amendes administratives prononcées, aux frais de l’intéressé ;
2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans.

L’amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :
1° De ne pas respecter les exigences des dispositions des articles 10 et 11 ;
2° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens du II de l’article 12.
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131-34 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 5° de l’article 131-39 du même code.
La parole est à M. le ministre.
Je présenterai dans le même temps cet amendement, ainsi que l’amendement n° 39 sur l’article 14 et l’amendement n° 40 sur l’article 15, puisqu’ils forment un tout.
Le débat dépasse ici, à mon sens, le périmètre de la proposition de loi telle qu’elle nous est soumise. La question du rôle de la HATVP renvoie aux débats sur la loi relative à la transparence de la vie publique ou sur la loi Sapin 2, qui portaient justement sur cette question, ainsi que sur celle du pouvoir que nous donnions à la Haute Autorité de transparence pour la vie publique.
Adopter les articles 13, 14 et 15 reviendrait à remettre fondamentalement en cause la façon dont a été pensée la HATVP pour les cas spécifiques des cabinets de conseil. Il est en effet question des régimes de sanctions. Le législateur s’est déjà penché sur la question du bon régime de sanctions applicables aux représentants d’intérêts ; il a admis une exception, celle de permettre à la HATVP d’effectuer des contrôles sur place, chez les représentants d’intérêt. Malgré cette exception, un pouvoir de sanction pénale a été réaffirmé, qui ne relevait pas de la HATVP, puisqu’il ne s’agissait pas d’un pouvoir de sanction administrative.
Ce nouveau pouvoir de sanction spécifique pour les seuls cabinets de conseil constituerait, selon moi, une dissonance par rapport au rôle de la HATVP et au droit élaboré par le législateur.
On peut débattre de ce qui serait le plus dissuasif. Pour ma part, je considère que les sanctions pénales, qui sont définies par la loi, sont dissuasives.
J’entends parfois que la HATVP serait démunie de ce pouvoir de sanction et que son rôle serait de fait inopérant. Ce n’est pas vrai : la HATVP a déjà transmis des éléments au procureur de la République : 178 dossiers ont ainsi été transmis à la justice depuis 2014, donnant lieu à 28 condamnations effectives et définitives pour des ministres et des parlementaires. Ce pouvoir est donc pleinement effectif et le dispositif déjà prévu n’est pas du tout inopérant ; bien au contraire, il me semble largement dissuasif.
L’amendement n° 39 à l’article 14 est un amendement de suppression, en cohérence avec ce que je viens d’indiquer : je suis contre la création d’un régime de sanctions, donc contre la création d’une commission des sanctions.
L’amendement n° 40 à l’article 15 est quant à lui un amendement de cohérence avec le droit européen. Le dispositif de sanctions pénales prévoit déjà des mécanismes d’exclusion des marchés publics et des mises en cohérence avec les mécanismes existants d’auto-apurement prévus par les textes européens.

La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 38.
Ce n’est pas qu’une question de procédure : nous pensons que la sanction administrative sera, en la matière, bien plus efficace, car plus rapide dans son application, par rapport à une sanction pénale qui prend beaucoup plus de temps. Nous demeurons favorables à la création d’une commission des sanctions.
Les cabinets de conseil constituent un cas spécifique. L’objectif est non pas de généraliser le dispositif à d’autres champs, mais de garder le périmètre initial prévu par cette proposition de loi. C’est pourquoi nous souhaitons maintenir la création d’une commission des sanctions au sein de la HATVP, réservée à ces seuls acteurs.
Par voie de conséquence, la commission émet un avis défavorable sur les amendements n° 39 et 40 déposés respectivement aux articles 14 et 15. Je précise que, dans le respect du droit européen, l’article 15 prévoit un mécanisme de régulation, en s’appuyant sur une collaboration « active », qui reprend la disposition de la directive, entre, d’une part, la HATVP et, d’autre part, l’administration qui a bénéficié de la prestation de conseil.

L’amendement n° 38 vise à supprimer des sanctions, par exemple lorsqu’un cabinet de conseil réalise une prestation pro bono ou qu’il utilise le logo de l’administration, ce qui est bien évidemment inacceptable à nos yeux.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 31, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer le mot :
total
par le mot :
consolidé
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L’adjectif « total » permet un parallélisme des formes avec la rédaction de l’article 20 de la loi de 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés créant la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Cet adjectif est également utilisé pour définir le montant de la sanction pécuniaire, puisqu’il est question de « chiffre d’affaires annuel total ».
Cette modification rédactionnelle créerait donc une difficulté.
L ’ article 13 est adopté.
Après l’article 19 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19 -1. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« II. – La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :
« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes ne peut pas être supérieur à un.
« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
« Le président de la commission des sanctions est élu par ses membres.
« III. – Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.
« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19.
« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle-ci.
« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »

L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 14 est adopté.
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2141-5, il est inséré un article L. 2141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141 -5 -1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
2° À l’article L. 2341-2, la référence : « L. 2141-5 » est remplacée par la référence : « L. 2141-5-1 » ;
3° Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :
a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 2141-4 et L. 2141-5
L. 2141-5-1
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141-6 à L. 2142-1
b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 2341-1
L. 2341-2
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341-3 à L. 2342-2
4° Après l’article L. 3123-5, il est inséré un article L. 3123-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -5 -1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;
5° La quatorzième ligne du tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
L. 3123-4 et L. 3123-5
L. 3123-5-1
Résultant de la loi n° … du … encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6 à L. 3126-2

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 rectifié est présenté par Mme N. Goulet.
L’amendement n° 46 rectifié bis est présenté par Mme Assassi, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. - Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 2141-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : «, 434-13 » ;
II. - Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Au premier alinéa de l’article L. 2341-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : «, 434-13 » ;
III. - Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 3123-1, après la référence : « 434-9-1 », est insérée la référence : «, 434-13 » ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

L’examen attentif des dispositions ayant pour objet d’entraîner l’exclusion de la commande publique révèle que celles-ci omettent de viser l’article L. 434-13 du code pénal relatif au faux témoignage.
Le travail de la commission d’enquête a montré que cela pouvait arriver. C’est pourquoi il convient d’ajouter à la liste des infractions pouvant entraîner l’exclusion de la commande publique les personnes qui auraient été condamnées pour ce motif.

La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 46 rectifié bis.

M. Éric Bocquet. Je rappelle l’un des temps forts de cette commission d’enquête, qui a fait le buzz, comme on dit aujourd’hui en bon français
Sourires

Arnaud Bazin a rappelé les pouvoirs d’investigation d’une commission d’enquête, dont il faut se féliciter. La commission d’enquête s’est rendue à Bercy et a constaté que le cabinet McKinsey n’avait pas payé d’impôt sur les sociétés depuis au moins dix ans, alors que le chiffre d’affaires de la firme en France a, par exemple, atteint 329 millions d’euros en 2020 – dont environ 5 % réalisés dans le secteur public – et qu’elle y emploie environ 600 salariés.
À l’évidence, nous sommes face une forme de parjure, puisque les personnes auditionnées par une commission d’enquête parlent sous serment. La commission d’enquête a donc saisi le bureau du Sénat, qui a invoqué l’article 40 du code de procédure pénale pour suspicion de faux témoignage, ce qui n’est pas rien.
Par conséquent, comme Nathalie Goulet, nous estimons qu’il n’est pas question de donner le moindre euro d’argent public à un cabinet qui serait convaincu de parjure ni de lui permettre de soumissionner pour un quelconque marché public.
Mon cabinet, qui n’a eu besoin d’aucun cabinet de conseil pour me donner cette position, me signale des difficultés rédactionnelles quant à la conformité de cette mesure par rapport aux textes européens.
C’est pourquoi je vous propose, dans un esprit très constructif, de retravailler la rédaction de ces amendements à l’occasion de la navette parlementaire, afin de l’améliorer.
Par conséquent, sur ces amendements dont il partage la finalité, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 rectifié et 46 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.

L’amendement n° 40, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 3 et 12
Remplacer les mots :
exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application
par les mots :
peine d’exclusion de l’accès à la commande publique en application du 1°
II. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a régularisé sa situation en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.
« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;
III. – Alinéa 13
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle n’a pas fait l’objet d’une peine d’exclusion des contrats de concession inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l’article 775-1 du code de procédure pénale, qu’elle a réglé l’ensemble des amendes et indemnités dues, qu’elle a régularisé sa situation en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle infraction pénale.
« Cette exclusion n’est pas non plus applicable en cas d’obtention d’un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d’un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d’un relèvement de peine en application de l’article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale. » ;
Cet amendement a précédemment été présenté par le Gouvernement. La commission a émis un avis défavorable.
Je mets aux voix l’amendement n° 40.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 15 est adopté.

Section 2
Mieux encadrer les « allers-retours » entre l’administration et les cabinets de conseil
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 124-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;
2° À la première phrase de l’article L. 124-7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;
3° L’article L. 124-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;
4° L’article L. 124-18 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé :
« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124-5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;
5° Au 3° de l’article L. 124-26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ».

L’amendement n° 41, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 124-4 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « précédant le début de cette activité, », sont insérés les mots : « s’agissant en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue des demandes émanant d’un agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, et souhaitant fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. »
2° L’article L. 124-7 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « une activité privée lucrative », sont insérés les mots : «, en particulier des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, » ;
b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique élabore des recommandations afin d’harmoniser l’examen par l’autorité hiérarchique et par le référent déontologue de la compatibilité des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif fournies au cours des trois dernières années par la personne qu’il est envisagé de nommer avec les fonctions auxquelles elle candidate. »
La parole est à M. le ministre.
La question du contrôle des aller et retour entre le public et le privé constitue sans doute le dernier débat que nous aurons sur ce texte.
Je constate que la rédaction de l’article 16 s’écarte très nettement de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et des principes relatifs à l’architecture de contrôle déontologique, introduits, non par le gouvernement de l’époque, mais bien par le Parlement. Il s’agit de principes dont la HATVP dit le plus grand bien et de mécanismes de contrôle que les administrations se sont appropriés.
Cet article créerait deux distorsions par rapport au mécanisme introduit dans la loi de 2019.
Première distorsion : il n’y aurait plus aucune hiérarchie entre les agents concernés. Alors que la loi de 2019 était centrée sur les postes à responsabilité au sein des administrations, ce qui me semble correspondre à l’exercice, à l’objectif et à la finalité de ce texte, à savoir éviter les influences, absolument tous les agents administratifs seraient concernés par le dispositif que vous voulez mettre en place. En d’autres termes, un agent administratif, tout en bas de l’échelle hiérarchique, aurait les mêmes prérogatives ou les mêmes contraintes en termes de contrôle par la HATVP que les agents occupant des postes à plus forte responsabilité.
Seconde distorsion : cet article crée un régime ad hoc pour les cabinets de conseil. Si je peux en comprendre la philosophie, cela sous-entend qu’il y a moins d’enjeux déontologiques ou d’influence pour un haut fonctionnaire qui rejoindrait l’industrie de l’armement, alors qu’il viendrait du ministère des armées, que pour un simple fonctionnaire très bas dans l’échelle hiérarchique qui rejoindrait un cabinet de conseil pour diversifier son parcours professionnel.
Dans une logique de proportionnalité et d’effectivité du texte, il vaudrait mieux se reposer sur l’architecture créée par la loi de 2019 permettant aux responsables de l’administration d’apprécier s’il existe une situation de conflit avant d’en référer au référent déontologue et, en cas de difficultés, à la HATVP pour les postes concernés. Il s’agit d’un mécanisme qui fonctionne, qui a fait ses preuves et sur lequel nous devrions pouvoir nous reposer.

Sans surprise, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le ministre, vous proposez un compromis un peu bancal entre le droit commun et la dérogation visée à cet article.
De deux choses l’une : soit le secteur du conseil entre déjà dans le cadre des dispositions prévues par le code général de la fonction publique et il faudrait alors aller au bout de la logique et supprimer complètement l’article 16, soit il est nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques pour l’activité de conseil privé, ce qui correspond à la position de la commission.
Même si j’entends les réserves que vous avez émises, monsieur le ministre, nous souhaitons conserver l’article 16 dans sa rédaction actuelle pour gagner en clarté et en lisibilité.
Un mot sur votre appréciation du caractère bancal de ce que nous proposons, madame la rapporteure. En l’occurrence, notre intention est d’améliorer le dispositif actuel d’architecture prévu dans la loi de 2019 en mentionnant les enjeux spécifiques liés aux cabinets de conseil et en s’appuyant sur la HATVP pour contribuer à la rédaction des lignes directrices de gestion dans le but de mieux travailler avec les référents déontologues des administrations.
Il s’agit donc d’un mécanisme tout à fait effectif et amélioré.

Je ne crois pas trahir l’esprit de la commission d’enquête et des cosignataires de cette proposition de loi en précisant que nous visions les responsables publics et non tous les agents publics – d’ailleurs, l’exposé des motifs le rappelle, ce qui restreint bien le périmètre.
Dans l’article 16, il est fait mention d’« agent public », ce qui peut entraîner quelques confusions. La navette parlementaire pourrait être l’occasion d’améliorer et de préciser cette rédaction.
Le nombre de responsables publics concernés chaque année est assez limité, de l’ordre d’une centaine – il n’est qu’à s’appuyer sur les données des années précédentes.
La transmission à la HATVP ne présente pas de difficulté d’examen. Sur ces questions, nous avons identifié une véritable zone de risque. J’ai déjà pris l’exemple d’un responsable de cabinet de conseil qui prend un poste à l’Élysée et qui fait venir ce même cabinet de conseil pour réorganiser le service dont il a la responsabilité : voilà une réelle zone de risques.
Nous avons besoin de prévenir de telles situations par une transmission pour avis à la HATVP, afin qu’elle détermine la liste des exclusions nécessaires et se donne les moyens du contrôle.
Une telle mesure nous paraît tout à fait proportionnée et réalisable.
Dans son rapport, la commission des lois fait mention d’agent public. À mon sens, il y a bien un véritable problème de rédaction, puisque l’article 16 concernerait l’ensemble des agents publics.
Quant au cas particulier de recrutement par l’Élysée que vous avez évoqué, monsieur le sénateur, il n’aurait pas été remis en cause par la HATVP et aucun conflit d’intérêts n’a été mis en lumière.
M. Arnaud Bazin manifeste sa circonspection.
Ce cas particulier, dont nous avons déjà discuté en amont de ce texte, n’aurait pas été visé par le dispositif proposé, j’ai eu l’occasion de le vérifier.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 16 est adopté.

Chapitre V
Assurer une meilleure protection des données de l’administration
I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils échangent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.
Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à l’issue de la prestation.
II. – Le I ne s’applique pas aux données publiées par l’administration bénéficiaire ou par les tiers mentionnés au même I.
III. – Lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I ont un doute sur le respect du présent article, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui n’ont pas de caractère personnel.
IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. –
Adopté.
I. –
Supprimé
II. – Pour participer à la procédure de passation d’un contrat de la commande publique pour une administration bénéficiaire, le prestataire de conseil produit les conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, attestant d’un niveau minimal de sécurité.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

L’amendement n° 23, présenté par Mme Duranton, MM. Patriat, Richard, Mohamed Soilihi, Théophile, Bargeton et Buis, Mme Cazebonne, MM. Dagbert, Dennemont, Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch et Mme Schillinger, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
publique
insérer les mots :
qui nécessite un haut niveau de sécurité des systèmes d’information
La parole est à Mme Nicole Duranton.

Cet amendement vise à limiter l’obligation de réaliser un audit de sécurité aux seuls contrats de la commande publique nécessitant un haut niveau de sécurité des systèmes d’information.
Nous souhaitons ainsi assurer la compatibilité de l’article 18 avec les directives européennes relatives à la passation des concessions et des marchés publics qui prévoient que les exigences en matière de recevabilité et de sélection des candidatures ne sont destinées qu’à garantir qu’un candidat ou un soumissionnaire dispose de la capacité juridique et financière, ainsi que des compétences techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat.
L’adoption de cet amendement aiderait les cabinets de plus petite taille, qui ne disposent pas toujours des ressources financières nécessaires pour mener les audits en sécurité informatique exigés : avis favorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 18 est adopté.
I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil en cours à la date de sa promulgation, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le code de conduite prévu au II de l’article 9 est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi ;
2° Les déclarations d’intérêts des prestataires de conseil et des consultants, prévues à l’article 10, sont adressées à l’administration bénéficiaire dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
II. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts.
III. – L’article 16 s’applique aux avis rendus par la Haute Autorité de la transparence de la vie publique à compter de la promulgation de la présente loi.

L’amendement n° 42, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à supprimer l’article 19, qui ne me paraît pas conforme au droit régissant la relation contractuelle. L’article 2 du code civil dispose en effet que « la loi ne dispose que pour l’avenir » et qu’« elle n’a point d’effet rétroactif. »
Lorsque votre assemblée, en 2017, a examiné le projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, vous avez réaffirmé la protection constitutionnelle des contrats en cours. Adopter l’article 19 remettrait en cause cette protection constitutionnelle.

Le débat est là depuis le début, mais nous souhaitons que ce texte s’applique, notamment aux accords-cadres de l’UGAP et de la DITP, alors même que le premier vient d’être renouvelé et que le second est en passe de l’être.
Ces accords-cadres représentent des sommes significatives et ne peuvent être ignorés : pour la DITP, il s’agit de 150 millions d’euros hors taxes entre 2023 et 2027, avec un plafond de 200 millions d’euros. Il serait donc excessif d’attendre l’expiration de ces accords-cadres, dans quatre ans, pour que la proposition de loi puisse s’appliquer pleinement.
De plus, l’absence d’application immédiate aurait pour conséquence une rupture d’égalité entre les prestations de conseil se rattachant à un accord-cadre et celles qui auraient été contractées hors accord-cadre.
Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 19 est adopté.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Nicole Duranton, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je souhaite, au nom du groupe RDPI, saluer la qualité de nos débats.
Je me réjouis de constater que l’objectif visé par la proposition de loi fait largement consensus sur les travées de notre assemblée. Les modifications apportées au texte initial vont dans le bon sens, à commencer par celles relatives à son champ d’application.
Parmi les autres avancées figure l’interdiction pour l’administration d’attribuer une adresse électronique aux consultants. Je mentionnerai également l’obligation pour les prestataires de conseil de produire les conclusions d’un audit attestant d’un niveau minimal de sécurité.
En ce qui concerne les mécanismes de transparence et de contrôle déontologique, des ajustements sont nécessaires, pour ne pas dire indispensables. Nous regrettons donc que nos amendements n’aient pas été adoptés. Nous regrettons également le rejet des amendements présentés par le Gouvernement.
À l’instar du ministre, nous souhaitons que la proposition de loi chemine. Nous sommes en effet convaincus que la navette permettra de trouver un point d’équilibre et d’aboutir à un dispositif effectif et proportionné. Elle sera aussi l’occasion de trancher la question des modalités d’inclusion des collectivités territoriales dans le champ d’application du texte.
Vous l’avez dit, madame la rapporteure, le débat de ce soir est un point d’étape, et non d’aboutissement. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera cette proposition de loi.

Nous pouvons être satisfaits du travail qui a été fait, non seulement en commission, mais aussi au cours de ces débats.
Merci, monsieur le ministre, d’avoir mentionné à plusieurs reprises la navette, ce qui nous donne beaucoup d’espoir sur le suivi des dispositions que nous nous apprêtons à voter et sur leur avenir parlementaire. Il est incontestable que la navette sera nécessaire pour rendre ce texte meilleur et plus précis.
Je regrette que nous n’ayons pas voté l’amendement n° 11 de Guy Benarroche qui visait à interdire les prestations ayant pour objet la rédaction d’études d’impact et d’exposés des motifs. Il s’agit pourtant d’un sujet très important, en ce qu’il touche à une délégation de ce qu’il y a de plus régalien dans nos ministères : la rédaction des projets de loi. Je comprends bien les propos de Jean-Pierre Sueur sur les études d’impact. Mais en ce qui concerne l’exposé des motifs, quand on sait que les cabinets d’avocats n’offrent strictement aucune garantie sur les liens d’intérêts, pour ne pas dire les conflits d’intérêts, il faudra creuser le sujet au cours de la navette.
Nous nous reverrons donc pour évoquer ces questions. Nous aborderons également, dans le cadre du projet de loi de finances, que nous examinerons dans quelques jours, le sujet d’un jaune ou d’un orange budgétaire sur les prestations de conseil.
En attendant, nous voterons ce texte avec enthousiasme.
M. Guy Benarroche applaudit.

Le groupe Les Républicains votera ce texte.
On m’indique que la mesure proposée par M. Benarroche, dans son amendement n° 11, relèverait d’une loi organique. Plusieurs sujets restent à approfondir pour parfaire et polir cette proposition de loi. Nous faisons confiance à la navette pour y parvenir.
Le principal est que l’esprit et l’architecture de la proposition de loi ont été conservés. Un État qui serait aveugle en matière de déontologie serait en danger, comme je l’ai déjà souligné. Lorsque ces dispositions auront été définitivement adoptées et stabilisées, les administrations s’en porteront mieux, car elles seront sécurisées dans leurs rapports avec les cabinets de consultants. De même, les ministres n’en seront que plus sereins.
Nous avons fait un travail intéressant sur le fond, totalement transpartisan, tout en préservant l’esprit et les objectifs de cette proposition de loi, que nous voterons donc avec beaucoup de satisfaction.
M. Marc Laménie applaudit.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 6 :
Nombre de votants344Nombre de suffrages exprimés331Pour l’adoption331Le Sénat a adopté.
Applaudissements.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 19 octobre 2022 :
À quinze heures :
Questions d’actualité au Gouvernement.
De seize heures trente à vingt heures trente :
Ordre du jour réservé au GEST

Proposition de loi constitutionnelle visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception, présentée par Mme Mélanie Vogel et plusieurs de ses collègues (texte n° 872, 2021-2022) ;
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à faire évoluer la formation de sage-femme (texte de la commission n° 16, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 19 octobre 2022, à deux heures dix.