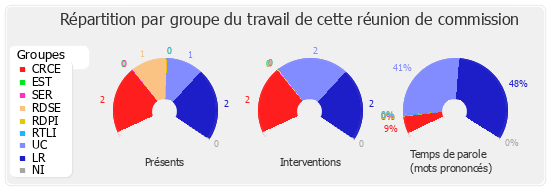Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Réunion du 20 juin 2007 : 1ère réunion
Sommaire
- Nouvelles procédures d'application de l'article 40 de la constitution
- Projet de loi portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement
- Traités et conventions
- Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort - examen du rapport (voir le dossier)
- Consentement au mariage âge minimum du mariage et enregistrement des mariages - examen du rapport (voir le dossier)
- Nomination de rapporteurs (voir le dossier)
La réunion

a présenté à la commission l'état de la réflexion et les solutions du groupe de travail sur les nouvelles procédures d'application de l'article 40. Il a rappelé le droit en vigueur issu de l'article 40 de la Constitution et de l'article 47 de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) et a indiqué que, lors de la dernière session parlementaire, 62 amendements sur 4.712 avaient fait l'objet de l'irrecevabilité financière. Il a ensuite décrit la procédure actuellement appliquée au Sénat, qui, contrairement à l'Assemblée nationale, permet le dépôt et la discussion d'amendements qui tombent sous le coup de l'article 40, la décision de la commission des finances étant alors rendue en séance. Le maintien de cette pratique ne paraît plus possible après les différentes décisions du Conseil Constitutionnel et, en particulier, celle du 14 décembre 2006 sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. En l'absence de modification, le Sénat s'exposerait à ce que le Conseil Constitutionnel sanctionne d'office les dispositions de la loi adoptée qui seraient contraires à sa jurisprudence, établissant ainsi un cadre plus contraignant que celui en vigueur à l'Assemblée nationale. Telle est la raison pour laquelle le Bureau élargi du Sénat, réuni le 5 juin, a approuvé une modification de la procédure permettant de déclarer l'irrecevabilité d'un amendement au titre de l'article 40 de la Constitution, dès son dépôt. M. Jean Arthuis s'est engagé à veiller à ce que les auteurs de ces amendements soient complètement informés et la décision de la commission des finances motivée.

A M. Robert del Picchia, qui s'interrogeait sur la solution des litiges, M. Jean Arthuis a rappelé qu'il incombait au président de la commission, directement ou par délégation, de prendre la décision. Dans ce dernier cas, en cas de contestation, il s'est engagé à réexaminer la décision et, en dernier recours, à faire trancher la question par le président du Sénat.

et Maryse Bergé Lavigne ont fait part de leur crainte que cette procédure n'aboutisse à une nouvelle restriction du droit des parlementaires à s'exprimer et à soulever des questions pertinentes.

a indiqué que les propositions de loi restaient en dehors du champ de la proposition de la commission des finances et, qu'en tout état de cause, l'application de l'article 40 n'empêchait pas la prise de parole et l'expression parlementaires. A Mme Maryse Bergé Lavigne, qui soulignait que cette nouvelle restriction pouvait être en partie compensée par l'augmentation des pouvoirs de contrôle du Parlement, M. Jean Arthuis a rappelé l'importance de développer les actions de contrôle sur pièces et sur place, faute de quoi le Parlement pourrait être accusé de « complicité dans les dysfonctionnements de l'Etat ». Il a proposé d'associer de manière pragmatique les rapporteurs pour avis et d'autres sénateurs non rapporteurs aux opérations de contrôle sur pièces et sur place des rapporteurs spéciaux.

a envisagé d'aller plus loin, en permettant à chaque parlementaire d'enquêter sur pièces et sur place.

En conclusion, M. Jean Arthuis a souligné qu'il était nécessaire, pour que le gouvernement entende le Sénat, que les commissions se mettent d'accord et que l'association des sénateurs aux missions de contrôle de la commission des finances poursuivait cet objectif. Il a enfin annoncé qu'il présenterait un rapport d'évaluation de cette nouvelle procédure d'application de l'article 40 au mois de juin 2008.
La commission a procédé à l'examen du rapport pour avis de M. Serge Vinçon sur le projet de loi n° 326 rectifié (2006-2007) portant création d'une délégation parlementaire pour le renseignement.

En préambule, M. Serge Vinçon, rapporteur pour avis, a rappelé que la commission avait souhaité se saisir pour avis de ce projet de loi qui concerne directement les trois services de renseignement du ministère de la défense et qui reprend, sous une forme identique, le projet déposé en mars 2006 à l'Assemblée nationale par le précédent gouvernement, mais qui n'avait pu être examiné au cours de la précédente législature.
Parmi les raisons qui militent pour la création d'une instance parlementaire en charge des questions de renseignement et qui avaient justifié le dépôt de propositions de loi, le rapporteur pour avis a tout d'abord cité la situation singulière de la France en Europe et parmi la plupart des démocraties parlementaires, qui disposent toutes d'une telle structure. Il s'est référé, à ce propos, à une étude de législation comparée effectuée par le service des affaires européennes du Sénat. Il rappelé que la réforme des fonds spéciaux avait certes eu pour conséquence inattendue, en 2002, la création d'une commission de vérification des dépenses réalisées par les services de renseignement à partir des fonds spéciaux, composée de deux députés, de deux sénateurs et de deux magistrats de la Cour des comptes. Mais cet organe spécialisé ne saurait dispenser d'une instance ayant une compétence plus générale sur l'organisation et les missions des services, ainsi que sur les moyens humains et techniques dont ils disposent.
Le rapporteur pour avis a estimé que la mise en place d'une instance parlementaire chargée de suivre les questions de renseignement répond à une exigence démocratique, mais vise aussi à mieux prendre en compte, au niveau politique, les enjeux du renseignement, à un moment où celui-ci joue un rôle de plus en plus crucial pour notre sécurité, notamment dans le contexte des crises régionales, du terrorisme ou de la prolifération des armes de destruction massive. Maintenir le renseignement à l'écart du débat national présenterait le double risque d'alimenter à son encontre un sentiment de méfiance, voire de suspicion, et de ne pas lui donner la place qui lui revient dans les politiques de sécurité. Une instance parlementaire contribuerait, en revanche, à une meilleure compréhension des enjeux majeurs liés au renseignement, alors que, par ailleurs, l'instauration d'un climat de confiance à l'égard des services au sein de la représentation nationale fortifierait la communauté du renseignement dans son action. Une telle instance ne peut cependant fonctionner selon les modalités habituelles du contrôle parlementaire. Le nombre de ses membres, les conditions de leur désignation, les règles applicables à ses travaux, le type d'informations auxquelles elle aurait accès et les modalités de ses relations avec les services de renseignement devaient être déterminés en tenant compte des exigences propres à l'efficacité de l'action de renseignement.
Le rapporteur pour avis a ensuite présenté les principales dispositions du projet de loi.
La délégation parlementaire pour le renseignement, commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, comporterait six membres, dont trois députés et trois sénateurs. Sur ces six membres, quatre seraient membres de droit, à savoir les présidents des commissions de la défense et des lois des deux assemblées. Les deux autres membres seraient désignés par chaque Président d'assemblée de manière à garantir une composition pluraliste.
Le champ de compétence de la délégation couvrirait les services de renseignement du ministère de la défense (direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), direction du renseignement militaire (DRM) et direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD)) et ceux du ministère de l'intérieur (direction de la surveillance du territoire (DST) et direction centrale des renseignements généraux (DCRG)).
Le rapporteur pour avis a précisé que la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale Tracfin sont généralement considérés comme appartenant à la « communauté du renseignement » et agissent dans certains domaines intéressant la sécurité nationale, comme la lutte contre le financement du terrorisme, contre les organisations criminelles transnationales ou contre le trafic d'armes. Considérant cependant que leur action, en la matière, semble moins directe que celle des services des ministères de la défense et de l'intérieur, il ne lui a pas paru indispensable, à ce stade, d'élargir le champ de compétence de la délégation au-delà des services spécialisés dans le renseignement de sécurité proprement dit.
Le projet de loi encadre strictement les attributions de la délégation, dont la mission générale est d'être informée sur l'activité générale et sur les moyens des services précités. Les ministres de la défense et de l'intérieur lui adresseront des informations et des éléments d'appréciation relatifs au budget, à l'activité générale et à l'organisation de ces services.
Toutefois, trois restrictions sont imposées quant à la nature des informations transmises :
- elles ne peuvent porter sur les activités opérationnelles des services, les instructions données par les pouvoirs publics à cet égard et le financement de ces activités ;
- elles ne peuvent porter sur les relations avec des services étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement ;
- elles excluent toute donnée dont la communication pourrait mettre en péril l'anonymat, la sécurité ou la vie d'une personne relevant ou non des services intéressés, ou pourrait compromettre les modes opératoires propres à l'acquisition du renseignement.
Le projet de loi précise que, seuls, les ministres et les directeurs des services concernés, ainsi que le secrétaire général de la défense nationale peuvent être entendus par la délégation.
Le rapporteur pour avis a justifié certaines de ces restrictions, qui visent à ne pas porter atteinte à l'efficacité des actions des services ou à la sécurité de leurs agents. Il a en revanche estimé que la rédaction du texte mérite d'être améliorée afin de compléter la nature des informations qui seront transmises à la délégation et à élargir ses possibilités d'audition.
Le projet de loi impose le secret des travaux de la délégation. Les parlementaires seront habilités ès qualités à connaître des informations relevant du secret de la défense nationale, et les agents des assemblées parlementaires les assistant pourront connaître des mêmes informations après avoir satisfait à la procédure d'habilitation prévue pour la protection du secret de la défense nationale. Les uns et les autres seront astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils auront pu avoir connaissance dans le cadre de ces travaux.
Enfin, le projet de loi prévoit qu'un rapport annuel, non public, serait remis par le président de la délégation au Président de la République, au Premier ministre et au Président de chaque assemblée.
En conclusion, le rapporteur pour avis a estimé que, d'une manière générale, le projet de loi témoignait d'un souci d'équilibre entre l'exigence d'information et celle de confidentialité, ainsi qu'entre l'évaluation parlementaire du fonctionnement des services et la nécessité d'éviter les interférences avec le domaine opérationnel. Il a ajouté que les amendements qu'il proposera viseront à renforcer le rôle de la délégation sans modifier cet équilibre. Il a souligné que le succès de la démarche reposera sur l'établissement d'une relation de confiance entre la délégation et les services.

A la suite de cet exposé, M. Yves Pozzo di Borgo a souligné l'importance du rôle joué par les services des douanes en matière de renseignement. Il a souhaité que ces services entrent dans le champ de compétence de la délégation parlementaire. Tout en reconnaissant que la délégation ne devait pas s'immiscer dans les questions relevant de la conduite des opérations, il a estimé qu'elle devrait néanmoins être informée de la liste des opérations menées par les services. Une telle disposition renforcerait, à ses yeux, la crédibilité de la délégation parlementaire, l'expérience passée ayant montré que le pouvoir politique avait parfois été tenté d'utiliser les services de renseignement à des fins contestables.

s'est félicité de la discussion prochaine de ce projet de loi. Rappelant les propositions de loi déposées il y a nombreuses années tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, il a jugé que la création d'une instance parlementaire en charge du renseignement avait beaucoup tardé et constituait moins une véritable avancée qu'une mise au niveau des normes en vigueur dans pratiquement tous les autres pays démocratiques. Il a observé que l'engagement pris devant le Parlement à la fin de l'année 2005 par le Président de la République, alors ministre de l'intérieur, n'avait été que partiellement tenu. En effet, le groupe de travail dont il avait annoncé la création et qui devait associer les représentants des principaux groupes politiques, n'a pas réellement été mis en place.
a souligné la timidité du projet de loi présenté au Parlement en matière de contrôle parlementaire des services de renseignement et a estimé que ce texte ne pouvait être qualifié d'équilibré, dans la mesure où les dispositions visant à garantir la confidentialité et à ne pas interférer avec l'activité opérationnelle avaient été, à ses yeux, exagérément privilégiées au détriment des possibilités d'information de la délégation parlementaire. Il a annoncé que le groupe socialiste présenterait plusieurs amendements visant notamment à prévoir une délégation propre à chacune des deux assemblées, une augmentation du nombre de membres, afin de permettre une meilleure représentativité, et des moyens d'investigation moins restreints. Il s'est interrogé sur la raison d'être de la commission de vérification des fonds spéciaux, dès lors qu'une délégation parlementaire pour le renseignement sera mise en place. Enfin, il s'est étonné de l'interdiction faite à la délégation de réaliser un rapport public, estimant que, dans un tel cas de figure, le Parlement en serait réduit à n'être informé que par la presse.
a considéré que si la délégation n'était pas, dès sa création, clairement mandatée dans ses attributions et dotée d'une autorité suffisante, elle serait inévitablement cantonnée dans un rôle d'intérêt limité. Il a ajouté qu'en l'état du texte, le groupe socialiste s'abstiendrait sur le projet de loi.

a tout d'abord indiqué que la démarche visant à créer une instance parlementaire compétente pour le renseignement recueille l'approbation de principe du groupe communiste, républicain et citoyen. Elle a toutefois estimé que la garantie du pluralisme est une condition indispensable à la crédibilité de la future délégation. Elle a observé qu'au vu de l'effectif prévu dans le projet de loi, éventuellement augmenté de deux parlementaires, comme le propose le rapporteur pour avis, la représentation du groupe communiste n'est pas assurée. Elle a souligné qu'une telle délégation doit inclure des représentants de tous les grands partis politiques. Par ailleurs, tout en reconnaissant qu'il fallait concilier l'information du Parlement et l'exigence de confidentialité, elle a également jugé indispensable que le rapport de la délégation puisse être rendu public. Un tel rapport public pourrait, au demeurant, asseoir la légitimité de l'action des services de renseignement et attirer l'attention sur les moyens qui leur sont nécessaires. Il éviterait que la seule information disponible pour le public sur les questions relatives aux services de renseignement résulte d'articles de presse parfois peu conformes à la réalité.
La commission a ensuite procédé à l'examen des amendements au projet de loi.
Sur le texte proposé par l'article unique pour le I de l'article 6 nonies de l'ordonnance n°58-1100 du 17 novembre 1958, elle a adopté un amendement portant de six à huit, dont deux membres nommés par le président de chaque assemblée, l'effectif de la délégation, et dénommant cette dernière : délégation parlementaire au renseignement.
Elle a adopté un amendement de conséquence au texte proposé pour le II de l'article 6 nonies de l'ordonnance précitée.
Sur le texte proposé pour le IV, elle a adopté :
un amendement reformulant les attributions de la délégation qui serait chargée de suivre l'activité générale et les moyens des services ;
un amendement précisant que la délégation recueille les informations utiles à sa mission et qu'elle ne peut connaître des informations et éléments d'appréciation concernant les échanges avec des services étrangers ;
un amendement lui permettant de procéder à l'audition du Premier ministre, ainsi que de toute personne ne relevant pas des services de renseignement.
Elle a adopté un amendement de conséquence au V, puis, au VII, un amendement prévoyant que la délégation établira un rapport public dressant le bilan de son activité.
Elle a adopté un amendement de conséquence au VIII.
Après l'article unique, elle a adopté un amendement tendant à insérer un article additionnel complétant l'article 154 de la loi de finances pour 2002 afin que la délégation parlementaire au renseignement soit destinataire du rapport de la commission de vérification des fonds spéciaux qui est actuellement adressé au Président de la République, au Premier ministre, aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances des deux assemblées.
Enfin, elle a adopté un amendement de conséquence sur l'intitulé du projet de loi.
La commission a ensuite émis un avis favorable sur l'ensemble du projet de loi modifié par ces amendements.

Après une suspension de ses travaux, la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Guy Branger sur le projet de loi n° 303 (2006-2007) autorisant la ratification de la convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.
a déploré que la traite des êtres humains fasse aujourd'hui un nombre croissant de victimes à travers le monde.
Il a rappelé que, face à ce constat, l'Organisation des Nations Unies avait élaboré, dès novembre 2000, un protocole additionnel à sa Convention contre la criminalité transnationale organisée, qui visait à « prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants », et que la France avait ratifié ce texte, dit « protocole de Palerme », en 2002.
Le Conseil de l'Europe a également jugé nécessaire, face à la montée de cette forme de crime organisé, d'élaborer un texte dont les exigences sont supérieures aux normes édictées dans le protocole de Palerme, particulièrement en matière de protection des victimes.
Ainsi a été établie, en 2005, la convention sur la lutte contre le traite des êtres humains, aujourd'hui signée par 29 Etats membres, dont la France, mais ratifiée jusqu'à présent par seulement 7 d'entre eux, alors que son entrée en vigueur en requiert 8. Il a donc souligné combien il serait opportun que ce soit la ratification française qui permette sa mise en application.
Il a décrit cette convention comme un traité global, axé sur la protection des victimes de la traite et la sauvegarde de leurs droits, mais qui comporte également des actions de prévention de la traite, ainsi que de poursuite des trafiquants.
Ce texte s'applique à toutes les formes de traite, nationale ou transnationale, liée ou non au crime organisé, quelles qu'en soient les victimes et les formes d'exploitation.
La convention prévoit aussi la mise en place d'un mécanisme de suivi indépendant garantissant le respect de ses stipulations par les Parties.
Il a rappelé qu'elle comportait une définition large de la traite, consistant dans : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation ». L'exploitation ainsi visée comprend celle « de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. »
Le consentement d'une victime à l'exploitation envisagée est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés a été utilisé.
Le rapporteur a souligné l'importance de cette stipulation, car le consentement de la victime est souvent obtenu sous la menace.
Par ailleurs, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'un enfant aux fins d'exploitation sont réputés être des formes de traite. Est considérée comme un enfant, dans le présent texte, toute personne âgée de moins de 18 ans.
a alors rappelé l'ampleur et la gravité d'un phénomène qui ne cesse de croître, y compris sur le continent européen.
Ainsi, les chiffres avancés, s'agissant des victimes, varient de 100.000 à 500.000 personnes, hommes, femmes et enfants. Plusieurs facteurs contribuent à ce développement : les restructurations économiques et politiques consécutives à la chute de l'Union soviétique et aux crises balkaniques, la mondialisation des échanges, qui touche aussi le crime organisé, comme les nouvelles méthodes utilisées par les réseaux criminels. Ceux-ci ont compris le parti à tirer de l'ouverture des frontières et des nouvelles technologies de la communication. Aux trafics d'armes et de drogues, s'est ainsi ajouté le trafic d'êtres humains, qui est au moins aussi rémunérateur et, jusqu'à présent, moins risqué pour ses auteurs.
Les femmes et les enfants en sont les premières victimes, mais sont loin d'en être les seules. Les hommes sont également touchés, notamment par le travail forcé.
a ensuite décrit les principaux éléments du texte, incitant à des actions d'information, qui doivent prévoir des mesures spécifiques au profit des migrants réguliers et des enfants, ainsi qu'une amélioration des contrôles pour prévenir et détecter la traite.
Il a plaidé pour que les documents de voyage ou d'identité soient sécurisés, pour réduire les possibilités de les falsifier, de les modifier ou de les reproduire.
Le texte stipule que les enfants ou présumés tels, jusqu'au contrôle de leur âge effectif, bénéficient de mesures spécifiques lorsqu'ils ne sont pas accompagnés, notamment de leur représentation par une autorité chargée de défendre leurs intérêts.
Les victimes de la traite doivent bénéficier d'une assistance leur assurant des conditions de vie décentes par la fourniture de logement, soins médicaux et l'accès à l'éducation pour les enfants. Ainsi, les victimes bénéficient d'un « délai de rétablissement » d'au moins 30 jours, durant lequel aucune mesure d'éloignement n'est exécutée à leur égard. Un permis de séjour peut leur être accordé, notamment aux fins d'enquête ou de procédure pénale contre les individus ayant commis des abus à leur encontre.
L'établissement éventuel d'un fonds d'indemnisation doit viser à faire bénéficier ces victimes des compensations financières prévues dans le droit interne des Etats.
Ceux-ci doivent accepter le retour de leurs ressortissants victimes de traite, sous une série de conditions précisément énumérées.
La complicité à des actes de traite est réprimée, tout comme la responsabilité des personnes morales. Les victimes, témoins et personnes collaborant avec les autorités judiciaires bénéficient de protections spécifiques. Enfin, la convention instaure un groupe de suivi de son application, par la mise en place d'« un groupe d'experts sur la lutte contre la traite des êtres humains ».
Chaque Etat peut assortir sa ratification d'une déclaration précisant qu'il se réserve le droit d'appliquer dans des conditions spécifiques certains éléments de cette convention. Sur ce point, le rapporteur a relevé que le gouvernement français a assorti la Convention d'une étude d'impact juridique détaillée, précisant les éléments de la convention qui impliquent une modification ultérieure de la législation française.
La commission a adopté le projet de loi.
La commission a ensuite procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Guy Branger sur le projet de loi n° 277 (2006-2007) autorisant la ratification du protocole n° 13 à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances.

a tout d'abord rappelé le contenu de la révision constitutionnelle du 23 février dernier, introduisant dans notre Loi fondamentale l'abolition de la peine de mort. Il a précisé que cette nouvelle rédaction de la Constitution ouvrait à la France la possibilité de ratifier plusieurs engagements internationaux, dont le protocole n° 13 à la convention de 1950 du Conseil de l'Europe, sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il a constaté que, du fait de son ancienneté, ce texte fondateur a fait l'objet de plusieurs modifications, dont deux portant sur la peine de mort.
Ainsi, le protocole n° 6, élaboré en 1983, entré en vigueur en 1985 et ratifié par la France en 1986, stipulait que : « la peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine, ni exécuté ». Mais cette affirmation de principe s'accompagnait d'une possibilité de maintien de cette peine pour « des actes commis en temps de guerre, ou de danger imminent de guerre ». En dépit de cette réserve, ce texte, a-t-il estimé, constituait une avancée notable, puisqu'il était le premier instrument juridiquement contraignant en Europe interdisant la peine de mort. Quarante-six des quarante-sept Etats membres du Conseil de l'Europe l'ont, à ce jour, ratifié. Seule, la Russie s'en est abstenue.
Le protocole n° 13, conclu en 2002, stipule que : « la peine de mort est abolie. Aucune dérogation n'est autorisée aux dispositions du présent protocole ».
Déjà ratifié par 39 Etats membres, et entré en vigueur le 1er juillet 2003, ce texte prend acte de l'évolution du droit, interne ou international, en faveur de la totale abolition de la peine de mort, y compris en temps de guerre. Cette évolution a été soutenue par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui requiert, des Etats souhaitant rejoindre cette institution, de s'engager à trois démarches successives : appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions, supprimer la peine capitale de leur législation nationale et ratifier le protocole n° 6.
L'évolution vers la prohibition totale marquée par le protocole n° 13 a été consacrée par la Conférence ministérielle européenne sur les droits de l'homme, tenue à Rome en novembre 2000, à l'occasion du 50e anniversaire de la Cour européenne des droits de l'homme. Cette conférence s'est, en effet, prononcée en faveur de l'abolition de la peine de mort en temps de guerre, et a demandé aux Etats qui n'avaient pas encore procédé à cette abolition, ni à la ratification du protocole n° 6, de ratifier ce protocole dans les plus brefs délais et, dans l'intervalle, de respecter strictement les moratoires concernant les exécutions.
Au terme de ce processus, ce 13e protocole a été adopté en 2002 par la réunion des délégués des ministres des Etats membres du Conseil de l'Europe.
en a alors explicité le dispositif, constitué de sept articles, dont les principaux éléments touchent à l'interdiction de dérogations, y compris en temps de guerre, à l'abolition de la peine de mort, et à l'irrecevabilité de réserves formulées sur les Etats signataires.
En revanche, des déclarations peuvent être faites sur l'application territoriale du protocole, les Etats pouvant, en effet, assortir leur ratification d'éléments en restreignant l'application territoriale.
La Géorgie et la Moldavie ont ainsi assorti leur ratification de déclarations relevant qu'elles ne peuvent être tenues pour responsables des actions accomplies sur les portions de leur territoire qui échappent, actuellement, à leur contrôle, respectivement l'Abkhazie et la Transnistrie.
En revanche, un Etat peut dénoncer son adhésion au protocole : cette dénonciation est possible au terme d'un délai de cinq ans après l'entrée en vigueur de la convention sur cet Etat, et avec un préavis de six mois. Cette éventuelle dénonciation est adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, qui en informe les autres Etats.
Suivant l'avis du rapporteur, la commission a adopté le projet de loi.
La commission a examiné le rapport de Mme Monique Ceriser-ben Guiga sur le projet de loi n° 278 (2006-2007) autorisant l'adhésion au deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

Après avoir rappelé le contenu de la révision constitutionnelle du 23 février dernier, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, rapporteur, a décrit l'élaboration du deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international aux droits civils et politiques élaboré sous l'égide de l'ONU. Ce pacte, adopté par les Nations unies en 1966, entré en vigueur en 1976, et auquel notre pays a adhéré en 1989, stipule que « le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Il est protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie ». A ce stade, l'affirmation du droit à la vie n'entraîne donc pas l'impossibilité pour les Etats d'y mettre un terme par une peine dûment motivée.
En 1989 a été élaboré le deuxième protocole, qui stipule qu' « aucune personne relevant de la juridiction d'un Etat partie au présent protocole ne sera exécutée » et que « chaque Etat-partie prendra toutes les mesures voulues pour abolir la peine de mort dans le ressort de sa juridiction. »
Ce protocole, une fois ratifié par un Etat, ne peut plus être dénoncé par cet Etat : il s'agit donc là d'un engagement définitif sur lequel il est impossible de revenir ultérieurement.
La seule réserve admise par ce texte est contenue dans son article 2 et porte sur la possibilité donnée aux Etats, lors de leur ratification, de continuer à prévoir l'application de la peine de mort « en temps de guerre, à la suite d'une condamnation pour un crime de caractère militaire, d'une gravité extrême, commis en temps de guerre. »
L'Etat formulant cette réserve doit alors communiquer au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies les dispositions pertinentes de sa législation interne qui s'appliquent en temps de guerre.
La formulation d'une telle réserve implique que l'Etat auteur doit notifier au secrétaire général de l'ONU la proclamation, ou la levée, de l'état de guerre sur son territoire.
a rappelé qu'une telle réserve ne saurait être émise par notre pays, alors qu'il s'apprête à ratifier le texte élaboré sous l'égide du Conseil de l'Europe, qui prohibe tout rétablissement de la peine capitale, y compris en temps de guerre.
Ainsi, a-t-elle estimé, la ratification combinée des textes adéquats de l'ONU et du Conseil de l'Europe engage la France, sans réserve, et pour l'avenir.
Elle a rappelé qu'à la différence du texte élaboré par le Conseil de l'Europe, le texte de l'ONU a une portée universelle ; ouvert aux 160 Etats, dont la France, qui ont rejoint le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce deuxième protocole facultatif regroupe 60 Etats adhérents, dont 35 l'ont seulement signé, mais pas encore ratifié.
Sur ces 60 Etats, seuls l'Azerbaïdjan, la Grèce et la Moldavie ont exprimé la réserve de maintien de la peine de mort en temps de guerre.
En conclusion, Mme Monique Cerisier-ben Guiga a conclu à l'adoption du deuxième protocole.
Suivant ces conclusions, la commission a adopté le projet de loi.
La commission a examiné le rapport de Mme Joëlle Garriaud-Maylam sur le projet de loi n° 299 (2006-2007) autorisant l'adhésion à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants.

a rappelé, en préambule, qu'en tant que sénateur représentant les Français de l'étranger, elle s'était préoccupée, depuis déjà de nombreuses années, des conflits autour de la garde des enfants de couples binationaux divorcés ou séparés et des cas douloureux d'enlèvements transfrontaliers d'enfants.
a ensuite présenté l'origine et le contenu de la convention. Elle a rappelé que la convention du 19 octobre 1996 avait été élaborée dans le cadre de la Conférence de La Haye sur le droit international privé, une organisation intergouvernementale ayant pour but de travailler à l'unification progressive des règles de droit privé. Cette convention représente une avancée majeure du point de vue de la protection des mineurs, en améliorant sensiblement les mécanismes prévus par une précédente convention de 1961. En particulier, la convention de 1996 introduit une importante novation dans la détermination de l'autorité compétente pour prendre des mesures de protection de l'enfant. Cette convention de 1961 stipulait une compétence concurrente de la juridiction de l'Etat de résidence de l'enfant et de celle de l'Etat de sa nationalité, permettant que les juges prononcent des décisions contradictoires au sujet de la garde des enfants de couples binationaux divorcés ou séparés, entraînant souvent le risque d'un déplacement illicite d'enfant ou le non-respect du droit de visite. Afin de remédier à ces difficultés, la convention de 1996 pose la compétence de principe de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. Elle unifie la loi applicable en matière de responsabilité parentale et concernant les mesures de protection de l'enfant. Elle s'efforce, enfin, de résoudre les problèmes soulevés par les déplacements illicites d'enfants.
a ensuite indiqué que la ratification de cette convention par la plupart des Etats membres de l'Union européenne, dont la France, était actuellement bloquée en raison d'une difficulté portant sur son articulation avec le droit communautaire, le cadre juridique communautaire de la coopération judiciaire civile ayant considérablement évolué entre la fin des négociations et la signature de cette convention. Le traité d'Amsterdam a entraîné la « communautarisation de ces matières » et la Communauté s'est vue reconnaître une compétence pour légiférer dans ces domaines. Sur cette base, le Conseil a adopté, le 29 mai 2000, un règlement communautaire, dit « règlement de Bruxelles II », relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale. Ce règlement a été remplacé par un nouveau règlement, dit « Bruxelles II bis », entré en vigueur le 1er mars 2005. Certaines dispositions de ce règlement couvrent exactement le même champ que la convention de La Haye de 1996.
Aujourd'hui, la Communauté a donc une compétence en vertu des traités en matière de coopération judiciaire civile et elle a exercé cette compétence sur le plan interne. La Commission européenne a en conséquence considéré que les Etats membres n'étaient plus libres de ratifier eux-mêmes la convention de La Haye, en application de la jurisprudence AETR de la Cour de justice de Luxembourg. Selon cette jurisprudence, seule, la Communauté est compétente pour signer ou ratifier des traités dans des domaines où elle dispose d'une compétence et où elle a légiféré.
Toutefois, étant donné que la convention de La Haye contient des stipulations qui n'affectent pas les compétences communautaires, il a été admis que les Etats membres et la Communauté ont une compétence partagée pour participer à cette convention, qui s'apparente donc à un « accord mixte ».
Le Conseil de l'Union européenne a donc adopté une décision le 19 décembre 2002 autorisant les Etats membres à signer cette convention dans l'intérêt de la Communauté. A l'exception des Pays-Bas, les Etats membres ont donc simultanément signé la convention de La Haye, le 1er avril 2003. Le Conseil et la Commission ont convenu que cette décision serait suivie d'une décision du Conseil autorisant les Etats membres à ratifier cette Convention, dans l'intérêt de la Communauté. Cette dérogation exceptionnelle à l'exercice normal de la compétence communautaire a été justifiée, dans ce cas particulier, en raison de l'utilité de la convention pour la protection des enfants et de la nécessité de s'assurer de l'entrée en vigueur rapide de ce texte.
La ratification de cette convention est soumise à deux conditions, l'une sur la forme, l'autre sur le fond. D'une part, les Etats membres doivent déposer simultanément les instruments de ratification ou d'adhésion à la convention. D'autre part, les Etats membres doivent souscrire, lors de la ratification, une déclaration selon laquelle les dispositions du règlement communautaire primeront sur les stipulations de la convention dans les relations entre les Etats membres de l'Union européenne. La convention de La Haye a, en effet, vocation à s'appliquer dans les rapports avec les Etats tiers, tandis que le règlement communautaire devrait régir, pour l'essentiel, les relations entre les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark, auquel le règlement communautaire ne s'applique pas.
La Commission européenne a présenté un projet de décision autorisant les Etats membres à ratifier la convention de La Haye dans l'intérêt de la Communauté. Toutefois, l'adoption de cette décision est bloquée depuis plusieurs années, en raison d'un différend entre le Royaume-Uni et l'Espagne sur l'application de ces dispositions à Gibraltar.
En définitive, pour Mme Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteur, la situation actuelle est paradoxale, puisque, d'un côté, la ratification et l'application de la convention de La Haye font partie des engagements communautaires de la France et, de l'autre côté, la France ne pourra pas déposer ses instruments de ratification auprès du dépositaire de la convention tant que n'aura pas été réglé le différend qui oppose le Royaume-Uni et l'Espagne au sujet de Gibraltar.
En conclusion, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, rapporteur, a fait part de sa profonde préoccupation à l'égard du fait qu'un instrument d'une importance majeure pour la protection des enfants reste bloqué pour une question sans rapport avec son objet.

Compte tenu de l'importance de ce sujet, M. Robert Del Picchia, président, a invité Mme Joëlle Garriaud-Maylam à présenter prochainement devant la commission une communication sur le thème de la protection des enfants dans des situations internationales.
Traités et conventions - Exercice des droits des enfants - Examen du rapport
La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Didier Boulaud sur le projet de loi n° 315 (2006-2007) autorisant l'approbation de la convention européenne sur l'exercice des droits des enfants.

a rappelé que la notion de droits de l'enfant est récente. Dans l'Antiquité, l'enfant n'était pas considéré comme une personne qu'il faut spécialement protéger. Ainsi, dans le droit romain, le père avait droit de vie et de mort sur son enfant. Le mot « enfant » vient d'ailleurs du latin « infans » qui signifie « celui qui ne parle pas ». Ce n'est qu'au milieu du XIXe siècle, essentiellement dans le cadre du droit français, qu'est née l'idée que les enfants doivent être spécialement protégés.
La reconnaissance d'un statut juridique de l'enfant au niveau international est plus tardive. Elle s'est d'abord faite dans le cadre de la Société des Nations, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'UNICEF a été créé pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre ou orphelins.
La convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, adoptée en 1989, signée et ratifiée par l'ensemble des Etats, à l'exception des Etats-Unis et de la Somalie, a marqué une étape importante. Cette convention a consacré, en effet, une approche nouvelle de l'enfant, comme une personne humaine bénéficiant, à ce titre, de droits propres.
a rappelé, à cet égard, les interrogations soulevées en France sur le caractère directement applicable ou non de cette convention. Dans un premier temps, la Cour de cassation a, en effet, par plusieurs arrêts, refusé de reconnaître un caractère directement applicable à cette convention, alors que le Conseil d'Etat établissait une distinction entre certains articles de la convention, qui étaient directement applicables, et d'autres, qui ne l'étaient pas. Par deux arrêts de 2005, la Cour de cassation s'est ralliée à l'interprétation du Conseil d'Etat. De son côté, l'Union européenne s'est également préoccupée de cette question. Les droits de l'enfant ont été reconnus dans la Charte des droits fondamentaux et la Commission européenne a proposé, en 2006, une stratégie européenne sur les droits de l'enfant.
a ensuite présenté l'origine et le contenu de la convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant. Cette convention trouve son origine dans une demande de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, qui a invité le Comité des ministres à élaborer un instrument juridique sur les droits de l'enfant qui soit propre au Conseil de l'Europe.
Au départ, cette idée avait été accueillie avec un certain scepticisme. Etant donné que la convention de l'ONU s'applique à tous ces Etats, ce nouvel instrument ne risquerait-il pas de faire double emploi ? Afin d'éviter toute duplication entre les deux textes, il a été décidé de consacrer une attention particulière à la prise en compte de l'intérêt de l'enfant dans le cadre des procédures devant les tribunaux, notamment en matière de droit de la famille.
a indiqué que la convention du Conseil de l'Europe avait été conclue le 25 janvier 1996 et qu'elle avait été signée par la France le 4 juin 1996.
Cette convention vise à promouvoir les droits des enfants, notamment en veillant à ce qu'ils puissent eux-mêmes, ou par l'intermédiaire d'autres personnes ou organes, être informés et autorisés à participer aux procédures judiciaires qui les concernent.
Chaque Etat doit, au moment de la signature ou de la ratification de la convention, déclarer au moins trois catégories de litiges familiaux auxquels la convention a vocation à s'appliquer. D'après l'exposé des motifs du projet de loi, le Gouvernement entend appliquer cette convention aussi bien aux procédures où l'enfant est partie, notamment lorsqu'il est victime de maltraitance, qu'à des contentieux où le mineur n'a pas la qualité de partie, comme le divorce de ses parents par exemple.
La principale nouveauté tient à la reconnaissance à l'enfant capable de discernement du droit d'être informé et d'exprimer son opinion dans les procédures qui le concernent directement. Il appartient aux Etats de définir les critères d'appréciation de la capacité des enfants à forger et exprimer leur propre jugement.
a indiqué que la ratification de cette convention ne devrait entraîner aucune modification du droit français. Notre pays dispose, en effet, d'une législation très complète en matière de protection des mineurs. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance a introduit dans le code civil, pour le mineur capable de discernement, le droit à être entendu par le juge dans toutes les procédures qui le concernent, dès lors qu'il en fait la demande (article 388-1 du code civil). Par un amendement du groupe socialiste, adopté à l'unanimité, le Sénat a d'ailleurs renforcé ce dispositif, en prévoyant une disposition selon laquelle le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
a précisé que le droit de l'enfant d'être entendu ne signifie pas qu'il faille systématiquement l'auditionner s'il ne manifeste pas de volonté en ce sens. L'enfant a aussi le droit de rester silencieux, notamment en cas de conflit familial où il est très difficile, pour un enfant, de se sentir l'enjeu de ses parents.

Enfin, la commission a examiné le rapport de M. Yves Pozzo di Borgo sur le projet de loi n° 319 (2006-2007) autorisant l'adhésion de la France à la convention sur le consentement au mariage, l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages.
a tout d'abord indiqué que le représentant permanent de la France auprès des Nations unies avait signé la convention relative au consentement au mariage, à l'âge minimum du mariage et à l'enregistrement des mariages et que cette convention était entrée en vigueur le 10 décembre 1962, après la ratification de huit Etats. Une cinquantaine d'Etats y étaient parties à ce jour.
Sur les dix articles que compte la convention, trois étaient relatifs au fond, les autres articles traitant de questions de procédure.
Il a souligné que le texte réaffirmait dans son préambule, visant l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout à la fois le principe de liberté du mariage et celui du consentement au mariage.
Dans son article 1er, la convention pose le principe du consentement au mariage qui doit être exprimé en personne, en présence de l'autorité compétente et de témoins, après une publicité suffisante, conformément aux dispositions de la loi.
Le rapporteur a précisé que le deuxième alinéa de l'article, qui apporte un tempérament important à la règle de la présence des époux, avait fait l'objet d'une série de réserves de la part des Etats signataires visant à limiter les exceptions possibles aux seuls cas prévus par le droit interne.
L'article 2 de la convention est relatif à l'âge minimum du mariage. Il stipule que la loi spécifie un âge minimum pour le mariage, à moins d'une dispense d'âge accordée par l'autorité compétente pour des motifs graves et dans l'intérêt des futurs époux.
L'article 3 prévoit que tous les mariages devront être inscrits par l'autorité compétente, sur un registre officiel.
a indiqué que ce texte était en plein accord avec les dispositions du code civil français.
La procédure de ratification française avait cependant été interrompue à plusieurs reprises, le droit local applicable dans certaines collectivités d'outre-mer ne remplissant pas les conditions énoncées par la convention.
Les modifications législatives intervenues sur le droit local à Mayotte ont permis d'en rapprocher les dispositions des stipulations de la convention. Jusqu'alors, la majeure partie des unions y était contractée selon le droit coutumier non écrit, qui mêle la loi islamique et les coutumes locales.
a indiqué que la loi applicable à Mayotte depuis juillet 2006 disposait désormais que la célébration du mariage serait désormais faite en mairie, en présence des futurs époux et des deux témoins, par l'officier de l'état civil de la commune de résidence de l'un des futurs époux.
Il a précisé qu'il restait à trouver une solution pour satisfaire à l'obligation de publicité suffisante stipulée par la convention dans la mesure où, même après cette réforme, la publication des bans, prévue par l'article 63 du code civil, n'existait pas pour les personnes qui ont conservé leur statut personnel, comme la Constitution l'autorise à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna.
Cette modification du droit local devait être préalable au dépôt des instruments d'adhésion.
a par ailleurs souligné que la France envisageait en outre d'assortir le dépôt de son instrument de ratification de déclarations interprétatives portant sur deux points : le principe de la comparution personnelle, pour lequel le droit français ne prévoit que deux exceptions : le mariage posthume et le mariage par procuration des militaires ; et la condition de publicité suffisante, pour prévoir les cas où le procureur de la République peut prononcer une dispense de bans pour des causes graves.
a précisé que la convention entrait en vigueur à l'égard de la France le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations unies.
Il s'est ensuite interrogé sur la portée de ce texte, qui renvoie à la loi interne le soin de mettre en application les principes qu'il prévoit.
Il a considéré que la réalité du consentement au mariage restait encore largement à ancrer dans de nombreux pays, y compris chez certains signataires de la convention, et que l'état civil de nombreux Etats restait tenu dans des conditions qui ne garantissaient pas son efficacité. Il a souligné la nécessité d'une coopération de la France et en particulier de ses collectivités territoriales.
La commission a adopté le projet de loi.
Enfin, la commission a nommé comme rapporteurs :

sur le projet de loi n° 327 (2006-2007) autorisant la ratification de la convention destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative entre la République française et la Principauté de Monaco ;

sur le projet de loi n° 328 (2006-2007) portant application du protocole additionnel à l'accord entre la France, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties en France, signé à Vienne le 22 septembre 1998.