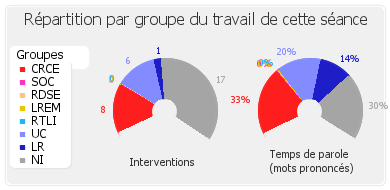Séance en hémicycle du 6 mai 2008 à 16h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.
Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité. Monsieur Fischer, ce projet de loi est effectivement très important. Je vais en faire la présentation initiale mais, rassurez-vous, Xavier Bertrand va très rapidement me rejoindre. Il est actuellement sur le chemin du retour après avoir suivi le président de la République en déplacement dans le département du Gard et vous prie, monsieur le président mesdames, messieurs les sénateurs, de vouloir bien excuser son retard. En tout cas nous serons tous les deux dans cet hémicycle pour travailler avec vous sur cette question de la modernisation du marché du travail.
Nouveaux applaudissementssur les mêmes travées.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Prends garde à toi, Fischer !
Sourires
La flexicurité est l’intérêt naturel des entreprises et des salariés : depuis presque vingt-cinq ans – depuis 1984, pour être précis, date de l’échec des négociations sur « l’adaptation des conditions de l’emploi » –, la flexicurité attendait de prendre forme en France.
En apportant des réponses concrètes à cette question, les partenaires sociaux ont témoigné du succès de la négociation collective et le projet de loi qui vous est soumis aujourd’hui est né de l’accord interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail qui a été signé le 11 janvier 2008.
Premier accord conclu dans le cadre de la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, il a été signé par les partenaires sociaux, qui ont su trouver eux-mêmes les solutions adaptées aux problèmes qui les concernent. Cet accord prouve que nous sommes entrés dans une nouvelle ère du dialogue social ; il prouve que, dans une société moderne, on a toujours raison de privilégier la voie de la négociation, voire de la concertation, selon les sujets.
Le projet de loi qui vous est soumis atteste que le Gouvernement souhaite mettre en œuvre cet accord et lui donner force obligatoire le plus rapidement possible.
Ce texte a été élaboré en étroite concertation avec les signataires. Nous avons identifié les points qui nécessitaient une loi, sachant que, à terme, tout l’accord sera applicable à tous les salariés selon des modalités négociées.
Comme les parties signataires en sont convenues, certains sujets feront l’objet de négociations ultérieures, comme la formation professionnelle, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC, ou l’assurance chômage.
D’autres domaines seront précisés dans les décrets et arrêtés d’application de ce projet de loi. Nous avons travaillé à ces décrets avec les signataires et avec les parlementaires, afin qu’ils puissent être publiés aussitôt que la loi aura été promulguée. Ces projets de décrets que Xavier Bertrand vous a fait parvenir ont été transmis à la commission nationale de la négociation collective, qui les examinera le 13 mai prochain. C’est également le cas de l’arrêté prévoyant le formulaire type pour la rupture conventionnelle.
Enfin, nous avons également mis en place le groupe de réflexion tripartite demandé par les signataires de l’accord sur le contexte juridique nécessaire pour fixer le minimum et le maximum des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce groupe s’est réuni le 31 mars et se réunira de nouveau le 20 mai.
Le présent texte rendra applicables les avancées considérables introduites par l’accord du 11 janvier. Celles-ci façonnent un nouvel équilibre entre flexibilité et sécurité, pour une flexicurité à la française.
Ce projet de loi apporte tout d’abord des garanties nouvelles aux salariés.
Il pose un principe essentiel : la forme normale de la relation de travail, la forme de droit commun, est le contrat de travail à durée indéterminée.
Les représentants du personnel seront désormais informés sur le recours prévisionnel aux contrats de travail à durée déterminée et temporaire.
En cas de maladie, l’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnisation complémentaire sera réduite de trois ans à un an.
La durée des stages de fin d’études sera comprise dans la période d’essai, jusqu’à réduire celle-ci de moitié.
Le montant de l’indemnité de licenciement sera unifié en doublant celui qui est prévu en cas de licenciement pour motif personnel, et l’ancienneté nécessaire pour percevoir l’indemnité passera de deux ans à un an.
Enfin, ce projet de loi pose le principe selon lequel tout licenciement doit être motivé, et il vient clarifier une situation de fait : il abroge le contrat « nouvelles embauches », le CNE.
Désormais, tout salarié dont le contrat de travail est rompu par son employeur connaîtra donc le motif de son licenciement, selon le principe présent dans l’accord qui demandait aux pouvoirs publics de prendre les dispositions nécessaires pour que l’exigence de motivation et de cause réelle et sérieuse en cas de licenciement « s’applique à tous les contrats ». Xavier Bertrand l’avait dit dès qu’ont été connus la décision de l’Organisation internationale du travail, en novembre 2007, et les arrêts des cours d’appel qui ont rendu inopérant le CNE.
La meilleure sécurisation juridique, pour les salariés comme pour les entreprises, consiste à mettre en cohérence le droit et la réalité, dans un souci de pragmatisme, pour éviter aux entreprises et aux salariés de courir des risques inutiles. Tel était le vœu des signataires de l’accord du 11 janvier 2008, mais telle était aussi la volonté du Gouvernement.
Ce projet de loi modernise les relations individuelles de travail en offrant des règles plus simples, qui s’appuient sur des garanties.
Les partenaires sociaux ont voulu mettre en place de nouvelles périodes d’essai interprofessionnelles par catégories, qui seront donc applicables dans toutes les professions et dans tous les secteurs d’activité.
Les rares périodes d’essai plus longues que prévoient aujourd’hui les accords de branche resteront applicables, comme le requiert l’accord interprofessionnel du 11 janvier 2008. Pour les périodes d’essai plus courtes, le projet de loi ménage une période de transition d’une année avant de les rendre inopérantes. Ce délai, qui correspond à la période légale de survie d’un accord collectif dénoncé, permettra aux négociations de branche d’adapter la durée des périodes pour les cas où cela s’avérerait nécessaire.
Le projet de loi permet aussi au contrat de travail ou aux accords collectifs qui seront conclus après l’entrée en vigueur de la loi de fixer des périodes d’essai plus courtes.
Le projet de loi rendra possible la rupture conventionnelle du contrat de travail. Il s’agit d’une modernisation sans précédent des relations individuelles de travail. Cela rejoint la décision 145 du rapport de la commission pour la libération de la croissance française, présidée par Jacques Attali. La modernisation de l’économie souhaitée par les membres de cette commission trouve ici son premier écho concret dans le domaine social. Ce ne sera pas le dernier ; nous avons besoin de mettre en œuvre ce type de propositions contenues dans le « rapport Attali ».
Ainsi, l’employeur et le salarié pourront convenir ensemble de rompre leurs relations de travail dans un cadre légal entouré de garanties : assistance des parties, délai de rétractation de quinze jours et homologation par le directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ces garanties sont reprises par le projet de loi, qui en précise la mise en œuvre.
Cette nouvelle forme de rupture vise à la simplification : c’est pourquoi il est apparu naturel que les recours juridictionnels soient tous traités par les conseils de prud’hommes, que les contentieux portent sur l’homologation ou sur la convention.
Il s’agit d’une innovation essentielle dans notre droit : elle devrait sécuriser les modes de rupture et réduire la judiciarisation dans notre pays, où un quart des licenciements pour motif personnel donne aujourd’hui lieu à un recours en justice.
Le projet de loi offrira aux entreprises des outils pour accompagner et sécuriser leur activité.
Pendant cinq ans sera expérimenté un contrat à durée déterminée à objet défini. Il permettra à une entreprise d’embaucher un ingénieur ou un cadre afin de réaliser un projet pour une durée de dix-huit à trente-six mois. Cela offrira aux entreprises une plus grande souplesse pour recruter les compétences nécessaires à l’exécution de certaines missions ponctuelles. Un accord collectif devra être préalablement conclu pour garantir les conditions d’utilisation de ce contrat.
Enfin, le portage salarial pourra être encadré par un accord qui sera conclu d’ici à deux ans dans la branche du travail temporaire, comme l’ont souhaité les partenaires sociaux. Nous souhaitons que, dans cette perspective, les intérêts de tous soient pris en compte, et Xavier Bertrand a écrit à cet effet au syndicat des entreprises de travail temporaire, qui lui a donné des assurances à ce sujet.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la discussion qui s’ouvre aujourd’hui va nous permettre de donner force obligatoire à cet accord et, sur certains points, d’améliorer le texte qui vous est soumis, dans le respect de l’équilibre de l’accord.
L’Assemblée nationale a d’ores et déjà procédé à quelques améliorations, que je voudrais rappeler brièvement.
En premier lieu, les députés ont souhaité préciser que les personnes qui signeront une rupture conventionnelle bénéficieront des droits à l’assurance chômage.
C’est une clarification importante, qui reprend une stipulation de l’accord du 11 janvier 2008, et les négociations de la future convention d’assurance chômage viendront confirmer ce principe.
Toutefois, la précision apportée par l’Assemblée nationale peut être encore améliorée, et c’est d’ailleurs, me semble-t-il, l’objet de l’un des amendements de la commission des affaires sociales.
Les députés ont également souhaité que les parties s’informent mutuellement de l’utilisation qu’elles entendent faire de la possibilité de se faire assister lors de l’entretien prévu en matière de rupture conventionnelle.
Ensuite, les députés ont écrit noir sur blanc que l’indemnité de rupture de 10 % prévue pour le CDD à objet défini est due par l’employeur au salarié, et non l’inverse, en cas de rupture engagée sur l’initiative du salarié.
Concernant le nouveau CDD à objet défini, Xavier Bertrand a été amené, au cours des débats qui se sont déroulés à l’Assemblée nationale, à apporter quelques clarifications, sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir, d’autant qu’un amendement de la commission des affaires sociales vise à apporter d’utiles précisions sur ce point.
Enfin, les députés ont complété la sécurisation juridique que nous avions voulu mettre en œuvre pour le CNE en prévoyant l’application des périodes d’essai conventionnelles pour les CNE requalifiés en CDI.
Mesdames, messieurs les sénateurs, ce projet de loi contient de grandes avancées dans le domaine des relations sociales. Il constitue une première étape importante, et même décisive. Nous le savons tous, la modernisation de notre économie et de notre marché du travail appelle d’autres accords, en particulier sur la formation professionnelle et l’assurance chômage.
Ce que veulent les Français, ce que nous voulons et ce que nous mettons en œuvre pour la société française, c’est la modernisation du contrat de travail, la modernisation du droit du travail, la modernisation du marché du travail.
Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la France est-elle entrée, depuis le 31 janvier 2007, dans une ère nouvelle des relations du travail ? Nous sommes parfaitement fondés à le croire si l’on en juge par l’application réussie qui vient d’être faite de la loi de modernisation du dialogue social, promulguée à cette date.
Saisis par le Gouvernement, qui leur a adressé un document d’orientation en juin dernier, les partenaires sociaux se sont livrés à d’intenses négociations pour parvenir, le 11 janvier 2008, à un accord sur la modernisation du marché du travail, signé par sept organisations représentatives sur huit. Seule la CGT n’a pas apposé sa signature au bas du parchemin, mais elle a joué un rôle actif dans les débats et est ouverte aux négociations de branche qui en découleront.
Cet accord est placé sous le signe de la « flexisécurité », néologisme parfaitement explicite.
La mondialisation exacerbe la compétition économique et, en l’absence de régulation internationale, exige de chaque économie innovations et adaptations permanentes. C’est particulièrement vrai dans le monde du travail. Le temps n’est plus où un contrat de travail pouvait servir de base à toute une vie professionnelle ; pour une part de plus en plus importante de nos concitoyens, le changement est la règle. Celui-ci peut être perçu comme une opportunité, mais il peut aussi être ressenti, en particulier par le salarié, comme une source d’angoisse et de souffrance. Il convient donc d’entourer la flexibilité de toute la sécurité nécessaire pour que le changement se fasse au moindre coût humain et signifie réellement pour chacun enrichissement plutôt que risque.
Au demeurant cette sécurité est également utile pour l’employeur, qui souhaite améliorer le climat dans son entreprise, de manière à en assurer la stabilité et à lui donner la plus grande visibilité.
Afin de parvenir au meilleur équilibre possible entre la flexibilité et la sécurité, plusieurs outils sont à notre disposition, notamment la portabilité de certains droits. C’est ainsi que le salarié quittant l’entreprise gardera sa couverture complémentaire santé et prévoyance pendant au moins trois mois et conservera 100 % du solde des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation.

Divers autres outils de la flexisécurité ont été largement expérimentés, et ce depuis longtemps, par nos partenaires européens, en particulier par les économies nordiques, au premier rang desquelles le Danemark, afin d’assurer une vraie sécurisation des parcours (M. Jean-Luc Mélenchon proteste), notamment en attachant les droits sociaux à la personne des travailleurs plutôt qu’à leur emploi, car toutes les économies avancées sont confrontées à ce même problème. C’est la raison pour laquelle l’Europe s’y est intéressée, et l’accord conclu en France répond bien aux préconisations qu’elle a formalisées en décembre dernier.
Certes, la flexisécurité ne se fera pas en un jour, en un accord, en une loi ; il s’agit d’un problème culturel, qui nécessitera encore beaucoup de négociations, d’avancées, de reculs, de tâtonnements, mais nous avons conscience qu’une direction est prise et qu’un seuil est franchi.
Cet accord est en effet exemplaire tant sur la forme que sur le fond.
Sur la forme, il semble bien que le Gouvernement, les organisations patronales et syndicales et le Parlement aient trouvé la bonne méthode : le Gouvernement propose, fixe le cadre et le calendrier ; les organisations négocient ; le Parlement légifère.
Les relations du travail ont tout simplement franchi le pas de la modernité, que nous avons si longtemps enviée à d’autres pays et qui va procurer, si cette orientation se confirme, un nouvel atout essentiel à la France.
Sur le fond, c’est aussi de modernité qu’il s’agit, puisque nous nous donnons les moyens de mieux répondre à un formidable défi par des solutions qui construisent un modèle social et qui affirment clairement que, face à la loi de la jungle, il existe des réponses qui font – encore imparfaitement, certes – toute sa place à l’homme dans l’économie.
La flexisécurité, j’en suis persuadé, c’est la dernière chance du modèle social européen face au libéralisme sauvage.
M. le président de la commission des affaires sociales acquiesce.

La mise en œuvre totale de cet accord nécessite une loi pour certaines de ses dispositions, mais aussi des décrets, que le Gouvernement a d’ores et déjà commencé à rédiger en concertation avec les signataires, ainsi que des accords interprofessionnels et des accords de branche.
S’agissant du texte de loi, je voudrais attirer votre attention, mes chers collègues, sur la réaffirmation solennelle du principe selon lequel le CDI est « la forme normale et générale de la relation de travail ». Tous les autres contrats – et ils sont, semble-t-il, nombreux – ne sont destinés qu’à répondre à des besoins d’adaptation, à des situations ponctuelles, et ils participent à ce titre de la flexibilité.
Toutefois, madame la secrétaire d’État, une certaine rationalisation tendant à réduire le nombre de ces contrats ne serait certainement pas superflue, s’il est vrai, comme on nous l’a indiqué, que notre législation en compte déjà trente-huit formes différentes.
Le deuxième point fort de ce projet de loi est la réglementation de la période d’essai, que le code du travail ne traitait curieusement jusqu’ici que de façon allusive. La période d’essai ne pourra dépasser une durée maximale, différente selon les catégories de salariés, et ne pourra être renouvelée qu’une fois.
Le troisième point important du texte est la rupture conventionnelle du contrat de travail par le commun accord des parties. Outre la démission et le licenciement, employeur et salarié peuvent désormais se séparer à l’amiable, à condition de respecter une procédure qui garantit la liberté de consentement des parties.
Les partenaires sociaux ont d’abord prévu que salarié et employeur pourraient se faire assister, pour négocier la rupture, par un membre du personnel de l’entreprise. Souhaitant vraisemblablement écarter toute idée de « judiciarisation » de la procédure, ils n’ont en revanche pas retenu la possibilité de se faire assister par un avocat.
Les partenaires sociaux ont ensuite confié une mission de contrôle au directeur départemental du travail et ils ont souhaité que, en cas de conflit, les prud’hommes, et eux seuls, soient amenés à statuer.
Cette séparation à l’amiable donne droit aux allocations chômage, ce qui devrait dissuader les salariés de chercher à se faire licencier, plutôt que de démissionner, comme cela arrive parfois.
Le quatrième point consiste à créer un nouveau type de contrat : le contrat à durée déterminée à objet défini.
Ce contrat a été imaginé dans le but de faire accomplir une tâche bien circonscrite, limitée dans le temps, de dix-huit à trente-six mois, et qui ne devrait pas concerner des emplois permanents dans l’entreprise. En cas de rupture, ce contrat donne lieu à indemnisation dans les mêmes conditions qu’un CDD classique.
Enfin, ce projet de loi légalise le portage salarial, pratique née il y a une vingtaine d’années, qui concerne environ 20 000 personnes chaque année en France et qu’aucune disposition n’est venue codifier jusqu’à aujourd’hui, ses utilisateurs se trouvant ainsi placés dans une grande insécurité juridique.
Le portage salarial vise à concilier les avantages du travail indépendant et ceux du salariat : un professionnel autonome cherche une mission auprès d’une entreprise cliente ; une fois qu’il l’a trouvée, il s’adresse à une société de portage, avec laquelle il signe un contrat de travail ; lorsque la mission est terminée, la société encaisse les honoraires versés par le client et reverse au professionnel une rémunération sous forme de salaire, après avoir retenu les frais de gestion et la totalité des cotisations sociales.
Le professionnel se trouve ainsi allégé des charges de gestion et peut en outre bénéficier d’une assurance chômage entre deux missions.
Les partenaires sociaux se sont accordés pour reconnaître une véritable utilité sociale à cette forme de contrat, en particulier pour les seniors. Ils en ont donc souhaité la légalisation et ont demandé que son organisation soit dévolue à la branche de l’intérim.
Toutefois, plusieurs organisations professionnelles existent dans ce secteur et l’une d’entre elles a même déjà signé un accord avec trois organisations syndicales. Il conviendrait donc que la branche de l’intérim tienne compte de leur expérience et les associe aux négociations, dans des formes à déterminer.
Telles sont, mes chers collègues, les principales dispositions du texte qui nous est soumis. Vous aurez compris que rompre l’équilibre de ce texte remettrait en cause tant l’esprit de la loi de janvier 2007 que le contenu de l’accord signé en janvier 2008. Mais, plus grave encore, il serait démontré que, décidément, la France est incapable de conduire des relations de travail de façon moderne, apaisée, contractualisée.
Certes, ce type d’accord n’est pas le premier de notre histoire : l’initiative du général de Gaulle aboutissant à la création de l’Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, l’UNEDIC, de même que les travaux de Jacques Chaban-Delmas, Joseph Fontanet, Jacques Delors aboutissant à la loi de 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente sont là pour le prouver.
Mais nous pouvons espérer que, cette fois-ci, nous entrons dans une forme de négociation durable et que, désormais, tous les accords nécessaires seront élaborés dans cet esprit et selon cette procédure. Nous vivons donc un moment important de l’histoire des relations du travail ; ne brisons pas cet élan !
C’est pourquoi, avant de conclure, je voudrais m’adresser, d’abord, à celles et ceux de nos collègues que l’équilibre atteint ne satisfait pas et qui ont peut-être le sentiment que les salariés ne bénéficient pas, dans ce projet de loi, de toutes les protections nécessaires.

Quatre grandes centrales syndicales de salariés se sont engagées, en conscience, sur ce texte.

M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur. Peut-on imaginer qu’elles l’aient fait à la légère et, si oui, pour atteindre quel objectif ?
Mme Annie David s’exclame.

Le présent projet de loi introduit davantage de flexibilité. Mais la rigidité ne revient-elle pas à arbitrer en faveur de ceux qui ont un emploi contre ceux qui n’en ont pas, comme ce fut trop longtemps le cas dans notre pays ?
Dans les circonstances présentes, la flexibilité est utile à l’emploi, elle devient même la condition de l’emploi. Sachons le reconnaître et inventons les filets de sécurité nécessaires pour que le contrat de travail ne constitue pas une variable d’ajustement, mais qu’il soit resitué, grâce à la formation, à l’incitation à la recherche d’emploi, à des indemnités conséquentes, à la réduction des inégalités encore trop criantes dans ce pays, dans une perspective de travail et de carrière propice à l’épanouissement de chacun.

M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur. Si nous refusons cette évolution, si nous refusons de voir ce qui se passe autour de nous, nous récolterons le déclin, dans le libéralisme pur et dur, et nous assisterons au retour des vieux antagonismes à base idéologique.
Mme Raymonde Le Texier s’esclaffe.

Je m’adresserai à présent à ceux de nos collègues qui s’interrogent sur le rôle du législateur, sur la part qui est laissée à ce dernier à l’heure actuelle.
Cette question est légitime et d’autant plus justifiée que nous sommes à la veille d’une réforme des institutions qui est censée donner davantage de pouvoirs au Parlement.

Les institutions de la Ve République, que je défends, ont dû réduire les prérogatives du Parlement face au pouvoir exécutif pour conférer à ce dernier plus de stabilité et d’efficacité.
Les lois de décentralisation successives, que j’approuve, ont retiré à l’État, et donc au législateur, une partie de ses prérogatives.
Le développement de l’Europe, que j’appelle également de mes vœux, nonobstant le principe de subsidiarité, a également transféré à un autre échelon certaines responsabilités, ce qui donne parfois au parlementaire français le sentiment qu’il n’est plus qu’un « transposeur » de directives.

Enfin, on l’a constaté dans certains débats récents, des groupes de pression, incapables de réunir plus de 1 % à 2 % aux élections politiques, se camouflent derrière le joli nom de « société civile » pour envahir le champ du débat public et obtenir, par un puissant lobbying très bien organisé, ce qu’ils n’ont pu recueillir par les urnes.

C’est dans ces circonstances que nous sommes aussi appelés à transposer dans notre droit positif une partie d’un accord conclu en dehors de nous par les partenaires sociaux.
Face à de telles évolutions, je comprends la gêne que peuvent éprouver certains de nos collègues, mais notre rôle, notre responsabilité, à l’instar de ceux qui incombent au Gouvernement, même s’ils sont distincts, ne sont-ils pas de faire en sorte que la « maison France » fonctionne le mieux possible, de façon concertée et solidaire ?

M. Pierre Bernard-Reymond, rapporteur. En l’occurrence, je suis profondément convaincu que l’accord qui nous est présenté est un bon accord, qui fait franchir une étape significative au dialogue social, renforce l’efficacité de la politique de l’emploi, donne de nouvelles chances à notre économie et ouvre la voie à l’élaboration d’un modèle social français et européen adapté au XXIe siècle.
Applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, pour assurer la clarté de nos débats et le bon déroulement de la discussion des amendements, je propose au Sénat, avec l’accord des membres de la commission des affaires sociales, de disjoindre de la discussion commune les amendements de suppression n° 44 et 64, à l’article 2, n° 51 et 74, à l’article 5, et n° 79 ; à l’article 6.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la relance du dialogue social et la mise en place d’une véritable flexsécurité à la française : ce sont là deux approches que nous avons toujours prônées en matière d’emploi.
Sur ces deux plans, le projet de loi portant modernisation du marché du travail paraît constituer une avancée.
En effet, nous ne pourrons moderniser le marché du travail qu’en nous appuyant sur une démocratie sociale régénérée et redynamisée. Relancer le dialogue social, telle était la raison d’être de la loi du 31 janvier 2007, qui a établi une procédure de concertation et de négociation préalable à toute réforme dans le domaine du travail.
Sur le fondement de ce texte, que nous avions soutenu, les partenaires sociaux sont parvenus, le 11 janvier dernier, à un compromis porteur de véritables avancées, l’accord national interprofessionnel, ou ANI. Nous nous en félicitons.
Cet accord m’inspire deux observations : son objet est, par nature, beaucoup plus large que celui du projet de loi et, d’autre part, il constitue une base solide pour le présent projet de loi. Sa légitimité est d’autant plus grande qu’il a été signé par quatre des cinq grandes centrales syndicales à l’échelon national et par toutes les organisations patronales.
M. Jean-Luc Mélenchon s’exclame.

Fausse légitimité, affirment certains, arguant du fait que les centrales syndicales signataires sont moins représentatives qu’elles ne l’ont été historiquement. C’est vrai, mais l’ANI a été signé avant que les accords du 18 avril sur la représentativité syndicale ne trouvent de traduction législative. Dès lors, on comprend aisément l’ordre séquentiel qui a été retenu pour l’ANI. Il est donc inutile d’épiloguer.
Faux consensus, diront encore ceux qui dénonçaient déjà la légitimité de l’accord : les syndicats sont parvenus à un accord a minima uniquement sous la menace d’un projet de loi gouvernemental ; ils n’ont fait que sauver les meubles. C’est donc un accord défensif.
Mais, après tout, peu importe que ce soit un accord défensif, puisqu’il comporte de vraies avancées. Et c’est aussi parce que c’est un accord défensif que la représentation nationale ne doit avoir aucun complexe à l’amender, à en corriger les imperfections ou en combler les insuffisances.

Dans cette optique, nous défendrons, par exemple, un amendement visant à ce que le projet de loi prenne en compte l’accord déjà intervenu en matière de portage salarial, quitte à l’étendre.
En effet, dans l’état actuel du texte, il est prévu que le portage sera encadré sur le fondement de l’ANI. Or une convention visant à couvrir les principales entreprises organisant le portage est déjà intervenue. Elle ne doit pas être passée sous silence et, partant, courir le risque de passer par pertes et profits !
Donc, malgré toutes les imperfections mentionnées, le premier pilier d’une véritable modernisation du marché du travail, celui du dialogue social, se consolide. Réjouissons-nous-en ! Sa consolidation doit se faire en partenariat avec un Parlement constructif, dont les prérogatives seront accrues par la réforme des institutions.
À notre avis, je l’ai dit, l’autre pilier d’une modernisation du marché du travail digne de ce nom est la mise en place d’un modèle français de flexsécurité. De quoi parle-t-on ? Pour qu’il y ait flexsécurité, il faut que les facteurs de flexibilité soient contrebalancés par de réels éléments de sécurisation du parcours professionnel des salariés.
C’est la raison pour laquelle, dès le début, nous avons été très opposés au contrat « nouvelles embauches ». Créer le CNE, c’était précariser le marché du travail, au lieu de le dynamiser ; c’était opter pour un modèle ultralibéral anglo-saxon, mais non pour la flexsécurité danoise. Le CNE traduisait, selon nous, une grave erreur de cap, et nous l’avons dénoncée !
À cet égard, je ne peux que rappeler les propos tenus par Michel Mercier le 7 juillet 2005, lors de l’examen par le Sénat du projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre, par ordonnance, des mesures d’urgence pour l’emploi, dont est sorti le CNE : « Nous devons mener une réforme équilibrée : à l’entreprise plus de liberté et plus de souplesse dans la gestion de ses effectifs, à la nation le soin de renforcer à due concurrence la solidarité collective... ». Le CNE ne respectait pas ces équilibres. Notre collègue Michel Mercier précisait encore : « Il faut fluidifier le marché du travail, mais pas au prix d’une précarisation généralisée des salariés. »
Aujourd’hui, j’ajoute que le fait de permettre des licenciements sans cause « réelle et sérieuse » pendant les deux ans de la « période de consolidation », revenait à s’asseoir sur les droits fondamentaux sous-tendant le code du travail.
Il aura fallu deux ans, une masse de contentieux ahurissante et des requalifications jurisprudentielles pour que le Gouvernement entende raison.
L’ANI est peut-être un accord défensif, mais les partenaires sociaux ont pu y inscrire leur souhait de voir tous les contrats de travail régis par les mêmes modes de rupture. Ce souhait a conduit, dans le présent projet de loi, à l’abrogation du CNE et à la requalification des contrats ainsi signés en CDI. C’est donc une excellente chose.

Au-delà de l’abrogation du CNE, le projet de loi que nous examinons nous semble poser les premiers jalons d’une vraie flexsécurité à la française. Il présente un assez bon équilibre entre les points de sécurisation des parcours professionnels et ceux concernant l’assouplissement des règles du marché du travail.
Au chapitre de la sécurisation des parcours, il y a d’autres mesures que l’abrogation du CNE.
Alors même que de lourdes incertitudes pèsent sur l’emploi, l’affirmation du CDI comme forme normale de la relation de travail ne nous semble ni un luxe ni un os à ronger !
Le passage de trois à deux ans d’ancienneté requise pour bénéficier des indemnités d’assurance maladie complémentaire est aussi un acquis social.
L’article 4 du projet de loi, qui porte obligation de motiver tous les licenciements, améliore les indemnités légales de licenciement et rétablit le caractère libératoire du reçu pour solde de tout compte, participe bien entendu de ce souci prégnant de sécurisation.
Il en est de même de la mutualisation de l’indemnisation des salariés licenciés pour inaptitude.
Enfin, l’établissement d’un cadre général pour la période d’essai pourrait être plus protecteur pour certains salariés, compte tenu du fait que le projet de loi reprend fidèlement les plafonds fixés par l’ANI. C’était ce qui comptait, le code du travail n’ayant pas à prohiber les options éventuellement plus favorables aux salariés.
En matière de flexibilité, le projet de loi est également porteur d’innovations intéressantes.
La première d’entre elles est, à l’évidence, la création de la procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail, reprenant la proposition 145 du rapport Attali. Cette rupture conventionnelle existait en droit français, mais la loi ne la prévoyait explicitement que dans des cas très marginaux ; en outre, pour que celle-ci soit valable, la jurisprudence lui fixait un régime très restrictif.
Nous considérons que faire du mode amiable le mode de rupture normal du contrat de travail représente une véritable modernisation du marché du travail, à condition, toutefois, qu’il soit assorti de solides garanties procédurales et financières. En l’occurrence, cela semble être le cas, même si le système peut sans doute être amélioré et si des incertitudes peuvent être levées.
Le système procédural peut être amélioré, notamment en permettant au salarié, s’il le souhaite, de se faire assister d’une personne extérieure à l’entreprise lors des entretiens préalables à une rupture conventionnelle du contrat de travail. Tel est d’ailleurs l’objet de l’un de nos amendements.
Il semble clair qu’une rupture dûment homologuée par l’administration ouvrira droit à l’assurance chômage dans les conditions de droit commun pour le salarié. Le texte ne comporte pas d’incertitude à cet égard, mais, madame la secrétaire d'État, nous aimerions que le Gouvernement confirme ce point.
En matière de flexibilisation, l’autre innovation notable introduite par ce projet de loi réside dans la création du contrat à durée déterminée dont le terme sera déterminé par la réalisation d’un objet défini. C’est en fait le contrat de projet tel qu’il avait été suggéré il y a quatre ans dans le rapport Virville. Il s’agit d’une formule intéressante, adaptée sans doute aux cadres et aux ingénieurs, mais nous serons très attentifs à ce qu’elle ne soit pas plus largement ouverte, car cela remettrait en question toute l’architecture du droit du travail, et encore une fois dans le sens d’une précarisation généralisée.

Cependant, en l’état actuel du texte, de grosses incertitudes subsistent quant à la durée légale de ce nouveau contrat. Madame la secrétaire d'État, les bornes de 18 à 36 mois visées dans le projet de loi s’imposeront-elles aux parties, même quand la réalisation de l’objet du contrat contraindra de les avancer ou de les retarder ? C’est pourquoi le régime de ce nouveau contrat doit être précisé.

En conclusion, ce texte établit un équilibre relatif entre flexibilité et sécurité et il pose des jalons intéressants pour l’émergence de cette « flexsécurité » à la française. Certes, nous n’assistons pas au « Grand soir », et il faudra œuvrer davantage pour mettre en place un véritable accompagnement des parcours professionnels. On peut simplement regretter que le périmètre du projet de loi ne soit pas un peu plus large.
Nous ne revenons pas sur le choix fait par le Gouvernement d’un morcellement du dossier de la modernisation du marché du travail. Même si nous eussions préféré une loi de programmation globale, nous comprenons l’option retenue dans la mesure où l’accord passe par une négociation collective. Dans l’optique de cette modernisation, l’augmentation de l’indemnisation chômage pour les jeunes, la création d’un bilan d’étape professionnel, l’amélioration de l’orientation des droits et de leur transférabilité, notamment en ce qui concerne le DIF, le droit individuel à la formation, font aussi partie du champ des interrogations.
Les négociations sur l’assurance chômage et la formation professionnelle seront déterminantes. Seuls leurs résultats, additionnés aux innovations du présent projet de loi, donneront du corps à la réforme en cours.
Pour l’heure, nous regrettons cependant que ce texte n’aille pas plus loin dans le transfert des droits des salariés. C’est en les rattachant à la personne plutôt qu’au statut de salarié qu’on inscrira l’individu dans un parcours professionnel sécurisé.
Nous regrettons aussi que la question du travail précaire – le travail temporaire ou le temps partiel subi – ne soit pas abordée, alors même qu’elle est centrale.
Madame la secrétaire d'État, ce projet de loi nous semble intéressant et porteur d’avenir, mais il doit s’inscrire, selon nous, dans un cadre de réformes beaucoup plus global et ambitieux.
Applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce texte a pour objet de transposer dans notre législation 10 des 19 articles que compte l’accord passé le 11 janvier entre des organisations syndicales de salariés – la CGT ne l’ayant pas signé – et les organisations patronales.
Loin de « constituer un tournant dans notre vie sociale », comme le disait le ministre, ce projet de loi n’en renvoie pas moins à l’articulation qui existe entre la démocratie sociale et la démocratie représentative. Or, en cette année anniversaire des grandes luttes sociales de 1968, nous savons que l’une et l’autre sont aussi fonction du cadre dans lequel elles s’inscrivent. Aussi me permettrez-vous de revenir sur le contexte dans lequel l’accord du 11 janvier a été signé et sur la forme qu’a prise cette signature.
Les rapports qui lient ce texte à l’accord national interprofessionnel négocié par les partenaires sociaux et au rôle du Parlement méritent que nous nous y attardions parce que c’est la première fois, sans que ce soit sans doute la dernière, que nous aurons à travailler de la sorte. Au sein de cet hémicycle, nous considérons certainement tous qu’il est impératif que le dialogue social puisse se dérouler dans un climat propice à la négociation. Or de fortes pressions ont été exercées sur les syndicats de salariés.

Je pense notamment au calendrier des négociations, qui fut très contraignant, et à la lettre d’orientation remise par le Gouvernement, qui, outre qu’elle reprenait nombre de points du rapport Virville de janvier 2004, définissait les axes précis de la négociation. Cela est regrettable et nombreux sont les partenaires sociaux à nous l’avoir fait savoir.
La démocratie sociale ne devrait pas être placée sous la primauté du politique et subir l’injonction de celui-ci, faute de quoi la recherche d’une bonne articulation entre démocratie sociale et démocratie représentative risque, dans les faits, de n’être qu’une instrumentalisation du dialogue social ayant pour objectif d’imposer un rapport de force précis.

Mme Christiane Demontès. Désormais débarrassé des principes chers au Conseil national de la Résistance, qui promouvait l’intervention de l’État dans la sphère économique afin de tenter d’atténuer les injustices du marché, et tout acquis au modèle anglo-saxon du marché de l’emploi ultraflexible, dans lequel le code du travail ne serait plus qu’un frein à la création de plus-value et le salariat une simple variable d’ajustement des coûts de production, le Gouvernement n’a cessé de faire peser sur les syndicats la menace d’un recours à la loi, laquelle, n’en doutons pas, aurait été de facture ultralibérale, et donc beaucoup plus favorable aux exigences du MEDEF.
M. Jean-Luc Mélenchon applaudit.

À cet égard, on ne peut que s’étonner, madame la secrétaire d'État, du peu d’empressement dont votre collègue Xavier Bertrand fait preuve pour que les négociations sur la pénibilité, débutées en 2003, aboutissent.

De même, comment ne pas s’interroger sur le fait que vous n’entériniez pas l’accord sur le dialogue social dans l’artisanat conclu par les partenaires sociaux en décembre 2001 ?

Tel est donc le cadre dans lequel s’est inscrite cette négociation. Le primat du politique, voire « l’interventionnisme outrancier de l’exécutif », pour reprendre les termes de notre collègue Gérard Larcher, a été déterminant. Dès lors, affirmer, comme le fait M. le rapporteur, que « l’ANI est une première application réussie de la procédure prévue par la loi de modernisation sociale » est un peu excessif, c’est le moins que l’on puisse dire.

Certes, le 19 décembre dernier, à l’occasion de la conférence sociale destinée à fixer l’agenda des réformes de 2008, le Président de la République déclarait assez justement ceci : « Le temps du dialogue social est un temps long, mais un temps utile, car il permet la maturation des réformes et favorise le consensus. » Cependant, il précisait aussi aux partenaires sociaux que, s’ils ne parvenaient pas rapidement à un accord, le Gouvernement entreprendrait une concertation rapide avant d’élaborer un projet de loi.
Quant au Premier ministre, il fixait laconiquement l’échéancier : la réforme du marché du travail serait votée avant l’été. Somme toute, une fois de plus, l’exécutif réaffirme que l’application de l’article L. 101–1 du code du travail demeure inféodée à ses desiderata.
Rien d’étonnant à cela puisque les partenaires sociaux, comme les parlementaires, ont, au cours du dernier semestre de 2007, mesuré combien étaient relatifs cette volonté de dialogue social renouvelé et équilibré ainsi que ce désir de faire « des acteurs sociaux, aux cotés de l’État, le moteur du progrès social ».
De fait, les centrales syndicales signataires ont visiblement choisi de porter un coup d’arrêt à une évolution sur laquelle elles n’auraient plus eu prise. M. le rapporteur parle de « compromis », mais il en va ainsi de tout accord. Il n’en demeure pas moins que qualifier cet accord de défensif n’est pas un abus de langage : c’est une stricte traduction de la réalité. Les syndicats, dans cette affaire, ont évité le pire, notamment le contrat unique, projet cher au candidat Sarkozy.
Cet accord est majoritaire. À cet égard, nous respectons le travail accompli par les partenaires sociaux, sans pour autant remettre en cause notre rôle de législateur, en l’occurrence : veiller au respect de l’intérêt général et garantir un équilibre entre le puissant et le faible.
Cette négociation devait, selon le Président de la République, « offrir aux entreprises, comme aux salariés, à la fois des sécurités nouvelles et plus de mobilités ». Il s’agissait donc de parvenir à un savant équilibre afin de donner corps à une « flexicurité à la française », soit un savant dosage entre une plus grande flexibilité du marché du travail et une réelle sécurisation du parcours professionnel.
Nous notons, comme M. le rapporteur, que les dispositions de l’accord relatives à la sécurisation du parcours professionnel ne sont pas retranscrites dans le projet de loi et sont renvoyées aux éventuelles négociations futures. Nous le regrettons très vivement.
Concernant la flexibilité, si chère au MEDEF et à sa présidente, elle se concrétise notamment par l’article 2, qui allonge les périodes d’essai pour l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et autorise, sous le couvert d’un accord de branche, leur renouvellement.
L’article 5, qui instaure la rupture à l’amiable, dite « séparation conventionnelle », entre le salarié et l’employeur, donne une base légale aux ruptures d’un commun accord, jusqu’à présent souvent présentées comme des licenciements pour motif personnel et donnant lieu à des indemnités négociées de gré à gré.
Enfin, l’article 6 instaure une nouvelle forme de contrat de travail, « le contrat de travail à durée déterminée [pour] la réalisation d’un objet défini », qui, réservé aux cadres et aux ingénieurs – notons que des amendements ayant pour objet d’en étendre le champ ont été déposés – peut être considéré sous l’angle de la fin de contrat exclusive de licenciement.
Sans entrer dans le détail, nous pouvons observer que l’article 2 codifie et allonge la période d’essai. Si, comme le rappelle M. le rapporteur, « actuellement, le code du travail n’encadre pas la période d’essai », la durée de celle-ci étant définie par les accords de branche ou d’entreprise, comment ne pas voir dans cet allongement, qui peut atteindre huit mois et paraît peu justifiable, notamment au regard de l’année exigée pour bénéficier de l’indemnité légale de licenciement, le signe d’une volonté patronale de revanche après l’échec du CNE ?
Comment doit-on interpréter le fait que les accords prévoyant une durée plus longue que les nouveaux plafonds resteront de mise alors que ceux qui prévoient des périodes plus courtes devront, après le 30 juin 2009, intégrer la nouvelle hiérarchie ?
En outre, si la période de stage effectuée au sein d’un cursus pédagogique est intégrée, pour moitié de sa durée, à la période d’essai, il ne s’agit que d’une transposition a minima des dispositions qui sont souvent appliquées par les entreprises à l’issu d’un stage long.
L’article 5, qui renvoie à l’article 12 de l’accord, est symptomatique de la volonté du patronat de sortir le contrat de travail du corpus législatif pour le confier uniquement à l’accord.
Il est question de donner un cadre légal à la rupture de gré à gré, laquelle n’est ni un licenciement ni une démission et ne nécessite aucun motif réel et sérieux pour être licite. Or l’article 11 de l’ANI réaffirme « l’obligation de motiver les licenciements ». Dans ce contexte, le MEDEF, notamment, a reformulé son exigence via la mise en place de la « séparabilité », terme cher à Mme Parisot.
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, rejoint le banc du Gouvernement.

Ma chère collègue, permettez-moi de vous interrompre un bref instant pour saluer l’arrivée dans l’hémicycle de M. Xavier Bertrand.

Il s’agit là d’une rupture fondamentale avec la philosophie juridique du droit du travail, laquelle tient pour essentielle la dimension inégale des liens contractuels entre salarié et employeur et a octroyé des droits supplémentaires à la partie la plus faible afin d’assurer un équilibre.
Une rupture de gré à gré induit nécessairement égalité entre les parties. Or, dans un contexte de précarisation galopante, de fragilisation du salariat et de chômage important, l’égalité ou, pour reprendre les termes de M. le rapporteur, la « liberté de consentement » sera-t-elle réellement garantie ?
Le salarié ne va-t-il pas se voir contraint d’accepter cette rupture conventionnelle qui lui garantit des indemnités immédiatement versées, ainsi que le droit à l’assurance chômage, plutôt que de risquer un futur licenciement pour faute qui le privera de toute indemnité et qui, même infondé, le contraindra à engager une longue procédure ?
En outre, ne peut-on s’interroger sur le choix qu’effectueront les employeurs dès lors qu’avec cette nouvelle possibilité ils échapperont, par exemple, à l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi ?
Autre interrogation : cette forme de rupture ne risque-t-elle pas de priver le salarié de la possibilité de négocier en position plus avantageuse grâce à l’assistance du comité d’entreprise ou des syndicats ? Or telle est bien la situation en cas de licenciement, voire de plan social.
Dans le même ordre d’idée, il nous semble nécessaire de préciser la date de mise en application de cette disposition ainsi que la nature de l’assistance dont pourront bénéficier les deux parties. Nous présenterons d’ailleurs des amendements en ce sens.
Certes, de nouvelles garanties procédurales sont instaurées. Il en est ainsi de l’assistance du salarié, du droit de rétractation durant quinze jours et de l’homologation par les directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, lesquelles disposeront de dix jours effectifs pour vérifier qu’il n’y a pas de vice dans ce consentement mutuel, en raison notamment de motifs discriminatoires non prévus pour autant.
Au regard des dispositions existantes en cas de licenciement – entretien préalable, convocation du salarié, qui peut se faire assister, envoi d’une lettre recommandée détaillant les motifs « réels et sérieux », obligation de reclasser le salarié, respect du délai de réflexion –, peut-on considérer qu’il ne s’agit pas pour le salarié d’un recul ? Il me semble que la question vaut d’être posée.
L’article 6 du projet de loi, qui met en œuvre le b) de l’article 12 de l’accord national interprofessionnel, crée un nouveau CDD dit « contrat à objet défini ». Il est exigé par le patronat depuis de nombreuses années.
En effet, le MEDEF a, le premier, avancé l’idée d’un « CDI à objet précis », qui s’inspirait directement du rapport Virville. À l’époque, les organisations salariales avaient catégoriquement rejeté cette proposition.
Comme nous pouvons l’observer, l’appellation retenue permet de ne pas remettre en question, au moins dans la terminologie, le contrat à durée indéterminée. Ainsi, ce nouveau CDD réservé aux ingénieurs et aux cadres, soit plus d’un actif sur dix, est conclu comme un contrat commercial pour un objet défini, en l’occurrence une mission définie par l’employeur. Une fois cette dernière terminée, le contrat à objet défini prend fin. Le recours à ce type de contrat est subordonné à un accord de branche étendu ou à un accord d’entreprise, ce qui a pour effet d’étendre le champ d’application potentiel à l’ensemble de notre économie.
En outre, nous constatons que, si le code du travail, dans ses articles L. 1241-1 et suivants, définit précisément les possibilités qui s’offrent aux employeurs pour avoir recours aux divers CDD existants, ce nouveau contrat échappe à cette logique limitative. La rédaction proposée ne reprend pas celle de l’accord, qui stipulait que ces contrats devaient permettre de « faire face à un accroissement temporaire d’activité ».
En faisant appel à ce nouveau contrat, il n’en sera plus question. Rien ne garantit donc que les employeurs n’en feront pas un usage abusif. Cette crainte est renforcée par le fait que, si la durée du CDD classique était au maximum de dix-huit mois, elle est pour ce contrat au minimum de dix-huit mois et au maximum de trente-six mois.
S’ajoute à cela que, si le CDD ne pouvait être rompu que pour faute grave, le contrat de mission peut être résilié au bout de douze mois sans raison de nature fautive. De là à penser que ce nouveau contrat combine la précarité du CDD et celle du CDI dans la possibilité qu’il offre à l’employeur de mettre fin au contrat à tout moment pour un « motif réel et sérieux », il n’y a qu’un pas que nombre d’observateurs n’ont pas hésité à franchir.
Enfin, nous pouvons nous interroger sur la portée économique de cette disposition dès lors qu’elle offre à toute entreprise la possibilité de sous-traiter à l’interne, en lieu et place d’une société prestataire de services, et qu’en parallèle elle permet, via la précarisation de ce salariat qui n’aura donc plus aucun attachement pour son entreprise, la possibilité de devenir du jour au lendemain un acteur essentiel de sa propre concurrence.
En contrepartie, puisque telle est la règle qu’impose la recherche d’un équilibre, nous notons avec satisfaction que le contrat à durée indéterminée est reconnu comme « la forme normale et générale de la relation de travail ».
Dans le même temps, l’employeur devra informer le comité d’entreprise ou les représentants du personnel des éléments qui l’ont conduit à faire appel à des formes dérogatoires au CDI. Les périodes de stages effectués au sein de l’entreprise lors de la dernière année d’étude seront intégrées à la période d’essai.
Notons que la période d’ancienneté nécessaire à la conservation de son salaire en cas de maladie passe de trois à deux ans, alors que celle qui permet l’obtention d’une indemnité de licenciement ne sera plus que d’une année, contre deux précédemment.
Le CNE, de triste mémoire, qui ne concerne pas moins de 100 000 de nos concitoyens, condamné par notre jurisprudence et contraire à la convention n° 158 de l’OIT, est enfin requalifié en CDI de droit commun. Pour nous, socialistes, qui nous sommes tant mobilisés contre cette généralisation de la précarité, pour tous nos concitoyens qui ont refusé cette disposition inique, il s’agit là d’un aboutissement et nous le saluons.
Ces dispositions sont d’incontestables avancées. Cependant, elles ne permettent pas de donner corps à la sécurisation professionnelle qui se situe au centre de toute volonté de moderniser le marché du travail.
En effet, l’accord du 11 janvier prévoit d’augmenter l’indemnisation chômage des jeunes, lesquels, rappelons-le, connaissent un taux de chômage qui s’établit à près de 20 % et qui, dans certains quartiers, monsieur le ministre, vous le savez bien, avoisine les 40 %.
Cet accord prévoit également le développement de la validation des acquis de l’expérience et de la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences telle que l’instaure la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. À ce titre, notre collègue Gérard Larcher notait qu’il s’agissait « d’un facteur déterminant pour éviter les restructurations brutales ». Il suffit de penser aux salariés du site de Gandrange ou bien à ceux de l’usine Duralex pour percevoir la pertinence de cette disposition. Il en va de même pour la création d’un bilan d’étape professionnel, l’amélioration et la transférabilité des droits, notamment du droit individuel à la formation.
Ces dispositions, nous en convenons tous, participent activement de l’établissement d’une véritable sécurisation professionnelle pour les salariés. Cependant, certaines relèvent de la réglementation alors que d’autres renvoient directement aux futures négociations sur la formation professionnelle ou sur la convention d’assurance chômage, par exemple.
Les résultats des prochaines négociations, alliés à la volonté du Gouvernement de respecter cet équilibre entre déréglementation et sécurisation, conditionneront donc la nature exacte de cette modernisation du marché du travail.
Comment ne pas s’inquiéter lorsque la transformation des CNE en CDI est attaquée par une partie du patronat, quand la ministre de l’économie annonce depuis l’étranger – cela apparaît désormais comme une tradition ! – que les séniors « doivent pouvoir chercher du travail » et que, le 28 mars dernier, le secrétaire d’État chargé de l’emploi annonçait : « La négociation de la nouvelle convention d’assurance chômage doit être l’occasion de préciser ce qu’on entend vraiment par offre valable d’emploi. Si les partenaires sociaux ne parviennent pas à un accord, il reviendra effectivement au Gouvernement de traiter cette question » ?
Comment passer sous silence l’énergie déployée par le Président de la République pour attaquer la formation professionnelle alors que l’accord du 11 janvier est à ce sujet satisfaisant ? Comment ne pas y voir une tentative de s’emparer des fonds paritaires de l’assurance chômage et de la formation professionnelle afin de renflouer des comptes sociaux que la droite a fait plonger dans le rouge ?
Moderniser le marché du travail nécessite une approche globale. Avec ce texte, vous n’offrez, monsieur le ministre, une approche parcellisée, qui ne répond pas ou qui répond très insuffisamment aux difficultés qui caractérisent ce marché : faible taux d’activité des seniors, chômage de masse pour une partie de notre jeunesse, précarisation galopante du salariat, notamment des personnes les plus fragiles comme les femmes, manque de main-d’œuvre dans certains secteurs. Nous regrettons vivement cette méthode.
Parce qu’il est impératif que cette modernisation du marché du travail s’inscrive dans le respect total des partenaires sociaux, parce que l’alignement sur le modèle anglo-saxon, en lieu et place de la recherche d’une plus grande justice et d’une meilleure répartition des efforts et des richesses, constituerait une remise en cause intégrale de notre cohésion sociale, soyez assuré, monsieur le ministre, que nous demeurerons extrêmement vigilants lors des négociations à venir et très attentifs au contenu des décrets qui seront pris.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, aujourd’hui, les salariés et les employeurs de notre pays, mais aussi ceux des pays voisins partagent un profond sentiment d’insécurité face à une mondialisation qui intensifie la concurrence et contraint les entreprises à se transformer en permanence, parfois même à délocaliser leurs activités.
Pour la Commission européenne, le bilan peut être positif pour tous, à condition d’améliorer les capacités d’adaptation des entreprises et des travailleurs d’Europe à un environnement dans lequel la flexibilité et la sécurité se renforcent mutuellement.
En effet, la gestion flexible de l’emploi offre aux entreprises un moyen de répondre aux contraintes financières ou concurrentielles qu’elles subissent. Mais en même temps, il faut trouver les moyens de concilier, pour les salariés, les changements professionnels, la continuité du revenu et des droits et trajectoires ascendants : la sécurité doit accompagner la mobilité.
Bruxelles souhaite que tous les États suivent l’exemple des pays d’Europe du nord. Ils ont introduit avec succès la « flexicurité » dans leur législation. Je rappelle que notre collègue et ancien ministre Gérard Larcher pilote actuellement une mission sur la « flexicurité » en Europe.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui a conduit les observateurs économiques à parler d’une « flexicurité à la française ».
En matière d’emploi, sous l’impulsion de M. le Président de la République, la France est engagée dans une réforme d’ampleur. Celle-ci s’appuie sur la concertation et la négociation.
Le Gouvernement a fait le choix de réunir des conférences tripartites associant syndicats, patronat et État, sur différents thèmes majeurs : la modernisation du marché du travail, la formation professionnelle, la démocratie sociale et l’assurance chômage. Dans le même temps, la réforme du service public de l’emploi a franchi une étape majeure avec la fusion ANPE-UNEDIC, que nous avons appelée de nos vœux lors de l’examen du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, dont j’étais le rapporteur, en décembre 2004.
L’ensemble du processus a un caractère tripartite prononcé, les pouvoirs publics tenant un rôle actif dans le calendrier et l’ordre du jour des négociations.
Le texte, qui reprend des dispositions de l’accord interprofessionnel du 11 janvier dernier, est avant tout un succès de la négociation collective.

Il vise à apaiser les relations entre partenaires sociaux, sujet sur lequel je milite personnellement depuis que j’ai été chargé d’exercer des responsabilités en entreprise.
Il s’agit du premier accord conclu dans le cadre de la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, qui a prévu, dans le domaine des relations de travail, une procédure de concertation préalable aux réformes avec les organisations patronales et syndicales.
Monsieur le rapporteur, vous vous êtes demandé si nous étions entrés dans une nouvelle ère des relations entre les partenaires sociaux. Selon un proverbe chinois, « un long voyage commence par un petit pas ». Espérons que le voyage sera long et que le petit pas sera prometteur. Soyons optimistes, bien sûr, mais restons modestes, car une hirondelle ne fait pas le printemps ! Nous devrons donc persévérer.
L’accord obtenu a été signé par les trois organisations d’employeurs – le MEDEF, la CGPME et l’UPA – et par quatre syndicats représentatifs, hormis la CGT.
Il n’était pas évident de parvenir à un accord sur les thèmes abordés. Les partenaires sociaux ont su trouver des points d’entente pour rendre notre droit plus souple, plus adapté aux réalités économiques. Ils ont su faire confiance au Gouvernement pour donner une force obligatoire au texte.
La volonté du Gouvernement de respecter les termes de l’accord ne s’est pas démentie. Le dialogue social s’est poursuivi lors du travail de transposition auquel ont été associés les partenaires sociaux, y compris la CGT, même si elle n’avait pas signé l’accord.
Comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, c’est cette méthode, celle d’un dialogue social quotidien, qui donne au texte une légitimité supplémentaire et sans doute aussi une efficacité et une durabilité accrues. Car il s’agit bien d’améliorer notre droit du travail dans une perspective de long terme, au-delà du jeu des alternances politiques.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui est un texte d’équilibre. Il apporte des garanties nouvelles aux salariés et offre aux entreprises des outils pour faciliter leur activité.
Je rappellerai brièvement les dispositions qui me semblent essentielles.
En ce qui concerne les garanties apportées aux salariés, l’article 1er est le plus symbolique puisqu’il affirme que la forme normale de la relation de travail est le contrat à durée indéterminé. Cette disposition fixe de façon officielle la prépondérance du CDI sur les autres types de contrats, en particulier le CDD et l’intérim, mais vous avez rappelé, monsieur le rapporteur qu’il en existait trente-huit au total. Les uns et les autres devront par conséquent faire l’objet d’une information renforcée du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Par ailleurs, les contrats nouvelles embauches, les CNE, mis en place en 2005, seront automatiquement transformés en CDI classiques après l’entrée en vigueur de la loi.
Le projet de loi réduit de trois à un an la durée d’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnisation conventionnelle de la maladie et de deux à un an celle qui est nécessaire pour prétendre aux indemnités de licenciement. Ces dernières seront calculées sur la base d’un taux unique, ce qui est plus favorable pour le salarié que le régime précédent, qui distinguait les licenciements pour raison économique et les licenciements pour motif personnel.
Par ailleurs, bien que cette disposition ne soit pas nouvelle, tout licenciement devra aussi être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce motif étant porté à la connaissance du salarié.
Je souhaite souligner l’importance d’autres mesures modernisant les relations individuelles de travail, notamment la rupture conventionnelle du contrat de travail. En tenant compte de la volonté commune du salarié et de l’employeur, elle permet d’échapper à l’alternative démission ou licenciement et à la judiciarisation de ce dernier.
Ce nouveau mode de rupture ouvre droit à une indemnité égale à celle du licenciement et est assorti de garanties : entretiens, assistance des parties, faculté de rétractation, homologation par le directeur départemental du travail. Il s’agit certainement de la disposition centrale du projet de loi, car, en réduisant le risque lié à l’embauche, elle facilitera l’emploi, tout en garantissant aux salariés la sécurité qui leur est nécessaire.
Un autre signe fort tient à l’introduction dans le code du travail d’un terme à la période d’essai. Elle sera dorénavant limitée à une durée maximale variant selon la catégorie à laquelle appartient le salarié. De plus, la durée des stages de fin d’études a été incluse dans la période d’essai.
Enfin, le texte donne à l’entreprise la possibilité d’élargir son champ d’action en fonction de ses besoins.
L’actuel droit du travail ne prend pas suffisamment en compte certaines hypothèses de relations de travail qui s’organisent autour de projets s’étendant sur quelques mois ou quelques années, et dont les délais de réalisation ne sont pas toujours connus.
Le projet de loi prévoit la mise en place, à titre expérimental, d’un nouveau contrat à durée déterminée à objet défini, qui permettra à l’entreprise d’embaucher, pour une période de dix-huit mois à trois ans, un cadre ou un ingénieur en vue de la réalisation d’un projet précis.
L’Assemblée nationale a apporté des précisions sur divers points du projet de loi. Notre commission a également tenu à améliorer certains de ses aspects. Le rapporteur s’est particulièrement attaché à respecter l’accord des partenaires sociaux. Je tiens à le féliciter de la qualité de son travail, de la clarté de son propos, de son écoute et de l’intérêt qu’il a su porter aux observations de ses collègues.
Bien que le Parlement ait son rôle à jouer, il est clair qu’aller plus loin dans la modification du texte reviendrait soit à sortir du cadre de l’accord interprofessionnel, soit à le pervertir. Or il n’est pas conseillé de remettre en cause l’équilibre issu des négociations.
La CGT, je le rappelle, n’a pas souhaité signer l’accord interprofessionnel en faisant valoir que le législateur allait ensuite dénaturer le texte. En réalisant une transposition d’une fidélité parfaite, nous démontrerons que ces craintes étaient infondées et nous manifesterons à tous, pour l’avenir, la confiance que nous plaçons dans les négociations.
Le présent projet ne transpose qu’une partie de l’accord. Il sera complété par des dispositions d’ordre réglementaire. La réforme engagée appelle par ailleurs d’autres textes, sur l’assurance chômage et sur la formation.
Monsieur le ministre, je saisis l’occasion que fournit ce débat pour souligner que nous sommes nombreux, au sein de la Haute Assemblée, à souhaiter une réforme profonde de la formation professionnelle. Une mission présidée par M. Jean-Claude Carle, et dont le rapporteur est M. Bernard Seillier, a dénoncé les trois maux dont souffre la formation professionnelle : complexité, cloisonnements et corporatisme. Nous serons donc très attentifs aux négociations à venir.
La conjoncture de l’emploi s’est améliorée. Le taux de chômage s’établissait, à la fin de 2007, à 7, 5 %, soit une baisse de 0, 9 point sur un an. La modernisation du marché du travail représente une évolution capitale pour parvenir au plein emploi, conformément à l’objectif qui a été fixé par le Président de la République. Notre groupe apportera bien évidemment son soutien à cette politique.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi est en l’état inacceptable puisqu’il participe d’un long processus, cohérent et rigoureux, de démantèlement du droit du travail !
Ça commence fort !

Au moins les choses sont dites, monsieur le ministre !
En outre, il ne répond en rien aux attentes actuelles du monde du travail s’agissant du fort taux de chômage, du développement de la précarité, du temps partiel subi, des difficultés d’emploi des seniors et des jeunes, de la formation professionnelle, de l’augmentation des salaires !
Cependant, quelques dispositions, positives en apparence, côtoient des mesures inacceptables, mais cela dans le but de faire taire les éventuelles contestations et de vous donner l’occasion, monsieur le ministre, d’affirmer qu’il s’agit d’un texte équilibré, répondant aux revendications des partenaires sociaux et à une philosophie dont le Parlement ne saurait défaire la trame.
Tel est le cas de l’abrogation du CNE. Pourtant, chacun dans cette enceinte sait bien que cette abrogation résulte non pas de la négociation, mais de différentes jurisprudences et de la condamnation de la France par l’Organisation internationale du travail !
Tel est aussi le cas d’une partie de l’article 4 du projet, qui abaisse la durée d’ancienneté nécessaire dans l’entreprise pour pouvoir prétendre aux indemnités de licenciements. L’absence d’études sur les conséquences de cette mesure sur notre système d’indemnisation du chômage nous fait craindre l’adoption future de mesures de rétorsion, la diminution de la durée d’indemnisation, par exemple. Les négociations qui s’engagent sont, de ce point de vue, des plus importantes. Nous serons vigilants quant à leur déroulement.
En outre, cette disposition, qui permet également de doubler le montant de l’indemnité, doit être considérée avec la plus grande prudence. Ce doublement ne touche en réalité que certains salariés dans la mesure où ceux qui sont licenciés pour motif économique ou pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle bénéficient déjà de ce niveau.
De surcroît, la création d’une indemnité unique entraîne la suppression de la majoration accordée aux salariés licenciés après dix ans d’ancienneté. L’indemnité des uns est donc financée par la baisse des indemnités des autres : l’accord rend moins cher le licenciement des salariés ayant une grande ancienneté !
Monsieur le ministre, nous attendons, comme vous nous l’avez promis en commission, que vous nous indiquiez les grandes lignes du futur décret et que vous confirmiez que cette « anomalie » n’aura existé que le temps du débat parlementaire.
L’article 3 du projet de loi prévoit d’abaisser de trois années à une seule l’ancienneté requise pour bénéficier de l’indemnité complémentaire en cas de maladie.
Cependant, nous nous souvenons des récentes déclarations de Mme Bachelot ou du Président de la République sur une mise à contribution accrue des mutuelles. Nous nous souvenons aussi et surtout des franchises médicales, cet impôt injuste sur la maladie.
Comment dès lors ne pas s’interroger sur la portée réelle de cette mesure ? Entendez-vous ouvrir droit à une protection sociale rabougrie ? Ou bien, et cela n’est pas contradictoire, souhaitez-vous orienter les salariés vers un système d’assurance complémentaire dont le champ de compétences sera, on le devine, considérablement étendu, quitte à accroître les coûts qui pèsent sur les cotisants ?
Les mesures prétendument bénéfiques de ce projet de loi nous inspirent donc de grandes interrogations. Mais ce texte comprend également des dispositions largement insatisfaisantes.
Ainsi en est-il la disposition de l’article 2 qui prévoit que seule une partie de la durée des stages réalisés dans l’entreprise au cours de la dernière année d’études est déduite de la période d’essai. Pourquoi limiter la portée de cette mesure et ne pas prévoir que la durée des stages est intégralement déduite de la période d’essai ? Rien, sur le fond, ne l’interdit. Cela répondrait en outre à une demande réitérée des associations et des organisations représentatives des stagiaires.
Quant à l’article 1er, que dire si ce n’est qu’il se limite à une déclaration de bonnes intentions, tout en légitimant l’existence des emplois précaires, au nom des « impératifs économiques de la mondialisation ». Le fait qu’il retranscrive dans la loi l’article 1er de l’accord national interprofessionnel ne change rien. On peut d’ailleurs se demander pourquoi des organisations syndicales de salariés reprennent les ritournelles patronales : en quoi est-il nécessaire de créer des contrats précaires pour faire face à des besoins certes ponctuels, mais néanmoins prévisibles ? Pourquoi faut-il multiplier le nombre des statuts précaires qui remplissent la même fonction ? Tout cela, bien sûr, en vertu de la mondialisation !
De plus, comment comprendre que vous donniez toute sa valeur à cette pétition de principe alors que, dans le même temps, non seulement vous conservez les trente-sept contrats dérogatoires existants, mais vous en ajoutez même un nouveau, avec l’article 6 du projet de loi ?
Monsieur le ministre, les sénatrices et sénateurs communistes attachent une grande importance au contrat à durée indéterminée. Nous considérons qu’il est utile aux salariés, à l’économie et aux employeurs.
Le CDI est utile aux salariés et à l’économie, car il est un gage d’équilibre et de sécurité. Il est également utile à l’employeur, car la contrepartie de cette sécurité juridique est, toutes les études le prouvent, une productivité supérieure à la moyenne.
C’est pourquoi nous avons déposé sur ce sujet un certain nombre d’amendements. Je regrette que vous n’ayez pas saisi l’occasion de cet article pour reprendre à votre compte les amendements déposés par mon groupe lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008, visant à instaurer une sorte de « bonus-malus » applicable aux entreprises en fonction de leurs politiques sociales et salariales.
Voilà un instant, M. le président de la commission des affaires sociales me disait que je n’avais sans doute pas trouvé le bon véhicule pour faire « passer » ces amendements. Peut-être aurai-je plus de chance aujourd’hui ?
À l'instar des organisations représentatives des salariés privés d’emplois, de la CGT et de bon nombre de juristes, nous considérons que cet article ne sera d’aucune efficacité contre la précarisation du salariat, car il n’est nullement contraignant. Autant dire qu’il s’agit d’un coup d’épée dans l’eau !
Au-delà de la doctrine générale qui l’inspire, ce texte a pour réel objet de précariser le monde du travail ou, pour utiliser un terme faisant un meilleur écho à ce projet, de le « flexibiliser » davantage. Il s’agit d’un objectif que nous ne pouvons approuver.
M. Emmanuel Dockès, professeur à l’université de Lyon 2 et directeur de l’Institut d’études du travail de Lyon, considère que ce texte « comprend un certain nombre de régressions qui devraient le faire entrer dans l’histoire comme l’un des plus importants reculs qu’ait eu à connaître le droit du travail français depuis 1945 ».

Autant dire que nous récusons votre conception de la « flexicurité à la française », dont les salariés n’auront à connaître que la flexibilité. Ce sera la flexibilité imposée par l’employeur aux salariés, contraints d’accepter un contrat à durée déterminé dont l’échéance est la réalisation d’une mission. Il s’agit de la transposition dans notre droit de l’un des désirs anciens du MEDEF : le recours au « salarié Kleenex », que l’on peut utiliser, exploiter, pressurer et jeter dès lors qu’il a rempli sa mission !
Monsieur le ministre, quelle sécurité sera offerte à ces salariés recrutés sous contrat de mission, alors qu’ils pourront être licenciés à l’issue de la mission – c’est l’objet même du contrat –, mais aussi pendant la période d’essai ainsi qu’à l’occasion des douzième ou vingt-quatrième mois correspondant à la date anniversaire de la conclusion du contrat, voire au dix-huitième mois si l’amendement déposé par le rapporteur est adopté ?
Drôle de conception de la sécurité de l’emploi qui se traduit par la multiplication des occasions légales de rupture sur l’initiative de l’employeur ! Parlons plutôt d’insécurité, cadeau en direction des employeurs, MEDEF et CGPME.
Je n’oublierai pas non plus l’allongement des périodes d’essai, obtenu sous la pression permanente du patronat et insidieuse du Gouvernement. De l’aveu même du représentant du MEDEF devant notre commission – j’ai d’ailleurs trouvé très honnête de sa part qu’il le formule clairement ! –, à partir du moment où le CNE disparaissait, il fallait influer sur la période d’essai.
Cela marque un recul pour les salariés, car aujourd’hui les conventions collectives prévoient des durées de période d’essai d’une semaine à trois mois, suivant la qualification demandée, ce qui correspond à ce qu’il est convenu d’appeler la « durée raisonnable ». On se situe avec l’article 2 du projet de loi bien au-delà du raisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai affirmée par l’accord national interprofessionnel, l’ANI !
Alors, de quelle sécurité pour les salariés s’agit-il ?
De celle de percevoir une indemnité de chômage plus importante et plus longue ? Nous savons que non, et je ne reviendrai pas sur l’« offre valable d’emploi » qui va devenir une « offre acceptable d’emploi », nous en avons discuté suffisamment lors de l’examen du texte portant sur la fusion de l’UNEDIC et de l’ANPE. Ce sera d’ailleurs l’objet de prochaines négociations avec les partenaires sociaux, prévues à l’article 18 de l’ANI, l’enjeu étant pour le Gouvernement d’imposer à un salarié licencié d’accepter un emploi moins qualifié, donc moins rémunéré, sous peine de perdre les allocations chômage.
Sans doute s’agit-il plutôt de la sécurité du patronat : celui-ci, une fois encore, dispose d’outils adaptés à sa politique managériale, traduction du libéralisme économique qui transforme les hommes et les femmes composant l’entreprise et faisant sa richesse en simple variable d’ajustement.
Ainsi, grâce à la rupture conventionnelle, qui met à bas quarante ans de construction des protections contre le licenciement arbitraire, les employeurs pourront obtenir légalement qu’un salarié accepte cette rupture plutôt qu’il n’exige un licenciement. Cette disposition n’est nullement créatrice de droits nouveaux pour le salarié : elle existe déjà, comme vous l’avez d’ailleurs rappelé vous-même, monsieur le ministre, ainsi que le rapporteur, devant la commission. Le seul droit nouveau qui aurait pu être créé aurait consisté à donner au salarié un moyen juridique de faire reconnaître ce droit par son employeur. Mais de cela il n’est nullement question, si ce n’est à travers la précision : « d’un commun accord », formule dont toutes et tous ici connaissons la valeur ! L’employeur, au contraire, en raison de l’existence du lien de subordination, dispose de tous les moyens pour imposer cette décision.
Le projet de loi, tout comme l’accord national interprofessionnel lui-même, s’est, de mon point de vue, construit en défaveur des salariés. Il ne s’agit donc pas, contrairement à ce que vous voudriez nous faire croire, monsieur le ministre, d’un texte équilibré. Les organisations syndicales signataires de l’accord le reconnaissent elles-mêmes et nous invitent à être vigilants lorsque viendront en examen devant le Parlement, notamment, les textes portant sur la formation professionnelle et sur l’indemnisation des salariés privés d’emploi – c’est en cours –, ou encore lors de l’élaboration des nombreux décrets à venir.
Pour mieux comprendre cet accord, il nous faut nous intéresser au contexte dans lequel se sont inscrites les négociations. Il faut nous souvenir – et je comprends que cela vous déplaise, monsieur le ministre, en cette période où le Président de la République dénonce le chantage exercé par certaines entreprises –…

…du chantage qui a pesé sur les négociations : soit les syndicats parvenaient à s’entendre avec le patronat, soit le Gouvernement déposait un projet de loi. Les syndicats, ne sachant que trop bien comment le texte serait rédigé, se sont sentis obligés d’accepter de signer l’ANI. Cela a fait dire à Thomas Coutrot, économiste, que la menace planait du vote d’une « loi MEDEF » ; ce sentiment est d’ailleurs partagé par M. François Chérèque, dirigeant de la CFDT – pourtant signataire de l’accord –, pour qui « les documents d’orientation du Gouvernement sont quelque peu directifs ».
Comment ignorer encore que, dès le début de la négociation, vous avez pesé sur son contenu, sur son déroulement, en créant le concept ambigu d’« organisations syndicales responsables », donnant à croire que les syndicats ne trouvent leur légitimité que dans la seule négociation avec le patronat et le Gouvernement ? C’est là une nouvelle raison qui m’incite à ne pas voter le projet de loi, monsieur le ministre : cet accord s’est construit sans consultation des militantes et militants des différents syndicats, par faute de temps puisque, en plus du chantage à la « loi MEDEF », vous avez imposé un rythme infernal pour mener à bien ces négociations – rythme que curieusement, comme le relevait à l’instant ma collègue Christiane Demontès, vous n’avez pas encore voulu imposer pour les discussions sur la pénibilité ou sur l’égalité professionnelle !
Pour conclure, je soulignerai que les récentes déclarations du Président de la République ne nous laissent que peu d’espoirs et amènent une question : pourquoi vouloir flexibiliser un marché du travail français qui ne semble guère rigide ? Car 2, 5 millions de salariés en CDD ou en intérim, c’est un record historique ; 800 000 à 900 000 salariés en CDI sont licenciés chaque année. Les licenciements pour motif « personnel » se sont multipliés et représentent désormais les trois quarts des licenciements. Dans neuf cas sur dix, les procédures sont extrêmement simples : un entretien suivi de l’envoi d’une lettre précisant les motifs. Licencier un CDI dans les deux premières années ne coûte quasiment rien ; et ce n’est pas la « mesurette » incluse dans votre projet de loi qui va beaucoup changer les choses !
Pour toutes ces raisons, monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe communiste républicain et citoyen votera contre ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.
M. Xavier Bertrand, ministre. Ce n’est pas ce à quoi nous nous attentions !
Sourires.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici sollicités par le Gouvernement pour valider conforme l’ANI, l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail, qu’il présente comme une avancée historique vers la flexisécurité à la française.
Tout d’abord, évoquons la méthode employée.
Que l’on incite les partenaires sociaux à négocier pour définir par le dialogue social des compromis intelligents, tel l’accord interprofessionnel sur la formation, c’est une excellente chose. Mais ce n’est absolument pas cette logique qui a prévalu en ce qui concerne l’ANI !
Première étape : le Président de la République a mis en demeure les salariés d’engager une négociation dont il fixait lui-même les objectifs politiques, le contenu et les échéances, les menaçant même de l’adoption d’une loi au contenu pire pour les salariés en cas de non-accord.

Je me permettrai simplement de rappeler qu’en droit civil la signature d’un contrat sous contrainte entache ce dernier d’un vice de consentement ayant pour conséquence… la nullité du contrat. Eh bien, c’est exactement ce qui s’est passé, et c’est la raison pour laquelle, contrairement à l’accord interprofessionnel sur la formation, l’ANI n’a pas reçu l’aval de l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Deuxième étape : le Gouvernement nous demande aujourd’hui de valider en l’état le texte transposé. En clair, après avoir mis la pression sur les syndicats de salariés, le Gouvernement récidive avec les parlementaires en les invitant à cautionner un texte profondément déséquilibré.
C’est d’abord faire injure à la représentation nationale, qui devient une simple chambre d’enregistrement.

C’est également l’empêcher de faire son travail. En effet, le rôle de la loi est de rétablir l’équilibre entre le puissant et le faible, ce qui est dans ce cas précis indispensable puisque le texte présente un déséquilibre inacceptable.
Le projet de loi fait droit à trois revendications principales du patronat : l’allongement de la période d’essai, la création du contrat de mission et la rupture conventionnelle du contrat de travail, sans que soient accordées des contreparties significatives aux salariés.
La rupture conventionnelle du contrat de travail est emblématique du dérapage que l’on nous demande de cautionner : on glisse insensiblement du droit du travail au droit civil, ce qui constitue implicitement une négation du déséquilibre structurel qui prévaut dans la relation entre l’employeur et le salarié, plus particulièrement en situation de crise économique.
J’examinerai plus précisément certaines dispositions du texte.
L’article 2 introduit la codification du régime de la période d’essai, qui jusqu’à présent relevait uniquement des conventions collectives de branche. Les durées d’essai et de renouvellement de toutes les catégories sont ainsi allongées par la loi : elles pourront aller jusqu’à quatre mois pour les ouvriers et huit mois pour les cadres ! Ainsi, alors que, conformément à l’avis du Conseil d’État, les durées définies dans l’ANI devraient être comprises comme des plafonds, le projet de loi oblige toutes les conventions de branche à aligner les périodes d’essai sur ces maxima d’ici au 30 juin 2009 : nous n’avons plus le CNE, mais nous avons l’allongement des périodes d’essai !

Les dispositions de l’article 5 introduisent la « rupture conventionnelle ». Elles semblent ignorer certaines réalités du monde du travail : les pressions subies par les employés, le harcèlement moral ou sexuel, les discriminations raciales, les inégalités de traitement entre femmes et hommes… Elles font surtout disparaître l’obligation de motivation.
Ces dispositions constituent ainsi une rupture historique avec la philosophie juridique dominante du droit du travail, …

…qui reconnaît la subordination du salarié par rapport à l’employeur et qui a jusqu’aujourd’hui conféré des droits à la partie faible, les salariés, pour tenter de rétablir la relation.
En réalité, le déséquilibre est même renforcé au profit… de l’employeur ! En effet, l’auteur de l’initiative de la rupture conventionnelle n’étant pas mentionné dans l’acte, l’employeur peut se retrancher derrière cette procédure pour éviter un licenciement motivé en bonne et due forme.
Il en va de même avec la disposition qui prévoit que, face à un salarié assisté par une personne de l’entreprise, l’employeur dispose du droit de se faire assister par une personne extérieure à l’entreprise, notamment par un avocat !
Ainsi, plutôt que de moderniser le marché du travail, ce projet de loi introduit une régression préoccupante sur une question essentielle pour les salariés : celle des conditions de la rupture du contrat de travail.
M. Guy Fischer applaudit.

En conclusion, je voudrais revenir sur cette prétendue « flexisécurité à la française » vers laquelle nous conduirait ce texte : une plus grande souplesse du marché du travail pour l’employeur contre une plus grande sécurité du parcours professionnel pour le salarié.
Mme Nicole Borvo Cohen-Seat s’exclame.

…qui affiche un taux de chômage de 2, 9 % et un taux d’emploi de 77, 3 %. Si le licenciement y est facilité, la sécurité pour les salariés tout au long de leur vie professionnelle est effectivement garantie. Les chômeurs sont bien indemnisés : avec 90 % du salaire brut pendant quatre ans, ils ne subissent pas de rupture… du pouvoir d’achat ! Leurs compétences sont reconnues : ils ne doivent se voir proposer que des emplois correspondant à leur qualification.

La garantie de retour à l’emploi est assurée, le cas échéant via une formation qualifiante bien rémunérée. Enfin, la suspension de l’indemnisation en cas de refus de proposition d’emploi ou de formation, systématiquement mise en exergue par les promoteurs de la flexibilité à tout crin, est pour l’essentiel confiée aux syndicats… qui sont également très présents dans le fonctionnement des agences pour l’emploi.
Ce sont là autant de dispositions qui évitent la multiplication des emplois de mauvaise qualité et contribuent à la consolidation effective des droits des salariés en termes de parcours professionnel.
Cependant, un tel système ne fonctionne que si deux conditions impératives sont réunies. D’une part, l’État et les entreprises doivent accepter d’y consacrer les moyens nécessaires, notamment en termes de formation et d’indemnisation des chômeurs : 5% du PIB, soit la moitié de plus qu’en France ! D’autre part, le syndicalisme doit être fort et gestionnaire, capable de négocier des accords équilibrés et de participer activement à leur application sur le terrain. Notre pays en est aujourd’hui très loin !
Monsieur le ministre, en nous invitant à valider en l’état un texte profondément déséquilibré, au sein duquel les quelques prétendues avancées au bénéfice des salariés pèsent très peu par rapport au « détricotage » du droit du travail auquel vous nous demandez de participer, vous affirmez instituer une flexisécurité à la française. En réalité, il s’agit tout simplement d’une nouvelle forme de flexibilité pour les employeurs… sans sécurité pour les salariés !
Cessons de nous payer de mots : avec des syndicats de salariés affaiblis, dans un contexte de taux de chômage élevé, le fameux « dialogue social » ne peut en aucun cas aboutir à des « compromis sociaux » équilibrés.
Dans une telle situation, il revient au législateur de protéger le faible et de faire prévaloir la logique du droit du travail, qui reconnaît dès son origine le déséquilibre structurel entre l’employeur et l’employé.
Abdiquer ses responsabilités pour « laisser faire » les partenaires sociaux, c’est nier ce déséquilibre structurel porteur d’insécurité sociale ! Dans ce contexte, parler de flexisécurité relève de l’imposture !
Est-ce une nouvelle dérive atlantiste du Président de la République ? Une nouvelle traduction de sa fascination avérée pour le modèle libéral anglo-saxon ? Des salariés, qui ont vu des leaders syndicaux finir par se résoudre sous la contrainte à signer l’ANI, en passant par nos concitoyens, plus personne n’est dupe !
Les Verts ne participeront pas à ce détricotage historique du droit du travail sous couvert de je ne sais quelle modernité.
Nous ne cautionnerons pas non plus ce qui risque de devenir un fâcheux précédent : le Parlement devrait-il désormais valider servilement n’importe quel accord entre les partenaires sociaux, quel que soit son contenu, au motif qu’il résulte de « négociations » ?
C’est pourquoi nous voterons contre ce mauvais texte, tout en proposant des amendements destinés à en limiter les dégâts pour les salariés.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi résulte d’un accord interprofessionnel signé le 21 janvier 2008 par trois organisations patronales et quatre syndicats – encore faudrait-il savoir ce que ces organismes représentent réellement, soit auprès des chefs d’entreprise, soit auprès des salariés, ce qui n’est nullement garanti.
Cela semble exceptionnel et est salué comme tel, d’abord parce qu’il s’agit d’un accord patronat-syndicats, mais surtout parce qu’il est très rare qu’un texte destiné à devenir une loi ne soit pas conçu par le Gouvernement, puis présenté aux parlementaires et, enfin, aux syndicats.
Aujourd'hui, c’est l’inverse. On doit voter un projet de loi dont les termes ont été acceptés d’abord par les syndicats. Dès lors, à quoi servent les parlementaires s’ils doivent entériner sans modification des textes acceptés par les syndicats ?
À ma connaissance, ni les parlementaires, ni les commissions, ni les groupes n’ont été consultés sur la tenue de ces accords, ce qui est anormal et aurait facilité bien des choses.
Certes des progrès seront réalisés grâce à la rupture conventionnelle de certains contrats de travail, des contrats pour la réalisation d’un objet défini pourront être proposés, ce qui est appréciable, même si les conditions prévues sont à mon sens trop limitées.
Permettez cependant au chef d’entreprise que je suis d’être déçu que ce texte soit un complément du code du travail en vigueur, et non une véritable modernisation. En effet, il commence par la déclaration suivante : « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ». Tout est dit ! La rigidité du travail continuera à gérer nos emplois, ce qui sera une source considérable de pertes d’emplois en France, au profit de l’étranger.
Il s’agit également de savoir si cette loi sera favorable à la réduction du chômage et pas seulement au climat social. Je ne crois pas que la flexisécurité présentée par M. le rapporteur ait sa place dans ce texte, ce que je regrette d’ailleurs.
Je regrette aussi la suppression inattendue des CNE, transformés brutalement, sans explication et sans préavis en CDI, alors que l’on ne pouvait que se féliciter des résultats obtenus par l’embauche de plusieurs centaines de milliers de chômeurs. C’est une profonde erreur, car, on pouvait, le cas échéant, les amender.
En effet, ce sont ces contrats, limités d’ailleurs aux entreprises de moins de vingt salariés, qui ont permis la réduction du chômage dont on se félicite aujourd’hui. Il est donc à craindre que sans ces CNE le chômage n’augmente brutalement, car ils étaient très appréciés des PME.
Si la raison principale de la suppression de ces CNE est, paraît-il, la non-information sur les raisons du licenciement, bien que cela n’ait pas été explicité dans l’article 9, il serait beaucoup plus utile de les réintroduire dans la loi sur les CNE ou de créer un autre CNE plutôt que de supprimer cette disposition fondamentale pour la réduction du chômage. C’est ce que je vous proposerai dans un amendement très attendu par les PME, lesquelles sont les principales bénéficiaires de ces CNE qui leur ont permis d’embaucher des milliers de chômeurs.
Mais puisqu’il s’agit de faire des réformes, quand fera-t-on réellement celles qui concernent notre législation du travail, en nous orientant plus résolument vers la flexibilité de l’emploi associée à la flexsécurité ? La flexibilité ne coûte rien à l’État. Elle est appliquée dans tous les pays du monde où le chômage est le plus bas. C’est la preuve que cela marche !
La rigidité de l’emploi, dont on n’arrive pas à sortir en France, loin d’assurer la pérennité des emplois assure plutôt la pérennité du chômage.
Le maintien des contrats à durée indéterminée comme base normale et générale du travail indique bien la volonté des syndicats et du Gouvernement de ne pas changer de politique et de maintenir la rigidité de l’emploi comme règle absolue, ce qui n’est certes pas la volonté des chefs d’entreprise.
Il faudrait tout de même qu’un jour chacun comprenne que le maintien des contrats à durée indéterminée comme forme normale du travail conduit les entreprises à embaucher de moins en moins en France et à délocaliser de plus en plus à l’étranger, ce qui entraîne un accroissement considérable du chômage dans notre pays. La croissance que chacun recherche risque une fois de plus de ne jamais se réaliser.
Je voudrais maintenant vous faire part de quelques réflexions pratiques relatives au fonctionnement des entreprises.
Il faudra bien qu’un jour on comprenne qu’une entreprise a besoin de souplesse dans la gestion de son personnel. Une activité commerciale ou industrielle, quelle qu’elle soit, est précaire. Elle dépend notamment du marché qui évolue, des clients qui veulent du changement, de la concurrence qui propose des produits de même qualité et moins chers, de l’évolution des technologies, de la variation des monnaies. Pour survivre, elle doit adapter en permanence son personnel à ses charges et aucun chef d’entreprise ne le fait s’il n’y est pas obligé.
D’où le dogme absolu qui est le même pour toutes les entreprises dans le monde entier : un chef d’entreprise qui ne peut pas, si besoin est, licencier son personnel comme il l’entend n’embauchera plus et sous-traitera sa production à l’étranger. Rien n’y changera quoi que ce soit, ni grève, ni loi !
C’est la raison pour laquelle la flexibilité de l’emploi est aussi nécessaire pour les entreprises que l’air pour respirer.
Toutefois, ce système ne fonctionne bien que si le salarié licencié peut retrouver rapidement du travail. C’est pourquoi il doit être accompagné dans sa recherche d’emploi, si possible avant même d’être licencié. C’est ce que l’on appelle la « flexsécurité », appliquée avec succès en particulier au Danemark, que M. le rapporteur a évoquée et dont je ne vois malheureusement aucune application dans ce projet de loi.
Par ailleurs, on oublie trop souvent qu’il ne suffit pas d’empêcher les entreprises de licencier, ni de créer des dispositifs divers comme les aides à l’emploi, les aides au retour à l’emploi et maintenant le RSA, qui aggrave notre déficit budgétaire, pour que les entreprises embauchent si elles ne le veulent pas et si le personnel disponible n’a pas les compétences requises.
On oublie toujours que la réduction du chômage nécessite l’équilibre de deux éléments, l’offre par les entreprises et la demande par les chômeurs. Si l’on privilégie chaque fois les chômeurs sans se préoccuper des entreprises, on n’arrivera à rien et on dépensera beaucoup d’argent en vain.
Je rappellerai enfin qu’une entreprise qui a du travail et un personnel motivé et compétent ne licencie jamais, même s’il n’y a pas de contrat car elle a besoin de son personnel. C’est ce qui se passe en particulier aux États-Unis, où les salariés sont embauchés sans aucune garantie de durée et où le chômage est au minimum, preuve de l’efficacité du dispositif américain, et ce sans une multiplication, comme dans notre pays, des contrats de travail.
Pour conclure, monsieur le ministre, je souhaite que les réformes continuent et, si l’on veut vraiment obtenir le plein emploi en France, que l’on s’oriente plus avant vers la flexibilité de l’emploi associée à la flexsécurité, qui ne coûte rien à l’État. En attendant, il faut appliquer cette loi en ne supprimant pas le CNE et en le modifiant comme je le proposerai par voie d’amendement.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord d’excuser mon retard et je remercie Mme Valérie Létard d’être intervenue pour présenter ce texte. Le contrat de travail et le monde du travail sont étroitement liés et cette question faisait justement aujourd'hui l’objet d’un déplacement important sur un sujet qui constitue l’une des priorités essentielles de notre pays : l’emploi des seniors, à la fois pour le rendez-vous des retraites mais aussi pour le marché du travail et de l’emploi. C’est dans ce cadre que M. le Président de la République, M. Laurent Wauquiez et moi-même avons présenté le plan seniors.
J’ai bien sûr écouté avec attention les différentes interventions et l’on m’a rapporté les propos que je n’avais pu suivre.
Monsieur le rapporteur, vous avez raison de souligner le fait que l’accord du 11 janvier 2008 constitue un progrès essentiel dû à la loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007, dite « loi Larcher », qui a permis la mise en place d’une nouvelle méthode dans l’élaboration des lois, gage de stabilité et d’efficacité.
L’histoire nous a montré que les lois les plus durables et les plus reconnues, celles qui sont entrées dans notre vie quotidienne de la meilleure façon, sont consécutives à des accords. La force de la loi du 31 janvier 2007 est d’avoir institutionnalisé cette méthode. Le présent projet de loi en est la première traduction législative mais certainement pas la dernière. Nous aurons sûrement l’occasion de nous retrouver prochainement avec un texte sur la représentativité, le financement et le temps de travail.
Comme l’a montré M. Vanlerenberghe, la flexsécurité à laquelle répondent l’accord du 11 janvier 2008 et le projet de loi qui nous est soumis se définit par une exigence d’équilibre, de l’accord et du projet de loi tout d’abord, équilibre qui a permis la signature de la majorité des partenaires sociaux. Mais c’est aussi, on le dit moins, une série d’équilibres partiels. Par exemple, les dispositions concernant la rupture conventionnelle ou la période d’essai traduisent le souci de trouver un équilibre entre les exigences de flexibilité et de sécurisation de la situation des salariés. Ce point me semble important pour notre discussion car nous devons bien être conscients que les signataires ont constamment eu cet équilibre à l’esprit et ont toujours cherché à le garantir et à le conforter.
Vous avez également évoqué le portage, sujet important qui requiert notre vigilance. Les partenaires sociaux qui ont signé l’accord du 11 janvier 2008 l’ont fait à l’échelon interprofessionnel et ils ont donc pris en compte les différentes professions concernées. Et si des garanties supplémentaires sont nécessaires, la correspondance que j’ai échangée, notamment avec le syndicat des entreprises de travail temporaire, le permettra. Nous évoquerons l’ensemble de ces garanties lors de la discussion des articles et elles nous permettront, je l’espère, de stabiliser ce secteur important, mais également de bien correspondre à la volonté des partenaires sociaux, en respectant l’équilibre de l’accord.
Madame Demontès, nous semblons opposés sur des questions de méthode. La discussion dira si nous le sommes vraiment et totalement jusqu’au bout.
Quoi qu’il en soit, la loi du 31 janvier 2007 et le présent projet de loi traduisent bien une exigence, à savoir un document d’orientation envoyé aux partenaires sociaux, puis une négociation réelle, un souci d’équilibre et finalement un projet de loi transcrivant l’accord. Voilà la réalité des choses.
Pourquoi serions-nous opposés sur une telle méthode ?
Sans vouloir polémiquer, je pense que ce texte s’inscrit plus dans la modernité des relations sociales telle que l’a voulue la loi de 2007 que dans la modernité d’une loi qui n’en portait que le nom, la loi de modernisation sociale de 2002, qui résultait quant à elle d’une volonté unilatérale du Gouvernement constatée par les partenaires sociaux.
Je ne sais pas si c’est ma vérité, cependant force m’est de constater que pour beaucoup, c’est aussi la vérité.
Je ne comprends pas vos craintes sur le CDD à objet défini : il est encadré par un accord de branche, il répond à un motif précis et ses conditions sont plus restrictives que celles du CDD de droit commun, dont les règles s’appliqueront. De plus, une expérimentation permettra à tous les acteurs de s’assurer que ce contrat correspond bien à un besoin et que les garanties sont au rendez-vous.
Monsieur Souvet, vous avez souligné la nécessité d’évoluer vers une flexsécurité dans laquelle flexibilité et sécurité se renforcent mutuellement.
Je crois profondément à cette logique, et je ne suis pas le seul, car elle garantit à la fois plus de souplesse et plus de sécurité, mais pas au profit exclusif de l’un ou de l’autre : la flexibilité et la sécurité valent tant pour les entreprises que pour les salariés. Nous devons nous situer au-delà de l’année qui vient et présenter des textes susceptibles de s’adapter à un contexte du marché de l’emploi évolutif. Le retour au plein emploi donnera davantage d’atouts aux salariés, qui gagneront en souplesse.
Mme Christiane Demontès s’exclame.
La sécurité apportée par ce projet de loi vaut aussi bien pour les salariés, qui ont besoin d’inscrire leur parcours professionnel dans la durée, que pour les entreprises, lesquelles doivent bénéficier d’un cadre juridique stable.
Cet équilibre qu’ont su trouver nombre de nos partenaires européens, il était temps que nous parvenions à le faire émerger en France sur des sujets qui faisaient l’objet d’un blocage depuis un quart de siècle. Excusez du peu !
Comme vous l’avez rappelé, les dispositions de l’accord du 11 janvier devront être complétées par d’autres négociations, notamment sur la formation professionnelle, dossier prioritaire que suivront Christine Lagarde et Laurent Wauquiez. Les uns et les autres pourront s’appuyer sur le rapport de la mission sénatoriale confiée en son temps à M. Carle. Feront également l’objet de négociations la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou GPEC, et l’assurance chômage.
Madame David, excusez-moi de vous le dire, ce texte, loin d’être une ritournelle, constitue, au contraire, une innovation dans le champ des relations sociales : innovation dans la méthode avec un retour au dialogue social, innovation dans le fond par rapport au nouvel équilibre qui a été trouvé.
Et je pense que les partenaires sociaux représentants des salariés apprécieront à sa juste mesure votre propos selon lequel ce texte serait d’inspiration patronale tant il est, au contraire, le résultat d’une négociation entre des partenaires sociaux libres et responsables.
Je tiens également à le souligner, nous sommes dans un monde en mouvement, où les relations sociales évoluent.
J’en veux pour preuve la position commune qui a été signée, dont j’ignore si elle trouve davantage grâce à vos yeux. D’autres y ont apposé leur signature. Nous verrons si votre position change. Quoi qu’il en soit, j’aurais aimé que, sur un tel sujet, nous puissions arriver une position commune. Peut-être y parviendrons-nous au fil de la discussion.
Puisque vous avez parlé de « recul dans le droit du travail », le plus important, selon vous, depuis 1945, je tiens quand même à vous dire que quatre syndicats sont signataires.
M. Guy Fischer s’exclame.
Votre propos ne m’aurait pas surpris si ce texte avait été d’inspiration, ou de source, gouvernementale. Je vous l’avoue, en effet, il m’arrive parfois de vous soupçonner de quelque a priori à l’égard du Gouvernement. Mais, en l’occurrence, il s’agit des syndicats, et je suis particulièrement surpris !
Que vous puissiez ne pas être d’accord avec ce texte, je vous le concède volontiers, mais vous ne pouvez pas utiliser ce type d’argument, qui nie le principe même de la négociation collective.
Je le redis devant la Haute Assemblée : le montant des indemnités de licenciement ne pourra en aucun cas être réduit pour un quelconque salarié. Le projet de décret transmis à la Commission nationale de la négociation collective et que j’ai fait parvenir aux présidents de l’ensemble des groupes parlementaires le montre très clairement.
C’est faux !
Monsieur Muller, vous avez parlé de « pistolet sur la tempe ». Je ne sais pas si c’est pour légitimer une position de principe du groupe, cependant vos propos visent non seulement le Gouvernement, mais aussi les partenaires sociaux. Or, je tiens à vous le dire, ils ont montré à chaque fois qu’ils savent prendre leurs responsabilités. Le dialogue social se porte mieux en France, un an après notre élection.
M. Jean-Luc Mélenchon s’exclame.
Cela devrait faire plaisir à tous, sur les travées de droite comme sur les travées de gauche.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Si nous n’y sommes pas pour rien, les partenaires sociaux y sont pour beaucoup. La réalité, c’est que ce dialogue social bien portant et si longtemps attendu est enfin au rendez-vous.
Nous pouvons nous en réjouir les uns et les autres. Et je serais même tenté de dire : si nous pouvions nous en réjouir les uns avec les autres, ce serait encore préférable.
Monsieur Dassault, la rupture conventionnelle correspond, c’est vrai, à un besoin de souplesse, avec la mise en place d’un mode de rupture sécurisé, simple, rapide, assorti de garanties.
Sur la question du CNE, je suis certain que nous reviendrons en détail. L’abrogation du CNE ne date ni du 11 janvier ni de la présentation de ce texte. Son origine se trouve dans la décision de l’Organisation internationale du travail, laquelle faisait d’ailleurs suite à deux arrêts très clairs des cours d’appel de Bordeaux et Paris. Depuis cette décision, comme je l’avais écrit aux représentants d’organisations professionnelles patronales, nous avons besoin de sécuriser les acteurs.
Je le sais, nombre de chefs d’entreprise ont joué le jeu sincèrement. Or nous les exposons à une incertitude juridique si nous n’apportons pas cette clarification, assortie de la garantie supplémentaire adoptée par l’Assemblée nationale. Mieux vaut avoir le courage de dire et d’écrire les choses ; c’est un gage de clarté.
Aujourd’hui, le CNE ne représente plus que 1, 4 % des recrutements. Nous devons apporter à ces salariés, comme à ces chefs d’entreprise, toute la lumière, toute la clarté et toutes les garanties. C’est une question de sécurisation, monsieur le sénateur. Je suis favorable à la souplesse, mais elle ne peut produire tous ses effets que dans la sécurité réclamée, voulue et attendue par les uns comme par les autres.
Voilà ce que je voulais dire en réponse aux différents orateurs qui se sont succédé dans cette discussion générale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.

Je suis saisi, par Mme David, MM. Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n°56, tendant à opposer la question préalable.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant modernisation du marché du travail (n° 302, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la motion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a un an, Nicolas Sarkozy devenait Président de la République avec un slogan : « Travailler plus pour gagner plus » et une conception de sa fonction incarnée par le mot « rupture ».
Nous nous souvenons toutes et tous l’avoir entendu vanter la « valeur travail ». Nous nous souvenons également de ses nombreuses exhortations en direction de la France qui se lève tôt pour travailler. Il devait être son Président, celui qui augmenterait son pouvoir d’achat, reconnaîtrait ses efforts, celui qui, en quelque sorte, saurait redonner au travail la place qui devrait être la sienne.
Or, en douze mois, les Français n’ont rien vu à cet égard !
Ils ont vu les prix croître – à l’image du gaz qui a augmenté de près de 10 % depuis le 1er janvier 2008. Ils ont vu les prix des produits de première nécessité flamber, et ils subissent, jour après jour, madame la secrétaire d’État, les dégâts de votre politique libérale.
Il n’est qu’à lire la presse pour constater le mécontentement généralisé de la population. Les Échos titrent : « Le bilan de Sarkozy : une rupture de méthode, des désillusions sociales ». On peut lire dans Libération un dossier très intéressant de plusieurs pages sur l’insatisfaction des Français que la une de ce journal exprime parfaitement : « Un an après, la grande désillusion ». Il n’y a que Le Figaro pour apporter une vision positive en titrant « Les Français sont d’accord avec les réformes… » Mais Le Figaro de reconnaître, immédiatement après, que les Français sont déçus par les résultats. La presse est donc unanime.

Nos concitoyens attendent encore – et risquent d’attendre longtemps – la fameuse reconnaissance du travail. Vos deux lois en faveur du pouvoir d’achat n’y ont rien changé. D’ailleurs, deux lois en six mois, n’est-ce pas la preuve que la première, la loi TEPA, travail, emploi et pouvoir d’achat, n’était pas efficace ?
Le déblocage de l’épargne salariale ou l’art de s’autoredistribuer du pouvoir d’achat ? Nenni !
La prime de 1 000 euros, versée selon le bon vouloir de l’employeur ? Cela ne marche pas !
Le rachat des RTT, véritable monétisation des droits acquis ? Cela ne va qu’à quelques-uns !
Toutes ces mesures sont insuffisantes et ne répondent pas à l’exigence réelle de nos concitoyens : l’accroissement de leur pouvoir d’achat par l’augmentation de leur salaire et de leur retraite.
Mais, sur ce sujet, madame la secrétaire d’État, votre gouvernement reste bien silencieux, et c’est là encore un motif de colère : à peine arrivé au pouvoir, Nicolas Sarkozy se rend au Fouquet’s, fait une croisière luxueuse, laissant penser que chacune et chacun de nos concitoyens pouvaient espérer la même chose, ou tout au moins l’équivalent en fonction de son train de vie. Or qu’a-t-il fait en un an ? Le pire que l’on pouvait attendre du libéralisme : donner encore plus à celles et ceux qui ont déjà beaucoup, sans rien octroyer à la grande majorité de celles et ceux qui l’ont élu !

En effet, Nicolas Sarkozy a satisfait en partie ses promesses électorales, celles qui avaient été faites au patronat. Et, dans ce domaine, votre gouvernement est prolixe.
Progressivement, projet de loi après projet de loi, vous redessinez un modèle social qui n’a rien à voir avec celui qui fonde notre République, établie sur notre pacte social tel que les législateurs de 1945 l’ont créé.
Il y a eu la recodification du code du travail : elle devait se faire à droit constant, elle s’est faite, au contraire, au détriment des salariés, qui perdent là une de leurs protections. Elle s’applique à compter du 1er mai.
Il y a eu la fermeture annoncée de 63 juridictions prud’homales, la fusion forcée des ASSEDIC et de l’ANPE, qui vient s’ajouter aux différentes lois antérieures visant à réduire les droits des travailleurs privés d’emploi.
Pas à pas, vous redessinez sans le dire un modèle global de société ne répondant plus – dans tous les domaines – qu’à une exigence, celle de rentabilité dictée par la logique libérale.
Et il y a aujourd’hui ce projet de loi, dont le Président de la République, dans sa lettre du 31 mai 2007 aux organisations patronales et syndicales, a fixé la feuille de route et au sujet duquel les pouvoirs publics ont affirmé à plusieurs reprises leur volonté de légiférer rapidement en l’absence d’accord. Il ne fait pas de doute que ce contexte a pesé sur les négociations, d’ailleurs délimitées et en partie commandées par votre gouvernement ! À n’en pas douter, ce texte est l’une de vos étapes fondamentales dans le démantèlement progressif, mais certain, de la relation de travail telle que nous la connaissons aujourd’hui.
Je m’étonne de voir combien ce projet de loi est profondément déséquilibré.
Ainsi, les citoyens noteront que les mesures favorables aux employeurs, celles qui facilitent notamment le droit et les conditions de licencier, de précariser encore plus, sont inscrites dans la loi. Or, comme convenu dans l’accord national interprofessionnel, les mesures favorables aux salariés exigent un certain nombre de décrets et de négociations futures, en particulier la portabilité des droits, l’indemnisation des demandeurs d’emploi, la formation professionnelle, ce qui n’est pas sans nous inquiéter.
Et cela fait dire à Jacques Freyssinet, professeur émérite à l’université Paris-I : « Il convient de rappeler que le mode de construction de l’accord engendre un degré élevé d’incertitude sur la nature et l’ampleur de ses effets prévisibles. ». Il y a donc, dans ce texte, une règle à deux vitesses : la certitude pour les employeurs, le doute pour les salariés.
Ce doute persiste également face à la proposition, aux apparences généreuses, de réduire à un an la durée nécessaire pour bénéficier de l’indemnisation chômage. Simultanément, le Président de la République, Mme Lagarde et M. Wauquiez relancent le débat engagé lors de l’examen du projet de loi fusionnant l’ANPE et les ASSEDIC et les négociations débutent sur ce texte dans un contexte là encore bien délimité.
Ainsi, les salariés privés d’emploi se verraient contraints d’accepter non plus « une offre valable d’emploi », mais, au choix, selon à qui l’on s’adresse, « une offre raisonnable d’emploi » ou « une offre acceptable d’emploi ». Toutefois, derrière ce vocable se dissimule une diversité de conception que votre gouvernement ne veut pas préciser aujourd’hui, jouant avec l’ambiguïté.
Une chose est sûre, cependant, la logique sera au durcissement et les salariés ont tout à y perdre.

Ne croyez-vous pas toutefois que l’éclaircissement de ces notions et la définition des conditions qui pourraient conduire, en cas de refus, à une sanction pouvant aller jusqu’à la radiation mériteraient d’être traitées simultanément et de faire partie intégrante de ce projet de loi ?
De la même manière, nombreux sont les syndicalistes et les représentants des associations de chômeurs à s’inquiéter d’une baisse annoncée de la durée et du montant des indemnisations chômage.
Face à ces interrogations, – chose curieuse – pas un mot de votre gouvernement ou du Président de la République ! Et pas un mot non plus dans ce texte de loi, qui doit pourtant traiter de la modernisation du marché du travail !
De même, il est surprenant que la question de l’aménagement et de la modulation du temps de travail ou encore celle de l’organisation du travail, pourtant centrale en matière de « flexisécurité » dite interne, soient déconnectées de ce texte.

S’agissant des 35 heures, on peut aisément concevoir que cet aspect pour le moins conflictuel ait été écarté des négociations. Concernant l’organisation du travail, nous sommes cependant là au cœur du sujet : gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, allongement de la durée d’activité des seniors, emploi des jeunes, développement de l’effort de formation en direction des salariés les moins qualifiés, dont on sait qu’il n’est efficace que s’il s’appuie sur une organisation du travail qualifiante, etc.
Il est fort regrettable que ces questions soient absentes du projet de loi, mais il est vrai, madame la secrétaire d'État, qu’il n’est que l’une des premières pierres d’un édifice de généralisation de la précarité.
Mme Parisot, présidente du MEDEF, ne s’y est d’ailleurs pas trompée, annonçant dans le journal Les Échos en date du 14 janvier 2008 : « Cet accord n’est pas révolutionnaire. Il constitue une première étape. »

La question légitime que nous devons vous poser, et que les Français se posent, est donc la suivante : nous connaissons les réformes à venir, mais pour quelle finalité les engagez-vous ?
À quoi ressemblera le « marché du travail » dont vous rêvez et, plus globalement, que sera la politique sociale de notre pays ?
Je voudrais d’ailleurs revenir sur cette notion même de « marché du travail ». Celle-ci renvoie à une réalité que peu de salariés connaissent. Le marché, économiquement parlant, est l’espace où s’échangent des biens contre une rémunération juste, correspondant à leur valeur. Tel n’est pas le cas pour le travail, dont la nature même devrait rendre impossible son assimilation à un simple bien.
Surtout, nous savons que la rémunération que perçoivent les salariés en échange de leur travail n’est pas, loin s’en faut, à la hauteur de leur tâche. Preuve en est les grandes difficultés que rencontrent des millions de nos concitoyens pour vivre dans la dignité, pour consommer ou pour épargner.
Souvenons-nous au contraire que les patrons français sont au premier rang des patrons européens les mieux payés alors que les salariés ne sont qu’à la quatorzième position !
La précarité dans le travail n’est malheureusement pas une lubie inventée par les sénatrices et sénateurs communistes ; c’est le vécu douloureux de celles et de ceux qui sont payés en dessous des besoins ou contraints à travailler à temps partiel.
Vos deux lois censées, à six mois d’écart, redonner du pouvoir d’achat aux Français n’auront en fait été que de la poudre aux yeux, car vous concentrez l’essentiel de vos efforts sur la précarisation du salariat, faisant vôtre le désormais célèbre adage de Mme Parisot, selon lequel, puisque « la vie, la santé, l’amour sont précaires, pourquoi le travail échapperait-il à cette loi ? ».
Il faut dire que votre gouvernement, en un an, aura tout fait pour satisfaire à ces exigences, à commencer par les 15 milliards d’euros de cadeaux accordés aux plus riches au mois d’août…

Ces cadeaux aux plus riches allaient contre le bon sens économique et contre l’intérêt du monde du travail, et le projet de loi que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans cette triste continuité.
Vous partez du postulat idéologique selon lequel il faudrait toujours que les règles protectrices en matière de travail soient amoindries et vous vantez la capacité du marché à s’autoréguler dès lors que l’État n’intervient plus ou intervient peu.
Ces éléments sont caractéristiques du système libéral. « Déréglementer, privatiser, libérer les échanges, faire respecter le droit de propriété et réduire drastiquement le champ d’intervention de la loi et de l’État au bénéfice du contrat », voilà comment Alain Laurent, auteur du Libéralisme américain, histoire d’un détournement, décrit la feuille de route d’une économie libérale efficace, l’efficacité se mesurant alors à l’aune de profits accumulés par quelques-uns.
Mme Christiane Hummel s’exclame.

Telle est la ligne directrice de vos gouvernements successifs, et ce projet de loi ne fait pas exception. Comment ne pas le relier au rapport Virville qui avait pour objectif de réduire considérablement l’impératif légal au profit du contrat ou, autrement dit, de sécuriser encore plus les entreprises ?
On a l’impression que votre recherche perpétuelle du modèle social le plus adapté conduit notre pays à la disparition pure et simple de tout modèle. Hier, c’étaient l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Aujourd’hui, c’est le Danemark. Pourtant, entre ce pays et le nôtre, il n’y rien de comparable, et Jacques Muller a cité quelques exemples.
Près de 30% des salariés danois changent chaque année d’employeurs, mais il s’agit là d’une mobilité voulue et non subie. La moitié des femmes travaillent à temps partiel. Est-ce cela que vous voulez reproduire en France, en contraignant les femmes à subir des parcours incomplets, à « faire » avec la précarité et la misère, à percevoir des retraites largement amputées ? Jusqu’où irez-vous dans la recherche du modèle le moins protecteur, alors que l’on a vu que l’engagement du Gouvernement et des syndicats danois est d’une tout autre nature ?
En réalité, la fameuse « flexisécurité » n’est cependant pas l’apanage de M. Sarkozy : il s’agit là d’un mouvement européen. Il s’agit même de l’un des objectifs de l’Europe libérale et technocratique que vous construisez. Nous nous souvenons tous du traité constitutionnel européen et de la fameuse concurrence « libre et non faussée », ainsi que de la directive Bolkestein.
Le concept de « flexisécurité » que vous développez est l’un des objectifs de l’Union européenne. La Commission le précisait en 2007 en ces termes : « une stratégie intégrée, visant à améliorer simultanément la flexibilité et la sécurité sur le marché du travail ».
Si nous comprenons de quoi il s’agit lorsque la Commission fait référence à la flexibilité, qu’entend-elle par la sécurité ? Cela « représente bien plus que l’assurance de garder son emploi. Il s’agit de donner aux individus les compétences qui leur permettent de progresser dans leur vie professionnelle et de les aider à trouver un nouvel emploi. »
Pour Henri Houben, docteur en économie et membre d’ATTAC Bruxelles, « la flexibilité se justifie par l’existence de la mondialisation capitaliste actuelle : pour être compétitive, l’entreprise doit pouvoir s’adapter rapidement aux changements du marché. De fait, cela heurte de plein fouet la possibilité pour les salariés de garder leur poste et affecte leur sécurité d’emploi ».
Les salariés ne savent que trop combien ils sont considérés dans les entreprises comme un coût alors que précisément ils participent, par leur force de travail, par leur expérience et par leur volonté, au développement de l’entreprise et de la France !
Les tenants de l’économie libérale les considèrent comme une variable d’ajustement sur laquelle on peut rogner sans cesse, et les salariés à qui l’on vient d’imposer un chantage odieux entre licenciement et recul social ne nous démentiront pas.
En conclusion, ce projet de loi effectue un transfert de sécurité. L’enjeu est donc pour vous non plus de protéger collectivement l’emploi, mais d’instaurer une fausse protection individuelle consistant à accompagner la perte d’emploi.
C’est sur cela que se fonde votre « flexisécurité », et l’on sait que l’employabilité est au cœur de cette conception, qui ne cherche plus à garantir ni le droit au travail, ni les conditions dans lesquelles le salarié effectue celui-ci, tout en niant le rôle des organisations syndicales.
La conférence européenne des syndicats l’a d’ailleurs bien compris, en précisant que « réduire la protection contre le licenciement creusera le fossé des inégalités et entraînera une augmentation du nombre d’exclus, tout en étant néfaste pour la performance économique en termes de productivité du marché ».
Je terminerai en me référant au rapport intitulé Les indicateurs clés du marché du travail rendu par le Bureau international du travail en 2007 : la France, grâce à ses salariés et à ses ouvriers, est placée au troisième rang de la productivité, derrière la Norvège et les États-Unis. C’est à croire que les « déclinologues », qui n’ont de cesse de nous dire que la législation française trop protectrice est un carcan faisant fuir les investisseurs et plombant la productivité, se trompent !
Je regrette sincèrement que vous n’ayez pas profité de l’examen de ce projet de loi pour dire à la représentation nationale, comme à tous les Français, quelle est votre conception du travail et des règles qui doivent lui être associées. Vous en êtes restés aux slogans – d’ailleurs contradictoires – alors que, dans les textes, vous déconstruisez pas à pas tout ce qui fonde la relation employeur-employé telle que nous la connaissons, exception faite du rapport de subordination, qui persiste et qui, du fait de l’individualisation des rapports, se renforce même.
Une seule certitude demeure et, à la veille de la présidence de l’Union européenne par la France, un spectre hante toute l’Europe : le capitalisme financiarisé dont le libéralisme économique est un outil.
En dehors de cette certitude, les Français ignorent tout de vos projets réels. C’est la raison pour laquelle je vous demande, mes chers collègues, de voter la motion tendant à opposer la question préalable, afin d’obliger le Gouvernement à préciser ce qu’il préfère taire !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Le chemin pour parvenir à un consensus sera encore long et difficile ! Ce débat démontre en effet que, dans la façon d’aborder les relations du travail, il y a toujours dans notre pays deux conceptions qui s’affrontent.
D’une part, il y a ceux qui pensent, et j’en suis, que, compte tenu de la situation internationale, nous devons aller progressivement, en dialoguant et en écoutant, vers plus de flexibilité, mais de flexibilité compensée par plus de sécurité.
D’autre part, il y a ceux qui, et je le dis avec regret, sont attachés aux méthodes anciennes, c'est-à-dire aux rapports de force inspirés de la théorie de la lutte des classes, et qui estiment pouvoir continuer aujourd'hui à suivre ces méthodes en prenant le risque de mettre demain notre pays dans une situation plus difficile encore pour avoir capitulé devant l’ultralibéralisme faute d’avoir été capable d’adapter la voie moyenne que représente la « flexisécurité » déjà élaborée par nos partenaires nordiques, que vous avez un peu brocardés mais qui sont tout de même parvenus à de bons résultats.
Mme Annie David s’exclame.

Nous sommes ici une majorité à estimer que cette voie mérite d’être explorée et qu’elle est même la seule de nature à nous permettre d’avancer vers un consensus plus large dans notre pays. Nous ne pouvons prendre le risque de vous suivre, raison pour laquelle je demande le rejet de la motion tendant à opposer la question préalable.
Monsieur Fischer, on ne peut parler de certitude pour les employeurs et de doute pour les salariés.
Nous sommes en train d’essayer de trouver les voies et moyens qui nous éviteront plus tard d’être dans une situation que nous regretterions tout en maintenant une position juste et équilibrée.
Le doublement des indemnités de licenciement, c’est certain ! L’abaissement de l’ancienneté et du délai de carence pour obtenir une meilleure indemnisation maladie, c’est certain ! Le fait que le CDI est la forme normale et générale du travail, c’est certain !
Mme Annie David fait un signe de dénégation.
De la même façon, monsieur le sénateur, vous savez très bien que ce projet de loi s’inscrit dans une globalité, qu’il doit être regardé avec du recul et qu’il faut tenir compte de l’ensemble des mesures et des décisions qui ont été prises pour accompagner précisément l’accord du 11 janvier 2008.
Le texte dont nous débattons est une chose, mais il faut aussi prendre en considération tout à la fois les décrets qui ont été transmis aux présidents de groupe, l’arrêté d’extension, toutes les négociations programmées dans le cadre de l’accord, sur la mobilité, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ou encore la convention avec l’assurance chômage, c’est-à-dire un ensemble de mesures qui feront que, véritablement, le travail de négociation sera honoré.
Tel le sens de ce texte, à savoir accompagner un vaste projet qui, en même temps qu’il permettra de la flexibilité, apportera de la sécurité.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Muguette Dini applaudit également.

Je mets aux voix la motion n° 56, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.

Je suis saisi, par Mmes Le Texier, Demontès et Schillinger, MM. Godefroy, Muller et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 39 tendant au renvoi à la commission.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des affaires sociales le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, portant modernisation du marché du travail (n° 302, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à Mme Raymonde Le Texier, auteur de la motion.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est soumis constitue la première application concrète du dialogue social instauré par la loi du 31 janvier 2007 et, à ce titre, nous devrions tous pouvoir nous en réjouir ; je note d’ailleurs qu’il y a pléthore de satisfecit, mais plus particulièrement de la part du Gouvernement et du patronat.
À l’écoute plus attentive des différentes réactions, « le chœur des célébrations » nous est apparu pour ce qu’il est, c’est-à-dire beaucoup plus contrasté qu’il n’y paraît.
Mais, avant d’entrer dans le texte, parlons du contexte.
La menace d’un passage en force, par le biais d’une loi, a constamment plané sur les négociations. Même les représentants des syndicats de salariés ayant signé l’accord ont admis l’avoir fait avec la crainte, en cas d’échec, d’une loi plus dure, qui imposerait par exemple le contrat unique, fantasme du MEDEF.
Or, je le redis ici, la menace ne doit pas être le pistolet que l’on pose sur la tempe des partenaires sociaux. En tout cas, telle n’est pas notre conception du dialogue social.

Mais tout cela, notre collègue Christiane Demontès l’a dit avec force voilà quelques instants.
Par ailleurs, c’est la prérogative du Parlement d’examiner et de modifier ou non les textes qui lui sont soumis. Ce n’est pas parce qu’un accord interprofessionnel a été trouvé, même avec un équilibre prétendument « délicat », que le Parlement ne doit pas faire son travail. La hiérarchie des normes et des légitimités demeure claire : à son sommet, il y a la loi et le suffrage universel. Le Parlement ne peut être, ne doit être, ni un moyen de pression, ni une chambre d’enregistrement.
Madame la secrétaire d’État, je voudrais revenir sur le fameux modèle danois auquel le Gouvernement aime se référer. De la flexisécurité danoise, celui-ci n’a gardé que la plus grande facilité d’embauche et de débauche pour les entreprises. Disparues les indemnités de chômage jusqu’à 90 % de l’ancien salaire, pendant deux ans, pour les revenus les plus faibles.

De la politique de l’emploi, le Gouvernement n’a gardé que l’encadrement strict des allocations chômage. Disparus les importants moyens financiers et humains au service de la formation et de la reconversion des chômeurs pourtant au cœur du dispositif danois !

Oubliés aussi les propos tenus voilà quelques semaines à M. Xavier Bertrand par son homologue danois M. Frederiksen : « La seule chose que nous pouvons faire, c’est donc garantir les revenus. Si nous avions eu ce débat il y a quinze ans, j’aurais eu un discours différent car j’étais alors plus libéral que social. J’aurais dit que l’on ne doit pas avoir d’allocations chômage trop élevées. Maintenant je pense que si l’on protège les revenus, on donne confiance et ce point est essentiel. ».
Peut-être le Gouvernement actuel regrettera-t-il à son tour, dans quinze ans, d’être passé à côté de l’essentiel ? Entre- temps, ce sont les Français qui auront payé cet aveuglement idéologique !
Ces éléments lourds de sens étant rappelés, venons-en aux raisons précises qui rendent nécessaire à nos yeux le renvoi à la commission, à travers l’examen des trois mesures phares de la loi : le contrat d’objectif, la rupture conventionnelle et les périodes d’essai.
Avant tout, ce projet de loi présente une incohérence constitutive en ce qu’il tente d’associer des contraires.
En effet, comment concilier les articles 1er et 6 ? Comment concilier la réaffirmation de la prédominance du CDI comme « la forme normale et générale du travail » avec la création d’un nouveau CDD, le contrat de mission ? Le Gouvernement prône la stabilité alors que, dans le même temps, il met en place des outils qui la sapent.
Le contrat d’objectif répondra certainement à la flexibilité d’embauche et de débauche réclamée par certains secteurs économiques. Mais, ajoutant de la précarité à la précarité, en quoi va-t-il améliorer la situation de nombre de ses bénéficiaires ?
En outre, si pour l’instant il ne concerne que 10 % des actifs – cadres qualifiés et ingénieurs –, et si l’on tente de nous rassurer en mettant en avant son caractère expérimental, il y a tout lieu de penser qu’il sera rapidement étendu à d’autres catégories professionnelles. Dans son édition du 10 avril dernier, le journal Les Échos rapportait que, lors de sa dernière assemblée, l’Association nationale des directeurs de ressources humaines proposait l’extension de ce contrat d’objectif à l’ensemble des salariés, alors même que le texte n’est pas encore voté !
Du fait de ces lacunes et imprécisions, l’article 6 mettant en place ce nouveau contrat précaire – le trente-septième ou trente-huitième, je ne sais plus – pose plusieurs problèmes qui doivent être résolus avant le vote.
Premier point : la question de la date anniversaire à partir de laquelle il est possible de rompre le contrat. Si le salarié peut être licencié dès le douzième mois, cela ne lui ouvrira bien sûr des droits aux indemnités de chômage que sur douze mois. En revanche, si la rupture du contrat ne peut intervenir avant le dix-huitième mois, cela ouvrira des droits sur vingt-trois mois. Il ne s’agit donc pas là d’un détail technique qu’il importe peu de préciser : entre douze et vingt-trois mois de droits au chômage, la différence est énorme !
En outre, si la date anniversaire est au douzième mois, doit-on comprendre qu’il y aura au vingt-quatrième mois une nouvelle opportunité de licenciement ? Au regard de ce que nous prépare le Gouvernement avec la nouvelle convention chômage, ces interrogations, madame la secrétaire d’État, doivent déjà vous paraître de luxueuses considérations.
Deuxième point : la possibilité de rupture à la date anniversaire, quelle qu’elle soit, offre pour la première fois à l’employeur l’opportunité de mettre fin à un CDD dans des conditions moins restrictives, c’est-à-dire en dehors de la faute grave ou du cas de force majeure, ce qui constitue une dose supplémentaire de précarité dans des contrats déjà précaires par définition.
Troisième point : dans la mesure où ces éléments fourniront à la jurisprudence des principes d’appréciation, il semble important de clarifier ce que peuvent être « l’événement ou le résultat d’objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ». Cette formulation générique risque de prêter le flanc à de trop grandes interprétations.
Quatrième point : ce contrat participe à la tendance générale du recul de la primauté de la loi en matière de droit du travail, au profit des mesures contractuelles et du droit civil ; j’aurai l’occasion d’y revenir.
En effet, contrairement aux autres CDD, c’est un accord de branche ou d’entreprise qui fixera ce que le Gouvernement appelle pudiquement « les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ». En termes profanes, ce n’est donc plus la loi qui fixera les cas de recours !
Cinquième et dernier point : pour restreindre le champ d’application de ce CDD, pour qu’il ne soit pas un moyen d’embaucher et de débaucher à volonté, l’accord national interprofessionnel, l’ANI, précise que ce contrat ne peut pas être utilisé pour faire face à un accroissement temporaire d’activité. Pourquoi cette disposition de l’ANI n’est-elle pas reprise dans le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui ? Peut-être parce qu’il s’agit bien dans l’esprit du Gouvernement d’un contrat précaire supplémentaire et de rien de plus.
Les cinq points que je viens de mentionner mériteraient à eux seuls d’être précisés dans le cadre d’un renvoi à la commission.
Mais, au-delà, il serait intéressant que la commission considère la dimension humaine de ce projet de loi. N’est-ce pas aussi notre rôle de parlementaires ? À peine le CNE abrogé, le Gouvernement créé un nouveau CDD, qui, comme tous les contrats précaires, interdit aux salariés l’accès au crédit immobilier et donc à la propriété de leur logement, aucune banque ne voulant prêter aux travailleurs en CDD.
Quant aux locations, le problème est identique. En effet, quel propriétaire acceptera de louer son bien à une personne dont les revenus sont programmés pour s’arrêter ?
Enfin, fussent-ils cadres ou ingénieurs, a-t-on bien mesuré tout l’impact que ces dispositions vont avoir dans la vie personnelle de ces salariés soumis sans arrêt à des fins de contrats, et ne sachant jamais de quoi demain sera fait ?
Si l’on voit bien l’intérêt de l’employeur à embaucher sur contrat d’objectif, quel est l’intérêt du salarié ? Il est vrai que le fait de rester à la recherche d’un emploi pendant des mois, même à la sortie d’une école d’ingénieur, rend moins regardant sur la qualité du contrat que l’on finit par se voir proposer !
Passons maintenant à une autre disposition phare de ce projet, je veux parler de la rupture conventionnelle, que certains nomment « séparation à l’amiable ».
Dans un premier temps, il m’avait semblé que cette expression empruntée au registre des relations de couple était déplacée et inappropriée. Or, à bien y regarder, elle est au contraire éclairante.
Ainsi, dans un couple qui se sépare « d’un commun accord », nous savons bien qu’il y a toujours l’un des deux qui « est plus d’accord que l’autre » ! Dans le cas qui nous intéresse, l’employeur sera assurément celui qui sera « plus d’accord que l’autre », puisqu’il conservera, pour ainsi dire, « l’appartement, les meubles, et la voiture », le salarié, quant à lui, ne gardant que ses cliques, ses claques, plus une indemnité de chômage grâce à un amendement proposé par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale rétablissant ce qui avait été négocié dans l’ANI, et oublié dans la loi !
Instituer la rupture conventionnelle en l’état, c’est témoigner d’une incompréhension fondamentale sur la nature de la relation de travail en ignorant, délibérément, la persistance du rapport de subordination entre le salarié et l’employeur.

En outre, la rupture conventionnelle pourrait relever du droit international du licenciement. La convention 158 de l’OIT énonce : « le terme de licenciement signifie la cessation de relation de travail à l’initiative de l’employeur ». Or, en toute logique, comme l’a expliqué Emmanuel Dockès, dans le numéro de mars 2008 de la revue Droit social, la rupture conventionnelle sur l’initiative de l’employeur s’apparentera sans équivoque à un licenciement.
Dès lors, doit-on s’attendre à ce que ce texte soit, comme le CNE, condamné par l’OIT ? Cela est tout à fait envisageable, même si nous avons bien noté que celui qui est à l’origine de la rupture n’a pas à apparaître en tant que tel dans l’accord.
Confrontée à la réalité, la « séparation à l’amiable » se révélera profondément inégalitaire. En effet, comment un employé souhaitant initier une rupture conventionnelle pourra-t-il convaincre l’entreprise de l’accepter, alors même que cela engendrera pour celle-ci un coût financier, à savoir l’indemnité de rupture ?
À l’inverse, une entreprise voulant se séparer d’un ou plusieurs employés, tout en se libérant de ses obligations de reclassement ou d’information-consultation, et surtout sans avoir à fournir de motif « réel et sérieux », aura tout loisir de faire comprendre au salarié où est son intérêt.
L’absence de motif pour justifier cette rupture de la relation de travail – licenciement qui ne dit pas son nom – constitue une dérive préoccupante. Cela revient ni plus ni moins à offrir aux entreprises la capacité de contourner la loi sur le licenciement, une nouvelle fois par le biais d’une disposition d’ordre contractuel.
Nous sortons ainsi peu à peu le droit du travail du champ de la loi pour le livrer aux aléas et déséquilibres du droit civil.
Si, depuis des générations, nous avons institué et développé un code du travail volontairement dissocié du droit civil, ce n’est pas pour rien. De ce point de vue, les « garanties » prévues par ce texte ne suffisent pas pour rééquilibrer le rapport de force qui fausse le principe même de cette rupture. Ainsi, le délai excessivement restreint de quinze jours pour le traitement du dossier et l’absence d’un représentant de la direction départementale du travail, la DDT, lors de la signature de la convention de rupture rendent uniquement formelle et tout à fait insuffisante l’homologation de la DDT, et vous le savez parfaitement, madame la secrétaire d’État !
On a bien compris que, pour les entreprises, l’intérêt essentiel de cette rupture conventionnelle était de limiter la judiciarisation des ruptures de contrats. Toutefois, s’agissant de l’intérêt des salariés, ceux-ci seront une fois de plus les dindons de la farce !
Mes chers collègues, j’en viens à l’article 2 du projet de loi et à la question des périodes d’essai.
Au regard de l’allongement substantiel, à travers ce texte, des durées de périodes d’essai, qui pourront atteindre, renouvellement compris, quatre, six ou huit mois, on est obligé de s’interroger sur ce qui peut justifier des périodes d’essai aussi longues.
À cet égard, on ne peut s’empêcher de noter la concomitance entre la disparition du CNE, condamné par l’OIT, notamment en raison de sa période d’essai de deux ans, et la volonté d’instaurer ces nouvelles périodes d’essai. S’agit-il d’une compensation, d’une solution de secours pour permettre aux employeurs de disposer encore d’une longue période pendant laquelle il leur est possible de licencier un salarié sans avoir à motiver ce licenciement ? Cela y ressemble.
Car enfin, tous ceux parmi nous qui ont travaillé dans le milieu de l’entreprise le savent bien, un bon recruteur voit en quelques jours, en quelques semaines dans certains cas, si sa nouvelle recrue est à la hauteur. Par conséquent, si ces longues périodes de précarité tolérée se révèlent disproportionnées par rapport à leur objectif d’évaluation du salarié, elles n’ont pas lieu d’être.
Je rappelle que, jusqu’à présent, les périodes d’essai dépendaient uniquement des conventions collectives de branche. Pourquoi ce passage en force ?
De même, il est prévu que les accords de branche antérieurs instituant des périodes d’essai plus courtes que celles qui sont définies à l’article 2 devront se conformer à la loi d’ici au 30 juin 2009, tandis que les accords prévoyant des périodes d’essai plus longues pourront rester en l’état ad vitam æternam.
Il s'agit véritablement d’un flagrant délit de manipulation. Quand on est dans une période d’essai de huit mois, c’est d’autre chose qu’il s’agit.
Je terminerai en pointant une seconde fois l’incohérence constitutive qui grève ce texte.
L’article 4 relatif à l’encadrement des licenciements consacre que tout licenciement, pour motif personnel ou économique, doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et que celle-ci est portée à la connaissance du salarié, alignant ainsi le droit national sur les impératifs de la convention 158 de l’OIT.
Il s’agit là de réaffirmer que le licenciement ne se fait pas à la légère. Pourtant, les principales dispositions de ce texte disent le contraire et facilitent les licenciements.
Les CDD à objet défini offrent pour la première fois à l’employeur, à la date anniversaire, la possibilité de licencier le salarié même s’il n’y a pas faute grave ou cas de force majeure. Les licenciements déguisés de la rupture conventionnelle se feront sans motif. Les périodes d’essai, pouvant aller jusqu’à huit mois, changent de nature et se transforment en ersatz des CNE défunts.
On constate clairement que l’axe directeur de ce projet de loi est, au mieux, le contournement, au pire, la déconstruction des barrières législatives encadrant le licenciement.
Cette majorité, dans une négociation du pire, a concocté un texte démantelant le cadre législatif du licenciement. Les salariés se trouvent pris en otage en raison de votre incapacité manifeste à sortir d’une pensée unique : la sacro-sainte flexibilité comme panacée au problème de l’emploi.
On comprend bien que les partenaires sociaux aient considéré cette négociation comme une occasion de mieux contrôler les abus et les dysfonctionnements dont ils sont témoins. On comprend aussi qu’ils aient surtout été sensibles à vos pressions. Ils vous connaissent bien, ils savent que vous pouvez faire pire. §

Madame la secrétaire d'État, ce texte est plus flexible pour le patronat que sécurisant pour les salariés, et son équilibre annoncé est un leurre. La démocratie sociale, dont vous semblez vous réjouir, doit être une avancée, pas un marché de dupes !
Afin de clarifier les principales zones d’ombre que nous avons mises en évidence, nous demandons le renvoi de ce texte à la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Ma chère collègue, vous nous avez offert un bel éloge de la rigidité du marché du travail, que nous entendons justement fluidifier !

Je ne peux suivre votre raisonnement.
Tout d'abord, nous avons beaucoup travaillé en commission. Nous avons reçu tous les syndicats signataires de l’accord, et je me demande ce qu’ils penseraient s’ils lisaient le compte rendu des propos que vous venez de tenir. Ils se demanderaient à quoi ils servent, si leur signature aboutit aux résultats que vous venez de décrire !
Mme Raymonde Le Texier s’exclame.

Ensuite, je rappelle que nous avons reçu aussi les syndicats qui n’ont pas signé l’accord. Nous avons écouté attentivement les arguments des représentants de la CGT. Je leur ai demandé d'ailleurs s’ils auraient signé s’ils avaient obtenu satisfaction, et ils étaient très embarrassés pour me répondre.
Sourires sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Il me semble que, même dans ce cas, ils n’auraient pas signé cet accord !

Outre les organisations patronales et syndicales, j’ai reçu personnellement les représentants du portage salarial, de l’intérim et des avocats. Et bien entendu, nous avons tous écouté attentivement le ministre M. Xavier Bertrand.
Madame Le Texier, vous avez évoqué les éminents professeurs de faculté que nous n’aurions pas reçus. Toutefois, nous avons tous pu consulter les revues où ils s’étaient exprimés, et leurs appréciations sont très diverses. Vous avez cité un professeur de Lyon très hostile au projet de loi, mais d’autres universitaires lui sont très favorables.
Je ne vois donc pas ce que pourrait apporter la prolongation de notre discussion en commission, qui, au demeurant, nous empêcherait de débattre ici même de ce texte, en répondant, article après article, à tous les arguments que vous avez présentés.
Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cette motion.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Muguette Dini applaudit également.
La motion n'est pas adoptée.

Mes chers collègues, je vous indique que la commission des affaires sociales va se réunir immédiatement afin d’examiner les amendements au présent projet de loi.
Sourires.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures quarante.