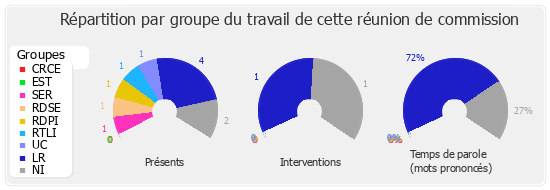Commission de la culture, de l'éducation et de la communication
Réunion du 18 juillet 2012 : 2ème réunion
Sommaire
- Audition d'une délégation du conseil permanent des écrivains cpe : mmes marie sellier co-présidente du cpe agnès defaux responsable juridique de la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe saif mm. jean-claude bologne président de la société des gens de lettres sgdl et emmanuel de rengervé juriste du syndicat national des auteurs et des compositeurs snac (voir le dossier)
- Audition de représentants du collectif « le droit du serf » (voir le dossier)
La réunion
Audition d'une délégation du conseil permanent des écrivains cpe : mmes marie sellier co-présidente du cpe agnès defaux responsable juridique de la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe saif Mm. Jean-Claude Bologne président de la société des gens de lettres sgdl et emmanuel de rengervé juriste du syndicat national des auteurs et des compositeurs snac
Audition d'une délégation du conseil permanent des écrivains cpe : mmes marie sellier co-présidente du cpe agnès defaux responsable juridique de la société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe saif Mm. Jean-Claude Bologne président de la société des gens de lettres sgdl et emmanuel de rengervé juriste du syndicat national des auteurs et des compositeurs snac
Au cours d'une deuxième séance tenue dans l'après-midi, la commission entend une délégation du Conseil permanent des écrivains (CPE).

Après avoir reçu ce matin libraires et éditeurs, nous entendons cet après-midi les créateurs, soit une délégation du Conseil permanent des écrivains (CPE), qui regroupe dix-sept associations comme la Société des auteurs des arts visuels et de l'image fixe (SAIF), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC). Nous aimerions connaître votre point de vue sur l'avenir du livre papier, la numérisation, le désaccord apparu au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) entre auteurs et éditeurs, et tout autre sujet sur lequel que vous estimeriez devoir attirer notre attention.
Nous négocions depuis quatre ans avec le Syndicat national de l'édition (SNE) au sujet du contrat numérique. Nos exigences étaient d'abord au nombre de six : un contrat séparé pour l'exploitation numérique des oeuvres, une durée limitée de cession des droits numériques, la reddition trimestrielle des comptes, l'engagement d'une réflexion sur l'exploitation « permanente et suivie » des livres - puisqu'un livre numérique n'est jamais épuisé -, un bon à diffuser numérique, une rémunération juste et équitable des auteurs, dont l'assiette pourrait être élargie à d'autres sources que la vente directe, comme la publicité. Après un premier constat d'échec en mars 2011, les négociations ont repris en septembre sur la modification du code de la propriété intellectuelle et la rédaction d'un code des usages numériques, sous l'égide du ministère. Les auteurs ont fait beaucoup de concessions : ils ont renoncé au contrat séparé, à la durée limitée, à la reddition trimestrielle des comptes, ils ont renoncé également à aborder les questions des rémunérations et des nouveaux modèles économiques, pour se concentrer sur le livre homothétique.
En mars, les négociateurs ont annoncé avoir trouvé les bases d'un accord. Il s'agissait, comme disait M. Sirinelli, d'une fusée à deux étages : dans le contrat d'édition, les clauses relatives au numérique auraient formé une partie identifiable et séparable, et ces dispositions auraient fait l'objet d'une clause de réexamen. Cela laissait aux auteurs la possibilité de récupérer leurs droits automatiquement si le livre n'était plus publié. Une définition de l'exploitation « permanente et suivie » était donnée.
Mais en juin 2012, des divergences sont apparues sur deux sujets très importants. Premièrement, lorsqu'une oeuvre est épuisée sous format papier, les éditeurs entendent conserver les droits numériques, même s'ils perdent les droits papier. A nos yeux, c'est inadmissible : que ferait un auteur de droits papier non monnayables ? Le second problème concerne la rémunération des auteurs : pour nous, il n'est pas question de signer un chèque en blanc, en prenant en compte dans les contrats des modèles économiques inexistants au moment de la signature.
Le CPE souhaite reprendre les pourparlers dans un autre cadre et réitère ses demandes initiales d'un contrat séparé et d'une durée limitée de cession des droits. Nous avons fait part de nos demandes hier aux représentants du ministère de la culture, qui souhaitent que l'on parvienne à un accord coûte que coûte.
C'est au moment de la rédaction de l'accord que nous avons buté sur ces divergences. Les éditeurs présentent leurs arguments de manière claire et convaincante, mais nous ne saurions accepter leur logique. Nous avions demandé une autonomie de gestion et d'exploitation pour les oeuvres numériques et imprimées. Normalement, il eût fallu deux contrats séparés. Mais les éditeurs, arguant qu'il s'agit de la même oeuvre sous deux formats, voulaient un contrat unique, comportant une partie sur le numérique et les autres cessions possibles - adaptations, etc. Il était donc logique que, lorsque le contrat cesserait, toutes les cessions cessassent également. Mais les éditeurs veulent conserver les droits numériques. C'est inacceptable. Que deviendront les droits de traduction, liés normalement au contrat papier ? Rendre une veste sans un bouton, d'accord, mais pas le bouton sans la veste !
Ce problème est lié à celui de la rémunération. Nous avions demandé que le contrat, qui cède les droits jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur, ne porte que sur les modèles d'exploitation existants. Les éditeurs refusent. Prenons l'exemple de la vente par abonnement, qui n'existe pas jusqu'à présent, mais est prévue par les contrats d'édition numérique. En cas d'abonnement, les auteurs perçoivent 10 % du montant, divisé par le nombre de livres compris dans l'abonnement : c'est peu, d'autant qu'un abonnement pourrait bientôt coûter 2 euros au lieu de 14... Nous exigeons donc que le contrat soit à durée limitée et renégocié lorsque le modèle devient effectif.
Pour ma part, je suis juriste et non auteur. Aujourd'hui, les droits d'auteur courent jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Or les éditeurs exigent que les auteurs leur cèdent leurs droits pour la même durée, dans les contrats d'édition papier comme numérique. C'est très long. Si nous demandons une durée limitée, c'est pour que les auteurs puissent reprendre leurs droits. Même dans l'univers papier, ce serait souhaitable, car un auteur qui veut récupérer ses droits lorsque son oeuvre n'est plus exploitée doit entreprendre des démarches très lourdes : mise en demeure, lettre recommandée, voire saisine du juge. C'est encore plus important dans l'univers numérique, où les modes de rémunération et d'exploitation changent à toute vitesse. En général, les éditeurs proposent aux auteurs le même taux de rémunération pour le numérique que pour le papier, même si les choses s'améliorent. Or le rapport Mazars montre qu'avec ce nouveau format, la marge des éditeurs s'élève à 38 % au lieu de 15 % ! La rémunération des auteurs doit progresser de même.
On agite le spectre d'Amazon. Mais si un auteur récupère ses droits, ce n'est ni pour les mettre dans un tiroir, ni pour les confier à Amazon, mais, neuf fois sur dix, pour les attribuer à un nouvel éditeur. Il est donc aussi dans l'intérêt des éditeurs que les auteurs puissent reprendre leurs droits. Le rachat de droits par un éditeur coûte très cher. Il ne faut pas figer le marché de l'édition.
S'agissant de l'exploitation « permanente et suivie », l'article 3 de la loi du 1er mars 2012 relative à l'exploitation numérique des oeuvres indisponibles du XXe siècle prévoit, dans les six mois de sa promulgation, une concertation entre auteurs, éditeurs, libraires et imprimeurs sur la fabrication à la demande. Nous avons beau réclamer, nous ne voyons rien venir... L'épuisement d'un livre est la seule façon pour un auteur de récupérer ses droits sans se tourner vers les tribunaux ; si ce moyen lui est ôté, il sera à la merci de l'éditeur, et les tribunaux seront engorgés. Si la fabrication à la demande peut éviter l'épuisement d'un livre, tant mieux pour tout le monde et pour l'environnement. Mais elle ne saurait se substituer à l'exploitation « permanente et suivie » - ou alors l'auteur doit être libre de reprendre ses droits, ce qui serait le cas s'ils étaient cédés pour une durée limitée. On ôte peu à peu toutes les soupapes de sûreté, et la chaudière va exploser !
Naturellement, les contrats à durée limitée seraient à tacite reconduction : il ne s'agit pas de rendre la vie impossible aux éditeurs.
Nous nous agaçons d'entendre dire que « les éditeurs investissent pour les livres ». Un auteur passe un an de sa vie à écrire un livre ! S'il n'est pas vendu, c'est un an de perdu ! Jamais un auteur n'a retiré ses droits à un éditeur lorsque les ventes étaient bonnes. Mais il y a des livres épuisés, qui ne sont plus commercialisés !

Quels autres commentaires pouvez-vous faire sur la loi du 1er mars 2012 ?
La Société des gens de lettres que je préside a négocié les principes de cette loi avec le ministère, le SNE, la Bibliothèque nationale de France (BnF) et le commissariat général à l'investissement. Il n'y a pas de position commune au sein du CPE, mais aux yeux de la SGDL il s'agit d'une bonne loi. On réfléchit actuellement en Europe à une exception applicable aux oeuvres orphelines et à une directive relative aux oeuvres indisponibles. A notre connaissance, les législations actuelles seraient respectées. Si l'adoption de cette loi permettait d'échapper à une exception sur les oeuvres orphelines, qui serait très dommageable aux auteurs, il faudrait pour cette seule raison s'en féliciter. En ce qui concerne l'accès au grand nombre de livres indisponibles, nous demandons que les droits d'auteur soient respectés. Nous avions obtenu comme garantie une note établissant la constitutionnalité de la loi. Pour dissiper les fantasmes, il serait souhaitable qu'elle fût rendue publique, comme tous les documents préparatoires, y compris le préaccord entre le ministère, la SGDL, la BNF et le commissariat général.
Les auteurs souhaitent qu'on leur garantisse la possibilité de refuser d'entrer dans le dispositif pendant six mois. Afin que tous les auteurs et leurs ayants droit, y compris ceux qui s'y ignorent, puissent donner leur avis, ce qui dépend de la communication. Il est indispensable de lancer un grand plan de communication dans la presse et l'audiovisuel.
Nous avons aussi demandé que soit établie une liste unique de 500 000 oeuvres, afin de pouvoir repérer les livres qui nous concernent. Pour des raisons compréhensibles, on nous a répondu qu'il y aurait dix listes de 50 000 oeuvres. Mais il est difficile pour un auteur de vérifier l'état des listes tous les ans, le 1er mars. Des procédures plus simples sont possibles. L'association « Le Droit du Serf » a proposé qu'un auteur puisse s'opposer par principe à l'utilisation de l'ensemble de ses livres. D'après le ministère, il est impossible de prendre une telle disposition par décret, mais la commission chargée de définir les priorités pourrait prendre acte de l'opposition des auteurs. Or cette règle n'est écrite nulle part. Je ne sais si le Sénat peut influer sur le ministère...
Nous demandons aussi qu'un auteur puisse se retirer s'il le souhaite, et par exemple s'il juge l'exploitation de ses oeuvres attentatoire à sa dignité, à son honneur ou à sa réputation, sans avoir à se justifier. Nous l'avions obtenu, mais lors des discussions sur le décret, le ministère a semblé vouloir revenir sur cet engagement. Un auteur peut pourtant s'estimer déshonoré par une faute d'orthographe !
Pour un auteur, l'édition qui fait foi est la dernière qu'il a revue, même s'il s'agit d'un livre de poche. Or c'est souvent un autre éditeur qui publie une oeuvre en poche. La loi comporte à cet égard une légère contradiction. La priorité donnée à l'éditeur d'origine signifie-t-elle que l'on numérisera l'édition originale, éventuellement fautive ?
Cela mis à part, je répète que cette loi est une bonne loi aux yeux de la SGDL. Elle reconnaît aux auteurs le droit de se retirer du dispositif sans avoir à se justifier, et le droit de ne pas y entrer pendant six mois. Elle assure aussi la rémunération des auteurs ayant récupéré leurs droits.
Les auteurs d'images fixes portent sur cette loi un jugement plus mitigé. Les auteurs du texte et des images d'une bande dessinée sont considérés comme co-auteurs, et ont donc tous deux le droit de solliciter le retrait de l'oeuvre. Mais s'il y a plusieurs auteurs d'images dites « isolées », ce droit leur est dénié. Certes, l'exploitation de l'oeuvre est rémunérée, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une exception au principe du droit d'auteur.
La SAIF soutenait plutôt la proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines défendue par Mme la présidente Blandin et par Mme Cartron, qui inscrivait dans le code de la propriété intellectuelle une définition de ces oeuvres. Nous étions plutôt favorables à un système de gestion collective, comprenant l'autorisation préalable d'une société de gestion collective pour l'ensemble des oeuvres et des acteurs, et pour tous les modes d'exploitation. Bien sûr, nous souhaitions que l'exploitation des oeuvres fût rémunérée. J'entends les arguments de Jean-Claude Bologne, et je sais qu'est suspendue sur notre tête l'épée de Damoclès d'une directive européenne instituant une exception pour les oeuvres orphelines. Mais à nos yeux, il est hors de question que l'exploitation soit gratuite, même si elle est à but non lucratif. Les sociétés de gestion collective savent adapter leurs barèmes aux types d'exploitation : musées, associations, sociétés commerciales...

Au sujet de la proposition de loi relative aux oeuvres visuelles orphelines, dont le rapporteur était M. Humbert, la navette parlementaire se poursuit. Le texte - réduit à la seule définition de l'oeuvre orpheline - a été adopté par le Sénat à l'unanimité, mais il doit encore être examiné par l'Assemblée nationale, où il est en instance. Nous pourrons donc proposer les ajustements nécessaires, au vu des textes adoptés d'ici là.
Quant à M. Legendre, notre rapporteur budgétaire sur le livre, il demeure très attentif aux décrets d'application des lois.

Merci, madame la présidente, d'avoir rappelé les initiatives du Sénat sur le livre.
En mars, nous avions cru comprendre que les négociations entre auteurs et éditeurs étaient près d'aboutir, mais à vous entendre, il semble que des débats de fond aient ressurgi, plutôt que de simples problèmes de rédaction. Qu'en est-il ? Les éditeurs, que nous avons reçus ce matin, semblent camper sur leur position.
S'agissant des oeuvres orphelines, je comprends qu'un écrivain puisse estimer que son honneur est en jeu lorsqu'une de ses oeuvres est exploitée. Mais faut-il accorder la même faculté aux ayants droit ? La soeur de Rimbaud et Paterne Berrichon ont fait longtemps obstacle pour de tels motifs à l'édition des oeuvres du poète... Il faut trouver un juste équilibre, et les ayants droit devraient sans doute être soumis à l'obligation de justifier leur demande de retrait.
Quant aux problèmes touchant les décrets qui doivent paraître, même s'ils concernent avant tout le ministère, les rapporteurs parlementaires ont un droit de regard pour voir si l'on s'éloigne de l'esprit de la loi.

Mme la présidente a eu la gentillesse de rappeler que j'avais été rapporteur de la proposition de loi sur les oeuvres visuelles orphelines, mais sa modestie l'a empêchée de dire qu'elle en était elle-même l'auteure.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, le problème de la réversibilité ou de la réciprocité n'était pas apparu au moment où l'on a annoncé que les bases d'un accord avaient été trouvées. Je vous accorde qu'il ne s'agit pas d'un simple problème de rédaction. Les auteurs ne peuvent se contenter de reprendre les seuls droits papier. La solution passe par le contrat séparé et la durée limitée. On pourrait envisager des clauses numériques séparées dans un contrat unique, mais que deviendraient les autres droits comme ceux de traduction ?
Nous sommes prêts à signer dès demain un accord conforme à celui qui a été annoncé le 26 janvier ou en mars. Ce sont les éditeurs qui se sont ravisés.
Le 11 juin a été annoncé un accord-cadre entre Google et les éditeurs qui souhaitent s'y associer. Les éditeurs qui publient des livres papier disposeront ainsi de tous les fichiers nécessaires pour la fabrication à la demande. Autrement dit, les auteurs ne récupéreront jamais leurs droits... Les éditeurs pourraient publier leurs livres sur le site de Google. Or, pour qu'il y ait exploitation permanente et suivie, il suffit que l'éditeur publie l'ouvrage sur un seul site autre que le sien. Cet accord-cadre ne change pas grand-chose au fond du problème, mais il a passablement agacé les auteurs.
La loi sur le prix unique du livre numérique a prévu le dépôt d'un rapport annuel sur le principe d'une rémunération juste et équitable des auteurs. Or cette loi date de mars 2011, et aucun rapport n'a encore été publié... Ce serait pourtant un bon moyen de relancer les négociations.

Soyez assurés que nous veillerons à la bonne application des textes votés. Cette commission y consacre chaque année une réunion, et il existe depuis peu une commission sénatoriale pour le contrôle de l'application des lois.
Puis la commission entend les représentants du collectif « Le Droit du Serf ».

Nous recevons à présent les représentants du collectif « Le Droit du Serf », formé par des auteurs que la loi sur les oeuvres indisponibles du XXe siècle a fâchés, parce qu'ils ne se fient pas aux éditeurs et s'estiment potentiellement spoliés. Vous avez donc créé un site d'édition coopérative pour mettre en ligne des oeuvres et alerter les écrivains. Toute critique est bonne à entendre, et vous avez une expertise d'usage. C'est pourquoi j'aimerais que vous nous exposiez vos griefs.
Pour ma part, je suis juriste plutôt qu'écrivain, maître de conférences au Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle de l'université de Strasbourg. Je me suis naturellement intéressé à la loi sur la numérisation des oeuvres indisponibles du XXe siècle, à propos de laquelle j'ai publié dans le recueil Dalloz un article très critique, car elle me semble contraire tant aux principes généraux du droit qu'à la Constitution, aux directives européennes et à la convention de Berne. Cette loi est très complexe, sans doute trop. Toujours est-il qu'aux yeux d'un juriste français, le droit d'auteur est un droit de l'auteur, ce que ce texte remet en cause.
A l'occasion de la loi dite DADVSI (droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information) transposant la directive européenne 2001/29/CE, le Conseil constitutionnel en 2006 a reconnu que le droit d'auteur était un droit de propriété au sens de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Le texte qui nous occupe contient deux aspects problématiques. C'est tout d'abord le cas de la gestion collective à parité entre éditeurs et auteurs, car les clauses de cession numérique n'étant apparues qu'au début des années 1990, les auteurs sont donc propriétaires de l'essentiel des droits du XXe siècle, ce qui remet en cause l'argument de l'incertitude quant à la titularité des droits, retenu comme fondement de cette gestion paritaire. D'ailleurs, le fait que les éditeurs tentent de faire signer aux auteurs des avenants numériques prouve qu'ils ne possèdent pas ces droits. Cela s'apparente au final à une expropriation.
Ensuite le mécanisme d'opt-out pose problème puisqu'il implique que, pour exercer son droit de propriété, l'auteur doive accomplir un acte positif. Or, lorsque l'on est propriétaire, il n'y a pas lieu de le prouver par une formalité. La charge de la preuve devrait donc être inversée. L'article 5.2 de la convention de Berne, qui pose des règles universelles en la matière, interdit les formalités destinées à obtenir la protection du droit d'auteur puisque ce dernier naît automatiquement de la seule création.
Aussi, j'incite les auteurs qui m'interrogent à faire valoir leurs droits, éventuellement par une question prioritaire de constitutionnalité. Mon collègue juriste vous en dira plus.

Compte tenu de l'expertise d'usage que vous avez sur cette loi, nous sommes intéressés de savoir comment vous envisagez d'agir.
Pour éviter que ce mécanisme n'entre en application, nous pourrions, dès la parution du décret, annoncée pour le mois septembre, former contre lui un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Ce texte devrait notamment préciser le contenu du mécanisme d'opt-out mais également la manière dont l'auteur devra se manifester, les pièces à fournir, les délais impartis et tous ces aspects qui constituent bien des « formalités » au sens de la convention de Berne. Ce recours sera l'occasion de soulever une question prioritaire de constitutionnalité que le Conseil d'État pourra transmettre au Conseil constitutionnel.
Ce dispositif législatif, qui a des conséquences économiques importantes au travers de la création de sociétés de gestion collective ou des engagements financiers pris pour que ces livres soient numérisés, nécessite d'être rediscuté afin que les équilibres soient rétablis.
Co-présidente du collectif, je considère que ce texte est vraiment déséquilibré car, à partir du moment où un éditeur déclare un ouvrage indisponible, il devrait, selon le code de la propriété intellectuelle, disposer d'un an pour le réimprimer en un nombre d'exemplaires suffisants, faute de quoi il perdrait les droits sur l'ouvrage.
Les auteurs n'ont pas confiance dans l'exploitation numérique des droits par les éditeurs et la création d'une société à parité entre auteurs et éditeurs (une SPRD) n'est pas souhaitable compte tenu de la façon dont les choses se pratiquent aujourd'hui...
Tels que les contrats sont rédigés, la preuve de l'exploitation d'un ouvrage est finalement à la charge de l'auteur. Or, en cas de numérisation, l'auteur aura du mal à retrouver les droits de ses ouvrages. Dans ces conditions, une loi qui donne à l'éditeur l'exploitation des droits numériques le fait au détriment des auteurs.
D'autant plus que confier aux éditeurs une partie de l'exploitation numérique d'oeuvres qu'ils ont cessé d'exploiter depuis onze ans nous parait un peu aberrant.
Je n'ai jamais admis qu'il y ait une société collective de gestion paritaire puisque c'est aux auteurs qu'appartiennent les droits numériques. Certes, au cours des dix dernières années du siècle, ils ont pu céder ces droits mais, pour le reste, ce que l'auteur n'a pas expressément cédé lui appartient.
Je pense aussi que la loi doit protéger la partie faible, à savoir l'auteur qui se trouve en situation de faiblesse économique et technique face à son éditeur. Le droit d'auteur ayant toujours été un droit de protection de l'auteur, cette loi de 2012 est révolutionnaire et aussi inquiétante pour la suite. Son exposé des motifs soutient par exemple qu'il n'est pas économiquement rationnel pour les éditeurs de mettre à jour tous les contrats. Certes, mais si l'on accepte cet argument pour le livre, on peut très bien l'accepter pour la musique ou l'audiovisuel et l'on procèderait ainsi à de véritables expropriations, aboutissant à ce que le droit d'auteur ne soit alors plus un droit de l'auteur.

Êtes-vous bien une coopérative d'éditeurs libres de livres numériques ? Allez-vous créer un portail présentant les oeuvres des écrivains qui refusent ce dispositif ?
En effet, l'association Indisponibles.fr est en cours de création. Le site existe déjà et la structure sera opérationnelle en septembre 2012.

Les écrivains concernés transgressent-ils des contrats déjà signés avec des éditeurs ou bien s'agit-il d'auteurs ayant récupéré tous leurs droits ?
Ce sont bien des auteurs ayant récupéré tous leurs droits. Nous préférons travailler sur l'opt-in plutôt que sur l'opt-out.
Lorsque des auteurs viennent me voir avec leurs contrats, je leur indique que, s'ils n'ont pas cédé leurs droits numériques, ces droits leur appartiennent et qu'ils peuvent les exploiter eux-mêmes.

Pouvez-vous expliquer le nom de votre collectif, « le Droit du Serf » ? Est-ce le serf au sens du servant ?
Oui. Il s'agit d'un collectif créé en 2000 contre le prêt payant, car nous estimons que l'accès gratuit à la culture est un droit fondamental. Il a continué à se battre régulièrement contre les atteintes au droit d'auteur, notamment contre la loi Hadopi. Pourquoi le Serf ? Car la plupart du temps, dans les rapports de pouvoirs au sein de la chaîne du livre, la personne la plus précaire reste malheureusement l'auteur.
Selon le rapport Gaymard, la vente représente ainsi 36 % du prix du livre, l'édition 21 %, la distribution et la diffusion 20 %, la fabrication 15 %, et l'auteur n'en représente que 8 %. Avec un tirage moyen de 8 500 exemplaires et des ventes de 6 700, sur 55 000 auteurs recensés, 25 000 publient régulièrement et seulement 1 200 gagnent plus que le Smic. Pour les autres, les droits annuels moyens s'élèvent à 7 300 euros, soit 610 euros par mois. Pourtant, sans auteurs et sans créateurs, il n'y a pas de littérature.
Alors que pour les éditions numériques les frais sont en principe beaucoup moins importants, j'ai l'impression que la part de l'auteur baisse.
Dans la plupart des avenants, la part des auteurs est effectivement en baisse. S'il ne touche que 8 % du prix de vente, l'auteur fait vivre par son travail les 80 000 personnes employées dans le secteur. Pourtant il reste le plus précaire, le moins payé et le moins considéré.
Il y a effectivement un éditeur numérique, David Queffélec, qui édite la revue Angle mort et qui est un des fondateurs du site Indisponibles.fr.
En tant qu'éditeur j'ai créé une revue publiant des nouvelles dont les auteurs sont rémunérés grâce à la vente de la revue.
Pour le reste, j'ai intégré le « Droit du Serf » parce que je suis favorable à l'édition numérique et que j'estime qu'elle est actuellement réalisée au détriment de l'auteur. Parallèlement, j'ai décidé de mettre en place une coopérative d'éditeurs entièrement numériques, pour leur offrir une alternative au système prévu par la loi. La structure technique est actuellement en voie de développement et l'on estime pouvoir rétribuer les auteurs à hauteur de 50 % du prix.
Je précise qu'il s'agit de 50 % du prix de vente du livre, comme cela est prévu dans la loi, et non pas, comme dans la plupart des avenants numériques, d'un pourcentage sur le revenu net de l'éditeur...
Il s'agit de 50 % du prix de vente, une fois déduits les frais de diffusion.
Il y aura effectivement un contrat. La coopérative s'adressera aux auteurs ayant récupéré leurs droits numériques ou figurant sur la liste des auteurs ayant des livres indisponibles qui souhaiteront, plutôt que de passer par la société de gestion des droits d'auteur, passer par un autre canal sans enfreindre la loi.
Deux hypothèses : soit l'auteur n'a jamais cédé ses droits numériques et il peut donc les exploiter ; soit le livre est indisponible et alors, si l'éditeur ne remplit plus son obligation d'exploiter, l'auteur peut, à la fin du contrat, demander à récupérer l'intégralité de ses droits.

Je suppose que vous aurez peu de frais de numérisation, étant donné que de nombreux auteurs ont déjà dû recourir à l'écriture numérique ?
Pas forcément. Ce sera le cas dans un premier temps mais nous espérons pouvoir ensuite procéder à la numérisation de livres papier au moyen de scanners construits par des communautés du libre constituées à cet effet.
Notre liste comprend effectivement des auteurs qui ont plus de quarante ans d'écriture et qui sont les auteurs d'écrits et de publications dont ils ont récupéré les droits.
Dans un premier temps, il s'agira d'une association, qui se transformera si elle fonctionne.

J'ai beaucoup mieux compris en vous écoutant qu'en lisant vos déclarations dans la presse. Y a-t-il une législation étrangère qui aurait retenu votre attention ? Vous êtes libres de ne pas me répondre mais, trois points du programme des Pirates de Berlin correspondent totalement à ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce le fruit du hasard ou bien travaillez-vous en coordination avec eux dans le cadre d'une réflexion européenne ?
Il existe à l'étranger davantage de dispositions sur les oeuvres orphelines que sur les oeuvres indisponibles ou épuisées. Une directive européenne a par ailleurs été proposée par la Commission, dont l'articulation avec ces dispositifs est relativement incertaine puisqu'elle prévoit que, si un mécanisme de gestion collective est en place dans un État membre, c'est ce dernier qui prévaudra.
Certains pays ont des commissions spécialisées ressemblant à nos autorités administratives indépendantes qui permettent de gérer les questions d'oeuvres orphelines, mais il s'agit surtout d'apporter des réponses ponctuelles. La seule solution que l'on puisse mettre en avant est celle envisagée aux États-Unis dans le cadre du règlement Google Books, mais qui a été arrêtée par la justice américaine au motif qu'elle mettait en place une procédure d'opt-out trop attentatoire au droit de propriété.
Une solution intéressante, la Digital Public Library of America, initiée par Robert Darnton de Harvard, ressemble le plus à la solution française mais en hésitant entre opt-in et opt-out, même si elle tend à s'orienter vers le premier.
Cette loi comporte beaucoup d'imperfections mais force est de reconnaître qu'elle est novatrice et que le même dispositif, s'il prévoyait des sociétés d'auteurs et l'opt-in, serait satisfaisant.

Le décret, qui traduira les intentions du gouvernement en la matière, n'a pas encore été pris. Nous verrons bien à l'usage ce qui se passera.