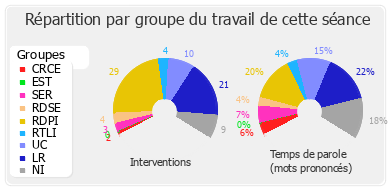Séance en hémicycle du 24 mai 2013 à 9h45
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures quarante.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République (projet n° 441, texte de la commission n° 569, rapport n° 568, avis n° 570 et 567).
Nous poursuivons la discussion des articles.
TITRE IER (suite)
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre iii
Le contenu des enseignements scolaires
Section 4
L’enseignement du premier degré
Nous en sommes parvenus, au sein du chapitre III du titre Ier, à l’article 28.
(Non modifié)
I. – La seconde phrase de l’article L. 311-4 du code de l’éducation est ainsi rédigée :
« L’école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. »
II. – L’intitulé de la section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigé : « L’enseignement moral et civique ».
III. – L’article L. 312-15 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’enseignement d’éducation civique » sont remplacés par les mots : « l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement » ;
2° Au troisième alinéa, à l’avant-dernier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les mots : « moral et ».

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 119, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
enseignement moral et civique
par les mots :
enseignement d’éducation civique
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéas 4 à 6
Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312-15, après les mots : « l’enseignement d’éducation civique », sont insérés les mots : « vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens libres et responsables, à se forger un sens critique. Cet enseignement ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Monsieur le ministre, avec l’article 28, nous abordons un sujet qui, je le sais, vous est cher.
L’école doit évidemment aider les élèves à intégrer dans leur comportement les valeurs fondatrices de la République, indispensables pour vivre ensemble. Elle doit aussi les amener à développer leur raison et leur esprit critique, les aider à devenir des êtres émancipés, uniques et responsables. C’est un objectif ambitieux.
Toutefois, à l’idée de l’enseignement moral et civique, nous préférons celle de l’éducation civique, car nous considérons que les termes « enseignement moral » peuvent porter à confusion et, ainsi, manquer leur cible.
Il ne faudrait pas que cet enseignement soit perçu comme le combat de certaines valeurs contre d’autres. Il doit au contraire être vu comme l’ouverture à des réponses différentes, à des sens variés que tout individu peut donner à sa vie, dans le respect des autres. Il faut permettre à chacune et à chacun de comprendre comment faire émerger, quelle que soit sa culture, une part d’universel qui permette justement le lien à autrui, quel qu’il soit.
En outre, la notion d’éducation civique traversant tous les enseignements, donc plus souple qu’un enseignement moral et civique, pourrait s’enrichir de la prise en compte de l’évolution de la jeunesse, qui est aujourd’hui fortement traversée par les métissages. Or, l’école travaille encore de façon cloisonnée et la hiérarchie des disciplines est souvent inversée par rapport aux pratiques culturelles des jeunes, qui vivent beaucoup plus intimement le métissage des cultures que les générations précédentes.

L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Guerriau, J.L. Dupont et Merceron, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
hommes
insérer les mots :
, du principe de non-discrimination
II. - Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa, les mots : « d’éducation » sont remplacés par les mots : « moral et » et le mot : « intégration » est remplacé par le mot : « inclusion » ;
III. - En conséquence, alinéa 6
Supprimer les mots :
Au troisième alinéa
Cet amendement n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 119 ?

Mme Françoise Cartron, rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Comme vous l’avez rappelé, madame Gonthier-Maurin, cet article tient à cœur à M. le ministre. On ne peut donc pas douter de la force de son engagement sur ce sujet.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin fait un signe d’assentiment.
Le sujet de l’article 28 constitue, nous le savons, une source de confusion, et c’est la raison pour laquelle il m’a semblé utile d’en revenir à des valeurs simples et traditionnelles qui fondent la République.
La République, aussi bien dans sa tendance libérale que dans sa mouvance que l’on qualifie parfois de jacobine, a toujours considéré que morale et politique étaient inséparables : le citoyen n’a pas seulement à obéir à la loi sous l’effet de la contrainte, il doit aussi agir dans le respect d’un certain nombre de valeurs, à partir de dispositions intérieures qui répondent à la liberté de conscience que vous venez d’évoquer.
Ces principes étaient connus. Que l’on songe à Montesquieu, proclamant que la République a besoin de vertu, ou à Rousseau, déclarant que politique et morale sont inséparables.
Lorsque l’on faisait ce qui semble juste, comme par exemple la poursuite des valeurs républicaines – liberté, égalité, fraternité –, on le faisait non pas simplement par peur du gendarme, mais parce que l’on pensait que c’était mieux et que c’était un bien à poursuivre en commun.
Les difficultés de notre société, marquée par un individualisme toujours plus conséquent, par un libéralisme sans limite, tiennent au fait que nous perdons cette idée d’un certain nombre de valeurs communes qui seules permettent de vivre ensemble.
L’école de la République a toujours pensé qu’il fallait un équilibre très précis entre l’éducation, généralement comprise comme l’imposition des valeurs de la société, et l’instruction, c’est-à-dire l’enseignement destiné à forger un esprit critique.
Nous avons donc souhaité rétablir cette tradition, animés par la conviction – et nous l’avons constaté à maintes reprises – qu’un élève ne sait que ce qu’on lui a enseigné. À force de ne pas défendre nos valeurs – qu’est-ce que la liberté ? Comment atteint-on l’égalité ? Quelles sont les différentes formes de l’égalité ? –, de ne pas développer chez les enfants un jugement critique et libre – c’est l’objectif de l’école –, nous perdons nos valeurs en route.
C’est pourquoi nous avons souhaité restaurer l’enseignement moral et civique, les deux étant liés. Nous avons voulu aller un peu au-delà de la tendance trop mécanique, dénoncée à la fin du XIXe siècle par certains fondateurs de la République, à répéter et à ânonner des devises dont on ne s’approprie pas vraiment les valeurs.
Il ne s’agit pas, contrairement à ce que j’entends, notamment au sujet des rythmes scolaires, d’une proposition du ministre. Il faut que la Nation assume ce qui est et doit être porté par tous. Dans un pays qui ne compte que 144 jours de classe, une réforme ne peut pas être la réforme du seul ministre. Il doit s’agir de la réforme de tous les Français. L’enseignement moral et civique n’est pas une marotte, une lubie du ministre ; c’est une nécessité absolue de renouer avec ce qu’il y a de plus libre et de plus fort dans notre tradition.
J’ajoute qu’il faut mesurer à quel point ces valeurs, simples en apparence, sont souvent contestées aujourd’hui.
La morale, tout le monde l’enseigne. Elle est fréquemment invoquée pour défendre l’égalité entre les hommes et les femmes. Des modèles sont imposés en permanence par la société civile : Qu’est-ce que le bonheur ? Que faut-il faire pour accomplir sa propre existence, pour réussir sa vie ? Les publicitaires, les marchands ont le droit de le faire.
Le seul endroit où l’on n’aurait plus le droit de parler du bien, du juste, de ce qui contribue à une vie accomplie, à une vie heureuse, et de réfléchir aux différents modèles existants, ce serait l’école.
Je dirai simplement que la neutralité de l’école, c’est la neutralité confessionnelle, la neutralité politique ; nous en avons parlé. Il n’a jamais été question, dans les discours de Jules Ferry ou des autres fondateurs de l’école publique, de la neutralité morale. Bien au contraire, la République a toujours pensé qu’elle avait à enseigner un certain nombre de valeurs et à les défendre.
Notre volonté est de réinstaurer cet enseignement. Si nous revenions du côté de l’éducation, nous perdrions la dimension critique de l’instruction, de l’enseignement, du savoir, de l’interrogation.
Pour ce qui est de l’amendement n° 119, le Gouvernement y est défavorable.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

J’entends bien que cette proposition n’émane pas seulement de vous, monsieur le ministre, puisque nous sommes ici pour légiférer ; néanmoins, vous la défendez.
Notre divergence ne porte pas sur le fait de savoir si l’éducation nationale doit ou non être porteuse des valeurs intrinsèques de notre République. La question est de savoir comment le faire. Or nous considérons que l’éducation civique, précisément du fait de son aspect universel, est plus à même de répondre à cet objectif.
La morale peut être diverse. Si elle peut permettre le « vivre ensemble », elle est susceptible de susciter des séparations et des oppositions.
Vous me pardonnerez d’avoir déclenché un débat philosophique qui nous fera perdre un peu de temps, mais celui-ci est d’une grande importance.
Je suis d’accord avec vous, madame la sénatrice, si nous sommes ici, c’est justement pour débattre de ces sujets.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par exemple, est-elle civique ou morale ? Est-elle universelle ou particulière ?
Quand on parle d’éducation civique – ce fut le grand débat dès la Révolution française –, on envisage uniquement son aspect national civique : la cité dans laquelle on vit. Par conséquent, contrairement à ce que vous dites, cet enseignement n’est pas universel ; c’est la morale qui l’est.
En perdant cette compréhension de l’articulation entre l’universel – principe discutable qui ne s’impose pas en soi, mais qui est de l’ordre de la morale, au-dessus de la politique – et le civisme, nous avons perdu le sens même de la République. Pourquoi ? Parce que la République est le premier modèle qui a articulé, y compris dans sa Constitution, une dimension dite « des droits de l’homme », droits naturels au-delà du civisme et qui doit inspirer celui-ci.
Pour illustrer mon propos, je citerai l’affaire Dreyfus. On peut considérer que, au Parlement, nous faisons la loi, mais que nous ne disons pas nécessairement ce qui est juste. Il est arrivé que des lois soient injustes ; et, si l’on peut juger que ces lois sont injustes, c’est parce que nous nous référons à des valeurs qui viennent d’ailleurs.
Cette articulation entre l’universel et le civisme doit être restituée, car elle permet de garder l’attitude des républicains, d’être toujours critique à l’égard de tous les pouvoirs et de respecter toutes les consciences. C’est très important dans le moment que nous vivons.
Madame la sénatrice, je crois que nous sommes d’accord, en fait. L’éducation civique signifie que nous devons nous plier à la morale ou à la politique choisie par un État, alors que la morale est ce qui permet de critiquer à tout moment toutes les morales d’État.

Il est redoutable de prendre la parole dans un pareil débat quand le ministre de l’éducation est aussi un philosophe et qu’il nous donne sa vision, dans l’enceinte du Parlement, de ce qui est bon et de ce qui l’est moins.
Vous remarquerez, monsieur le ministre, que nous n’avons pas déposé d’amendement sur l’article 28 du présent texte, ce qui ne veut pas dire que nous ne soyons pas, nous aussi, très attentifs à ce débat.
Simplement, si les mots ont un sens, la manière dont les enseignants conçoivent leur rôle dans la classe et en présence de leurs élèves compte aussi.
À cet égard, certains parents peuvent redouter que tel ou tel professeur ne soit tenté de transmettre ses propres convictions et conceptions avant la morale plus désincarnée, …

–, cette erreur serait évidemment inacceptable !
Il faut le rappeler, nous pourrons écrire dans la loi ce que nous voudrons, mais il faut que se dégage le rôle du professeur, avec, d’une part, les aspects acceptables – développer l’esprit critique, présenter éventuellement plusieurs interprétations et laisser à l’élève le soin de choisir et d’élaborer sa culture : ce débat nous renvoie à celui que nous avons eu sur la notion de culture commune –, et, d’autre part, les aspects qui sont inacceptables – formater les esprits pour les conformer à une seule morale, une vision unique du monde et de la société.
Nous devons faire confiance a priori à la bonne foi des uns et des autres, mais rappeler que les débordements, s’ils se produisaient, devraient être sanctionnés.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 28 est adopté.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 178 rectifié, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … - L'éducation à l'environnement et au développement durable
« Art. L. 312-…. - L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux.
« Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Comme je vous l’ai dit hier soir, sur cette question, nous avons déposé très peu d’amendements, mais notre attachement à leur égard et notre motivation sont inversement proportionnels à leur nombre.
Cet amendement a trait à l’éducation à l’environnement et au développement durable. Nous pensons que cela débute à l’école primaire.
Comme vous le savez, depuis plus de quarante ans, les conférences mondiales sur l’environnement ont rappelé le caractère crucial de cet enseignement, qui doit commencer dès le plus jeune âge.
Selon nous, l’éducation à l’environnement et au développement durable est une éducation qui met au premier plan des valeurs. Les séquences éducatives qui sont mises en place doivent tendre à faire prendre conscience à tous que la Terre est un bien commun dont nous devons tous prendre soin.
L’éducation à l’environnement et au développement durable doit faire des élèves des citoyens et citoyennes porteurs des valeurs démocratiques et toujours mobilisés pour leur mise en œuvre ici et ailleurs.
Elle doit faire comprendre que chaque individu influe sur le milieu dans lequel il évolue.
Elle vise également à l’adoption, librement choisie par le plus grand nombre, de comportements quotidiens nécessaires à l’éradication de la pauvreté, à la sauvegarde de nos ressources et l’amélioration de la qualité de notre environnement.
Cette éducation est à nos yeux indispensable si l’on veut faire évoluer les modèles de pensée et les comportements afin qu’ils intègrent la compréhension des enjeux environnementaux auxquels nous sommes tous attachés.
En cohérence avec la mention de cette éducation à l’environnement dans le rapport annexé, il nous semble important que l’éducation à l’environnement et au développement durable soit considérée comme une composante des enseignements scolaires.

L'amendement n° 179, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section … - L'éducation à l'environnement et au développement durable
« Art. L. 312-…. - L'éducation à l'environnement et au développement durable fait percevoir et comprendre la dépendance de la qualité de vie au bon état des écosystèmes. »
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Nos visions de la société et de l’éducation étant un peu différentes, nous sommes persuadés que la notion de dépendance entre qualité de vie et bon état des écosystèmes n’est pas assez prise en compte.
C’est la raison pour laquelle cet amendement, comme le précédent, vise à insister sur l’importance de la compréhension de ce lien de dépendance.
Cette proposition correspond par ailleurs au préambule de la charte de l’environnement de 2004, selon lequel « l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de son milieu naturel ».
La perception et la compréhension de ce lien de dépendance dans le cadre d’un enseignement scolaire dédié permettront aux élèves de développer des valeurs très importantes.


Madame Bouchoux, les amendements n° 178 rectifié et 179 sont-ils maintenus ?

Nous maintenons l’amendement n° 178 rectifié mais retirons l’amendement n° 179 sur lequel, je continue à le répéter, nous avons des petites divergences de vue quant à la notion de dépendance entre qualité de vie et bon état des écosystèmes.
L'amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 28.
L'amendement n° 120, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre … : De la psychologie dans l’éducation nationale
« Art. L. 315 – Les psychologues de l’éducation nationale, psychologue du premier degré et conseiller d’orientation-psychologue, contribuent au fonctionnement du système éducatif de la maternelle à l’université.
« Ils prennent en compte les difficultés des élèves et mettent en œuvre les conditions pour faciliter leur apprentissage et leur développement. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Cet amendement a pour objet de consacrer dans la partie législative du code de l’éducation les missions des personnels psychologues de l’éducation nationale. À cet égard, il traduit le même esprit que la proposition de loi que nous avions déposée afin de créer, au sein du service public de l’éducation nationale, une direction de la psychologie pour l’éducation et l’orientation des élèves et étudiants, couvrant la scolarité des jeunes de la maternelle à l’université.
En effet, si la place des conseillers d’orientation psychologues, les Copsys, qui constituent un corps, est identifiée au sein des personnels de l’éducation nationale, celle des psychologues du premier degré ne l’est pas, dans la mesure où ces derniers appartiennent au corps des professeurs des écoles.
Noyés dans la masse des professeurs des écoles, ces personnels souffrent de ne pouvoir être identifiés à part entière dans leurs fonctions de psychologue, pourtant essentielles dans les écoles. Ils existent, interviennent, participent à la mise en place de dispositifs d’aide spécialisée aux élèves en difficulté et assurent les contacts avec les psychologues travaillant dans d’autres institutions, avec les structures de soins ou avec d’autres professionnels du champ social et de l’aide à l’insertion. Ils exercent, si nécessaire, un rôle de médiation entre les enseignants et les familles dans la recherche constructive de liens, de dialogue et de mise en cohérence dans le cadre du projet scolaire et personnel des enfants comme des adolescents. Ils jouent également ce rôle entre l’enfant et l’enseignant. Pourtant, ils sont peu visibles, faute d’un statut qui les distingue en qualité de psychologues du premier degré.
C’est pourquoi ces professionnels demandent une formation et un recrutement comparables à ceux des psychologues des autres fonctions publiques, c’est-à-dire après un master 2 de psychologie, toutes options comprises.
Cette évolution est nécessaire, compte tenu des difficultés de recrutement engendrées par cette absence de statut, et ce alors même que le nombre des psychologues, comme celui des Copsys, est dramatiquement bas : ces fonctions sont même en véritable déshérence !
Cette pluri-professionnalité est une richesse de notre système éducatif qui est en train de disparaître : en moyenne, la France compte un Copsy pour 1 500 élèves et un psychologue du premier degré pour 2 000 élèves, quand la Finlande, souvent citée en exemple, en dénombre un pour 500 à 700 élèves.
Mes chers collègues, l’existence de ces personnels garantit que tous les élèves, quelle que soit leur origine sociale, aient accès à une écoute, à un suivi et à des conseils personnalisés relatifs à leur scolarité comme à leurs projets d’avenir. Ces psychologues sont une ressource dans la mise en œuvre d’une politique éducative véritablement ambitieuse pour tous les élèves, soucieuse de lutter contre les déterminismes sociaux et de favoriser l’accès à l’autonomie et l’émancipation de tous les jeunes. C’est aussi cela, à mon sens, avancer vers une école bienveillante.
La reconnaissance pleine et entière de ces personnels est donc, à nos yeux, une nécessité. C’est pourquoi je vous invite à adopter cet amendement.

Chère collègue, il n’existe pas de corps de psychologues de l’éducation nationale : les psychologues du premier degré occupent en effet des postes fonctionnels.

Les conseillers d’orientation psychologues forment, eux, un corps à part entière, et il convient de ne pas confondre ces différents professionnels. À ce titre, la commission émet un avis défavorable.

Cet amendement tend, d’une certaine manière, à sanctuariser plusieurs catégories de personnels, à affirmer leur existence au sein de l’éducation nationale et sans doute à éviter que celle-ci ne soit remise en cause.
Que les choses soient bien claires : il est évident que nous avons besoin de psychologues dans l’éducation nationale et, a priori, les dispositions du présent amendement n’ont rien de choquant.
Toutefois, sur ce sujet extrêmement important qu’est l’orientation, le problème réside peut-être dans la définition de ce que sont actuellement les principaux acteurs de l’orientation, à savoir les conseillers d’orientation psychologues.
Il faut certainement des connaissances en psychologie pour assumer ces fonctions ; il faut également une connaissance personnelle de la vie à l’extérieur de l’école, notamment au sein de l’entreprise – et donc des différents métiers en dehors de la fonction publique en général et de l’éducation nationale en particulier !
Monsieur le ministre, dans le cadre de la rénovation du parcours d’orientation, allez-vous vous doter d’hommes et de femmes susceptibles de présenter aux élèves les métiers dans leur diversité et la réalité de la vie professionnelle ? À nos yeux, il s’agit également d’un enjeu de la rénovation de l’orientation ! §
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 174, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Avant l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 113-1, à l’article L. 133-3, aux premier et quatrième alinéas de l’article L. 133-4, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 133-12, au premier alinéa de l’article L. 321-1, à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 321-2, aux première et deuxième phrases de l’article L. 411-1 et au premier alinéa des articles L. 914-4 et L. 921-1, le mot : « maternelle » est remplacé par le mot : « initiale » ;
2° Aux intitulés du titre III du livre Ier de la première partie, du chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie, de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier de la première partie, de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II de la première partie, du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie, les mots : « maternelles » sont remplacés par les mots : « initiales » ;
3°Au premier alinéa de l’article L. 113-1, à l’article L. 132-1, au III de l’article L. 133-2, à l’article L. 133-6, au premier alinéa des articles L. 133-11 et L. 133-12, au second alinéa des articles L. 161-3, L. 162-4, L. 163-4 et L. 164-3, aux 1° et 7° de l’article L. 211-8, aux premier et second alinéas de l’article L. 212-1, au premier alinéa de l’article L. 212-8, au dernier alinéa de l’article L. 213-11, au premier alinéa et au 1° de l’article L. 312-3, aux articles L. 312-5, L. 312-11 et L. 321-11-1, à la première phrase du premier alinéa des articles L. 312-2 et L. 351-1, et à l’article L. 511-5, les mots : « maternelles » sont remplacés par les mots : « initiales ».
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Mes chers collègues, cet amendement pourra vous sembler symbolique ou décoratif, mais il est à nos yeux extrêmement important. En effet, les mots ont un sens et, en dépit de l’immense attachement que nous portons à notre école maternelle, s’agissant tant du concept et du fonctionnement, il nous semble nécessaire de revenir sur son nom. Pourquoi ?
Monsieur le ministre, je sais que vous êtes féru d’histoire. Je me permets donc de rappeler que, lorsque Pauline Kergomard, l’inventeur des écoles maternelles, s’est penchée sur cette question, elle a énormément réfléchi au choix des termes. Elle a alors parlé d’« école initiale », expression qui présente deux avantages : d’une part, l’école est nommée : il n’y a donc pas d’ambiguïté ; d’autre part, l’adjectif « initiale » traduit l’idée d’un début, d’un commencement.
Aujourd’hui, les termes « école maternelle » véhiculent certes une histoire que nous connaissons, qui est formidable et à laquelle Mme la rapporteur est particulièrement attachée, mais ils peuvent cependant induire en erreur, pour deux raisons.
Premièrement, l’adjectif « maternelle » suppose la notion de « maternage ». Or tous les enseignants des écoles maternelles l’expliquent précisément, la mise en apprentissage sollicite, au-delà des affects, une démarche d’enseignement active. Le terme peut donc prêter à confusion.
Deuxièmement, nous sommes, à ma connaissance, le seul pays au monde où cette école est ainsi désignée. Chacun en conviendra sur toutes les travées de cet hémicycle, nous aspirons à une répartition des tâches plus égalitaire entre les pères et les mères dans notre société, et à un recul des préjugés entre leurs rôles respectifs, tout en reconnaissant leurs spécificités.
Les jeunes générations actuelles connaissent la mixité dès le plus jeune âge. Quand on les interroge sur les raisons de la dénomination « école maternelle », on constate que, si le terme « école » leur parle, l’adjectif « maternelle » ne leur dit rien.
Notre proposition, quoique extrêmement modeste, nous semble de nature à rassembler tout le monde, puisqu’elle s’inspire de la mère de l’école maternelle, Pauline Kergomard : il s’agit simplement de renommer l’école maternelle « école initiale ». À nos yeux, cette disposition extrêmement simple a un sens, qui est en cohérence avec toutes les positions que nous défendons par ailleurs. §

Cet amendement tend à modifier la dénomination de l’école maternelle sans modifier le statut de cette dernière.
Le Conseil constitutionnel a considéré que les dispositions de ce type, n’étant pas normatives, devaient être déclarées contraires à la Constitution. C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.

Madame Bouchoux, les mots ont bel et bien un sens : parler d’école initiale, c’est évoquer l’école par laquelle on débute. Mais si on n’y a pas pris part, qu’en sera-t-il par la suite ? Il faut être clair : à mon sens, si l’école maternelle devient école initiale, elle doit non seulement exister mais devenir obligatoire.

De plus, j’ai bien entendu que vous citiez Pauline Kergomard. Un peu historien moi aussi, j’admets que cette référence n’est pas inintéressante. Reste que les Français sont très attachés à l’appellation « école maternelle ». Ils y voient un lien sentimental, et c’est probablement un argument fort pour intéresser les familles à l’école des premiers âges que de l’appeler ainsi. Ce ne serait pas rendre service à cette école que de la débaptiser, permettez-moi de vous le dire.

Madame Bouchoux, au vu de l’argument d’inconstitutionnalité, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

J’entends bien les arguments que me sont opposés.
Selon M. Legendre, les termes « école initiale » induisent qu’un enfant n’ayant pas suivi cet enseignement ne pourrait être scolarisé ensuite : rien dans la sémantique ne permet une telle déduction ; il s’agit simplement d’une interprétation !
Par ailleurs, le législateur, qui fait la loi dans le sens de l’intérêt général, ne peut qu’être sensible au motif d’inconstitutionnalité. Je remarque simplement que nombre de dispositions votées dans cet hémicycle ne sont pas nécessairement conformes à la Constitution, et n’ont pas pour autant été censurées par le Conseil constitutionnel !
Je tenais à ce que nous ayons cette discussion, tout comme je tiens au débat que nous consacrerons, dans quelques instants, à un autre sujet, même s’il n’est que symbolique.
Cela étant, dans un esprit de consensus, je retire mon amendement, madame la présidente.
(Non modifié)
L’article L. 321-1 du code de l’éducation est abrogé. –
Adopté.
L’article L. 321-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l’éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l’estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s’attache à développer chez chaque enfant l’envie et le plaisir d’apprendre afin de leur permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ;
2° §(nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des éléments de formation spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à l’article L. 721-1. »

L'amendement n° 253 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle prépare progressivement les enfants à l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
La parole est à Mme Françoise Laborde.

La préscolarisation des enfants requiert un accueil spécifique pour favoriser leur éveil, et, à cet égard, je salue la nouvelle rédaction des missions de l’école maternelle.
Toutefois, l’école maternelle doit, à mon sens, préparer progressivement à l’acquisition du socle commun de compétences et de culture. Dans ce cadre, je précise que cet amendement ne tend pas à introduire une « primarisation » précoce.
Quel est l’enjeu ? Il ne faut pas oublier que l’objectif principal de la préscolarisation reste la réussite des enfants tout au long de leur scolarité. C’est pourquoi la formation dispensée doit tendre à l’acquisition du socle commun par la stimulation des enfants, afin de leur donner envie d’apprendre à lire, à écrire et à compter. Il ne s’agit en aucun cas d’inclure les écoles maternelles dans le périmètre du socle ou de sanctionner celles dont les élèves n’auraient pas appris à lire ou à écrire.

Dans ce cadre, la référence au socle risque de renforcer un processus auquel nous ne souscrivons pas, à savoir la « primarisation » de la formation dispensée au sein de cette école maternelle si particulière, unique et partant exemplaire. C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

L’article 30 du présent projet de loi traite des formations dispensées aux enfants de maternelle, et mes collègues et moi-même tenions à déposer un amendement d’appel afin d’insister également sur la formation des enseignants, qui seront évidemment des professeurs de maternelle.
La commission ayant introduit dans le présent texte la notion de « devenir élève », je retire cet amendement, madame la présidente.

L’amendement n° 253 rectifié est retiré.
L'amendement n° 370, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle veille à favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Mes chers collègues, si vous me le permettez, je coifferai un instant ma casquette de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, pour évoquer la promotion si essentielle de l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les sphères de notre société.
À plusieurs reprises, notre délégation a eu l’occasion de mettre en avant l’école maternelle pour empêcher la formation de mécanismes qui concourent à la construction de stéréotypes de genre.
Dans ce cadre, cet amendement a un objet assez simple : son adoption permettrait de généraliser des pratiques déjà existantes, qui favorisent l’égalité entre les filles et les garçons. Je songe notamment aux supports des abécédaires, employés dès le plus jeune âge.

Madame Gonthier-Maurin, comme je vous l’ai déjà dit en commission, la rédaction de cet amendement laisse supposer que l’école maternelle ne respecte pas l’égalité entre filles et garçons. Or il me semble que votre propos porte en fait sur les stéréotypes de genre.

La rédaction du présent amendement paraissant ambiguë à la commission, celle-ci émet un avis défavorable.
Vous savez que, sur ce sujet très important, nous avons signé une convention avec le ministère des droits des femmes.
En outre, les « ABCD de l’égalité » seront mis en place dès la rentrée et sont d'ores et déjà très demandés par les enseignants.
Vous savez également que j’ai engagé une lutte contre les stéréotypes, qui sont effectivement très prégnants au sein de l’éducation nationale, comme d'ailleurs dans l’ensemble de la société, et qui, d’après toutes les études dont nous disposons, s’intègrent dès le plus jeune âge.
La question de l’égalité filles-garçons est déjà couverte par nombre de nos textes – certains avaient d'ailleurs cherché à créer des polémiques inutiles sur la question du genre – et nous l’avons réaffirmée dans le présent projet de loi à plusieurs reprises.
Vous le voyez, nous agissons très concrètement et très puissamment dans la lutte contre les stéréotypes. Dans ces conditions, je demande le retrait de l’amendement.
Je tiens à répéter que la lutte contre les stéréotypes constituera aussi l’un des éléments du parcours d’orientation que nous préparons. Comme vous le savez, la France enregistre des pénuries très spécifiques d’étudiantes féminines dans les cursus scientifiques, malgré leur réussite dans ces disciplines au lycée.
D’ailleurs, la lutte contre les stéréotypes a également été mise en œuvre par la ministre des droits des femmes dans les ministères eux-mêmes.

Oui, madame la présidente. En effet, le débat que nous venons d’avoir et les précisions apportées par M. le ministre contribuent très fortement à l’identification de la problématique et donc des voies pour y remédier.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 121, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
I. Après le mot :
formation
insérer les mots :
initiale et continue
II. Supprimer les mots :
à ce personnel
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

L’article 30 réécrit les missions de l’école maternelle dans un sens qui nous convient parfaitement puisque nous en avions proposé une réécriture similaire dans la proposition de loi que nous avions déposée sur cette école.
Cet article précise les missions qui sont assignées à l’école maternelle et affirme ainsi la spécificité de cette dernière.
Il distingue l’école maternelle et enfantine de l’école primaire, tout en précisant qu’elle est une véritable école, sans pour autant en faire une pré-école élémentaire. Il était important de le faire, le débat d’hier nous ayant montré que tout le monde ne partage pas cette idée et qu’il y a débat.
Bien au contraire, l’école maternelle constitue un temps spécifique de l’éducation, qui, comme l’affirme justement cet article, « favorise l’éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l’estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif ».
L’un de nos amendements a été adopté en commission et a encore enrichi le texte, ce dont nous nous félicitons. Il introduit une notion selon nous fondamentale, qui doit figurer au cœur du système éducatif : l’envie et le plaisir d’apprendre, afin de devenir progressivement élève. Cette notion de plaisir et d’envie est essentielle et constitue un facteur de motivation et de réussite qui doit en faire un des fondements de l’école maternelle.
Autre élément important, l’article 30 du projet de loi introduit une formation spécifique pour les personnels des écoles maternelles au sein des futures écoles supérieures du professorat et de l’éducation, les ESPE. En effet, il nous paraît indispensable de former les enseignants aux spécificités des enjeux de la maternelle et aux particularités de ces jeunes enfants.
Cependant, quelques points nous semblent devoir être revus concernant cette formation.
L’alinéa 5 affirme que « des éléments de formation spécifiques sont dispensés à ce personnel ». Le I de notre amendement tend à préciser que cette formation est initiale et continue.
Quant au II de notre amendement, il vise à supprimer les mots : « à ce personnel », en cohérence avec l’idée d’une formation continue et, bien sûr, initiale. En effet, il nous semble que la mention des « personnels » limite la formation à une formation continue, la formation initiale étant dispensée non à des « personnels », mais à des élèves.

La commission émet un avis favorable sur le paragraphe I, même si ce dernier lui paraît d’ores et déjà satisfait par le texte.
S’agissant du paragraphe II, dont elle avait demandé le retrait en commission, elle émet un avis défavorable.
Le Gouvernement se range à l’avis de la commission.
Le I de l’amendement est adopté.
Le II de l’amendement n’est pas adopté.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Primas, MM. Humbert et B. Fournier, Mmes Mélot et Duchêne et M. Duvernois, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enseignements dispensés durant le cycle des apprentissages fondamentaux sont individualisés et adaptés au niveau de progression de chaque élève.
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles l’individualisation des enseignements est organisée. »
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.

Cet amendement, dont Jean-Claude Carle est le premier signataire, découle du constat que l’éducation nationale n’a, au fond, pas réussi à grande échelle l’individualisation des enseignements. Les enseignements de l’école élémentaire sont aujourd’hui encore peu nombreux à mettre en application cette individualisation : nos enseignants de CP et de CE1 enseignent souvent face à la classe entière, de façon encore magistrale.
Pourtant, l’individualisation des enseignements, qui, dans plusieurs pays, a pris la forme du travail en petits groupes, ne nécessite pas de moyens supplémentaires. En revanche, elle exige une formation spécifique.
Du reste, comment penser la politique des cycles sans penser l’individualisation des enseignements ? En effet, l’individualisation est un corollaire de cette politique des cycles, laquelle vise à ce que chaque élève apprenne à son rythme.

Madame Duchêne, l’un des objectifs assignés à l’école maternelle est justement de permettre et de réussir la socialisation des enfants. Bien sûr, cette dernière ne peut se faire qu’au travers d’activités collectives. Dans ces conditions, prôner l’individualisation de l’enseignement me paraît aller à l’encontre de ce que l’on souhaite voir se passer à l’école maternelle.
En outre, l’individualisation nous paraît impraticable.
Pour ces deux raisons, l’avis de la commission est défavorable.
Ce débat n’est pas neutre.
Ce qui caractérise et ce qui a, d'ailleurs, fait la place de l’école dans notre République, c’est une certaine conception de l’individualisme républicain. Cette conception est assez simple. Elle consiste à considérer qu’un individu a besoin, pour se construire, de règles communes, et même d’un certain soutien de la puissance publique.
Cette conception peut avoir une traduction matérielle : je pense aux secours, à la justice, aux assurances… En vertu d’une tradition continue, nous avons toujours considéré qu’elle trouve un autre terrain d’application dans l’éducation. En effet, pour être vraiment soi-même, il faut souvent passer par des règles communes. Je pense, madame Duchêne, que vous avez transmis cette idée vertueuse à vos élèves !
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, on n’est pas tout de suite un grand peintre, un grand poète, un grand mathématicien ou un grand philosophe, et ceux qui ont appris les règles sont aussi ceux qui, au final, peuvent le mieux exprimer leur individualité.
Or, depuis quelques années, cette idée de base, cette idée simple, qui organise tout notre système civique mais aussi éducatif, se perd. Depuis quelques années, on s’acharne à célébrer l’individu, à exalter la différence et à appeler à une éducation pour chacun.
Toutefois, à l’instar du sur-mesure dans la confection, une telle éducation serait quelque peu coûteuse puisqu’elle nécessiterait beaucoup de postes d’enseignant. En outre, elle n’aurait pas les vertus que l’on attend d’une école, ne garantissant ni le partage de valeurs communes ni les conditions permettant aux élèves de se constituer comme individus. En effet, faire croire que l’on devient un individu sans passer par des règles communes et des apprentissages revient à jouer contre l’école elle-même.
Ces dernières années, cette conception a fait l’objet d’une opposition très virulente et, à mon avis, fondée sur rien. Il me semble très important que nous renouions avec l’idée que l’école vise à faire partager du commun et qu’elle ne lutte pas pour autant contre les natures individuelles – pour ma part, j’assume pleinement cette vision ! Bien au contraire, une école qui produit du commun permet à l’individu de s’émanciper – j’ai souvent entendu Mme Brigitte Gonthier-Maurin le dire –, de se construire – je le répète, on n’est pas immédiatement savant, poète ou citoyen – et, en même temps, de se délivrer.
Cela dit, si vous êtes favorable à des pédagogies différenciées, sachez qu’elles se pratiquent depuis très longtemps, sans pour autant relever de l’individualisation au sens où nous l’entendons aujourd'hui.
Je terminerai par un point sur lequel les débats ne m’ont pas encore donné l’occasion de revenir : l’aide individualisée, telle qu’elle a été pratiquée, sur des journées alourdies, en plus des six heures de cours, pour les enfants en difficulté, et dont le rapport d’une inspection a d'ailleurs montré que le résultat était assez nuancé.
Nous avons remplacé cette aide individualisée par des activités pédagogiques complémentaires, qui, je l’espère, seront davantage bénéfiques aux enfants. Je souhait qu’il n’y ait pas de débat théorique à cet égard. D’aucuns ont en effet affirmé que nous avions supprimé cette aide individualisée. Non, nous ne l’avons pas supprimée ! Nous l’avons repensée de manière à la rendre plus efficace pour les enfants en difficulté.
Pour conclure, faisons attention à ne pas opposer l’individu et le commun : c’est ainsi que l’on mine les fondements mêmes de notre école.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 30 est adopté.

L'amendement n° 122, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 30
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 321-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 321-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 321-2-... – Le Gouvernement, en lien avec les autorités académiques, effectue un état des lieux annuel de la situation des écoles maternelles. Cet état des lieux est communiqué sous forme de rapport annuel aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Le Gouvernement remet également aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat un rapport annuel spécifique sur la scolarisation des enfants de deux ans à trois ans, faisant notamment état des demandes de scolarisation et de la prise en compte de celles-ci dans les effectifs. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

L’école maternelle a été particulièrement mise à mal lors du dernier quinquennat. Présentant la caractéristique d’être gratuite sans être obligatoire, elle a constitué la variable privilégiée d’ajustements budgétaires.
Considérée comme trop coûteuse, l’école maternelle ne recevait plus les moyens nécessaires à son fonctionnement, alors même que les effectifs d’enfants de plus de trois ans augmentent chaque année.
La rédaction de l’article L. 131-1 du code de l’éducation, prévoyant une « priorité » de scolarisation en zone prioritaire, a surtout permis au ministère de l’éducation nationale de se prévaloir du caractère facultatif de cette possibilité pour s’en dégager largement.
Selon la volonté du ministère, l’inspecteur d’académie ne prenait plus en compte les enfants de moins de trois ans dans le calcul des effectifs des enseignants des écoles maternelles, ce qui permettait également d’arguer d’un recul effectif de leur scolarisation.
L’objectif n’était qu’économique, puisqu’il s’agissait de justifier de la diminution des effectifs enseignants, même en zone prioritaire, rendant de facto impossible la scolarisation des enfants âgés de deux et trois ans, actuellement conditionnée par « la limite des places disponibles ».
Le rapport de la Cour des comptes du 10 septembre 2008 sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale indiquait déjà : « le taux de scolarisation des 2-3 ans a diminué de 27 % entre 2003 et 2007 – moins 29 % dans le public, moins 18 % dans le privé.
Certains départements, comme la Seine-Saint-Denis, ont été plus particulièrement touchés, puisque le taux de scolarisation de cette tranche d’âge est passé de 22 % en 1999 à 8 % en 2006. « À la rentrée 2005, 5 000 enfants étaient en attente de scolarisation en maternelle, dont 300 avaient plus de trois ans. », était-il ajouté dans le rapport de la Cour des comptes ; cette dernière évoquait même un désengagement du ministère de l’éducation nationale de la scolarisation des enfants de deux ans.
Le gouvernement actuel, en réaffirmant la nécessité de la scolarisation des enfants de deux à trois ans et en affectant 3 000 postes à la maternelle, s’inscrit bien dans l’objectif de priorité au primaire. Priorité du Gouvernement, la maternelle doit faire l’objet de rapports sur son évolution, qui prennent en compte toutes les demandes de scolarisation dans la prévision des effectifs enseignants affectés, afin de rompre avec l’expérience précédente.
Notre amendement n° 122 tend donc à ce que le Gouvernement effectue un état des lieux annuel de la situation des écoles maternelles, qui serait communiqué aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.
« Un rapport annuel spécifique sur la scolarisation des enfants de deux ans à trois ans, faisant notamment état des demandes de scolarisation et de la prise en compte de celles-ci dans les effectifs », serait également rendu.

Madame Gonthier-Maurin, la multiplication de demandes de rapports annuels dans un même amendement, ainsi que vous le proposez, ne nous paraît pas constituer une bonne méthode de contrôle de l’action du Gouvernement, d’autant moins bonne qu’aucun dispositif ne viendrait en sanctionner les conclusions.
Il vaut mieux utiliser les structures d’évaluation existantes, comme le comité de suivi, prévu à l’article 60, les organes de contrôle de l’application des lois du Parlement et le conseil national d’évaluation du système éducatif créé par l’article 21.
Votre demande lui semblant satisfaite par ce qui existe déjà, la commission vous invite à retirer votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L’article L. 321-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « et résolution de problèmes » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :
« Elle dispense les éléments d’une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts plastiques et musicaux. Elle assure l’enseignement d’une langue vivante étrangère et une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l’acquisition et la compréhension de l’exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences, mais aussi de l’égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l’éducation morale et civique, qui comprend, pour permettre l’exercice de la citoyenneté, l’apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l’Union Européenne, notamment de l’hymne national et de son histoire. »

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, cet article 31 vise à accompagner les nouvelles organisations pédagogiques et à répondre au défi de l’enseignement pour tous.
Toutefois, les enseignants d’éducation physique et sportive, ou EPS, se sentent exclus de ce changement. Ils sont 33 000 professeurs à enseigner cette discipline, soit environ 300 par département.
Ils s’inquiètent pour l’avenir de leur discipline, déjà mise à mal par le socle commun de la loi Fillon sur l’éducation dans lequel elle était seulement considérée comme préparatoire ou complémentaire aux autres matières dites fondamentales. Dans ce socle commun, par exemple, le seul savoir moteur inscrit était la notion de « savoir nager ».
De plus, la mise en place de ce projet s’est traduite par l’exigence de voir les collectivités locales prendre en charge la formation sportive, renforçant de fait les inégalités sur le territoire.
Dans cet article 31, la redéfinition du socle commun est abordée, soulevant directement la question de la place et de la fonction de l’EPS dans l’école. L’éventualité d’un déplacement de l’enseignement sportif vers la fin d’après-midi paraît contraire à la volonté de construire une école forte, formatrice et structurée afin de favoriser la réussite de tous les élèves, tant le sport est un tremplin exceptionnel pour l’ensemble des disciplines. Il semble donc indispensable de réaffirmer la prépondérance de l’apprentissage des activités physiques dans la formation des élèves.
Mme la ministre des sports vient d’ailleurs récemment de témoigner, dans un entretien au journal 20 minutes, du « besoin » impératif pour le sport « d’être au rendez-vous de l’école ». L’EPS participe, comme les autres matières, au développement et à l’équilibre des jeunes dans le champ scolaire. Il est impératif de lui redonner une place valorisée au sein du système éducatif, sous la forme, par exemple, d’une augmentation des horaires, d’une extension des dispositifs comme les sections sportives et les options, ou bien encore d’une dynamisation du sport scolaire.
Par ailleurs, notre patrimoine de culture physique et sportive est composé d’un nombre important de pratiques. Le législateur a proposé plusieurs types de classement de ces APSA, les activités physiques, sportives et artistiques, mais la classification imposée en EPS depuis 2010 apparaît comme incohérente à la fois pour les enseignants, les élèves et les parents.
Il est impérieux de redonner tout son sens à l’enseignement du sport qui, au-delà de la simple dépense physique, participe bien à la mixité sociale et à la réussite de tous. Je le redis, la réussite de l’élève en sport se traduit bien souvent par un bond dans l’acquisition des savoirs fondamentaux et une motivation nouvelle à cet égard.
Le sport est, au même titre que les activités artistiques, un levier efficace pour acquérir de la confiance en soi. Il est donc temps de redonner à l’enseignement de l’EPS une place réaffirmée et essentielle dans l’école de demain.

Chaque loi sur l’école mentionne l’hymne national ou veut le faire apprendre. Je souhaite, sans prendre beaucoup de votre temps, partager avec vous mon émotion sur ce sujet.
Notre hymne contient cette fameuse phrase : « qu’un sang impur abreuve nos sillons ». Il nous faut tout de même réfléchir au fait que cette phrase est vraiment porteur de messages d’un autre âge : hors du contexte révolutionnaire, ce « sang impur » qui véhiculerait quelque chose est une hérésie scientifique, un appel à la xénophobie – qu’est ce que c’est qu’un « sang impur » ? et à la violence sanguinaire. De récents événements ayant occupé les écrans de tous les médias nous prouvent bien l’actualité du sujet.
Je rêve d’un jour où nous sera proposé un nouveau vers afin de remplacer l’actuel, lourd d’un doute affreux.
Devons-nous transmettre cette phrase ? Devons-nous la faire répéter par les enfants ? Avons-nous vraiment cette ambition ?
Je n’ai pas déposé sur ce point d’amendement, car ce chantier dépasse bien cet hémicycle ; mais, monsieur le ministre, le texte prévoit que la formation primaire assure « l’apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l’Union Européenne, notamment de l’hymne national et de son histoire », et je m’en félicite. Ainsi, les enseignants auront l’opportunité de replacer cette phrase dans son contexte, de manière qu’elle ne soit pas prise au premier degré. §

Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 150 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Primas, MM. Humbert et B. Fournier, Mmes Mélot et Duchêne et M. Duvernois, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 321-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-3. - La formation primaire dispensée dans les écoles élémentaires suit un programme unique réparti sur les cycles mentionnés à l'article L. 311-1 ; la période initiale peut être organisée sur une durée variable.
« Cette formation assure l'acquisition des instruments fondamentaux de la connaissance : expression orale ou écrite, lecture, calcul et résolution de problème. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et offre un enseignement d'éducation civique qui comporte obligatoirement l'apprentissage de l'hymne national et de son histoire. »
La parole est à Mme Marie-Annick Duchêne.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, la France voit ses résultats baisser continuellement en lecture depuis plus de deux décennies. Aujourd’hui, ce sont 40 % des élèves français qui ne savent pas bien lire ou compter lors de leur entrée au collège. Et 20 % des élèves français, faute de maîtriser les savoirs fondamentaux, sortent du système éducatif sans aucun diplôme. Nous savons combien vous vous battez pour résoudre ces problèmes, vous qui occupez à votre tour des fonctions ministérielles.
Jean-Claude Carle, premier signataire de cet amendement, souhaite que la représentation nationale puisse tirer la sonnette d’alarme en instaurant, par la loi, la nécessité de dédier plus encore qu’aujourd’hui l’enseignement du premier degré tout entier à l’apprentissage des savoirs fondamentaux – lecture, écriture et calcul –, en affirmant que leur maîtrise est « la base de tout », ainsi que l’écrivait Charles Péguy.
Nous sommes totalement en accord avec notre collègue Michel Le Scouarnec quant à l’importance que peut revêtir la pratique du sport pour le développement personnel de l’enfant et la confiance en soi de l’élève. Cependant, nous savons également que le cycle des apprentissages fondamentaux est le terreau de la construction des inégalités scolaires et que l’école ne permet pas de réduire les difficultés repérées au début de la scolarité.

L'amendement n° 123, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Après le mot :
plastiques
insérer le mot :
, visuels
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Dans le document d’application des nouveaux programmes concernant Les arts à l’école primaire, le ministère de la jeunesse, de l’éducation et de la recherche définissait, en 2002, « une liste d’œuvres de référence pour les arts visuels et l’écoute musicale ». C’était la première référence aux arts visuels dans des programmes officiels en remplacement de la seule référence à la discipline des arts plastiques. Cela a constitué une ouverture majeure du champ des enseignements artistiques à l’école.
S’agissant des arts visuels, il était fait état de la diversité des expressions artistiques : architecture, cinéma, dessin, peinture et compositions plastiques, photographie, sculpture et vitrail.
Les conseillers pédagogiques en arts plastiques sont dès lors devenus des conseillers en arts visuels.
Nous devons absolument encourager le développement des enseignements aux arts visuels et musicaux de telle façon qu’ils soient bien inscrits dans le temps scolaire et dispensés à l’école. C’est l’objet de notre amendement n° 123.
L’opération « École et cinéma », par exemple, lancée en 1994, ouvre les portes du cinéma aux jeunes enfants dans le cadre d’un parcours scolaire. Celui-ci fait ainsi découvrir en salle de cinéma des films de qualité à de jeunes spectateurs et à leurs enseignants, de la grande section de maternelle à la fin du cycle élémentaire. Ce dispositif permet donc de lier le cinéma à l’école avec deux objectifs : d’une part, inciter les enfants à prendre le chemin de la salle de cinéma et à s’approprier ce lieu de pratique culturelle, de partage, de lien social ; d’autre part, initier une réelle approche du cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer.
Cette opération de grande qualité prend place dans le temps scolaire et dans le cadre de l’enseignement des arts visuels, mais pas dans celui des arts plastiques.
Voilà donc une illustration de la nécessité, onze ans après son introduction dans les programmes officiels, d’inscrire dans le code de l’éducation la référence à l’enseignement des arts visuels en lieu et place des seuls arts plastiques, plus réducteurs.
Madame la présidente, je rectifie mon amendement afin de remplacer les mots : « plastiques et musicaux » par les mots : « visuels et arts musicaux »

Je suis donc saisi d’un amendement n° 123 rectifié, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Le Scouarnec, P. Laurent et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et ainsi libellé :
Alinéa 6, deuxième phrase
Remplacer les mots :
plastiques et musicaux
par les mots :
visuels et arts musicaux
L'amendement n° 534, présenté par Mme Cartron, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Après le mot :
et
insérer les mots :
elle peut comporter
La parole est à Mme la rapporteur.

Cet amendement vise à préciser que l’initiation à la diversité linguistique est facultative.

L'amendement n° 180, présenté par M. Dantec, Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6, troisième phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, dont les langues régionales
La parole est à M. André Gattolin.

Cet amendement s’inscrit, je le dis avec sincérité et avec une profonde émotion, dans le droit-fil de la reconnaissance des langues régionales intervenue hier soir, avec le vote de l’article 27 bis. Ceux d’entre nous qui ont eu le temps de lire, ce matin, la presse régionale électronique ont dû se rendre compte que notre débat a fait écho dans nos territoires.
À cet égard, nous ne pouvons que saluer l’intelligence collective, la culture commune de notre assemblée, qui, dans sa diversité, a voté, à l’unanimité des présents, me semble-t-il, en faveur de l’enseignement des langues régionales.
Il faut aussi reconnaître que M. le ministre a fait preuve d’intelligence, en comprenant que nous voulions aller plus loin que l'Assemblée nationale en la matière.
Dans cette logique, nous proposons de modifier la troisième phrase de l’alinéa 6 de l’article 31, qui vise lui-même à modifier l’article L. 321-3 du code de l’éducation, en précisant que la formation primaire « assure l’enseignement d’une langue vivante étrangère et une initiation à la diversité linguistique, dont les langues régionales ». Nous voulons ainsi répéter notre attachement aux langues régionales.
Il s’agit d’un amendement d’insistance, monsieur le ministre. Nous ne mourrons pas pour cet amendement ; notre sang riche n’abreuvera pas les sillons de l’éducation nationale !
Sourires.

L'amendement n° 176, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 6, cinquième phrase
Remplacer les mots :
, mais aussi de l'égalité entre les femmes et les hommes
par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure les conditions de l'éducation à l'égalité de genre.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Je vais essayer d’aborder avec calme cette question, qui fait parfois l’objet d’interprétations erronées, notamment dans le contexte que nous connaissons.
Afin de veiller à ce que l’enseignement dispensé, non seulement intègre l’égalité entre les femmes et les hommes, mais assure aussi les conditions de l’éducation à l’égalité de genre, nous aimerions modifier la cinquième phrase de l’alinéa 6 de l’article 31.
Permettez-moi de vous expliquer ce que nous entendons par là.
Vous le savez, un enfant sur 100 naît avec une sexuation approximative. Jadis, on réglait le problème de manière très simple : on opérait à la naissance. Aujourd'hui, dès la petite enfance, il vit cette identité indéterminée à l’école.
Aussi, il importe de sensibiliser tous les enfants à cette question, en leur demandant de faire preuve de tolérance : ce n’est pas parce qu’un enfant n’a pas l’air totalement conforme à l’image que l’on a d’un garçon ou d’une fille qu’il n’est pas bien. D’ailleurs, j’invite tous nos collègues à lire la littérature médicale, qui aborde aujourd'hui différemment – c’est un point important – cette question.
Vous le savez très bien, les enfants attachent une grande importance aux apparences, et ils peuvent être rudes entre eux. Si un garçon, premier de la classe, a l’air un peu frêle, il sera traité de « pédé » et d’« intello » ; si une fille est un peu forte, elle sera traitée de « camionneur » ou de « gouinasse », alors que son apparence n’a aucun lien avec ses orientations sexuelles.
Nous voulons introduire la notion d’éducation à l’égalité de genre pour alerter les enfants sur le fait que les choses peuvent être parfois plus compliquées que les apparences. C’est cet objectif, et le seul, que nous avons ; nous ne visons là aucune théorie sulfureuse. D’ailleurs, en commission, nos collègues d’une autre sensibilité politique que la nôtre ont compris notre démarche.

L'amendement n° 219 rectifié, présenté par MM. Lenoir et Leleux, Mme Primas et M. Chauveau, est ainsi libellé :
Alinéa 6
1° Dernière phrase
Supprimer les mots :
, notamment de l’hymne national et de son histoire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle assure obligatoirement l’apprentissage de l’hymne national et de son histoire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur ces amendements en discussion commune ?

L’amendement n° 150 rectifié vise à concentrer les apprentissages autour de la lecture, du calcul et de la morale, ce qui est réducteur de l’enseignement dispensé à l’école primaire. Une séquence d’éducation artistique, d’histoire ou de géographie participe aussi à l’ambition de maîtrise de la lecture et de la compréhension de l’écrit.
En conséquence, la commission est défavorable à cet amendement.
La commission est favorable à l’amendement n° 123 rectifié.
L’amendement n° 534 vise à préciser, je le répète, que l’initiation à la diversité linguistique est facultative et non pas obligatoire.
Comme l’a relevé notre collègue André Gattolin, nous avons très bien travaillé et avancé hier soir sur la question de l’enseignement des langues régionales. C’est pourquoi je lui demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 180.
Pour ce qui concerne l’amendement n° 176, la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur tous les amendements en discussion commune et est favorable à l’amendement n° 534 de la commission.
Permettez-moi de revenir sur l’amendement n° 176 présenté par Mme Bouchoux.
Il convient de lever le malaise actuel ; il ne faut pas faire comme s’il n’existait pas.
L’identité de genre est introduite dans nombre de textes internationaux, en étant reconnue comme une notion commune, sans s’apparenter pour autant à ce que l’on appelle la théorie du genre, soutenue par un certain nombre de personnes qui vont jusqu’à nier des différences qui sont de l’ordre non pas des représentations culturelles, mais des identités physiologiques et biologiques.
Notre pays est ainsi fait : lorsque cette notion a été introduite, certains ont fait exprès, a fortiori dans le climat que nous connaissons actuellement avec le mariage pour tous, de faire croire que la majorité avait la volonté d’imposer la théorie du genre à l’école.
J’ai considéré qu’il était de ma responsabilité, quelle que soit la sympathie que je peux avoir pour le sens commun de cette notion, de ne pas alimenter ces polémiques malsaines, qui dégradent le débat sur l’école.
Comme vous le savez, madame la sénatrice, nous partageons profondément l’objectif de lutte contre les discriminations et contre l’homophobie. Pour la première fois, mon ministère mène actuellement une action spécifique pour favoriser l’égalité entre les filles et les garçons.
Je souhaite que l’on en reste là. Sinon, je vous le dis, les dispositions positives que contient ce projet de loi risquent malheureusement d’être passées sous silence. On essaiera de mener un débat idéologique malsain qui déchaînera de mauvaises passions.
Telle est la raison – mais elle est très profonde – qui me conduit à vous demander, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.

J’ai bien entendu les propos de M. le ministre, et j’accepte de retirer mon amendement.
Toutefois, j’aimerais que, dans l’année qui vient, deux sénateurs de sensibilité très différente engagent, dans le cadre peut-être de la commission sénatoriale pour le contrôle de l’application des lois, un travail pour voir, de façon précise, sur le terrain, la manière dont peut être traitée la question des jeunes élèves scolarisés en primaire nés avec une identité sexuelle indéterminée, car ils sont en situation de souffrance extrême.
Je le répète, la pratique médicale a changé. Autrefois, ces enfants n’existaient pas puisque l’on décidait à la naissance, avec toutes les conséquences que cela pouvait avoir, qu’il s’agissait plutôt d’un garçon ou d’une fille. Aujourd’hui, avec la nouvelle approche médicale, il y a de plus en plus d’enfants concernés, dont le cas est méconnu du plus grand nombre, des parents des autres enfants, des enseignants.
Comme l’a relevé subtilement M. le ministre, quoi que l’on pense du mariage pour tous, la loi de la République est désormais votée et promulguée, et s’applique donc de fait.
Le débat sur cette question a été tout à fait courtois au Sénat. Mais, d’une manière générale, il a été musclé. Si les adultes gèrent cette situation paisiblement, n’oublions pas que des enfants ont dû entendre des choses difficiles, peut-être même traumatisantes, notamment sur ce que l’on peut croire possible ou pas pour les personnes homosexuelles.
Aussi, il importe d’engager un travail parlementaire sur le sujet pour voir de quelle manière l’enseignement peut prendre en compte l’éducation à l’égalité de genre.
Dans un souci d’apaisement – je ne veux pas créer de nouvelles polémiques, ni ici ni ailleurs ! –, je retire cet amendement auquel nous tenions beaucoup.
Je vous remercie très chaleureusement de la décision difficile que vous venez de prendre, madame la sénatrice, car les arguments que j’ai avancés relevaient plus du fait que du droit.
Je tiens à vous assurer que nous suivons cette question de très près. D’ailleurs, lorsque j’ai demandé aux adultes des deux camps de ne pas importer dans l’école le débat qui avait lieu à l’extérieur, cela m’a valu quelques critiques.
Dès le début du mois de décembre, on m’a alerté qu’un nombre beaucoup plus important d’enfants et de jeunes – j’ai des données chiffrées – étaient en souffrance cette année. Aussi serait-il en effet utile que la représentation nationale, en liaison avec le Gouvernement, suive de très près cette question dans l’année qui vient.
Les débats qui ont eu lieu dans la société, avec le déchaînement d’un certain nombre de propos, ont conduit à une recrudescence de la souffrance chez ceux qui, à un moment ô combien difficile de leur existence, l’adolescence, ont à se déterminer quant à leur identité sexuelle. Il ne faut pas laisser la situation en l’état. Notre rôle, quelles que soient nos opinions politiques et nos orientations, est de protéger les enfants en toutes circonstances.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC, du groupe écologiste et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Mme Bouchoux a vraiment eu raison de provoquer ce débat. Personnellement, j’avais été émue lorsque nous avions examiné cet amendement en commission.
M. le ministre a eu raison de souligner avec force l’instrumentalisation du débat et la confusion qui a été alors orchestrée.
Parler de l’éducation à l’égalité de genre, c’est aussi chercher à connaître les raisons profondes qui conduisent aux inégalités qui perdurent, malheureusement, dans notre société. Ce débat est essentiel. Il est nécessaire de prendre des engagements. Nous devons contribuer à démonter entièrement la théorisation à propos du genre.
L'article 31 est adopté.
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 321-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies d’outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l’enseignement de l’expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieu principalement créolophone. »

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 387, présenté par MM. Patient, Antiste, Antoinette et Cornano, Mme Claireaux et MM. Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Tuheiava, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et plus spécifiquement pour l'académie de Guyane, des milieux amérindiens, bushinengue et hmong
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 319 rectifié, présenté par MM. Antoinette, Antiste, Desplan, J. Gillot, S. Larcher, Patient et Tuheiava, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
ou amérindien
La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

Dans les académies d’outre-mer, les approches pédagogiques spécifiques prévues par l’article 31 bis au profit des élèves issus de milieux créolophones doivent, pour ce qui concerne la région Guyane, être impérativement élargies aux langues amérindiennes.
Par anticipation, je remercie la commission de l’avis favorable qu’elle a émis sur cet amendement, qui vise à distinguer les langues endémiques et les autres.
Je rappelle que, dans certaines régions de la Guyane, seules les langues amérindiennes sont pratiquées, le français n’étant parlé qu’à l’école.
Les langues amérindiennes, millénaires, et les langues créoles de la Guyane, séculaires, ont la particularité d’être apparues et de s’être développées dans le contexte historique et social évolutif de ce territoire. Langues endémiques, elles connaissent à notre époque une expansion considérable de leurs locuteurs. En outre, leur enseignement a fait l’objet, dans ses objectifs et dans ses méthodes, d’investigations validées par les unités de formation et de recherche de l’enseignement supérieur de l’éducation nationale. À ce titre, elles ont vocation à bénéficier du statut de langue régionale.

L’amendement n° 319 rectifié vise à compléter l’alinéa 2 de l’article 31 bis par un terme sociolinguistique permettant de couvrir, au-delà des catégories typologiques strictes, les populations bushinenge et tupi-guarani. La commission y est favorable.
Je tiens à souligner que ce qui existe déjà sur le terrain est assez remarquable. Monsieur Antoinette, lorsque nous avons visité ensemble des maternelles sur le fleuve, nous avons observé comment, avec l’aide d’auxiliaires issus des populations, on parvenait à prendre en compte les langues régionales, qu’elles soient amérindiennes ou bushinenge, dans l’apprentissage du français.
Il n’est peut-être pas indispensable qu’une disposition soit introduite dans le projet de loi, mais c’est votre souhait et je pense qu’il est bon de reconnaître la manière tout à fait subtile et intéressante dont, sur le terrain, les langues régionales sont déjà prises en compte.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 31 bis est adopté.
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7. – L’orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l’économie et de l’aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d’élaborer son projet d’orientation scolaire et professionnelle et d’éclairer ses choix d’orientation, un parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 313-1 sont supprimés.

L'amendement n° 218, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Jacques Legendre.

Nous demandons la suppression de la seconde phrase de l’alinéa 3 de l’article 32 A, que nous trouvons un peu curieuse. Qu’il faille indiquer aux jeunes que certaines filières ne sont pas exclusivement réservées aux hommes ou aux femmes et casser les stéréotypes sur les professions, nous en sommes bien d’accord. En revanche, introduire une certaine autolimitation dans les choix des jeunes de manière à favoriser la mixité dans toutes les voies professionnelles nous paraît un peu excessif.

Monsieur Legendre, vous savez que nous sommes nombreuses et nombreux à être attachés à l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes.

C’est parce que nous tenons beaucoup à cet objectif que nous sommes très ambitieux. Dans la mesure où, selon nous, la suppression que vous proposez affaiblirait cette ambition, j’émets un avis défavorable sur votre amendement.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 162 rectifié, présenté par MM. Antiste, Antoinette, Cornano, S. Larcher, Desplan et Patient, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il est créé dans chaque établissement scolaire du second degré un conseil d’orientation présidé par le chef d’établissement dont la composition est fixée par décret. Le conseil d’orientation est chargé de fournir l’ensemble des informations destinées à faciliter le choix d’un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d’éducation qui y conduisent. »
II. – Alinéa 5
1° Seconde phrase
Compléter cette phrase par le mot :
individualisé
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Chaque élève dispose d’un dossier individualisé spécifique qui mentionne son projet de formation ainsi que les résultats scolaires accordés à ce projet.
La parole est à M. Félix Desplan.

Je présente cet amendement en remplacement de M. Antiste.
Nous proposons la création d’un conseil d’orientation dans chaque établissement scolaire du second degré afin de faciliter le choix par chaque élève d’un avenir professionnel, ainsi que de la voie et de la méthode d’éducation qui y conduisent.
La création d’un nouveau dossier scolaire individualisé présentant le projet de formation de l’élève, ainsi que ses résultats scolaires ordonnés autour de ce projet, devrait, au même titre que le partenariat avec les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations, contribuer au succès de la mise en œuvre d’un parcours individuel de formation organisé autour du choix professionnel de l’élève.

L'amendement n° 124, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ce parcours est défini sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’aide des parents par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres membres de la communauté éducative qui peuvent s’appuyer sur les centres d’information et d’orientation. Ces personnels en assurent la mise en œuvre à laquelle peuvent contribuer les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations. » ;
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Cet amendement vise à clarifier la mise en œuvre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel proposé aux élèves du second degré.
Il ne s’agit pas du premier parcours de ce genre à être mis en place. En 2009, en effet, le parcours de découverte des métiers et des formations, le PDMF, a été créé pour permettre aux élèves d’acquérir la compétence de s’orienter. Dans ce cadre, de véritables cours sont dispensés par les enseignants, de la cinquième à la terminale, mais sans que ceux-ci aient reçu une formation. Le PDMF procède d’une conception dans laquelle l’orientation est systématiquement rabattue sur l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi.
Par ailleurs, depuis la circulaire du 31 juillet 1996 sur la mise en œuvre de l’expérimentation sur l’éducation à l’orientation au collège, trois axes sont fixés : améliorer la connaissance des métiers, des formations et de soi. L’idée sous-jacente est que le choix d’orientation correspond à un ajustement de profils. Or comment ajuster les deux espaces mouvants que sont l’adolescent et l’évolution des métiers ?
De plus, la notion de connaissance de soi présuppose chez les jeunes une personnalité déjà affirmée, alors qu’au collège la question se pose davantage en termes de développement et d’émancipation par rapport aux déterminismes sociaux, culturels et familiaux.
Selon nous, la définition du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel relève bien du métier des conseillers d’orientation-psychologues ; ceux-ci, en lien avec les parents, les enseignants et les autres membres de la communauté éducative, doivent participer pleinement à la définition et à la mise en œuvre de ce parcours. Quant aux administrations concernées, aux collectivités territoriales, aux organisations professionnelles, aux entreprises et aux associations, notre amendement prévoit qu’elles peuvent contribuer à sa mise en œuvre.

L'amendement n° 271 rectifié, présenté par Mme Laborde et MM. Alfonsi, Barbier, Baylet, Bertrand, C. Bourquin, Collin, Collombat, Fortassin, Hue, Mazars, Mézard, Plancade, Requier, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première phrase
Remplacer les mots :
des parents
par les mots :
de l'élève et de ses parents ou de son responsable légal
La parole est à Mme Françoise Laborde.

Nous sommes persuadés que l’orientation qui a le plus de chances de réussir est l’orientation choisie par l’élève. C’est pourquoi nous pensons que l’élève doit pouvoir participer à la définition de son parcours individuel d’information et d’orientation et jouer un rôle actif dans l’ensemble du processus.
Bien sûr, tous les acteurs qui contribuent à l’élaboration de ce parcours – parents, enseignants, personnels d’orientation, professionnels compétents – agissent dans l’intérêt de l’enfant ou de l’adolescent. Seulement, en réalité, ils ne tiennent pas forcément compte de ses aspirations et la place des résultats scolaires dans la définition du parcours de l’élève est souvent excessive.
C’est pourquoi nous souhaitons que le parcours individuel d’information et d’orientation ne soit pas uniquement proposé à l’élève lorsqu’il est achevé. Selon nous, l’élève doit pouvoir à tout moment exprimer son sentiment au sujet de ce projet et celui-ci doit pouvoir évoluer tout au long de sa scolarité.
Modifiée par notre amendement, la première phrase de l’alinéa 5, qui porte sur le projet d’orientation, s’établirait ainsi : « il est défini sous la responsabilité du chef d’établissement et avec l’aide de l’élève et de ses parents ou de son responsable légal par les conseillers d’orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. »

En ce qui concerne l’amendement de M. Antiste, si l’idée de préparer en amont les choix d’orientation et d’accompagner les élèves et les parents nous semble évidemment excellente, nous nous demandons s’il est bien nécessaire de créer une structure ad hoc dans chaque établissement public local d’enseignement. Dans la mesure où le conseil de classe et les centres d’information et d’orientation assument déjà ce genre de missions, une structure supplémentaire ne nous apparaît pas comme le gage évident d’une meilleure efficacité. Aussi, monsieur Desplan, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 162 rectifié.
L’amendement de Mme Gonthier-Maurin pose un problème légistique car les centres d’information et d’orientation figurent sous une autre forme dans le code de l’éducation ; l’amendement devrait viser ces dispositions pour être opérant. Sur le fond, je rappelle que ces centres n’ont pas de compétence pour la mise en œuvre des parcours de découverte, qui doit dépendre des établissements scolaires : ils ont un rôle d’information et de conseil et sont intrinsèquement incapables de prendre en compte la scolarité des jeunes et d’organiser des stages. En conséquence, monsieur Le Scouarnec, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° 124 ; si vous le maintenez, l’avis de la commission sera défavorable.
Madame Laborde, votre amendement étant satisfait par le droit en vigueur, je vous demande également de bien vouloir le retirer.
Les avis du Gouvernement sur ces trois amendements sont identiques à ceux de la commission.
Je tiens à préciser davantage notre pensée au sujet de ce parcours. J’ai dit tout à l’heure qu’il était utile de transmettre des valeurs, ce qui est l’objet de l’enseignement moral et civique. Je considère aussi qu’il est de la responsabilité de l’école de garantir l’insertion professionnelle des jeunes ; c’est un aspect dont on n’a pas suffisamment tenu compte.
Songez, mesdames, messieurs les sénateurs, que 25 % de notre jeunesse est au chômage et que, chaque année, 150 000 jeunes décrochent ! Nous menons souvent des débats très théoriques sans nous soucier suffisamment des causes de ces échecs, surtout en ce qui concerne les jeunes issus des milieux les plus modestes. Vous connaissez aussi la corrélation tout à fait exceptionnelle qui existe dans notre pays entre, d’une part, les études et les diplômes et, d’autre part, l’insertion professionnelle.
Nous estimons que, parmi les facteurs bien analysés de l’échec scolaire et du décrochage, il y a l’orientation, dont on constate qu’elle est souvent négative, entraînant très rapidement un décrochage.
Quand on considère les autres systèmes éducatifs, en particulier ceux qui obtiennent des résultats meilleurs que les nôtres de ce point de vue, on remarque que, dans la formation même des enseignants, l’idée est présente que l’orientation est une dimension fondamentale de la pédagogie et de la relation pédagogique.
C’est pourquoi j’ai voulu que ce parcours soit mis en place dès la sixième, qu’il soit obligatoire et que sa définition fasse intervenir des acteurs qui n’ont pas l’habitude de collaborer : les conseillers d’orientation-psychologues, qu’il est inutile de chercher à critiquer – ils ont leur rôle et nous les confortons –, mais aussi les professeurs, les responsables de la vie de l’établissement et, à l’extérieur de l’école, les entreprises et les professionnels. Loin d’être les ennemis de l’école, ceux-là doivent permettre aux élèves de réussir !
Quand on vient d’un milieu favorisé, il est beaucoup plus facile de trouver un stage de troisième ! Finalement, derrière des discours parfois très idéologiques de méfiance à l’égard de l’entreprise, nous laissons perdurer certaines inégalités. Ceux qui, par leur famille, ont accès à l’information et à l’orientation profitent des dispositifs existants ; tel n’est pas le cas des autres.
J’ai noté d’ailleurs que, dans la plupart des grands lycées de centre-ville, comme dans les grandes écoles, on organise le soir, pour les élèves, un certain nombre de rencontres, au cours desquelles certains parents d’élèves sont invités à venir expliquer leur métier et le fonctionnement de l’entreprise.
Ces rencontres ne sont pas organisées dans les établissements plus éloignés des centres-villes, sous prétexte que cela reviendrait à faire entrer l’entreprise dans l’école.
Une telle situation est selon moi injuste. L’école est puissante, forte, fière de ses valeurs. Elle peut tout à fait assumer ce type de dialogue, pour que les enfants puissent construire positivement leur orientation. Comment y parvenir en ignorant les formations offertes et les métiers existants ?
Ce parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel, que vous allez, je n’en doute pas, voter dans un instant, mesdames, messieurs les sénateurs, est un élément très important de la refondation de l’école, et surtout de la lutte contre l’échec scolaire et le chômage des jeunes qui gangrènent notre pays.

L’amendement n° 162 rectifié est retiré.
L’amendement n° 124 est-il maintenu, monsieur Le Scouarnec ?

L’amendement n° 124 est retiré.
L’amendement n° 271 rectifié est-il maintenu, madame Laborde ?

Je le maintiens, madame la présidente, malgré tous les arguments que je viens d’entendre en faveur de son retrait.
S’il s’agit bien de viser le projet du jeune, et non celui de ses parents ou du chef d’établissement, il me semble que l’insertion du terme « élève » s’impose dans l’alinéa 5 de l’article 32 A.

La parole est à M. Jacques Legendre, pour explication de vote sur l'amendement n° 271 rectifié.

Il s’agit bien évidemment d’un débat important. Ayant écouté attentivement vos propos, monsieur le ministre, j’ai l’impression que vous chargez l’école d’une responsabilité qui va bien au-delà de ce qu’elle peut accomplir, ou garantir, en matière d’insertion.
Au demeurant, je vous remercie de souligner l’importance de l’insertion. Je rappelle toutefois que celle-ci ne peut se faire que si l’activité économique du pays permet d’offrir des emplois sains, stables et durables. Or cette condition indispensable, l’école ne peut pas, bien évidemment, la mettre en œuvre. Mais vous avez raison de dire qu’elle doit contribuer à l’insertion, en assumant ses propres responsabilités en matière d’orientation et de formation.
Monsieur le ministre, n’écartez pas d’un revers de main le problème des conseillers d’orientation-psychologues ! Je n’ai rien contre eux, mais il semble que leur formation, dont ils ne sont en rien responsables, doit être revue. Dire ici, comme beaucoup d’hommes et de femmes de terrain, que de nombreux CIO ne remplissent pas avec efficacité la mission qu’on voudrait leur voir remplir, ce n’est pas s’en prendre aux personnels, c’est appeler à une amélioration.
Je tenais à le dire, nous ne pouvons pas nous contenter de créer des parcours d’orientation ! Il nous faudra revoir les choses de manière plus approfondie. Sur ce point aussi, monsieur le ministre, soyez réformateur !
Sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 32 A est adopté.
À titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l’éducation nationale, la procédure d’orientation prévue à l’article L. 331-8 du code de l’éducation peut être modifiée afin qu’après avoir fait l’objet d’une proposition du conseil de classe et au terme d’une concertation approfondie avec l’équipe éducative, la décision d’orientation revienne aux responsables légaux de l’élève ou à celui-ci lorsqu’il est majeur. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis aux commissions compétentes en matière d’éducation de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, cet article, inséré par notre rapporteure, soulève un débat intéressant en matière d’orientation. Il s’agit de procéder à une expérimentation sur trois ans, dont l’objet est de confier aux parents la décision d’orientation.
Un groupe de travail a, me semble-t-il, été installé par le ministère sur cette question et l’expérimentation sera bientôt lancée. L’idée de confier aux parents le choix de l’orientation de leur enfant en fin de troisième figure également dans le rapport de la Cour des comptes sur l’orientation en fin de collège. En effet, compte tenu du coût et de la lourdeur des procédures et des commissions d’appel pour ce qui concerne les décisions d’orientation, dans le cadre desquelles les parents obtiennent très souvent gain de cause, la Cour estime que le choix devrait être laissé aux parents.
Cependant, le choix de l’orientation n’est qu’un des critères de l’orientation en fin de troisième, l’élément déterminant, et même discriminant, pour la poursuite d’études étant la procédure d’affectation dans un établissement ou une formation. À cet égard, ce sont les autorités académiques qui décident, par le biais de la procédure AFFELNET – affectation des élèves par le net –, notamment en fonction des résultats scolaires, d’un jeu de bonus méconnu des familles non initiées et des places disponibles. C’est cet aspect qui compte le plus en matière d’orientation, loin devant le « choix d’orientation ».
Une autre expérimentation à mener serait donc de permettre aux familles, par exemple en vertu d’un principe de seconde chance, d’avoir davantage la main sur les affectations. Cela impliquerait un travail d’information préalable des familles sur les enjeux de l’affectation.
Sinon, on prend un double risque : d’une part, les déterminismes sociaux font que les familles des milieux populaires ont tendance à rabaisser leur ambition en matière d’orientation de leurs enfants ; d’autre part, le critère de la proximité de la formation par rapport au domicile, qui peut paraître mineur, devient paradoxalement prépondérant, notamment pour les filles, supplantant ainsi le critère du choix d’une formation ou d’un métier précis.
L’inconvénient serait également de donner de faux espoirs de maîtrise de l’orientation, en occultant le couperet de l’affectation. En effet, comme le souligne notamment la Cour des comptes dans son rapport, et contrairement à ce qu’imaginent les jeunes et les familles, le critère des résultats scolaires est particulièrement important pour obtenir une affectation dans la filière professionnelle, alors que le critère de la carte scolaire prédomine dans la filière générale.
Le taux d’abandon en voie professionnelle est en effet corrélé au fait que, compte tenu de l’offre de formation, nombre d’élèves échouent dans des filières ne correspondant tout simplement pas au projet de métier ayant motivé leur choix d’une voie professionnelle. Il s’agit d’un élément déterminant, qui devrait être mieux pris en compte dans l’élaboration des cartes de formation.

L'amendement n° 163 rectifié, présenté par MM. Antiste, Antoinette, Cornano, Desplan, S. Larcher et Patient, est ainsi libellé :
Première phrase
Après le mot :
classe
insérer les mots :
formulée après avoir recueilli l’avis du conseil d’orientation
La parole est à M. Félix Desplan.

L’école devrait aider les collégiens, d’une part, à définir leur projet de formation et, d’autre part, à le respecter au moment de leur affectation à l’issue du collège. L’orientation par défaut, qui nuit à la motivation et à la réussite des élèves, a d’ailleurs été dénoncée à de nombreuses reprises.
L’affectation dans une voie de formation, du fait de la rigidité des structures et des procédures, est souvent déconnectée des vœux et du profil de l’élève. L’école devrait prendre l’engagement de respecter le projet éclairé de l’élève.
C’est la raison pour laquelle l’amendement n° 162 rectifié tendait à créer un conseil d’orientation aux missions et à la composition élargies, qui aurait décidé de l’orientation et de l’affectation de l’élève, notamment en fonction de son projet, ainsi qu’un nouveau dossier scolaire individualisé, qui aurait consigné à la fois le projet de formation de l’élève et ses résultats, ordonnés autour de ce projet.
L’amendement n° 163 rectifié vise pour sa part à associer ce conseil d’orientation à l’expérimentation prévue par l’article 32 B.

Dans la mesure où l’amendement n° 162 rectifié a été retiré, je vous demande, mon cher collègue, de bien vouloir retirer également, par cohérence, l’amendement n° 163 rectifié.
Comme l’a dit Mme la rapporteur, nous sommes confrontés à un problème technique, l’amendement n° 162 rectifié, qui visait à créer un conseil d’orientation, ayant été retiré. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de faire de même pour ce qui concerne l’amendement n° 163 rectifié.
En revanche, sur le fond, je veux souligner, comme l’a fait Mme Cohen, l’importance de l’article 32 B, qui témoigne d’une préoccupation sur l’orientation identique à la vôtre.
Il est clair que, pour beaucoup de jeunes, l’orientation est un moment difficile. Pour les familles, il s’agit même parfois d’un moment d’humiliation. Nous le savons, le décrochage vient très souvent de ce que l’orientation proposée au jeune ne correspond pas à la vision qu’il a de lui-même et de son avenir.
Le fait que la commission propose, par cet article, conformément à ce que nous avions souhaité lors du Comité interministériel sur la jeunesse, de donner plus de poids à l’avis des parents et du jeune pour choisir l’orientation est extrêmement positif. L’élève et sa famille seront dorénavant mieux impliqués dans l’orientation, ce qui permettra d’éviter le découragement imputable à une orientation mal vécue.
Au demeurant, monsieur le sénateur, cette orientation me semble conforme à votre proposition.
L'article 32 B est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 332-1 du code de l’éducation est abrogé. –
Adopté.
(Non modifié)
Les deux premières phrases de l’article L. 332-2 du code de l’éducation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la continuité de l’école primaire et dans le cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. » –
Adopté.
L’article L. 332-3 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées :
« À chacun d’entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l’élaboration du projet d’orientation mentionné à l’article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés. » ;
2°
Supprimé
3° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les lycées professionnels et les établissements d’enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. »

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, je rappellerai tout d’abord que notre pays ne compte actuellement pas moins de 1, 9 million de jeunes de 15 à 29 ans qui ne sont ni à l’école ni à l’université, ne bénéficient pas d’une formation et n’ont pas intégré la vie professionnelle. Ils représentent 17 % de cette tranche d’âge !
Aujourd’hui, nous sommes tous d’accord sur ce point, la plus grande difficulté rencontrée par nos jeunes est leur insertion sur le marché du travail. Le niveau d’étude et l’obtention d’un diplôme professionnalisant sont la clé de leur réussite.
Or l’apprentissage et la formation professionnelle peuvent être une solution efficace. C’est pourquoi je ne comprends pas les nombreuses inquiétudes soulevées par cet enseignement. N’oublions pas qu’il s’agit bien d’un système éducatif s’appuyant sur l’acquisition du socle commun. L’apprentissage, c’est la transmission d’un métier, d’un savoir-faire et, souvent, d’une passion.
La sélection à l’entrée est stricte, la clé étant la motivation du jeune. L’apprentissage et la formation professionnelle ne sont ni un second choix ni un choix par défaut.
C’est pourquoi je ne suis pas en accord avec l’article 33 du présent projet de loi, notamment en ce qu’il ne permettra pas aux élèves de quatrième de se voir proposer des enseignements complémentaires préparant à des formations professionnelles.
Continuer d’offrir cette possibilité aux élèves au cours des deux dernières années du collège me semble primordial. Il s’agit d’un accompagnement, d’une chance supplémentaire, et en aucun cas d’une obligation !
Ce qui est essentiel, c’est que l’orientation soit choisie et non subie : elle doit permettre au jeune de s’insérer dans le monde du travail.
L’enseignement agricole en est le meilleur exemple. L’article 33, tel qu’il est rédigé, met d’ailleurs en danger les classes de quatrième de cet enseignement.
Monsieur le ministre, je crois que le Gouvernement a déposé un amendement visant à clarifier la situation en matière de stages. Ce problème semble donc réglé, et c’est l’essentiel. Je regrette cependant de n’avoir pas été entendue sur ce point en commission.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, nous consolidons le collège unique pour éviter les orientations précoces : l’ensemble des enquêtes internationales montrent que les systèmes scolaires qui réussissent le mieux et sont les plus égalitaires sont ceux qui possèdent le tronc commun le plus long.
L’introduction du socle commun aurait dû logiquement exiger que le collège mène l’ensemble d’une génération à le maîtriser. Ainsi Claude Lelièvre, historien de l’éducation, explique-t-il que le collège du socle commun ne peut plus être conçu pour quelques élèves, en fonction de son « aval, le lycée, mais pour tous, afin de délivrer ce bien fondamental qu’est l’instruction obligatoire ».
Tout au contraire, l’ancienne majorité n’a eu de cesse d’étendre les dispositifs dérogatoires aux exigences de l’obligation scolaire et au collège unique : je citerai, notamment, le dispositif d’initiation aux métiers en alternance – DIMA – ou la classe de troisième « prépa-pro ». Or, bien souvent, l’orientation précoce s’apparente à de la sélection précoce et, parfois, à de la sélection sociale qui ne dit pas son nom.
Mais « collège unique » ne signifie pas « collège uniforme ». Bien entendu, nous sommes favorables à des approches pédagogiques différenciées, tant qu’elles ne constituent pas des dispositifs d’éviction précoce, n’enferment pas dans une filière spécifique et ne sont pas contradictoires avec l’objectif de maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

L'amendement n° 220, présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jacques Legendre.

Nous proposons la suppression de l’article 33, c’est-à-dire le retour à la rédaction initiale de l’article L. 332-3 du code de l’éducation.
En effet l’article 33 comprend une dangereuse limitation du recours aux stages, qui pourtant n’émanent pas d’une demande des entreprises.
Selon nous, avec cette nouvelle rédaction, nombre d’élèves auront des difficultés à trouver un stage, qui leur permet pourtant d’avoir une première approche de la réalité de la vie et des métiers.
Alors que les stages sont déjà difficiles à trouver, ce n’est pas le moment d’encadrer davantage la procédure et ainsi de dissuader les jeunes d’y recourir.

La commission estime l’article 33 essentiel à la consolidation du collège unique et à la lutte contre les déterminismes sociaux lors de l’orientation vers la voie professionnelle. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable à cet amendement.

Va-t-on enfin écouter l’avis des hommes et des femmes de terrain, qui, dans le présent débat, sont préoccupés de voir l’idéologie prendre le pas sur les réalités de terrain ?
Attention, mes chers collègues ! Quand on veut maintenir trop longtemps au collège un jeune qui ne s’y sent pas à l’aise, il devient agressif à l’égard de l’institution scolaire, voire violent.

Cette remarque est partagée, me semble-t-il, par de nombreux collègues siégeant sur les différentes travées de cet hémicycle. À cet égard, nous avons tous entendu le témoignage de Mme la présidente de la région Poitou-Charentes, qui a tenu à s’exprimer pour rendre service au Gouvernement. Elle a affirmé que, pour des raisons idéologiques ou par manque de réflexion, un gouvernement ne peut pas supprimer des dispositifs très concrets qui permettent à des jeunes de s’en sortir et de ne pas sombrer dans la délinquance, l’abandon ou l’oisiveté. Nous aussi, nous voulons éviter cela. Je suis d’ailleurs heureux de constater que cette volonté n’anime pas uniquement l’actuelle opposition.
En bref, l’important, c’est que les jeunes, au moment opportun, puissent trouver une orientation qui leur permette de continuer à se former tout en se sentant bien et, surtout, de se préparer à un métier.
Telles sont les raisons pour lesquelles je tenais une fois encore à défendre l’amendement n° 220, qui nous paraît essentiel.

À mon tour, je voudrais insister sur le bienfait des stages, de la découverte de l’entreprise, de la prise de conscience que l’on peut travailler de façon différente qu’au collège.
Bien évidemment, je suis favorable au collège unique : il faut que tous les enfants de France soient scolarisés et puissent recevoir la même éducation jusqu’à seize ans, âge auquel cesse la scolarité obligatoire.
Pour ma part, j’ai enseigné en zone d’éducation prioritaire. Par expérience, je puis vous dire que lorsque des élèves s’ennuient en classe, sont déjà laissés au bord de la route parce qu’ils sont distancés par d’autres élèves et que les enseignants, qui doivent faire cours à l’ensemble de la classe, n’ont pas le temps de les prendre en considération, ils finissent par devenir une gêne pour les autres.

Il faut donc leur proposer autre chose. Loin de moi la volonté de les exclure, mais ils doivent pouvoir découvrir d’autres façons de travailler. Bien entendu, après avoir acquis une expérience de l’entreprise, ils pourront revenir en classe et se rendre compte qu’avec un peu de travail et de l’aide, ils arriveront à progresser et à choisir ensuite une autre orientation. C’est aussi cela le travail d’orientation : permettre aux jeunes de savoir qu’il existe autre chose et leur ouvrir les yeux.
En classe, les élèves ne se rendent pas compte qu’ils peuvent apprendre un métier. Or exercer un métier manuel, notamment, c’est très beau. En Allemagne, des stages sont organisés dans les banques, dans les compagnies d’assurance pour les élèves qui optent pour la filière professionnelle, et ce dès leur plus jeune âge.
Par conséquent, je souhaite que l’on prenne en considération les stages, qui sont très profitables à des enfants ayant besoin d’autre chose que de travail scolaire.
Pour ma part, je continue à penser que les élèves ont besoin de travail scolaire.
Au cours du présent débat, de nombreuses confusions ont été commises.
La première d’entre elles émane de la présidente de la région Poitou-Charentes. Il ressort de la lecture de ses déclarations largement relayées qu’elle considère que nous voulons abroger les dispositifs d’alternance bénéficiant aux jeunes âgés de quinze ans. Or tel n’est pas du tout le cas. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, ce sont les dispositifs applicables aux élèves âgés de moins de quinze ans qui sont concernés. Si, une fois encore, il n’y avait pas eu d’approximation intellectuelle, cette affirmation n’aurait pas été formulée. Quoi qu’il en soit, elle ne mérite pas d’être relayée.
Par ailleurs, l’une de nos préoccupations est de structurer avec les entreprises une offre de stages dans le parcours d’orientation. Or croyez-vous vraiment qu’elle existe en France ? Mais non !
À juste titre, vous m’avez fait observer que l’école ne pourra conduire à l’insertion dans la vie professionnelle qu’à la condition qu’il y ait de l’emploi. Depuis très longtemps, nous rencontrons la difficulté de structurer au sein des stages puis dans des lycées professionnels cette offre de formation pour les jeunes. Par le biais du travail que nous menons actuellement avec les branches et grâce au conseil que nous proposons de créer, nous essayons d’y parvenir.
Nous ne témoignons d’aucune hostilité en la matière, dès lors que n’est pas imposée une alternative entre le stage et l’élévation du niveau de scolarité mais que les deux cheminent ensemble, comme d’ailleurs les entreprises le demandent.
Pour autant, il ne faudrait pas que la logique de l’orientation précoce mise en œuvre et que je désavoue nous conduise à renoncer à la transformation du collège, qui est nécessaire.
Monsieur Magner, je vous remercie d’avoir expliqué notre vision du collège. Le cadre commun, qui fait la réussite des systèmes éducatifs qui fonctionnent, doit être le plus long possible. Mais le collège unique, ce n’est pas l’uniformité.
Nombreux sont ceux qui me demandent de revaloriser l’enseignement professionnel. Toutefois, dans le même temps, ils soutiennent qu’un élève qui ne peut pas suivre les enseignements généraux doit intégrer la filière professionnelle, laquelle est toujours considérée comme une voie de relégation et, par conséquent, dévalorisée.
On observe donc une contradiction : le choix positif de la filière professionnelle n’est pas un choix par défaut en raison de l’échec dans l’enseignement général. D’ailleurs, lorsque dans notre pays, qui véhicule des traditions très anciennes sur ce sujet, nous voudrons revaloriser la filière professionnelle, il faudra rapprocher les trois lycées. Il faudra faire comprendre que le choix de suivre les cours dans un lycée technologique ou professionnel ne revient pas à renoncer à la philosophie, aux langues étrangères, à l’histoire, car ces disciplines restent inscrites dans les parcours.
Vous m’avez reproché – quelle extravagance ! – de ne pas d’ores et déjà disposer de la réforme du collège et du lycée. Mais la précédente majorité vient de réaliser la réforme du lycée ! La moindre des sagesses pour un ministre de l’éducation qui engage déjà de profondes réformes était bien de laisser un peu de temps à la réforme du lycée qui s’achève cette année par la modification de la terminale et du baccalauréat, afin d’en apprécier les effets. L’une des idées des auteurs de la réforme engagée était de rapprocher les différentes sections et d’éviter la partition qui existe aujourd’hui entre les littéraires et les scientifiques, évidemment au détriment des premiers d’entre eux.
Nous allons évaluer plus finement cette réforme avec l’inspection générale, mais il ne semble toutefois pas que ce dernier objectif ait été réalisé. Par conséquent, il faudra y revenir.
Je serai très ferme : quand, d’un point de vue thérapeutique, le collège est en souffrance et pose des difficultés, il faut le réformer, certainement pas cependant en excluant les jeunes qui sont en difficulté, mais en le transformant pour que ceux-ci s’y sentent bien. Tel est l’objectif que nous devons nous fixer. Tous les élèves de France, qu’ils soient âgés de quatorze, quinze ou seize ans, doivent pouvoir suivre une scolarité obligatoire – c’est notre idée du socle – qui leur assure l’enseignement le plus complet et le plus long possible. Face aux grandes difficultés qu’éprouvent certains collèges comme certains jeunes, n’excluons pas les élèves, mais transformons le collège. C’est ce que nous allons vous proposer.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
L'amendement n'est pas adopté.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 74 rectifié, présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 332-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - Les collèges dispensent un enseignement commun, réparti sur quatre niveaux successifs. À chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Au cours des deux dernières années de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'État et accomplis auprès de professionnels agréés. Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. »
La parole est à Mme Françoise Férat.

Pour une plus grande cohérence, nous avons souhaité réécrire l’article 33 et ainsi conserver la possibilité donnée aux élèves au cours des deux dernières années de collège de se voir proposer des enseignements complémentaires qui les préparent à des formations professionnelles. Cela me semble primordial.
Par le biais de notre amendement, nous confirmons l’acquisition du socle commun comme un objectif de ces enseignements complémentaires. Cependant, la formation professionnelle ne doit pas être stigmatisée, mais doit pouvoir être proposée dès la classe de quatrième. Elle constitue une chance supplémentaire pour les élèves qui en font le choix.
Encore une fois, ce qui est essentiel, c’est que l’orientation soit choisie et non subie. L’enseignement agricole en est le meilleur exemple. Monsieur le ministre, je compte sur vous pour ne pas mettre en danger les classes de quatrième de l’enseignement agricole.
Je souhaite maintenant vous faire part de mon expérience non seulement d’élue locale, mais aussi d’épouse d’artisan. Pendant quarante ans, j’ai secondé mon mari et je peux vous dire que les apprentis n’étaient pas très nombreux. Ceux qui se sont présentés chez nous avaient, je n’ai pas peur de le dire, une réelle volonté de s’intégrer au monde professionnel, une réelle vocation. Ils souhaitaient suivre un stage non pas parce qu’ils ne pouvaient pas faire autre chose, mais parce qu’ils désiraient vraiment exercer ce métier.
Être artisan, ce n’est pas seulement avoir un savoir-faire. C’est aussi être un bon comptable, un bon gestionnaire, un bon représentant de commerce, un bon communicant. De grâce, cessons de mettre d’un côté l’éducation nationale et de l’autre l’enseignement technique, qui débouche sur des professions particulièrement intéressantes.
L’apprentissage est apparenté à une formation associant à la fois les cours dispensés à l’école et la vie professionnelle en entreprise. De ce fait, le contrat d’apprentissage n’est pas un contrat de travail au sens strict.
Un jeune sortant de troisième, qui aura quinze ans avant la fin de l’année civile – nous en reparlerons tout à l'heure – et qui a fait ce choix de la formation par apprentissage après avoir acquis le socle commun – j’y tiens beaucoup – est considéré comme scolarisé et poursuivant sa formation.
Je suis très attentive à vos propos, monsieur le ministre, et je les crois bien volontiers. Lors du débat parlementaire de la deuxième séance du mardi 19 mars à l’Assemblée nationale, vous déclariez : « Je maintiens le DIMA, le contrat d’apprentissage pour les quinze ans qui concerne 7 000 jeunes Français. Nous sommes absolument favorables à l’enseignement par apprentissage. » Vous avez donc vous-même employé le mot « enseignement » et non « contrat de travail ».

L'amendement n° 125, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
1° Remplacer les mots :
au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci
par le mot :
ils
2° Supprimer les mots :
préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas
La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

L’objectif de l’article 33 est de réaffirmer le principe du collège unique.
Il supprime ainsi les enseignements complémentaires qui peuvent actuellement être dispensés aux élèves des deux derniers niveaux du collège afin de préparer une formation professionnelle, enseignements qui s’accompagnent éventuellement de stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés.
La nouvelle rédaction qu’il prévoit pour l’article L. 332-3 du code de l’éducation introduit des enseignements complémentaires à chacun des quatre niveaux du collège.
Le principe du collège unique semble dès lors respecté. Je dis bien « semble », car la notion même d’enseignement complémentaire laisse supposer que ces derniers, s’ils sont dispensés à tous les niveaux, ne le sont pas à tous les élèves.
Quel est le but de ces enseignements complémentaires, leur contenu, le public qu’ils concernent ? Rien n’est précisé.
Mais surtout, dans un deuxième temps, l’article 33 réintroduit la possibilité de préparer les élèves à une formation professionnelle au cours de la dernière année de scolarité au collège, à travers ces enseignements complémentaires, le cas échéant complétés de stages contrôlés par l’État.
La réaffirmation du collège unique n’est pas assez forte et le maintien de cette préparation à la voie professionnelle, quand bien même elle n’aurait lieu qu’en dernière année de collège au lieu des deux dernières, n’est pas satisfaisant.
Avec cet amendement, qui vise à supprimer la mention d’une formation professionnelle en dernière année de collège, nous entendons donc réaffirmer le collège unique avec plus de force que ne le fait cet article.
Si la possibilité d’effectuer des stages demeure, nous souhaitons mentionner qu’ils peuvent être effectués par tous les élèves, à tous les niveaux. Ils ne correspondront donc plus à une orientation précoce.

L'amendement n° 435, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans les établissements d’enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l’État et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège.
La parole est à M. le ministre.
Il s’agit d’un amendement de précision qui vise à étendre l’application de l’article 33 à l’enseignement agricole.
Dans les établissements d’enseignement agricole, les élèves sont amenés à suivre des stages au cours des deux dernières années de collège du fait de la pédagogie spécifique mise en œuvre dans ces établissements.
Cet amendement, rédigé avec le ministère de l’agriculture et réclamé par les acteurs de l’enseignement agricole, permet d’adapter nos dispositions aux pratiques de ce secteur.

Madame Férat, nous sommes favorables à une consolidation du collège unique, mais il existe une vraie difficulté pour les classes de quatrième de l’enseignement agricole.
L’amendement que vient de présenter M. le ministre répond, me semble-t-il, à cette difficulté, et donc à vos préoccupations. Votre amendement étant satisfait, je vous demande donc de bien vouloir le retirer, madame la sénatrice.
Monsieur Le Scouarnec, vous nous avez présenté un bel amendement dont nous partageons l’ambition, celle d’une scolarité commune à tous les enfants. Ce faisant, vous réglez également la question de l’enseignement agricole en laissant ouverte la possibilité d’effectuer des stages en classe de quatrième. L’amendement du Gouvernement ayant précisément pour objet de résoudre ce problème, puis-je vous demander de retirer le vôtre, monsieur le sénateur ?
Enfin, vous aurez compris que nous sommes favorables à l’amendement n° 435 du Gouvernement.
Sourires.

J’aurais préféré que cet amendement soit le mien. Il est le vôtre, mais cela n’a aucune importance à partir du moment où ce problème est réglé.
Il s’agissait d’une réelle inquiétude pour l’ensemble des membres du groupe UDI-UC, plus particulièrement pour ma collègue Catherine Morin-Desailly et moi-même.
Ce problème étant écarté, je retire bien volontiers mon amendement pour voter le vôtre.

L'amendement n° 74 rectifié est retiré.
Monsieur Le Scouarnec, l'amendement n° 125 est-il maintenu ?
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l'article 33, modifié.
L'article 33 est adopté.
(Non modifié)
Le quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation est supprimé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.
L'amendement n° 221 est présenté par MM. Legendre, Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas, MM. Savin, Soilihi, Vendegou, Lenoir et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 75.

Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement de réécriture de l’article 33 dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Vouloir garder à tout prix un élève dans un parcours au sein duquel il ne s’épanouit pas, c’est prendre le risque qu’il décroche et quitte le milieu scolaire.
C’est pourquoi, avec mes collègues du groupe UDI-UC, il nous semble opportun de supprimer cet article afin que soient maintenus des aménagements particuliers permettant, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations, ainsi qu’une première formation professionnelle.

La parole est à M. Jacques Legendre, pour présenter l'amendement n° 221.

Nous sommes étonnés de voir le Gouvernement se montrer réticent – le mot est faible – au recours à l’alternance alors qu’il s’est pourtant engagé à le développer.
Cet article limite la possibilité offerte au jeune d’effectuer des stages lui permettant d’acquérir une expérience et, surtout, de s’orienter en connaissance de cause dans une voie professionnelle qu’il aura appréciée concrètement.
Je suis très profondément attaché à l’alternance, monsieur le ministre, et de longue date, puisque j’ai présenté au Parlement la première loi sur l’alternance en 1980.
Que n’a-t-on entendu à cette époque ! Nous étions soupçonnés de vouloir livrer une main-d’œuvre juvénile au grand patronat qui n’attendait sans doute que cela pour faire des bénéfices !
Sourires.

M. Jacques-Bernard Magner. Je m’en souviens, c’est moi qui ai dit cela !
Nouveaux sourires.

La réalité était tout autre ! Le premier frein à l’alternance résidait dans la conception que l’entreprise se faisait de son rôle dans le domaine de la formation. Elle souhaitait qu’on lui amène des travailleurs formés et ne voulait pas participer concrètement à l’effort de formation, en offrant par exemple une première expérience à ces jeunes ou une aide financière.
Les mentalités ont évolué. Toutefois, pour être parfaitement honnête, je dois dire que certains secteurs du patronat comprenaient leurs devoirs en ce domaine tandis que d’autres étaient beaucoup plus réticents…

Certaines ambiguïtés, mais pas seulement dans ce domaine, ont perduré.
Cette malheureuse loi a été abolie en 1981 comme étant une loi scélérate ! Elle a été reprise, à quelques inflexions près, par Michel Delebarre en 1983. Il s’en est souvent glorifié… Pour ma part, je salue le fait qu’il l’ait reprise et je ne vais pas lui intenter un procès en paternité.
Je crois que l’alternance, sous différents statuts – sous statut scolaire comme sous statut de contrat de travail de type particulier –, est un élément de la réponse aux problèmes que rencontrent certains jeunes actuellement.
Je ne voudrais donc surtout pas, à l’occasion de ce débat, que nous donnions à nouveau l’impression d’une petite hésitation en ce domaine. C’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.
Je voudrais évoquer un dernier point. Tout à l’heure, monsieur le ministre, dans votre réponse sur la situation de la région Poitou-Charentes, vous m’indiquiez qu’il y régnait une certaine confusion. Moi, je lis que la présidente de cette région…

… pratique l’apprentissage dès l’âge de quatorze ans. Je tenais à apporter cette précision, sous réserve, bien évidemment, de vérification sur place.

M. le ministre a été très clair et la commission partage son opinion. Avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 34 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 332-5 du code de l’éducation est complété par les mots : « ainsi qu’une éducation aux médias et à l’information ».

Le fait qu’aucun amendement n’ait été déposé sur cet article témoigne du consensus et de l’attention particulière qui nous rassemblent sur la nécessité de l’éducation aux médias, aujourd’hui acceptée, assimilée et devenue obligatoire au collège.
Toutefois, s’agissant d’une telle nouveauté, ce ne serait pas un bon signe que de ne pas débattre. Je vais donc tout de même dire un mot
Sourires.

Inscrire cette formation n’est que le début du processus. Comment allons-nous faire pour qu’elle soit effective ?
Nous savons que quelque chose qui est enseigné et qui n’est pas évalué risque parfois, avec toutes les contraintes d’enseignement et de discipline qui incombent à l’éducation nationale, de « passer à l’as », surtout s’il s’agit d’une nouveauté et qu’il faut développer des efforts particuliers pour pratiquer cet enseignement.
Par ailleurs, le fait que cet enseignement soit obligatoire au niveau du seul collège n’empêche pas de le dispenser, sous une forme ou une autre, dès le primaire, ni de l’articuler avec une nouvelle étape au lycée.
Je ne pense pas que l’on puisse aller plus loin dans la loi. La mise en pratique va être importante et intéressante, en particulier dans ce domaine. Je pense d’ailleurs que nous devrions, nous, parlementaires, assez rapidement – peut-être dans les six à dix mois suivant l’entrée en vigueur de ce texte – mener des évaluations sur les premières mises en pratique de cette disposition.
La question de l’éducation aux médias avait déjà été acceptée, notamment dans la loi de 2006. Cette mission entrait dans les attributions du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information, ou CLEMI.
Il s’agissait d’ailleurs d’une mission quasi militante et les moyens du CLEMI ont baissé de façon régulière alors que tout le monde déclarait que l’éducation aux médias était appelée à recouvrir de plus en plus d’importance.
Mon propos est donc aussi une adresse au ministre. Nous devons conforter cette mission du CLEMI – ce n’est pas la seule –, car il s’agit d’une mine, y compris en raison du travail et de l’expérience accumulés jusqu’à présent.
Personnellement, j’aurais été partisan de donner une application concrète à cette initiation obligatoire, qui n’est pas une discipline en tant que telle, en créant un module de dix-huit heures, par exemple, réparties sur un cycle, comme le collège, et dédiées à la réalisation d’un projet.
Réaliser un projet dans ce domaine, les médias, faire un reportage journalistique, tourner une vidéo, capter des images, permet d’allier la technique au contenu.
Faire de dix heures de rush trois minutes de film permet de comprendre que ces trois minutes ont été choisies de manière subjective. On saisit bien, alors, que ces quelques minutes que l’on voit sur internet ne sont pas la vérité révélée et ne relèvent pas de l’objectivité absolue.
À mon sens, donc, il faudra préciser, à un moment ou à un autre, ce que cette initiation obligatoire veut dire, et comment elle peut être évaluée, sans que cela soit une sanction.
Je tenais à souligner ce point devenu fondamental, il y a un hiatus entre ce que les jeunes reçoivent au quotidien devant leurs écrans, où ils passent plus de temps qu’en cours, et l’absence de médiation, y compris familiale, dont ils pâtissent. Cela requiert qu’un effort soit fait sur le regard critique et l’analyse à porter sur ces médias.
Toute l’école de Jules Ferry s’est construite à partir des textes, la connaissance du monde s’est faite par l’écrit, et la culture de l’éducation nationale est livresque. Passer au regard sur l’image, à l’analyse, aux techniques, à l’étude des textes spécialisés, c’est rentrer dans la fabrication de l’imaginaire et le cerveau de nos enfants. Ce n’est pas une mince affaire. C’est pourquoi je voulais insister sur ce point : ce n’est pas parce que le projet de loi contient cet article que ce qu’il instaure doit être perçu comme une évidence. Il va donc falloir beaucoup d’attention et de suivi.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste.

M. Assouline était fondé à intervenir sur un sujet pour lequel il avait rédigé un rapport, qui, je le rappelle, avait été adopté à l’unanimité par la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, en son temps.
Vous avez bien noté qu’il n’y a pas d’amendement sur l’article 35. L’éducation aux médias est, me semble-t-il, un sujet très important. Cela fait partie de la formation de l’esprit critique des futurs citoyens. Je tiens simplement à souligner qu’il y a consensus sur nos travées pour qu’il en soit ainsi.
Je rejoins M. Assouline pour dire qu’un module serait, en effet, le bienvenu.

Je tiens simplement à compléter ce qui vient d’être dit.
Je voudrais souligner que le groupe UDI-UC a eu à cœur, dans le cadre de cette réflexion sur l’éducation aux médias et aux nouvelles technologies, notamment numériques, de repenser le rôle du professeur documentaliste.

La commission, d’ailleurs, a adopté un amendement allant dans ce sens, la semaine dernière.
Je voulais attirer l’attention de M. le ministre sur ce point. Les professeurs documentalistes se posent vraiment beaucoup de questions sur leur rôle futur. Ils se demandent, notamment, comment ils peuvent s’insérer dans cette révolution numérique en cours, à l’heure où l’on bâtit un grand plan pour le numérique à l’école.
Si le rôle du maître est essentiel, peut-être plus que jamais, dans la formation à l’esprit critique et à la distanciation par rapport à l’information, le rôle du professeur documentaliste lui est tout à fait complémentaire. C’est bien, en définitive, une stratégie d’équipe qu’il faut construire au sein de l’établissement, pour répondre à cette exigence.

Je voudrais abonder dans le sens de ce qui vient d’être dit, et confirmer l’unanimité qui règne entre nos groupes sur cette question.
En tant que professionnel et universitaire, j’ai eu l’occasion de collaborer avec le CLEMI et de monter un grand nombre d’événements avec cette formidable cellule. Celle-ci compte, me semble-t-il, six salariés.
Au passage, et sans esprit de polémique, je tenais simplement à dire que la décision prise par un précédent gouvernement de couper dans le budget du CLEMI, qui s’inscrivait dans le cadre de la réduction du budget de l’éducation nationale, a eu pour conséquence le départ de deux des plus expérimentés et valeureux artisans du Centre. C’est vraiment dommage.
En tant que professionnel de la presse, ayant travaillé dans un grand quotidien, je me suis beaucoup attaché à cette éducation aux médias, notamment avec les salariés du CLEMI. Avec un autre sénateur, M. Pierre Laurent, lui aussi journaliste mais dans un autre quotidien que le mien, nous avons mené une expérience extraordinaire, en collaboration avec un enseignant d’histoire-géographie de Seine-Saint-Denis, qui, d’ailleurs, y a mis toute son énergie. L’idée était de faire produire un quotidien par des jeunes des banlieues, pendant cinq jours. Ils ont dû le fabriquer, le produire, et le diffuser. J’ai rencontré ces jeunes après l’expérience : ils étaient transformés. Leur vision de la citoyenneté et de l’information était métamorphosée.
Les expérimentations de ce type doivent être vraiment encouragées. Cela requiert que des moyens soient affectés au CLEMI.
Les acteurs de la vie publique et de la vie civile doivent s’investir. Les médias d’information et les journalistes le font déjà, eux qui se rendent souvent à la semaine de la presse et des médias dans l’école. C’est un moment de rencontre, où les journalistes parlent avec des classes et expliquent l’information aux élèves.
Un grand sémiologue et linguiste, le professeur Patrick Charaudeau, explique que la compréhension de l’information passe par trois lieux de pertinence : le lieu du message – les médias –, le lieu de la réception – l’analyse et la compréhension –, et, en amont, le lieu de la production.
Montrer à des jeunes comment se construit, s’élabore et se sélectionne l’information, comme le disait David Assouline, est absolument essentiel. Cela leur permettra de comprendre, analyser, s’instruire et remplir pleinement leur rôle de citoyen.

Merci, mes chers collègues, d’avoir appelé l’attention du Sénat sur l’importance de l’article 35.
La parole est à M. le ministre.
Je souhaite vous livrer, mesdames, messieurs les sénateurs, trois réflexions très brèves.
Je vous remercie, d’abord, d’avoir attiré notre attention sur l’importance de cette éducation aux médias, sans avoir pourtant déposé d’amendement. C’est absolument déterminant pour les années qui viennent.
Ensuite, je remarque que ce n’est pas la première fois que nous voyons se former dans l’hémicycle des accords qui dépassent les sensibilités politiques traditionnelles. Je m’en réjouis vraiment pour l’école, d’autant que cela n’a pas été le cas dans les débats précédents.
Enfin, je veux vous le dire, il faut que nous ayons en tête que le temps de l’école n’est ni le temps politique ni le temps médiatique. C’est pour cela que j’ai beaucoup insisté sur certaines indépendances, hier, ce n’était pas pour frustrer Mme Laborde ! Garder cela en tête, en ce qui concerne, notamment, la production des programmes et des manuels, nous permettra de faire un bon travail, auquel le Parlement sera associé, d’ailleurs.
J’entends souvent dire que les nouveaux programmes scolaires arriveront en septembre. Ce n’est pas vrai, cela demandera plusieurs années ! Lorsque nous nous attellerons à ce travail, l’année prochaine, vous pourrez constater, mesdames, messieurs les sénateurs, que la programmation pour le primaire, le collège et le lycée se prépare sur un ou deux ans, si l’on veut qu’elle soit sérieuse. Nous devrons compter avec les délais propres aux éditeurs, et puis viendra le temps de la mise en œuvre, cycle par cycle. Ce sont donc des réformes qu’il faut penser sur plusieurs années. Ce point est très important : c’est en procédant ainsi que l’on peut faire des choses de qualité. Cette démarche concernera, évidemment, l’éducation aux médias.
L’article 35 est adopté.
L’article L. 332-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1°A
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret. »

L’amendement n° 126, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.

L’Assemblée nationale a modifié le brevet en en retirant des éléments très contestés, comme la note de vie scolaire, ou la formule qui concernait les « autres enseignements » qui pouvaient être pris en compte, qui faisait apparaître la notion de capacités différentes.
S’il atteste la maîtrise du socle, il « sanctionne », ou « certifie » la formation acquise en fin de collège, sans que celle-ci se réduise nécessairement au socle.
Il y a donc bien, dans la loi, deux objets distincts : d’une part, les programmes scolaires et, d’autre part, le socle, qui constitue un élément du brevet parmi d’autres.
En outre, l’articulation entre le brevet et le socle n’est pas claire. On y retrouve la confusion entretenue entre socle et programmes.
L’article 36 confirme et précise la conception d’une séparation du programme et du socle en scindant leur évaluation : le brevet « valide » les programmes et inclut l’attestation de la maîtrise du socle, ce qui renvoie, sans le dire, au livret de compétences.
De plus, le diplôme national du brevet se transforme en une sorte de certification à géométrie variable. Il intégrera désormais des projets personnels individuels, système souvent injuste, car une bonne part du travail se trouve reléguée en dehors de la classe. Il est aussi moins rigoureux et transparent dans les critères d’évaluation, et, enfin, soumis au local, car les mêmes enseignants conçoivent l’épreuve, la font préparer et passer. Les candidats se trouvent donc privés des garanties offertes par l’anonymat de la correction et l’uniformité des épreuves.
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à cet article 36, et nous en demandons la suppression.

Par cohérence avec la position de la commission sur l’article 7, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n’est pas adopté.

L’amendement n° 419, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement tend à supprimer l’alinéa 2, ajouté en commission.
Comprenons-nous bien, l’idée de prendre en compte des projets et des compétences transdisciplinaires est intéressante. Elle se met d’ailleurs en œuvre progressivement dans nos collèges et lycées, et nos élèves en profitent. Elle alimentera la réflexion.
Cependant, chacun comprendra qu’il convient de penser aux objectifs et au contenu des enseignements, le fameux « socle », et à leur ajustement avec les programmes, avant d’en déterminer les modalités de validation.
Le nouvel alinéa 2 de l’article 36, introduit par la commission, fixerait dans la loi des modalités d’organisation et d’attribution du diplôme du brevet, avant même qu’ait été mené ce travail préalable.
Cet ajout anticiperait la réflexion en cours pour repenser le brevet en cohérence avec le socle, qui doit être défini, et les programmes.
Ceci dit, la direction indiquée par la commission dans l’amendement qu’elle a adopté me semble être la bonne. Je la ferai mienne lorsque je saisirai le Conseil supérieur des programmes pour concevoir le nouveau diplôme national du brevet. Les projets et les compétences transdisciplinaires me semblent devoir être au cœur de cette évaluation.

Monsieur le ministre, vous l’avez bien compris, notre commission était très attachée au développement de l’interdisciplinarité des projets personnels de l’élève.
Cependant, elle comprend, bien évidemment, qu’il faille harmoniser dans le temps l’ensemble de ces mesures.
Elle émet donc un avis favorable sur cet amendement.

J’ai dû avoir un moment d’absence en commission, car je n’avais pas compris qu’elle était favorable à cet amendement. C’est peut-être parce que cela m’arrangeait !
J’entends bien les propos tenus par Mme la rapporteur, et je conçois qu’elle puisse, à titre personnel, suivre la position de M. le ministre, dont nous comprenons les arguments.
Toutefois, comme il n’y a pas, cette fois, matière à polémique, nous nous permettrons, en toute quiétude, de voter contre l’amendement du Gouvernement.
Quand les travaux personnels encadrés, les TPE, ont été mis en place au lycée, on a cru que ce serait l’apocalypse, qu’on n’arriverait jamais à les mettre en œuvre et à les évaluer. Finalement, tout le monde s’est attelé à la tâche et reconnaît la dimension hautement pédagogique de ces travaux. En outre, leur notation, qui ne donne lieu à aucun contentieux particulier, est retenue pour le baccalauréat.
Par conséquent, nous persistons à penser que la prise en compte d’éléments transdisciplinaires doit être à la base de la refondation de l’évaluation du brevet.
Pour nous, c’est très important. C’est une mesure à laquelle nous tenons beaucoup, et vous remarquerez que nous n’employons pas de gros mots, comme la « capacité à travailler en groupe »…
Monsieur le ministre, nous ferons une exception par rapport à notre attitude générale sur le projet de loi, en ne vous suivant pas sur cet amendement, même si je comprends très bien que nos collègues puissent le voter.

Ma chère collègue, je vous précise que j’ai bien exprimé l’avis de la commission. Je ne me serais certainement pas permis d’y substituer mon point de vue personnel.
L'amendement est adopté.

L'amendement n° 171, présenté par Mmes Bouchoux et Blandin, M. Gattolin et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...°Le troisième alinéa est supprimé ;
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.

Dans un souci de cohérence avec ce que nous avons défendu – certes, j’imagine déjà ce que sera la réponse du Gouvernement –, nous proposons la suppression des mentions au brevet des collèges, et ce pour plusieurs raisons.
D’abord, puisque certains de nos collègues nous exhortent à faire confiance à « l’expérience d’usage », je note le caractère extrêmement incertain de la signification des mentions compte tenu des modalités de notation du brevet. Car, et tous les enseignants vous le diront, hormis pour les excellents élèves, qui obtiendront la mention très bien, et pour les cancres, qui seront collés, c’est le règne de l’aléa. On s’en étonne chaque année, souvent pour s’en émouvoir, parfois pour s’en réjouir…
Tout le monde reconnaît en privé l’absence de fiabilité des mentions au brevet. Nous, nous sommes cohérents : comme nous pensons que le système n’a aucun sens, nous en proposons la suppression.
En outre, et, pour nous, c’est encore plus important, le brevet, ce sont les fondamentaux de base. Il s’agit de jeunes âgés de quinze ans ou seize ans. On est encore dans le cadre de l’obligation scolaire, de la culture commune – je prends soin de ne pas aborder des termes qui pourraient fâcher certains de nos collègues. À cet égard, les mentions n’ont aucun sens. Observons le modèle finlandais : un système qui marche, c’est un système où les élèves ne redoublent pas et ne sont pas classés avant l’âge de quatorze ans.
M. le ministre me répondra certainement, d’ailleurs à juste titre, que le Gouvernement compte s’attaquer prochainement à la réforme du brevet et que nos réflexions seront prises en compte dans ce cadre. Nous pouvons l’entendre. Mais il ne s’agit pas de lancer une polémique ou de faire de l’ombre à quiconque. Nous tenons simplement à la suppression des mentions au brevet.
Enfin, je réponds par avance au Gouvernement, qui va sans doute arguer que les mentions au brevet permettent d’accorder quelques bourses en plus des bourses sur critères sociaux. Mais, précisément, comme les critères d’attribution en sont irrationnels, cela relève de la loterie ! J’ai pu le constater. Pour notre part, nous souhaitons des bourses sur critères sociaux stricts, dans le cadre de la scolarité avant seize ans.
Vous le voyez, c’est au nom de nos idées, de nos valeurs et du bon sens que nous avons déposé cet amendement. Nous le maintenons, car il n’y a pas péril en la demeure. Nous tenons beaucoup à la suppression des mentions au brevet. (

Mme la présidente. Ma chère collègue, je constate que vous anticipez beaucoup sur la réponse du Gouvernement.
Sourires.

Mme Françoise Cartron, rapporteur. Je ne reprendrai pas tout ce que nous devrions dire, puisque Mme Bouchoux a déjà fait le travail à notre place.
Nouveaux sourires.
Mme Bouchoux soulève un vrai sujet, qui est devant nous, celui de l’évaluation.
Mais elle a aussi évoqué la question des bourses. Dans le contexte actuel, avec les difficultés de pouvoir d'achat que nous connaissons, il paraît difficile de supprimer les bourses au mérite, dont les élèves éligibles aux bourses sur critères sociaux sont aussi susceptibles de bénéficier. C’est uniquement pour cette raison que je ne retiens pas votre amendement à ce stade.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 145 rectifié, présenté par Mme Duchêne, M. Carle, Mmes Primas et Mélot et MM. B. Fournier et Chauveau, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
la maîtrise
par les mots :
du niveau requis pour la maîtrise
La parole est à Mme Colette Mélot.

L’objectif qui sous-tend l’alinéa 5 de l’article 36 est tout à fait respectable.
Toutefois, la référence au « niveau requis pour la maîtrise » serait, me semble-t-il, plus modeste et plus appropriée. Certes, il s’agit juste d’une question sémantique. Mais je pense que notre rédaction serait meilleure.

À mon sens, la rédaction qui nous est proposée complique les choses plus qu’elle ne les clarifie. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 36 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333 -4. – L’examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d’études supérieures et à l’insertion professionnelle. Il comporte la vérification d’un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article L. 333-3 du même code est abrogé.
III. – L’article L. 334–1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334–1. – Dans les sections d’enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d’évaluation et aux jurys du baccalauréat. »

Avec l’article 37, nous abordons le problème du baccalauréat.
Monsieur le ministre, vous avez tout à l’heure eu un mot un peu fort. Vous avez qualifié d’« extravagant » le reproche qui vous était adressé de ne pas présenter des points de réforme importants sur le second cycle du second degré. Sans doute vos paroles ont-elles quelque peu dépassé votre pensée.

Nous abordons le baccalauréat, mais de manière partielle seulement. Pourtant, le baccalauréat, c’est la clé de voûte du second degré. Dès lors, on ne peut pas réformer ce dernier sans s’interroger sur le baccalauréat.
Voilà quelques années, j’avais demandé au Sénat à pouvoir me livrer à une étude sur le sujet. J’avais alors commis un rapport sur le, ou plutôt les baccalauréats en France.
Certes, monsieur le ministre, vous ne pouvez pas tout faire en même temps ; je le comprends bien.
Mais il est plus qu’urgent de poursuivre ce qui a été engagé, à mon sens trop timidement, par votre prédécesseur : le rééquilibrage des sections du baccalauréat.
Nous ne pouvons pas continuer à voir les « bons » élèves se précipiter vers le bac S même s’ils ne sont pas scientifiques, à avoir une majorité des baccalauréats réputés qui sont des bac S et à manquer ensuite de scientifiques dans l’enseignement supérieur. C’est tout de même bien le signe d’une anomalie.
M. le ministre acquiesce.

De même, nous ne pouvons pas continuer à voir des titulaires du baccalauréat technologique, qui est un bac difficile et de qualité, ne pas parvenir à trouver ensuite leur place dans l’enseignement supérieur dans les filières qui devraient leur être destinées parce que les bacheliers S s’y replient !
Et, alors que le baccalauréat professionnel était à l’origine conçu pour permettre l’insertion professionnelle avec un bon niveau de connaissances, ses titulaires sont de plus en plus incités à aller dans l’enseignement supérieur, avec des risques d’échec considérables.
Tous les bacheliers professionnels ne sont pas faits pour aller dans l’enseignement supérieur. Mais la société doit convenir qu’elle n’a pas consacré autant d’efforts à ces jeunes qui renoncent à aller dans le supérieur et entrent dans la vie professionnelle. Aussi, au nom de l’égalité, il faut leur reconnaître un droit à pouvoir ensuite reprendre des études complémentaires, avec l’expérience professionnelle acquise. L’ascenseur social ne doit pas s’arrêter à l’étage initial !
M. Michel Le Scouarnec acquiesce.

Par ailleurs, il faut également une réflexion sur l’organisation de l’examen du baccalauréat, une machine très lourde qui donne lieu à un nombre croissant d'incidents.
Monsieur le ministre, vous avez rappelé tout à l’heure que vous aviez remis l’histoire en terminale pour les bacheliers scientifiques. Mais peut-être faudrait-il s’interroger aussi sur la répartition des matières entre les classes de première et de terminale. On ne peut pas passer toutes les épreuves en même temps.
Entendez donc mon intervention comme un appel à réformer sur ce point ou à améliorer encore la situation. Le baccalauréat, c’est la clé de l’enseignement secondaire. Si nous ne lui assurons pas la remise en état nécessaire – notons que le bac est aussi le premier diplôme de l’enseignement supérieur ; ce dernier devrait donc s’en occuper davantage –, nous n’aurons pas mené la réforme indispensable.
Mme Colette Mélot applaudit.
M. Vincent Peillon, ministre. Je ne cessais d’approuver les propos de M. Legendre : est-ce de la fatigue ?
Sourires.
Nouveaux sourires.
Vous l’aurez compris, notre objectif n’est pas la réforme du baccalauréat ou de l’enseignement secondaire, qui viendra en son temps. Commençons par mener à bien cette première réforme.
Nous voulons rapprocher les trois baccalauréats. Nous n’arriverons à surmonter les difficultés tellement anciennes de hiérarchisation entre les trois catégories de lycées et entre les filières à l’intérieur même du lycée général qu’avec des réformes beaucoup plus audacieuses que celles qui ont été menées précédemment. Il faudra aussi évoquer l’articulation entre le lycée et les premières années des études supérieures. Ces questions doivent être traitées en bloc.
Vous le savez, nous avons décidé de réserver les sections de technicien supérieur et d’IUT aux élèves issus des baccalauréats technologiques et professionnels, qui en ont été évincés ces dernières années. Car quand il n’y a pas perspective de progression, il y a dévalorisation de la formation.
Ce chantier ne sera pas abandonné. Vous évoquez les nombreux travaux que vous avez réalisés, dont nous pouvons partager une partie des conclusions. Certains rapports ont même été, et c’est naturel, adoptés à l’unanimité.
Dès lors, la question que doivent se poser tous ceux qui aiment l’école est la suivante : pourquoi tant de propositions, tant de bonnes intentions, n’ont-elles pas trouvé de traduction dans les faits ? Nous devons donc analyser les obstacles qui se dressent depuis trente ans sur le chemin des réformes. Nous verrons alors mieux comment les surmonter.
D’ailleurs, c’est le sens de la démarche scientifique. C’est en analysant les obstacles surmontés et les erreurs rectifiées que la science se développe.
Le projet de refondation de l’école – c’est peut-être difficile à comprendre au départ, entre le texte, le rapport d’orientation, la programmation et les annonces qui peuvent être faites – est fondé sur une méthodologie ordonnée. Commençons par le commencement, c'est-à-dire ce qui est le plus facile, pour ensuite réduire les difficultés et avancer progressivement. La réforme du lycée viendra ensuite, je l’espère avec une inspiration aussi ambitieuse et, si possible, le même consensus.
Je n’ai pas souligné par hasard au début de la discussion générale le caractère consensuel de ce texte. Réforme des rythmes, priorité au primaire, formation des enseignants : je savais que tout le monde était d’accord. On voit la difficulté quand on passe à la mise en œuvre.
Sur le collège et sur le lycée, le ministère a démarré les discussions, comme sur l’éducation prioritaire ou sur le métier d’enseignant. Mais là, vous le savez, nous sommes loin d’avoir trouvé les consensus. Il faudra un peu plus de temps pour mettre en œuvre cette grande réforme, pour qu’elle produise enfin des résultats.

L'amendement n° 127, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Il comporte la vérification d’un niveau de culture défini par les programmes du lycée, ainsi que le contrôle des connaissances et des compétences dans des enseignements suivis par l’élève en dernière année. Ce contrôle est effectué indépendamment dans chacun de ces enseignements.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Cet amendement tend à revenir à la rédaction initiale du projet de loi avant son examen à l’Assemblée nationale, ce qui est assez rare pour être souligné.
En effet, cette nouvelle formulation ouvre la porte à une réforme du baccalauréat qui pourrait passer, en partie ou en totalité, encontrôle en cours de formation sur les années de cycle terminale, voire sur les trois années pour la voie professionnelle. Cela ne manquerait pas de décrédibiliser le bac pro. Vous le savez, je plaide au contraire pour sa revalorisation grâce à la possibilité d’un retour vers un passage en quatre ans, qui n’interdirait pas, d’ailleurs, des possibilités en trois ans.
Attachés au diplôme national du bac, nous nous inquiétons de la réforme qui pourrait s’engager ainsi au détour d’un amendement.
Pour avoir participé aux travaux d’un groupe de travail sur le bac il y a quelques années au sein de la commission de la culture, je sais la forte portée symbolique que cet examen revêt et je n’ignore pas que toute réforme « à la hussarde » du bac serait assez largement incomprise.

La rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale paraît plus souple et plus favorable à l’interdisciplinarité. Aussi, la commission est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 37 est adopté.

L'amendement n° 371, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. P. Laurent, Le Scouarnec et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 335-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Les formations sous statut scolaire ou étudiant permettent une entrée dans la vie professionnelle aux différents niveaux de qualification exigés par l’évolution des métiers. Elles permettent également la poursuite d’études autorisant des réorientations par le développement de passerelles au sein et entre les trois voies. »
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Aujourd’hui, un élève sur quatre sortant de troisième poursuit ses études dans la voie professionnelle, en CAP ou en bac professionnel, très majoritairement sous statut scolaire, même si les formations sous statut d’apprenti se sont développées ces dernières années.
Cette voie de formation en lycée a fortement contribué, avec la création du bac professionnel en 1985, à l’élévation du taux de bacheliers de notre pays.
Avec la voie technologique, la voie professionnelle sous statut scolaire constitue, ainsi, une spécificité française, à laquelle nous sommes très attachés. Elle participe pleinement à la diversification des voies de réussite pour les jeunes, notamment dans les milieux populaires. Je rappelle qu’elle compte dans ses rangs 56 % de jeunes de milieux populaires, quand la voie générale en compte 23 %.
La formation professionnelle initiale est marquée par l’existence d’un système dual, puisque les jeunes peuvent opter pour des formations sous statut scolaire, mais aussi sous statut salarié avec l’apprentissage.
Cependant, avant d’être celui du jeune, ce choix appartient d’abord à l’entreprise. En effet, les candidats à l’apprentissage sont naturellement sélectionnés par les employeurs d’après les critères classiques de recrutement des salariés. Nous savons que les jeunes sont confrontés à des problèmes de discriminations. Dans de nombreuses filières, les élèves les plus fragiles scolairement et socialement se concentrent ainsi dans les lycées.
La formation professionnelle initiale est également aujourd’hui marquée par la volonté des jeunes et de leurs familles de poursuivre les études après le bac professionnel, ce qui n’était pas l’objet de ce diplôme au moment de sa création.
Cette aspiration rencontre les besoins de l’économie. Dans de nombreux métiers, les recrutements se font en effet maintenant à partir du niveau III. C’est la raison pour laquelle l’offre de formation sous statut scolaire doit se construire dans les lycées publics, dans le cadre de parcours complets et lisibles par les jeunes et leurs familles.
La formation professionnelle initiale a connu bien des bouleversements ces dernières années avec une réforme qui, au motif affiché de l’égalité des trois voies, a instauré le bac professionnel en trois ans au lieu de quatre, et a entraîné la quasi-disparition du diplôme intermédiaire que constitue le BEP.
En tant que rapporteur pour avis sur le budget de l’enseignement scolaire, je puis vous assurer que je ne finis pas de mesurer les conséquences de cette réforme, qui a ébranlé en profondeur tout le système.
Sa mise en œuvre interroge aujourd’hui l’architecture des formations dans certaines filières, je pense en particulier à la filière sanitaire et sociale en pré-bac comme en post-bac.
Elle doit absolument faire l’objet d’un bilan, tout comme la réforme de la voie technologique et générale.
La région d’Île-de-France, très engagée sur cette question – je salue l’engagement de ma collègue et amie Henriette Zoughebi – avec le travail mené sur la lutte contre le décrochage dans le cadre de l’observatoire régional pour la réussite scolaire et la mixité sociale, envisage ainsi d’expérimenter avec les académies la mise en place de ces passerelles.
En l’état actuel du projet de loi, les évolutions et les enjeux liés à la poursuite d’études, à la construction de parcours diversifiés, à la nécessité d’une complémentarité entre la formation scolaire et la formation salariée ne sont pas évoqués.
C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de préciser le sens et les missions spécifiques de l’enseignement professionnel sous statut scolaire, à savoir permettre une entrée dans la vie professionnelle aux différents niveaux de qualification exigés par l’évolution des métiers, rendre possible la poursuite d’études et offrir des possibilités de réorientation par le développement de passerelles entre les filières de formation.

Nous partageons bien sûr les propos que vous venez de tenir, madame Gonthier-Maurin. À nos yeux, cet amendement est satisfait par le droit existant, notamment par les articles L. 335–4, L. 335–9, L. 336–1 et L. 337–1 du code de l’éducation. Aussi, je vous demande de bien vouloir le retirer.
(Non modifié)
I. – L’article L. 337-3 du code de l’éducation est abrogé.
II. – Le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « tout en leur permettant de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122-1-1 ».
III. – Au second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail, les mots : « au cours de l’année civile » et les mots : « ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation » sont supprimés.
IV. – L’article L. 6222-20 du même code est abrogé.
V. – À l’article L. 6222-21 du même code, les mots : « ou en application de l’article L. 6222-20 » sont supprimés.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je suis très attachée à la suppression de l’article 38 de ce projet de loi.
Je ne me lasserai jamais de répéter combien l’apprentissage et la formation professionnelle sont des voies d’excellence, qui permettent à des jeunes, pour près de 80 % d’entre eux, de trouver un emploi. Nous parlons, ici, de jeunes qui ont sélectionné leur parcours professionnel après un choix parfaitement mûri.
Face aux difficultés que rencontrent les jeunes à l’heure actuelle pour trouver un emploi, il paraît important de promouvoir la diversité des intelligences. Est-il besoin de rappeler ici que cette semaine ont eu lieu au Sénat la 13e édition des Rencontres sénatoriales de l’apprentissage, …

… sur le thème « L’apprentissage, construction d’un parcours professionnel » ? Au travers de ces mots, tout est dit.
Penser que l’apprentissage puisse enfermer trop tôt des jeunes dans une filière n’est pas exact. C’est oublier que ces jeunes ont fait le choix d’un parcours en manifestant une motivation forte, épanouissante, et en bénéficiant de l’accompagnement de l’entreprise, qui n’a pas d’intérêts financiers, contrairement à ce qu’on a pu entendre ici ou là. En revanche, l’entreprise s’investit en temps et en patience pour la transmission d’un savoir-faire.
L’apprentissage est pourvoyeur d’emplois et forme à des métiers qui connaissent aujourd’hui une pénurie de main-d’œuvre.
C’est pourquoi il serait souhaitable de voter la suppression de l’article 38 de ce texte, notamment en ce qu’il limite le dispositif d’initiation aux métiers en alternance, le DIMA.
Au-delà des débats sur l’apprentissage junior et la limitation du DIMA, une difficulté demeure. Avec la rédaction actuelle de l’article 38, on en arrive à la situation incohérente où un jeune qui sort de troisième en ayant acquis le socle commun de connaissances ne pourra pas entrer en formation par apprentissage avant la date anniversaire de ses quinze ans, et ce même s’il aura quinze ans au cours de l’année civile.

Je suis saisie de deux amendements identiques.
L’amendement n° 76 est présenté par Mmes Férat, Morin-Desailly et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants-UC.
L’amendement n° 222 est présenté par MM. Carle, Bordier et Chauveau, Mme Duchêne, MM. Dufaut, A. Dupont et Duvernois, Mme Farreyrol, MM. B. Fournier, J.C. Gaudin, Grosdidier, Humbert, Leleux et Martin, Mme Mélot, M. Nachbar, Mme Primas et MM. Savin, Soilihi, Vendegou et Lenoir.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 76.

Vous l’aurez bien compris, je suis pour la suppression de cet article, qui vise à abroger le dispositif de la loi dite « Cherpion ».
Ce dispositif, selon moi, répondait bien à un besoin spécifique de jeunes de moins de seize ans ayant terminé, c’est important de le redire, leur parcours au collège et ayant, c’est tout aussi important de le souligner, une idée claire de leur projet professionnel.
Il convient donc de maintenir ce dispositif, car l’apprentissage est une voie d’excellence.

Nous avons été nombreux à nous exprimer sur les avantages de la diversification des parcours, sur l’importance des stages, sur l’apprentissage et sur tous les dispositifs qui permettent aux jeunes de mieux connaître les voies dans lesquelles ils peuvent s’épanouir.
Il est fort dommageable de laisser des jeunes dans des classes où ils ne s’épanouissent pas et où ils sont en situation d’échec. Leur offrir une occasion de réussir autrement grâce à l’apprentissage peut être un facteur déclenchant.
Il est primordial de supprimer cet article pour ne pas abroger la loi dite « Cherpion », qui a introduit un dispositif d’initiation aux métiers en alternance pour les jeunes de quinze ans.
Ce dispositif doit être mis en œuvre, car il répond à une véritable demande de diversification des parcours à partir de la quatrième. Il n’est pas du tout en opposition avec la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences, dont l’acquisition peut continuer jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire, de même que l’apprentissage d’une langue vivante peut se poursuivre durant le DIMA.
Ce dispositif, qui permet à des élèves sous statut scolaire d’entrer dans la voie professionnelle, est souhaité par de nombreuses familles. L’apprentissage de la « main » est aussi une filière d’excellence.
Qu’il me soit permis de revenir, une fois encore, sur l’exactitude des faits, et je demande bien sûr à chacun de procéder aux vérifications nécessaires.
L’article 38 du projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République vise à supprimer deux dispositions relatives à une orientation trop précoce : ce qui s’appelait l’apprentissage junior et l’accès au DIMA pour les jeunes de moins de quinze ans.
L’apprentissage junior n’est pas lié à la loi Cherpion ni au DIMA. Il est aujourd’hui obsolète, contraire au droit européen et son abrogation n’est guère contestée. Elle avait d’ailleurs été annoncée par la majorité précédente, mais celle-ci ne l’avait finalement pas mise en œuvre. En l’occurrence, nous ne faisons qu’ordonner les choses.
Ce dispositif n’avait fonctionné que sur l’année 2006–2007 ; il avait concerné une centaine de jeunes. C’est dès 2007 que le précédent gouvernement avait indiqué qu’il souhaitait le supprimer. Je ne sais pourquoi il n’est pas passé à l’acte, mais, dans les faits, cela ne changeait rien.
Le DIMA, dispositif d’initiation aux métiers en alternance, a été introduit par la loi Cherpion en juillet 2011.
Tel qu’il avait été conçu par la loi Cherpion, le DIMA permettait d’écarter dès quatorze ans un jeune de la scolarité normale du collège et de l’occuper – car il n’est pas encore en stage, contrairement à ce que j’entends ! – en lui faisant plus ou moins découvrir un champ professionnel – il faut voir, sur le terrain, ce que cela a donné – en attendant qu’il trouve un contrat d’apprentissage, qui venait assez rarement, parce que les entreprises n’ont pas envie de donner un contrat professionnel, de surcroît dans la situation économique actuelle, à un jeune de quatorze ans, préférant prendre de plus âgés ?
Théoriquement en tout cas, dès que ce contrat aurait été trouvé et signé, donc éventuellement dès quatorze ans ou au bout de quelques mois, le jeune pouvait sortir du DIMA pour entrer en apprentissage.
En pratique, sachez tout de même – et, là encore, cela renvoie à des déclarations – que ce dispositif n’a jamais été mis en place tel qu’il avait été initialement conçu, puisqu’il devait être appliqué à la rentrée 2012 et que l’alternance politique m’a conduit à ne pas le mettre en œuvre.
Ainsi, les jeunes qui ont entamé un DIMA pour l’année scolaire 2012–2013 sont entrés dans un dispositif corrigé déjà par ma circulaire de rentrée 2012. L’article 38 du projet de loi est donc au-delà de quatorze ans.
Cet article 38 supprime les dispositions qui font du DIMA un dispositif d’orientation précoce et un sas d’attente d’un contrat d’apprentissage. Il en fait un dispositif de découverte de la formation par apprentissage dans le cadre de la dernière année de scolarité au collège : un jeune doit avoir quinze ans révolus – là est la différence – pour entrer dans ce dispositif ; le collège doit lui permettre de poursuivre – ce n’était pas le cas – l’acquisition du socle commun, de telle sorte que ce jeune puisse faire un autre choix d’orientation en fin de troisième, s’il le souhaite, en particulier si le DIMA ne s’est pas avéré concluant pour lui. Vous évoquez sans cesse des passerelles : en voilà une qui manquait !
Le projet de loi maintient, je le redis, la possibilité pour des jeunes de plus de quinze ans d’accéder à une classe de troisième « préparatoire à l’apprentissage ». Cette classe répond à un besoin réel de certains jeunes. Aujourd'hui, ils sont 7 000 à être concernés, ce qui n’est pas un nombre considérable.
En outre, je rappelle que les entreprises n’étaient pas du tout demandeuses d’apprentis de quatorze ans, car ce n’est pas ce qu’elles souhaitent, et, donc, l’offre de stages ne suivait pas.
Enfin, la possibilité d’entrer en apprentissage à quatorze ans contredit la directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail.
La loi de 2011 était une loi idéologique dans sa formulation, qui n’était même pas efficace – elle n’a donné aucun résultat – et qui contrevenait à la fois au droit et au progrès. Nous gardons l’apprentissage, auquel je crois, sous statut scolaire. Nous devons construire une offre de stages ; ce n’était pas l’objectif de cette loi.

Monsieur le ministre, je le dis en toute objectivité, j’ai besoin de comprendre. J’ai sous les yeux la fameuse directive que vous avez évoquée, qui dispose : « Sans préjudice de règles plus favorables aux jeunes, notamment celles assurant par la formation leur insertion professionnelle et sauf dérogations limitées à certains travaux légers… ». Manifestement nous n’avons pas la même appréhension du texte, car, selon moi, il existe bien des possibilités de dérogations.
Vous avez également dit que le dispositif n’avait pas réellement fonctionné depuis 2006. Moi qui ai la chance, à travers l’enseignement agricole, de parcourir la France, je peux vous donner un exemple tout à fait vérifiable qui se passe en Vendée, un département que je connais un peu, même si ce n’est pas le mien : cette année, 1 300 apprentis ont trouvé un maître de stage, mais 100 jeunes sont concernés par la fixation de l’âge minimal à quinze ans. N’allez pas croire que ces pauvres enfants seraient retirés du collège sans avoir une formation convenable ! Ces 100 jeunes ont bien acquis le socle commun, n’ont pas quinze ans et vont devoir attendre leur date anniversaire. Que vont faire ces jeunes ? Le maître de stage qu’ils ont trouvé va-t-il patienter ? On m’a répondu qu’ils iront en seconde au lycée. Très honnêtement, ils ont choisi un parcours, ils n’éprouveront pas d’intérêt pour suivre pendant cette période les enseignements lycéens.
C’est un véritable problème, monsieur le ministre. Je ne sais comment le résoudre.
Les amendements ne sont pas adoptés.

Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein de la Commission permanente pour l’emploi et la formation professionnelle des Français de l’étranger.
La commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle propose la candidature de Mme Christiane Kammermann pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.
Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quatorze heures cinquante.