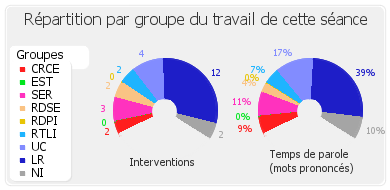Séance en hémicycle du 20 mai 2014 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi
- Demande d'avis sur un projet de nomination
- Communication du conseil constitutionnel
- Questions orales (voir le dossier)
- Actualisation des conditions de renouvellement du permis de conduire international (voir le dossier)
- Reversement aux intercommunalités du fonds d'amorçage de la réforme des rythmes scolaires (voir le dossier)
- Conséquences au titre des financements de la politique agricole commune de la vidange du barrage de guerlédan (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Questions orales
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires.
J’informe le Sénat que la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à cette commission mixte paritaire.
Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
Il sera procédé à la nomination des représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire selon les modalités prévues par l’article 12 du règlement.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif à la prévention de la récidive et à l’individualisation des peines, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 9 octobre 2013.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 16 mai 2014, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission du Sénat compétente sur le projet de nomination de M. Stéphane Saint-André en qualité de président du conseil d’administration de l’établissement public Voies navigables de France.
Cette demande d’avis a été transmise à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.

Mme la présidente. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 16 mai 2014, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’alinéa 4 de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation
Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d’usage et aux démolitions d’éléments du patrimoine immobilier

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.

La parole est à Mme Patricia Bordas, auteur de la question n° 756, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion.

Madame la secrétaire d'État, le 26 février dernier, Jean-Marc Ayrault a annoncé que la date d’échéance pour les travaux de mise en accessibilité par les transports collectifs et les établissements recevant du public, les ERP, était reportée. Ces derniers se sont vu octroyer un délai supplémentaire allant de trois ans à neuf ans.
Cette décision était malheureusement devenue incontournable. Pour rappel, le titre IV de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixait à 2015 l’obligation de mise en accessibilité du cadre bâti et des transports.
Or, en 2012, sept ans après la promulgation de la loi précitée, le constat était alarmant : seuls 15 % des ERP et des transports publics étaient accessibles.
Le retard pris dans la mise en conformité de la loi de 2005 s’explique par un ensemble de facteurs : un délai de parution des décrets plus long que prévu, un impact financier des travaux à mener mal évalué, une réglementation singulièrement complexe et, principalement, un portage politique insuffisant, voire inexistant.
Pour preuve, entre 2005 et 2012, en matière de handicap, seules deux conférences nationales ont eu lieu. Par conséquent, l’impulsion politique était bien trop faible pour mobiliser les acteurs et opérer ce qui constitue à mon avis une véritable révolution sociétale.
Afin de relancer la dynamique et de traduire en actes l’esprit de la loi de 2005, le gouvernement précédent a confié à notre collègue Claire-Lise Campion la mission d’effectuer un bilan de l’application de ladite loi. S’est ensuivie l’ouverture d’une concertation inédite sur l’accessibilité avec l’ensemble des acteurs concernés : associations, représentants des secteurs du transport, du logement, de la construction, du commerce, de l’hôtellerie, etc.
Au final, les conclusions de cette concertation ont fondé le projet de loi habilitant le Gouvernement à adopter des mesures législatives pour la mise en accessibilité des ERP, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées. Actuellement étudié dans le cadre de la discussion parlementaire, ce texte doit être le second souffle tant espéré par les divers protagonistes œuvrant dans le domaine du handicap.
En aparté, le recours aux ordonnances, qui ne peut être considéré comme un mode opportun d’élaboration de la loi, se révèle légitime en l’espèce : non seulement l’urgence de la situation commande d’agir promptement, mais le milieu associatif a fait de cette méthode sa préférence.
Engagée depuis longtemps sur les questions de handicap, je souhaite connaître le dispositif qui vise à consacrer, dans les faits, l’accessibilité universelle.
Madame la secrétaire d'État, dans un contexte général de réduction de la dépense publique, le Gouvernement entend-il aider les collectivités territoriales à mettre en œuvre cette réforme essentielle qui n’est autre qu’un devoir pour tous, éminemment civique et profondément humain ?
Dans cette même perspective, le Gouvernement envisage-t-il d’établir un mécanisme incitatif pour les collectivités territoriales qui prendraient rapidement des mesures en faveur de l’accessibilité, en jouant sur leur dotation générale de décentralisation par exemple ? Il ne faut pas oublier que ces dernières, en tant qu’entités publiques, ont un devoir d’exemplarité.
Madame la sénatrice, je vous remercie de rappeler dans cet hémicycle l’importance de l’accessibilité universelle. C’est un objectif que nous partageons tous.
Le retard pris dans la mise en œuvre de la loi de 2005 est indéniable, et vous l’avez souligné, madame la sénatrice : tous les établissements recevant du public, toutes les voiries, tous les services publics de transport, ne seront pas aux normes au 1er janvier 2015.
Bien sûr, ce retard suscite de l’impatience. Bien sûr, cette impatience est légitime. Bien sûr, le Gouvernement la comprend. Oui, c’est vrai qu’il y a urgence, urgence pour toutes les personnes dont la vie quotidienne peut devenir un véritable parcours du combattant du fait d’aménagements insuffisants.
C’est pourquoi, dès le mois de juillet 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault a missionné la sénatrice Claire-Lise Campion sur le sujet.
C’est pourquoi, courant 2013, ce même gouvernement a invité toutes les parties prenantes à se mettre autour d’une table et à trouver des solutions concrètes pour mettre en application la loi de 2005. Pour la première fois – car c’était réellement la première fois –, les associations de personnes handicapées, les élus locaux, les fédérations de professionnels, ont discuté ensemble et se sont mis d’accord sur des conclusions qui ont permis d’écrire le projet de loi d’habilitation que je suis venue présenter il y a peu ici même.
L’objectif de ce projet de loi n’est pas de se donner du temps. Il est bien de se donner les moyens d’appliquer la loi de 2005, en corrigeant ses faiblesses, c’est-à-dire en accompagnant les acteurs publics et privés et en réajustant les normes, qui peuvent, dans certains cas, être trop complexes et, dans d’autres, ne pas prendre en compte toutes les formes de handicap.
La loi de 2005 restera donc effective : tout établissement qui ne sera pas accessible en 2015 pourra être sanctionné pénalement, sauf s’il a déposé un agenda d’accessibilité programmée avant le 31 décembre 2014. Cet agenda est un document de programmation des travaux et de leur financement, programmation qui, dans 80 % des cas, s’étendra sur une période maximale de trois ans, avec des comptes à rendre dès la fin de la première année.
Sur les moyens financiers des collectivités territoriales, mais aussi des acteurs privés, madame la sénatrice, je vous donnerai deux réponses.
D’une part, je signerai prochainement avec Michel Sapin une convention avec la Caisse des dépôts et consignations et BPI France pour proposer des prêts avantageux aux acteurs tant privés que publics.
D’autre part, la concertation évoquée à l’instant a permis d’aboutir à un réajustement des normes, précisément pour éviter que les travaux de mise en accessibilité ne soient rendus impossibles par le montant des dépenses : par exemple, dans certains cas, une rampe d’accès amovible sera suffisante. Dans cette réforme, comme vous le voyez, c’est l’esprit pratique qui domine.
Pour informer les professionnels et les élus, une campagne de communication nationale va démarrer, aidée par des jeunes en service civique qui seront chargés d’expliquer partout sur le territoire le mode d’emploi des agendas d’accessibilité.
Je veux terminer en affirmant que l’accessibilité doit être considérée non plus comme une charge supplémentaire, mais bien comme un investissement d’avenir. L’accessibilité concerne 12 millions de personnes en France. Être accessible pour un établissement, pour une ville, pour un lieu touristique, comme l’est la Corrèze – département dont vous êtes élue, madame la sénatrice –, c’est être attractif.
L’accessibilité, c’est aussi une question d’égalité de tous les citoyens. C’est donc une exigence républicaine. Soyez assurée, madame la sénatrice, que le Gouvernement y est extrêmement attaché.

Madame la secrétaire d'État, je vous remercie des éléments de réponse que vous avez apportés.
Tout d’abord, j’aimerais ardemment souligner que l’accessibilité universelle ne s’adresse pas seulement aux personnes atteintes d’un handicap : elle s’adresse à tous les individus pouvant être confrontés, un jour ou l’autre, à des difficultés pour se déplacer. Je pense aussi aux jeunes parents accompagnés de leur enfant en poussette : on oublie souvent ce public quand on parle d’accessibilité. En outre, eu égard au vieillissement de la population, cette approche transversale se révèle un enjeu considérable.
Ensuite, en matière d’accessibilité, il convient d’insister sur la forte hétérogénéité entre territoires. À titre d’exemple, si certaines villes comme Grenoble ou Brive-la-Gaillarde ont effectué de substantiels investissements, à l’inverse, d’autres communes et régions n’ont ni suivi ni approfondi le processus entamé en 2005. Cette diversité illustre le rôle déterminant des élus locaux qui, par leur volontarisme politique, peuvent influer sur l’insertion des personnes en situation de handicap dans la vie de la cité.
Enfin, madame la secrétaire d'État, les parlementaires ainsi que l’exécutif doivent être extrêmement vigilants quant à l’application de la loi habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Les futures échéances doivent être impérativement respectées, sans concession aucune. Tout nouveau retard serait à mon avis une véritable régression, aussi bien pour les personnes en situation de handicap que pour la société dans son ensemble. L’espoir né de la loi de 2005, aujourd’hui déçu, doit revivre et prendre racine dans une société enfin et entièrement accessible. Sur ce sujet, vous avez toute ma confiance.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, auteur de la question n° 740, adressée à Mme la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports.

Monsieur le secrétaire d'État, au mois de février 2013, j’ai interpellé le gouvernement d’alors sur la question du port du foulard à la suite de la décision de la Fédération internationale de football association, la FIFA, autorisant le port du voile dans les compétitions. En effet, la FIFA avait adopté un certain nombre d’amendements aux Lois du jeu pour préciser le « design », la « couleur » et le « matériau » du foulard qui serait autorisé, tout en précisant que ce foulard ne pouvait être porté que par des femmes...
Au mois de mars dernier, triste épilogue, si je puis dire, l’International Football association board, l’IFAB, fortement inspirée par la décision de la FIFA, a officiellement autorisé le port du hijab après vingt mois d’essai.
Cette décision n’est malheureusement pas une surprise, quand on sait que cette instance chargée de débattre et de trancher les propositions de modification des Lois du jeu du football, est notamment composée de représentants de la FIFA. L’IFAB a jugé n’avoir « aucune raison valable » pour interdire le foulard...
Je ne partage évidemment pas cette décision qui est en totale contraction avec les deux grands principes fondamentaux du sport, garantis par la Charte olympique et les règlements des grandes fédérations internationales.
D’une part, cette décision bafoue le principe de neutralité du sport consacré dans la règle 50, alinéa 3, de la Charte olympique, selon lequel « aucune sorte de démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale n’est autorisée dans un lieu, site ou autre emplacement olympique ». Or je ne pense pas que l’on puisse se méprendre sur la signification religieuse du port du foulard.
D’autre part, dans la mesure où le port du foulard est exclusivement réservé aux femmes, ces décisions me paraissent contraires au refus par la Charte olympique de toute discrimination fondée sur des considérations de race, de religion, de politique ou de sexe.
La Fédération française de football s’est à plusieurs reprises dite opposée à cette mesure, et a rappelé que ces principes restent valables, y compris « en ce qui concerne la participation des sélections nationales françaises dans des compétitions internationales ». Elle a maintenu « l’interdiction du port de tous signes religieux ou confessionnels » dans le pays.
Cependant, en avril dernier, son président, Noël Le Graët, en évoquant la candidature de la France à l’organisation de la coupe du monde féminine en 2019, a reconnu que « si l’Arabie Saoudite se qualifie, on respectera les règles de la FIFA » !
Monsieur le ministre, alors que la coupe du monde féminine de football, organisée par la FIFA, se tiendra en 2015 au Canada, et que la France s’est portée candidate à l’organisation du mondial féminin 2019, quelles démarches le Gouvernement compte-t-il engager pour défendre le principe de neutralité du sport auprès des instances internationales et pour assurer le respect de ce principe sur les terrains de football en France ? Il me semble bien, en effet, que la FIFA et l’IFAB ont ouvert la boîte de Pandore.
Madame Gonthier-Maurin, comme vous venez de le rappeler, les instances sportives internationales ont érigé la neutralité, qu’elle soit politique ou religieuse, en principe sur les terrains. La France est profondément attachée à cette neutralité.
Le règlement de la FIFA précise même que « l’équipement de base obligatoire ne doit présenter aucune inscription politique, religieuse ou personnelle ».
La décision que vous avez citée de l’International Football Association Board, organe réglementaire de la FIFA, d’autoriser définitivement, lors des rencontres de football, le port du couvre-chef – voile, kippa, casquette, etc. –, entrera en vigueur au 1er juillet, après deux ans d’expérimentation. La FIFA justifie cette décision en considérant que les couvre-chefs, notamment le voile, sont des signes culturels, et non pas confessionnels.
Il n’appartient pas au Gouvernement de commenter la décision d’une fédération internationale indépendante, tout commentaire pouvant être considéré comme de l’ingérence.
La Fédération française de football, la FFF, par la voix de son président, Noël Le Graët, et la Ligue de football professionnel, la LFP, par l’intermédiaire de son président, Frédéric Thiriez, ont fait part de leur profond attachement au principe de neutralité sur les terrains de sport.
Le Gouvernement se félicite de cette prise de position et apporte tout son soutien à la FFF et à la LFP. Nous faisons toute confiance aux dirigeants de la fédération, et surtout aux arbitres – ils sont seuls maîtres sur un terrain de sport –, pour faire respecter ce principe.
Le Gouvernement est profondément attaché à ce que les terrains de sport restent neutres, religieusement, mais aussi politiquement. Soyez assurée, madame la sénatrice, qu’il y veillera avec attention.
Le sport porte un message universel et humaniste qui transcende les clivages traditionnels. N’introduisons pas de la discorde là où il y a de l’unité. Préservons le sport !
Vous pouvez compter sur la vigilance du Gouvernement, la mienne en particulier, pour continuer le dialogue que nous avons engagé avec la Fédération française de football, afin que celle-ci puisse influer au mieux sur les décisions prises par la FIFA.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
En 2013, Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, avait fait une réponse extrêmement ferme s’agissant du respect de la neutralité du sport.
J’attire votre attention sur le fait qu’imposer exclusivement aux femmes le port d’un couvre-chef est parfaitement discriminatoire
M. le secrétaire d’État acquiesce.

Nous devrons donc être extrêmement vigilants sur le terrain, et aussi travailler à faire avancer la féminisation des instances dirigeantes du sport
M. le secrétaire d’État acquiesce à nouveau

La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 745, adressée à Mme la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique.

Madame la présidente, madame la ministre, ma question concerne les difficultés qu’éprouvent les quelque 6 000 lauréats de l’examen professionnel de rédacteur territorial pour se faire nommer, malgré leur réussite à l’examen correspondant.
À la suite de la mobilisation de nombreux lauréats, inquiets de ne pas voir leurs efforts récompensés, le Gouvernement a étendu les possibilités de nommer les lauréats.
Le décret du 30 juillet 2012 a ainsi offert de nouvelles garanties aux lauréats non promus, comme la prorogation de la validité de l’examen professionnel sans limitation de durée. Il a aussi assoupli les quotas de promotions internes des lauréats de l’examen professionnel de rédacteur territorial.
Avec ce décret, ces promotions internes peuvent représenter 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le cadre d’emplois des rédacteurs au sein de la collectivité ou de l’établissement, ou de l’ensemble des collectivités ou établissements affiliés à un centre de gestion.
Toutefois, l’assouplissement de ces quotas de promotion interne par ce décret n’est que provisoire, puisque ce dernier n’est valable que jusqu’au 31 décembre de cette année. Il ne constitue donc pas une solution pour les 6 000 lauréats de l’examen professionnel en attente de nomination.
Après le 31 décembre, ces lauréats se retrouveront en concurrence avec les lauréats du concours externe, si bien que bon nombre de fonctionnaires envisagent de passer ledit concours externe.
C’est un véritable paradoxe pour ces agents, qui se sont investis dans leurs missions au sein de la collectivité. Ils ont le sentiment de ne pas être considérés à la hauteur de leurs mérites et ont l’impression que les efforts consentis pour réussir cet examen professionnel ne sont pas reconnus.
Pour prendre un exemple concret, à la communauté urbaine de Lille, ce sont ainsi treize agents qui, de longues années après la réussite de leur examen professionnel, ne peuvent pas être nommés en raison de la réglementation en vigueur ; ils m’ont fait part de leur amertume et de leur frustration à cet égard.
Face à ce problème, il semblerait opportun, comme le proposent les représentants syndicaux, de supprimer la règle de promotions internes hors quotas, afin de permettre aux collectivités ayant des besoins en cadres de catégorie B de nommer leurs agents déjà formés par elles et titulaires de l’examen professionnel.
C’est notamment le souhait qu’a exprimé M. Philippe Laurent, le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, en se positionnant pour un rehaussement du quota de ces nominations de 5 à 10 %.
Madame la ministre, ma question est donc la suivante : pour mettre un terme à l’injustice que ressentent ces « reçus-collés », comme ils se qualifient eux-mêmes, et pour une bonne gestion des collectivités territoriales, le Gouvernement envisage-t-il de supprimer ce système de quotas, ou du moins d’y introduire une plus grande souplesse ?
Madame Demessine, je reconnais bien, dans les termes de votre question, votre souci de vous attacher à relever précisément ce qui ne fonctionne pas.
Les fonctionnaires territoriaux de la filière administrative de catégorie C ont en effet bénéficié d’une voie exceptionnelle de promotion interne leur permettant l’accès au cadre d’emplois de rédacteur territorial à l’issue d’un examen professionnel institué, comme vous l’avez rappelé, par les décrets du 30 décembre 2004.
Cet examen, dont la fréquence est annuelle, a été ouvert dans un premier temps sans contingentement du nombre des lauréats. En effet, l’objectif était d’améliorer les conditions de promotion interne des agents de catégorie C dans le cadre d’emplois des rédacteurs – catégorie B –, pour tenir compte de la réforme de la catégorie C portant notamment fusion des cadres d’emplois des agents et des adjoints administratifs.
Ce décret avait pour objet de prendre des mesures temporaires, destinées à accompagner une réforme, et non pas à créer des modalités pérennes de promotion, ce point faisant d’ailleurs l’objet d’une discussion récurrente entre les organisations syndicales et l’ensemble des personnes concernées.
Cependant, tous les lauréats n’ont pu être promus du fait de l’application de la règle du quota de promotion interne. Ainsi, ce qui visait à régler une situation globale s’est heurté au mur du quota.
L’existence de quotas est un principe fixé par la loi du 26 janvier 1984, l’idée étant de pouvoir promouvoir sans excès, de façon équilibrée – peut-être vous souvenez-vous des débats nourris sur ce point ? –, en définissant le juste pyramidage des effectifs.
Cette sélection se fait donc en deux temps dans la fonction publique territoriale, le premier étant l’examen professionnel, le second la sélection imposée par les quotas. Dans la fonction publique de l’État, l’examen professionnel est contingenté. Le résultat est donc comparable dans les deux fonctions publiques, au terme de mécanismes de sélection différents.
C’est pourquoi les lauréats d’un examen professionnel sont éligibles à la promotion interne dans les deux cas. Afin de favoriser la nomination effective des lauréats au sein des collectivités, alors même que la validité de l’examen était provisoire, nous avons prolongé la validité de ce dernier sans limitation de durée, ce qui nous semble être, en dépit des difficultés, la meilleure solution.
Ainsi, à titre dérogatoire pour les lauréats de cet examen exceptionnel pour l’accès au cadre d’emplois des rédacteurs, la durée de validité de l’examen à ce jour, et contrairement aux règles dans ce type de dispositif de promotion spécifique, n’est pas limitée.
En outre, des mesures favorables sur les quotas ont été prévues successivement par les décrets du 30 décembre 2004, du 28 novembre 2006, du 22 mars 2010, ainsi que par le décret du 30 juillet 2012 précité. Ce dernier prévoit, dans son article 28, que, pendant une période de trois ans, si cela est plus favorable que le quota d’une promotion interne pour trois recrutements externes, le nombre de promotions internes peut être égal à 5 % de l’effectif du cadre d’emplois des rédacteurs, au lieu d’un tiers de 5 % de l’effectif, alternative de droit commun.
Les organisations syndicales, comme les représentants du Gouvernement à l’époque, estimaient que cette mesure, provisoire mais très avantageuse, permettrait de résoudre le problème.
Par ailleurs, si aucune promotion interne n’a été possible pendant ces trois années, une clause de sauvegarde autorise une promotion interne en 2015, même si aucun recrutement externe n’a lieu pendant cette période, contrairement au droit commun des clauses de sauvegarde. Ainsi, les lauréats de l’examen professionnel exceptionnel bénéficieront encore, jusqu’en 2015 inclus, de quotas très favorables permettant leur nomination dans le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
Il convient d’attirer l’attention de l’ensemble des élus locaux sur cette disposition, voulue par Philippe Laurent, président de Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Alors que le dispositif instauré en 2004 était un dispositif exceptionnel, expressément transitoire et temporaire, il a donc au fil du temps fait l’objet d’aménagements très favorables aux agents, par le biais d’une extension de sa durée et d’un accroissement sensible des quotas de promotion depuis 2012.
Au regard de ces éléments, mais aussi pour tenir compte de la structure des effectifs et de la nécessaire maîtrise des dépenses publiques, il ne paraît pas concevable de modifier ces règles.
Je me suis toutefois engagée, devant le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à faire à la fin de l’année 2014 – en octobre ou novembre 2014, dirai-je – un bilan de ce qui se passe dans les territoires. L’année 2015 devant permettre de régler une grande partie des cas en suspens, je veux donc savoir, en amont, quelle est la réalité, notamment en termes de pourcentage, et je sais que vous serez vigilante, madame la sénatrice, avec d’autres, pour m’indiquer les difficultés qui subsistent.
Enfin, vous savez que nous allons engager dans quelques jours une discussion sur les parcours, les traitements, les formations et les passerelles ; les circonstances sont certes un peu particulières, mais la séance qui a été levée hier sera reprise d’ici à quelques jours, car les fonctionnaires sont très attachés à ces discussions.
À partir de cet exemple, qui partait d’une idée plutôt généreuse et assez enthousiasmante pour nos fonctionnaires, nous devons réfléchir à la manière d’améliorer les parcours professionnels et les promotions sans provoquer de « bugs » du type de celui que vous avez souligné. Je vous remercie en tout cas, madame la sénatrice, d’avoir rappelé cette situation à la Haute Assemblée.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse, qui apporte quelques éclaircissements sur un sujet particulièrement complexe.
Je vous remercie surtout de rester très vigilante quant à la situation de ces agents, dont vous imaginez aisément la frustration : alors même qu’ils ont franchi avec succès les épreuves d’un examen qui reste l’une des seules voies de promotion possibles dans la fonction publique, ils n’ont pas droit, après une carrière bien remplie, à la reconnaissance non seulement pécuniaire mais aussi morale §qu’ils méritent.
Il nous reste donc beaucoup à faire pour sortir, par le haut, de cette situation.

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 755, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame le ministre, ce n’est certainement pas une question surprise que je me permets de vous poser. Je souhaite attirer votre attention sur la ou les dates programmées des futures élections au conseil départemental et au conseil régional. Cette question est de plus en plus d’actualité – tout le monde partagera cette analyse –, et il faut qu’une réponse officielle soit rapidement apportée aux élus. En effet, depuis quelques semaines – je dis cela sans la moindre polémique –, des déclarations laissent entendre ou supposer que les élections pourraient être reportées. Dans un tel cas, y aurait-il deux scrutins séparés, à des dates différentes ?
Oui, cette question se pose déjà compte tenu de la constitution des binômes et de l’agrandissement important des cantons, en particulier ruraux. En raison des nouvelles configurations géographiques des cantons, il est indispensable, si nous voulons garder notre rôle d’élus de proximité, de nous faire connaître en personne par des visites, qui seront exigeantes, notamment dans les zones rurales, où les cantons sont plus grands.
Il y a en effet deux sortes de cantons. Dans certains cantons urbains, au sein de certaines villes, les habitants, et même les élus, ne connaissent pas leur secteur ; je dis cela sans connotation négative. En revanche, dans les cantons ruraux – je peux en parler, en tant qu’Altiligérien, en tant qu’homme du Massif central –, il est rare que les élus ne connaissent pas au moins un ou deux habitants dans chaque village.
Madame le ministre, il y a la France rurale et la France urbaine. Pour la France rurale, le canton a une réalité particulière : il est personnalisé. Comment le Gouvernement envisage-t-il l’avenir des cantons et donc l’avenir des départements, peut-être plus spécialement encore en zone de montagne ?
La réforme territoriale ne doit pas être éphémère, nous le savons tous. Nous devons regarder objectivement vers l’avenir.
Ma conclusion sera courte, synthétique, et très respectueuse à votre égard, madame le ministre, parce que je sais que vous êtes un ministre très apprécié. Vous êtes Bretonne, je suis Auvergnat ; je ne souhaite vraiment pas une réponse de Normand ! §
Mme Marylise Lebranchu, ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique. Monsieur le sénateur, M. le ministre de l’intérieur est Normand
Sourires.
Vous nous interrogez, Bernard Cazeneuve, André Vallini et moi-même – nous sommes tous les trois concernés au premier chef –, sur la date officielle des futures échéances électorales. Conformément à la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le prochain renouvellement devrait avoir lieu en mars 2015, le mandat de l’ensemble des conseillers généraux et régionaux prenant fin à cette date.
Cependant, comme l’a rappelé le Président de la République, l’accélération de la réforme territoriale pourrait conduire le Gouvernement à procéder prochainement, et même le plus rapidement possible, à la définition d’une nouvelle carte des régions. Rappelez-vous, monsieur le sénateur, que la demande d’une refonte de la carte des régions a été formulée de manière transpartisane dans cette enceinte en janvier, au cours d’un excellent débat.
Par ailleurs, un texte de loi est en préparation – il est quasiment prêt désormais et sera bientôt présenté en conseil des ministres – concernant les compétences des collectivités locales. Le Président de la République a jugé opportun et très républicain de consulter les principaux responsables politiques pour faire le point sur ces réformes et leur calendrier, sans écrire les conclusions à l’avance. Le Président de la République a tenu à dire qu’il n’y avait aucun prérequis ni a priori, qu’il n’y avait rien de prédéterminé sur l’ensemble de ces sujets.
Le Président de la République considère, comme nous qui sommes ici présents, qu’il est absolument indispensable de réaliser la réforme territoriale le plus vite possible. Pouvons-nous y parvenir si les débats s’arrêtent – soyons clairs – de novembre à juin pour cause de période électorale ? Il s’agit pour nous d’être aussi efficaces que possible. Le ministre de l’intérieur recevra mandat du Premier ministre et du Président de la République pour formuler des propositions. Et c’est au Sénat que le texte sera d’abord examiné. Le Normand, le Dauphinois et la Bretonne que nous sommes, Bernard Cazeneuve, André Vallini et moi-même, sont très attentifs à ce que les territoires se sentent bien et participent au redressement de la France.

Madame le ministre, j’ai bien compris qu’il y avait une volonté de concertation. Vous le savez mieux que moi, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Soyez certaine que la France d’en bas, ou des zones moyennes, aspire à connaître ses élus. Dans les nouveaux cantons dont la superficie est deux ou trois fois supérieure à celle des anciens, il est nécessaire, si l’on veut garder la proximité, de laisser du temps aux membres du binôme pour qu’ils puissent découvrir leur territoire.
Madame le ministre, j’essaie de faire remonter les demandes – je dis cela sans aucune démagogie, puisque je mettrai volontairement un terme à mon mandat le 1er octobre prochain –, sans prétendre avoir le monopole du message de la France d’en bas. Il ne faudrait pas que certains cantons meurent avant de naître. Je vous remercie de la volonté de nous aider que vous manifestez.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 611, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Je tiens à remercier M. Vallini de sa présence au Sénat ce matin pour répondre à ma question.
Le permis de conduire français est reconnu par convention dans tous les États membres de l’Union européenne. Toutefois, certains pays exigent un permis de conduire international. Ce permis est délivré pour une durée de trois ans. Il est renouvelable une seule fois ; il comporte d'ailleurs une page pour le tampon de renouvellement. §Le permis international n’est que la traduction officielle du permis national ; la plupart du temps, les deux doivent être présentés.
Ce n’est pas la première fois que j’interviens sur ce sujet en plaidant pour une simplification administrative. J’ai d’ailleurs réussi, par une précédente intervention, à faire harmoniser les modalités de renouvellement du permis international, qui variaient selon les services préfectoraux. Cependant, je ne comprends toujours pas certaines de ces modalités. Ainsi, deux photographies d’identité récentes sont demandées. À quoi servent-elles, puisque le permis de conduire ne comporte qu’une photo et que, en outre, c’est l’ancienne photographie qui reste sur le document ? De plus, pourquoi demander les mêmes documents que pour une première demande ? Il suffirait de vérifier au guichet la validité du permis national et de tamponner le permis international à la page prévue à cet effet.
Mme Catherine Procaccia montre à nouveau la page en question sur son permis.

Les règles en matière de permis international varient selon les pays. Dans certains pays, il est indispensable d’avoir un permis international, non pas pour louer une voiture, certes, mais lorsqu’on s’y installe temporairement. J’aimerais que les informations soient plus claires. Que comptez-vous faire pour tout harmoniser ? Nos services consulaires à l’étranger pourraient-ils être plus précis dans ce domaine ?

Madame la sénatrice, je vous prie tout d'abord d’excuser M. le ministre de l’intérieur, qui préside en ce moment même une réunion de préfets place Beauvau.
Le permis international de conduire, ou permis de conduire international, est prévu par les articles 41 à 43 de la convention de Vienne sur la circulation routière du 8 novembre 1968. Le modèle du permis international de conduire figure à son annexe 7. Cette convention a fait l’objet de plusieurs amendements entrés en vigueur le 29 mars 2011, qui ont notamment pour but d’obtenir une plus grande sécurisation du permis de conduire international, soumis à de nombreuses fraudes, et d’intégrer les nouvelles catégories et sous-catégories de véhicules ajoutées au nouveau modèle de permis de conduire national adopté par ailleurs.
C’est dans ce contexte que l’annexe 7 de la convention de Vienne a été modifiée et qu’un nouveau modèle de permis de conduire international a été instauré. Ce modèle a été repris à l’annexe 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Contrairement au précédent, il ne permet plus aux autorités des États parties à la convention de Vienne de proroger le permis de conduire international. Par conséquent, les conducteurs dont le permis de conduire international est arrivé à expiration doivent solliciter la délivrance d’un nouveau permis. Pour cela, ils doivent compléter le formulaire Cerfa n° 14881*01 et joindre à celui-ci, en plus de la photocopie de leur permis de conduire national en cours de validité, au moins trois photographies. §Celles-ci sont apposées respectivement sur l’exemplaire n° 1 du Cerfa, destiné au demandeur, sur l’exemplaire n° 2, destiné à la préfecture, et sur le permis de conduire international qui sera délivré au conducteur.
Le permis de conduire international reste obligatoire pour conduire avec son permis national sur le territoire des États qui n’appartiennent pas à l’Espace économique européen.
Comme vous l’avez demandé, madame la sénatrice, l’attention du ministère des affaires étrangères a été attirée sur la possibilité que soit systématiquement mentionnée, sous la rubrique « Conseils aux voyageurs » des sites Internet de nos représentations consulaires à l’étranger, la nécessité, le cas échéant – selon les pays –, d’être en possession d’un permis de conduire international.

Mme Catherine Procaccia . Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. J’ignorais qu’un nouveau modèle de permis de conduire international avait été instauré. Au moins, en l’absence de prorogation, n’y aura-t-il plus d’ambiguïté à cet égard. Je ne sais pas si le nouveau modèle est sécurisé ; vous avez parlé de fraude, mais, à mon avis, on doit pouvoir falsifier sans difficulté ce bout de carton
Mme Catherine Procaccia montre son permis de conduire international.

J’attire à nouveau votre attention sur le manque d’information disponible sur Internet. Je suis allée sur le site de la préfecture du Val-de-Marne, et je n’y ai trouvé absolument aucune information sur le permis de conduire international : on ne sait pas comment le faire établir, ni même qu’il existe… Il est vrai que le site de la préfecture de l’Isère comporte quant à lui des informations sur ce permis ; mais, pour ce qui est des modalités, on est invité à contacter la préfecture… À quoi bon contacter la préfecture si certaines préfectures n’ont pas d’information sur le permis de conduire international ?
Dans le souci de poursuivre la démarche de simplification administrative, j’aimerais que le ministère de l’intérieur exige de chaque préfecture qu’elle fournisse sur son site des informations précises, et intégrant les modifications dont vous venez de nous faire part, sur le permis de conduire international.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Bruguière, auteur de la question n° 769, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la présidente, monsieur le ministre, je regrette que l’emploi du temps de Mme Taubira, garde des sceaux, ne lui ait pas permis d’être présente aujourd’hui pour répondre à cette question importante relative à la situation des mineurs emprisonnés.
En effet, à la suite des recommandations en urgence du Contrôleur général des lieux de privation de liberté relatives au quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, dans l’Hérault, je souhaiterais revenir sur la situation des mineurs emprisonnés.
J’ai été choquée d’apprendre, comme beaucoup de personnes ayant suivi les informations, cette manifestation de violence gratuite dans une institution publique. Certes, je ne suis pas naïve et j’ai bien conscience que, si ces adolescents arrivent dans ces établissements, c’est qu’ils présentent des problèmes sérieux.
Toutefois, je rappelle que, entre janvier 2013 et février 2014, vingt-quatre cas de violences graves ont été recensés dans la cour de promenade des mineurs, dont 13 % ont moins de seize ans. Plus d’un tiers de ces faits impliquent des enfants arrivés la veille ou l’avant-veille dans l’établissement. Ces actes s’assimileraient donc à un rite de passage – presque un bizutage –, lors de l’entrée en prison.
Aussi, je souhaiterais faire deux remarques à la suite des recommandations que je viens d’évoquer.
En premier lieu, je considère qu’il est de mon devoir de relayer ces recommandations, pour qu’on ne puisse pas dire plus tard qu’on ne savait pas. Au demeurant, ce qui émane de ce rapport, c’est la difficulté d’obtenir les informations nécessaires à l’établissement des faits, comme si notre société s’était accoutumée à ces manifestations de violence et banalisait le recours par les mineurs à la brutalité. Faute de pouvoir remédier à ces situations, on les minimise, alors même que la persistance de pratiques violentes au sein de ces quartiers des mineurs met très sérieusement en péril l’intégrité corporelle des jeunes incarcérés. Une fois sortis de prison, certains d’entre eux restent traumatisés, ce qui peut compromettre leurs chances de réinsertion.
En second lieu, il semblerait que, face à ces manifestations de violence, les procédures mises à la disposition du personnel pénitentiaire soient inadaptées.
En effet, toujours d’après le rapport, il apparaîtrait que ces actes sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont dénoncés, car toutes les violences ne feraient pas l’objet d’un compte rendu d’incident. Comme je l’ai dit, les faits ont lieu hors des cellules, lors des déplacements dans la cour de promenade, placée sous caméra de surveillance fixe, mais sans personnel présent. Aussi, des témoignages recueillis établissent que de nombreux incidents pourraient échapper à la vigilance des gardiens.
De plus, les modalités d’intervention des surveillants, dont l’intégrité physique doit être préservée, sont lourdes et lentes. Les procédures disciplinaires sont trop longues, les délais de convocation devant la commission de discipline pouvant atteindre plusieurs mois, ce qui, compte tenu de la durée moyenne de détention des enfants, garantit l’impunité aux auteurs des violences.
Enfin, je sais que Mme la garde des sceaux a été destinataire de ce rapport ; elle a demandé qu’une enquête soit réalisée afin de connaître les dysfonctionnements de l’institution, ces faits n’étant malheureusement pas nouveaux puisqu’ils ont déjà été dénoncés en 2009 à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. Aussi, je serai particulièrement attentive à la suite que vous apporterez à au moins deux des recommandations de ce rapport.
La première concerne la prise en charge éducative de ces enfants, qui doit inclure une éducation aux règlements, au respect mutuel, ainsi qu’une incitation aux dénonciations de toutes ces pratiques et rites d’un autre âge.
La seconde recommandation a trait à la question du signalement à l’autorité judiciaire par les médecins ayant constaté les conséquences corporelles d’agressions. La possibilité offerte aux médecins de signaler les cas de sévices ou de mauvais traitements devrait être une obligation s’agissant des enfants incarcérés, isolés de leurs familles et, pour beaucoup, ayant peur de se plaindre. Il s’agit de lutter contre ce sentiment de résignation face aux agressions constatées au motif que ces enfants seraient naturellement portés à la violence.
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence de Mme la garde des sceaux qui regrette de ne pouvoir être présente ce matin au Sénat et m’a demandé de vous faire part de sa réponse.
À la suite des événements survenus dans le quartier des mineurs de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, il n’est pas question pour le Gouvernement de chercher à relativiser, à dissimuler ou à banaliser les faits de violence constatés.
Aussi, par courrier en date du 25 avril 2014, Christiane Taubira a répondu au Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour lui indiquer les initiatives qu’elle avait prises afin de répondre à la gravité de la situation dans ce quartier marqué par des violences commises entre mineurs détenus, que vous avez, à juste titre, signalées.
Mme la garde des sceaux a saisi, dès le 17 avril, les inspections des services pénitentiaires et de la protection judiciaire de la jeunesse, pour répondre rapidement à la situation de ce site. Sans attendre les conclusions de cette mission qui a débuté, et pour prévenir toute situation de violence, des dispositions ont été prises sur la cour de promenade : modification du planning, un créneau horaire étant désormais réservé aux seuls arrivants, de façon à réduire les tensions et d’éviter tout passage à l’acte violent ; travaux de sécurisation pour éviter tout contact entre majeurs et mineurs et sécuriser la cour des mineurs ; présence de personnels, puisqu’un gradé sera très prochainement affecté dans ce quartier pour asseoir l’autorité d’un membre de l’encadrement.
De plus, dans l’attente de l’ouverture du quartier des mineurs de vingt-cinq places à la maison d’arrêt d’Aix-Luynes, prévue fin 2015, Mme la garde des sceaux a décidé d’ouvrir temporairement un quartier pour mineurs au centre pénitentiaire de Toulon-la-Farlède de vingt-cinq places, dès juillet 2014, afin de remédier au manque de places pour mineurs dans les établissements du grand Sud-Est, qui contribue inévitablement à aggraver les tensions.
Concernant les deux recommandations qui vous préoccupent tout particulièrement, sachez d’abord que, pour mettre un terme au sentiment d’impunité qui pourrait régner parmi les jeunes détenus, Mme la garde des sceaux a fait mettre en place une commission de discipline spécifique pour les mineurs détenus, pilotée par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, qui agit désormais en temps réel.
Parallèlement, le procureur de la République de Montpellier veille à ce qu’une enquête pénale soit systématiquement diligentée à la suite de la commission d’une infraction pénale caractérisée. La réponse pénale est empreinte de la plus grande efficacité dès lors que les auteurs sont identifiés.
Ma collègue Christiane Taubira est aussi consciente du travail éducatif à mener auprès des mineurs. C’est pourquoi la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse continuera à œuvrer dans ce sens non seulement au moyen d’entretiens éducatifs et d’activités portant sur des questions essentielles comme le respect de l’autre, la distinction entre l’auteur et la victime, ou encore les addictions, en lien avec les associations compétentes dans ce domaine, mais également grâce à un important travail réalisé avec les familles, dans les locaux administratifs et au domicile familial.

Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse sur un sujet aussi difficile. Mon collègue Robert Tropeano, ici présent, et moi-même, tous deux élus du département de l’Hérault, espérons maintenant des solutions, lesquelles passent, comme vous l’avez dit, par le respect de l’autre et une grande implication dans l’éducation de ces jeunes. Nous resterons vigilants sur ce dossier.

La parole est à M. Antoine Lefèvre, auteur de la question n° 758, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat sur les rythmes scolaires n’est pas clos : d’une part, les conclusions de la mission commune d’information du Sénat n’ont pas été adoptées, ce qui fait polémique, et, d’autre part, le récent décret du 7 mai censé assouplir le précédent décret, dit « décret Peillon », aurait plutôt tendance à apporter d’autres complexités.
Par ailleurs, je vous fais grâce, monsieur le ministre, des réactions pour le moins caustiques à la suite de l’annonce du report de la pré-rentrée, et donc de la rentrée de septembre, qui ferait suite à un bug informatique et qui paraît particulièrement malvenu à l’heure de la mise en place de ces fameux rythmes. Encore sans doute une ultime confusion du Gouvernement…
Je souhaite néanmoins attirer votre attention sur les conditions de la prise en charge des élèves en situation de handicap lors des activités organisées durant ce temps périscolaire.
Les journées de classe étant allégées, se terminant plus tôt et ne devant plus dépasser une durée de cinq heures trente, les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant la compétence en matière d’enseignement maternel et primaire doivent, par conséquent, adapter leurs activités périscolaires afin d’assurer la prise en charge obligatoire des élèves au moins jusqu’à seize heures trente, heure de fin de classe, dans la plupart des cas, avant la réforme.
Cependant, ni le décret 24 janvier 2013 ni celui du 7 mai 2014 ne précise quoi que ce soit quant à la prise en charge des enfants handicapés pendant cette période périscolaire.
Or les auxiliaires de vie scolaire, les AVS, ont vocation à intervenir pendant le temps scolaire uniquement. Des animateurs, non qualifiés pour cette prise en charge, sont alors amenés à encadrer ces enfants, cependant que, dans certains départements, de jeunes enfants handicapés sont exclus de ces activités périscolaires et se retrouvent ainsi marginalisés dans leur processus de socialisation auprès de leurs camarades de classe.
Pour les communes ou EPCI, il paraît difficilement concevable d’opérer une rupture d’accueil, potentiellement discriminatoire, entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Plusieurs fois, au cours des auditions de la mission commune d’information, cette difficulté d’accueil des écoliers en situation de handicap pour les activités périscolaires a été évoquée, que ce soit par les représentants des municipalités, par ceux des associations ou de la Caisse nationale d’allocations familiales elle-même. Cependant, aucune réponse n’a été donnée !
Je demande donc au Gouvernement, par votre intermédiaire, monsieur le ministre, de prendre les mesures nécessaires à l’adaptation des missions des auxiliaires de vie scolaire afin qu’ils puissent couvrir non seulement le temps scolaire, mais aussi les périodes réservées aux activités périscolaires telles qu’elles découlent des décrets.
Je demande également, par conséquent, de prévoir les crédits et personnels nécessaires au financement de l’élargissement des missions des AVS aux activités périscolaires afin que les maisons départementales des personnes handicapées puissent réellement déterminer un nombre d’heures suffisant pour couvrir aussi bien le temps scolaire que les périodes d’activités périscolaires, et d’assurer ainsi à l’enfant une prise en charge de qualité.
Monsieur le sénateur, je vous ferai une réponse en deux temps.
Vous évoquez les remarques faites par l’excellente mission commune d’information du Sénat sur les rythmes scolaires. À cet égard, je note le décalage entre, d’une part, les déclarations de Mme Troendlé et de M. Carle, qui ont indiqué publiquement que le décret du 7 mai 2014 visant à la mise en œuvre et à la généralisation des nouveaux rythmes scolaires « allait dans le bon sens » et, d’autre part, le vote qu’ils ont émis le surlendemain, à rebours de leurs déclarations publiques.
Je vous le dis ici, et je n’aurai de cesse de le répéter, cette question, qui relève des intérêts supérieurs de nos enfants – et « l’intérêt supérieur de l’enfant » est d’ailleurs une expression souvent employée actuellement à l’Assemblée nationale à l’occasion de la discussion de la proposition relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant –, ne doit pas être prise en otage par les bureaux nationaux des partis politiques, aussi respectables soient-ils, qui font de cette question des rythmes scolaires un sujet polémique, alors que nous avions recherché un consensus, en tout cas une approche concertée, partagée des rythmes scolaires.
Oui, nous avons décidé de généraliser la réforme des rythmes scolaires aux termes de laquelle la faculté des collectivités à organiser les activités périscolaires concerne, notamment dans le cadre des projets éducatifs territoriaux, les PEDT, les enfants en situation de handicap.
S’agissant du handicap, je suis heureux que vous vous réclamiez des principes qui sont ceux de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République en faveur de l’inclusion scolaire ; et c’est bien le gouvernement dont je suis membre qui a décidé, s’agissant du temps scolaire, qui était en net recul sous le précédent quinquennat, de permettre à tous les auxiliaires de vie scolaire, d’être « déprécarisés », c’est-à-dire de pouvoir bénéficier d’un CDI au terme de six ans d’activité. Par ailleurs, il a introduit le principe d’une démarche de validation des acquis de l’expérience qui leur permettra d’obtenir un diplôme.
Pour ce qui concerne le temps périscolaire, qui est l’objet de vos préoccupations, nous avons, grâce à la loi et au décret, mis en place les projets éducatifs territoriaux, lesquels ont vocation à associer non seulement tous les services et établissements qui concourent à la mission éducative de l’État, mais aussi les associations, les mairies, bref tous les acteurs qui travaillent à l’élaboration des programmes d’activités périscolaires, de façon que celles-ci concernent tous les enfants, sans discrimination liée notamment à une situation de handicap.
La réforme des rythmes scolaires doit donc bénéficier à tous les enfants dans le cadre du temps scolaire, lequel relève d’une prérogative de l’État. En parallèle, il revient aux collectivités locales d’organiser le temps périscolaire. Certes, il ne m’appartient pas de les obliger à le faire, mais je rappelle à l’attention des élus des communes qui disent qu’ils n’organiseront pas d’activités périscolaires que l’État maintiendra quand même la subvention de 50 euros par enfant à leur profit. Il faudra donc que ces maires, qui assument le fait de ne pas organiser de telles activités, nous disent ce qu’ils feront de ce fonds d’amorçage qui leur sera versé en toute hypothèse.
J’espère que leurs explications seront au moins aussi convaincantes que celles du Gouvernement quand il affirme son ambition en faveur de meilleurs apprentissages à l’école primaire pour tous les enfants grâce à la réforme des rythmes scolaires.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, même si sa première partie était très politique, peut-être à raison. Tout comme vous, j’estime que cette question ne doit pas être prise en otage par les partis politiques. Cependant, puisque vous êtes membre du Gouvernement et que celui-ci assume la responsabilité de la conduite des affaires de la France, il faut aussi qu’il assume l’intégralité de ses prérogatives.
Je ne suis pas non plus tout à fait convaincu par la seconde partie de votre réponse relative au financement. Je ne remets pas en cause vos intentions ni votre engagement, mais vous avez fait état à plusieurs reprises de l’action des précédents gouvernements. Or ce ne sont pas les gouvernements nommés par le président Sarkozy qui ont décidé d’engager cette réforme, que je sache !
Il faut donc que le Gouvernement assume toutes les conséquences de sa décision et que la prise en charge des enfants soit assurée dans les meilleures conditions partout, y compris dans les communes rurales moins favorisées.
J’insiste particulièrement sur la situation des AVS, dont les nouvelles missions ne sont pas financées. Même si vous vous êtes préoccupé de remédier à la précarité de leur situation, une partie de leurs nouvelles tâches n’est pas budgétée et les collectivités locales ne sont pas en mesure de faire face à cette charge, ce que je regrette.

La parole est à Mme Françoise Férat, en remplacement de M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 746, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord d’excuser mon collègue Hervé Maurey, retenu dans son département de l’Eure par les obsèques de Denis Régnier, maire de Fourges, dont il tient particulièrement à saluer la mémoire, car l’objet de cette question lui tenait à cœur.
Au nom de mon collègue, j’attire une nouvelle fois votre attention, monsieur le ministre, sur l’épineuse question de la réforme des rythmes scolaires. Pas plus tard que samedi dernier, Hervé Maurey se trouvait devant la préfecture de l’Eure aux côtés de nombreux élus, parents d’élèves et enseignants réunis pour exprimer leur mécontentement.
Je ne reviendrai pas ce matin sur la genèse de cette réforme, décidée dans la précipitation et l’impréparation la plus complète ; je me concentrerai uniquement sur son financement. En effet, les aménagements que vous avez engagés le 7 mai dernier ne règlent nullement le problème du financement.
Comment financer la mise en place de cette réforme, qui coûtera de l’ordre de 200 euros par enfant, avec des ressources moindres ? La diminution des dotations de 11 milliards d’euros d’ici à 2017 équivaudra vraisemblablement à une baisse de 30 % de la dotation globale de fonctionnement. Dans ce contexte, il est tout simplement inacceptable, mais aussi irréaliste, d’imposer de telles charges nouvelles aux collectivités locales.
J’ai pris note de votre engagement à prolonger le fonds d’amorçage pour la rentrée scolaire 2015-2016. Toutefois, vous indiquez que cette prolongation bénéficiera aux communes les plus en difficultés sans que l’on sache ce que cela signifie à ce stade. Il est pourtant clair, monsieur le ministre, et vous le savez aussi bien que moi, que la situation financière des communes rend indispensable la pérennisation de ce fonds.
Malgré leur sens des responsabilités et leur bonne volonté pour répondre au mieux aux intérêts des enfants et de leur famille, les élus se heurtent à des difficultés réelles en termes de locaux, de personnels et de moyens financiers, difficultés que le Gouvernement refuse de prendre en compte.
Cette réforme semble avoir été bâclée. J’en veux pour preuve supplémentaire les conditions de reversement par les communes aux intercommunalités des sommes perçues au titre du fonds d’amorçage. Celles-ci témoignent, si cela était encore nécessaire, de l’impréparation de cette réforme et de la nécessité de la revoir dans son ensemble.
Conformément à l’article 67 de la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République et à son décret d’application du 2 août 2013, les communes perçoivent les sommes versées par le fonds d’amorçage. Cependant, le décret prévoit qu’elles peuvent les reverser à un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, mais seulement si ce dernier exerce conjointement les compétences relatives aux activités périscolaires et au service des écoles. Or la plupart des EPCI n’exercent que la compétence concernant les activités périscolaires.
Dans de tels cas, alors que l’organisation des activités périscolaires et leur financement sont à la charge des EPCI, les communes membres perçoivent les aides versées par le fonds d’amorçage mais ne peuvent pas les reverser, quand bien même elles le souhaiteraient. Vous conviendrez que cette situation est aberrante et témoigne, une nouvelle fois, de l’impréparation de cette réforme décidée sans concertation.
Monsieur le ministre, quelle solution concrète entendez-vous apporter à ce problème ? Quels engagements votre gouvernement est-il prêt à prendre quant à la pérennité des financements ?
Madame la sénatrice, je vais essayer de répondre le plus précisément possible à la question que vous m’avez posée en lieu et place de M. Hervé Maurey.
Vous vous faites l’interprète de la préoccupation de votre collègue quant au manque de préparation et de concertation qui aurait caractérisé la réforme des rythmes scolaires. Permettez-moi de vous le rappeler, cette réforme se fonde sur un consensus dégagé lors du précédent quinquennat, sous les auspices de Luc Chatel, autour du constat de journées de classe trop longues. En matière d’apprentissages fondamentaux, notre école est devenue si inégalitaire qu’elle est désormais championne d’Europe en matière de poids de l’origine sociale dans le destin scolaire des enfants. Telle est la réalité !
Cette réalité appelait des réponses qui, aux yeux de tous – syndicats d’enseignants, organisations de parents d’élèves, élus locaux, chronobiologistes –, supposaient d’alléger le temps travaillé par les enfants et surtout de leur offrir une matinée supplémentaire. C’est la raison pour laquelle la réforme des rythmes scolaires a retenu le principe d’une organisation de la semaine en neuf demi-journées.
Toutefois, le décret pris le 7 mai dernier précise que, en cas de dérogation à ce principe, il est impératif de conserver cinq matinées travaillées, pour mieux apprendre le français et les mathématiques, afin que les enfants ne soient pas en situation de décrochage dès la fin du CM2, comme c’est actuellement la situation pour 15 % d’entre eux. Telle est notre ambition.
Cela posé, quelles sont les prérogatives des collectivités locales et celles de l’État ?
Je tiens à rappeler solennellement tout d’abord qu’il revient à l’État de fixer l’organisation du temps scolaire et qu’aucune commune ne saurait lui disputer cette compétence. Toute commune qui refuserait d’appliquer la réforme des rythmes scolaires à la prochaine rentrée serait donc dans l’illégalité.
Par ailleurs, il revient aux communes et aux EPCI d’organiser les activités périscolaires. En tant que représentant de l’État, il ne m’appartient pas de leur contester cette prérogative. C’est la raison pour laquelle la réforme des rythmes scolaires prévoit que l’organisation des activités périscolaires est facultative. L’État verse, par l’intermédiaire du fonds d’amorçage, 50 euros par enfant, mais l’organisation de ces activités reste facultative.
Néanmoins, la plupart des élus partagent la volonté de construire un projet éducatif cohérent et ambitieux pour favoriser l’épanouissement de tous les enfants. C’est pourquoi ils s’impliquent dans ce projet.
J’insiste cependant sur le caractère facultatif de l’organisation des activités périscolaires. Le fonds d’amorçage est destiné à accompagner l’effort réalisé par les collectivités locales : il est ainsi prévu que leur soient versés 50 euros par enfant, auxquels s’ajoutent 40 euros supplémentaires dans les zones urbaines ou rurales en difficulté. Par ailleurs, les caisses d’allocations familiales peuvent allouer jusqu’à 54 euros d’aide par enfant, dans le cadre de l’accueil de loisirs sans hébergement. Le montant total des aides versées aux communes pour financer les activités périscolaires peut donc s’élever jusqu’à 144 euros par enfant.
Vous avez souligné une réalité, madame la sénatrice. Les aides du fonds d’amorçage sont allouées aujourd’hui aux communes dans lesquelles sont situées les écoles. Les communes doivent reverser ces sommes aux EPCI, dès lors que ceux-ci exercent la double compétence « service des écoles » et « activités périscolaires ». Lorsqu’une seule compétence est transférée, les communes conservent la faculté de reverser les aides perçues, si elles le souhaitent.
Je le rappelle, la réforme porte bien sur l’organisation des temps scolaires. Concentrons-nous donc sur les rythmes biologiques et d’apprentissage des enfants. Il est important d’organiser des activités périscolaires, mais celles-ci restent facultatives, je le répète. Le Gouvernement, à commencer par le ministre chargé de l’éducation nationale, veut se concentrer sur l’essentiel : faire en sorte que, à la sortie de l’école primaire, les enfants sachent parler le français, lire, écrire et compter correctement, ce qui est de moins en moins en le cas depuis quelques années.
Cette réalité nous préoccupe tous légitimement et cette réforme vise à y répondre aujourd’hui. J’espère que vous serez tous au rendez-vous d’une rentrée scolaire réussie dès le 2 septembre prochain, puisque c’est la date à laquelle tous les écoliers de France feront leur rentrée.

Monsieur le ministre, excusez ma prétention, mais j’estime avoir jusqu’à présent réussi toutes les rentrées scolaires avec les moyens qui m’étaient accordés ! Vous engagez aujourd’hui une réforme qui ne va pas améliorer la situation et c’est la raison pour laquelle nous réagissons. Et de grâce, épargnez-nous l’argument de l’héritage, que vous avez encore invoqué ce matin, nous finissons par nous en lasser !
Cela étant, vos réponses ne m’ont pas convaincue. Nous sommes tous d’accord sur le constat, mais la réforme des rythmes scolaires ne règle pas les difficultés relevées. C’est la raison pour laquelle la mission commune d’information du Sénat à laquelle j’appartiens n’a pas adopté de rapport final. Pour compléter votre information, je précise que je n’ai pas été influencée. Si vous en doutiez, lisez le compte rendu des auditions : je fais les mêmes constats et je pose les mêmes questions depuis le début des travaux de la mission.
Quoi qu’il en soit, dans mon département, je rencontre des problèmes identiques à ceux qui ont été évoqués par Hervé Maurey dans sa question. Les maires, notamment ceux qui sont nouvellement élus, sont totalement démunis et inquiets dans la perspective de la prochaine rentrée. À cela s’ajoute la fusion parfois difficile de certaines intercommunalités. Le caractère aberrant des modalités de fonctionnement du fonds d’amorçage n’en prend que plus de relief.
Avec tous ces rafistolages, vous vous éloignez de l’idée initiale, à savoir répondre au problème de l’échec scolaire, point sur lequel nous sommes d’accord. Vous perdez également de vue la priorité de l’intérêt de l’enfant.
Monsieur le ministre, il faut différer la généralisation de la réforme, faire de la prochaine année scolaire une année d’expérimentation, procéder à l’évaluation de celle qui s’achève, avant d’en passer par la loi.
M. Jean Boyer applaudit.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 749, adressée à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interroger aujourd’hui sur le manque de remorqueurs dans le golfe de Gascogne.
Depuis le mois d’août 2011, le remorqueur de haute mer Abeille Languedoc, qui était basé à La Rochelle, est remonté dans le pas de Calais, à la suite de la décision du gouvernement britannique de ne pas renouveler le contrat d’affrètement du remorqueur qui assurait la sécurité maritime dans ce détroit. La ministre chargée de l’écologie de l’époque, Nathalie Kosciusko-Morizet, s’était engagée à obtenir un navire en remplacement : promesse non tenue !
Sont donc actuellement présentes sur nos côtes : l’Abeille Languedoc, pour protéger le pas de Calais, l’Abeille Liberté à Cherbourg et l’Abeille Bourbon à Brest. En revanche, entre Brest et Bayonne, plus aucun navire ne permet de protéger l’ensemble de nos côtes atlantiques.
Pourtant, comme partout dans le monde, le trafic maritime s’accroît chaque année dans le golfe de Gascogne. En outre, nous devons prendre en compte le gigantisme des porte-conteneurs de nouvelle génération, transportant plus de 16 000 conteneurs, et bientôt l’arrivée de navires pouvant en transporter jusqu’à 20 000. Le développement des paquebots est également un élément à ne pas négliger, puisque ce type de navire peut désormais embarquer 8 000 passagers et plus de 2 000 membres d’équipages. Tout cela rend impératif une meilleure protection du littoral.
La situation actuelle ne peut perdurer et l’utilité de nos remorqueurs n’est plus à démontrer. Leur nature spécifique, ainsi que le professionnalisme de leurs équipages et équipes de sauvetage, a en effet permis d’éviter vingt et une catastrophes maritimes et écologiques, depuis leur mise en place en 1978, à la suite du naufrage de l’Amoco Cadiz.
Entre 2006 et 2011, le remorqueur Abeille Languedoc avait effectué trente-cinq opérations : dix-sept remorquages ou assistances, treize escortes de navires et cinq opérations diverses concernant des conteneurs, ou encore du bois à la dérive. Les navires marchands utilisent très souvent du fioul lourd pour leur propulsion, à l’instar de l’Erika ou encore du Prestige, restés tristement célèbres. Ainsi, toutes ces opérations correspondent à des milliers de tonnes de fioul lourd ramenées à bon port, au lieu d’être déversées sur nos plages. La mise en service et le développement non seulement de l’autoroute de la mer de Gijon à Saint-Nazaire, mais aussi des ports atlantiques, comme Nantes-Saint-Nazaire, La Pallice ou Le Verdon, imposent de maintenir un moyen de sauvetage efficace et prêt à intervenir vingt-quatre heures sur vingt-quatre, trois cent soixante-cinq jours par an, sous l’autorité du préfet maritime de l’Atlantique.
Il serait par conséquent urgent d’investir dans deux remorqueurs polyvalents capables de récupérer des conteneurs en mer. Cet investissement sera grandement rentabilisé par les marées noires qu’il permettrait d’éviter. La France se doit, en effet, de détenir les moyens nautiques nécessaires pour venir en aide aux équipages et aux biens.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, de bien vouloir m’indiquer quels moyens le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour assurer la protection des côtes entre Brest et Bayonne.
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser l’absence de Frédéric Cuvillier qui aurait aimé vous répondre directement, mais a dû se rendre à Berlin pour participer au conseil des ministres « Airbus ».
En 2011, le gouvernement britannique a décidé de mettre fin à l’affrètement du remorqueur de haute mer Anglian Monarch, basé dans le pas de Calais. Le gouvernement français a alors décidé de redéployer dans ce détroit le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Languedoc, basé initialement à La Rochelle, afin de maintenir un moyen de remorquage dans une zone de convergence du trafic maritime qui voit passer chaque année 100 000 navires et près de 170 millions de tonnes de marchandises dangereuses.
Cette décision a été prise sur la base d’une analyse rigoureuse des accidents de la navigation maritime qui a montré que les zones les plus accidentogènes sont celles de resserrement du trafic près des côtes, c’est-à-dire celles qui sont situées près des abords du cap Finistère, de l’île d’Ouessant jusqu’au détroit du pas de Calais.
Cette décision s’appuyait également sur une étude du ministère de la défense qui concluait à un taux d’utilisation très faible de l’Abeille Languedoc en zone Atlantique Ouest.
L’Abeille Bourbon, basée à Brest, a un rayon d’action et des caractéristiques qui lui permettent d’assister des navires en difficulté dans le golfe de Gascogne.
Parallèlement et en cas d’avaries multiples dans cette zone, le plan d’intervention franco-espagnol dénommé « Biscaye plan » peut être activé pour compléter le dispositif d’assistance.
Par ailleurs, la France dispose de deux bâtiments de soutien, d’assistance et de dépollution basés à Brest, l’Alcyon et l’Argonaute, qui sont en alerte pour faire face aux risques engendrés par les conteneurs perdus en mer. Ainsi, par exemple, il a été possible de récupérer les 528 conteneurs perdus cet hiver par le porte-conteneurs Svendborg Maersk au large de Brest.
Le dispositif juridique et opérationnel existant permet de répondre aux obligations internationales et européennes, comme la Commission européenne l’a d’ailleurs reconnu à travers l’audit conduit en début d’année 2013.

Monsieur le ministre, je crains que votre réponse ne donne pas satisfaction aux professionnels de la mer. En effet, selon moi, l’Abeille Languedoc, basée précédemment à La Rochelle, avait une certaine utilité.
De plus, il me paraîtrait préférable d’anticiper en se situant dans une démarche préventive, plutôt que de se voir contraint de mobiliser des navires permettant de dépolluer.
Il serait intéressant que les services du Gouvernement réfléchissent un peu plus sur cette problématique, car il est beaucoup plus coûteux pour la puissance publique de devoir réparer les dégâts écologiques commis par des navires polluants – nous avons malheureusement tous en mémoire les naufrages du Prestige, de l’Amoco Cadiz et autres navires de ce genre – que d’anticiper !
Au-delà des éléments que vous venez de me communiquer, il me serait agréable, monsieur le ministre, que vous interveniez auprès de votre collègue chargé des transports pour qu’une réponse plus positive soit apportée aux professionnels de la mer responsables de la sécurité de nos côtes atlantiques.

La parole est à M. Robert Tropeano, en remplacement de M. Christian Bourquin, auteur de la question n° 743, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Christian Bourquin ne pouvant être présent ce matin, il m’a demandé d’intervenir à sa place, ce que je fais avec plaisir puisque les problèmes rencontrés en Languedoc-Roussillon se posent également dans les Pyrénées-Orientales, l’Aude, le Gard ou l’Hérault.
Depuis les vendanges de l’année 2012, les vignobles du sud de la France n’ont plus droit aux aides communautaires aux moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés. Certes, l’Organisation commune du marché – l’OCM – de 2008 prévoyait la fin de ces aides au 31 juillet 2012. Toutefois, entre-temps, un dispositif pérenne aurait dû être mis en place, ce qui n’a pas été le cas. La suppression de ces mécanismes entraîne des surcoûts très importants pour les caves particulières et les coopératives du Languedoc-Roussillon.
Celles-ci ne sont pas autorisées à enrichir le vin par chaptalisation, c’est-à-dire par ajout de saccharose, contrairement à leurs homologues du reste de la France et d’une partie de l’Europe. Or la chaptalisation coûte entre trois et quatre fois moins cher que le recours aux concentrés et moûts concentrés rectifiés. Dès lors, vous le comprenez, nous nous trouvons dans une situation de concurrence déloyale. Mon intervention a-t-elle pour autant pour finalité de vous demander, monsieur le ministre, de nous autoriser à recourir à la chaptalisation ? Je réponds : « non » !
Les vins du Languedoc-Roussillon se distinguent par leur qualité naturelle et, contrairement à d’autres, ils ne contiennent que du raisin. Leur rayonnement à travers le monde entier se confirme d’année en année, notamment à travers le label « Sud de France ». La capacité à assurer ce rayonnement, à faire connaître et à vendre ces produits, tout comme à fidéliser la clientèle repose sur cette authenticité.
Aussi, la seule solution viable est d’obtenir au plan communautaire la remise en place de l’aide aux moûts concentrés et moûts concentrés rectifiés.
Eu égard à l’environnement concurrentiel mondial dans lequel se situe la viticulture du Languedoc-Roussillon, cette solution fait l’unanimité au sein de la profession agricole.
Monsieur le ministre, ma question est donc simple : quelles mesures comptez-vous prendre pour que les viticulteurs du Languedoc-Roussillon puissent bénéficier d’une compensation financière, et ce, dès les vendanges de cette année ?
Monsieur le sénateur, vous avez soulevé la question posée par l’enrichissement en sucre des vins à l’échelle européenne.
Vous l’avez rappelé, la décision de supprimer les subventions liées à l’enrichissement par ajout de moûts concentrés ou de moûts concentrés rectifiés a été prise dans le cadre de l’OCM, en 2008, et devait entrer en application dès 2012.
Vous avez évoqué la chaptalisation, qui est l’autre manière d’enrichir les vins en sucre et qui est réservée, dans le cadre de l’OCM viticole, à l’échelon européen, aux régions les moins ensoleillées, celles qui sont situées au nord de l’Europe. Des dérogations sont toutefois prévues en cas de nécessité, ce qui a donné lieu, dès l’an dernier, à des discussions entre les différentes régions viticoles.
Ainsi, en Languedoc-Roussillon, un débat, qui n’a pas été totalement arbitré, a opposé les partisans de la chaptalisation à ses détracteurs. Ces derniers, je tiens à le dire ici, m’adressant, au-delà de vous, à tous les viticulteurs du Languedoc-Roussillon, soulignaient l’évolution majeure et extrêmement positive de l’ensemble du vignoble de cette région devenu de haute qualité. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour saluer l’engagement de cette filière.
Cela étant, nous allons essayer de renégocier au plan européen. Convenez toutefois que, sur cette question, la négociation ne sera pas facile entre pays producteurs et consommateurs. Vous vous en souvenez, monsieur le sénateur, les droits de plantation ont déjà été revus, mais il est des sujets sur lesquels une renégociation est beaucoup plus difficile. Nous devons néanmoins engager le débat et trouver des solutions, puisqu’il s’agit là d’éléments stratégiques.
À l’instar de ce que j’avais demandé dans le cadre du plan stratégique sur la viticulture, il faut aussi déterminer des objectifs clairs et en connaître les raisons.
Par ailleurs, à l’échelon européen, le changement ne pourra pas intervenir dès les vendanges de cette année. Quoi qu’il en soit, j’ai donné des instructions en vue d’harmoniser le dispositif au niveau national et d’éviter les difficultés survenues l’an dernier au sujet de la chaptalisation.
Tel est donc mon état d’esprit : poursuivre la même stratégie, à savoir la production de vins de grande qualité, à l’instar de ceux qui bénéficient du label « Sud de France », et, parallèlement, trouver une solution à la question de l’enrichissement dans le cadre européen, au sein duquel la chaptalisation en tant que telle a été réservée aux pays du Nord. S’agissant des moûts concentrés et des moûts concentrés rectifiés, il faudra revenir sur la décision prise dès 2008. Il y va de l’intérêt des viticulteurs de votre région, monsieur le sénateur.

Monsieur le ministre, comme vous l’avez souligné, les vignerons du Languedoc-Roussillon ont fait d’énormes efforts pour produire des vins de très grande qualité. Ce sont leurs préoccupations et leurs inquiétudes par rapport aux moûts concentrés rectifiés que nous essayons de relayer aujourd'hui. Je pense qu’ils trouveront corrects les solutions et le soutien que vous souhaitez leur apporter et dont je vous remercie.

La parole est à M. Yannick Botrel, auteur de la question n° 762, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les modalités de la vidange du barrage de Guerlédan, que vous connaissez bien, site touristique très fréquenté en limite des départements du Morbihan et des Côtes-d’Armor.
La vidange totale du barrage, ouvrage soumis à la législation hydro-électrique, est programmée en 2015. Huit mois d’intervention sont nécessaires, dont six mois d’assec.
Il sera procédé à la vidange au cours des mois d’avril et de mai 2015 et le nouveau remplissage aura lieu à compter du mois de novembre de la même année.
Les autorités préfectorales prévoient une affluence massive autour du barrage de Guerlédan durant cette période, comme cela fut le cas lors de la précédente vidange en 1985. Elles envisagent une fréquentation de 2 et 3 millions de visiteurs, et une foule de plusieurs milliers de personnes au cours des week-ends estivaux.
En conséquence, la zone de mise en sécurité des visiteurs est importante et s’étend sur plusieurs communes, dans les Côtes-d’Armor en particulier.
S’agissant du stationnement, les services de l’État ont prévu un conventionnement avec les agriculteurs pour la mise à disposition de parcelles, ainsi que l’indemnisation correspondante de leur occupation.
Toutefois, la difficulté majeure réside dans le fait que 2015 sera la première année d’application de la nouvelle PAC. Or la déclaration des terres agricoles éligibles à la PAC est effectuée en début de période et, de fait, exclura les surfaces non exploitées.
Dans le cas particulier qui nous préoccupe, il y aurait donc une incidence négative importante pour les exploitants en raison de la non-activation de droits sur plusieurs années.
Les agriculteurs concernés, au nombre d’une vingtaine, attendent une réponse claire leur garantissant les droits PAC en préalable d’un accord de mise à disposition, et on les comprend.
Face à cette réglementation relevant de l’Union européenne, des dispositifs de compensation doivent être imaginés. Est-il concevable qu’une dérogation puisse être accordée en raison du caractère très spécifique de l’opération ?
Par ailleurs, le comité de pilotage a mis en avant une autre possibilité consistant à mettre à disposition des agriculteurs des parcelles appartenant à l’État. En effet, celui-ci dispose de réserves foncières à proximité des lieux pressentis pour la réalisation de parkings. Ainsi, les déclarations PAC pourraient être transférées sur ces surfaces de terres disponibles et publiques. Dans cette perspective, se pose la question de la faisabilité réglementaire, tout comme celle de la durée de mise à disposition, qui devrait être de six ans.
Quelle que soit la solution retenue, les élus locaux, qui sont en première ligne, attendent, comme les agriculteurs, une réponse claire au problème soulevé.
Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, quelles options vous pourriez envisager en réponse à ma question et quelle pourrait être l’implication de vos services.
Monsieur le sénateur, je connais bien le lac de Guerlédan, à proximité duquel je passe régulièrement pour me rendre dans le centre des Monts d’Arrée. Certes, on le voit moins bien à présent que l’on emprunte la route à quatre voies.
Je reviens au sujet que vous avez évoqué, la vidange de ce lac et les conséquences qu’elle peut avoir, en particulier sur toutes les terres agricoles qui sont limitrophes – il en existe de nombreuses sur les communes auxquelles vous avez fait référence. Cette opération pourrait affecter la mise en œuvre de la politique agricole commune, plus spécifiquement les droits à paiement de base, les DPB, lesquels remplacent les droits à paiement unique, les DPU.
Dès cette année, tous les DPU peuvent être activés, sans anticiper en quoi que ce soit ce se passera en 2015, dans le cas que vous évoquez, l’occupation de certaines parcelles agricoles résultant de la vidange du barrage en question. Ainsi, les agriculteurs peuvent percevoir l’intégralité des paiements correspondants, les travaux n’ayant pas encore commencé.
Par ailleurs, le mécanisme dit de « clause de gains exceptionnels », qui sera mis en place en 2015 afin de réduire proportionnellement le montant de DPB à attribuer à un exploitant lorsqu’il a cédé des terres entre 2014 et 2015, ne s’appliquera pas aux exploitants concernés, dans la mesure où il s’agit non d’une cession volontaire, mais d’une occupation de terres par des autorités publiques.
Dès lors, la valeur initiale globale du portefeuille des DPB des agriculteurs ne sera pas affectée par la non- déclaration de certaines surfaces en 2015.
La part des surfaces d’un exploitant qui sera utilisée à partir du mois d’avril 2015 afin de permettre le stationnement des visiteurs ne pourra être prise en compte dans la détermination du nombre de droits à créer à cet exploitant, puisqu’elle ne portera pas d’activité agricole.
Ainsi, pour un exploitant concerné par une occupation des surfaces à partir du mois d’avril 2015, la valeur faciale initiale de ses DPB sera plus élevée du fait de l’occupation des terres qui entraîne une concentration de son portefeuille, lequel conserve sa valeur, sur un nombre moindre de droits.
Autrement dit, pour l’ensemble des terres d’une exploitation dont une partie va être utilisée à des fins de stationnement, on remontera les DPB sur les terres agricoles effectives, afin de permettre aux agriculteurs de retrouver ensuite la valeur globale des DPB.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse très complète et très circonstanciée, qui est de nature à mettre un terme à la situation de blocage que nous avons constatée lors de réunions techniques préparatoires à cet événement
Si la profession agricole est bien évidemment concernée, les élus, en particulier les maires, sont en première ligne dans cette affaire, car ils sont extrêmement sollicités par leurs administrés agriculteurs.
Monsieur le ministre, votre réponse fera progresser rapidement la discussion au cours des réunions techniques qui vont se tenir à un rythme rapproché durant la période qui nous sépare de l’année 2015 et d’un événement majeur. Car, je le répète, paradoxalement, c’est au moment où le lac de Guerlédan sera vide que le nombre de visiteurs sera encore plus important que les années précédentes ! Mais nous avons déjà connu pareille situation par le passé.
Je souhaiterais maintenant évoquer un autre point qui vous concerne moins directement, mais qui me paraît quelque peu surprenant et déplorable. Je l’ai dit, les communes vont être sollicitées, et leurs budgets mis à contribution. Or les services de l’État n’ont aucun moyen de répondre aux attentes des maires s’agissant des dépenses que les communes vont devoir supporter et qui représentent des sommes minimes, de l’ordre de 60 000 à 70 000 euros ; EDF pourrait d’ailleurs participer à ces frais. Ce serait également un élément qui permettrait de faire avancer les choses.
Si votre influence vous le permet, monsieur le ministre, il serait bon que vous puissiez relayer ce message, afin de faciliter la suite de l’opération.

La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 744, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, ma question porte sur l’arrivée à son terme du mandat de l’Observatoire national de l’enseignement agricole, l’ONEA, qui a été très pertinent et très productif pour la compréhension des enjeux de cette formation spécifique.
En effet, le mandat des dix membres de l’ONEA pour la période 2009-2014 s’achève. Aucun décret n’est, me semble-t-il, en préparation, afin de nommer les prochains membres ou, le cas échéant, de proroger le mandat des membres actuels de quelques mois, comme le prévoit le règlement et comme cela s’est déjà fait auparavant.
Je ne comprends pas cette absence de mise en conformité avec les textes, et ce, pour deux raisons.
D’une part, les personnalités désignées dans cette instance ont démontré une réelle motivation et ont fourni un travail effectif, qui a été rendu public dans leur rapport de 2013. La diversité de ces membres et leur complémentarité ont permis la constitution d’un corpus de propositions pertinentes, en phase avec cette formation originale.
D’autre part, le Gouvernement a, par votre voix, monsieur le ministre, plusieurs fois avancé son soutien à l’enseignement agricole. Reconnaissez que l’absence de décret rend perplexe et laisse paraître une volonté de mettre purement et simplement fin à l’existence de l’ONEA.
Comme je le précisais à l’instant, l’observatoire, présidé par l’ancien ministre Henri Nallet, a remis en 2013 un rapport intitulé L’enseignement agricole face aux défis de l’agriculture à l’horizon 2025. Dans ce document, ont été imaginées et mises en forme de nombreuses idées et préconisations permettant d’inscrire la formation des futurs acteurs du monde rural dans une agriculture du XXIe siècle.
L’ONEA a présenté sept recommandations dressant le panorama de l’enseignement agricole et de sa gouvernance.
Plus largement, comme vous le savez, les compétences de cette instance d’évaluation et de prospective, placée sous votre autorité, s’étendent à l’ensemble du dispositif de formation agricole : formation scolaire, apprentissage, formation continue, enseignement supérieur agronomique et vétérinaire. Elles portent sur toutes les missions de l’enseignement agricole public et privé : formation ; insertion sociale, scolaire et professionnelle ; animation et développement des territoires ; développement, expérimentation et innovation agricoles et agroalimentaires ; coopération internationale.
Depuis 1996, l’ONEA apporte une aide à la décision et au pilotage à l’ensemble des acteurs de l’enseignement agricole. Contribuant à une meilleure connaissance de cet enseignement, l’observatoire participe aussi à l’information et à la communication sur les spécificités de celui-ci auprès des partenaires et du grand public.
Ancré dans la réalité des problématiques de terrain, l’ONEA a, par exemple, identifié la gouvernance disparate de l’enseignement agricole suivant les régions. Il a ainsi préconisé de redéfinir – point très important selon lui – un projet global et fédérateur, de repenser son pilotage et sa gouvernance, d’accompagner l’autonomie des établissements. Il a constaté qu’il fallait valoriser et faciliter le rôle et l’implication des professionnels de l’agriculture dans l’orientation stratégique de notre formation. Lors de la deuxième lecture du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, je ferai de nouveau, monsieur le ministre, des propositions sur ces points.
Son histoire, ses travaux et ses analyses, la diversité et la complémentarité de ses membres confèrent à l’ONEA une véritable légitimité pour s’inscrire dans la durée et continuer à apporter son expertise et son regard sur l’enseignement agricole.
L’ONEA ne peut pas disparaître ! Aucune instance de concertation aussi large ne pourra donner des orientations si pertinentes pour l’enseignement agricole.
Monsieur le ministre, je souhaiterais que vous m’indiquiez la date à laquelle sera publié le décret de désignation des membres de l’observatoire.
Madame la sénatrice, je sais votre attachement à l’enseignement agricole. Je l’ai constaté durant les longues heures de débat que nous avons eu sur le projet de loi d’avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Je découvre aujourd'hui que vous tenez également à l’ONEA.
Vous l’avez rappelé, cet observatoire a produit un rapport qui nous a été rendu par Henri Nallet. Ce document a été plus qu’utile, puisqu’il a servi à la préparation de la partie relative à l’enseignement agricole du texte précité.
Vous avez également rappelé les missions de l’observatoire quant à l’état de l’enseignement agricole, public et privé, ses évolutions et ses perspectives d’avenir, l’adaptation de ses contenus et des méthodes, la mise en œuvre par ses établissements des missions qui leur sont dévolues, les besoins en matière d’emploi et les qualifications, ainsi que l’insertion des élèves, apprentis et stagiaires.
À titre personnel, je suis favorable au maintien d’un tel observatoire, car j’estime, tout comme vous, que cet organisme est utile pour éclairer les grands enjeux de l’enseignement agricole. D’ailleurs j’observe qu’un observatoire est aussi visé dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République. Cela étant, le mandat des membres de l’ONEA a pris fin le 31 décembre 2013.
À cet égard, je souhaite que l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt soit achevé le plus rapidement possible, malgré un calendrier parlementaire chargé, pour disposer d’un cadre définitif. Ensuite, nous pourrons publier un décret qui définira les missions et les objectifs de cet observatoire et lui redonnera une place dans ce nouveau cadre.
J’indique enfin que grâce, à l’existence de cet organisme, des personnalités sont mobilisées afin d’appuyer la politique du ministère et, surtout, d’anticiper les évolutions.

Monsieur le ministre, vos propos m’apportent entière satisfaction. Au vu des documents dont je dispose, je vous accordais un petit sursis jusqu’au mois de juin. Vous avez évoqué l’achèvement du mandat des membres de l’observatoire à la fin de l’année 2013 : cela « précipitera » peut-être quelque peu la préparation du prochain décret…
Certes, la discussion du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt est importante. Pour autant, il conviendrait, me semble-t-il, de mettre en place dès que possible le nouvel observatoire, car une trop longue attente soulèverait de nombreuses questions et risquerait de susciter des inquiétudes inutiles.
Je ne vous cache pas que le rapporteur pour avis du budget que je suis se réfère très régulièrement aux préconisations de cet observatoire. Il serait dommage que nous ne puissions disposer de son travail cette année.
Je vous remercie toutefois, monsieur le ministre, de vos propos très rassurants.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 759, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Monsieur le ministre, ma question est relative à la politique de sécurité routière française, qu’il convient de comparer à celle d’autres pays européens de la zone euro.
La répression pratiquée en France avec la multiplication incessante du nombre de radars ne constitue en aucun cas l’unique solution à une politique équilibrée de sécurité routière et de responsabilisation du conducteur.
Le président Chirac en avait fait l’un de ses grands chantiers. Acceptée au début, la mise en place des radars automatiques est aujourd’hui ressentie comme un moyen pour l’État de disposer d’une véritable manne financière, et non comme un outil servant à diminuer le taux de mortalité : les Français ne sont pas dupes sur ce point.
La politique du radar est utile et procure des résultats – on voit la différence avec les pays qui n’en possèdent pas ou qui n’en ont que très peu –, mais elle doit être équilibrée. Le tout-radar est excessif !
Je prendrai l’exemple de l’Allemagne, qui pratique une politique basée sur la confiance et non sur le tout-répressif. Les conclusions sont sans appel : la population de ce pays est supérieure à celle de la France, le nombre de permis en circulation et le parc automobile sont plus importants et pourtant la mortalité sur les routes y est plus faible que chez nous.
Bien sûr, dans les zones urbaines accidentogènes, il existe un contrôle-sanction, mais sur de nombreuses autoroutes, aucune limitation de vitesse n’est appliquée.
Dans ce pays, depuis vingt ans, le nombre d’accidents mortels a diminué de 71 %, malgré une augmentation de 25 % du trafic et de 17 % du nombre de véhicules.
Le tout-répressif, quand il s’accompagne de sanctions drastiques à l’encontre des automobilistes qui commettent de petites infractions, a ses limites. Monsieur le ministre, ne me dites pas qu’un excès de vitesse de cinq à huit kilomètres par heure entraîne une perte de contrôle du véhicule et une augmentation du potentiel de mortalité ! Pourtant, nombreux sont ceux qui sont sanctionnés pour avoir dépassé de peu la vitesse autorisée.
Ces petits excès, qui sont les plus verbalisés, ne sont pas responsables de la mortalité sur nos routes. Ce sont bien les chauffards – ceux qui consomment de l’alcool, qui se droguent ou qui vont trop vite – qu’il convient de sanctionner fermement.
Le pari allemand est payant : notre voisin occupe la cinquième place du classement européen en matière de sécurité routière, alors que notre pays se situe en huitième position.
Monsieur le ministre, pourquoi continuer la politique du tout-répressif ? Il n’échappe à personne que la mission est aussi de remplir les caisses de l’État. Seriez-vous prêt à engager définitivement, dans la concertation, de véritables réformes structurelles d’ampleur, fondées notamment sur un rapport de confiance entre l’État et les automobilistes ?
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser le ministre de l’intérieur, qui préside actuellement une réunion de préfets place Beauvau.
Les actions menées par le Gouvernement en matière de sécurité routière ont une seule finalité, que nous partageons tous : sauver des vies. Pour parvenir en dessous du seuil des 2 000 tués par an sur les routes françaises d’ici à la fin de la décennie, le Gouvernement mobilise tous les leviers d’action à sa disposition.
La prévention n’est pas une alternative à la sanction. En matière de sécurité, ces actions sont complémentaires.
Le Gouvernement agit résolument en matière de prévention : l’État conçoit et finance des campagnes de communication nationales, finance des actions de sensibilisation et travaille avec les collectivités locales pour que les infrastructures routières soient plus sûres. Vous le savez, dans chacun de nos départements, des améliorations peuvent toujours être apportées en la matière.
Contrairement à ce que vous indiquez, la lutte contre l’insécurité routière n’a en aucun cas un objectif financier pour l’État. Le contrôle automatisé, directement responsable de la baisse de la vitesse moyenne pratiquée sur les routes, a permis de sauver plus de 30 000 vies.
En 2013, le produit des amendes résultant des infractions constatées par le biais de radars automatisés a représenté 708 millions d’euros. Sur cette somme, 238 millions d’euros ont été reversés aux collectivités locales pour améliorer leur réseau de transport, ce qui est très important, 170 millions d’euros ont contribué au budget de l’AFITF, l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, et 61 millions d’euros ont été affectés au désendettement de l’État.
Ces 708 millions d’euros doivent être mis en regard des 21, 7 milliards d’euros qu’ont coûtés en 2013 les accidents de la route.
Je souhaite également vous répondre sur la question des petits excès : alors que la part des accidents dus aux grands excès de vitesse a fortement diminué, passant de 38 % à 15 % entre 2001 et 2010, les accidents mortels consécutifs à des excès inférieurs à dix kilomètres par heure représentent désormais 46 % des accidents mortels dus à des excès de vitesse sur le réseau bidirectionnel.
Quant à la lutte contre l’alcool et les stupéfiants, elle constitue également une priorité : plus de 10 millions de contrôles d’alcoolémie, ciblés sur les périodes et les lieux les plus sensibles, ont été menés par les forces de l’ordre l’année dernière.
S’agissant enfin des comparaisons avec l’Allemagne auxquelles vous avez procédé en matière de lutte contre la vitesse excessive, vous me donnez l’occasion de répondre à quelques idées reçues : vous avez évoqué les zones dites « ouvertes » des autoroutes allemandes. Rapportée au kilomètre, la mortalité sur les autoroutes allemandes est plus forte que sur les autoroutes françaises. Par ailleurs, comme vous l’avez indiqué, le nombre de morts rapporté au trafic a baissé de 71, 6 % entre 1990 et 2010 en Allemagne. Mais il a diminué de 72, 3 % en France durant la même période. Nous avons donc été plus efficaces en ce domaine, ce dont nous ne pouvons que nous réjouir !
Enfin, alors que le nombre d’accidents corporels diminuait de 20, 5 % en Allemagne pendant cette même période, il baissait de 59 % en France.
En déployant sa politique de sécurité routière, le Gouvernement entend donc non pas infantiliser et réprimer à l’excès les Français, mais agir de manière équilibrée sur tous les leviers pour qu’un nombre toujours plus limité de nos concitoyens perde la vie au volant.

Monsieur le ministre, je ne sais pas d’où proviennent vos chiffres : je conteste le fait que 46 % des accidents mortels soient dus à de petites infractions.
Mon propos concerne les toutes petites infractions. Les conséquences de votre politique sont les suivantes : une augmentation du nombre de conducteurs sans permis, qui s’élève à plus de 600 000 en France ; un encouragement, pour nos concitoyens qui habitent le nord de la France, par exemple, à passer leur permis de conduire en Belgique, où celui-ci revient beaucoup moins cher et n’est pas un permis à points, mais est naturellement valable dans toute l’Union européenne.
Telle est votre politique : sanctionner toujours plus les mêmes, à savoir les travailleurs, ceux qui se lèvent tôt le matin, qui perçoivent un salaire ne leur permettant pas d’acheter des points sur internet – cette pratique existe, mais elle est très onéreuse – et pour lesquels la route est synonyme de gouffre financier !
Dans mon département, voilà quinze jours, au cours d’un week-end, 500 verbalisations ont été enregistrées avec les nouveaux radars pour des excès de vitesse, la grande majorité correspondant à de très petites infractions.
Cela étant, monsieur le ministre, l’aspect financier compte bien puisque vous nous avez expliqué que les sommes ainsi perçues étaient en partie affectées au désendettement de l’État.
Le système en cause est synonyme d’une incroyable injustice. Il faut l’adapter, le modifier, et cela en concertation avec les automobilistes et leurs représentants !

La parole est à M. Dominique Bailly, auteur de la question n° 733, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai souhaité, ce matin, attirer l’attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social sur le nombre alarmant de chômeurs dans le Nord-Pas-de-Calais.
À la fin du mois de janvier dernier, ma région s’est malheureusement illustrée par un triste record : 14 % de la population active était sans emploi, soit 269 600 demandeurs d’emploi en catégorie A et plus de 375 000 demandeurs d’emploi, toutes catégories confondues, inscrits à Pôle emploi.
Les dernières statistiques mensuelles du chômage montrent un très léger recul à la fin du mois de mars : elles font apparaître à présent un peu plus de 371 000 demandeurs d’emploi inscrits, toutes catégories confondues. Ce chiffre reste néanmoins extrêmement alarmant, monsieur le ministre, surtout lorsque l’on relève que plus de 70 000 de ces personnes sont âgées de moins de vingt-cinq ans.
Vous le savez, derrière ces chiffres, se trouvent des femmes et des hommes en situation de précarité, des jeunes qui restent dépendants de leurs parents et ne peuvent pas construire leur vie, ou encore des seniors qui vivent dans l’inquiétude de ne plus pouvoir payer les factures à la fin du mois.
Le Gouvernement a appelé à une mobilisation générale en 2014 pour faire reculer ce fléau qu’est le chômage, et ce durablement, avec une mise en œuvre rapide du pacte de responsabilité, comprenant des engagements chiffrés en termes de création d’emplois.
Aussi, je souhaite connaître, monsieur le ministre, les dispositions que le Gouvernement entend prendre dans le cadre de ce pacte de responsabilité pour réduire le taux de chômage dans le Nord-Pas-de-Calais, ainsi que les perspectives de création d’emplois dans cette région.
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, qui est retenu dans son ministère par une rencontre avec les représentants des régions sur les grandes questions posées par la formation professionnelle.
J’en viens à votre question. Dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans les autres régions marquées par des difficultés structurelles, l’État fait jouer la solidarité territoriale en y mobilisant plus de moyens que son poids économique. Toujours dans le Nord-Pas-de-Calais, les dépenses de l’État en matière de politique d’emploi, qui s’élèvent à près de 1 milliard d’euros, atteignent 8, 4 % des dépenses nationales, soit un taux supérieur de deux points au poids économique de la région, supérieur également à son poids démographique et à son poids au regard du chômage.
Au cours des dernières années, tous les leviers ont été activés à l’égard de cette région pour lutter contre la crise.
Pour prévenir les licenciements économiques et aider les entreprises à passer les périodes de baisse d’activité, l’activité partielle est fortement mobilisée : 28 000 salariés en ont bénéficié en 2013, pour une dépense de l’État de 16 millions d’euros.
Lorsque les licenciements économiques n’ont pu être évités, le contrat de sécurisation professionnelle permet un accompagnement renforcé et des formations individualisées pour retrouver rapidement le chemin de l’emploi ; plus de 7 500 personnes en ont bénéficié en 2013.
Pour lutter contre le chômage de longue durée, les contrats aidés sont activés à plein. Dans le Nord-Pas-de-Calais, ils représentent près de 12 % des contrats aidés de France métropolitaine, soit plus de 50 000 en 2013. Dans cet ensemble, les emplois d’avenir ont bénéficié à des jeunes sans formation, qui avaient besoin de la main tendue de l’État pour prendre la place qui leur est due sur le marché du travail. Les résultats sont au rendez-vous : le chômage des jeunes recule dans le Nord-Pas-de-Calais de 6 %, plus que la moyenne nationale, qui est en baisse de 2 %.
Pour conforter ces résultats, des contrats aidés supplémentaires ont été récemment octroyés à cette région dans le secteur marchand : 1 350 nouveaux contrats initiative-emploi, ou CIE, seront déployés d’ici à la fin du mois de juin prochain pour les seniors et les chômeurs de très longue durée.
Enfin, grâce à des fonds supplémentaires mobilisés par l’État, la région et les partenaires sociaux, dans le cadre du plan de 100 000 formations prioritaires pour l’emploi lancé à Dunkerque par le Président de la République en 2013, la formation des demandeurs d’emploi est renforcée sur les métiers qui recrutent.
Ces dispositifs constituent des réponses face à la crise. Ils doivent à présent être amplifiés grâce au choc de confiance qui doit accompagner le pacte de responsabilité pour les entreprises du Nord-Pas-de-Calais et de la France entière.
Je vous ai transmis toutes les réponses qui m’ont été fournies par le ministère de l’emploi, monsieur le sénateur, en particulier sur les actions directes et spécifiques. J’ajoute que le pacte de responsabilité vise à redonner des capacités aux entreprises en termes de financement et de compétitivité, en particulier à celles du Nord-Pas-de-Calais. Il existe également des projets dans le domaine qui me concerne, l’agriculture et l’agroalimentaire. Nous devrons développer les investissements prévus.
Il faut effectivement se mobiliser de manière constante et déterminée face aux difficultés rencontrées, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais, pour faire en sorte que ceux qui n’ont pas d’emploi aujourd'hui retrouvent de l’espoir en ayant la possibilité de se réaliser dans le travail. Vous le souhaitez, tout comme nous, et notre collaboration sera, à ce titre, l’un des enjeux pour réussir.

Je remercie M. le ministre de ces précisions et je salue vivement l’engagement du Gouvernement en faveur de la lutte contre le chômage, qui est une priorité.
La région Nord-Pas-de-Calais est la plus jeune région de France. Aussi voudrais-je saluer l’engagement du Président de la République en faveur de la mise en œuvre de l’initiative européenne « garantie pour la jeunesse » et le combat qu’il mène à l’échelon européen, afin que l’expérimentation conduite dans dix régions françaises puisse être pérennisée à partir de 2016, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. Cette initiative va permettre à des milliers de jeunes de s’insérer dans la vie active et d’avoir ainsi un parcours de vie qui corresponde au pacte républicain que nous défendons tous.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures vingt-cinq, est reprise à onze heures trente.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires.
La liste des candidats établie par la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire a été publiée, conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : M. Raymond Vall, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Richard, Michel Teston, Jean-Jacques Hyest, Mme Hélène Masson-Maret et M. Jean-Marie Bockel ;
Suppléants : MM. Jean-Louis Carrère, Gérard Cornu, Mmes Évelyne Didier, Marie-Françoise Gaouyer, MM. Thani Mohamed Soilihi, Charles Revet et Mme Esther Sittler.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, auteur de la question n° 753, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai souhaité attirer l’attention du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social sur les effets collatéraux négatifs de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, qui rend obligatoire une couverture complémentaire santé collective minimale dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016.
Je regrette que, au cours de la réunion de la commission mixte paritaire du mardi 23 avril 2013, plusieurs dispositions introduites par le Sénat à l’article 1er du projet loi relatif à la sécurisation de l’emploi aient été supprimées. C’est le cas en particulier d’une modification de bon sens qui permettait à un salarié disposant, à titre personnel ou en tant qu’ayant droit, d’une assurance complémentaire santé à la date de signature de l’accord de branche de bénéficier à sa demande d’une dispense d’affiliation.
En effet, notre excellente collègue Catherine Procaccia avait fait adopter un amendement – il s’agissait de l’amendement n° 627 rectifié ter – tendant à laisser le libre choix à des affiliés déjà couverts par une complémentaire santé de conserver leur couverture santé. Malgré une demande de retrait de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, la sagesse des sénateurs avait alors prévalu.
Par ailleurs, les modalités spécifiques de financement en cas d’employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel doivent être déterminées par décret. Or, à ce jour, le décret est toujours en attente de publication.
De plus, l’imposition fiscale des mutuelles de santé sur les bulletins de salaire était discutable, car tous les salariés ne sont pas imposables. Aujourd’hui, il est clair qu’il s’agit là d’un nouvel impôt, lequel limitera les garanties mutuelles familiales aux foyers dont seul un membre est salarié. Il s’agit, en outre, d’un nouveau mode de financement de la sécurité sociale, qui se nourrit des cotisants par l’intermédiaire des mutuelles de santé.
Je demande donc au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social quelle réponse satisfaisante peut être apportée à un salarié ayant des employeurs multiples et travaillant à temps très partiel, couvert par une mutuelle, par exemple familiale – c’est souvent le cas –, qui se voit imposer par son employeur l’adhésion obligatoire à une complémentaire santé. Que dire à un salarié dont le pouvoir d’achat sera ainsi diminué ?
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord d’excuser l’absence du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, François Rebsamen. Il rencontre en ce moment même les présidents de régions, qui sont, comme vous le savez, des acteurs essentiels dans la mobilisation de toutes les énergies sur les territoires au service de l’emploi et de la compétitivité des entreprises.
L’assurance complémentaire santé contribue à garantir un accès complet aux soins pour les Français. Toutefois, tous nos concitoyens n’ont pas accès à une complémentaire. Par ailleurs, on le sait, la qualité des contrats est très inégale. C’est pourquoi une série d’engagements ont été pris. Il me semble utile d’en rappeler les différentes étapes avant de répondre plus précisément à la question que vous avez posée.
Lors du congrès de la Fédération nationale de la mutualité française, au mois d’octobre 2012, le Président de la République a souhaité la généralisation de l’accès à une complémentaire santé.
L’accord interprofessionnel signé par les partenaires sociaux le 11 janvier 2013 vise à permettre d’atteindre cet objectif et prévoit l’obligation d’instaurer une couverture complémentaire santé collective minimale dans toutes les entreprises au 1er janvier 2016. La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, que vous avez évoquée, a transcrit cette obligation au plan législatif.
Vous soulevez, madame la sénatrice, une série de problèmes posés par ces dispositions.
En premier lieu, vous interrogez le ministre du travail sur les possibilités de dispenses d’affiliation pour certains salariés ou cas individuels. La loi prévoit déjà de telles dispenses aux contrats collectifs obligatoires, notamment pour éviter les doubles couvertures. C’est le cas, par exemple, pour les salariés déjà couverts par le contrat collectif obligatoire de leur conjoint.
Il n’a pas été jugé souhaitable d’aller plus loin et d’élargir les possibilités de dispenses, afin de ne pas affaiblir la couverture des salariés et de ne pas réduire la mutualisation, nécessaire, au sein des entreprises ou des branches que permettent les contrats collectifs obligatoires.
En second lieu, les décrets d’application de cette disposition de la loi du 14 juin 2013 ont été rédigés et ont fait l’objet d’une concertation avec les partenaires sociaux et les fédérations d’assureurs. Ils devraient être publiés très prochainement.
Enfin, la fiscalisation de la participation de l’employeur aux complémentaires d’entreprise constitue une mesure d’équité, dès lors que les personnes qui souscrivent aujourd’hui une complémentaire à titre individuel ne peuvent, à l’exception des travailleurs indépendants, déduire de l’assiette de leur impôt sur le revenu le coût de leur complémentaire santé. Cette disposition, qui est sans effet sur le champ des garanties d’assurance des familles, contribuera à financer le coût de la généralisation de la complémentaire santé.
Vous l’aurez compris, il s’est agi de trouver un équilibre délicat entre la volonté, légitime et partagée sur ces travées, de favoriser l’accès le plus large possible à une couverture santé complémentaire et celle de respecter la compétitivité des entreprises, sans alourdir leurs charges et les contributions des salariés.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de ce rappel.
Néanmoins, pour ma part, j’ai relu le compte rendu des débats du Sénat du 18 avril 2013 sur le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi. Il met clairement en lumière, non pas un problème d’équilibre, mais la volonté des sénateurs, qui se sont exprimés par la voix de notre collègue Catherine Procaccia, d’éviter aux salariés de payer deux fois sans obtenir de bénéfice supplémentaire. C’est cela qui est très important ! Les salariés doivent avoir le libre choix.
Par ailleurs, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer la liste des justificatifs, laquelle n’a pas à figurer dans une loi. Je tiens néanmoins à rappeler à cet égard l’engagement pris par le Gouvernement. M. Sapin nous a dit clairement qu’une garantie serait apportée aux salariés produisant tout document prouvant la souscription par ailleurs d’une couverture individuelle portant sur le même type de garanties.
Nous serons donc très attentifs sur ces points. Il y va du respect de la parole du Gouvernement. Je suis ravie d’apprendre que les décrets seront publiés très prochainement. Nous espérons y trouver réponse à notre questionnement. C’est le pouvoir d’achat des salariés qui est en jeu.

La parole est à M. Jean-François Husson, auteur de la question n° 734, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social.

Madame la secrétaire d’État, en pleine crise de l’emploi, le Gouvernement a fait le choix, à l’automne 2013, de réduire de plus de moitié le budget des maisons de l’emploi, et ce sans concertation, les autorisations d’engagement étant passées de 54 millions d’euros en 2013 à 26 millions d’euros en 2014. La territorialisation des politiques de l’emploi et de l’insertion manque-t-elle à ce point d’intérêt pour justifier un tel sort ? C’est là, me semble-t-il, une nouvelle démonstration du peu de considération que le Gouvernement a pour ces dispositifs originaux et innovants, qui associent pourtant les collectivités locales à la politique de l’emploi, laquelle relève – faut-il le rappeler ? – de l’État. Il commence par trancher dans le vif, sans concertation ni évaluation, puis il faut presque le supplier pour reprendre la négociation et le dialogue ! C’est pratiquer la politique de l’autruche.
Sans doute allez-vous me dire, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement a augmenté de 7 % par rapport à 2013 les crédits qu’il consacre à l’emploi et à la lutte contre le chômage, tout en recentrant les missions financées. Mais en fonction de quels critères et pour quels résultats ?
Aujourd’hui, on recense plus de 180 maisons de l’emploi, dont le périmètre couvre plus de 10 000 communes, 20 millions d’habitants et plus de 1, 5 million d’entreprises. Au total, 100 000 entreprises ont ainsi bénéficié de leurs actions.
Les maisons de l’emploi sont ancrées dans les territoires. Elles sont implantées dans les bassins d’emploi non seulement urbains, mais aussi ruraux. Mon département, la Meurthe-et-Moselle, en compte trois : la Maison de l’emploi du Grand Nancy, la Maison de l’entreprise, de l’emploi et de la formation en pays Terres de Lorraine, dans le Toulois, et la Maison territoriale pour l’emploi et la formation du Val de Lorraine.
Ces maisons travaillent en harmonie avec les collectivités et les entreprises locales. À ce titre, elles sont un appui « précieux de Pôle Emploi », selon l’Inspection générale des affaires sociales, qui souligne dans son rapport officiel du mois de septembre 2013 que les maisons de l’emploi « développent une fonction d’animation territoriale que l’État n’est plus à même de remplir ».
Dans ces conditions, comment osez-vous prendre le risque de casser les dynamiques locales mises en œuvre par ces maisons en asséchant leurs budgets, pour finalement, peut-être, et malheureusement, mieux les asphyxier ? Vous faites ainsi un choix qui dépasse l’entendement !
Pensez-vous que Pôle emploi pourra, seul, en 2015, soutenir les politiques de l’emploi, alors qu’il ne peut, seul, prendre en charge l’accueil et l’accompagnement des personnes concernées ?
Comment imaginer recentraliser les politiques de l’emploi, alors que l’importance et l’efficacité de l’animation et du maillage territorial ne sont plus à démontrer, surtout lorsque l’État n’est pas en mesure de remplir ce rôle ?
Non seulement ce pari du jacobinisme est peu respectueux de l’action mise en œuvre localement, mais il est également extrêmement dangereux. Évitez donc toute forme d’aveuglément au sujet des maisons de l’emploi. Je rappelle que votre décision d’assécher les budgets des maisons de l’emploi ne repose sur aucune évaluation ni de leurs actions ni de leurs résultats !
Il a fallu attendre l’arrêté du 18 décembre 2013 portant avenant au cahier des charges des maisons de l’emploi pour qu’une évaluation soit prévue, à l’échelon régional par le préfet et au plan national par le ministre chargé de l’emploi.
Je vous demande d’aller au bout de cette évaluation, madame la secrétaire d’État, et de reconnaître la complémentarité des actions des maisons de l’emploi avec celles des acteurs du service public de l’emploi.
Les missions confiées aux maisons de l’emploi sont certes inégales et diverses, selon leur territoire d’implantation. Ces maisons peuvent et doivent travailler davantage encore en réseau, mais la valeur ajoutée de leur action est indéniable.
Reconnaissez les maisons de l’emploi comme des acteurs indispensables du service public de l’emploi et révisez donc leur financement à la hausse, afin de conforter un dispositif qui donne satisfaction !
Nous avons aujourd'hui besoin de toutes les bonnes volontés et de toutes les énergies pour combattre le fléau du chômage. Confortons l’intelligence collective au service de l’emploi. Nous n’avons pas le choix ! L’efficacité de nos politiques publiques, notamment celle de l’emploi, repose plus que jamais sur le travail collaboratif entre tous les acteurs.
Monsieur le sénateur, je vous prie également d’excuser l’absence du ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, François Rebsamen. Comme je l’ai déjà indiqué, il rencontre actuellement les présidents de régions, qui sont au cœur des dispositifs de lutte contre le chômage.
Vous le savez, cette lutte est la priorité du Gouvernement, qui entend favoriser et encourager la création d’emplois dans les territoires. En 2014, cela se traduit par la croissance des crédits de la mission « Travail et emploi » de l’ordre de 7 % par rapport à 2013. Toutefois, cela ne nous exonère pas d’une réflexion sur le périmètre d’intervention de l’État, question que vous soulevez concernant les maisons de l’emploi.
L’ensemble des rapports récents présentés au Gouvernement relatifs à la contribution des maisons de l’emploi, et à la politique de l’emploi de manière plus globale, ont relevé le manque de clarté des missions confiées à ces structures. Elles sont hétérogènes, vous l’avez vous-même indiqué, selon les implantations territoriales et leur rôle semble devoir être clarifié, ce qui contredit la pertinence d’un soutien uniforme de l’État sur l’ensemble des territoires.
Dans ce cadre, la loi de finances pour 2014 a prévu une diminution de moitié des crédits destinés aux maisons de l’emploi. Ces crédits s’établissaient initialement à 26 millions d’euros, contre 54 millions d’euros d’autorisations d’engagement en 2013.
Notre objectif est de recentrer ce financement sur des actions ciblées, qualitatives, répondant à des besoins prioritaires sur les territoires. Il s’agit non seulement d’accompagner les mutations économiques, mais aussi de les anticiper, afin de contribuer au développement de l’emploi local. Mieux cibler pour être plus efficace en matière de lutte contre le chômage, voilà un objectif que vous pouvez partager, monsieur le sénateur.
En effet, la principale plus-value constatée des maisons de l’emploi consiste dans leur participation à des démarches de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, les GPEC, au plan territorial. C’est pourquoi le Gouvernement a soutenu le souhait des parlementaires de voir compléter les crédits de fonctionnement des maisons de l’emploi par une enveloppe supplémentaire de 10 millions d’euros destinée exclusivement à financer des projets relatifs à ces GPEC territoriales portés par les maisons de l’emploi. Le dialogue existe donc bel et bien, en particulier avec les parlementaires.
La répartition des enveloppes entre les régions a été arrêtée à la fin du mois de janvier dernier sur la base de critères non pas subjectifs, mais bien objectifs : la population couverte, les actions menées par les maisons de l’emploi sur les deux axes du nouveau cahier des charges auquel vous avez fait référence et la masse salariale de ces structures.
Pour ce qui concerne la répartition au sein des régions elles-mêmes, des orientations ont été adressées aux représentants de l’État dans les régions, aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi – les DIRRECTE –, afin de leur permettre d’affecter les crédits aux maisons de l’emploi, là aussi sur la base de critères objectifs préalablement définis, notamment celui de la plus-value identifiée de chacune des maisons, ou encore selon les projets de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qu’elles conduisent.
Ainsi, vous l’aurez compris, nous ciblons le financement de l’État sur des actions à forte plus-value entrant dans le cadre des priorités fixées par le Gouvernement tout en favorisant une rationalisation du paysage institutionnel des politiques de l’emploi. La finalité est de conduire une action efficace et d’éviter les doublons en luttant contre le millefeuille du service public de l’emploi, ô combien souvent dénoncé sur ces travées.
Il s’agit non pas de recentralisation ou de jacobinisme des politiques de l’emploi, mais bien d’une territorialisation des politiques menées par l’État au plus près des besoins exprimés par les territoires, tout en assurant le respect des règles d’équité et en laissant aux acteurs locaux le soin d’opérer les ajustements nécessaires au regard de leurs spécificités et du contexte local. Coller au plus près de la réalité locale, tel est notre objectif.
Pour ce qui est de l’avenir, je vous rappelle que l’arrêté du 18 décembre 2013 – vous l’avez cité – a prévu que le dispositif des maisons de l’emploi fasse notamment l’objet d’une évaluation partenariale présentée au Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles.
Ce bilan, qui sera bien effectué, sera partagé puisque le groupe de travail présidé par Mme Patricia Bouillaguet – personnalité qualifiée, membre du Conseil national de l’emploi – inclut des représentants des collectivités, ainsi que des maisons de l’emploi elles-mêmes. Ce groupe de travail a déjà commencé ses réunions ; il est prévu qu’il rende ses conclusions d’ici au second semestre. Il dressera un état des lieux factuel sur l’activité des maisons de l’emploi au regard des dernières décisions prises pour proposer des pistes d’évolution
Vous l’avez dit vous-même, monsieur le sénateur, nous travaillons dans un esprit de complémentarité des missions. Nous poursuivons un objectif d’efficacité et de rationalisation. Ce travail se fait en réseau, en procédant à un recentrage autour de la valeur ajoutée. Je vous invite à travailler aux côtés du Gouvernement à la réussite de ces objectifs en faisant preuve de l’intelligence collective que nous vous connaissons.

Vous êtes trop aimable, madame la secrétaire d’État…
Voilà quelques instants, vous avez dit vouloir faire en fonction des besoins exprimés par les territoires. Permettez-moi d’être leur porte-parole : ils vous demandent de faire mieux. Ils ne veulent pas d’un régime amaigrissant. Faire mieux avec moins, c’est compliqué ; avec beaucoup moins, c’est douloureux. Il en va du régime imposé à la politique de l’emploi comme des régimes amaigrissants : il faut faire attention aux excès pour la santé, en l’occurrence pour la santé de l’emploi !
Malheureusement, certains des éléments de votre réponse ne m’ont pas convaincu – ce qui ne manquera peut-être pas de vous surprendre –, pas plus qu’ils n’ont convaincu les Français, qui ne voient pas l’inversion de la courbe du chômage longtemps promise à un horizon incertain – horizon qui tend d’ailleurs à reculer à mesure que l’on s’en approche. Nous ne constatons aucun retournement de tendance favorable en matière de croissance ou d’emploi. Depuis l’arrivée de cette majorité aux responsabilités, les choix du gouvernement de la France se sont révélés plutôt inefficaces, voire contreproductifs.
Le choix a été fait d’augmenter la dépense publique à travers, notamment, le traitement social du chômage et les emplois aidés – ceux-ci se justifient pour une part mais on en connaît les limites –, tandis que les choix fiscaux ont fini par tarir le potentiel d’innovation, de croissance et de création d’emplois.
Croissance atone, accroissement inexorable du chômage, absence de politique volontariste en matière de formation sous toutes ses formes – formation professionnelle tout au long de la vie, politique de l’alternance ou de l’apprentissage –, autant de voyants qui sont au rouge et qui viennent confirmer le chiffre de 24 000 emplois détruits dans le secteur marchand au cours du premier trimestre de cette année.
Il est grand temps, madame la secrétaire d’État, que le Gouvernement prenne la pleine mesure de cette dégradation, qu’il s’en saisisse à bras-le-corps et qu’il fasse enfin confiance aux entreprises. Il semble qu’une lueur d’espoir soit née en ce domaine. Toutefois, évitons le dispositif « donnant-donnant » qui s’accompagnerait d’un engagement chiffré en contrepartie des assouplissements accordés aux entreprises. Dites-vous bien que ces dernières ont d’abord besoin de restaurer leurs marges, de retrouver un peu de souffle dans leur trésorerie. Elles n’auront ensuite qu’un objectif et qu’une ambition : créer de la richesse et offrir des emplois dans tous les territoires de notre beau pays de France.

La parole est à Mme Mireille Schurch, auteur de la question n° 757, adressée à M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, il est indispensable que l’État, à travers les importantes commandes publiques qu’il est amené à passer, œuvre au mieux pour la croissance industrielle et l’emploi dans notre pays. Deux exemples nous montrent que tel n’est pas toujours le cas.
Répondant à un appel d’offres lancé en 2009, Alstom a signé un contrat-cadre portant sur la production de 1 000 TER ou Régiolis.
Dans le contexte financier actuel difficile que connaissent les collectivités locales, notamment les régions, seules 200 commandes fermes ont été confirmées par ces dernières. Dans ces conditions, l’objectif de ce contrat-cadre ne pourra sans doute pas être atteint.
Toutefois, les caractéristiques de la plateforme développée par Alstom pour le Régiolis permettent de répondre également à d’autres types de trains. Aussi, puisque l’État souhaite remplacer les trente-quatre voitures Corail sur les axes Paris-Limoges-Toulouse et Paris-Clermont-Ferrand, il paraîtrait opportun de prélever ces rames dans le cadre du contrat passé avec Alstom. C’est d’ailleurs ce que déclarait au mois de février dernier M. Frédéric Cuvillier. Or il semble que l’État ait récemment chargé la SNCF de lancer un nouvel appel d’offres indépendant pour du matériel « grandes lignes ».
Je m’étonne que l’État ne profite pas du contrat-cadre existant, dont l’objectif est loin d’être atteint, comme je l’ai souligné tout à l'heure, pour équiper l’ensemble des lignes. Un nouvel appel d’offres retarderait les décisions et mettrait en difficulté l’entreprise Alstom et ses sous-traitants.
De telles informations contradictoires rendent illisible tout message relatif à la nécessité de conforter la production française. Par ailleurs, le grand Massif central, insuffisamment doté – je pense en particulier aux lignes desservant Montluçon, Vichy, Moulins et Clermont-Ferrand –, ne peut attendre davantage un matériel roulant performant indispensable à son attractivité.
Autre exemple emblématique, celui des drones tactiques prévus par la loi de programmation militaire.
Il semble que le choix initial se porte sur la version présentée par Thalès concernant un matériel construit essentiellement en Israël, sans qu’il ait été procédé à consultation d’autres entreprises ni mise en concurrence des matériels.
Pourtant, sur ce segment, la société Sagem du groupe Safran propose son drone Patroller, dont la fabrication, hors la cellule produite en Allemagne, est complètement française : le travail de recherche et développement est effectué en région parisienne, les composants sont fabriqués à Dijon, Poitiers et Fougères, et l’assemblage est effectué à Montluçon, dans l’Allier.
Là encore, les hésitations doivent être levées et le choix d’un process de fabrication maîtrisé sur notre territoire national me semble, sur le secteur hautement stratégique de la défense nationale, devoir être privilégié.
J’attire aussi votre attention sur le fait que, dans ces deux cas précis, il est possible de favoriser nos entreprises sans porter atteinte aux règles de la politique européenne de la concurrence.
Je vous demande donc, concernant ces deux marchés en cours, quelles mesures concrètes compte prendre le Gouvernement pour conforter les entreprises qui font le choix de produire en France et soutenir ainsi nos emplois industriels.
Sur cette question, il nous faut, madame la secrétaire d’État – et à travers vous, je m’adresse également à M. Montebourg –, affirmer la même détermination politique que celle qui a été montrée par la publication du décret étendant à l’énergie et aux transports le mécanisme de protection des entreprises stratégiques contre les appétits étrangers.
Madame la sénatrice, la mobilisation des outils de la commande publique est essentielle pour stimuler et promouvoir l’activité productive et manufacturière, et par voie de conséquence l’emploi. Les récents chiffres concernant cette production sont plutôt rassurants et illustrent la priorité qui lui est donnée par le Gouvernement et Arnaud Montebourg, qui m’a demandé de vous transmettre ses excuses et de répondre à sa place à votre question.
Le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique a eu l’occasion de s’exprimer à maintes reprises sur la question de la commande publique.
Cette priorité s’est exprimée dans les orientations données aux grands opérateurs de l’État qui utilisent, pour satisfaire leurs besoins, les procédures de passation des marchés publics – en particulier dans les secteurs de l’énergie et des transports – organisées par une directive européenne.
Ce texte du 31 mars 2004 permet, sans considération de seuil, le recours à une procédure négociée à l’issue d’une consultation ouverte, transparente et non discriminatoire, fondée sur des spécifications techniques propres aux besoins de l’acheteur.
La préparation au défi de l’appel d’offres relatif aux compteurs Linky par les acteurs de la filière a, par exemple, été perçue comme une préoccupation immédiate de l’opérateur et de l’État. Les industriels présents dans notre pays ou souhaitant participer à ce grand projet ont eu le temps de construire des programmes de création ou d’adaptation de leur outil industriel en France, ce que justifient les quantités en jeu, sans équivalent en Europe.
De manière générale, les grands appels d’offres permettent d’intégrer une dynamique d’innovation très favorable au tissu des PME gravitant autour des grands groupes industriels, implantées sur l’ensemble du territoire et qu’il convient de privilégier. Ces PME représentent 57 % en volume des achats publics, mais seulement 27 % en valeur. Le Gouvernement a conscience de la priorité qui doit être accordée au ciblage de ces PME pour faire en sorte qu’elles deviennent plus compétitives grâce à la commande publique.
S’agissant tout particulièrement des drones tactiques, la société Sagem, du groupe Safran, a reçu, à la fin du mois de décembre dernier, une commande de la direction générale de l’armement, la DGA, portant sur cinq drones Sperwer supplémentaires au profit de l’armée de terre, dans le cadre des systèmes de drones tactiques intérimaires, ou SDTI. Le matériel sera livré en 2015.
Ce contrat impliquera les établissements Sagem de Dijon et de Poitiers pour les capteurs optroniques, de Fougères pour les cartes électroniques et de Montluçon pour les systèmes de pilotage, de navigation et l’intégration des drones, ainsi que de nombreuses sociétés françaises, notamment des PME fournisseurs de sous-ensembles du drone.
À partir de l’expérience acquise avec ce projet et en s’appuyant sur les commandes de la DGA pour ce drone, la société Sagem développe, avec tous ses partenaires, le système de drones tactiques endurant Patroller pour les marchés internationaux et pour répondre aux besoins futurs de l’armée de terre. Un cercle vertueux a donc été enclenché.
Pour ce qui concerne les matériels roulants, que vous avez mentionnés, en 2013, grâce à l’implication forte des régions, la SNCF a passé un ensemble important de commandes, notamment auprès de Bombardier – trains Regio 2N – et d’Alstom – rames Régiolis, adaptées aux longues distances –, sans oublier la commande, au mois de juillet de la même année, de quarante rames de TGV Alstom.
Ces commandes viennent nourrir l’activité des sites d’assemblage des deux constructeurs, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi de toute une filière de fournisseurs, en particulier des PME. Elles sont la concrétisation d’efforts d’innovation associant les grands industriels et l’ensemble de la filière et des laboratoires.
Pour préparer une étape supplémentaire, l’initiative de la « nouvelle France industrielle », lancée par le Président de la République, comporte un plan industriel dédié à la conception et à l’industrialisation, à l’horizon 2018, d’un TGV du futur, plus économe et plus confortable. Ce plan, piloté par Alstom, associe des PME qui seront chargées d’apporter des solutions innovantes sur certains sous-ensembles.
À l’échelon national, le Gouvernement a fixé comme objectif qu’au moins 2 % du volume des marchés de l’État, de ses opérateurs et des hôpitaux soient attribués aux PME innovantes d’ici à 2020. À cette fin, chaque ministère a reçu pour instruction d’établir une feuille de route des achats innovants permettant aux entreprises de cibler les domaines porteurs pour lesquels les acheteurs recherchent des solutions innovantes. Un réseau de onze « référents achats innovants » appuiera des actions de sourcing, d’identification, et diffusera une large information sur les possibilités offertes par le code des marchés publics sur les achats pré-commerciaux et la nouvelle procédure du partenariat d’innovation.
Des expérimentations sont par ailleurs en cours pour utiliser l’open data, pour favoriser l’accès de ces entreprises innovantes à ces marchés.
Ces mesures permettront de donner son plein effet à une nouvelle procédure, introduite lors de la révision des directives sur les marchés publics au mois de mars dernier : le partenariat d’innovation. Cette procédure est très fortement soutenue par la France à Bruxelles. Son intérêt principal réside dans la possibilité pour le pouvoir adjudicateur de prévoir à la fois la recherche et la commercialisation du produit ou de la solution développés.
Il s’agit d’une procédure négociée par phases en vue du développement et de l’acquisition d’un produit, d’un service ou de travaux nouveaux et innovants, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une passation de marché distincte pour l’acquisition.
L’innovation est définie largement comme tout produit, service ou processus nouveau ou sensiblement amélioré et qui n’est pas encore disponible sur le marché. L’accès aux marchés publics est facilité pour les entreprises.
Au-delà du levier de l’innovation, le Gouvernement construit l’équivalent d’un Small Business Act à la française conforme aux règles européennes et à celles de l’Organisation mondiale du commerce.
L’allotissement, qui est la règle pour la passation des marchés en France, est désormais également inscrit dans les directives européennes, sur proposition du gouvernement français.
Au-delà de cette mesure très structurante, celui-ci a pris plusieurs dispositions visant à encourager l’accès des PME à la commande publique : d’une part, la création du médiateur des marchés publics, en 2012, a pour objet d’améliorer les relations au quotidien entre entreprises et acheteurs ; d’autre part, le service des achats de l’État s’assure que ces achats sont réalisés dans des conditions favorisant le plus large accès des PME à la commande publique ; il diffuse pour cela les bonnes pratiques et mène des actions auprès des acheteurs publics.
Madame la sénatrice, l’accès à la commande publique, en particulier pour les PME, est une priorité du Gouvernement. J’espère que cette réponse vous rassurera, si besoin était, sur l’engagement de l’État en faveur de nos entreprises et donc de l’emploi en France.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse très détaillée.
S’agissant d’Alstom, vous savez que le contrat-cadre fait référence à 1 000 commandes ; or, à ce jour, il est question de seulement 200 ou 250 commandes. Bien sûr, vous avez parlé du TGV, mais les trains Intercités et les trains grandes lignes seront-ils compris dans ce contrat-cadre ? Le cas échéant, il ne serait pas nécessaire de lancer de nouveaux appels d’offres. Vous ne m’avez pas tout à fait répondu sur ce point.
S’agissant des drones tactiques, vous m’avez expliqué qu’une commande portant sur cinq exemplaires avait été passée. C’est intéressant. Je suis sollicitée par les salariés des entreprises concernées, qui souhaiteraient un peu plus de lisibilité de la part du Gouvernement. Vous m’avez apporté des réponses extrêmement précises, ce dont je vous remercie.
La jurisprudence du Conseil d’État, ainsi que celle de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’introduire dans les appels d’offres un critère fondé sur l’implantation géographique s’il est justifié par les conditions d’exécution du marché et son objet, ainsi qu’un critère lié au développement durable. C’est en m’appuyant sur ces éléments juridiques que j’avais déjà alerté Arnaud Montebourg, alors ministre du redressement productif, sur l’appel d’offres relatif aux compteurs électriques intelligents dits « Linky ».
J’ai été heureuse de vous entendre parler du Small Business Act européen. J’encourage le Gouvernement à aller dans ce sens. Nous pourrons ainsi fixer des critères contraignants – environnementaux, de circuits courts – pour favoriser l’emploi en France. C’est bien ce qui nous est demandé. Cela permettrait à nos entreprises de se positionner sur des marchés publics nationaux et européens.
Enfin, le Front de gauche, dans son programme européen, entend également favoriser la relocalisation des entreprises en instaurant une taxe kilométrique à l’échelon national et européen et ce qu’il appelle des « visas sociaux et environnementaux » aux frontières de l’Union européenne. Ce sont là peut-être des pistes de travail.
Madame la secrétaire d’État, je ferai part de votre réponse aux salariés des deux entreprises en cause qui sont inquiets et qui demandaient une clarification.

La parole est à M. Rachel Mazuir, auteur de la question n° 730, adressée à M. le ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique.

La production de lait biologique en circuit court se développe dans l’Ain, département que j’ai l’honneur de présider. À cet égard, je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la réglementation relative aux modalités de contrôle des distributeurs de lait.
L’ordonnance du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides dispose que les volumes de liquides qui font l’objet de transactions commerciales doivent être mesurés au moyen d’instruments de mesures légaux – c’est bien le moins ! L’installation et le contrôle des distributeurs de lait sont donc soumis au respect de ces mesures.
Concernant leur mise en service, ces distributeurs doivent être conformes aux dispositions de la directive européenne du 31 mars 2004 sur les instruments de mesure, transposée en France par le décret du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et son arrêté d’application du 28 avril 2006.
C’est ainsi qu’ils doivent être équipés d’un débitmètre, un compteur certifié conforme, lequel garantit au consommateur que, quand il paie un litre de lait, la machine lui distribue bien un litre.
Concernant leur contrôle – c’est là où se pose un problème –, ces distributeurs sont soumis à l’arrêté du 28 juin 2002 fixant certaines modalités du contrôle métrologique des ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau, dont l’article 5 précise que ces machines sont soumises à un contrôle en service annuel qui se compose à la fois d’une vérification – point qui nous intéresse plus particulièrement – et d’une révision périodiques, définies respectivement aux articles 30 et 34 du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.
Ces contrôles sont effectués par un unique organisme en France, basé en Charente, le seul à avoir été agréé.
La révision périodique vise les opérations d’entretien, de maintenance et de réglage permettant de maintenir un instrument en conformité et, en particulier, de ramener ses erreurs au plus près du zéro. La vérification périodique, quant à elle, a pour objet de vérifier la conformité d’un instrument et, plus spécifiquement, de s’assurer que ses erreurs sont inférieures aux erreurs maximales tolérées, à savoir plus ou moins 1 %.
Pour les distributeurs de lait cru, la réglementation a déjà été aménagée, puisque l’organisme agréé est autorisé à procéder à la vérification périodique quand bien même la révision périodique n’aurait pas été réalisée. Cela permet de maintenir ces instruments en service tant que leurs performances métrologiques restent suffisantes, sans avoir besoin de faire intervenir un réparateur pour effectuer les opérations d’entretien, de maintenance et d’ajustage.
Fort de cette vérification, le gérant du distributeur de lait bénéficie d’une présomption de bonne foi, même si l’appareil en lui-même nécessiterait une intervention technique.
Pour autant, cette réglementation pénalise encore lourdement les agriculteurs désireux de se lancer dans ce type de commercialisation de leur lait – ils sont nombreux dans mon département.
Madame la secrétaire d’État, serait-il envisageable d’assouplir les opérations de contrôle des débitmètres des distributeurs de lait ? Certes, il semble délicat de supprimer l’article 5 de l’arrêté du 28 juin 2002, car de tels contrôles offrent une garantie pour la transaction. Pour autant, le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique entend-il revenir sur la périodicité de ces contrôles, qui, une fois la machine installée et donc homologuée, pourraient être espacés et non effectués tous les ans ? L’aménagement de cette réglementation encouragerait le développement de ce commerce du lait.
Monsieur le sénateur, votre question porte sur les modalités de contrôle des distributeurs de lait.
En France, la vente de lait cru aux consommateurs relève de l’ordonnance du 18 octobre 1945 relative au mesurage du volume des liquides, laquelle dispose que les volumes de liquides qui font l’objet de transactions commerciales doivent être mesurés au moyen d’instruments de mesure légaux.
Les distributeurs de lait cru sont réglementés en tant qu’instruments de mesure de liquides autres que l’eau : d’une part, par le décret du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et son arrêté d’application du 28 avril 2006 – transposition de la directive que vous avez citée – ; d’autre part, par l’arrêté du 28 juin 2002, qui concerne le contrôle en service des ensembles de mesurage de liquides autres que l’eau sur le territoire national.
Ce contrôle en service comprend une révision et une vérification annuelles. La révision est effectuée par un réparateur et la vérification par un vérificateur agréé accrédité par le Comité français d’accréditation, le COFRAC.
Cette réglementation spécifique a pour objet de protéger les consommateurs en leur garantissant l’exactitude des volumes qu’ils achètent.
Pour un litre de lait, la justesse demandée par la réglementation pour un ensemble de mesurage en service correspond à plus ou moins 1 % du volume, ce qui est du même ordre de grandeur que la tolérance à l’égard du volume contenu dans la bouteille de lait préemballé.
Dans le contexte du faible prix de vente du lait par les agriculteurs aux laiteries, des importateurs de matériels, principalement italiens, ont convaincu des agriculteurs, au lieu de vendre leur lait à 28 centimes le litre aux laiteries, de le vendre en direct aux consommateurs à 1 euro le litre, voire plus, et, pour ce faire, de s’équiper de distributeurs de lait.
Des difficultés sont apparues lors des contrôles en service, certains instruments étant hors tolérance, ou dès les premières pannes. En effet, certains importateurs n’assurent pas le service après-vente et le coût d’une intervention du fabricant sur site ou du retour de l’instrument à l’usine est très élevé. Nous sommes conscients de cet état de fait.
La situation a d’ailleurs déjà amené les services de l’administration à ne plus exiger la révision périodique des distributeurs de lait s’ils respectent les erreurs maximales tolérées en service, afin d’éviter un blocage du fait de l’absence de réparateurs pour effectuer la révision des instruments. Cette mesure sera sans doute prise en compte lors de la révision, toute prochaine, de l’arrêté du 28 juin 2002 précité. À cette occasion, la périodicité de la vérification pourra également être réexaminée.
Cependant, comme les résultats des contrôles effectués jusqu’à présent révèlent que le maintien des performances des instruments visés est peu satisfaisant dans le temps du point de vue de leur exactitude, une étude d’impact devra être menée pour évaluer les possibilités d’allongement du délai entre deux vérifications. En effet, il n’y a pas de raison de créer une différence en matière de garantie apportée au consommateur dans le domaine de la vente du lait via ces distributeurs automatiques par rapport aux autres modes de vente du lait.
Enfin, les volumes écoulés entre la vente aux laiteries et la vente directe aux consommateurs ne sont pas les mêmes et l’avantage pour les producteurs n’est pas si élevé que celui qui leur avait été initialement annoncé.
L’expérience de ces dernières années montre que les quantités de lait vendues directement à des consommateurs au moyen de chacun des distributeurs en cause sont, au final, faibles, de 40 litres par jour pour les fermes à 200 litres par jour pour des installations situées dans des lieux que l’on peut considérer comme très fréquentés. Par ailleurs, les contraintes d’exploitation sont importantes, en termes d’entretien sanitaire – nettoyage complet de l’appareil, avec élimination systémique du lait invendu – et de maintien en service, du fait de pannes fréquentes et de l’absence de service après-vente ; j’y ai déjà fait référence.
Un assouplissement de la réglementation ne nous semblerait donc pas de nature à favoriser le développement du commerce du lait, ce qui reste un objectif pour le Gouvernement.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, de votre réponse.
L’événement en question a fait la une de la presse dans le département que je préside, notamment dans le chef-lieu. Certains avaient alors observé que les Italiens s’étaient placés en dehors du droit, les exigences qui s’imposent chez nous ne s’appliquant pas chez eux. Bien entendu, on peut comprendre que, en tant que vendeurs des instruments, ils soient intéressés à en écouler le plus possible. Nous connaissons par ailleurs les problèmes d’hygiène que vous avez rappelés.
L’agriculteur concerné, dont les revenus étaient confortables, a vu son distributeur fermé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, laquelle a apposé sur son matériel un papillon rouge. Il a lui a fallu patienter pendant trente-quatre jours de fermeture avant que l’organisme agréé ne vienne procéder à des mesures et constater que l’écart, de 0, 5 %, était parfaitement conforme. Au final, ce professionnel, qui a dû acquitter en plus les frais d’intervention, aura perdu près de 1 500 euros ! C’est tout de même une somme pour ce type de métiers, dont nous connaissons les difficultés.
J’ai bien compris que l’on réfléchissait à un assouplissement. À mon sens, il faudrait améliorer les contrôles en les rendant moins fréquents.

La parole est à M. Jean Louis Masson, auteur de la question n° 767, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, si nous sommes amenés à poser des questions orales en séance publique, c’est peut-être parce que le système des questions écrites fonctionne très mal…
En théorie, un gouvernement doit répondre à une question écrite dans un délai de deux mois. Dès lors, si les gouvernements – je parle des gouvernements en général, et pas seulement du gouvernement actuel – faisaient correctement leur travail, nous ne serions pas obligés de poser des questions orales en séance, d’autant qu’il faut s’inscrire un mois ou un mois et demi à l’avance. Cela permettrait aux parlementaires, et sans doute également aux ministres, d’économiser du temps de travail.
Cela fait quatre fois que je pose une question orale à M. le ministre de l’intérieur, et cela quatre fois qu’il ne vient pas ! Il se fait systématiquement représenter, dont deux fois par Mme la secrétaire d'État chargée du numérique, ce qui est bien sympathique, mais je ne vois pas forcément le rapport entre l’économie numérique et ce qui relève des attributions du ministère de l’intérieur.
Certes, on pourra toujours me rétorquer que les membres du Gouvernement sont solidaires et capables de s’exprimer sur l’ensemble des sujets… Mais, tant qu’à faire, l’auteur d’une question préférerait avoir en face de lui le ministre compétent, celui qui connaît les dossiers, plutôt qu’une personne lisant un papier rédigé par les services du ministère.
Il s’agit d’un problème important. Les questions orales et écrites constituent la base du contrôle de l’action gouvernementale, qui est l’une des missions du Parlement.
Pour ma part, j’y suis particulièrement attaché. En effet, les sénateurs non inscrits n’ont pas les mêmes facilités que les sénateurs appartenant à des groupes politiques. Or nous avons les mêmes droits. Nous demandons que l’on nous traite correctement et que l’on apporte dans les délais des réponses sérieuses et de bon sens à nos questions.
À la mi-avril, j’avais indiqué à M. le ministre de l’intérieur que plus de 200 de mes questions écrites – le chiffre a peut-être un peu évolué depuis – adressées à ses services demeuraient toujours sans réponse. Vous jugerez peut-être que je pose beaucoup de questions écrites. Mais c’est tout simplement parce que le Gouvernement ne répond pas ; certaines questions attendent une réponse depuis un an ou un an et demi. Si le Gouvernement répondait dans les délais, je n’aurais pas 200 questions en instance !
Dans un certain nombre de domaines, nous, sénateurs non inscrits, n’avons pas les moyens d’intervenir. Ainsi, nous ne pouvons ni appartenir aux commissions d’enquête ni utiliser les niches parlementaires pour faire examiner nos propositions de loi.
Par conséquent, nous sommes bien obligés de nous rabattre sur les possibilités qui nous restent. La moindre des choses serait tout de même de répondre correctement à nos questions. Cela éviterait de faire déplacer Mme la secrétaire d'État chargée du numérique pour remplacer M. le ministre de l’intérieur, qui ne peut jamais venir.
Monsieur Masson, je dois effectivement vous prier d’excuser M. le ministre de l’intérieur, qui préside ce matin une réunion de préfets place Beauvau. La sécurité des Français est une priorité du Gouvernement. En tant que parlementaire représentant la nation, vous pouvez comprendre le besoin de répondre à de telles préoccupations. Mais je suis très heureuse de vous retrouver lors de cette séance de questions orales pour discuter des questions écrites, sujet que nous avions déjà abordé lors de notre précédente rencontre dans cet hémicycle.
Après vérification minutieuse auprès des services du ministère de l’intérieur et du Secrétariat général du Gouvernement, je suis en mesure de vous donner quelques statistiques précises concernant vos questions écrites, puisque le sujet, je le sais, vous tient à cœur.
Depuis le début de la présente législature, vous avez posé 1 493 questions écrites, soit 13 % de l’ensemble des questions écrites adressées par la totalité des membres du Sénat, quelle que soit leur appartenance politique. Pour l’heure, 1 088 réponses vous ont été fournies.
Vous soulevez le cas spécifique du ministère de l’intérieur. Sur les 1 493 questions écrites que vous avez posées au Gouvernement, 749, soit environ la moitié, ont été adressées à ce ministère.
À vous seul, vous êtes ainsi l’auteur de plus de la moitié des questions adressées au ministère de l’intérieur par la totalité des membres du Sénat. À ce jour, le ministère de l’intérieur, qui est donc très sollicité par vos soins, a répondu très précisément à 517 de vos questions écrites, ce qui représente 57 % de toutes ses réponses aux sénateurs.
Vous en conviendrez, vos questions écrites nécessitent une pleine mobilisation des fonctionnaires œuvrant à la sécurité des Français. Le Premier ministre a à cœur de respecter le Parlement faisant partie des institutions de la Ve République. L’efficacité des services administratifs à répondre à vos questions écrites en est la preuve.
Au regard de ces chiffres, vous concéderez donc que le ministère en cause n’a pas manqué de diligence particulière à votre égard.
Il me reste tout simplement à regretter votre déception quant au fait que je réponde, en tant que secrétaire d’État chargée du numérique, à votre question orale portant sur les questions écrites. Il se trouve que je suis membre du Gouvernement et que le ministre de l’intérieur m’a chargée de parler en son nom.

Madame la secrétaire d’État, c’est M. le ministre de l’intérieur qui fixe les dates de réunion place Beauvau et convoque les préfets. Ce n’est pas moi qui ai placé la réunion à laquelle vous avez fait référence en même temps que la séance des questions orales du Sénat, séance qui était d’ailleurs annoncée depuis plus deux mois. M. le ministre aurait donc pu retenir une autre date pour réunir les préfets.
Vous avez également mentionné le nombre de questions que j’ai posées. Mais la moitié de celles-ci sont de simples relances parce que le Gouvernement ne fait pas son travail !
La dernière fois, j’avais évoqué devant vous une question à laquelle le ministère de l’intérieur m’avait littéralement répondu n’importe quoi. Or, contrairement peut-être à d’autres collègues, je suis moi-même l’auteur de mes questions et je lis ce qu’on me répond. Et s’il m’arrive de reposer plusieurs fois la même question, c’est parce que je suis obligé d’interpeller le ministre pour me plaindre de ses réponses, ce qui n’arriverait pas si l’on me répondait correctement.
Souvenez-vous, madame la secrétaire d’État. La dernière fois, j’étais intervenu, j’y insiste, parce que l’on m’avait répondu n’importe quoi. Comme je l’ai indiqué dans le texte de ma question de ce jour, la réponse que j’avais alors reçue consistait seulement à souligner qu’il s’agissait d’un problème important et que l’on me répondrait prochainement ! §Vous-même aviez reconnu que c’était un peu problématique. Avec des réponses comme ça, il ne faut pas s’étonner que je repose mes questions !
Il serait, me semble-t-il, bon d’en informer le ministère de l’intérieur : je lis les réponses qui me sont adressées et j’examine leur contenu. Leurs auteurs devraient donc faire un peu plus attention.
Je ne vois pas en quoi il est choquant qu’un sénateur fasse son travail. On se plaint souvent de la faible activité des parlementaires ; pour une fois que l’un d’eux fait son travail… Il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’un sénateur interroge le ministre de l’intérieur sur les activités de ses services ou sur la vie des collectivités locales.
Madame la secrétaire d’État, j’espère que vous aurez l’amabilité de faire remonter tout cela à vos collègues et de les exhorter à ne pas me répondre n’importe quoi. Le délai de deux mois étant ce qu’il est, cela m’éviterait de reposer des questions auxquelles on ne me répond pas correctement ou de relancer le Gouvernement quand mes questions restent trois mois, quatre mois, voire six mois sans réponse. Je compte sur vous !

La parole est à Mme Jacqueline Alquier, auteur de la question n° 768, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Ma question s’adresse à Mme la garde des sceaux et concerne la mise en œuvre des tribunaux départementaux de première instance, préconisés par la proposition n° 14 du rapport rédigé par M. Marshall, premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Ce rapport, intitulé Les Juridictions du XXI e siècle, se situe dans le cadre de la réflexion nationale que le Gouvernement a engagée au cours de l’année 2013. Il a été débattu lors de rencontres nationales sur l’avenir de notre système judiciaire, en janvier 2014, puis un document, Les Scénarios de réforme, a été soumis par la Chancellerie à la concertation des juridictions.
Le 4 février, alertée par le bâtonnier de Castres, j’avais déjà interpellé le Gouvernement par courrier, car selon les critères d’effectifs, le nombre de magistrats du Tarn permet qu’un tribunal de première instance soit fixé à Albi, chef-lieu du département, le TGI de Castres devenant un site détaché.
Or, dans le contexte de ce département, cette décision irait à l’encontre des objectifs d’une réforme que vous avez souhaitée tournée vers le service rendu aux justiciables et respectant les exigences de proximité et de lisibilité.
En effet, la population du département se répartit en deux ensembles démographiques d’un volume quasi identique d’environ 190 000 habitants, l’un autour d’Albi et l’autre autour de Castres.
Les bassins d’emploi dans ces deux ensembles sont équilibrés, ainsi que le volume des contentieux dont sont saisis les deux TGI d’Albi et Castres.
Cette bipolarité équilibrée serait inévitablement mise à mal par le projet qui nous inquiète : la zone géographique ramenée au statut de juridiction détachée serait en situation de faiblesse, éloignée du centre des décisions judiciaires. Parallèlement, la juridiction qui se verrait attribuer le siège du tribunal de première instance serait saturée et ne pourrait faire face à un afflux d’activités en termes tant de personnel, de matériel que de locaux.
L’expérience d’autres départements, notamment de l’Aveyron, qui a vu le TGI de Millau devenir un site détaché, montre qu’à terme l’activité y a été quasiment réduite à néant.
Ainsi, si le concept d’une juridiction de première instance, que vous situez au cœur de la réforme à venir, est perçu positivement car il permettra d’uniformiser les pratiques, il apparaît que sa départementalisation systématique serait aberrante et contraire à l’esprit de la réforme que vous souhaitez, à savoir une réforme menée dans la concertation et permettant de rendre un meilleur service aux justiciables.
Permettez-moi de rappeler ici la recommandation n° 17 de deux de nos collègues sénateurs, Virginie Klès et Yves Détraigne, sur la question de l’opportunité d’un tribunal départemental de première instance : « Créer le tribunal de première instance au siège actuel de chaque TGI, sans imposer par principe un seul tribunal de première instance par département, et créer un réseau de chambres détachées correspondant aux implantations actuelles des tribunaux d’instance. »
Je demande donc à Mme la garde des sceaux de nous rassurer, d’abord sur le maintien d’une juridiction de plein exercice pour les deux TGI du Tarn, comme elle l’a fait, à ma connaissance, concernant un département voisin, celui de l’Aude, ensuite, plus largement, sur les moyens qui seront mis en œuvre pour pérenniser les juridictions de proximité, déjà attaquées en 2007 par la carte judiciaire qu’avait voulu imposer Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, à laquelle nous nous étions déjà opposés, avec succès, dans le département du Tarn, les arguments développés alors restant d’actualité.
Madame la sénatrice, Mme la garde des sceaux vous prie de bien vouloir excuser son absence, les contraintes de son agenda ne lui permettant pas d’être parmi nous ce matin.
Vous avez bien voulu appeler son attention sur les conséquences qu’aurait la création des tribunaux départementaux dans le cadre de la réflexion sur la justice du XXIe siècle, et plus particulièrement sur la disparition du tribunal de grande instance de Castres, dans le département du Tarn. Vous vous faites ainsi l’écho des professionnels de justice de la région, qui souhaitent le maintien de cette juridiction.
Il me semble important de rappeler le contexte et la méthode. Conformément aux engagements pris par Mme la ministre de la justice, à la suite des préconisations du rapport Daël, et contrairement aux orientations du gouvernement précédent, plusieurs juridictions ont été rouvertes : les TGI de Tulle, Saint-Gaudens et Saumur fonctionneront en septembre prochain. Des chambres détachées ont aussi été créées, là où cela s’avérait nécessaire. La démarche de la Chancellerie est ainsi de renforcer la justice de proximité, au plus près des besoins des citoyens.
C’est dans cet objectif que Mme la garde des sceaux a engagé une réflexion sur l’organisation judiciaire de première instance, laquelle, après le débat national des 10 et 11 janvier dernier à la maison de l’UNESCO à Paris, s’est poursuivie dans l’ensemble des juridictions. Toutes ont répondu, et l’ensemble des professions du droit a été consulté. Les contributions sont très nombreuses, et l’analyse des services de la Chancellerie sera prochainement communiquée.
Vous le voyez, il s’agit d’une consultation de très grande ampleur, réalisée sur l’ensemble du territoire national, la méthode consistant à analyser les besoins locaux.
Mme la ministre annoncera prochainement, conformément au calendrier qu’elle avait fixé, les premières mesures de la réforme judiciaire.
Je peux d’ores et déjà vous confirmer, comme Mme Taubira l’a fait devant le Conseil national des barreaux et la Conférence des bâtonniers, ainsi qu’auprès de tous les parlementaires qui l’interpellent sur ce sujet important, qu’aucun tribunal de grande instance ne sera supprimé.
La réforme judiciaire permettra à la justice d’être au plus près des besoins de droit et le Gouvernement sait combien ils sont importants dans votre région.
Nous mesurons tout l’attachement que vous-même et vos concitoyens portez au maintien du service public de la justice sur votre territoire. Soyez assurée de l’attention que Mme Taubira porte à la situation de la région Midi-Pyrénées, et plus particulièrement au département du Tarn.

Votre réponse témoigne de l’attention que vous portez à la situation du Tarn et aux réflexions qui ont pu être menées. Nous souhaitons être entendus, dans la mesure où nous avons déjà interpellé plusieurs fois le Gouvernement sur ce sujet.

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures quarante, en raison du retard que nous avons pris au cours des réponses aux questions orales.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante, est reprise à quatorze heures quarante, sous la présidence de Mme Christiane Demontès .