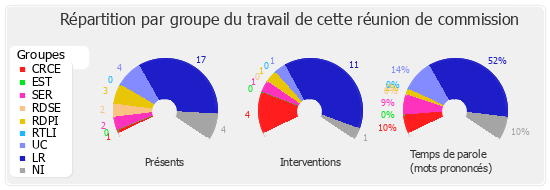Commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation
Réunion du 3 juin 2015 à 9h06
Sommaire
- Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014
- Audition de mme virginie magnant adjointe à la directrice générale cheffe de service des politiques d'appui de la direction générale de la cohésion sociale sur le rsa activité programme 304 « inclusion sociale protection des personnes et économie sociale et solidaire » (voir le dossier)
- Actualisation de la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense
- Fonds cmu
La réunion
Projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2014
Audition de Mme Virginie Magnant adjointe à la directrice générale cheffe de service des politiques d'appui de la direction générale de la cohésion sociale sur le rsa activité programme 304 « inclusion sociale protection des personnes et économie sociale et solidaire »

Nous entamons ce matin une série d'auditions préparatoires à l'examen du projet de loi de règlement. Cette année, nous avons pris le parti d'entendre des responsables de programme sur des sujets bien identifiés et à fort enjeu budgétaire.
Nous débutons donc ces travaux avec Virginie Magnant, cheffe du service des politiques d'appui et adjointe à la directrice générale de la cohésion sociale au sein du ministère des affaires sociales, de la santé et du droit des femmes, afin d'examiner l'exécution des crédits du programme 304 consacrés au RSA « activité ».
Je voudrais saluer la présence parmi nous de notre collègue Philippe Mouiller, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».
Je rappelle que le RSA « activité » est une prestation sociale qui vient compléter les revenus d'activité des ménages modestes afin de leur garantir un niveau de ressources minimum. Il est financé pour majeure partie par des crédits budgétaires.
Le projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, qui sera examiné par le Sénat en séance publique à partir du 22 juin, prévoit de remplacer le RSA « activité » et la prime pour l'emploi par une nouvelle prestation, appelée « prime d'activité », à compter du 1er janvier 2016. La préparation de cette réforme ne manquera pas de susciter des questions.
Afin que cette réunion soit aussi vivante que possible, je vais d'emblée donner la parole au rapporteur spécial Éric Bocquet pour une première séquence de questions-réponses.

Le RSA « activité » constitue la principale dépense du programme 304 de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » dont je suis rapporteur spécial. En 2014, il a représenté une dépense de près de 2 milliards d'euros, pour environ 822 000 bénéficiaires.
Je commencerai par une série de questions, dont certaines ont déjà été posées lors des exercices antérieurs, mais qui demeurent d'actualité.
Tout d'abord on constate, en 2014 un écart très important entre les crédits ouverts en loi de finances initiale et ceux exécutés s'agissant de la contribution de l'État au Fonds national de solidarité active (FNSA), qui finance principalement le RSA « activité ». Les crédits ouverts étaient d'environ 600 millions d'euros, mais 970 millions d'euros de crédits ont été consommés, soit un dépassement de plus de 61 %. Pourtant, les facteurs de risque semblaient connus : une augmentation du nombre de bénéficiaires du RSA « activité » et de son montant compte tenu de sa revalorisation de 2 % en 2013 et de 2 % en 2014 d'une part, et la baisse des recettes du FNSA en raison de la baisse du taux du prélèvement de solidarité qui lui est affecté d'autre part. Comment s'explique donc cette sous-budgétisation ?
Par ailleurs, la Cour des comptes relève un important report de charges en 2014 au titre de l'année 2013, de 147 millions d'euros. À quoi ce report est-il dû et pourquoi ne figure-t-il pas dans le rapport annuel de performance annexé à la loi de règlement ?
Enfin, connait-on l'impact qu'ont eu les revalorisations que j'ai mentionnées sur le montant total de la dépense de RSA « activité » ?
Je commencerai par rappeler que la contribution que l'État verse au FNSA constitue l'une des deux sources de financement du RSA « activité ». Le solde du FNSA résulte, en effet, d'un équilibre entre ses charges, principalement constituées par le financement du RSA « activité », et ses recettes, constituées du prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine et des placements, pour une part initialement importante, ainsi que d'une contribution d'équilibre versée par l'État.
Le décalage entre la prévision initiale du montant de la contribution de l'État et l'exécution s'explique à la fois par des raisons classiques, ou du moins récurrentes, et par des facteurs nouveaux intervenus au cours de l'exercice 2014. Pour ce qui est des explications récurrentes, il faut souligner que, depuis sa mise en place pour accompagner la généralisation du RSA en 2009, il extrêmement difficile de prévoir le rendement du prélèvement de solidarité au moment de la budgétisation. Ce prélèvement se caractérise en effet par une assez grande volatilité. En conséquence, il est compliqué d'arriver à ajuster correctement la contribution d'équilibre de l'État au FNSA. Un facteur de complexité supplémentaire est intervenu en 2014, du fait de la baisse du taux de ce prélèvement de 1,45 % à 1,37 %. La baisse de son rendement a été plus que supérieure à ce qui était attendu et ainsi, l'exécution de la recette a été significativement inférieure au montant initialement prévu.
Parallèlement à cela, la dépense de RSA a été plus dynamique que prévu. Vous avez mentionné, Monsieur le rapporteur, la revalorisation exceptionnelle du RSA de 2 % en 2013. Il est vrai que cette revalorisation a provoqué un « effet de champ » qui était difficile à simuler, et qui a conduit à faire entrer dans la prestation davantage de bénéficiaires. Une note récente de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) a fait le point sur l'évolution du RSA entre juin 2013 et juin 2014. Elle souligne qu'en plus de l'effet produit par la revalorisation, la dynamique du RSA « activité » s'est infléchie à la hausse au cours de cette période. Ainsi, sur la période de l'exécution 2014, le nombre de bénéficiaires du RSA « activité » a augmenté de 8 %, en lien avec les premiers signes d'amélioration sur le marché du travail. Or, lors de la budgétisation, les calculs consistent souvent à poursuivre une projection de manière linéaire.
Pour résumer, nous avons eu en 2014 une recette difficile à prévoir et dont le rendement a été inférieur aux prévisions, et une dépense de RSA « activité » supérieure à ce qui était attendu. Il a donc été nécessaire d'ajuster la contribution d'équilibre de l'État en fin de gestion. Il est vrai que cet ajustement n'a pas permis un rétablissement complet de l'équilibre du FNSA. Il a en revanche permis de régler le solde de 2013 sur 2014, et de réduire l'écart entre les dépenses des organismes qui servent le RSA et les recettes du FNSA.
Vous m'avez également interrogée sur la mesure de l'impact de la revalorisation du RSA de 2 % en septembre 2013 et en 2014. Nous pouvons mesurer précisément l'évolution du nombre de bénéficiaires du RSA « activité » et celle du montant moyen de prestation versé, associées à la revalorisation exceptionnelle de 2013. Celle-ci a permis l'accès à la prestation d'environ 15 000 à 16 000 personnes supplémentaires, et le montant moyen du RSA versé a progressé, tant concernant sa part « socle » que sa part « activité », s'établissant à 400 euros par mois pour l'ensemble du dispositif. En revanche, il n'est à ce stade pas possible de mesurer précisément l'impact de ces revalorisations sur l'insertion dans l'activité des travailleurs pauvres.

Vous l'avez évoqué, le nombre de bénéficiaires du RSA « activité » a augmenté de 8 % en 2014. Cela m'amène à vous interroger sur la problématique du taux de non-recours du RSA « activité », qui a été estimé à plus de 60 % en 2011. Avez-vous des éléments nouveaux concernant l'évolution de ce taux ?
La mesure du taux de non-recours est une question délicate. Lorsque la réforme du RSA est entrée en vigueur, un certain nombre de simulations avaient été effectuées afin d'évaluer le nombre de foyers potentiellement bénéficiaires de ce nouveau dispositif. Dans un premier temps, la notion de non-recours a été appréciée en rapportant le nombre de bénéficiaires réels, enregistrés par le réseau des caisses d'allocations familiales (CAF) et des mutualités sociales agricoles (MSA), au volume de bénéficiaires simulé lors de la réforme. D'un point de vue méthodologique, il est évidemment compliqué de comparer une projection théorique et une situation réelle.
La commission d'évaluation du RSA, qui était présidée par François Bourguignon et rassemblait un certain nombre d'économistes et de chercheurs, a été conduite, lors de la conclusion de ses travaux, à apprécier à partir d'un échantillon de personnes potentiellement éligibles celles qui avaient effectivement recouru à ce dispositif. Elle a abouti à un chiffre de taux de recours de 32 % s'agissant du RSA « activité ». Compte tenu de la complexité de ces travaux, nous ne les avons pas actualisés depuis, mais on considère généralement que la situation, si elle s'est un peu améliorée, n'a pas évolué de manière radicale.
Ce constat d'un faible taux de recours au RSA « activité », qui est peut être le signe de sa faible lisibilité pour les bénéficiaires potentiels ou de sa faible efficacité, est directement à l'origine de la réforme de la prime d'activité,

La mise en place de la prime d'activité devrait donc prendre en compte les difficultés constatées s'agissant du recours au RSA « activité » ?
Oui, tout à fait.

Le dernier point que je souhaiterais aborder concerne le RSA « jeunes actifs ». Ce dispositif a du mal à trouver son public. En 2011, il y avait 6 590 jeunes bénéficiaires du RSA « activité » seul. Ce nombre a baissé régulièrement pour atteindre 4 968 en 2014. Comment expliquez-vous l'ampleur de cette baisse ?
Il est vraisemblable que ce faible succès tienne aux conditions d'accès très restrictives qui ont été imaginées lors de l'ouverture du RSA aux jeunes actifs de 18 à 25 ans. Un certain nombre de conditions ont en effet été mises en place qui ne favorisent pas l'entrée des jeunes dans le dispositif, puisque ceux-ci doivent attester d'une activité continue de deux années à temps plein durant les trois ans précédant la demande. Il s'agit d'une condition difficile à réunir pour les jeunes, a fortiori dans la période économique que l'on connait. Les conditions initiales pour bénéficier du dispositif et le contexte économique sont les deux facteurs qui expliquent que le nombre de jeunes bénéficiaires du RSA « activité » soit faible, et qu'il ait même décru sur la période récente.
Cette problématique est également prise en compte dans la réforme de la prime d'activité puisque celle-ci sera ouverte à cette part de la population très sensible aux évolutions de la conjoncture, et qui connait des périodes d'insertion professionnelle délicates. L'ambition est de permettre à un million de jeunes de bénéficier à l'avenir d'un soutien à leurs revenus à travers la nouvelle prime.

Pourriez-vous nous préciser si les revenus qui seront pris en compte dans le calcul de la prime d'activité seront les mêmes que pour le RSA « activité »?
Quel sera le nombre de « perdants » et quels seront les ménages concernés ? Ces estimations tiennent-elles bien compte des personnes qui bénéficiaient auparavant de la prime pour l'emploi (PPE) mais qui ne recourront pas à la prime d'activité ?
Le Gouvernement a prévu, par voie d'amendement déposé à l'Assemblée nationale, d'inclure dans les bénéficiaires de la prime d'activité les étudiants et les apprentis. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine, a annoncé que ce coût serait compensé par une réduction du montant de la prime pour le restant des bénéficiaires. Quel sera le montant moyen mensuel ainsi « prélevé » pour financer cette extension ?
S'agissant de votre première question, qui a trait à la comparaison des assiettes des dispositifs, les revenus qui seront pris en compte pour le calcul de la prime d'activité qui, je le rappelle, constituera un différentiel entre un montant cible et des revenus perçus, seront, pour l'essentiel, les mêmes que ceux pris en compte pour le calcul de la plupart des prestations sociales, dont le RSA. Il s'agit d'un point important, l'ambition de ce nouveau dispositif consistant précisément à ne pas revenir sur ce qui a constitué le coeur de la réforme précédente du RSA, c'est-à-dire garantir une fluidité entre les situations. Je précise cependant que les revenus du patrimoine non imposables, qui sont pris en compte dans le RSA, ne le seront pas dans le calcul de la prime d'activité. Dans la mesure où ces revenus ont un impact peu significatif sur l'accès aux prestations, il a été jugé préférable de privilégier l'allègement des formalités administratives et la diminution du volume de justificatifs à produire.

Dans la mesure où les paramètres de calcul retenus sont proches de ceux qui existent actuellement, les caisses d'allocations familiales seront-elles en mesure de mettre en place rapidement ce nouveau dispositif ?
En effet, le montant de la prime pour l'emploi résultait d'un calcul simple réalisé par la direction générale des finances publiques, ce qui ne sera plus le cas pour la nouvelle prime d'activité. Or, j'ai été, comme Éric Bocquet, rapporteur spécial de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » et je sais les difficultés entraînées pour les caisses d'allocations familiales par ce type de réformes, à l'origine d'une augmentation importante du nombre de bénéficiaires.
Cette réforme constitue évidemment un défi pour le réseau de la branche famille. Je pense notamment à la nécessité pour les caisses d'allocations familiales de procéder au reparamétrage du système de gestion et de liquidation Cristal, ou de former les conseillers afin qu'ils puissent renseigner le public et gérer l'afflux de public au guichet. Néanmoins, il a été tenu compte de ces difficultés d'adaptation en essayant, lorsque cela était possible, de s'inscrire dans la continuité afin d'éviter qu'il y ait des « perdants » à cause de difficultés techniques.
S'agissant justement de votre question sur les « perdants » de la réforme, je vous confirme que les chiffres qui ont été annoncés prennent en compte les bénéficiaires actuels de la prime pour l'emploi. La réduction du nombre de bénéficiaires de la future prime d'activité par rapport au nombre de bénéficiaires cumulés du RSA « activité » et de la prime pour l'emploi s'explique par le choix qui a été fait de cibler cette aide sur les personnes dont les revenus sont compris entre 800 euros et 1 300 euros par mois, c'est-à-dire trop élevés pour bénéficier de certaines prestations sociales, mais trop faibles pour être concernés par les baisses d'impôts qui entreront en vigueur en septembre prochain.

Pourriez-vous nous préciser quelle sera la perte moyenne pour les personnes qui bénéficiaient des dispositifs précédents et qui seront exclus du bénéfice de la prime d'activité ?
Cette perte sera d'environ 53 euros pour les personnes dont les revenus dépassent 1 400 euros par mois. Cela correspond au point de sortie de la prime d'activité.

L'extension par amendement adopté à l'Assemblée nationale du bénéfice de la prime aux apprentis et aux étudiants sera financée par une diminution du montant de la prime pour les autres publics. Pourriez-vous nous indiquer de combien sera cette baisse ?
L'amendement adopté lors de la discussion à l'Assemblée nationale vise en effet à étendre le bénéfice de la future prime aux apprentis et aux étudiants. Le seuil de revenu d'activité sera fixé à 78 % du plafond de référence, soit environ 900 euros par mois, ce qui correspond à la situation d'un apprenti en troisième année. Ce seuil a été fixé par référence au seuil retenu pour les prestations familiales à partir duquel le jeune est considéré comme autonome.
La diminution résultant de cette extension pour les autres publics sera de l'ordre de 5 à 10 euros par mois. Elle concernera la bonification individuelle qui, je le rappelle, se superposera à la composante familialisée du dispositif.

Merci pour cette intervention et d'avoir accepté de vous plier à un exercice difficile, alors que vous manquez d'éléments de prévision tant sur les dépenses que sur les recettes.
Sur la question du financement du dispositif justement, il me semble que de nombreuses interrogations demeurent en suspens. Cela est compréhensible dans la mesure où les recettes dépendent de l'évolution de la situation économique.
S'agissant des dépenses en revanche, je rappelle que l'augmentation annuelle de 2 % était connue et a été votée. De même, l'augmentation du taux de recours fait également l'objet d'un objectif chiffré. La progression était donc connue et nous avions d'ailleurs alerté sur la probabilité d'un décalage entre le budget voté et la réalité.
Je souhaiterais vous poser trois questions.
Avec la mise en place de la prime d'activité, disposez-vous d'une meilleure prévision de l'évolution de la dépense, alors que le nombre de bénéficiaires risque d'augmenter ?
Disposez-vous d'instruments permettant de consolider l'ensemble des aides auxquelles ont accès les bénéficiaires du RSA ? Je pense notamment à la couverture maladie universelle ou aux diverses exonérations. Cela nous permettrait de mesurer l'écart de revenus entre les bénéficiaires du RSA et les personnes rémunérées au SMIC.
Enfin, pourriez-vous nous préciser quels sont les objectifs de la réforme en matière de retour à l'emploi ?

Mes questions vont déborder la problématique du RSA « activité ». On se souvient des déclarations de François Chérèque selon lesquelles 40 % des personnes pouvant bénéficier du RSA n'y ont pas recours. Avez-vous constaté une évolution sur ce point ? Pourriez-vous nous indiquer comment sera financée l'éventuelle augmentation du taux d'utilisation ?
Par ailleurs, avez-vous eu connaissance de collectivités qui n'auraient pas inscrit dans leur budget 2015 l'ensemble des dépenses de RSA ? On m'a cité le cas d'un département qui n'aurait pas inscrit le mois de décembre. C'est une question importante tant les sommes concernées sont considérables.
Vous avez indiqué que l'augmentation de la dépense relative au RSA « activité » résultait d'une amélioration du marché du travail. Avez-vous davantage d'informations sur cette tendance ? Quelles sont les perspectives en matière d'emploi ?
Vous avez qualifié les dépenses en augmentation de « dynamiques ». Le caractère dynamique de la dépense semble être positif dans votre propos. Est-il effectivement positif que la dépense augmente ?
Enfin, l'augmentation du chômage devrait avoir un impact sur les dépenses de RSA. Disposez-vous d'évaluations des risques d'augmentation des dépenses de RSA au-delà de l'objectif de 2 % par an pendant cinq ans ?

Je souhaiterais compléter les questions de mes collègues par des questions simples. Pourriez-vous nous indiquer quelle est l'utilité de ce nouveau dispositif, qui inclura l'actuelle prime pour l'emploi, dont on connait la faible efficacité et son coût qui s'élevait à plusieurs milliards d'euros. Constituera-t-il réellement une incitation à la reprise d'emploi ? Comment sera financé ce dispositif alors que l'État est en quasi faillite ? Enfin, qui versera cette nouvelle aide : l'État ou les conseils départementaux ?

Vous avez exposé la difficulté à évaluer les entrées et les dépenses du futur dispositif à partir de modélisations. Ne pensez-vous pas que nous pourrions avoir davantage recours à l'expérimentation ? Ne serait-il pas plus judicieux de procéder à des expérimentations locales, comme cela été le cas lors de la mise en place du revenu minimal d'insertion, plutôt que de se fier à des modélisations très audacieuses de recettes et de dépenses dont on découvre a posteriori qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on a envisagé ?
Vous m'avez interrogée sur les difficultés de prévision en dépenses et en recettes ainsi que sur la fiabilité et la crédibilité qui peut leur être apportée, notamment au moment de la présentation en loi de finances.
S'agissant des prévisions de dépenses, il me paraît important de souligner que l'année 2014 a été marquée par le plein effet d'une première revalorisation exceptionnelle de 2 %, décidée et appliquée en septembre 2013, de manière relativement rapide. Cette décision résultait du plan de lutte contre la pauvreté et avait été mal prise en compte lors de la budgétisation.
Il faut rappeler à cet égard que le projet de loi de finances se prépare très tôt. S'il est déposé sur le bureau des assemblées en octobre, le travail technique entre les services et la direction du budget commence dès le début de l'année. Les premières simulations et projections sont échangées au printemps, puis les lettres plafonds du Premier ministre sont adressées aux ministres à la fin du mois de juin ou début juillet. Par conséquent, les simulations et projections traduites dans le projet de loi de finances reposent sur des chiffrages du premier semestre, lesquels, compte tenu du fonctionnement de l'appareil statistique, rendent compte des données de l'année précédente. Il existe donc un décalage entre les données disponibles au moment de la construction budgétaire et l'exécution réelle. Les collectifs budgétaires ont précisément pour vocation de tenir compte des évolutions de conjoncture entre la prévision et l'exécution. Car il peut effectivement exister des évolutions importantes en cours d'année, avec un impact sur les prestations, ces dernières constituant des revenus monétaires qui s'ajustent à différents paramètres, tels que la situation macroéconomique ou la situation de l'emploi.
Je ne pense pas, pour autant, que ces contraintes calendaires et techniques invalident l'exercice de projection et de simulation.
Il n'est pas rare, d'ailleurs, que des prestations connaissent des évolutions dynamiques. Par exemple, l'allocation adulte handicapé (AAH), financée sur le programme 157 « Handicap et dépendance », et dont le montant est proche de 7 milliards d'euros, a connu par le passé une telle évolution, en lien notamment avec la revalorisation de 25 % de son montant décidée sous la précédente mandature.
Tout au long de la mise en oeuvre de cette revalorisation exceptionnelle, nous avons a constaté des effets sur les publics bénéficiaires et une dynamique de la dépense significativement supérieurs aux évolutions liées à « l'effet prix » - à savoir la revalorisation régulière du montant de la prestation en lien avec l'inflation - et à « l'effet volume », c'est-à-dire l'augmentation régulière du nombre de bénéficiaires. Des effets de champ se sont ainsi cumulés avec des changements de contexte économique. En conséquence, le nombre de bénéficiaires du dispositif s'est avéré supérieur à nos prévisions.
La fin de la revalorisation exceptionnelle a permis un retour à des évolutions plus classiques. Les deux effets majeurs ont repris leur importance, nos prévisions sont désormais plus fiables et les ouvertures en collectif de fin d'année, qui ont été importantes par le passé, ont été réduites. On constate ainsi peu d'écart entre la prévision de la loi de finances initiale pour 2014 et l'exécution, ainsi que des ouvertures de crédits limitées en collectif.
Les dynamiques de prestations sont donc plus ou moins complexes à estimer. Nous travaillons avec des statisticiens en nous efforçant d'intégrer dans nos projections les phénomènes qui peuvent faire évoluer les paramètres. Il est compliqué de s'ajuster mais je ne crois pas que cela invalide pour autant la sincérité et le sérieux de nos prévisions.
En ce qui concerne la fiabilité des prévisions relatives à la prime d'activité par rapport à la future exécution budgétaire, je voudrais ici rappeler l'histoire récente de la généralisation du RSA en juin 2009 et insister sur la difficulté inhérente au passage d'une simulation théorique, à partir de modèles statistiques, à la réalité. En effet, il nous est impossible de simuler quel sera le taux de recours à la prestation.
S'agissant du RSA, à l'époque, nous avions fait le choix de considérer que le taux de recours serait maximal. Autrement dit, dès la première année de la mise en place de la réforme, il était nécessaire de budgéter le dispositif à son montant cible. Or, en pratique, on a constaté que la prestation ne trouvait pas son public et que le taux de non-recours demeurait important dans la durée. En outre, avant d'atteindre le palier connu par cette prestation sur les années récentes, on s'est heurté à un phénomène de montée en charge, sur lequel aucun statisticien ne peut s'engager, dans la mesure où chaque montée en charge de chaque prestation a été différente.
Pour conclure, je dirais que nos simulations sont les plus fiables possibles, nos données étant issues de micro-simulations croisées et convergentes entre plusieurs départements statistiques. Elles nous permettent de produire des études d'impact fournissant à la fois des montants individuels par composition du foyer ou par tranche de revenus, et de simuler un impact budgétaire.
En revanche, une donnée demeure une inconnue dans la présentation du prochain projet de loi de finances pour 2016, même si l'on en a tenu compte dans la projection budgétaire. Nous évaluons le taux de recours à 50 %, et nous émettons des hypothèses sur les conditions de montée en charge. Mais cela reste des hypothèses et il sera temps de revenir sur leur pertinence lorsque nous discuterons de l'exécution 2016.
Vous m'avez par ailleurs interrogée sur l'intérêt de l'expérimentation pour sortir des modèles théoriques. Pour la direction générale de la cohésion sociale, il est clair que l'expérimentation en matière sociale constitue un outil précieux. Toutefois, encore faut-il réaliser de telles expérimentations dans des conditions sérieuses, comme nous l'avons fait pour le RSA, à travers la mise en place de territoires pilotes d'un côté et de territoires témoins de l'autre, ainsi que d'un dispositif de collecte d'indicateurs et de suivi. L'expérimentation présentait un réel intérêt dans le cas du RSA « activité ». En effet, celui-ci poursuivait plusieurs objectifs, notamment le soutien au revenu des travailleurs modestes et le retour à l'activité pour éviter la discontinuité entre des situations de non-emploi et des situations d'emploi. Dans ce cas, il était décisif de pouvoir disposer d'informations sur l'effectivité des reprises d'emploi associées. Effectivement, lorsque l'on a comparé le revenu des personnes percevant le RSA « activité » à celui de celles qui ne le recevaient pas dans la phase expérimentale, on a pu constater clairement que les bénéficiaires avaient des revenus plus élevés que les autres.
Pour autant, l'expérimentation présente peut-être moins d'intérêt au regard de la prime d'activité. En effet, cette prestation poursuit avant tout un objectif primordial de soutien au pouvoir d'achat. Doit-elle viser un effet incitatif sur le retour à l'emploi ? Ce n'est pas son but premier. Il s'agit de mettre en place une aide monétaire différente, concentrée sur des publics qui disposent d'un revenu d'activité qui ne correspond pas, pour la plupart d'entre eux, à un revenu d'activité à temps plein, mais qui sont d'ores et déjà en voie d'insertion sur le marché du travail. Le Gouvernement a d'abord visé un objectif de rapidité dans le déploiement de cette réforme.
Le financement de la prime d'activité sera assuré par l'État. Le RSA bénéficiait d'un double financement en provenance des conseils généraux pour le RSA « socle » et de l'État pour le RSA « activité ».
La prime d'activité sera quant à elle exclusivement financée par l'État, à travers deux sources existantes : les crédits consacrés au RSA « activité », qui continueront d'être alloués à la prime d'activité, et les financements auparavant dédiés à la prime pour l'emploi, qui seront réorientés vers la prime d'activité.
Cela représente un montant total estimé à 3,8 milliards d'euros.
La commission demande à se saisir pour avis sur le projet de loi n° 2779 (AN - XIVe législature) actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (sous réserve de sa transmission) et nomme M. Dominique de Legge rapporteur pour avis.
Puis, la commission procède à l'audition pour suite à donner à l'enquête de la Cour des comptes, transmise en application de l'article 58-2° de la LOLF, sur le fonds CMU.
La réunion reprend à 10 heures 15.

Je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans la salle Clemenceau pour cette réunion à laquelle nous avons convié les membres de la commission des affaires sociales, venus nombreux. Je veux saluer en particulier la présence de son président, Alain Milon, et de son rapporteur général, Jean-Marie Vanlerenberghe. Cette réunion est également ouverte à la presse et retransmise en direct sur Public Sénat.
Je vous rappelle qu'en novembre 2013, en application du paragraphe 2 de l'article 58 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), la commission des finances a confié à la Cour des comptes le soin de réaliser une enquête sur le fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie, également appelé « fonds CMU ». Ce Fonds a pour principale mission de financer, d'une part, la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et, d'autre part, l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (ACS). Ces deux aides sont gérées par l'assurance maladie.
Ce travail avait été proposé par Jean Pierre Caffet, qui était à l'époque rapporteur spécial de la mission « Santé ». Il a été réalisé dans un contexte d'élargissement des conditions d'accès à la CMU-C et à l'ACS et de modifications importantes des modalités de financement du fonds CMU. Aujourd'hui, c'est Francis Delattre qui exerce les fonctions de rapporteur spécial et qui a suivi le déroulement de l'enquête.
Comme à l'accoutumée, nous avons souhaité entendre, lors de cette audition pour « suite à donner », les principaux acteurs impliqués dans la gestion de la CMU-C et de l'ACS. Je donnerai, tout d'abord, la parole à Antoine Durrleman, président de la sixième chambre de la Cour des comptes, afin qu'il présente les principales conclusions de l'enquête. Il est accompagné de Jean-Pierre Viola, conseiller maître et rapporteur. Puis, nous entendrons la réaction du directeur du fonds CMU, Vincent Beaugrand.
Après ces deux propos liminaires commencera l'échange avec les sénateurs. Vos questions pourront également s'adresser à Nicolas Revel, directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), à Thomas Fatome, directeur de la sécurité sociale, et à Agnès Bocognano, qui est directrice déléguée « santé » de la fédération nationale de la Mutualité française (FNMF).
À l'issue de l'audition, je demanderai aux membres de la commission des finances leur accord pour publier l'enquête remise par la Cour des comptes.

La demande que votre commission a adressée à la Cour des comptes nous paraît particulièrement pertinente. Il est en effet nécessaire d'évaluer les dispositifs financés par le fonds CMU, d'autant que ceux-ci ont fait l'objet de nombreux aménagements dans les années récentes. L'ensemble des membres de la commission des affaires sociales seront donc attentifs aux conclusions de la Cour des comptes, qui appelleront un certain nombre de questions de notre part et en particulier de notre rapporteur général.

Je regrette que des indiscrétions malheureuses aient permis à certains organes de presse de révéler une partie des constats et conclusions de votre enquête, mais l'affluence de ce matin montre que votre travail suscite malgré tout de l'intérêt. Monsieur le président de la sixième chambre, je vous invite sans plus attendre à nous présenter la synthèse des travaux de la Cour des comptes.
La commission des finances nous a proposé une thématique paradoxale. Le paradoxe réside tout d'abord dans la dimension de l'institution sur laquelle porte stricto sensu l'enquête. Le fonds CMU est, si j'ose dire un « confetti » de l'empire par rapport à l'immensité de la protection sociale. C'est un organisme qui apparaît svelte et efficient - avec dix emplois au total et deux cents mètres carrés de bureaux dans le XIIIe arrondissement.
Le fonds CMU mérite d'exister. Il a su prendre ses fonctions et assurer ses missions dans de très bonnes conditions. Il existe bien évidemment une disproportion très forte entre la dimension volontairement modeste de cet établissement public et l'importance des dispositifs que celui-ci a reçu pour mission de financer et de promouvoir.
Notre enquête a porté essentiellement sur la CMU-C et l'ACS. Ces deux dispositifs sont conjoints et complémentaires. Ils s'articulent autour de la CMU de base, à laquelle est liée la CMU-C, sans que ce lien soit obligatoire, l'ensemble des bénéficiaires de la CMU-C n'étant pas seulement les bénéficiaires de la CMU de base.
Le premier constat réside dans le fait que ces deux dispositifs signent une certaine forme d'échec de l'assurance maladie obligatoire, qui se révèle dans la difficulté à couvrir, à un niveau suffisant, la prise en charge des soins des assurés sociaux.
Selon le rapport annuel pour 2013 du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, l'assurance maladie obligatoire de base a pris en charge, en 2012, 76,1 % des dépenses de soins présentées au remboursement. Cette part atteint 88,6 % pour les titulaires d'une affection de longue durée (ALD), qui sont mieux protégés parce que pris en charge à 100 % au titre de la maladie principale. Cette prise en charge correspond à 95 % pour les soins à l'hôpital, et à 84,4 % pour les soins en ville.
Le niveau de prise en charge pour les autres assurés sociaux est aujourd'hui de seulement 61,3 %, dont 88,1 % à l'hôpital et 51 % pour les soins ambulatoires. Au fond, la création de la CMU-C, puis de l'ACS, acte cette érosion progressive de la couverture par l'assurance maladie obligatoire. Ce retrait a entraîné des phénomènes de renoncement aux soins, et rend aujourd'hui nécessaire une couverture complémentaire des frais de santé.
Ces dispositifs couvrent aujourd'hui une population importante : au total, 6,4 millions de personnes dont 5,2 millions au titre de la CMU-C et 1,2 million de personnes au titre de l'ACS soit, au total, 9,5 % de la population des assurés sociaux, 7,7 % pour les bénéficiaires de la CMU-C et 1,8 % pour ceux qui utilisent l'ACS. Ils jouent donc un rôle majeur pour l'accès aux soins de la part la plus défavorisée de nos concitoyens.
Ces aides ont été, depuis leur création, élargies à une population de plus en plus importante par des relèvements successifs des plafonds de ressources, qui ont permis de faire entrer dans leur champ davantage de personnes. L'élargissement du champ des bénéficiaires potentiels a permis une augmentation du nombre des bénéficiaires effectifs, même si celle-ci est moins rapide. Cette dynamique est également liée aux effets de la crise économique, à compter de 2008, qui ont fait basculer un nombre plus important de personnes vers ces dispositifs.
Paradoxalement, les pouvoirs publics ont davantage donné la priorité à l'extension du périmètre de la population éligible à la CMU-C et à l'ACS, plutôt qu'à l'accès effectif à ces droits. Pour des raisons de coût, ils n'ont pas souhaité entrer dans une logique d'attribution automatique de ces droits à certaines populations qui, pour autant, compte tenu de leurs ressources, en sont nécessairement bénéficiaires. Il s'agit en particulier des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) socle, ou de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
On constate d'année en année, quels que soient les efforts du fonds CMU et des caisses d'assurance maladie, un taux massif de non-recours. En 2013, le taux de non-recours de la CMU-C représentait entre 28 % et 40 % de ses bénéficiaires. Entre 1,6 million et 2,7 millions de personnes qui pourraient avoir ainsi droit à une couverture maladie complémentaire gratuite, grâce à la CMU-C, n'y ont pas accès. Les causes de ce non-recours nous apparaissent aujourd'hui insuffisamment claires. Bien sûr, l'hypothèse d'un taux d'accès à 100 % à un dispositif est par nature conventionnelle ; malgré tout, la récurrence du non-recours suscite beaucoup d'interrogations.
L'ACS connaît une situation encore plus défavorable. Selon les dernières estimations, les personnes n'ayant pas demandé l'ACS représentaient, en 2013, entre 59 % et 72 % de la population des bénéficiaires potentiels. Ce sont entre 1,9 million et 3,4 millions de personnes qui pourraient avoir accès à cette aide mais qui n'y recourent pas.
Bien sûr, nous avons constaté que les organismes sociaux mettent en place des actions de promotion de ces dispositifs, mais celles-ci nous sont apparues comme étant encore en cours de définition. Les actions de la CNAMTS ou de la CNAF, au moment de l'attribution du RSA, restent lacunaires et ne réussissent pas à enrayer significativement l'importance de ce phénomène.
Troisième constat : ces dispositifs n'ont pas réglé toutes les difficultés d'accès aux soins, même pour ceux qui y ont effectivement recours. Nous constatons, d'une part, que demeurent des cas de renoncement aux soins parmi les bénéficiaires de la CMU-C, et que les bénéficiaires de l'ACS ne choisissent pas toujours des contrats de très bonne qualité. De ce point de vue, le bilan apparaît en demi-teinte au regard de l'accès effectif aux soins de ces populations.
Dans le rapport, nous soulignons l'intérêt du nouveau dispositif de sélection des contrats éligibles à l'ACS, qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2015. Devant le constat que l'ACS ne permettait pas toujours de bénéficier de garanties de suffisamment bonne qualité à des tarifs intéressants, les pouvoirs publics ont décidé d'organiser un appel à la concurrence. Ceci a eu pour conséquence d'améliorer la qualité des garanties procurées par les contrats auxquels les bénéficiaires de l'ACS peuvent souscrire. Cette mesure apporte une réponse très intéressante à la question du caractère insuffisamment solvabilisateur de l'aide et au faible niveau de garanties des contrats auxquels elle permet d'accéder.
Quels que soient les progrès que nous pouvons constater en termes d'amélioration de l'accès aux soins, les modalités de gestion de la CMU-C et de l'aide à l'ACS mériteraient d'être simplifiées. Nous avons constaté la lourdeur des démarches que les demandeurs doivent effectuer. Les conditions d'instruction par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) restent encore insuffisamment sécurisées et les risques d'anomalie et d'erreur dans l'attribution de la CMU-C sont importants. Ce sont des constats que la Cour des comptes avait déjà faits dans le passé, notamment dans son rapport sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) de 2006.
Ce n'est qu'à partir du début de l'année 2015 que la CNAMTS a engagé une politique active de rapprochement des ressources déclarées par les demandeurs de la CMU-C et de l'ACS avec leurs comptes bancaires. Ce travail de rapprochement nous apparaît tout à fait essentiel, puisque les expérimentations conduites dans quatre CPAM - même si elles ne constituent pas un échantillon représentatif - représentent 10 % des demandes de renouvellement. Le taux d'attribution irrégulière apparaît élevé : pour la CMU-C, 24,7 % des dossiers étudiés comportent des ressources supérieures au plafond de la CMU-C, principalement en raison de déclaration incomplète des ressources et environ 13 % des dossiers comportent des ressources excédant le plafond de l'ACS.
Au-delà de ces constats sur le faible recours et les modalités de gestion, la Cour des comptes appelle votre attention sur trois risques.
Le premier concerne les perspectives financières du fond CMU. Celles-ci sont en voie de dégradation. À situation inchangée, le fonds CMU pourrait connaître un déficit en 2017 ou 2018. Cette situation est d'autant plus inquiétante que l'extension considérable de la population éligible se traduit, pour le fonds CMU, par des engagements latents considérables. En prenant l'hypothèse, conventionnelle, selon laquelle 100 % de la population éligible utiliserait la CMU-C ou l'ACS, il faudrait compléter les financements actuels dont dispose le fonds CMU-C de 1,2 à 2 milliards d'euros. Les pouvoirs publics devraient réaliser un effort considérable, alors même que la généralisation de la protection sociale complémentaire d'entreprise, dans le cadre de la loi du 24 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, suppose déjà un effort très important de la part de l'État, estimé entre 1,5 et 2 milliards d'euros en année pleine.
Le deuxième risque que nous soulignons est celui de l'analyse, insuffisante à nos yeux, des conditions de recours au système de soins par les bénéficiaires de la CMU-C et de l'ACS. La CMU-C offre un accès gratuit à la majeure partie des soins et présente donc un caractère très protecteur. Les études réalisées sur les modalités du recours aux soins des bénéficiaires de la CMU-C restent insuffisantes pour écarter de manière claire et étayée le risque surconsommation.
Le troisième risque est celui d'un décrochage entre le seuil de pauvreté monétaire et le plafond d'attribution de ces dispositifs. Nous relevons en particulier une déconnexion entre ces deux éléments. C'est évidemment un choix qui permet de faire entrer davantage de personnes dans le dispositif. Toutefois, la totalité des ressources des bénéficiaires n'étant pas prise en compte, le plafond de la CMU-C va au-delà du seuil de pauvreté monétaire.
Ce sont là nos principaux constats. Ils se traduisent par douze recommandations qui sont de nature et de portée très différentes. Nous insistons en particulier sur l'impératif de soutenabilité de l'effort qui est consenti en faveur de ces dispositifs. Nous insistons également sur le fait que leur connaissance et celle des populations éligibles sont encore aujourd'hui insuffisamment documentées ; les modes de recours aux soins mériteraient d'être précisés. Enfin, les conditions de gestion de ces dispositifs gagneraient à être sécurisées et simplifiées.

J'invite maintenant Vincent Beaugrand, qui est directeur du fonds CMU depuis décembre 2013, à nous faire part de sa réaction aux conclusions et préconisations de la Cour des comptes. Monsieur Beaugrand, partagez-vous l'analyse de la Cour des comptes s'agissant des causes du non-recours ? Est-il bien nécessaire de réviser le champ de la CMU-C et de l'ACS ?
Je remercie le président de la sixième chambre de la Cour des comptes pour ses propos positifs sur le travail que le fonds CMU réalise au quotidien. « Svelte et efficient » sont des termes qui nous caractérisent bien ; celui de « confetti » également.
Nous sommes petits, mais nous travaillons sur des dispositifs qui apportent beaucoup à nos concitoyens en matière d'accès à la santé. L'objectif de la CMU-C et de l'ACS est, en effet, de lever les barrières financières pour diminuer le renoncement aux soins. Cette question a été essentielle au moment de la création de la CMU-C, puis de l'ACS. Elle est posée dans l'ensemble du rapport.
Comme le souligne le rapport de la Cour des comptes, on estime que, pour les quelque 5 millions de bénéficiaires de la CMU-C, à peu près la moitié des freins financiers à l'accès aux soins sont levés. Concrètement, un million de personnes accèdent aux soins grâce à ce dispositif, ce qui permet de maintenir l'insertion sociale. Je souhaitais donc rappeler la pertinence de cette dépense, ce qui n'empêche pas de s'interroger sur le non-recours ou sur le fait que certaines personnes renoncent aux soins malgré cette aide ou certains cas de refus de soins. Par ailleurs, le choix du législateur a été de permettre l'accès des plus démunis à l'ensemble du système de soins. Il n'y a pas de sous-système, comme dans certains pays, dans lesquels on oriente les plus pauvres vers des centres de soins dédiés. C'est un point positif en matière de solidarité nationale.
Concernant la consommation de soins et de produits de santé, nous ne disposons certes pas d'étude parfaite, mais la CNAMTS travaille sur ce sujet. Beaucoup d'éléments démontrent qu'il n'existe pas de surconsommation liée au dispositif. L'augmentation du recours aux soins est normale : c'est en effet le but de ce dispositif.
En second lieu, la consommation moyenne d'un bénéficiaire de la CMU-C apparaît supérieure à celle d'un Français moyen. Mais il ne faut pas perdre de vue que l'état de santé des personnes concernées est très dégradé - avec une forte prévalence des affections de longue durée, le doublement du nombre de cas de dépressions, de diabète, d'hypertension et d'obésité. Il en va de même des pathologies chroniques. Le VIH connaît une prévalence supérieure de 50 % chez les bénéficiaires de la CMU-C. Pour ces pathologies lourdes et chères, le coût moyen d'un bénéficiaire de la CMU-C est supérieur au coût moyen de la prise en charge d'un assuré du régime général d'assurance maladie. Ceci est lié aux inégalités sociales en matière de santé, qui font que plus on est en bas de l'échelle sociale, plus l'état de santé nécessite des soins importants.
Enfin, nous ne disposons d'aucune étude permettant de démontrer la surconsommation de soins liée à l'existence du dispositif. Il est difficile d'imaginer que l'on aille chez le médecin par pur plaisir. Cela n'empêche pas les fraudes, et les services sont mobilisés pour lutter contre ces abus. Des dispositifs sont en cours de mise en place. Une cohorte permettra ainsi à moyen terme d'avoir plus d'informations de la part de la CNAMTS sur la consommation de soins.
Un autre point positif a été mis en avant par la Cour des comptes concernant l'évolution de l'ACS. Ceci représente un travail de longue haleine, notamment grâce aux rapports produits chaque année par le fonds CMU. Ils démontrent que les contrats d'ACS étaient de mauvaise qualité. Une procédure de sélection des contrats a été mise en oeuvre afin de lutter contre le non-recours. Le lancement officiel de ces nouveaux contrats est prévu le 1er juillet 2015. Il sera relayé par une campagne d'information importante pour toucher les nouvelles cibles de l'ACS.
Nous avons récemment mis à jour les perspectives financières du fonds CMU à l'horizon 2017, afin de tenir compte de l'évolution de la baisse du coût moyen de la CMU-C depuis 2013. En intégrant l'année 2014, le moment où le fonds serait déficitaire et où la CNAMTS ne serait pas remboursée de l'ensemble des dépenses de CMU-C serait décalé d'environ une année. Cette situation interviendrait donc plutôt en 2018 ou 2019.
Les hypothèses utilisées pour établir les prévisions financières demeurent très prudentes. Notre objectif étant d'alerter en amont le Gouvernement et le Parlement sur d'éventuels besoins de financement, nous intégrons des hypothèses de croissance des effectifs importantes, de plus de 700 000 bénéficiaires de la CMU-C à l'horizon 2019, et de plus de 500 000 bénéficiaires de l'ACS, en tenant compte de la croissance naturelle du dispositif, mais aussi d'augmentation du taux de recours. La deuxième hypothèse est celle d'une croissance de 2 % à 2,5 % des chiffres d'affaires des organismes complémentaires qui forment la base de notre ressource. C'est une hypothèse assez raisonnable puisque le taux de croissance était plutôt de 2,5 % à 3 % depuis des années. L'hypothèse d'évolution du coût moyen retenue est de 0 % à 1 %, alors même que le coût moyen par bénéficiaire est plutôt en baisse depuis 2013, de 1,5 % à 2 %. La question financière se poserait donc dans quelques années, mais en retenant des hypothèses assez prudentes.
Enfin, la collecte de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) comporte des marges d'améliorations. Vous avez voté, dans le cadre de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, une fusion de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance (TSCA) et de la TSA qui va permettre d'améliorer notre efficience et la qualité des contrôles que nous menons en matière de collecte. Nous travaillons pour que cette fusion soit mise en place au 1er janvier 2016.
Pour conclure, je signale que nous produisons des rapports d'évaluation tous les deux ans et qu'il existe, tous les ans, des rapports précis sur le coût moyen de la CMU-C et sur les contrats choisis par les bénéficiaires de l'ACS, qui permettent de formuler un certain nombre de recommandations. Cela fait dix-huit mois que je suis à la tête du fonds CMU. Durant cette période, nous avons mené un certain nombre de réformes, comme la modification en profondeur de l'ACS.

Monsieur le président de la sixième chambre, le rapport présenté est de qualité et nous indique quelques pistes de réforme pour les années qui viennent.
Vous évoquez de graves déficiences dans la gestion de la CMU-C et de l'ACS, ce qui nous amène à poser à la fois des questions techniques, mais aussi des questions du ressort politique. Personne ne remet en cause l'utilité de ces dispositifs, mais l'analyse de la Cour des comptes me paraît assez juste : le relèvement exceptionnel de 7 % des plafonds de ressources dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté, a augmenté le nombre de bénéficiaires potentiels, d'où la difficulté, du point de vue de la commission des finances, soutenir cette dépense à l'avenir. À brève échéance, le montant de ce déficit serait faible, de l'ordre de quelques millions d'euros. Ce qui nous fait davantage réagir, c'est le montant total des engagements compris entre 1,2 et 2 milliards d'euros. Si le taux de recours augmentait fortement, nous serions confrontés à un vrai problème de soutenabilité. Il conviendrait alors de redéfinir les plafonds de ressources conditionnant l'accès à ces dispositifs. Le seuil de pauvreté monétaire est utilisé par beaucoup d'organismes ; il peut y en avoir d'autres et il nous faut y réfléchir.
Par ailleurs, faire en sorte que tous ceux qui ont besoin de la CMU-C et de l'ACS puissent la comprendre ne nous paraît pas inutile. Nous sommes tous des élus de terrain, et nous savons bien qu'il existe un véritable problème d'accessibilité et de compréhension vis-à-vis de ces mécanismes. Monsieur le président de la sixième chambre, pouvez-nous nous préciser sur quelles hypothèses reposent les chiffres du déficit compris entre 1,2 et de 2 milliards d'euros ?
Par ailleurs, quels revenus souhaiteriez-vous réintégrer dans les plafonds de ressources pris en compte pour bénéficier de la CMU-C et de l'ACS ? Il faut en effet être équitable, et je pense que tous les revenus doivent être intégrés, y compris la totalité des aides au logement. Cette même logique pourrait-elle être suivie pour d'autres aides sociales ?
Je voudrais ensuite m'adresser à Thomas Fatome et lui demander quelques informations techniques, en particulier s'agissant des déficiences informatiques. Il est fort dommageable que de grandes administrations comme l'assurance maladie ne disposent pas de logiciels capables de servir pareil projet ! Quelles mesures mettez-vous en place pour rectifier le tir ?
Je m'interroge également sur la concentration géographique de ces aides. Beaucoup de personnes bénéficiant de la CMU-C se trouvent dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Or on sait qu'on y compte beaucoup de retraités, catégorie qui a le moins recours à ce système, les titulaires du minimum vieillesse étant à la limite des seuils. Comment expliquez-vous cette situation ? Par ailleurs, pourriez-vous nous donner des précisions concernant la simplification des démarches ? Enfin, quelles sont vos estimations concernant l'évolution du taux de recours à l'ACS d'ici 2020 ? Quels coûts supplémentaires cela pourrait-il entraîner ?
Monsieur Revel, les travaux de la Cour des comptes mettent en lumière de graves problèmes dans la gestion des demandes de CMU-C et d'ACS, ainsi qu'une insuffisance des contrôles. Pourriez-vous préciser quel est l'état d'avancement du projet de refonte du logiciel ? Ce projet ayant été lancé en 2009, quelles sont, selon vous, les causes du retard ? De plus, vous avez annoncé, le 13 mai dernier, le lancement d'un plan national de contrôle des ressources des bénéficiaires de la CMU-C à partir des comptes bancaires. Disposez-vous de toutes les autorisations vous permettant d'effectuer ce type de contrôles ?
Par ailleurs, Monsieur Beaugrand, vous affirmez que la surconsommation constitue pour vous un sujet de préoccupations ; pour nous aussi ! Nous attendons donc le résultat des études en cours.
Enfin, Madame Bocognano, que pensez-vous de l'appel d'offres lancé à propos des contrats éligibles à l'ACS, en particulier pour les personnes âgées de plus de quatre-vingts ans et de moins de seize ans ?
La fourchette de 1,2 à 2,2 milliards d'euros d'engagements latents, fondée sur l'hypothèse conventionnelle selon laquelle 100 % de la population éligible accéderait au dispositif, est liée à l'incertitude concernant le taux effectif de non-recours. S'agissant de la CMU-C, on estime le taux de non-recours entre 28 % et 40 % des bénéficiaires éligibles. Pour l'ACS, ce taux de non-recours serait compris entre 59 % et 72 %. Si on prend la borne basse, on est à 1,2 milliard d'euros d'engagements latents ; si on prend la borne haute de ces deux estimations, on est à 2,2 milliards d'engagements latents. L'analyse plus fine du taux de non-recours est donc une question centrale pour améliorer les précisions financières. C'est d'ailleurs l'une de nos recommandations.
S'agissant des ressources des demandeurs prises en compte pour déterminer l'éligibilité à la CMU-C ou à l'ACS, nous constatons que l'exclusion d'une partie des ressources par rapport à celles entrant dans le revenu disponible des ménages fait que la référence au seuil de pauvreté pour apprécier le niveau relatif des plafonds de ressources de la CMU-C et de l'ACS - comme cela a été le cas pour calibrer à 7 % la revalorisation des plafonds en termes réels en juillet 2013 - n'est en fait pas pleinement justifiée, les quotités de ressources prises en compte n'étant pas les mêmes. Caler l'objectif de population prise en charge sur le seuil de pauvreté monétaire, toutes choses égales par ailleurs, devrait amener à élargir la base de ressources.
Dans notre esprit, ce n'est pas la solution qui paraît la plus directement envisageable. Améliorer la soutenabilité du dispositif consiste d'abord à s'assurer de l'attribution à bon droit de la CMU-C et de l'ACS, aux personnes qui en remplissent les conditions. C'est ce que nous avions déjà dit en 2006 : les contrôles des ressources doivent être intensifiés. Nous avons constaté qu'entre 2006, date de notre dernière enquête sur la CMU-C et l'ACS, et fin 2014, il n'y a pas eu d'action de grande envergure.
En second lieu, nous insistons sur la question du niveau de consommation des soins. En 2006 et 2011, nous avions déjà recommandé de « purger » cette question. L'apparente surconsommation de soins des bénéficiaires de la CMU-C, qui serait de 30 % supérieure à celle de l'assuré moyen, est-elle uniquement due à un état de santé plus dégradé et à un phénomène de rattrapage dans l'accès aux soins ? Si tel est le cas, il ne s'agirait pas d'une surconsommation, mais d'un phénomène de rattrapage, qui n'aurait pas dû se produire dans le cadre d'une protection sociale solidaire permettant l'accès de tous aux soins. Le dispositif lui-même, du fait de sa gratuité, entretient-il une forme de surconsommation ? C'est une question centrale au regard de deux points. Tout d'abord, en matière de gestion du risque, faut-il ou non accorder une attention particulière au recours aux soins de ces personnes ? Pour l'instant, il n'y a pas de gestion du risque très spécifique sur cette partie de la population. Peut-être n'y en a-t-il pas besoin mais encore faut-il le démontrer.
Ensuite, la question de la légitimité de ces dispositifs nous paraît au moins aussi importante que celle de leur soutenabilité financière. Ce sont des dispositifs exceptionnels, qui se traduisent par des engagements financiers massifs et qui constituent une sorte de bouclier sanitaire, qui protège du mieux possible du désengagement rampant de l'assurance maladie qui a pu se produire à une certaine période.
Ce sont des dispositions plus protectrices que celles qui s'appliquent au reste de la population. Ceci était traditionnellement vrai pour la CMU-C ; c'est aujourd'hui vrai pour l'ACS telle qu'elle sera redéfinie à partir du 1er juillet 2015. Il faut une transparence « de diamant » pour asseoir la légitimité de ces dispositifs, dans la mesure où la taxe de solidarité additionnelle (TSA) les finançant est payée par tous les autres assurés sociaux disposant d'une couverture maladie complémentaire.
directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. - Nous étudions les questions de soutenabilité financière et de prévision avec beaucoup d'attention. Si la Cour des comptes est dans son rôle en attirant l'attention sur les risques latents, il ne nous semble pas, au regard de l'évolution des taux de recours ou des évolutions récentes des dépenses du fonds CMU, que la soutenabilité financière de celui-ci présente des risques à l'horizon 2017-2018. C'est d'ailleurs le sens des prévisions pluriannuelles que nous transmettons au Parlement.
Certes, si le taux de recours était demain de 100 %, nous serions amenés à revoir ces projections. Pour la direction de la sécurité sociale, il n'existe pas de risque de soutenabilité à moyen terme remettant en cause l'équilibre du fonds CMU. S'il devait y en avoir, nous serions évidemment en mesure d'ajuster les recettes aux dépenses du fonds. Toutefois, à moyen terme, et en prenant des hypothèses de taux de recours raisonnables, les montants de soldes sont bien inférieurs aux enjeux de déficit de la sécurité sociale que nous rencontrons aujourd'hui, et qui constituent notre préoccupation majeure du moment. Les hypothèses pluriannuelles de taux de recours prévoient une augmentation de dix points, soit 500 000 bénéficiaires de plus de l'ACS.
Vous m'avez interrogé sur les mesures de simplification. C'est pour nous un enjeu majeur. Le premier élément de simplification - et je remercie le président Durrleman pour cette appréciation favorable - est la mise en concurrence des contrats éligibles à l'ACS. Nous sommes en train de travailler pour mettre en oeuvre cette réforme au 1er juillet 2015. Les travaux d'évaluation réguliers qui ont été faits ont montré que le premier élément de complexité pour les personnes concernées est la diversité des organismes complémentaires et des offres. Les dix offres qui seront sélectionnées à compter de juillet constitueront un élément de simplification majeur, sur lequel nous fondons des espoirs importants pour permettre un accès renforcé à ce dispositif.
Nous travaillons également avec l'assurance maladie à la simplification du formulaire de demande d'ACS. Le nouveau formulaire sera mis à disposition du public à compter du mois de juillet. Nous avons essayé de le rendre plus clair et lisible. Nous avons également tenté de rendre plus lisible la politique de lutte contre la fraude vis-à-vis des assurés, afin qu'ils comprennent bien que leurs déclarations sont susceptibles d'être vérifiées.
L'un des paradoxes du non-recours réside dans le fait que figurent dans la CMU-C des bénéficiaires du RSA socle, qui remplissent les conditions de ressources. Or, 20 % d'entre eux n'exercent pas ce droit. Nous avons travaillé avec les Caisses d'allocations familiales (CAF) pour que, dans le logiciel d'instruction du RSA, la possibilité d'inscription à la CMU-C soit simplifiée et que les blocages techniques soient contournés.
La répartition géographique des bénéficiaires est un point qu'il nous faut étudier plus précisément. De mémoire, il ne me semble pas qu'il y ait de décalage entre la cartographie de la précarité et celle de l'accès à la CMU-C. C'est sans doute un point que nous pourrions creuser, mais je ne crois pas que cet écart soit significatif.
Enfin, le « juste droit » est l'objectif que nous nous fixons depuis plusieurs années. Il convient de rechercher les bénéficiaires potentiels en mobilisant les caisses de sécurité sociale, tout en évitant d'accorder des droits à ceux qui n'ont pas à en bénéficier. Les CAF ont mis en place cette année des rendez-vous des droits pour vérifier pourquoi les populations éligibles n'ont pas choisi de recourir à la CMU-C et à l'ACS.
Nous devons aussi multiplier les croisements de fichiers entre titulaires de minima sociaux qui figurent dans les bases de données de la CNAF et celles de l'assurance maladie, pour que des courriers soient adressés aux bénéficiaires potentiels de l'ACS pour les informer qu'ils y ont peut-être droit.
La CNAMTS consacre aujourd'hui environ 1 350 équivalents temps pleins (ETP) à la gestion de la CMU-C et de l'ACS. Ceci démontre l'importance que nous attachons à ce sujet, à la fois dans une logique de contrôle et de vérification des droits, mais aussi dans un objectif d'accès aux droits grâce à une politique efficace.
La procédure d'instruction des dossiers repose essentiellement sur des documents en version papier. Elle nécessite de produire beaucoup de pièces justificatives, ceux qui n'entrent pas dans la CMU-C par le RSA devant justifier de leurs ressources sur les douze derniers mois glissants. Il est possible à n'importe quel moment de l'année de demander la CMU-C. Au moment où l'on dépose une demande, il faut pouvoir justifier de la composition du foyer et de la totalité des ressources prises en compte au titre des douze mois précédents. Ce travail est donc assez lourd. Le plus souvent, un assuré a en moyenne trois contacts avec la CPAM pour aller au bout de l'instruction de son dossier et de la production des pièces permettant de boucler cette demande, dans un délai moyen inférieur à un mois et qui se situe aux alentours de vingt-huit jours.
La CNAMTS a conçu un système informatique venant en appui de nos techniciens pour essayer d'automatiser davantage l'enregistrement des dossiers et les calculs de la base des ressources. Ce projet s'intitule « Indigo » et connaîtra une mise en oeuvre en deux paliers, le premier fin 2016, et le second fin 2017.
Ces deux paliers permettront de disposer à la fois d'un outil d'intégration et de calcul des ressources, d'acquérir directement des éléments de ressources réglées par l'assurance maladie (au titre de l'invalidité, des indemnités journalières ou des rentes) et également, fin 2016, de réduire le volume des pièces justificatives demandées aux assurés, notamment concernant la production de photocopies des pièces d'identité. Il s'agit d'éviter toutes redondances dans la production de pièces justificatives. Le second palier, fin 2017, permettra à l'assuré de saisir une demande en ligne de CMU-C et d'y intégrer ses pièces justificatives.
C'est un chantier qui n'a pas pu aboutir aussi vite qu'il aurait fallu, mais la CNAMTS a par ailleurs un portefeuille de projets informatiques considérables ; ses moyens pour les conduire sont par définition limités. Des arbitrages sont parfois rendus et le projet « Indigo » fait aujourd'hui partie de nos priorités, dans le cadre du nouveau schéma directeur des systèmes d'information 2014-2017.
L'accès aux droits constitue une politique sur laquelle l'assurance maladie s'engage fortement depuis deux ans, qui a conduit à mobiliser l'ensemble des CPAM. Dans un premier temps, les démarches ont été laissées à l'initiative des caisses, parce que nous considérons que celles-ci peuvent avoir des idées et mener des actions locales pertinentes pour aller chercher les assurés. Mais nous avons constaté qu'il était difficile d'augmenter le taux d'accès.
Le président de la sixième chambre de la Cour des comptes a raison de souligner que l'hypothèse de 100 % de taux de recours est très conventionnelle. À titre d'illustration, nous écrivons chaque année à environ 335 000 personnes dont nous considérons qu'elles sont potentiellement éligibles à la CMU-C. Il s'ensuit un pourcentage de dépôt de demandes inférieur à 5 %.
Il faut donc essayer de diversifier les méthodes pour faire en sorte que ceux qui détiennent un droit puissent l'exercer. Il y a, en matière de CMU-C, un enjeu considérable si l'on calcule ce que représente le renoncement aux soins. Celui-ci reste en effet important, même lorsqu'on bénéficie de la CMU-C.
Des études de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) démontrent que 20 % à 30 % des bénéficiaires de la CMU-C peuvent renoncer à certains types de soins. Pour ceux qui n'ont pas d'assurance complémentaire santé, cette proportion est supérieure de vingt-deux points. Au terme de la remontée des initiatives des caisses primaires, nous allons déployer, à compter d'octobre prochain, un plan local d'accompagnement du non-recours, des incompréhensions et des ruptures (PLANIR).
Notre seconde priorité est de faire en sorte que tous ceux qui ont droit à la CMU-C puissent y accéder, et que tous ceux qui y accèdent respectent bien les conditions pour en bénéficier. Nous nous livrons pour cela à une vérification approfondie des conditions de ressources des bénéficiaires.
Nous nous appuyons sur des contrôles de premier niveau qui permettent d'identifier un pourcentage récurrent de 4 % à 5 % de dossiers sur lesquels il peut y avoir un doute au moment de l'instruction. Il s'agit là d'un premier filtre. Nous nous appuyons également depuis peu sur une disposition votée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2011, qui permet aux organismes sociaux de pouvoir exercer leur droit de communication bancaire. Ceci nous permet de vérifier, sur la base des comptes que les banques nous transmettent, que les ressources déclarées sont cohérentes avec les ressources figurant sur ces comptes bancaires. Il y a en effet souvent plusieurs comptes pour un même assuré.
Nous avons pour la première fois, au début de l'année 2014, demandé, de manière expérimentale, à quatre organismes d'exercer ce droit sur un nombre total de mille dossiers. Ces mille dossiers ont fait apparaître un pourcentage élevé d'anomalies, sans toutefois pouvoir être considéré comme représentatif, compte tenu de l'étroitesse de l'échantillon. Le pourcentage de dossiers dépassant le plafond de ressources de la CMU-C, comme l'a dit Antoine Durrleman, s'élève à un peu plus de 24 %. Quant à la part des dossiers dépassant le plafond de ressources de l'ACS, elle s'élève à 13 %. Les niveaux de dépassement de l'ACS sont variables, les plus importants étant heureusement rares, et caractérisant un comportement frauduleux.
Beaucoup d'éléments interviennent dans les causes de sous-déclaration de ressources. Certaines activités sont parfois non déclarées, mais il existe également des soutiens financiers familiaux. Beaucoup de bénéficiaires de la CMU-C reçoivent en effet de la part de proches des aides ponctuelles pour vivre. Or, la réglementation prévoit que ces revenus doivent être déclarés et intégrés dans le calcul du plafond de ressources. Il faut donc aussi les prendre en compte.
Nous considérons néanmoins que cet échantillon de contrôles ne saurait représenter une réalité nationale. Notre responsabilité étant d'étendre ce contrôle à l'ensemble des caisses primaires de tous les départements, nous allons progressivement contrôler 10 % des demandes d'accès à la CMU-C, grâce au droit de communication bancaire, qu'il s'agisse de primo demandes ou de renouvellements.
C'est un volume très important. D'ici la fin de l'année, nous aurons contrôlé environ 40 000 dossiers. Le rythme annuel sera ensuite bien supérieur, de l'ordre de 400 000 contrôles chaque année. Je suggère d'attendre les résultats de ces contrôles à grande échelle pour quantifier le phénomène. Il faudra ensuite les analyser plus finement afin de distinguer l'anomalie de la fraude. À ce stade, certains éléments justifient le plan national de contrôle que nous sommes en train d'engager, mais ils ne permettent pas d'en tirer de conclusions quantitatives.

Le fonds CMU est financé par la TSA, qui fait partie de ce que l'on peut appeler la « fiscalité sectorielle ». À compter du 1er janvier 2016, cette taxe, collectée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) d'Île-de-France, devait fusionner avec la TSCA, actuellement collectée par le DGFiP. Madame Bocognano, les mutuelles que vous représentez sont-elles satisfaites de cette mesure ? Est-ce une véritable simplification ? En particulier, quel est votre avis concernant la recommandation de la Cour des comptes de transférer l'ensemble des fonctions de recouvrement de la future taxe fusionnée à l'URSSAF ?
Vous m'avez interrogée sur la question de savoir ce que pouvait penser la Mutualité française de cet appel à la concurrence relatif à l'ACS. Aujourd'hui, on constate une réelle avancée, du moins en apparence. Les garanties sont améliorées. Les prix tendent à diminuer, en tout cas à garantie comparable. Nous espérons que ces avancées bénéficieront aux allocataires de l'ACS.
Il me semble important d'analyser les raisons de ce progrès. Sans doute a-t-on donné aux organismes, notamment aux mutuelles, les moyens de créer une offre efficiente. Je pense aux mécanismes de la coassurance, qui permettent de diminuer le coût du risque et de proposer des offres solides, à des tarifs plus intéressants que ceux des offres individualisées.
Il faut aussi reconnaître qu'un effort important - que l'on ne peut pas réaliser pour toutes les populations - a été opéré en matière de frais de gestion des organismes complémentaires.
Ces avancées présentent cependant des limites. En premier lieu, il ne faudrait pas commettre l'erreur de ne pas laisser « vivre » les offres correctement. Il convient donc de vérifier que les opérateurs ne vendent pas à perte. Il ne faut pas non plus que le prix soit le seul critère du choix des bénéficiaires. Des comparateurs d'offres qui ne seraient basés que sur les prix déséquilibreraient totalement les organismes complémentaires. Créer une garantie, c'est en effet créer un équilibre entre les différentes populations et classes d'âge qui en bénéficient.
Le second type de limites porte sur un problème de fond. Pardon pour cette évidence, mais on répond, avec l'ACS, uniquement aux problèmes de ceux qui en bénéficient ! De même, avec la CMU-C. Malheureusement, la liste pourrait être longue : avec des contrats d'entreprise, on répond aux besoins des personnes qui disposent de contrats d'entreprise. Cette politique n'intervient pas sur les facteurs qui ont présidé à la création de ces différents dispositifs.
La Cour des comptes indique que l'origine de ces dispositifs est le recul de la prise en charge de l'assurance maladie. Il s'agit aussi de l'une des conséquences du renchérissement des soins. Tant que l'on n'aura pas réglé ce problème, souvent illustré par la multiplication des dépassements d'horaires, on assistera à une déconnexion entre le remboursement et les prix.
Les complémentaires santé permettront bien sûr de diminuer l'écart entre le remboursement et les prix, mais sans jamais combler le reste à charge, lié aux tarifs, qui demeurent libres. Plus les complémentaires rembourseront, plus les prix seront importants.
Si on ne s'attaque pas à l'ensemble du problème, on favorisera la création d'un troisième volet de la CMU-C, et d'un second volet de l'ACS. Lorsqu'a été créée la CMU, en 1999, elle concernait 5 % de la population ; les détracteurs du système assuraient à l'époque que l'on atteindrait 10 % de la population en quelques années. Nous y sommes aujourd'hui si l'on inclut l'ACS.
L'ACS illustre bien ce problème non résolu de l'accès aux soins : la CMU-C a été créée et il y a eu besoin, dix ans plus tard environ, de créer l'ACS. Comment ne pas imaginer que, dans cinq ans, dans dix ans, il ne faudra pas à nouveau augmenter le niveau de garantie ? Le chemin vers une troisième version de la CMU n'est sans doute pas ce que nous souhaitons. Il serait difficile à soutenir financièrement !

J'imagine qu'il existe un cahier des charges des contrats éligibles à l'ACS, établi avec les administrations compétentes.
Pardonnez-moi, mais c'est à votre fédération de faire le ménage ! La Cour des comptes l'a dit, mais tout le monde le sait : un certain nombre de contrats offraient un très faible niveau de garantie !
L'appel d'offres, en encadrant les garanties, en créant un cahier des charges, a permis une avancée, en ce sens que les garanties sont aujourd'hui mieux connues.
Les offres seront sans doute plus efficientes, avec un meilleur niveau de garanties, mais on ne résoudra ni avec l'ACS, ni avec la CMU-C, ou d'autres dispositifs compartimentés ou segmentés, les problèmes d'accès aux soins du reste de la population.
Quant aux questions sur la TSA et la TSCA, les mutuelles ont pris acte de cette fusion. Pour l'instant, il ne s'agit pas d'une véritable simplification, en ce sens qu'il faut mettre tous les dispositifs en oeuvre. Le souci de la Mutualité était de s'assurer que la fusion était bien à périmètre et à enveloppe constante.

Ce rapport comporte des éléments intéressants, qui démontrent des disparités géographiques considérables, qui m'ont quelque peu étonné : le nombre de bénéficiaires en pourcentage de la population peut en effet aller d'un à cinq en fonction des départements. Le niveau de revenus est-il le seul facteur justifiant ces différences ? Sont-elles dues à l'action des CPAM ? Certaines sont-elles plus efficaces que d'autres ?
Par ailleurs, la DGFiP disposant des ressources fiscales de l'année précédente, un transfert automatique de données ne permettrait-il pas de dégager des gains de productivité ? Une expérimentation a été menée en 2010 : pourquoi a-t-elle été abandonnée ?
Je suis effrayé de lire ce qu'écrit la Cour des comptes à propos de la vérification des ressources et de l'outil informatique. Elle explique ainsi que : « Dans une CPAM dont la Cour a examiné l'activité, l'utilisation des tableurs est laissée à la libre appréciation des agents. Une partie d'entre eux détermine les ressources en utilisant une calculatrice ou sur papier libre, ce qui prive de toute traçabilité l'instruction des ressources et accentue les risques d'anomalies. Dans une autre caisse, le tableur est systématiquement utilisé. Cependant, cet organisme n'archive pas l'image du calcul ».

Je remercie le président Durrleman pour la qualité de ce rapport. Comme d'habitude, la Cour des comptes est incisive et pénétrante dans son analyse.
Loin de nous l'idée de remettre en cause la légitimité de la CMU-C ou de l'ACS. Personne ici, je pense, ne conteste son utilité, mais sa légitimité repose sur la transparence et sur le recours à bon droit. Or, vous avez posé un certain nombre de questions sur ce point. Quand on se penche sur les chiffres, on est en droit de s'interroger sur les équilibres financiers. C'est aussi le devoir de notre commission, en complément de ce que Francis Delattre a pu dire, de trouver un équilibre financier aux comptes de la sécurité sociale.
Trois à six millions de personnes pourraient avoir recours à ces dispositifs, soit un doublement du nombre de ceux qui l'utilisent actuellement : cinq millions pour la CMU-C et environ un million pour l'ACS. Cela entraînerait une augmentation des besoins de financement : 4 milliards d'euros au total si l'on additionne ce que pourraient coûter la CMU-C et l'ACS.
Vous indiquez qu'augmenter la taxe de trois à six points serait difficile à envisager. Vous proposez donc de réduire le champ des dispositifs ou de revoir le plafond et la base des ressources ou le panier des soins.
Je me tourne vers les représentants de la direction de la sécurité sociale. Thomas Fatome a dit qu'il n'existait pas de difficultés à l'horizon 2017-2018. Vous me permettrez d'être quelque peu inquiet : je suis moins sûr que vous que nous n'ayons pas à faire face, en 2017 et 2018, à une augmentation importante des coûts de la CMU-C et de l'ACS du fait de la publicité que vous proposez.
Avez-vous évalué à un horizon plus lointain ce que représenteraient l'intégration de ces populations éligibles et la solvabilité des dispositifs ? En a-t-on actuellement la capacité, avec le régime de base de la sécurité sociale et ses modalités de financement ? C'est là le fond de la question. On ajoute des tuyauteries aux tuyauteries existantes. Je crains qu'il n'y ait, un jour, une difficulté quelconque et que l'on nous demande de tout intégrer dans le régime de base la sécurité sociale - ce qui me paraîtrait d'ailleurs tout à fait naturel. C'est même la question que l'on peut se poser pour les complémentaires santé.
La Cour des comptes note que la CMU-C est potentiellement inflationniste, au-delà d'un rattrapage de soins pour les populations fragiles, et demande un contrôle renforcé. Vous avez d'ailleurs dit que vous alliez y procéder. Ce risque d'inflation n'est-il pas lié aux mécanismes de tiers payant mis en place pour les bénéficiaires de la CMU et que l'on propos d'élargir à l'ensemble des bénéficiaires de la sécurité sociale. C'est un sujet sensible en ce moment.
Par ailleurs, la Cour des comptes souligne la nécessité de simplifier les démarches. Nicolas Revel a expliqué les dispositifs qu'il entend mettre en oeuvre, mais recommande par ailleurs de rendre plus contraignantes les conditions d'accès, notamment en prenant en compte l'ensemble des ressources. N'y a-t-il pas là une certaine contradiction, dont je ne mesure pas tout à fait les effets aujourd'hui ?

J'ai envie, en vous interrogeant, d'être quelque peu provocateur. Je suis surpris du décalage entre l'orientation des lois, qui cherchent à ouvrir plus de droits à davantage de personnes, et de constater en même temps le peu d'efficience du système, qui comporte des taux de recours très faibles, en particulier pour l'ACS. Le citoyen, qui entend parler de certaines lois, de textes, de perspectives d'améliorations, d'une certaine manière, ne les constate pas concrètement.
Ne pourrait-on pas inverser le système ? Vous disiez envoyer des milliers de courriers par an, et que seulement 5 % des personnes susceptibles de bénéficier de la CMU y répondaient. Ne peut-on inscrire d'office ceux que l'on pense pouvoir bénéficier de cette couverture et leur demander, après leur avoir indiqué les règles en vigueur, s'ils confirment ou infirment leur participation au dispositif ?
Pour rester provocateur, je précise que cela impose bien entendu, pour des raisons budgétaires, de recadrer préalablement le dispositif pour anticiper les augmentations. Il faut donc que la loi dise clairement ce qu'elle veut faire, et ne pas ouvrir les droits si l'État n'est pas capable de les prendre en charge.
Dans mon esprit, il ne s'agit pas uniquement d'éviter une dépense supplémentaire, mais cela aurait l'avantage de clarifier les choses, d'apporter une réponse à ceux qui en ont besoin, et d'avoir un taux de retour effectif plus important.
Cela porte sur des montants considérables, je ne l'oublie pas, mais la question se pose de la même façon dans les collectivités locales en matière de cantine, d'action sociale ou culturelle. Or, il existe dans ce domaine deux formules, l'une où l'on doit se déclarer pour avoir droit à une aide, l'autre qui accorde des droits sous réserve de vérifications. Nous ne sommes, j'en suis conscient, ni à la même échelle ni sur les mêmes montants. Mais du point de vue du résultat, je pense que cela aurait un effet bénéfique sur nos concitoyens !

Vous avez, monsieur le président de la sixième chambre, souligné que l'existence de ces aides traduisait une forme d'échec de l'assurance maladie obligatoire. On pourrait aller au-delà et s'interroger sur la part respective de l'assurance maladie et des organismes complémentaires dans le financement de la santé, ainsi que sur le type de recettes permettant ces financements à partir des cotisations sociales et de contributions qui ne sont pas fondées sur le travail mais le débat dépasserait largement cette matinée.
Je voudrais exprimer ici le malaise que je ressens à propos du contrôle des comptes bancaires. La mesure est très spectaculaire ; elle a été médiatisée. Vous avez insisté les uns et les autres sur sa portée limitée : mille contrôles, si je ne m'abuse. Or, nous savons que les fraudes que subissent la sécurité sociale et l'assurance maladie s'élèvent à environ 200 millions d'euros, et que la part imputable aux assurés est de l'ordre de moins de 20 %. Ne stigmatise-t-on pas les assurés par ce biais ?
Les recours excessifs au système de soin constituent par ailleurs un véritable sujet de préoccupation. Les médecins pourraient-ils être associés à l'étude et à la lutte contre ceux-ci, s'ils existent réellement ?
Enfin, connaît-on la répartition entre les mutuelles, les assurances privées et les institutions de prévoyance des résultats de l'appel d'offres lancé en matière d'ACS ?

J'ai remis en septembre 2013 à Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, les conclusions d'une mission parlementaire sur l'accès aux soins des plus démunis. On me demandait notamment d'en rechercher les causes et de faire des propositions sur les non-recours.
Je constate que les taux de non-recours sur lesquels nous avions à l'époque travaillé étaient plus faibles que ceux que vous indiquez aujourd'hui. Il y a donc une augmentation préoccupante du nombre de non-recours à la CMU-C, puisque l'on passe de 28 % à 40 %.
Monsieur Revel, vous avez indiqué qu'une dynamique destinée à simplifier les procédures avait été mise en place et nous nous en félicitons. Nous avions constaté que certains dossiers de CMU-C comportaient plus de soixante ou de quatre-vingts documents ! Un accompagnement personnel et une connexion des fichiers doivent être envisagés, comme vous l'avez évoqué. Nous proposions l'ouverture automatique des droits pour les bénéficiaires du RSA « socle » et du CMU-C. Je crois que vous réfléchissez à cette question.
Enfin, ne serait-il pas intéressant que la Cour des comptes fasse une étude sur le coût du non-recours ? Beaucoup de médecins reconnaissent que plus les soins sont tardifs, plus ils sont coûteux pour les finances publiques. Ne serait-il pas intéressant de calculer ce coût pour éclairer le débat devant le Parlement ? Y avez-vous songé ?
François Chérèque, lorsqu'il était venu devant la commission des affaires sociales, avait expliqué que les « économies » représentées par l'ouverture précoce de certains droits étaient importantes, de l'ordre de 6 milliards d'euros.
Monsieur le président de la sixième chambre, vous avez évoqué le risque de surconsommation des soins. Je suppose que vous appuyez sur des études. Quelles sont-elles ? Que pensez-vous de l'étude rendue publique en octobre 2013 par le secrétariat général pour la modernisation de l'action publique sur le gisement « moins de maladies », qui comparait la situation de personnes bénéficiant de droits à la CMU-C à d'autres ayant le même revenu mais n'en bénéficiant pas ? Au bout d'un an, en moyenne, les dépenses de santé étaient moins élevées pour les personnes relevant de la CMU-C.
Sans doute faudrait-il actualiser ces études, mais l'accès à des soins réguliers et à des parcours de prévention peut permettre de diminuer la gravité des maladies et être très bénéfique pour les finances publiques.

Je voudrais dire mon intérêt pour cette communication et pour le débat qui s'en est suivi, surtout pour des personnes qui, comme moi, ne sont pas forcément familières du sujet.
Je souhaiterais poser une question de fiscaliste, à la suite de ce qu'a dit Yves Daudigny et de ce qui nous a été rapporté tout à l'heure sur la prise en compte des ressources et notamment des dons des familles.
On m'a posé une question à laquelle je n'ai pas été capable de répondre. Je conçois que les dons des familles, au titre de ce qui est déduit de l'impôt sur le revenu, soient intégrés dans le calcul des ressources, mais quid des sommes qui pourraient être versées dans le cadre de l'exonération des successions et qui ne font pas l'objet d'une déduction d'impôt ? Cela fait-il partie des ressources prises en compte ? En vérifiez-vous l'utilisation ?
Les inégalités territoriales présentent en effet une forte corrélation entre pauvreté du territoire et recours à la CMU-C et à l'ACS. Néanmoins, cela n'explique pas 100 % de la variance même si les départements d'outre-mer ont plus de 30 % de CMU-C, et si la Seine-Saint-Denis et la région PACA sont plus concernées.
L'action locale a certes un enjeu et modifie les taux de recours. Ceci a été mis en évidence par un certain nombre de statistiques qui figurent dans le rapport.
Quels sont les déterminants des recours au niveau local ? Ils reposent sur l'action des CPAM. Le renforcement de la campagne nationale de lutte contre le non-recours à travers le plan PLANIR va homogénéiser les réponses locales des caisses. Le régime social des Indépendants (RSI) et la mutualité sociale agricole (MSA) mènent également des actions positives qui peuvent avoir des impacts en matière de recours sur certains territoires.
Certains autres partenaires, comme les centres communaux d'action sociale (CCAS), mènent une action spécifique en matière d'accompagnement. Ces dernières se mettent en relation avec les CPAM, ce qui permet d'augmenter les taux de recours. Au-delà des acteurs de l'assurance maladie, d'autres acteurs territoriaux (collectivités locales, CAF) s'investissent plus ou moins. Ceci peut expliquer certaines divergences de taux de recours.
S'agissant du contrôle renforcé en matière de dépenses de santé et de la surconsommation, le fonds CMU, en tant que tel, ne vérifie pas l'effectivité du recours aux soins. C'est le rôle des caisses, qui contrôlent la pertinence et la réalité des soins. D'autres indicateurs montrent que certaines situations sont assez favorables : ainsi, le fait de choisir un médecin traitant est légèrement plus répandu dans la population concernée par ces dispositifs que dans le reste de la population française. Ce praticien assure une bonne coordination, une bonne entrée et un bon suivi dans le système de soins.
Des études sont menées par la CNAM : la direction des études du ministère effectue également des travaux sur ce sujet, qui seront publiés cet été. Les réponses sont plutôt rassurantes, mais nous renforçons notre vigilance.
S'agissant du tiers payant, l'objectif de la CMU-C est de lever toutes les barrières d'accès aux soins. L'avance de frais a été considérée comme un motif de renoncement aux soins. Le tiers payant lève cette barrière. Il ne fait donc, dans ce cas, aucun doute qu'il s'agit d'un facteur favorisant l'accès aux soins.
Quant au risque de surconsommation, tous les indices dont nous disposons nous indiquent qu'il est faible.
S'agissant de la base des ressources et des questions de simplification, l'alternative est assez simple. Les bases de ressources fiscales ont le mérite de la simplicité, mais la difficulté vient de leur caractère daté, n-1, voire n-2 selon la période dans laquelle on se trouve. Avec la CMU-C et le RSA « socle », historiquement, le choix a été fait de « coller » le plus possible à la situation financière de l'assuré au moment où il fait sa déclaration pour pouvoir ouvrir un droit correspondant.
Nous avons travaillé avec l'assurance maladie pour voir si nous pouvions simplifier le dispositif. C'est une vraie question politique : assumerions-nous de ne plus tenir compte de la situation effective de la personne en un instant « t », comme pour les aides au logement, et de supprimer la déclaration de ressources des douze derniers mois ? Ceci génère en effet un nombre important de justificatifs. Nous n'avons pas franchi le cap mais nous poursuivons cette réflexion avec l'assurance maladie. Le problème est réel, car complexe pour les assurés.
S'agissant des prévisions financières, nous ne retenons pas d'hypothèse de taux de recours stable, mais une augmentation du taux de recours, et intégrons l'effet de ces mesures, auxquelles nous croyons. Cela étant, nous pensons que ces effets seront progressifs.
Par ailleurs, il est important de distinguer la CMU-C et l'ACS en matière de non-recours. Les ressorts sont très différents : quoi que nous fassions, bien que nous ayons mis énormément d'énergie dans ce dispositif d'appel à la concurrence, sur lequel nous fondons beaucoup d'espoirs, il est évident que le taux non-recours va subsister, tout simplement parce que les personnes concernées effectuent un arbitrage de court terme et qu'elles n'ont pas forcément envie de débourser de petits restes à charge. Mécaniquement, quelle que soit la qualité du travail que nous pourrons faire, et malgré le fait que les organismes complémentaires, notamment les mutuelles, jouent le jeu, il subsistera un volant structurel de non-recours.
Je rappelle qu'un certain nombre de personnes ne recourent pas à la CMU-C parce qu'elles ne le veulent pas, et considèrent, à tort ou à raison, que cette situation serait stigmatisante. C'est également le cas du RSA-socle. Un certain nombre de personnes n'éprouvent pas le besoin d'y recourir. Je rappelle que 5 % des bénéficiaires de la CMU-C ne consomment aucun soin dans l'année et estiment qu'ils n'ont pas besoin de cette couverture. Peut-être font-ils un mauvais calcul.
Le fait de demander une prestation nous semble une démarche importante. Néanmoins, dans une logique de simplification, il convient d'essayer de tendre vers l'automaticité. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, un dispositif de renouvellement automatique de l'ACS pour les bénéficiaires du minimum vieillesse. C'est la direction prise pour certains champs très spécifiques.
S'agissant de la typologie des assurances complémentaires sélectionnées, elle figure dans l'arrêté publié le 10 avril 2015, et couvre le panel des mutuelles, des institutions de prévoyance et des assureurs.
Enfin, sans rouvrir un débat très général, je me permets de nuancer le terme « d'échec » employé pour qualifier la situation de l'assurance maladie obligatoire. Notre système couvre 76 % des dépenses de santé. C'est un taux extrêmement élevé comparé à d'autres systèmes européens. Il est stable sur longue période ; sur très courte période, le reste à charge des patients diminue de 0,4 % sur les deux dernières années. Ne pas augmenter le reste à charge, voire le diminuer, est un élément majeur de la politique du Gouvernement.
Les complémentaires sont historiquement un élément du paysage du système de santé de notre pays, qui remonte à 1945. Certes, sur une longue période, il est évident que la couverture de l'assurance maladie obligatoire de base a pu s'éroder ; elle reste néanmoins à des niveaux très élevés par rapport à d'autres pays européens. C'est un élément extrêmement important.
On ne peut pas considérer d'un côté des soins courants et, de l'autre, les soins lourds pris en charge à 100 %. Le système est construit dans un continuum entre les deux. Il est illusoire de compter mourir à 99 ans dans son lit. À un moment ou à un autre, chacun aura besoin de soins pris en charge à 100 %, comme c'est aujourd'hui le cas de plus de 10 % de la population. Cette déconnexion rend donc partiellement compte de la réalité actuelle du système d'assurance maladie.

Je trouve ce dernier propos à la fois complètement vrai et relativement faux. Vous avez raison de dire que, lorsqu'on vit jusqu'à 99 ans, on est sûr de bénéficier de tout l'argent qu'on aura investi durant la période active.
Le différentiel est cependant très important entre les soins courants et les affections de longue durée (ALD). Or, un certain nombre de nos concitoyens, qui connaissent la précarité, s'interrogent sur le principe fondamental de solidarité, qui est de cotiser beaucoup et de recevoir peu, le système complémentaire intervenant de façon importante dans certains secteurs - audiométrie, dentisterie, ophtalmologie - alors que le régime général en est quasiment absent, non seulement en matière de remboursement, mais également sur les aspects qualitatifs.
Tout en étant attachée à ces principes fondamentaux, issus du Conseil national de la résistance, je suis inquiète de constater que nombre de nos concitoyens se demandent où vont leurs cotisations. Les couples avec enfants considèrent qu'ils ne sont pas bien couverts, alors qu'ils cotisent fortement - sans parler des employeurs, qui partagent ce sentiment.
Je pense qu'il faut être politiquement très vigilant sur le maintien du principe de solidarité. Il existe un hiatus, largement ressenti par la population, entre la couverture des ALD à 100 % et celle des soins courants, moins importante.
C'est là un vaste sujet !
Il est toutefois inexact de dire qu'il existe un recul en valeur absolue de l'assurance maladie obligatoire. Il y a, en revanche, une augmentation significative de la dépense de soins globale. Pour certains types de soins, comme les frais dentaires, sur la longue période, la dépense en valeur absolue de l'assurance maladie obligatoire continue de progresser, bien qu'elle augmente moins que celle des complémentaires. Comme Thomas Fatome, je relativiserais donc la formule utilisée par la Cour des comptes dans son rapport.
Je voudrais revenir sur le risque inflationniste, ainsi que sur le risque lié au programme de contrôle que nous engageons.
S'agissant du risque inflationniste, l'augmentation du taux de recours est une politique et un objectif que nous assumons. Nous nous sommes fixés des hypothèses intégrées dans les projections financières. Pour autant, même si nous allons déployer beaucoup d'efforts, il faut être lucide et reconnaître qu'il s'agit d'un travail ardu. Le jour où nous serons à 95 % de taux de recours pour ces deux dispositifs n'est pas encore arrivé, d'autant qu'il existe des différences entre la CMU-C et l'ACS.
En effet, beaucoup des bénéficiaires de l'ACS ont déjà une assurance complémentaire santé. Elle n'est pas forcément de bonne qualité et peut être chère. L'intérêt de cet appel à la concurrence est de faire émerger une offre bien plus lisible, dont le rapport qualité-prix sera mieux perçu. Nous espérons que le taux de recours progressera, mais l'assurance complémentaire de santé de certains ménages ne peut être résiliée qu'à des moments très précis du contrat, et tout cela ajoute de la complexité à la complexité.
Pour ce qui est du risque de surconsommation, aucune étude ne prouve aujourd'hui que celui-ci existe. Certes, nous n'avons pas administré la preuve qu'il n'y en ait pas, mais encore faut-il administrer la preuve qu'il y en ait un ! Nous évoquerons ce sujet dans le rapport sur les charges et produits de l'assurance maladie qui sera adressé au Parlement cet été. Nous communiquerons sur la consommation de soins remboursables, plus élevée que pour la moyenne du régime général, les bénéficiaires de l'ACS et de la CMU-C. Parmi les bénéficiaires de l'ACS, il y a en effet une part très importante d'allocataires de l'allocation pour adulte handicapé (AAH) pour laquelle la consommation de soins est plus importante que celle des bénéficiaires de la CMU-C. Vincent Beaugrand l'a dit, en matière de CMU-C, comme d'ACS, les risques relatifs à certaines pathologies sont très supérieurs à ce qu'ils sont pour les autres assurés du régime général.
Faut-il engager des actions de gestion du risque ciblant des publics d'assurés particuliers ? Nous ne l'avons pas prévu. Nous avons parlé de stigmatisation : je pense que, si nous lancions de telles actions, ce terme serait utilisé à bon droit. Nous avons un programme de contrôle à spectre large qui, nous l'espérons, permettra de dégager des économies sur la maîtrise médicalisée des dépenses, et qui permettraient de compenser les coûts supplémentaires liés au développement de la CMU-C. Je préfère faire des économies sur des dépenses de soins non justifiées, facturées à des prix trop importants, travailler sur la durée des indemnités journalières par exemple, et dégager des moyens budgétaires permettant d'accompagner une augmentation du recours à la CMU-C. C'est un enjeu qui est inscrit dans le cadre du pacte social français, qui veut que, quelle que soit la condition des uns et des autres, les dépenses de santé de chacun peuvent être prises en charge.
En contrepartie, nous devons contrôler que tous ceux qui entrent dans un dispositif n'ont pas dissimulé des ressources qui, si elles avaient été connues, les en auraient exclus. La personne qui dépasse de peu le plafond de la CMU-C, mais qui est éligible à l'ACS pourra bénéficier de l'ACS. Quantifier le risque de dissimulation des ressources est de bonne politique, de sorte que nous puissions faire entrer dans ces dispositifs tous ceux qui y ont droit, mais uniquement ceux-là.
Nous avons une politique de lutte contre la fraude à large spectre, qui porte aussi bien sur les professionnels de santé que sur les assurés. Nous avons engagé des actions, dont nous avons récemment informé la Cour des comptes, pour vérifier que les facturations d'un certain nombre de professions de santé sont conformes à la prescription qui les justifient. Nous devons agir sur l'ensemble du champ de la dépense et sur l'ensemble des acteurs, professionnels et assurés.
Le financement de l'ACS et de la CMU est aujourd'hui assuré essentiellement par des taxes sur les organismes de complémentaire santé. Quatre milliards d'euros de taxes sont prélevés sur ces contrats soit, en moyenne, 13 % du montant de la prime. Pour la Mutualité, il n'est pas envisageable d'aller au-delà en augmentant le taux de la TSA.
Je me permets de vous faire part d'une proposition. Il s'agirait de transformer les sept points de TSCA actuels en moins de 0,1 point de CSG. Cette proposition aurait trois avantages. Le premier est d'élargir l'assiette de financement du fonds CMU. Le deuxième est de rendre le financement plus équitable, les taxes étant aujourd'hui prélevées sur le montant des primes. À mon sens, elle aurait aussi un troisième avantage, celui de rouvrir la question de l'avenir de notre système de santé et son financement.
Augmenter encore les taxes sur les contrats d'assurance, c'est multiplier les filets de sécurité. Passer par la CSG, c'est renforcer et asseoir la solidarité du système que nous avons aujourd'hui et que la Mutualité souhaite préserver au maximum.

Charles Guené semble très affecté par le fait que Nicolas Revel ne lui ait pas apporté de réponse...
Je ne suis pas en mesure de vous éclairer sur ce point. Thomas Fatome me glisse à l'oreille qu'il n'en est pas davantage capable. Nous reviendrons vers vous à ce sujet.
Je précise qu'il y a une dissociation complète par rapport au domaine fiscal. La réglementation applicable en matière de CMU-C et d'ACS considère que l'ensemble des versements effectués par des tiers au cours des douze derniers mois précédant la demande constitue des ressources, quelle qu'en soit l'origine.
Le sujet que la commission des finances nous a demandé de traiter pose la question de l'élargissement continu des bénéficiaires du système et du non-recours à ces droits.
Le risque que nous voyons réside bien dans la légitimité même de ces dispositifs. Au fond, fixer une priorité entre les objectifs est nécessaire, toutes choses égales par ailleurs.
Nous sentons bien la mobilisation croissante des administrations pour rendre effectif l'accès au droit mais, d'une certaine manière, la conjoncture économique fait que plus l'on se rapproche de l'horizon, plus il s'éloigne. C'est un point sur lequel les pouvoirs publics doivent être particulièrement attentifs.
Par ailleurs, la CMU-C, tout comme l'ACS, ne sont plus des dispositifs interstitiels ; ils sont majeurs et massifs, ancrés durablement dans notre paysage social. Cela signifie qu'un certain nombre de dispositions, qui résultent des conditions mêmes dans lesquelles ces dispositifs sont entrés en vigueur, méritent aujourd'hui d'être revues, révisées et sécurisées.
Vous avez insisté, comme nous l'avons fait nous-mêmes, sur les dispositifs de gestion informatique. Ces dispositifs ont été mis en place de façon accélérée entre le vote de la loi du 27 juillet 1999, portant création d'une couverture maladie universelle, et le 1er janvier 2000, date à laquelle la CMU-C est entrée en vigueur.
Il en va de même de la question de la sécurisation des bases de ressources. La Cour des comptes, en 2006, avait insisté sur le fait que la relation avec les services fiscaux devait être bien plus étroite, et qu'il convenait d'adopter un parti-pris entre le souci d'un ajustement au plus près de la réalité des ressources et la simplicité de la prestation.
Enfin, nous n'avons pas voulu nous prononcer de manière catégorique s'agissant des risques que nous entrevoyons, mais appeler l'attention sur un certain nombre de facteurs qui nous semblent devoir plus précisément être analysés et documentés.
Nous constatons certains progrès par rapport aux constats que nous avions réalisés dans le passé. De notre point de vue, ils ne sont pas suffisants. Vous avez été plusieurs à estimer que ces dispositifs interrogent l'architecture même de notre système de protection sociale. J'ai parlé « d'une certaine forme d'échec ». Ce qui est certain, c'est qu'il existe des exemples de pays dont l'assurance de base rembourse mieux les prestations prises en charge. C'est en particulier le cas de l'Allemagne, qui a fait des choix différents des nôtres, où la protection sociale complémentaire est beaucoup plus réduite.
L'Allemagne a recours à un panier de biens et de ressources plus restreint. L'optique n'est pas prise en charge par l'assurance maladie de base et les transports sanitaires ne sont pris en charge que dans des conditions extrêmement strictes.
Un choix tout à fait clair a été fait dans notre pays au profit d'une protection de base, qui est à certains égards plus large que dans d'autres pays, mais qui garantit des taux de prise en charge plus faibles qu'ailleurs. Il s'agit de choix majeurs, qu'il n'appartient pas à la Cour des comptes de commenter, mais qu'elle peut éclairer.
L'intérêt du sujet que vous nous avez proposé de traiter, au-delà des dispositifs eux-mêmes, est de mettre en perspective les évolutions de notre système sur la longue durée. Ce dernier est le résultat d'une longue évolution.

Merci beaucoup. Nous apprécions toujours, au Sénat, de travailler avec la Cour des comptes et ses équipes.
La commission autorise la publication de l'enquête de la Cour des comptes ainsi que du compte rendu de la présente réunion en annexe à un rapport d'information de M. Francis Delattre.
La réunion est levée à 12 h 40.