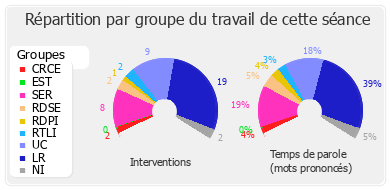Séance en hémicycle du 22 mai 2018 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Absence de médecin traitant dans les zones sous-dotées et remboursement des consultations (voir le dossier)
- Respect de la législation en vigueur sur les « devis modèles » relatifs aux obsèques (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 17 mai 2018 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, en remplacement de M. Alain Joyandet, auteur de la question n° 096, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

Monsieur le ministre, je suis chargé de présenter la question de M. Joyandet, qui a été empêché à la dernière minute et qui vous adresse ses excuses.
M. Joyandet souhaite attirer votre attention sur l’application des frais de garderie aux revenus issus des éoliennes présentes en forêt.
En effet, en application du premier alinéa de l’article 92 de la loi de finances n° 78-1239 du 29 décembre 1978, les contributions des collectivités territoriales, sections de communes, établissements publics, établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne aux frais de garderie et d’administration de leurs forêts relevant du régime forestier, prévues à l’article L. 147-1 du code forestier, sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts. Dans les communes classées en zone de montagne, ce taux est fixé à 10 %.
Les produits des forêts mentionnés au premier alinéa de l’article 92 précité sont tous les produits des forêts relevant du régime forestier, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol.
Il résulte de ces dispositions que les recettes tirées de la présence d’éoliennes dans les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont prises en compte dans l’assiette des frais de garderie. Or cette situation n’est pas compréhensible pour les élus locaux. De surcroît, elle peut dans certains endroits constituer un frein au développement de cette énergie renouvelable.
Aussi, M. Joyandet souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d’exonérer des frais de garderie ces revenus particuliers afin de faciliter le lancement et l’aboutissement des projets d’implantation d’éoliennes en zone forestière.
Monsieur le sénateur Vogel, vous m’interrogez, au nom de M. Joyandet, sur l’application des frais de garderie aux revenus issus des éoliennes présentes en forêt.
En application du code forestier, les forêts des collectivités territoriales relèvent du régime forestier lorsqu’elles sont « susceptibles d’aménagement, d’exploitation régulière ou de reconstitution ». À ce titre, elles sont gérées par l’Office national des forêts, l’ONF.
La mise en œuvre du régime forestier garantit une gestion durable des forêts des collectivités territoriales. Elle permet de répondre aux diverses attentes de la société, comme la protection de l’environnement et l’accueil du public, tout en assurant, bien entendu, la pérennité de notre patrimoine forestier.
L’entretien de chaque forêt est assuré en vertu d’un document de gestion, dit « document d’aménagement », qui fixe notamment les travaux et les coupes à réaliser. Chaque forêt bénéficie ainsi d’une gestion adaptée à ses spécificités.
En contrepartie de cette gestion, les collectivités territoriales doivent verser à l’Office national des forêts des frais de garderie assis sur tous les produits de leur domaine forestier. Les contributions des collectivités territoriales sont fixées à 12 % du montant hors taxe des produits de ces forêts. Dans les communes classées en zone de montagne, ce taux s’établit à 10 %.
Tous les produits des forêts relevant du régime forestier sont pris en compte, y compris ceux issus de la chasse, de la pêche et des conventions ou concessions de toute nature liées à l’utilisation ou à l’occupation de ces forêts, ainsi que tous les produits physiques ou financiers tirés du sol ou de l’exploitation du sous-sol. En conséquence, les recettes tirées de la présence d’éoliennes dans les bois et forêts qui relèvent du régime forestier sont prises en compte dans l’assiette des frais de garderie.
Le développement de l’énergie éolienne dans les forêts peu productives offre une ressource financière complémentaire non négligeable pour les collectivités territoriales ; le Gouvernement y est très sensible.
De plus, l’application du régime forestier à tous les revenus des forêts communales permet de financer les activités de l’ONF.
Je rappelle que, moyennant les perceptions ordonnées par la loi pour indemniser l’ONF des frais de garderie et d’administration des bois et forêts relevant du régime forestier, toutes les opérations de conservation et de régie dans les bois et forêts des collectivités territoriales sont assurées sans aucuns frais par l’établissement public.
Les frais de garderie contribuent à hauteur de 17 % au coût de l’application du régime forestier dans les forêts des collectivités. Le reste est financé par l’État au travers du versement compensateur attribué à l’Office national des forêts.
Au regard des services rendus par l’ONF, vous comprenez qu’il n’est pas envisageable d’exclure de l’assiette des frais de garderie les recettes tirées de la présence d’éoliennes. Une telle exclusion ouvrirait la porte à d’autres demandes et serait de nature à remettre en cause l’équilibre dégagé entre l’État, les communes forestières et l’Office national des forêts.

La parole est à M. Jean Pierre Vogel, auteur de la question n° 338, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale.

Monsieur le ministre, avec le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d’éducation prioritaire, destiné à offrir aux enfants un meilleur accompagnement, le Gouvernement défend une idée louable. Mais cet effort ne peut être mené au détriment des communes rurales, lesquelles sont déjà fortement affectées par la désertification des services publics locaux.
Ainsi, dans le département de la Sarthe, le dédoublement en réseau d’éducation prioritaire va entraîner la suppression de 38 postes d’enseignants dans les écoles rurales. Ces postes vont être redirigés vers des écoles de quartiers prioritaires. Les fermetures de classes rurales vont donc permettre de pourvoir les emplois nécessaires aux dédoublements des classes de la métropole mancelle.
Les territoires ruraux sont donc bien les variables d’ajustement de votre politique éducative !
Le Gouvernement doit comprendre que nos campagnes doivent être traitées de la même manière que les zones urbaines défavorisées.
Ainsi, le seuil de fermeture des classes devrait être divisé par deux en milieu rural, comme il est divisé par deux dans les zones urbaines d’éducation prioritaire. De nombreuses communes rurales de la Sarthe ont été classées en zone de revitalisation rurale, ou ZRR, ce qui revient à reconnaître leur statut de territoire défavorisé. Tous les enfants habitant des zones défavorisées doivent être traités avec la même attention, qu’ils soient scolarisés en ville ou à la campagne.
Le Président de la République a fait de l’école l’un des enjeux phares de sa campagne électorale. Il l’a d’ailleurs réaffirmé, lors de l’entretien qu’il a accordé au journal de 13 heures de TF1, le 12 avril dernier : « La base de notre pays, c’est l’école, c’est la première des batailles que j’avais définies. » Encore faudrait-il se donner les moyens de la remporter sans que l’effort se fasse au détriment des élèves des campagnes !
Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour apaiser la colère des écoles rurales ?
Monsieur le sénateur Vogel, tout d’abord, je vous prie d’excuser Jean-Michel Blanquer, qui m’a chargé de répondre, à sa place, à votre question.
La préparation de la rentrée 2018 est marquée par un soutien budgétaire incontestable en faveur du premier degré.
À ce titre, je vous rappelle quelques données générales. À la prochaine rentrée, il y aura, dans le premier degré, 32 657 élèves de moins et 3 881 emplois de professeurs supplémentaires. À l’inverse, si l’on avait strictement suivi la baisse démographique, 1 438 postes auraient été supprimés.
Les efforts budgétaires consentis se traduisent par un meilleur taux d’encadrement sur l’ensemble du territoire dans le premier degré. Ainsi, le ratio du nombre de professeurs pour 100 élèves sera de 5, 55 à la rentrée 2018, contre 5, 46 à la rentrée 2017. Pour mémoire, il s’élevait à 5, 20 à la rentrée 2012.
Dans chaque département, il y aura donc davantage de professeurs par élève à la rentrée 2018 dans le premier degré.
J’en viens au département qui vous concerne tout particulièrement.
Dans la Sarthe, à la rentrée 2018, il y aura 750 élèves en moins dans le premier degré, selon les premières prévisions. Toutefois, aucun poste n’est supprimé dans ce département. Or, si la baisse démographique avait été répercutée de manière automatique, quarante postes auraient été supprimés.
Le ratio du nombre de postes d’enseignants en équivalents temps plein pour 100 élèves progressera donc à la rentrée 2018 : il passera à 5, 44, contre 5, 22 en 2017.
Le nombre d’élèves par classe en milieu rural restera inférieur au nombre d’élèves par classe en milieu urbain, hors éducation prioritaire.
Enfin, aucune fermeture d’école n’est prévue dans ce département pour la rentrée 2018.
Bien entendu, les services de l’éducation nationale sont très sensibilisés à la situation de l’école en milieu rural. La carte scolaire prévisionnelle du département de la Sarthe en est la parfaite illustration.
Il va sans dire que tous les services du ministère se tiennent à votre disposition pour poursuivre ce dialogue singulier et régulier que vous consacrez, comme tous les élus de la République, à l’école de la République.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je la transmettrai aux maires qui, dans le département dont je suis l’élu, subissent des fermetures de classe.
En effet, même si, dans la Sarthe, il n’y aura pas de fermeture d’école en 2018, un certain nombre d’écoles seront fragilisées par des fermetures de classe.
Les chiffres sont têtus : à la rentrée prochaine, mon département connaîtra 38 fermetures de classe en milieu rural et 38 dédoublements en milieu urbain. Les élus ruraux concernés analyseront la situation !

La parole est à M. Pierre Cuypers, auteur de la question n° 341, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale.

Monsieur le ministre, je suis certain que vous vous êtes déjà interrogé sur l’état d’esprit d’un enfant qui, après un, voire deux ans de suivi, perd l’aide d’un ou d’une auxiliaire de vie scolaire, ou AVS, connaissant parfaitement sa pathologie.
Je rappelle que les AVS relèvent actuellement de deux statuts différents : d’une part, les accompagnants des élèves en situation de handicap, ou AESH, qui bénéficient d’un contrat de droit public ; d’autre part, les agents engagés par contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi, ou CUI-CAE, recrutés sous contrat de droit privé et relevant donc du code du travail.
Le statut de ces derniers agents est très précaire, notamment dans l’enseignement privé. Ces personnels sont recrutés dans le cadre d’un contrat aidé d’une durée d’un an renouvelable une seule fois : ils se retrouvent donc sans emploi au terme de cette période de vingt-quatre mois.
J’insiste sur le paradoxe incroyable que constitue l’obligation faite aux directeurs des établissements de recruter de nouveaux AVS pour remplacer ceux qui étaient en poste.
Monsieur le ministre, à l’instar du recteur d’académie dont relève mon département, vous êtes pleinement conscient de l’importance du rôle des AVS pour la scolarisation en milieu ordinaire des élèves en situation de handicap. Par leur présence en classe, ainsi que dans l’ensemble des activités scolaires, ces professionnels apportent à l’enfant un soutien continu, adapté et humain, en un mot indispensable.
Il est donc urgent de changer les procédures de recrutement et de pérenniser l’emploi des AVS. Je m’interroge sur la logique du système, alors que le Gouvernement a fait de l’inclusion des personnes handicapées une véritable priorité.
Le 11 avril dernier, à l’Assemblée nationale, vous avez annoncé qu’un décret était en préparation. Pouvez-vous nous préciser en quoi ce texte améliorera le statut des AVS et nous indiquer l’époque à laquelle il paraîtra ?
Monsieur le sénateur Cuypers, je vous prie d’accepter les excuses de Jean-Michel Blanquer, qui ne pouvait être présent ce matin et qui m’a chargé de vous répondre en son nom.
La situation que vous décrivez est celle qui existait avant 2014, année de la création du statut d’accompagnant des élèves en situation de handicap. Les missions de ces agents sont précisées dans le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014.
Depuis la rentrée 2014, les AESH se sont substitués sur la mission AVS aux assistants d’éducation, ou AED. Ils interviennent selon les mêmes modalités que les anciens AED-AVS.
Votre question porte spécifiquement sur l’enseignement privé, mais je précise que les règles de gestion des AESH sont les mêmes dans l’enseignement public et dans l’enseignement privé.
À la fin de mars 2018, les 11 908 élèves du privé bénéficiant d’une prescription d’aide individuelle émise par une maison départementale des personnes handicapées, ou MDPH, étaient accompagnés par 2 070 AESH et 3 450 CUI-AVS.
Contrairement aux AED, les AESH ont la possibilité d’accéder à un CDI, après six années d’engagement en CDD.
Les candidats aux fonctions d’AESH doivent être titulaires d’un diplôme professionnel dans le domaine de l’aide à la personne. Toutefois, peuvent être dispensées de la condition de diplôme les personnes qui ont exercé pendant au moins deux années les fonctions d’aide à l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap.
L’accès à un contrat d’AESH est possible pour tous les titulaires d’un contrat unique d’insertion, qu’ils exercent dans le public ou dans le privé. C’est le cas des personnels recrutés sous statut de CUI-CAE : après deux ans d’engagement dans la mission d’AVS, ils peuvent accéder au statut d’AESH.
C’est pour atteindre ce but qui nous semble essentiel, la déprécarisation des personnels, qu’est engagée, depuis la rentrée 2016, la transformation sur cinq ans de 56 000 CUI-CAE en 32 000 équivalents temps plein d’AESH, à raison de 11 200 CUI-CAE transformés par an.
Le décret que vous mentionnez est en cours de finalisation entre les différents ministères concernés. Ce texte sera publié avant la rentrée scolaire 2018. Il assouplira les conditions de recrutement des AESH, en diminuant notamment la durée d’expérience requise pour accéder à ce statut.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces quelques précisions, même si votre réponse ne me rassure pas totalement.
Vous confirmez la rédaction d’un décret : c’est bien, mais je souhaiterais que le ministre de l’éducation nationale aille plus loin dans ses explications, notamment pour ce qui concerne la situation de ces personnels, qui restent soumis à des régimes différents. Enfin, il n’est pas compréhensible que des enfants puissent être abandonnés par leur AVS au bout de deux ans.
Le Gouvernement va-t-il enfin mettre en œuvre des règles à même d’améliorer et de pérenniser le statut des AVS ? Nous vous demandons de prendre des mesures de justice en ce sens.

La parole est à M. Pierre Cuypers, en remplacement de M. Didier Mandelli, auteur de la question n° 317, adressée à M. le ministre de l’action et des comptes publics.

Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi d’excuser M. Mandelli, dont je supplée à l’absence.
La dotation de solidarité rurale, ou DSR, est attribuée aux communes de moins de 10 000 habitants. Elle permet de soutenir les collectivités dans la réalisation de projets d’aménagement de leur territoire et les aide à assurer le bon fonctionnement de leur offre de service.
Or de nombreuses communes bénéficiant d’un fort dynamisme devraient bientôt franchir le seuil de 10 000 habitants et, ainsi, perdre l’éligibilité à la dotation de solidarité rurale.
C’est le cas de la commune d’Aizenay, en Vendée, dont la population est passée de 6 095 à 9 212 habitants en quinze ans. Cette commune bénéficie actuellement de la DSR à hauteur de 794 000 euros. Le montant de cette dotation devrait atteindre 1, 047 million d’euros en 2021.
Aizenay accueille 200 à 250 nouveaux habitants chaque année. Du fait de cette évolution démographique, cette commune devrait franchir très prochainement le seuil de 10 000 habitants. Dès lors, elle serait privée de la dotation de solidarité rurale. Certes, elle deviendrait éligible à la dotation de solidarité urbaine, mais celle-ci ne s’élèverait, pour ce qui la concerne, qu’à 300 000 euros.
Cette commune perdrait donc plus de 700 000 euros de dotations, pour la simple raison qu’elle aura franchi le seuil symbolique de 10 000 habitants.
Ce système de paliers est extrêmement pénalisant pour les communes.
Maintenir ce seuil n’encourage d’ailleurs pas la création de communes nouvelles. En effet, un pacte financier garantit pendant trois ans le niveau des dotations de l’État aux communes fusionnant au sein de communes nouvelles de moins de 10 000 habitants, avec une majoration de 5 %. Cependant, rien n’est envisagé pour les communes nouvelles de plus de 10 000 habitants.
Dès lors, deux solutions peuvent être envisagées : la première consisterait tout simplement à relever ces seuils ; la seconde serait d’instaurer une dégressivité sur cinq ans, par exemple, de la dotation de solidarité rurale, jusqu’à parvenir au niveau de la dotation de solidarité urbaine. Ce système garantirait une transition beaucoup plus souple pour le budget des communes.
Monsieur le secrétaire d’État, M. Mandelli souhaite connaître la position du Gouvernement face à ces deux propositions.

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu relayer les interrogations de votre collègue, M. Mandelli, au sujet de la commune d’Aizenay.
Aizenay perçoit cette année une dotation globale de fonctionnement, ou DGF, en hausse de 8, 5 % – cette dotation s’élève à 1, 7 million d’euros, contre 1, 6 million d’euros l’année dernière. Cette augmentation résulte notamment de la progression de la dotation de solidarité rurale, qui voit son montant augmenter pour atteindre 867 000 euros en 2018.
Toutefois, je précise que le montant que cette commune devrait percevoir en 2021 ne peut être garanti. En effet, la DGF est une dotation que l’on qualifie de « vivante » : elle évolue chaque année en fonction de critères de ressources et de charges, et ne suit pas une trajectoire linéaire, commune par commune.
En conséquence, il est impossible de prévoir ce que percevrait la commune d’Aizenay si elle restait éligible à la dotation de solidarité rurale. De même, il est impossible d’imaginer le montant qu’elle pourrait percevoir si elle devenait éligible à la dotation de solidarité urbaine, la DSU. Je le répète, ces montants sont calculés en fonction de la situation relative de chacune des communes.
Aizenay connaît effectivement une progression constante de sa population, sur laquelle M. Mandelli insiste dans sa question, et que vous venez de rappeler. Cette évolution est susceptible de lui faire franchir le seuil de 10 000 habitants, en deçà duquel une commune est éligible à la DSR.
Un tel effet de seuil est inhérent aux mécanismes de répartition. Il est en effet indispensable de fixer des seuils au-dessus ou en dessous desquels les communes sont ou ne sont pas éligibles à tel ou tel dispositif. Si l’on ne procède pas ainsi, on dispersera nécessairement les concours financiers de l’État entre l’ensemble des collectivités.
Ce n’est pas là une simple réponse théorique, il s’agit d’un cas tout à fait concret : tout élargissement de la liste des communes éligibles à une dotation réduit d’autant les montants attribués aux autres communes.
Ainsi, en 2018, seize communes ont dépassé en métropole le seuil de 10 000 habitants. Si leurs attributions de DSR avaient été maintenues, il aurait fallu déduire plus de 3 millions d’euros des dotations attribuées aux communes de moins de 10 000 habitants.
Au demeurant, rehausser le seuil de 10 000 habitants afin d’attribuer la DSR aux communes de 15 000 ou 20 000 habitants ne permettrait pas de remédier à l’existence des effets de seuil, que le sénateur Mandelli critique de manière générale.
Le Conseil constitutionnel s’assure que le législateur ne fixe pas des seuils sans lien avec l’objet de la loi. Pour ce qui concerne la distinction entre communes rurales et communes urbaines, le seuil de 10 000 habitants paraît objectif et rationnel.
Le Conseil constitutionnel exige également que les seuils ne produisent pas des effets disproportionnés pour ceux qui y sont soumis. Sur ce point, vous observez vous-même que le passage au-dessus des 10 000 habitants permet souvent à une commune perdant son éligibilité à la DSR de devenir bénéficiaire de la DSU : on peut citer, par exemple, la commune de Juvignac, dans l’Hérault, qui a perdu 107 000 euros de DSR et gagné 238 000 euros de DSU, ou encore celle de Borgo, en Corse, qui a perdu 293 000 euros de DSR et gagné 346 000 euros de DSU.
De telles améliorations ne sont évidemment pas automatiques. Elles dépendent du classement de la commune au sein de chaque dispositif, en fonction des critères que j’ai précédemment évoqués.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite simplement revenir sur la seconde proposition formulée par M. Mandelli : un système de dégressivité, permettant d’assurer un lissage. Mon collègue suggère d’assurer ce lissage sur cinq ans, mais cela peut être réévalué et recalculé.

La parole est à Mme Christine Lanfranchi Dorgal, auteur de la question n° 332, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

Ma question concerne la situation économique des opérateurs privés de l’archéologie préventive agréés par le ministère de la culture, ainsi que leurs salariés, inquiets pour leur emploi.
La principale entreprise du secteur, laquelle compte 250 salariés, a été placée en redressement judiciaire. Certes, la crise économique peut constituer une explication, mais il semble également que les opérateurs privés subissent les effets d’une distorsion de concurrence avec les activités de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, l’INRAP.
Cet institut a été créé par l’État en 2001, en même temps que l’obligation de diagnostic et, si nécessaire, de fouilles pour tout aménagement dans les zones sensibles sur le plan archéologique.
Subventionné par l’État, l’INRAP dispose du monopole des diagnostics préventifs, mais il peut aussi soumissionner aux marchés publics de fouilles au même titre que les opérateurs privés.
En juin 2017, l’Autorité de la concurrence a reconnu un risque de « subventions croisées pouvant aboutir à des prix prédateurs ou produire des effets d’éviction ». Cette instance a donc demandé à l’INRAP une séparation comptable entre ses missions de service public et ses activités commerciales. Cet engagement a-t-il été respecté depuis lors ?
En outre, sachant que la loi du 17 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a régulé ce secteur, qui dépend des décisions publiques, il semble urgent de lancer une mission de l’Inspection générale des finances. Il faut aussi imaginer au plus vite des mesures afin d’éviter que la douzaine d’opérateurs privés concernés et leurs 600 emplois ne subissent le pire.
Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cette proposition.

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics – monsieur le secrétaire d’État, je vous saurais gré de bien vouloir respecter les deux minutes trente qui vous sont imparties.
Je vais m’y efforcer, monsieur le président !
Madame la sénatrice Christine Lanfranchi Dorgal, l’activité des entreprises du secteur de l’archéologie préventive s’est contractée entre 2013 et 2016, en raison d’une baisse significative des opérations à réaliser.
Cette situation a conduit plusieurs acteurs à se retirer, et la principale entreprise du secteur est aujourd’hui placée en redressement judiciaire.
Je peux vous assurer que les services de l’État suivent avec attention la situation de l’ensemble de ces acteurs et mettent en œuvre les moyens dont ils disposent pour les accompagner dans ce contexte économique difficile.
L’Autorité de la concurrence a été saisie en 2015 par des opérateurs privés se plaignant de pratiques de l’INRAP pouvant créer des distorsions de concurrence. Dans le cadre de cette procédure, l’INRAP s’est notamment engagé à mettre en place, au plus tard le 1er janvier 2018, une comptabilité analytique permettant d’assurer une stricte séparation comptable entre, d’une part, ses activités relevant de sa mission de service public et, de l’autre, ses activités lucratives, donc ouvertes à la concurrence.
Dans sa décision du 1er juin 2017, l’Autorité de la concurrence a mis un terme à la procédure engagée contre l’INRAP. Elle a estimé que les engagements proposés répondaient aux préoccupations de concurrence exprimées et présentaient un caractère substantiel, crédible et vérifiable.
Conformément à ces engagements, l’INRAP a mis en œuvre depuis le 1er janvier 2018 un nouveau modèle de comptabilité analytique, qui a été présenté et validé lors du conseil d’administration de l’établissement du 28 mars dernier.
Il relève de la seule compétence de l’Autorité de la concurrence de vérifier que la comptabilité analytique mise en place par l’INRAP correspond bien aux engagements rendus obligatoires par l’Autorité. À cette fin, l’INRAP doit transmettre à l’Autorité de la concurrence une restitution annuelle comprenant un état synthétique de la comptabilité analytique auditée, ainsi que l’attestation de conformité du système de comptabilité analytique établie par l’auditeur missionné.
Par ailleurs, du fait de la spécificité du secteur de l’archéologie préventive, plusieurs missions lui ont déjà été consacrées ces dernières années, et des mesures visant à remédier aux dysfonctionnements constatés ont ainsi été proposées. On les trouve, notamment, dans le rapport remis par la députée Martine Faure en 2015 et dans le rapport annuel de la Cour des comptes, en 2016. De même, par sa décision du 1er juin 2017, l’Autorité de la concurrence a permis de faire l’état de la situation de la concurrence dans ce secteur.
Sur le fondement de ces constats, le Gouvernement a récemment pris l’initiative de plusieurs mesures visant à prévenir toute distorsion de concurrence entre les acteurs de l’archéologie préventive, notamment en garantissant l’égal accès de tous aux documents nécessaires à la réalisation d’opérations d’archéologie préventive.
Dans ces conditions, l’utilité du lancement d’une mission de l’Inspection générale des finances, que vous préconisez, ne nous paraît pas strictement établie. Je peux toutefois vous assurer que le Gouvernement sera attentif à ce que l’ensemble de ces mesures soient mises en œuvre, et à ce que les décisions de l’Autorité de la concurrence soient parfaitement respectées.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse très détaillée.
Permettez-moi d’ajouter que ce mode de fonctionnement peut aussi avoir des répercussions sur les finances des collectivités locales, qui sont maîtres d’ouvrage pour les marchés de fouilles. Celles-ci ont en effet l’obligation, conformément aux règles de la commande publique, de soumettre le choix du candidat retenu comme le mieux-disant selon les critères du prix et de la valeur technique à la direction des affaires culturelles dont elles dépendent. La validation du marché par cette DAC conditionne son exécution.
Or il arrive que le candidat pressenti par une collectivité locale et celui que la DAC propose ne soient pas les mêmes, et que l’écart de prix entre les deux projets – parfois très important, j’en ai eu la preuve – menace de fragiliser le financement de l’opération dans son ensemble.
Dans ces conditions, ne pourrait-on pas imaginer un autre mode de fonctionnement, afin notamment que l’INRAP, qui détient le monopole des diagnostics, ne soumissionne pas aux marchés publics ouverts aux entreprises agréées par le ministère de la culture ? Ce n’est qu’un vœu pieux…

La parole est à Mme Laurence Harribey, auteur de la question n° 325, adressée à Mme la ministre de la culture.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur les modalités d’application de l’article 32 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
Ces modalités ont été fixées par le décret du 10 mai 2017 relatif à la participation d’amateurs à des représentations d’une œuvre de l’esprit dans un cadre lucratif, lui-même précisé par un arrêté du 25 janvier 2018.
Premièrement, l’article 2 du décret susvisé limite le nombre de participations à cinq spectacles par an pour les amateurs participant à titre individuel, et à huit spectacles par an pour les groupements d’artistes amateurs constitués. De plus, un amateur ne peut participer, à titre individuel, à plus de dix représentations par an. Le ministre chargé de la culture peut toutefois accorder une dérogation à ces plafonds, après avis du Conseil national des professions du spectacle, si le spectacle comporte un intérêt artistique et culturel particulier.
Deuxièmement, aux termes de l’article 4 du décret, deux mois avant la première représentation, les spectacles doivent faire l’objet d’une télédéclaration auprès du ministère de la culture précisant les noms de tous les amateurs et les jours de représentation.
En pratique, même s’il est nécessaire de protéger le statut des amateurs participant à un spectacle lucratif, il est clair que cette réglementation peut aboutir à l’abandon de toutes les manifestations proposant une reconstitution historique ou une mise en valeur du patrimoine.
À titre d’exemple, en Gironde, le spectacle La Bataille de Castillon nécessite 450 bénévoles pour chacune de ses quinze représentations. Une solution semble avoir été trouvée pour cette année. Cela étant, ma question porte plus largement sur la définition de l’« intérêt artistique et culturel particulier » qui justifie les dérogations.
Par ailleurs, est-il possible de revoir à la baisse le délai de la télédéclaration, ou de concevoir une procédure moins figée dans le temps, afin d’éviter le découragement des entrepreneurs de spectacles vivants ?

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.
Madame la sénatrice Harribey, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Mme Françoise Nyssen, ministre de la culture, qui m’a chargé de vous répondre.
Jusqu’à la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, la pratique artistique amateur n’était pas encadrée juridiquement. Ainsi, la participation d’amateurs à des spectacles courait le risque d’être assimilée à du travail dissimulé du seul fait qu’elle avait impliqué le recours à une billetterie payante, justifié l’utilisation d’équipements professionnels ou été précédée d’actions de publicité.
Il était donc nécessaire de doter cette pratique d’un cadre juridique protecteur et incitatif à son développement, ce qu’a fait la loi de 2016.
Cette dernière a tout d’abord créé une dérogation à la présomption de salariat afin de sécuriser le recours à des amateurs non rémunérés lorsqu’ils interviennent dans unspectacle lucratif s’inscrivant dans le cadre d’actions d’accompagnement de la pratique artistique amateur ou d’actions pédagogiques culturelles.
Le décret du 10 mai 2017 a ensuite précisé le périmètre du recours aux amateurs dans un cadre lucratif, prévoyant en particulier les plafonds de représentations que vous avez rappelés.
Enfin, l’arrêté du 25 janvier 2018 a finalisé le dispositif en déterminant le contenu de la convention passée avec une collectivité par les structures mobilisant des amateurs dans un spectacle professionnel et les modalités de la télédéclaration des spectacles.
Ces dispositions réglementaires encadrent donc la possibilité donnée par la loi à une entreprise de spectacle de faire appel à des amateurs sans avoir à les rémunérer ; elles ne s’appliquent que lorsqu’il s’agit de spectacles lucratifs. En revanche, la pratique amateur exercée dans un cadre non lucratif ne fait l’objet d’aucune limitation, en particulier quant au nombre de représentations.
La loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine protège ainsi la pratique amateur individuelle ou en groupement constitué intervenant dans un cadre non lucratif en lui ouvrant l’accès à la publicité, à la billetterie et aux moyens techniques professionnels.
Les spectacles nocturnes de la Cinéscénie du Puy du Fou, ainsi que la reconstitution de la bataille de Castillon, que vous avez évoquée, font intervenir exclusivement des amateurs comme figurants. Comme il s’agit de reconstitutions historiques organisées par des associations à but non lucratif, elles sont sécurisées par la loi et ne sont en rien plafonnées. Aucune menace ne pèse donc de ce point de vue sur ces spectacles.
Quant à vos propositions concernant, notamment, les délais de télédéclaration et l’ajustement de certaines procédures, Mme la ministre de la culture se tient à votre disposition pour continuer à débattre des améliorations possibles.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d’État, pour ces éléments de réponse, même si la première partie de votre réponse ne faisait que répéter les faits que j’avais rappelés dans ma question.
Comme vous l’avez indiqué, le problème essentiel est lié à la notion de « spectacle lucratif ». Une solution a été trouvée cette année pour La Bataille de Castillon, le spectacle n’étant pas considéré comme ayant un but lucratif. C’est une bonne chose, mais il convient de préciser la distinction entre activités lucratives et non lucratives. En effet, il est évident que nombre de spectacles de reconstitution historique ou de valorisation du patrimoine ne peuvent se réaliser sans un système ouvert à l’économie, aux entrées payantes et aux partenariats financiers. Il faut donc préciser la notion de « spectacle lucratif », qui va de pair avec la présomption de salariat, d’autant que cette dernière peut mettre en danger d’autres volets de l’action culturelle, en particulier les chantiers de bénévoles pour le patrimoine.
Considérant que vous recevez mes propositions de manière positive, monsieur le secrétaire d’État, je reprendrai contact avec le ministère de la culture pour essayer d’aller plus loin dans cette discussion. Cela m’importe d’autant plus que je reste d’accord, sur le fond, avec la démarche de la loi de 2016 : il était nécessaire de réglementer le recours aux bénévoles dans ce secteur.

La parole est à M. Jean-Marie Janssens, auteur de la question n° 293, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur l’organisation des concours « Meilleurs ouvriers de France ».
En effet, à l’occasion du Salon des fromagers qui se tenait parallèlement au Salon international de l’agriculture, j’ai été interpellé par des représentants de la profession, dont le président de la Fédération française des fromagers, qui m’ont fait part de leur inquiétude concernant l’organisation des concours « Meilleurs ouvriers de France ».
Une nouvelle organisation est actuellement mise en place pour ces concours.
En effet, un partenaire privé – en l’occurrence, une maison d’édition – prend désormais une place importante dans l’organisation des concours ainsi que dans leur financement. Les critères de sélection et de notation ont ainsi été modifiés.
Ces concours, organisés sous l’égide du ministère de l’éducation nationale, ont pour objet la reconnaissance et la valorisation de l’excellence professionnelle. Or le rôle prépondérant joué par un partenaire privé dans leur organisation est difficilement compréhensible pour les professionnels du secteur, qui craignent que l’indépendance et la dimension académique de ces concours ne soient remises en question.
Cette inquiétude est d’ailleurs partagée par tous les professionnels des secteurs, alimentaires ou non alimentaires, pour lesquels est organisé un concours « Meilleurs ouvriers de France ».
Monsieur le secrétaire d’État, pouvez-vous me garantir que ces concours auront toujours pour finalité de récompenser l’excellence en toute indépendance et en toute objectivité ?
Par ailleurs, pouvez-vous m’indiquer les différents acteurs du financement de ces concours et le rôle que vous entendez laisser jouer aux nouveaux partenaires privés ?

La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.
Monsieur le sénateur Janssens, je vous prie de bien vouloir excuser M. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, qui m’a demandé de bien vouloir vous répondre.
L’organisation du concours pour l’obtention du diplôme d’État « Un des meilleurs ouvriers de France » repose sur un modèle original – vous l’avez rappelé – de coopération entre partenaires publics et privés, qui réunit le ministère de l’éducation nationale et ses partenaires ministériels, le comité d’organisation du concours et des expositions du travail, ou COET, les professionnels et leurs représentants.
Le COET met en œuvre les modalités d’attribution du diplôme « Un des meilleurs ouvriers de France ». Il organise les expositions du travail et la remise des diplômes. Il est financé par des subventions publiques, le ministère de l’éducation nationale étant le plus gros contributeur. Il est, dans le cadre actuel, éligible à la taxe d’apprentissage. Il peut également recevoir des dons, et perçoit des droits d’inscription des candidats.
Afin de pallier une fragilité financière récurrente, le comité d’organisation a passé une convention avec le groupe Uni-éditions, société filiale du Crédit Agricole. Ce partenariat financier ne présente aucun risque d’ingérence, dans la mesure où les métiers de la banque sont totalement absents des métiers ouverts au concours.
Par ailleurs, la modification des critères de notation n’est pas liée à cette convention ; elle traduit la volonté du COET de procéder à une vaste remise en ordre de l’organisation même de l’examen.
Dans le cadre de la réglementation fixée par le ministère de l’éducation nationale, le comité a ainsi rénové ses statuts et engagé une politique de transparence sur les conditions d’organisation des épreuves relevant de sa propre responsabilité.
Le COET a aussi chargé l’inspecteur général, président du jury général, de revoir l’ensemble des sujets, des référentiels et des critères d’évaluation des épreuves.
L’intervention des professionnels et de leurs fédérations est essentielle pour définir les exigences professionnelles attendues et, de la sorte, le niveau et la qualité du concours. Toutefois – il faut le préciser –, les fédérations professionnelles sont des partenaires, et non pas les organisateurs des épreuves, ce rôle étant dévolu au COET par le ministère de l’éducation nationale.
Le comité d’organisation, en accord avec sa tutelle ministérielle, a souhaité reprendre avec les fédérations professionnelles une coopération plus rationnelle dans le cadre organisationnel et juridique imparti. Une telle coopération permet d’assurer l’équilibre entre, d’une part, le respect des règles applicables aux candidats aux diplômes de l’éducation nationale et, de l’autre, la recherche permanente d’une définition de l’excellence professionnelle dans plus de deux cents métiers.
Monsieur le sénateur, j’espère avoir répondu à vos inquiétudes, notamment quant à l’absence d’interférence des acteurs privés dans le processus d’évaluation.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants pour permettre à Mme la secrétaire d’État auprès de M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, de rejoindre l’hémicycle.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures dix, est reprise à dix heures quinze.

La parole est à M. Dany Wattebled, auteur de la question n° 328, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la secrétaire d’État, dans le cadre de la réforme de l’autorité environnementale, le préfet de région était désigné comme autorité compétente de l’État en matière d’environnement.
Le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé cette disposition par sa décision n° 400559 en date du 6 décembre dernier. En conséquence, la seule possibilité réglementaire laissée aux porteurs de projet réside dans le pouvoir d’évocation du ministre, dont l’opportunité de mise en œuvre est laissée au libre choix de ce dernier.
Une instruction ministérielle non parue au Journal officiel préconise que les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement fassent prononcer les avis nécessaires par la mission régionale d’autorité environnementale, en lieu et place du préfet de région, sans toutefois qu’un texte législatif ou réglementaire le permette. À ce jour, nous sommes toujours dans l’attente d’un décret désignant la nouvelle autorité environnementale.
Madame la secrétaire d’État, j’en viens à mes questions.
Tout d’abord, comment sécuriser les projets avancés, qui ont été engagés sous la responsabilité du préfet de région antérieurement à la décision du Conseil d’État, et éviter les dérapages de calendrier, sachant que l’obtention des avis nécessaires demande entre six et douze mois ? Afin de ne pas bloquer les porteurs de projets, peut-on envisager de leur accorder un régime dérogatoire ?
Ensuite, concernant les procédures futures, les porteurs de projets sont invités à saisir la mission régionale d’autorité environnementale. Néanmoins, comme aucun texte ne lui donne compétence, ne faut-il pas craindre une éventuelle remise en cause de la légalité des procédures nécessaires à la réalisation des projets d’aménagement ? Dès lors, afin de permettre aux porteurs de projets de programmer au mieux chaque projet, pouvez-vous nous indiquer l’échéance à laquelle paraîtra le décret désignant l’autorité environnementale compétente ?
Enfin, ne faut-il pas craindre un engorgement des missions régionales d’autorité environnementale, non dimensionnées à ce jour pour traiter un tel volume de sollicitations ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Wattebled, l’évaluation environnementale permet à l’autorité compétente en la matière d’autoriser ou non un projet. Cette décision est éclairée par les conséquences envisagées dudit projet sur la santé humaine et sur l’environnement.
Le droit français prévoit qu’une autorité environnementale rend un avis sur le dossier en amont de l’ouverture de l’enquête publique, en indiquant comment le demandeur intègre les enjeux environnementaux dans la conception de son projet.
Le 6 décembre 2017, le Conseil d’État a annulé les dispositions du code de l’environnement qui instituaient le préfet de région comme autorité compétente pour rendre l’avis d’autorité environnementale et autoriser ou non un projet. Le Conseil d’État a en effet jugé que le préfet de région ne pouvait cumuler les deux fonctions.
Cette décision a inauguré une période d’incertitude pesante pour tous les acteurs. Très conscient de l’urgence que représente la sécurisation de ces procédures et soucieux d’éviter les blocages, le Gouvernement a transmis des instructions aux préfets et aux services chargés de l’évaluation environnementale dès le 20 décembre 2017. Cela a permis que les projets engagés pâtissent le moins possible de la situation actuelle.
La période transitoire est exploitée par les services de l’État et par les missions régionales d’autorité environnementale pour rechercher la meilleure solution.
En parallèle, le Gouvernement travaille activement à l’élaboration d’un nouveau décret. Plusieurs pistes ont été explorées pour mettre en place un dispositif à la fois conforme au droit européen et opérationnel sur le terrain. Le Gouvernement envisage une parution du décret dans le courant de l’été.

Il y a quand même urgence ! De nombreux dossiers vont être en panne. Vous savez bien comment cela se passe sur le terrain : une fois qu’un dossier a pris du retard, même si le décret paraît en juillet, les travaux ne pourront être engagés que l’année prochaine, alors que les entreprises ont besoin de travail !

La parole est à M. Stéphane Piednoir, auteur de la question n° 330, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Ma question porte sur le coût de l’instruction des demandes d’autorisation de mise sur le marché des produits biocides.
Cette autorisation s’obtient au terme d’une procédure en deux temps régie par le règlement européen n° 528/2012 du 22 mai 2012.
Dans un premier temps, les substances actives sont évaluées et approuvées à l’échelon européen par une agence dédiée, l’Agence européenne des produits chimiques, puis, dans un second temps, les produits contenant ces substances actives ayant vocation à être commercialisés en France doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES.
L’instruction de cette demande par l’ANSES a un coût, qui est à la charge des entreprises souhaitant commercialiser des produits biocides. Son montant est fixé, par arrêté, de manière forfaitaire et par produit contenant des substances actives.
Je m’interroge sur le bien-fondé de ce mode de calcul forfaitaire et par produit, indépendant de la quantité produite.
En effet, le coût d’instruction pour la commercialisation d’un produit est le même que ce dernier soit commercialisé par un grand groupe et à l’échelle nationale, ou bien par une petite entreprise dont le réseau de diffusion n’est que régional, voire départemental.
En vertu du principe du pollueur-payeur, il semblerait plus juste qu’une entreprise produisant des centaines de milliers de tonnes de produits polluants paye une redevance plus importante qu’une PME qui en produit moins de dix tonnes par an. C’est le cas d’une entreprise de mon département : elle ne peut assumer la charge que représentent ces coûts d’instructions.
Madame la secrétaire d’État, quelles mesures le Gouvernement compte-t-il prendre pour corriger cette disposition qui entrave la libre concurrence ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Stéphane Piednoir, qu’ils soient utilisés par le grand public ou les professionnels, les produits biocides font partie intégrante de notre quotidien. Ils peuvent porter préjudice à notre santé comme à l’environnement, et c’est pourquoi ils font l’objet d’un encadrement réglementaire très strict aussi bien au niveau européen qu’au niveau national visant à évaluer leur impact de manière précise.
Je n’entrerai pas dans le détail des différentes dispositions, mais il me semble essentiel de rappeler l’importance de cet encadrement en raison des conséquences potentielles de ces produits sur la santé des Français.
En France, c’est l’ANSES qui procède à l’évaluation des produits biocides et délivre, ou non, l’autorisation de mise sur le marché. Son attention est centrée en priorité sur les PME. Environ 20 % d’entre elles, soit près d’un million d’entreprises, sont concernées par la réglementation relative aux produits biocides en France.
Les demandes d’autorisation soumises à l’ANSES par les entreprises sont soumises à une redevance fixée par l’arrêté du 22 novembre 2017. Ce texte a été élaboré en concertation avec les organisations professionnelles œuvrant dans le domaine des produits biocides. Il n’a pas été jugé pertinent de moduler le montant de la redevance en fonction de la taille de l’entreprise, car les frais engagés par les pétitionnaires servent à couvrir les coûts de l’instruction des dossiers par l’ANSES.
Je tiens par ailleurs à rappeler que la France dispose d’outils fiscaux compensatoires qui n’existent pas dans d’autres pays européens ; je pense par exemple au crédit d’impôt recherche ou au crédit d’impôt innovation. Ce dernier, consacré spécifiquement aux TPE et PME, leur permet de bénéficier d’un crédit d’impôt de 20 % des dépenses liées à la conception ou à la réalisation du prototype d’un produit nouveau. Les TPE et PME produisant des produits biocides peuvent donc en bénéficier directement. Bien que plafonnée à 400 000 euros par an et par entreprise, cette aide compense les désavantages de ces petites structures face aux grands groupes.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d’État. Je prends bonne note des mesures compensatoires propres à la fiscalité française.
Néanmoins, quant à la phase d’autorisation des substances actives, des réductions de redevance sont envisagées à l’échelon européen pour les microentreprises et les petites entreprises qui ne peuvent en supporter le coût.
Plus globalement, il relève de notre responsabilité collective de maintenir des PME dans nos territoires. C’est pourquoi je vous invite à considérer la disproportion qui existe entre les coûts que cette redevance représente pour une petite entreprise et pour une multinationale, qui peut les assumer bien plus aisément.

La parole est à Mme Corinne Féret, auteur de la question n° 347, adressée à M. le ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur la diminution des aides publiques destinées à l’électrification rurale et, plus précisément, sur la situation du syndicat départemental d’énergie du Calvados, le SDEC Énergie.
Alors que, pour 2017, la dotation octroyée par le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, ou FACÉ, à ce syndicat s’élevait à 6 425 000 euros, elle n’est plus que de 5 138 000 euros cette année. Cette baisse brutale de près de 1, 3 million d’euros lui a été notifiée en mars dernier sans raison claire et objective.
La priorité du SDEC Énergie est naturellement le renouvellement des installations électriques obsolètes et le renforcement du réseau. Or, avec une dotation du FACÉ amputée de 20 %, notre syndicat départemental ne pourra plus continuer à investir et, à court terme, la qualité du réseau d’électricité en secteur rural en sera affectée.
Cette situation est d’autant plus mal vécue que l’inventaire de l’état du réseau apparaît tronqué. En effet, depuis plusieurs années, le SDEC Énergie réalise à sa charge des campagnes de mesure de tension qui, sur la base de plusieurs centaines d’enregistrements, démontrent une différence notable – de plus de 20 %, tout de même – entre la mesure réalisée chez l’habitant et l’étude statistique GDO d’Enedis.
On peut déplorer qu’il ne soit pas davantage tenu compte, non seulement de ces différences de données, mais aussi des efforts récurrents du syndicat pour limiter au juste minimum les reports de crédits. Dans le Calvados, les dotations du FACÉ sont consommées, car les nécessités d’investissement sur les réseaux sont réelles et les réponses ne peuvent pas être ajournées.
Mes questions sont donc les suivantes, madame la secrétaire d’État.
Au-delà du coup de rabot général, de l’ordre de 5 %, voté dans la loi de finances pour 2018, pourriez-vous m’indiquer les raisons – et les données – qui ont motivé la baisse de 20 % des dotations du FACÉ cette année dans le Calvados ?
J’attire particulièrement votre attention sur la problématique des écarts de mesure de tension que je viens d’évoquer, et souhaite également connaître votre position sur cette question.
Enfin, plus globalement, pourriez-vous préciser les intentions du Gouvernement quant à l’avenir du FACÉ ? Une augmentation de cette aide publique à l’électrification rurale est-elle envisagée pour 2019 ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice Féret, comme vous le soulignez, le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ, doté de 360 millions d’euros en 2018, permet de réaliser les investissements nécessaires pour la qualité du réseau de distribution d’électricité en milieu rural.
Cet outil essentiel de la solidarité entre les territoires assure la péréquation entre milieu rural et milieu urbain. Le Gouvernement y est donc particulièrement attaché.
L’année dernière, nous avons réalisé un inventaire de l’état de nos réseaux électriques qui nous a permis de démontrer l’efficacité du FACÉ et l’amélioration continue de la qualité de la redistribution d’électricité en milieu rural.
Ainsi, pour l’année 2018, la dotation du syndicat départemental d’énergie du Calvados s’élève à plus de 5 millions d’euros. Elle était de 6, 4 millions d’euros en 2017. Cette diminution est le produit de deux effets, l’un contextuel et l’autre factuel.
Premièrement, lapolitique d’électrification rurale participe, comme l’ensemble des politiques publiques, à l’effort de redressement des finances publiques. Dans ce cadre, le montant total du FACÉ, voté dans la loi de finances pour 2018, est en baisse de 5 %, passant à 360 millions d’euros.
Deuxièmement, en ce qui concerne les zones rurales du Calvados, le dernier inventaire a établi l’évolution favorable de la qualité du réseau électrique basse tension. À l’inverse, les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy ont subi l’année dernière un cyclone qui a été – vous en conviendrez, madame la sénatrice – d’une gravité exceptionnelle. Le conseil du FACÉ a donc décidé d’accorder une subvention elle aussi exceptionnelle à ces deux collectivités.
Ces critères de répartition, tout comme les dotations du FACÉ pour 2018, ont par ailleurs été approuvés à l’unanimité par le comité compétent. La diminution de 20 % des dotations octroyées au Calvados résulte donc d’un arbitrage que nous jugeons juste, équitable et transparent.

Madame la secrétaire d’État, je vous ai bien écoutée : vous justifiez une baisse de 1, 3 million d’euros d’aides publiques par l’évolution prétendue favorable de la qualité du réseau électrique basse tension en zone rurale dans le Calvados, en la comparant à celle que connaissent d’autres départements français, et par la situation, certes exceptionnelle et dramatique, de deux collectivités d’outre-mer.
Pour autant, je pense qu’il est grand temps de ne plus orienter à la baisse les dotations du FACÉ et, surtout, de s’accorder sur un inventaire partagé de l’état du réseau et des besoins. En effet, tant que les mesures de tension réalisées par le SDEC Énergie, autorité organisatrice dans le Calvados, ne seront pas mieux prises en compte, le conseil du FACÉ continuera à avoir une vision tronquée de la réalité du réseau et de la qualité de l’électricité distribuée dans le département.
Sachez, madame la secrétaire d’État, que je me tiens à votre disposition, de même que les responsables du SDEC Énergie, pour travailler sur ces questions. L’électrification en milieu rural, notamment dans un département comme le mien, est un enjeu primordial !

La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone, auteur de la question n° 314, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur l’aménagement de l’autoroute A8, qui passe à proximité de la commune de Biot, dans les Alpes-Maritimes, commune partiellement située dans la plaine inondable de la Brague.
Lors des inondations meurtrières qui ont frappé mon département en octobre 2015, causant vingt morts et plusieurs centaines de millions d’euros de dégâts matériels, les buses de l’autoroute A8, gérée sur le réseau Escota par Vinci Autoroutes, se sont bouchées, empêchant l’eau de s’écouler normalement. L’eau a alors stagné à une hauteur de plus de 1, 50 mètre, pendant plus d’une heure, dans des zones d’habitation de la commune de Biot.
En mars 2018, lors d’une intempérie a priori sans conséquence, puisque sa puissance n’a été décelée ni par la préfecture, ni par Météo France, ni par les logiciels municipaux, le même schéma s’est reproduit. Les buses se sont trouvées partiellement bouchées, et la plaine de la Brague inondée. Fort heureusement, cette fois, il n’y a eu aucune victime.
Lors de cet épisode météorologique, la plaine a atteint sa limite de rétention d’eau sans que l’autoroute soit fermée, ce qui a créé une véritable dangerosité sur l’infrastructure autoroutière. Pris au piège par l’eau dans la zone de rétention, les habitants n’auraient eu aucun moyen de fuir, sans parler des dommages matériels subis que nous aurions pu répertorier une fois de plus, notamment sur les habitations.
Après les intempéries de 2015, la maire de Biot, Mme Guilaine Debras, avait alerté, sans succès, le précédent gouvernement, ainsi que le concessionnaire autoroutier, Vinci, afin de discuter des aménagements qu’il faudrait apporter à cette autoroute, qui forme un véritable barrage à l’écoulement de l’eau en cas de fortes pluies.
Madame la secrétaire d’État, si Vinci est gestionnaire d’Escota, l’autoroute reste bien la propriété de l’État. Comptez-vous donc intervenir auprès du concessionnaire afin de réduire le risque d’inondation en ordonnant les travaux d’aménagement nécessaires à la sécurité des habitants et à la pérennité des infrastructures ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice Estrosi Sassone, la ministre des transports, Mme Élisabeth Borne, empêchée ce matin, m’a chargée de répondre à votre question sur l’autoroute A8.
À la suite des inondations ayant frappé la commune de Biot, dans les Alpes-Maritimes, en octobre 2015, vous l’interrogez sur les risques liés à ces fortes intempéries. Sachez que nous partageons vos préoccupations.
Sur la base des discussions engagées autour du bassin de la Brague entre les collectivités territoriales, les services de l’État et la société Escota, concessionnaire de l’autoroute A8, une étude hydraulique a été commandée en 2015 par la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis. Cette étude a été transmise aux services du ministère des transports, où elle est en cours d’analyse, je vous le confirme.
Les aménagements réalisés le long de la Brague au cours des cinquante dernières années ont entraîné l’imperméabilisation de grandes surfaces urbaines, ce qui explique en partie les conséquences dramatiques des inondations. En effet, conçus dans les années soixante, ces aménagements ont été réalisés sans tenir compte ni des évolutions urbaines ni de l’accentuation des phénomènes d’engorgement. Ils ont en conséquence aggravé le phénomène d’écoulement des eaux au droit des ouvrages de l’autoroute A8.
La situation n’est donc pas satisfaisante ; nous partageons ce constat avec vous.
Soucieuse de l’amélioration de la situation et de la garantie apportée à la sécurité des personnes, Élisabeth Borne a demandé elle-même à ses services de traiter ce dossier avec vigilance.
Le programme d’aménagement devra être examiné au regard des conditions permettant de limiter les incidences sur les populations et territoires en aval de l’autoroute. Quant à son financement, il devra faire l’objet d’une mobilisation de ressources apportées par les différentes parties intéressées.

Merci, madame la secrétaire d’État, pour votre réponse. J’espère que l’instruction du dossier ne sera pas trop longue.
Pour être vous-même venue dans les Alpes-Maritimes parler de la culture du risque, en septembre 2017, et avoir à cette occasion été sensibilisée par les élus locaux à la nécessité de mettre en œuvre des ouvrages de protection des habitants et des habitations, vous savez qu’élus et habitants ne peuvent pas attendre un nouveau coup du sort, après les inondations meurtrières que nous avons connues.
J’espère donc que le Gouvernement va se saisir à bras-le-corps de cette question, car la multiplication d’épisodes pluvieux à l’origine de telles difficultés crée un véritable problème dans le département.
Je tiens à souligner la difficulté qu’il y a à négocier avec le délégataire : Vinci ne fait rien, alors que l’autoroute A8 est la plus fréquentée du territoire national et que les tarifs ont considérablement augmenté entre 2010 et 2016, jusqu’à devenir prohibitifs – plus de dix centimes par kilomètre sur l’ensemble de l’ouvrage !
Il appartient maintenant à Vinci de réaliser les aménagements nécessaires. Comme vous l’avez souligné, les communes ont fait ce qu’elles avaient à faire au niveau local, en réalisant des modélisations hydrauliques qui sont à la disposition tant de la ministre des transports que du délégataire.
Je compte vraiment sur votre force de persuasion, madame la secrétaire d’État, ainsi que sur celle de Mme Borne, pour que l’autoroute A8 reçoive enfin ces aménagements !

La parole est à M. Jacques Bigot, auteur de la question n° 193, adressée à Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Madame la secrétaire d’État, j’imagine que vous représentez ici aujourd’hui Mme la ministre de l’enseignement supérieur…
Au sein de l’enseignement supérieur, les facultés de droit présentent une particularité : elles offrent aux étudiants non bacheliers la possibilité d’entrer dans un cursus universitaire, par le biais de la capacité en droit.
Or ces étudiants ne sont pas traités de manière égalitaire, puisqu’ils ne peuvent pas bénéficier d’une bourse, ni en première ni en seconde années. En seconde année, la situation est même plus compliquée encore pour certains d’entre eux, qui, ayant pourtant réussi leur première année, non seulement ne peuvent pas être boursiers, mais doivent payer des frais d’inscription et cotiser à la sécurité sociale étudiante. Certains pourraient pourtant, compte tenu de leur situation extrêmement modeste, bénéficier de la couverture maladie universelle, la CMU.
Ces difficultés doivent impérativement être revues si nous voulons permettre le développement de la capacité en droit, qui donne à des jeunes en échec scolaire ou qui, en tout cas, n’ont pas réussi leur cursus, l’occasion de rejoindre, tout de suite avant le bac ou plus tard, la filière juridique. Cette formation accueille aussi de nombreux étudiants étrangers.
Il existe donc là un réel enjeu : assurer l’égalité entre ces étudiants et ceux du cursus classique de l’enseignement supérieur et faire perdurer une tradition propre aux facultés de droit, tradition qui, par le passé, a permis à certains d’atteindre un très haut niveau – j’ai eu des professeurs agrégés issus de la filière capacitaire en droit !

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Jacques Bigot, Mme la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, empêchée ce matin, m’a chargée de répondre à votre question.
Comme vous l’avez expliqué, la capacité en droit est une formation destinée à des étudiants non titulaires du baccalauréat qui permet d’accéder à l’enseignement supérieur, mais ne correspond pas à des études du niveau de l’enseignement supérieur : à certaines conditions, les étudiants de cette filière accèdent à la première ou à la deuxième année de la licence de droit.
Pour cette raison, la capacité en droit ne fait pas partie des formations ouvrant droit au bénéfice d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.
Pour autant, le public de cette formation n’est pas dénué de droits, et le Gouvernement travaille à les renforcer.
En matière de protection sociale, les étudiants inscrits en capacité en droit ne seront plus assujettis au régime de la protection sociale des étudiants, qui est voué à disparaître conformément aux dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants. Ils seront désormais affiliés, en tant qu’assurés autonomes, à leur régime de protection sociale, généralement celui de leurs parents, c’est-à-dire le régime général de la sécurité sociale. La cotisation annuelle de 217 euros sera supprimée pour tous les nouveaux étudiants dès la rentrée 2018 ; elle le sera pour l’ensemble des étudiants en 2019.
Les étudiants inscrits en capacité en droit bénéficieront de cette mesure générale, qui se traduira par un gain net de pouvoir d’achat dès la rentrée prochaine.
En outre, ils disposent de droits spécifiques en tant qu’étudiants : ils peuvent bénéficier de prestations et de services offerts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, les CROUS. Ils peuvent en particulier accéder à la restauration universitaire à tarif social et déposer une demande de logement en cité universitaire. Si les étudiants concernés rencontrent des difficultés, ils peuvent prendre contact avec le service social du CROUS pour qu’il leur indique les aides susceptibles de leur être accordées compte tenu de leur situation.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, ainsi que Mme la ministre de l’enseignement supérieur, pour cette réponse.
Les étudiants en capacité en droit ne dépendent pas forcément tous de leurs parents ; ils sont parfois largement majeurs.
S’agissant du régime de sécurité sociale, avec le système mis en place, ils devraient donc pouvoir faire valoir leur droit éventuel à la CMU : cela peut être une solution, s’ils n’ont pas la possibilité de s’assurer.
S’agissant des frais d’inscription, je note que vous ne m’avez pas répondu.
J’ai bien entendu qu’il ne s’agit pas d’étudiants comme les autres, mais, en même temps, les lycéens, eux, peuvent être boursiers. Pourquoi donc ceux qui suivent la capacité en droit, jeunes ou personnes ayant choisi une reconversion professionnelle, ne peuvent-ils pas bénéficier d’aides ?
Le sujet reste entier, et la réponse que j’ai reçue ce matin n’est pas satisfaisante. J’espère, madame la secrétaire d’État, que votre gouvernement pensera, non seulement aux premiers de cordée, mais aussi à ceux qui peuvent réussir à monter !

La parole est à Mme Éliane Assassi, auteur de la question n° 318, transmise à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite interpeller le Gouvernement sur la situation de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis et, en particulier, sur les conditions de travail de ses agents.
Le gel des salaires depuis 2010 entraîne une précarisation accrue de ces agents, dont une grande partie perçoit la prime d’activité. Les départs en retraite non remplacés et la multiplication des contrats précaires, avec recours aux heures supplémentaires comme variable d’ajustement, creusent le manque d’effectifs et accentuent la détérioration des conditions de travail.
Les agents font aussi face à un management dont la boussole est la rentabilité. Des missions sont mutualisées et externalisées, au détriment de la qualité du traitement des dossiers et du service rendu aux usagers. Ainsi, la paie des agents de Seine-Saint-Denis est traitée à Paris, tandis que des traitements de données sont confiés à des entreprises privées.
Malgré l’augmentation des charges de travail et la complexité accrue de la législation, les agents n’ont aucune reconnaissance de leur métier. Par ailleurs, les fermetures de locaux contraignent les agents, mais aussi les familles, à se déplacer régulièrement, aux dépens d’un service de proximité.
Les conventions d’objectifs et de gestion se succèdent, toujours plus drastiques. Les organismes sont de plus en plus sous tension dans l’ensemble des branches, particulièrement en Seine-Saint-Denis, où, de ce fait, de nombreuses familles ne peuvent être accompagnées.
Madame la secrétaire d’État, à quelques jours de la présentation d’un rapport de deux députés pointant que, en Seine-Saint-Denis, il y a moins de tout, le Gouvernement va-t-il prendre les mesures qui s’imposent pour que les caisses d’allocations familiales puissent accomplir au mieux leurs missions ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame Assassi, je réponds à votre question en lieu et place de ma collègue ministre des solidarités et de la santé, qui ne peut être ici ce matin.
La caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, au regard de l’augmentation du nombre de bénéficiaires, est victime d’un allongement des délais de traitement des dossiers. Je rappelle toutefois que la Caisse nationale des allocations familiales lui a alloué ces dernières années des moyens importants pour lui permettre d’assurer pleinement ses missions compte tenu de ses spécificités. D’importants travaux ont également été réalisés.
Madame la sénatrice, le Gouvernement a entrepris une réflexion sur la simplification des démarches administratives, ainsi que sur l’ouverture nocturne dans les zones urbaines et l’ouverture sur rendez-vous, afin de répondre encore et toujours mieux aux contraintes des bénéficiaires.
Comme vous pouvez le constater, nous nous engageons pour améliorer notre service public. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sera l’occasion pour Mme la ministre des solidarités et de la santé d’avancer plus loin encore dans la voie de la simplification.

Madame la secrétaire d’État, vous avez commencé par constater, comme nous, que la situation de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis n’était pas bonne, et que cette administration se portait mal. Aussi ai-je pensé que vous alliez peut-être apporter des réponses concrètes à ses agents, dont plusieurs sont présents ce matin dans les tribunes !
Imaginez qu’il y a en moyenne onze semaines de retard dans le traitement des dossiers ! La paie même des agents est affectée par des retards importants, et des entretiens d’embauche sont réalisés – tenez-vous bien ! – dans les locaux de la cantine. Oui, à la cantine, et pas dans les bureaux ! C’est tout de même un peu méprisant pour les personnes qui veulent travailler à la CAF…
À cette situation, vous n’apportez aucune réponse concrète. Vous renvoyez au projet de loi de financement de la sécurité sociale de la fin de l’année, mais il y a urgence !
Les agents sont en souffrance, les familles bénéficiaires aussi, et que proposez-vous ? Des heures d’ouverture nocturnes ! Pourquoi pas le dimanche ? Vous rendez-vous compte de ce que vous proposez ? C’est méprisant, madame la secrétaire d’État, pour les agents et pour les populations de Seine-Saint-Denis.
Pour notre part, nous ne nous résignerons jamais, jamais ! Nous créerons les conditions pour que la Seine-Saint-Denis ne soit pas sacrifiée sur l’autel de la finance, comme le montre le rapport qui sera présenté à l’Assemblée nationale le 31 mai, un rapport qui fera beaucoup de bruit !

La parole est à Mme Françoise Laborde, auteur de la question n° 291, transmise à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question a trait aux menaces sur la santé publique et aux problématiques suscitées par la dangerosité des terrains de sport synthétiques.
Depuis le mois de novembre, les médias se font l’écho de risques sérieux pour la santé des usagers de ces gazons artificiels. Des milliers de stades, qui appartiennent le plus souvent aux communes, sont couverts d’une très grande quantité de granulats issus du recyclage de pneus broyés. Ces substances seraient, selon plusieurs études récentes, fortement nocives à la fois pour la santé, du fait de la présence de composés hautement cancérogènes, et pour l’environnement.
Des solutions existent, telles que l’aspiration des billes et le remplacement par des matériaux naturels, ou encore l’encapsulement par résine, mais elles présentent un coût élevé.
En outre, de nombreux terrains sont en commande ou en cours d’installation, et le simple report envisagé par certains élus entraîne lui aussi des frais colossaux.
Interpellée par plusieurs parlementaires, Mme la ministre des sports a répondu en des termes ambigus, pointant à la fois des études rassurantes et des incertitudes, avec pour conséquence la saisine par six ministères de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. L’ANSES devrait rendre très prochainement ses premiers résultats.
Selon les données invoquées, qui ont d’ailleurs été très largement contredites, les risques pour la santé seraient négligeables, du fait d’un seuil de toxicité en accord avec les normes européennes. Or c’est précisément le problème : comme l’ont souligné des chercheurs néerlandais, le règlement européen, bâti en fonction d’un usage normal des pneus automobiles, se révèle tout à fait inadapté s’agissant de ces granulats broyés. En effet, l’exposition aux matériaux toxiques et les sources de contact sont démultipliées pour les personnes : frottements, respiration des émanations, ingestion.
En vertu du principe de précaution, il ne faut pas, en présence d’un risque de dommages graves et irréversibles, que l’absence de certitude scientifique absolue serve de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives.
C’est pourquoi je demande au Gouvernement de mettre en place un fonds d’urgence à destination des collectivités territoriales, afin de les aider à engager des travaux de mise en sécurité de leurs équipements, à reporter leurs marchés publics dans l’attente des conclusions de l’ANSES et à communiquer sur les risques courus.

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice Françoise Laborde, je vous réponds en lieu et place de ma collègue ministre des solidarités et de la santé, qui s’excuse de ne pouvoir être présente ici ce matin.
Comme vous l’avez souligné, madame la sénatrice, les terrains synthétiques à usage sportif à base de caoutchouc se sont considérablement développés en France à partir des années quatre-vingt-dix. En novembre dernier, à la suite d’un article publié par le magazine So Foot, plusieurs médias se sont interrogés sur les conséquences potentielles de ce type de revêtements sur la santé des utilisateurs.
Ces terrains synthétiques soulèvent des interrogations quant à leurs effets sur la santé et l’environnement en raison de substances dangereuses potentiellement présentes dans des granulés, en particulier dans le cadre de leur utilisation comme terrain de sport ou aire de jeux pour enfants.
L’Agence européenne des produits chimiques, l’ECHA, a conclu à un faible niveau de préoccupation, au vu des concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. Il faut toutefois remarquer que les limites de concentration prévues par le règlement REACH ne sont pas spécifiques à un usage pour des terrains synthétiques, ce qui soulève, il est vrai, des incertitudes.
Face aux préoccupations des pratiquants et des communes, principaux propriétaires de terrains de grands jeux dans notre pays, les ministères de la transition écologique et solidaire, des solidarités et de la santé, de l’économie et des finances, du travail, de l’agriculture et de l’alimentation, et des sports, ont saisi l’ANSES le 21 février dernier.
Dans un premier temps, l’ANSES fera part de son analyse sur les données et études disponibles, ainsi que sur les préoccupations qui pourraient en résulter. La publication de ce premier travail est attendue pour la fin du mois de juin.
Dans un second temps, l’Agence devra compléter son analyse en identifiant et en hiérarchisant les besoins de connaissances supplémentaires qui pourraient justifier une évaluation des risques pour la santé et l’environnement à plus long terme.
Nous ne manquerons pas, madame la sénatrice, de vous communiquer les résultats de ces travaux.

Je vous remercie pour votre réponse, madame la secrétaire d’État, mais je me permets d’insister, parce que je ne voudrais pas que, dans quelques années, on nous accuse, on vous accuse, d’avoir laissé passer un risque sanitaire et environnemental majeur – cancers, asthme et autres pathologies respiratoires, mais aussi diffusion dans l’atmosphère – dont nous découvrirons sûrement rapidement les effets.
Je voudrais aussi que le soutien du Gouvernement aux élus soit sans faille, avec une aide financière, bien sûr, mais également s’agissant de la conduite à tenir. Vous le savez, chaque élu gère au mieux dans sa commune, selon son propre intérêt sur la question, mais aussi selon ses moyens financiers et les remontées des usagers – parents, professeurs, ou associations, de futsal, par exemple.
Enverrez-vous des instructions claires aux communes, en interdisant l’installation de nouveaux terrains à base de billes de pneus, comme l’ont fait la Suède ou deux grandes villes telles qu’Amsterdam et New York, qui appliquent le principe de précaution en attendant des normes plus sévères en la matière ?
Vous n’ignorez pas, madame la secrétaire d’État, qu’il faut des années pour changer la réglementation. Même si l’installation de ces terrains partait d’une bonne idée – le recyclage des pneus –, nous devons être très attentifs et, peut-être, stopper momentanément la filière, faute de disposer de toutes les études épidémiologiques.
Je vous remercie en tout cas d’avoir répondu à cette question transversale : dans la mesure où elle touche également votre secrétariat d’État, je suppose que vous y serez très attentive.

La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier, auteur de la question n° 279, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question concerne le moindre remboursement des consultations pour les patients se trouvant en zone sous-dotée et n’ayant plus, de ce fait, de médecin traitant.
Du fait du manque de médecins généralistes et des nombreux départs à la retraite, de plus en plus de patients se retrouvent aujourd’hui sans médecin traitant. Ils vivent cette situation subie avec d’autant plus d’inquiétude, voire d’angoisse, qu’ils sont vulnérables, malades, âgés ou isolés.
Quand enfin ils ont accès à un médecin, l’absence de médecin traitant déclaré ne leur permet plus d’être pris en charge à 70 % : pour une consultation de base, facturée vingt-cinq euros et habituellement prise en charge à 70 %, moins l’euro de solidarité, soit 16, 50 euros, seuls 6, 50 euros, soit 30 % du total, leur sont remboursés.
Ces patients subissent ainsi une double peine : absence de médecin traitant en mesure de suivre leur dossier de santé, et reste à charge plus élevé sur les consultations.
Ces situations préoccupantes constituent un frein, un frein de plus, à l’accès aux soins, notamment en zone rurale. Sont-elles bien appréhendées par les services du ministère de la santé ? Serait-il envisageable, en zone sous-dotée, que l’absence de médecin traitant n’entraîne pas systématiquement une diminution du remboursement des consultations ?

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice Loisier, je réponds à votre question en lieu et place de Mme la ministre des solidarités et de la santé, qui ne peut être présente ici ce matin.
Pour remédier aux difficultés que rencontrent nos concitoyens en matière d’accès aux soins, Agnès Buzyn a présenté l’année dernière le plan territorial d’accès aux soins, qui comporte vingt-six mesures issues du terrain. Ce plan s’appuie en effet sur les remontées des professionnels de santé, des collectivités territoriales et des usagers.
L’accès aux soins repose, non pas sur l’installation d’un médecin, mais sur l’organisation coordonnée de tous les professionnels de santé d’un territoire donné. C’est pourquoi nous travaillons actuellement sur la stratégie du système de santé.
Le plan comme la stratégie ont pour objectif d’augmenter le temps soignant des professionnels de santé ; ils généralisent la téléconsultation et la téléexpertise.
Mme Buzyn l’a toujours dit : ce plan sera amené à évoluer en fonction des besoins. Voilà pourquoi, à la suite des derniers chiffres de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques du ministère, la DREES, elle souhaite le compléter par de nouvelles mesures. Votre proposition est une demande forte et légitime des patients, qu’il faut étudier.
Pour remédier aux difficultés auxquelles font face nos concitoyens en matière d’accès aux soins, il n’y a pas de réponse miracle, mais un panel de solutions. Ces solutions, c’est ensemble que nous devons les trouver !

Nous sommes tous convaincus qu’il faut un panel de mesures. En particulier, un assouplissement des dispositifs existants est nécessaire pour les patients dont nous parlons, qui sont isolés et vivent des situations difficiles. Ils n’ont pas de médecin traitant, non pas parce qu’ils n’en cherchent pas, mais parce qu’ils ne peuvent plus accéder à un médecin de proximité : il est urgent de les aider !

La parole est à Mme Catherine Deroche, auteur de la question n° 286, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Ma question porte sur la place des infirmiers dans l’organisation de la vaccination.
Depuis plusieurs années, la loi permet aux infirmiers de revacciner l’ensemble de la population, afin d’élargir la couverture vaccinale. C’est ainsi que, depuis 2008, les infirmiers vaccinent sans prescription médicale préalable les personnes fragiles contre la grippe, à l’exception de la primo-vaccination. Cette mesure de santé publique est efficace : elle a augmenté le nombre de personnes vaccinées, ce qui a permis de réduire la mortalité due à la grippe dans la population fragile.
Toutefois, un décret du 29 août 2008 restreint les possibilités de vaccination des infirmiers à la grippe et aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, ainsi qu’aux personnes fragiles. L’entourage est exclu de cette possibilité de vaccination, ce qui limite la couverture vaccinale.
De nombreux rapports ont préconisé, pour assurer une couverture vaccinale large, une simplification de la vaccination en ville, notamment la possibilité pour les professionnels de santé autres que les médecins d’administrer des vaccins. Je pense en particulier au rapport public annuel de la Cour des comptes pour 2018 et au rapport du comité d’orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination.
Ma question est simple : le Gouvernement envisage-t-il d’élargir le droit de vaccination qui a été accordé aux infirmiers, sachant qu’ils sont plus de 600 000 professionnels et offrent donc un maillage territorial important ?
Nous avons soutenu la politique du Gouvernement en ce qui concerne l’extension de la couverture vaccinale. Il s’agit d’un sujet majeur. C’est pourquoi je souhaiterais savoir si vous comptez maintenir cette possibilité de vaccination en l’état.

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Madame la sénatrice Catherine Deroche, Mme la ministre des solidarités et de la santé partage votre préoccupation.
Je tiens en son nom à réaffirmer que la vaccination est un geste de prévention simple et efficace. Selon l’Organisation mondiale de la santé, elle permet d’éviter deux à trois millions de décès chaque année dans le monde pour les seules maladies de la diphtérie, du tétanos, de la coqueluche et de la rougeole.
Acteurs majeurs de la prévention et du soin, les infirmiers peuvent, sur prescription médicale, vacciner la population générale pour tous les vaccins. Depuis 2008, ils peuvent aussi vacciner sans prescription médicale – à l’exception des primovaccinés et des femmes enceintes – les personnes cibles de la vaccination antigrippale, à savoir les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans et les patients porteurs de pathologies chroniques comme les infections cardio-pulmonaires, le diabète ou l’obésité.
Nous dressons un bilan positif de cette possibilité offerte aux infirmiers. Compte tenu des résultats encourageants enregistrés, Agnès Buzyn a souhaité conduire une réflexion sur l’élargissement des compétences des infirmiers en matière de vaccination, afin de simplifier et d’améliorer le parcours vaccinal d’un plus grand nombre de personnes. Aussi a-t-elle adressé à la commission technique des vaccinations de la HAS, la Haute Autorité de santé, une saisine relative à l’élargissement des compétences des infirmiers et des pharmaciens en matière de vaccination.
Une consultation des ordres des professions médicales sera aussi menée sur le sujet pour aboutir à des propositions concrètes et rapides.

Je vous remercie pour ces précisions, madame la secrétaire d’État.
Il s’agit d’un sujet important : c’est donc une bonne chose que des consultations soient conduites avec les ordres professionnels.
En 2016, la loi de modernisation de notre système de santé a notamment étendu aux sages-femmes la possibilité de vacciner l’entourage et la famille des nouveau-nés au cours de la période postnatale. On verra bien ce que donneront les discussions que vous avez évoquées, mais il s’agit en tout cas, je le répète, d’un sujet important.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, auteur de la question n° 356, adressée à Mme la ministre des solidarités et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question, qui s’adresse en effet à Mme la ministre des solidarités et de la santé, concerne la situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD.
C’est un sujet sur lequel Mme la ministre s’est exprimée à deux reprises au Sénat en mars et avril derniers. Je l’ai écoutée à chaque fois avec un grand intérêt.
Permettez-moi cependant, madame la secrétaire d’État, de vous interroger à nouveau sur la politique du Gouvernement dans ce domaine, tant il est vrai qu’il s’agit d’une question de la plus haute importance pour nous tous.
La France vieillit. Pour autant, et contre toute attente, la politique de santé publique menée dans notre pays en direction des personnes âgées est quelque peu défaillante. Elle continue notamment à prendre insuffisamment en compte toutes les prévisions démographiques faisant systématiquement état d’un allongement de la durée de vie dans l’Hexagone.
Aussi, et en dépit d’avancées certaines portées par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, la situation est aujourd’hui particulièrement préoccupante. Le nombre trop réduit d’établissements spécialisés en gériatrie en atteste. Qui plus est, ces établissements sont inégalement répartis sur l’ensemble du territoire, tant en zone urbaine qu’en zone rurale.
En Moselle, plus précisément, les EHPAD font presque partout cruellement défaut et souffrent d’un taux d’encadrement des personnes hébergées insuffisant. En outre, les salariés dénoncent régulièrement la pénibilité de leur travail et l’usure professionnelle. Ils demandent que l’organisation des soins soit revisitée, afin de pouvoir mener à bien leur mission.
Il n’en demeure pas moins que ces établissements sont littéralement pris d’assaut. C’est notamment le cas des établissements implantés dans le Nord lorrain, dont certains disposent d’une unité Alzheimer. Malheureusement, leur capacité d’accueil est limitée : toutes leurs chambres sont aujourd’hui occupées.
Ouvrir un nouvel établissement serait naturellement la solution idéale. Or, du point de vue financier, la création d’un EHPAD représente un investissement important, même dans le cadre d’un partenariat public-privé. Ainsi, l’ouverture d’un nouvel établissement est à l’étude – et toujours seulement à l’étude – à Ars-sur-Moselle, commune qui attend depuis plusieurs années maintenant la construction d’un EHPAD.
Cette situation n’étant pas spécifique à la Moselle, pourriez-vous m’indiquer, madame la secrétaire d’État, quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour pallier le manque dramatique d’établissements spécialisés de ce type ? Ils sont très attendus par de nombreuses communes, comme celle d’Ars-sur-Moselle, qui commence à trouver l’attente trop longue.

La parole est à Mme la secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire.
Monsieur le sénateur Mizzon, je vous réponds en lieu et place de Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Nous sommes face à un véritable enjeu de société. Vous avez raison, nous devons changer en profondeur le modèle des EHPAD en tirant le meilleur parti de ce qui se fait déjà dans les territoires. L’augmentation du nombre de places d’hébergement temporaire est également nécessaire, et nous devons mieux les valoriser financièrement.
L’une des priorités de Mme Buzyn sera de valoriser les personnes qui travaillent auprès des personnes âgées, notamment en orientant les nouveaux contrats parcours emploi compétences vers les EHPAD. Dans la mesure du possible, il faut améliorer le taux d’encadrement dans les établissements, en particulier autour de la dépendance et des soins.
Concernant les démarches pour l’ouverture d’un EHPAD, monsieur le sénateur, vous savez qu’elles sont extrêmement longues. Le lancement d’un établissement de ce type doit répondre à un appel à projets auquel est associé un cahier des charges.
Concrètement, oui, un projet d’EHPAD est prévu dans la commune d’Ars-sur-Moselle. L’Agence régionale de santé Grand Est se tient bien sûr à votre disposition pour travailler et évoquer ce dossier avec vous.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État, même si elle ne me donne pas entièrement satisfaction.
Notre département a un premier problème à régler : le taux d’équipement y est inférieur à la moyenne nationale. Si cette moyenne était atteinte, nous pourrions ouvrir quelque 450 lits.
Notre deuxième problème touche à l’évolution du profil des personnes âgées. Ces dernières présentent un état de santé de plus en plus compliqué à soigner. Or les dotations en soins ne suivent pas, ce qui engendre un manque de personnel et, d’une certaine manière, une forme de maltraitance.
Enfin, le troisième et dernier problème que je souhaitais évoquer concerne le reste à charge, qui est de plus en plus élevé, alors que les départements sont en extrême difficulté et que les familles ne sont pas toujours capables de le supporter.

Mes chers collègues, madame la secrétaire d’État, nous avons si bien rattrapé le retard pris qu’il nous faut interrompre quelques instants nos travaux pour permettre à Mme la garde des sceaux de gagner l’hémicycle.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures dix, est reprise à onze heures quinze.

La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 285, adressée à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice.

Madame la ministre, en tant qu’élue des Français établis hors de France, je suis très souvent sollicitée pour résoudre des difficultés rencontrées dans le cadre de démarches d’obtention d’un certificat de nationalité française.
Je dois souvent expliquer l’inexplicable aux demandeurs qui m’interrogent sur les délais de procédure. Le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, qui souffre d’un sous-effectif depuis trop longtemps, prévoit des délais moyens de traitement des dossiers d’environ trente-six mois.
En 2014 déjà, des mesures d’urgence avaient été mises en place, et des renforts temporaires accordés. Malgré cela, le retard accumulé n’a manifestement pas été absorbé, puisqu’il faut compter en moyenne trois ans de procédure, au lieu de deux ans.
Cette situation n’est pas acceptable : imaginez la détresse de la personne que l’on informe du temps moyen qu’il faut attendre pour faire reconnaître la nationalité française de son enfant et pouvoir le faire venir en France !
Face à une situation qui ne fait qu’empirer, les usagers du service de la nationalité sont de plus en plus nombreux à nous saisir, mes collègues et moi-même, pour nous faire part de leur inquiétude et même, parfois, de leur détresse.
Par ailleurs, il est prévu que ce service déménage pour s’installer dans les nouveaux locaux du tribunal de grande instance de Paris, ce qui sera positif à moyen terme pour les conditions de travail du personnel, mais risque à court terme de le perturber et, donc, d’allonger encore les délais de procédure.
Ma question est la suivante : des mesures d’urgence comme des mesures pérennes vont-elles être mises en place afin de garantir un réel service public de la justice ? Si oui, lesquelles et, surtout, quand ?
Madame la sénatrice Claudine Lepage, plus de 65 000 demandes de délivrance de certificats de nationalité sont enregistrées chaque année dans les tribunaux d’instance. Près d’un tiers des certificats sont délivrés à Paris.
Les délais de délivrance que vous avez relevés, et qui sont effectivement très longs, ont deux explications principales : d’une part, la complexité de l’analyse, qui doit être menée au cas par cas, et, d’autre part, le fait que différents acteurs sont appelés à authentifier le processus de délivrance. Je souhaite revenir sur ces deux éléments qui sont très importants.
Chaque situation est unique ; en effet, pour des questions de sécurité de l’état civil, les textes qui s’appliquent en matière de nationalité ne sont pas rétroactifs. Le texte applicable est donc celui qui était en vigueur lors de la minorité du demandeur.
En ce sens, et en fonction de la date de la demande, un droit très ancien peut trouver à s’appliquer, auquel cas il faut parfois remonter toute une chaîne d’ascendants pour trouver l’ascendant français transmettant sa nationalité et, donc, le droit qui s’applique.
En outre, pour les personnes originaires de territoires devenus indépendants, il faut vérifier les conditions de conservation et de perte de la nationalité française qui ont été fixées par les traités signés lors des indépendances, ce qui peut parfois prendre un certain temps.
Par ailleurs, au sens de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité repose sur celui qui s’en prévaut. Il appartient donc au demandeur de réunir et de déposer les pièces qui sont liées à sa demande. Chaque situation étant unique, je le répète, le requérant se voit par conséquent chargé d’établir une liste de pièces personnalisée. Dès lors que le requérant constitue son propre dossier, il peut omettre de transmettre un certain nombre d’éléments, si bien que le délai de délivrance ne dépend pas toujours des services chargés de la nationalité ou n’est pas toujours maîtrisé par eux.
Les actes d’état civil étrangers qui sont nécessaires au traitement de la demande doivent de surcroît être authentifiés. Ces opérations d’authentification, qui sont conduites sous l’égide du ministère des affaires étrangères – elles ne dépendent donc pas du ministère de la justice – et qui impliquent des vérifications sur place, peuvent également prendre du temps. Comme vous le savez, l’accès à ces actes est plus ou moins difficile selon leur lieu d’établissement, en raison de la géographie ou des conditions de sécurité en vigueur dans le pays.
J’ajoute que certaines erreurs relevées peuvent également faire l’objet de jugements de rectification des actes demandés. Cependant, les preuves doivent être délivrées par l’autorité étrangère compétente et être complétées par la transmission d’un nouvel acte qui porte la mention de la rectification dudit jugement, ce qui explique que les délais puissent être longs.
Le délai moyen de délivrance des certificats de nationalité française masque en fait une réalité très contrastée : certains peuvent être délivrés très rapidement, alors que d’autres, pour les raisons que je viens d’évoquer, le sont dans de très longs délais.
Outre la complexité des demandes et leur nombre, le délai de délivrance résulte également de difficultés qui peuvent être liées à un certain manque d’effectifs dans les juridictions. Cette situation va s’améliorer au cours de l’année 2018 grâce à la diminution significative des vacances d’emplois qui résultera de l’arrivée de plus de mille directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers, en cours de scolarité, arrivée qui profitera à l’ensemble des juridictions.
Enfin, vous l’avez vous-même rappelé, la création du tribunal d’instance de Paris et la fusion des tribunaux d’instance d’arrondissement, au mois de juin 2018, ainsi que la mise en place d’un pôle de la nationalité aux effectifs adaptés au traitement de ces demandes, contribueront à l’amélioration de la situation en matière de demandes de certificats de nationalité.

Je vous remercie, madame la garde des sceaux, tout en vous rappelant que le temps qui vous est imparti est de deux minutes et trente secondes.

Madame la ministre, je vous remercie de ces précisions.
Pour avoir visité le service de la nationalité, rue du Château-des-Rentiers, à Paris, et pour avoir parlé à son directeur, je suis bien consciente de la complexité des procédures.
Vous l’avez mentionné, le sous-effectif et le turn-over très importants dans ce service sont l’une des principales causes du problème. En effet, les greffiers en place n’y restent pas très longtemps, compte tenu de la charge de travail. Il faut à chaque fois former de nouveaux greffiers, ce qui ralentit encore le processus.
Cela étant, madame la ministre, vous nous apportez comme une lueur d’espoir. Si j’ai bien compris vos propos, à partir de l’année prochaine, on pourrait noter une amélioration grâce à l’arrivée d’un nombre important de greffiers, actuellement en formation.
Néanmoins, je le répète, les procédures suivies par le service de la nationalité sont quelque peu différentes, si bien que les greffiers qui y travaillent doivent bénéficier d’une formation supplémentaire. Ils ont en outre tendance à ne jamais rester très longtemps en poste à cause de la charge de travail inhérente à leur mission.

La parole est à M. Jean Louis Masson, auteur de la question n° 351, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame le ministre, les différentes modifications législatives intervenues l’an dernier en matière de gestion et de contrôle des partis politiques sont très importantes.
Certains aspects de la législation ont connu des transformations absolument radicales. Évidemment, cette situation pose un certain nombre de questions. Il est donc nécessaire d’apporter une clarification sur les modalités pratiques d’application de cette loi.
La situation est actuellement très obscure. Malheureusement, il est difficile d’obtenir des réponses précises, aussi bien de la part de l’administration que de la part de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP. Les questions écrites adressées au ministre de l’intérieur se heurtent quant à elles à une absence de réponse. Or, quand on n’en reçoit pas, on n’a malheureusement d’autre choix que d’attendre : cela peut durer un an, deux ans, voire beaucoup plus longtemps !
Nous nous heurtons véritablement à des réponses évasives, dilatoires, et qui, bien souvent, ne font qu’indiquer qu’il faut attendre que l’ordre des commissaires aux comptes ait publié un guide de comptabilité. Or la parution de ce guide n’est pas prévue avant la fin de l’année 2018, voire le début de l’année 2019. Pire, rien ne dit que ce guide éclaircira tous les points obscurs de la loi.
En attendant, la loi s’applique à compter du 1er janvier 2018, ce qui crée à l’évidence un vide juridique tout à fait inacceptable.
Madame le ministre, ne pensez-vous pas que l’administration, la CNCCFP, voire le ministre de l’intérieur quand on l’interroge, devraient fournir des réponses précises aux questions qui leur sont posées au sujet des modalités d’application d’une loi adoptée il y a un an ? En l’état actuel des choses, il n’est pas possible d’attendre le début de 2019 pour savoir comment les partis politiques doivent être gérés en 2018 !
Monsieur le sénateur Masson, comme chaque année, la CNCCFP a rappelé, par une lettre en date du 13 avril 2018 envoyée à l’ensemble des formations politiques concernées, la définition du périmètre des comptes d’ensemble des partis au regard de l’article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
Il y est indiqué que « les comptes remis au(x) commissaire(s) aux comptes sont des “ comptes d’ensemble ” constitués », entre autres, « des comptes des entités dans lesquelles le parti exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ». La CNCCFP précise que, pour déterminer l’existence d’un pouvoir prépondérant, elle a recours à la technique du faisceau d’indices développée par le juge financier et le juge administratif à l’encontre des associations dites « transparentes » ou para-administratives.
Ainsi, la CNCCFP examine si le parti politique est à l’initiative de la création de l’entité, en contrôle l’organisation et le fonctionnement, et lui procure l’essentiel de ses ressources. Dans l’affirmative, elle estime, sous le contrôle du juge, que les comptes de l’entité doivent être consolidés dans les comptes d’ensemble du parti.
Dans ce contexte, et pour déterminer l’existence d’un pouvoir prépondérant, l’aide financière attribuée par un parti politique à un tiers ayant ou non un objet politique, relevant ou non de la loi du 11 mars 1988, sera analysée pour les comptes de l’exercice 2017 au regard de ces différents critères, et non au seul regard de la dépendance financière de l’un envers l’autre.
Enfin, en application du décret du 28 décembre 2017 pris pour l’application de la loi pour la confiance dans la vie politique, le périmètre des comptes d’ensemble des partis pour les exercices ouverts après le 31 décembre 2017 devra inclure les comptes des organisations territoriales affiliées au parti, avec son accord ou à sa demande, ou qui ont participé localement, au cours de l’année considérée, à son activité ou au financement d’une campagne.
À cet égard, conformément aux nouvelles dispositions introduites par la loi précitée, l’Autorité des normes comptables doit établir un projet de règlement dont la version définitive devra être homologuée in fine par le ministre de l’économie et des finances avant la fin de l’année 2018.

Madame le ministre, je suis tout de même un peu surpris de votre réponse !
Alors que la loi a subi tout un tas de modifications, on nous laisse aujourd’hui dans l’incertitude la plus absolue quant à la façon dont les partis politiques doivent être gérés en 2018 !
Vous me répondez qu’à la fin de l’année ou, éventuellement, au début de l’année suivante, on nous expliquera comment il fallait gérer les partis politiques en 2018. Ce n’est pas sérieux, madame le ministre !
Vous venez vous-même de dire qu’il y a deux mois la CNCCFP a publié un récapitulatif – je l’ai lu, d’ailleurs – relatif aux comptes des partis de 2017.
Mais où sommes-nous, madame le ministre ? On publie au début de l’année 2018 un récapitulatif expliquant comment les partis politiques devaient être gérés en 2017 ! Et là, on va publier, à la fin de l’année 2018 ou au début de l’année 2019, une note sur la manière dont les partis doivent être gérés en 2018. C’est invraisemblable ! Ce n’est vraiment pas sérieux !
La moindre des choses, c’est d’être capable de répondre aux questions concernant les nouvelles modalités qui s’appliquent à la gestion des partis politiques en 2018. Il faut que ce vide permanent cesse !
Tout cela est incroyable ! C’est un peu comme si l’on adoptait un texte pénal – puisque vous êtes garde des sceaux – tout en annonçant à nos concitoyens qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent, et qu’on leur indiquera dans un an si ce qu’ils ont fait était légal ! C’est vraiment de la rigolade !

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la question n° 280, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la garde des sceaux, lorsqu’un deuil survient, les membres de la famille sont éprouvés et, par conséquent, vulnérables.
Ils doivent à cette occasion prendre un grand nombre de décisions en moins de vingt-quatre heures. C’est pourquoi la transparence quant au coût des différentes prestations liées aux obsèques est absolument fondamentale.
Je me bats sur ce sujet depuis de très nombreuses années. Grâce à la loi du 19 décembre 2008, qui est très importante, nous avons enfin obtenu que les entreprises habilitées déposent obligatoirement un devis modèle chaque année dans les communes de plus de 5 000 habitants ou dans celles au sein desquelles elles ont un établissement.
Le ministère de l’intérieur a publié un arrêté en 2010, modifié en 2011, qui fixe les prestations devant figurer dans ce devis modèle. Toutes les entreprises ont donc l’obligation de répondre aux communes et d’indiquer chaque année, en toute transparence, en toute clarté, les prix qu’elles pratiquent pour chaque prestation inscrite dans ce devis, étant bien entendu qu’elles peuvent proposer d’autres prestations, cette faculté ne posant aucun problème.
Or il se trouve que la fédération Familles rurales a mené une enquête, démontrant que cette législation est appliquée par 40 %, seulement, des entreprises. L’UFC-Que Choisir a aussi travaillé sur la question et parvient à un chiffre encore moins élevé.
Il y a donc un véritable problème au niveau de l’application de la loi.
Madame la garde des sceaux, un seul lobby me pousse à intervenir sur le sujet : les familles, éprouvées et, donc, vulnérables. Les entreprises habilitées doivent toutes appliquer la loi et les maires, en vertu de cette même loi, doivent rendre publics tous les devis modèles, en particulier via le site internet de la commune. Il s’agit de permettre aux familles d’avoir des informations comparables, en toute clarté et de manière extrêmement rapide.
Quelles dispositions pensez-vous pouvoir prendre afin que la loi s’applique pleinement ?
Monsieur le sénateur Jean-Pierre Sueur, vous évoquez un sujet important, qui nous concerne évidemment tous. Les familles venant de perdre un être cher sont malheureusement amenées à prendre des décisions importantes, dans un temps extrêmement contraint et à un moment particulièrement difficile.
Votre proposition de loi, devenue la loi du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, a incontestablement constitué une avancée très importante. Elle a notamment instauré, vous l’indiquiez, un modèle de devis pour les prestations funéraires.
L’arrêté du 23 août 2010 portant définition du modèle de devis applicable aux prestations fournies par les opérateurs funéraires, qui a été modifié par l’arrêté du 3 août 2011, est ensuite venu définir une terminologie commune, permettant de faciliter la comparaison des tarifs pratiqués par les différentes entreprises de pompes funèbres. Ce modèle de devis est en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et il a permis aux familles d’organiser les obsèques de leurs proches dans une plus grande transparence des prix et des pratiques commerciales.
Vous avez également mentionné une enquête publiée par l’association Familles rurales le 1er novembre 2017, selon laquelle 4 entreprises habilitées sur 10, seulement, respectent cette obligation. Comme vous, je ne peux que déplorer ce résultat.
La situation décrite par cette enquête ne peut pas perdurer. L’application de la loi doit devenir effective sur l’ensemble du territoire.
Dans ces conditions, le Gouvernement va travailler à renforcer le dispositif de contrôle du respect de cette obligation, ainsi que le dispositif de sanctions en cas de manquement.
Ces devis étant consultés selon les modalités définies dans chaque commune par le maire, j’ai également souhaité que les représentants des collectivités siégeant au sein du Conseil national des opérations funéraires soient à nouveau sensibilisés sur l’importance de l’application de ces dispositions et qu’ils veillent à faciliter cette mise en œuvre. Ce sera fait dans les prochaines semaines.
Je ne manquerai pas, monsieur le sénateur, de vous tenir informé de l’avancée de ce travail.

Je vous remercie, madame la garde des sceaux, pour les précisions que vous avez bien voulu m’apporter.
J’ajouterai simplement une double remarque.
S’agissant des maires, il va de soi que la loi doit être appliquée et ce n’est pas un effort exorbitant que de veiller, dans chaque commune, chaque année, à ce que les opérateurs agréés ou habilités fournissent leurs devis modèles et que ceux-ci soient diffusés sur le site internet de ladite commune. Une telle disposition n’est pas difficile à mettre en œuvre ; il faut juste bien sensibiliser les élus.
Concernant les entreprises, j’ai toujours insisté auprès des représentants des fédérations d’entreprises du secteur, que je connais bien, sur l’intérêt qu’il y avait à jouer le jeu de la transparence, sur les prix et sur les prestations. C’est vraiment une preuve de respect, la garantie d’un bon rapport avec les familles et d’une bonne réputation auprès d’elles.
D’ailleurs, madame la garde des sceaux, si une entreprise ne respecte pas la loi en matière de devis modèle, il serait naturel que les préfets – et à cet égard, le ministère de l’intérieur peut donner des instructions – retirent ou suspendent l’habilitation. Je vous assure qu’une telle mesure, très simple, aurait des effets très concrets.

La parole est à M. Jean-Claude Carle, auteur de la question n° 352, transmise à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la ministre, je souhaite appeler votre attention sur les conséquences de la contractualisation entre les collectivités territoriales et l’État.
La loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 dispose que « les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique ».
Sur le fondement de ce texte, le Gouvernement propose aux collectivités une contractualisation visant à encadrer leurs dépenses de fonctionnement, avec une marge de progression très serrée.
La loi précise en effet que l’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités et de leurs groupements à fiscalité propre correspond à un taux de croissance annuel de 1, 2 %, appliqué à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constant, sur les cinq années concernées.
Pour le conseil départemental de la Haute-Savoie, ce cadrage laisse une marge de 7 millions d’euros de dépenses de fonctionnement pour chaque année.
Or notre département connaît, depuis deux décennies, une progression démographique particulièrement forte, de l’ordre de 1, 2 %. Plus précisément, ce sont 10 000 habitants supplémentaires que nous accueillons chaque année. Cette hausse engendre mécaniquement des besoins nouveaux significatifs en matière d’accompagnement des usagers sur les compétences départementales – collèges, action sociale, etc.
De plus, je tiens à souligner un point important : la seule prise en charge des mineurs non accompagnés, les MNA, absorbe annuellement une enveloppe de 4 millions d’euros.
Ainsi, l’objectif d’encadrement des dépenses de fonctionnement proposé par le Gouvernement apparaît strictement impossible à atteindre, et ce alors même que le département se montre, depuis plus d’une décennie, exemplaire dans la gestion de ses finances. À titre d’exemple, il respecte un ratio entre le nombre de fonctionnaires territoriaux et la population très inférieur à la moyenne nationale et s’attache à parvenir à un taux d’endettement parmi les plus faibles de France.
En matière de maîtrise des dépenses, un effort considérable a été demandé aux collectivités depuis quelques années, de nouveaux transferts de compétences et de nouvelles charges, pour la plupart non compensées, venant s’ajouter à la baisse des dotations.
En conclusion, alors que le département de la Haute-Savoie atteint pleinement les objectifs de désendettement affichés comme prioritaires par le Gouvernement, il se trouve durement pénalisé par l’exigence qui est lui est faite de financer un volet de la politique migratoire.
Il est nécessaire, à mon sens, de prendre en compte de telles situations et de prévoir des dispositions dérogatoires pour les collectivités, dont le nombre est d’ailleurs limité, qui y sont confrontées.
Je vous demande donc, madame la ministre, de bien vouloir m’indiquer les mesures que le Gouvernement envisage de mettre en œuvre à cette fin.
Monsieur le sénateur Carle, vous appelez mon attention sur le dispositif des contrats de maîtrise de la dépense entre l’État et les collectivités, représentant les deux tiers de la dépense publique locale.
Ce dispositif constitue un axe majeur de la nouvelle relation de confiance que le Gouvernement souhaite établir avec les collectivités, notamment avec les départements. C’est bien dans cet état d’esprit qu’il a été conçu, aux termes d’échanges nourris avec les représentations d’élus. Ces discussions ont permis d’aboutir à un mécanisme prenant en compte les spécificités de chacune des collectivités concernées.
À ce titre, personne ne peut nier que, comme vous le faites remarquer, une augmentation de la population engendre des charges supplémentaires.
L’article 29 de la loi de programmation mentionnée par vos soins permet de tenir compte de ce phénomène. Il ouvre en effet la possibilité d’une modulation à la hausse du taux d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement figurant dans le contrat d’au plus 0, 15 point pour les collectivités connaissant une progression démographique marquée.
Le département dont vous êtes l’élu est bien éligible à cette modulation, sa population ayant augmenté, en moyenne, de près de 1, 5 % entre 2013 et 2018.
Vous mentionnez par ailleurs la problématique des MNA pris en charge par les conseils départementaux au titre de l’aide sociale à l’enfance. Vous le savez, le Gouvernement est pleinement conscient de l’acuité de ce phénomène et des dépenses qu’il peut entraîner. Des négociations ont eu lieu avec l’Assemblée des départements de France et une solution, je crois, est en train d’être trouvée, portant sur la reprise par l’État du dispositif d’évaluation et sur une participation au niveau du dispositif de prise en charge post-évaluation.
Nous sommes évidemment sensibles aux efforts que les départements doivent continuer d’accomplir dans ce domaine. C’est pour cette raison qu’une négociation a été engagée avec les représentants des départements, en vue d’un accord global sur le financement des allocations individuelles de solidarité, les mesures financières supplémentaires pour les MNA et sur l’application qui peut en être faite en cas d’augmentation de ces dépenses dans les contrats.
Je souhaite enfin vous rappeler que les contrats ne se résument pas à la fixation d’un objectif d’évolution des dépenses de fonctionnement. Les échanges avec le préfet sur l’amélioration du besoin de financement permettront de mettre en lumière les engagements de votre département en matière de bonne gestion de ses finances, de même que des éléments d’explication d’ordre qualitatif – les élus locaux peuvent, s’ils le souhaitent, en faire figurer dans ces mêmes contrats.

Je voudrais vous remercier, madame la ministre, pour les précisions que vous avez bien voulu m’apporter. Je pense notamment au rappel de la modulation à la hausse figurant à l’article 29 et au fait que le département de la Haute-Savoie y est éligible.
Par ailleurs, la prise en charge des mineurs isolés représente effectivement une dépense importante pour notre département, du fait de sa situation géographique. Si j’ai bien compris, la négociation est engagée sur ce sujet précis.
Madame la ministre, je suis conscient, comme l’ensemble des élus, de l’effort qui doit être réalisé par les collectivités pour réduire la dette publique, une dette colossale puisqu’elle s’élève à 2 200 milliards d’euros.
Mais sur ce total, 2 000 milliards d’euros sont imputables à l’État et 200 milliards d’euros – seulement, si j’ose dire – aux collectivités. En outre, la nature même de ces montants n’est pas la même : vous le savez comme moi, madame la ministre, la dette de l’État est une dette de fonctionnement, de voilure, tandis que celle des collectivités territoriales est essentiellement liée à leurs investissements.
En étant trop « drastique », allais-je dire, il ne faudrait pas pénaliser ces investissements et, parce que les investissements préparent l’avenir, pénaliser des départements comme celui de la Haute-Savoie, pourtant exemplaire, je l’ai dit, en termes de gestion des finances locales.

La parole est à M. Didier Rambaud, auteur de la question n° 322, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Ma question concerne l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales, posant le principe d’une répartition des charges de tenue de l’état civil au profit d’une commune qui accueille sur son territoire un établissement de santé pourvu d’une maternité.
Selon cet article, introduit dans la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite NOTRe, par mon collègue député de l’Isère Olivier Véran, les communes dont les habitants ont accouché ou sont décédés dans un établissement situé hors du territoire communal contribuent aux charges de tenue de l’état civil de la commune siège dudit établissement, selon trois critères de seuil. Sont pris en compte dans ce cadre la taille de la commune accueillant l’établissement, le rapport entre le nombre de naissances dans l’établissement et la population de la commune qui l’accueille et, enfin, le nombre de décès ou de naissances imputables, si je puis dire, aux habitants des communes appelées à contribuer aux charges.
Ce dernier critère pose aujourd’hui problème. En effet, la contribution d’une commune est déclenchée à partir d’un seuil, pour une année, de 1 % des naissances ou des décès dans l’établissement concerné.
Après deux ans de mise en œuvre, ce seuil apparaît trop élevé et constitue un obstacle à une juste répartition, permettant à de nombreuses collectivités d’échapper à ce qui devrait apparaître comme une légitime contribution. La commune d’accueil du centre hospitalier supporte ainsi, de fait, une charge très largement supérieure à celle qui devrait être la sienne, eu égard au nombre de ses propres habitants nés ou décédés dans l’établissement de santé.
À titre d’exemple, dans mon département, la commune de La Tronche – 6 900 habitants – accueille le centre hospitalier universitaire de Grenoble. En 2016, près de 3 000 enfants y sont nés et 2 000 personnes y sont décédées. La mairie traite plus de 54 000 actes par an, maintient un service composé de 9 agents, pour une charge budgétaire représentant près de 350 000 euros. Si La Tronche ne devait supporter que les actes induits par les naissances et décès de ses propres habitants, sa charge budgétaire s’élèverait à 6 588 euros !
La commune n’est pas seule dans ce cas. Rien qu’en région Auvergne-Rhône-Alpes, mes collègues de la Loire, avec Saint-Priest-en-Jarez, du Rhône, avec Pierre-Bénite, ou encore de Haute-Savoie, avec Metz-Tessy, pourraient sans doute en témoigner.
Il apparaît dès lors qu’une fixation de ce seuil à 0, 1 %, plutôt qu’à 1 %, permettrait une répartition beaucoup plus équitable.
Madame la garde des sceaux, de quelle manière le Gouvernement pourrait-il envisager une modification de cette répartition des charges, par exemple par une réduction du seuil contenu dans l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales ?
Monsieur le sénateur Rambaud, vous évoquez la charge importante que représentent les dépenses d’état civil pour les communes qui sont le siège d’un établissement de santé accueillant un public en provenance de l’extérieur. Vous jugez insuffisante la contribution financière des communes extérieures concernées, fixée par l’article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales.
Cette contribution a été créée par la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
Elle s’appliquait initialement selon les trois critères de seuil suivants : la différence entre le nombre de naissances comptabilisées au sein de l’établissement et la population d’implantation devait dépasser 40 % ; la commune dans laquelle se situait l’établissement devait compter moins de 3 500 habitants ; la contribution financière s’appliquait seulement aux communes dont les habitants représentaient au moins 10 % des naissances ou des décès constatés dans l’établissement.
L’intention du législateur était donc de répondre aux situations exceptionnelles de petites communes situées à proximité de grandes villes et accueillant de grands hôpitaux.
La loi NOTRe a étendu ce dispositif, pour prendre en compte la hausse des charges d’état civil d’un plus grand nombre de petites communes en difficultés financières.
Le plafond des communes éligibles au dispositif a été rehaussé pour englober toutes les communes de moins de 10 000 habitants. Le seuil d’éligibilité entre les naissances constatées dans un établissement et la population d’implantation a été abaissé à 30 %. Enfin, la contribution financière des communes extérieures a sensiblement augmenté, puisqu’elle s’applique à toutes les communes ayant plus de 1 % de naissances ou de décès dans un établissement.
Il semble donc au Gouvernement que, loin d’être marginale, cette contribution est devenue un vecteur réel du financement des charges d’état civil pour les communes accueillant un établissement de santé.

La parole est à Mme Brigitte Lherbier, auteur de la question n° 261, adressée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Je m’adresse à vous, madame la garde des sceaux, mais cette question était effectivement destinée à M. le ministre d’État, ministre de l’intérieur, et à son ministre, Mme Gourault.
Au cours des dernières années, les missions dévolues par les municipalités à leur police municipale ont eu tendance à s’étoffer, en raison des événements survenus en France et de la menace terroriste qui pèse sur notre pays. Les policiers municipaux ont incontestablement gagné en professionnalisme et assurent une sécurité de proximité indispensable et complémentaire à l’intervention de la police nationale.
Pourtant, ils ont de grandes difficultés à assurer ces missions dans des conditions décentes, car les moyens dont ils disposent sont limités.
Par exemple, lors d’un banal contrôle de vitesse, ils n’ont pas accès au fichier national des permis de conduire – le FNPC – pour s’assurer de la détention effective et de la validité du titre présenté, ni au fichier des véhicules volés – le FVV – avant de procéder à la mise en fourrière d’un véhicule, ni au système d’immatriculation des véhicules – le SIV – pour notifier l’immobilisation ou l’annulation de l’immobilisation d’un véhicule, ni au fichier des personnes recherchées – le FPR –, qui permettrait également de garantir des conditions d’intervention plus sûres, notamment dans cette période de menace terroriste.
Les policiers municipaux sont donc dans l’obligation de faire appel à leurs collègues de la police nationale ou de la gendarmerie pour pouvoir effectuer toutes les vérifications d’usage qui s’imposent, même pour un banal contrôle de vitesse.
Il s’agit incontestablement d’une perte de temps et d’efficacité pour la police nationale, comme pour la police municipale, qui ne dispose pas de tous les moyens indispensables au bon accomplissement de ses missions.
C’est pourquoi de nombreux élus m’ont demandé d’intervenir ce matin. Ils souhaiteraient que l’État puisse revoir sa position concernant l’accès des policiers municipaux à l’ensemble des fichiers qu’ils doivent pouvoir consulter dans le cadre de leurs missions.
Comme vous le savez, madame la sénatrice Lherbier, les fichiers comportant des données à caractère personnel font l’objet d’un encadrement très strict. Bien évidemment, la loi du 6 janvier 1978 doit être respectée, sous le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés – la CNIL –, mais comme nous l’avons vu ensemble dans cet hémicycle, le droit relatif à ces fichiers s’inscrit également dans un cadre constitutionnel et dans un cadre européen, avec l’entrée en vigueur de nouvelles directives le 25 mai prochain.
Une personne ne peut donc légalement consulter un fichier que si cette consultation est nécessaire et proportionnée à raison de sa fonction.
Dès lors que les policiers municipaux, agents de police judiciaire adjoints, ne disposent pas de la possibilité de réaliser des actes d’enquête, il n’y a pas nécessité de leur ouvrir un accès direct aux fichiers sur lesquels ces actes pourraient notamment se fonder.
Ainsi, au regard des missions dévolues aux policiers municipaux, il n’a pas été jugé nécessaire de leur permettre un accès direct au fichier des personnes recherchées, le FPR. Je tiens à vous rappeler qu’en application des dispositions en vigueur les policiers municipaux peuvent déjà être rendus destinataires, sous certaines conditions, d’informations issues de ce fichier, notamment afin de parer à un danger pour la population.
Pour des raisons similaires, un accès direct des policiers municipaux au fichier des objets et des véhicules signalés, le FOVeS, qui a remplacé le fichier des véhicules volés, n’est pas prévu.
Dans la pratique, les agents de police municipale peuvent avoir accès à un extrait actualisé du fichier en saisissant la plaque d’immatriculation sur leur terminal personnel, afin de savoir si un véhicule est volé ou utilise des plaques aux numéros usurpés avant mise en fourrière.
En outre, le Gouvernement ne peut que vous rejoindre sur la nécessité d’ouvrir aux agents de police municipaux un accès direct au système d’immatriculation des véhicules et au système national des permis de conduire, compte tenu de leurs prérogatives en matière de constatation des infractions au code de la route.
Cette évolution est déjà engagée, puisqu’un projet de décret en ce sens a été préparé par mes services. Ayant fait l’objet d’avis favorables du Conseil national d’évaluation des normes et de la CNIL, il est actuellement en phase d’examen devant le Conseil d’État.
Enfin, je suis sûre que la mission parlementaire en cours sur le continuum de sécurité, portée par les députés Jean-Michel Fauvergue et Alice Thourot, nous apportera un éclairage intéressant sur l’adaptation des conditions d’accès des policiers municipaux à ces fichiers.

Merci de cette réponse, madame la ministre, et de cette perspective d’amélioration des possibilités d’action de la police municipale. Pendant des années, j’ai présidé chaque vendredi matin une cellule de veille et de partage d’informations à Tourcoing et très souvent, de tels dysfonctionnements remontaient dans ce cadre : perte de temps, obligation d’avoir recours à la police nationale pour des petits renseignements. Vous nous avez rassurés, vous allez prendre en main cette évolution et tout le monde, je pense, aura à y gagner.

La parole est à Mme Annick Billon, auteur de la question n° 244, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la ministre, je me permets d’attirer votre attention sur la demande d’effectifs nécessaires dans les commissariats de police de Vendée.
Par un courrier en date du 2 novembre 2017, dont vous avez accusé réception, je vous ai alertée sur les conditions de travail dégradées dans les commissariats de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne.
Le 8 février dernier, vous avez annoncé le lancement de la police de sécurité du quotidien – ou PSQ –, plan quinquennal ambitieux qui vise à construire dans notre pays une société rassemblée et apaisée. En Vendée, la mise en place de cette police de sécurité du quotidien devait conduire à l’arrivée d’effectifs supplémentaires à la gendarmerie de Fontenay-le-Comte, mais rien n’était envisagé pour les commissariats de police des Sables-d’Olonne et de La Roche-sur-Yon.
Or si ces établissements ne sont pas directement concernés par le nouveau dispositif, le besoin de personnel complémentaire n’en est pas moins indispensable.
La Vendée fait partie des 20 départements dans lesquels les extractions judiciaires sont toujours assurées par les policiers. Les évolutions, notamment numériques et contraventionnelles, censées réduire la charge de travail ne sont pas opérationnelles à ce jour.
Mais, surtout, les effectifs de référence sont totalement obsolètes et la situation ne s’arrange pas, avec un nombre de résidents qui continue d’évoluer à la hausse. La carence en personnel se concrétise par des journées à rallonge, des décalages horaires incessants. Le taux d’effectif en arrêt de travail ou en mi-temps thérapeutique atteint 20 % !
Depuis l’annonce du 8 février, la situation a évolué et je vous remercie d’avoir répondu aux attentes du commissariat des Sables-d’Olonne.
Pour que les créations de nouveaux délits soient constatées, comme l’outrage sexiste du projet de loi de la secrétaire d’État Marlène Schiappa, les commissariats doivent être suffisamment dotés en personnel.
Le 2 juillet prochain, la commission administrative paritaire nationale statuera sur les mutations. Une nouvelle fois, madame la ministre, je vous demande de répondre à la souffrance des personnels, en dotant les forces de police de Vendée, notamment de La Roche-sur-Yon, d’effectifs supplémentaires et attendus. Je vous remercie de prendre en compte cette demande, incessante.
Je suis ravie, madame la sénatrice Billon, de trouver dans cet hémicycle, aujourd’hui, un continuum avec les questions qui m’ont été posées, voilà quelques jours, aux Achards, en Vendée.
La sécurité, vous le savez, est une priorité pour ce gouvernement et, en la matière, les attentes des Français sont grandes, qu’il s’agisse de terrorisme ou de délinquance du quotidien.
C’est pourquoi, dans un contexte budgétaire contraint, le Gouvernement a fait le choix de renforcer les moyens matériels et humains des forces de l’ordre, avec, notamment, le recrutement de 10 000 policiers et gendarmes au cours du quinquennat.
Cette action portera ses fruits en Vendée, j’en suis sûre.
Dans le cadre de la PSQ, la Vendée bénéficie d’un « groupement prioritaire de gendarmerie départementale », qui se verra octroyer des renforts humains spécifiques. Mais la montée en puissance de la police de sécurité du quotidien concerne tout le territoire national : elle s’applique donc dans toute la Vendée, grâce à de nouvelles méthodes reposant sur les stratégies locales de sécurité, couplées à une simplification significative, écrit mon collègue de l’Intérieur, de la procédure pénale à venir – j’en suis d’accord.
Si les effectifs de police en Vendée ont légèrement diminué entre 2016 et 2017, le nombre de gradés et de gardiens de la paix affectés en sécurité publique – ce sont les principaux policiers mobilisés au quotidien sur la voie publique – est, lui, quasi conforme à l’effectif de référence de ce département. On dénombre 153 personnels, pour un effectif cible de 154.
La circonscription de police de La Roche-sur-Yon compte, elle, 125 agents, avec un nombre de gradés et de gardiens de la paix très légèrement supérieur à l’effectif de référence, dont je sais – M. le maire me l’a dit – qu’il est contesté. Quoi qu’il en soit, cette situation sera attentivement examinée lors de la préparation du mouvement de mutation polyvalent 2018, qui aura lieu en septembre prochain.
Quant aux Sables-d’Olonne, cette circonscription compte actuellement 77 agents. Elle va gagner 3 agents supplémentaires d’ici à l’été et parviendra ainsi, à une unité près, à son effectif de référence. J’ajoute qu’un poste d’officier de police judiciaire y a été ouvert au titre du mouvement de mutation dit « profilé » pour une prise de poste au 1er septembre 2018. Comme pour La Roche-sur-Yon, la situation des effectifs de cette circonscription sera réexaminée dans le cadre du mouvement de mutation polyvalent 2018.
Vous pouvez être certaine, madame la sénatrice, qu’en Vendée comme sur l’ensemble du territoire national, tout sera fait pour doter les forces de l’ordre des moyens et des modes d’action qui leur permettront d’être très proches du terrain et d’agir efficacement. Bien sûr, l’implication des élus locaux, dont je peux porter témoignage, sera, elle aussi, l’une des clés de la réussite.

Effectivement, madame la ministre, nous nous retrouvons très peu de temps après votre visite aux Achards. Mais, vous l’avez bien compris, La Roche-sur-Yon conteste légitimement l’effectif de référence. Pour une satisfaction totale des Vendéens, cet effectif de référence ne doit plus être pris en compte et il faut doter, enfin, le commissariat de La Roche-sur-Yon d’effectifs supplémentaires.
J’insiste vraiment sur ce point, car la souffrance est réelle. D’ailleurs, les équipes du commissariat de La Roche-sur-Yon manifestaient lundi dernier devant la préfecture, en présence de M. Luc Bouard, maire de la ville, et de M. le président du département.
Il y a urgence, madame la ministre ! Il y a souffrance ! Merci donc de donner satisfaction à La Roche-sur-Yon le 2 juillet prochain, et à très bientôt en Vendée !

La parole est à Mme Dominique Vérien, auteur de la question n° 277, adressée à Mme la ministre auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur.

Madame la garde des sceaux, je veux à mon tour vous remercier de votre visite dans l’Yonne et de l’écoute attentive dont vous avez fait preuve à notre égard.
À travers cette question, je voulais interroger Mme Jacqueline Gourault sur un problème que rencontrent les élus locaux.
Vous connaissez la crise de vocation qui sévit actuellement chez les élus locaux, notamment en milieu rural. Une réflexion a été lancée sur leur statut et, dans ce cadre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent les présidents et vice-présidents de communautés de communes, faute d’être remboursés de leurs frais de transport au sein des établissements publics de coopération intercommunale – les EPCI – ruraux.
Les modalités de remboursement de ces frais sont actuellement régies par le code général des collectivités territoriales, le CGCT.
Les conseillers d’EPCI ne sont remboursés de leurs frais de transport que s’ils ne touchent pas d’indemnité dans le cadre de leur fonction et si le déplacement a lieu en dehors de leur commune. De fait, les présidents et vice-présidents d’EPCI percevant une indemnité ne peuvent donc pas bénéficier de ces remboursements.
Ces dispositions ne sont pas adaptées à la réalité de notre territoire. En effet, les EPCI ont souvent une superficie très étendue, mais comptent peu d’habitants, ce qui implique des indemnités faibles pour leurs présidents et vice-présidents.
Ma communauté de communes, par exemple, a un diamètre de 100 kilomètres pour 38 000 habitants. Les président et vice-présidents touchent donc un peu plus de 1 000 euros par mois et doivent parcourir des distances considérables pour accomplir leur devoir de représentant communautaire. Leur indemnité est alors uniquement dédiée à leurs frais d’essence, ce qui est contraire à son esprit originel.
Ainsi, madame la ministre, pouvez-vous envisager la mise en place d’un système de remboursement des frais de transport pour les présidents et vice-présidents de communautés de communes sur justificatifs, comme cela existe d’ores et déjà pour les conseillers régionaux ?
Madame la sénatrice, sur le fondement de l’article L. 5211–13 du code général des collectivités territoriales, les élus des communautés de communes qui ne bénéficient pas d’une indemnité de fonction au titre de leur mandat intercommunal peuvent demander l’indemnisation des frais de déplacement engagés à l’occasion de certaines réunions qui ont lieu dans une commune autre que la leur.
Le législateur n’a pas entendu autoriser le remboursement des frais de déplacement aux élus des communautés de communes qui bénéficient d’une indemnité de fonction. Lors de l’examen du projet de loi relatif à la démocratie de proximité, le Sénat avait repoussé un amendement qui tendait à leur accorder ce remboursement, après un débat qui avait été particulièrement intense. Les arguments échangés étaient alors les mêmes qu’aujourd’hui.
En revanche, les élus des communautés de communes peuvent, en application de l’article L. 5211–14 du CGCT, être remboursés des frais engagés lors de l’exécution d’un mandat spécial, dans les mêmes conditions que les élus municipaux.
Vous avez raison de souligner la difficulté engendrée par ces règles.
Le Président de la République a annoncé, le 23 novembre 2017, à l’occasion de la clôture du Congrès des maires, son souhait d’améliorer les conditions d’exercice des mandats locaux. Un chantier est consacré à cette thématique dans le cadre de la Conférence nationale des territoires. Il pourra se nourrir des travaux engagés par la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation du Sénat, qui a constitué un groupe de travail sur le statut des élus locaux et qui devrait présenter ses préconisations d’ici à l’été 2018.
Ce sera un élément positif pour engager la recherche d’une solution à la difficulté que vous soulevez.

Je vous remercie de votre réponse, madame la garde des sceaux. J’ai également soulevé cette question auprès de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
En zone rurale, le faible nombre d’habitants implique une indemnité de montant lui aussi très faible. C’est d’ailleurs également le cas dans certaines communes. Or le prix de l’essence est, lui, relativement élevé ! Il importe donc de tenir compte des caractéristiques du territoire. C’est un vrai sujet.
J’en profite pour dire que, de façon globale, mais tout particulièrement dans le cadre de la réforme constitutionnelle, la question des distances à parcourir et de la surface du territoire devrait alimenter la réflexion, notamment sur le nombre d’élus locaux.

M. le président. Je vous remercie, madame la garde des sceaux, de votre endurance.
Sourires.

Nous en avons terminé avec les réponses à des questions orales.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.