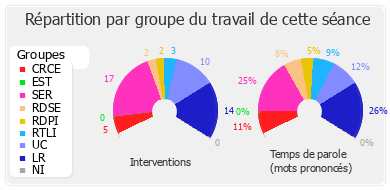Séance en hémicycle du 23 juillet 2020 à 10h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Rappel des règles sanitaires
- Hommage à catherine troendlé vice-présidente du sénat (voir le dossier)
- Prorogation du mandat des membres du conseil économique social et environnemental (voir le dossier)
- Mesures de sûreté contre les auteurs d'infractions terroristes à l'issue de leur peine (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vous rappelle que le port du masque est obligatoire dans l’ensemble des salles de réunion et des circulations du Sénat. Il vous est donc demandé de bien vouloir en porter un dans l’hémicycle.

Madame la présidente, chère Catherine Troendlé, je crois que c’est la dernière séance que vous présidez. Je tenais à profiter de l’occasion pour vous exprimer le plaisir que nous avons eu de vous voir tant au plateau que dans l’hémicycle et pour vous dire combien vous allez nous manquer.
Je voudrais vous souhaiter bonne chance dans vos nouvelles aventures. J’espère que vous ne changerez pas de numéro de téléphone, afin que nous puissions continuer à discuter et à travailler ensemble. Nos échanges ont toujours été empreints de bienveillance, dans une maison qui en manque parfois.
Applaudissements.

Je vous remercie du fond du cœur, ma chère collègue.
La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, au nom du groupe Les Républicains, je m’associe bien évidemment aux propos que vient de tenir Mme Goulet. Nous vous souhaitons le meilleur pour la suite, et nous vous remercions de votre présidence.
Applaudissements.

C’est moi qui vous remercie, ma chère collègue. Vous allez me faire pleurer…
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Madame la présidente – et, avec votre permission, je serais tentée de dire : « chère Catherine » –, je vous remercie de tout ce que vous avez fait pour notre Haute Assemblée et de l’écoute dont vous avez su faire preuve, y compris à l’égard des élus de mon groupe. D’un point de vue plus personnel, vous et moi avons eu des relations – je crois pouvoir l’affirmer – très cordiales, voire amicales.
Chère Catherine, je vous souhaite le meilleur pour la suite.
Applaudissements.

Merci beaucoup, ma chère collègue.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, chère Catherine Troendlé, je m’associe au nom de mon groupe à cet hommage et à ces félicitations très sincères. Ici, nous n’avons pas les mêmes idées politiques – nous le savons bien –, mais nous avons une faculté de travailler ensemble. Je pense que c’est très bien pour notre République.
Applaudissements.

Madame la présidente, je voudrais m’associer au nom du groupe Les Indépendants aux vœux qui sont formés.
Je les partage d’autant plus que je suis dans la même situation que vous : il s’agit de ma dernière séance, et de ma dernière prise de parole dans l’hémicycle. Voilà une quarantaine d’années que je suis dans la vie publique et je comprends donc parfaitement ce que nos collègues viennent de dire : c’est un moment particulier quand on a été engagée comme vous l’avez été, de surcroît en ayant exercé les responsabilités que vous avez exercées et que vous exercez encore ce matin. Je suis totalement solidaire de l’émotion que vous devez ressentir aujourd’hui.
Applaudissements.

M. Didier Rambaud. Madame la présidente, je m’associe bien évidemment, au nom du groupe La République En Marche, à tout ce qui vient d’être dit. Étant encore un jeune parlementaire, je vous connais moins bien que mes collègues, mais je ne doute pas de leur sincérité !
Applaudissements.

Merci beaucoup, mon cher collègue.
La parole est à M. le président de la commission des lois.

Madame la présidente, le moment est venu pour moi, en qualité de président de la commission des lois, de m’associer à cet hommage, qui n’est pas seulement officiel, mais qui est aussi amical, et que je voudrais particulièrement chaleureux.
La personnalité très attachante de Catherine Troendlé s’est imposée comme extrêmement riche d’humanité, dénuée d’artifice et de désir de se mettre en avant, avec pour autant une vraie force de caractère. Elle manquera beaucoup à notre Haute Assemblée.
Madame la présidente, il faut saluer l’engagement dont vous avez fait preuve dans vos fonctions, tant pour représenter votre territoire, auquel vous êtes tellement attachée que vous souhaitez désormais ne plus le quitter, que comme législatrice. J’ai le souvenir de nombreux textes que vous avez rapportés à la commission des lois, dont vous avez été la vice-présidente. Je pense à celui sur les manifestations, avec les Black Blocs qu’il fallait contenir, ou à celui sur les hooligans dans les stades. J’ai aussi en tête toute votre action sur la question si importante de la protection civile, ainsi que votre implication dans le dossier de la radicalisation et de la déradicalisation. Tous ces travaux – et je n’ai pas épuisé la liste – montrent à quel point vous vous êtes investie dans votre rôle de législatrice au sein la commission des lois.
Nous avons tous eu un immense plaisir à siéger dans cet hémicycle lorsque vous présidiez nos séances. Nous éprouvons beaucoup de reconnaissance pour la manière dont vous avez conduit nos travaux, avec autorité, mais également avec souplesse quand il le fallait.
Je vous adresse donc mes plus vifs remerciements ! Si votre visage est aujourd’hui dissimulé derrière un masque – c’est une protection inhabituelle pour un président ou une présidente de séance –, j’espère au moins que nous ne vous aurons pas fait trop rougir !
Applaudissements.

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation dans l’ensemble de vos fonctions.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental (projet n° 596, texte de la commission n° 633, rapport n° 632).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Madame la présidente, qu’il me soit permis à mon tour de vous souhaiter bon vent, des alizés peut-être au goût sucré… Vous avez présidé mes premières séances au Sénat. Je vous remercie de votre attention bienveillante.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai l’honneur de défendre aujourd’hui devant votre Haute Assemblée un projet de loi organique qui, pour deux raisons au moins, me semble particulièrement important.
D’abord, à titre personnel, c’est le premier texte que j’ai présenté en conseil des ministres, au lendemain de ma nomination. C’est donc un privilège de le soumettre ce matin à votre examen.
Surtout, ce texte marque la traduction concrète de la volonté du Président de la République de répondre à une aspiration apparue entre 2017 et 2019, mais qui couvait en réalité depuis bien plus longtemps : celle d’un changement de la vie politique pour laisser davantage de possibilités d’expression et d’action à des personnes qui en sont habituellement éloignées, afin de mieux la transformer.
Mais ce changement ardemment désiré est aussi et avant tout celui d’un renouveau de nos institutions et de leur fonctionnement. En effet, nos concitoyens ont appelé de leurs vœux une mutation des pratiques politiques, en particulier de notre démocratie représentative.
C’est pourquoi, pour répondre à cette attente légitime, le Président de la République a proposé aux Français de moderniser notre démocratie en rendant nos institutions plus représentatives, plus responsables et plus efficaces. Le projet de réforme du Conseil économique, social et environnemental (CESE) qui vous sera présenté à l’automne en sera la traduction concrète. Ce sera, je l’espère, un grand moment de débat démocratique, afin que nous puissions ensemble réfléchir aux institutions que nous voulons aujourd’hui pour la France de demain.
Depuis son origine, en 1925, le CESE est chargé de représenter les forces économiques et sociales du pays. Sa composition et ses attributions n’ont cessé d’évoluer, s’adaptant aux besoins de la société civile.
C’est pourquoi le texte de réforme organique portera sur plusieurs points importants. Il s’agira, notamment, de permettre au CESE d’organiser des conventions citoyennes, sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat, en tirant des citoyens au sort pour organiser une consultation sur un sujet, afin que cet organe devienne la chambre des conventions citoyennes, de renforcer l’importance de ses avis dans le processus législatif et de voir sa composition modifiée pour renouer avec sa vocation initiale de représentation de la société civile.
Ce n’est toutefois pas ce texte que je vous présente aujourd’hui. En effet, pour nous permettre d’avoir cette discussion si nécessaire sur nos institutions et leur fonctionnement dans un temps long, propice au consensus et à la coconstruction, il est indispensable de prolonger le mandat des membres actuels du CESE. La réforme organique ne pourra pas être définitivement adoptée par le Parlement et promulguée, après décision du Conseil constitutionnel, par le Président de la République avant la fin du mandat en cours. Fixé à cinq ans par l’article 9 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, ce mandat a débuté le 15 novembre 2015 et doit s’achever au mois de novembre 2020. Vous l’avez donc compris, sans le texte d’aujourd’hui, il ne peut pas y avoir le texte de demain.
Dans ces conditions, afin de préserver de manière transitoire le fonctionnement du CESE et d’éviter d’avoir à nommer de nouveaux membres pour quelques mois seulement, le présent projet de loi organique, qui se compose d’un article unique, vise à prolonger le mandat des membres du Conseil pour la durée strictement nécessaire à l’adoption de la loi organique en modifiant la composition et aux opérations de renouvellement consécutives à sa publication. Une date butoir est néanmoins prévue, afin que la prorogation du mandat ne puisse pas excéder le 1er juin 2021.
C’est pourquoi je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, d’adopter le projet de loi organique prorogeant le mandat des membres actuels du Conseil économique, social et environnemental.
Applaudissements sur les travées des groupes LaREM et Les Indépendants. – M. Bruno Sido applaudit également.

Madame la présidente, à mon tour de vous saluer ! Je sais l’engagement qui a été le vôtre, notamment en tant que représentante du Sénat au sein de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), institution très importante qui veille au respect de nos libertés publiques. Je vous remercie également de nous avoir accompagnés au sein de la commission des lois au cours de ces dernières années.
Le Conseil économique, social et environnemental est la troisième assemblée constitutionnelle de la République. Il a vocation à représenter la société civile organisée. Il découle de la création en 1925 du Conseil national économique pour constituer un centre de résonance de l’opinion publique. Il a pour missions de conseiller le Gouvernement sur les politiques économiques, sociales et environnementales, de favoriser le dialogue entre les forces vives de la Nation et de contribuer à l’information du Parlement.
Le texte qui nous est proposé est très simple. Il s’agit de prolonger, jusqu’au mois de juin 2021 au plus tard, le mandat des 233 membres du CESE, afin de pouvoir examiner et voter, d’ici là, la réforme de cette institution.
Le projet de loi organique de réforme du CESE a été déposé en même temps que le texte dont nous discutons actuellement, lors du premier conseil des ministres auquel vous avez assisté, monsieur le garde des sceaux. Il sera examiné à l’automne, car il exige évidemment des débats beaucoup plus approfondis qu’un simple vote de prorogation. La réforme est préparée par l’ensemble des membres actuels du CESE depuis le début de leur mandat. Des retards ayant été pris, du fait notamment de la crise sanitaire et des processus préalables à la nomination des représentants d’un certain nombre de corps constitués, la commission des lois propose d’accepter le projet de loi organique qui nous est soumis.
Toutefois, cela ne préjuge en rien de l’accord du Sénat sur le projet de loi organique de réforme du CESE tel qu’il est proposé par le Gouvernement.

Il ne s’agit pas pour nous de l’avant-garde d’une réforme constitutionnelle. Nous débattrons du texte portant réforme du CESE pour ce qu’il est ; les autres sujets seront abordés à d’autres moments. Adopter un projet de loi organique ne signifie pas en approuver un autre plus tard, encore moins valider sans débat l’ensemble d’une réforme des institutions.
Assemblée des représentants de la société civile organisée, le Conseil économique, social et environnemental est un lieu de débats et d’échanges. Les employeurs, les entreprises, les syndicats, les jeunes, les associations environnementales, les acteurs mutualistes ou encore ceux du logement peuvent y discuter en toute transparence. Dans un pays où les débats sont souvent vifs, parfois violents, et où les affrontements sociaux paralysent parfois longtemps la société, c’est un cadre très précieux, qui favorise le dialogue et permet d’avoir, dans chaque syndicat, dans chaque institution, des personnes aux contacts des autres. Au fond, le Conseil économique, social et environnemental contribue à cimenter l’appartenance à la même communauté de destin, au-delà de nos oppositions d’intérêts sur un certain nombre de sujets, à trouver des solutions pragmatiques et à faire nation. Sa vocation est donc essentielle. Il corrige un peu nos habitudes gauloises de confrontation et permet de trouver des solutions utiles. Cette institution est donc vitale à notre unité.
Cependant, un constat s’impose. Depuis 2017, le nombre d’autosaisines, faute de saisine par le Gouvernement du CESE, est passé de 50 % à 80 %. C’est d’ailleurs assez étonnant, car les deux dernières années n’ont pas été particulièrement paisibles en matière sociale ! Le Gouvernement n’a donc manifestement pas perçu l’utilité de cette institution au cours des dernières années. C’est parfois vrai aussi du Parlement – il faut bien le reconnaître –, mais il est difficile de demander un avis au Conseil économique, social et environnemental quand nous n’avons que quelques semaines pour nous prononcer parce que nous sommes saisis en urgence. Cela étant, le 24 juin dernier, le président du Sénat, M. Gérard Larcher, s’est rendu au CESE pour assister à l’adoption de l’avis qu’il avait demandé sur les réponses à apporter au chômage de longue durée. Il y a donc une tradition d’échanges entre le Sénat et le CESE.
Il y a un autre problème : on peut toujours trouver des structures de concertation plus pointues que le CESE sur des sujets un peu techniques inscrits à son ordre du jour. La réforme doit donc également viser à renforcer sa visibilité et son efficacité.
Un amendement tendant à proroger aussi le mandat des soixante-dix-sept personnalités associées au CESE a été déposé en commission. Il a été rejeté, car ce sujet ne relève pas du domaine législatif ; c’est au Gouvernement qu’il appartient de décider en la matière. Vous pourrez peut-être nous faire part de votre position à propos du mandat de ces personnalités, monsieur le garde des sceaux.
S’il ne s’agit pas de valider aujourd’hui la réforme du CESE, permettons l’ouverture des débats. Il y a tant à dire. Deux sujets seront au centre des discussions.
Le premier est la baisse du nombre de membres du CESE. À mon sens, le chiffre de 40 personnalités qualifiées sur les 203 membres du CESE ne fera pas débat entre nous ; il est consensuel. En revanche, le fait de réduire de 18 le nombre de membres peut poser une difficulté au regard de la nécessité de représenter correctement l’ensemble des corps constitués du pays. C’est aussi le cas de l’idée de permettre au pouvoir réglementaire, dans un souci de flexibilité – du moins, c’est l’argument qui est mis en avant –, de finaliser la répartition entre ces différents corps.
Le second sujet est celui de la participation des citoyens tirés au sort. Le projet de loi organique de réforme, dont nous ne débattons pas aujourd’hui, prévoit non pas que des membres du CESE puissent être tirés au sort, mais que celui-ci s’adjoigne dans certaines conditions des citoyens tirés au sort.
Cette proposition soulève le débat entre démocratie participative et démocratie représentative. Nous sommes tous convaincus ici, je le crois, que la révolution numérique nous oblige à faire évoluer progressivement notre manière de faire de la politique, mais démontre aussi la nécessité de maintenir la démocratie représentative, seule à même d’assurer une réelle démocratie et de garantir le contrôle par des élus de l’ensemble de l’administration d’un État. Il est donc absolument indispensable que la démocratie représentative puisse continuer à vivre.
Les débats sur le tirage au sort auront lieu. Faut-il intégrer des citoyens tirés au sort au sein du CESE, créer une structure parallèle ou ne rien faire du tout ? Nous en discuterons probablement à l’automne. D’ailleurs, procéder par tirage au sort pour recueillir un avis, c’est finalement ce que font tous les instituts de sondages. On ne peut pas remplacer les élections par les sondages. Comment concilier le tirage au sort, si nous décidons de l’intégrer, et le renforcement de la démocratie représentative ? Nous n’avons pas nécessairement tous la même position entre nous, mais nous pourrons débattre, y compris des choix que le Gouvernement a faits en la matière.
En réalité, ces débats sont profondément liés à la réforme non pas des institutions, mais de notre manière de faire de la politique après la révolution numérique. Ils ne sont pas notre sujet aujourd’hui, mais l’adoption du présent projet de loi organique nous permettra de les avoir demain. Comment la société française peut-elle retrouver la voie de la compréhension entre les différents intérêts qui la traversent ? Comment un intérêt général peut-il se dégager au-delà des intérêts particuliers qui se confrontent ?
Qu’il s’agisse de questions sociales ou environnementales, le CESE est aujourd’hui absolument indispensable pour notre pays. Nous devons donc favoriser le débat qui en permettra la réforme. C’est pourquoi la commission des lois vous propose d’adopter le présent projet de loi organique.
Applaudissements sur les travées des groupes SOCR, LaREM et Les Indépendants. – M. Philippe Bas, président de la commission des lois, applaudit également.

Madame la présidente, chère Catherine, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous examinons en toute fin de session ce texte visant à prolonger le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. Il s’agit d’un examen en urgence, lié à un calendrier resserré.
Une telle prolongation a pour justification de se donner le temps de l’adoption et de la mise en œuvre d’un autre projet de loi, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Nous discutons donc aujourd’hui du premier étage de la fusée ; l’objectif est une réforme globale de cette instance, qui a toujours eu – il faut le dire – du mal à trouver sa place et sa légitimité au sein de l’architecture institutionnelle.
La commission des lois et le Conseil d’État ont estimé qu’il n’y avait aucune raison juridique de s’opposer à la prolongation. L’ensemble des groupes ont donné leur aval. La démarche n’a suscité aucune opposition, y compris parmi les membres du CESE.
Pour autant, et je souhaite le réaffirmer ici, le vote formulé aujourd’hui ne constitue en aucune manière un accord sur l’ensemble de la réforme qui nous est proposée. Nous devrons prendre le temps du débat sur le rôle du CESE et son utilité à l’automne, lorsque nous examinerons l’autre texte.
L’ensemble de la réforme étant déjà connu à ce stade, je souhaiterais vous faire part de l’état d’esprit de notre groupe.
Nous nous réjouissons que l’hypothèse d’une fusion entre le Sénat et le CESE n’ait pas été retenue. Le bicamérisme est un élément important de notre démocratie ; nous le constatons souvent dans cet hémicycle. Notre Haute Assemblée contribue pleinement à la qualité de la loi du fait de la représentation spécifique des territoires.
Dans le détail de la réforme présentée, trois problématiques nous semblent majeures.
D’abord, nous déplorons la volonté de réduire des effectifs du CESE – nous regrettons aussi le recours facilité à la procédure d’urgence – alors même que certaines associations très importantes n’y sont pas représentées aujourd’hui. Je pense par exemple à ATD Quart Monde, à la Croix-Rouge, au Planning familial, à la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), au Secours populaire, etc. Accroître les missions du CESE tout en réduisant le nombre de ses membres risque d’entraîner une professionnalisation des fonctions ; ce n’est pas conforme à l’idée que nous nous faisons d’une démocratisation des institutions.
Il en est de même s’agissant du recours aux procédures accélérées ressemblant à celles que nous connaissons au Sénat, comme la législation en commission (LEC). Nous dénonçons régulièrement ce recours aux procédures d’exception, qui consistent à abattre un maximum de travail en un temps record, limitant drastiquement le débat et la pluralité des échanges.
Ensuite, nous pensons qu’il faudra avoir un vrai débat sur les modalités de participation citoyenne, notamment la place du tirage au sort.
La question a été largement ouverte par la Convention citoyenne pour le climat. Si le tirage au sort peut se justifier ponctuellement, cette procédure interroge sur les légitimités ainsi créées et les stratégies de ceux qui la proposent. S’il faut favoriser et prendre en compte l’expression de la parole citoyenne, il ne saurait s’agir d’un substitut à celle des forces vives et à la représentation de la société civile organisée, colonne vertébrale du CESE.
Nous prônons, plus positivement, non pas la création d’un espace concurrent, mais bien le renforcement des possibilités de coconstruction, d’échanges et de débats propices à l’expression de cette parole spécifique.
Encore faut-il que le Gouvernement la prenne en compte, bien entendu. Au regard des réponses apportées aux avis existants du CESE, le doute est légitime sur ce point et la crédibilité de l’exécutif largement entamée dans cette démarche.
Dans tous les cas, il est indispensable de s’assurer que la parole des citoyens ne soit pas instrumentalisée et que leur « formation », le cas échéant, soit de nature pluraliste.
Sur le fond, le devoir d’innovation démocratique qui nous incombe, notamment au regard du taux d’abstention constaté aux élections, dépasse les formes d’expression citoyenne pour toucher aux modalités concrètes de partage des pouvoirs et de représentativité de nos institutions.
Enfin, nous sommes extrêmement dubitatifs quant à la substitution du CESE aux organes de consultation sectoriels pour la préparation des projets de loi.

Faute de plus de précisions, nous pensons que la réforme proposée par le Gouvernement pourrait supprimer certaines compétences dévolues à des organismes consultatifs, et donc potentiellement porter atteinte à la démocratie sociale. Le Conseil d’État lui-même déplore, dans son avis, une mauvaise appréciation du champ d’application de cette mesure.
Au fond, nous devrons, lors de nos prochains débats, rendre plus nettes les motivations profondes du Gouvernement, qui pourrait voir dans cette réforme une occasion de discréditer la représentation des corps intermédiaires, sous couvert de démocratie directe. Nous y serons bien évidemment très attentifs.
Pour l’heure, nous apporterons nos voix à ce projet de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SOCR.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, acteur essentiel de notre démocratie sociale, le Conseil économique, social et environnemental fut chargé, dès sa création en 1925, de représenter les forces économiques et sociales du pays. Sa composition et ses attributions n’ont cessé d’évoluer, s’adaptant aux besoins de la société civile.
Il comprend aujourd’hui 233 membres – l’effectif maximal prévu par la Constitution –, dont le mandat expire le 14 novembre 2020, cinq années après leur nomination.
Le Gouvernement a engagé un grand projet de réforme du CESE avec un triple objectif : modifier sa composition, adapter son fonctionnement et lui confier de nouveaux outils.
Il entend ainsi faire du CESE un véritable carrefour de la consultation publique, ainsi que le vecteur de la consultation citoyenne. Vous l’avez souligné, monsieur le garde des sceaux, en présentant ce texte.
Le calendrier d’examen ne permettra toutefois pas l’adoption définitive du projet de loi organique et sa promulgation, après décision du Conseil constitutionnel, par le Président de la République avant l’expiration du mandat des membres du CESE en novembre 2020.
Ainsi, en l’absence de dispositions législatives, les nouveaux membres du CESE devraient être nommés pour quelques mois seulement, voire quelques semaines.
Le texte que nous examinons ce matin vise donc à prolonger le mandat des 233 membres du CESE jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de cette institution, et au plus tard jusqu’au 1er juin 2021.
Transitoire, cette prorogation se limiterait donc à une durée de six mois, ce délai devant permettre de préserver la continuité des travaux du CESE jusqu’à l’entrée en vigueur du projet de loi organique réformant l’institution, qui a été déposé le 7 juillet dernier sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Je me réjouis que la commission des lois ait admis la prolongation du mandat des membres du CESE, car s’y opposer aurait eu pour effet de renoncer à la possibilité même de réformer l’institution.
Pour autant, comme cela a été dit, cette décision ne préjuge en rien de la position qu’adoptera notre assemblée – Catherine Troendlé et moi-même n’en ferons plus partie – sur le projet de loi organique réformant le CESE, dont elle n’est pas encore saisie. Plusieurs de ses dispositions sont délicates et méritent des débats approfondis, que le calendrier de la session extraordinaire ne permet pas.
Le Gouvernement et le CESE ont travaillé à un projet de réforme qui prévoit, notamment, une réduction du nombre des membres du Conseil – il en comprend actuellement 233, dont 40 personnalités qualifiées –, une extension de la procédure simplifiée pour la publication des avis et une mention du recours à des techniques de tirage au sort.
Il reviendra aux assemblées parlementaires de trancher un certain nombre de sujets lors de l’examen, dans les prochains mois, du projet de loi organique.
Comment concilier l’affirmation du tirage au sort et la légitimité des urnes, fondement même de notre pacte républicain ? La réduction de 25 % des effectifs du CESE se justifie-t-elle vraiment ? Quelles en seraient les conséquences sur la représentation de la société organisée ? Peut-on renvoyer à un décret la liste des organisations représentées dans les pôles « cohésion sociale » et « protection de l’environnement », alors qu’elle figure aujourd’hui dans la loi organique ?
Comme l’a justement souligné l’excellent rapporteur, pour pouvoir débattre de tous ces sujets, vraisemblablement au cours de l’automne, il nous faut dès à présent proroger le mandat des membres actuels du CESE.
Il paraît opportun de garantir la continuité des travaux du Conseil économique, social et environnemental jusqu’à la date d’adoption de la réforme, la participation active de ses membres au projet de réforme et le fait de ne pas avoir à procéder à deux renouvellements dans des délais extrêmement restreints.
Dans ces conditions, le groupe Les Indépendants votera évidemment ce projet de loi organique.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 29 juin dernier, le Président de la République a témoigné de sa volonté de transformer le CESE en ce qu’il a nommé la « chambre des conventions citoyennes ». Lors du conseil des ministres du 7 juillet 2020, vous avez, monsieur le garde des sceaux, ministre de la justice, présenté un projet de loi organique de réforme du Conseil économique, social et environnemental.
Son objectif est d’accroître le rôle du CESE dans le développement de la démocratie participative. Car, s’il est en effet un acteur essentiel de la démocratie sociale, par sa culture du consensus, dans un pays où les conflits sociaux sont légion, il peine toujours, après tant d’années d’existence, à trouver sa place dans les institutions.
Ses travaux, pourtant nombreux et rarement lacunaires, souffrent d’un grand manque de visibilité. Sans surprise, ils sont peu connus du grand public, ce qui s’explique facilement par le manque de lisibilité des nombreux organismes consultatifs qu’abrite la France.
Mais ses avis sont également loin, parfois, de l’attention des pouvoirs publics, ce qui est plus inattendu. La concurrence des nombreux autres organes consultatifs en est très probablement l’explication la plus plausible. Pire encore, l’institution du dialogue social est très peu sollicitée, 79 % de ses travaux résultant d’une autosollicitation.
Cette institution, troisième chambre prévue par notre Constitution, mérite donc une réforme qui lui attribuerait la place qui lui revient au sein de la République. Celle-ci interviendra au début de l’année 2021, ce qui nous pousse à prolonger le mandat des 233 membres du Conseil, supposé expirer le 14 novembre 2020 après cinq ans de loyaux services. Cette prorogation doit bien évidemment courir jusqu’à l’entrée en vigueur de ladite réforme.
Cependant, si nous convenons de la nécessité d’une réforme, la teneur exacte de celle-ci suscite débat.
Assurer un meilleur fonctionnement du CESE pour mieux faire participer les corps intermédiaires au débat public ? Nous partageons tous cet objectif.
Veiller à ce que les travaux du CESE reçoivent les échos qui leur sont dus ? Cela va de soi.
Doter le CESE des outils dont il a besoin pour accomplir ses missions ? Nous ne pouvons pas nous y opposer.
Toutefois, à la lecture du texte déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, nous nous interrogeons déjà sur certains points.
La première réserve concerne le rôle de représentation de la société organisée du CESE : la réduction de ses effectifs de 25 %, qui porterait le nombre de ses membres à 175, pourrait être lourde de conséquences pour cette noble tâche.
Un autre aspect de la réforme suscite d’ores et déjà le scepticisme, le recours au tirage au sort, qui, jour après jour, prend une place de plus en plus importante dans certains esprits.
Si beaucoup chantent les louanges d’un modèle démocratique athénien, le tirage au sort n’en reste pas moins en contradiction totale avec le principe de démocratie représentative si cher à la majorité de nos concitoyens, et qui constitue l’un des fondements de notre histoire politique.
Mes chers collègues, méfions-nous de cette douce chanson qui fait l’éloge de la démocratie participative et directe, devenue depuis peu le fer de lance du dégagisme et du populisme.
Méfions-nous du tirage au sort, non pas en raison d’une quelconque crainte de nous voir concurrencés dans notre rôle de représentation nationale, mais parce qu’il est tout aussi attirant que dangereux pour les fondements de notre pacte républicain.
La place qui est réservée au tirage au sort dans ce projet, nous en conviendrons, n’est pas scandaleuse en soi. Mais cette réforme consacre tout de même le tirage au sort dans la loi, promettant ainsi un avenir institutionnel à cette pratique. Il faut y penser.

Ce sujet majeur vaudra d’être débattu aussi longtemps que nécessaire au Parlement, et je sais que vous ne manquerez pas, mes chers collègues, de vous emparer pleinement de cette question.
Dans l’immédiat, et justement pour que ce débat de fond puisse avoir lieu sereinement, nous voterons en faveur de la prorogation du mandat des membres du CESE prévue par le présent projet de loi organique.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne pense pas épuiser mon temps de parole de six minutes, car j’ai le sentiment que tout a déjà été dit et que ce projet de loi fait consensus, d’abord parce qu’il est très bref
Sourires.

Je souligne néanmoins l’adoption en commission d’un amendement de coordination tout à fait légitime, qui met à jour le texte de l’ordonnance de 1958 après le changement de dénomination intervenu depuis 2008. Il aura quand même fallu attendre douze ans, et je veux ici saluer le travail de la commission.
C’est à présent le futur qui nous attend, avec un texte beaucoup plus substantiel, déjà déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, qui vise à réformer dans son ensemble le Conseil économique, social et environnemental.
Les perturbations de l’ordre du jour liées à l’épidémie de covid chamboulant quelque peu l’agenda parlementaire, ce texte n’arrivera pas assez tôt pour être étudié avant le terme du mandat actuel des membres du CESE. Il n’aurait pas été pertinent, alors même que la procédure de renouvellement est assez longue, de l’examiner dans l’urgence.
J’en viens maintenant au fond, à savoir la réforme du CESE. En 2008, quelques aspects du fonctionnement de cette assemblée avaient déjà été rénovés. Mais il nous semble pertinent de nous interroger de nouveau sur l’adéquation des objectifs de l’institution avec sa composition, ses procédures et ses moyens.
Un certain nombre de propositions ont été faites, et certaines figurent dans le projet de loi organique déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. Il n’est pas temps d’en discuter ce matin, mais nous pourrons nous y atteler à l’automne, lorsque le texte arrivera au Sénat.
Dans tous les cas, ce ne sera pas une grande révolution, qui aurait nécessité une réforme constitutionnelle, et non une loi organique.
À cette heure, et sans préjuger des débats ni du contenu du texte qui nous sera transmis par les députés, je rappelle l’attachement du groupe Les Républicains au rôle que la Constitution accorde à chaque chambre et chaque institution. C’est vrai pour le CESE comme pour le Sénat. Le CESE est un acteur important de la démocratie sociale depuis près d’un siècle. Son rôle a été reconnu en 1958 et il participe depuis lors à l’équilibre constitutionnel.
Au regard de ces éléments, et en osant paraphraser le président Philippe Bas, il convient de laisser sa chance à la réforme et de voter le projet de loi qui nous est soumis ce matin.
Applaudissements sur les travé es du groupe Les Républicains. – MM. Yves Détraigne et Jérôme Bignon applaudissent également.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce projet de loi vise à reporter le renouvellement des membres du CESE au 1er juin 2021, dans l’attente d’une réforme qui serait destinée à lui donner un nouveau souffle et une nouvelle visibilité, non seulement comme l’enceinte de la représentation des acteurs de la société civile, mais aussi comme un véritable carrefour de la consultation publique et de la participation directe des citoyens.
Sur le plan du calendrier, il n’y a pas de débat, la prorogation du mandat de ses membres est indispensable à l’examen préalable de la réforme envisagée.
Toutefois, l’adoption de ce texte ne doit en rien présager de la position du Parlement, en particulier du Sénat, sur le projet de loi organique réformant le CESE.
Sur le texte examiné ce matin, mon propos pourrait s’arrêter là. Mais son examen en commission des lois a fait l’objet de différentes appréciations, et les pistes d’évolution du rôle et des méthodes de l’institution ont été largement évoquées.
Avant d’envisager de nouvelles orientations, il conviendrait de faire un diagnostic de l’activité du CESE au cours de ces dernières années, voire de ces dernières décennies.
Sans revenir aux objectifs qui lui étaient fixés dans la Constitution de la Ve République, rappelons, comme l’indique le rapport de la commission, que le CESE devrait remplir trois missions principales : conseiller le Gouvernement sur les politiques économiques, sociales et environnementales, favoriser le dialogue entre les forces vives de la Nation et contribuer à l’information du Parlement.
L’institution assume-t-elle de manière satisfaisante ces trois missions ? Osons le dire, la réponse est évidemment non.
En effet, le CESE est peu sollicité par le Gouvernement et le Parlement, 80 % des sujets qu’il étudie relevant de l’autosaisine. C’est sans doute l’expression d’une grande autonomie, mais surtout la preuve du peu d’intérêt qui est réservé à ses travaux. Faut-il de surcroît remarquer que les 20 % de saisine par le Gouvernement relèvent d’une démarche obligatoire pour les lois à caractère économique, social ou environnemental ?
On peut aussi noter que le CESE, pour l’étude de certains sujets, est concurrencé par de nombreux autres organismes consultatifs plus spécialisés, et donc mieux outillés pour aborder en profondeur certaines thématiques.
Ces doubles emplois risquent encore de s’étendre, notamment à travers la concurrence qui ne manquera pas de s’installer avec la Commission nationale du débat public dans un rôle d’organisateur de la participation directe des citoyens et de la consultation publique.
Par ailleurs, il faut noter que la saisine par voie de pétition sur toutes les questions à caractère économique, social et environnemental, possible depuis 2010, n’a jamais été mise en œuvre.
Le CESE ne joue pratiquement aucun rôle opérationnel dans la consultation des corps intermédiaires, qui préfèrent s’adresser directement au Gouvernement et au Parlement pour faire valoir leurs avis et préoccupations.
Je n’évoquerai pas la déclinaison régionale du CESE que sont les CESER, dont l’apport réel dans l’élaboration des politiques régionales est tout à fait illusoire ou marginal. À l’occasion de l’examen de la loi NOTRe, j’avais d’ailleurs déposé des amendements visant à supprimer ces instances.
Sans remettre en cause son indépendance, la qualité de ses membres ou la pertinence de certains de ses avis, il convient, au vu de ce diagnostic, de s’interroger sur l’utilité du CESE.
Cette prolongation du mandat de ses membres permettra quand même de donner une chance à la réforme envisagée, et même souhaitée, par le Président de la République. Elle donnera sans doute lieu dans cette enceinte à des débats animés, qui pourraient entre autres révéler un goût très modéré du Sénat pour la démocratie du tirage au sort.
Dans cette attente, le groupe du RDSE approuve le texte de prorogation qui nous est proposé.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. - M. Yves Détraigne applaudit également.

Monsieur le garde des sceaux, ce n’est pas sans émotion que je m’exprime devant vous ce matin. Je vous ai beaucoup lu, écouté et regardé ces dernières années, et je n’imaginais pas que vous seriez un jour amené à m’écouter quelques minutes !
Madame la présidente, mes chers collègues, le projet de loi organique qui nous rassemble aujourd’hui, nonobstant son caractère formel, n’est pas un texte mineur. Aux termes de l’ordonnance du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, le mandat de ses membres, d’une durée de cinq ans, arrivera à échéance le 14 novembre prochain. Or, le 7 juillet dernier a été présenté en conseil des ministres un projet de loi organique réformant le CESE. Ce texte prévoit notamment, en son dernier article, que ses dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Le calendrier ne permettra pas que cette réforme puisse être adoptée et promulguée, à l’issue d’un débat approfondi puis d’une décision du Conseil constitutionnel, avant l’expiration du mandat des membres actuels du CESE. Le Conseil d’État a, en outre, souligné dans son avis la nécessité que le Gouvernement prépare les décrets d’application concomitamment aux travaux parlementaires sur cette réforme, ce qui implique un enjeu de temporalité qui ne peut être éludé.
Toutes ces raisons ont conduit le Gouvernement à soumettre à nos voix le présent texte, qui vise donc à proroger le mandat des membres du CESE jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique réformant cette institution, et au plus tard jusqu’au 1er juin 2021, soit une prorogation maximale de six mois et demi, de nature à satisfaire la stricte proportionnalité de cette mesure à l’objectif d’intérêt général.
Comme le souligne l’avis du Conseil d’État, une telle prorogation ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ni conventionnel. Une précédente prorogation avait d’ailleurs été validée dans le cadre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, pour une durée qui était supérieure.
Cette simplicité apparente du dispositif appelait en réalité une certaine approche de la Haute Assemblée, et plus spécifiquement de notre rapporteur, la raison d’être du texte étant directement liée à la perspective de l’examen ultérieur d’un projet de réforme. Refuser le principe d’une prorogation aurait conduit à s’opposer a priori à la tenue d’un débat sur la réforme du CESE. A contrario, accepter cette prorogation était irréductible à l’expression d’une position sur le contenu de la réforme. Cela ne préjuge en rien du positionnement sur le fond, certes, mais témoigne en revanche – je voudrais saluer sur ce point notre rapporteur, Jean-Yves Leconte – d’une volonté que puisse se tenir un débat sur l’évolution de cette assemblée consultative animée par la culture du consensus, qui ne peut être négligée.
L’existence même de cette réflexion, au-delà du contenu du projet de réforme, est invoquée depuis un temps certain, non seulement par le Président de la République et par le Gouvernement, mais également par le CESE lui-même. La part croissante et paradoxale des autosaisines, qui devrait atteindre 80 % en 2020, nous y invite en tout cas, de même que la nécessité de réaffirmer la place de cet organe consultatif dans les institutions, face, tantôt à la défiance, tantôt à l’insuffisante connaissance dont elle peut faire l’objet aujourd’hui.
Je salue donc l’adoption par notre commission des lois, sur proposition de notre rapporteur, du présent texte de prorogation. Je veux également saluer la coordination à laquelle il a procédé, formelle certes, mais qui fait pleinement sens et ne pouvait pas ne pas être, notamment au regard du rôle récent de l’institution dans l’organisation de la Convention citoyenne pour le climat. Il nous sera, enfin, présenté tout à l’heure une clarification rédactionnelle qui paraît bienvenue.
En conclusion, mes chers collègues, je n’allongerai pas plus mon intervention en m’attardant sur le contenu de la réforme, qui n’est pas l’objet de nos échanges du jour.
Les prochains mois nous permettront de débattre en profondeur, avec le sens et l’intelligence de la prudence qui caractérisent la Haute Assemblée, des interrogations qui parcourent nos travées sur plusieurs points.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, le groupe La République En Marche votera ce projet de loi organique de prorogation. Il ouvre la possibilité prochaine de « frotter et limer notre cervelle contre celle d’autrui », pour reprendre la formule si juste de Montaigne, afin de trouver ensemble les modalités d’une juste conciliation entre les différentes expressions de la démocratie et de l’aspiration à la chose publique.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux, pour la seconde fois cette semaine, saluer la gratitude du Sénat, qui m’offre dix minutes de temps de parole, alors qu’une seule serait déjà de trop pour dire qu’il est inutile de répéter ce que tous les collègues ont excellemment exprimé, à savoir qu’il est judicieux de proroger d’un an le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental !
Je pourrais en rester là, mais ce serait tout de même désobligeant pour notre institution, qui a bien voulu me gratifier des neuf minutes qui restent. §Je vais donc les occuper, au moins en partie – je vous rassure, mes chers collègues ! – pour renforcer, si je le puis, les propos du président de la commission des lois, lequel a beaucoup insisté, comme d’autres orateurs, sur le fait que le vote d’aujourd’hui n’engageait aucun assentiment à l’égard du texte de fond que vous avez présenté devant le conseil des ministres, monsieur le garde des sceaux.
Permettez-moi de développer quelques arguments à l’appui de ce propos. Nous pourrons ainsi, durant la période moins chargée qui s’annonce, poursuivre la réflexion et être parfaitement au point à la rentrée.
Monsieur le ministre, vous avez dit qu’il s’agissait du premier texte que vous souteniez devant le conseil des ministres. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le lire…

Je vous en félicite !
Il est dit, dans l’exposé des motifs, que le Conseil ainsi rénové offrira, tant au Gouvernement qu’au Parlement, un regard tourné vers l’avenir…

Je m’en réjouis, mais une telle rédaction semble présupposer que le regard du Gouvernement, mais aussi de l’Assemblée nationale et du Sénat, ne serait point tourné vers l’avenir…
Nous avons une délégation à la prospective, présidée par l’excellent Roger Karoutchi et, chaque fois que nous débattons d’une loi, nous essayons de penser à ses effets à court, moyen et long terme. Par conséquent, pour reprendre les termes que vous avez employés dans votre exposé des motifs, nous pensons aux « générations qui nous succéderont ».
Peut-être pourrions-nous convenir que le Sénat, l’Assemblée nationale, le Conseil économique, social et environnemental – et même le Gouvernement ! – songent à préparer l’avenir et celui des générations qui nous succéderont. C’est un peu une pétition de principe, j’en conviens, mais ce n’est que mon premier point… J’en viens au second !
Sourires.

Ainsi que Mme Éliane Assassi l’a excellemment souligné, l’article 6 est étrange. Lorsque le Gouvernement décidera de consulter le Conseil économique, social et environnemental sur un projet portant sur les questions économiques, sociales et environnementales, le Gouvernement ne procédera pas aux consultations prévues en application des dispositions législatives et réglementaires, sauf exception nommément indiquée, dispose-t-il en substance.
À la lecture de cet article, monsieur le ministre – je n’imagine pas que vous ayez pu rédiger l’intégralité du projet de loi en une nuit… –, vous n’avez sans doute pas manqué de penser qu’il demanderait vérification et discussion. Est-il vraiment sage de maintenir cet article 6 ? Nous avons, mes chers collègues, l’été pour y réfléchir…
Je voudrais ensuite évoquer la question du tirage au sort.
Il a déjà été fait référence à l’Antiquité, mais je dois dire que, pour ma part, je suis tout à fait hostile à l’idée du tirage au sort. La politique consiste à choisir des hommes et des femmes qui défendent des positions et s’engagent sur des programmes et des projets. Il est très différent d’utiliser une procédure aléatoire, qui correspond finalement à ce que font les sondages, comme notre rapporteur, Jean-Yves Leconte, que je salue, l’a parfaitement indiqué.
J’en profite pour vous dire, monsieur le garde des sceaux, que le Sénat a adopté une excellente proposition de loi sur les sondages, dont les dispositions ont finalement été insérées dans un texte relatif à l’élection présidentielle. Ces dispositions sont malheureusement détournées en ce qui concerne la publication d’informations sur la marge d’erreur. Or c’est évidemment un point extrêmement important : on ne peut pas interpréter un sondage si l’on ne considère pas la marge d’erreur ! Dire qu’un candidat obtiendrait 51 % et l’autre 49 % ne signifie rien, puisque la marge d’erreur est de 2 ou 3 points. Un tel sondage n’a aucune valeur prédictive, ni absolue ni relative.
C’est pour cette raison que le Parlement a décidé que la marge d’erreur serait indiquée lors de la première publication d’un sondage. Or, si les instituts de sondage respectent indiscutablement cette règle, il arrive régulièrement que la première publication soit en réalité diffusée sur un site internet que personne ne regarde. Par conséquent, la loi perd de son sens. C’est pourquoi j’ai déposé une proposition de loi visant à réformer la rédaction de cette disposition.
Pour revenir à notre débat, je vous ai dit que j’étais en désaccord avec la procédure du tirage au sort, mais j’appelle votre attention sur la rédaction de l’article 4 du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental que j’ai eu la curiosité de regarder. Je ne sais si vous avez présenté ce texte à votre corps défendant, mais je vous lis une phrase de cet article : « Les modalités du tirage au sort permettent d’assurer une représentation appropriée du public concerné. » Mes chers collègues, le Gouvernement va vous demander de vous prononcer sur cette phrase tout à fait remarquable.
Sourires.

Tout d’abord, on ne sait pas quel est le public concerné. Ensuite, je ne vois pas comment un tirage au sort peut aboutir à une représentation « appropriée ». Je n’aurai que deux questions à ce stade : à quoi cette représentation est-elle appropriée ? Comment conjuguer l’aléatoire et une représentation dite appropriée ? Cette phrase est vraiment étrange !
Nous avons l’été pour méditer sur ces questions. Vous le ferez peut-être de votre côté, monsieur le garde des sceaux, …

… ce qui pourrait vous conduire à déposer un amendement de suppression de tout cela…
Je termine sur une note plus positive pour vous dire que je me réjouis que le projet de loi organique acte la disparition des personnalités dites qualifiées.

Cette formulation avait quelque chose d’un peu étonnant : elle semblait présupposer que les autres personnalités ne fussent point qualifiées, ce qui est assez étrange… Il est vrai que, si quelqu’un avait un peu de temps pour réaliser un mémoire – je ne dirais pas une thèse – sur la sociologie des personnalités qualifiées désignées au fil du temps par les pouvoirs exécutifs de toutes tendances, on trouverait assurément matière à réflexion. Mais je n’en dirai pas plus… En tout cas, il est sage que le Conseil économique, social et environnemental soit constitué de représentants effectifs des différentes forces économiques, sociales et environnementales de notre pays.
Mes chers collègues, il me reste à vous dire que le groupe socialiste et républicain votera très volontiers ce texte et à vous remercier de votre bienveillante attention.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Yves Détraigne applaudit également.
Je voudrais répondre très brièvement à M. le rapporteur Leconte et à M. le sénateur Sueur.
Je n’entends pas abuser de mon temps de parole, qui est illimité, car les choses me paraissent à ce stade assez simples et la discussion de fond, vous le savez, aura lieu ultérieurement.
Monsieur le rapporteur, la question de la prolongation des activités des personnalités associées relève du champ réglementaire et pourra être réglée par décret simple.
S’agissant du tirage au sort, il vous vient à l’esprit le sondage, il me vient à l’esprit la cour d’assises, qui n’est pas qu’aléas, même si cela l’est un peu, car c’est la part d’incertitude liée à tout tirage au sort.
J’entends votre avertissement, monsieur le sénateur Sueur. Un homme et un ministre avertis en valent deux !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Vous me prévenez de la possible âpreté des débats à venir. Je vois que vous vous êtes emparé de ce texte, que je me suis contenté de lire et dont je ne suis pas, vous l’avez souligné avec beaucoup d’honnêteté, le rédacteur. J’ai entendu les leçons du sénateur et celles du professeur de linguistique que vous êtes et, même si la formule peut être déplaisante, j’essaierai – pour l’avenir – de les retenir.
M. Didier Rambaud applaudit.

La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission.

Je voudrais d’abord apporter mon témoignage en faveur du Conseil économique et social devenu Conseil économique, social et environnemental.
À la fois en tant que parlementaire et, dans une vie antérieure, au service de l’État, j’ai observé à de nombreuses reprises la qualité des rapports produits par le Conseil. J’attribue cette qualité au fait qu’il est une forge du dialogue social et que tous les arguments venant de l’ensemble des sphères économiques, sociales et associatives sont pris en compte. J’ai aussi pu observer à de nombreuses reprises qu’à l’abri des projecteurs les débats qui se déroulent au Conseil économique, social et environnemental, notamment ceux qui se déroulent en marge des séances ou au sein des commissions, permettent aux organisations syndicales et patronales et aux associations de rapprocher leurs points de vue, alors que, dans d’autres enceintes, ces organisations s’opposent.
C’est dire que je crois que le général de Gaulle, quand il a souhaité la création de cette institution, a bien fait de vouloir que, à côté du Parlement, qui seul représente la Nation dans sa diversité, il y ait non pas une chambre ou une assemblée, mais un conseil qui puisse être le réceptacle de l’expression de ce qu’on appelle dans notre pays les forces vives.
Pour autant, ce n’est pas parce que l’on est reconnaissant au Conseil économique, social et environnemental de son travail au service du pays que l’on doit se laisser entraîner vers des dérives qui seraient, je dois le dire, assez toxiques pour le respect des valeurs fondamentales de la démocratie.
Je souhaite tout d’abord dire que le Conseil économique, social et environnemental ne fait pas partie du Parlement. La Constitution mentionne des institutions, dont le statut est varié, et le Conseil économique, social et environnemental est une instance consultative qui permet de prendre en compte les points de vue divers de ceux qui représentent l’économie et la société. C’est un rôle important, mais le Conseil économique, social et environnemental doit rester à sa place s’il veut que sa légitimité soit pleinement assurée. Cette légitimité ne saurait être concurrente de celle de la représentation nationale, mais seulement complémentaire.
J’espère que, sur ce point, le Gouvernement et nous pourrons converger, car il me semble qu’il existe un risque de dévalorisation de nos institutions démocratiques lorsque l’on prétend qu’il y aurait dans notre pays trois assemblées représentatives, dont les présidents à égalité de dignité pourraient être une sorte de collectif et consultés à l’envi par le pouvoir exécutif. Cette confusion risque d’être assez toxique, je le redis, et je crois qu’il faut y mettre le holà.
Le point que je souhaite évoquer ensuite est plus important encore de mon point de vue : c’est la qualité démocratique que l’on prête à cet instrument curieux qu’est le tirage au sort.
En ce qui me concerne, je n’ai pas suffisamment d’imagination pour considérer que le tirage au sort aurait une quelconque supériorité par rapport à l’expression du suffrage universel. Si ce que je dis est le produit d’une idéologie conservatrice, voire réactionnaire, il faut m’en informer immédiatement !

J’ai peut-être, en déformant la réalité historique, tant et tant admiré ceux qui se sont battus pour permettre à nos pères, puis à nos mères de s’exprimer par le suffrage universel pour former cette volonté générale que le Parlement doit incarner que j’ai vraiment du mal à mettre à jour mes conceptions démocratiques et que je n’arrive pas à entrevoir la valeur démocratique du tirage au sort.
Qui plus est, le tirage au sort que l’on a mis en œuvre à travers ce qu’on a appelé de manière si prétentieuse la Convention citoyenne n’est pas un tirage au sort dont les effets seraient naturels.
Premièrement, parce que l’on a mêlé au tirage au sort les techniques des enquêtes d’opinion, c’est-à-dire la constitution d’échantillons représentatifs. Par conséquent, ce tirage au sort n’était pas totalement, comme pour les jurés d’assises, le fruit du hasard.
Deuxièmement, parce que les personnes tirées au sort se sont, dans leur écrasante majorité, récusées, ce qui fait que, en quelque sorte – pardonnez-moi cette expression triviale –, il n’y a que le fond du panier qui soit resté et qui ait pu participer au travail organisé au sein de cette instance.
Troisièmement, il faut tout de même rappeler que les personnes tirées au sort – 150 sur 66 millions d’habitants – représentent 1/440 000 de la population française et n’ont reçu aucun mandat de personne. Par conséquent, il n’est pas démocratique, disons-le haut et fort, de postuler par avance que le fruit de leurs travaux devrait être repris par l’exécutif ou le Parlement ou soumis au suffrage universel par la voie du référendum pour une sorte de validation par oui ou par non sans délibération.
À ce stade de notre débat sur le Conseil économique, social et environnemental, il est donc important d’exprimer les plus expresses réserves sur l’utilisation de l’outil du tirage au sort, qui peut aussi apparaître comme une sorte de gadget. Il ne faudrait pas mettre sous le couvert de l’innovation démocratique ce qui ne serait en réalité qu’une grave régression.
Dans ces conditions, pourquoi la commission des lois a-t-elle accepté d’entrer dans ce débat ? Tout simplement, parce que c’est notre rôle. Nous sommes prêts à discuter !
Si nous votions contre ce texte qui prolonge le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental et que le Parlement décidait de diminuer le nombre de membres de cette institution, cette diminution n’interviendrait qu’après le renouvellement, par conséquent à l’issue seulement du nouveau mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental. Elle interviendrait donc bien après l’élection présidentielle et les élections législatives, alors que les autorités démocratiques pourraient avoir changé d’avis depuis longtemps. Cela ne serait pas raisonnable.
Ainsi, indépendamment de la question du tirage au sort – ma position sur ce sujet est définitive, et je n’en changerai pas –, je ne veux pas priver le Gouvernement, s’il le souhaite vraiment, de la possibilité de faire aboutir l’idée de baisser l’effectif du Conseil économique, social et environnemental.
J’ajoute que je trouve très déplaisant à l’égard des Présidents de la République et Premiers ministres de considérer que les nominations de personnalités qualifiées qu’ils ont décidées depuis le début de la Ve République ont eu pour seuls objectifs de recaser des battus du suffrage universel ou de faire plaisir à tel ou tel proche du pouvoir. C’est désobligeant, et je crois que ce n’est pas exact. D’une certaine manière, adresser ce reproche aux Présidents de la République et aux Premiers ministres revient aussi à l’adresser aux responsables des organisations syndicales et patronales, qui pourraient également être tentés de procéder à de tels reclassements. Il faudra aussi être attentif à ce point ; la présence d’experts au Conseil économique, social et environnemental n’est peut-être pas une si mauvaise idée.
Madame la présidente, j’ai abusé de mon temps de parole, mais je voulais donner l’éclairage du président de la commission des lois sur ce débat. Approuver le report de la fin du mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental ne signifie pas la signature d’un chèque en blanc sur la réforme de ce Conseil.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et Les Indépendants. – M. Jean-Marc Gabouty applaudit également.
Le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental est prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental et, au plus tard, jusqu’au 1er juin 2021.

L’amendement n° 1, présenté par M. Leconte, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Remplacer le mot :
relative
par les mots :
résultant de l’adoption du projet de loi organique relatif
2° Après la seconde occurrence du mot :
environnemental
insérer les mots :
délibéré en conseil des ministres le 7 juillet 2020
La parole est à M. le rapporteur.

Comme l’a indiqué notre collègue Christine Lavarde, un report de la fin du mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental a déjà été décidé en juillet 2009 pour mettre en œuvre la réforme qui a suivi la révision constitutionnelle de 2008. Pour éviter toute confusion entre les différents projets de loi passés et en cours, nous proposons d’ajouter les mots : « délibéré en conseil des ministres le 7 juillet 2020. » Il s’agit donc d’un amendement de précision.
C’est un amendement de clarification. Le Gouvernement y est favorable.
L ’ amendement est adopté.

Je constate que l’amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Je mets aux voix l’article 1er, modifié.
L ’ article 1 er est adopté.
À la fin de l’intitulé de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : «, social et environnemental ». –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble du projet de loi organique prorogeant le mandat des membres du Conseil économique, social et environnemental.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 145 :
Le Sénat a adopté.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Madame la présidente, je sollicite une suspension de séance de quelques minutes.

Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques minutes.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinquante-cinq, est reprise à midi.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine (texte de la commission n° 674, rapport n° 673).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteure.

Madame la présidente, chère Catherine, je voudrais juste te dire que tu vas me manquer. Depuis que je siège ici – cela fait trois ans –, tu es un modèle pour moi.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le Sénat est appelé ce matin à examiner les conclusions de la commission mixte paritaire qui s’est réunie hier après-midi pour élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
J’ai déjà insisté dans cet hémicycle, il y a seulement deux jours, sur l’utilité de ce texte. En effet, d’ici à 2022, plus de 150 terroristes sortiront de détention, alors que les pouvoirs publics ne sont pas dotés aujourd’hui des moyens juridiques suffisants pour assurer leur surveillance efficace. Il nous fallait donc agir avec célérité et efficacité : c’est l’ambition de cette proposition de loi.
En première lecture, députés et sénateurs ont travaillé dans un état d’esprit identique en vue d’un objectif commun. Cela explique que nous soyons parvenus à trouver sans difficulté un compromis sur les quelques points de divergence qui subsistaient entre nous. Sur ce sujet majeur pour la sécurité de notre pays, il était d’ailleurs essentiel que l’Assemblée nationale et le Sénat affichent leur unité, comme ils l’ont toujours fait jusqu’à présent en matière de lutte contre le terrorisme. Il me semble que le contraire aurait été difficilement concevable pour nos concitoyens.
Au terme de cette commission mixte paritaire, nous avons confirmé notre préoccupation commune d’introduire un dispositif efficace tout en restant protecteurs des libertés. L’exercice n’était pas aisé, mais je suis convaincue que nous sommes parvenus, ensemble, à un texte équilibré.
La commission mixte paritaire s’est tout d’abord accordée sur une série de garanties visant à assurer la conformité à la Constitution de la mesure de sûreté.
Parmi ces garanties, on relève en particulier la limitation du champ de la mesure aux personnes condamnées à des peines lourdes, supérieures à cinq ans d’emprisonnement, ou trois ans en cas de récidive, comme l’avait souhaité le Sénat. Il s’agit d’un élément essentiel, qui est de nature à renforcer la proportionnalité du dispositif.
S’agissant de la durée de la mesure, la commission mixte paritaire a également fait le choix de la sécurité juridique en revenant à la durée d’un an qui figurait dans la version initiale de la proposition de loi. Nous nous étions montrés favorables à une durée plus longue, de deux ans. Toutefois, les échanges que nous avons pu avoir avec les différents acteurs judiciaires ont permis de lever les craintes qui étaient apparues quant aux contraintes procédurales.
Au vu de ces éléments, la solution finalement adoptée me semble donc satisfaisante, dès lors qu’elle ne risque pas de nuire à l’applicabilité de la mesure, ce qui était ma principale préoccupation.
La commission mixte paritaire a également trouvé un compromis sur l’articulation de la mesure avec les dispositifs de suivi existants ; ce compromis garantit que la mesure ne sera prononcée que lorsqu’elle est strictement nécessaire et adaptée au suivi de ces profils.
Enfin, l’ensemble des garanties procédurales introduites au cours des travaux parlementaires afin de garantir les droits de la défense comme le droit à un recours juridictionnel effectif ont été conservées. S’agissant plus particulièrement de la modification des obligations en cours d’exécution de la mesure, une rédaction de compromis a été trouvée, qui maintient une collégialité pour les modifications importantes tout en conférant une capacité d’adaptation au juge de l’application des peines.
La commission mixte paritaire a également été guidée par le souci d’élaborer un texte opérationnel.
Elle a tout d’abord retenu la définition de la dangerosité que le Sénat avait adoptée.
En ce qui concerne le contenu de la mesure de sûreté, la commission mixte paritaire a conforté notre volonté de renforcer – c’est important – le volet d’accompagnement à la réinsertion, qui était absent du texte initial. Les obligations nouvelles introduites par le Sénat ont donc été conservées.
De la même manière, l’intervention du service pénitentiaire d’insertion et de probation a été maintenue. Il s’agit d’un apport auquel j’étais personnellement très attachée et qui est essentiel, à mes yeux, si nous voulons gérer efficacement ces profils et prévenir la récidive.
Sur ce point, je voudrais également préciser que la commission mixte paritaire a réservé la compétence du suivi des mesures au juge de l’application des peines spécialisé en matière de lutte antiterroriste plutôt qu’au juge territorialement compétent. Il s’agit d’un choix de cohérence et d’efficacité qui permettra un suivi spécialisé et adapté aux profils concernés.
Sur l’obligation de placement sous surveillance électronique mobile, la commission mixte paritaire a retenu, pour l’essentiel, la rédaction du Sénat, à laquelle elle a reconnu une plus grande opérationnalité. Elle a en revanche rétabli la possibilité d’un cumul avec une obligation de pointage par semaine. Votre amendement, monsieur le garde des sceaux, a ainsi finalement connu le succès : vous voyez, tout peut changer !
Sourires.

Enfin, la commission mixte paritaire a conservé l’article 1er bis, introduit par le Sénat, qui prévoit l’inscription des obligations au fichier des personnes recherchées afin de faciliter leur contrôle par les forces de sécurité.
Doter les pouvoirs publics de nouveaux moyens adaptés à la prise en charge des terroristes sortant de détention est une priorité pour la sécurité des Français. L’Assemblée nationale et le Sénat ont su, une fois encore, faire preuve de responsabilité en adoptant, dans un délai très court, ce texte essentiel. Je crois que nous pouvons collectivement nous en féliciter.
Bien entendu, ce texte ne résoudra pas toutes les difficultés. Il ne pourra – je me tourne vers vous, monsieur le garde des sceaux – se substituer aux réformes encore nécessaires pour renforcer l’efficacité des programmes de prise en charge de la radicalisation, en détention comme en milieu ouvert. Il a toutefois le mérite d’apporter un cadre nécessaire pour faciliter la prise en charge de profils encore dangereux. C’est pourquoi je vous invite, mes chers collègues, à adopter le texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Arnaud de Belenet, M. Yves Détraigne et Mme Colette Mélot applaudissent également.
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, non, non et non, je n’ai pas été pris soudain d’une folie liberticide ! Je n’ai pas du tout le sentiment de m’être renié !
Si cette proposition de loi avait consisté à maintenir en détention des condamnés après qu’ils ont purgé leur peine, alors, à l’évidence, je ne l’aurais pas portée.
Mais il est ici question de tout autre chose, n’en déplaise à quelques esprits chagrins. Le condamné a purgé sa peine, il sort de détention, mais un certain nombre d’obligations lui sont imposées par un magistrat de l’ordre judiciaire : il doit les respecter ; sinon, il sera à nouveau incarcéré.
La remise en liberté de détenus condamnés et potentiellement toujours radicalisés, en dépit du travail réalisé, nous met collectivement face à un problème qu’il serait dangereux d’ignorer.
Nous devons tout mettre en œuvre pour garantir la sûreté de nos concitoyens tout en maintenant le pacte républicain, qui repose sur nos libertés fondamentales et inaliénables.
Si je reviens parmi vous aujourd’hui, alors que nous étions déjà ensemble avant-hier, c’est bien parce que le Parlement, tout comme le Gouvernement, a pris la mesure de cet impératif ; cela doit être salué. En effet, la célérité de la commission mixte paritaire et le fait qu’elle soit parvenue, hier après-midi, à un accord solide témoignent de l’engagement du législateur et, en particulier, de la détermination des rapporteures des deux assemblées, Mme la sénatrice Eustache-Brinio et Mme Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l’Assemblée nationale, à faire aboutir ce texte dans les plus brefs délais. Qu’elles en soient ici remerciées !
À l’issue du travail de chacune des deux chambres, qui s’est appuyé sur un avis très étayé du Conseil d’État, il me semble qu’une solution d’équilibre a été trouvée.
L’article 1er de la proposition de loi introduit dans le code de procédure pénale un dispositif permettant au juge judiciaire d’imposer des mesures de sûreté aux personnes condamnées pour des faits de terrorisme qui ont purgé leur peine d’emprisonnement.
Vous vous êtes attachés à encadrer scrupuleusement ce nouveau dispositif par des garanties qui me paraissent indispensables.
Ainsi, le nouveau dispositif ne peut s’appliquer qu’aux personnes ayant déjà été condamnées pour des actes de terrorisme. Il sera limité aux personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à cinq ans, ou trois ans en cas de récidive. Cet ajout constitue un élément supplémentaire de proportionnalité du dispositif.
La durée initiale de la mesure est fixée à un an. La réévaluation régulière des mesures de sûreté constitue à mon sens une garantie importante pour assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire ; je me réjouis de la décision de la commission mixte paritaire en ce sens.
Il est indispensable de rappeler que c’est l’autorité judiciaire, et elle seule, qui sera compétente pour prononcer, le cas échéant, ces mesures de sûreté. En ce sens, cette loi est un progrès.
En effet, nul n’ignore que les condamnés pour infractions terroristes feraient sans doute l’objet d’un suivi par nos services de renseignements, qui pourrait s’opérer, pour sa part, sans aucune intervention ni aucun contrôle du juge.
Ce texte va au contraire permettre au juge de rendre une décision qui interviendra à l’issue d’un débat contradictoire. Les parties auront ainsi l’opportunité de présenter leurs observations. Le condamné sera assisté d’un avocat et pourra faire appel devant la juridiction compétente.
Vous avez retravaillé le dispositif permettant au condamné de solliciter, à tout moment, la modification ou la mainlevée de ces mesures de sûreté. Le texte prévoit ainsi que le juge de l’application des peines spécialisé en matière terroriste pourra à tout moment adapter les obligations.
Dans son œuvre normative, le législateur a toujours cherché à articuler la spécificité de la criminalité terroriste et les valeurs qui sont les nôtres. C’est également le travail auquel vous vous êtes livrés lors de l’examen de cette proposition de loi.
Je tiens ici à redire qu’il sera essentiel de réaliser une évaluation des dispositifs de prévention de la récidive terroriste dans leur ensemble.
La complexité actuelle peut en effet nuire à l’efficacité de l’action de l’État. Il est nécessaire de proposer une remise à plat des dispositifs existants afin que l’empilement actuel retrouve une cohérence et une lisibilité d’ensemble. C’est au prix d’une telle évaluation que l’action de l’État trouvera sa pleine efficacité, son sens et sa cohérence dans une matière qui n’appelle aucune hésitation : la protection de nos concitoyens.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, permettez-moi en conclusion d’appeler votre attention sur un point. Ceux-là mêmes qui semblent ne pas vouloir admettre l’équilibre auquel vous êtes parvenus dans ce texte sont ceux qui critiqueront demain votre effroyable laxisme lorsqu’un condamné, par malheur, récidivera. Mais n’oubliez pas non plus qu’ils sont aussi ceux que l’on n’entendra plus lorsque cette loi portera pleinement ses effets, à savoir protéger les Français tout en préservant notre modèle de société, les libertés fondamentales et l’État de droit qui le fondent. C’est pourquoi j’apporte ici, comme je le ferai lundi à l’Assemblée nationale, mon soutien le plus entier et le plus clair aux conclusions de vos travaux.
Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC. – M. Arnaud de Belenet applaudit également.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, permettez-moi avant tout de saluer le travail de notre présidente, Mme Catherine Troendlé, avec qui nous avons partagé beaucoup de moments importants et inoubliables au cours des dernières années. Je pense en particulier au groupe d’amitié France-Allemagne, que Mme Troendlé a animé avec beaucoup de diplomatie et de passion.
Les deux chambres du Parlement se sont accordées sur une version commune du présent texte. Nous avons déjà eu l’occasion d’expliquer que nous partageons pleinement l’objectif de cette proposition de loi, qui vise à instaurer des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine. Le terrorisme est une menace qu’il nous faut combattre. Nous avons néanmoins toujours quelques réserves quant aux moyens prévus pour ce faire.
La plus emblématique des mesures de sûreté dont il est question est le port du bracelet électronique, qui n’est en rien une géolocalisation. Cette mesure pourra être ordonnée seulement si la personne concernée y consent. Les autres mesures proposées figurent déjà dans d’autres dispositifs et ne nous paraissent pas suffisantes pour garantir une absence de récidive.
Le gain de sécurité pour les Français nous paraît trop mineur pour justifier le coût juridique de ces mesures. Ce texte a en effet soulevé de nombreuses critiques, notamment de la part des avocats et des magistrats. Ils dénoncent ainsi la contradiction entre ce texte et plusieurs principes juridiques fondamentaux, comme le principe non bis in idem, ou encore celui de non-rétroactivité de la loi pénale.
Dans son avis, le Conseil d’État a qualifié les dispositions envisagées de mesures de sûreté, et non de peines, même s’il reconnaît que, en raison de l’empilement des dispositifs en la matière, la frontière entre peine et mesure de sûreté n’est « pas toujours nette ».
Comme ses mesures sont seulement restrictives, et non privatives de liberté, le Conseil d’État ne voit pas d’obstacle à leur application rétroactive. Il est cependant problématique de relever, dans le même avis, que ces mesures ont vocation à remplir la fonction du suivi socio-judiciaire pour les personnes détenues pour terrorisme qui n’y auraient pas été condamnées. C’est problématique, parce que le suivi socio-judiciaire est une peine complémentaire ; comme toute peine, son application ne devrait pas être rétroactive.
Enfin, l’arsenal juridique permettant de lutter contre le terrorisme a été rendu trop complexe par un empilement de mesures éparses, comme vous l’avez indiqué, monsieur le garde des sceaux. Cette complexité nuit à l’efficacité de l’action de l’État, comme le rappelle le Conseil d’État.
Nous ne souhaitons pas ajouter aujourd’hui une nouvelle mesure exceptionnelle à un arsenal qui souffre déjà d’une trop grande complexité.
Le sujet de la lutte contre le terrorisme mérite toute notre attention et un travail approfondi. Nous souhaitons que les dispositifs existants fassent l’objet d’une évaluation et qu’ils soient, le cas échéant, harmonisés pour être rendus plus efficaces. Nous voulons également davantage de moyens matériels et humains pour la justice et pour les services d’enquête. C’est ainsi que nous pourrons combattre efficacement la menace terroriste.
Plus généralement, il faudra réfléchir, à terme, aux moyens de renforcer l’efficacité de la réinsertion des personnes condamnées. La récidive est l’un des défis les plus importants pour notre politique pénale. Nous devons nous assurer que la sanction pénale concourt à la diminution de la criminalité en permettant la réhabilitation du citoyen.
La présente proposition de loi nous semble être en contradiction avec des principes essentiels de notre droit sans pour autant apporter les solutions nécessaires à la sécurité des Français. Le groupe Les Indépendants s’abstiendra donc majoritairement.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je n’utiliserai pas les six minutes de temps de parole qui me sont offertes, car il me suffit d’une minute pour saluer le travail de la commission mixte paritaire et les apports du Sénat et pour vous dire que le groupe Union Centriste votera en faveur de ce texte.
Cela étant, je vais me livrer un peu au même exercice que notre ami Sueur, même si je ne serai pas aussi brillante que lui.

Je vous remercie, monsieur le président de la commission, pour le crédit que vous accordez à mon talent d’orateur.
Monsieur le garde des sceaux, vous l’avez vous-même indiqué, ces dispositifs devront être évalués. Or la culture de l’évaluation est quelque chose que nous n’avons pas et qui, jusqu’à présent, fait défaut à votre ministère. J’avais insisté avant-hier sur ce sujet ; je vois que vous l’avez repris, ainsi que plusieurs de nos collègues. Tant mieux ! L’évaluation est effectivement essentielle en ces matières. Vous avez parlé de mauvaises habitudes : je crois que le défaut d’évaluation en fait partie.
Vous nous trouverez évidemment à vos côtés sur l’ensemble de ces sujets de sécurité, comme l’a rappelé Mme la rapporteure. Le Sénat a toujours été extrêmement solidaire du Gouvernement, dans les moments difficiles que nous avons traversés, sur les questions de terrorisme, sur l’état d’urgence et sur beaucoup d’autres sujets de ce type.
Permettez-moi d’évoquer brièvement un point qui ne figure pas dans ce texte, mais lui est connexe : le Brexit. Que va-t-il se passer vis-à-vis de ces dispositifs ? Le mandat d’arrêt européen va poser un certain nombre de problèmes, tout comme Europol. Toute la politique de sécurité qu’on renforce n’aura de sens que si on l’exerce à l’échelle européenne. Or, de ce point de vue, le Brexit risque de nous poser des difficultés. Il faut donc y penser et avoir ce problème en ligne de mire : tous ces dispositifs ne fonctionnent qu’à l’échelle européenne, ne serait-ce que du fait de l’existence des questions frontalières.
Monsieur le garde des sceaux, nous nous retrouverons lors de l’examen du prochain projet de loi de finances : nous serons évidemment très attentifs au budget de votre ministère, qui conditionnera la mise en pratique des mesures que nous allons adopter aujourd’hui.
Mme la rapporteure et M. Yves Détraigne applaudissent.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la lutte contre le terrorisme mérite une clarification complète des responsabilités de chacun, de l’autorité judiciaire comme du pouvoir exécutif.
Lorsque nous avons vu les dangers augmenter au cours des années 2010, en particulier entre 2012 et 2015, nous avons fait un certain nombre de choses : en 2014, nous avons créé de nouvelles infractions afin de permettre la judiciarisation de personnes n’étant pas encore passées à l’acte violent et de renforcer ainsi la capacité de l’action judiciaire ; en 2015, la loi relative au renseignement a donné à nos services de renseignement la possibilité de détecter, dans un cadre légal, les risques qui pouvaient exister sur notre territoire. Voilà les deux moments qui ont fait bouger les choses de manière cohérente et rationnelle.
Monsieur le garde des sceaux, vous affirmez vous-même qu’il faut éviter les mesures éparses. Pourtant, le texte que nous examinons aujourd’hui est bien une mesure de plus qui va complexifier et rendre moins lisible la responsabilité de chacun.
Il est question d’une contrainte après la peine, qui serait prononcée quelque temps avant la libération de la personne, et non au moment de sa condamnation. Vous insistez bien sur le fait que ce ne serait pas une peine ; nous vous avons bien compris. Seulement, si c’est clair dans votre esprit, force m’est de constater que, même hier lors de la réunion de la commission mixte paritaire, plusieurs personnes extrêmement impliquées dans ce texte ont utilisé le mot « peine » à la place du mot « contrainte ».

D’autres auraient voulu que ces contraintes s’appliquent à un champ beaucoup plus large. En effet, quand on s’engage dans cette direction, on ne s’arrête jamais !
Or ce texte pose quand même le principe selon lequel on va imposer une contrainte, non du fait d’un acte déjà jugé et pour lequel une peine aura été prononcée, mais par rapport à une dangerosité. Pardonnez-moi, monsieur le garde des sceaux, mais c’est tout de même en contradiction avec votre conviction…

… plusieurs fois rappelée, selon laquelle vous ne voulez pas d’une société où l’on remplacerait la responsabilité et l’acte par la menace que quelqu’un représenterait.
Il est hors de question d’accepter une société où l’on remplacerait la culpabilité par la dangerosité. On supprimerait le code pénal, pour le remplacer par un code de la sûreté !

Vous dites « caricatural », mais je vous réponds que, quand on va dans cette direction, on invite d’autres personnes, qui ont l’esprit moins subtil que vous, à aller plus loin ! C’est pourquoi il faut rester ferme.
Vous avez le sentiment de rester sur une ligne de crête, mais tel n’est pas le cas. Vous pensez peut-être qu’on doit parfois essayer de conjuguer deux principes qui peuvent se heurter, mais je veux vous dire avec toute la conviction possible que l’on n’a pas à conjuguer deux principes qui peuvent se heurter. Le principe à suivre est le suivant : on ne condamne pas deux fois ; il n’y a pas de peine après la peine.
Quant à la disposition en cause ici, elle exprime une disproportion entre la dangerosité que représente la personne et ce qui est possible au travers des autres mesures administratives prévues.
Vous affirmez que ce que vous prévoyez sera mis en œuvre par l’autorité judiciaire.

Seulement, d’autres mesures, plus fortes, peuvent être imposées par l’autorité administrative. Certes, ces mesures-ci seront prononcées par une autorité judiciaire, mais tout leur suivi sera assuré par le juge de l’application des peines. Cela participe aussi à la confusion.
Dès lors, au vu de la disproportion entre les mesures possibles et la dangerosité des personnes, du non-respect du principe du contradictoire – comme je l’ai rappelé lors de notre débat d’avant-hier, l’évaluation d’un danger en matière de terrorisme n’est pas la même chose qu’une expertise psychiatrique ; elle s’effectue sur la base d’informations qu’il serait inutile et probablement dangereux de divulguer – et de la confusion induite entre la responsabilité de l’autorité judiciaire et celle de l’autorité administrative, mon groupe, animé par la conviction que, sur ce texte-ci comme dans bien d’autres cas, le plus efficace serait le retour aux principes de base, votera contre les conclusions de cette commission mixte paritaire.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, les travaux de la commission mixte paritaire ont permis d’aboutir à un texte destiné à soumettre les personnes condamnées pour des actes de terrorisme à des peines supérieures à cinq ans, ou à trois ans en cas de récidive, à un certain nombre de mesures de contrainte au-delà de leurs peines.
Cette proposition de loi est originale, puisqu’elle vise à rassembler sous un régime commun des mesures de nature judiciaire et administrative. Grâce aux modifications introduites par la Haute Assemblée, elle permet une clarification bienvenue, alors que l’ensemble des initiatives législatives intervenues après 2015 ont parfois conduit à complexifier, en les diversifiant, tous les moyens juridiques de lutte contre le terrorisme.
Précisément, il s’agit de pouvoir obliger ces personnes à répondre aux convocations d’un juge, à recevoir la visite du service pénitentiaire d’insertion et de probation, à avertir ledit service en cas de changement d’emploi ou de résidence, à exercer une activité professionnelle ou à se former, à établir leur lieu de résidence en un lieu, à se soumettre à une autorisation préalable du juge pour tout déplacement à l’étranger, à se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie et à s’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes ou de paraître en certains lieux.
Cela inclut également, et ces ajouts pertinents sont à mettre au crédit de la commission des lois de notre assemblée, l’interdiction de détenir ou porter une arme – cela paraît une évidence –, l’obligation de se soumettre à un suivi sanitaire, social, éducatif ou psychologique, ou encore l’interdiction de se livrer à une activité en lien avec le contexte de l’infraction commise.
La commission d’enquête sur la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre, dont vous avez également été la rapporteure, madame Eustache-Brinio, a en effet montré à quel point certains milieux, notamment le milieu sportif, étaient devenus des terrains de recrutement privilégiés du djihadisme. Cette dernière disposition paraît donc tout à fait pertinente.
En définitive, aucune de ces mesures ne peut être assimilée à une peine, même si les condamnés ou les anciens condamnés peuvent le vivre différemment, ce qui écarte l’inquiétude d’instaurer « une peine après la peine ». Cette préoccupation justifiait notamment d’écarter la possibilité de soumettre ces personnes au port d’un bracelet électronique pour rester dans le cadre de conventionnalité défini par la Cour européenne des droits de l’homme.
En outre, les modifications introduites au Sénat ont également le mérite de rapprocher ces mesures de l’objectif de réinsertion de ces détenus particuliers, dimension moins présente dans le texte initial de nos collègues députés.
Nous nous félicitons enfin que la durée initiale des mesures ait été réduite à un an, au lieu de deux ans, comme nous l’avions proposé. Cette évolution s’ajoute à un encadrement plus raisonnable de la durée totale des mesures de sûreté susceptibles d’être mises en œuvre, ce qui est également bienvenu. Nous serons vigilants à l’application de ces mesures et à la façon dont les magistrats s’approprieront ce nouvel instrument. Nous gardons en effet en tête la difficulté avec laquelle s’est mise en place la rétention de sûreté, actionnée seulement cinq fois entre 2011 et 2015.
L’équilibre entre la nécessité de protéger l’ensemble de la population et le respect des droits de la personne condamnée ressort grandi de l’ensemble de nos débats. C’est pourquoi, dans sa majorité, le groupe du RDSE votera pour le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – M. Yves Détraigne applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, en cette fin de session, il est particulièrement agréable de constater ce petit miracle d’intelligence collective, miracle qui a demandé courage et ténacité. Je veux saluer l’effort accompli à la fois par la majorité de l’Assemblée nationale, la majorité sénatoriale et la Chancellerie pour protéger les Français dans le respect de notre État de droit.
Réunir ces deux objectifs de protection et de respect de notre État de droit était difficile. Il n’est qu’à voir les positions qui ont été exprimées ici au cours de nos débats : la frange de la droite extrême, représentée par l’un de nos collègues, a dénoncé l’inefficacité du dispositif, en s’affranchissant allègrement – cela ne laisse pas de nous surprendre – des contraintes de l’État de droit ; l’aile gauche de notre hémicycle – pardonnez-moi la formule, vous mettrez cela sur le compte de la fatigue de la fin de la session – s’est positionnée en gardien zélateur du temple constitutionnel…

… et a dénoncé une atteinte aux libertés, en s’affranchissant de l’efficacité du dispositif.

Peut-être que le souci de faire de la politique a primé sur le souci de faire bien.

Il était sans doute tentant de profiter de la notoriété et de l’intérêt médiatique d’un nouveau garde des sceaux pour essayer d’exister.

M. Arnaud de Belenet. En vérité, je le confesse, je suis en pleine forme !
Sourires.

Chers collègues, cet effort d’intelligence collective a demandé du courage et, à l’exception de quelques réfractaires, un compromis a émergé de nos débats, qui permet d’assurer la sécurité juridique du dispositif, sans renoncer à son efficacité. Il suffit de regarder le contenu du texte : le rétablissement de la durée initiale d’un an de la mesure de sûreté, la référence à une durée minimale de la peine d’emprisonnement comme condition du prononcé des obligations de la mesure de sûreté, le caractère opérationnel avec le placement sous surveillance électronique mobile qui pourra être cumulable avec l’obligation de pointage réduite, le cas échéant, à une fois par semaine.

Par ailleurs, il m’apparaît nécessaire de redire que le placement est explicitement subordonné au consentement de la personne, dans le respect de la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
J’espère bien que personne ne dénoncera un éventuel laxisme, puisque ce risque a été souligné précédemment.
Voilà une nouvelle mesure de sûreté qui donne la faculté au juge, dans le respect du contradictoire, redisons-le, d’appliquer des obligations en matière de surveillance et de suivi aux condamnés pour terrorisme présentant à l’issue de leur peine une particulière dangerosité.
Ce texte renforce, et c’est là l’essentiel, la mise en œuvre du suivi socio-judiciaire en vigueur et l’insertion. Voilà un beau texte, responsable, raisonnable, efficace autant qu’il est possible de l’être. Je veux saluer encore une fois ce succès collectif.
Chacun des orateurs précédents a conclu son intervention en évoquant le budget de la Chancellerie. Je note que la trajectoire budgétaire induit une hausse qui, cumulée sur l’ensemble de la période concernée par nos lois d’orientation, laisse envisager une progression de 25 %, ce qui, nous l’avons indiqué par honnêteté voilà deux ans, est tout à fait inattendu et exceptionnel. Toutefois, je note aussi, peut-être par un excès naïf de sincérité – second péché avoué à cette tribune §–, qu’un autre défi attend le garde des sceaux, celui de l’organisation de la Chancellerie. Beaucoup ont évoqué à cette tribune la question du budget de la Chancellerie, je m’en serais voulu de ne pas évoquer celle de son organisation et de son efficience.

M. Arnaud de Belenet. Je vous remercie, chers collègues, du grand bonheur que nous aurons, à quelques exceptions près, à approuver ce texte, bonheur partagé par le groupe La République En Marche.
Mme Colette Mélot applaudit.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je ne répondrai pas aux provocations de l’orateur précédent. J’aurai d’autres occasions de le faire. Je me concentrerai sur le texte qui nous réunit ce matin, dans sa rédaction finale issue des travaux de la commission mixte paritaire hier soir.
Je m’attarderai un instant sur les conditions d’examen dans lesquelles nous travaillons, qui sont de moins en moins sérieuses, et sur l’ordre du jour qui est toujours plus resserré. Croyez bien que nous le regrettons, et nous ne sommes sans doute pas les seuls. Par ailleurs, je signale qu’il y a encore quelques minutes le rapport de la commission mixte paritaire n’était toujours pas en ligne, ce qui n’est pas propice à un travail de qualité. Or, monsieur le président de la commission des lois, vous connaissez notre rigueur en la matière ici, au Sénat.

Sauf si cela m’a échappé, il semble qu’au regard du texte final dont j’ai eu connaissance très peu d’évolutions ont été apportées à l’ensemble du dispositif de mesures de sûreté proposé. Aussi, de toute évidence, nous conservons notre position initiale sur le sujet.
Les mesures qu’instaure cette proposition de loi sont pour nous problématiques, voire dangereuses, et source de dérives à bien des égards, n’en déplaise à certains.
Le fait même d’avoir à réfléchir en catastrophe à la marche à suivre pour gérer la sortie de condamnés pour des actes de terrorisme, alors même que 31 condamnés seront libérés cette année et 62 l’année prochaine, est révélateur du manque de vision des lois que nous votons et des échéances que nous repoussons sans cesse en adoptant des dispositifs de circonstances.
Selon nous, toutes les mesures de contrôle et de surveillance d’individus enclins à la récidive à l’issue de leur peine existent déjà. Or leur inapplicabilité aux auteurs d’infractions en lien avec le terrorisme a été créée de toutes pièces en 2016 avec la loi Urvoas.
Je persiste à penser que la philosophie globale du dispositif proposé n’est pas la bonne, aussi circonstanciées que soient les obligations qui pourront être assignées aux condamnés qui auront purgé leur peine.
Certes, la commission des lois du Sénat, fidèle à sa réputation de défenderesse des libertés publiques, a globalement réécrit le texte dans le bon sens, en posant par exemple un jalon de cinq ans minimum de peine pour les condamnés visés ou encore en renforçant le volet réinsertion de la proposition de loi. Reste que la commission des lois du Sénat, bien ancrée dans la tradition sécuritaire de la droite sénatoriale majoritaire, a élevé à deux ans la durée initiale des mesures de sûreté qui seront décidées et a rendu encore plus floue la notion de dangerosité qui permettra de juger la marche à suivre pour tel ou tel condamné.
Certes, il ne s’agit pas d’une rétention de sûreté, nous l’avons bien compris, mais il s’agit bel et bien d’imposer à des condamnés qui ont purgé leur peine d’autres mesures contraignantes au quotidien, comme pour leur signaler qu’aucune confiance ne leur est faite et que leurs faits passés les poursuivront possiblement jusqu’à dix années après qu’ils auront purgé leur peine. Est-ce que cela les convaincra de ne pas récidiver ? Je ne sais pas, mais la question peut être posée.
En parallèle, qu’en est-il des véritables réflexions pour endiguer la radicalisation ? Il n’y a rien.
Qu’en est-il de l’analyse des dispositifs – et ils sont nombreux – déjà mis en place par le passé ? Il n’y a rien.
Le rapport que nous demandions au Gouvernement sur les quartiers de surveillance et de prise en charge de la radicalisation nous a été refusé, pour un motif purement formel. Bien loin d’un exercice de style, il s’agissait bel et bien pour nous de comprendre les tenants et aboutissants de l’échec pénitentiaire auquel nous sommes aujourd’hui confrontés.
Je confirme donc ce matin notre opposition à ce texte.
Monsieur le garde des sceaux, il ne faut pas se méprendre : parmi celles et ceux qui soutiennent ce texte, vous retrouverez demain celles et ceux qui continueront de penser que notre justice est laxiste.

Mme Éliane Assassi. Ceux-là, vous ne les retrouverez jamais – je dis bien « jamais » – au sein de mon groupe.
MM. Jean-Yves Leconte et Jean-Pierre Sueur applaudissent.

Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’ancien procureur de la République de Paris François Molins déclarait, au lendemain des attentats terroristes de 2015, que, « jusqu’alors, le spectre des peines prononcées ne correspondait absolument pas à l’échelle de gravité des comportements ». Le même constat s’impose aujourd’hui s’agissant du traitement des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
Pourtant, dès le 17 décembre 2015, notre groupe, sur l’initiative de Philippe Bas et de Bruno Retailleau, avait déposé une proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la lutte antiterroriste, dont j’étais cosignataire. Je rappelle que l’article 18 de ce texte autorisait le placement sous surveillance de sûreté des personnes condamnées pour terrorisme à l’issue de l’exécution de leur peine, dès lors que serait établie leur particulière dangerosité. Il prévoyait en outre que cette décision serait de la compétence de la juridiction régionale de la rétention de sûreté et qu’elle comprendrait des obligations identiques à celles qui sont prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l’article 723-30 du code de procédure pénale. Il permettait enfin de prononcer le placement sous surveillance électronique mobile des terroristes islamistes, après vérification de la faisabilité technique de la mesure.
Mes chers collègues, que de temps perdu !
Il y a cinq ans maintenant que la quasi-totalité des mesures que nous allons adopter aujourd’hui aurait pu être inscrite dans notre droit positif.
La dernière étude du Centre d’analyse du terrorisme communiquée au Sénat illustre, une fois de plus s’il en était besoin, l’urgence et la gravité de cette question. Elle révèle en effet que le taux de récidive des djihadistes se situe, selon les situations, au-delà de 50 % : un islamiste engagé dans une action violente a toutes les chances de se maintenir dans cette mouvance et de récidiver.
Dès lors, malgré le retard pris, et nous le déplorons, il est urgent d’adapter notre arsenal législatif en matière de traitement post-sentenciel des auteurs d’actes terroristes.
Nous saluons l’accord trouvé hier en commission mixte paritaire. Je tiens à remercier notre rapporteure, Jacqueline Eustache-Brinio, de la qualité de son travail.
Pour l’ensemble des raisons évoquées, je ne doute pas que les membres du groupe LR voteront cette proposition de loi, dans la rédaction issue des travaux de la commission mixte paritaire.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les amendements puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : «, du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;
1° bis A
1° bis L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de sûreté prévues à la section 4 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
1° ter
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mesures de sûreté applicables aux auteurs d’infractions terroristes
« Art. 706 -25 -15. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, aux seules fins de prévenir la récidive, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
« 1° bis Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
« 1° ter Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ou de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour. Lorsque le changement d’emploi ou de résidence est de nature à mettre obstacle à l’exécution de la mesure de sûreté, obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines ;
« 1° quater Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3°
Supprimé
« 4° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 4° bis Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;
« 5° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite de trois fois par semaine ;
« 6° Ne pas entrer en relation avec certaines personnes, notamment les auteurs ou complices de l’infraction, ou catégories de personnes spécialement désignées ;
« 7° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 7° bis Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 8°
Supprimé
« 9° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel la personne concernée est tenue de résider.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« I bis. – Après vérification de la faisabilité technique de la mesure, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut décider du placement sous surveillance électronique mobile de la personne faisant l’objet de l’une ou de plusieurs des obligations mentionnées aux 4°, 6° et 7° du I du présent article, dans les conditions prévues aux articles 763-12 et 763-13. Ce placement est subordonné au consentement de la personne. Il y est mis fin en cas de dysfonctionnement temporaire du dispositif ou sur demande de l’intéressé. La limite mentionnée au 5° est abaissée à une fois par semaine.
« II. – La mesure de sûreté prévue au I peut être ordonnée pour une période d’une durée maximale d’un an. À l’issue de cette période, la mesure de sûreté peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, et pour la même durée dans la limite de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Cette limite est portée à dix ans lorsque les faits commis par le condamné constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement ou, lorsque le condamné est mineur, à cinq ans.
« II bis. – La mesure de sûreté prévue au I ne peut pas être ordonnée à l’encontre des personnes libérées avant la publication de la loi n° … du … instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
« III. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que :
« 1° Si les obligations imposées dans le cadre de l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des infractions mentionnées au premier alinéa du même I ;
« 2° Et si cette mesure apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive.
« La mesure de sûreté prévue audit I n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
« Art. 706 -25 -16. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-15 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues aux fins d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse à la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la surveillance mentionnée à l’article 706-25-15 au vu des critères définis au I du même article 706-25-15.
« Art. 706 -25 -17. – La décision prévue à l’article 706-25-15 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-16, ainsi que des conditions mentionnées au III de l’article 706-25-15.
« Le jugement précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la libération.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier les mesures de sûreté ou ordonner leur mainlevée. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations de la mesure de sûreté.
« Art. 706 -25 -17 -1. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.
« Art. 706 -25 -17 -2. – Les obligations prévues à l’article 706-25-15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706 -25 -18. – Le fait pour la personne soumise à une mesure de sûreté en application de l’article 706-25-15 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Art. 706 -25 -19. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »
L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les obligations ou interdictions prononcées en application des 1° ter, 4°, 4° bis, 6°, 7° et 7° bis du I de l’article 706-25-15 du présent code. »
Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…
Le vote est réservé.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. le président de la commission.

Je remercie les représentants des groupes qui ont apporté leur soutien à cette proposition de loi, laquelle, vous vous en souvenez, mes chers collègues, est issue d’un travail mené par la commission des lois, sous la houlette de Marc-Philippe Daubresse, pour évaluer les mesures prises pour la surveillance des terroristes.
Je m’adresse maintenant aux représentants des groupes qui ne voteront pas cette proposition de loi. Je comprends leur point de vue. À dire vrai, je comprends moins bien celui de nos collègues du groupe socialiste. En effet, si nous n’adoptons pas ce texte, les instruments aux mains de l’État pour surveiller les terroristes sortis de prison resteront au nombre de deux :…

… d’une part, les mesures prises dans le cadre de la loi Collomb pour la surveillance des personnes radicalisées – ce sont des mesures administratives sans contrôle du juge ; d’autre part, les mesures prises dans le cadre de la loi relative au renseignement. Je rappelle que ce texte a été adopté en 2015, sur l’initiative d’un gouvernement socialiste.

J’en étais le rapporteur. Il permet à l’État de mettre en œuvre des mesures très restrictives en matière d’exercice des libertés et très intrusives en matière de vie privée.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mes chers collègues, si vous ne votez pas la proposition de loi qui nous est aujourd’hui soumise, c’est que vous préférez des mesures administratives à des mesures contrôlées par le juge judiciaire. Je comprends que vous les préfériez, puisque c’est le gouvernement que vous souteniez qui les avait proposées, et vous avez bien évidemment contribué à leur adoption par votre vote.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Arnaud de Belenet applaudit également.

Je n’avais pas l’intention d’intervenir en explication de vote, mais j’y suis invité…
Le groupe socialiste a voté la loi relative au renseignement. Ce texte, qui a par ailleurs créé la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, laquelle comptait dans son collège une éminente représentante du Sénat en la personne de Catherine Troendlé, a fait ses preuves.
Comme je l’ai souligné voilà deux jours lors de l’examen de ce texte, monsieur le président de la commission des lois, nous considérons que, par rapport aux mesures qui existent déjà, les nouvelles dispositions prévues risquent de provoquer une sorte d’empilement et une dispersion des responsabilités. Je ne suis pas le seul à le dire : dans son avis, le Conseil d’État a demandé une clarification et une évaluation des mesures déjà prises. D’ailleurs, le garde des sceaux a repris une partie de cet avis dans son discours.
Face aux risques que représente le terrorisme, ce qui importe, ce sont les moyens pour suivre les personnes représentant un danger. Je rappelle que les mesures prévues par cette proposition de loi ne concernent que les sortants de prison condamnés pour terrorisme ; or ils ne sont malheureusement pas les seuls à présenter un risque.
Par ailleurs, nous sommes attachés à la proportionnalité entre le risque que représentent ces personnes et les mesures qui peuvent leur être appliquées. Avec le texte que vous nous invitez à voter, compte tenu de l’empilement des textes et de la confusion des responsabilités, cette proportionnalité n’est pas respectée.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine.
La proposition de loi est adoptée.

Mes chers collègues – je vous remercie tous de vos belles paroles –, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.