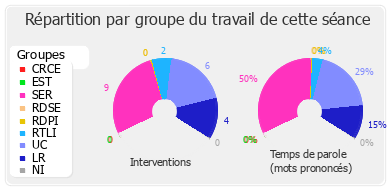Séance en hémicycle du 21 décembre 2010 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Ratification des nominations à une commission mixte paritaire
- Dépôt d'un document en application d'une loi
- Questions orales (voir le dossier)
- Situation des zones ayant une couverture en téléphonie mobile qualifiée d'« acceptable » (voir le dossier)
- Stratégie de déneigement des routes nationales et des autoroutes de l'est de la france (voir le dossier)
- Prise en charge des frais liés aux manifestations sportives culturelles et récréatives (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Jean Grandon, qui fut sénateur d’Eure-et-Loir de 1989 à 1998.
Je présente à sa famille et à ses proches les condoléances attristées de la Haute Assemblée.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.
En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du 17 décembre dernier prennent effet.

M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, l’état semestriel des sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base de sécurité sociale au 30 juin 2010.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des affaires sociales et sera disponible au bureau de la distribution.

La parole est à M. Alain Fauconnier, en remplacement de Mme Anne-Marie Escoffier, auteur de la question n° 1089, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser ma collègue et amie Anne-Marie Escoffier, retenue en Aveyron pour une raison indépendante de sa volonté. Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de bien vouloir répondre à la question qu’elle avait adressée à Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Dans le contexte socio-économique, industriel et financier tendu que connaît notre pays depuis de nombreux mois, l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, ou ACCRE, devait être un moteur et un vecteur de reprise économique, de croissance et de développement d’entreprises nouvelles.
Pourtant, l’attribution du bénéfice de cette exonération de charges sociales est confrontée dans de nombreux cas d’espèce à l’absence de recours efficace contre la décision du Centre de formalités des entreprises, le CFE.
Conformément à l’article R. 5141-11 du code du travail, le CFE, à l’exemple d’un guichet unique, intervient dans la procédure uniquement pour assurer la centralisation des informations requises pour l’instruction du dossier de demande par l’URSSAF et ne dispose donc d’aucun pouvoir décisionnaire eu égard aux dispositions réglementaires.
Ainsi, l’article R. 5141-8 du code du travail exige que la demande soit introduite dans un délai, non suspensif, et à peine de forclusion, de quarante-cinq jours à compter du dépôt de dossier auprès du CFE. Sur le fondement de cette disposition, le CFE oppose à de nombreux candidats la forclusion et refuse de transférer leur dossier à l’URSSAF. Dès lors, le candidat de bonne foi, qui satisfait à toutes les conditions d’attribution et qui prouve la force majeure comme moyen de justification de retard, ne dispose d’aucun recours efficace contre le refus du CFE, refus qui génère lui-même celui de l’URSSAF.
L’URSSAF est donc en droit de rejeter un éventuel recours pour incompétence en motivant sa décision par l’absence de transmission, qui lui garantit ainsi de ne pas connaître de la demande et donc de ne pas avoir à statuer « irrégulièrement », ou contre les intérêts du candidat-bénéficiaire.
Face à une telle situation, monsieur le ministre, et dans la mesure où votre collègue Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’industrie soulignait, dans un courrier du 7 septembre, qu’il était peu probable qu’un recours administratif ou qu’un recours de plein contentieux contre le refus de transmettre du CFE soit recevable et puisse prospérer, la question se pose, premièrement, de définir une autorité ou un organisme compétent pour connaître des justes motifs et du litige résultant du dépassement de délai par un candidat de bonne foi et, deuxièmement, de fixer au CFE des règles précises permettant d’identifier les exceptions au refus de non-transmission dans l’intérêt du candidat qui justifie son retard par la force majeure.
Monsieur le sénateur, je vous répondrai en lieu et place de M. Frédéric Lefebvre.
Les décisions en matière de demande d’attribution de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise, l’ACCRE, relèvent, en application de l’article R. 5141-11 du code du travail, de la compétence de l’URSSAF, qui statue sur la demande dans un délai d’un mois. Les demandes d’ACCRE, ainsi que les pièces justificatives, sont adressées à cette dernière via le Centre de formalités des entreprises compétent.
Dans le cadre de la procédure d’octroi de l’ACCRE, le rôle du CFE est non pas de statuer sur la demande, mais d’informer le déclarant sur les démarches à effectuer, de vérifier que le dossier est complet et de le transmettre à l’URSSAF dès lors que le délai imparti pour le dépôt de la demande d’ACCRE est respecté, conformément aux dispositions des articles R. 5141-8 et R. 5141-11 du code du travail.
La demande d’attribution peut être introduite auprès du CFE, au plus tôt lors du dépôt de la déclaration de création ou de reprise d’entreprise, et au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent. Ce délai de quarante-cinq jours court à compter de la date de dépôt de la déclaration de création de l’entreprise au CFE compétent.
Lorsque le dossier de demande d’attribution de l’ACCRE est complet, le CFE délivre au demandeur un récépissé l’informant que sa demande d’ACCRE a été enregistrée ; il en informe les organismes sociaux concernés et transmet, dans les vingt-quatre heures, le dossier de demande et une copie du récépissé à l’URSSAF.
Lorsque le dossier n’est pas complet, le CFE précise au déclarant la liste des informations et des pièces manquantes à fournir et lui délivre un accusé de réception de son dossier de demande. Le déclarant doit alors apporter les compléments nécessaires au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit la date de récépissé du dépôt de déclaration de création de l’entreprise.
Dans tous les cas, lorsqu’une demande est présentée après le terme du délai de quarante-cinq jours, le CFE informe le déclarant que sa demande ne peut être prise en compte, et celle-ci n’est pas transmise à l’URSSAF.
Il ressort de cette procédure que l’URSSAF est la seule instance décisionnaire en matière d’octroi de l’ACCRE. Les textes ne confèrent au CFE qu’un rôle d’intermédiaire chargé de filtrer les dossiers manifestement incomplets ou hors délai, que l’URSSAF devrait de toute façon rejeter.
Toutefois, les décisions des CFE de ne pas transmettre les demandes constituent des décisions administratives qui peuvent être contestées, soit sous la forme d’un recours administratif introduit auprès du président ou du directeur de l’organisme gérant le CFE, soit d’un recours contentieux porté devant la juridiction administrative.
Il est peu probable néanmoins qu’un tel recours puisse prospérer dès lors qu’aucune dérogation n’est prévue à l’application de la règle de droit définie à l’article R. 5141-8 du code du travail et que le CFE, en application de cette règle, a compétence liée pour refuser la transmission du dossier à l’URSSAF.
Enfin, il convient de remarquer le caractère protecteur que revêt le délai de quarante-cinq jours pour le demandeur. En effet, l’existence, à peine de forclusion, de ce délai s’explique, d’une part, par le souci de laisser au déclarant un délai administratif suffisant lui permettant de réunir les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande d’ACCRE et, d’autre part, de lui apporter la garantie de ne pas recevoir les premiers appels de cotisation de droit commun s’il remplit les conditions pour bénéficier de l’ACCRE.

Je rappelle que vingt et une questions orales sans débat sont inscrites à l’ordre du jour de cette séance. Je vous invite donc tous à la célérité, car nous ne pouvons prolonger nos travaux au-delà de douze heures trente.
La parole est à M. Alain Fauconnier.

Je ne manquerai pas de transmettre votre réponse à ma collègue, monsieur le ministre.

question n° 1101, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Je vous prie, mes chers collègues, de bien vouloir excuser mon collègue François Marc, bloqué dans son département en raison des intempéries.
Sa question porte sur l’explosion du trafic internet « mobilité » et le déploiement du WiMax en France.
Comme vous le savez, mes chers collègues, ce marché de l’internet mobile est aujourd’hui en plein essor, et il est d’ailleurs prévu que son volume double chaque année jusqu’en 2013. Les exigences de la mobilité, privée ou professionnelle, appellent aujourd’hui la satisfaction de nouvelles exigences techniques. En réponse, tout territoire, quel qu’il soit, devra pouvoir offrir une accessibilité maximale en termes d’internet mobile.
La téléphonie mobile de quatrième génération, communément appelée 4G, répond à cette exigence aujourd’hui incontournable. C’est d’ailleurs pourquoi l’État veut aujourd’hui une couverture en téléphonie 4G quasi-totale. Il indiquait encore ce mois-ci « que, en quinze ans, 99 % de la population française [devrait] être couverte par au moins deux réseaux d’opérateurs lors de l’attribution des licences de téléphonie mobile de quatrième génération ».
Dans un communiqué daté du 1er décembre dernier, l’Association des maires ruraux qualifiait quant à elle la couverture des territoires ruraux d’« urgence des urgences ».
Deux procédés peuvent assurer la diffusion de la 4G : la technologie Long Term Evolution-Advanced, dite LTE-Advanced, et la technologie du WiMax 2 – norme 802.16m.
Ces deux technologies offrent des performances identiques et permettent de la même manière de se déplacer sans interruption de service en termes d’internet « mobile ».
Le WiMax 2 – norme 802.16m – est particulièrement présent dans les pays émergents ainsi que dans les zones de fracture numérique des pays développés. Aux États-Unis, le WiMax 2 permet par exemple de transformer chaque grande ville en un gigantesque point d’accès à internet sans fil, appelé hotspot.
En France, le WiMax 2 n’est pas autorisé à ce jour… Les opérateurs qui ont déployé le WiMax de première génération l’ont fait exclusivement pour répondre aux besoins des collectivités et assurer une couverture minimale à 2 mégabits par seconde en site fixe.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, va bientôt lancer la procédure d’attribution des licences des bandes 800 mégahertz et 2, 6 gigahertz. Ces dernières sont nécessaires au déploiement de la 4G. Si l’on peut douter que l’ARCEP fixe une quelconque norme, qu’en sera-t-il pour le WiMax 2 ?
Je souhaiterais savoir, monsieur le ministre, si le Gouvernement envisage d’autoriser l’activation de « mobilité » du WiMax 2 et, par conséquent, le libre déploiement de cette technologie en France.
Est-il envisagé de donner aux acteurs ayant investi dans le WiMax les moyens d’accompagner leur montée en débit ?
Pour pouvoir augmenter la qualité de service offerte à l’utilisateur final, l’amélioration des bandes de fréquence se révèle nécessaire, et les acteurs qui ont déjà investi dans des technologies radio attendent de savoir si, demain, cette montée en débit sera facilitée. Va-t-on par exemple mettre à leur disposition les deux fréquences attribuées au groupe Bolloré et à Free, mais qui ne sont pas utilisées à ce jour ?

Mon cher collègue, vous avez longuement dépassé votre temps de parole… Il est temps de conclure.

N’est-il pas opportun d’encourager ceux des opérateurs qui ont tenu leurs engagements, en leur donnant les moyens de poursuivre leur développement dans les technologies « radio » les plus évoluées ?
Monsieur le sénateur, l’attribution de nouvelles bandes de fréquences est en effet nécessaire pour faire face aux augmentations de trafic, liées au développement constant de la demande d’accès en internet mobile.
Des autorisations d’utiliser des fréquences dans les bandes 800 mégahertz et 2, 6 gigahertzs devraient être attribuées à la mi-2011 par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, afin de permettre le déploiement des technologies mobiles de quatrième génération.
Ces autorisations n’imposeront pas de technologie. Les opérateurs dont les candidatures auront été retenues choisiront donc les technologies qu’ils souhaitent déployer. Ils pourront notamment choisir la norme mobile LTE, dite de quatrième génération.
Vous le savez, la norme 802.16m, dite WiMax 2, est récente, et il n’existe pas à ce jour d’équipements disponibles dans cette norme. Les seules technologies WiMax déployées actuellement en France correspondent à des normes WiMax plus anciennes.
Il n’est pas prévu de frein réglementaire au développement du WiMax 2 dans les bandes qui seront prochainement attribuées pour les réseaux mobiles. Il faudra simplement, si les opérateurs souhaitent déployer cette technologie, que les spécifications techniques prévenant d’éventuels brouillages entre systèmes de communication soient respectées.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, que je transmettrai à mon collègue François Marc.

La parole est à M. Alain Fauconnier, auteur de la question n° 1113, adressée à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Monsieur le ministre, dans moins d’un an, ce qu’il est convenu d’appeler le signal analogique sera remplacé par la télévision numérique terrestre, avec les dix-huit chaînes qui y sont attachées.
Or, ce qui, à Paris ou dans les grandes métropoles, ne sera probablement qu’une formalité va constituer, dans le monde rural, une véritable révolution.
Compte tenu des très nombreuses zones blanches encore existantes, un certain nombre de Français, qui sont déjà privés de téléphonie mobile et d’internet à haut débit, risquent d’être aussi privés de télévision. Ce n’est pas conforme à la notion de service public et à l’aménagement du territoire. De plus, si, avec le signal analogique, on peut recevoir des images brouillées, mais des images tout de même, avec la TNT, on reçoit tout ou rien. Tel est le cas d’un certain nombre de communes de mon département, l’Aveyron, à qui l’on vient de signifier que, en l’état actuel du système, elles seront privées de télévision.
Depuis un certain nombre de mois, les maires, en particulier, sont inquiets de ce qui se passera – ou ne se passera pas ! – dans leur commune.
Le 28 juin 2010, la région Midi-Pyrénées a demandé à M. le Premier ministre d’évaluer les zones qui ne seront pas couvertes par la TNT. Son président, Martin Malvy, déclarait : « Le passage au numérique risque de créer d’importantes inégalités entre les populations urbaines et rurales, en particulier pour les zones de montagne. »
L’Association nationale des élus de la montagne, l’ANEM, dans un communiqué daté du 11 septembre 2009, a exigé « l’égalité entre tous les Français pour l’accès à la TNT, en tout point du territoire », quitte, pour ce faire, à créer « un fonds d’équité territoriale », destiné à prendre en charge intégralement les foyers non desservis par la TNT. Je sais bien que trois sortes d’aide sont prévues, allant de vingt-cinq euros à deux cent cinquante euros. Mais, selon les spécialistes, ces aides pourraient non seulement être insuffisantes selon les cas ou, pis, inopérantes, puisqu’elles n’empêcheraient pas l’inexistence de la TNT dans certains secteurs. Je pense, en particulier, aux 500 000 foyers qui, selon un avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel, devraient se retrouver « sur le carreau ». Quant aux commissions départementales de transition vers la TNT, à ma connaissance, elles ne sont à ce jour toujours pas constituées !
Monsieur le ministre, je vous demande de m’indiquer ce que, de la manière la plus concrète possible, le Gouvernement entend mettre en œuvre pour nos compatriotes des zones rurales, en Aveyron comme ailleurs, afin qu’ils ne se retrouvent pas avec un écran noir à l’automne 2011.
Monsieur le sénateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, a publié le 23 décembre 2008 la liste des 1 626 zones qui seront, en effet, couvertes par la TNT au plus tard le 30 novembre 2011, date d’extinction de la diffusion analogique. À cette date, la TNT couvrira plus de 95 % de la population. Dans ce cadre, le CSA a désigné soixante-dix-huit émetteurs qui seront numérisés dans l’Aveyron.
Pour les zones qui ne seront pas couvertes au terme du passage à la télévision tout numérique, des solutions de réception alternatives sont disponibles. D’une part, cet accès est possible dans certaines zones par le câble ou l’ADSL. D’autre part, une offre gratuite par satellite disponible sur tout le territoire, en application de la loi du 5 mars 2007, permet depuis l’été 2007 de recevoir en clair l’ensemble des chaînes nationales de la TNT, sans abonnement ni frais de location. Une deuxième offre satellitaire sans abonnement ni frais de location a également vu le jour au mois de juin 2009.
De plus, le Gouvernement a prévu un effort financier global, s’élevant à 333 millions d’euros sur la période 2009-2011, afin de ne laisser personne à l’écart de la TNT, comme vous le suggérez. Une attention particulière a été portée sur l’aide et l’accompagnement des catégories sociales les plus fragiles et des foyers résidant dans des zones qui ne seront pas couvertes.
Ainsi, un fonds d’aide a été institué par la loi du 5 mars 2007. Il est destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite des services de télévision hertzienne en clair après l’extinction de leur diffusion en mode analogique.
Un dispositif d’assistance technique est prévu pour les personnes de plus de soixante-dix ans et les personnes handicapées.
Cette même loi institue un Fonds d’aide complémentaire pour les foyers résidant dans des zones qui ne seront pas couvertes par la TNT.
Enfin, la loi du 17 décembre 2009 institue une compensation financière destinée aux collectivités territoriales et à leurs groupements, qui mettent en œuvre toute solution permettant d’assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans les zones où la continuité de réception en clair ne peut être assurée par cette voie, après l’extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement partage votre préoccupation et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il n’y ait aucun « écran noir », pour reprendre l’expression que vous avez utilisée tout à l’heure.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
Je voudrais cependant insister sur le fait que les commissions départementales de transition vers la TNT ne se réunissant pas ou n’étant pas encore constituées, les maires craignent de se retrouver en première ligne et dans l’incapacité de pouvoir répondre.
Par conséquent, je réitère ma demande : il serait important, me semble-t-il, que les élus locaux soient très rapidement informés de la mise en place de ces commissions.

La parole est à Mme Nicole Bonnefoy, auteur de la question n° 1093, transmise à M. le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique.

Monsieur le ministre, je tiens à attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par de nombreuses communes de Charente – mais c’est la même chose dans d’autres départements – situées dans une zone ayant une couverture en téléphonie mobile qualifiée d’« acceptable » par les opérateurs, mais en réalité très médiocre, voire nulle pour les usagers.
Partant du constat qu’une partie du territoire national ne bénéficiait d’aucune couverture, les opérateurs, le Gouvernement, les représentants des collectivités territoriales et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, ont conclu en 2003 une convention nationale de mise en œuvre du plan d’extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile aux termes de laquelle les opérateurs se sont engagés à couvrir les zones blanches, selon la technique de l’« itinérance » ou de la « mutualisation ».
Les zones concernées, soit 8, 4 % du territoire national et environ 390 000 personnes, se caractérisent par une faible rentabilité potentielle, une non-couverture par les réseaux de téléphonie mobile de l’ensemble des opérateurs, ainsi qu’une absence de prise en compte de ces territoires dans les programmes futurs de déploiement des opérateurs.
C’est dans ce cadre que le département de la Charente a assuré la maîtrise d’ouvrage de la première phase du plan national de résorption des zones blanches de téléphonie mobile. La seconde phase a été menée directement par Orange et par Bouygues Telecom. Un plan complémentaire a été acté et négocié avec les opérateurs, au niveau national, afin de viser l’achèvement de la couverture en téléphonie mobile.
Or, à ce jour, un problème se pose pour certaines communes de Charente, qui sont aujourd’hui des sinistrées de la téléphonie mobile et qui risquent de le rester longtemps, si la définition même de « zone blanche », telle qu’elle a été actée par l’État et les directions nationales des opérateurs, n’est pas modifiée.
En effet, sont considérées comme « zones blanches », les communes non couvertes par les trois opérateurs. Sont définies comme « couvertes », les communes dans lesquelles au moins 50 % des appels passés dans le cœur du centre-bourg – souvent devant la mairie – sont considérés comme acceptables, « acceptable » signifiant de « parfait » à « médiocre ».
On comprend aisément, à la lecture du mode opératoire des mesures sur le terrain pour qualifier une commune de « zone blanche » et de la définition du qualificatif « acceptable » pour une zone dite « couverte », que le programme national de résorption des zones blanches, même s’il a permis d’améliorer sensiblement le taux de couverture des zones « non rentables », laisse de côté un certain nombre de communes, comme c’est le cas en Charente.
Monsieur le ministre, je tiens à ajouter que, dans le cadre de la proposition de loi relative aux télécommunications, débattue ici au Sénat le 8 décembre dernier, a été adopté à l’unanimité un amendement visant, dans les trois ans, à mettre en œuvre une obligation de couverture des zones dites « grises » et « blanches » de téléphonie mobile. C’est là une avancée extrêmement importante.
Cependant, lors des débats, le Gouvernement s’est opposé à l’adoption de cet amendement pourtant voté à l’unanimité, jugeant trop prématurée l’adoption d’une disposition législative sur la couverture de ces zones. Or, il apparaît au contraire urgent d’apporter une réponse rapide et efficace à tous nos concitoyens qui ne disposent pas d’une couverture en téléphonie satisfaisante.

J’espère donc que cette disposition sera maintenue et qu’aucun retour en arrière n’aura lieu sur ce point lors de l’examen de ce texte à l’Assemblée nationale.
Devant ces constats, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir quelles dispositions vous comptez prendre pour faire évoluer le protocole de mesures sur le terrain afin d’améliorer la couverture du territoire en téléphonie mobile dans les zones non rentables.

Mes chers collègues, j’y insiste : nous devons à tout prix interrompre nos travaux à douze heures trente pour les reprendre à quatorze heures trente ; or, il nous reste encore dix-huit questions…
La parole est à M. le ministre.
Madame la sénatrice, le Gouvernement est très attaché, comme vous, à la couverture numérique du territoire, et en particulier à la résorption des zones blanches de téléphonie mobile.
La convention signée en 2003 par l’Association des maires de France, l’AMF, l’Assemblée des départements de France, l’ADF, les trois opérateurs mobiles et le Gouvernement a ainsi engagé un vaste programme national visant à apporter la couverture mobile dans les centres-bourgs d’environ 3 000 communes de France situées en zone blanche, c’est-à-dire qui ne sont couvertes par aucun opérateur de téléphonie mobile.
Ces communes ont été identifiées par l’État sous l’égide des préfets. Vous l’avez souligné, la définition retenue est la suivante : une commune est réputée « couverte » lorsqu’il est possible d’y passer un appel téléphonique de manière continue pendant une minute, avec un téléphone portable, à l’extérieur des bâtiments, en situation statique, au centre-bourg.
À l’issue d’un point d’étape effectué en 2009, 364 communes ont été ajoutées à ce programme.
En 2010, 98 % des communes identifiées en 2003 sont maintenant couvertes par les trois opérateurs : Orange France, SFR et Bouygues Telecom. Les déploiements dans les communes identifiées en 2009 sont en cours, avec pour objectif une couverture complète des centres-bourgs d’ici à la fin de 2011. Grâce au programme de couverture des zones blanches, ce sont ainsi près de 8 % de communes françaises qui ont maintenant accès à la téléphonie mobile.
Ces zones blanches ne représentent plus que 0, 18 % de la population française, soit 2, 25 % du territoire métropolitain.
S’agissant en particulier de la Charente, trente-sept communes du département ont été retenues dans le cadre du programme initial en 2003 et sont couvertes à ce jour par les trois opérateurs. Deux communes ont été identifiées en 2009, qui seront couvertes d’ici à l’an prochain : Épenède et Vouzan.
Les efforts à venir, dans le cadre de ce programme, ont vocation à se concentrer sur les communes identifiées en 2009 qui ne sont pas couvertes à l’heure actuelle, dont les deux communes de la Charente que je viens de mentionner.

Ma chère collègue, les vingt et une questions traitent de vingt et un sujets importants ! Je le répète, il nous faut interrompre nos travaux à douze heures trente pour les reprendre à quatorze heures trente.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.

Je me doutais un peu de la réponse que me ferait M. le ministre.
Cela dit, compte tenu de la situation dans quelques communes de Charente – Ambleville, Bonneuil, Juillac-le-Coq, Lignières-Sonneville, Touzac, Verrières, etc. –, ce sont au moins 2 000 personnes qui sont aujourd'hui des sinistrées de la téléphonie mobile ; en effet, eu égard aux mesures sur le terrain, on considère que ces communes sont couvertes alors que la réception de la téléphonie ne se fait qu’en centre-bourg et qu’aucune connexion n’est possible partout ailleurs.
D’ailleurs, à l’occasion de l’examen par le Sénat, le 8 décembre dernier, de la proposition de loi relative aux télécommunications, a été adopté un amendement prévoyant qu’« une commune est réputée couverte quand, sur l’ensemble de son territoire, sont offerts au public les services répondant aux obligations de permanence, de qualité et de disponibilité visées aux articles L. 41 et suivants du même code. » J’y insiste, il s’agit bien de l’ensemble du territoire. Cet amendement a été adopté à l’unanimité. J’espère, monsieur le ministre, qu’il en ira de même à l'Assemblée nationale et que le Gouvernement ne reviendra pas sur cette disposition, qui permettra à tous les habitants de toutes les communes aujourd'hui sinistrées de recevoir la téléphonie mobile, quel que soit leur lieu d’habitation.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, auteur de la question n° 1105, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation.

Monsieur le ministre, ma question concerne le commerce, l’artisanat, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les métiers de la consommation.
Je veux attirer l’attention du Gouvernement sur l’inquiétude que ressentent les acteurs du secteur des métiers de bouche quant à la pérennité de leur activité économique.
Un décret départemental de 1949, révisé en 1956, obligeait tous les commerces alimentaires à fermer une journée entière. Il maintenait également un équilibre avec l’attractivité des commerces non sédentaires. Les sorties de ville commençant à être délaissées, les grandes enseignes ont aujourd’hui tendance à s’installer en centre-ville, sans respect de la législation, et sont ouvertes six jours et demi sur sept.
Cette amplitude d’horaire ne peut bien évidemment être assurée par ces petites entreprises, la plupart du temps familiales, qui, par ailleurs, se sont vues réaffirmées dans leurs obligations de fermeture par la loi n° 98-405 et la circulaire du 6 juin 2000 sur les conditions d’application de l’article L. 221-17 du code du travail.
Face à cette concurrence déloyale, les artisans des métiers de bouche ont le sentiment que, dans un avenir proche, ils n’auront plus leur place dans le commerce de proximité, qui leur sera volée par les grandes enseignes. Cela signifie un manque à gagner immédiat et implique l’absence de repreneurs pour leur commerce ; de ce fait, la transmission de leurs savoirs leur semble devenir inutile.
Monsieur le ministre, les grandes surfaces, sentant la désaffection de leur clientèle sur les sites extérieurs, s’installent de plus en plus, je le répète, au cœur de nos villes. Comment entendez-vous réguler ces installations afin que soient respectés, d’une part, la réglementation imposée aux commerces alimentaires et, d’autre part, le jeu de la concurrence ?
Tout d’abord, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir excuser l’absence de Frédéric Lefebvre, qui ne peut être présent au Sénat ce matin.
Vous le savez, le Gouvernement partage votre souci que soit maintenue une offre commerciale équilibrée entre toutes les formes de distribution, grandes et moyennes surfaces, commerce de proximité, dont naturellement les métiers de bouche. C’est cet équilibre qu’a constamment recherché le Gouvernement en inscrivant dans la loi du 10 août 2009 relative au repos dominical la possibilité pour les commerces de détail à prédominance alimentaire employant des salariés d’ouvrir jusqu’à treize heures le dimanche et en n’imposant pas de fermeture hebdomadaire pour les commerces qui n’emploient pas de salariés.
Le Gouvernement a également souhaité maintenir la possibilité d’organiser l’équilibre de la concurrence par la voie conventionnelle au niveau local.
C’est pourquoi l’article L. 3132-29 du code du travail, que le Gouvernement n’a pas entendu modifier dans la loi relative au repos dominical, prévoit qu’un accord entre les partenaires sociaux d’une profession et d’une région déterminées peut assurer un jour de repos hebdomadaire dans tous les établissements d’une profession et une égalité de traitement entre ces établissements, qu’ils emploient ou non des salariés. Dans ce cas, le préfet du département peut, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner par arrêté la fermeture au public des établissements de la profession et de la région concernée pendant toute la durée de ce repos. C’est le cas, dans de nombreux départements, pour le secteur de la vente de pain.
Le Gouvernement entend rester très vigilant sur le respect de l’application de toutes ces dispositions qui participent de la qualité de vie dans notre pays, particulièrement en zone rurale, et qui ont permis à l’artisanat de bouche d’être le secteur de l’artisanat ayant le mieux résisté à la crise.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de toutes ces précisions.
Vous dites que la loi du 10 août 2009 n’impose pas de fermeture aux commerces sans salariés. Certes, mais les petits commerces, qui sont souvent tenus par des familles, ne peuvent pas assurer cette permanence.

La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, auteur de la question n° 1108, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports.

Madame la ministre, la Direction interdépartementale des routes de l’Est, la DIR Est, a récemment révélé sa nouvelle stratégie en matière de déneigement des routes nationales et des autoroutes de l’Est, dont elle assure la gestion et l’entretien.
Ainsi, dans son dossier d’ « organisation de la viabilité hivernale », la DIR Est a fait part de son intention de réduire les conditions de déneigement des routes nationales et autoroutes dont elle assure la gestion et l’entretien depuis 2006. Ce nouveau plan vise, en réalité, à différer le déneigement des voies de gauche à huit heures après l’épisode neigeux, afin de se concentrer sur le dégagement de la seule voie de droite.
Cette mesure, qui s’applique aux quelque 1 660 kilomètres de grands axes dans douze départements, s’apparente à une expérimentation périlleuse, qui, selon plusieurs experts des questions de transport, « ne peut fonctionner que lors de petites neiges ». De plus, si cette stratégie peut être efficace sur des axes routiers à faible fréquentation routière, elle paraît, à l’inverse, particulièrement inadaptée pour des axes comme l’autoroute A31, qui compte environ 100 000 véhicules par jour pour la partie située au nord de Metz.
Hélas ! les conséquences néfastes de cette décision n’ont pas tardé à se faire sentir lors des derniers épisodes neigeux qui ont touché l’ensemble du territoire et l’est de la France en particulier.
La « pagaille » que M. le ministre de l’intérieur a cherché à nier a pourtant bien eu lieu sur les grands axes routiers de l’est de la France. Sur ce terrain, la décision prise par la DIR Est n’a rien arrangé !
Ce sont ainsi des situations de blocage complet, avec des automobilistes immobilisés pendant de nombreuses heures dans leur véhicule, que l’on a connues sur l’A31. Cet axe constitue pourtant une artère essentielle de la vie économique et sociale de notre région, puisque c’est notamment la voie empruntée par des milliers de travailleurs frontaliers qui se rendent au Luxembourg.
Ainsi, même si la DIR Est avance l’argument de la sécurité routière pour justifier sa décision, cette mesure paraît au contraire découler directement du désengagement de l’État quant à la politique tant d’entretien des routes nationales et autoroutes que de la sécurité routière. Cette décision intervient en effet dans un contexte de fort recul financier de l’État, qui s’est engagé dans une politique de baisse des crédits alloués à l’entretien des quelque 10 000 kilomètres de routes encore gérés par l’État. Le projet de loi de finances pour 2011 prévoit, en ce sens, une baisse de 10 % des crédits de fonctionnement des routes, qui englobent les dépenses pour le déneigement, de même qu’une forte diminution des sommes allouées à l’entretien.
Dans ces conditions, j’aimerais savoir, madame la ministre, quelles mesures le Gouvernement compte adopter pour éviter une nouvelle détérioration des infrastructures routières, qui viendrait encore aggraver la situation de nombreux citoyens contraints d’emprunter les routes nationales et les autoroutes. Mais peut-être allez-vous m’annoncer que, compte tenu des épisodes neigeux que nous venons de connaître, les annonces de la DIR Est sont reportées, voire annulées…
Monsieur le sénateur, la politique de déneigement de l’État et, dans ce cas particulier, de la Direction interdépartementale des routes de l’Est consiste, en fonction de l’intensité des précipitations neigeuses, à redonner une possibilité de circulation le plus rapidement possible aux usagers.
Concernant les routes à 2x2 voies, quand il y a relativement peu de neige, les importants moyens engagés permettent de traiter simultanément les deux voies de circulation. Dans ce cas, la question ne se pose donc pas.
En revanche, lorsque les chutes de neige sont très intenses ou continues, il n’est pas possible de traiter en permanence l’ensemble des voies. Cette situation n’arrive, en principe, que quelques jours par an, mais peut avoir des conséquences considérables, comme on l’a vu dernièrement en Île-de-France et dans l’est de la France.
L’engagement pris par la DIR Est consiste non pas à attendre huit heures avant d’intervenir sur la voie de gauche, comme on a pu l’entendre ici ou là, mais bien à remettre cette voie en état de circulation satisfaisante dans un délai de huit heures au plus tard après l’épisode neigeux.
Cette stratégie s’accompagne bien sûr de mesures de restriction de circulation et, naturellement aussi, d’informations aux usagers. Tous les moyens à la disposition de l’État sont utilisés : site internet de la préfecture, de la Direction interdépartementale des routes, site Bison Futé, médias, radios partenaires, panneaux à message variable ainsi que messages spécifiques aux fédérations de transporteurs et aux grands groupes et abonnés du site Bison Futé.
L’épisode neigeux intervenu en Moselle le lundi 29 novembre a bloqué le réseau secondaire. Les transports urbains ne circulaient plus, mais la méthode déployée par la DIR Est a permis de garantir la circulation sur l’A31 pendant toute la journée. Il n’a pas été besoin d’attendre huit heures pour que toutes les voies soient rendues à la circulation. Il s’agit bien d’organiser le plus rapidement possible la poursuite des déplacements en toute sécurité, mais en tenant compte des moyens qui peuvent être raisonnablement mis en œuvre. À cet égard, je vous rappelle que la Direction interdépartementale des routes de l’Est est celle qui dispose, au même niveau que la saison précédente, du plus grand parc de matériels et de la plus grande densité de circuits de déneigement de toute la France.

Madame la ministre, je vous remercie de m’avoir répondu, mais les informations que vous avez communiquées ne sont pas tout à fait vraies.
Pour habiter dans une commune située en bordure de l’A31, entre Metz et Thionville – j’en suis d’ailleurs l’élu –, je puis vous dire que nous avons connu un blocage total tant à la fin du mois de novembre que voilà quelques jours. Vous dites, madame la ministre, que tout le réseau secondaire était bloqué. Oui, il l’était, mais à cause de l’autoroute A31, sur laquelle il était impossible de circuler. Vos informations sont totalement erronées : entre Metz, Thionville et le Luxembourg, tout était bloqué ! Bien sûr, un arrêté préfectoral a été pris pour stopper la circulation des camions ; mais quelques camions avaient bloqué la troisième voie et les voitures qui se sont aventurées sur la troisième voie ont également été bloquées. On a donc connu une paralysie totale de tout le secteur en raison du non-déneigement convenable de l’A31.
Je reconnais que les événements neigeux que nous venons de connaître sont exceptionnels, surtout en novembre et en décembre. Mais la mesure préconisée par la DIR Est n’est pas, je le répète, une bonne mesure : elle fait franchement partie des mesures d’économie prises en matière de fonctionnement du service public.
Jamais, j’y insiste, je n’ai connu une telle situation sur nos axes routiers depuis que j’habite la Moselle, et j’y habite depuis très longtemps ! C’est la première fois ! En général, on circulait moins bien, il est vrai, sur les réseaux secondaires, mais l’autoroute A31 était toujours ouverte à la circulation. Le 29 novembre et l’épisode intervenu voilà quelques jours sont les deux seules fois où tout le réseau a été bloqué. Je pense que vous devez sérieusement revoir la question, madame la ministre.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 1117, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Madame la ministre, je souhaite attirer votre attention sur les carences constatées de l’État dans mon département, la Meurthe-et-Moselle – nous sommes encore en Lorraine ! –, en matière d’instruction des permis de construire.
Cette question a été soulevée lors de l’assemblée générale des maires de ce département au mois d’octobre dernier : de nombreux maires de l’arrondissement de Nancy ont en effet relevé un certain nombre d’erreurs dans l’instruction des permis de construire ou la délivrance de permis tacites.
Depuis le 1er janvier 2010, les directions départementales des territoires, qui sont issues des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture, mettent en œuvre les politiques publiques d’aménagement et de développement durable des territoires.
Créées dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la fameuse RGPP, les DDT font partie des nouveaux services déconcentrés de l’État à compétence interministérielle. À ce titre, elles sont chargées de l’instruction des permis de construire pour les communes de moins de 10 000 habitants et les EPCI de moins de 20 000 habitants. Les autres, en vertu d’une ordonnance de 2005, règlent les affaires par elles-mêmes.
En outre, l’article L. 422-8 du code de l’urbanisme dispose qu’une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l’État, pour l’instruction des demandes de permis, à toutes les communes, quel que soit le nombre d’habitants, et les établissements publics de coopération intercommunale compétents.
Or on assiste actuellement dans le département de la Meurthe-et-Moselle à de nombreux dysfonctionnements en la matière aboutissant à des erreurs, voire à la délivrance de permis tacites parce que les délais autorisés sont dépassés.
Interrogé sur le sujet, le préfet de Meurthe-et-Moselle non seulement reconnaît ces dysfonctionnements qu’il attribue à « une baisse continue des effectifs et à l’impossibilité de publier en externe les postes qui deviennent vacants », mais ajoute aussi que « ces difficultés qui affectent essentiellement l’arrondissement de Nancy vont inéluctablement, à plus ou moins long terme, concerner l’ensemble du département ».
Bien évidemment, les communes et intercommunalités qui souhaitent offrir un service convenable à leurs administrés réfléchissent à se doter elles-mêmes des moyens d’instruction adéquats. Dans le département dont je suis l’élu, le représentant de l’État se déclare d’ailleurs « naturellement prêt à apporter tout l’appui nécessaire aux collectivités qui s’engagent dans cette démarche ».
Cependant, je m’interroge sur ce qui peut apparaître comme le « glissement » vers les collectivités locales d’une compétence qui, pour l’instant, doit être assurée par l’État. Certes, en la matière, depuis les lois de décentralisation de 1982, la signature est accordée aux mairies, ainsi que, le cas échéant, aux collectivités intercommunales. Toutefois, pour les communes de moins de 10 000 habitants, la loi prévoit que l’instruction des demandes reste du ressort de l’État.
Or, pour pallier la carence de l’État dans ce domaine, les collectivités sont amenées à prendre également en charge l’instruction des dossiers et à créer en conséquence des postes de personnels. Et l’on dit ensuite que les charges des collectivités augmentent !
J’aimerais donc savoir quelles sont les intentions du Gouvernement en la matière. Madame la ministre, face à ces dysfonctionnements, comptez-vous donner aux directions départementales des territoires les moyens nécessaires pour remplir leurs missions, ce qu’elles sont aujourd’hui, à leur grand désespoir d’ailleurs, dans l’incapacité de faire ?
Monsieur le sénateur, vous avez appelé mon attention sur les difficultés d’instruction des demandes d’autorisation en urbanisme par la direction départementale des territoires, la DDT, en Meurthe-et-Moselle.
Cette direction départementale des territoires a en effet rencontré des difficultés à pourvoir certains postes devenus vacants. C’est pourquoi il a pu arriver que, localement, les services instructeurs connaissent des dysfonctionnements momentanés, qui se sont traduits par des retards dans l’instruction des dossiers et par un recours plus important à la délivrance d’autorisations tacites. Ces dernières sont rendues possibles par le code de l’urbanisme et ne signifient aucunement, je le précise, qu’il n’y a pas eu d’instruction, même s’il est vrai qu’un tel cas de figure a pu se présenter.
Je constate cependant que, au regard des indicateurs de suivi de l’activité des services dont je dispose, la DDT de Meurthe-et-Moselle se situe dans la moyenne nationale : le délai moyen d’instruction y est de 52 jours et 86 % des projets de décision sont transmis au moins 8 jours avant la date limite.
De manière plus générale, depuis la mise en place de la révision générale des politiques publiques, le ministère en charge de l’urbanisme participe à l’effort de réduction des déficits budgétaires, ce qui se traduit, au cours de la période 2009-2012, par la suppression progressive de l’ingénierie publique concurrentielle.
L’objectif est en effet de recentrer l’expertise d’ingénierie publique sur les missions de service public, en particulier sur les prestations de solidarité et les politiques de développement durable.
Je puis par conséquent vous assurer que le ministère de l’urbanisme n’a pas l’intention de faillir aux obligations que lui confère la loi en matière d’assistance apportée aux communes dans l’instruction des autorisations de construire.
Pour assurer au mieux cette mission, le ministère a engagé cette année un vaste plan de modernisation visant à intégrer progressivement la géomatique et la dématérialisation des procédures dans l’instruction des autorisations d’urbanisme. Conjugué aux mesures de simplification de l’urbanisme auxquelles nous travaillons en ce moment, ce plan de modernisation devra permettre d’assurer le maintien de la qualité du service rendu aux communes. L’ensemble des directions départementales des territoires seront ainsi dotées, dans le courant de l’année 2011, d’un outil géomatique, adossé au logiciel d’instruction, qui permettra une instruction géolocalisée des demandes. Je veillerai d’ailleurs à ce que la DDT de Meurthe-et-Moselle soit parmi les premières à bénéficier de cet outil.
Enfin, lorsque les communes souhaiteront, par exemple, confier cette compétence d’instruction à un établissement public de coopération intercommunale, la DDT facilitera bien sûr la mise en place d’un tel service et apportera gratuitement un soutien en termes de formation, d’appui méthodologique et d’expertise. Ainsi ce service pourra-t-il bénéficier de l’expérience accumulée par l’État.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, à travers laquelle vous reconnaissez d’ailleurs les difficultés que rencontrent vos services. Je ferai part aux personnes concernées de vos projets de modernisation technique. Je crains cependant que l’on ne continue de manquer, pour instruire les permis de construire, de moyens humains, d’autant que les dispositifs techniques ne peuvent remplacer complètement ces derniers.
En revanche, en tant que membre du comité directeur de l’association des maires du département de Meurthe-et-Moselle, je constate que les communautés de communes, devant la mauvaise qualité du service rendu par l’État aux administrés, sont conduites à faire le travail elles-mêmes.
Certes, le préfet et la direction départementale des territoires sont disposés à les aider. Toutefois, les communautés de communes doivent alors embaucher un ingénieur et deux attachés d’administration, ce qui crée pour elles des charges supplémentaires. Or ces collectivités, qui ont souvent moins de 20 000 habitants, ne sont normalement pas concernées par le transfert de compétences prévu par la loi !
Si l’État considère qu’il ne peut plus assurer convenablement sa mission d’instruction des demandes de permis de construire – il faudra vous prononcer clairement sur ce point, madame la ministre –, il convient d’aller jusqu’au bout du raisonnement suivi : puisque, depuis 1982, la commune s’est vu reconnaître une compétence en ce domaine, il faut lui confier aussi l’instruction des dossiers. Il revient alors à l’État d’estimer le coût de ce service et de transférer aux collectivités locales les financements correspondants. En effet, les collectivités locales qui, aujourd’hui, traitent ces dossiers le font en quelque sorte « hors la loi » et doivent en assurer elles-mêmes le financement !
Il faudrait éclaircir une situation qui est aujourd’hui très confuse. Ou bien l’État s’engage à conserver ses prérogatives pendant les prochaines années et à accorder les moyens technologiques et humains nécessaires pour que l’instruction des dossiers soit assurée convenablement, ce qui éviterait en outre à ses services nombre de contentieux souvent pénibles à gérer. Ou bien l’État choisit de transférer ses compétences aux collectivités locales ; cette solution est également valable, mais il faudra alors mettre les moyens nécessaires. Il faut trancher !

La parole est à M. Philippe Madrelle, auteur de la question n° 1110, adressée à M. le ministre d'État, ministre de la défense et des anciens combattants.

Madame la ministre, je vous salue avec plaisir, mais je regrette l’absence de M. Alain Juppé, concerné pourtant à double titre – en tant que ministre de la défense et comme maire de Bordeaux – par le problème que je vais soulever.
Le secteur aéronautique pèse lourd en Gironde et en Aquitaine. Depuis soixante-quinze ans, c’est-à-dire depuis leur création, les ateliers industriels de l’aéronautique, les AIA, dont celui de Bordeaux, qui est situé à Floirac, contribuent à la maintenance et à la réparation du matériel programmé par les constructeurs. Ce sont ces ouvriers d’État, hautement spécialisés, très qualifiés et expérimentés qui assurent la maintenance des turbomoteurs et turboréacteurs de l’armée française.
Or les décrets salariaux du 22 mai 1951, qui régissent l’évolution des salaires des personnels et des ouvriers d’État de la défense sont menacés de suppression, ce qui risque d’hypothéquer l’avenir même des AIA.
Mes chers collègues, n’oublions pas que de tels statuts ont permis de maintenir un haut degré d’expertise. En outre, ces décrets ont donné aux ouvriers d’État un pouvoir d’achat attrayant ainsi qu’une juste reconnaissance de leur compétence. Il me semble essentiel de valoriser l’expérience et le savoir-faire nécessaires à la maintenance d’appareils souvent vieillissants, de constituer un contre-pouvoir efficace vis-à-vis des constructeurs et de maintenir des coûts soutenables pour l’armée française.
Madame la ministre, vous me permettrez d’insister sur la formation des ouvriers d’État, qui sont considérés comme des experts. En effet, ce sont eux qui, les premiers, interviennent sur les matériels, établissent un diagnostic et envisagent l’étendue des travaux de réparation et de maintenance nécessaires.
L’AIA de Bordeaux possède un plan de charge très satisfaisant, avec une visibilité à dix ans. L’efficacité d’un tel établissement repose sur un équilibre reconnu entre différentes professions qui apportent chacune leur compétence propre. Or toute l’inquiétude du personnel découle des actuelles modalités de recrutement des ouvriers aéronautiques.
En 2009, une centaine de contractuels ont été recrutés. Formés et pris en charge au sein même de l’atelier, ces jeunes techniciens ne sont pas motivés pour y rester et préfèrent souvent poursuivre leur carrière dans une autre entreprise, alors qu’ils ont bénéficié d’une formation représentant une dépense lourde, en temps et en coût. On ne peut que déplorer l’absence de retour sur investissement !
Pourquoi donc, madame la ministre, donner la préférence, pour ne pas dire la priorité, à l’embauche de contractuels alors que les ouvriers d’État constituent un personnel qualifié et expérimenté ?
Signer la suspension de ces décrets salariaux reviendrait à mettre à mort l’AIA. Chacun connaît l’attachement du ministre d’État, ministre de la défense, Alain Juppé, au potentiel aéronautique de la banlieue bordelaise. C’est la raison pour laquelle j’espère fermement qu’il se battra pour continuer à reconnaître et faire reconnaître la légitimité de l’engagement des ouvriers d’État au sein du ministère de la défense et qu’il refusera clairement et nettement de supprimer les décrets salariaux en question.
Je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence du ministre de la défense et des anciens combattants qui, malheureusement, ne peut être présent ce matin.
Les taux des salaires des personnels ouvriers du ministère de la défense sont déterminés d’après les rémunérations pratiquées dans l’industrie métallurgique privée et nationalisée de la région parisienne, conformément à trois décrets : celui du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale, celui du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées et celui du 31 janvier 1967 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers du ministère des armées.
Le projet de loi de finances pour 2011, qui répond à une volonté gouvernementale de réduction du déficit budgétaire de l’État au travers d’une meilleure maîtrise de la dépense publique, prévoit, à l’instar de la stabilisation de la valeur du point d’indice servant de référence au calcul du traitement des fonctionnaires, le maintien des salaires des ouvriers au niveau qu’ils atteindront le 1er janvier 2011.
Le décret portant application de cette mesure de suspension concerne l’ensemble des personnels ouvriers du ministère de la défense, tant à l’atelier industriel de l’aéronautique de Bordeaux que dans les autres établissements.
Toutefois, l’AIA de Bordeaux est un établissement dont le plan de charge est stabilisé pour les années à venir et qui s’appuie sur un portefeuille d’activités varié.
Cet établissement n’est pas concerné par la réorganisation territoriale de la défense. Il a vu au contraire ses domaines d’action et ses attributions confirmés par les instances de pilotage du service industriel de l’aéronautique. Il a, notamment, développé avec les industriels un mode de fonctionnement très innovant dans le domaine de la réparation des moteurs.
De plus, il est totalement conforté par l’arrivée sur la base aérienne 106 de Mérignac, en 2012, de la partie « conduite des opérations » de la structure intégrée de maintien en condition opérationnelle du matériel aéronautique de la défense, la SIMMAD.
Enfin, soyez assuré, monsieur le sénateur, que le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, a demandé à ses services d’examiner les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé à des recrutements d’ouvriers hautement qualifiés pour cet établissement.

Madame la ministre, je vous remercie d’avoir indiqué, entre autres éléments tout à fait exacts, que l’AIA de Bordeaux avait une excellente visibilité quant à son plan de charge.
Toutefois, l’intersyndicale de l’AIA reste inquiète pour l’avenir, et à juste titre. La tragique fermeture de l’École de santé navale de Bordeaux, qui, hélas, sera effective en juillet 2011 et qui portera un coup très dur à la ville, semble donner un certain fondement à ces craintes.
L’AIA, forte du haut degré de qualification de ses personnels, doit demeurer un contrepoids à la maintenance privée. Vouloir modifier ou faire évoluer le statut des ouvriers d’État de cet établissement constituerait une déclaration de guerre. Je compte donc sur Alain Juppé pour contrecarrer toute initiative en ce sens.

La parole est à M. Claude Biwer, auteur de la question n° 1104, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Après plusieurs reports de son inscription à l’ordre du jour de notre assemblée, ma question peut apparaître quelque peu décalée. C’est en effet à Mme Roselyne Bachelot que je la destinais, lorsqu’elle était encore ministre de la santé.
C’est avec la plus grande surprise, et même une certaine stupéfaction, que j’ai entendu, au cours du mois de juin dernier, les déclarations de Mme Bachelot, alors ministre de la santé, au congrès de médecine générale de Nice. Elle y annonçait, en effet, qu’elle mettait volontairement entre parenthèses le contrat santé solidarité, qui figurait pourtant dans la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires de juillet 2009, que nous avions adoptée ici même.
Cette mesure consistait, pour un médecin exerçant dans une zone « surdotée » en praticiens, à exercer quelques jours par mois en zone « sousdotée », sous peine de pénalités. Il convient de noter que ces contrats étaient, dans un premier temps, facultatifs, et qu’ils ne devenaient obligatoires qu’en 2013.
Sur la forme, je trouve étonnant qu’un ministre puisse annoncer qu’il n’appliquera pas une disposition législative souhaitée et votée par le Parlement.
Sur le fond, nul ne conteste la situation préoccupante en matière de démographie médicale dans laquelle se trouvent certains territoires ruraux, mais aussi certaines zones de banlieue. Le Président de la République lui-même s’en est souvent fait l’écho.
Nul ne peut non plus contester que toutes les mesures incitatives visant à favoriser l’implantation de médecins dans ces zones déficitaires ont échoué. Nous pouvions donc penser que cette nouvelle mesure, finalement peu contraignante, aurait pu conduire à accroître, même légèrement, la présence de médecins en milieu rural.
Pour ma part, je me suis toujours prononcé en faveur de la mise en place d’un numerus clausus pour l’installation des médecins, à l’image de celui qui est appliqué aux pharmaciens. En d’autres termes, il ne pourrait plus y avoir d’installation nouvelle dans les zones où les médecins sont nombreux, et ceux qui souhaiteraient s’installer ne pourraient plus le faire que dans les zones déficitaires en médecins.
En n’appliquant pas sciemment une disposition législative adoptée par le Parlement, on ne lutte pas de manière efficace contre les déserts médicaux. Pourtant, l’absence de médecins, voire, dans certains cas, d’urgences hospitalières, parce qu’elle entraîne une absence de soins, peut mettre en danger la vie de ceux de nos compatriotes qui vivent en zone rurale.
Par conséquent, je souhaite que la volonté du législateur soit respectée et que les contrats santé solidarité voient le jour dans les meilleurs délais. Si tel ne devait pas être le cas, il faudrait s’interroger sur l’opportunité de continuer à voter des lois que les ministres n’appliquent que partiellement !
Par ailleurs, nous savons que voient le jour certaines initiatives privées consistant à faire venir en France des professionnels de santé depuis les pays de l’Est ou d’Afrique. Ne pourrions-nous pas adapter et améliorer le processus d’accueil de ceux qui s’engagent à se mettre aux normes françaises et à s’implanter là où la demande est forte ?
Je compte sur vous, madame la ministre, pour nous faire des propositions permettant de mettre en œuvre rapidement une couverture décente de nos territoires en difficulté.
Monsieur le sénateur, je vous prie d’excuser M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui m’a chargée de vous répondre.
Vous le savez, le Gouvernement a pris à bras-le-corps, depuis plusieurs années, le problème de la désertification médicale. Bien que la France demeure parmi les tout premiers pays occidentaux en nombre de praticiens par habitant, il n’en demeure pas moins que nous serons confrontés à une baisse de la démographie médicale dans les prochaines années.
Néanmoins, avec la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des solutions ont d’ores et déjà été apportées pour lutter contre la désertification médicale, par exemple en proposant un contrat d’engagement aux médecins en formation qui s’engagent à exercer dans les zones sous-denses.
Le numerus clausus a par ailleurs été augmenté chaque année depuis quatre ans.
Toutefois, le Président de la République souhaite aller plus loin. Pour cela, le Gouvernement va s’appuyer, notamment, sur le rapport d’Élisabeth Hubert.
Tout d’abord, Xavier Bertrand poursuivra, avec Valérie Pécresse et Nora Berra, le développement de la filière universitaire de médecine générale.
Ensuite, nous favoriserons davantage l’exercice regroupé des professionnels de santé : deux cent cinquante maisons de santé recevront un financement substantiel de l’État, ce qui permettra d’améliorer l’offre de soins en zone rurale et périurbaine.
Les agences régionales de santé ont également mis en place des guichets uniques pour faciliter l’installation des jeunes médecins, accompagner les promoteurs de regroupements pluridisciplinaires et promouvoir la télémédecine.
Enfin, nous voulons faire évoluer les modes de rémunération, afin d’être au plus près des évolutions des pratiques médicales et des aspirations des praticiens, notamment des plus jeunes d’entre eux.
Le contrat santé solidarité auquel vous faites référence, monsieur le sénateur, se révèle difficilement applicable sur le terrain et crée de vives oppositions chez les représentants des médecins.
Les représentants des professionnels de santé proposent dès à présent d’instaurer un contrat type, fondé sur le volontariat. Cette piste a été reprise à l’article 7 de la proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, déposée par M. Jean-Pierre Fourcade.
Considérant que cette méthode, qui a le soutien des professionnels, est plus efficace, le Gouvernement soutiendra la mesure inscrite dans la proposition de loi.
Vous l’avez compris, monsieur le sénateur, le Gouvernement n’a qu’un objectif : garantir l’accès à des soins de qualité de tous nos concitoyens, sur l’ensemble du territoire national.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse. Les mesures proposées vont dans le bon sens, et j’ose espérer que les parlementaires ne se ligueront pas pour vous empêcher d’agir, car le contraire s’est souvent produit !
Nous attendons qu’il soit remédié au problème des « déserts médicaux », dans la mesure du possible, bien sûr, c’est-à-dire avec les moyens du bord et du temps. Toutefois, je me réjouis de percevoir, dans la réponse que vous m’avez apportée, une volonté du Gouvernement d’évoluer sur cette question.
Madame la ministre, il est urgent d’agir. Nous venons de traverser une période très difficile. Personnellement, j’ai connu dans mon entourage un cas où l’éloignement d’un centre de soins – il fallait donc beaucoup de temps pour l’atteindre – a failli provoquer une catastrophe.
Je me réjouis que le Gouvernement ait la volonté de le régler ce problème qui nous préoccupe, en suivant la proposition de Jean-Pierre Fourcade. Je souhaite maintenant que son action aboutisse le plus vite possible.

La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 1094, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

Madame la ministre, je compte sur vous pour transmettre à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, à qui je comptais m’adresser, ma question relative aux contrôles exercés par les caisses d’assurance maladie sur les hôpitaux pour les codages des séjours hospitaliers.
Mis en place depuis 2005, ces contrôles stricts, ajoutés à la tarification à l’activité, devaient éviter tout risque d’utilisation abusive de la codification des séjours dans les établissements hospitaliers.
Ce système, que l’on voulait correcteur et irréprochable, débouche en fait sur une double sanction : s’il peut permettre de récupérer des sommes jugées indûment versées par la CNAM, ce qui est déjà lourd de conséquences, il aggrave la pénalisation en augmentant les sommes en cause par un coefficient multiplicateur établi suivant des paramètres compliqués.
Inutile de préciser que le climat entre contrôleurs et praticiens n’est pas bon, puisqu’il y a suspicion de tricherie et remise en cause des diagnostics. Les différends portent surtout sur des soins difficiles à codifier, en particulier les soins palliatifs.
En Bourgogne, pour douze établissements contrôlés, les sommes atteignent 9 700 000 euros, soit entre dix et quarante fois les indus relevés ! L’hôpital de Château-Chinon, par exemple, qui est pourtant tout petit, se voit taxer de 150 000 euros.
Il faut que ce système soit revu et la CNAM ramenée à la raison. Les établissements qui doivent supporter ces ponctions souvent pour le moins discutables voient leurs mesures d’économie annulées et le confort hospitalier en pâtit. Je le répète, il faut souhaiter que les sanctions prises en cette fin d’année soient revues, afin que nos établissements ne soient pas pénalisés de manière déraisonnable.
Monsieur le sénateur, vous appelez l’attention du ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur les contrôles exercés par les caisses d’assurance maladie sur les hôpitaux. Ce sujet a été longuement débattu lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011.
Les établissements et leurs fédérations ne comprennent pas toujours le dispositif et son application et demandent des éclaircissements fort compréhensibles. En effet, il est indispensable que le dispositif soit bien compris par les acteurs et que son fonctionnement ne pose pas de question de principe.
Il convient de réaffirmer la logique qui sous-tend ce dispositif : dans un système de tarification à l’activité, il est essentiel que l’ensemble des établissements respectent les règles de codage, ce qui, fort heureusement, est très majoritairement le cas.
Ce dispositif de contrôle de la tarification à l’activité, qui a pour corollaire son caractère dissuasif, est le seul garant de l’efficacité et de l’efficience du contrôle T2A. Les hôpitaux représentent une dépense de 70 milliards d’euros pour l’assurance maladie. Il est donc normal qu’ils fassent l’objet de contrôles.
Monsieur le sénateur, vous me faites part de l’étonnement de certains établissements, qui constatent que les indus et la sanction ne sont pas du même ordre de grandeur. Sachez que l’indu est constaté sur l’échantillon représentatif effectivement contrôlé et ne repose donc que sur le nombre de dossiers de ce dernier.
En revanche, le mécanisme de calcul du montant de la sanction est fixé, comme il est prévu dans les textes, en proportion du préjudice réellement subi par l’assurance maladie sur l’ensemble de l’activité contrôlée, donc sur un nombre de dossiers potentiellement bien plus grand que celui de l’échantillon.
Le point important est le mode de calcul de cette sanction, qui repose sur le caractère représentatif de l’échantillon contrôlé. Dès lors que ce caractère représentatif est assuré par l’utilisation de règles claires et transparentes, le calcul de la sanction ne devrait pas susciter d’incompréhension.
Il a donc été décidé avec les fédérations que le groupe de travail avec l’administration arbitrerait au cours de ses réunions les difficultés d’interprétation qui lui seraient soumises par les fédérations et les établissements.
De plus, à la demande des fédérations, un outil sera mis en place pour permettre les remontées « anonymes » des difficultés rencontrées par les établissements ou les points de désaccord.
Enfin, s’agissant des demandes de clarification des règles de codage et de facturation, les établissements ont la possibilité de saisir directement l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation dès qu’un problème de codage se pose, notamment sur les points médicaux pouvant prêter à discussion.

Madame la ministre, je vous remercie de cette réponse qui, je dois vous le dire, ne me satisfait pas tout à fait.
Depuis 2005, les contrôles mis en œuvre avec la tarification à l’activité ont une double vocation : remplir une mission d’ordre pédagogique destinée à accompagner les établissements pour améliorer la qualité du codage de leur activité et éviter tout risque d’utilisation abusive de la codification des séjours par les hôpitaux. Très bien !
Sur le plan pratique, ce dispositif a été instauré de manière progressive, ce qui n’est pas mal non plus.
Les séjours de 2005 ont ainsi fait l’objet de réclamations d’indus aux établissements, mais pas de sanctions. Ceux de 2006 et de 2007 ont subi les conséquences de la totalité du dispositif. Voilà qui est moins bien !
Vous vous en doutez, madame la ministre, le climat n’a jamais été bon entre des contrôleurs qui se sont éloignés de la dimension pédagogique et des cliniciens qui considèrent souvent que certains de leurs diagnostics sont remis en cause par leurs confrères des caisses d’assurance maladie.
Personne ne met en doute l’intérêt des contrôles ni la légitimité de la majorité des indus. Néanmoins, la suspicion qui entoure notre pratique du codage a mis à mal l’esprit du dispositif. Celui-ci était toutefois vicié à la base, puisqu’il n’a jamais été question que l’assurance maladie reverse aux hôpitaux une facturation insuffisante des séjours contrôlés. Autrement dit, cela vaut dans un sens, mais pas dans l’autre !
Oserai-je ajouter que le coefficient multiplicateur est proprement scandaleux ? C’est comme si un automobiliste ayant grillé un feu rouge en ville était sanctionné pour le nombre de feux existants dans cette commune, sous le prétexte qu’en ayant franchi un il est susceptible de les franchir tous ! Ce coefficient multiplicateur mérite donc d’être revu.
Dans la région dont je suis l’élu, la Bourgogne, l’assurance maladie veut réclamer aux douze établissements contrôlés en 2009, dont neuf appartiennent au secteur hospitalier public, la somme de 9 700 100 euros, soit entre dix et quarante fois le montant des indus relevés !
La directrice générale de l’ARS Bourgogne, probablement gênée par ces demandes inconséquentes, a mis en place un processus de concertation associant les établissements et prendra sa décision avant la fin de l’année 2010.
Je sais qu’il y aura des remontées, des discussions, des négociations, mais tout de même ; il faut revoir le système au fond, madame la ministre !
Je vous prie de transmettre ma demande, afin que, à l’avenir, il soit remédié à cette dérive, et de rappeler avec insistance à Mme la secrétaire d’État à la santé que ces sanctions sont non seulement injustes, mais mal calculées. Il ne faudrait pas qu’elles soient prises en fin d’année, afin de ne pas pénaliser nos établissements d’une façon déraisonnable. Laissons plutôt la place à une nouvelle négociation tenant compte de tous les arguments.

La parole est à Mme Claudine Lepage, en remplacement de M. Jean-Luc Fichet, auteur de la question n° 1069, adressée à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame la ministre, mon collègue Jean-Luc Fichet, qui n’a pu être présent ce matin, m’a demandé de vous soumettre sa question orale.
Il souhaite attirer l’attention du ministre de l’intérieur sur ses craintes quant à la disparition d’un service public essentiel sur le territoire de Morlaix : la sous-préfecture.
En France, le réseau de sous-préfectures d’arrondissement est l’un des plus denses de l’administration territoriale. C’est une vraie chance pour les territoires, en particulier ruraux.
La proximité avec les services de l’État est essentielle pour l’arrondissement de Morlaix, un territoire majoritairement rural et touché par une certaine fragilité sociale.
La suppression de la sous-préfecture de Morlaix ne ferait malheureusement qu’allonger la liste de la disparition des services publics sur le territoire morlaisien. Je pense au tribunal de grande instance ou à la Banque de France.
Notre inquiétude fait suite aux déclarations de M. Brice Hortefeux à Saint-Malo, le 11 octobre dernier, sur ce qu’il appelait des « réajustements provisoires » de la carte préfectorale.
Ainsi, dans quelle mesure la troisième vague de suppressions d’emplois prévue dans le cadre de la révision générale des politiques publiques affectera-t-elle l’avenir de la sous-préfecture de Morlaix ?
Madame la ministre, rappelons que la révision générale des politiques publiques que vous mettez en œuvre depuis 2007, sous couvert d’une meilleure gestion des deniers publics, procède, en réalité, à des coupes en règle dans les services publics locaux et à une réduction des appuis de l’État aux collectivités territoriales. De vastes zones rurales et périurbaines sont, aujourd’hui, totalement laissées à l’abandon.
Or la RGPP part du postulat que les missions de production de titres d’identité et de contrôle des actes des collectivités territoriales sont amenées à décroître rapidement.
Pourtant, il est important de préserver la qualité du réseau de l’administration territoriale, afin de répondre au plus près aux attentes des citoyens et des collectivités.
En effet, les collectivités locales ont besoin d’expertise pour appréhender leurs fonctions. Il n’est pas possible d’éloigner les services publics des citoyens si l’on veut mettre en œuvre un développement durable de nos territoires
Concrètement, faute de transports ou d’horaires compatibles, nos citoyens ne pourront plus se rendre sur les lieux du service public et les files d’attente ne feront que s’allonger. Faute de service public de qualité, c’est une privatisation qui se profile à l’horizon.
Quant au motif financier, il n’est pas recevable. Un récent rapport de l’inspection générale de l’administration met en lumière les gains très limités de ces mutualisations.
À l’heure où, dans le cadre de la réforme des chambres de commerce et d’industrie, notre collègue François Marc interpelle le Gouvernement sur l’avenir de la chambre régionale et l’équilibre des territoires, nous souhaiterions, madame la ministre, que vous nous apportiez des assurances quant au maintien de ce service public essentiel de l’État à Morlaix, dans le cadre d’une transparence totale avec les élus locaux.
Madame la sénatrice, au nom de M. Jean-Luc Fichet, vous avez attiré l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’avenir de la sous-préfecture de Morlaix, ainsi que, plus généralement, sur celui des sous-préfectures.
À la date du 20 octobre 2010, aucune vacance de poste de sous-préfet d’arrondissement n’était constatée en Bretagne, et seulement quatre postes de sous-préfets d’arrondissement restaient vacants dans le reste du pays.
À elle seule, cette donnée montre tout l’intérêt qui est porté au réseau des sous-préfectures d’arrondissement, l’un des plus denses de l’administration territoriale, qui traduit la diversité démographique, géographique et économique de nos territoires. Ce réseau incarne la présence, l’autorité et la permanence de l’État.
Le sous-préfet lui-même a vocation à demeurer l’interlocuteur de proximité qui anime et coordonne l’action de l’État. Il peut être, dans un certain nombre d’arrondissements, un conseiller d’administration, c’est-à-dire un cadre supérieur issu des personnels des préfectures et des sous-préfectures. Il convient de rappeler que le nombre maximum de conseillers d’arrondissement pouvant être nommés sous-préfets est limité à quinze. Trois conseillers d’administration sont actuellement sous-préfets à Montdidier, dans la Somme, Boulay-Moselle, en Moselle, et Saint-Pierre, en Martinique.
Le maintien du réseau des sous-préfectures n’interdit cependant pas des ajustements ponctuels, là où cela semble possible par un accord local.
Ainsi, dans les zones urbaines où la densité des services publics est importante et les possibilités de circulation relativement aisées, une adaptation du réseau, selon les circonstances, est envisageable. En revanche, dans les zones fragiles, qu’elles soient urbaines ou rurales, la présence de l’État doit être réaffirmée.
Cette adaptation peut prendre des formes diverses. Elle ne peut en tout état de cause être envisagée sans une concertation préalable avec les élus concernés.
Les sous-préfectures doivent relever le défi d’une véritable réorganisation, pour devenir des administrations de mission tournées vers le développement des territoires et la sécurité des populations.
Concrètement, il s’agit de passer d’une administration de guichet à une administration de projet. La sous-préfecture doit apparaître, pour les élus locaux comme pour les services déconcentrés de l’État, comme la tête de pont de l’État territorial.
Telle est l’ambition exigeante et moderne du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration pour les sous-préfectures, ainsi qu’il a pu l’évoquer lors de son récent déplacement à la sous-préfecture de Saint-Malo, le 11 octobre dernier.

Je vous remercie, madame la ministre, de votre réponse, laquelle me semble cependant revêtir un caractère très général. Je laisse à M. Fichet le soin de réagir concernant la situation de Morlaix.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 1062, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame la ministre, la sécurité est une compétence régalienne de l’État. C’est aussi une préoccupation centrale, et l’une des plus légitimes, de nos concitoyens. Toutefois, les forces de l’ordre peuvent-elles remplir correctement leur mission ?
La question se pose quand on observe la situation difficile dans laquelle se trouve un poste de police situé dans le département dont je suis l’élu, celui de la ville de Coulounieix-Chamiers en Dordogne.
Ce poste de police est chargé d’un territoire regroupant quatre communes, deux zones économiques et deux quartiers sensibles bénéficiant de contrats urbains de cohésion sociale, soit une population totale de 18 000 habitants, en forte augmentation depuis dix ans.
Les élus de ce territoire en pleine expansion se plaignent du nombre croissant des délits et actes de petite délinquance auxquels ils sont confrontés.
Alors que l’on recensait au sein de ce poste de police douze agents en 2003, ils ne sont plus que onze aujourd’hui. À ceux qui voudraient y voir un signe de stabilité, précisons que, sur ces onze agents, cinq sont des adjoints de sécurité. Il faut également tenir compte de l’absence non remplacée de l’un d’entre eux et des impératifs de gestion du personnel. Ainsi, entre les récupérations pour les permanences du samedi, les tâches indues et le renfort à apporter au commissariat de Périgueux, les effectifs sont, en pratique, amputés d’un tiers. Au total, le commissariat tourne avec un effectif d’environ six personnes, ce qui est trop peu ! Cela nuit à la mission des forces de l’ordre.
Depuis 2006, le poste de police n’est ouvert que de onze heures trente à vingt heures, ce qui pose des problèmes aux personnes qui souhaitent porter plainte et qui ne sont pas forcément informées de ces horaires.
Il faut savoir aussi que le territoire concerné est tout en longueur : il faut vingt-cinq minutes au moins pour le traverser. Or le commissariat dispose de deux véhicules pour quatre communes et, souvent, un seul est disponible sur le terrain !
La nuit, c’est encore pire, puisque la BAC, la brigade anti-criminalité, doit couvrir l’ensemble de l’agglomération périgourdine, soit 70 000 habitants, avec un seul véhicule !
Tout cela fait que les policiers ne peuvent exercer leur mission dans les meilleures conditions, malgré leur professionnalisme. Ils n’ont plus le temps non plus d’assurer un travail de proximité digne de ce nom.
Pour remédier à cette situation, l’État nous invite à augmenter le nombre des caméras de vidéosurveillance. Cette réponse est selon moi insuffisante, madame la ministre, car la technologie ne pourra jamais remplacer la présence et le savoir-faire des forces de l’ordre. J’attends donc de l’État, et les élus du département avec moi, qu’il assume pleinement ses responsabilités.
Dans ces conditions, ma question est extrêmement simple : quels engagements permettant d’améliorer la situation actuelle du commissariat de Coulounieix-Chamiers pouvez-vous nous donner ?
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur le poste de police de la ville de Coulounieix-Chamiers en Dordogne.
Au 30 novembre 2010, la circonscription de sécurité publique de Périgueux, dont dépend la commune de Coulounieix-Chamiers, comptait 156 fonctionnaires, soit un chiffre supérieur à l’effectif de référence pour cette circonscription, auxquels s’ajoutaient 36 adjoints de sécurité. Le commissariat de secteur de Coulounieix-Chamiers, compétent pour les communes de Chancelade et Notre-Dame-de-Sanilhac, assure ses missions de sécurité de proximité avec l’appui des unités spécialisées du commissariat central.
Si les moyens humains sont essentiels, ils ne sont pas tout, et le service rendu à la population dépend d’abord de l’efficacité et de la disponibilité des forces de l’ordre. L’action de ces dernières s’appuie en particulier sur la BAC, tandis que des équipages de motocyclistes patrouillent du matin au soir pour assurer aussi bien des missions de sécurité routière que de lutte contre la délinquance. La police technique et scientifique est également fortement mobilisée et dispose d’agents tout à fait qualifiés.
Un effort particulier est mené en matière de prévention de la délinquance, notamment à Coulounieix-Chamiers. Les halls d’immeuble de la rue Jean-Moulin ont ainsi été aménagés, à la suite d’une concertation efficace entre la mairie, le bailleur, les habitants et la police nationale.
Un projet de vidéoprotection est par ailleurs à l’examen pour une nouvelle zone d’activité commerciale, située sur le territoire de deux communes, dans un lieu isolé et à proximité d’axes routiers. La vidéoprotection constitue en effet un outil à l’efficacité reconnue, en matière de prévention comme de répression. Ce projet vous a été soumis, monsieur le sénateur, en votre qualité de président de la communauté d’agglomération.
Soucieuse de travailler en partenariat avec tous les acteurs concernés, la police nationale s’est particulièrement mobilisée à la suite d’une série de troubles à l’ordre public commis par de jeunes voyous de la cité Pagot à Coulounieix-Chamiers. Ces incidents ont conduit à la réunion, en octobre dernier, d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance restreint et à une réunion en préfecture avec le parquet. La police nationale a pu à cet égard rappeler l’opportunité pour le maire de recourir aux moyens d’action que lui confère la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
La mobilisation et l’efficacité portent leurs fruits. Sachez par exemple, monsieur le sénateur, que 12 personnes, dont certaines résidaient à Coulounieix-Chamiers, ont été récemment interpellées et écrouées dans le cadre du démantèlement d’un réseau de trafics de stupéfiants qui fonctionnait depuis plusieurs années.
Plus globalement, les bons résultats obtenus dans cette circonscription de sécurité publique témoignent de l’efficacité du travail accompli par les forces de l’ordre : les atteintes aux personnes ont baissé de 6, 48 % au cours des onze premiers mois de l’année et les atteintes aux biens de 3, 15 %.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que les forces de l’ordre resteront totalement mobilisées pour continuer à assurer la tranquillité et la sécurité des habitants de ces communes du territoire périgourdin.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. À vous écouter, j’ai l’impression que tout va très bien dans le secteur de Coulounieix-Chamiers !
Je souhaite cependant rappeler que la petite délinquance et les actes d’incivilité n’ont jamais été aussi importants sur ce territoire. Ce sont non pas simplement deux communes qui sont concernées par le commissariat, mais quatre, et qui sont importantes, puisque, comme je le précisais, elles comptent au total 18 000 habitants et comportent deux quartiers sensibles, deux zones d’activité économique, ainsi qu’une zone d’activité économique doublée d’une zone commerciale, où la délinquance est également présente.
Pour ma part, je déplore que le nombre de fonctionnaires de police ait diminué, passant de douze en 2006 à onze aujourd’hui. Par ailleurs, du fait de l’absence non remplacée d’un agent, leur nombre effectif est de dix. Si l’on met de côté les adjoints de sécurité, lesquels, vous le savez, ne peuvent fonctionner qu’en équipe avec un fonctionnaire de police, on constate nécessairement que les effectifs sur le terrain sont particulièrement réduits.
En outre, contrairement à ce que vous avez affirmé, madame la ministre, les effectifs du commissariat de police de Coulounieix-Chamiers servent de variable d’ajustement et permettent de renforcer ceux du commissariat de Périgueux. Prétendre que, à l’échelle du territoire, nous disposons d’un nombre de fonctionnaires très important, c’est déformer la réalité ! On dépouille le poste de Coulounieix-Chamiers pour assurer le respect d’un certain nombre de priorités sur d’autres secteurs.
Pour ma part, en tant que président de la communauté d’agglomération périgourdine, qui regroupe les quatre communes en question, et maire de Chancelade, je réitère ma demande, qui est soutenue par l’ensemble des élus de ce territoire.
Nous souhaiterions que l’État nous propose autre chose que de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection ! La légère différence sémantique entre ces termes pourrait d’ailleurs nous faire croire, à tort, que la seconde technique nous permettra de dormir tranquille.
Je respecte les forces de police, qui effectuent, lorsqu’elles sont en nombre suffisant, un très bon travail, indispensable pour assurer la sécurité sur un territoire dont la population est en augmentation.
Madame la ministre, je ne me satisfais pas de votre réponse. Permettez-moi d’insister en faveur de la mise en place, dans ce cas particulier, de renforts ou d’une organisation plus pertinente et plus efficace sur le terrain.

La parole est à M. Jean-Pierre Chauveau, auteur de la question n° 1111, adressée à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Madame la ministre, j’ai souhaité interroger M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration au sujet de la prise en charge par l’État des frais induits par les manifestations sportives, culturelles ou festives rassemblant du public.
En effet, chaque année, en France, de très nombreuses manifestations sportives, culturelles ou simplement récréatives sont organisées. Il s’agit d’événements auxquels les Françaises et les Français sont très attachés et qui témoignent souvent du dynamisme de notre tissu associatif.
Dans la plupart des cas, les organisateurs respectent scrupuleusement les obligations qui leur incombent. On peut même observer que, pour ces associations, les coûts sont de plus en plus importants. Ainsi, l’organisateur du circuit cycliste Sarthe–Pays de la Loire, qui dure quatre jours, m’a écrit récemment pour me signaler une hausse de 20 000 euros de ces frais, consécutive à la revalorisation du tarif applicable aux épreuves sur route ! Il faut noter d’ailleurs que cette course est entièrement organisée par des bénévoles.
À l’inverse, un certain nombre de grands rassemblements, organisés à titre lucratif, nécessitent la mise en œuvre d’importants moyens de la part de l’État, notamment au regard des risques liés à la sécurité des biens et des personnes. Je pense en particulier aux épreuves sportives de haut niveau, par exemple dans le football professionnel, ou aux grands spectacles, par exemple ceux qui se déroulent au Stade de France et qui nécessitent, au nom du maintien de l’ordre, un important déploiement de forces de police ou de gendarmerie.
Aussi, madame la ministre, je vous remercie de bien vouloir me préciser les conditions dans lesquelles ces frais sont remboursés par les organisateurs et, le cas échéant, les mesures nouvelles qui pourraient être envisagées afin de réduire la charge résiduelle venant éventuellement à peser sur l’État, donc sur l’ensemble des contribuables.
J’ajoute qu’il convient de veiller à différencier les manifestations selon qu’elles ont, ou non, un caractère lucratif.
Monsieur le sénateur, vous appelez l’attention du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur la prise en charge par l’État des frais induits par les manifestations sportives, culturelles ou festives rassemblant du public et organisées à titre lucratif.
S’il est normal, pour le bon déroulement de ces manifestations, que l’État satisfasse aux obligations qui incombent à la puissance publique, il est tout aussi naturel que, lorsque l’intervention des forces de sécurité dépasse ces obligations, le coût ne soit pas uniquement pris en charge par l’État, donc par les contribuables.
Le ministre de l’intérieur a donc proposé un nouveau dispositif de tarification, qui a fait l’objet d’un décret en Conseil d’État du 28 octobre 2010, suivi d’un arrêté.
Conformément aux règles de la loi organique relative aux lois de finances, les décrets relatifs à la rémunération des services rendus par l’État doivent être soumis à ratification parlementaire en loi de finances. En l’espèce, la ratification du décret du 28 octobre 2010 fait l’objet de l’article 3 du projet de loi de finances rectificative pour 2010, que l’Assemblée nationale et le Sénat viennent d’adopter dans les mêmes termes.
Il faut savoir que le dispositif de facturation des services d’ordre jusqu’à présent non seulement était très complexe, mais aboutissait, d’une part, à faire peser sur le contribuable une charge qui aurait dû normalement incomber aux organisateurs, et, d’autre part, à concentrer les forces de l’ordre sur des missions qui auraient dû, elles aussi, revenir aux organisateurs.
De fait, le nouveau dispositif a deux objectifs.
Premièrement, il vise à recentrer l’action des forces de la police et de la gendarmerie sur leur priorité, qui est la lutte contre la délinquance : pour cela, il convient de facturer aux organisateurs un prix adapté au coût réel de la mise à disposition de forces pour la partie non liée à l’ordre public, afin de les inciter à recourir de préférence à des personnels bénévoles ou rémunérés. Ainsi, le nouvel arrêté de tarification prévoit une réévaluation progressive étalée dans le temps.
Deuxièmement, ce dispositif tend bien évidemment à accompagner les manifestations sportives et culturelles : cette réforme n’a pas pour vocation de « faire gagner de l’argent à l’État », ni de mettre en péril certaines manifestations. Nous veillerons tout particulièrement à une application équitable à l’ensemble des événements et organisateurs concernés.
Les plus grandes manifestations, qui ont souvent des capacités financières importantes, sont ainsi frappées d’un coefficient multiplicateur dont sont exonérés les plus petits événements.
Par ailleurs, comme vous en avez émis le souhait, une attention particulière est portée aux courses cyclistes, qui ne figurent pas dans la catégorie des événements organisés à titre lucratif.
Soyez-en assuré, monsieur le sénateur, le Gouvernement veillera à cette équité et continuera d’assumer toutes ses missions, mais il ne veut pas que les forces de l’ordre perdent de vue leur objectif essentiel, qui est d’assurer le service que les citoyens attendent d’elles : la sécurité et la tranquillité de tous.

Madame la ministre, je vous remercie de vos propos, qui répondent en grande partie à mes interrogations.
Tout le monde en convient, les opérations à but lucratif doivent faire l’objet d’une facturation au prix réel. En revanche, comme vous l’avez signalé, madame la ministre, il convient de veiller expressément à ne pas faire supporter une charge excessive sur les organisateurs de manifestations telles que les courses cyclistes, qui œuvrent bénévolement sur l’ensemble de notre territoire.

La parole est à M. Marc Laménie, auteur de la question n° 1083, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé.

Madame la ministre, j’appelle l’attention de Mme la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l’annonce, le 26 juin dernier, par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies, le LFB, de son souhait d’acquérir trois sociétés autrichiennes dont l’activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque.
Comme d’autres collègues l’ont été dans les départements dont ils sont les élus, j’ai été alerté de ce projet par les associations de donneurs de sang bénévoles des Ardennes. Ces amicales, dont les membres sont très impliqués et sont animés de la meilleure volonté, voient là une remise en cause du principe de la gratuité du don, dans la mesure où, en Autriche, la collecte de plasma est indemnisée à hauteur de 20 euros.
Bien que cette démarche d’acquisition soit tout à fait légale compte tenu du statut de société anonyme du LFB, depuis la loi du 21 juillet 2009 dite « HPST », c’est-à-dire portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, elle nous pose problème sur le plan éthique, puisque rien ne semble garantir que la France ne diffusera pas, désormais, des produits collectés ou fabriqués à partir de « dons » rémunérés, alors même que les textes fondateurs de notre République et la directive européenne 2002/98/CE du 27 janvier 2003 préconisent la gratuité.
Aussi, madame la ministre, je souhaiterais savoir comment les institutions publiques pourraient assurer le respect de l’éthique s’agissant des médicaments fabriqués par le LFB postérieurement à l’acquisition de ces sociétés étrangères.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention de la secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sur l’annonce, le 26 juin dernier, par le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies de son souhait d’acquérir trois sociétés autrichiennes dont l’activité consiste à collecter du plasma humain en Autriche et en République tchèque.
L’acquisition d’un groupe de collecte étranger s’inscrit dans la logique d’internationalisation du LFB. Son implantation sur le marché international est une condition essentielle de son développement, dans un contexte de concentration des géants internationaux du fractionnement.
Le LFB joue un rôle majeur en matière de santé publique et la France ne peut se permettre d’affaiblir cette entreprise, qui dispose d’un monopole pour fractionner le sang collecté par l’Établissement français du sang.
Ce processus d’internationalisation, maîtrisé et respectant nos exigences de qualité et de sécurité des produits, ne doit donc pas être freiné par les pouvoirs publics, à la condition sine qua non que cela n’affecte en rien le respect sur notre territoire des principes éthiques attachés à la collecte du sang : il s’agit de dons bénévoles, non rémunérés, gratuits et anonymes.
C’est notamment pour ces raisons que la loi affirme le caractère public du LFB. Dans une récente déclaration, le 26 octobre 2009, le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, n’évoque l’ouverture du capital que pour la filière des biotechnologies, affirmant ainsi la préservation absolue de la filière plasma.
Cette acquisition n’aura aucune incidence sur le marché français du plasma, gouverné par des principes éthiques.
En tant que société anonyme, le LFB dispose de la possibilité de s’implanter à l’étranger, à condition de respecter la législation en vigueur dans les pays concernés, en l’occurrence l’Autriche et la République tchèque, mais également de respecter le droit international et européen auquel la France est soumise.
En tout état de cause, le LFB doit mettre sur le marché français des médicaments dérivés du sang respectueux des principes éthiques. Les cas d’autorisation de mise sur le marché dérogatoire sont explicitement prévus par le code de la santé publique.
La loi HPST donne donc au LFB les moyens de se développer, tout en lui assignant des missions de service public précises et contraignantes sur le marché français.
Par ailleurs, le LFB est fortement engagé dans un processus de sécurisation de ses moyens de production, afin d’améliorer encore la sécurité et la qualité de ses produits.
La collecte et la production de produits dérivés du plasma indemnisé pour les marchés étrangers n’affecteront pas la qualité et l’innocuité des produits vendus en France, pas plus que la sécurité des patients, dans le respect de la dignité des donneurs.
L’engagement du Gouvernement en faveur des valeurs éthiques du don de sang ne faiblit pas. Son travail au sein des instances européennes se poursuit dans cette perspective.

Madame la ministre, je vous remercie de vos informations. Vous avez insisté sur la notion d’éthique : les nombreux bénévoles membres des amicales de donneurs de sang, dont je suis un modeste porte-parole, sont légitimement préoccupés par cette dimension, mais vos propos et les engagements du Gouvernement devraient les rassurer pour l’avenir.
Nous sommes tous attachés au don de soi, au don pour les autres et au principe de gratuité. Je vous remercie donc de votre réponse.

La parole est à M. Yves Détraigne, auteur de la question n° 1107, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Je souhaite appeler attention du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants pour le compte et à la demande des collectivités territoriales, ainsi que sur la mise en œuvre de leur défiscalisation.
En effet, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », et son décret d’application n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 précisent que les heures supplémentaires effectuées, à la demande des collectivités territoriales, par les enseignants conformément au décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 sur la surveillance, les études surveillées et l’enseignement entrent dans le champ de l’exonération.
En conséquence, l’exonération des charges – contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale – doit être imputée sur la retenue pour pension, puisqu’il faut que l’URSSAF continue à encaisser les montants dus.
Sur le principe, il est donc demandé aux collectivités territoriales d’avancer ces sommes, qui doivent leur être remboursées, chaque trimestre, à compter de l’exercice 2010, par le ministère de l’éducation nationale, sur présentation d’états justificatifs.
Pour l’heure, il semblerait toutefois que ni les inspections d’académie ni les rectorats n’aient reçu d’instruction en ce sens de la part du ministère.
Ils ont au contraire reçu, le 19 juillet dernier, une circulaire du ministre chargé du budget, laquelle précise que « le remboursement est assuré par le ministre de tutelle […] pour les collectivités territoriales […] et par le ministère de rattachement du corps d’origine du fonctionnaire de l’État détaché exerçant pour tout ou partie de son activité au sein de la collectivité territoriale […] ».
Ainsi, il semblerait que le remboursement ne puisse concerner que les fonctionnaires de l’éducation nationale en détachement auprès des collectivités territoriales ou leurs établissements publics, et non les enseignants en activité à l’éducation nationale qui y font des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il est à craindre que beaucoup de collectivités cessent de recourir à des personnels enseignants pour assurer les activités périscolaires, ce qui ne manquerait pas de créer de nombreuses difficultés avec ces professionnels, voire d’entraîner la disparition des activités périscolaires que l’éducation nationale tend pourtant à encourager.
Je vous saurai donc gré, madame la ministre, de bien vouloir m’indiquer si M. le ministre de l’éducation nationale compte intervenir auprès de son collègue chargé du budget pour faire abroger la circulaire du 19 juillet dernier et la remplacer par une nouvelle circulaire conforme à l’esprit du décret de 1982. En attendant, je peux vous confirmer que les collectivités locales n’entendent pas faire l’avance des cotisations si elles n’ont pas la garantie de leur remboursement.
Avant tout, monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, qui est retenu par d’autres obligations.
Vous attirez son attention sur les exonérations relatives aux heures supplémentaires versées aux enseignants, plus précisément aux heures qu’ils effectuent à la demande des collectivités territoriales à des fins diverses.
L’article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, dite « loi TEPA », vise les agents publics qui voient l’essentiel de leurs heures supplémentaires bénéficier de l’exonération de l’impôt sur le revenu et d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale. L’agent bénéficiaire perçoit le montant brut des heures supplémentaires effectuées et l’employeur continue de s’acquitter des cotisations sociales légales auprès des organismes sociaux.
De ce mécanisme résulte pour l’employeur une charge budgétaire supplémentaire, dont le financement et le circuit de compensation doivent être déterminés selon les cas.
Dans un premier cas – celui des personnels rémunérés sur budget ministériel et assurant des heures supplémentaires dans leur département ministériel d’origine –, les ministères employeurs ont bénéficié en 2008 et 2009 d’un remboursement a posteriori de cette charge supplémentaire à partir d’une provision suivie par le ministère chargé du budget. À compter de l’exercice 2010, le surcoût est, en revanche, financé directement sur les budgets ministériels. La mise en œuvre de ces dispositions de compensation ouvertes au budget du département de l’éducation nationale ne pose pas de problème particulier.
Dans un second cas – celui des personnels fonctionnaires de l’État détachés et exerçant tout ou partie de leur activité au sein des établissements publics de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements hospitaliers ou médico-sociaux –, comme le prévoit une circulaire du ministre chargé du budget en date du 19 juillet 2010, la charge supplémentaire que représente l’acquittement des cotisations sociales doit être remboursée par le ministère de rattachement du corps d’origine du fonctionnaire concerné.
Monsieur le sénateur, aucun de ces deux dispositifs de financement et de compensation ne s’applique toutefois au cas particulier sur lequel vous interrogez le ministre de l’éducation nationale : celui des heures supplémentaires effectuées par une part importante des 300 000 instituteurs et professeurs des écoles françaises et payées par plusieurs milliers de communes.
En effet, ce sont principalement des enseignants du premier degré qui sont concernés par le versement de ces heures supplémentaires exonérées. Au-delà de leurs obligations professionnelles normales, ils assurent des heures de soutien scolaire pour le compte et à la demande des collectivités territoriales.
Au titre de ces activités, les enseignants ne sont en aucun cas détachés auprès des communes qui les emploient, les collectivités territoriales n’étant que leurs employeurs secondaires. En outre, les services de l’éducation nationale n’interviennent nullement dans la certification du service rendu à cette occasion ni dans la liquidation de ces heures, puisque les communes assurent, sur leur propre budget, le paiement direct aux agents des heures supplémentaires.
C’est en ce sens que le ministre de l’éducation nationale a récemment saisi le ministre en charge du budget afin que soit déterminée, en lien avec le ministre chargé des collectivités territoriales, la procédure budgétaire selon laquelle les collectivités seront remboursées, le cas échéant, du surcoût lié aux réductions de cotisations décidées dans le cadre de la loi TEPA.
Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous serons particulièrement attentifs à trouver une solution adaptée à cette question.

Vous avez parfaitement ciblé le problème que je soulevais, madame la ministre, et je vous remercie de cette réponse extrêmement claire. Je la diffuserai aux collectivités territoriales, qui sont tout particulièrement concernées et qui s’interrogent sur ce sujet. J’ai bien noté que certains points étaient encore à régler et j’espère qu’ils le seront rapidement. En effet, nous arrivons à la fin de 2010 et ce dispositif était censé entrer en vigueur dès le début de cette année.

La parole est à Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 1106, adressée à Mme le ministre d'État, ministre des affaires étrangères et européennes.

Depuis quelques années, les cas de harcèlement moral, qui se multiplient, sont dénoncés. Sont-ils les symptômes d’une époque, d’un malaise individuel ou général ? Les analyses divergent sur l’interprétation de cette forme inédite de violence.
Pour ma part, je remarque que plus de 50 % des plaintes pour harcèlement moral sont déposées par des membres de la fonction publique.
Dans une décision rendue le 12 mars dernier, le Conseil d’État a reconnu à une fonctionnaire victime de harcèlement moral le bénéfice de la protection fonctionnelle instituée par la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Cette décision confirme la réponse ministérielle apportée, en juillet 2008, à une question écrite du sénateur Alain Gournac : « L’octroi de [cette] protection entraîne l’obligation pour l’administration, dès qu’elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en œuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre de l’auteur du harcèlement, de l’éloigner de l’agent victime et de rétablir l’agent dans ses droits […]. »
Mais qu’en est-il pour le fonctionnaire en poste à l’étranger ?
Des informations ou des témoignages que j’ai pu recueillir lors de mes visites aux communautés françaises de l’étranger montrent que celles-ci ne sont pas exemptes de cas de harcèlement moral. Pourquoi le seraient-elles, d’ailleurs ? Parfois, les conséquences sont gravissimes. Plusieurs suicides ou tentatives de suicide ont été constatés à travers le monde.
Nous nous devons de prendre conscience du handicap supplémentaire des agents en poste à l’étranger, à savoir leur éloignement géographique de la France – donc de leur administration de rattachement –, mais aussi, pour les petits postes d’une dizaine d’agents, l’isolement social et l’impression qu’ont les fonctionnaires de vivre en vase clos, loin de leurs familles et de leurs amis. Quand, en outre, ils résident dans un pays hostile, où règne l’insécurité, cela ne fait qu’ajouter à leur stress.
Les conflits entre agents ont toujours existé – on ne les a pas créés avec la révision générale des politiques publiques –, mais quand les suppressions de postes pleuvent, quand elles constituent une menace guettant chacun, la propension à l’affrontement augmente.
Dans ces conditions, quelle aide recevoir en cas de mal-être au travail, de souffrance, de harcèlement moral ?
Les différents cas de harcèlement moral constatés me semblent donc justifier la création d’un bureau de la médiation apte à répondre aux plaintes venues de tous les pays.
Ce bureau qui, dans une exigence de neutralité, rendrait compte, au sein du ministère, à la direction générale de l’administration – la DGA –, et non à la direction des ressources humaines, pourrait agir pour apaiser les conflits par le dialogue, le conseil, la médiation. Il pourrait mettre en contact les interlocuteurs, ou proposer une orientation vers un psychologue, voire vers un syndicat, apte à apporter son aide dans le cadre d’une action en justice, si celle-ci se révèle nécessaire.
Que pensez-vous, monsieur le ministre, de la création d’un tel bureau de la médiation, destiné tant à la résolution des conflits, quels qu’ils soient, qu’à la prévention du harcèlement – ce dernier débute souvent par une série de conflits qui ne se règlent pas et s’enveniment – et permettant aux protagonistes de retrouver un quotidien serein ?
Permettez-moi tout d’abord, madame la sénatrice, de vous remercier d’avoir posé cette question, qui aborde un sujet très important : les cas de harcèlement moral dans la fonction publique, plus particulièrement chez les fonctionnaires français à l’étranger.
Michèle Alliot-Marie, qui n’a pu être présente ce matin du fait d’un déplacement – je vous prie d’excuser son absence –, attache une très grande importance à la gestion des ressources humaines de son ministère, l’expatriation répétée des agents, comme vous l’avez indiqué, pouvant conduire à des situations humaines douloureuses.
Dans les situations décrites sous le terme générique de harcèlement moral, on peut effectivement trouver d’autres composantes – problèmes liés au stress, à la vie familiale, à la gestion des déplacements, aux difficultés à assurer au mieux ses missions dans un contexte évolutif. Ces difficultés peuvent être exacerbées dans une situation d’expatriation, la transplantation dans un nouveau pays ou une nouvelle culture venant s’ajouter au choc du nouveau poste.
Nos équipes de gestion des ressources humaines ont donc développé des outils particulièrement innovants, qui constituent l’une des particularités du ministère des affaires étrangères et européennes.
Tout d’abord, pour repérer les problèmes, il faut les connaître ! Une politique de prévention a été développée, reposant sur la formation des agents : gestion d’équipe, traitement du stress, préparation spécifique au départ dans les postes. Ces dispositifs, reliés à une évaluation « à 360 degrés » que le ministère des affaires étrangères et européennes est le seul à mettre en œuvre au sein de la fonction publique, sont autant d’outils visant à prévenir les situations problématiques, plutôt qu’à les corriger a posteriori.
En outre, lorsqu’une situation paraît préoccupante, l’inspection générale, qui dépend directement du ministre, dépêche une mission sur place. Nous nous appuyons également sur le travail d’un psychologue, rattaché à la direction des ressources humaines, qui se tient à l’écoute des agents et n’hésite pas à effectuer des missions sur le terrain.
Bien évidemment, si un comportement inacceptable est avéré, le ministère engage une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent fautif et l’autorité disciplinaire peut être amenée à prononcer une sanction. Je précise d’ailleurs que Michèle Alliot-Marie n’hésitera pas à intervenir dans des cas où le comportement fautif est constitutif d’un délit – c’est le cas du harcèlement moral –, le parquet pouvant même être saisi.
Enfin, un cadre a été mis en place pour le dialogue social dans les postes à l’étranger, en accord avec les organisations syndicales.
Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice, vous avez raison : même si les situations de harcèlement moral restent – heureusement – très exceptionnelles, elles ne doivent pas être sous-estimées et méritent toutes une réponse. Dans ce domaine, c’est la tolérance zéro qui doit prévaloir !

Les cas que nous évoquons ici, monsieur le ministre, sont effectivement très sensibles et difficiles à régler.
Parfois, pour les victimes, le plus grand ennemi est le silence. En effet, toutes n’ont pas d’interlocuteur. Voilà pourquoi l’idée d’un bureau de la médiation prenait, dans le contexte de l’expatriation, toute son importance.
Outre la question de la neutralité, indispensable aux victimes, il faut noter que les cas de harcèlement se multiplient parfois dans un même poste, provoquant une réaction en chaîne et une succession d’arrêts de travail, sans que l’administration réagisse, parce que, peut-être, elle n’est pas immédiatement consciente de ce qui se passe.
Par exemple, je suis le dossier d’un agent qui, plusieurs mois après l’arrêt sans motif de son contrat, à un mois de sa titularisation, n’a toujours pas obtenu réparation du préjudice subi. Dans un autre pays, le responsable harceleur a été rappelé à Paris huit mois après les faits…
Cela dit, monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Je suis certaine que le ministère des affaires étrangères et européennes sera attentif à toutes ces situations douloureuses.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 1086, adressée à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer l’attention de votre collègue Xavier Bertrand, ministre du travail, de l'emploi et de la santé, sur la situation inquiétante des contrats d’accompagnement dans l’emploi – les CAE – et, plus généralement, des contrats aidés.
Voilà trois mois, le Gouvernement a décidé de mettre un terme au renouvellement des contrats aidés existants et à la signature de nouveaux contrats aidés.
Cette décision n’a pas été sans conséquences pour bon nombre de nos concitoyens, qui se sont retrouvés au chômage alors même que leur employeur avait la ferme volonté de prolonger leur contrat.
Les collectivités territoriales désirant poursuivre ces collaborations se sont, quant à elles, retrouvées dans l’obligation de se substituer à l’État, s’agissant du financement de ces projets.
Sont particulièrement concernés les demandeurs d’emploi, les jeunes et les personnes les plus fragiles, c’est-à-dire celles qui se trouvent en situation de réinsertion professionnelle.
Cette mesure avait permis aux collectivités, aux associations et aux entreprises, grâce aux aides précieuses de l’État, de recruter du personnel en vue d’une embauche définitive.
Si les financements ne peuvent s’inscrire dans la continuité, on peut s’interroger sur l’avenir de ce type de contrats et, plus globalement, sur celui des contrats aidés.
Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer quelles orientations prendra le Gouvernement sur ce sujet ? Êtes-vous en mesure de nous préciser si cette situation se reproduira en 2011 ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser Xavier Bertrand, ministre du travail, de l’emploi et de la santé, qui se trouve en déplacement et qui m’a demandé de le remplacer.
Je sais l’attention que vous portez à ces questions, qui sont à la croisée de deux de vos préoccupations : le rôle des collectivités locales, des mairies en particulier, en matière d’animation du territoire et les enjeux de cette politique en termes d’emploi. Ce sont des sujets que je connais un peu, ce qui me permettra de vous répondre directement.
Tout d’abord, en matière de contrats aidés, l’État a consenti, en 2010, l’effort le plus important de ces dix dernières années. Alors que la loi de finances prévoyait 410 000 contrats aidés, ce sont en fait plus de 520 000 contrats qui auront été conclus cette année avec l’État pour soutenir des collectivités locales, des associations et des chantiers d’insertion, afin que nous puissions, tous ensemble, relever le défi de l’emploi.
Toutefois, l’année 2010 a aussi été marquée par une surconsommation très importante des crédits qui avaient été consacrés à cette action par l’État. L’enveloppe initiale permettait de financer 400 000 contrats d’accès à l’emploi, ou CAE, et 120 000 contrats initiative emploi, ou CIE. Nous avons connu une surconsommation très importante, surtout à partir du mois de septembre dernier, avec un effet d’emballement. Il en est résulté que, au mois de novembre 2010, la totalité de l’enveloppe prévue pour l’année avait été consommée.
L’État n’a pas ménagé ses efforts, mais on ne peut pas laisser la machine s’emballer, au risque de devoir gérer des à-coups brutaux, ce que nous aurions dû faire en 2011 si nous n’avions pas tempéré la situation. Xavier Bertrand a donc été contraint de prendre des décisions de nature à calmer la machine à la fin de l’année 2010 et à permettre ainsi une transition qui soit la plus harmonieuse possible avec l’année 2011.
Monsieur le sénateur, dans un département que vous connaissez bien, la Vienne, près de 2 500 CAE ont été mobilisés, soit 55 % de plus qu’en 2008. Il a donc été décidé de prescrire des contrats aidés là où ils sont indispensables. Il s’agissait en priorité de ne pas suspendre les chantiers d’insertion, qui ont besoin de contrats aidés pour fonctionner, de porter une attention particulière aux auxiliaires de vie scolaire, notamment pour préserver la situation des enfants handicapés, laquelle fait également l’objet de vos préoccupations.
L’État pourra ainsi respecter ses engagements et reprendre la prescription de nouveaux contrats aidés dès le début de l’année 2011.
En résumé, nous financerons tous les contrats aidés qui ont été prévus et, à partir du tout début de l’année 2011, nous pourrons reprendre le mouvement de prescription qui permettra de relancer des contrats suspendus à la fin de l’année 2010.

Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions, qui étaient indispensables et qui rassureront à la fois les collectivités et les associations. Votre action s’inscrit dans la continuité pour 2010 et dans la perspective d’une reprise pour 2011. Il était important de le rappeler, car cela ne correspond pas toujours ce que l’on peut entendre.

La parole est à M. Jean-Claude Carle, auteur de la question n° 1100, adressée à M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Je souhaitais appeler l’attention de M. le garde des sceaux sur la législation relative au droit de recours des tiers en matière d’urbanisme.
En effet, depuis plusieurs années, nous assistons à une multiplication impressionnante des recours à l’encontre de projets d’urbanisme. Si nombre de ces procédures semblent parfaitement justifiées, une certaine proportion d’entre elles paraît abusive. Notre législation se trouve donc détournée de sa finalité première.
Par ailleurs, cette hausse considérable des procédures n’a pas manqué de provoquer un engorgement des juridictions. Ainsi, le délai de jugement au tribunal administratif de Grenoble est aujourd’hui compris entre trois et quatre ans. En cas d’appel, puis de pourvoi en cassation, certains dossiers peuvent être pendants durant une période de dix ans, ce qui est très long. Et, dans l’intervalle, les projets d’urbanisme sont bien sûr à l’arrêt.
Il n’est en aucun cas question de remettre en cause le droit de recours des tiers en matière d’urbanisme. Il est vrai qu’une démocratie ne peut bien fonctionner sans la possibilité pour les citoyens de protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes, c’est-à-dire sans droit de recours, mais l’abus ou le dévoiement de ce dernier doit être réprimé, et cela à la hauteur des préjudices subis par l’autre partie. Or il n’en est rien en France, où toute personne morale ou physique initiatrice d’un recours est à l’abri d’une sanction judiciaire, ce qui laisse la voie libre à des procédures abusives.
Il en va tout autrement chez nos voisins d’Europe du Nord, où il existe un droit de recours en matière d’urbanisme. Afin de prévenir les contentieux injustifiés, ces pays ont mis en œuvre plusieurs dispositions : le dépôt par l’auteur d’une procédure d’une caution financière préalable ; un examen rapide et rigoureux de la recevabilité du recours ; l’obligation d’un rendu de jugement dans des délais très courts ; des condamnations significatives pour les auteurs de recours reconnus comme abusifs.
En cette période d’incertitudes et de difficultés économiques, une plus grande efficacité de notre justice administrative permettrait de restaurer la confiance des porteurs de projets et garantirait la sauvegarde de nombreux emplois et entreprises.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, je souhaite savoir si le Gouvernement est disposé à faire évoluer notre législation.
Monsieur le sénateur, le législateur a toujours été soucieux de garantir la sécurité juridique des décisions prises en matière d’urbanisme, en raison de l’impact de celles-ci sur le plan économique, social ou environnemental.
Des conditions de recevabilité des recours propres au contentieux de l’urbanisme ont été introduites dans le code de l’urbanisme à cet effet. C’est ainsi que l’article L. 600-1 de ce code limite la possibilité d’invoquer devant le juge administratif, par voie d’exception, les vices de forme ou de procédure pouvant toucher certains documents d’urbanisme passé un délai de six mois à compter de la prise d’effet de l’acte en cause.
De même, l’article R. 600-1 prévoit une obligation de notification de certains recours à la charge du tiers requérant, au titulaire d’une autorisation et à l’auteur d’une décision d’urbanisme, sous peine d’irrecevabilité de la requête.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme, l’action en démolition de l’immeuble fondée sur la violation des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique ne peut être exercée par le tiers lésé que si le permis de construire a été annulé préalablement par le juge. Par conséquent, l’expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, qui est en principe de deux mois, vient ici conditionner directement l’exercice de l’action en démolition, ce qui limite fortement les possibilités de recours.
Dans les hypothèses d’annulation du permis de construire par le juge administratif, il convient de souligner que le délai de prescription de l’action ouverte au tiers lésé a été réduit, par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, de cinq à deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction administrative ou de l’achèvement des travaux.
En outre, lorsqu’il se trouve en présence d’un recours qu’il estime abusif, le juge peut toujours faire application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, qui prévoit dans ce cas une amende de 3 000 euros. Il convient de rappeler, au demeurant, que les recours dirigés contre les autorisations d’urbanisme n’étant pas suspensifs, les projets contestés ne s’en trouvent aucunement bloqués.
L’ensemble de ce dispositif permet en l’état d’atteindre l’objectif de sécurité juridique précédemment évoqué. Il ne paraît donc pas nécessaire de le compléter, et ce notamment afin de ne pas porter atteinte de manière excessive au principe du droit au recours juridictionnel, protégé par l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Au demeurant, d’autres dispositions procédurales, non spécifiques au contentieux de l’urbanisme, permettent un traitement rapide de certaines affaires et une mise en œuvre immédiate des décisions d’urbanisme : ainsi, les requêtes manifestement irrecevables peuvent être rejetées par simple ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que les requêtes qui ne comportent que des moyens inopérants.
Enfin, comme vous le savez, monsieur le sénateur, les délais de jugement des juridictions administratives ont été considérablement réduits dans la pratique. Toute priorité accordée au traitement d’un contentieux particulier entraînerait mécaniquement l’apparition d’un délai supplémentaire dans le traitement des autres contentieux, dont certains ne sont pas moins importants pour nos concitoyens.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions, notamment en ce qui concerne la garantie de la sécurité juridique des maîtres d’ouvrage. Les textes ont évolué de manière positive, en ce qui concerne tant les amendes que les rejets ou les délais, même si ces derniers sont encore, à mes yeux, beaucoup trop longs.
J’aurais toutefois souhaité que l’on se montrât un peu plus offensif. Nous vivons dans une démocratie, dans un État de droit, ce qui nous impose de respecter le droit des tiers. Toutefois, si la démocratie n’a pas de prix, elle a un coût, notamment économique. Parfois, les délais trop longs, les recours abusifs sont propres à décourager les plus entreprenants, qu’ils appartiennent au secteur public ou au secteur privé.
Il faut aller plus loin. C’est l’une des préoccupations du Sénat, et Jacques Gautier et Michel Houel ont d’ailleurs déposé une proposition de loi, que je soutiens, visant à faire évoluer le cadre juridique et à éviter des abus qui, je le répète, ont un coût économique. Je ne peux donc qu’espérer qu’elle sera rapidement examinée par le Parlement.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 939, transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite aujourd’hui aborder la question du congé parental, c’est-à-dire du complément de libre choix d’activité, ou CLCA.
La Fédération jumeaux et plus, représentant quatre-vingt-trois associations départementales et plus de 1 500 familles en 2009, s’inquiète du projet de réforme visant à réduire la durée du congé parental pour les familles de multiples.
Les spécificités des familles de multiples induisent de profondes inégalités par rapport aux autres familles en France. Il est vrai que le dispositif du CLCA a permis à de nombreux parents de concilier vie professionnelle et vie de famille. Pourtant le congé parental n’est pas nécessairement un choix ; il constitue souvent la seule solution possible, pour des raisons matérielles.
Dans le cas de naissances multiples, on peut parler de simultanéité des charges : on consacrera, par exemple, quatre heures de maternage par jour à un enfant seul, huit heures à des jumeaux, douze heures à des triplés. L’arrivée d’un nourrisson de 0 à 3 mois représente un budget de 887 euros contre 1017 euros par enfant pour des jumeaux, et ce coût atteint 1984 euros par enfant pour des triplés.
La réduction du CLCA pose le problème de la scolarisation des enfants à l’âge de 3 ans révolus. Au regard de la pénurie de l’offre d’accueil pour les jeunes enfants et du développement des horaires atypiques de travail des parents, force est de constater que les modes de garde sont peu adaptés aux enfants multiples du même âge et de la même famille. Les jardins d’éveil ou établissements d’accueil collectif d’enfants âgés de plus de 2 ans sont des structures intermédiaires essentielles avant la scolarisation, mais, en raison de leur coût financier important, peu de familles en profitent. Dans ces conditions, il semblerait cohérent d’aligner la fin du CLCA non plus sur la date de l’anniversaire des 3 ans des enfants, mais sur celle de leur entrée dans le cursus scolaire, dans leur quatrième année.
La réduction de la durée du congé parental entraînerait une dégradation des conditions de vie des parents de multiples en obligeant l’un des deux parents, privé du CLCA, à cesser son activité professionnelle pour s’occuper de ses enfants. Une année de transition vers la reprise de l’activité professionnelle au moment de la dernière année du congé parental d’éducation pourrait être envisagée, en facilitant par exemple l’accès au droit individuel à la formation.
C’est pourquoi, madame la secrétaire d’État, je vous demande de bien vouloir me faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de remédier à cette situation.
Madame la sénatrice, le soutien aux familles nombreuses est au cœur de notre politique familiale.
S’agissant des allocations familiales, leur montant croît avec le nombre d’enfants à charge. Ces familles obtiennent en outre le « complément familial », qui permet d’aider spécifiquement celles qui assument la charge d’au moins trois enfants.
En outre, la réglementation relative aux prestations familiales accorde une attention toute particulière aux familles qui accueillent des naissances multiples, notamment pendant les premières années de vie des enfants, une période durant laquelle les charges pesant sur ces familles sont très lourdes.
Ainsi, par dérogation à la durée de droit commun de trois ans, les familles qui accueillent des naissances multiples d’au moins trois enfants bénéficient d’une extension de la durée de versement du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant, la PAJE, jusqu’au sixième anniversaire des enfants.
Il en est de même pour le droit à l’allocation de base de la PAJE. Dans le droit commun, si la condition de ressources est remplie, une seule allocation doit être versée par famille, et cela quel que soit le nombre d’enfants de moins de trois ans à charge. Toutefois, dans le cas particulier de naissances multiples, il sera versé autant d’allocations de base que d’enfants issus de la naissance multiple, et ce jusqu’aux trois ans révolus des enfants.
La question d’une réforme éventuelle du complément de libre choix d’activité soulève des enjeux importants pour la politique familiale. À la fin de 2009, près de 550 000 familles étaient en effet bénéficiaires du CLCA, pour une dépense globale de près de 2, 3 milliards d’euros.
Pour étudier le champ des réformes possibles, le Haut Conseil de la famille, le HCF, composé de parlementaires, de représentants de l’État, d’associations et de personnalités qualifiées, a d’ailleurs été saisi de cette question. Il a rendu son avis le 11 février 2010, sans privilégier toutefois de scénario particulier au regard des pistes de réforme explorées.
Madame la sénatrice, pour améliorer les conditions de vie des parents, vous préconisez ainsi l’allongement du congé parental indemnisé jusqu’à la date d’entrée dans le cursus scolaire, au cours de la quatrième année des enfants.
Votre proposition doit d’abord être examinée au regard du juste équilibre entre solidarité collective et responsabilité individuelle : la collectivité doit-elle systématiquement couvrir les coûts qui résultent de choix individuels ?
Il convient ensuite de prendre en compte les effets d’un allongement du congé parental sur les perspectives de reprise d’un emploi et sur le déroulement de la carrière professionnelle des bénéficiaires, notamment des femmes ayant les niveaux de qualification les moins élevés.
Enfin, une éventuelle augmentation de la durée du congé parental doit également tenir compte de la situation financière actuelle de la branche famille, qui, vous le savez, madame la sénatrice, sera déficitaire de 2, 9 milliards d’euros en 2010.
Ces différents éléments doivent éclairer toute évolution éventuelle du dispositif, qui fera nécessairement l’objet, en toute hypothèse, d’une concertation approfondie avec l’ensemble des partenaires sociaux.
Je vous rappelle toutefois que, pour faciliter la poursuite de l’activité professionnelle des parents, le Gouvernement a mis l’accent, depuis plusieurs années, sur le développement et la diversification des modes d’accueil.
Il s’agit ainsi non seulement de soutenir la natalité mais aussi de lutter contre la pauvreté en facilitant l’insertion professionnelle. C’est une priorité pour nous.
Comme le Président de la République s’y est engagé, le plan de développement des modes de garde prévoit, notamment, la création de 200 000 solutions d’accueil supplémentaires durant la période 2009-2012. Les bilans montrent d’ailleurs que cet objectif prioritaire sera atteint.
À titre personnel, j’ajouterai que je suis particulièrement attentive à la scolarisation des très jeunes enfants issus de familles en situation de précarité : outre qu’elle est une solution pour leur garde, cette politique permet de les soutenir dès le début de leur vie par l’apprentissage du langage et de la socialisation.
Tels sont, madame la sénatrice, les éléments de réponse que je peux aujourd’hui vous apporter.

Madame la secrétaire d’État, je salue votre engagement dans ce dossier.
Votre réponse ne rassurera peut-être pas complètement les familles et les associations concernées, qui attendent des modifications dans les textes. Néanmoins, vous faites preuve d’une profonde motivation en la matière !

La parole est à M. Roland Ries, auteur de la question n° 1074, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement.

Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des retraités vivant en France et ayant travaillé en Allemagne.
Alors que l’Union européenne entend promouvoir la libre circulation des travailleurs, les frontaliers sont aujourd’hui confrontés à des difficultés administratives et fiscales considérables. Ils subissent en effet, d’une part, les dommages collatéraux de la réforme fiscale allemande, et, d’autre part, le durcissement du système de contrôle de l’administration française.
En 2005, le Parlement allemand, souhaitant rééquilibrer ses finances publiques, a adopté une loi réformant les retraites. Ce texte a abaissé le seuil de ressources à partir duquel les personnes sont imposables. Les frontaliers, auparavant épargnés, ont vu alors leurs pensions soumises au régime fiscal allemand.
Ainsi, le Trésor public allemand est chargé, depuis le deuxième semestre 2009, d’organiser la collecte de l’impôt. À partir de ce moment, les retraités frontaliers ont connu plusieurs difficultés.
Tout d’abord, la déclaration fiscale obligatoire est incompréhensible pour une personne ne maîtrisant pas parfaitement la langue allemande – il est vrai que certains documents fiscaux de notre pays ne sont pas non plus très clairs, même pour ceux qui parlent parfaitement le français !
Sourires.

En outre, étant « non-résidents », ils sont imposés plus lourdement sans pouvoir bénéficier des abattements en vigueur pour les travailleurs allemands dits « résidents ».
Enfin, l’État allemand exige des frontaliers qu’ils déclarent rétroactivement les pensions perçues depuis 2005. La politique fiscale actuelle de l’Allemagne est, vous le concéderez, madame la secrétaire d’État, manifestement défavorable aux travailleurs frontaliers français.
Je suis d’autant plus inquiet que les frontaliers rencontrent également des difficultés avec l’administration française. En effet, jusqu’à présent, conformément aux instructions des services fiscaux français, les retraités déclaraient leurs pensions de retraite allemandes et bénéficiaient en retour d’un crédit d’impôt sur celles-ci, pour éviter la double imposition. Aucun justificatif d’acquittement de l’impôt en Allemagne ne leur était alors demandé. Dorénavant, l’État français impose aux retraités de le fournir rétroactivement, sur plusieurs années.
Or nombre de retraités sont dans l’incapacité de présenter ce document, puisque leurs revenus n’atteignaient pas le seuil requis pour être soumis à l’impôt allemand. S’il est opportun que l’Allemagne et la France rééquilibrent leurs finances publiques, il est en revanche tout à fait regrettable que les retraités frontaliers en subissent les conséquences, à la fois en France et en Allemagne.
Madame la secrétaire d’État, je souhaiterais donc connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier aux difficultés rencontrées par les retraités frontaliers, d’une part, à l’échelon national, et, d’autre part, dans les négociations bilatérales franco-allemandes.
Monsieur le sénateur, comme vous, plusieurs députés et sénateurs ont appelé l’attention du Gouvernement sur le problème que connaissent aujourd’hui un certain nombre de frontaliers français ayant travaillé en Allemagne, à la suite de la modification par le Parlement allemand, en janvier 2005, du régime d’imposition des pensions et retraites.
Tout d’abord, François Baroin tient à vous préciser que les modalités d’imposition des pensions de source allemande perçues par des personnes résidant en France relèvent de la souveraineté de l’État allemand, dès lors qu’elles respectent les stipulations de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959.
Cela étant, à la demande du Gouvernement, les autorités fiscales françaises se sont rapprochées de leurs homologues allemandes afin de leur demander d’assurer aux bénéficiaires de pensions qui résident en France un traitement équitable, en renonçant notamment à l’application de pénalités pour tenir compte de la bonne foi des intéressés, qui paraissent ne pas avoir été bien informés du changement opéré dans la législation fiscale allemande, du fait des difficultés linguistiques qu’ils ont pu rencontrer et que vous avez évoquées.
Dans l’immédiat, l’Allemagne a désigné un point d’entrée unique pour gérer les dossiers – le Finanzamt de Neubrandenburg – qui tient à la disposition des retraités frontaliers certains formulaires en français.
Par ailleurs, des consignes ont été adressées aux services fiscaux locaux en vue de régler certaines situations de double imposition : celle-ci sera ainsi éliminée par le remboursement de l’impôt payé en France depuis 2005 au titre de ces pensions, sans opposer les délais de prescription, dès lors que les personnes concernées pourront justifier par tout moyen de l’imposition de ces pensions en Allemagne. De plus, il leur a été demandé d’accorder le paiement d’intérêts moratoires sur ces remboursements.
Ces éléments témoignent de la mobilisation des services de l’État pour venir en assistance à ces frontaliers en difficulté, dans le respect de la souveraineté fiscale de l’Allemagne.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de ces précisions.
En l’occurrence, je dirai, pour reprendre une formule de la philosophie stoïcienne, qu’« il y a des choses qui dépendent de nous et d’autres qui n’en dépendent pas ».

Ce qui dépend de nous, c’est l’administration française. Essayons de faire en sorte que ceux de nos compatriotes qui ont effectué tout ou partie de leur carrière professionnelle de l’autre côté de la frontière ne soient pas en difficulté de notre propre fait. Il y a là une action à mener.
Pour la partie allemande, vous l’avez souligné et je partage votre point de vue, nos moyens sont plus limités. Toutefois, cette question pourrait être abordée dans le cadre des relations bilatérales franco-allemandes, me semble-t-il. En outre, je viens de découvrir le texte de cette communication de la Commission de Bruxelles, en date du 20 décembre dernier :
« La Commission souhaite promouvoir un vaste dialogue entre les autorités nationales et les parties prenantes, afin de déterminer quelles sont les autres mesures envisageables pour simplifier les règles fiscales, au bénéfice des citoyens et du marché intérieur. Il pourrait s’agir, par exemple, d’établir, à l’échelle de l’Union, des formulaires types pour les déclarations et créances fiscales, de créer des points de contact uniques – vous avez parlé du Finanzamt à l’instant, madame la secrétaire d’État –, où les travailleurs et les investisseurs pourraient obtenir des informations fiscales claires et fiables, et de mettre en place, au niveau national, des régimes fiscaux spéciaux destinés à prendre en compte les besoins des travailleurs mobiles et frontaliers. »
La Commission s’est visiblement saisie de ce problème. Il sera donc sans doute possible de simplifier la vie de nos retraités, qui sont nombreux à présenter aujourd’hui leurs doléances aux parlementaires.

La parole est à M. Ambroise Dupont, auteur de la question n° 1120, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Madame la secrétaire d’État, je souhaitais attirer l’attention de Mme Pécresse, ainsi que la vôtre et celle du Gouvernement dans son ensemble, sur l’inquiétude des professeurs des universités concernant les conditions de recrutement des vacataires assurant les séances de travaux dirigés, les TD.
Comme vous le savez, les TD sont assurés soit par des doctorants, avec une limite d’âge, soit par des personnes justifiant d’une activité professionnelle extérieure d’au moins mille heures annuelles. Par ailleurs, le nombre de groupes d’étudiants pouvant être pris en charge par ces vacataires est limité à trois.
Ce système, régi par le décret n°87-889 du 29 octobre 1987, trouve aujourd’hui ses limites.
Les professionnels extérieurs ont peu de temps pour s’impliquer et ne sont pas attirés par les rémunérations. Les doctorants sont limités par l’âge et de plus en plus rebutés par des conditions d’emploi peu attractives : faible reconnaissance de cette fonction, modicité des rémunérations, modalités de paiement insuffisamment attrayantes. Au quotidien, cela se traduit pour les enseignants par une difficulté croissante, et parfois insurmontable, à pourvoir chaque semestre les postes de chargés de travaux dirigés.
L’exemple de la faculté de droit de Nancy montre que, faute d’avoir pu réunir des candidatures répondant aux critères du décret, il ne sera pas possible de compléter les équipes pédagogiques, et plusieurs centaines d’étudiants seront ainsi privés de TD dès la rentrée de janvier prochain.
Certaines universités ne sont donc plus en mesure de recruter des vacataires si les conditions figurant dans le décret ne sont pas réexaminées.
Plusieurs pistes pourraient être examinées : l’abaissement du nombre d’heures exigées ; l’augmentation du nombre de travaux dirigés par vacataire ; la suppression de l’exigence d’une inscription en thèse pour les titulaires d’un master 2 ; le relèvement de la limite d’âge.
Compte tenu de l’acuité du problème posé, il conviendrait, madame la secrétaire d’État, que vous puissiez envisager, avec les enseignants, des solutions rapides susceptibles d’éviter les situations de blocage.
Mme Pécresse a fait beaucoup pour moderniser l’université. Il me semble que la mise à jour des conditions de recrutement des vacataires consoliderait ce travail de modernisation dont nous nous réjouissons tous.
Monsieur le sénateur, permettez-moi tout d’abord de vous transmettre les regrets de Valérie Pécresse, qui n’a pu vous répondre elle-même.
Vous posez une question complexe. Il faut rappeler qu’un certain nombre de dispositions visent à éviter la constitution d’une catégorie de vacataires permanents, une préoccupation dont vous comprendrez la justification : il n’est pas souhaitable d’installer des jeunes doctorants ou titulaires de masters dans une forme de précarité organisée.
Toutefois, et pour répondre au besoin légitime des universités, qui souhaitent disposer d’intervenants en nombre suffisant, deux dispositions d’âge devraient permettre de remédier à la situation de pénurie à laquelle semblent confrontés certains établissements.
Ainsi, la loi portant réforme des retraites permettra dorénavant le maintien en fonction d’intervenants réguliers : chargés d’enseignement, professeurs associés ou invités, qui font bénéficier l’université de leur expérience et de leurs connaissances, au-delà de l’âge de 65 ans. En ouvrant ainsi plus largement la porte à des personnalités tout à fait expertes dans leurs domaines respectifs, souvent très avancées dans leur carrière et/ou déjà à la retraite ou proches de celle-ci, nous devrions contribuer à élargir le vivier qui est à la disposition des universités.
Par ailleurs, en ce qui concerne les vacataires intervenant à titre ponctuel, l’administration considère qu’ils peuvent être recrutés sans limite d’âge.
Enfin, et de manière générale, en réponse à une demande de la HALDE, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la limite d’âge de 28 ans imposée jusqu’à présent sera prochainement également levée.
Ces mesures d’âge devraient donc améliorer la situation au sein des universités. En outre, si certaines d’entre elles continuaient à trouver le régime du décret de 1987 trop contraignant pour faire face à l’ensemble de leurs besoins d’enseignement, il pourrait être envisagé, pour les établissements RCE, c’est-à-dire aux responsabilités et aux compétences élargies, des solutions locales, sur la base de délibérations qui définiraient des conditions d’emploi et de rémunération, conformément à l’article L. 954-3 du code de l’éducation.
Dans les tous les cas, je serai vigilante afin d’offrir à nos jeunes diplômés qui envisagent des carrières à l’université des solutions pérennes.

Madame la secrétaire d’État, je voudrais saluer la précision de votre réponse.
Premièrement, je souscris tout à fait aux mesures d’âge. Dans ces domaines, il est tout à fait souhaitable que des gens qui ont dépassé la limite d’âge puissent continuer à donner des cours ou à faire bénéficier de leur savoir les étudiants. J’ai eu connaissance de tels dispositifs à la faculté de médecine, notamment.
Deuxièmement, ce qui m’intéresse dans votre réponse, madame la secrétaire d’État, c’est que les possibilités que vous ouvrez renforcent l’autonomie des universités. J’espère que, grâce à ces mesures et aux délibérations locales que vous avez évoquées – celles-ci vont tout à fait dans le sens de l’autonomie –, nous parviendrons à pallier les inconvénients de l’absence de travaux dirigés, qui constitue tout de même un grave problème dans certaines universités. Pour l’instant, en effet, il n’y a guère de risque que se constitue un corps intermédiaire !

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.