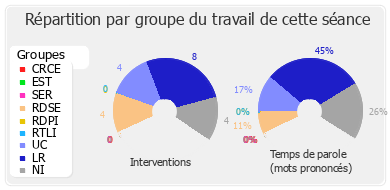Séance en hémicycle du 19 février 2013 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Demande d'avis sur un projet de nomination
- Dépôt d'un rapport
- Communication de rapports et d'avis de l'assemblée de la polynésie française
- Décision du conseil constitutionnel sur une question prioritaire de constitutionnalité
- Questions orales (voir le dossier)
- Incidences dans le secteur de l'eau des propositions de la commission européenne sur l'avenir de la tva (voir le dossier)
- Création d'emplois de fonctionnaires civils ou militaires à cambrai en compensation de la fermeture de la base aérienne 103 (voir le dossier)
- Conditions d'attribution de croix de l'ordre national du mérite aux officiers de gendarmerie (voir le dossier)
- Conséquences de la réorganisation du système de permanence des soins de nuit en drôme (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Marcel Cavaillé, qui fut sénateur de la Haute-Garonne de 1971 à 1974.

Conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010, relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et en application de l’article R. 131-6 du code de l’environnement, M. le Premier ministre, par lettre en date du 14 février 2013, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission compétente du Sénat sur le projet de nomination de M. Bruno Léchevin à la présidence du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Cette demande d’avis a été transmise à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire.
Acte est donné de cette communication.

M. le président du Sénat a reçu de M. Philippe Deslandes, président de la Commission nationale du débat public, le rapport d’activité de cette commission, établi en application de l’article L. 121-7 du code de l’environnement.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du territoire, et est disponible au bureau de la distribution.

M. le président du Sénat a reçu, par lettre en date du 16 janvier 2013, les rapports et avis de l’Assemblée de la Polynésie française concernant :
- le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Serbie relatif à la coopération dans le domaine de la défense et au statut de leurs forces ;
- les trois projets de loi autorisant la ratification de traités de coopération en matière de défense entre la France et respectivement le Sénégal, Djibouti et la Côte d’Ivoire ;
- et le projet de loi autorisant la ratification du traité relatif à l’adhésion de la République de Croatie à l’Union européenne.
Acte est donné de cette communication.
Ces documents ont été transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

M. le président du Conseil constitutionnel a communiqué au Sénat, par courrier en date du 15 février 2013, une décision du Conseil sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et aux libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l’article L. 12-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique (n° 2012-292 QPC).
Acte est donné de cette communication.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 296, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

Madame la ministre, j’ai appris, un jour, par les organisations syndicales, puis, le jour suivant, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de Narbonne, puis, enfin, par certains articles de presse, que de fortes menaces de suppression pesaient sur le bureau de douane de Port-la-Nouvelle.
Pour moi, ce fut la stupéfaction la plus totale : d’abord, au regard de la méthode employée ; ensuite, du fait d’être le dernier informé, mais, là encore, ce n’est pas très grave ; enfin et surtout, par rapport aux importants projets de développement et d’agrandissement de ce port.
Comment, en effet, l’administration peut-elle annoncer la suppression de ce bureau, alors que les collectivités – région, département, intercommunalité – et l’État s’engagent actuellement sur des projets d’importance majeure, destinés à donner à ce port un net surcroît d’activité, ce qui devrait en toute logique déboucher non pas sur la suppression du service des douanes mais plutôt sur son renforcement ? Allez donc comprendre quelque chose ! J’avoue une nouvelle fois ma stupéfaction de constater que l’administration peut ignorer des évolutions d’une telle ampleur.
Vous le savez bien, madame la ministre, la députée de Narbonne et moi-même sommes allés expliquer aux proches collaborateurs du ministre du budget qu’un débat public était lancé en vue de la réalisation de travaux d’agrandissement, mobilisant quelque 200 millions d’euros. Et c’est le moment qu’a choisi l’administration – bien tardivement, reconnaissons-le – pour nous écrire à nous, parlementaires, qu’elle souhaitait s’entretenir avec ces mêmes parlementaires pour leur expliquer « les raisons pour lesquelles elle envisage de fermer le bureau de douane » ! Drôle de mise en œuvre de la concertation !
Dois-je en outre préciser qu’actuellement, en termes de logistique, Port-la-Nouvelle affiche pleinement son efficacité et son attractivité internationale au regard de sa réactivité douanière ?
Bref, il est clair que le développement de ce port ne peut se passer du service des douanes.
Les douaniers de Port-la-Nouvelle assurent en effet un service de proximité, primordial, notamment en ce qui concerne les importations de carburants en provenance des pays tiers. Ils apportent aussi une expertise et des compétences essentielles à la communauté portuaire ainsi qu’à la sécurité des marchandises du port – je pense à la lutte contre les flux commerciaux illicites. Enfin, ils font preuve d’une réactivité indispensable à la fluidité des trafics, grâce à l’intervention des agents en dehors des heures d’ouverture : c’est ce que l’on appelle l’organisation RTS.
Madame la ministre, dites bien au ministre du budget de ne pas aller, en supprimant ces douanes, à contresens des efforts engagés par les collectivités, par la chambre de commerce et d’industrie de Narbonne ainsi que par l’ensemble des acteurs économiques en matière de développement économique et de création d’emplois.
Gardez-vous d’oublier que toute délocalisation du service des douanes pourrait, à terme, condamner ce port qui, aujourd’hui, peut être un moteur puissant de développement économique pour le département de l’Aude et tout le sud de la France.
Je demande donc au Gouvernement de ne pas valider ce projet de suppression et de prendre en compte les engagements des collectivités et des acteurs économiques en matière de développement économique et d’emploi.
Je lui demande de ne pas approuver ce projet funeste, de nous démontrer ainsi à la fois ce qu’est une vraie concertation et sa volonté de rompre avec des méthodes révolues.
Monsieur le sénateur, je tiens tout d’abord à vous assurer que l’implantation des services publics sur les territoires est une préoccupation majeure du Gouvernement, qui entend à cet égard trouver un juste équilibre entre la satisfaction des besoins des usagers, l’évolution des missions des administrations et le respect de la trajectoire ambitieuse de redressement des comptes publics qui vient d’être engagée.
La concertation avec l’ensemble des parties prenantes – élus locaux, représentants des personnels et des usagers, monde économique – est une exigence de méthode essentielle pour y parvenir.
Pierre Moscovici et Jérome Cahuzac en font une priorité pour l’ensemble des réseaux déconcentrés relevant du ministère de l’économie et des finances. Chacune des propositions de leurs administrations est validée à leur niveau.
C’est dans ce contexte général que les évolutions du réseau de la direction générale des douanes doivent être resituées. Administration de services, la douane s’est engagée depuis plusieurs années déjà dans une démarche d’accompagnement et de partenariat avec les entreprises tournées vers l’international, démarche qui va être poursuivie et même accélérée, dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de compétitivité. Par la simplification des formalités et grâce à un important mouvement de dématérialisation des procédures, l’environnement douanier porte tous ses efforts vers le « zéro papier », en concertation bien sûr avec les acteurs économiques concernés.
L’évolution générale des méthodes de contrôle s’oriente également vers une analyse de risque et un ciblage des opérations, plus adaptés aux enjeux réels de la fraude, assurant ainsi aux opérateurs une prise en compte plus personnalisée de leurs trafics et une réduction générale du délai de traitement de leurs opérations.
La rationalisation du réseau de dédouanement s’inscrit dans cette trajectoire de modernisation, qui donne lieu à des réflexions au niveau déconcentré. La fermeture du bureau de Port-la-Nouvelle n’est, à ce stade, que l’une des pistes d’évolution envisagées par la direction interrégionale des douanes et droits indirects de Montpellier.
L’activité dédouanement de ce bureau ne représente en effet qu’un peu plus de 1 % du trafic enregistré dans l’interrégion de Montpellier. De surcroît, trois opérations sur quatre environ sont gérées au moyen de procédures simplifiées qui ne requièrent pas la présentation des marchandises à la douane. Le décalage apparent de perception entre ces chiffres et ceux que vous rappelez, qui montrent que Port-la-Nouvelle est bien l’un des principaux sites portuaires de Méditerranée, tient à l’importance des opérations intracommunautaires, sur lesquelles la douane n’intervient pas.
Sur cette base, il a effectivement été envisagé de fermer le bureau de douane de Port-la-Nouvelle avec transfert de l’activité, pour les produits pétroliers, vers le bureau de Sète, qui dispose déjà d’une compétence reconnue dans ce secteur à forte technicité et, pour le dédouanement résiduel, vers le bureau de Perpignan.
Quelle que soit la décision prise, il va de soi que la réactivité de la douane à Port-la-Nouvelle sera préservée puisque, au-delà de formalités simplifiées qui assurent aux opérateurs la disponibilité immédiate de leurs marchandises, le projet reposerait sur des contrôles ciblés, dont l’efficacité est éprouvée.
J’ai bien noté, monsieur le sénateur, les réactions locales dont vous vous faites l’écho aujourd’hui. Il est clair qu’il faut tirer toutes les conséquences de l’annonce du plan d’extension des installations portuaires de Port-la-Nouvelle qui n’a été portée que récemment à la connaissance de l’État.
À ce stade, ce projet n’a pas été validé. Jérome Cahuzac a demandé au directeur interrégional des douanes et droits indirects de Montpellier de poursuivre la concertation de manière à pouvoir prendre en compte cet important développement, dont il mesure l’ambition et l’incidence potentielle sur l’emploi local. Aucune décision ne sera prise, en toute hypothèse, avant le second semestre 2013.
Monsieur le sénateur, comme vous le soulignez, nous entendons rompre avec les méthodes de la révision générale des politiques publiques, la RGPP, en accordant une place déterminante à la concertation tant avec les agents qu’avec les usagers du service public. Cela ne signifie pas qu’il faille s’interdire toute adaptation des réseaux déconcentrés de l’État ; notre approche doit être pragmatique, mesurée, mais sans immobilisme. Cela implique qu’il n’est pas possible de prendre un engagement dès maintenant, dans un sens ou dans l’autre, sur le cas que vous évoquez. Nous nous donnerons le temps nécessaire pour écouter et pour tenir compte des positions de chacun, avant la décision finale, que nous assumerons et dont le ministre du budget ne manquera pas de vous faire part.

Je vous remercie, madame la ministre, mais je me permets d’insister une fois de plus : sachez que les élus de ce département et l’ensemble des acteurs économiques comptent sur le gouvernement actuel pour assurer le maintien de ce service des douanes de Port-la-Nouvelle.
Nul ne comprendrait un désengagement de l’État sur ce port au moment où ce même État et l’ensemble des collectivités, départements et régions, mettent tout en œuvre pour lui donner une tout autre dimension.
Récemment encore, les différents opérateurs du port ont fait part de leur attachement à la présence permanente d’un service public de douaniers efficace et disponible. C’est un maillon essentiel au bon fonctionnement du circuit économique du port.
Tout est dit, je crois, en ces quelques mots : nous faisons confiance au Gouvernement, notamment au ministre du budget ; nous vous faisons confiance, madame la ministre ; de grâce, ne nous décevez pas !

La parole est à M. Michel Doublet, auteur de la question n° 316, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget.

Madame la ministre, ma question porte sur le projet de la Commission européenne visant à mettre en place un système de TVA favorable aux entreprises et à la croissance.
La Commission européenne a ainsi adopté, le 6 décembre 2011, une communication sur l’avenir de la TVA intitulée Vers un système de TVA plus simple, plus robuste et plus efficace adapté au marché unique, dont les objectifs principaux sont la simplification des procédures pour les entreprises, l’augmentation de l’assiette de TVA et des recettes fiscales afférentes et, enfin, la lutte contre la fraude à la TVA.
Concernant l’assiette de la TVA, la Commission européenne préconise de restreindre, voire de supprimer la liste des activités-opérations pouvant bénéficier des taux réduits de TVA.
Une consultation publique sur les objectifs vient d’être close. Elle portait sur l’élargissement de l’assiette de la TVA, sur les distorsions de concurrence entre États, sur le renchérissement du coût des produits et services dont la consommation doit être réduite et, enfin, sur l’uniformisation des taux applicables à des produits ou services différents mais remplissant la même fonction.
Sont ainsi particulièrement visés les secteurs de l’eau, de l’énergie et des déchets.
En ce qui concerne le secteur de l’eau, afin de compenser l’augmentation du taux de TVA, les investissements pourraient être revus à la baisse pour contenir les factures des usagers, obérant in fine les objectifs sanitaires et environnementaux à atteindre.
L’augmentation du taux de TVA étant neutre pour les abonnés professionnels, qui représentent 76 % de la consommation totale d’eau, contre 24 % pour les ménages français, l’incidence sur la baisse de la consommation sera marginale.
Si l’objectif recherché est d’économiser l’eau en renchérissant le coût pour le consommateur, on peut dès lors s’interroger sur l’opportunité d’utiliser le vecteur de la TVA. En conséquence, madame la ministre, je souhaiterais que vous nous fassiez part de la position du Gouvernement en la matière, plus particulièrement sur une taxation qui affecterait l’ensemble des consommateurs et dont le produit serait réaffecté au financement du secteur de l’eau, à l’instar de ce qui existe pour les agences de l’eau.
Cette problématique, je le sais, n’est que le préambule du processus d’élaboration d’une directive européenne, mais j’aimerais d’ores et déjà connaître votre position.
Monsieur le sénateur Michel Doublet, à la fin de l’année 2012, la Commission européenne a élaboré un questionnaire public pour préparer la proposition de directive visant à réformer le système des taux de TVA qu’elle doit présenter à la fin de la présente année. Ce questionnaire est destiné aux États et aux opérateurs économiques.
Vous relevez avec raison que la Commission y pose la question du taux applicable pour l’eau, qui peut être taxée au taux réduit de la TVA, comme c’est le cas en France.
L’interrogation est posée de manière neutre : « Quels arguments […] souhaitez-vous faire valoir dans le cadre de l’évaluation du taux réduit de TVA pour l’eau ? » Néanmoins, on peut imaginer que cette question fait écho à une réflexion menée par la Commission, dont il est vraisemblable qu’elle ait pour objet de renchérir le coût de l’eau, afin d’éviter son gaspillage.
La France a répondu le mois dernier à ce questionnaire. Sur la question de l’eau, sa réponse est très claire. La France considère que le taux réduit de TVA doit continuer à pouvoir s’appliquer sur ce produit de première nécessité. Le passage au taux normal ne serait supporté que par les ménages, les entreprises déduisant la TVA, ce qui ne serait pas acceptable. La remise en cause du bénéfice du taux réduit n’aurait donc que peu d’effet sur la réalisation des objectifs environnementaux de gestion de la ressource, tout en pénalisant le pouvoir d’achat des ménages.
Dans ces conditions, et compte tenu de la règle de l’unanimité exigée en matière fiscale par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il n’est pas envisageable de recourir au vecteur de la TVA pour inciter à une baisse de la consommation d’eau. La France, ainsi que d’autres États, s’y opposerait vigoureusement.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse, qui me rassure. J’espère bien évidemment que le taux de TVA sur l’eau ne sera pas augmenté.

La parole est à M. Raymond Couderc, auteur de la question n° 269, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Madame le ministre, la Banque de France a annoncé à l’automne dernier qu’elle avait l’intention de restructurer son réseau, ce qui aurait pour conséquence la suppression de 2 500 emplois, la fermeture de quarante-deux des soixante et onze caisses locales, et même la disparition totale de ses implantations dans vingt agglomérations.
Dans l’Hérault, les sites de Béziers et de Sète sont menacés. À Sète, seul un bureau d’accueil serait maintenu. À Béziers, il est prévu la fermeture dès 2014 de la caisse, puis la disparition dans les années suivantes non seulement du bureau de surendettement au profit d’un site dématérialisé mais aussi du bureau de cotation des entreprises.
Cela paraît un non-sens dans la mesure où près de 8 000 personnes ont été reçues au guichet de la Banque de France de Béziers pour des dossiers de désendettement et où le nombre de dépôts de dossier a augmenté de près de 50 % entre 2007 et 2011, d’autant que, dans de tels cas, une présence humaine paraît nécessaire.
Quant à la cotation des entreprises, elle est essentielle quand on observe le poids économique du Biterrois dans le département, et même au-delà : on y compte autant d’entreprises suivies que dans l’ensemble du département de l’Aude voisin. Le rôle de proximité du bureau des cotations est majeur pour le conseil financier, la médiation bancaire et l’aide aux entreprises en difficulté, surtout dans des périodes de crise économique comme celle que nous affrontons.
Tous les acteurs économiques et de très nombreuses collectivités locales du Biterrois ont fait connaître leur désaccord sur ce projet de la Banque de France qui aboutirait à une déshumanisation du contact avec le public.
La France n’est pas constituée seulement de capitales régionales : les antennes locales ont tout leur rôle de relais à jouer avec les entreprises et nos concitoyens.
Dans ces conditions, madame le ministre, pourriez-vous expliquer à la représentation nationale les mesures que le Gouvernement entend prendre pour maintenir dans nos territoires les antennes locales de la Banque de France en tant qu’interlocuteurs privilégiés des particuliers et des entreprises connaissant des difficultés financières ?
Monsieur le sénateur Raymond Couderc, vous avez souhaité interroger le ministre de l’économie et des finances sur la situation de la Banque de France dans votre département. Pierre Moscovici, actuellement en déplacement, vous prie de bien vouloir l’excuser de ne pouvoir vous répondre aujourd’hui personnellement.
Je veux vous dire toute l’attention portée par le Gouvernement au sujet que vous évoquez, et le souci qu’a la majorité de moderniser l’action publique et celle de ses opérateurs pour l’adapter aux changements de notre société, tout en préservant la qualité du service public.
C’est notamment le cas de la Banque de France, autorité indépendante mais à qui l’État a confié l’exercice pour son compte de certaines missions, comme la gestion de la procédure de surendettement des particuliers : la Banque de France doit faire face à une mutation profonde des conditions d’exercice de ses missions, notamment à une réduction importante de l’activité de certaines de ses implantations.
Ces défis ont incité la Banque de France à engager une réflexion sur l’optimisation de son organisation. L’État soutient cette démarche de bonne gouvernance qui doit notamment lui permettre de prendre efficacement en charge le traitement du surendettement.
Dans ce contexte, le gouverneur de la Banque de France a présenté, lors du comité central d’entreprise du 21 septembre dernier, un plan de réorganisation qui fait actuellement l’objet d’une consultation tant des personnels que de l’ensemble des acteurs locaux. Ce plan, qui porte à la fois sur l’activité fiduciaire et sur l’activité tertiaire de la Banque de France, doit être progressivement mis en place entre 2013 et 2020.
L’État est particulièrement attentif au respect de différents principes.
Tout d’abord, une couverture géographique importante doit être maintenue via la présence d’une succursale de la Banque de France dans chaque département. Le Gouvernement est néanmoins attentif à ce que cette règle prenne en compte la réalité du terrain, notamment les contraintes d’accès à certaines succursales. C’est pourquoi il est important qu’une implantation infradépartementale soit également assurée là où des conditions géographiques ou économiques le justifient.
Ainsi, la Banque de France maintiendra des antennes économiques dans neuf villes et conservera, ou ouvrira, des bureaux d’accueil et d’information dans les villes où la Banque reçoit plus de 1 000 visiteurs par an.
Ensuite, il faut assurer une optimisation de la gestion des activités qui ne nécessitent pas de contact avec le public. La gestion administrative des dossiers de surendettement, qui nécessite un important travail de traitement, sera effectuée par trente-cinq centres de gestion partagée, et l’activité de cotation des entreprises par quarante centres de traitement partagé, soit au total quarante-quatre implantations réparties entre les chefs-lieux de région et les succursales départementales ayant un volume d’activité suffisant.
S’agissant de l’activité fiduciaire, la Banque est confrontée à de lourds défis liés à la modernisation de ses équipements, aux évolutions des pratiques de recyclage et des transports de fonds ainsi qu’aux contraintes posées par l’Eurosystème. Le maillage du territoire à partir de deux nouveaux centres fiduciaires dans le Nord et en Seine-Saint-Denis, d’un centre d’appui à Chamalières et de vingt-neuf caisses réparties sur l’ensemble du territoire est de nature à répondre de manière efficace aux besoins, en garantissant la sécurité des implantations et des transports. Il est important de noter que les activités fiduciaires de la Banque de France ne constituent pas un service en contact avec le public et que la fermeture des caisses n’implique pas une fermeture des implantations correspondantes de la Banque de France.
De plus, aucune fermeture d’unité tertiaire n’interviendra avant 2016. Le plan de fermeture des caisses sera lui aussi très progressif : il sera lié à la livraison des nouveaux centres fiduciaires et au renouvellement des équipements de tri.
Enfin et surtout, un important accompagnement social est mis en place : un plan de sauvegarde de l’emploi est prévu pour les 227 agents concernés par les fermetures de caisses. Compte tenu des départs en retraite, ce sont seulement 175 agents qui seront concernés par les reclassements géographiques ou fonctionnels. La Banque de France prévoit d’ores et déjà les formations et les offres de mutation permettant d’anticiper cette mobilité dans les meilleures conditions. In fine, la mise en œuvre de ce plan pourra se faire sans aucun licenciement.
Au terme de la réforme, la région du Languedoc-Roussillon sera couverte par cinq unités permanentes situées dans un chef-lieu de département et par trois bureaux d’accueil et d’information.
L’antenne économique de Béziers sera remplacée par un bureau d’accueil et d’information. Le traitement de ses dossiers relatifs aux entreprises et au surendettement sera repris par la succursale de Montpellier, qui verra ses activités développées. Ce maillage est de nature à répondre aux besoins de la population et des entreprises de la région.
L’État souhaite que cette réforme permette de garantir l’efficacité de l’action de la Banque de France et de maintenir un haut niveau de service auprès des usagers sans remettre en cause les activités de la Banque en matière de surendettement et de médiation du crédit. Celle-ci a la responsabilité d’être attentive à ces critères.
Je puis vous l’assurer, monsieur le sénateur, l’État veillera à la qualité du dialogue entre les parties prenantes, notamment avec les élus locaux, que la Banque de France a la responsabilité de mener.

Vous comprendrez, madame le ministre, que votre réponse n’apaise pas mes craintes. Tout le monde le sait, les bureaux d’accueil et d’information de la Banque de France sont des coquilles vides. Une fois de plus, on va éloigner les services de la population.
Dans le Biterrois, qui compte 300 000 habitants, soit une population supérieure à celle de beaucoup de départements, de nombreuses personnes ont besoin des services des bureaux de désendettement. Madame le ministre, il est nécessaire que la Banque de France réagisse et que vous l’y incitiez.

La parole est à M. Jean-Pierre Godefroy, auteur de la question n° 251, adressée à M. le ministre de la défense.

Monsieur le ministre, ma question porte sur trois problèmes récurrents concernant les ouvriers d’État au ministère de la défense : les bordereaux trimestriels, l’accès à la participation pour les personnels mis à disposition, ou PMAD, et le jour de carence pour arrêt pour maladie.
Les bordereaux trimestriels sont le pilier des relations sociales des ouvriers d’État depuis des dizaines d’années. Or ils sont suspendus depuis bientôt deux ans. Le directeur des relations humaines du ministère de la défense serait enclin à prolonger ce blocage pour 2013, voire pour plus longtemps, quand une suppression pure et simple n’est pas évoquée.
Ces mêmes bordereaux avaient été suspendus par Raymond Barre en 1979 et redébloqués dès 1981 par Pierre Mauroy.
Ce blocage a pour conséquence, à chaque 1er janvier, la baisse des salaires par rapport à l’année précédente, alors que les cotisations à la mutuelle de la marine et les cotisations retraite augmentent tous les ans.
Si rien n’est fait, les jeunes ouvriers qui sont en cinquième ou sixième catégorie toucheront à la fin de leur carrière moins d’un SMIC.
Le deuxième point concerne les PMAD qui n’ont pas accès à la participation versée par DCNS aux salariés de l’entreprise, alors qu’ils contribuent eux aussi aux bons résultats économiques de celle-ci. J’avais déposé en novembre 2006 un amendement visant à donner accès à ces personnels à la participation : ce texte fut voté par le Sénat, mais malheureusement supprimé en commission mixte paritaire par un amendement de M. Ollier.
Il conviendrait, monsieur le ministre, que ces personnes puissent avoir accès à la participation, comme les autres personnels de DCNS.
Enfin, concernant le jour de carence, les PMAD sont maintenant assujettis, comme l’ensemble des agents et personnels de la fonction publique, à un jour de carence.
Or, l’entreprise DCNS prend à sa charge les trois jours de carence applicables aux salariés de droit privé. Sur le principe de l’équité entre les personnels de l’entreprise, il serait logique que les PMAD soient éligibles à la même disposition, faute de quoi ils pourraient avoir le sentiment de ne pas faire réellement partie de l’entreprise.
J’aimerais connaître, monsieur le ministre, les intentions du ministère de la défense concernant ces ouvriers d’État, donc chacun se plaît à reconnaître la compétence.
Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur la rémunération des ouvriers de l’État au ministère de la défense, sujet que vous et moi connaissons bien.
Vous le savez, ces personnels sont rémunérés sur la base d’un salaire horaire qui varie selon le groupe d’appartenance et l’échelon détenu, pour un forfait mensuel de 152 heures dans le cas général. Ce salaire horaire peut varier selon le lieu d’affectation puisqu’un abattement de zone est pratiqué suivant la zone de résidence des ouvriers.
Ce dispositif repose sur deux décrets : les décrets dits « salariaux » du 22 mai 1951 et du 31 janvier 1967, qui prévoient que le salaire des ouvriers de l’État au ministère de la défense est revalorisé chaque trimestre, par application d’un pourcentage relatif à la hausse moyenne des salaires constatés au cours du trimestre précédent dans l’industrie métallurgique de la région parisienne.
Il se trouve que la programmation budgétaire triennale 2011-2013 a prévu, de manière concomitante au gel du point d’indice dans la fonction publique, la suspension de la procédure de revalorisation des bordereaux de salaires ouvriers, ou BSO. Ainsi, comme vous l’avez rappelé, cette revalorisation est suspendue depuis le 1er janvier 2011.
Le 7 février 2013, lors d’une réunion avec les organisations syndicales, le ministre de la fonction publique a confirmé la reconduction de ce gel en 2013.
Le 2 octobre 2012, présentant aux organisations syndicales le budget pour 2013 du ministère de la défense, je leur ai fait part de mon intention d’ouvrir avec les partenaires sociaux du ministère de la défense certains chantiers relatifs aux ressources humaines. De fait, j’ai mis en place plusieurs ateliers, dont les conclusions doivent être rendues au cours de cette année 2013.
Parmi ces dossiers figure celui auquel vous comme moi tenons beaucoup : celui des modalités de rémunération des ouvriers de l’État et, d'ailleurs, de leur recrutement potentiel. La situation de ces personnels pose véritablement question. C’est pourquoi j’ai souhaité rouvrir ce dossier, qui n’avait pas été examiné depuis un certain temps.
Je suis bien conscient des complications et des difficultés engendrées par le gel des salaires des ouvriers de l’État.
Souhaitant que l’on puisse sortir par le haut de cette situation, j’ai demandé à ce groupe de travail de me faire des propositions dans le courant de l’année, pour aboutir à une issue qui, je l’espère, sera positive et permettra d’identifier les métiers des personnels concernés ainsi que les leviers concourant à l’évolution de leur rémunération, et de trouver une solution juste à ces difficultés.
J’y intégrerai la question des ouvriers de l’État mis à disposition, personnels spécifiques dont je connais la réalité et la complexité de la situation – vous avez cité le cas de ceux qui sont mis à la disposition de DCNS, pour la partie marine de la défense.
Monsieur le sénateur, telles sont les explications que je souhaitais vous donner. Je le répète, je suis comme vous très attaché à ce dossier !

La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 178, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Monsieur le ministre, je souhaite vous faire part des préoccupations des producteurs de la filière tabacole de France, plus particulièrement de mon département de la Charente-Maritime, dans un contexte de diminution des aides européennes.
Afin de maintenir un haut niveau de qualité des produits et malgré le découplage des aides communautaires, l’avenir de la filière nécessitait une amélioration de la productivité du secteur, au travers de la modernisation et de la revalorisation des prix commerciaux négociés entre les producteurs et les industriels.
Dans le cadre du programme de développement rural hexagonal – plus précisément de ses mesures 121 C2 et 121 C6 –, les exploitations agricoles et les coopératives d’utilisation du matériel agricole, les CUMA, peuvent bénéficier d’aides à l’investissement, afin d’accroître la compétitivité des exploitations.
De même, pour optimiser les fonds alloués au financement des investissements, a été mis en place un dispositif d’aide aux investissements pour les exploitations et CUMA tabacoles, financé par FranceAgriMer et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER : il s’agit de la mesure 144 du programme de développement rural hexagonal. Les régions peuvent utiliser les fonds FEADER pour le financement de cette mesure, ainsi que pour l’ensemble des autres mesures du programme.
Les producteurs ont donc investi, dans l’esprit du développement durable, soit pour des installations de séchage aux copeaux de bois, soit pour des fours de séchage plus performants, afin de maîtriser les coûts, ou pour des installations de goutte à goutte.
Or il semblerait que, dans la région Poitou-Charentes, les planteurs, qui, lorsque le montant des aides baissait de plus de 25 %, pouvaient bénéficier d’une aide substantielle de 9 000 euros par exploitation sur trois ans, n’aient pas eu accès à ces mesures.
Force est de constater que, depuis la réforme à mi-parcours de la politique agricole commune, la PAC, les dispositifs d’aides aux producteurs font l’objet de dysfonctionnements sur les territoires, mettant en difficulté les planteurs de tabac, qui doivent faire face aux hausses de prix de l’énergie et du coût de la main-d’œuvre.
Le sud de la Charente-Maritime est particulièrement concerné, d’autant que les deux dernières campagnes ont causé des pertes importantes, consécutives aux conditions climatiques, pesant ainsi lourdement sur la caisse d’assurance des producteurs. Les coopératives Poitou-Tabac et Périgord-Tabac sont confrontées à une diminution de surface et de volumes récoltés. Quant au nombre de producteurs, il est passé de 121 en 2010 à 80 en 2012.
Par ailleurs, au-delà des efforts de productivité que pourraient assurer les producteurs, le marché de la matière première qu’est le tabac est complètement déséquilibré sur le plan international. La France et l’Europe se trouvent confrontées à la concurrence directe des pays émergents, et ce depuis l’arrêt des soutiens directs dans le cadre de la PAC, à partir de la campagne 2010.
Les négociations menées par la Fédération nationale des producteurs de tabac, en relation avec la FNSEA, ont permis de débloquer 18 millions d’euros pour les campagnes 2011 et 2012. Les producteurs ont pu retrouver un meilleur équilibre de leur compte de résultat du fait de cette prime à la qualité.
Or, cette décision ne vaut que pour deux ans. Il est donc impératif de la reconduire dans le cadre de la nouvelle réforme de la PAC 2014-2020. Précisons que, si les dispositifs budgétaires ne sont pas définis dans les délais utiles pour mettre en œuvre la nouvelle PAC en 2014, il convient qu’une enveloppe de 9 millions d’euros supplémentaires soit reconduite en 2014 pour préserver la prime à la qualité.
En conséquence, monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour accompagner les producteurs de tabac, dont certains sont confrontés à d’importantes difficultés de trésorerie pouvant affecter la pérennité de leurs exploitations ?
Monsieur le sénateur, vous le savez, trois aides publiques existent aujourd'hui en faveur du tabac.
La première est une aide aux investissements pour les exploitations et les CUMA tabacoles, dispositif du plan de développement rural hexagonal, financé par FranceAgriMer – à hauteur de 1, 4 million d’euros –, par les régions françaises et par le FEADER, pour les années 2011-2013.
Dans le cadre de ce dispositif, FranceAgriMer prévoit une enveloppe de 500 000 euros pour 2013, dans un contexte budgétaire que je n’ai pas besoin de rappeler. Le conseil régional de Poitou-Charentes a ouvert, via FranceAgriMer, une enveloppe de 228 000 euros couvrant l’ensemble des projets prévus. Plus de 85 % de ces crédits avaient été engagés au 30 novembre 2012 et, au regard des compléments de projets portés par les professionnels, l’ensemble des crédits prévus par la région seront utilisés.
La deuxième aide porte sur la restructuration des exploitations tabacoles, mesure liée, en particulier, à un cofinancement du FEADER. Le programme prévoit une aide de près de 9 000 euros par exploitation pour les années 2011 à 2013. Ce dispositif spécifique, qui s’adressait à un certain nombre d’exploitations, n’a pas été ouvert par le conseil régional de Poitou-Charentes.
Enfin, une troisième aide, « à la qualité du tabac », au titre de l’article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, permet de procéder à des modulations. Cette aide s’élève à 9 millions d’euros par an pour les années 2012 et 2013. Elle a été mise à la disposition de la France : pour 2012, un acompte de 50 % du montant provisoire de l’aide a été versé au cours des mois de décembre et de janvier derniers.
Je suis particulièrement attentif à ce que ces aides puissent être mises en œuvre. En effet, dans un contexte de négociation de la réforme de la politique agricole commune et de pressions exercées sur le tabac au nom d’impératifs sanitaires – vous les connaissez, monsieur le sénateur –, nous devons faire en sorte que la filière tabacole puisse s’adapter et, surtout, se spécialiser dans une production de qualité. Je suis parfaitement d’accord sur ce point.
Dans le même temps, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et des discussions qui la précéderont, nous devons aussi anticiper un certain nombre de mesures, en particulier la fin, programmée par la Commission européenne, du fameux article 68 et des aides à la qualité.
Ensemble, nous devons donc être clairement tournés vers l’aide à la filière tabacole, pour permettre à cette dernière de s’adapter rapidement.
La réforme de la PAC prendra peut-être un peu plus de temps que prévu : monsieur le sénateur, profitons de ces délais pour assurer ce que vous appelez de vos vœux ! Profitons-en pour donner à la filière la capacité d’améliorer ses qualités et pour faire en sorte que la restructuration en cours tienne compte de la situation actuelle des producteurs de tabac en France, en particulier dans la région Poitou-Charentes.

Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse encourageante.
Sachez que je veillerai à ce que votre défense de la filière tabacole soit la plus opérationnelle possible. En effet, si, comme vous l’avez très justement déclaré, le tabac peut voir sa consommation décriée, il crée aussi des emplois en milieu rural, pour des personnes qui ne trouvaient pas de travail.
Il faut donc défendre cette filière importante, dont vous avez vu qu’elle est dès à présent en grande difficulté, de nombreuses exploitations ayant déjà disparu.

La parole est à M. Jacques Legendre, auteur de la question n° 268, adressée à M. le ministre de la défense.

Monsieur le ministre, je me dois aujourd'hui d’exprimer dans notre enceinte le cri d’angoisse de tout un territoire, celui qui, pour une population de 150 000 habitants, a perdu cet été 1 500 emplois permanents en raison de la fermeture de la base aérienne de Cambrai.
Cette décision avait été prise par le précédent gouvernement pour tenir compte de la diminution du volume de notre force aérienne de combat.
Si nous ne discutons pas les raisons de cette fermeture, nous notons que, compte tenu de la gravité de cette décision pour le territoire local, un certain nombre de mesures de compensation avaient à l’époque étaient demandées et obtenues. Ainsi, une partie du commissariat des armées, service du ministère de la défense, devait être transférée à Cambrai. Par ailleurs, des mesures fiscales et financières avaient été prévues, comme dans toutes les zones touchées par les restructurations de défense.
Finalement, monsieur le ministre, vous avez estimé au milieu de l’été qu’il n’y avait plus lieu de transférer le moindre service à Cambrai.
Je rappelle que nous n’avions pas spécialement demandé que nous soit transféré tel ou tel service de l’armée : nous souhaitions simplement que l’on nous aide à passer ce mauvais moment, en remplaçant les 1 500 emplois d’État perdus par quelques centaines d’emplois, via éventuellement le transfert d’un autre service public, militaire ou civil.
Cette décision a d’autant plus angoissé les habitants de notre territoire que ce dernier est actuellement très touché par les restructurations. En effet, dans la torpeur du même été 2012, nous perdions une usine du volailler Doux et, par là même, 250 emplois. Par ailleurs, nous apprenions que la décision de réalisation du canal Seine-Nord Europe, qui aurait pu être un élément dynamisant très important, était au moins remise en cause et soumise à nouvel examen.
Monsieur le ministre, cette situation angoisse tous les acteurs et les représentants politiques du territoire, quelle que soit leur appartenance politique. Sur votre invitation, nous sommes allés vous exprimer nos craintes en janvier dernier. Je sais que certains de mes collègues – deux sénateurs du groupe CRC et le député maire de Cambrai – se sont rendus la semaine dernière à Matignon pour faire état de leur inquiétude.
En janvier, si vous n’aviez pu nous annoncer la création de nouveaux emplois, vous aviez néanmoins envisagé une aide financière supplémentaire pour la restructuration des zones de défense. Or, le 21 janvier dernier, j’ai reçu une lettre du préfet du Nord m’indiquant qu’il est impossible de prolonger les mesures financières au titre des zones de restructuration de la défense, ou ZRD.
Monsieur le ministre, dans un territoire si meurtri, il n’est pas possible de répondre par la négative à toutes nos demandes. Je me permets donc, monsieur le ministre, de vous questionner sur ce que vous pourrez faire pour un territoire aussi durement touché, qui aime l’armée et qui, tant sur le plan moral que sur celui de l’emploi, ne s’est pas remis de la nouvelle situation qui lui est faite.
Monsieur le sénateur Jacques Legendre, nous avons déjà évoqué ensemble à plusieurs reprises cette question, et je comprends vos préoccupations et les difficultés que rencontre l’agglomération de Cambrai.
Je voudrais rappeler – vous l’avez d’ailleurs dit vous-même – que cette décision a été prise dans le cadre de la restructuration générale des forces armées engagée par le gouvernement précédent ; il s’agit d’une mesure que j’accompagne, car elle s’impose pour l’équilibre général de nos forces sur le territoire national.
Concernant l’implantation de l’organisme qui avait été décidée pour compenser la suppression de la base 103 de Cambrai, je rappellerai d’abord l’annonce antérieure du transfert d’un service du commissariat des armées, qui devait initialement concerner 690 agents. Progressivement, ces effectifs se sont trouvés de moins en moins garantis et, quand je suis entré en fonctions, il n’était même plus question de ce transfert : était évoquée la création d’un centre d’expertise et d’analyse des coûts qui ne devait employer que 200 personnes. Mais, après avoir examiné ce projet, j’ai constaté que, pas plus qu’avec les projets antérieurs, il n’apportait de garanties suffisantes en termes d'efficience, cela notamment parce que les besoins avérés dans ce domaine d'expertise de très haut niveau pouvaient être mieux satisfaits à partir de structures préexistantes.
Dans la période que nous traversons, avec l’objectif général de réduction des coûts et des déficits publics, il paraissait donc difficile de procéder à la création ex nihilo d’un organisme qui pouvait répondre à des besoins aujourd'hui satisfaits par d’autres organismes. Cette redondance m’a conduit à renoncer à ce projet.
La commune de Cambrai a protesté, elle a contesté en justice la décision que j’avais prise, et le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. Je n’en reste pas moins attentif à la situation de votre territoire. Voilà peu, je vous ai reçu avec plusieurs élus dont le président de région. Je sais que votre territoire est également touché par la fermeture de l'usine Doux et par les incertitudes qui pèsent encore sur la réalisation du canal Seine-Nord Europe, dossier sur lequel je me propose d’être à vos côtés afin d’essayer de le faire aboutir.
Je suis très attentif aux possibilités de reconversion sur le territoire, et surtout à la création d’emplois nouveaux : 34 millions d'euros ont été affectés à cela. Vous me faites part d’une décision du préfet dont je prends note à l’instant. Je m’étais effectivement engagé à conforter les engagements financiers, et je m’engage donc auprès de vous à revoir ce dossier afin d’accompagner le Cambrésis dans une reconversion que je sais difficile – j’ai moi-même été élu local durant de nombreuses années.
Je souhaite que le ministère de la défense puisse vous accompagner de la meilleure manière possible, sachant que le dispositif initialement prévu ne correspondait absolument pas aux nécessités du moment ni aux contraintes budgétaires qui s’imposent actuellement à la France.

Monsieur le ministre, je suis évidemment satisfait que nous puissions avoir sur ce dossier un débat apaisé, mais ce dernier ne règle pas le problème : 1 500 emplois perdus dans une petite ville moyenne française, deux bases aériennes fermées de part et d’autre de la ville, 600 hectares de friches militaires… Vous comprendrez que cela pose tout de même de sérieux problèmes !
Nous vous avions indiqué que nous souhaitions la création ou le transfert d’un certain nombre d’emplois, ce qui paraît justifié. Vous nous expliquez que vous avez estimé que les emplois promis n’étaient pas pertinents.
Mais la définition de ces emplois ne venait pas de nous… Ce qui compte, de notre point de vue, c’est l’implantation d’emplois. Très franchement, monsieur le ministre, nous avons le sentiment que l’administration militaire, sous le précédent gouvernement comme sous l’actuel, ne s’est pas particulièrement attachée à respecter les engagements pris par l’État, au plus haut niveau, lors de la fermeture de la base aérienne de Cambrai. Cela nous paraît vraiment grave.
Par ailleurs, nous avons parlé des compensations financières – en particulier, la prolongation de la zone de restructuration de la défense, initialement prévue pour deux ans –, le temps que les choses se mettent en place dans une conjoncture marquée par la crise, qui rend très difficile tout nouveau projet industriel.
Demander la prolongation de la ZRD n’est pas quelque chose de scandaleux. Monsieur le ministre, nous avons besoin que des réponses concrètes soient enfin apportées à nos requêtes légitimes. D’avance, je vous en remercie.

La parole est à M. Jean-Pierre Leleux, auteur de la question n° 298, adressée à M. le ministre de la défense.

Monsieur le ministre, ma question concerne les marques de reconnaissance de la Nation envers nos officiers de gendarmerie.
Entre 2005 et 2010, la réalisation du plan d'adaptation des grades aux responsabilités exercées – le PAGRE – en gendarmerie a conduit les 4 500 sous-officiers de gendarmerie les plus méritants à intégrer le corps des officiers.
Tout en remplissant les conditions d'âge pour leur intégration dans le corps des officiers, la plupart de ces sous-officiers, bien qu'ayant une large expérience professionnelle, n'avaient pas l'ancienneté généralement requise pour être titulaires de la médaille militaire.
Aujourd'hui officiers, ces militaires ne peuvent plus prétendre à l'attribution de cette prestigieuse décoration, qui est réservée aux sous-officiers. Par ailleurs, ces officiers méritants issus du rang, ayant pour la plupart atteint le grade de capitaine, ne rempliront pas avant l'âge de la retraite les conditions de temps de service habituellement requises en tant qu’officier pour se voir décerner l'ordre national du Mérite – du moins en l'état actuel du contingent accordé à la gendarmerie, qui est d'environ 450 croix par an.
Pourtant, ces officiers, occupant dans leur immense majorité des postes de commandement opérationnels difficiles, présentent un parcours professionnel long et riche en responsabilités, une indiscutable valeur personnelle et un engagement sans faille au service de l'État et de la population.
Faute d'un aménagement juridique adéquat, ces officiers quitteront donc le service de la Nation sans aucune distinction honorifique autre que la médaille de la défense nationale, alors qu'ils ont occupé des postes à forte responsabilité et ont exposé leur vie dans le combat quotidien contre la délinquance, sur la ligne de front contre la criminalité et pour protéger nos concitoyens.
Monsieur le ministre, il semble à la fois légitime et nécessaire d'octroyer à titre exceptionnel à la gendarmerie, pour les cinq années à venir, un contingent de croix de l'ordre national du Mérite qui puisse remédier à cet oubli et honorer ces officiers qui ont servi la France avec dévouement et engagement, souvent au-delà des devoirs que leur assigne leur statut.
Je vous remercie de m’indiquer les initiatives que vous pourriez prendre pour prouver à ces militaires valeureux la reconnaissance de la Nation, au terme d'une carrière exposée et placée sous le signe du risque.
Monsieur le sénateur Jean-Pierre Leleux, les conditions d'attribution de l'ordre national du Mérite n'empêchent nullement les officiers de la gendarmerie issus du rang de postuler à l'attribution de cette décoration, puisqu'il suffit de compter quinze ans de service minimum, condition que remplissent nécessairement ces officiers recrutés après l'âge de 40 ans.
De plus, la circulaire ministérielle relative aux conditions de proposition pour cet ordre national précise que ces officiers issus du rang et non titulaires de la médaille militaire sont proposés dans les meilleures conditions pour l'ordre national du Mérite.
La situation, que vous faites bien de rappeler, est donc connue de mes services et prise en compte.
Cependant, la sélection des candidats à l’ordre national du Mérite ne peut répondre au seul critère de l'ancienneté de service. Ce sont bien – vous l’avez dit vous-même – les mérites individuels qui fondent les propositions, tant pour ces officiers que pour leurs camarades issus d'autres recrutements, vis-à-vis desquels l'égalité de traitement ne saurait être rompue.
Il est vrai que le contingent triennal de croix pour l'ordre national du Mérite attribué au ministère de la défense a été réduit sous le précédent gouvernement, passant de 1 800 pour les années 2009-2011 à 1 500 pour les années 2012-2014. Voilà la situation, telle que je l’ai trouvée. Cependant, je voudrais vous rassurer : au sein du ministère de la défense, la répartition entre les armées, la gendarmerie et les services est effectuée au prorata des effectifs proposables, ce qui garantit – et garantira – une totale équité.
En conclusion, monsieur le sénateur, je peux vous assurer que les officiers de gendarmerie issus du rang bénéficient d'un dispositif qui prend en compte la spécificité de leur situation et permet, dans le respect d'une équité de bon aloi, de reconnaître leurs mérites par leur nomination dans l'ordre national du Mérite.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse.
Il m’avait semblé que, compte tenu du PAGRE, les sous-officiers devenus officiers se trouvaient exclus du bénéfice de la croix militaire tandis que leur temps de carrière en tant qu’officier restait insuffisant pour leur permettre d’être admis dans l’ordre national du Mérite. Je comprends très bien qu’aucune systématicité ne puisse présider à l’attribution de cette distinction, qui doit reposer sur le mérite et non sur l’ancienneté. Il m’avait toutefois été indiqué que, au cours des quatre à cinq prochaines années, un certain nombre de militaires, compte tenu des anciennetés requises et de ce passage de sous-officier à officier dans le cadre du PAGRE, ne pouvaient plus bénéficier de quelque distinction que ce soit…
Mais je prends acte de votre réponse. Je vois que vous être sensible à la question posée et que vous pourrez, dans la mesure de ce qui est possible, accéder à la demande que je vous présente.

Mes chers collègues, en attendant l’arrivée de Mme la ministre chargée de la décentralisation, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures vingt-huit, est reprise à dix heures trente.

La parole est à M. Francis Grignon, auteur de la question n° 145, adressée à Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation.

Madame la ministre, ma question porte sur l’application de la réforme de la fiscalité de l’aménagement, qui suscite quelques inquiétudes chez un certain nombre d’élus, en particulier dans un cas précis que je vais vous exposer.
L’article L. 331-6 du code de l’urbanisme prévoit que les opérations d’aménagement et de construction, de reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement.
Il s’agit généralement de petites constructions dont la superficie est inférieure à 20 mètres carrés. C’est ainsi qu’un contribuable de ma région se voit dans l’obligation de payer une taxe de 303 euros pour un abri de jardin de 7, 35 mètres carrés, et je pourrais citer plusieurs exemples du même ordre. Les abris de ce type appartiennent souvent à des gens assez modestes qui les ont construits de leurs propres mains, de sorte que le montant de la taxe s’avère parfois plus élevé que le prix des matériaux, ce qui n’est pas sans provoquer un certain émoi dans les campagnes…
Vous entrevoyez, bien sûr, les conséquences de cette réforme : les petites constructions ne seront plus déclarées, le maire aura des problèmes, les plaintes des voisins et les contentieux vont se multiplier… Ma question est donc simple, madame la ministre : un aménagement de la taxe pour ces cas particuliers est-il envisageable ?
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie tout d’abord de m’excuser de vous avoir fait attendre. Je pensais d'ailleurs être à l’heure…
Monsieur Grignon, je vous remercie d’avoir posé cette question « de bon sens ». Il y a effectivement quelque chose de paradoxal dans le fait que la taxe sur un petit abri de jardin de 7, 35 mètres carrés soit éventuellement supérieure au coût des matériaux de construction.
Je rappellerai simplement la réglementation en vigueur. La taxe locale d’équipement concerne tous les bâtiments qui ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux jusqu’à 20 mètres carrés de surface de plancher. Seules les petites constructions de type abri de jardin inférieures à 5 mètres carrés sont exonérées de la taxe d’aménagement.
L’abri de jardin de 7, 35 mètres carrés que vous évoquez n’est donc pas concerné par l’exonération…
De nombreuses personnes se sont émues de cette situation. Un amendement avait d'ailleurs été déposé à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2012 afin de la corriger. Cependant, il n’a pu aboutir et, comme vous le savez, le texte a été rejeté par le Sénat. Il nous reste donc à revoir, dans le cadre d’un travail qui va être prochainement mené avec le comité de suivi de la réforme de la fiscalité et de l’aménagement, dans quelles conditions nous pourrions réviser ces dispositions.
Mme Duflot, Mme Lebranchu et moi-même nous sommes engagées à retravailler ce dispositif et à voir comment il pourrait être aménagé afin que le bon sens l’emporte dans l’application des textes.

Je vous remercie de votre réponse, madame la ministre. Dans un premier temps, je conseillerai donc aux intéressés de ne pas construire d’abri de plus de 5 mètres carrés, mais je vous fais confiance, à vous et à vos deux collègues, pour régler le problème !

La parole est à M. Didier Guillaume, auteur de la question n° 311, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Madame la ministre, je veux vous faire part de la grande inquiétude des élus des territoires ruraux, des professionnels de santé et, plus généralement, de l’ensemble des acteurs concernés par les conséquences de la réorganisation du système de permanence des soins en Drôme.
Il semblerait que l’Agence régionale de santé, l’ARS, ait décidé de supprimer, à compter du 1er juin 2013, les permanences de soins ambulatoires de nuit de minuit à huit heures du matin, appelées dans le jargon les gardes en « nuit profonde ». En Drôme, sept zones géographiques sont concernées.
Les permanences étaient jusqu’alors assurées par vingt médecins libéraux. Or, depuis quelque temps, les appels d’urgence sont régulés par le « 15 », qui décide soit de faire appel à un des médecins, soit de mobiliser les pompiers du secteur. Depuis ce changement de méthode, les médecins sont de moins en moins appelés à intervenir.
La suppression par l’ARS de ces gardes en nuit profonde aurait des conséquences graves pour la population drômoise des arrière-pays.
En premier lieu, les habitants des zones concernées seront très éloignés des premiers secours. Des médecins pouvaient jusqu’à présent intervenir en moins de trente minutes sur l’ensemble du territoire, alors qu’avec l’organisation envisagée le délai d’intervention sera la plupart du temps doublé, voire triplé, puisque les secours viendront de l’un des hôpitaux du territoire – Valréas, Vaison-la-Romaine, Gap ou Orange –, qui sont éloignés.
En second lieu, la mission confiée aux médecins libéraux et l’indemnité qui s’y rattache permettent de maintenir économiquement l’activité des médecins en zone rurale ; sa suppression entraînerait le départ de nombreux médecins, qui n’arriveraient plus à vivre correctement de leur profession. Cette réorganisation amplifierait ainsi le risque de désertification de territoires qui souffrent déjà du recul permanent de la présence des services publics.
Vous comprendrez, madame la ministre, qu’il est difficile d’accepter cette éventualité. Le médecin local connaît les habitants par cœur. Il peut exclure d’éventuels cas peu sérieux, éviter ainsi des coûts de secours trop importants et, en étant présent, faire un diagnostic solide. En intervenant rapidement sur place, il assure les gestes de premiers secours et, dans certains cas, le « geste qui sauve ».
C’est pourquoi je souhaite attirer votre attention sur ces territoires dont les habitants demandent une égalité de traitement devant la santé et l’urgence médicale.
Nos territoires, leurs élus, la population souhaitent pouvoir garder leurs médecins de proximité. Or nous savons que l’implantation des médecins dans les zones rurales est compliquée du fait de la moindre activité, de l’importance des déplacements, des difficultés pour leur conjoint de trouver du travail, ou encore des difficultés pour avoir un remplaçant le temps des vacances…
Je partage l’objectif du « pacte territoire-santé » de garantir à tous un accès aux soins urgents, madame la ministre. La suppression des gardes de nuit ne semble pas correspondre à ces orientations. À l’heure où la priorité est donnée à la lutte contre les déserts médicaux, pouvez-vous apporter des éléments rassurants quant au maintien d’un dispositif qui fonctionne aujourd’hui ?
Monsieur le sénateur, Mme la ministre des affaires sociales et de la santé, retenue à Matignon où se réunit un comité interministériel des villes, m’a chargée de répondre à la question que vous lui posez, question pertinente s’il en est dans les territoires ruraux, où je rencontre, en tant qu’élue locale, les mêmes difficultés.
Mme Touraine a bien pris en compte votre question concernant les conséquences du nouveau cahier des charges de la permanence des soins ambulatoires, la PDSA, publié le 27 novembre 2012 par l’ARS de Rhône-Alpes.
Elle a pour préoccupation la lutte contre les déserts médicaux. C’est tout le sens qu’elle a donné au pacte territoire-santé engagé le 13 décembre dernier. C’est d’ailleurs dans ce but que l’ARS de Rhône-Alpes a prévu de supprimer la permanence des soins ambulatoires en nuit profonde entre minuit et huit heures dans les secteurs dans lesquels est réalisé moins d’un acte par semaine. Cette contrainte est en effet l’un des principaux obstacles identifiés à l’installation de jeunes médecins, laquelle est pour nous tous une priorité.
Dans les secteurs que vous évoquez, les chiffres sont éloquents : La Chapelle-en-Vercors, six actes de permanence des soins en nuit profonde pour toute l’année 2011 ; dans le Haut-Diois, trente-neuf actes en 2011, huit en 2010 ; à Saillans, quinze en 2011 ; la même année, onze actes à Bourdeaux, quatre à La Motte-Chalencon, huit à Buis-les-Baronnies, quatre à Séderon…
Dans ces conditions, vous comprendrez l’absolue nécessité de participer à la mise en œuvre progressive du pacte territoire-santé et d’appliquer la suppression de la PDSA en nuit profonde, laquelle interviendra le 31 mai prochain. Ce délai a été prévu pour permettre à l’ARS, en lien étroit avec les professionnels de santé et le comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, de traiter l’ensemble des conséquences de cette mesure.
Mme la ministre des affaires sociales et de la santé tient aussi à ce que l’évolution de la PDSA et l’accès aux soins urgents, sujet qui vous préoccupe également, soient bien distingués. L’ARS travaille à la mise en œuvre de l’engagement du Président de la République d’assurer à l’ensemble de nos concitoyens un accès à des soins urgents de qualité en moins de trente minutes.
Dans ce cadre, le dispositif des médecins correspondants du SAMU, que la région Rhône-Alpes a déjà développé, apparaît comme une solution pertinente. Son extension fait l’objet d’études et de discussions entre l’ARS, le ministère, les professionnels de santé et le SAMU pour assurer la meilleure organisation des zones d’intervention des services mobiles d’urgence et de réanimation, les SMUR.
Sur tous ces sujets, pour s’assurer de la bonne organisation de la PDSA et de l’aide médicale urgente dans les secteurs du sud de la Drôme, une réunion avec l’ensemble des médecins des secteurs concernés est organisée par l’ARS à Valence le 27 février prochain. Ce sera l’occasion de faire le point avec tous les professionnels de ces secteurs, de répondre à leurs interrogations et d’envisager chaque situation individuelle.
Vous le voyez, monsieur le sénateur, les enjeux de la médecine en zone rurale sont au cœur des préoccupations de Mme Touraine.

J’ai bien écouté votre réponse, madame la ministre.
Je serai moi-même présent à la réunion avec l’ARS à Valence.
Il me semble que, dans le pacte territoire-santé, il faut prendre en considération le caractère très rural de certaines zones et ne pas s’en tenir uniquement à la comptabilité, comme cela a pu être le cas précédemment dans le cadre de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Si nous voulons réellement lutter contre les déserts médicaux, nous devons nous donner les moyens de le faire.
Je suis entièrement d’accord avec la politique menée par le ministère des affaires sociales et de la santé, concernant notamment l’installation, indispensable, de jeunes médecins dans les zones rurales. Je tiens simplement à souligner que, là où il est très compliqué de les faire venir, il faut tout faire, en attendant leur arrivée, pour garder les médecins déjà installés, médecins à qui les gardes en nuit profonde assuraient un revenu et permettaient de maintenir une activité.
J’insiste aussi sur le fait que la suppression des gardes en nuit profonde éloignera considérablement le malade potentiel du médecin, et cela pour une raison bien simple : dans les territoires ruraux et de montagne, il faut raisonner non pas en kilomètres, mais en temps de parcours. Or les médecins correspondants du SAMU, situés à Gap dans les Hautes-Alpes, à Valréas ou à Orange dans le Vaucluse, sont très éloignés.
Nous allons évidemment aborder les propositions du ministère des affaires sociales et de la santé de façon positive, car il faut aller de l’avant, rien n’étant immuable, mais, dans le même temps, c’est la santé de tous nos concitoyens qui doit avant tout être prise en compte, et les territoires ruraux ne doivent plus être les grands oubliés de la République.

La parole est à M. Jean Boyer, auteur de la question n° 209, adressée à Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Madame la ministre, en arrivant, vous vous êtes excusée de votre très léger retard, ce qui m’a permis de constater que vous restiez égale à vous-même et toujours très attachée à la ponctualité. Eh bien, mon souhait pour cette année 2013 est que les TGV arrivent à l’heure !
Dans le prolongement des questions que j’ai posées au cours des dernières années et après les demandes de Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire et maire du Puy-en-Velay, permettez-moi d’interpeller une nouvelle fois le Gouvernement à propos de la nécessaire prolongation jusqu’à Firminy de la ligne de train à grande vitesse reliant Paris à Saint-Étienne.
L’extension de la ligne de TGV ouvrirait la porte sur la Haute-Loire, département qui compte vingt-deux cantons en zone de revitalisation rurale – élue rurale, vous connaissez, madame la ministre, les difficultés des ZRR –, mais permettrait également d’irriguer la Haute Ardèche ainsi que la Lozère, dont les habitants viennent prendre le train au Puy-en-Velay.
Quels espoirs peut-on donc former, madame la ministre, concernant la liaison entre Saint-Étienne et Firminy ? Je sais bien que les élus émettent des vœux, s’ils ne sont pas des rêves, sont parfois difficiles à réaliser !
Depuis douze ans, j’effectue deux fois par semaine la liaison en TGV entre le Puy-en-Velay et Paris, soit un trajet d’environ cinq heures. Je puis vous assurer que si cette liaison était prolongée jusqu’à Firminy, porte d’une grande partie du Massif central, le TGV serait utilisé et rationalisé.
Votre question, monsieur le sénateur, me va droit au cœur, car, comme vous l’avez dit, en tant qu’élue rurale, je connais les problèmes d’enclavement et les besoins de désenclavement de certains territoires.
Il est vrai que le prolongement de la ligne entre Saint-Étienne et Firminy, qui « irriguerait », pour reprendre votre expression, à la fois la Haute-Loire et la Lozère, paraît être une solution d’avenir. Toutefois, il se heurte à un certain nombre de difficultés et de contraintes, que Mme Duflot, retenue par une réunion du comité interministériel des villes, m’a chargée de vous exposer.
Compte tenu du trafic escompté, et, partant, des recettes estimées, sur la section entre Saint-Étienne et Firminy, la SNCF a considéré que le coût des travaux d’adaptation de la gare, ajouté au surcoût d’exploitation lié à l’utilisation d’un TGV, ne lui permettait pas, en l’état, d’étendre sa desserte TGV jusqu’à Firminy.
Cette décision de l’entreprise ne préjuge cependant pas d’un possible conventionnement de la desserte qui serait, le cas échéant, et sous réserve de faisabilité technique, négocié et financé par les collectivités locales demandeuses.
En l’occurrence, si la recherche d’un aménagement équilibré du territoire est au cœur de la mission de service public ferroviaire confiée à la SNCF, l’exploitation des TGV implique cependant la prise en compte des contraintes de soutenabilité économique attachées à ce service de transport.
Ces contraintes sont actuellement très fortes, la dette du système ferroviaire dérivant chaque année. À cet égard, comme l’a rappelé la Cour des comptes dans son récent rapport, le TGV n’a pas vocation à desservir la totalité des gares du territoire français ; il doit être finement articulé avec les services de transport régionaux et interrégionaux, qui constituent l’armature d’une desserte au plus près des territoires.
Mme la ministre de l’égalité des territoires et du logement est particulièrement attentive à la coordination des différents types de services de transports ferroviaires, afin qu’ils répondent au mieux aux besoins des territoires et de leurs habitants.
Pour les voyageurs désireux de se rendre à Paris depuis Firminy, la liaison est actuellement assurée par une complémentarité entre TER et TGV, avec une correspondance à Saint-Étienne ou Lyon, le temps de parcours étant compris entre trois heures huit et quatre heures quarante.
Tels sont les éléments techniques, monsieur le sénateur, que Mme Duflot m’a demandé de porter à votre connaissance.

Madame la ministre, je ne suis honnêtement pas très surpris par la réponse que vous me transmettez : je connais en effet les analyses sur lesquelles elle se fonde.
Pour être très concret, je dirai que, si une correspondance en TER à destination de Firminy était assurée pour les quelques TGV effectuant chaque jour la liaison entre Paris et Saint-Étienne, ce serait déjà une grande amélioration !
J’évoquerai d’ailleurs cette perspective avec le conseil régional et la direction de la SNCF, car je puis vous assurer que les quinze kilomètres du trajet entre Firminy et Saint-Étienne par la vallée de l’Ondaine sont pratiquement autant de kilomètres d’embouteillages !

La parole est à Mme Michelle Demessine, auteur de la question n° 252, adressée à M. le ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes.

Madame la ministre, le 12 octobre dernier, au Sénat, l’Association nationale de défense des victimes de l’amiante organisait un colloque pour un monde sans amiante à l’occasion de la Journée internationale des victimes de l’amiante, sous la présidence de notre collègue Annie David, présidente de la commission des affaires sociales.
À cette occasion, des médecins, des chercheurs, des militants associatifs et des responsables politiques, venus de quarante-deux pays, s’étaient réunis.
L’ensemble des participants à cette riche et émouvante initiative s’étaient rassemblés autour d’un objectif commun : créer une véritable multinationale des victimes de l’amiante, selon leurs termes, pour faire face aux industries multinationales qui continuent d’utiliser ce matériau, malgré ses effets dévastateurs sur la santé publique.
À travers le monde, ce sont ainsi chaque année 2, 5 millions de tonnes d’amiante qui sont produites et qui provoquent la mort de plus de 90 000 personnes par an selon l’Organisation mondiale de la santé.
Pour sa part, la France a prononcé l’interdiction de l’amiante en 1997, soit trop tardivement, hélas ! pour désamorcer cette véritable bombe à retardement pour la santé publique dans notre pays qui pourrait coûter la vie à plus de 100 000 personnes d’ici à 2025.
Quant à l’Union européenne, elle a emboîté le pas de la France en interdisant l’amiante dans ses pays membres au 1er janvier 2005.
Cependant, le lobby de l’amiante et les intérêts économiques à court terme de certains pays de l’Union européenne s’accommodent mal de cette interdiction. Sous leur pression, une dérogation à cette interdiction a donc été introduite.
L’annexe XVII du règlement européen REACH – pour Registration, Evaluation and Autorisation of Chemicals –, toujours en vigueur, permet ainsi aux États membres de l’Union européenne d’autoriser la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant de l’amiante chrysotile dans les cellules d’électrolyses existantes. L’Allemagne, notamment, s’est ainsi engouffrée dans la brèche en important, en 2010, 60 tonnes de fibres d’amiante à l’état brut.
Cette réintroduction de l’amiante expose des populations européennes à un risque inacceptable pour leur santé et brouille le message de l’Union européenne.
En effet, comment l’Union européenne peut-elle prôner l’interdiction de l’amiante dans le monde, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé et, dans le même temps, continuer d’en importer ?
La production astronomique d’amiante dans des pays industriels comme la Russie, la Chine, le Brésil ou le Canada constitue pourtant un défi pour l’Union européenne. Il est en effet effroyable de constater que 125 millions de travailleurs, dont la plupart vivent dans le tiers-monde, sont encore aujourd’hui exposés.
Les participants à ce colloque ont lancé un vibrant appel en faveur d’une interdiction mondiale de l’amiante et ont rappelé l’urgence qu’il y a à mettre fin aux doubles standards entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, les premiers exportant l’épidémie de cancer de l’amiante vers les seconds.
Madame la ministre, quelles mesures diplomatiques le Gouvernement entend-il prendre pour que la France joue un rôle prépondérant afin de débarrasser entièrement l’Europe et le monde de ce fléau qu’est l’amiante ?
Madame la sénatrice, M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes, est à l’heure actuelle en Grèce, où il accompagne le Président de la République. Il m’a donc chargée de vous communiquer sa réponse à la question très grave – les chiffres que vous avez indiqués sont terriblement évocateurs – de l’interdiction de l’amiante au sein de l’Union européenne et de l’extension de cette interdiction au monde entier.
Vous l’avez rappelé, la France a interdit l’amiante en 1997. À l’échelon de l’Union européenne, l’annexe XVII du règlement REACH a confirmé cette interdiction. Deux dérogations ont toutefois été accordées.
Pour compléter votre information, je vous indique que l’annexe XVII au règlement REACH a fait l’objet d’une révision en février 2009. Cette dernière a permis plusieurs progrès. Le texte prévoit ainsi une anticipation au 1er juin 2011 de la date de révision de la dérogation pour les diaphragmes, ainsi qu’un renforcement de l’interdiction de l’utilisation et de la mise sur le marché des articles contenant de l’amiante installés ou mis en service avant le 1er juin 2005, ces articles faisant l’objet d’une dérogation. Il est ainsi clairement indiqué que les pièces détachées d’un article entrant dans le cadre de la dérogation ne bénéficient pas, eux, de cette même dérogation.
La Commission s’est également engagée, sur le fondement des dérogations prises par les États membres, à élaborer des dossiers de restriction en vue d’harmoniser à l’échelon communautaire la mise sur le marché de seconde main des articles mis en service avant le 1er janvier 2005 et contenant de l’amiante, ce qui revient à définir une liste harmonisée limitative.
Les États membres devaient communiquer à la Commission les mesures de dérogation prises à l’échelle nationale avant le 1er juin 2011. La Commission a rendu publiques les informations qui lui ont été ainsi transmises. Sur cette base, elle a invité, en janvier 2013, l’Agence européenne des produits chimiques à préparer un dossier visant à interdire la mise sur le marché et l’utilisation de diaphragmes contenant de la chrysotile.
La Commission a prévu de remettre un document d’information lors de la prochaine réunion des autorités compétentes les 13 et 14 mars prochains.
À cette occasion, la France ne manquera pas de rappeler son ambition de voir, dans un avenir proche, l’amiante bannie, sous toutes ses formes et dans tous ses usages. Elle encouragera la Commission à prendre des dispositions – cette dernière s’y est, d’ailleurs, engagée – qui permettront de limiter le marché de seconde main et de contribuer aux démarches de substitution des technologies utilisant les diaphragmes contenant de l’amiante.
Vous le voyez, madame la sénatrice, le Gouvernement porte une attention particulièrement soutenue à ce grave problème.

Madame la ministre, je vous remercie de votre très intéressante réponse, qui s’appuie sur des éléments tout à fait actuels.
On le voit bien, dès qu’une brèche est ouverte, il peut être tentant de s’y engouffrer. Comme je l’indiquais dans ma question, l’Allemagne a ainsi pu continuer à importer des produits contenant de l’amiante. Il faudrait tellement de contrôles pour s’assurer du respect de la réglementation en vigueur qu’il paraît impossible de juguler complètement les abus.
Je me réjouis donc de la position récemment prise par la Commission, qui semble se convertir à l’idée d’une interdiction totale. Nous allons surveiller de très près le déroulement des travaux de l’Agence européenne des produits chimiques.
J’ai bien entendu le mot d’ordre : bannir l’amiante sous toutes ses formes. Notre expérience de ses méfaits nous conduit naturellement à nous en réjouir.
Je tiens toutefois à indiquer que l’action de la France en la matière pourrait également se déployer à l’international, au-delà de l’Union européenne. Trop de pays continuent en effet à exploiter et à utiliser l’amiante, laquelle, nous le savons fort bien, finira par nous revenir, sous une forme ou sous une autre.
J’ai noté que le Brésil avait pris des mesures allant dans le bon sens. Si la diplomatie française pouvait encourager ces progrès, elle contribuerait à rendre moins lointain l’objectif d’élimination de l’amiante de la surface de la planète.

La parole est à M. Georges Labazée, auteur de la question n° 318, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale.

Madame la ministre, je souhaite attirer l’attention du ministre de l’éducation nationale sur la place des langues régionales dans le projet de loi de programmation et d’orientation pour la refondation de l’école de la République.
Il s’agit d’une réforme ambitieuse, qui pose les fondements d’une école républicaine rénovée. Je tiens d’ailleurs à saluer l’action du Gouvernement sur ce point.
Je regrette toutefois que le projet de loi ne prenne pas en considération, tout au moins en l’état, l’intérêt de l’enseignement des langues et cultures régionales. Ces langues sont notre patrimoine ; nous devons les défendre et les faire exister.
Le département des Pyrénées-Atlantiques a souhaité montrer l’exemple en menant diverses actions, qui ont illustré la volonté des élus de faire vivre les langues basque, béarnaise, ou encore occitane, rejoignant en cela les attentes des administrés.
Certes, l’article L. 312-10 du code de l’éducation, qui prévoit, rappelons-le, qu’un « enseignement de langues et cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l’État et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage », ne sera pas modifié par le nouveau projet de loi. Cependant, l’absence de mention des langues régionales dans ce dernier peut être perçue comme un signal négatif.
L’expérience le montre, fragiliser cet enseignement nuirait à son développement. En attendant la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui confirmera l’engagement du Président de la République en faveur de ce « patrimoine de la France », il est urgent de donner un statut à nos langues régionales au sein de l’éducation nationale afin de développer leur enseignement et de réaffirmer l’importance de leur connaissance et de leur transmission.
Madame la ministre, je souhaiterais donc connaître vos intentions s’agissant, d’une part, de la prise en compte de l’enseignement des langues régionales dans le projet de loi pour la refondation de l’école, d’autre part, de l’extension au premier degré de l’application de l’article L. 151-4 du code de l’éducation, qui n’autorise, à l’heure actuelle, le versement de subventions publiques que pour les établissements d’enseignement général du second degré privés.
Monsieur le sénateur, vous m’interrogez sur la prise en compte des langues et cultures régionales dans le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Je tiens à insister sur la continuité de notre action en ce domaine. Notre pays se livre en effet à un effort constant pour assurer la diffusion des langues et cultures régionales. Ainsi, c’est au plus haut niveau de l’ordre juridique interne que les langues régionales ont été consacrées : selon l’article 75-1 de la Constitution, elles « appartiennent au patrimoine de la France ». Je me souviens, d’ailleurs, de la bataille considérable qu’avait été la discussion à l’Assemblée nationale de la révision constitutionnelle, une partie des élus, notamment ceux que j’appellerai les moins progressistes, s’étant opposés à l’insertion des dispositions relatives aux langues régionales à l’article 1 de la Constitution. Au moins sont-elles consacrées aujourd'hui dans l’article 75-1 !
La loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation et la loi du 24 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ont affirmé la possibilité pour les élèves qui le souhaitent de suivre un enseignement de langue régionale dans les régions où celles-ci sont en usage. Dans ces régions, la promotion et le développement des langues et cultures régionales sont le plus souvent encadrés par des conventions liant l’État et les collectivités territoriales. Ce mode de collaboration doit être généralisé.
Cet engagement fort et constant de l’État comme des collectivités territoriales permet aujourd’hui à environ 272 000 élèves, répartis dans treize académies, de pratiquer ou d’être sensibilisés à l’une des onze langues régionales reconnues. Ainsi, entre 2009-2010 et 2011-2012, le nombre d’élèves marquant un intérêt pour les langues et cultures régionales a augmenté de 24 %.
Je me suis récemment rendue en Guyane, où environ 80 % des enfants parlent une langue différente du français avant d’aller à l’école et où des intervenants en langue maternelle épaulent les instituteurs à la maternelle. On constate que permettre à ces enfants de parler dans leur langue maternelle tout en étant scolarisés dans des établissements dont la langue est le français est bénéfique, notamment parce que leur dignité s’en trouve préservée. Vous le voyez, monsieur le sénateur, nous partageons votre position sur l’importance des langues régionales à l’école !
Les chiffres que j’ai cités démontrent l’intérêt de nos concitoyens pour la valorisation du patrimoine culturel et régional, qui ne saurait être négligé par l’État.
Comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République ne fait pas référence aux langues régionales ou minoritaires. En effet, avec cette nouvelle loi, qui complète et précise les précédentes, le Gouvernement a fait le choix de privilégier certains objectifs, en fixant un nombre limité de priorités, indispensables à la refondation de l’école.
Vous le savez, monsieur le sénateur, le contrôle exercé par le Conseil constitutionnel nous oblige à être extrêmement attentifs. Il ne s’agit pas qu’une loi répète des dispositions déjà contenues dans un autre code, ou qu’elle édicte des normes non pas législatives mais réglementaires. Cela exposerait le texte à la censure du Conseil. C’est la raison pour laquelle il n’a pas semblé utile d’introduire dans cette loi des mentions qui figuraient déjà dans le code de l’éducation.
Par ailleurs, la problématique des langues régionales dépasse le seul cadre de l’éducation nationale. La question de la ratification de la charte européenne des langues régionales et minoritaires est toujours à l’étude. Je ne doute pas qu’il y aura sur ce point des avancées significatives.
Nous aurons sans doute l’occasion de reparler de ces questions au cours du débat parlementaire qui va s’engager sur le projet de loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République.
Il faudra donc trouver un moyen de prendre en compte votre préoccupation, sans que cela ne conduise à fragiliser la future loi.

Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.
Je voudrais néanmoins apporter une précision supplémentaire. Dans le débat portant sur les langues régionales, il faut distinguer l’enseignement de la langue et l’enseignement dans la langue, c'est-à-dire l’enseignement bilingue et l’enseignement par immersion.
Tout en respectant chacune des catégories d’apprentissage, je souhaite, madame la ministre, que l’enseignement des langues par immersion à l’école publique continue de bénéficier des moyens alloués par l’État à l’éducation.

La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 312, adressée à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

Ma question s’adressait à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, mais je suis certain que M. le ministre de l’intérieur, avec sa polyvalence et sa compétence, …

… saura parfaitement y répondre.
Le 5 juillet dernier, la Fédération internationale de football association, la FIFA, décidait d’autoriser le port du voile islamique par les joueuses de football en compétition officielle.
Cette décision, très contestée, est contraire aux règlements de la FIFA, selon lesquels « l’équipement de base obligatoire ne doit présenter aucune inscription politique, religieuse ou personnelle ». Si la Fédération française de football a pris acte de cette décision, elle n’en a pas moins pris position en réitérant son refus d’autoriser les joueuses à porter le voile dans le cadre des sélections nationales françaises, d’une part, et des compétitions nationales qu’elle organise, d’autre part, au nom du principe constitutionnel de laïcité, auquel vous savez, monsieur le ministre, que les radicaux sont fondamentalement et viscéralement attachés.
Néanmoins, cette décision laisse ouverte la possibilité pour des joueuses étrangères prenant part en France à une compétition organisée par la FIFA de porter le voile ou tout autre signe religieux distinctif.
De façon plus générale, la décision de la FIFA est un signal lourd de sens envoyé aux acteurs du monde sportif, plus particulièrement aux acteurs du sport amateur et scolaire. Ces derniers, nous le savons pour le vivre au quotidien au sein des collectivités territoriales, tentent de sauvegarder la dimension universelle et neutre, sur le plan politique ou religieux, du sport.
Il est à craindre que cette décision serve d’argument pour justifier les réclamations tendant à admettre le port de signes religieux dans d’autres disciplines et dans des lieux déjà soumis à de fortes pressions communautaristes. Je prendrai comme exemple les centres aqua-ludiques, où les élus locaux sont souvent confrontés à des difficultés de ce type. Il est d’ailleurs inquiétant que M. Jacques Rogge, président du Comité international olympique, explique, dans un entretien au quotidien L’Équipe en date du 24 juillet 2012, que le port du voile ou du turban ne présente aucune incompatibilité avec la Charte olympique.

Bien au contraire, il n’y voit que l’expression d’une conviction religieuse et estime qu’on ne saurait, de la même façon, reprocher à un athlète de porter une croix.
Tout aussi préoccupante est la décision du 14 janvier dernier de la Fédération mondiale de karaté qui autorise le port du hijab en compétition officielle de karaté, précisant même qu’un seul modèle de voile serait approuvé. D’aucuns y voient aussi, monsieur le ministre, un moyen subtil d’obtenir le vote de certains États pour faire du karaté un sport olympique…
Au vu de ces éléments, je souhaiterais que vous nous indiquiez comment le Gouvernement entend assurer la pleine application du principe de laïcité dans le sport professionnel et amateur.
Monsieur le sénateur, ma collègue Valérie Fourneyron vous prie de bien vouloir excuser son absence. C’est avec beaucoup de plaisir que je vais moi-même répondre à votre question, car je connais vos convictions. Sachez que, ces convictions, nous les partageons.
La décision prise l’été dernier par la FIFA est un important – et inquiétant ! – changement de doctrine. Depuis, cette association a décidé qu’une période de test serait ouverte, jusqu’en mars 2014, pour permettre aux joueuses voilées de participer aux compétitions internationales, alors qu’elles en étaient jusqu’à présent exclues.
Cette décision heurte la conception française de la neutralité dans la pratique sportive, qui implique non seulement l’absence de discrimination, mais aussi la discrétion et l’impossibilité d’arborer des signes politiques ou religieux sur un terrain de sport.
Cette conception, qui correspond aussi à ma conviction personnelle, n’est pas seulement celle de la France. Elle puise son origine, me semble-t-il, dans des valeurs universelles, qui tendent à séparer l’État des religions et, surtout, à permettre aux femmes de s’émanciper. Il n’est pas question de les recouvrir d’un voile les différenciant du reste de l’humanité !
Le sport est précisément porteur de valeurs morales, d’humanité, de fraternité, d’intégration, de mixité. C’est ainsi qu’il restera un vecteur incontournable d’éducation à la citoyenneté et d’apprentissage du vivre-ensemble. C’est vrai aussi au niveau international.
J’étais tout à l’heure au comité interministériel des villes. Élu de la banlieue parisienne, je connais la chape de plomb, faite de machisme et de conservatisme, qui pèse sur certains quartiers, au détriment notamment des jeunes filles, qui peuvent s’émanciper d’abord par l’école, mais aussi par le sport.
Le Gouvernement a soutenu la décision de la Fédération française de football, qui, vous le savez, dispose d’une délégation de la part de l’État pour édicter les règles techniques propres à ce sport pour les compétitions nationales, de refuser aux joueuses le port du voile dans les compétitions nationales. Nous devons évidemment veiller à ce qu’une telle interdiction n’écarte pas certaines catégories de population de la pratique sportive, mais sans transiger sur nos convictions.
Il faut faire en sorte que les athlètes français restent un exemple pour notre jeunesse, en s’inscrivant pleinement dans les principes de la Charte olympique. Il ne peut pas y avoir de démonstration ou de propagande politique ou religieuse – pour ma part, je crois qu’il s’agit avant tout de propagande politique – sur un site sportif ou olympique.
Ce n’est pas un sujet facile. La laïcité, fruit de l’Histoire et garantie de paix et de concorde civile, crée des limites à l’expression d’une préférence religieuse. La loi les a clairement fixées pour les agents publics et pour les écoliers, collégiens et lycéens des établissements d’enseignement public. Mais il y a d’autres domaines où l’équilibre entre la liberté de croire et le principe de laïcité n’est pas clairement défini. La pratique sportive en est parfois un.
L’observatoire de la laïcité dont le président de la République a annoncé la mise en place le 9 décembre dernier pourra se saisir de ce sujet délicat et contribuer au débat important du champ d’application de la laïcité sur l’espace public.
Des lois importantes ont été adoptées ; je serai évidemment très vigilant quant à leur application.
Monsieur Mézard, je crois, comme vous, que la laïcité reste un combat profondément moderne, adapté à notre temps et porteur d’espoir partout où les femmes se battent pour leur dignité.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Je n’en attendais d’ailleurs pas moins de vous, connaissant votre attachement personnel à ce qui constitue à nos yeux une valeur fondamentale de la République.
L’enjeu, c’est la liberté, au sens premier du terme. Il n’est donc pas possible de transiger. Nous savons trop bien l’utilisation qui serait faite de dérogations consenties dans telle fédération ou sur tel territoire…
L’État doit veiller au respect du principe de laïcité, qui est, vous l’avez souligné, l’outil pour défendre la liberté dans notre pays et faire avancer la cause des femmes : voir des femmes revêtues d’un hijab sur un terrain de sport ou un tatami est une aberration et un véritable recul en termes de liberté et d’émancipation des femmes.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, auteur de la question n° 301, adressée à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.

Monsieur le ministre, je partage les inquiétudes que M. Mézard vient d’exprimer.

Je souhaitais également vous faire part, en ma qualité de présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, de la très vive préoccupation que m’inspirent les décisions prises par certaines instances internationales du sport pour autoriser le port par des sportives d’un foulard, voire d’un hijab.
Je pense d’abord à la décision de la Fédération internationale de football, qui a adopté le 26 octobre 2012 un certain nombre d’amendements aux Lois du jeu pour préciser le « design », la « couleur » et le « matériau » du foulard qui sera autorisé, tout en précisant que ce foulard ne peut être porté que par des femmes.
Mais ce cas n’est malheureusement pas isolé : la Fédération de karaté a également décidé d’autoriser des athlètes féminines musulmanes à porter un hijab – c’est le terme utilisé dans la décision du comité exécutif – à compter du 1er janvier 2013.
Ces décisions choquantes sont de surcroît en contradiction manifeste avec les deux grands principes fondamentaux du sport garantis par la Charte olympique et les règlements des grandes fédérations internationales. Elles violent le principe de neutralité du sport consacré dans la règle 50, alinéa 3, de la Charte olympique, qui proscrit toute sorte de « démonstration ou de propagande politique, religieuse ou raciale » dans les manifestations olympiques et sportives. Or je ne pense pas que l’on puisse se méprendre sans mauvaise foi sur la signification religieuse du port du hijab ou de l’un de ses succédanés.
En outre, dans la mesure où le port du voile est exclusivement réservé aux femmes, ces décisions me paraissent contraires au refus par la Charte olympique de toute discrimination fondée sur des considérations de race, de religion, de politique ou de sexe.
Dans le rapport qu’elle avait consacré au mois de juin 2011 à l’égalité des femmes et des hommes dans le sport, notre délégation avait adopté à l’unanimité une recommandation pour rappeler son attachement au strict respect de ces principes et élever une mise en garde contre ces dérives absolument inacceptables.

Nous avions invité les autorités françaises chargées du sport à relayer cette préoccupation auprès des instances internationales du sport.
Monsieur le ministre, le Gouvernement auquel vous appartenez a fait de la défense de l’égalité entre les femmes et les hommes un des axes forts de sa politique. Je souhaiterais que vous nous précisiez sa position à l’égard de ce type de dérives, ainsi que les démarches que vous comptez entreprendre ou que vous avez déjà entreprises pour y remédier, même si vous m’avez déjà renseignée pour partie en répondant à M. Mézard.
Madame Gonthier-Maurin, je ne m’en réjouis pas moins de répondre à votre question sur ce problème que vous connaissez bien et dont il est souhaitable que l’on se préoccupe sur l’ensemble des travées de la Haute Assemblée.
Les instances internationales du sport ont une approche de la notion de neutralité qui n’est pas celle de la République française, en raison d’ailleurs d’une série d’influences qui nous semblent préoccupantes.
Ainsi, le Comité international olympique, majoritairement composé d’hommes et peut-être sensible au poids de certains pays, estime le port du foulard islamique compatible avec la compétition sportive, comme l’ont encore démontré récemment les jeux Olympiques de Londres.
La décision prise par la FIFA le 5 juillet 2012 va dans le même sens. Son objectif initial est de permettre aux joueuses voilées de participer à des compétitions internationales, ce qui était exclu, je l’ai rappelé, auparavant.
La position du Gouvernement est claire : on ne met pas de voile pour faire du sport. Un terrain de football, un stade, un gymnase, un dojo ne sont pas des lieux d’expression politique ou religieuse. Ce sont des lieux de neutralité où doivent primer les valeurs du sport : l’égalité, la fraternité, l’impartialité, l’apprentissage du respect de soi-même et de celui d’autrui.
Il appartient donc aux fédérations de faire en sorte que leur règlement respecte ces valeurs, tout en garantissant l’absence de discrimination et une stricte égalité hommes-femmes. En effet, nul ne doit être écarté de la pratique sportive en raison de ses opinions religieuses et politiques.
Or la décision de la FIFA, en mettant en cause la stricte égalité entre les hommes et les femmes, crée une discrimination supplémentaire : couvrir les femmes d’un voile, c’est encore une fois chercher à les soustraire au regard de tous les autres.
Le sport est un formidable levier d’intégration, de lutte contre l’échec scolaire, d’émancipation et de réduction des inégalités sociales et culturelles. Le Gouvernement et l’ensemble des acteurs du monde sportif restent vigilants, mobilisés et déterminés à empêcher que le sport ne devienne un lieu de tensions, de sexisme ou d’exclusion.

Je vous remercie de la fermeté de votre réponse, monsieur le ministre.
Vous avez à juste titre évoqué la composition des instances internationales du sport. Je crois que nous devrions effectivement nous y intéresser. Favoriser la promotion des femmes au sein de ces organismes permettrait sans doute de faire avancer les choses.
Comme vous l’avez rappelé, le sport est un formidable espace de solidarité, de fraternité et d’humanité. Il serait tout de même paradoxal, à l’heure où un gouvernement applique la parité et où un ministère est dédié spécifiquement aux droits des femmes, d’enregistrer de tels reculs sur notre territoire national. Mobilisons-nous pour faire respecter les principes de la Charte olympique !

La parole est à M. Henri Tandonnet, auteur de la question n° 215, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Je souhaite soulever une question technique à vocation économique.
J’attire l’attention du Gouvernement sur le déclassement des dépendances du domaine public communal. J’évoquerai plus spécifiquement la vente des biens du domaine public des collectivités territoriales sans déclassement préalable de son affectation à son utilité publique.
L’État est aujourd’hui dispensé de ce déclassement préalable. En effet, selon l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, un dispositif dérogatoire permet à l’État, à ses établissements publics ou, depuis 2009, aux établissements publics de santé de déclasser des immeubles appartenant au domaine public et affectés à un service public avant même qu’ils soient matériellement désaffectés.
Ce déclassement par anticipation permet aux personnes publiques concernées par la vente d’immeubles encore occupés de financer, par exemple, la construction des immeubles dans lesquels les services intéressés pourront être transférés. C’est souvent le cas pour des hôpitaux.
En revanche, les collectivités territoriales ne disposent pas de telles dérogations. Il serait souhaitable d’harmoniser la situation des collectivités territoriales avec celle de l’État et de ses établissements publics au regard des possibilités de déclassement des dépendances du domaine public.
Des exemples concrets illustrent parfaitement la nécessité d’une telle harmonisation.
Prenons le cas d’un terrain sportif, par exemple une carrière équestre, appartenant à la collectivité territoriale. Si la collectivité veut le céder à un club d’équitation, elle ne peut le faire sans démontrer que le bien n’est plus affecté au service sportif. Il faudra donc arrêter les activités sur une période significative.
Il serait nécessaire d’appréhender de la même manière que pour l’État la notion de désaffectation et de supprimer la période pendant laquelle le bien est rendu inutilisable, bien souvent artificiellement. En effet, il est actuellement souvent difficile de transférer des biens du domaine public au domaine privé pour poursuivre des activités pouvant être gérées par des acteurs privés, notamment associatifs.
Je souhaite connaître les raisons pour lesquelles la solution souple à laquelle peur recourir l’État ne serait pas applicable aux collectivités territoriales.
Je voudrais également savoir si des mesures pourraient être prises pour rendre possible la vente d’un bien public sans désaffectation préalable lorsque le service affecté à ce bien relève d’une activité économique au sens large : tourisme, activités sportives, loisirs et découvertes. L’objectif est de ne pas arrêter l’activité pour une période de désaffectation et de pouvoir céder l’activité à des acteurs plus qualifiés, associatifs ou professionnels.
Monsieur Tandonnet, vous m’interrogez sur le déclassement des dépendances du domaine public communal.
Vous le savez, la procédure normale de sortie d’un bien du domaine public nécessite un acte formel de déclassement postérieur ou simultané à la désaffectation de fait du bien concerné.
Comme vous l’avez rappelé, les dispositions de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisent, sous certaines conditions, l’État ou ses établissements publics à déclasser un de leurs biens avant que la désaffectation matérielle de celui-ci ne soit intervenue.
Par ailleurs, l’article L. 6148-6 du code de la santé publique a prévu que les dispositions de l’article précité s’appliquaient au domaine des établissements publics de santé afin d’accélérer les cessions concernées et d’améliorer les conditions de leur autofinancement.
Ces dispositions dérogatoires ont été adoptées pour répondre aux enjeux spécifiques de valorisation du domaine de l’État et de ses établissements publics.
Le dispositif de l’article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques s’applique dans des conditions restrictives. On ne saurait permettre, de manière générale, la vente d’un bien appartenant au domaine public sans aucune désaffectation, au risque de remettre en cause les principes fondamentaux protecteurs du domaine public. La désaffectation est, en effet, tout comme le déclassement, un attribut du droit de propriété des personnes publiques.
Cela étant, les règles de droit commun applicables en matière de domanialité publique n’interdisent pas une succession rapide dans le temps, voire une concomitance, entre la désaffectation d’un bien et son déclassement. Il est, en effet, loisible à l’organe délibérant d’une collectivité territoriale, dans la même délibération, à la fois de constater la désaffectation d’un bien et de le déclasser.
Ma réponse ne vous paraît peut-être pas suffisante, mais il me semble néanmoins que cette procédure répond au vœu que vous formulez de permettre une gestion optimale du patrimoine public.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, mais il n’en reste pas moins que les dispositions qui concernent l’État et celles qui concernent les collectivités territoriales portent la marque d’une certaine discrimination. J’y vois une forme de suspicion à l’encontre des élus ou des fonctionnaires territoriaux. Je sais que vous êtes membre d’un gouvernement qui se veut être un gouvernement de la justice. Une simple modification du texte permettrait-elle peut-être d’étendre aux collectivités territoriales le dispositif applicable à l’État…

La parole est à Mme Nathalie Goulet, auteur de la question n° 300, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Monsieur le ministre, je ne suis pas de nature liberticide – d’ailleurs, le port d’un petit voile dans le sport ne me dérange personnellement pas… –, mais mon attention a été attirée sur un certain nombre de « chansons » – si l’on peut dire – de rappeurs tels que 113, Sniper, Salif, Ministère Amer, Smala ou encore Lunatic, dont les paroles sont d’une violence absolument inouïe contre la France, ses autorités civiles et militaires, son drapeau.
J’ose à peine les citer : « Du commissaire au stagiaire : tous détestés ! » ; « J’aimerais voir brûler Panam au napalm… » – je vous épargne la suite de ce texte et notamment les propos châtiés sur la carte d’identité – ; « La France aux Français, tant que j’y serai, ça serait impossible. Leur laisser des traces et des séquelles… » Bref !
Monsieur le ministre, ces « compositions » sont en vente libre et sont diffusées sur toutes les radios. J’estime que leurs paroles sont des appels à la violence et à la haine envers les autorités de police qui s’efforcent de faire respecter la loi de la République dans des secteurs qui, vous le savez comme moi, deviennent des espèces de zones « grises » sur lesquelles plus personne n’a de contrôle.
La représentation nationale ne peut évidemment supporter ces appels à la violence, et il y a eu plusieurs réactions. Je vous interroge aujourd'hui, monsieur le ministre, pour savoir ce que vous comptez faire. Je sais que la liberté d’expression est importante dans notre pays, mais de tels propos dépassent, et de très loin, ce qui est tolérable.
Madame la sénatrice, je suis déçu de votre remarque concernant le voile dans le sport, car il me paraît nécessaire que quelques principes soient maintenus et respectés.
Vous m’avez cependant interrogé sur un autre sujet, à savoir le contenu de plusieurs albums de rap qui attentent gravement à la dignité, à l’honneur des membres des forces de l’ordre ou, plus généralement, des autorités publiques, ainsi qu’aux valeurs qui nous rassemblent.
Aucun d’entre nous, évidemment, ne souhaite mettre en cause la liberté d’expression et la créativité. Le rap fait partie de notre culture urbaine ; il existe incontestablement des talents, et certains textes sont d’une grande qualité. Néanmoins, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres domaines, il y a aussi des abus – en l’occurrence, le mot est faible –, et je partage votre préoccupation : il faut lutter contre les paroles agressives à l’encontre des autorités ou insultantes pour les forces de l’ordre et les symboles de notre République.
Sachez que j’adresse des signalements au garde des sceaux ou que je dépose plainte lorsque les faits sont avérés et non prescrits. C’est ensuite le juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, qui sanctionne ces propos.
Mes services sont mobilisés face à ce phénomène qui dépasse, bien sûr, le seul support du disque ou du livre et s’exprime de plus en plus sur Internet.
Ainsi, en 2012, la plate-forme d’harmonisation, d’analyse, de recoupement et d’orientation des signalements, ou plate-forme PHAROS, a recensé sur Internet soixante et un outrages à personnes chargées d’un service public ou dépositaires de l’ordre public. De même, trente-neuf provocations à la désobéissance ont été relevées.
Les productions que vous avez mentionnées ont été mises à la disposition du public depuis plus de trois mois. Elles sont donc atteintes par la prescription de trois mois prévue par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que nous avons évoquée dans cet hémicycle à l’occasion du débat sur la loi antiterroriste et qui appelle incontestablement une réflexion tant la presse dématérialisée sur Internet a évolué.
Mme Nathalie Goulet approuve.
Je rappelle cependant que le groupe Ministère Amer a déjà été condamné en 1995 – rendez-vous compte ! – à l’équivalent de 38 000 euros d’amende pour provocation au meurtre de policiers. La plainte avait été déposée par le ministère de l’intérieur.
Vous connaissez ma volonté de lutter contre la délinquance et contre le sentiment d’impunité. N’en doutez donc pas. Lutter contre la violence dans notre société, au sein de notre jeunesse, c’est refuser la banalisation de la violence, fût-elle verbale. C’est aussi refuser que l’on dégrade ceux qui, chaque jour, travaillent pour la sécurité des Français.
Les paroles de ces chansons non seulement s’en prennent aux symboles de la Républiques et aux forces de l’ordre, mais aussi donnent souvent une image dégradée de la place de la femme au sein de la société.
Soyez assurée, madame la sénatrice, qu’avec les moyens qui sont les nôtres, en nous appuyant notamment sur la justice, nous ne faiblirons pas dans cette lutte.

Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse ; je ne doutais pas du tout de la fermeté de votre action en ce qui concerne ces propos.
Voilà quelques jours, le Sénat a justement examiné, avec votre collègue Najat Vallaud-Belkacem, la proposition de loi relative à la suppression des délais de prescription prévus par la loi sur liberté de la presse du 21 juillet 1881.
Cette loi appelle effectivement un sérieux dépoussiérage, car elle est totalement inadaptée aux nouveaux médias. Les auteurs d’infractions ne peuvent pas, par exemple, être poursuivis parce qu’il n’est pas possible de déterminer les adresses IP. Le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, s’est engagé à aller dans cette voie et, pour ma part, monsieur le ministre, je me permets de vous faire une offre de services, car j’aimerais travailler sur ce sujet que je connais un peu. Ayant en effet moi-même fait l’objet d’une procédure extrêmement désagréable, je sais que le droit à l’oubli sur Internet n’existe pas. Je crois qu’il s’agit de questions qui méritent amplement que l’on fasse avancer le droit !

Mes chers collègues, grâce à votre concision et à celle des ministres, nous avons pris un peu d’avance ; en attendant l’arrivée de M. le ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche, nous allons donc interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures quarante, est reprise à onze heures quarante-cinq.

La parole est à M. Jean-Patrick Courtois, auteur de la question n° 291, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le ministre, je me permets d’attirer votre attention sur la distinction budgétaire que l’autorité organisatrice des transports publics doit faire entre l’organisation des transports publics stricto sensu et l’organisation des transports scolaires.
Lors de l’examen des projets de loi de finance pour 2011 et pour 2012, j’ai déposé un amendement visant à préciser, dans l’article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales, relatif au versement transport, que ce dernier ne peut être affecté au financement des transports scolaires au sens de l’article L. 213-11 du code de l’éducation.
En décembre 2010, Philippe Richert, alors ministre des collectivités territoriales, avait admis qu’une clarification était nécessaire pour éviter toute ambiguïté quant à l’affectation du versement transport. Cette précision de droit a été rappelée dans la circulaire N°COTG/11/0800410 du 28 mars 2011 sur l’usage relatif des crédits du versement transport.
Ce rappel s’est toutefois avéré insuffisant. L’ambiguïté demeure donc, même si, le 5 décembre 2011, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2012, Mmes Valérie Pécresse etNicole Bricq, alors respectivement ministre du budget et rapporteure générale de la commission des finances, ont à nouveau confirmé que le versement transport ne pouvait être affecté au financement des transports scolaires.
Force est de constater que les dérives perdurent, l’affectation des recettes du versement transport par les organismes en charge du transport conduisant parfois à la suppression de services de transport de voyageurs dans certains secteurs géographiques pour assurer le financement du transport scolaire.
Par ailleurs, une telle politique conduit à léser les usagers des transports publics, puisque la diminution des financements empêche d’instaurer une politique tarifaire incitative, au profit notamment des catégories sociales les plus défavorisées. Je tiens d'ailleurs à souligner que cette situation risque de s’aggraver avec les changements des rythmes scolaires prévus pour la rentrée prochaine.
Il me paraît donc urgent de rappeler dans les meilleurs délais, par exemple au moyen d’une nouvelle circulaire, les modalités d’affectation du versement transport ou de les spécifier très clairement dans l’instruction générale adressée aux préfets avant la préparation des budgets locaux, en insérant dans la ligne budgétaire « versement transport » une séparation entre transport urbain et transport scolaire. Cette distinction permettrait aux préfets, lors du contrôle de légalité, et aux chambres régionales des comptes de visualiser clairement l’affectation du versement transport.
Au début des années 1980, les lois de décentralisation ont transféré aux départements la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement du transport scolaire.
Ce transfert était justifié par les caractéristiques du transport scolaire – vous les avez soulignées –, qui est essentiellement un transport interurbain, c’est-à-dire assuré principalement en dehors des périmètres de transport urbain sur lesquels peut être prélevé le versement transport.
La loi a toutefois prévu les cas où, à la date de la décentralisation, des transports scolaires seraient assurés à l’intérieur de périmètres de transport urbain. Dans ces cas, l’autorité organisatrice des transports urbains demeure compétente, et, à moins qu’il y ait une présentation séparée des budgets, le financement des transports scolaires n’est pas distinct de celui des autres services de transport public.
Vous demandez une clarification. Cette question a été soulevée à plusieurs reprises et a donné lieu à de nombreuses discussions au sein de votre assemblée ; un certain nombre de précisions ont été apportées, notamment par mes prédécesseurs.
Faut-il nécessairement, comme vous le demandez, chercher à séparer, pour ne pas dire à opposer, le transport scolaire et les autres services de transport public ?
Les transports publics sont accessibles aux scolaires, tout comme les transports scolaires peuvent, et doivent, être accessibles aux autres voyageurs. Pour éclairer notre débat, il est important de rappeler que le transport public, qu’il soit scolaire ou non, dépend finalement des subventions que versent les collectivités locales, même en tenant compte du versement transport.
Par conséquent, la clarification de l’affectation du versement transport modifierait assez peu l’origine du financement du transport public. Cela équivaudrait à un jeu de vases communicants, purement comptable, entre deux activités de transport plus ou moins financées par le versement transport ou par des subventions d’équilibre.
Vous appelez de vos vœux la publication d’une nouvelle circulaire. Je me permets toutefois de souligner, puisque vous avez évoqué le contrôle de légalité, que les circulaires ne peuvent être qu’interprétatives.
J’ajoute qu’il est de la responsabilité des autorités organisatrices des transports urbains de présenter les budgets de manière séparée ; ce n’est pas une obligation, mais elles peuvent le faire. Cela permettrait peut-être d’opérer une clarification entre ce qui est financé par le versement transport et ce qui l’est par les subventions ou l’impôt.
Pour ma part, j’aurais tendance à faire confiance à la sagesse des collectivités territoriales, qui souhaiteront sans doute clarifier d’elles-mêmes les choses si nécessaire, sachant que les opérateurs et les autorités organisatrices des transports ont tout intérêt à optimiser le fonctionnement du système et à en améliorer l’efficacité.
Vous avez cité un certain nombre de situations dans lesquelles le transport scolaire se fait au détriment du transport urbain, ce qui est paradoxal, vous en conviendrez. Je le répète, il est de la responsabilité des autorités organisatrices des transports et des opérateurs de répondre aux besoins des usagers du service public. Si un besoin de clarification ou de séparation se faisait sentir, il appartiendrait aux collectivités territoriales d’organiser spontanément une information des élus et de la population grâce à une présentation comptable adaptée.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre. Il faut être clair avec les entreprises qui paient le versement transport, car elles souhaitent, elles, que ce versement serve à financer le transport des usagers et qu’une politique tarifaire intéressante soit mise en œuvre pour les particuliers qui se trouvent dans une situation sociale difficile : chômeurs, personnes handicapées, etc. Or, aujourd'hui, on ne peut pas faire la différence entre les différentes affectations du versement transport, dans la mesure où les masses sont regroupées dans le budget. Les entreprises ont donc l’impression qu’elles paient le transport scolaire à la place des collectivités territoriales.
Ce n’est pas ce que prévoit la loi, qui précise que le versement transport doit financer le transport des usagers. Je pense donc qu’il faudra clarifier les choses un jour ou l’autre.
Je ne manquerai par ailleurs pas de signaler aux autorités organisatrices des transports qu’elles auraient intérêt à présenter de leur propre chef un budget totalement transparent afin que les contributeurs puissent exercer un contrôle efficace.

La parole est à Mme Claire-Lise Campion, auteur de la question n° 314, adressée à M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le ministre, le 15 novembre 2011, Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était alors ministre de l’écologie, a signé deux arrêtés portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne.
L’un d’entre eux, né d’une collaboration entre les services du ministère et la direction générale de l’aviation civile, la DGAC, avait pour objectif, nous disait-on alors, d’atténuer les nuisances sonores liées à l’activité aéroportuaire, source de désagrément pour les populations survolées, notamment dans l’Essonne. Il n’en fut rien.
Non seulement le relèvement de 300 mètres des altitudes n’a pas entraîné une diminution significative des nuisances sonores, mais, en outre, il a occasionné un accroissement des émissions de polluants, du fait de la surconsommation de kérosène due à l’allongement des trajectoires. De surcroît, cet allongement des trajectoires s’est accompagné d’un étalement des zones de survol et, par conséquent, une augmentation du nombre de personnes soumises aux nuisances.
Constatant ces dégradations, les associations essonniennes ont décidé d’entamer une procédure de référé-suspension auprès du Conseil d’État, afin de faire suspendre l’application de l’arrêté tant que le juge administratif n’aura pas jugé le recours au fond.
Dans son ordonnance du 16 avril 2012, le Conseil d’État admet qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 15 novembre 2011. Deux raisons motivent ce doute : d’une part, une consultation irrégulière de la Commission consultative de l’environnement a été réalisée ; d’autre part, l’arrêté méconnaît les objectifs constitutionnels d’accessibilité et d’intelligibilité de la norme.
Pour autant, le Conseil d'État n’a pas suspendu l’application de l’arrêté, estimant qu’un retour en arrière serait trop complexe.
En septembre 2012, le nouveau gouvernement a finalement abrogé l’arrêté du 15 novembre 2011. Cependant, le problème des nuisances aériennes reste entier et nos concitoyens attendent légitimement des réponses.
Ces réponses doivent être le fruit d’une réflexion menée main dans la main avec les élus et les associations concernés.
Monsieur le ministre, je sais que la concertation est la voie que souhaite emprunter le Gouvernement, comme vous l’avez d’ailleurs rappelé le 6 novembre dernier au député Jacques Krabal. J’ai donc trois questions à vous poser : quel est l’état d’avancement des évaluations que vous avez lancées sur le sujet ? Quand envisagez-vous de mettre en place l’étroite concertation que vous évoquez ? Quelles seront les modalités concrètes de cette concertation ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question, qui me permet de vous apporter quelques précisions complémentaires au vu de l’évolution de la situation.
Vous l’avez rappelé, le relèvement des trajectoires d’approche dans la région Île-de-France est un chantier qui a été lancé en 2007. La concertation s’est déroulée dans le respect des procédures et règlementations en vigueur. Une consultation du public et des institutions concernées par les changements de trajectoire a notamment été organisée. Cette concertation s’est conclue par la publication de deux arrêtés le 15 novembre 2011 ; le nouveau dispositif fut ensuite immédiatement mis en œuvre.
Cependant, même si toutes les règles ont été respectées, les opposants restent nombreux ; votre question en fournit une illustration supplémentaire. Ces opposants estiment que la situation environnementale n’est globalement pas satisfaisante. Il conviendra donc certainement de revoir le cadre juridique de la concertation relative à la modification des trajectoires de circulation aérienne, puisque la précédente concertation n’a pas abouti à des solutions satisfaisantes.
Par ailleurs, j’ai été particulièrement attentif à ce qu’une évaluation des résultats soit conduite pour mesurer la cohérence des niveaux de bruit avec ce qui était prévu au moment de la publication des arrêtés, sur le fondement de l’enquête préalable.
Cette évaluation répond à une demande, dont vous vous faites le relais et qui est tout à fait légitime, des habitants de l’Île-de-France, en particulier de ceux des départements les plus concernés par les nouvelles trajectoires.
Les mesures démontrent que les zones qui étaient déjà survolées sous l’empire de l’ancien dispositif ont bien connu une réduction de bruit comprise entre 2 et 3 décibels avec le nouveau dispositif lorsque l’altitude de survol a été augmentée de 300 mètres.
Cependant, l’allongement des trajectoires pour permettre la descente depuis une altitude supérieure a eu pour résultat une dégradation de la situation, avec une augmentation du bruit, dans les zones nouvellement survolées.
Ce bilan, s’il permet de constater des améliorations ponctuelles pour certains riverains, reste donc très mitigé pour d’autres populations dont la situation s’est au contraire dégradée.
Vous l’avez dit, le dossier du relèvement des altitudes en région parisienne est encore en phase contentieuse et ne relève donc plus du seul pouvoir exécutif. Nous avions indiqué que, compte tenu de cette situation, le Gouvernement observerait avec attention la décision prise par le Conseil d’État.
Quoi qu’il en soit, madame la sénatrice, je tiens à vous confirmer que j’accorde une importance toute particulière au maintien du haut niveau d’implication de la DGAC.
Régulièrement, nous évoquons ce sujet avec l’ensemble des services afin de définir des solutions de nature à diminuer progressivement l’impact environnemental de l’activité aérienne en ce qui concerne non seulement le bruit, mais également, vous les avez évoquées, les émissions gazeuses.
Ainsi, à ma demande, la DGAC étudie actuellement, dans le cadre du programme de recherche européen SESAR, de nouvelles perspectives. Elle réfléchit à une modélisation permettant de simuler de nouveaux profils d’approche, dont elle espère retirer les bénéfices sous la forme d’améliorations environnementales. Ses services y travaillent depuis de nombreux mois, notamment en intégrant des avancées technologiques susceptibles d’entraîner des avancées sensibles, qui permettront autant de progrès dans l’intérêt général à un horizon relativement proche, ce qui, dans le domaine aérien, signifie, malgré tout, quelques années.
Cela étant, tout en attendant la réponse de la juridiction administrative, nous continuons à travailler pour pouvoir présenter, dans les prochains mois, du moins je l’espère, une modélisation qui pourrait ouvrir des perspectives favorables à des survols diminuant sensiblement les nuisances subies par les populations.

Monsieur le ministre, j’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les éléments d’information que vous m’avez communiqués.
Il est important, pour nous tous, d’avoir confirmation du travail mené, en liaison avec vous-même, par la DGAC.
J’ai également pris note du bilan que vous avez dressé. On ne relève en effet que quelques améliorations ponctuelles, qui sont bien en deçà de l’objectif initial. Je fais miens les mots – et je serais même tentée de les amplifier – que vous avez prononcés : c’est bien un bilan « très mitigé » pour les populations concernées.
Un contentieux est, certes, en cours, mais il est nécessaire, et je vous remercie de l’avoir fait, que le Gouvernement montre à ces dernières, qu’elles habitent l’Essonne ou ailleurs en Île-de-France, le haut niveau d’implication des pouvoirs publics.
Il est important de rappeler que les impacts sont réels, en termes tant de bruit que d’émissions de gaz. C’est donc avec grand intérêt et beaucoup d’impatience que les élus, les associations et les populations concernées attendent les résultats du travail d’étude sur les nouvelles perspectives qu’ouvre la modélisation de nouveaux profils d’approche, qui ne pourront qu’être bénéfiques, j’en suis convaincue, sur le plan environnemental. J’étais un peu inquiète de vous entendre parler d’années ; je suis rassurée par vos dernières paroles qui font état de quelques mois avant que nous puissions nous mettre de nouveau tous ensemble autour de la table. C’est indispensable et très attendu !

La parole est à M. Michel Teston, auteur de la question n° 149, adressée à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Monsieur le ministre, selon les préconisations de la feuille de route pour la transition écologique issue des travaux de la Conférence environnementale, le Gouvernement a annoncé, le 7 janvier dernier, des mesures d’urgence pour la relance de la filière photovoltaïque.
Outre le doublement à 1 000 mégawatts de l’objectif annuel de développement, ces mesures intègrent, notamment, des critères environnementaux et des systèmes de bonification qui expriment clairement la volonté de relancer le développement de la production d’énergie solaire en France.
Ces mesures étaient attendues par la filière. Cependant, de nombreuses entreprises porteuses de projets photovoltaïques, qu’ils concernent de grandes installations, au-delà de 250 kilowatts, ou des installations de taille moyenne, entre 100 et 250 kilowatts, sont dans l’expectative, car elles sont inquiètes des délais de mise en œuvre des prochains appels d’offres et de l’abaissement de 20 % du tarif de rachat T5, lequel est destiné aux installations ne remplissant pas les conditions de taille ou d’intégration définies.
C’est notamment le cas en Ardèche où beaucoup de projets de petites installations et d’installations de taille moyenne ont été bloqués à la suite du moratoire de décembre 2010 et où aucun des projets de grandes installations, soutenus ou engagés par les collectivités territoriales, n’a été retenu dans le cadre des appels d’offres de 2012.
La plupart de ces projets, conçus dans un objectif de développement économique local maîtrisé, sont aujourd’hui en attente et les délais jusqu’aux prochains appels d’offres – début 2014 pour les grandes installations et fin 2013 pour les installations de taille moyenne – risquent de mettre en difficulté les entreprises concernées, avec le préjudice que cela impliquerait pour la filière photovoltaïque française.
Aussi, monsieur le ministre, quelles réponses pouvez-vous apporter pour apaiser les inquiétudes sur l’avenir qu’expriment tant les porteurs de projet que les collectivités territoriales impliquées ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, qui inaugure actuellement le Salon des énergies renouvelables, à Lyon. Elle m’a demandé de bien vouloir vous transmettre à la fois ses excuses et sa réponse.
Par ma voix, elle tient à réaffirmer combien le Gouvernement est attaché au développement des énergies renouvelables. C’est un engagement du Président de la République, du Premier ministre et de l’ensemble du Gouvernement, engagement que la politique conduite par Delphine Batho traduit et que le Président de la République a lui-même avait rappelé lors de la Conférence environnementale, le 14 septembre dernier.
Il s’agit maintenant de construire des politiques de soutien durable pour chacune des filières qui prennent en compte leur maturité spécifique, leur coût, leur potentiel ainsi que les contraintes environnementales ou sociales qui s’y rapportent.
Vous évoquez, à ce sujet, l’insécurité dans laquelle la politique du précédent gouvernement a plongé les porteurs de projets photovoltaïques, notamment en Ardèche. Le résultat du moratoire décidé en 2010 est connu : le secteur photovoltaïque a perdu près de 15 000 emplois entre 2010 et 2012.
À ce résultat s’ajoute une situation du marché mondial extrêmement tendue : après des années de croissance effrénée, qui ont vu l’émergence de grands groupes chinois qui l’ont, tout simplement, envahi, le marché du photovoltaïque souffre aujourd’hui de surcapacités importantes rendant nécessaire une phase de consolidation.
Nous avons donc souhaité sécuriser le secteur, garantir à la filière photovoltaïque, comme à toutes les autres filières, les conditions d’un développement équitable et pérenne, tout en nous assurant de la plus haute qualité environnementale des produits.
Delphine Batho s’y est employée depuis sa prise de fonction. Elle a notamment présenté, le 7 janvier dernier, comme vous le savez, monsieur Teston, un ensemble de mesures d’urgence cohérent visant à atteindre le développement d’au moins 1 000 mégawatts de projets solaires en France en 2013, chiffre à comparer à l’objectif annuel de 500 mégawatts fixé par le précédent gouvernement.
Les mesures prises s’articulent autour de trois axes.
Le premier consiste à soutenir les technologies françaises innovantes pour les grandes installations photovoltaïques. Un appel d’offres pour de telles structures, d’une puissance supérieure à 250 kilowatts, sera lancé d’ici à quelques semaines. Il portera sur un volume de 400 mégawatts et il fera la part belle aux technologies novatrices.
Concernant les centrales au sol, l’appel d’offres privilégiera le développement sur des sites où les conflits d’usage, notamment à propos de l’artificialisation de terres agricoles, pourront être évités.
Il valorisera la compétitivité-coût des projets proposés, mais aussi leur contribution à la protection de l’environnement et du climat, ainsi qu’à la recherche, au développement et à l’innovation. Ces critères ont vocation à soutenir la filière solaire française dans un contexte de concurrence déloyale.
Un deuxième appel d’offres sera lancé au cours de l’année 2013, ciblant notamment d’autres technologies innovantes dans le domaine solaire.
Le deuxième axe vise à améliorer les conditions d’appel d’offres pour les installations de taille moyenne.
Les résultats des premiers appels d’offres automatiques pour les installations sur toiture d’une puissance comprise entre 100 et 250 kilowatts ont été peu satisfaisants, notamment en termes de retombées industrielles, retombées qui constituent une de nos préoccupations.
Aussi Delphine Batho a-t-elle décidé de revoir les conditions des appels d’offres. Le deuxième appel d’offres sera prorogé donc d’un an pour un volume global de 120 mégawatts, répartis en trois tranches de 40 mégawatts.
Outre le prix, sera désormais accordée une attention particulière aux projets qui protègent le climat et à des critères d’évaluation carbone du processus de fabrication des modules photovoltaïques.
Enfin, le troisième axe consiste à bonifier les tarifs et à récompenser la qualité pour les petites installations.
Deux arrêtés tarifaires ont été pris pour les petites installations sur toiture d’une puissance allant jusqu’à 100 kilowatts, entérinant le doublement des volumes cibles de 200 à 400 mégawatts par an.
La grille tarifaire a été simplifiée pour mettre fin à la distinction faite entre installations selon l’usage du bâtiment. Les tarifs d’intégration simplifiée au bâti ont augmenté de 5 % et tous les projets pourront désormais bénéficier d’une bonification supplémentaire, allant jusqu’à 10 %, en fonction du lieu de fabrication des modules photovoltaïques pour prendre en compte les différences de coût observées.
Vous évoquiez le tarif T5 dédié aux autres installations, lequel a été, certes, baissé de 20 %, mais également assorti d’une bonification, d’au plus 10 %, afin de privilégier le développement des installations porteuses d’innovation et de développement local.
Toutes ces mesures vont entraîner des investissements de plus de 2 milliards d’euros et créer ou maintenir environ 10 000 emplois. Leur coût annuel pour la collectivité est maîtrisé : il est estimé entre 90 millions et 170 millions d’euros, soit environ 1 à 2 euros en moyenne par an et par ménage.

Monsieur le ministre, je vous remercie de cette réponse.
J’ai bien noté que le plan d’urgence adopté par le Gouvernement pour relancer la filière photovoltaïque avait pour objectif de développer cette énergie, de soutenir les entreprises européennes, particulièrement celles de notre pays, et de créer des emplois.
Je souhaite que ces objectifs soient atteints, notamment grâce à la prise en compte du bilan carbone des panneaux photovoltaïques pour les moyennes installations et à la bonification du tarif d’achat pour les petites installations.
Cela étant dit, lors de l’appel d’offres de 2012, seulement deux des projets retenus concernaient la région Rhône-Alpes et aucun le département de l’Ardèche, ce que je regrette vivement. J’estime donc que la Commission de régulation de l’énergie devra adopter une vision beaucoup plus équilibrée de l’implantation des installations photovoltaïques sur l’ensemble du territoire national lors des prochains appels d’offres.

La parole est à Mme Aline Archimbaud, auteur de la question n° 297, adressée à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Monsieur le ministre, je souhaite vous interpeller sur le passage et le stationnement à la gare de Drancy-Le Bourget d’un train chargé de déchets nucléaires le 13 décembre 2012. Ce train, en provenance de la centrale de Borssele aux Pays-Bas et en route pour l’usine de retraitement des déchets nucléaires de La Hague, est resté dans le département de Seine-Saint-Denis pendant une journée entière. Il contenait 6, 7 tonnes de combustible usagé à base d’uranium !
Il ne paraît pas responsable qu’un train chargé de déchets radioactifs circule sur des voies ferroviaires empruntées chaque jour par des dizaines de milliers de voyageurs et traverse des zones fortement urbanisées, malgré la dangerosité de son chargement. En effet, les wagons émettent des rayonnements gamma qui se propagent à plusieurs dizaines de mètres, mettant ainsi en danger le personnel à bord des trains, les forces de l’ordre et les riverains.
Compte tenu non seulement du passage du convoi en milieu urbain dense et de la virulence des radiations émises, mais aussi, et surtout, de son stationnement pendant plus de douze heures en gare de triage de Drancy, à quelques mètres de la gare du RER bondée à dix-huit heures, de la proximité du stade de football Paul André, de la présence de nombreux enfants à cette même heure et de la proximité des habitations des riverains, les risques pris nous paraissent énormes.
De plus, à quatorze heures, deux autres wagons « Castor » ont été accrochés au convoi. Nous supposons qu’ils contenaient des combustibles nucléaires usagés français. D’où provenaient ces combustibles ? Par où sont-ils passés ? Où ont-ils été stockés et pendant combien de temps ?
Quatre wagons « Castor » ont également été repérés samedi 5 janvier 2013, à douze heures quinze, à proximité immédiate des quais de la gare du RER B de Drancy. Ils sont repartis le lendemain, dimanche 7 janvier, entre vingt heures et vingt et une heures quinze. Le personnel au guichet n’était au courant ni de la présence de ces wagons ni de leur caractère potentiellement dangereux. Les maires de Drancy ou du Blanc-Mesnil n’ont pas non plus été informés.
Monsieur le ministre, pourquoi les élus locaux concernés n’ont-ils pas été prévenus de ce passage et de ce stationnement de longue durée sur leur territoire ? Pourriez-vous m’indiquer quelles sont les autres villes dans lesquelles ce convoi est passé et a stationné, ainsi que les mesures de sécurité prises ?
Mme Batho, en réponse à une question de mon collègue député Jean-Christophe Lagarde, a affirmé : « L’application des contraintes réglementaires et les débits de dose à proximité du véhicule sont […] très strictement contrôlés. » Mais, s’il n’y a pas de danger, pourquoi éviter les heures de pointe et faire stationner le convoi pendant plus de douze heures ?
Mme Hélène Lipietz applaudit.
Madame la sénatrice, le transport des marchandises dangereuses est une problématique à laquelle Delphine Batho et moi-même attachons la plus grande importance. La maîtrise des risques est essentielle, en particulier dans les gares de triage où sont concentrés les wagons de marchandise.
Le principe est que toutes les mesures doivent être prises dans la plus grande transparence pour assurer la sûreté et la sécurité de nos concitoyens. En France, il appartient à l’Autorité de sûreté nucléaire, l’ASN, d’exercer le contrôle de la sûreté des transports de substances radioactives à usage civil.
Cette autorité procède à des inspections, de même qu’elle instruit les demandes d’agrément des emballages nécessaires. Ce contrôle vise à assurer la maîtrise des risques d’irradiation, de contamination et de criticité, ainsi que la prévention des dommages causés par la chaleur émanant des colis de transport de substances radioactives ; il porte également sur la conception des emballages. Les opérations de transport sont soumises à des contraintes réglementaires rigoureuses.
En 2012, l’ASN a autorisé 1 482 transports de matières.
En ce qui concerne la limitation de l’exposition du public et des travailleurs, le débit de dose radioactive à proximité du véhicule ne doit pas dépasser certains plafonds. En pratique, les niveaux relevés sont beaucoup plus faibles que ces plafonds.
L’ASN intègre dans son programme de contrôle des inspections relatives à l’expédition des colis de substances radioactives. Certaines inspections portent spécifiquement sur les contrôles de radioprotection que les responsables de transport doivent réaliser avant le départ. Des mesures de radioprotection indépendantes de celles qu’opèrent les responsables de transport sont réalisées par l’ASN à l’occasion de ces inspections.
S’agissant plus précisément de l’import de combustibles usés néerlandais du 10 au 14 décembre 2012, je précise qu’il entre dans le cadre de contrats commerciaux établis entre la société COGEMA, devenue AREVA NC, et l’opérateur des centrales hollandaises, EPZ. Ces accords concernent un total de 402 tonnes de combustibles usés qui ont vocation, après traitement et conformément au droit, à retourner dans leur pays d’origine.
Puisqu’il n’existe pas de réseau ferré réservé au fret, le réseau est donc indifféremment partagé entre le fret et les voyageurs. C’est pourquoi la sécurité des transports ferroviaires implique de réduire au maximum le temps de parcours et le nombre d’arrêts des convois transportant des combustibles usés. Ces contraintes conduisent très souvent à choisir des itinéraires traversant la région parisienne, le maillage du réseau ferré national étant ce qu’il est, afin d’optimiser les temps de parcours. Une attention particulière est alors portée aux horaires de traversée, afin d’éviter les heures d’affluence du public.
L’évacuation de combustibles usés à destination de La Hague induit un transport quasi hebdomadaire d’un wagon au départ de chaque centre nucléaire de production d’électricité, et un train de lotissement remonte chaque semaine la vallée du Rhône.
L’import de combustibles usés néerlandais est arrivé en France de nuit, à vingt-trois heures trente-deux, et a atteint le Bourget à six heures huit. Il n’est reparti qu’à vingt heures cinquante-neuf pour éviter les périodes de pointe. Pendant cet arrêt de moins de quatorze heures dans la zone de fret isolée du Bourget, les trois wagons ont été surveillés en permanence par l’opérateur ainsi que par le service de la sûreté générale de la SNCF.
Les services du ministère de l’intérieur associés à la préparation et à la planification de ces transports les suivent avec une attention particulière pour assurer leur sécurité et, le cas échéant, le maintien de l’ordre public. Ils en informent les préfectures concernées.
Il n’est pas prévu d’informer spécifiquement les élus transport par transport, pour des raisons de confidentialité, et donc de sécurité, que vous comprendrez. Comme l’a rappelé la Commission d’accès aux documents administratifs, le 3 novembre 2011, même leur connaissance a posteriori « pourrait permettre de recouper des habitudes, des procédures et des itinéraires validés et d’anticiper avec précision les conditions d’exécution des expéditions de matières radioactives à venir ». Une diffusion à plusieurs centaines de personnes ne permettrait pas, vous en conviendrez, de conserver un niveau de diffusion de l’information compatible avec les enjeux de sécurité.
Pour autant, toutes les assurances sont données au public ; l’ASN, en raison de son statut et de sa neutralité, apporte toutes les garanties. L’ensemble des contrôles réalisés est donc de nature à éviter toute prise de risque inutile en matière de sûreté et de sécurité.

Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous avez apportées. Je demeure cependant très inquiète, et mon inquiétude est encore renforcée par des événements récents.
Le 21 janvier dernier, un wagon contenant des fûts d’uranium appauvri, parti de la centrale nucléaire de Tricastin à destination des Pays-Bas, a déraillé dans la gare de triage de Saint-Rambert-d’Albon, dans la Drôme, ce qui a nécessité l’intervention d’une grue. C’est bien la preuve que des accidents peuvent se produire lors de ces transports !
Par ailleurs, depuis que j’ai rédigé cette question, d’autres trains transportant des matières radioactives ont stationné en Seine-Saint-Denis : le 6 février dernier, un nouveau convoi est passé à Sevran, Aulnay-sous-Bois et au Bourget, où il a stationné toute la journée.
La Seine-Saint-Denis compte 1, 5 million d’habitants : si un accident survenait, on imagine sans peine l’ampleur des dégâts qui pourraient en résulter !
Au nom du principe de précaution, je souhaiterais donc que l’information soit mieux diffusée. De nombreuses associations de riverains expriment leur inquiétude, inquiétude dont je tiens à me faire l’écho auprès de vous, monsieur le ministre. J’ai bien conscience des efforts accomplis par le Gouvernement et par l’ASN, mais un accident est toujours possible, comme nous le prouvent les événements du 21 janvier.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thierry Foucaud.