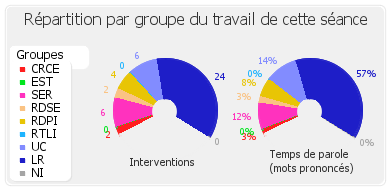Séance en hémicycle du 20 décembre 2016 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Dépôt d'un document
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Questions orales (voir le dossier)
- Stage obligatoire dans une petite entreprise pour les étudiants des grandes écoles (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le tableau de programmation des mesures d’application de la loi n° 2016–1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Acte est donné du dépôt de ce document.
Il a été transmis à la commission des lois.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est parvenue à un texte commun.

La parole est à M. Alain Duran, auteur de la question n° 1546, adressée à Mme la ministre de la fonction publique.

Madame la ministre de la fonction publique, je souhaitais appeler votre attention sur les éventuelles implications des mesures d’interdiction administrative ou judiciaire de stade pouvant être prises à l’encontre de supporters de clubs sportifs.
J’ai été saisi récemment du cas d’un supporter qui s’est vu retirer le bénéfice d’un concours de la fonction publique pour avoir, par le passé, fait l’objet de mesures d’interdiction administrative de stade, lesquelles n’ont pas été suivies d’une confirmation par l’autorité judiciaire. J’ajoute que ces faits n’étaient pas empreints de violence.
L’article 5 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur, dispose : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire […] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
Au regard de ce cas particulier, et sans nullement viser à porter une quelconque appréciation sur les fondements et la justesse des décisions des autorités administratives et judiciaires, je souhaite vous interroger, madame la ministre, en vue de savoir, d’une part, si le prononcé d’une ou plusieurs interdictions administratives ou judiciaires de stade est inscrit au casier judiciaire et, d’autre part, s’il est susceptible d’interdire aux personnes concernées d’intégrer la fonction publique au titre de l’article 5 de la loi précitée ou de l’enquête de moralité accompagnant l’accès à certains métiers publics.
Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question. En effet, l’article 5 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
Toutefois, le juge administratif rejette tout caractère automatique au refus de nomination fondé exclusivement sur la seule mention au bulletin n° 2.
Il incombe en effet à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au cas par cas, et selon une approche de proportionnalité, si les faits à l’origine de la condamnation mentionnée au bulletin n° 2 sont compatibles ou non avec la nature des fonctions auxquelles prétend l’intéressé.
Le cas sur lequel vous m’interpellez concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique ayant fait l’objet d’une mesure préventive d’interdiction administrative de stade et non de la peine complémentaire d’interdiction de stade.
Faute d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l’interdiction administrative de stade n’est pas un motif qui entre dans le champ des dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.
Au-delà de l’incompatibilité prévue à l’article 5 et qui est examinée au regard des fonctions que le candidat à un emploi public est amené à exercer, l’administration peut exiger davantage des candidats à des emplois publics dont la déontologie est renforcée ; c’est le cas, par exemple, des corps de police ou des métiers de la justice.
Et, dans ce cadre, elle peut vérifier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé présente les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il prétend.
L’administration peut, à cet effet, prendre en compte des faits matériellement établis dont elle a connaissance, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2.
En l’absence de précisions sur le corps auquel ce lauréat pouvait accéder, il m’est difficile de vous en dire plus.
En effet, c’est au regard de la nature des fonctions à occuper que le comportement passé du lauréat, le cas échéant révélé lors d’une enquête de moralité, peut fonder la décision de refus de nomination, en dehors des motifs de refus énumérés à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.

Je vous remercie, madame la ministre, de cette réponse, qui apporte un éclairage utile sur un point de droit qui, force est de le constater, peut avoir des conséquences dramatiques pour certains jeunes susceptibles de se trouver dans cette situation.

La parole est à M. Jean-François Rapin, auteur de la question n° 1492, adressée à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargé des transports, de la mer et de la pêche.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nos discussions de ce matin peuvent paraître futiles au regard des événements de cette nuit. Il me paraît important de le rappeler mais la vie continue…
Ma question s’adressait à M. Vidalies. Depuis le 23 juin dernier, date du référendum actant la volonté des Britanniques de sortir de l’Union européenne, les pêcheurs français sont inquiets, et parmi eux, les pêcheurs des Hauts-de-France le sont plus particulièrement. Cette décision, qui a des incidences sur de nombreux secteurs de notre économie, les inquiète à plusieurs titres.
En effet, si l’Union européenne a incontestablement des défauts et des lourdeurs bureaucratiques, elle a néanmoins instauré la communautarisation des zones économiques exclusives de ses États membres, ainsi que la négociation des totaux admissibles de capture, les TAC, et des quotas annuels.
La politique commune des pêches engendre d’âpres discussions chaque année, mais elle constitue un cadre connu, déterminé, pour une activité qui dépasse bien souvent les frontières nationales : 60 % de l’activité de la flottille régionale française se situent dans les eaux anglaises. Ce chiffre monte à 80 % pour les navires hauturiers qui pêchent au large de l’Écosse.
Les milliers d’emplois directs et indirects engendrés par la pêche doivent être protégés, et les professionnels méritent une lisibilité dans l’exercice de leur activité.
Alors que le gouvernement britannique a annoncé son intention d’activer la clause de sortie de l’Union européenne avant la fin du mois de mars prochain, les négociations seront rudes, et le rôle de la Commission sera primordial.
Qu’adviendra-t-il de l’accès des navires français aux eaux anglaises ? Qu’en sera-t-il de l’accès au marché unique pour les produits britanniques ? Et, enfin, les droits historiques des pêcheurs français, bien antérieurs à la création de l’Union européenne, puisqu’ils existent depuis la fin du XlXe siècle avec les pays riverains de la Manche, seront-ils également remis en cause ?
Même si les négociations à Bruxelles ont permis de maintenir un niveau de capture de pêche acceptable, comment le Gouvernement compte-t-il s’assurer que les intérêts français seront bien défendus à Bruxelles dans le cadre de l’aboutissement du Brexit ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Alain Vidalies, qui n’a pas pu être présent ce matin.
Vous attirez l’attention du Gouvernement sur les conséquences de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne pour les entreprises françaises de pêche exerçant dans la zone économique exclusive, la ZEE, de cet État, ainsi que sur le marché des produits de la mer. Sachez que cette inquiétude, nous la partageons. Elle est légitime.
Le peuple britannique a exprimé, à l’occasion du référendum du 23 juin 2016, le choix de ne plus être membre de l’Union européenne. Ce choix démocratique doit être respecté.
Les implications du retrait du Royaume-Uni pourraient être importantes pour de nombreux secteurs économiques français, dont la pêche maritime, bien sûr.
Le Gouvernement, lors du dernier comité interministériel à la mer auquel j’ai participé, et le Président de la République, durant les Assises de la mer, ont affirmé que les intérêts français en matière de pêche maritime seraient âprement défendus durant les discussions qui s’ouvriront le moment venu.
Le Premier ministre Bernard Cazeneuve l’a d’ailleurs confirmé lors de sa déclaration de politique générale le 13 décembre à l’Assemblée nationale.
Vous soulignez, à juste titre, la forte dépendance de la pêche française aux eaux britanniques, particulièrement dans les Hauts-de-France, en Bretagne ou en Normandie.
À l’heure actuelle, les revendications du Royaume-Uni sur ce sujet ne sont pas connues, mais nous imaginons qu’elles pourraient porter sur l’accès des navires de l’Union à la ZEE britannique dans son ensemble, l’accès aux zones de pêches historiques situées dans les eaux territoriales, ou encore la répartition future des quotas entre l’Union européenne à 27 et le Royaume-Uni.
Comme vous, nous sommes bien conscients que le Royaume-Uni est exportateur de produits de la mer et que son marché principal est aujourd’hui l’Union européenne.
Ces négociations, comme cela a été décidé par les 27 chefs des États membres concernés, ne pourront débuter que lorsque le Royaume-Uni aura formellement notifié le recours à l’article 50 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui encadre la procédure de retrait volontaire et prévoit un délai de deux ans pour négocier un accord.
Le Gouvernement est pleinement mobilisé pour défendre les intérêts français dans les négociations à venir et les échanges avec les représentants professionnels du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, le CNPMEM, sur ce sujet sont denses et coordonnés. Je veux vous le redire, monsieur le sénateur, comme à l’ensemble des pêcheurs français concernés par cette question, le Gouvernement est vigilant et mobilisé.

M. Jean-François Rapin. Madame la ministre, si j’ai bien noté l’implication du Gouvernement sur le sujet, je relève qu’il y a beaucoup de « si » et que de nombreuses questions se posent encore. Je préconise que le Parlement soit pleinement associé à ces discussions.
M. Philippe Mouiller opine.

La parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la question n° 1573, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur l’appellation d’origine contrôlée bugey-cerdon, délivrée en 2009.
En effet, dans l’Ain, des générations de producteurs bugistes représentés aujourd’hui par le Syndicat des vins du Bugey, reconnu comme organisme de défense et de gestion, ont œuvré pour faire reconnaître le vin effervescent bugey-cerdon méthode ancestrale.
Le bugey-cerdon représente 50 % de la production des vins du Bugey, pour un total de 15 000 hectolitres par an. Il s’inscrit, comme il se doit, dans le cadre d’un cahier des charges très restrictif.
Or il apparaît que la clairette de Die, historiquement vin effervescent blanc issu de la vallée de la Drôme, a fait l’objet d’une appellation d’origine contrôlée pour un vin effervescent rosé, reconnue par l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, le 7 septembre 2016. Depuis, le cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Clairette de Die rosée » a été homologué par un arrêté du 16 novembre 2016 paru au Journal o fficiel du 26 novembre 2016.
Cette reconnaissance, monsieur le ministre, est étonnante en ce qu’elle concerne la création d’une catégorie jusqu’alors inexistante, puisqu’il s’agit d’une nouvelle couleur de vin et de nouveaux cépages au cahier des charges. Les quelques références historiques ne sauraient donner une légitimité à la clairette de Die rosé.
Cette situation sans précédent constitue un non-sens. En effet, l’AOC bugey-cerdon a elle-même été reconnue sur la base d’us et coutumes, d’une notoriété dûment établie, ainsi que sur une antériorité certaine dans sa propre région de production.
La clairette de Die rosé qui sera produite va disposer d’un potentiel sans commune mesure avec la production de bugey-cerdon. Autrement dit, la typicité du bugey-cerdon se trouvera noyée dans une production plus importante et concurrencée par un vignoble voisin disposant de règles différentes.
La récente décision de l’INAO suscite une inquiétude profonde et légitime, en ce qu’elle constitue une concurrence directe qui risque de mettre à mal toute la production des vins du Bugey et de casser la dynamique existante depuis plusieurs années maintenant.
Les viticulteurs bugistes, leurs représentants, les acteurs de ce territoire et l’ensemble des élus de l’Ain sont tous mobilisés sur ce dossier important.
C’est pourquoi je souhaite, monsieur le ministre, que vous puissiez me donner des explications concernant cette décision. En effet, elle met en cause le concept même de l’appellation, lequel assure une garantie d’origine, de tradition et d’authenticité de tout produit ainsi labellisé.
Monsieur le sénateur, vous me posez une question dont je comprends le sens, tout comme je comprends que vous soyez mobilisé sur ce sujet. Le ministre a certes des responsabilités. Toutefois, pour ce qui concerne les signes officiels de la qualité et de l’origine, les fameux SIQO, c’est un institut composé de professionnels, l’INAO, qui décide, en toute connaissance de cause, des appellations. Le ministre a peu de choses à dire sur les décisions qui sont prises. Heureusement qu’il en est ainsi parce que les sujets en cause sont tellement complexes que je me garderais bien de venir donner moi-même des avis qui seraient retenus – ou pas d'ailleurs ! – par le conseil de l’INAO !
Il se trouve que le Syndicat de la clairette de Die a effectivement demandé, en septembre 2013, à l’INAO d’introduire la clairette de Die rosé dans la gamme de ses productions d’appellation contrôlée.
Lors du débat qui a eu lieu, comme c’est toujours le cas, au sein de cette institution, les producteurs de vin de Bugey ont pu faire connaître leur opposition à cette reconnaissance.
Les experts ont tranché et ont décidé de satisfaire la demande présentée par le Syndicat de la clairette de Die.
Le ministre de l’agriculture respecte les décisions des professionnels.
D’ailleurs, si je m’avisais de faire l’inverse, j’aurais droit aux protestations des producteurs de clairette de Die rosé qui viendraient me demander pourquoi j’ai refusé cet agrément. Je suis obligé de respecter les règles fixées par les producteurs eux-mêmes et par l’INAO pour être en mesure de juger, apprécier et attribuer des AOC-AOP à un certain nombre de zones de production.
Je comprends votre position. Je sais que la notoriété de cette production de Bugey est parfaitement assise, ce qui n’interdit pas à la clairette de Die rosé d’avoir quelques ambitions ! L’appellation Bugey me semble suffisamment solide…
… pour apaiser les craintes de ses producteurs : la reconnaissance obtenue par la clairette de Die rosé ne va pas menacer– au contraire ! – les vins du Bugey, …
… qui sont connus et appréciés par les consommateurs.
Me demander de me prononcer sur cette question reviendrait à dire que le ministre de l’agriculture a pouvoir de décision sur les appellations d’origine ! Vous imaginez les problèmes que cela poserait ! Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que ceci : je respecte une décision des professionnels.

Monsieur le ministre, votre réponse ne me donne pas satisfaction pour une raison simple : c’est vous qui signez l’arrêté.

Et si l’avis du ministre n’était pas nécessaire, il n’y aurait pas besoin qu’il signe un arrêté ! Quand vous signez un arrêté, vous le faites en votre âme et conscience.
Je vous ai alerté par courrier sur ce point. Je n’ai d'ailleurs pas eu de réponse.
J’aurais apprécié que vous preniez le temps de faire une contre-expertise, ou du moins que vous vous donniez la peine de poser un certain nombre de questions. Quoi qu’il en soit, au vu de votre réponse, monsieur le ministre, je suis très inquiet pour la protection à l’avenir de l’ensemble des produits français historiquement reconnus en AOC. Après cette décision, la copie pourra se faire de façon impunie.

M. Patrick Chaize. Bien sûr que si, monsieur Guillaume, et vous le savez très bien ! Jusqu’à présent, le label AOC reposait sur des us et coutumes, sur des cépages existants et sur des process existants, ce qui n’est pas le cas pour la clairette de Die rosé, que vous le vouliez ou non !
M. Didier Guillaume s’exclame.

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud, auteur de la question n° 1488, adressée à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la réglementation en matière de sécurité des travailleurs de la filière arboricole fruitière.
En France, elle représente 6 % de la totalité des exploitants agricoles, leurs exploitations mobilisent 9 % de la main-d’œuvre totale et 27 % du salariat saisonnier. Plus de 70 % des exploitations fruitières sont pourvoyeuses d’emplois et les exploitations produisant des fruits à pépins sont celles qui emploient le plus. Le premier bassin de production est le Sud-Est.
La prévention du risque de chute des travailleurs est donc une problématique omniprésente. La réglementation en vigueur prévoit de réaliser la cueillette depuis un plan de travail conçu, installé et équipé de manière à garantir la sécurité des personnes. Le décret du 7 mars 2008 impose l’usage d’une plateforme élévatrice et interdit l’utilisation d’échelles, escabeaux et marchepieds.
Sans ignorer la nécessaire protection collective des travailleurs, il est indispensable de préciser les conditions d’utilisation des plateformes et brouettes de cueillette qui ne sont pas adaptées aux caractéristiques des vergers anciens.
En effet, deux mesures dérogatoires peuvent être prises, mais la principale difficulté est liée au fait que les travaux doivent s’effectuer sur une courte durée, sans être répétitifs.
La filière arboricole fruitière traverse une grave crise. Cette mesure est inadaptée. De plus, elle conduirait au doublement du nombre de plateformes de relève, ce qui ne serait pas sans conséquence financière sur les exploitations. Enfin, le temps de cueillette serait rallongé et le travail des saisonniers, mis à mal.
C’est pourquoi je vous demande de suspendre cette mesure et j’attends que les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, les DIRECCTE, accompagnent les professionnels pour une mise en œuvre de mesures adaptées à la réalité d’un secteur agricole en difficulté.
Madame Morhet-Richaud, deux sénateurs viennent de me poser des questions, l’un me demande de suivre l’avis des professionnels, tandis que l’auteur de l’autre m’enjoignait d’aller contre !
Les questions de crises rencontrées par l’arboriculture, je les mesure parfaitement. Je sais aussi que la prévention du risque de chute de hauteur est un enjeu important pour cette filière. Un engagement a été pris – et il est partagé par tous les partenaires sociaux –, il s’agit d’éviter les accidents du travail, principalement dus aux chutes dans les vergers. Ce genre de problème, on doit le solutionner par la négociation.
Vous me demandez de suspendre l’application d’une règle qui vise à éviter des chutes et des accidents du travail. Je vous ai écoutée, c’est ce que vous voulez, madame la sénatrice ! Pour ma part, je suis conscient de mes responsabilités tout en sachant qu’il faut toujours trouver les ajustements nécessaires.
Cet objectif de prévenir les accidents et les chutes dans les vergers, au demeurant partagé par tous, notamment par les partenaires sociaux, doit être un engagement de chacun.
Les préventions des chutes de hauteur dans l’arboriculture figurent en bonne place dans le plan « santé et sécurité au travail de l’agriculture 2016–2020 », négocié et discuté.
Comme vous l’avez dit, certains producteurs de fruits peuvent toutefois rencontrer des difficultés en raison de la configuration de leurs vergers. Il faut être capable de s’adapter à la configuration de chacun des vergers pour mettre en œuvre la réglementation sur la prévention des chutes en hauteur, s’agissant, en particulier, de l’obligation de réaliser des travaux de cueillette depuis une surface plane et horizontale. J’ai bien compris que dans des vergers dont les surfaces ne sont pas planes et pas horizontales, il est en effet plus difficile d’avoir des plateformes elles aussi planes et horizontales.
Mes services, en lien avec le ministère du travail, ont publié en mars 2015 un guide sur le travail en hauteur en arboriculture. Les représentants des professionnels ont été associés, aux côtés des pouvoirs publics, à la rédaction de ce guide technique, garantissant ainsi sa bonne lisibilité par les acteurs sur le terrain.
L’objectif de ce document est d’accompagner les arboriculteurs dans la démarche d’évaluation des risques et de mise en œuvre générale de la réglementation, en s’adaptant, bien sûr. Il ne s’agit pas d’imposer des contraintes à des gens qui sont dans l’impossibilité de les appliquer !
Pour les vergers dans lesquels il n’est pas possible de recourir à des équipements techniques mécanisés de protection, l’utilisation de matériels type brouettes de cueille – que vous avez cités –, escabeaux et traîneaux moins volumineux est possible. Les services de l’État disposent ainsi de l’ensemble des éléments pour répondre à toutes les situations pratiques que l’on peut rencontrer sur le terrain.
Enfin, l’Association française de normalisation, l’AFNOR, travaille depuis cet automne à la rédaction d’un guide qui précisera à l’attention des professionnels et en pleine concertation avec eux les adaptations techniques que doivent comporter ces matériels. Les constructeurs pourront ainsi développer des produits innovants, qui répondent aux configurations des vergers anciens, tout en respectant les conditions de sécurité.
Comment réussir à concilier la sauvegarde de l’activité et la protection des salariés ? Eh bien, en étant capable de s’adapter ! Les règles ne peuvent pas être appliquées de la même manière partout, il faut qu’elles soient adaptées. Et nous cherchons à trouver les voies et les moyens de ces adaptations pour que l’activité nécessaire à l’arboriculture se poursuive tout en protégeant les salariés des accidents du travail.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de votre réponse. En revanche, Mme la ministre du travail est venue, voilà quelques mois, dans notre territoire et a rencontré à cette occasion une délégation d’arboriculteurs, qui l’ont interrogé sur ces questions. Elle leur a promis une réponse rapide. Or, à ce jour, les agriculteurs de mon département n’ont malheureusement reçu aucune réponse – ils me l’ont confirmé dernièrement – alors même que la cueillette de 2016 est finie depuis bien longtemps.
Le guide que vous avez évoqué ou le fascicule que l’AFNOR a rédigé sur les équipements de travail en arboriculture ont certes le mérite d’exister, mais ils ne résolvent absolument pas le problème d’une réglementation trop coûteuse et contraignante. Il semblerait qu’une norme européenne soit également en projet. J’espère que votre ministère veillera à ce qu’elle n’impose pas de contrainte supplémentaire à l’arboriculture, qui est, je le répète, en grande difficulté.

La parole est à M. Alain Vasselle, auteur de la question n° 1497, adressée à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés rencontrées notamment par les éleveurs autour de la délivrance de permis de construire. Mon collègue Michel Raison, sénateur de la Haute-Saône, s’associe à ma démarche, car il vit les mêmes préoccupations.
Le code de l’urbanisme prévoit, à son article L. 431–1, que le recours à un architecte pour établir le projet architectural est obligatoire pour l’instruction de la demande de permis de construire. L’exception prévue à l’article L. 431–3 du même code concerne les exploitations agricoles qui modifient elles-mêmes une construction de faible importance, dont la surface maximale est fixée par décret. Or ce décret, modifié le 29 décembre 2011, fixe ce seuil à 800 mètres carrés, ce que l’ensemble de la profession agricole et, notamment, les éleveurs s’accordent à juger trop bas.
Une révision des textes réglementaires nous apparaît donc nécessaire, afin de permettre aux agriculteurs de ne pas souffrir de cette difficulté administrative.
Je crains par ailleurs que l’obligation faite aux éleveurs de faire appel à un architecte n’engendre un surcoût, pour leurs constructions nouvelles, de l’ordre de 5 % à 10 %. Vous admettrez que cela, dans un contexte économique particulièrement difficile, n’est pas propice à leur investissement.
Monsieur le ministre, seriez-vous favorables à un rehaussement de ce seuil à 4 000 mètres carrés de plancher et d’emprise au sol ?
Monsieur le sénateur, je vous rappellerai avant tout que le Gouvernement a mis en place, avec les régions, le plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles, ou PCAE, qui vise à soutenir les investissements dans les bâtiments agricoles. Ces investissements avaient été estimés entre 200 millions et 250 millions d’euros. Or, en deux ans, plus de 450 millions d’euros auront été dépensés, et je reçois encore beaucoup de demandes d’investissements dans les bâtiments. Vous me demandez, comme à l’accoutumée, si la réglementation existante est un frein à l’investissement. Pour ma part, et je m’en félicite d’ailleurs, je ne peux que constater que le PCAE a fonctionné bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer.
Vous avez évoqué les règles d’urbanisme qui prévoient le recours obligatoire à un architecte pour les projets de constructions professionnelles au-dessus du seuil de 800 mètres carrés. À n’en pas douter, je ne suis pas opposé à une éventuelle révision de ce seuil pour les bâtiments d’élevage. Peut-être pourrait-on fixer des critères qui, s’ils étaient respectés dans le projet, dispenseraient du recours à l’architecte. Bien d’autres règles mériteraient encore un débat. Il n’en reste pas moins que rehausser le seuil en question de 800 à 4 000 mètres carrés représenterait un changement complet : on peut sûrement faire évoluer la réglementation sans aller aussi loin.
De fait, la question de l’insertion des bâtiments dans les paysages se pose dans d’autres pays européens. Ainsi, aux Pays-Bas, dans les zones de polders, on impose à tous les bâtiments d’élevage des caractéristiques très précises, notamment des couleurs spécifiques. Je ne souhaite pas aller dans ce sens. En revanche, des règles existent. Souvent, pourtant, dans le Limousin par exemple, tous ces bâtiments se ressemblent dans leur forme et leur architecture. On pourrait donc peut-être envisager de faire évoluer le code de l’urbanisme.
En revanche, le Gouvernement ne prévoit pas actuellement de rehausser ce seuil jusqu’à 4 000 mètres carrés. Je comprends bien que les coûts encourus du fait du recours à l’architecte peuvent constituer un frein pour certains éleveurs. Néanmoins, j’ai pu constater l’ampleur des investissements, d’ailleurs nécessaires, réalisés ces deux dernières années dans les bâtiments d’élevage. C’est tout de même la preuve que le système fonctionne. Dès lors, bien que je sois prêt à me pencher sur ce problème, il est clair qu’une vraie dynamique existe aujourd’hui pour l’investissement dans les bâtiments d’élevage.

Je vous donne acte, monsieur le ministre, de la volonté du Gouvernement de soutenir les éleveurs par une augmentation des aides à l’investissement. En effet, les crédits qui y sont consacrés ont très nettement progressé.
En revanche, monsieur le ministre, considérez-vous vraiment qu’il est nécessaire, pour les agriculteurs, de faire appel à un architecte pour concevoir des projets qui s’intègrent bien dans le paysage et qui répondent aux normes environnementales ? Vous savez bien que, là où les municipalités produisent des documents d’urbanisme, les contraintes s’imposent déjà naturellement aux agriculteurs. Alors, faut-il retenir le seuil de 4 000 mètres carrés ? Je relève du moins que vous êtes prêt à réviser le décret pour faire évoluer ce seuil, fût-ce pour le fixer à une valeur intermédiaire.
En toute franchise, l’idéal serait de supprimer complètement l’obligation de recours à un architecte. Elle est le fruit des efforts du lobby de cette profession, qui a réussi son opération et fait supporter aux agriculteurs des honoraires d’architectes dont ils pourraient bien se passer !

La parole est à M. Gérard Bailly, auteur de la question n° 1487, transmise à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre de l’agriculture, j’avais adressé ma question à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé. Je ne mets pas pour autant en doute votre parole, loin s’en faut, et je m’adresserai à vous en tant que porte-parole du Gouvernement.
Je souhaitais attirer l’attention de Mme la ministre sur la façon dont certains médias dénigrent sans cesse la qualité des produits alimentaires français, créant ainsi de grandes suspicions et inquiétudes dans l’esprit de nos concitoyens.
En effet, il ne se passe pas une semaine sans que les médias évoquent un problème de santé publique qui serait lié à notre alimentation. À cet égard, il me semble qu’on ne peut laisser dire n’importe quoi sur un sujet aussi important que la santé, a fortiori lorsque les propos tenus sont malveillants et faux. Or, malheureusement, je constate que pratiquement tous nos produits alimentaires ont été ou sont concernés : un jour le lait, un autre jour le pain, les œufs, le sucre, les crustacés, certains fruits et légumes, et surtout la viande, point de mire des critiques depuis le printemps dernier.
De fait, ces derniers mois – j’ai déposé ma question en mai dernier –, la critique se focalise sur la viande : on évoque, pêle-mêle, les gaz entériques des bovins, les conditions d’abattage, le bien-être animal et désormais la consommation d’eau. J’ai ainsi lu dans l’édition du 15 mai 2016 du Progrès de Lyon un article §selon lequel il faudrait 15 500 litres d’eau pour faire un kilo de bœuf, soit 4 650 000 litres, c’est-à-dire 4 650 mètres cubes d’eau par bovin ! Cet article prétendait en outre que 40 % des ressources en eau du pays seraient utilisées pour nourrir le bétail, affirmation complètement fausse et qui, de surcroît, ne tient pas compte du recyclage de l’eau. Outre ces articles de presse, des réunions se tiennent régulièrement où l’agriculture est montrée du doigt.
Aussi, je ne peux que constater et déplorer cette profusion de contrevérités relayées par les médias. Je suis intimement convaincu que l’objectif de leurs auteurs est de pousser le consommateur français à devenir végétarien, voire végétalien : non seulement il ne mangerait plus ni viande ni poisson, mais il supprimerait aussi de son alimentation tous produits ayant une origine animale, comme le lait ou les œufs.
Pour ma part, je pense qu’on ne saurait, par manque de clairvoyance ou simplement par laisser-faire, permettre à ces propos faux et médisants de proliférer. Il conviendrait, au contraire, de prendre enfin toute la mesure du découragement de nos agriculteurs et de nos éleveurs et de les soutenir efficacement, puisque, a contrario, ils se battent pour maintenir leurs exploitations et les modes de travail qui leur permettent d’assurer aux consommateurs français des produits de qualité et une nourriture saine. J’ajoute que, sans culture et sans élevage, nos pâtures et tous nos beaux paysages de montagne seraient rapidement rendus à l’état de friche.
C’est pourquoi, pour clarifier la situation et afin que puisse cesser ce dénigrement quasi constant et injustifié des produits alimentaires français, j’aurais aimé que Mme la ministre de la santé puisse indiquer clairement à la représentation nationale s’il y a un danger pour la santé à manger les produits français et, si tel peut être le cas, quels sont les produits qui poseraient problème.
Mme Patricia Morhet-Richaud applaudit.
Monsieur le sénateur, ce n’est pas vraiment une question. Y aurait-il un problème à manger des produits français ? Non ! Le Gouvernement a-t-il engagé, depuis que j’occupe cette fonction, une valorisation de l’origine France des produits et, en particulier, de la viande ?
Oui ! Cela commence-t-il à avoir un impact si sérieux que des investisseurs européens désireux d’obtenir ces labels viennent en France ? Oui ! Il y a donc bien eu des changements.
Par ailleurs, nous continuons de faire des efforts en faveur du bien-être animal. L’utilisation des antibiotiques, par exemple, qui a été dénoncée, a diminué de plus de 20 % en trois ans. Il faut mettre en valeur ces avancées : nous avons rempli plus vite que prévu l’objectif que nous avions fixé. Dans les filières professionnelles, le travail engagé est très important ; tous ceux qui médisent doivent le savoir.
En outre, nous développons à présent des stratégies pour intégrer à l’alimentation animale des éléments favorables à la santé humaine. Ainsi, des élevages bovins et porcins utilisent des aliments riches en lin et en légumineuses, ce qui rend la viande riche en oméga-3, en acides gras polyinsaturés, ce qui est très important pour la santé. Tous ces processus vont dans le même sens : plus de bien-être, de meilleures conditions de production et, dans le même temps, des viandes dont la qualité s’améliore de plus en plus. C’est cela la vérité, voilà ce qu’on doit répondre à ceux qui le contestent !
Cependant, comme vous l’avez rappelé, des offensives très fortes et virulentes sont menées contre la consommation de viande. Les vegans, comme on les appelle, ont un engagement militant en faveur du mode de vie végétarien ou végétalien.
Ce faisant, ils oublient que, si l’on ne consommait plus aucune viande, il n’y aurait plus d’animaux domestiques. Par quoi seraient-ils remplacés ? Peut-être par des animaux sauvages, et encore. Laisser penser que la nature laisserait les choses se faire sans aucune réponse est une erreur, mais ces militants seraient responsables, suivant leur logique, de la disparition massive de toutes les espèces domestiques : ce serait radical ! Il faut donc répéter à tous ceux qui pensent qu’il suffirait d’arrêter de manger de la viande que cela aurait de graves conséquences. Tous les gens qui viennent admirer les magnifiques animaux présents au Salon de l’agriculture doivent savoir que, si l’on entrait dans cette logique, ces animaux disparaîtraient !
Certes, je ne nie pas l’existence d’un débat sur cette question, et je respecte le choix de devenir végétarien ou végétalien. Il faut en revanche s’adresser au grand public. La production et l’élevage français ont fait, font et feront encore des progrès. Cela doit sécuriser nos concitoyens et les consommateurs.
Il faut aussi répéter à quel point la décision prise par les vegans est particulière. Dans l’histoire de l’humanité, les chasseurs-cueilleurs transhumants ont eu une existence stable et durable, pour près de 70 000 ans ! Je crains que certains, aujourd’hui, ne mesurent pas que leurs positions radicales ne nous permettront pas de subsister aussi longtemps. Quant aux chasseurs-cueilleurs, ils cueillaient, mais ils chassaient aussi ! S’ils n’avaient pas de troupeaux domestiques, ils mangeaient du gibier. Tout cela doit être rappelé. Certains veulent changer radicalement le monde, mais il existe depuis des millions d’années, et l’espèce humaine telle qu’elle est aujourd’hui a vécu de la chasse pendant des dizaines de milliers d’années !
M. Stéphane Le Foll, ministre. Volontiers, monsieur le président. Permettez-moi de conclure en évoquant le fait que la transition du mode de vie de chasseur-cueilleur à l’agriculture a eu lieu très tôt à Marseille !
Sourires.

Monsieur le ministre, je ne mets pas en doute votre parole. Nous avons participé ensemble à suffisamment de manifestations de valorisation de la production agricole – je vous en remercie d’ailleurs – pour que vous le sachiez.
En revanche, j’aurais aimé pouvoir obtenir ces assurances de Mme la ministre de la santé, à qui ma question était adressée. On lit des articles selon lesquels la consommation de viande rouge nuit à la santé, la viande est cancérigène, et manger de la viande n’est pas indispensable : ces attaques ne s’arrêtent jamais ! Pour ma part, je voudrais que Mme la ministre, un jour, dise à nos concitoyens que ce n’est pas vrai et que ces attaques doivent cesser, car elles pèsent tout de même lourd.
En outre, s’il n’y avait plus d’agriculteurs en France, on devrait importer nos produits alimentaires d’outre-Atlantique, d’Amérique du Sud, ce qui mettrait dans nos assiettes des organismes génétiquement modifiés et des hormones. Je doute que ces produits auraient la qualité française ! C’est pourquoi, monsieur le ministre, non seulement il faut répéter ces choses, mais il faudrait que ce soit Mme Touraine, en tant que ministre de la santé, qui le dise à l’opinion publique.

La parole est à M. Philippe Mouiller, auteur de la question n° 1505, adressée à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement.

Monsieur le ministre, ma question porte sur la situation économique désastreuse que connaissent, depuis de longs mois, nos éleveurs de bovins allaitants. J’ai déjà eu l’occasion d’évoquer ce sujet lors du débat qui s’est tenu au Sénat, le 23 novembre 2016, sur la sauvegarde et la valorisation de la filière élevage.
En matière d’élevage, nos races et nos savoir-faire, qui constituent l’exemple même du made in France, sont aujourd’hui clairement mis en péril. Plusieurs facteurs contribuent à cette situation.
Tout d’abord, la crise laitière met sévèrement en danger la production de viande de qualité, compte tenu de l’afflux de vaches laitières de réforme dans les abattoirs.
En outre, les éleveurs bovins français croulent sous les charges et les normes, ce qui les empêche de jouer à armes égales avec leurs concurrents, notamment européens.
Par ailleurs, la surtransposition des directives européennes entraîne des surcoûts financiers et la perte de compétitivité dont souffrent nos entreprises agricoles.
Je regrette à ce propos que la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire n’ait toujours pas été adoptée définitivement. Ce texte, examiné sur l’initiative du Sénat, dispose que, pour chaque norme nouvellement créée dans le domaine agricole, une norme antérieure soit abrogée.
De plus, il n’est pas acceptable que l’élevage allaitant et les territoires qui en vivent soient offerts comme monnaie d’échange de notre positionnement politique international. Ainsi, l’attitude française à l’égard de la Russie cause à nos éleveurs un tort considérable, tout comme les restrictions à l’exportation de bovins vers la Turquie, qui relèvent davantage d’une question de géopolitique que d’une question sanitaire. L’élevage est stratégique pour notre économie et ne doit pas constituer un faire-valoir dans les rapports de force.
Malgré les beaux atouts dont elle est dotée en matière d’élevage, la France semble incapable de porter une réelle stratégie de conquête des marchés d’exportation. La réponse structurelle à la crise que traverse la filière bovine passe pourtant par une stratégie offensive à l’exportation. Accompagner la filière vers ces marchés doit être une des priorités de l’État.
Or aucun comité export n’a été convoqué depuis le mois d’octobre 2015. Il doit être réuni de toute urgence. Il ne suffit pas de créer une plateforme export sans vocation commerciale et de laisser la main, principalement, à des opérateurs industriels.
Je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir me préciser les mesures que vous entendez prendre en faveur de l’élevage et de l’exportation.
Monsieur le sénateur, la mise en place de la plateforme export que vous avez évoquée, et qui ne se réunit pas suffisamment, s’est faite sur l’initiative du ministre de l’agriculture. Certes, vous êtes dans votre rôle en posant cette question – et chacun pourra la poser à nouveau au prochain ministre – mais si les exportateurs ne s’organisent pas pour faire vivre cette plateforme, le ministre ne peut pas exporter à leur place ! Il faut que tout le monde en ait conscience.
On pourra raconter tout ce qu’on voudra pendant la campagne présidentielle, mais chacun se retrouvera ensuite devant ses responsabilités, même si l’on continuera de laisser penser qu’il suffit de faire ceci ou cela. Pour ma part, j’ai créé une plateforme export qui n’existait pas auparavant. Nous avons cherché à mettre autour de la table tous les opérateurs de l’exportation française, ainsi que les abattoirs, pour qu’ils puissent discuter des objectifs et répondre ensemble à des appels d’offres. Une fois la plateforme créée, je peux bien les réunir dix fois, mais s’ils ne veulent pas coopérer pour répondre aux appels d’offres, que puis-je y faire ?
Puisque vous avez mentionné la Turquie, qui a rouvert le marché turc ? C’est moi, à la suite de la visite du Président de la République dans ce pays, qui s’est bien passée. Peut-être des questions géopolitiques ont-elles joué ; il n’en reste pas moins que ce marché nous avait été fermé à cause de la fièvre catarrhale ovine. C’est pour cette raison que, même si l’on respecte aujourd’hui les critères de l’Organisation mondiale de la santé animale, l’OIE, la Turquie nous a causé des difficultés, alors même que le flux d’exportations vers ce pays avait dépassé les 80 000 têtes en vif entre les sommets de l’élevage de Cournon 2014 et 2015. J’en étais surpris moi-même.
Par ailleurs, nous sommes en train de faire le nécessaire pour ouvrir des perspectives d’exportation vers l’Égypte et les pays du Maghreb, notamment en Algérie. Nous cherchons à signer des contrats, à faire en sorte que les conditions sanitaires soient respectées et, plus largement, à aider les exportateurs chaque fois que nous le pouvons. Mais cela nécessite aussi que des choix stratégiques soient faits par les filières et que les opérateurs travaillent sur ces questions.
J’en viens à la question des normes, qui est elle aussi très politique. Vous laissez penser aux agriculteurs que c’est cela qui pose problème aujourd’hui, mais vous aurez à leur expliquer demain que c’est plus compliqué. Vous allez toutes les supprimer – très bien ! – mais allez-vous régler le problème ? Les prix ont pu baisser jusqu’à 20 % ou 25 %. Trouvez-moi donc des normes dont la suppression ferait gagner 20 % à 25 % en compétitivité ! Il n’y en a pas.
Vous prétendez qu’il suffit de supprimer des normes pour retrouver les prix antérieurs ; il vous faudra donc assumer, devant les agriculteurs, l’absence d’effet de ces suppressions. Que viendront-ils alors vous dire ? Je dis cela avec beaucoup de sérieux et de responsabilité car, pour ma part, j’assume toutes les critiques depuis quatre ans et demi : j’ai battu le record de longévité à la tête de ce ministère, et je connais tout cela par cœur. Je sais donc ce qu’il est possible de faire, et ce que nous devons faire pour améliorer les choses. En revanche, je sais que les discours selon lesquels « il suffit de… » pour tout régler mènent à des lendemains difficiles.
Quant à la gestion du marché de la viande et du lait, nous avons essayé de diminuer la production laitière, ce qui a donné lieu à des abattages. Comme la production est désormais stabilisée à nouveau, les abattages de vaches laitières de réforme ne devraient plus perturber le marché de la viande bovine autant qu’ils l’ont fait récemment.
Par ailleurs, nous essayons de structurer ce marché. Nous allons offrir 150 euros afin de plafonner les carcasses de jeunes bovins à 360 kilos et d’éviter ainsi que trop de kilos de viande ne se retrouvent sur le marché ; ainsi, les prix pourront remonter. Voilà comment on fait !
Quant aux plateformes export, je le répète, nous avons tout fait pour développer des filières d’exportation, mais nous ne pouvons pas exporter à la place des exportateurs !

J’entends la réponse de M. le ministre. Selon moi, il existe plusieurs niveaux d’intervention.
De manière générale, à l’heure actuelle, on passe notre temps à courir derrière les difficultés pour essayer de les résoudre, alors que, en matière de développement économique et, notamment, d’agriculture, l’anticipation, la prospective et la stratégie sont elles aussi fondamentales : il ne s’agit pas simplement de répondre à une crise conjoncturelle.
Je reviens sur la problématique de l’exportation. Vis-à-vis des marchés que vous avez évoqués, on s’est trouvé face à une difficulté et l’outil a été créé, mais ce n’est pas suffisant ! On ne peut simplement le créer puis en laisser la responsabilité aux agriculteurs et aux entreprises. Une volonté existe pour s’impliquer dans un schéma beaucoup plus large que la simple démarche de marché : cela implique des échanges dans les domaines sanitaire, politique et économique. Voilà ce que les agriculteurs attendent en matière de portage.
Les problèmes s’accumulent. Dans mon département des Deux-Sèvres, les éleveurs subissent maintenant, en plus de leurs problèmes antérieurs, la nouvelle carte des zones défavorisées. On est en train de cumuler les difficultés dans une période où nos éleveurs n’en peuvent plus.
Quant aux normes, c’est extraordinaire ! Selon vous, on ne peut rien faire !

M. Philippe Mouiller. Or, si l’on prend le temps de regarder comment le Gouvernement transpose les directives européennes, on s’aperçoit qu’il apporte un niveau de complexité encore bien supérieur. Dire qu’on ne peut rien faire, c’est du fatalisme, et je pense que votre bilan se fondera sur le fatalisme !
M. Loïc Hervé applaudit. – M. le ministre s’exclame.

La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, auteur de la question n° 1528, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Il n’y a jamais eu autant de médecins en France ; néanmoins, selon un constat établi par le Conseil national de l’ordre des médecins, les déserts médicaux à la campagne et dans les zones périurbaines se développent. C’est ainsi que 49 % des Sarthois ont vu leur accès géographique aux médecins généralistes reculer, et plus encore pour les spécialistes : 84 % en ce qui concerne les pédiatres, 75 % pour les ophtalmologues, 73 % pour les gynécologues.
Le 25 août dernier, une nouvelle convention entre médecins et assurance maladie a été signée, ce qui a officialisé quatre nouvelles mesures pour les zones sous-dotées, mesures qui restent pourtant simplement incitatives.
Ainsi, la signature de contrats visant à séduire les étudiants ou à sécuriser les médecins généralistes pour revigorer les zones sous-dotées n’a pas vraiment permis d’inverser la tendance, et la mise en place des maisons de santé pluriprofessionnelles, qui visent à encourager l’exercice collectif pluridisciplinaire, reste aujourd’hui extrêmement coûteuse et, en pratique, met en exergue des divergences d’approche entre élus et professionnels de santé.
Par ailleurs, augmenter le numerus clausus, comme il est proposé dans les régions déficitaires, reste un moyen à long terme et hypothétique de lutter contre ces zones sous-dotées, puisque le laps de temps entre la formation et l’installation effective de médecins ne permet pas d’apporter une réponse immédiate et, par ailleurs, ne permet pas d’assurer que cette installation se fera dans ces zones.
Il est donc urgent de mettre en place une politique ambitieuse qui garantisse l’accès de tous à des soins de qualité et satisfasse ainsi l’intérêt général.
Nous regrettons que plusieurs mesures qui pouvaient constituer de vraies solutions sur le sujet n’aient pas prospéré lors des débats relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 ; je pense notamment au conventionnement sélectif, pourtant introduit par votre majorité, ou à la situation des médecins retraités en zones sous-denses, qui avait largement rassemblé le Sénat.
Aussi, je souhaite particulièrement attirer votre attention sur ces mesures de régulation qui pourraient être mises en place en complément de l’arsenal incitatif existant. Peut-être, et avant toute chose, faudrait-il rendre obligatoire, dans le cadre de la convention nationale, les négociations sur le conventionnement afin d’encourager l’installation en zones rurales.
On pourrait aussi, par exemple, revaloriser substantiellement les aides prévues par la convention médicale, dans ses options « démographie » et « santé-solidarité territoriale », au sein des zonages déterminés par les agences régionales de santé, mais également dans les zones de revitalisation rurale, tout en y allégeant les conditions. Ces mesures peuvent évidemment être envisagées sur des périodes transitoires.
Monsieur le sénateur, nombre de Français éprouvent des inquiétudes légitimes concernant le maintien d’une offre de soins dans les territoires ruraux. Ces inquiétudes ne datent pas d’hier : elles sont le fruit d’années durant lesquelles les pouvoirs publics avaient tout simplement cessé d’inventer. Elles sont aussi la conséquence d’un creux démographique lié aux départs en retraite de la génération du baby-boom, phénomène qui dépasse très largement les seuls médecins.
Pour répondre à cette inquiétude, le Gouvernement poursuit une ambition claire et assumée : inciter les jeunes médecins à s’installer dans les territoires sous-dotés.
Concrètement, il s’agit de faciliter l’installation du médecin en lui assurant une certaine sécurité professionnelle, sociale et financière. Les dispositifs mis en place dans le cadre du pacte territoire-santé connaissent aujourd’hui un vrai succès : 665 praticiens territoriaux de médecine générale se sont installés dans des zones sous-dotées, 1 750 étudiants ont signé un contrat d’engagement de service public, et notre pays compte désormais 830 maisons de santé pluriprofessionnelles.
Pour encourager les jeunes médecins à s’installer dans ces territoires, il fallait aussi revoir en profondeur leur formation pour la rendre mieux adaptée et plus professionnalisante. Nous avons donc augmenté le nombre de maîtres de stage universitaires parmi les professionnels de santé de terrain.
Marisol Touraine, ministre des affaires sociales et de la santé, aura très prochainement l’occasion de présenter le bilan du pacte territoire-santé.
En revanche, nous avons la conviction que la mise en place d’une restriction à la liberté d’installation serait inefficace. Un quart des étudiants diplômés en médecine ne s’inscrivent pas à l’Ordre et choisissent des professions sans lien avec le soin. Les autres risquent quant à eux d’opter pour un exercice spécialisé, au détriment de la médecine générale.
Enfin, le conventionnement sélectif inciterait le médecin à opter pour un exercice hors convention, non remboursé par la sécurité sociale, créant ainsi une médecine à deux vitesses.
Instaurer de tels mécanismes remettrait en cause le travail qui est aujourd’hui bien engagé avec l’ensemble des acteurs, sans proposer de solution de remplacement crédible ou durable.
La démographie médicale est un sujet complexe, exigeant. Il doit nous appeler à refuser le mirage du court-termisme et à réformer en profondeur.

Madame la secrétaire d’État, je n’ignore pas les efforts accomplis pour essayer de trouver des solutions au problème de démographie médicale dans les territoires. Aujourd’hui, certains territoires souffrent beaucoup plus que d’autres et ont des difficultés à voir des médecins s’installer.
Certes, les décisions générales qui sont prises peuvent être quelquefois assez efficaces, mais des mesures encore plus spécifiques manquent encore pour inciter les médecins à s’installer dans des territoires qui risquent de perdre dans les trois ou quatre prochaines années la totalité de leurs médecins. Une carte de la région des Pays de la Loire a été publiée dernièrement : on y voit de véritables déserts médicaux. Dans ces zones, les mesures, bien qu’elles soient très incitatives, ne sont pas assez puissantes pour obliger les médecins à s’installer.

La parole est à M. Jean-Yves Roux, auteur de la question n° 1544, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question concerne les secours en montagne, plus précisément le statut des médecins embarqués lors de missions de sauvetage en territoires de montagne. Les interventions d’urgence en territoires de montagne mobilisent des personnels civils et militaires qui effectuent des missions de haute technicité dans des conditions parfois périlleuses.
La difficulté de leurs missions tient à plusieurs critères.
Ces tâches, spécifiques à la médecine de montagne et à la médecine d’urgence, d’une grande polyvalence, doivent être accomplies dans un temps réduit. Par ailleurs, le lieu même de l’intervention se révèle parfois très difficile d’accès ou peu adapté en cas d’urgence réelle. Il faut en effet souligner qu’en territoires de montagne la distance moyenne pour accéder à un SAMU ou un SMUR est de vingt-sept kilomètres, soit trente à quarante minutes par la route et quinze à trente-cinq minutes par hélicoptère.
À ce jour, on compte environ 150 médecins qui effectuent ces missions de secours embarqué. Ils ne bénéficient pas du même statut, certains étant civils, d’autres militaires. Or certains de ces médecins, qui ne bénéficient pas du statut de fonctionnaires, sont de facto exclus de la bonification des points de retraite, qui est attribuée en compensation de la dangerosité des tâches accomplies. Ces personnels, civils et embarqués, remplissent pourtant de la même manière, avec un niveau équivalent de compétence et de prise de risque, les missions de service public qui leur sont confiées.
Aussi, madame la secrétaire d’État, je souhaite connaître les possibilités permettant à ces médecins de bénéficier de la même bonification des points de retraite.
Monsieur le sénateur, je comprends l’importance que cette question revêt pour un territoire de montagne comme le vôtre, dans lequel les hélicoptères de secours ont un rôle majeur pour la population.
La question que vous posez a trait directement aux statuts des différents intervenants des équipes de secours. Ces différences statutaires se traduisent par des modes de rémunérations différents, une sécurité de l’emploi qui n’est pas la même et in fine des avantages de retraite différents.
La comparaison entre les différents régimes de retraite et les avantages qu’ils servent ne peut pas se faire de manière isolée, sur une dimension particulière. Elle nécessite d’apprécier l’ensemble des droits et obligations qui caractérisent chacun des régimes.
En effet, selon le régime de sécurité sociale applicable, les droits à retraite reposent sur une logique différente. Par exemple, si certains services peuvent ouvrir droit à bonification dans les régimes de la fonction publique, à l’inverse, certains avantages familiaux pourront se révéler plus intéressants dans le régime général.
La même approche doit être retenue pour apprécier les situations des différents médecins susceptibles d’intervenir à bord des hélicoptères. Dans ce cas précis, les différences liées à leur statut ne se limitent pas à la seule question des retraites : deux médecins pourront, par exemple, percevoir une rémunération différente pour cette même activité.
Concernant précisément les bonifications pour service aérien, je veux rappeler que celles-ci sont prévues, pour les fonctionnaires, par les articles L. 12 et R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Un arrêté des ministres chargés de la défense, de l’économie et des finances et des transports de 1971 détaille les coefficients applicables aux différents types de service aérien.
Il s’agit d’un mécanisme propre aux régimes de la fonction publique. Par conséquent, les médecins libéraux, les praticiens hospitaliers et l’ensemble des personnels médicaux des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux affiliés au régime général, ne peuvent pas en bénéficier.

Madame la secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse, mais j’appelle votre attention sur le fait que le nombre de médecins concernés est très faible. Aussi, la pénibilité de ces professions combinée à la prise en compte des particularités territoriales, telles que la montagne, pourrait sans doute permettre de faire évoluer cette situation.

La parole est à M. Olivier Cigolotti, auteur de la question n° 1516, adressée à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé.

Madame la secrétaire d’État, ma question porte sur la désertification médicale et l’aggravation de la fracture sanitaire.
Les déserts médicaux se sont agrandis, les dépassements d’honoraires n’ont pas régressé et les refus de soins sont en hausse. Aujourd’hui, jusqu’à un tiers des Français ont des difficultés d’accès géographique à trois spécialités – pédiatrie, gynécologie, ophtalmologie – et un quart aux médecins généralistes.
Dès lors que l’on souhaite se soigner au tarif de la sécurité sociale, pour plus de huit Français sur dix, les gynécologues et ophtalmologistes sans dépassements d’honoraires manquent. Pis, l’offre au tarif opposable pour les trois spécialités étudiées s’est réduite depuis 2012 pour plus d’un Français sur deux.
La première cause est géographique. Malgré les mesures incitatives à destination des médecins, la répartition géographique des professionnels de santé s’est dégradée. En quatre ans, 27 % des Français ont vu leur accès aux généralistes reculer.
La seconde cause est liée aux tarifs. Les dépassements d’honoraires ont continué à croître depuis 2012. Le contrat d’accès aux soins, qui a été mis en œuvre en 2013 et qui devait réguler les dépassements d’honoraires, est un échec. Ainsi, en Haute-Loire, si l’on cherche un spécialiste sans dépassement d’honoraires, l’accès aux soins est difficile et la plupart des bassins de proximité sont en situation de désert médical.
Pour mieux répartir les médecins sur le territoire, pourquoi ne pas envisager un numerus clausus pouvant être décliné régionalement ainsi qu’un conventionnement sélectif permettant aux médecins de s’installer prioritairement en zones sous-denses, afin d’injecter dans ces territoires l’offre à tarif opposable qui y fait paradoxalement défaut aujourd’hui ? Ces zones sous-denses doivent être déterminées par les ARS en concertation avec les élus et non par les caisses d’assurance maladie dont le seul objectif doit être la liquidation de prestations.
Le nouveau « contrat responsable » des complémentaires santé visant à mettre fin à la surenchère inflationniste de certains remboursements se révèle lui aussi un échec. En effet, la mutuelle ne peut entrer en action qu’à condition que le médecin ait signé le « contrat d’accès aux soins » ; il a été décidé à tort, semble-t-il, de lier le remboursement complémentaire au choix du médecin.
Aussi, madame la secrétaire d’État, que compte mettre en place le Gouvernement pour offrir un accès aux soins de qualité sur l’ensemble du territoire national ?
Monsieur le sénateur, « les dépassements d’honoraires ont continué à croître depuis 2012 », avez-vous affirmé. Voilà une assertion surprenante, puisque les chiffres de la Caisse nationale d’assurance maladie montrent qu’après vingt ans de hausse ininterrompue le taux de dépassement d’honoraires des médecins de secteur 2 a diminué de plus de deux points entre 2012 et 2016.
Cependant, je vous rejoins lorsque vous valorisez l’exercice à tarif opposable. C’est bien pour cela que Marisol Touraine a insisté dès 2012 pour la maîtrise des dépassements d’honoraires. C’est l’objet de l’avenant 8 à la convention médicale qui crée le contrat d’accès aux soins. La nouvelle convention médicale, conclue au mois d’août dernier, poursuit les efforts de valorisation de la maîtrise des dépassements d’honoraires. À ce titre, le contrat d’accès aux soins a été rebaptisé « option pratique tarifaire maîtrisée ».
Selon vous encore, monsieur le sénateur, aujourd'hui, les dépassements d’honoraires sont trop importants. C’est pourquoi vous proposez un conventionnement qui ne pourrait se faire qu’en secteur 1 dans les zones dites « sur-dotées ». Si cette mesure était appliquée, nous aurions à terme dans ces territoires une minorité de médecins à tarif opposable avec des délais d’attente sans commune mesure avec ce que l’on constate actuellement et des médecins déconventionnés, c’est-à-dire non remboursés par la sécurité sociale, avec des dépassements d’honoraires incontrôlés, donc accessibles rapidement pour qui en aurait les moyens.
Monsieur le sénateur, cette proposition, c’est tout simplement la mise en place d’une médecine du « riche » rapide et d’une médecine du « pauvre » avec des délais de consultations inacceptables. Voilà pourquoi le Gouvernement est opposé à cette proposition de conventionnement sélectif.
À l’inverse, les mesures incitatives à l’installation mises en place depuis 2012 ont d’ores et déjà des résultats visibles. Dans votre département, la Haute-Loire, les mesures du pacte territoire-santé ont permis l’installation de trois praticiens territoriaux de médecine générale, de sept médecins correspondant SAMU qui facilitent l’accès aux soins d’urgence. Désormais, sept maisons de santé et trois pôles de santé maillent le territoire.
Pour résoudre cette problématique d’accès aux soins, ce sont des mesures pragmatiques, diverses, allant de la formation aux conditions d’installation qu’il nous faut utiliser. Le Gouvernement reste pleinement mobilisé et convaincu que c’est dans la durée que nous mesurerons la portée de nos efforts !

M. Olivier Cigolotti. Madame la secrétaire d’État, j’entends bien vos arguments. Certes, des améliorations ont été apportées, mais elles sont nettement insuffisantes, d’autant que, dans le même temps, les collectivités consentent des efforts importants pour réaliser des maisons de santé pluridisciplinaires. Les mesures d’incitation que vous évoquez ont atteint leurs limites. Il va donc falloir envisager des mesures coercitives si l’on veut mailler le territoire de façon plus cohérente.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – Mme Brigitte Micouleau applaudit également.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, auteur de la question n° 1548, adressée à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur la possibilité de rendre obligatoire un stage dans une PME pour les étudiants des grandes écoles.
En 2015, 63 % des salariés étaient employés dans des PME. Cependant, ces entreprises embauchent beaucoup moins de jeunes diplômés que les grandes entreprises, ce qui leur porte préjudice, car de nombreuses études montrent l’importance de ces profils pour leur développement et leur dynamisme. Même pour les PME françaises les plus performantes, les difficultés à recruter des jeunes diplômés sont réelles.
Cette situation constitue une différence majeure avec l’Allemagne, où le niveau moyen d’encadrement des entreprises est bien meilleur que celui des PME et entreprises de taille intermédiaire françaises, notamment parce que les jeunes diplômés s’y orientent naturellement à la sortie de leurs études. Le Royaume-Uni s’est, quant à lui, saisi du problème et a mis en place des programmes particuliers associant grandes universités et PME, permettant ainsi aux étudiants d’effectuer des stages dans ces entreprises.
Il me semble donc opportun de faire découvrir aux futurs grands décideurs ce qui fait notre richesse économique. Trop souvent, les étudiants des grandes écoles intègrent directement des grandes entreprises, publiques ou privées, ce qui ne leur donne pas une image réelle de la diversité économique de notre pays.
Je souhaite donc que s’engage une réflexion afin d’instaurer un stage obligatoire en PME dans le cursus des étudiants de nos grandes écoles françaises.
Nos entrepreneurs sont très demandeurs de la création de ce type d’initiatives en France ; c’est une volonté forte exprimée par les réseaux de petites et moyennes entreprises. En outre, la Banque publique d’investissement, la BPI, a déjà travaillé sur cette question.
La BPI pourrait donc être, notamment par son programme Bpifrance Excellence et les réseaux Business France, un facilitateur des liens entre les étudiants des grandes écoles et les PME.
Monsieur le secrétaire d’État, quelle est votre position sur cette proposition ? Selon vous, de quelle manière pourrait-elle être mise en œuvre ?
Monsieur le sénateur, vous insistez sur l’intérêt que trouveraient à la fois les étudiants et les petites et moyennes entreprises si était mis en place un système de stage obligatoire dans le cadre du parcours de scolarité.
Le constat que vous dressez est absolument juste : les PME françaises auraient intérêt à bénéficier de l’expertise des étudiants des grandes écoles, comme d’ailleurs des étudiants issus de l’université, car il n’y a pas de raison de considérer que seuls les premiers devraient être concernés. On peut imaginer un système applicable au niveau master, voire doctorat. Ces échanges sont trop peu nombreux et il serait bon, à la fois pour les étudiants et pour l’économie, qu’ils se développent.
Vous proposez de rendre ce parcours obligatoire et vous vous appuyez, avec raison, sur des expériences étrangères. En Allemagne, les relations entre les entreprises et le système universitaire relèvent d’une tradition particulièrement forte, dont on voit bien l’intérêt.
Monsieur le sénateur, si je partage votre constat, je ne suis pas sûr d’aller aussi loin, notamment en ce qui concerne le caractère obligatoire de ces stages.
En effet, pour qu’une telle mesure soit efficace, il faudrait que le tissu des PME-PMI françaises soit prêt à jouer le jeu, donc à proposer des offres en nombre permettant l’accueil des étudiants des grandes écoles comme de ceux des universités – pourquoi réserver cela aux seuls étudiants des grandes écoles ? Or telle n’est pas la tradition française. Par ailleurs, le caractère obligatoire de ces stages heurterait l’autonomie des écoles dans l’organisation de leur scolarité.
Reste qu’il s’agit là d’une question importante. Nous avons nous-mêmes essayé de mettre en place des relations beaucoup plus étroites, notamment avec les conventions industrielles de formation par la recherche, les CIFRE, qui permettent à des doctorants de faire, d’une certaine manière en alternance, leur apprentissage. D’autres solutions innovantes restent probablement à trouver.
Monsieur le sénateur, je le répète, je partage le constat, mais suis plus réservé sur la réponse à apporter. Je souhaite cependant poursuivre cet échange pour que nous étudiions ensemble les formes que pourrait prendre une disposition non coercitive qui favoriserait des échanges approfondis entre les étudiants des écoles et des universités et les PME-PMI. Cela peut d’ailleurs faire l’objet d’un rapport, si vous le souhaitez.

Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes d’accord sur le constat ! Voilà qui constitue un élément de satisfaction.
J’entends bien les difficultés auxquelles nous pouvons nous heurter à partir du moment où le dispositif que je propose serait généralisé du jour au lendemain. C’est pourquoi je saisis au bond votre proposition. Il me semble intéressant d’aller vers une expérimentation, qui donnera ensuite lieu à une évaluation, avant une éventuelle généralisation de ce dispositif.
Je suis convaincu, pour en avoir discuté avec les représentants de la CGPME, la Confédération générale du patronat des petites et moyennes entreprises, qui sont d’accord avec cette expérimentation, que nous souffrons du fait que les grands décideurs de demain connaissent moins bien que les autres grands décideurs, par exemple allemands ou britanniques, le tissu des PME-PMI. Nous en pâtissons incontestablement sur le plan économique.
À partir du moment où nous partageons le constat, il faut faire en sorte d’avancer le plus rapidement possible.

La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, auteur de la question n° 1553, adressée à Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Le Gouvernement a inscrit, depuis 2012, dans ses priorités et de façon très concrète, l’accès des personnes en situation de handicap, particulièrement des jeunes, à tous les espaces publics, aux lieux de culture, de loisirs et d’éducation. À l’école, d’importants efforts ont été consentis pour favoriser l’intégration de tous les élèves, quelles que soient leurs différences ou leurs difficultés particulières. Un bon nombre d’enfants en situation de handicap sont maintenant scolarisés avec tous les enfants de leur classe d’âge.
Or le défi que le Gouvernement s’emploie à relever concerne non seulement l’inclusion dans des classes indifférenciées – ce n’est pas qu’une question de nombre –, mais également la réussite de ces élèves en la favorisant. L’environnement matériel et l’accompagnement humain doivent donc être à la hauteur de l’enjeu. Cela a été fait, puisque d’importants efforts ont été accomplis. Je pense au recours amplifié aux outils numériques, aux transports scolaires adaptés, ce qu’ont parfaitement réussis les communes et les départements, au recrutement d’auxiliaires de vie scolaire, les AVS, à leur formation et à la pérennisation de leur emploi.
Parce qu’il s’agit bien d’une activité très spécialisée qui nécessite des connaissances précises, les AVS ne sauraient être, comme cela s’est pratiqué dans les années passées, des personnes en emploi d’insertion sans formation aucune et appelées à n’avoir qu’un passage éphémère en tant qu’accompagnants.
À ce jour, il me semble utile de mesurer le chemin parcouru. Il n’est qu’à citer l’évolution du nombre d’AVS formés, le nombre d’emplois pérennisés, l’écart éventuel entre les besoins exprimés, notamment par décision des maisons départementales des personnes handicapées, et la réalité de la réponse fournie. Il convient également de préciser les mesures envisagées pour mettre demain parfaitement en adéquation l’offre et la demande.
Monsieur le sénateur, vous avez raison de rappeler que la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, qui avait pour objectif de prendre en compte la spécificité de chaque élève et de construire une école inclusive, a permis qu’un certain nombre de dispositions soient prises.
Les agents exerçant des missions d’aide humaine, de soutien et d’accompagnement des élèves en situation de handicap ont une place primordiale dans la scolarité. C’est pour mettre fin à la précarité professionnelle et financière dans laquelle ils se trouvaient que le statut des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, a été concrétisé par le décret du 27 juin 2014.
Ce statut permet de recruter des auxiliaires de vie scolaire en qualité d’AESH en leur offrant des garanties professionnelles sur le long terme. En effet, ils peuvent accéder à un CDI après six années d’ancienneté, y compris celles qui sont effectuées sous le statut d’assistant d’éducation.
La circulaire du 8 juillet 2014 prévoit également que les personnes ayant acquis de l’expérience dans le domaine de l’inclusion scolaire et étant parvenues au terme de leur contrat unique d’insertion, le CUI, peuvent bénéficier d’un recrutement en CDD et de la dispense de diplôme.
Lors de la dernière Conférence nationale du handicap, le Président de la République a annoncé la création de 32 000 postes d’AESH sur cinq ans par transformation de 56 000 emplois de CUI ou CAE, contrat d’accompagnement dans l’emploi. Ainsi, 6 400 équivalents temps plein AESH ont été créés en 2016.
De plus, depuis 2012, 2 900 équivalents temps plein AESH ont été créés, auxquels s’ajoutent 1 351 emplois pour la rentrée scolaire 2017 prévus dans le projet de loi de finances pour 2017.
À terme, ce seront plus de 60 000 emplois d’AESH formés et stabilisés au sein des équipes pédagogiques qui assureront un accompagnement de qualité.
Ces personnels doivent être formés. À cette fin, ils suivent un module de formation obligatoire de soixante heures sur leur temps de travail.
Par ailleurs, les AESH bénéficient d’une rémunération comprise entre le traitement indiciaire correspondant au salaire minimum interprofessionnel de croissance et celui afférant à l’indice brut 400, ainsi que le prévoit l’arrêté du 27 juin 2014.
En tout, ce sont près de 800 millions d’euros qui sont inscrits au projet de loi de finances pour 2017 pour développer une école encore plus inclusive.
Monsieur le sénateur, vous pouvez le constater : nous souhaitons bien pérenniser des emplois essentiels à l’épanouissement de tous les élèves et offrir des perspectives d’évolution à ceux qui les accompagnent.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de la qualité de votre réponse, qui nous permet de mesurer les impressionnants efforts accomplis au cours des dernières années. L’enjeu le mérite : la politique d’intégration nécessite que des moyens particuliers et suffisants soient déployés.
Il convient d’ajouter qu’émergent aujourd’hui de nouveaux handicaps d’ordre cognitif qui, jusqu’à présent, n’étaient pas décelés. Ils concernent notamment des enfants dont l’intelligence peut être supérieure à la moyenne ou est en tout cas suffisamment normale pour leur permettre de suivre des études correctes. Ces enfants souffrent aujourd’hui de « dys » – dyscalculie, dyslexie, dysorthographie. Jusqu’à présent, ils sont peu pris en charge et on demande souvent aux enseignants et aux directeurs d’école de les accompagner pour qu’ils puissent poursuivre une scolarité normale, ce qu’ils sont incapables de faire, n’ayant pas la formation adéquate.
Aussi, monsieur le secrétaire d’État, au-delà même des efforts qui ont été accomplis, il y a toute une catégorie d’enfants qui mériteraient que l’on s’intéresse à eux et qui ne poursuivent pas les études qu’ils pourraient entreprendre. Cela constitue un gaspillage d’intelligence. C’est pourquoi je souhaite que nous puissions réfléchir et travailler ensemble pour améliorer la situation.

La parole est à M. Yannick Vaugrenard, en remplacement de Mme Claudine Lepage, auteur de la question n° 1559, adressée à Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le secrétaire d’État, Mme Lepage, souffrante, m’a demandé de vous poser la question qu’elle avait préparée. Le code de l’éducation indique que les établissements scolaires du second degré permettent la préparation des élèves en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau et la pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention.
Comme vous le savez, ces articles du code de l’éducation sont censés s’appliquer aux établissements scolaires français à l’étranger. Malheureusement, des élèves scolarisés dans le réseau d’enseignement français à l’étranger et qui, au vu de leur talent et de leur situation – ils sont par exemple membres d’un club sportif de haut niveau –, pourraient bénéficier du statut de sportif de haut niveau éprouvent des difficultés à s’inscrire à l’option sport de haut niveau au baccalauréat.
Lors de la discussion du projet de loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, Claudine Lepage a défendu un amendement visant à mettre fin à ces difficultés, qui n’a pas été adopté, mais le secrétaire d’État au sport avait alors indiqué : « Quoi qu’il en soit, votre amendement est satisfait, madame Lepage, par le code de l’éducation. S’il existe un problème, c’est que le club en question n’a pas passé de convention avec le lycée. Lorsque ce club aura conclu une telle convention, l’article du code de l’éducation qui concerne aussi les établissements français situés à l’étranger pourra s’appliquer. »
Plus d’un an après cette déclaration, les difficultés subsistent. Claudine Lepage souhaite donc savoir si, à l’avenir, un dispositif peut être mis en place entre le ministère de l’éducation nationale, les établissements français de l’étranger et les postes diplomatiques afin que la signature de conventions entre les clubs sportifs locaux et les établissements scolaires soit facilitée et, ainsi, que les élèves français à l’étranger puissent bénéficier réellement du statut de sportif de haut niveau.
Monsieur le sénateur, vous remercierez Mme Lepage de cette question très précise qui appelle une réponse de même nature.
Je rappelle le contexte légal, défini par la note de service interministérielle du 30 avril 2014 des ministères des sports et de l’éducation nationale, relative aux avantages d’aménagement de scolarité des élèves sportifs de haut niveau et espoirs. Elle définit le champ des sportifs concernés, précise les aménagements de scolarité et d’examens ainsi que l’organisation et le déroulement des études, et ce pour les élèves de tous les établissements du second degré, qu’ils soient publics ou privés sous contrat, sur le territoire français ou à l’étranger, scolarisés ou non.
Pour permettre à chacun d’atteindre l’excellence, de nombreux dispositifs d’aides aux sportifs de haut niveau ont été mis en place. Pour l’examen au baccalauréat, ces derniers voient leur spécialité valorisée dans l’option facultative EPS, éducation physique et sportive, et sont dispensés de la partie physique de cette épreuve. Ils ont ensuite la possibilité d’effectuer leur premier cycle en trois ans au lieu de deux. Une section sur admission post-bac est d’ailleurs prévue à cet effet.
Ceux qui étudient à l’étranger bénéficient de droit – j’insiste sur ce point – de cet aménagement. Quant à ceux qui pratiqueraient leur discipline dans un club étranger qui ne figure pas sur les listes ministérielles, seule une convention entre la fédération française du sport considéré et le club local pourrait être une solution alternative à la situation actuelle. La convention entre le club sportif local et l’établissement est beaucoup trop longue et trop peu souvent appliquée, cela a été souligné. Cette convention ne suffit donc pas. Si elle était complétée par une convention directe entre la fédération française du sport concerné et le club sportif local, nous pourrions traiter beaucoup plus facilement et plus rapidement ces demandes.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de cette réponse et vous soumets une autre solution, suggérée par Mme Lepage, et plus simple selon elle : il s’agirait de donner une délégation au conseiller de coopération et d’action culturelle ou au proviseur afin qu’il puisse signer de lui-même une convention avec un club sportif local.

La parole est à Mme Agnès Canayer, auteur de la question n° 1537, adressée à Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat.

Ma question porte sur la mise en place d’une filière pérenne de régénération des huiles noires usagées.
La régénération des huiles usagées est le mode le plus abouti en termes d’économie circulaire. Elle assure la préservation des ressources pétrolifères tout en protégeant l’environnement. Malheureusement, en France, ce modèle vertueux de valorisation des déchets par la régénération, par ailleurs fortement encouragé par l’Union européenne, est aujourd’hui remis en cause.
L’arrêté du 28 janvier 1999 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées rendait gratuite la collecte des huiles noires. Il a permis la collecte de 100 % des huiles noires, soit 200 000 tonnes par an. Une filière s’est donc développée. Les deux seules usines françaises de régénération sont aujourd’hui installées en Seine-Maritime.
Or cette gratuité a été remise en cause par l’arrêté du 8 août 2016, qui rend désormais la collecte payante. Les effets ont été immédiats pour les usines Eco Huile et Osilub. Les garages, incités à stocker les huiles de vidange pour réduire les frais de collecte, n’approvisionnent plus suffisamment les deux usines de régénération. La semaine dernière, l’une d’elles a dû cesser le travail pendant une dizaine de jours, faute d’huile à régénérer. L’impact écologique est tout aussi notable.
Aussi, à la suite de la réunion qui s’est tenue le 29 novembre dernier avec l’ensemble des acteurs de la filière, je souhaite interroger le Gouvernement sur trois points, intimement liés.
Tout d’abord, l’arrêté du 8 août dernier impose une réflexion sur le mode de financement de la filière. Dans la réponse à une question écrite de mon collègue Gérard Bailly, vous évoquez la mise en place d’une responsabilité élargie du producteur. Or, lors de la réunion du 29 novembre, vous avez envisagé un crédit de TGAP, la taxe générale sur les activités polluantes, sur les huiles régénérées. Un amendement en ce sens a été déposé dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, mais il a rejeté. Quelle solution sera donc adoptée pour encourager la filière française ? Dans quel délai ?
Ensuite, la filière de régénération bénéficie depuis dix ans d’une subvention de l’ADEME, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Cette subvention doit s’éteindre en février 2017. Or rien n’est prévu pour la remplacer. Dans ce contexte fragile et incertain, ne pensez-vous pas qu’il serait opportun de poursuivre le soutien à la filière ?
Enfin, la législation française relative au traitement des déchets découle essentiellement de la réglementation européenne. Or les industries françaises ont développé un savoir-faire. Comment le Gouvernement entend-il soutenir cette filière ?
Madame la sénatrice, vous interrogez Mme Ségolène Royal, qui connaît mieux que moi le sujet, sur la régénération des huiles usagées. Ne pouvant être présente, elle m’a chargé de vous répondre.
Vous l’avez rappelé, l’arrêté du 8 août 2016 supprime la collecte gratuite des huiles usagées. Cette mesure était fortement attendue par les acteurs de la filière et contribue, au moins à court terme, à lever leurs incertitudes et à rétablir des conditions économiques acceptables. Ainsi les installations de régénération devraient-elles pouvoir prochainement observer une augmentation des volumes d’huiles usagées qui leur sont livrés par les ramasseurs par rapport à leurs niveaux passés.
Par ailleurs, sous l’impulsion de la ministre de l’environnement, les représentants professionnels des ramasseurs d’huiles agréés et des entreprises de régénération ont adopté, le 29 septembre 2016, une charte d’engagements mutuels dans laquelle les acteurs s’engagent à diriger prioritairement les huiles usagées collectées vers la régénération, ce qui est très positif.
Néanmoins, la situation de cette filière reste préoccupante, car la collecte payante n’est pas une solution satisfaisante, certains détenteurs pouvant être tentés de déverser leurs huiles polluantes dans le milieu naturel, malgré les sanctions prévues, plutôt que de payer un collecteur agréé. C’est pourquoi il nous faut continuer de travailler sur des solutions pérennes pour le fonctionnement de la filière des huiles usagées. Les réflexions se poursuivent et plusieurs pistes de solutions ont été identifiées, dont des évolutions de la TGAP, même si c’est compliqué, et la mise en place d’une filière de responsabilité élargie du producteur.

Il est urgent d’intervenir, car l’incertitude concernant les solutions fragilise fortement cette filière, qui se détourne aujourd’hui vers les usines situées en Italie ou en Allemagne, lesquelles sont beaucoup mieux soutenues par leur législation nationale.

La parole est à M. Thierry Foucaud, auteur de la question n° 1575, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

Le poste de police d’Oissel, en Seine-Maritime, qui dépend du commissariat de Saint-Étienne-du-Rouvray et de la zone de sécurité publique Rouen-Elbeuf, devait fonctionner avec un effectif de quatre policiers, ce qui est d’ailleurs peu pour une commune de 13 000 habitants. Or ce bureau connaît depuis quelque temps des dysfonctionnements importants de service dus à une insuffisance d’effectifs chronique.
Ce poste de police a d’ailleurs purement et simplement été fermé en 2015, alors même que l’état d’urgence venait d’être instauré. Aujourd'hui, il est ouvert épisodiquement, au mieux uniquement le mardi et le jeudi matin, ce qui prive les habitants de la commune d’un service de sécurité de proximité.
Alors qu’aucune amélioration de la situation n’a été constatée, le ministre de l’intérieur, devenu depuis lors Premier ministre, s’est rendu le 17 novembre dernier dans la ville d’Elbeuf, où il a souligné à juste titre « le courage des policiers qui sont intervenus à Saint-Étienne-du-Rouvray », propos auxquels je m’associe totalement. Saint-Étienne-du-Rouvray est la commune voisine d’Oissel. Dans ces secteurs, les habitants sont évidemment particulièrement meurtris par le souvenir des terribles événements qui s’y sont produits.
Le ministre de l’intérieur, aujourd’hui Premier ministre, lors de sa visite à Elbeuf, a annoncé l’arrivée de gardiens de la paix et de gradés. Le poste de police de la commune d’Oissel, qui fait partie de ce bassin de vie, se verra-t-il attribuer des effectifs suffisants pour assurer la sécurité des biens et des personnes ? Des délits se sont produits dernièrement dans ce secteur.
Avant toute chose, il convient de rappeler que 9 000 postes ont été créés durant le quinquennat pour augmenter les effectifs de police.
Le 17 novembre dernier à Elbeuf, Bernard Cazeneuve, alors ministre de l’intérieur, a annoncé le renfort de quinze gradés et gardiens de la paix pour la circonscription de sécurité publique de Rouen au printemps prochain. Cet engagement va bien sûr se concrétiser.
Les effectifs de police en Seine-Maritime vont augmenter dans les mois à venir. À la fin du mois de novembre, la police nationale comptait dans le département 2 682 agents. Elle devrait en compter 2 720 à la fin du mois de mai 2017. La seule sécurité publique, dont les policiers, dans les commissariats et sur le terrain, assurent la « police du quotidien » au plus près de la population et des élus, va bénéficier de 39 agents supplémentaires d’ici au printemps prochain, hors renseignement territorial.
J’en viens maintenant à votre question, monsieur le sénateur, concernant le poste d’Oissel.
La ville bénéficie, vous l’avez rappelé, d’un bureau de police, chargé de l’accueil du public et de l’enregistrement des plaintes, ouvert le mardi et le jeudi matin de neuf heures à douze heures, qui compte trois policiers. Je tiens à vous rassurer : ce bureau de police sera bien évidemment maintenu dans le cadre de la prochaine réorganisation des structures de la sécurité publique qui sera mise en place en février prochain. Il sera même renforcé par un agent supplémentaire. Il est vrai que les horaires d’ouverture que vous évoquez peuvent paraître contraints pour les habitants.
Au-delà des seuls effectifs de police dédiés à ce bureau de police, qui vont être renforcés, il va de soi que des effectifs bien plus importants assurent la sécurisation de la ville, qui relève de la circonscription de sécurité publique de Rouen et bénéficie donc de ses effectifs, voire, en cas de besoin, des renforts départementaux. Au quotidien, la sécurité d’Oissel est ainsi assurée, en particulier par une patrouille rattachée au commissariat de secteur de Saint-Étienne-du-Rouvray, qui compte seize policiers et trois adjoints de sécurité, mais aussi par des patrouilles de divers équipages de la circonscription, par exemple ceux de la BAC de Rouen, laquelle compte une cinquantaine de policiers.

Je prends acte de l’augmentation des effectifs en Seine-Maritime – je ne peux que m’en réjouir – ainsi que de l’octroi d’un poste supplémentaire à Oissel. Toutefois, ma question portait sur les horaires et les jours d’ouverture du poste de police. Je n’ai pas obtenu de réponse.
Dans une ville comme Oissel, où les délits sont en augmentation, il est impératif d’assurer un service de proximité. Même si des effectifs peuvent venir d’Elbeuf ou de Saint-Étienne-du-Rouvray, il leur faut du temps pour arriver.
J’aimerais que l’on puisse régler cette question d’une ouverture toute la semaine de ce poste de police. Avec un effectif supplémentaire, je pense que cela doit être possible.

La parole est à M. Jean-Léonce Dupont, auteur de la question n° 1568, transmise à Mme la ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes.

Nous restons en Normandie. Ma question porte en effet sur l’accueil des enfants placés dans le département du Calvados.
Madame la ministre, le nombre d’enfants qui nous est confié aujourd’hui est passé à 2 250, soit 15 % de plus que la moyenne nationale. Le système est totalement saturé. La maison départementale de l’enfance et de la famille, la MDEF, ne peut plus remplir son rôle d’accueil d’urgence. Plus aucune place n’est disponible.
Aujourd’hui, 120 décisions judiciaires de placement n’ont toujours pas été exécutées, avec tous les risques de mise en jeu de la responsabilité pénale que cela implique.
Pourquoi en sommes-nous là ?
Le manque de places en institut médico-éducatif, ou IME, et en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ou ITEP, oblige le département à accueillir, sans plateau technique adapté, des enfants orientés handicap. La fermeture de ces établissements les week-ends et pendant les vacances fait qu’entre 80 et 100 enfants relevant du secteur médico-social sont confiés au département par défaut.
Par ailleurs, la prise en charge des mineurs non accompagnés et des mineurs isolés étrangers est de plus en plus difficile. Au rythme de leur arrivée, il faudra réaliser l’instruction de 500 primo-demandes de mineurs non accompagnés, ou supposés tels, en 2016.
Au-delà du travail considérable d’investigation qui pèse sur la direction de l’enfance et de la famille, ces jeunes, quand ils sont reconnus mineurs – seuls 35 % le sont – et pendant la procédure d’évaluation, sont accueillis à la MDEF et dans les maisons d’enfants à caractère social. Outre leur coût – 6 millions d’euros –, ces prises en charge en constante augmentation paralysent notre dispositif de protection de l’enfance. Il apparaît pourtant évident que cette prise en charge relève de la politique migratoire, qui est de la compétence de l’État, et que les services du conseil départemental du Calvados ne sont pas équipés pour assurer une mission d’évaluation de la minorité. Pour le moins, toute la période de la phase d’investigation et d’évaluation de la minorité devrait être prise en charge par l’État et non pas seulement les cinq premiers jours.
Une batterie de mesures a été mise en place pour faire face à l’asphyxie de notre dispositif de protection de l’enfance, mais le problème reste entier et s’accroît.
Madame la ministre, qu’envisagez-vous de faire pour remédier à cette situation ?
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, j’ai porté la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant, dont la genèse se situe dans cet hémicycle. Elle a en effet été élaborée à partir d’une proposition de loi déposée par Muguette Dini et Michelle Meunier.
Ce texte conforte certains aspects de la loi de 2007, tire le bilan de celles de ses dispositions qui n’ont pas été réellement appliquées et de ce qui s’est passé depuis son entrée en vigueur. Il permet notamment de faire évoluer la philosophie de la protection de l’enfance, de mieux répondre aux préoccupations des départements, dont je mesure très bien la charge financière, indépendamment de la question des mineurs non accompagnés, et de mettre en place un ensemble de dispositifs. J’invite d’ailleurs les conseils départementaux, ainsi que les juges des enfants, dans leurs relations avec l’aide sociale à l’enfance, à avoir recours par exemple au tiers de confiance, qui permet de moins placer les enfants en établissement ou en famille d’accueil et de recourir davantage à l’environnement de l’enfant.
Je les invite également à utiliser les dispositifs mis en place en faveur de la fin de la prise en charge des jeunes majeurs par l’aide sociale à l’enfance. Cette sortie devra être anticipée par les départements un an à l’avance, en concertation avec les préfets pour les jeunes majeurs d’origine étrangère, afin, par exemple, que puisse leur être délivré un titre de séjour leur permettant de travailler. De nouveaux mineurs non accompagnés entrant dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance, il faut également qu’il en sorte. À cet égard, les conventions qui seront signées entre les préfets et les départements, ainsi que la circulaire du 25 janvier 2016, faciliteront la sortie des jeunes du dispositif.
Enfin, la loi comporte un important volet axé sur la mobilisation pluridisciplinaire et pluri-institutionnelle de la protection de l’enfance. Ce texte, élaboré dans la concertation, a permis la création du Conseil national de la protection de l’enfance chargé d’articuler les dispositifs. Ce conseil permet souvent de réaliser des économies d’échelle importantes, sept ou huit professionnels pouvant intervenir successivement auprès d’un enfant ou d’une famille.
J’invite en outre les départements à réaliser à l’échelon départemental le même travail que celui que nous avons effectué à l’échelle nationale, en réunissant autour de la table tous les acteurs de la protection de l’enfance et de l’accompagnement des familles afin de faire évoluer les dispositifs et de rationaliser une partie de leur travail.
J’en viens à la question des mineurs non accompagnés.
La loi du 14 mars 2016 a donné une base légale à la cellule de répartition entre les départements. Aujourd'hui, cette cellule organise la péréquation, et donc la solidarité, entre les départements en ce qui concerne l’accueil des mineurs non accompagnés. Certains départements, il faut dire la vérité, étaient en effet particulièrement visés par les passeurs. Désormais, tous les départements sont appelés à prendre part à la prise en charge de ces mineurs.
Par ailleurs, nous venons de conclure avec l’Assemblée des départements de France un accord prévoyant une évolution de la participation de l’État à la prise en charge des mineurs non accompagnés, comme je l’avais d’ailleurs moi-même souhaité, afin de soutenir les départements dans cette responsabilité nouvelle.
Les mineurs de Calais sont actuellement pris en charge dans des CAOMI, ou centres d’accueil et d’orientation pour mineurs isolés. Une fois que la Grande-Bretagne aura accueilli ceux d’entre eux qu’elle souhaite accueillir, les autres mineurs seront progressivement réorientés vers le dispositif de droit commun.
Voilà comment nous travaillons avec les départements pour faire évoluer la protection de l’enfance et pour mieux répartir la prise en charge des mineurs non accompagnés entre les départements, mais aussi entre l’État et les départements.

Loin de moi l’idée que vous ne travailliez pas ou que vous n’essayiez pas de prendre des mesures, mais je voudrais que vous ayez bien conscience du fait que le système est totalement embolisé.
Aujourd'hui, ce n’est pas de concertation que nous avons besoin. Vous l’avez bien compris, la situation résulte de l’accumulation d’un certain nombre de paramètres : un nombre de décisions de justice très nettement supérieur à la moyenne dans mon département, l’orientation à tort des enfants handicapés vers nos établissements et, enfin, la problématique tout à fait spécifique des mineurs isolés étrangers.
La situation est décourageante, pour ne pas dire désespérante pour les travailleurs sociaux, qui se sentent inefficaces. À peine ont-ils réussi à trouver une solution pour un cas que dix nouveaux se présentent !
Nous ne sommes plus en état de répondre à certaines obligations, alors que la responsabilité pénale d’un certain nombre d’acteurs peut être engagée.
Madame la ministre, je vous demande vraiment d’aller plus loin que dans les dispositifs que vous avez déjà mis en œuvre, notamment pour les mineurs non accompagnés. Il faut assurer la prise en charge des mineurs au-delà des cinq jours qui sont actuellement prévus, soit jusqu’au moment où l’on sait s’ils sont effectivement mineurs ou majeurs.
Permettez-moi de vous citer un seul chiffre : en cinq ans, la dépense de mon département est passée de 1, 5 million d’euros à plus de 6 millions d’euros. Et on m’annonce qu’elle s’élèvera à 7 millions d’euros l’année prochaine ! Il faut que vous ayez conscience de ces chiffres, dans le contexte budgétaire et financier, dont on dit gentiment et de manière élégante qu’il est « contraint », alors qu’il est en réalité extrêmement difficile pour la collectivité départementale ayant en charge la solidarité nationale.

La parole est à Mme Gisèle Jourda, auteur de la question n° 1549, adressée à Mme la ministre de la culture et de la communication.

Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à être intervenus pour défendre les guides-conférenciers, une profession qui lutte au quotidien face à la baisse de l’activité touristique et à une concurrence impitoyable. Ainsi avions-nous saisi l’occasion de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine pour déposer des amendements ayant tous un objectif similaire : garantir aux guides-conférenciers le droit d’être les seuls à exercer leur métier.
Le Gouvernement nous ayant entendus, il a fait adopter un amendement, perfectionné au cours de la navette parlementaire, visant à affirmer dans la loi que les visites guidées dans les musées de France et les monuments historiques ne seraient assurées que par des personnes qualifiées, titulaires d’une carte professionnelle de guide-conférencier. Mieux encore, les opérateurs économiques amenés à commercialiser ce type de prestations devaient avoir recours à des personnes qualifiées, titulaires de la carte professionnelle.
Mais cela, c’était avant la réunion interministérielle au cours de laquelle a été présenté aux syndicats un projet d’arrêté pour janvier 2017 révisant les conditions d’obtention de la carte de guide-conférencier. Alors que nous nous sommes battus pour protéger les guides-conférenciers de la concurrence extérieure, c’est désormais de l’intérieur que vient le péril ! Cet arrêté prévoit en effet l’élargissement de l’attribution de la carte professionnelle à tout titulaire d’un diplôme conférant le grade de master, ayant validé trois unités d’enseignement ou justifiant au minimum d’une expérience professionnelle d’un an cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines.
Quel gâchis ! Quel dommage ! Ce nivellement par le bas provoquera l’affaiblissement, voire la disqualification de cette profession qualifiée.
Ma question est donc la suivante : quelles garanties pouvez-vous apporter aux guides-conférenciers que la volonté affichée par la Direction générale des entreprises d’ouvrir cette profession ne se traduira pas par sa disparition ?
Madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir excuser Audrey Azoulay, ministre de la culture et de la communication, qui, n’ayant pu être présente ce matin, m’a chargée de vous répondre.
Le projet d’arrêté visant à élargir l’accès à la carte de guide-conférencier a provoqué de nombreuses inquiétudes chez les professionnels du secteur lors de sa première présentation au mois de septembre dernier. Il a fait l’objet de différents échanges entre le ministère de la culture et de la communication, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l’économie et des finances et le ministère de l’enseignement supérieur. Le projet d’arrêté a, depuis lors, été substantiellement amélioré.
Le premier projet d’arrêté avait inquiété les professionnels, car il ouvrait l’accès à la carte à l’ensemble des diplômés de licence justifiant d’une expérience professionnelle d’un an cumulé au cours des dix années précédentes dans la médiation orale des patrimoines. Cette ouverture était trop large et comportait un risque pour la qualité des visites proposées.
Le nouveau projet d’arrêté a supprimé cette disposition et a remonté le niveau minimum de qualification pour cette troisième voie d’accès à la carte de guide-conférencier. Celle-ci sera ouverte aux titulaires d’un diplôme conférant le grade de master, et non de licence, et justifiant d’une expérience d’un an cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines. En outre, la notion de « médiation orale des patrimoines » est désormais explicitée, puisqu’elle est définie en référence aux compétences exigées pour les guides-conférenciers en annexe du même arrêté.
Le projet d’arrêté a été présenté aux organisations professionnelles le 7 novembre. Elles ont constaté que le texte avait été amélioré. Afin de répondre aux attentes des professionnels et de s’assurer que les candidats à la carte professionnelle par cette troisième voie seront traités avec équité sur l’ensemble du territoire, une circulaire et des outils de cadrage seront élaborés avec la Direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances. Cette troisième voie sera explicitée et l’expérience professionnelle requise dans la médiation orale des patrimoines sera précisée.
Ce projet d’arrêté garantit donc la qualification des guides-conférenciers, tout en ouvrant une voie à des personnes dotées à la fois d’une solide formation initiale et d’une expérience professionnelle avérée. Il s’inscrit également dans le cadre de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, dont l’article 109 a clarifié le cadre du recours aux guides-conférenciers, garants de la qualité et de l’intelligibilité des visites.
Dans ces conditions, cette nouvelle voie d’accès ne constituera aucunement une menace pour les formations qualifiantes de guide-conférencier existantes. Elle permettra de revivifier les territoires en manque de guides-conférenciers et de diversifier les thèmes de visites dans toute la France.

Je prends acte des évolutions qui ont fait suite aux inquiétudes exprimées par les guides-conférenciers, une profession à laquelle nous tenons.
Néanmoins, cette troisième voie doit être regardée avec vigilance, car, eu égard aux difficultés qui pèsent sur elles, certaines collectivités territoriales qui comptent dans leur patrimoine des monuments historiques importants pourraient être tentées par la facilité. Il ne faudrait pas que cette troisième voie permette une concurrence déloyale. Ces jeunes ont suivi des études d’un haut niveau dans les filières historiques, culturelles ou architecturales et n’ont pour débouché exclusif que les visites guidées. Or, je le répète, ils ne doivent pas être concurrencés par des jeunes dont le bagage scientifique ne serait pas à la hauteur des monuments visités.

La parole est à M. Richard Yung, en remplacement de M. Jean-Yves Leconte – bloqué par Uber –, auteur de la question n° 1560, adressée à M. le ministre de l'intérieur.

J’ai cru comprendre que c’était non pas par Uber, mais par les autocars.

La question de M. Leconte porte sur l’allongement de la durée de validité des cartes nationales d’identité.
Aucune mention n’ayant été portée sur les cartes elles-mêmes, cet allongement pose un véritable problème de reconnaissance de ces titres dans certains États. Ainsi le gouvernement belge a-t-il récemment signifié qu’il ne reconnaissait plus l’allongement de dix à quinze ans – décidé en 2013 et entrée en vigueur le 1er janvier 2014 – du délai de validité des cartes d’identité françaises des personnes majeures.
Prise au titre de la « simplification », cette mesure, qui a établi un décalage entre les validités réelle et faciale d’une carte nationale d’identité, est en réalité une simple mesure d’économie budgétaire. Elle entraîne des difficultés ou des blocages pour de nombreux Français lors du passage à la frontière, de contrôles d’identité, de l’enregistrement dans les hôtels ou auprès des compagnies aériennes, ou lors de démarches administratives dans un pays de l’Union européenne.
Après la décision de la Belgique, les autorités françaises ne peuvent plus prétendre que l’ensemble de nos partenaires reconnaît systématiquement cet allongement. Cette décision n’est pas une surprise et confirme les difficultés que nous connaissons.
La mesure touche l’ensemble des Français ne disposant pas d’un passeport. En outre, le fait que les autorités françaises refusent, sauf en cas de perte ou de vol, le renouvellement d’une carte d’apparence périmée constitue une atteinte à la liberté de circulation au sein de l’Union européenne.
Madame la ministre, pourriez-vous nous indiquer le nombre de cartes nationales d’identité actuellement en circulation non reconnues par des États étrangers, en particulier par les autorités belges ? En effet, ce qui est inscrit sur ces cartes nationales d’identité conduit à les considérer comme périmées.
Par ailleurs, quel est le risque que cette décision conduise d’autres pays à adopter la même position ?
Enfin, une campagne de sensibilisation sera-t-elle menée auprès des Français se rendant en Belgique afin de leur éviter de s’y trouver en situation irrégulière ?
Mme Laurence Rossignol, ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes. Monsieur le sénateur Richard Yung, je vais répondre en lieu et place du ministre de l’intérieur à la question que vous avez posée en lieu et place du sénateur Jean-Yves Leconte.
Sourires.
Le décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d’identité, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a étendu la durée de validité des CNI sécurisées de dix à quinze ans. Cette mesure est applicable aux cartes nationales d’identité sécurisées délivrées à des personnes majeures et en cours de validité au 1er janvier 2014, c’est-à-dire délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013.
Cette mesure a conduit à réduire d’environ 30 % le nombre de renouvellements de cartes nationales d’identité : 7 millions de personnes sont actuellement titulaires d’une CNI prorogée et l’on estime qu’environ la moitié dispose par ailleurs d’un passeport valide.
Les autorités des pays qui acceptent à leurs frontières une CNI sécurisée ont été informées de la nouvelle réglementation.
En outre, l’annexe de l’accord européen du 13 décembre 1957 sur le régime de la circulation des personnes entre les pays membres du Conseil de l’Europe a été modifiée pour prendre en compte les cartes d’identité prorogées. Aucune objection n’ayant été formulée, les pays ayant ratifié cet accord sont donc juridiquement tenus de les accepter. Ces démarches, tant juridiques que diplomatiques, ont permis de réduire de manière significative les incidents signalés.
Toutefois, des difficultés persistent pour les usagers titulaires de cartes nationales d’identité facialement périmées qui souhaitent se rendre dans un pays autorisant la carte nationale d’identité comme titre de voyage. Ainsi en est-il, en effet, de la Belgique ou encore de la Norvège. Ces deux pays ont récemment fait part de manière explicite de leur refus d’accepter les CNI facialement périmées.
Aussi deux séries de mesures complémentaires ont-elles été mises en place.
Tout d’abord, le ministère de l’intérieur travaille étroitement avec le ministère des affaires étrangères pour que la rubrique « conseils aux voyageurs », régulièrement mise à jour, précise, pays par pays, si une carte nationale d’identité dont la date de validité est en apparence dépassée est utilisable pour entrer dans le pays. Les personnes qui souhaitent voyager sont donc invitées à vérifier sur le site du ministère des affaires étrangères les conditions d’entrée et de séjour dans le pays choisi.
Ensuite, les usagers qui souhaitent se rendre dans un pays pour lequel aucun refus formel de la part des autorités n’a été signalé peuvent télécharger un document, traduit en plusieurs langues, attestant de la prolongation de la validité de leur carte nationale d’identité.
En toute hypothèse, ils ont la possibilité de se munir de leur passeport. De manière générale, le site du ministère des affaires étrangères recommande de privilégier l’utilisation d’un passeport valide, qui constitue le titre de voyage de droit commun.
Outre ces mesures visant à mieux informer les personnes appelées à se déplacer à l’étranger, des instructions ont récemment été délivrées aux préfectures pour autoriser le renouvellement des cartes prorogées. Deux conditions ont été posées : l’usager ne doit pas être déjà titulaire d’un passeport valide et il doit justifier de son intention de voyager à l’étranger dans un pays acceptant la carte nationale d’identité comme document de voyage.
Des instructions similaires ont été adressées par le ministère des affaires étrangères aux postes consulaires des pays concernés – pays membres de l’Union européenne essentiellement – pour assouplir les conditions de renouvellement des CNI facialement périmées.
Ces instructions doivent permettre de concilier les effets attendus de la réforme sans créer de contraintes nouvelles pour les usagers désireux de voyager ou séjourner à l’étranger munis de leur seule carte d’identité.

Je vous remercie de ces précisions, madame la ministre. Cela étant, se présenter à une frontière avec le document téléchargé à partir du site du ministère de l’intérieur et qui atteste la prorogation de la carte d’identité ne suffit pas toujours. Le responsable de la police aux frontières peut parfaitement dénier à ce document toute valeur, dire que la carte d’identité est facialement périmée et vous obliger à faire demi-tour. Un certain nombre de personnes se sont ainsi retrouvées dans des situations délicates.
J’ai noté votre propos sur les instructions données aux préfectures. J’espère qu’elles seront suivies d’effet. J’ai moi-même fait l’expérience du contraire, puisque la prorogation de ma carte d’identité – facialement périmée, mais en réalité juridiquement valable – m’a été refusée par la préfecture d’Indre-et-Loire. Heureusement, je possède un passeport, qui me permet de voyager. Mais un certain nombre de personnes qui ne se connectent pas au site dédié aux voyages à l’étranger continuent de rencontrer des problèmes. Cette mesure est donc inadaptée.

M. le président. Pour compléter votre propos, mon cher collègue, je souligne que notre carte d’identité de parlementaire – en ce qui me concerne, je l’ai depuis très longtemps
Sourires.

La parole est à M. Daniel Gremillet, auteur de la question n° 1522, adressée à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du numérique et de l'innovation.

Lors de l’examen en séance publique au Sénat du volet « investissement » du projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’amendement déposé par le groupe Les Républicains visant à permettre, avant la fin de 2017, la résorption des zones grises et blanches sur le territoire national avait été retiré au profit d’un amendement présenté par le Gouvernement.
Lors de cette discussion, le Gouvernement avait expliqué que son premier objectif était de couvrir tous les territoires en 2G d’ici au 31 décembre 2016 et en 3G d’ici à la fin du premier semestre de 2017. Au travers de cet amendement, l’engagement avait été pris, d’une part, de définir les projets de convention qui devaient être finalisés dans les deux mois et, d’autre part, de mettre en place un mécanisme permettant à l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de sanctionner les opérateurs qui ne respecteraient pas leurs engagements.
Lors de la séance de questions d’actualité au Gouvernement qui a suivi ce débat, l’engagement en faveur des zones blanches « imparfaitement mesurées » a été renouvelé, un cofinancement de l’État et des collectivités territoriales et le bénéfice du Fonds national pour la société numérique ayant été annoncés.
Pour remédier à cette situation, le 24 avril 2015, les patrons des quatre grands opérateurs de télécommunications français ont été reçus pour faire le point sur la couverture du territoire en très haut débit. Les présidents d’Orange, du groupe Bouygues, de Bouygues Telecom et de SFR-Numericable se sont entretenus à Bercy pour faire le point sur le plan France très haut débit. Celui-ci vise à une couverture intégrale du territoire d’ici à 2022, 20 milliards d’euros d’investissements répartis entre acteurs privés et collectivités territoriales étant prévus. Or, un an après cette réunion, les acteurs économiques et les citoyens des territoires ruraux sont encore dans l’incertitude et rencontrent au quotidien des difficultés de connexion, de débit, de coûts exorbitants d’accès.
Aussi, dans un contexte de tension sur les finances des collectivités et de rupture numérique dans les territoires, je souhaite connaître la position du Gouvernement s’agissant de l’investissement des collectivités territoriales dans le développement du très haut débit. En effet, dans le contexte actuel de diminution des dotations de l’État, il est inquiétant que revienne encore aux collectivités territoriales la charge d’investir dans le développement du très haut débit. En fait, madame la secrétaire d’État, la solidarité est inversée puisque ce sont les territoires les plus exposés et les plus pauvres qui doivent financer ces investissements.
Je vous remercie d’avoir posé cette question, monsieur le sénateur, qui me permet de faire un point sur l’état d’avancement de la couverture de nos territoires en très haut débit et en mobile.
En 2012, le Président de la République a lancé le plan France très haut débit. Son niveau d’investissement est sans précédent : 3, 3 milliards d'euros proviennent exclusivement de l’État, autant des collectivités locales et plus de 10 milliards d'euros des opérateurs privés. L’investissement global représente environ 20 milliards d'euros. Ce ne sont que des chiffres, me direz-vous ! Certes, mais, à titre de comparaison, sachez que le Royaume-Uni n’investit que 500 millions d'euros. C’est vous dire l’ambition de ce plan qui doit faire de la France le pays le mieux connecté d’Europe à l’horizon de 2021.
Je vous entends dire : « Il y a urgence, c’est là que le bât blesse ! » Je suis consciente de cette urgence, dont me font part de nombreux élus locaux de communes rurales. Nous avons accéléré le plan France très haut débit : l’objectif de 50 % de la couverture d’ici à la fin de 2017 sera atteint à la fin de cette année.
Cela ne va pas assez vite, entends-je également. Nous avons pris toutes les mesures réglementaires, législatives et financières possibles pour accélérer la mise en œuvre de ce plan. La France sera connectée. Le déploiement de la fibre progresse.
Ce plan public finance uniquement le déploiement dans les zones rurales. La France se distingue par le choix qu’elle a fait de couvrir ses zones rurales, les zones urbaines étant laissées à la concurrence entre opérateurs privés.
La couverture mobile, c’est une autre histoire. En effet, rien n’avait été fait jusqu’à notre arrivée en 2012. Tous les efforts portaient sur le fixe. Il a fallu réorienter les politiques publiques.
L’urgence absolue était de supprimer les zones blanches, celles qui, même dans les centres-bourgs, ne sont couvertes par aucun opérateur ni aucun équipement. Cela sera fait d’ici à la fin de l’année prochaine.
Nous avons renouvelé les conventions de mutualisation à signer entre opérateurs. Nous avons donné à l’ARCEP, le régulateur des télécommunications, un pouvoir de sanction si ces conventions ne sont pas signées.
La semaine dernière, j’ai lancé le plan France Mobile, qui intègre enfin la partie mobile dans le plan France très haut débit. Il se fonde sur le principe que les élus locaux, qui sont le mieux à même d’identifier les besoins sur leur territoire, expliqueront aux préfets, aux opérateurs, à l’Agence du numérique et à l’ARCEP quelles sont en priorité les zones qu’il faut couvrir parmi les zones grises.

D’un point de vue économique, les territoires ruraux vivent une situation de rupture numérique et sont en train de décrocher. Les chefs d’entreprises artisanales, commerciales, les dirigeants de PME ou de TPE, par exemple, pour répondre aux appels d’offres doivent utiliser des procédures entièrement dématérialisées. Par conséquent, pour continuer d’exercer leur activité, ils délocalisent.
Le pire exemple a été donné en 2016, lorsque le ministère de l’agriculture a rendu obligatoire la déclaration PAC par internet. Dans le texte qu’il a adressé aux agriculteurs à ce sujet, le ministre les enjoignait, s’ils ne disposaient pas de connexion à internet, à aller voir la Direction départementale des territoires pour faire leur déclaration. Le monde paysan se sent totalement rejeté !
Ce sont des réalités que nous vivons au quotidien dans nos territoires.
Obéissant à la loi du marché et profitant du peu d’exigence de l’État, les opérateurs ont, de façon logique, privilégié les zones denses, rentables, ce que vous venez d’expliquer à l’instant, madame la secrétaire d'État, au détriment des zones intermédiaires, dans lesquelles il n’y a eu que des intentions d’investissement.
Pour pallier ces difficultés, les collectivités investissent. Le département des Vosges, par exemple, s’apprête à investir près de 20 millions d'euros. La grande région accompagne les départements à hauteur de 1 milliard d’euros. Bien sûr, l’ARCEP et l’État vont participer à ce financement, mais ce sont bien les collectivités locales, les contribuables locaux qui, là encore, doivent financer ce désengagement en termes de mutualisation dans nos territoires.
Le numérique raccourcit le temps. Quel jeune couple va s’installer, construire dans une zone où il n’y a pas d’accès au numérique ? Quel jeune entrepreneur, quelle entreprise va investir dans une zone où il n’y a pas de couverture ?
Effectivement, 2022, c’est dans six ans, mais le tissu des territoires les plus reculés peut-il encore attendre ? L’absence de couverture numérique s’apparente à un véritable trou noir pour nos territoires !

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 1554, adressée à M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie.

L’institut des ingénieurs électriciens et électroniciens des États-Unis, l’IEEE, est une association professionnelle puissante, qui joue un rôle majeur dans l’établissement des normes internationales dans le domaine des télécommunications. Cette association a récemment modifié ses règles de fonctionnement dans un sens favorable aux grandes entreprises américaines. On pense en particulier aux GAFA, dont l’objectif est de réduire les royalties – les redevances, en français – que doivent payer ces entreprises aux titulaires de brevets. Ces règles ont été approuvées par le département de la justice des États-Unis.
Même si les règles édictées par cette association, qu’on pourrait rapprocher de l’AFNOR, l’Association française de normalisation, sont dépourvues de valeur législative, elles désavantagent, comme vous pouvez facilement l’imaginer, les petites et moyennes entreprises d’une façon générale et font peser un risque lourd sur les entreprises innovantes françaises en particulier. On pense que le niveau moyen de redevance pourrait passer, dans le cas de figure qui est envisagé, de 15 % à 4 %, soit une baisse de plus de 10 points.
Au mois d’avril dernier, le Gouvernement m’avait indiqué « veiller à prévenir l’introduction de telles règles au sein des organismes de normalisation auprès desquelles la France dispose d’un siège ». Il m’avait également affirmé avoir proposé à la Commission européenne d’introduire des « dispositions permettant de garantir l’effectivité des droits des détenteurs de brevets ». Un Conseil « Industrie » s’est d'ailleurs, semble-t-il, réuni à ce sujet. Enfin, le Gouvernement avait annoncé avoir appelé l’attention de la Commission européenne sur le fait que « ces nouvelles règles pourraient constituer des violations de certains accords de l’Organisation mondiale du commerce ».
Sept mois plus tard, madame la secrétaire d'État, je souhaite savoir le premier bilan que vous tirez de ces initiatives prises pour prévenir la « contagion » des règles américaines et garantir une rémunération équitable de l’innovation.
Je vous remercie, monsieur le sénateur, d’avoir posé cette question. Elle est importante, et vous avez raison de suivre étroitement ce dossier.
Les normes et standards contribuent à structurer le marché et permettent l’interopérabilité entre les produits et les solutions techniques, en définissant des spécifications communes. À l’heure de l’internet des objets, la normalisation et la standardisation seront de plus en plus importantes.
Pour les acteurs privés à l’origine des développements technologiques, la contribution collective à la normalisation améliore le retour sur les investissements consentis, grâce à une diffusion plus large de l’innovation. En contrepartie, afin de prévenir le risque d’abus des droits attachés aux brevets essentiels à la mise en œuvre des normes, les BEN, les organismes de normalisation exigent de leurs détenteurs un engagement à concéder des licences d’exploitation à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Ce principe, dit FRAND pour fair, reasonable and non-discriminatory, propose un équilibre permettant aux contributeurs aux travaux de standardisation de bénéficier d’une fraction juste et raisonnable des profits réalisés en aval par les utilisateurs de la norme. Sa pleine application suppose néanmoins que les détenteurs de BEN puissent exercer réellement leurs droits, en particulier celui de demander une injonction, y compris à titre conservatoire, pour interdire la vente de produits contrefaits. Or les nouvelles règles adoptées par l’IEEE non seulement prévoient un mode de calcul des redevances particulièrement défavorable aux détenteurs de BEN, mais remettent également en cause l’exercice de leur pouvoir d’injonction.
Par leur portée mondiale, ces règles portent préjudice à l’industrie européenne des télécommunications, dont le modèle économique est structuré justement par la normalisation. Elles risquent de pénaliser, en priorité, les petites et moyennes entreprises. Elles vont aussi à l’encontre du projet européen de marché unique numérique, car elles favorisent le développement d’écosystèmes propriétaires, c’est-à-dire fermés, nuisant, à terme, au consommateur, qui est obligé de prendre lui-même en charge le coût des interactions.
Le Gouvernement est totalement conscient de l’importance du sujet. Nous veillons à prévenir l’introduction de telles règles au sein des organismes de normalisation dans lesquels la France dispose d’un siège, notamment l’ETSI, l’European Telecommunications Standards Institute, et l’UIT-T, l’Union internationale des télécommunications.
La position française a été communiquée officiellement à la Commission européenne. Nous proposons l’introduction dans le droit européen de dispositions permettant de garantir l’effectivité des droits des détenteurs de BEN, en particulier à l’occasion de la révision de la directive relative au respect des droits de propriété intellectuelle qui a été annoncée pour l’année prochaine.
La Commission européenne a pris acte des positions exprimées par la France. Elle a rappelé, dans sa stratégie pour le marché unique numérique, l’importance d’une politique de propriété intellectuelle pour les BEN qui soit fondée sur une relation équilibrée. Dans le cadre de sa communication récente sur le passage au numérique des entreprises, elle insiste sur l’importance de ces BEN dans le contexte de l’internet des objets ou de la future norme 5G. Elle a ainsi annoncé le lancement d’une concertation sur le sujet avec toutes les parties prenantes concernées.
L’organisme CEN/CENELEC, l’un des principaux organismes européens de standardisation des technologies électroniques avec l’ETSI, a pris position, en septembre 2016, sur la question des BEN, dans le cadre de la concertation lancée par la Commission européenne. Il s’est déclaré opposé à toute initiative visant à introduire un mode de calcul pour la valorisation ou la fixation de prix pour les licences FRAND et a souligné le risque de telles pratiques.
Je vous remercie une fois encore d’avoir posé cette question, dont je m’entretiendrai avec mes homologues européens et avec la Commission européenne. Je lancerai une mission sur la propriété intellectuelle dans le monde du numérique, qui pourrait inclure ce volet. J’en parlerai au président de l’ARCEP, le gendarme des télécoms français, qui présidera, à compter de l’année prochaine, l’organisme européen qui réunit tous les régulateurs.

Je vous remercie de vos explications, madame la secrétaire d’État. Je me félicite de la position forte que le Gouvernement français entend adopter sur ce dossier.
La dimension européenne est sans doute la bonne, puisqu’elle nous donne le poids suffisant pour résister aux tentatives américaines d’imposer un nouveau modèle qui ne vise, en fait, qu’à favoriser leurs grandes entreprises.
Nous sommes tout à fait prêts à vous suivre sur ce qui nous apparaît comme la bonne voie.

La parole est à M. Daniel Reiner, auteur de la question n° 1520, adressée à M. le ministre de l'économie et des finances.

Initiée dès 2011, annoncée en 2012 par le Premier ministre, qui avait alors lancé une mission de préfiguration, la réforme du code minier semble aujourd’hui « en panne », alors même que chacun s’accorde à dire qu’elle est absolument nécessaire. Ainsi, les élus appellent à une meilleure répartition des redevances minières, les associations de préservation de l’environnement à une mise en conformité avec la charte de l’environnement et les industriels à des procédures simplifiées et plus rapides.
Pourtant, à la suite du rapport de la mission de préfiguration, en décembre 2013, le Gouvernement avait transmis un premier avant-projet de loi à l’ensemble des acteurs, suivi d’un second qui reprenait certaines de leurs propositions. Mais c’était il y a plus d’un an, en juin 2015. Depuis lors, où en est-on ?
Dans l’attente de cette réforme, les projets stagnent et les industriels s’inquiètent. Pour mener à bien un dossier d’extraction, il est nécessaire d’avoir une lisibilité sur plusieurs années, parfois même des dizaines d’années. Cette attente n’est pas non plus un signe positif envoyé aux associations de protection de l’environnement, alors que Paris a accueilli la 21e conférence internationale sur le climat, en décembre 2015. En résumé, on pourrait dire que les industriels doutent, les élus patientent et les associations désespèrent.
Il est bien dommage que le rapport Tuot, qui faisait de nombreuses propositions comme l’établissement d’un schéma national des mines, le groupement momentané d’intérêt, la création d’un haut conseil des mines ou la répartition des redevances minières avec les collectivités territoriales, ne donne lieu à aucune avancée concrète de la part du Gouvernement.
Il est bien dommage également que la mobilisation constructive de l’ensemble des acteurs de la filière minière se heurte à ce qui pourrait s’apparenter à de la mauvaise volonté.
Il serait dommage enfin de donner à penser que les mines sont un vestige du passé glorieux de notre ère industrielle – n’est-ce pas, monsieur Abate ? –, …

… alors même que de nombreux projets d’extraction pourraient voir le jour.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, je souhaiterais connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.
Monsieur le sénateur, mon collègue Christophe Sirugue m’a chargée de vous répondre en son nom.
La réforme du code minier est bien un objectif du Gouvernement. L’actualité particulière dont la France a été victime et l’intense programme législatif l’ont cependant conduit à revoir ses priorités et ne lui ont pas permis de porter au Parlement le projet de loi préparé à la suite des travaux du groupe réuni sous la présidence de Thierry Tuot, dont vous avez fait mention.
Toutefois, pour répondre aux attentes que vous relayez, il a été convenu, en accord avec M. Jean-Paul Chanteguet, président de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, que les principales innovations que comportait le projet de loi soient reprises sous forme de proposition de loi, de façon à ce qu’elles puissent être examinées et débattues avant la fin de la mandature.
Une telle proposition de loi a été déposée le 23 novembre 2016 par plusieurs députés, auxquels se sont associés les membres du groupe socialiste, écologiste et apparentés. Elle reprend notamment le principe d’une évaluation environnementale de type « stratégique » pour les titres miniers, le recours possible à une procédure renforcée d’information et de concertation, la création d’un haut conseil des mines et l’élaboration d’une politique nationale des ressources et des usages miniers.
L’examen de cette proposition de loi est programmé à l’Assemblée nationale, en séance plénière, les 24 et 25 janvier prochain. Ce calendrier devrait permettre sa transmission au Sénat début février, ce qui vous donnera alors la possibilité d’en débattre. Ainsi les importants travaux conduits par le Gouvernement afin de réformer le code minier pourront-ils être poursuivis au-delà de la fin de l’actuelle mandature.

Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire d’État.
Depuis le dépôt de ma question, il est vrai que le dossier a progressé, ce dont je me réjouis. Le groupe de travail créé à l’Assemblée nationale sur l’initiative de Jean-Paul Chanteguet a déposé à la fin du mois de novembre une proposition de loi, qui sera étudiée par la commission du développement durable à la mi-janvier. Vous m’annoncez qu’elle sera inscrite à l’ordre du jour à la fin du même mois. Cette proposition de loi reprend plusieurs propositions intéressantes qui figuraient dans ce rapport.
Je regrette, je le répète, que cette réforme ait été si lente à voir le jour. Alors qu’elle a été initiée en 2011, je crains qu’elle n’aboutisse pas avant la fin de cette mandature, même si j’accepte l’augure que tel pourrait être le cas. Pourtant, il existait un consensus entre les différents acteurs et un énorme travail d’association et de concertation avec l’ensemble des personnes concernées a été réalisé.
Il me semble bien dommage d’associer la société civile à une réflexion aussi longue et de tant tarder à prendre des décisions. Encore une fois, j’accepte toutefois l’augure que nous aboutissions avant la fin de cette mandature.

La parole est à M. Patrick Abate, auteur de la question n° 1536, transmise à M. le ministre de l’économie et des finances.

La France a conclu des accords fiscaux et financiers avec quasiment tous les pays limitrophes qui accueillent des travailleurs français. Cependant, le Luxembourg et la France n’ont toujours pas ratifié d’accord, si ce n’est, il y a près de soixante ans, en 1958. Pourtant, en matière de relations avec les pays frontaliers, le Luxembourg en particulier, les choses ont incontestablement évolué. D’insignifiant en 1958, le nombre de travailleurs frontaliers est passé à 90 000 aujourd’hui. Il pourrait s’élever à 130 000 d’ici à cinq ans selon l’institut de la Grande Région.
Le volet fiscal de notre coopération avec le Luxembourg doit évoluer. Les progrès à effectuer en la matière sont de taille et doivent s’inscrire dans une logique européenne et dans le développement d’un espace transfrontalier, d’une agglomération transfrontalière, que dessinent déjà, côté français, l’établissement public d’aménagement Alzette-Belval, qui s’inscrit dans le cadre d’une opération d’intérêt national, et, côté luxembourgeois, le grand projet Esch-Belval.
Ces développements, pour lesquels nos deux pays ont montré leur intérêt, ne seront pérennes et mutuellement efficaces qu’à la condition d’une plus équitable répartition des charges et des ressources des deux côtés de la frontière, et cela dans une volonté gagnant-gagnant.
Cela passe par la mise en place de mesures de compensation en matière fiscale. Des exemples existent et ont prouvé leur efficacité. Faut-il rappeler l’intérêt de l’accord ratifié entre la France et le canton de Genève signé en 1973, alors même que ce territoire ne se situe pas dans l’Union européenne ? Cet accord se traduit, dans les faits, par le reversement aux départements de l’Ain et de la Savoie de 3, 5 % de la masse salariale des travailleurs frontaliers français.
Cette manne financière non négligeable permet surtout aux communes limitrophes de développer des projets qui bénéficient à tous. Il en est ainsi du développement de l’agglomération mixte du Grand Genève. Il s’agit donc bien d’une démarche gagnant-gagnant. Cela contribue, des deux côtés de la frontière, à un accroissement de l’attrait des territoires concernés.
J’ai interpellé, en avril dernier, M. Harlem Désir, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, par le biais d’un courrier et d’une question écrite, puis M. Christian Eckert, secrétaire d’État chargé du budget et des comptes publics. Je demandais l’inscription à l’ordre du jour de la CIG de cette question. Je n’ai reçu une réponse que le 24 novembre, soit trois jours après le déroulement de cette réunion entre la France et le Luxembourg. La question aurait bien été abordée par M. Harlem Désir, mais en marge de cette réunion du 21 novembre. En tout cas, elle n’a pas été inscrite à l’ordre du jour, le gouvernement luxembourgeois ayant opposé une fin de non-recevoir…
Dans ces conditions, comment le gouvernement français entend-il maintenant faire avancer ce dossier et le présenter comme mutuellement avantageux – je le répète, gagnant-gagnant – à nos amis luxembourgeois, afin de les convaincre de l’intérêt d’entrer dans la discussion ?
La coopération entre la France et le Luxembourg en matière de fiscalité est matérialisée par la convention fiscale de 1958, qui vise à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque. Cette convention ne prévoit effectivement pas de clause spécifique concernant les travailleurs frontaliers, contrairement aux accords que nous avons conclus avec l’Allemagne, la Belgique ou la Suisse. Des compensations financières à la charge de la France sont alors prévues.
Le Luxembourg est le seul pays frontalier avec la France et recevant des flux significatifs de travailleurs frontaliers qui ne soit pas lié à notre pays par un accord bilatéral instaurant un mécanisme de partage des recettes fiscales liées directement à ces flux.
Vous l’aurez compris, monsieur le sénateur, ce n’est pas une mauvaise volonté de la part du gouvernement français. Le Luxembourg n’a en effet mis en place ce type de régime qu’avec un seul de ses voisins. Il n’existe pas de volonté du côté luxembourgeois d’avancer sur la piste d’une renégociation de l’accord fiscal bilatéral qui lie nos deux pays.
Voilà pourquoi, tout en portant régulièrement ce sujet lors des commissions intergouvernementales franco-luxembourgeoises pour le renforcement de la coopération transfrontalière – comme cela a été le cas lors de la dernière CIG –, le gouvernement français développe une approche, que vous avez d’ailleurs décrite, qui doit permettre le cofinancement par le Luxembourg de projets réalisés sur notre territoire. Cette approche a porté ses fruits – peut-être pourriez-vous mettre en avant ces réussites ? –, par exemple avec le financement de la ligne à grande vitesse Grand Est, le contournement de Villerupt, des projets portant sur l’autoroute A 31 bis ou la création de parkings relais – aussi dénommés park and ride – dans les villes frontalières françaises.
C’est cette approche pragmatique de négociation projet par projet avec nos partenaires luxembourgeois qui l’emporte dans les circonstances actuelles.

Pour une bonne part, le Gouvernement cerne les enjeux de la même manière que nous. La problématique étant posée correctement, nous avons une chance d’aboutir à la résolution du problème.
Cependant, pour une autre part, l’enjeu n’est pas nécessairement celui que vous avez mis en avant, madame la secrétaire d’État. Vous avez cité des financements communs pour des projets comme l’A 31 bis, les parkings relais, la ligne à grande vitesse Grand Est ou le contournement de Villerupt. On pourrait ajouter à la liste le rétablissement de postes-frontières destinés non pas à bloquer les voitures, mais à opérer des contrôles sur l’initiative exclusive du gouvernement luxembourgeois. L’enjeu, c’est le fait que les frontaliers, qui sont formés en France, qui y font garder leurs enfants, qui utilisent de manière importante les services publics, créent une richesse au Luxembourg qui ne profite pas, en tout cas pour partie, à notre territoire. Pourtant, entre le Luxembourg et la Belgique, cela ne pose pas de problème, y compris en termes de compétitivité pour les travailleurs belges.
Pour convaincre nos amis luxembourgeois, il faut leur dire que, sans cette équité, les grands projets transfrontaliers ne seront pas pérennes. Proposons qu’un organisme indépendant – par exemple, la Caisse des dépôts et consignations, qui sait porter des projets de nature européenne – récupère cette manne financière et garantisse le financement de projets mutuels. En effet, ne confortons pas l’idée que nos amis luxembourgeois peuvent avoir qu’ils donnent déjà pas mal – ce qui est vrai : ils participent au financement d’infrastructures – et que nous ne serions que des pique-assiettes.
Nous devons donc imaginer une procédure permettant que les fonds, équitablement répartis, servent une démarche qui soit gagnant-gagnant, par exemple dans le cadre d’une grande agglomération transfrontalière, comme ce qui se fait pour le Grand Genève. Ces pistes de travail ne sont pas assez mises en avant. Nous avons trop tendance à nous contenter de ce que répondent les Luxembourgeois, à savoir qu’ils participent aux infrastructures. Or la France aussi participe aux infrastructures !
J’espère que le Gouvernement prendra en compte rapidement ce type de démarche gagnant-gagnant. Les habitants de mon département le ressentent comme une urgence.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils, auteur de la question n° 1547, adressée à M. le ministre de l’économie et des finances.

En Indre-et-Loire, la liste des bureaux de poste de plein exercice qui disparaissent les uns après les autres est longue. Dans nos villages, il n’en reste plus guère. Aujourd’hui, les villes ne sont plus épargnées : c’est le cas dans quatre quartiers de Tours. Le conseil municipal a voté hier soir, à l’unanimité, un vœu contre ces suppressions.
Les 17 000 points de contact, ce n’est plus La Poste, puisque seuls 9 000 sont en gestion propre. Les employés sont de moins en moins des postiers, car on recourt de plus en plus aux personnes qui travaillent dans les maisons de service au public. Finalement, les fonctionnaires ne représentent plus que 45 % des effectifs.
Les usagers n’acceptent pas ces choix. La mobilisation contre les fermetures est forte. Devant le Sénat, le 8 décembre dernier, plusieurs centaines de manifestants sont venus dire non seulement leur colère, mais aussi leurs propositions. De tels désaccords sont exprimés dans toute la France, comme hier à Tours, à Montlouis ou à Vouvray.
Quant aux salariés, ils sont excédés : 21 000 emplois ont disparu en trois ans, pendant que La Poste recevait près de 1 milliard d’euros de crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi !
Une expertise conduite pour le CHSCT du groupe dénonce publiquement « une situation préoccupante du fait de la rapide dégradation de l’état de santé des agents ».
Le conseil d’administration de La Poste a été informé, jeudi dernier, de deux suicides survenus la veille, mais, selon une source interne à l’entreprise, on atteindrait cinquante suicides cette année. Cela nous rappelle la situation – bien triste – de France Télécom dans les années 2008-2009. Le Gouvernement en a-t-il été informé ? Que compte-t-il faire ? Combien de suicides faudra-t-il encore pour que soit prise réellement en considération la vie des postiers ? J’aimerais une réponse claire à ces questions, alors que les salariés n’en ont encore eu aucune !
Les maires et de nombreux élus sont très inquiets, car beaucoup de territoires deviennent des déserts, sans services publics. Le fonds de péréquation de La Poste va être augmenté de 4 millions d’euros par an, mais pour quoi faire ? Pour moderniser et développer des bureaux de poste ? Il ne semble pas que ce soit la démarche engagée, puisqu’il va servir, à hauteur de 35 %, à fermer des bureaux ou à les transférer à des commerces.
Bien sûr, La Poste doit s’adapter, elle doit se moderniser, mais pas en aggravant les conditions de vie des habitants et les conditions de travail de ses salariés. Pour bien répondre à l’intérêt général en améliorant l’activité sur nos territoires, le service public est un véritable choix de société. C’est pourquoi je demande au Gouvernement d’intervenir pour que cesse enfin cette organisation de la dégradation de La Poste.
Madame la sénatrice, M. Christophe Sirugue m’a chargée de vous répondre en son nom, sans savoir que vous évoqueriez un tableau humain si sombre. C’est pourquoi ma réponse sera certainement sèche et technocratique, mais je crois que Christophe Sirugue souhaitera s’entretenir avec vous plus directement pour évoquer ce grave sujet.
Le Gouvernement est attentif au bon accomplissement par La Poste de sa contribution essentielle à la mission d’aménagement du territoire. Aussi, dans le cadre de la préparation du nouveau contrat de présence postale, l’État s’est-il attaché à favoriser des solutions équilibrées pour assurer le maillage territorial le plus dense possible et le plus adapté aux besoins des populations et des territoires. Il l’a fait en prenant en considération la réalité d’aujourd’hui : une concurrence très forte de la part d’autres acteurs économiques, une baisse drastique du volume du courrier – longtemps le cœur de métier de La Poste – et de la fréquentation des guichets, qui a par exemple diminué de 6 % en 2015. Le numérique a naturellement joué un rôle, mais il faut aussi prendre acte du changement des habitudes de consommation de nos concitoyens. Il l’a également fait avec un souci permanent de concertation et de dialogue entre les différents partenaires.
S’inscrivant dans la continuité des trois précédents contrats, le projet en préparation continue à donner la priorité aux actions en faveur des points de contact considérés comme les plus fragiles. Il vise aussi à faciliter la transformation du réseau pour mieux l’adapter aux habitudes de vie et aux attentes des habitants.
En matière de financement, l’État a décidé de consentir un effort accru en faveur de la présence postale dans les territoires. Le Gouvernement a ainsi décidé une augmentation du montant du Fonds postal national de péréquation territoriale de 12 millions d’euros pour pérenniser la participation de l’État au financement des maisons de service au public en bureaux de poste. Ce fonds sera donc abondé à hauteur de 174 millions d’euros par an, soit 522 millions d’euros sur les trois ans du nouveau contrat, contre 510 millions d’euros alloués dans le précédent.
Sur le plan local, les évolutions des points de contact de La Poste dans les départements sont examinées en prenant en compte l’avis de la commission départementale de présence postale territoriale et après un diagnostic partagé avec les municipalités concernées.
Dans le département de l’Indre-et-Loire, La Poste a maintenu un maillage dense de 220 points de contact, dont 97 bureaux de poste, 86 agences postales et 37 relais poste chez des commerçants, pour une population de 600 000 habitants, ce qui permet à 98, 9 % de la population du département de se trouver à moins de cinq kilomètres et moins de vingt minutes d’un point de contact. Au quotidien, si l’on voit que le bureau de poste s’éloigne, ces chiffres peuvent éventuellement choquer, mais, lorsqu’on regarde les choix opérés dans d’autres pays européens, on réalise que, sur le territoire français, cette densité du maillage territorial demeure importante.
En ce qui concerne la mission de service universel du courrier, La Poste continue à assurer une qualité de service de haut niveau, reconnue par nos concitoyens. L’entreprise a ainsi atteint, en 2015, quatorze des quinze objectifs de qualité qui lui ont été fixés par l’État et qui sont suivis et contrôlés par le gendarme du secteur, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Un comité de suivi de haut niveau du contrat d’entreprise entre l’État et La Poste a eu lieu le 30 novembre dernier. Christophe Sirugue y a rappelé aux participants l’importance que l’État attache à la poursuite d’un dialogue social de qualité dans l’entreprise ; il a aussi salué la décision de La Poste d’ouvrir des négociations sur les métiers et les conditions de travail des facteurs.

Comme je l’ai récemment dit au président de La Poste, si la qualité du service de distribution du courrier se dégrade, c’est évidemment en raison de l’allongement du temps de parcours des postiers, qui vise à répondre au manque d’effectifs.
On nous dit que le volume de courrier diminue. On nous dit aussi que la fréquentation des guichets est en baisse, mais sans préciser que cette baisse est aussi provoquée par la multiplication du nombre d’automates.
On doit donc raisonner non pas activité par activité, mais globalement.
Quoi qu’il en soit, les habitants sont très mobilisés, en particulier dans les secteurs les plus modestes et en zone rurale, où il n’existe plus d’autre activité qui puisse répondre aux besoins de la population.
Enfin, j’insiste sur la dégradation de l’état de santé des personnels, qui me soucie fortement. J’ai fait le parallèle avec France Télécom, car je veux lancer une alerte. Si le nombre des cinquante suicides est atteint en 2016 – c’est une situation que nous avons précédemment connue –, il est important que l’État, qui assure tout de même la tutelle du grand service public qu’est La Poste, soit très attentif à ce qui est en train de se passer.

La parole est à M. René Danesi, auteur de la question n° 1502, adressée à M. le ministre de l’intérieur.

Ma question est très technique.
L’article 27 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, ou loi Macron, a modifié l’article L. 221-2 du code de la route. Cette modification permet aux personnes titulaires d’un permis B de conduire « tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés ».
Cette modification, au demeurant issue d’un amendement sénatorial, avait pour but de simplifier la vie des personnes qui peuvent avoir occasionnellement besoin de conduire un engin de type tracteur. À première vue, ce texte paraît couler de source et ne pas poser de problème d’interprétation. Malheureusement, tel n’est pas le cas quand il s’agit de la conduite par les agents communaux de tracteurs appartenant aux communes. En effet, le texte vise expressément les véhicules et appareils agricoles ou forestiers, avec une extension aux véhicules « assimilés ».
Est-ce que ces véhicules « assimilés » doivent être attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou encore à une coopérative d’utilisation de matériel agricole ? C’est l’interprétation restrictive qui est faite par l’Association des maires de France. En conséquence, elle déconseille à un employé communal conduisant un tracteur appartenant à la commune d’être titulaire du seul permis B et de ne pas détenir un permis correspondant à la catégorie du véhicule.
La question est d’importance, puisque nombre de collectivités locales possèdent des tracteurs qu’elles sont fréquemment amenées à utiliser, par exemple pour le déblaiement ou le déneigement. Celles-ci ont donc besoin de savoir de manière claire si les véhicules « assimilés » comprennent les tracteurs leur appartenant et si elles peuvent les faire conduire par leurs employés municipaux uniquement détenteurs du permis B.
J’ai interrogé le Gouvernement sur ce sujet technique par voie de question écrite le 3 décembre 2015. Cette question a été vainement rappelée le 28 avril 2016. N’ayant obtenu aucune réponse, je suis contraint de poser oralement la question, car je souhaiterais être enfin éclairé. Je préférerais évidemment avoir une réponse claire. Les agents communaux sont-ils oui ou non concernés par la nouvelle rédaction du code de la route et peuvent-ils, en conséquence, se satisfaire d’un permis B lorsqu’ils conduisent un tracteur ou un véhicule assimilé ?
En cas de réponse négative ou évasive, voire alambiquée, comme les services juridiques ont parfois l’art de le faire, il faudrait en conclure à la nécessité de légiférer de nouveau.
À votre question technique, monsieur le sénateur, je ferai une réponse qui le sera tout autant, au nom de Bruno Le Roux, ministre de l’intérieur. J’espère qu’elle sera non pas alambiquée, mais juridiquement précise.
Les réglementations française et européenne en matière de conduite de véhicules prévoient que, selon la catégorie de véhicule qu’il conduit, le conducteur soit en possession du permis de conduire adéquat. La catégorie du permis de conduire est définie à l’article R. 221-4 du code de la route. Conformément à ce texte, la catégorie de permis de conduire exigée pour la conduite d’un tracteur, à savoir les permis B, BE, C ou CE, est définie en fonction du poids total autorisé en charge du véhicule, auquel s’ajoute celui de sa remorque éventuelle.
De plus, l’article L. 221-2 du code de la route autorise les conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole à conduire ces véhicules ou appareils pendant la durée de leur activité, agricole ou forestière, sans être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, dès lors qu’ils sont âgés d’au moins seize ans.
Récemment, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, que vous avez mentionnée, a modifié l’article L. 221-2. Dorénavant, les personnes titulaires du permis de conduire de la catégorie B sont autorisées à conduire tous les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure, ainsi que les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Cette mesure a remplacé les dispositions antérieures. La nouvelle rédaction ne modifie pas les catégories d’engins visés par l’article L. 221-2, à savoir les véhicules et appareils agricoles ou forestiers dont la vitesse n’excède pas 40 kilomètres par heure et les véhicules qui peuvent y être assimilés.
Ces véhicules et appareils agricoles ou forestiers sont définis au point 5 de l’article R. 311-1 du code de la route ; il s’agit des véhicules de catégories T – tracteurs agricoles à roues –, C – tracteurs agricoles à chenilles –, R – remorques ou semi-remorques – et S – machines ou instruments agricoles remorqués –, à l’exclusion des sous-catégories dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 kilomètres par heure.
Seul un conducteur « attaché à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d’utilisation de matériel agricole » est autorisé à conduire ces véhicules sans permis de conduire à partir de seize ans. Les autres conducteurs doivent obligatoirement avoir un permis de conduire de catégorie B, y compris s’ils travaillent pour une collectivité.
Ainsi, la nouvelle rédaction de l’article L. 221-2 du code de la route n’apporte pas de restriction à la précédente, s’agissant des autorisations des agents communaux à conduire des tracteurs agricoles. Il n’est donc pas besoin de légiférer de nouveau.

La parole est à M. Jean-François Longeot, auteur de la question n° 1511, adressée à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Je souhaite appeler l’attention de M. Baylet sur les conséquences de la loi NOTRe ainsi que de la loi de finances rectificative pour 2015, qui a réformé le régime des zones de revitalisation rurale. En effet, ces deux lois vont affecter les communes de petite taille situées en secteur rural concernées par le dernier classement en ZRR, soit plus de 40 % des communes dans lesquelles vivent 6 millions de Français.
Par la modification des modalités de classement des communes en ZRR, ces lois vont avoir pour conséquence de faire perdre à certaines communes leur classement, alors que leurs caractéristiques n’auront pas changé. Désormais, le niveau de l’intercommunalité sera pris en compte pour l’attribution du classement, sans distinction entre les communes la composant.
La perte du classement en ZRR risque, pour certaines communes, d’avoir un impact négatif sur leur niveau d’activité ainsi que sur leur attractivité économique, ouvrant la porte à une fracture économique et sociale accentuée entre espaces urbains et espaces ruraux, que le dispositif des ZRR tentait justement de réduire. En effet, les ZRR ont été créées pour soutenir le développement économique des territoires ruraux en compensant, par des exonérations, les obstacles logistiques tels que l’éloignement ou l’accès difficile à de nombreux services.
Par conséquent, je souhaiterais savoir si, dans un contexte de baisse sans précédent des dotations aux collectivités, le Gouvernement compte prendre des mesures pour permettre de maintenir l’activité économique de ces territoires et ne pas les laisser face à une désertification de leur tissu économique, désormais inévitable.
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence du ministre Jean-Michel Baylet, actuellement en déplacement en Corse.
Le dispositif des zones de revitalisation rurale a été créé, vous l’avez rappelé, dans l’objectif de compenser les difficultés particulières que rencontrent certains espaces ruraux en matière d’attractivité démographique et économique.
La réforme des ZRR, qui a été votée en décembre 2015, fait suite au rapport d’information des députés Alain Calmette et Jean-Pierre Vigier. Elle reprend très largement leurs préconisations, notamment en ce qui concerne les critères devant être pris en compte : la densité démographique et le revenu par habitant. Ces critères permettront de cibler les territoires qui sont à la fois les plus ruraux et les plus en difficulté d’un point de vue social et économique.
Le Gouvernement a également veillé à ce que les futurs critères permettent de maintenir globalement le nombre de communes classées en ZRR, soit environ 14 000 communes, même s’il y aura évidemment des variations importantes à l’intérieur de ce classement.
La nouvelle carte intercommunale est désormais connue. Jean-Michel Baylet a d’ores et déjà demandé à ses services de faire preuve de la plus grande diligence afin que le nouveau classement puisse être connu dans les meilleurs délais, au début d’année prochaine.
Concernant l’impact d’une sortie du dispositif des ZRR pour une commune, je rappelle que l’ensemble des exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises et associations sont maintenues jusqu’à leur terme. Par exemple, l’exonération de l’impôt sur les sociétés pourra aller jusqu’au 31 juillet 2025, terme des huit années d’exonération prévues.
En outre, ces communes bénéficient de l’action conduite par le Gouvernement en faveur des territoires ruraux. Je citerai la tenue de trois comités interministériels aux ruralités avec 104 mesures engagées ; je pourrais aussi parler de l’action réalisée pour le maintien des 1 565 petites stations de carburant qui bénéficie de 12, 6 millions d’euros de crédits spécifiques ou de l’action en faveur des services publics, avec la mise en place de 1 000 maisons de services au public.
Par ailleurs, des aides de l’État, comme l’aide à la réindustrialisation ou la prime d’aménagement du territoire, la PAT, favorisent la création d’emplois dans les zones les plus fragiles. En 2016, la PAT a ainsi permis de soutenir 29 projets pour accompagner la création ou le maintien de près de 2 000 emplois.
Enfin, le projet de loi de finances pour 2017, avec l’augmentation de la DETR, la dotation d’équipement des territoires ruraux, qui atteindra, pour la première fois, 1 milliard d’euros, ou le Fonds de soutien à l’investissement local, dont 216 millions d’euros sont réservés aux contrats de ruralité, permettra également de dynamiser les territoires ruraux.

Je remercie Mme la secrétaire d’État de sa réponse. J’ai bien noté que la DETR augmentait ; c’est effectivement important pour les territoires ruraux.
Je savais que l’exonération en faveur des entreprises installées allait se poursuivre et ma question portait surtout sur le cas des entreprises qui voudraient s’installer aujourd’hui : c’est pour elles que se pose le problème.
En fait, il me semble contre-productif de modifier trop souvent l’ensemble des lois qui concernent les collectivités locales, rurales notamment. En effet, les acteurs locaux fondent leurs projets sur un cadre légal existant et, quand ils commencent à les réaliser, celui-ci n’est déjà plus valable.
La modification du classement en ZRR, de même que la réforme de la carte des cantons, va donc faire perdre leur statut à certaines communes rurales. Par exemple, les anciens chefs-lieux de canton vont perdre le bénéfice d’une part spécifique de leur dotation globale de fonctionnement.

La parole est à M. Daniel Laurent, auteur de la question n° 1499, adressée à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales.

Ma question porte sur le financement des groupements d’associations syndicales de propriétaires par les collectivités territoriales. Elle est d’importance en Charente-Maritime, qui compte plus de 100 000 hectares de marais.
L’Union des marais de la Charente-Maritime est un syndicat mixte ouvert qui fédère plus de 250 adhérents, apporte conseils et assistance autour des questions de l’eau et de la protection contre les inondations. La mutualisation permet à cette structure d’œuvrer dans un esprit de service public, notamment lors d’événements catastrophiques, comme les tempêtes Martin ou Xynthia.
En pratique, les associations syndicales ont la responsabilité de la gestion hydraulique et de l’entretien des réseaux hydrauliques à l’intérieur de leur périmètre syndical. Ainsi, les services apportés par le syndicat aux territoires ruraux, dans un cadre de solidarité territoriale, ne peuvent être mis en défaut, compte tenu de la fragilité de ces territoires.
Les interventions d’entretien ou d’aménagement nécessitent d’importants moyens et revêtent un intérêt collectif, au vu des enjeux, des conséquences environnementales et socio-économiques pour les milieux, les usagers des territoires et les populations.
La loi MAPTAM rend obligatoire le transfert au « bloc » communal, à compter du 1er janvier 2018, des compétences concernant la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, ou GEMAPI.
Les missions des associations syndicales de propriétaires, sur leur périmètre et dans le cadre de leurs statuts, ont été préservées à l’article 59 de la loi du 27 janvier 2014.
De même, dans le cadre de la loi NOTRe, une disposition a été introduite, à l’article 94, en faveur des associations syndicales de propriétaires pour leur permettre de bénéficier de financements de la part des départements pour l’entretien et l’aménagement de l’espace rural.
Cependant, il conviendrait de préciser que ces mesures s’appliquent plus largement aux besoins d’investissements et de fonctionnement des associations syndicales et d’offrir la possibilité aux groupements des associations syndicales de continuer à bénéficier d’une possibilité d’accompagnement financier des collectivités territoriales, pour leurs actions menées au bénéfice des territoires et de leurs adhérents.
Ainsi, pour des raisons de solidarité territoriale, les départements et les régions doivent pouvoir contribuer au financement du fonctionnement et de l’investissement des associations syndicales de propriétaires régies par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et des unions, syndicats mixtes ou fédérations dont elles sont membres.
Madame la secrétaire d’État, quelles précisions pouvez-vous m’apporter sur la question du financement des groupements d’associations syndicales de propriétaires par les collectivités territoriales ?
Comme vous le savez, monsieur le sénateur, la loi NOTRe a clarifié la répartition des compétences entre collectivités en supprimant la clause de compétence générale des régions et des départements.
Certaines compétences, par nature transversales, restent cependant partagées. Il en est ainsi dans le domaine de l’eau, où l’article L. 211-7 du code de l’environnement permet de maintenir une intervention des différents échelons de collectivités. Ces dernières peuvent donc aujourd’hui contribuer au financement des associations syndicales de propriétaires œuvrant dans ce domaine.
En revanche, à partir du 1er janvier 2018, cette faculté sera réservée aux seules communes et établissements publics de coopération intercommunale, qui auront la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Régions et départements pourront tout de même continuer à soutenir financièrement les actions des associations syndicales de propriétaires dans le domaine de l’eau, à l’exclusion toutefois de celles portant exclusivement sur le champ de la compétence GEMAPI précitée.
Vous avez également rappelé que la loi NOTRe permet aux départements, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, de contribuer au financement des opérations en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. Cependant, le législateur a entendu réserver ce soutien aux seules opérations d’investissement. Il n’apparaît donc pas souhaitable d’étendre cette faculté aux dépenses de fonctionnement, car il convient de préserver l’équilibre et l’esprit de la réforme territoriale, qui a voulu clarifier les interventions des collectivités territoriales.
Le soutien que peuvent apporter les collectivités aux associations syndicales de propriétaires est désormais mieux encadré : il doit s’inscrire dans les limites des compétences de chaque catégorie de collectivité territoriale et respecter les règles relatives aux aides aux entreprises, telles qu’elles ont été voulues par le législateur. Il s’agit là d’un gage d’efficacité de l’action publique. Je vous rappelle, en outre, que la loi NOTRe a été votée par les deux chambres.

Madame la secrétaire d’État, vous avez compris l’importance de ces syndicats pour les collectivités situées en zone humide ou comportant de nombreux marais.
Vous m’avez répondu que les aides des collectivités locales étaient possibles uniquement pour financer des investissements. Or, dans le cas particulier que j’ai évoqué, le fonctionnement absorbe une grosse part des financements. En effet, l’investissement consiste à créer des fossés ou des ouvrages nouveaux, le fonctionnement correspondant à l’entretien. Si l’entretien n’est pas assuré par ces syndicats de marais, qui l’assumera ? Il risque donc d’être abandonné, ce qui emporte de graves conséquences pour l’environnement.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Gérard Larcher.