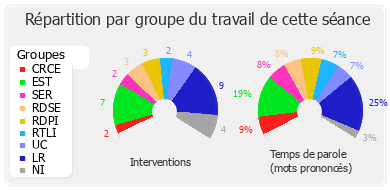Séance en hémicycle du 10 décembre 2020 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2021 n’est pas parvenue à l’adoption d’un texte commun.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, la discussion de la proposition de loi visant à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan, présentée par Mme Sophie Taillé-Polian (proposition n° 714 [2019-2020], résultat des travaux de la commission n° 171, rapport n° 170).
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, auteure de la proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant la crise sanitaire, l’article L. 642-3 du code de commerce était clair : dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ni le débiteur, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure n’étaient admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre de reprise, partielle ou totale, de l’entreprise placée en liquidation judiciaire.
Ça, c’était avant. Avant que le Gouvernement ne décide de déroger à ce principe – déjà assoupli, au demeurant, par la possibilité d’une reprise à la requête du ministère public, quand l’intérêt général le commandait –, pour garantir le maintien de l’emploi.
Ainsi, l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai dernier, prise sur le fondement du d du 1° du I de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit qu’une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise en liquidation judiciaire peut, jusqu’au 31 décembre de cette année, être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Cette disposition prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a rapidement été intégrée par un certain nombre d’entreprises : les exemples n’ont pas tardé à venir illustrer la dérive que l’on pouvait craindre, sous la forme de certains effets d’aubaine, lesquels suscitent des interrogations.
La présente proposition de loi est née du constat de ces dérives, qui se sont manifestées très rapidement, dès le début de l’été. Elle est née de l’indignation suscitée par ces situations, dont ont fait état bon nombre de journaux, mais aussi d’une seconde indignation, de forme. De fait, il nous est nécessaire, pour proposer l’abrogation de cette disposition, d’en proposer d’abord la ratification… N’est-il pas baroque de constater à quel point notre procédure parlementaire est mise à mal par l’inflation et la banalisation des ordonnances, et plus encore par l’absence de ratifications ?
Certes, le Parlement a joué son rôle. Alors que le nombre d’ordonnances prévu en mars dernier par le Gouvernement lors de l’instauration de l’état d’urgence sanitaire était de trente-trois, il l’a ramené à vingt-cinq. Toujours est-il que, dans le cadre de cette crise sanitaire et bien au-delà, au cours de cette législature comme des précédentes, on observe une inflation des ordonnances – sans compter les habilitations furtives demandées par voie d’amendement…
Ce procédé est source d’insécurité juridique et nuit à la qualité de la réglementation. Il met le Parlement – il faut le dire – à l’index !
Dans la situation actuelle, mes chers collègues, nous devons nous interroger très fortement sur le rôle du Parlement et sur les moyens d’action et de procédure. Car l’exception tend à devenir la règle, sans même que la procédure soit respectée jusqu’au bout, puisque, bien souvent, le projet de loi de ratification, s’il est déposé, n’est pas débattu. Le même phénomène s’observe d’ailleurs avec la procédure d’urgence : d’exceptionnelle, elle est devenue la règle puisqu’elle est appliquée dans 90 % des cas – pour ne pas dire plus.
C’est là une préoccupation majeure, partagée, je crois, par l’ensemble du Sénat. À cet égard, je salue la création par le président Larcher d’un comité de réforme et d’adaptation des procédures sénatoriales, dont l’un des objets sera le suivi des ordonnances.
En l’occurrence, une ratification aurait permis de procéder à une première évaluation de la mesure prise et de constater si, oui ou non, elle produit des effets bénéfiques.
Sur le fond, quels résultats cette disposition a-t-elle produits ? En septembre, au moment du dépôt de cette proposition de loi, les cas d’application dont la presse se faisait l’écho se sont multipliés.
L’assouplissement permet aux propriétaires ou anciens propriétaires d’une entreprise placée en liquidation ou en redressement judiciaire de présenter une offre de reprise. De fait, il entraîne des effets d’aubaine, du moins une grande incompréhension sociale, quand il permet à un gestionnaire qui n’a pas fait preuve des meilleures qualités de gestion de s’en tirer à bon compte.
Effet d’aubaine, oui, pour un certain nombre de grands groupes. On pourrait même parler de grandes familles : sixième fortune de France, la famille Mulliez a eu recours immédiatement à cette ordonnance pour deux de ses entreprises, Phildar et Alinéa.
Effet d’aubaine, oui, pour ces grandes entreprises toujours si bien conseillées, toujours à la pointe de la connaissance des avancées juridiques et des assouplissements bénéficiant aux entreprises. Pendant ce temps, les petites entreprises ont-elles la même capacité à accéder à cette information ?
Il est étonnant de constater que, dans certains cas où cet assouplissement a été mis en œuvre, les offres de reprise n’étaient pas les mieux-disantes du point de vue de l’emploi. Ce qui est source d’une grande incompréhension sociale : on peut donc créer des dettes, se mettre en redressement judiciaire et revenir en supprimant de l’emploi…
Cette incompréhension est plus grande encore lorsque les difficultés de l’entreprise préexistaient à la crise, conséquences notamment de choix stratégiques d’investissements qui n’avaient pas fait l’unanimité.
Ainsi, on peut s’interroger sur les choix effectués par la direction d’Orchestra. Or que voient les salariés ? La suppression de 400 emplois ! Quand un salarié commet une faute, ma foi, il est licencié… Eh bien, avec une telle mesure, on donne à penser qu’un dirigeant qui a commis des erreurs stratégiques majeures peut tout de même revenir, comme si de rien n’était, en supprimant des emplois.
Dans la période actuelle, si nous devons chercher avant tout à conserver l’emploi et l’activité dans notre pays, il faut le faire par des mesures dont chacun puisse comprendre qu’elles servent l’intérêt général. Dans cet esprit, nous proposons de revenir à la situation antérieure : les anciens propriétaires pouvaient reprendre l’entreprise, mais uniquement sur requête du ministère public, qui représente cet intérêt général.
Ces incompréhensions nombreuses, ce sentiment d’injustice sociale qui gagnent dans notre pays donnent à penser à nos concitoyens que tout est permis à certains, quand on s’efforce sans cesse de surveiller les autres – parfois même de les culpabiliser dans le discours. Ainsi, dans le projet de loi de finances pour 2021, nous avons pris des dispositions pour que les agents de Pôle emploi aient davantage de moyens pour lutter contre la fraude ; mais ils en manquent tellement pour aider les personnes les plus éloignées de l’emploi à en retrouver un…
Contrôle social de plus en plus fort pour les uns, assouplissements pour les autres : de ce double discours découle un sentiment d’injustice sociale majeur. C’est pourquoi je propose le retour au régime antérieur, qui permet, je le répète, la présentation d’une offre de reprise par d’anciens propriétaires, mais à la requête du ministère public, donc au nom de l’intérêt général.
Mme la rapporteure m’a indiqué que le Gouvernement n’envisageait pas de prolonger cette disposition ; Mme la ministre pourra, je l’espère, nous dire précisément ce qu’il en est, en nous apportant des garanties !
Applaudissements sur les travées des groupes GEST et SER.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons ce matin la proposition de loi, déposée par Mme Sophie Taillé-Polian le 21 septembre dernier, visant à supprimer la possibilité offerte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de celle-ci après avoir organisé son dépôt de bilan.
Elle a pour objet principal d’abroger l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Cette disposition assouplit temporairement la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour permettre aux dirigeants d’une entreprise ou à leurs parents ou alliés, ainsi qu’à ceux du débiteur personne physique, de présenter une offre d’achat partiel ou total. Ce dispositif est, je le répète temporaire : il s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2020 seulement.
Le code de commerce interdit, en principe, au débiteur, personne physique ou morale, aux dirigeants de l’entreprise en difficulté et à leurs parents ou alliés de se porter acquéreurs dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Cette interdiction s’explique par un souci bien légitime de moralisation de la vie des affaires. Il s’agit d’éviter la fraude aux intérêts des créanciers, c’est-à-dire que le débiteur ou le dirigeant ne conserve directement ou indirectement tout ou partie des actifs de l’entreprise, alors même qu’il se serait délesté du passif. Il s’agit de prévenir aussi la fraude à l’assurance contre le risque de non-paiement des créances salariales.
En revanche, contrairement à ce que l’on entend parfois, cette interdiction n’est pas destinée à protéger les salariés eux-mêmes contre un détournement de la procédure de licenciement, car les formes prévues par le code du travail pour tout licenciement pour motif économique doivent être respectées.
Le droit commun prévoit des dérogations à cette interdiction, en faveur des exploitations agricoles, d’abord, des autres entreprises ensuite, sous réserve des conditions suivantes : le tribunal ne peut ordonner leur cession à l’un des dirigeants, un allié ou un proche de ceux-ci ou du débiteur personne physique que sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé et après avis des contrôleurs. Cette dérogation est toutefois peu utilisée.
L’assouplissement prévu par l’ordonnance est d’ordre procédural : il permet au débiteur ou à l’administrateur de former lui-même une requête en vue d’une offre de rachat, sans que le ministère public soit tenu de la reprendre à son compte. Ce dispositif a suscité un grand émoi en raison d’une poignée d’affaires ayant défrayé la chronique et qui, sans doute, sont à l’origine de cette proposition de loi.
Il est toutefois très encadré : outre que le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs, comme le droit commun l’exige, l’ordonnance rend obligatoire la présence à l’audience du ministère public, qui peut y présenter des observations et, le cas échéant, interjeter appel. En outre, comme toujours en matière de procédures collectives, l’appel du parquet est suspensif. Au surplus, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent : l’offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation des emplois et d’apurement du passif.
Cet assouplissement a été motivé par deux raisons très pragmatiques, qu’il est difficile de contester. Sur le plan économique, d’abord, on pouvait craindre que les repreneurs potentiels ne soient beaucoup moins nombreux qu’habituellement dans un contexte économique très incertain. Du point de vue moral, ensuite, les dirigeants d’entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n’en portent aucunement la responsabilité : il pouvait donc paraître légitime de leur permettre de présenter plus facilement des offres de reprise.
En outre, un examen attentif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont fait un usage prudent de cette possibilité, le plus souvent avec l’assentiment des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Par exemple, dans le cas de la société Camaïeu, le tribunal de commerce de Lille a retenu l’offre présentée par la Financière immobilière bordelaise plutôt que celle d’un consortium dont faisait partie le dirigeant de Camaïeu, en raison principalement de l’opposition du comité social et économique à cette dernière offre et alors même que les administrateurs, les mandataires, les contrôleurs et le parquet plaidaient en faveur de l’offre du consortium.
Dans ces conditions, la commission des lois a considéré que la disposition mise en cause ne méritait excès ni d’honneur ni d’indignité. Il ne lui a pas paru utile de l’abroger alors qu’elle n’est en vigueur que jusqu’au 31 décembre prochain. Au reste, même si nous l’adoptions, la proposition de loi n’aurait aucune chance d’entrer en vigueur, faute d’être définitivement adoptée avant cette date…
Au contraire, j’estime que prolonger l’application de cette mesure aurait pu avoir du sens, éventuellement sous une forme modifiée pour dissiper toute crainte d’abus. Par exemple, le bénéfice pourrait en être expressément subordonné à l’absence de toute faute de gestion de la part des dirigeants. Alors que les difficultés des entreprises risquent d’exploser l’année prochaine en raison de la crise sanitaire, notamment parmi les petits commerces, les TPE et les PME, ce dispositif aurait peut-être pu leur être utile. D’ailleurs, les syndicats de salariés que nous avons entendus se sont montrés plus ouverts sur un dispositif ciblé.
Telle n’est pas l’intention du Gouvernement, d’après ce que le cabinet du garde des sceaux m’a indiqué lors de mes auditions. Je forme le vœu que l’ordonnance ait au moins permis aux acteurs économiques, aux praticiens des procédures collectives et aux parquets d’être désormais pleinement sensibilisés à la nécessité de faciliter les cessions d’entreprise, y compris à leurs dirigeants si cela se révèle opportun, et d’être mieux informés des souplesses prévues par le droit commun.
Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, la commission des lois vous recommande de ne pas adopter la présente proposition de loi.
Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis le mois de mars dernier, le Gouvernement, sous l’impulsion du Président de la République, mobilise des moyens exceptionnels pour protéger nos entreprises et leurs salariés des conséquences économiques de la crise sanitaire.
Le « quoi qu’il en coûte », la solidarité et la combativité des Français ont démontré leur efficacité : 30 % de faillites en moins ont été enregistrées par rapport à 2019. Les mécanismes mis en place ont donc fonctionné – même si cela ne préjuge pas de 2021.
Dans ce contexte, notre commission consiste à accompagner les entreprises dans leur transformation économique et à préserver les emplois des salariés. Le succès, mardi dernier, de la reprise de l’usine Daimler de Hambach illustre cette stratégie.
La proposition de loi soumise à l’examen du Sénat vise à supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan. Présenté par la sénatrice Sophie Taillé-Polian, ce texte supprime la disposition introduite par l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Prise dans un contexte de crise sanitaire ayant conduit à l’arrêt quasi total de notre économie en quelques heures – je ne manquerai pas d’y revenir –, cette ordonnance simplifie un dispositif préexistant et dérogatoire inscrit dans le code de commerce, qui permet aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ou à leurs parents ou alliés de présenter, avec des précautions et des garanties définies par la loi, une offre d’achat partiel ou total de l’entreprise.
Avant d’en venir au fond de cette proposition de loi, je formulerai deux remarques.
D’abord, il est inscrit très clairement dans l’ordonnance en question que la simplification introduite prendra fin le 31 décembre 2020, soit très exactement dans vingt et un jours. Je veux donc rassurer la sénatrice Taillé-Polian sur ce point : elle n’aura pas à patienter longtemps – ni à attendre l’issue d’une longue navette parlementaire – pour être satisfaite… Cette échéance avait été clairement rappelée par le Gouvernement lors d’une séance de questions d’actualité, voilà environ deux mois.
Ensuite, je m’interroge sur l’intitulé de cette proposition de loi : « supprimer la possibilité ouverte au dirigeant d’une entreprise de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan ». « Après avoir organisé son dépôt de bilan », vraiment ?
Pour échanger avec un très grand nombre d’entreprises, de toutes tailles, et pour avoir eu, dans une vie antérieure, une expérience au sein d’une entreprise et comme investisseur, je puis vous assurer que je ne connais pas beaucoup de chefs d’entreprise qui organisent sciemment leur dépôt de bilan. Prétendre le contraire me paraît très déconnecté du quotidien que vivent nos chefs d’entreprise !
Il n’aura échappé à personne au sein de cette assemblée que nous connaissons, depuis mars dernier, une crise économique d’une violence inouïe. Le quotidien des dirigeants et des salariés, dans ce contexte, ce sont l’incertitude et l’angoisse, la peur de voir les efforts d’une vie s’effondrer en quelques jours, malgré des mois de lutte et des nuits sans sommeil.
Cette détresse et cette peur, le Gouvernement les entend. Il met tout en œuvre, quoi qu’il en coûte, pour soutenir celles et ceux qui ne cessent de se battre, chaque jour, pour sauver leur activité : le fonds de solidarité, des prêts garantis par l’État, l’activité partielle la plus protectrice d’Europe pour préserver les salariés, des exonérations de charges sociales.
Non, madame la sénatrice, les chefs d’entreprise n’organisent pas la faillite de leur entreprise : ils se battent pour la survie de leur activité ! Au reste, nombre d’entre eux sont préoccupés par la protection de leurs salariés.
Je vous remercie néanmoins d’avoir déposé cette proposition de loi, car son examen fournit au Gouvernement la possibilité d’expliquer les objectifs de ce dispositif simplifié. De ce point de vue, je tiens à saluer le travail approfondi de Mme la rapporteure Thomas. Son rapport délimite exactement le périmètre du dispositif, ainsi que les garanties prévues par la loi. Par ailleurs, il réfute l’idée que ce dispositif constituerait un effet d’aubaine pour les entreprises.
Pour bien comprendre les objectifs du Gouvernement dans cette simplification d’un dispositif, je le répète, préexistant, il faut se replacer dans le contexte du 16 mars dernier. En dépit des mesures massives prises par le Gouvernement pour soutenir notre économie, nous craignions alors que des entreprises ne soient contraintes de fermer, en raison non d’une faute de gestion ou d’un manque de compétitivité, mais d’un facteur extérieur à leur activité – la crise sanitaire. Dans ces conditions, notre objectif était de mettre tous les atouts de notre côté et tous les outils au service des entreprises en difficulté pour leur permettre de passer ce cap.
Tel est le contexte dans lequel a été amodié ce dispositif existant de longue date dans le code de commerce. Sa simplification se justifiait à double titre.
D’abord, il s’agissait de sauver le maximum d’emplois. L’activité partielle a bénéficié, à son plus haut pic, à plus de 12 millions de salariés, soit un salarié du privé sur deux – ce qui traduit bien la violence de la crise –, comme le Gouvernement s’y était engagé. Prise dans le même esprit, l’ordonnance a permis de sauver des milliers d’emplois : 3 769 emplois chez Orchestra Prémaman, 9 429 emplois au sein du Groupe Novares ou encore, plus modestement, 59 emplois chez le lunettier jurassien L’Amy – soit, dans les deux derniers cas, l’intégralité des emplois. Le dispositif a donc profité à des entreprises de toutes tailles.
Ensuite, il s’agissait de répondre à l’urgence, qui ne permettait pas nécessairement à des repreneurs de se porter acquéreurs d’entreprises, compte tenu des délais très courts et des conditions de travail dégradées pour eux. Ainsi, le dépôt de bilan et la reprise de Novares ont eu lieu alors que le premier confinement n’était pas encore levé.
Simplifier ne veut pas dire réduire les garanties protectrices. Dans le droit commun, le débiteur ou les dirigeants disposaient déjà de la faculté de reprendre une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, sur réquisitions spéciales du ministère public, par un jugement spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs. Dans le dispositif simplifié, ni le ministère public, ni le jugement spécialement motivé, ni les contrôleurs n’ont disparu de la procédure ; le Gouvernement a mis un point d’honneur à les conserver dans la simplification.
Le changement est d’ordre strictement procédural : le débiteur ou les dirigeants peuvent former une requête en vue d’une offre de rachat, sans que le ministère public soit tenu de la reprendre à son compte. La présence de ce dernier est obligatoire à l’audience ; il peut présenter des observations et, surtout, interjeter appel, avec effet suspensif.
Non, il ne s’agit donc pas d’une régression des protections, non plus que d’un effet d’aubaine. Quand un dirigeant voit son entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, il risque de perdre son outil productif face à une offre concurrente : rien ne lui garantit qu’il pourra reprendre son entreprise, et il ne bénéficie d’aucun avantage ni d’aucune priorité face à une éventuelle offre alternative déposée devant le tribunal de commerce. C’est à celui-ci qu’il appartient de déterminer la meilleure offre au regard du maintien des activités, de la préservation des emplois et de l’apurement du passif.
À cette occasion, je salue le travail considérable accompli par les tribunaux de commerce sur tout le territoire. Ils sont des acteurs essentiels pour les entreprises dans la période particulière que nous traversons.
Un cas emblématique, Camaïeu, prouve bien que le dirigeant ne bénéficie d’aucun avantage : dans cette procédure, le tribunal de commerce de Lille a suivi l’avis du comité social et économique de l’entreprise, donc la voix des salariés, qui s’étaient prononcés en faveur de l’offre concurrente de celle des dirigeants.
Le Gouvernement estime que la prorogation de ce dispositif simplifié au-delà du 31 décembre prochain n’est pas nécessaire. Les parties prenantes, entreprises et tribunaux de commerce, fonctionnent désormais de manière quasi normale, et chacun est sensibilisé à la nécessité de faciliter les cessions d’entreprise. Nous laisserons donc ce dispositif s’éteindre à l’échéance prévue.
En revanche, madame la rapporteure, une mission a été lancée par le garde des sceaux et moi-même pour rechercher la manière d’améliorer l’accompagnement par les tribunaux de commerce des entreprises en difficulté, en particulier les TPE, moins familières de ce type d’institutions. Il est vrai, madame Taillé-Polian, que nous avons des progrès à faire pour que les petites entreprises se sentent prises en charge et bienvenues dans les tribunaux de commerce. Dans cette perspective, la mission rendra ses conclusions à la mi-janvier.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je partage totalement l’avis de notre rapporteure.
Si la disposition de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 ne mérite pas tant d’indignité, il est tout de même légitime de la pointer du doigt. Vous avez donc bien fait, madame Sophie Taillé-Polian, de déposer cette proposition de loi, même si la disposition que vous évoquez s’éteindra dans quelques jours. Votre texte aura eu au moins l’intérêt de nous permettre de discuter de certaines difficultés.
Vous avez ainsi évoqué le problème que posent les ordonnances. Je partage votre point de vue : ces dispositifs dessaisissent complètement le Parlement. Des séries d’ordonnances sont prises, mais jamais ratifiées. Le Sénat a organisé le suivi des nombreuses ordonnances qui ont été prises, et on comprend qu’elles aient été nombreuses compte tenu de la situation totalement inédite, mais il n’en demeure pas moins qu’elles posent problème.
Mes chers collègues, je souhaite attirer votre attention sur la situation des tribunaux de commerce. Madame la ministre, vous avez annoncé qu’une réflexion serait menée : j’estime que c’est la bonne solution. En effet, cette crise doit constituer une réelle occasion de revoir les règles des procédures collectives et de donner les moyens aux tribunaux de commerce de prévoir des procédures spéciales pour les entreprises qui ont chuté à cause non pas de fautes de gestion, mais de la crise tout à fait inédite que nous traversons.
Dans son deuxième rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’urgence sanitaire, le Sénat a relevé : « Du côté de la Chancellerie, l’on a pu observer un certain flottement dans la gestion de la crise en ce qui concerne ces juridictions. Les présidents des tribunaux de commerce n’ont pas été destinataires de la circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions. De premières directives leur ont été adressées par la dépêche du 19 mars 2020 du directeur des affaires civiles et du sceau, qui invitait les tribunaux de commerce à limiter leur activité aux “affaires urgentes” dans le cadre du contentieux général et à la désignation de mandataires ad hoc en ce qui concerne le traitement des difficultés des entreprises ; les tribunaux étaient en revanche invités à surseoir à statuer sur les demandes d’ouverture de procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, considérées comme non urgentes – ce qui ne manquait pas de surprendre. Cette dépêche a été abrogée par la circulaire du 30 mars 2020 […].
« Selon les informations fournies aux rapporteurs avant la survenue de l’épidémie, aucun plan de continuité d’activité n’avait été élaboré au sein des tribunaux de commerce, la Chancellerie n’ayant jamais donné d’instructions en ce sens. Cela n’a pas empêché les chefs de juridiction et les greffes d’organiser dans l’urgence les modalités de travail des magistrats […]. »
Madame la ministre, vous avez indiqué que le nombre de dépôts de bilan était le plus faible depuis des années. Certes, mais je ne fais pas exactement la même analyse que vous. Ce sont toutes les mesures d’accompagnement décidées par le Gouvernement, les efforts considérables faits pour l’économie, qui ont conduit à cette baisse : le fonds de solidarité, le dispositif d’activité partielle, les exonérations et les reports de charges sociales, les exonérations et les reports d’impôts, les prêts garantis par l’État, les crédits d’impôt sur les loyers, le soutien à l’emploi, aux projets industriels…
Selon l’Insee, 15 108 défaillances d’entreprises ont été enregistrées en France entre janvier et juin 2020, soit le niveau le plus bas depuis vingt ans, madame la ministre. Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce a indiqué qu’il n’y avait eu, durant les neuf premiers mois de l’année, que 19 220 ouvertures de procédures collectives. C’est un nombre très étonnant. Il considère toutefois qu’il s’agit d’une bombe à retardement, l’ensemble des aides constituant une sorte d’anesthésique pour l’économie française. Quand celle-ci se réveillera, il est probable que ce sera dans la douleur, parce que c’est alors que le nombre de procédures éclatera. La réflexion que vous menez, madame Taillé-Polian, et les amendements bien modestes que je présenterai dans un instant permettront peut-être d’amortir ce choc.
Toutes ces aides ont pour effet de retarder les procédures collectives, mais à un moment ou à un autre, face à la réalité, ou à la suite d’autres confinements si la crise sanitaire devait se prolonger, ce que ni vous ni moi ne pouvons prévoir aujourd’hui, il y aura forcément des réveils douloureux. Ce sont évidemment les tribunaux de commerce et les mandataires qui seront alors les premiers saisis. Seule la réflexion que vous menez et dans laquelle le Sénat se propose de vous accompagner, madame la ministre, permettra de limiter la casse.
Une attention particulière doit être portée aux mesures de sauvegarde, mais également aux mesures de prévention et d’accompagnement par les mandataires judiciaires ou les administrateurs. Dans le projet de loi de finances que nous venons de voter, aucune mesure particulière n’est prévue pour les 134 tribunaux de commerce. Or des moyens sont nécessaires pour améliorer l’organisation de ces mesures et donc la protection offerte aux entreprises.
Je tiens également à souligner le rôle des associations, madame la ministre. Des commerçants, des TPE se sont organisés au sein d’associations, à l’instar de l’association 60 000 rebonds, qui s’est constituée pour aider les entrepreneurs. Je pense qu’une phase de réforme et d’information est tout à fait essentielle.
Pour conclure, permettez-moi de vous transmettre un message de la part des tribunaux de commerce, madame la ministre. Les magistrats, les juges et les greffiers de ces tribunaux souhaiteraient avoir une adresse au format : nom.prénom@justice.fr. Pour l’instant, ils travaillent avec leur adresse personnelle, ce qui pose, entre autres, des problèmes de confidentialité.
Le groupe Union Centriste suivra notre rapporteure. Les amendements que je présenterai tout à l’heure n’ont que peu de chance d’être adoptés compte tenu de la situation et du fait que la présente proposition de loi émane du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires. J’espère toutefois parvenir à attirer votre attention sur les dispositions proposées, madame la ministre. Du reste, celles-ci devraient s’inscrire dans le droit fil de celles que vous formulerez à l’issue de la réflexion qui sera menée en janvier.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, avant la crise sanitaire – Mme la ministre et Mme la rapporteure l’ont rappelé –, l’article L. 642-3 du code de commerce était clair : dans le cadre d’une liquidation judiciaire, « Ni le débiteur […], ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre » de reprise partielle ou totale de l’entreprise placée en liquidation judiciaire. Je cite ces dispositions très précises pour montrer combien la loi est protectrice en la matière.
L’ordonnance du 20 mai 2020, prise sur le fondement de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire faire face à l’épidémie de covid-19, prévoit qu’une offre de reprise partielle ou totale de l’entreprise en liquidation judiciaire peut, jusqu’au 31 décembre prochain, être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
La requête aux fins de dérogation à l’interdiction pour certaines personnes de présenter une offre de reprise pouvait être faite avant cette ordonnance, mais uniquement après une autorisation explicite du procureur de la République. Une telle requête était donc possible, mais seulement dans des conditions exceptionnelles.
Par la présente proposition de loi, Sophie Taillé-Polian met en avant les problèmes posés par cette ordonnance et ses conséquences, quelles que soient les considérations qui ont pu présider à sa mise en œuvre. Je l’en remercie chaleureusement.
En effet, il est peu contestable que cet assouplissement de la procédure a créé des effets d’aubaine. Dans l’exposé des motifs de sa proposition de loi, Mme Sophie Taillé-Polian indique : « En quelques semaines, certains dirigeants d’entreprise ont déjà profité de cet effet d’aubaine pour effacer une partie de leurs dettes, faciliter les licenciements des salariés, faire prendre en charge des salaires par l’Unédic puis récupérer leur entreprise ainsi allégée alors qu’elle était déjà en difficulté avant la pandémie. » Cela ne peut manquer de susciter des interrogations.
Il est incontestableque cette procédure a eu ou peut avoir des effets pervers. En effet, la possibilité ouverte par l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 est avantageuse puisque, en cas de liquidation judiciaire, les indemnités de licenciement sont prises en charge non par l’employeur, mais par le régime de garantie des salaires, l’AGS. Elles s’élèvent alors au montant minimal prévu par la loi. Or lors d’une restructuration classique, le plan de sauvegarde de l’emploi doit faire l’objet de négociations et prévoir un accompagnement des salariés licenciés, selon des critères définis en concertation avec les organisations syndicales.
Madame la ministre, dans le cas que vous avez cité – pour ma part, je ne citerai aucune entreprise particulière –, la décision du tribunal coïncidait avec le souhait du comité social et économique représentant les salariés de l’entreprise.
Vous savez pourtant fort bien que, dans d’autres cas, l’exact inverse a pu se produire. Ainsi, alors que les membres du comité économique et social de l’entreprise réclamaient à cor et à cri qu’une offre différente fût retenue, non seulement il n’en a rien été, mais ce sont les responsables du groupe qui avaient organisé la faillite qui ont récupéré l’entreprise une fois qu’un certain nombre de charges financières ont été endossées par les autorités publiques. Pourtant, la volonté des salariés, clairement manifestée et même étayée par des rapports d’expertise, était tout autre.
Les risques de dérives et la réalité des effets d’aubaine induits doivent être pris en considération. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera donc en faveur de cette proposition de loi, même si la disposition visée prendra fin le 31 décembre. Il est important pour les parlementaires que nous sommes que le Sénat alerte fortement sur les effets pervers que peut avoir cette disposition pour les salariés, mais également pour l’entreprise.
J’observe d’ailleurs, madame la ministre, que même si le comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI), que j’ai rencontré à propos de l’une de ces entreprises, a souligné que les effets de cette disposition n’étaient pas tous négatifs – et je le reconnais –, le Gouvernement a considéré que les acteurs économiques, les praticiens des procédures collectives et les parquets étaient pleinement sensibilisés à la nécessité de faciliter les cessions d’entreprises, y compris à leurs dirigeants si cela se révèle opportun, et qu’ils étaient mieux informés désormais des souplesses prévues par le droit commun. Les dérogations qui restent toujours possibles sur l’initiative du procureur de la République suffiront donc à produire leur effet sans que cette disposition soit désormais nécessaire.
Le fait que le gouvernement auquel vous appartenez, madame la ministre, ait décidé de ne pas proroger cette mesure montre que cette proposition de loi va dans le bon sens. En effet, avant même qu’elle ne soit votée par le Sénat – et notre groupe milite pour que tel soit le cas –, vous avez pris en compte la réalité qu’elle tendait à souligner.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans un souci de moralisation de la vie des affaires, il est en principe interdit aux dirigeants d’une entreprise, ou à leurs parents ou alliés, ou à ceux du débiteur, de se porter acquéreurs d’une entreprise en difficulté dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. L’objectif est d’éviter la fraude, qu’elle soit aux intérêts des créanciers ou à l’assurance.
La proposition de loi qui nous est soumise ce matin a pour objet d’abroger l’article 7 de l’ordonnance 2020–596 du 20 mai 2020, qui a temporairement assoupli – jusqu’au 31 décembre 2020 – la procédure permettant aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire ou à leurs parents ou alliés, ou encore à ceux du débiteur lorsqu’il s’agit d’une personne physique, de présenter une offre de rachat partiel ou total de l’entreprise.
Cet assouplissement prévu par l’ordonnance est d’ordre procédural. Il permet au débiteur ou à l’administrateur de former lui-même une requête en vue d’une offre de rachat sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte.
Il reste toutefois très encadré : non seulement le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs, comme le droit commun l’exige, mais l’ordonnance rend également obligatoire la présence du ministère public à l’audience, au cours de laquelle il peut présenter des observations et, le cas échéant, interjeter l’appel. Dans ce cas, l’appel du parquet est suspensif.
Enfin, les conditions de fond régissant le choix du cessionnaire par le tribunal demeurent : l’offre choisie doit être celle qui satisfait le mieux aux trois objectifs de maintien des activités, de préservation des emplois et d’apurement du passif.
Selon notre collègue Sophie Taillé-Polian, auteure de la proposition de loi, cet assouplissement de la procédure de reprise prévu par l’ordonnance du 20 mai 2020 a constitué un effet d’aubaine pour les dirigeants dont la mauvaise foi ou la mauvaise gestion avaient elles-mêmes contribué aux difficultés de leur entreprise.
Nous comprenons bien l’émoi que plusieurs affaires très médiatisées ont suscité. Toutefois, nous partageons la position du ministère de la justice, qui considère que cet assouplissement procédural temporaire se justifie par le risque que les repreneurs potentiels soient beaucoup moins nombreux qu’habituellement en cette période, compte tenu du contexte économique très incertain et du fait que les dirigeants d’entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire n’en portent aucunement la responsabilité. Aussi, il apparaît légitime de leur permettre de présenter plus facilement des offres de reprise.
Par ailleurs, les juridictions ont fait une application prudente de cette possibilité, le plus souvent avec l’accord des organes de la procédure, des salariés et du parquet, et au vu de l’ensemble des circonstances de chaque cas.
En tout état de cause, compte tenu des délais qu’implique la navette parlementaire, nous nous interrogeons sur la pertinence de l’inscription de ce texte à l’ordre du jour, dans la mesure où nous sommes à quelques jours seulement du terme du dispositif que cette proposition de loi entend abroger, celui-ci étant fixé au 31 décembre prochain, soit dans vingt et un jours.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne prendra pas part au vote.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le tribunal de commerce d’Orléans a scellé en octobre dernier le sort d’Inteva Products France.
Ce groupe, filiale d’un équipementier automobile américain, était en redressement judiciaire depuis le mois de juin. La justice a tranché : c’est la maison mère, candidate à sa reprise, qui rachète son entreprise, après avoir organisé son dépôt de bilan pour une transaction fixée à 1, 25 million d’euros. Ce rachat lui permet d’abandonner – excusez du peu – 169 millions d’euros de créances !
Dans les faits, ce rachat entraînera la fermeture de l’usine de Saint-Dié-des-Vosges, qui emploie 223 salariés, ainsi que 42 licenciements sur les 160 postes que compte le siège à Sully-sur-Loire, soit 265 licenciements au total. Voilà un exemple assez parlant de ce que permet l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai dernier.
Celle-ci facilite la reprise d’une entreprise en redressement judiciaire par son dirigeant et permet un apurement de la dette, le ou les dirigeants se délestant au passage d’une partie des salariés. Auparavant, une réquisition spéciale du parquet était nécessaire pour pouvoir procéder ainsi. Sinon, il fallait respecter un délai minimum de cinq ans. Le Gouvernement a donc procédé à un sérieux assouplissement de la règle initiale.
Cette disposition a été prise dans l’objectif de limiter la casse économique et sociale post-covid et avec la volonté affichée de préserver les emplois. Cela peut se comprendre pour les PME de certains secteurs qui déposent le bilan alors qu’elles ont peu de concurrents et en l’absence de repreneur potentiel. Il faut d’ailleurs reconnaître que la mesure a pu être salutaire pour certaines petites entreprises.
Toutefois, ce dispositif n’ayant pas été suffisamment encadré, il a eu des effets d’aubaine et a ouvert la voie à des dérives inacceptables.
Ainsi, de grands groupes se sont engouffrés dans la brèche pour restructurer à moindre coût. C’est le cas d’Inteva Products France, mais aussi de l’entreprise Orchestra Prémaman, qui s’est séparée de plusieurs centaines de salariés, l’opération ayant permis à l’équipe dirigeante de poursuivre l’aventure à peu de frais après l’apurement du passif du groupe, estimé à 500 millions d’euros.
On peut citer également l’entreprise Alinéa, qui a supprimé près de 1 000 emplois. Permettez-moi un rappel historique : en 2019, c’est-à-dire avant la crise sanitaire, cette enseigne avait réalisé 257 millions d’euros de chiffre d’affaires et enregistré 62 millions d’euros de pertes.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, grâce à cette ordonnance, des entreprises effacent les dettes qu’elles ont contractées auprès de fournisseurs, de l’État et même des organismes sociaux. En résumé, elles repartent de zéro sur le dos de la collectivité. L’entreprise réduit ses effectifs à moindre coût puisque les licenciés sont indemnisés au minimum, sans aucun complément. Et encore une fois, ce sont les salariés qui paient le prix fort.
Il s’agit, pour de grands groupes peu soucieux des conséquences économiques et sociales de leurs décisions, non plus de sauvegarder des emplois, mais d’utiliser, voire de dévoyer des procédures juridiques temporaires pour s’alléger de difficultés financières accumulées avant la pandémie. Était-ce là l’intention du Gouvernement ?
Assouplir les règles de droit commun pour faciliter les reprises et éviter les faillites serait sans doute bénéfique dans un monde entrepreneurial tout à fait bienveillant, mais dans celui que nous connaissons, où un certain nombre de chefs d’entreprise agissent d’abord en acteurs économiques cyniques, leur rationalité étant tout entière tournée vers l’optimisation des coûts et la recherche du profit, nous savons que cela se fait trop souvent au détriment des droits des salariés.
Cette disposition doit arriver à terme le 31 décembre. Nous saluons le fait que la commission des lois ait choisi de ne pas la proroger, car tel était le risque. Nous serons attentifs à ce qu’elle ne le soit pas par d’autres canaux légistiques dans les mois à venir. Cette proposition de loi aura eu le mérite d’alerter et d’appeler à la vigilance.
Nous notons au passage que l’on n’entend ni le Gouvernement ni la majorité sénatoriale se plaindre de l’endettement de l’État qu’entraîne le recours à cette procédure. On laisse filer la dette publique pour renflouer les comptes de ces entreprises sur le dos du contribuable, selon un mécanisme – hélas classique – de privatisation des profits et de socialisation des pertes. Demain, on viendra nous expliquer que le coût du service public est insoutenable au regard de l’endettement de la Nation…
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, dans sa rédaction actuelle, l’article L. 642-3 du code de commerce relatif à la cession des entreprises en liquidation judiciaire pose un principe d’interdiction, pour un certain nombre de personnes, dont les dirigeants de la personne morale en liquidation judiciaire, de présenter une offre de reprise de cette même entreprise.
Le même texte prévoit également que le tribunal puisse déroger à cette interdiction et autoriser la cession à l’une des personnes visées sur requête du ministère public et par jugement spécialement motivé.
Pour répondre aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises durant la crise sanitaire, une ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a été prise en application de la loi du 23 mars 2020. L’article 7 de cette ordonnance prévoit un assouplissement de certaines dispositions de l’article L. 642-3 précité, assouplissement qui nous réunit – ou nous oppose – aujourd’hui.
La présente proposition de loi de notre collègue Sophie Taillé-Polian vise à supprimer l’article 7 de ladite ordonnance au motif qu’elle créerait un effet d’aubaine pour des patrons voyous et leur permettrait ainsi d’organiser un plan social à moindre coût.
Le groupe RDPI partage la position de la commission des lois, qui est défavorable à l’adoption de ce texte. J’en profite pour souligner la qualité du travail de notre rapporteure.
Les raisons de notre opposition sont simples.
Tout d’abord, l’article 7 ne modifie pas la catégorie des personnes autorisées à présenter une offre de reprise. Il ne porte que sur l’auteur de la requête qui, depuis le 20 mai et jusqu’au 31 décembre, peut être formée non plus seulement par le ministère public, mais également par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Par ailleurs, les garanties prévues pour la mise en œuvre d’une telle procédure restent les mêmes : le tribunal doit statuer sur la cession aux dirigeants de l’entreprise en rendant un jugement spécialement motivé, mais si la requête est formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire – ce que prévoit l’ordonnance –, alors les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, dont le recours éventuel contre le jugement est suspensif.
Vous conviendrez, mes chers collègues, que l’ordonnance assortit cet assouplissement de garanties supplémentaires.
Ensuite, et contrairement à ce que laisse entendre notre collègue, les reprises ne bénéficient pas toujours aux dirigeants de l’entreprise. Je pense notamment à l’entreprise Camaïeu – citée par plusieurs orateurs –, dont l’offre de reprise formée par les dirigeants a été rejetée au profit de celle de la Financière immobilière bordelaise, qui permettait le maintien d’un plus grand nombre d’emplois.
Madame la ministre, afin de nous rassurer, vous avez porté à notre connaissance le nombre d’offres de dirigeants effectuées sous ce régime qui ont été choisies par les tribunaux. Je vous en remercie.
Enfin, mon dernier argument a trait au terme de cette disposition. L’article 10 de l’ordonnance du 20 mai 2020 prévoit qu’elle prenne fin au 31 décembre 2020. S’il est vrai qu’elle entre dans le champ des mesures que le Gouvernement est habilité à prolonger par ordonnance, vous vous êtes engagée, madame la ministre, à ne pas le faire, et ce au moins à deux reprises : lors des questions d’actualité au Gouvernement à l’Assemblée nationale le 6 octobre dernier et devant le Sénat aujourd’hui.
En outre, la procédure accélérée n’ayant pas été engagée, si l’on poursuivait la navette, ce texte ne serait définitivement adopté qu’après le terme de l’application de la disposition qu’il vise à abroger.
L’enjeu majeur qu’est la préservation de l’emploi dans la période actuelle implique des mesures concrètes, dont celle-ci, et une réflexion de fond, plutôt que la mobilisation de l’ordre du jour pour l’examen d’un texte qui sera en tout état de cause caduc avant de connaître le sort qui lui est définitivement réservé.
La mesure contestée, salvatrice pour nombre d’entreprises, est assortie de garanties essentielles et limitée dans le temps. Aussi, le groupe RDPI ne votera pas cette proposition de loi.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, vous me permettrez de débuter mon intervention par ces mots de Portalis : « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit, d’établir des principes féconds en conséquence. »
Comme parlementaires, l’établissement de ces « principes féconds » doit nous guider, de sorte que nous devons sans cesse nous interroger sur l’applicabilité des lois que nous votons. Cette exigence nous oblige devant chaque texte de loi qui nous est présenté.
Si nous avons été habitués, ces dernières années, à la procédure accélérée, le temps législatif reste un temps long. Aussi, si nous votions ce texte, il ne fait aucun doute que son adoption définitive aurait lieu après le 31 décembre 2020, et donc après qu’aura cessé l’application du dispositif qu’il vient abroger.
Malgré cela, ce n’est pas la première fois que nous examinons des propositions ayant une forte portée symbolique. Ce débat est loin d’être vain, et je salue l’initiative de notre collègue Sophie Taillé-Polian, qui pourra ainsi entendre Mme la ministre exposer les intentions du Gouvernement sur le sujet.
Pour en venir au fond, le texte prévoit de mettre fin à la possibilité, ouverte par l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020, dans le contexte de crise que nous connaissons, pour un dirigeant d’entreprise de déposer une offre de rachat après avoir organisé le dépôt de bilan de son entreprise.
Le droit commun l’interdit pour plusieurs raisons. D’abord, dans un souci de moralité des affaires, il s’agit de ne pas permettre à un dirigeant d’organiser la faillite de son entreprise avant de la reprendre par la suite, délestée de ses dettes. Ensuite, l’objectif est de lutter contre la fraude à l’assurance concernant le non-paiement des créances salariales.
L’article 7 visait non seulement à pallier l’absence de repreneurs et à prévenir les éventuelles conséquences sur l’emploi, mais aussi à soutenir les dirigeants d’entreprise qui ne sont en aucun cas responsables du contexte économique et de ses conséquences sur leurs carnets de commandes.
Dire que certains chefs d’entreprise ont profité du dispositif est une réalité. L’exemple de l’équipementier automobile lnteva Products, installé dans les Vosges, est criant. Même s’il m’incite à partager l’objectif de cette proposition de loi, je ne pense pas qu’il soit généralisable à l’ensemble des entreprises. Le choix de l’offre de reprise ne se décide pas d’un claquement de doigts, car le juge doit se prononcer pour celle qui permettra d’assurer le maintien de l’emploi et des activités, ainsi que l’apurement du passif.
Aux exigences du droit commun, prévoyant que le jugement sera rendu après avis des contrôleurs, s’ajoute la présence obligatoire du ministère public à l’audience, qui peut présenter ses observations et même interjeter appel.
Comme le prouve l’affaire de l’enseigne Camaïeu, le repreneur, fût-il l’ancien dirigeant de l’entreprise, n’acquiert pas automatiquement la reprise, preuve que la procédure n’est pas dépourvue de tout contrôle.
Néanmoins, l’exception permise par cette ordonnance doit en rester une, afin de protéger les salariés et les créanciers.
Face à la poursuite de la crise sanitaire et économique, il nous faut nous interroger sur les réponses que nous souhaitons apporter à ces situations de cession, qui perdureront après le 31 décembre 2020.
La mission d’information sur les outils juridiques de traitement des difficultés des entreprises nous aidera, je l’espère, à y voir plus clair et à apporter des solutions permettant de lutter contre les dérives observées.
Vous l’aurez compris, chers collègues, les membres du groupe du RDSE partagent les constats des auteurs de cette proposition de loi, mais ils s’abstiendront majoritairement sur le texte. Ils restent en effet rassurés sur les intentions du Gouvernement de ne pas faire perdurer la mesure.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, quelques jours après le premier déconfinement, la ministre du travail d’alors, Muriel Pénicaud, a pris une série d’ordonnances, qui ne visaient certainement pas à reconnaître la covid-19 comme maladie professionnelle, ou à faire respecter leurs contrats aux assureurs et à sauver ainsi de nombreux commerçants et artisans.
Au lieu de cela, de multiples ordonnances ont été prises pour déroger au code du travail ou sur la consultation des comités sociaux et économiques. Celle du 20 mai dernier, qui nous intéresse aujourd’hui, ouvre la possibilité, pour le dirigeant d’une entreprise, de déposer une offre de rachat de l’entreprise après avoir organisé son dépôt de bilan.
Pourtant, l’article L. 642-3 du code de commerce interdisait à un dirigeant, ainsi qu’à ses parents ou alliés, de formuler une offre de reprise de sa propre entreprise dans le cadre d’un plan de cession, et ce dans un souci de moralisation des affaires, afin d’éviter les conflits d’intérêts et les fraudes, même s’il existait déjà des dérogations quand l’intérêt général le commandait.
Le code de commerce, comme de nombreux éléments procéduraux en cas de faillite, a été pensé pour protéger les créanciers. Il s’agit d’éviter que le débiteur ou les dirigeants ne conservent directement ou indirectement des actifs de l’entreprise, alors même qu’ils se débarrasseraient du passif. C’est donc une protection pour l’ensemble des créanciers, entreprises et sous-traitants, mais aussi pour l’État.
Il s’agit également d’empêcher la fraude à l’assurance, le non-paiement des créances salariales, ainsi que le risque de « nationalisation » des salaires consistant à les faire payer par le régime de garantie des salaires.
Sous couvert de faciliter le maintien de l’emploi, mais en évitant toute étude d’impact et tout débat démocratique au Parlement, l’ordonnance modifie en son article 7 cette disposition importante du code de commerce.
Cette ordonnance a fait polémique, au Medef comme chez les salariés. Bien évidemment, on nous a dit : « C’est pour les entreprises qui sont en difficulté à cause de la covid. Nous serons vigilants quant aux effets d’aubaine, et le tribunal et le ministère public seront intraitables, afin que ce ne soit pas l’occasion d’effacer des dettes et de réduire les effectifs ».
C’est évidemment raté, car de nombreuses entreprises qui ont fait appel à cette procédure avaient déjà des dettes fiscales et sociales et des plans sociaux dans les cartons avant même la crise de la covid.
Les exemples sont nombreux : Camaïeu, Inteva Products, Orchestra, Phildar, Ymagis, et la liste est longue… Il est vrai que, dans certains cas, ce sont des offres concurrentes qui ont remporté la partie, comme pour Camaïeu, vous l’avez dit, madame la ministre.
Cependant, que dire de l’entreprise Orchestra, qui croulait sous une dette de 650 millions d’euros bien avant la covid, et qui a été reprise par son fondateur Pierre Mestre, contre l’avis des représentants des salariés ?
Le meilleur exemple, c’est Alinéa, propriété de la famille Mulliez, dont la fortune, classée sixième de France, est évaluée à 26 milliards d’euros. L’entreprise a été placée en redressement judiciaire le 13 mai 2020 et n’a pas présenté de plan de redressement viable. En conséquence, le tribunal de commerce de Marseille a validé, le 14 septembre dernier, l’offre de reprise formulée par Alexis Mulliez, son président, assortie de la fermeture de plusieurs points de vente et de la suppression de près de 1 000 emplois.
Sous couvert de la crise économique due à la covid-19, la famille Mulliez, dont le groupe compte plus de quarante enseignes, enchaîne les plans de licenciements et les fermetures de sites, lesquels étaient pour la plupart envisagés depuis bien longtemps. Ainsi, Phildar, son enseigne de fils à tricoter et de prêt-à-porter – 137 suppressions d’emplois et 116 fermetures de magasins sur les 131 actuels –, a finalement été rachetée par les mêmes propriétaires !
Comment peut-on encore nier que ce procédé de dépôt de bilan-rachat, sans garde-fou ni contrepartie, a créé un réel effet d’aubaine pour certains dirigeants, et surtout pour certains grands groupes ?
La commission des lois précise dans son rapport que « les licenciements en procédure collective sont soumis aux mêmes formes et garanties que les licenciements économiques de droit commun. ».
Or la réalité est légèrement différente. Dans un plan de sauvegarde de l’emploi, la procédure est longue et les négociations avec les représentants syndicaux font que les congés de reclassement, de mobilité, les primes légales et supralégales, ou encore les plans de départ volontaire, bien mal nommés, sont plus favorables aux salariés que dans des plans de licenciements en procédure collective, dont les délais sont extrêmement raccourcis.
Enfin, le groupe CRCE avait raison d’alerter, dès le premier projet de loi de finances rectificative, sur le risque que ces dérogations ou exceptions pendant la période de crise ne s’inscrivent dans le droit commun. En effet, cette ordonnance doit prendre fin le 31 décembre prochain, mais la commission des lois propose de la proroger au-delà, voire de l’inscrire dans le droit commun. Pour nous, cela est inacceptable !
Nous voterons donc des deux mains cette proposition de loi, en espérant, si elle devait ne pas être adoptée aujourd’hui, que l’ordonnance prendra fin définitivement quand l’année s’achèvera…
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et GEST.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Voilà en peu de mots les raisons qui ont présidé à l’adoption de l’article 7 de l’ordonnance du 20 mai 2020 qui nous occupe ce matin. En effet, ce dispositif est né de la crise et ne saurait, à ce stade, lui survivre.
Entrée en vigueur alors que la France sortait à peine de son premier confinement, l’ordonnance en question répondait à l’urgence de soutenir nos entreprises les plus en difficulté. Elle complétait celle du 27 mars 2020 afin de mieux prendre en compte les conséquences de la crise sanitaire et de faciliter ainsi la reprise de l’activité.
Souvenons-nous de notre sidération collective face à la situation inédite que nous vivions alors et qui se poursuit. Souvenons-nous des craintes et des incertitudes quant au redémarrage tant attendu et des espoirs timides de reprise. Souvenons-nous qu’il nous fallait être dans l’action pour éviter un effondrement de l’économie française.
C’est dans ce contexte que l’article 7 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 a été rédigé.
Cette mesure a donc assoupli, jusqu’au 31 décembre 2020, la procédure permettant aux dirigeants d’une entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, ou à leurs parents ou alliés, de présenter une offre d’achat partiel ou total de l’entreprise.
Néanmoins, l’objet de la proposition de loi sur laquelle nous sommes amenés à nous prononcer aujourd’hui n’est autre que l’abrogation de cet article 7. Alors que le temps législatif ne s’inscrit pas toujours dans le temps très court, nous pouvons légitimement nous étonner d’un tel texte, conscients de cette échéance.
Les auteurs de la proposition de loi arguent que certains chefs d’entreprise auraient profité de l’effet d’aubaine qu’offrait cet assouplissement de la procédure de reprise. Je ne peux que déplorer les quelques dérives qui sont très marginales.
Ainsi s’explique, sans doute, la volonté de supprimer le dispositif de l’article 7, alors même que la crise couve toujours. Nous en mesurons les conséquences quotidiennes dans nos territoires. Cependant, peut-être que les circonstances ont obscurci les jugements… Je n’ose croire qu’il s’agisse de voir dans tous les chefs d’entreprise des personnes sans scrupules, alors qu’ils sont les forces vives de notre économie.
Plutôt que de succomber à l’émotion ou à l’idéologie, engageons un débat constructif afin de nous approcher, le plus possible, de la réalité des faits.
Deux étapes se distinguent, à mon sens, en vue de suivre cette démarche.
La première consiste à rappeler les motifs qui justifient l’assouplissement prévu par l’ordonnance du 20 mai 2020. Deux raisons conjoncturelles ont été retenues par le ministère de la justice : d’ordre économique, d’une part, car le climat des affaires, très incertain, laisse craindre un manque de repreneurs potentiels ; d’ordre moral, d’autre part, car les dirigeants d’entreprises ont été mis en difficulté par une crise sanitaire, dont ils ne sont pas responsables. Il était de ce fait légitime de faciliter leurs offres de reprise.
La seconde consiste à évaluer la nature du dispositif et sa mise en œuvre.
Concernant sa nature, le dispositif est d’ordre procédural : il permet au débiteur ou à 1’administrateur de former lui-même une requête en vue d’une offre de rachat, sans exiger que le ministère public la reprenne à son compte. Il reste pour le moins très encadré. Outre que le jugement doit être spécialement motivé et rendu après avis des contrôleurs comme le droit commun l’exige, la présence du ministère public à l’audience est obligatoire. Ce dernier peut présenter, à cette occasion, ses observations et, le cas échéant, interjeter appel.
Concernant la mise en œuvre du dispositif, un examen attentif de la jurisprudence montre que les tribunaux ont fait un usage prudent de la possibilité qu’il offre. Il a été le plus souvent utilisé avec l’assentiment des organes de la procédure, des salariés et du parquet, toujours en prenant en compte les spécificités de chacun des cas, et avec parcimonie.
Il faut aussi rappeler que la majorité des dirigeants sont honnêtes ! Ils n’ont aucun plaisir à venir déposer le bilan de leur entreprise au greffe du tribunal de commerce, parce qu’une page de leur vie se tourne. Certains y voient même un déshonneur et garderont dans leur mémoire cet instant.
En conclusion, les deux étapes d’évaluation du dispositif d’assouplissement en montrent toute la cohérence : l’idée à l’origine du dispositif est légitime et sa mise en application demeure prudente et efficace.
Demain, le sort du tissu productif français, notamment des petites et moyennes entreprises qui font la richesse et le dynamisme de nos territoires, sera suspendu à ce type de mesure de soutien. J’ai une pensée pour nos restaurateurs et tous ces chefs d’entreprise qui ne peuvent toujours pas exercer leur activité à cause du maintien des mesures sanitaires.
Je suis pleinement en accord avec les conclusions du rapport de la commission des lois, dont je salue le sérieux, sur une éventuelle prorogation, voire une pérennisation du dispositif.
Enfin, permettez-moi de formuler un vœu, celui que le Gouvernement use de toutes les possibilités offertes par notre droit pour sauver les entreprises viables, mais fragilisées par la crise, et préserver ainsi des milliers d’emplois.

Si l’État a pris des mesures indispensables pour limiter l’impact économique de la crise sanitaire, lesquelles ont d’ailleurs donné des résultats, il faut permettre à toutes nos entreprises de se remettre en ordre de marche. Il y va de leur survie et de notre avenir.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je peux aisément comprendre l’indignation de nos concitoyens lorsque les médias ont annoncé qu’il était désormais possible pour le dirigeant d’une entreprise ayant organisé son dépôt de bilan de faire une offre de rachat de sa propre entreprise.
Cela semble, au premier abord, aller complètement à l’encontre de la morale qui doit présider au monde des affaires, car la personne qui met en œuvre cette possibilité n’échappera pas au soupçon de vouloir contourner les lois applicables, notamment en matière de licenciement.
Toutefois, il n’en est rien, comme le souligne à juste titre le rapport de la commission des lois.
En effet, bien que la procédure ait été facilitée par ordonnance, le rachat d’une entreprise par son dirigeant était déjà autorisé par la loi, dans des conditions strictes et contrôlées par un juge. Ainsi, il est habituellement prévu que le ministère public demande que le rachat soit autorisé, et même lorsque cette faculté est employée, rien ne garantit que le juge y ouvre droit.
Cette possibilité, qui est par ailleurs très peu utilisée, est avantageuse lorsqu’il n’existe pas d’offre de rachat ou lorsque les offres sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, le maintien de l’activité et la préservation des emplois.
En outre, ni la procédure de sauvegarde, ni la liquidation judiciaire, ni la cession, qui peuvent déboucher sur un rachat, ne permettent de contourner les procédures, et les règles afférentes aux licenciements économiques restent de mise si des réductions d’emplois doivent avoir lieu.
Il s’agit donc d’une fausse polémique, résultant d’une désinformation, d’une méconnaissance du droit applicable, mais aussi de la diabolisation des chefs d’entreprise, lesquels chercheraient forcément à contourner la loi et à nuire à leurs employés. Je trouve cette vision extrêmement dommageable alors que la crise économique touche durement de nombreuses entreprises. Leurs dirigeants sont désemparés et préféreraient, j’en suis certain, ne pas avoir à vendre le fruit de longues années de travail.
J’estime naturel que le Gouvernement ait assoupli la procédure et supprimé jusqu’au 31 décembre 2020 la nécessité pour le ministère public de former une requête pour que le rachat par le dirigeant de l’entreprise puisse avoir lieu. Cet assouplissement vise uniquement à répondre aux nombreuses faillites qui interviennent et risquent d’intervenir, et dont les entreprises ne sont pas responsables. Ces faillites s’expliquent non par la mauvaise gestion du dirigeant, mais bien par la crise.
Devrions-nous laisser les chefs d’entreprise française tout perdre, au risque que leurs entreprises soient rachetées par des investisseurs étrangers ou, pis, qu’elles ne puissent être vendues et que tous leurs employés soient licenciés et viennent gonfler les chiffres du chômage, lesquels ne cessent de grimper ?
Je suis bien conscient que cette proposition de loi a été déposée dans le but de protéger les salariés des licenciements. Cependant, mes chers collègues, nous devons garder à l’esprit que cette protection n’est possible que si nous aidons également les entreprises. Ce sont elles qui créent de l’emploi, et il serait tout simplement contre-productif de leur mettre davantage de bâtons dans les roues en cette période difficile.
Bien évidemment, les largesses qui peuvent leur être accordées doivent être proportionnées et limitées dans le temps. C’est le cas du dispositif que nous examinons, car les tribunaux contrôlent très attentivement le respect de la procédure, et la souplesse consistant à ne plus rendre la requête du ministère public obligatoire prendra fin au 31 décembre 2020.
Passée cette date, la procédure habituelle reprendra. Le rachat par le dirigeant restera possible, comme cela est le cas depuis plusieurs années, mais dans des conditions plus strictes que celles qui ont pu avoir cours ces derniers mois.
Il ne me semble donc pas nécessaire, à quelques jours de l’échéance de ce dispositif, de l’abroger, pas plus qu’il ne semble utile de le prolonger.
Nous avons pour habitude de retravailler le droit, de l’améliorer, c’est l’un de nos rôles en tant que parlementaires. Cependant, n’oublions pas que le droit est souvent bien fait et qu’il n’est pas toujours nécessaire de le modifier. Faisons confiance aux juges pour l’appliquer correctement, pour faire preuve de prudence, mais aussi de justesse, ce qu’ils ont d’ailleurs fait à plusieurs reprises ces derniers mois lorsque des propositions de rachat ont été faites par le dirigeant de l’entreprise en vente.
La commission des lois a très justement remarqué dans son rapport que le droit applicable est efficace et que les modalités prévues en matière de rachats d’entreprises sont mieux connues des dirigeants, mais aussi des tribunaux, sensibilisés à la nécessité d’être souples en cette période. Elle a de ce fait estimé qu’il n’y avait pas besoin de modifier la loi et je partage pleinement son avis.
Je tiens à féliciter la commission des lois pour son travail encore une fois de qualité. Il démontre le sérieux et l’efficacité de la Haute Assemblée, qui ne s’engouffre pas, à la première porte ouverte, dans la polémique.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je salue tout d’abord l’initiative de Mme Sophie Taillé-Polian et de ses collègues du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, qui nous permet d’aborder un sujet hautement sensible, lié aux entreprises et au monde économique. En effet, cette proposition de loi vise à supprimer la possibilité pour un dirigeant de racheter son entreprise après avoir déposé le bilan.
J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt le travail de la commission des lois, madame la rapporteure, et les nombreuses auditions au cours desquelles se sont exprimés les questionnements des chefs d’entreprise et des représentants de salariés sur un sujet particulièrement sensible.
Certains de nos collègues ont évoqué un risque de dérive et ont rappelé les articles du code de commerce. À cet égard, je tiens à saluer également les travaux menés par la commission des affaires économiques et par la délégation aux entreprises que préside Serge Babary. En effet, le monde économique est fait de liens entre les entreprises, l’État et l’ensemble des collectivités territoriales, qui ont compétence en la matière.
Madame la ministre, vous avez rappelé qu’il convient de sauver le monde économique. Cette proposition de loi fait référence à la loi d’urgence du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et à l’ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19.
L’objet de cette proposition de loi est de mettre un terme à une dérive qui provoque de nombreux scandales sociaux. Mes collègues en ont cité plusieurs exemples d’entreprises.
À cet égard, il faut rappeler le rôle des tribunaux de commerce, le partenariat entre l’État, les collectivités territoriales, mais aussi la Banque de France et l’Unédic, ainsi que l’assouplissement temporaire de la procédure prévue par l’ordonnance du 20 mai 2020. Mme la rapporteure préconise de mobiliser l’ensemble des possibilités offertes par notre droit pour sauver les entreprises viables, mais fragilisées par la crise, et préserver ainsi des milliers d’emplois.
Des dispositifs existent, comme nous avons récemment eu l’occasion de le rappeler, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021 : loi de finance rectificative, prêts garantis par l’État, dont l’article 52 quinquies de la deuxième partie de la loi de finances limite l’encours total à 300 milliards d’euros, ce qui est énorme, fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire, ou bien encore les différents dispositifs d’exonération de charges.
Compte tenu des arguments de la rapporteure de la commission des lois, notre groupe ne votera pas cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.

L’amendement n° 1 rectifié quinquies, présenté par Mmes N. Goulet et Loisier, MM. Le Nay, Moga et Canevet, Mmes Dindar et Billon, M. Delahaye, Mme Doineau, M. Delcros et Mmes Vérien, Gatel et C. Fournier, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Jusqu’au 31 décembre 2021, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation prévue au chapitre V du titre IV du livre VI du code de commerce est ouverte, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 645-1 du même code et sous les réserves prévues aux deuxième et troisième alinéas du même article L. 645-1 ainsi qu’à l’article L. 645-2 dudit code, à toute personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 640-2 du même code, en cessation de paiement et dont le redressement est manifestement impossible, qui n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’État.
Dans le cas où le débiteur a employé un ou plusieurs salariés au cours des six derniers mois, la procédure de rétablissement ne peut être ouverte que si toutes les créances salariales exigibles ont été payées à la date où le tribunal statue.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Cette façon d’amender ce texte présenté par Mme Sophie Taillé-Polian et ses collègues est une procédure quelque peu cavalière, mais elle est aussi le moyen de faire passer un certain nombre d’idées et de propositions.
Ce premier amendement vise à étendre la procédure de rétablissement qui existe pour les TPE. Plus précisément, il s’agit d’en élargir le bénéfice aux entreprises de moins de dix salariés, ce qui permettrait à mon sens de sauver un certain nombre d’entre elles, victimes de la crise sanitaire.
Les créances salariales, mon cher collègue Fabien Gay, seront évidemment protégées, comme il est prévu dans le dispositif, de manière tout à fait légitime.
La Haute Assemblée gagnerait à adopter cette disposition.
Cet amendement d’appel vise surtout à engager la discussion puisqu’on sait que le texte ne devrait pas prospérer outre mesure.
Sur le fond, la procédure de rétablissement professionnel doit permettre à des débiteurs, personnes physiques, de bénéficier d’un effacement de leurs dettes, tout en poursuivant leur activité. Il s’agit d’une procédure simplifiée, soumise à des conditions tenant notamment au montant de l’actif déclaré par le débiteur.
Il est important de rappeler que le Gouvernement a souhaité étendre la possibilité pour les petits débiteurs d’utiliser cette procédure en rehaussant la valeur de l’actif en deçà duquel le débiteur est éligible à cette procédure. C’est notamment ce que prévoit l’article 6 de l’ordonnance du 20 mai 2020.
Cette mesure, favorable à l’utilisation de la procédure de rétablissement professionnel, a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 par la loi du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique. Elle permet donc à la personne physique de poursuivre et d’exercer une activité indépendante, malgré la cessation des paiements, sans restreindre son activité professionnelle à une activité salariée.
Le Gouvernement reste réticent à l’idée d’étendre le bénéfice de cette procédure aux personnes morales. En effet, cette ouverture présente des risques liés au contournement des règles applicables à la liquidation judiciaire et nécessite donc une étude d’impact approfondie.
On peut craindre que certains dirigeants, dont le comportement appellerait d’éventuelles sanctions, puissent contourner les règles applicables en demandant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel pour effacer les dettes de leur entreprise sans contrôle suffisant.
Ces quelques éléments de réponse permettront de nourrir une réflexion plus générale sur l’amélioration des procédures des tribunaux de commerce au service des entreprises en difficulté.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

En tant qu’ancien directeur général d’une chambre de métiers et de l’artisanat, je tiens à dire tout l’intérêt de cet amendement. De mon point de vue, ce n’est pas un amendement d’appel. S’il était adopté, il permettrait à n’en pas douter d’améliorer la situation de nombreux artisans qui connaissent des difficultés en cette période de crise, sachant que cette dernière risque de durer.
Même si, comme l’a dit Mme la ministre, aucune étude d’impact n’a été réalisée, la procédure de rétablissement offre un certain nombre d’avantages. J’aurais aimé que nous puissions en discuter au sein de la Haute Assemblée et que nous puissions adopter l’amendement, le cas échéant, afin que l’Assemblée nationale et le Sénat aient un souvenir commun sur ce sujet, même si le texte n’est pas appelé à prospérer.

J’ai bien entendu ce que vient de dire André Reichardt. Je pense tout de même qu’une étude d’impact est nécessaire. Il faut en effet rappeler que les entreprises françaises comptent six salariés en moyenne. Adopter un tel amendement, même si son dispositif est assez protecteur, pourrait créer des difficultés majeures aux personnes morales. Ce problème mérite à mon sens que l’on aille plus loin dans la réflexion.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, avant l’article 1er.
L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet, Vérien et C. Fournier, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La Banque de France intègre dans ses enquêtes toutes les informations liées à l’application éventuelle des dispositifs pris dans le cadre de l’urgence sanitaire. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Dans la mesure où Mme la ministre a déjà répondu de nombreuses fois à cette proposition, je retire mon amendement.
L’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est ratifiée, sous réserve des modifications prévues à l’article 2 de la présente loi.

L’article 1er met en exergue l’immense problème que constitue l’accroissement du recours aux ordonnances par ce gouvernement : 115 ordonnances ont déjà été publiées en 2020 et 232 depuis le début de la législature. Tous les records vont être largement battus !
Cette inflation normative par le biais d’ordonnances sur des sujets qui sont de moins en moins techniques est problématique et révélatrice de la vision qu’a l’exécutif du législateur.
En outre, ce qui choque, c’est que ces ordonnances sont loin d’être toutes ratifiées : le Gouvernement fait voter au Parlement une habilitation à prendre par ordonnances des mesures sur des sujets de plus en plus importants, puis signe lesdites ordonnances et dépose les projets de loi de ratification ; mais, très souvent, il n’inscrit pas ces projets de loi à l’ordre du jour, alors qu’il en a pourtant la maîtrise.
Certes, il y a l’urgence sanitaire cette année, mais légiférer autant par ordonnances sans procéder à la ratification expresse de celles-ci inquiète sur la réalité du système de contrôle et d’équilibre des pouvoirs prévu par notre Constitution.
Notre assemblée s’est d’ailleurs saisie du problème via une délégation chargée du travail parlementaire, qui s’est vue logiquement confier la mission de contrôle et de suivi des ordonnances. Je trouve regrettable que les sénateurs doivent, comme aujourd’hui, prendre sur leur temps d’initiative parlementaire pour avoir une discussion avec le Gouvernement à ce sujet et disposer d’un temps d’échange, pourtant promis lors du vote de l’habilitation.
Applaudissements sur les travées d u groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe SER.

Je vous rappelle que la commission est défavorable à cet article, qui vise à ratifier l’intégralité de l’ordonnance du 20 mai 2020. Le Parlement ne saurait ratifier cette ordonnance sans un examen plus approfondi qui dépasse le cadre de cette proposition de loi.
L’ordonnance du 20 mai 2020 comprend de nombreuses dispositions, dont certaines ont appelé des réserves de la part de nos collègues François-Noël Buffet et Patrick Kanner, rapporteurs de la mission de suivi de la commission des lois sur la mise en œuvre de l’état d’urgence sanitaire.
L ’ article 1 er n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 2 rectifié quater, présenté par Mmes N. Goulet et Loisier, MM. Le Nay, Moga et Canevet, Mmes Férat, Dindar et Billon, M. Delahaye et Mmes Doineau, Vérien, Gatel et C. Fournier, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, le privilège du Trésor mentionné à l’article 1920 du code général des impôts, l’hypothèque légale mentionnée à l’article 1929 ter du même code ainsi que le privilège mentionné à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale sont inefficaces, nonobstant leur inscription, en cas de liquidation judiciaire du redevable, lorsque celui-ci était éligible, à la date d’ouverture de la procédure, au fonds de solidarité prévu à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
L’article 7 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19 est abrogé.
L ’ article 2 n ’ est pas adopté.

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’ensemble de la proposition de loi.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 46 :
Le Sénat n’a pas adopté.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (proposition n° 321 [2019-2020], texte de la commission n° 177, rapport n° 176).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
Madame la présidente, madame le rapporteur, chère Monique de Marco, mesdames, messieurs les sénateurs, après son examen en première lecture à l’Assemblée nationale le 14 février dernier, la proposition de loi du député Paul Molac relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion est aujourd’hui discutée par votre Haute Assemblée.
Cette proposition de loi nourrit une ambition que nous avons tous en partage et qui figure depuis 2008 en toutes lettres dans notre Constitution, à l’article 75-1 qui dispose : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. »
Par ces mots, ce sont les attaches et les cultures de nos concitoyens qui sont reconnues. Par ces mots, ce sont les richesses des pays et des langues qui ont été et sont pleinement considérées comme parties prenantes de l’identité de chacun d’entre nous.
Comme la philosophe Simone Weil l’écrivait, nous savons que « l’enracinement est peut-être [notre] besoin le plus important et le plus méconnu. Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines. »
Très souvent, dans mes fonctions de ministre de l’éducation nationale, je suis amené à dire que nous devons donner « des racines et des ailes » à nos enfants, et que la question de leur ancrage dans la nation française est fondamentale. Nous devons d’abord et avant tout dire à nos enfants qu’ils sont les enfants de la République : ce message n’est non seulement pas incompatible, mais se nourrit des appartenances locales qui sont évidemment aussi la sève de notre beau pays.
Aucune société ne se projette avec confiance dans l’avenir sans de tels attachements. Tel est d’ailleurs le projet même de notre école : donner à chaque enfant des racines, par la transmission des savoirs des siècles passés, et lui donner des ailes, par l’accès aux connaissances les plus modernes.
C’est bien pourquoi, comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, je suis un partisan de l’enseignement des langues régionales : il est pour moi évident que les langues de nos régions figurent parmi les trésors culturels que compte notre pays ; j’ai également la conviction qu’elles contribuent à l’accomplissement intellectuel et sensible d’un être humain.
Dans mes différentes fonctions, j’ai eu à promouvoir les langues régionales, notamment comme recteur de Guyane. Je considère en effet que la diversité linguistique est de la plus haute importance : elle fait partie, d’une certaine façon, de ce que l’on appelle parfois la biodiversité de la vie humaine.
L’éducation nationale s’est pleinement saisie de cette richesse pour la proposer à nos élèves et la faire vivre. C’est pourquoi l’on ne doit jamais caricaturer ni notre pays ni notre système éducatif comme étant hostile aux langues régionales : ce n’est pas vrai !
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 514 professeurs sont aujourd’hui titulaires du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré (Capes) section langues régionales : basque, breton, catalan, corse, créole ou occitan-langue d’oc. Rappelons à cet égard qu’une agrégation des « langues de France » est ouverte depuis la session 2018, et que sept enseignants étaient agrégés de cette discipline en 2019.
Tous ces professeurs permettent aujourd’hui à 170 000 de nos élèves d’apprendre une langue vivante régionale. Chaque jour, nous nous attachons à faire progresser ce chiffre en proposant un parcours cohérent depuis l’école jusqu’au lycée.
J’en veux pour preuve la place ménagée aux langues régionales dans la réforme du lycée général et technologique.
Aujourd’hui, avec le nouveau lycée, un élève peut choisir de suivre un enseignement de langue et de culture régionales : tout d’abord, comme langue vivante B, avec un coefficient plus important qu’avant notre réforme – 6 sur 100 contre 2 sur 40 auparavant –, ce qui est le cas pour 4 367 élèves ; mais aussi comme langue vivante C, dans le cadre d’un enseignement optionnel, ce qui est le cas pour 3 389 élèves ; et, enfin, comme enseignement de spécialité sur le cycle terminal, avec des programmes riches et ambitieux adossés à des coefficients importants – 16 sur 100 au baccalauréat : 134 élèves de première sont concernés, et nous attendons les chiffres pour la terminale.
Nous avons donc démultiplié les possibilités d’apprendre une langue régionale au lycée, en maintenant les mêmes volumes horaires pour l’offre déjà existante et, surtout, en proposant, avec les nouveaux enseignements de spécialité, des horaires importants qui permettent aux élèves de découvrir de manière approfondie les caractéristiques, tant des langues que des cultures régionales.
J’ai entendu les critiques sur les difficultés que rencontreraient certains lycéens pour suivre un enseignement en langue régionale. Assurément, nous pouvons çà et là améliorer l’offre et le maillage, et je continuerai à m’y employer.
Pour autant, sachons tirer le bon diagnostic de la situation actuelle : les demandes des élèves et des familles sont en constante baisse, et ce indépendamment du nouveau lycée. Nous le savons tous, il n’est pas possible d’envisager des classes à un, deux ou trois élèves. Il faut donc agir pour susciter et stimuler la demande.
Le numérique nous donne aujourd’hui la capacité de répondre à ce défi, en endiguant la baisse constatée, voire – j’en suis convaincu – en encourageant une nouvelle dynamique.
J’ai donc demandé au Centre national d’enseignement à distance (CNED) de concevoir, pour la rentrée 2021, des parcours pour les élèves intéressés par le basque, le breton, le corse et l’occitan. Ils disposeront ainsi d’une offre de formation de qualité, qui pourra s’appuyer sur un accompagnement dans leur établissement par un professeur aux compétences reconnues.
Nous pouvons également progresser dans d’autres domaines. Je pense à la formation initiale, et en particulier à des modules spécifiques pour l’enseignement du bilinguisme.
Notre action n’est pas isolée : elle est pleinement concertée avec les acteurs et les défenseurs des langues régionales, qui siègent dans les conseils académiques des langues régionales, et qui font vivre ces langues au sein des offices publics de langue régionale.
Ces différents éléments, mesdames, messieurs les sénateurs, n’en sont que quelques-uns parmi d’autres que je pourrai développer tout à l’heure. Ils vous auront cependant permis de mesurer l’engagement de notre ministère pour la promotion des langues régionales.
Alors, pourquoi avoir supprimé les articles 3 à 7 de cette proposition de loi, qui portaient justement sur l’enseignement des langues régionales ?
J’ai eu l’occasion de le dire à l’Assemblée nationale le 14 février dernier, et je le redis aujourd’hui : les différents sujets traités dans ces articles ont déjà été discutés voilà plus d’un an dans le cadre de la loi pour une école de la confiance. Le Parlement a donc déjà tranché.
Sur d’autres aspects, plusieurs articles et amendements étaient de pure forme. Ils étaient la plupart du temps déjà satisfaits.
Aujourd’hui, nous abordons de nouveau un texte sur lequel plusieurs arguments ont été développés. L’un d’entre eux concerne l’enseignement dit « immersif », sur lequel je voudrais revenir un instant.
J’ai souligné tout à l’heure mon attachement à la reconnaissance et au développement de l’enseignement des langues régionales. Mais, en ce domaine, l’exigence d’équilibre s’impose et, en matière d’enseignement, cet équilibre doit se manifester à travers le respect des deux langues enseignées, qui peut aller jusqu’à la parité horaire dans le cadre de l’enseignement bilingue.
L’enseignement des langues régionales est un aboutissement et l’expression de notre idéal français, celui que nous avons construit au travers de notre histoire, et qui consiste précisément en une juste articulation entre la Nation et le pays, entre l’ambition de partager une même langue, de porter un message et des valeurs qui nous élèvent en tant que Français, et la reconnaissance bien légitime de nos attaches.
Le sujet n’est pas nouveau, nous le savons : il a déjà été éclairé par un avis du Conseil d’État en 2002. Je m’y tiendrai scrupuleusement, et je m’y tiendrai d’autant plus que je suis convaincu que les premières années d’apprentissage du français sont absolument fondamentales : c’est cette même conviction qui m’a conduit à défendre l’abaissement de l’instruction obligatoire à trois ans.
Aussi, l’expérimentation d’un enseignement immersif doit rester l’exception, une exception issue d’une demande légitime et soumise à un cadre, un protocole, une régulation et une durée déterminés.
Il ne s’agit donc pas d’une opposition de principe, mais de faire valoir notre grande priorité, qui est aussi un devoir à l’égard des enfants, à savoir la qualité de l’enseignement du français pour tous nos élèves.
Mesdames, messieurs les sénateurs, vous l’aurez compris, j’aborderai la proposition de loi qui est au centre de nos échanges aujourd’hui avec une ambition et des exigences chevillées au corps : l’ambition de faire mieux pour la promotion et l’enseignement des langues régionales, l’exigence du discernement et de la mesure, afin de garder toujours à l’esprit les efforts déjà déployés et le nécessaire respect de nos différents engagements et, enfin, l’intérêt des élèves et le respect du cadre juridique, qui constituent nos boussoles.
Je ne doute pas que nous partagerons ces exigences dans le cadre des discussions utiles et passionnantes qui vont suivre et qui doivent bien entendu nous unir.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Elles constituent une richesse culturelle, patrimoniale et linguistique pour notre pays.
Le ministère de la culture en dénombre une vingtaine en France métropolitaine, et plus d’une cinquantaine dans les territoires d’outre-mer. Toutefois, ces langues sont aujourd’hui menacées. Selon le classement de l’Unesco, les langues de France sont soit vulnérables, soit en danger, soit sérieusement en danger.
Un premier constat peut être dressé : nous connaissons très mal le nombre de locuteurs de langues régionales. La dernière enquête nationale date du recensement de 1999. L’Insee avait alors évalué à 5, 5 millions le nombre de personnes déclarant que leurs parents leur parlaient dans une langue régionale. C’était il y a plus de vingt ans, soit une génération. Quelle est la pratique de ces langues aujourd’hui ?
Certes, des collectivités territoriales, comme la région Bretagne, chère à Sylvie Robert, Ronan Dantec et bien d’autres, ou des associations ont pris l’initiative de lancer des études sur le nombre de locuteurs. Par exemple, l’occitan, dans l’ensemble de ses variantes, serait parlé par un million de locuteurs. Mais il nous manque une vision nationale actualisée.
Comment construire une politique ambitieuse de promotion des langues régionales si nous ne disposons pas d’une connaissance précise du nombre de locuteurs et de la situation de chaque langue ? Monsieur le ministre, il me semble important qu’une nouvelle enquête nationale soit lancée.
Cependant, même en l’absence de données précises, chacun s’accorde à dire que la pratique des langues régionales est en baisse.
Si la pratique des langues régionales ultramarines résiste bien, tout comme celle du breton et du basque, la pratique des autres langues connaît une forte diminution. À titre d’exemple, en l’espace de vingt ans, le nombre de locuteurs du flamand occidental a été divisé par deux, en raison du manque de soutien politique. Et encore, cette langue régionale a la chance d’être transfrontalière et de bénéficier du dynamisme linguistique en Belgique.
Mes chers collègues, prenons conscience de la situation d’autres langues régionales qui ne sont pratiquement plus transmises dans le cercle familial, qui ne peuvent pas s’appuyer sur un vivier linguistique transfrontalier et qui ne bénéficient pas d’un volontarisme politique pour les promouvoir et les défendre.
Deuxième constat : la valorisation et la promotion des langues régionales passent par leur utilisation et leur transmission. Le service public via France Télévision et Radio France propose des programmes bilingues ou en langue régionale. Peut-être pourraient-ils être plus nombreux…
Mais surtout, notre commission a souligné l’importance des radios associatives en langue régionale, qui participent activement à leur utilisation et, donc, à leur promotion.

Lors de l’examen du projet de loi de finances, le Sénat a adopté un amendement visant à les soutenir, dont le coût est estimé à 3, 5 millions d’euros. J’espère que cette disposition sera maintenue dans le texte – au moins en partie – après la réunion de la commission mixte paritaire.

Troisième constat : aujourd’hui, sauf pour quelques langues, la transmission ne se fait plus dans le cercle familial. L’école est le principal vecteur de transmission des langues régionales.
Aussi la commission a-t-elle regretté qu’un texte visant la promotion des langues régionales nous soit transmis amputé de ses principales dispositions relatives à l’enseignement des langues régionales. C’est pourquoi la commission a donné un avis favorable à plusieurs amendements tendant à encourager et à faciliter leur enseignement.
Nous ne pouvions pas laisser passer l’occasion de nous emparer de ce sujet à l’occasion de l’examen de la proposition de loi de Paul Molac. D’ailleurs, la thématique des langues régionales avait animé le Sénat lors de l’examen du projet de loi pour une école de la confiance. Notre collègue Max Brisson, dont chacun connaît l’attachement à la langue basque, et qui était rapporteur de ce texte, peut en témoigner.
M. Max Brisson acquiesce.

Monsieur le ministre, plusieurs intervenants nous ont par ailleurs alertés sur les conséquences de la réforme du baccalauréat pour l’enseignement des langues régionales. Les difficultés relèvent principalement de l’échelon infralégislatif. Votre ministère a donc la possibilité d’agir rapidement pour promouvoir les langues régionales.
Je pense tout d’abord à la comptabilisation des notes des épreuves de langue régionale pour le baccalauréat. Serait-il possible que le mode de calcul appliqué au latin et du grec ancien le soit également aux langues régionales ? Ces deux langues anciennes sont les seules options pour lesquelles le bonus des points au-dessus de la moyenne est maintenu. De plus, ces points sont affectés d’un coefficient de 3.
Par ailleurs, je suis avec intérêt la réflexion en cours pour développer, via le CNED, un enseignement à distance des langues régionales. Un tel dispositif permettrait à un élève de présenter cette matière au baccalauréat, même si l’enseignement n’est pas proposé dans son établissement ou s’il n’a pas pu le suivre. Il pourrait également intéresser un public plus large souhaitant se former à une langue régionale. J’espère que cette démarche pourra aboutir.
J’en viens enfin à mon quatrième et dernier constat : par méconnaissance, mais aussi par manque de volontarisme politique, les nombreux outils de promotion et de valorisation des langues régionales ne sont pas suffisamment exploités.
Aussi, ce texte vise à préciser l’articulation entre le français et le recours aux langues régionales. Il a également pour objet de lever les ambiguïtés sur l’utilisation des langues régionales dans l’espace public et pour les actes d’état civil.
Le Conseil constitutionnel l’a clairement indiqué dans sa décision relative à l’emploi de la langue française de 1994 : l’usage des traductions, notamment en langue régionale, est possible dès lors que l’utilisation de la langue française est assurée.
Néanmoins, dans les territoires, on constate de nombreuses interrogations sur la possibilité de recourir à des traductions en langue régionale. Il me paraît important d’apporter une réponse juridique claire à tous les promoteurs de ces langues.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est désormais urgent d’agir pour promouvoir les langues régionales. Sans volontarisme politique fort, la plupart de ces langues auront disparu dans quelques dizaines d’années ou seront vues comme des curiosités historiques. Cette proposition de loi doit leur permettre de rester un patrimoine vivant de notre pays.
Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER, INDEP et Les Républicains.

Mes chers collègues, je tiens simplement à vous informer qu’un amendement de suppression de l’article 9 a été déposé très tardivement par le Gouvernement.
N’ayant pas pu réunir la commission avant l’ouverture de la séance publique, je vous propose de nous retrouver après que Mme la présidente aura suspendu la séance – peut-être vers treize heures ou treize heures quinze. Nous n’en aurons vraisemblablement pas pour très longtemps, mais il nous faut tout de même le temps suffisant pour l’examiner.

Monsieur le président, mes chers collègues, pour votre bonne information, je compte suspendre la séance à treize heures.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Lucien Stanzione.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi est une nouvelle occasion d’opposer les jacobins centralisateurs aux girondins défenseurs de la diversité culturelle et linguistique.
Le principe d’une République une et indivisible s’applique jusque sur le plan linguistique. Pourtant le bilinguisme français-langues régionales est une vraie richesse au niveau intellectuel et éducatif.
Les jeunes Français ne sont pas les plus brillants en langues étrangères, mais un jeune bilingue français–langues régionales aura beaucoup plus de facilité pour apprendre plus vite et mieux une troisième, voire une quatrième langue.
À l’heure de l’Europe des régions et de la mondialisation, le jacobinisme est un réflexe de peur et de repli sur soi. La rupture avec ce jacobinisme a été amorcée à la fin des années 1970, mais c’est surtout l’engagement des socialistes qui a permis de faire entrer cette question dans le débat politique. De nombreuses avancées ont pu voir le jour, notamment sous la présidence de François Mitterrand.
Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a pu réaffirmer son attachement aux langues régionales, comme en témoignent la reconnaissance de l’enseignement bilingue dans la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République en 2013, la participation financière dans la loi NOTRe, la proposition de loi des députés socialistes de 2016, cosignée par le député-rapporteur Paul Molac, et la proposition de loi relative à l’installation de panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération en langue régionale, adoptée par le Sénat – et pas par l’Assemblée nationale.
Pourquoi sommes-nous tant attachés aux langues régionales ? Parce qu’une langue qui meurt entraîne la perte irrémédiable de la connaissance et d’une part de notre identité, dans le domaine culturel, historique et environnemental.
Chaque langue témoigne de l’expérience humaine. La maîtrise des langues apporte une réponse aux questions fondamentales de demain.
Or une évolution est en cours, lente et insidieuse. L’anglais et les anglicismes envahissent de plus en plus la langue française. Certains linguistes y voient, au mieux une perte des repères culturels, au pire une rampante victoire idéologique du libéralisme anglo-saxon. Défendre nos langues régionales, c’est donc défendre nos valeurs, comme héritage direct de notre histoire.
Les langues régionales consacrent la pluralité et la diversité de nos territoires.
La proposition de loi soumise à notre examen aujourd’hui est importante : elle institue la reconnaissance de l’intérêt patrimonial des différentes langues régionales, qui bénéficieront désormais d’actions de conservation et de promotion.
Une langue, c’est une perception du monde, une école de pensée, une culture.
Une langue, c’est une façon de vivre, de percevoir et de transmettre le monde. C’est le vecteur d’un héritage, d’une histoire passée, mais aussi celui de la transmission des conditions d’un renouveau dans notre conception de la Nation.
Les langues régionales sont une partie intégrante de notre patrimoine et leur richesse culturelle construit notre identité. Toutes les langues, quelles qu’elles soient, offrent un témoignage unique de notre génie culturel.
Afin de préserver la diversité linguistique de notre pays, l’usage et la présence au quotidien de nos langues régionales sont cruciaux.
Si les domaines de l’état civil et de l’espace public abordés dans cette proposition de loi en sont deux composantes essentielles, le champ de l’éducation ne doit pas être négligé.
Les amendements qui ont pris corps lors de nos échanges en commission, concernant l’extension du dispositif appliqué en Corse et la suppression du caractère volontaire de la contribution financière, ont été repris. Notre groupe les fait siens.
Vous l’aurez bien compris, monsieur le ministre, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain appuie ce texte avec force.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et GEST.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, charmes de la France métropolitaine et de nos outre-mer, nos langues régionales sont les accents variés de notre langue nationale. Elles sont les rivières qui viennent se jeter dans l’océan français.
Les articles 3 et 7, à l’origine de cette proposition de loi en faveur de l’enseignement bilingue, étaient les plus engageants pour l’État. Ils ont disparu depuis. Toutefois, il existe déjà de nombreuses dispositions dans la loi qui vont dans ce sens.
Par ailleurs, nous constatons que le niveau de l’enseignement de la langue française est en baisse constante. Il est urgent que nos enfants apprennent le français autrement que par la méthode globale, qu’ils écrivent autrement que par les SMS et qu’ils ne soient plus soumis au verbiage abrutissant de musiques « urbaines » qui riment avec « haine », haine de tout ce qui fait la France, y compris sa langue.
Exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.

Faite de subtilités, celle-ci est l’expression de notre culture commune, l’actrice ô combien vivante et vivace de notre histoire.
La langue dit qui l’on est, d’où l’on vient. Elle est un élément essentiel de la cohésion nationale. Clovis, qui étendit ses États de la Loire jusqu’au Rhin, parlait germanique et ce fut la rencontre avec le latin des Gallo-Romains qui donna naissance à la langue francique, jusqu’à l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, par laquelle le roi François Ier imposa le français pour la rédaction des actes légaux et notariés. Mais il faut attendre la fin du XIXe siècle pour qu’il devienne la langue de tous les Français.
Écouter la langue française, c’est entendre l’histoire de France ! Parler français, c’est rendre hommage et faire honneur à ceux qui ont fait notre pays !
Notre patrimoine linguistique est varié, il faut le valoriser. Il faut que nous soyons capables de valoriser également l’enseignement des langues latines et grecques dans nos écoles, car elles sont le cœur sémantique de notre langue.
Mais c’est la même République qui a fait interdire le provençal dans les cours d’école pour imposer l’unité nationale, qui veut désormais imposer l’enseignement de la langue arabe pour mieux valoriser l’autre. Quand la haine de soi va jusqu’à l’ethno-masochisme…
Protestations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.

Le français s’enrichit de la diversité linguistique de ses territoires. Les langues régionales rappellent à chaque région leurs réalités historiques, géographiques et identitaires. Un Provençal n’est pas un Breton, qui n’est pas un Corse, qui lui-même n’est pas un Martiniquais. Si tous sont fiers de leur petite patrie, tous s’unissent en admettant qu’elle ne saurait être au-dessus de la grande.
Félix Gras, disciple de Frédéric Mistral, nous rappelle cette nécessaire hiérarchie du sentiment d’appartenance : « J’aime mon village plus que ton village, j’aime ma Provence plus que ta province, j’aime la France plus que tout ! » Il est là, le génie français !
Accordons dès lors à nos territoires, à nos communes la possibilité de promouvoir nos langues régionales. Dans le fracas de l’uniformisation imposée par la mondialisation et face à la montée du communautarisme sous perfusion migratoire, pour que le français ne soit pas une langue morte, il faut que vivent nos langues régionales ! Il y va de l’intérêt culturel local et de notre patrimoine national !
Marques d ’ impatience sur les travées du groupe SER, où l ’ on fait remarquer à l ’ orateur qu ’ il dépasse son temps de parole.

Pour conclure, madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, en cette fin d’année 2020, comme nous le disons encore au Roudelet Felibren et au groupe Saint Éloi de Casteou Gombert : « Vous souvet en tòuti de fruchous fest calendale, un bouan bout d ’ an, e esper tamben pér dous mille vint un que se sian pas mai, que siguen pas mén. »
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, chère Monique de Marco – dont je voudrais saluer la qualité du travail –, mes chers collègues, ni la France ni la République n’ont eu de rapports faciles avec les langues de nos territoires qualifiées de « régionales ».
Celles-ci furent longtemps le symbole de la France restée celle du cheval de trait, archaïque, voire réactionnaire. Beaucoup de nos langues, appelées alors avec plus ou moins de mépris « patois », ne résistèrent pas au rouleau compresseur de la modernité.
L’école a contribué à ce recul. Mais l’urbanisation et la télévision jouèrent finalement, à partir des années 1950 et 1960, un rôle au moins tout aussi grand dans la rupture de la transmission familiale.
Pour autant, nous ne sommes plus en 1950. Nos langues, au moins là où elles ont survécu, si elles ne sont pas autant parlées dans les rues de nos villages et encore moins de nos villes, le sont désormais à l’école, où elles furent longtemps interdites : une inversion de situation, caractérisée par un recul de nos langues dans la société, mais par une irruption salvatrice à l’école.
Devons-nous le relever et le saluer ? Oui, monsieur le ministre !
Devons-nous nous en contenter ? Non, monsieur le ministre !
Car c’est sur l’école que reposent, désormais, la préservation et le développement de nos langues. C’est un renversement historique !
Or si l’institution scolaire a fait des efforts, elle n’a jamais intégré la notion de politique linguistique et son objectif final, la production de locuteurs complets, sachant vivre et travailler dans leur langue. Dans nos territoires, l’éducation nationale a trop souvent un train de retard, car elle n’intègre pas le réveil des langues, la demande sociale et l’appétence des jeunes générations pour ce qui est un élément du réveil des territoires.
Au Pays basque par exemple – je le dis sous le contrôle de Frédérique Espagnac –, nous avons compris depuis longtemps que les territoires sans identité étaient des territoires sans projet.
La langue appartient certes au patrimoine, mais elle est d’abord un facteur d’attractivité, et finalement, loin d’une approche muséographique et nostalgique, elle s’inscrit pour nous comme un facteur de modernité. Elle est aussi, loin des fantasmes jacobins, un vecteur d’intégration, de solidarité et de préservation du tissu social, dans un pays où il se délite si souvent.
Dans ces conditions, s’il faut féliciter Paul Molac pour sa proposition de loi – et je tiens à saluer sa présence dans nos tribunes –, il faut regretter que l’Assemblée nationale ait exfiltré tous les articles du texte qui concernaient l’enseignement, comme s’il pouvait y avoir une politique en faveur des langues régionales sans renouveler, fortifier, conforter la transmission via l’école.
Depuis la loi Deixonne, ce n’est en effet que par les marges que l’éducation nationale aborde le sujet, en annexe de lois majeures pour l’école ou les collectivités, comme la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République, la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ou encore la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Dans toutes ces lois majeures, les langues régionales sont un sujet mineur.
Parallèlement, mes chers collègues, la loi, dite Toubon, du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, pourtant voulue pour lutter contre l’anglomania, fut rarement utilisée face à la percée de l’impérium anglo-américain, mais très souvent contre les langues de France.
Combien de fois ai-je entendu préfets, recteurs, directeurs académiques des services de l’éducation nationale (Dasen) se draper dans cette loi de 1994, trahissant la volonté du législateur à tel point que mon ami Alain Lamassoure m’indiquait un jour que, s’il avait su comment cette loi serait instrumentalisée, il ne s’y serait pas associé.
Je conclurai en disant mon soutien à cette proposition de loi, qui rappelle l’État à ses obligations : préservation de ce patrimoine immatériel, sécurisation juridique de la présence des langues régionales dans les espaces publics, utilisation des signes diacritiques, cadrage de la loi Toubon.
Il faudra aussi parler de l’école, et ce sera l’objet des amendements que nous défendrons.
Nos langues de France sont une richesse. Le pays qui prône, ou du moins prônait, l’exception culturelle ne peut laisser dépérir ce trésor inestimable.
Le développement durable, c’est la transmission aux générations de demain d’un capital naturel et humain. Il est de la responsabilité de notre génération d’assurer cette transmission, pour les générations futures.
Dans certains territoires de France, ce matin, au travers des élèves des réseaux Seaska, Diwan, la Bressola, des calendrettes, d’ABCM, ou ceux des écoles publiques et privées bilingues, en basque, breton, catalan, occitan, alsacien ou dans nos langues ultramarines, les générations futures nous regardent et attendent que nous soyons à la hauteur des générations qui nous ont précédés et qui aimèrent et parlèrent leur langue maternelle.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDSE, INDEP, SER et GEST.
M . Daniel Chasseing applaudit.

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, la France est un État historiquement multilingue. On y trouve de nombreux locuteurs de langues romanes, comme le français, l’occitan, le catalan, le corse, le francoprovençal, mais également de langues germaniques, comme l’alsacien, le flamand occidental et le platt deutsch, ou encore du basque et du breton – pour ne parler que de la France métropolitaine.
Le texte de notre collègue Paul Molac, présent dans nos tribunes, tend à considérer toute la pluralité des langues dans notre pays. Il importe de changer le regard que l’on pose traditionnellement sur les langues régionales. Ces langues sont au français ce que nos territoires sont à la France.
J’aimerais vous citer un tweet – excusez l’expression ! – sans équivoque du président de la République, en date du 21 juin 2018 : « Les langues régionales jouent leur rôle dans l’enracinement qui fait la force des régions. Nous allons pérenniser leur enseignement. » Aujourd’hui, après plus de deux années, nous débattons d’une proposition de loi, dont l’un des objectifs principaux est bien d’enseigner nos langues de France.
Ce texte, débattu en premier lieu à l’Assemblée nationale, a été vidé de sa substance avant d’arriver dans cet hémicycle. Nous pouvons le regretter. Toutefois, les amendements visant à redonner du corps à la proposition de loi, en rétablissant l’article 3 et en permettant le versement d’un forfait scolaire de l’enseignement bilingue, sont de bon ton et ambitionnent de donner une réalité, au sein de l’école de la République, à nos langues régionales. Nous serons nombreux à les soutenir.
La défense et la promotion des langues régionales, ce n’est pas une lubie ; c’est encore moins une revendication communautariste. Il faut sortir de ce paradigme. Le cœur de cette proposition de loi est bien d’inclure les langues régionales au sein de nos institutions, afin qu’elles participent à la vie de la cité. Nos concitoyens y sont attachés.
Il est important de soulever un point essentiel. Pour la réussite de tels projets, l’État doit associer les collectivités territoriales et leur laisser une marge de manœuvre. Bien entendu, ces dernières n’ont pas attendu pour s’organiser ! Localement, on constate que de nombreux acteurs sont investis dans la défense et la promotion des langues régionales, pour l’acceptation de leurs identités. Dans les Hauts-de-France, je veux souligner le soutien actif du conseil régional, avec, notamment, la création d’un office public du flamand occidental.
Nos langues régionales ont fait preuve d’une grande résilience, voire de résistance, et restent des réalités. Pourtant, il y a urgence à agir, avant qu’elles ne soient plus que des folklores destinés à mourir tôt ou tard.
Bien que la Constitution érige les langues régionales au rang de patrimoine de la France, ces langues ne doivent pas être mises sous cloche ni admirées comme des vestiges du passé. Comme l’a si bien dit notre collègue Paul Molac, « une langue ne s’abîme pas quand on la parle, mais uniquement quand on ne la parle pas » !
L’enseignement est la seule manière viable et de long terme pour protéger et promouvoir les langues régionales.
Jean Jaurès, dans la Revue de l ’ enseignement primaire du 15 octobre 1911, s’étonnait déjà qu’un enfant parlant l’occitan, avec un réflexe d’analogie et de comparaison, déchiffrât aisément le portugais, l’espagnol et même l’italien.
Les langues régionales étaient pour lui un moyen d’être « en harmonie naturelle, en communication aisée avec ce vaste monde ». En somme, l’apprentissage de la langue de sa région est un avantage pour mieux se lancer dans le monde. Je tiens à rappeler que, au sein de l’Union européenne, on dénombre plus de 60 langues régionales ou minoritaires.
Monsieur le ministre, avec un peu de bonne foi, ce qui se dessine dans la dernière réforme du lycée ouvre la possibilité de créer des cursus d’enseignement de certaines langues régionales.
Toutefois, il faut préciser que toutes ces langues ne sont pas logées à la même enseigne. Ces disparités sont parfois vectrices de frustrations et d’incompréhension. Je pense, bien entendu et vous le savez, au flamand occidental, toujours exclu de la circulaire de 2017 et votre collègue a encore botté en touche sur ce point, la semaine dernière, lors de la séance de questions orales.
À ce propos, je vous remercie, madame la rapporteure, de votre détermination.
La proposition de loi que nous examinons vise à pérenniser et valoriser une partie de notre culture et de nos patrimoines. En l’espèce, ce n’est pas la panacée. Les dispositions de ce texte vont dans le sens d’une plus grande reconnaissance de nos langues régionales, des particularités de nos territoires et de leurs habitants. Cela nous permet de rappeler à quel point notre pays est beau et fort de sa pluralité.
Le groupe Les Indépendants votera donc cette proposition de loi.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, née à Rennes, je suis aujourd’hui sénatrice du Finistère, mais je dois vous faire une confidence : je ne parle ni le gallo ni le breton.
Parfois, je tente. Parfois, je baragouine. D’ailleurs, « bara » signifie le pain, et « gwin » le vin : union de deux mots d’origine bretonne !
La langue, c’est un trésor. La langue, c’est une histoire.
Mais, à vrai dire, je ne parle pas non plus l’alsacien, le francique-mosellan, le basque, le créole, le corse ou l’occitan, pas plus que le catalan, le wallisien et futunien ou le tahitien. Quoique, sur le tahitien, j’aie bon espoir de pouvoir progresser grâce à mon collègue de groupe, Teva Rohfritsch – je m’y suis d’ailleurs récemment essayée, sur un réseau social, pour le féliciter d’une nomination.
En fait, je parle le français, et l’espagnol par mes origines familiales.
J’ai voulu consulter les autres membres de mon groupe sur la signification que revêtaient, pour eux, les langues régionales, et j’ai voyagé, de départements en régions, de souvenirs d’enfance en moments plus présents.
Sans les parler donc, j’essaierais toutefois, dans les quelques minutes dont je dispose, de rappeler leur appartenance à notre patrimoine commun et d’en défendre l’apprentissage, puisque tel est l’objet de la proposition de loi votée en première lecture à l’Assemblée nationale et dont un grand nombre d’articles a été adopté conforme par les membres de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Je voudrais expliquer pourquoi…
Partons, tout d’abord, d’une définition la plus simple possible : une langue régionale est, du point de vue géographique, parlée dans une région faisant partie de l’État, plus vaste. D’un point de vue historique, elle est parlée depuis plus longtemps que le français.
Partons, ensuite, d’un constat : la pratique des langues régionales, richesse linguistique de notre pays, est aujourd’hui en baisse. À ce propos, je cite le linguiste George Steiner, décédé en début d’année : « La mort d’une langue, fût-elle chuchotée par une infime poignée sur quelque parcelle de territoire condamné, est la mort d’un monde. Chaque jour qui passe s’amenuise le nombre de manières de dire “espoir”. »
Rappelons enfin ce qui doit être une évidence : notre attachement profond au principe d’unicité du peuple français et d’indivisibilité de la République. Ainsi peut-on lire, à l’article 2 de notre Constitution, « la langue de la République est le français ».
Toutefois, la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, a introduit un article 75-1, nouveau, portant la mention suivante : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » Là aussi, une évidence !
C’est un équilibre à trouver, dans un cadre qu’il nous faut préserver et par l’échange. J’oserai presque dire qu’il nous faut parvenir à ce « en même temps », mais suis-je dans la bonne assemblée pour cela ?
Lors de sa visite à Quimper en 2018, dix ans après la révision constitutionnelle, Emmanuel Macron avait affirmé vouloir soutenir les langues régionales.
Disons-le, l’école est le principal vecteur de transmission de ces langues. Des dizaines de milliers d’élèves suivent ces enseignements dans un cadre défini et, comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, lors de l’examen de la loi pour une école de la confiance : « Je me réjouis du foisonnement de nos langues […]. Il y a une langue de la République et il y a des langues de France et nous devons les soutenir. Notre politique volontariste pour la bonne maîtrise du français par tous les enfants peut très bien aller de pair avec une politique dynamique au service des langues régionales. » Je partage ce point de vue.
Depuis votre arrivée, l’offre a été renforcée face à la baisse massive, au collège et au lycée, des effectifs d’élèves étudiant ces langues.
La loi précédemment évoquée a étendu à l’enseignement privé les dispositions relatives à la prise en charge du forfait scolaire dans le cas où un élève s’inscrit dans une école située en dehors de sa commune de résidence pour y recevoir un enseignement en langue régionale.

Un amendement déposé par des parlementaires présents sur ces travées, et sensibles à ces questions, sera discuté ultérieurement, de même que sera abordée la question du conventionnement.
Notons que la réforme du baccalauréat veut faire une meilleure place aux langues régionales dans les épreuves de cet examen.
Mon groupe est attaché à la défense et à la reconnaissance des langues régionales comme partie de notre patrimoine immatériel. Nous sommes donc favorables, collectivement, à certaines dispositions, notamment aux articles 1er et 2. Nous sommes aussi tout à fait favorables à l’esprit de l’article 8, qui tend à renforcer la visibilité des langues régionales et leur immersion dans la vie quotidienne, gages de leur pleine transmission.
Les langues et cultures régionales sont structurantes pour les territoires, pour nos régions et pour leur attractivité. Elles en traduisent l’histoire, la culture. Elles sont un lien intergénérationnel et familial.
Chacun reconnaît l’intérêt du plurilinguisme pour le développement cognitif des enfants. L’ouverture à d’autres langues et cultures, qu’elles soient régionales ou étrangères, s’inscrit dans une démarche positive et ne remet pas en cause le français comme langue de la République. Surtout pas !
Le groupe RDPI soutiendra, en conséquence, cette proposition de loi.
Je conclurai par ces mots, mes chers collègues : Roomp harpe dor yezhoù rannvroel ! Soutenons les langues régionales ! Vive le français !

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelle langue parlerions-nous si la monarchie s’était installée à Toulouse ? L’occitan probablement !
Nous connaissons bien les conditions historiques de l’ancrage du français. Les monarques, de Louis XI à François Ier – et la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts –, puis les révolutionnaires de 1789 : tous ont convergé vers un même principe : consolider leur pouvoir par l’usage d’une langue unique. D’un côté, le français servait l’unité du royaume ; de l’autre, l’affirmation de la République.
Au début du XXe siècle, ce n’est pas si vieux, le français n’était pas encore partout la langue usuelle. Voilà cent ans, mon grand-père était instituteur en Aveyron. Il m’a raconté comment il accueillait des élèves qui ne parlaient pas la langue française. À la ferme, on ne parlait pas le français.
Parce que les langues régionales ont aussi constitué le symbole de la résistance au pouvoir central, un sentiment a longtemps perduré, une certaine méfiance à leur encontre.
Aujourd’hui, nous avons heureusement passé ce cap. Il est bien acquis que la République est indivisible : ce principe constitutionnel n’interdit pas pour autant la coexistence du français avec le parler de nos territoires. Les langues régionales ne sont plus considérées comme une menace dans notre pays, qui – disons-le – affronte bien d’autres questions fragilisant sa cohésion.
Plusieurs textes adoptés depuis la fameuse loi Deixonne de 1951 illustrent l’ouverture du législateur à la promotion des langues régionales. Face au risque de leur extinction, nous pouvons toutefois aller plus loin, comme le propose le texte de notre collègue député Paul Molac.
Est-il utile de rappeler ici, au Sénat, maison des collectivités locales, combien la diversité linguistique est une richesse ?
Je passerai vite sur l’impact positif du bilinguisme sur le développement cognitif des enfants. C’est une affaire de spécialistes ! Seulement par quelques mots, je dirai que les études tendent à démontrer tout le bénéfice de ce que les linguistes appellent « la conscience métalinguistique ».
M. François Bonhomme s ’ exclame.

Plus simplement, comme certains orateurs l’ont rappelé, les langues régionales sont avant tout constitutives de notre patrimoine. Elles alimentent la richesse de nos territoires, leur attractivité culturelle. Aussi mon groupe est-il plutôt favorable aux deux premiers articles de ce texte, dont le dispositif renforce la protection patrimoniale des langues régionales.
Si, en 2008, le législateur a intégré les langues régionales à notre Constitution, leur inscription au code du patrimoine marquerait en effet une étape supplémentaire pour leur valorisation et leur conservation.
L’usage d’une langue locale répond aussi à un besoin d’affirmation identitaire, dans un monde très ouvert où la perte des repères et des racines s’accélère. Là aussi, la proposition de loi apporte une réponse : je pense, en particulier, à l’article relatif à la faculté d’utiliser les signes diacritiques dans les actes d’état civil, ainsi qu’à l’article visant à conforter la traduction en langue régionale des inscriptions publiques.
Mais, parce qu’une langue meurt quand elle n’est plus parlée, il faut agir au niveau de la transmission de ces langues régionales, laquelle se fait de moins en moins au sein des familles. Cela pose la question de leur place dans l’enseignement.
À cet égard, la proposition de loi initiale était assez ambitieuse, peut-être un peu trop au regard des leviers déjà existants, et qui ne sont pas suffisamment exploités. Il suffit d’observer ce qui se fait dans certains départements, comme pour le basque, par exemple, dans les Pyrénées-Atlantiques. Le cadre juridique actuel permet déjà de très nombreuses initiatives !
C’est pourquoi mon groupe est favorable à l’idée de laisser se développer toutes les démarches participatives et actions décentralisées, en particulier avec l’appui des régions.
Mais nous pourrions aller plus loin, s’agissant de la participation financière des communes à la scolarisation, en prenant garde, toutefois, à ne pas fragiliser le tissu des petites écoles en milieu rural.
Enfin, mes chers collègues, le texte ne l’aborde pas, mais il y a d’autres moyens pour valoriser notre patrimoine linguistique. Je pense aux médias. Cette valorisation fait ainsi partie des missions de service public de France Télévisions et Radio France. Plus de 5 000 heures de programmes en langues régionales sont diffusées chaque année, via le réseau France Bleu, mais aussi des radios associatives. J’en profite pour rappeler combien il est important – je suis intervenu sur ce sujet lors de l’examen du projet de loi de finances – de soutenir les radios locales, très fragilisées par la crise sanitaire.
Mes chers collègues, attentif à tout ce qui valorise la diversité des territoires, le groupe du RDSE est favorable à la proposition de loi. Nous espérons qu’elle contribuera à faire vivre toutes nos belles langues locales.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré les difficultés méthodologiques de décompte, on estime aujourd’hui qu’un peu plus de 7 % de la population en France est locutrice régionale, contre un quart il y a cent ans.
Ce déclin, attribué à de nombreux facteurs, doit nous interroger.
Nous devons surtout nous rappeler notre histoire. Les langues régionales ont connu, dès la Révolution française, un sort particulier. D’abord promues en 1790, car permettant une meilleure compréhension des lois et décrets, elles ont pâti dès 1794 de la politique linguistique de la Convention qui, en imposant le français partout, souhaitait construire l’unité de la Nation.
Dans un pays où, à quelques centaines de mètres d’écart, on n’avait ni la même langue, ni la même monnaie, ni la même unité de mesure, c’était une nécessité.
La fragile Troisième République a poursuivi cette politique d’effacement des langues régionales. Ce faisant, elle souhaitait une nouvelle fois l’union nationale et la consolidation du régime républicain face aux particularismes.
Aujourd’hui, notre République s’est consolidée par l’unification de la langue et le renforcement de l’État national. La question des langues régionales doit donc se poser autrement. Il me semble qu’il faut réaffirmer qu’elles sont une richesse nationale. Elles témoignent tout à la fois de l’histoire de France et de la construction difficile de l’État : comment nous sommes passés de la féodalité à la République en passant par la monarchie centralisée ; comment un peuple divisé et cloué sur son sol a pu s’unir dans un projet commun ; comment ce dernier s’est aussi enrichi grâce à la diversité, notamment linguistique, de ses habitants.
Il est loin le temps où Voltaire, voulant se rendre à Uzès, se plaignait d’avoir besoin d’un traducteur. Le français lui-même s’est enrichi des langues régionales en intégrant, au sein de son vocabulaire et de sa grammaire, des mots régionaux. Le « maquis » corse rencontrait, grâce à ce cadre commun qu’est le français, le « béret » béarnais, la « brioche » normande ou le « guignol » arpitan.
Et c’est bien en intégrant, en captant ces mots que le français s’est enrichi, s’est implanté durablement et a suivi la vocation d’une langue vivante, à savoir évoluer.
Cette proposition de loi revêt donc une dimension symbolique très forte, d’autant plus que la majorité de ses articles sont déjà couverts, partiellement ou totalement, par le droit en vigueur.
On peut d’ailleurs le regretter. En effet, malgré les dispositifs existants, nous voyons bien les difficultés actuellement rencontrées pour pérenniser les langues régionales. Cela veut dire que la protection actuelle n’est pas assez efficace. À titre d’exemple, l’augmentation des moyens accordés à l’éducation nationale publique pour qu’elle multiplie les cursus de langues régionales et le développement des initiatives locales devient un enjeu central.
L’Assemblée nationale a judicieusement supprimé une partie des dispositions de la proposition de loi originale.
Oui, la défense des langues régionales en tant que richesses nationales est nécessaire. Dans ce cadre, il est central que les initiatives permettant d’apprendre et de parler ces langues soient soutenues. En ce sens, les associations régionales de médiation culturelle et linguistique font un travail remarquable qu’il me faut saluer.
Notre Constitution pose, en la matière, trois principes que je veux rappeler : premièrement, la République est une et indivisible, et ne saurait donc se morceler sur un modèle fédéral ; deuxièmement, sa langue est le français ; troisièmement, comme je l’ai développé plus haut, les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.
En l’état, cette proposition de loi trouve un juste équilibre, quoique précaire ; avec mon groupe, nous la soutiendrons.
Mes chers collègues, un consensus s’est dégagé au sein de notre commission – et se dégagera probablement dans notre hémicycle – sur les enjeux de ce texte. Nous avons tous à cœur de défendre ce qui a fait la beauté de ce pays, son ancrage et sa diversité. Toutefois, certaines lignes rouges doivent être maintenues : l’adoption d’amendements tendant à encore renforcer le soutien public aux écoles privées dénaturerait le texte et viendrait mettre à mal ce consensus. En cohérence avec nos positions, notre groupe serait alors contraint de revoir éventuellement son vote.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.