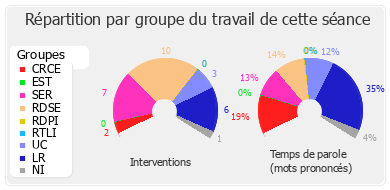Séance en hémicycle du 5 mai 2009 à 15h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Hommage à serge ravanel
- Communication relative à une commission mixte paritaire
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Débat sur la formation des hauts fonctionnaires de l'état (voir le dossier)
- Débat sur la politique de l'état en matière de gestion des ressources halieutiques et des pêches (voir le dossier)
- Dépôt d'un rapport
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quinze heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au moment même où les honneurs militaires sont rendus dans la cour d’honneur de l’hôtel national des Invalides à Serge Ravanel, compagnon de la Libération, je voudrais que nous ayons un instant une pensée pour ce héros de la Résistance.
Né sous le patronyme d’Asher, Serge Ravanel avait décidé de conserver son nom de guerre : la Résistance était en effet à ses yeux, comme pour nombre de ses compagnons, une refondation.
Cet élève de l’École Polytechnique a vingt et un ans en juin 1940 : il commence par distribuer la presse clandestine et des tracts. Il devient très jeune l’un des chefs de file des Mouvements unis de la Résistance, issus de la fusion, en janvier 1943, des trois grands mouvements de la zone sud : Combat, Franc-Tireur et Libération-Sud. À vingt-quatre ans, il est nommé par le commandant des Forces françaises de l’intérieur, le général Kœnig, chef des forces militaires de la région Midi-Pyrénées.
Compagnon de la Libération par décret du 18 janvier 1946, grand officier de la Légion d’honneur, tout au long de sa vie, Serge Ravanel a voulu réaffirmer l’« Esprit de Résistance », auquel il consacra un ouvrage ainsi que de nombreuses actions pédagogiques. Pour lui, cet esprit incarnait des valeurs qui, aujourd’hui, conservent un sens dans la République.
Je tenais, au début de cette séance, à évoquer la mémoire de Serge Ravanel.

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, ce rappel au règlement concerne le fonctionnement du Sénat en général et celui des commissions en particulier.
Depuis le 1er mars, les nouvelles dispositions de la Constitution sont entrées en application. On nous avait promis monts et merveilles : le rôle du Parlement serait revalorisé, les députés et les sénateurs auraient le temps de travailler en commission, de présenter des propositions de loi et de débattre en séance, les semaines d’initiative parlementaire permettraient aux parlementaires, à l’Assemblée comme au Sénat, de faire du bon travail…
Or, aujourd’hui, nous constatons qu’il n’en est rien. Et si les hémicycles ne sont guère remplis, ce n’est pas spécialement parce que les parlementaires sont des « cumulards », ou parce qu’ils passent leur temps à la piscine ou au golf ! C’est tout simplement parce qu’ils doivent faire mille choses en même temps : les commissions permanentes se réunissent toute la semaine et les auditions préalables à l’étude des projets de loi sont innombrables.
Il apparaît donc que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne portent pas les fruits que l’on nous promettait.
Je prendrai l’exemple du projet de loi « hôpital, patients, santé, territoires », qui est actuellement examiné par la commission des affaires sociales. Celle-ci y a travaillé quasiment jour et nuit la semaine dernière et hier encore jusqu’à une heure trente du matin ; il paraît même qu’elle a failli siéger le 1er mai : c’est dire si, en fin de compte, les parlementaires travaillent ! Malgré cela, nos collègues de la commission des affaires sociales ne sont pas en mesure d’aller vraiment au fond des choses.
Pourquoi ?
Mme la ministre de la santé assiste régulièrement aux réunions de la commission, comme elle en a le droit, et présente, au nom du Gouvernement, des amendements qui modifient parfois substantiellement le texte sans que les sénateurs aient pu en prendre préalablement connaissance. Cette procédure ne permet pas à la commission de travailler sereinement et il en ira vraisemblablement de même en séance publique, à partir de la semaine prochaine.
Par ailleurs, la commission tiendra sa dernière réunion jeudi à dix-huit heures pour examiner les amendements extérieurs, le délai limite de leur dépôt expirant ce même jour à dix-sept heures. Ce n’est pas ainsi que nous pouvons espérer avoir un débat approfondi sur ce projet de loi !
Enfin, après avoir déposé des amendements en commission, Mme la ministre en déposera de nouveaux en séance, qui s’appuieront sur les conclusions du rapport Marescaux, lequel n’a pas encore été remis…
Aussi pensons-nous, monsieur le président, que le Sénat doit réagir, après le précédent constitué par l’examen de ce projet de loi en commission des affaires sociales.
Le groupe socialiste a déjà demandé la levée de l’urgence afin que nous disposions vraiment du temps nécessaire pour travailler sur un texte aussi important, et nos collègues réitéreront cette demande lors de la discussion du projet de loi en séance publique.
Mais je pense surtout que devons accomplir un effort de réflexion – cette réflexion pourrait être amorcée en conférence des présidents – sur les moyens de faire en sorte que le travail en commission se déroule mieux. Au cours d’une semaine comme celle-ci, il est impossible aux sénateurs de répondre à toutes les convocations ou invitations qui leur sont adressées par leur commission tout en étant également présents dans l’hémicycle.
C’est pour vous alerter sur cette situation, monsieur le président, que j’ai souhaité, au nom du groupe socialiste, procéder à ce rappel au règlement.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Mon cher collègue, je vous rappellerai tout d’abord que nous vivons sous l’empire de nouvelles dispositions constitutionnelles, mais sans avoir encore adopté la révision de notre règlement.
Sur la base du rapport qui m’a été remis par le groupe de travail à l’issue de ses travaux, j’ai déposé, le jeudi 30 avril, une proposition de résolution tendant à modifier le règlement du Sénat pour mettre en œuvre la révision constitutionnelle, conforter le pluralisme sénatorial et rénover les méthodes de travail du Sénat ; elle devrait être discutée en séance publique au début du mois de juin.
Cette proposition de résolution prévoit notamment la possibilité, sur décision de la conférence des présidents, d’organiser un débat préalable en séance publique. Pour nous en tenir à l’exemple du projet de loi que vous avez cité, un tel débat serait fort utile : chacun pourrait faire valoir ses positions en amont et, pour le rapporteur, ce serait l’occasion de dresser un premier bilan des auditions qu’il conduit et de faire le point sur l’ensemble des informations qu’il a recueillies ; ensuite, l’examen du projet de loi par la commission s’engagerait.
En tout état de cause, la nouvelle procédure représente un succès : en effet, 1 460 amendements ont été déposés dans la première phase du travail en commission, amendements émanant du rapporteur, des différents commissaires et, pour une cinquantaine, de sénateurs membres d’une autre commission. À partir de jeudi, à dix-sept heures, la commission pourra examiner l’ensemble des amendements extérieurs qui auront été déposés avant l’expiration du délai limite, en vue de la séance publique.

Bien entendu, le Gouvernement, lors de chacune de ces phases, a la capacité de déposer également ses propres amendements.
Nous allons naturellement tirer les enseignements de cette expérience. En effet, le premier texte examiné sous l’empire des nouvelles dispositions constitutionnelles, le projet de loi pénitentiaire, venait en première lecture devant le Sénat. Le projet de loi que vous avez cité a déjà été examiné par l’Assemblée nationale : il comptait trente-cinq articles à l’origine et nous arrive avec cent deux articles. Si l’on ramène le nombre d’amendements examinés en commission à ce nombre d’articles, nous obtenons la moyenne, raisonnable, de quinze amendements par article ; il n’empêche que nous devrons prendre l’habitude de travailler autrement.
Se posent également des questions pratiques, comme l’installation de la commission et des commissaires du Gouvernement, puisque ses représentants jouent de facto ce rôle.
Sur toutes ces questions, qu’elle a au demeurant précédemment évoquées, la conférence des présidents procédera à une évaluation. J’ai moi-même déjà rencontré le président de la commission des affaires sociales pour faire le point ; je dois le revoir demain afin d’envisager les conclusions qui doivent être tirées. Je ne doute pas, monsieur Guillaume, que votre groupe est, comme l’ensemble des groupes, également très attentif à ces premiers pas dans l’application des nouvelles règles.
La conférence des présidents comme le bureau du Sénat sont particulièrement attachés à ce que notre assemblée puisse légiférer dans les meilleures conditions possibles. Nous voyons bien que, lors de l’examen de textes de cette importance, il nous faudra utiliser pleinement les délais impartis et nous saisir nous-mêmes des textes plus tôt lors de leur transmission.
Telles sont, mon cher collègue, les informations que je suis en mesure de vous communiquer. Je suis avec une attention particulière l’évolution de la situation, comme l’exige mon rôle de président du Sénat, mais c’est également le cas des membres du groupe du travail qui a préparé la réforme du règlement, ainsi que de l’ensemble de la conférence des présidents. La proposition de résolution que j’ai déposée prévoit d’ailleurs qu’il sera procédé à une évaluation des nouvelles dispositions à l’issue d’un délai d’un an, car il est bien évident que certaines d’entre elles donneront toute satisfaction et d’autres non, puisque nous appliquons des méthodes inédites et que nous les découvrons au fur et à mesure.
En tout cas, je vous le répète, notre préoccupation commune consiste à permettre au Sénat de légiférer dans les meilleures conditions possibles.

L’ordre du jour appelle un débat sur le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires de l’État, inscrit à l’ordre du jour à la demande du groupe UMP.
La parole est à M. Josselin de Rohan.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, mes chers collègues, au cours de ses vœux aux corps constitués et aux agents de la fonction publique du 11 janvier 2008 à Lille, le chef de l’État déplorait, s’agissant du classement de sortie de l’ENA, l’École nationale d’administration, que « le résultat d’un concours passé à vingt-cinq ans oriente toute une vie professionnelle ». Il annonçait vouloir « la création d’un véritable marché de l’emploi public, où les affectations ne dépendront plus d’une gestion centralisée et désincarnée des corps, mais d’un libre choix par celui qui recrute et par celui qui “candidate”, dans l’intérêt bien compris de chacun et de l’État ».
En juillet 2008, le président Sarkozy demandait aux ministres intéressés de construire un nouveau projet pour l’ENA. La réforme a été présentée en conseil des ministres le 25 mars 2009 et doit être conduite selon quatre axes.
Premièrement, la diversité et l’égalité des chances au sein de l’ENA seront encouragées, en créant une classe préparatoire réservée aux publics défavorisés.
Deuxièmement, la formation délivrée à l’ENA sera véritablement professionnalisée, en réduisant la scolarité de vingt-sept à vingt-quatre mois et en mettant en place une réelle alternance entre périodes d’enseignement et périodes de stages, les enseignements trop académiques étant écartés au profit d’enseignements plus pratiques.
Troisièmement, à l’issue de leur formation, les élèves seront affectés selon une nouvelle procédure, substituant à la logique de classement par concours une logique de recrutement direct par les employeurs sur la base d’un dossier d’aptitude, afin d’assurer une meilleure adéquation entre les besoins des administrations et les aspirations des élèves.
Enfin, quatrièmement, le rôle de l’ENA en matière de formation continue des hauts fonctionnaires sera renforcé, notamment à l’occasion des prises de poste.
Sur tout ce qui se rapporte à l’amélioration de l’égalité des chances, à la professionnalisation de la formation et au renforcement de la formation continue, on ne peut qu’approuver les orientations définies par la réforme. Le Président de la République a justement noté, lors de ses vœux de 2008, que la démocratisation de la haute fonction publique souhaitée par l’ordonnance du 9 octobre 1945 créant l’École nationale d’administration avait, au fil des années, plutôt régressé que progressé. Il convient d’y porter remède et le processus prévu par la réforme vise cet objectif.
La réduction de la scolarité de vingt-sept à vingt-quatre mois n’appelle pas d’observation particulière, sinon que la scolarité avait déjà fait l’objet d’une réforme définie par le décret du 30 décembre 2005 et qu’elle n’aura eu que trois années d’application.
Quant au renforcement de la formation continue, on ne peut que s’en féliciter, car il est important que les futurs directeurs ou chefs de service puissent périodiquement procéder à une remise à niveau de leurs connaissances ou s’initier à de nouvelles techniques ou méthodes de gestion qui les prépareront utilement à leurs prochaines tâches.
En revanche, les dispositions prévues par la réforme pour l’affectation des élèves à l’issue de leur scolarité suscitent beaucoup d’interrogations, d’inquiétudes et de réserves, pour ne pas dire de réprobation. Au concours de sortie est substitué un mécanisme de sélection complexe, flou et qui recèle des risques très forts d’inégalité.
Tout d’abord, il est clair dans l’esprit des auteurs de la réforme que ce ne sont plus les élèves qui choisiront leur corps, mais, désormais, les administrations qui choisiront leurs agents. Il s’agit d’une innovation profonde, qui n’est pas choquante dans son principe, mais dont tout le monde n’a pas encore saisi la portée. Il n’est pas anormal en effet que les employeurs cherchent à recruter ceux qu’ils jugent les plus aptes à remplir les tâches qui leur sont proposées ; encore faut-il que le choix s’opère dans la transparence et selon des critères objectifs et irrécusables.
L’élève-candidat à un poste recevra en premier lieu une fiche des postes disponibles précisant les critères requis pour être sélectionné, puis adressera sa candidature à la direction de l’école, qui enverra aux administrations des dossiers d’aptitude anonymes comprenant les notes et appréciations obtenues par chaque candidat pendant sa scolarité à l’ENA. Les administrations procéderont alors à une présélection des candidats qu’ils souhaitent éventuellement retenir.
À ce stade, fin de l’anonymat : l’élève-candidat présélectionné enverra son curriculum vitae complet à l’administration qui l’a présélectionné. Débutera alors un ou plusieurs tours d’entretiens individuels, chaque ministère se voyant imposer un plafond maximum de candidats ne pouvant être supérieur à trois fois le nombre de postes disponibles.
Les employeurs décideront de manière collégiale, leurs choix étant motivés en fonction de la grille de critères objectifs qu’ils auront élaborée.
S’ensuivra une période probatoire dite « Junior administration » – en français dans le texte ! –, d’une durée de trois à six mois, alternant stages de pré-affectation et formation, la titularisation et l’affectation définitive dans l’administration concernée étant décidée par la direction de l’ENA et l’employeur.
Un comité ad hoc devra veiller à l’objectivité des critères de sélection, au bon déroulement des entretiens d’embauche, à la prise en compte des vœux des élèves, et éventuellement statuer sur le sort de ceux qui n’auront été retenus par aucune administration.
Monsieur le secrétaire d'État, on est partagé, devant cette très étrange construction, entre l’admiration pour l’ingéniosité qui a présidé à sa conception et l’effroi que suscite sa mise en œuvre. La réforme soulève en effet beaucoup de questions.
Tout d’abord, on peut s’interroger sur le processus de sélection sur dossier d’aptitude. À quoi bon supprimer le classement de sortie alors même que les seules informations communiquées aux employeurs dans le dossier d’aptitude anonyme de chaque élève seront ses notes et appréciations relatives à ses stages et enseignements suivis à l’ENA, en faisant table rase, au cours de cette première étape du recrutement, de toute expérience antérieure ?
Les grilles de critères objectifs mises en place pour la sélection sur dossier d’aptitude anonyme permettront-elles de différencier des élèves ayant suivi les mêmes enseignements et effectué les mêmes stages ?
S’agissant de la sélection fondée sur les auditions des élèves, comment éviter qu’à l’occasion des entretiens individuels les facteurs subjectifs ne l’emportent sur le respect des critères objectifs ? Quelles véritables garanties d’impartialité ce processus nous offre-t-il ?
Faudra-t-il, pour être admis dans tel ou tel corps prestigieux, avoir des accointances dans le milieu concerné ? Dans telle autre administration, devra-t-on, pour séduire, laisser entendre qu’on appartient à tel ou tel réseau, syndicat ou parti politique ? Sera-t-il nécessaire de particulièrement soigner les apparences, de s’abstenir de tout propos qui puisse faire croire au moindre écart de langage ou de professer un conformisme de bon aloi dans tous les domaines ?

Faudra-t-il désormais plaire plutôt que prouver ?
On nous dira peut-être que, les employeurs prenant leur décision de manière collégiale, elle ne saurait être arbitraire. Mais les jurys d’assises n’ont jamais évité les erreurs judiciaires et la pluralité n’est en rien un obstacle à la cooptation.
Chaque « employeur » élaborant sa propre grille de critères, ne risque-t-on pas de voir des administrations plus accessibles que d’autres, et plus recherchées parce que moins exigeantes sur les critères d’admissibilité ? À l’inverse, des administrations désirant écarter certains profils ne seront-elles pas tentées de placer très haut la barre ?
Dans les deux cas, le comité ad hoc mis en place pour assurer la régularité de la procédure aura beaucoup de mal à prouver que les choix des employeurs contredisent les objectifs affichés. Comment pourra-t-il s’assurer que les principes d’égalité et d’équité ont été respectés au cours des différentes phases de sélection ? Si une administration refuse de recruter un élève, le comité pourra-t-il le lui imposer contre sa volonté ?
À la fin de la période probatoire assurée par le stage de pré-affectation, le comité ad hoc pourra-t-il être saisi d’un refus de titularisation ou d’affectation définitive émis par l’employeur et la direction de l’ENA ?
Pour justifier sa volonté de supprimer le concours de sortie de l’ENA, le Président de la République met en avant l’argument selon lequel le résultat du concours orienterait définitivement toute une vie professionnelle. Ce jugement mérite d’être nuancé, car les exemples sont nombreux, depuis 1945, d’anciens élèves ayant atteint les plus hautes responsabilités sans pour autant être sortis dans les premiers rangs de leur promotion.

Ni le président du conseil d’administration d’Air France, ni celui d’EADS, ni le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ni le directeur du budget ne sont issus des grands corps de l’État. Il ne viendrait pourtant à personne l’idée de mettre en doute leurs capacités. À l’inverse, j’ai connu une personne qui, bien que dernière de sa promotion, a fait une très belle carrière, laquelle s’est achevée au Conseil d’État.
Au demeurant, il incombe au Gouvernement de veiller à la mobilité au sein de l’administration et de s’assurer, pour des raisons de justice, d’efficacité et de bonne gestion, que les agents publics ne sont pas condamnés leur vie durant à demeurer dans leur corps d’origine. Il faut que les fonctionnaires qui le souhaitent puissent faire bénéficier de leur expérience et de leur talent d’autres administrations et d’autres corps que ceux qui les ont recrutés. Il faut également qu’ils puissent accomplir une vocation dans un autre cadre si leurs aptitudes et leurs mérites, comme leurs goûts, le leur permettent. Le tour extérieur pour les grands corps de l’État a été institué aussi à cette fin.
Ce n’est pas le concours de sortie de l’ENA qui crée entre les élèves ayant suivi une même formation un sentiment d’inégalité : c’est l’existence des grands corps de l’État, qui jouissent d’un prestige incontesté, attirent les meilleurs éléments d’une promotion et facilitent l’accès, dès le début d’une carrière, aux plus hauts emplois.
Sauf à modifier de manière radicale le statut de ces corps, ce qui ne semble guère d’actualité, le concours constitue le seul moyen de s’assurer que ce sont véritablement les plus brillants et les plus méritants qui y accèdent, quels que soient leur sexe, leur origine ou leur parcours antérieur.

Ce sont les concours qui ont ouvert les portes de l’École normale supérieure à Charles Péguy, fils d’une rempailleuse de chaise, …

… celles de l’agrégation à Jean Guéhenno, fils d’un cordonnier de Fougères, celles de l’École Polytechnique au fils d’un ouvrier menuisier de ma commune du Morbihan.
En substituant à ce système simple, objectif et démocratique une formule compliquée, controversée et faisant une part très importante à la subjectivité, vous ouvrez la voie aux frustrations, aux contestations et aux contentieux. Vous laissez la suspicion entacher le mode de recrutement des hauts fonctionnaires de l’État, alors que celui-ci se doit d’être irréprochable pour ceux qui sont amenés à servir l’intérêt général.
En exposant l’administration au risque de la cooptation ou du favoritisme, on contredit l’objectif proclamé par le Président de la République, qui souhaite justement ouvrir les responsabilités les plus élevées à toutes les catégories de la population, singulièrement à celles qui sont les plus défavorisées.
Relisez l’exposé des motifs de l’ordonnance de 1945 relative à l’ENA : « Les administrations organisent chacune de leur côté le recrutement et la carrière de leurs agents. Les conditions exigées pour des emplois cependant comparables varient d’une administration à l’autre. Le rythme des concours est laissé à l’appréciation de chaque service. Il en résulte une spécialisation et un cloisonnement excessifs. »
L’un des mérites de l’ENA a été de mettre fin aux recrutements séparés, à la spécialisation et au cloisonnement excessifs de l’administration dénoncés par l’ordonnance de 1945 en unifiant la formation des futurs hauts fonctionnaires et en créant un corps unique d’administrateurs civils.
Donner aux administrations une latitude excessive pour le recrutement de leurs futurs agents recrée les conditions du cloisonnement auquel l’ordonnance de 1945 entendait mettre fin. Ce serait un grave recul.
L’abolition du concours de sortie de l’ENA, monsieur le secrétaire d'État, va bien au-delà de la suppression de quelques épreuves. Elle conduit, en réalité, à une réforme profonde de l’accès à la fonction publique.
Ne pensez-vous pas, quand il s’agit de l’intérêt de l’État, qu’il aurait fallu accorder davantage de temps à la consultation et à la réflexion avant d’amorcer un tel bouleversement ?
Craignez qu’avant peu les mécomptes entraînés par ces changements ne vous amènent, vous-même ou vos successeurs, à revenir sur une décision dont on a mal mesuré les conséquences et qui pourrait porter tort au crédit de l’École nationale d’administration comme aux principes républicains qui doivent guider son action.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – MM. Robert Badinter et Rachel Mazuir applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 25 mars dernier, le Gouvernement a fait connaître sa réforme de l’École nationale d’administration.
J’ouvre tout de suite une parenthèse : je craignais que mon intervention ne soit un peu sévère, mais l’exemple du président de Rohan m’encourage !
Sourires

L’essentiel, ou du moins la mesure qui change tout, c’est la suppression du classement de sortie. Les recrutements auraient lieu après les stages et seraient effectués, sur la base d’un dossier d’aptitude, par les administrations utilisatrices.
Comme l’a souligné un écho dans le numéro 363 de La Revue administrative, la suppression du concours de sortie signifie que l’on aura une école d’une nature différente, une sorte d’école de management, j’allais dire « à l’américaine ».
Sourires

Il est vrai – et il y a longtemps qu’on le dit – que l’ENA est moins une école de formation qu’une école de classement. Le classement, certes, a quelque chose d’arbitraire, mais c’est l’arbitraire de la destinée. Lui préférer celui de l’employeur, des employeurs publics, c’est un changement quasi métaphysique, en tout cas historique.
L’ENA a mis longtemps à naître. Une semblable école fut, des siècles durant, le rêve des réformateurs, voire des révolutionnaires. Ce rêve, comme le montre le remarquable livre de Guy Thuillier, l’ENA avant l’ENA, a été porté par l’abbé Grégoire en l’an IV, par Hippolyte Carnot en 1848, par Jean Zay sous le Front populaire, …

… avant d’être transformé en réalité par le général de Gaulle et Michel Debré, à la Libération.
De quoi s’agissait-il pour ces deux grands hommes ? De mettre fin au système des concours particuliers, comme l’a très bien dit le président de Rohan, d’abord dans les traditionnels grands corps, Conseil d’État, Cour des comptes, Inspection des finances, auxquels on peut assimiler le Quai d’Orsay et le Trésor.
Ces corps prestigieux – trop peut-être – étaient, un peu avant la guerre, le domaine des « héritiers », comme aurait dit Pierre Bourdieu. Dès lors, ces postes enviés étaient choisis par les premiers du concours lors de la cérémonie dite de l’« amphi-garnison », qui n’existera donc plus l’an prochain, où se déroulaient des scènes de tensions et de surprises, et qui a d’ailleurs récemment donné lieu à une dramatique diffusée par Canal +.
Bien sûr, il arriva qu’une promotion se révoltât contre cette procédure cruelle : ce fut le cas en 1968, avec la promotion « Charles de Gaulle », et tout dernièrement encore.
Le système, qui aura duré plus d’un demi-siècle, ne récoltait pas que des compliments. Il fut brocardé, en 1967, par un très brillant ouvrage (L’orateur brandit un livre à la couverture jaune), l’Énarchie, d’un dénommé Jacques Mandrin, enseigne sous laquelle se dissimulaient de talentueux comploteurs, dont un futur ancien ministre qui, à présent, nous fait l’honneur de siéger parmi nous.
Sourires

Puis, autre petit malheur, il y eut le déménagement de l’ENA à Strasbourg, voulu par le Premier ministre Édith Cresson, ce qui posa quelques problèmes pour le recrutement des maîtres de conférence. En effet, ne l’oublions pas, l’ENA, comme toute école, avait un corps enseignant composé, comme il se doit, d’anciens élèves et de jeunes hauts fonctionnaires. Quoi qu’il en soit, l’école ne mourut pas de son transfert dans la magnifique commanderie Saint-Jean. Mais passons sur ce qui, bientôt, appartiendra au passé !
Il n’y aura donc plus de classement de sortie, mais des recrutements administratifs. Selon quelle procédure tiendra-t-on compte du visage des impétrants, de leur comportement au cours des stages en préfecture, en ambassade, voire en entreprise ? Je n’insiste pas sur ce point, le président de Rohan l’ayant fort bien analysé. Et, après tout, pourquoi pas ?
Qu’il soit cependant permis à un témoin des temps révolus – nous sommes assez nombreux à pouvoir prétendre à un tel titre dans cette assemblée ! – de poser trois questions.
D’abord, que deviendront, dans le nouveau cursus, ces stagiaires étrangers, venus parfois de pays fort lointains, qui ont appris à l’ENA tout simplement la France et qui, souvent, une fois retournés dans leur patrie, ont rendu des services appréciables à nos intérêts et à notre diplomatie ?
Ensuite, encadrer l’arbitraire du concours de sortie se révélera-t-il moins partial que ce que j’appellerai tout bonnement l’influence ?
Enfin, la mort de l’ENA ne présage-t-elle pas celle des grands corps, du moins pour leurs jeunes générations : auditeurs au Conseil d’État ou à la Cour des comptes, inspecteurs adjoints… N’y aura-t-il bientôt plus place aux échelons supérieurs de l’administration que pour des administrateurs ayant accompli dix ans de service et ayant rendu « des » services ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur quelques travées du RDSE et du groupe socialiste.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je vais m’employer à défendre l’ENA, peut-être parce que j’ai beaucoup attaqué les énarques au cours de ma vie politique.
Sourires
Nouveaux sourires.

Pour autant, je suis convaincu que certaines améliorations peuvent être apportées au fonctionnement de cette école.
Ce débat sur le recrutement et la formation des hauts fonctionnaires de l’État, qui se tient à la demande du groupe de l’UMP dans le cadre de la semaine d’initiative sénatoriale, est aussi l’occasion d’évoquer, au-delà des problèmes de recrutement et de formation, la question beaucoup plus large de la nécessaire mutation de la fonction publique. À mon sens, notre débat ne peut se limiter à parler de la suppression du classement de sortie de l’ENA : cela reviendrait à ne prendre en compte que la partie émergée de l’iceberg de la fonction publique.
Quelle est la situation de notre pays en ce qui concerne ses hauts fonctionnaires ? Tout d’abord, ceux-ci bénéficient d’une formation extrêmement performante, enviée dans le monde entier. Ensuite, ils font preuve d’une impartialité convenable, qui n’est d’ailleurs pas sans lien avec la qualité de la formation. Enfin, il faut le signaler, ils échappent à la tentation de corruption qui existe dans de nombreux pays, y compris dans des pays voisins.
Selon moi, nous devons reconnaître ces avantages et les défendre.
Néanmoins, je l’ai dit, le système peut, à l’évidence, être amélioré. On peut notamment reprocher au mécanisme de recrutement de favoriser l’« entre-soi », dont tout le monde dénonce les méfaits, mais qui se poursuit d’année en année. Il est tout de même incroyable de voir ce que les énarques peuvent faire comme petits !
Sourires

Comment peut-on remédier à ces dysfonctionnements ?
D’abord, il convient de rappeler que la pédagogie consiste souvent à répéter inlassablement un certain nombre de choses. Pourquoi les énarques et les élèves des écoles les plus prestigieuses, Polytechnique et autres, y échapperaient-ils ? En particulier, il faut leur rappeler sans cesse qu’ils doivent servir l’État et non le Gouvernement.
S’ils servent l’État, ils ont de fortes chances d’être véritablement impartiaux.
Sourires

… des personnages à l’échine souple.
S’il n’est pas anormal qu’un haut fonctionnaire soit carriériste, il ne doit pas pour autant n’avoir pour objectif que de plaire au « prince » qui l’a nommé, ou dont sa carrière dépend.
Ensuite, il faut améliorer le système des limites d’âge. D’ailleurs, si l’on tenait compte de ce critère, bon nombre d’entre nous devraient disparaître très vite de cet hémicycle !
Sourires

Dès lors, pourquoi ce qui vaut pour les responsables politiques ne vaudrait-il pas pour les hauts fonctionnaires ?
Il faut aussi qu’il y ait un véritable ascenseur social, fonctionnant aussi bien à l’entrée dans les grandes écoles, auxquelles doivent pouvoir accéder des jeunes de toutes origines, que tout au long de leur carrière.
Il conviendrait également d’accroître la diversité des stages. Ceux-ci se déroulent aujourd'hui, en général, dans des institutions extrêmement protégées. Cela donne-t-il à ces futurs hauts fonctionnaires une bonne connaissance du « pays réel » ? Ne serait-il pas utile qu’ils se « coltinent » avec les milieux populaires et aussi avec les problèmes propres à l’espace rural ? Une chose est de faire un stage dans une ambassade ou dans une préfecture ; une autre chose est de l’accomplir dans une petite communauté de communes où il faut se battre pour mener à bien un dossier.
Ces modifications, qui ne seraient pas forcément très coûteuses, permettraient d’éviter cette méconnaissance des réalités profondes du pays, notamment de ses zones rurales, que l’on constate trop souvent chez les hauts fonctionnaires.
En ce qui concerne le classement de sortie, j’y suis personnellement plutôt favorable : c’est la méritocratie.

M. François Fortassin. Toutefois, la carrière d’un haut fonctionnaire ne doit évidemment pas dépendre pendant plusieurs décennies de son rang de sortie. Tout ne peut pas rester éternellement figé. Ainsi, un haut fonctionnaire dont le rang de classement n’était pas extraordinaire ne doit pas traîner cela comme un boulet durant toute sa carrière. Après tout, certains ont pu considérer que, à vingt ans ou vingt-cinq ans, il y avait des choses beaucoup plus intéressantes à faire que de se plonger dans les études !
Sourires

M. François Fortassin. Le sport est un excellent dérivatif ! La montagne aussi ! Le grand « pyrénéiste » Henry Russell racontait que, à une certaine époque, quand on avait emmené une dame ou jeune femme au-dessus de 3 000 mètres, on pouvait la tutoyer toute sa vie, car, disait-il, tout ce qui s’est passé à une telle altitude est couvert par le silence des sommets !
Rires et applaudissements

Donc, je n’en dirai pas plus des autres passions des jeunes gens, d’autant que, je dois le dire, ma mémoire est, sur ce sujet, légèrement défaillante !
Sourires

Plus sérieusement, je voudrais insister en conclusion sur la réflexion qui mérite d’être menée et sur le bon sens qui doit guider cette réforme. De grâce, sous prétexte d’améliorer les choses, ne les rendons pas pires que ce qu’elles sont aujourd'hui !
Applaudissements sur les travées du RDSE, de l ’ Union centriste, de l ’ UMP et du groupe socialiste.

Quelle belle unanimité !
Pour ma part, je préfère que l’on parle de l’ENA que des écoles nationales vétérinaires !
Sourires

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je m’interroge sur le statut et l’utilité de ce débat. En effet, si j’ai bien compris – mais peut-être n’est-ce pas le cas –, la décision est déjà prise ; elle a été communiquée à l’ENA et a fait l’objet d’une communication en conseil des ministres.
Je remercie le président de Rohan d’avoir suscité ce débat, mais n’eût-il pas été préférable de saisir le Parlement avant de prendre une décision sur un sujet d’une telle importance ?

Monsieur le secrétaire d’État, je vous poserai donc une question simple, à laquelle, je l’espère, vous pourrez répondre : le Parlement, qui doit se contenter aujourd'hui de débattre, aura-t-il l’occasion de statuer sur cette affaire ?
Au demeurant, le sujet est vaste, car la formation des serviteurs de l’État comme de ceux des collectivités territoriales ne se réduit pas à la seule question de l’ENA.
À l’instar des orateurs qui sont intervenus avant moi, je voudrais revenir sur quelques principes, dont celui, qui est fondateur de la République, de l’égalité, de la promotion de tous, de la possibilité donnée à chacun d’aller le plus loin possible. Disant cela, je songe à un ami de Gien, dans le Loiret, dont les obsèques ont lieu en ce moment même, un homme issu de la classe ouvrière qui est devenu un grand historien. Je pense à tous ceux qui se sont élevés par la force de leur volonté – M. de Rohan a évoqué à juste titre Charles Péguy –, mais aussi grâce aux hussards noirs de la République, qui leur ont donné la main, qui ont été exigeants avec eux pour leur permettre d’aller le plus loin possible.
Le concours, tous ceux qui en ont passé un le savent, présente bien des inconvénients. Il reste cependant, comme on le dit souvent de la démocratie, le pire des systèmes à l’exception de tous les autres.
Il en va de même du classement qui a lieu à l’issue de la dernière année d’étude à l’ENA. On peut tout à fait en contester le principe. Mais la question est de savoir par quoi on le remplace.

Si la nouvelle procédure offre les mêmes garanties en termes d’impartialité ou d’objectivité que l’actuelle, quels que soient ses défauts, pourquoi pas ? Mais on perçoit bien que la sélection à partir de dossiers ouvre la porte à bien des risques !
Chaque corps, chaque administration consultera les dossiers, puis procédera à des entretiens en présence d’experts en « ressources humaines », concept sur lequel je reviendrai tout à l’heure. Or, en dépit des qualités de Jean-Cyril Spinetta, qui présidera un comité ad hoc veillant à la bonne régularité de la procédure de sortie, tout le monde voit bien que cela ne suffira pas à garantir l’impartialité requise. Il y aura, d’un côté, ceux que l’on connaît déjà, ceux que l’on reconnaît, ceux pour qui la voie est déjà tracée, et puis les autres… Ce sera le retour aux connivences, aux affinités, à l’héritage, à l’autoreproduction au bénéfice de ceux qui ont tellement l’habitude d’être dans le cercle qu’il est naturel qu’ils y restent.
En tout cas, les informations dont nous disposons actuellement ne nous garantissent aucunement que la nouvelle procédure sera plus juste que l’actuelle.
Notre réflexion ne se borne pas au rappel de ces principes républicains auxquels nous sommes très attachés. Nous défendons également des carrières diversifiées dans la haute fonction publique, comme, du reste, dans l’ensemble de la fonction publique.
En effet, la question peut se poser de savoir s’il est bon que quelqu’un qui est entré au Conseil d’État à vingt-trois ans y reste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, voire davantage, sans connaître autre chose dans sa carrière professionnelle, hors la période de mobilité ?
D’ailleurs, tous les grands corps ne fonctionnent pas de la même façon. De nombreux inspecteurs des finances – et il en est d’éminents parmi nous, monsieur le rapporteur général
Sourires

Nous devons repenser le système. Il ne serait sans doute pas mauvais, par exemple, que quelqu’un qui exercera ses fonctions au Conseil d’État ou à l’Inspection des finances ou à la Cour des comptes travaille quelques années dans une préfecture, une direction des affaires sociales, un hôpital ou une collectivité locale, bref sur le terrain, afin que puisse s’établir une dialectique entre des expériences professionnelles diverses et les fonctions exercées ensuite. Cela ne contreviendrait nullement aux principes républicains de l’accession à une fonction ou à un corps. Il est parfaitement imaginable de vivre autrement le fait d’appartenir à un grand corps, d’être administrateur civil ou membre d’une juridiction administrative, et d’instaurer une plus grande diversité dans les tâches exercées au cours d’une même carrière.
Après avoir parlé des principes républicains, de la nécessité de carrières diversifiées, je veux maintenant aborder la formation.
En effet, à cet égard, des évolutions sont certainement souhaitables. Je plaide pour que l’ENA, comme les autres grandes écoles, délivre une formation. Cette affirmation peut paraître banale, mais, aujourd’hui, sur deux années d’école, les élèves effectuent deux stages de six mois chacun dans une préfecture ou une ambassade. Ces stages sont très bénéfiques parce qu’ils sont d’une certaine durée et parce qu’ils offrent une certaine densité d’apprentissage. Si l’on crée un troisième stage, en entreprise, ce nouveau stage devra offrir la même utilité, présenter le même caractère formateur, les mêmes qualités que les deux autres en termes de durée, de densité : il faudra en tirer les conséquences, car, en la matière, on ne peut pas se contenter de subterfuges.
Je plaide en outre pour que la formation à l’ENA, comme d’ailleurs dans les autres grandes écoles ou à l’université, soit d’abord fondée sur la connaissance. « Mais vous n’y pensez pas, m’objecte-t-on, ce qui compte, c’est l’ouverture aux réalités professionnelles ! » Or, pour moi, l’ouverture aux réalités professionnelles fait justement partie de la connaissance… On me rétorque également : « Ce qui compte, c’est le management ». Voilà le grand mot lâché ! Aujourd’hui, si vous n’êtes pas dans le management, vous n’êtes pas bon ! Et bien entendu, il faut prononcer le mot à l’anglo-saxonne !
Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC-SPG.

J’ai dit que j’allais revenir sur les « ressources humaines ». Jadis, il existait des directions du personnel, appellation sans doute un peu archaïque. Aujourd'hui, c’est extraordinaire, tout le monde parle de « ressources humaines » ! Avouons-le, c’est un concept bizarre. Je connais la ressource pétrolifère, la ressource électrique, la ressource gazière, mais je me demande à quoi correspond cette notion vaporeuse de « ressources humaines ». Je ne connais, pour ma part, que des êtres humains, qui, pour accomplir leurs missions, doivent acquérir des connaissances.
En matière de fonction publique, précisément, il y a des connaissances à acquérir.
Récemment, j’ai rencontré un jeune énarque qui m’a avoué qu’il ne connaissait rien aux commissions paritaires, à la promotion dans la fonction publique, car il n’avait pas appris ces notions en cours. N’ayons crainte, il finira par apprendre de quoi il s’agit…
Quoi qu'il en soit, le service de l’État a une substance qui suppose certaines connaissances, en matière de déontologie, d’histoire, de fonctionnement de la démocratie, etc. Ne récusons donc pas la connaissance !
Même la connaissance des grandes œuvres de la littérature – je pense toujours à La Princesse de Clèves ! – est très bénéfique. Croire que la seule « formation » – j’insiste sur les guillemets ! – qui va nous aider à créer de bons hauts fonctionnaires, comme d’ailleurs de bons chefs d’entreprise ou de bons professionnels en général, serait une sorte de mixture de gestion des ressources humaines, de management et de quelques autres concepts à la mode, ce n’est pas forcément très sérieux.
Le savoir, la connaissance sont des réalités et, nous le savons tous, chacun doit s’efforcer de s’en approprier une part aussi large que possible.
En outre, il faut démocratiser l’accès à l’ENA ainsi qu’à toutes les grandes écoles et aux universités. Cela passe par des réformes, comme celle qu’a mise en œuvre M. Descoings. Les initiatives qui ont été prises ont été utiles. Notre collègue Yannick Bodin en parlera d’ailleurs dans un instant et abordera tout ce qui peut être fait pour favoriser cette nécessaire démocratisation.
Pour ma part, je tiens à dire que la démocratisation doit être partout. C’est seulement si l’on ose proposer à tous les jeunes de France, dans tous les quartiers, sans aucune exception, ce que j’appelle une école de l’exigence et non une école de la démagogie et de la facilité, que l’on ira vers la promotion du plus grand nombre. J’en suis absolument persuadé !
Même s’il a été utile de réaliser des zonages pour pouvoir donner plus à ceux qui ont moins, il ne faut pas aboutir à créer des ghettos où l’on se résoudrait à n’enseigner qu’une partie du savoir. Tous et toutes ont droit à cette connaissance qui est tellement nécessaire.
Si l’on veut aller vers plus de démocratisation, il conviendra également de s’interroger sur la coupure entre les universités et les grandes écoles. À mon sens, toutes les grandes écoles devraient appartenir à une université ou travailler avec une ou plusieurs d’entre elles. Les classes préparatoires devraient aussi avoir un lien avec l’université. Nous ne pouvons pas être le seul pays au monde où l’université est exclue de la formation de certaines de nos élites.

Même s’il y a beaucoup à faire dans les universités, je n’ouvrirai pas ce dossier maintenant.
Enfin, il faut favoriser l’accès de ceux qui ont déjà une expérience professionnelle. À cet égard, il faut développer la deuxième voie et la troisième voie. Il est vrai que peu parmi ceux qui sont reçus à ce titre ont accès aux grands corps. Peut-être serait-il judicieux de revoir le contenu des épreuves, tout en respectant bien entendu les principes républicains ? On peut également accorder davantage de bourses à ceux qui travaillent dur pour arriver à ces hautes responsabilités.
L’un de nos collègues a cité Jean Zay, ce grand ministre de l’éducation nationale – de l’instruction publique, comme l’on disait sous le Front populaire –, qui a posé les jalons de l’ENA. Nul plus que lui n’était attaché à ce que chacun réussisse ; nul plus que lui n’était attaché à ce qu’on donne à chacune et à chacun les moyens de la promotion dans une véritable exigence et dans le respect absolu du principe de l’égalité.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées du RDSE et de l’UMP.

Monsieur le secrétaire d’État, je veux vous faire part de toutes les craintes que m’inspire la réforme en cours de la scolarité et, surtout, du régime de sortie de l’École nationale d’administration. À cet égard, je souscris totalement aux excellents propos tenus par M. Josselin de Rohan, puis par M. Yann Gaillard, propos auxquels se sont associés, me semble-t-il, les orateurs suivants, à quelque groupe qu’ils appartiennent.
La République a besoin de hauts fonctionnaires neutres et de haute qualité et la seule méthode qui réponde à cette double exigence, c’est le concours. Le concours est une institution de la République.
Je me permettrai de rappeler que le cheminement qui conduit à l’École nationale d’administration et qui permet d’en sortir se déroule en trois temps.
Il y a d’abord le temps de la préparation. À cet égard, il est bon d’insister sur la nécessaire diversité des candidats. Notre collègue Jean-Pierre Sueur a fait allusion tout à l'heure à l’évolution de l’Institut d’études politiques de Paris et au principe de discrimination positive qui, dans une certaine mesure, s’est appliqué à certaines méthodes de recrutement des étudiants.
On sait par ailleurs que l’École nationale d’administration recrute par plusieurs voies et que cela a résulté de la nécessité d’y faire coexister des élèves de profil, d’origine et d’âge différents.
Le deuxième temps, c’est celui de la scolarité. Il est vrai qu’après des périodes très intenses, après la réussite du concours d’entrée, les élèves ne vivent pas forcément très bien une scolarité qui ne répond pas toujours à leurs vœux et à leur vision des choses.
La scolarité se répartit entre des activités intellectuelles aussi proches que possible de la future réalité professionnelle, mais sans exclure les nécessaires aspects de culture générale et d’ouverture d’esprit, et des stages qui conduisent à prendre contact avec la vie professionnelle et les réalités de l’administration.
Comme ceux qui m’ont précédé à cette tribune, je crois beaucoup aux vertus de ces stages, monsieur le secrétaire d’État. Ce ne sont pas des stages d’information ou de spectateurs, ce sont, pour une large part, des stages d’acteurs. Lorsqu’un stagiaire, jeune ou un peu moins jeune s’il vient du deuxième concours, assure l’intérim du directeur de cabinet d’un préfet ou occupe un poste qu’un diplomate professionnel pourrait tenir dans une petite ou moyenne ambassade, il est confronté à la fois à une expérience irremplaçable et à une véritable épreuve dont beaucoup de choses vont dépendre par la suite.
Avec le double siège de l’École à Strasbourg et à Paris, la conception de la scolarité est assurément très différente de ce que les plus anciens ici ont connu. La localisation à Paris assurait une proximité plus grande avec les administrations et permettait d’accroître la diversité du corps enseignant, mais peu importe puisqu’il s’agit d’une question d’hier ou d’avant-hier.
Le troisième temps, fondamental, celui qui m’a conduit à solliciter la parole, monsieur le secrétaire d’État, c’est la sortie. Le processus visant à remplacer le classement de sortie, qui capitalise toute la scolarité, est totalement insatisfaisant et repose sur de véritables illusions.
En premier lieu, le système retenu est trop complexe. Le classement est simple ; le système de commission, d’approche anonyme puis à visage découvert, en plusieurs temps, est difficile à décrypter, à interpréter.
En deuxième lieu, la complexité de ce système le rendra nécessairement instable, car les leçons de l’expérience conduiront d’année en année à en modifier tel ou tel terme. Que deviendra, dans ces conditions, la nécessaire égalité d’accès des étudiants d’une promotion à l’autre ?
En troisième lieu, inévitablement, quelle que soit la pureté des intentions, ce système sera perméable aux influences – c’est le risque principal, que plusieurs intervenants ont souligné fort bien avant moi.
Le risque de conformisme a été très justement mis en avant par M. de Rohan. Avec le classement, le corps accueille celui qui a reçu de la République le droit d’y entrer. Il n’a pas son mot à dire, et c’est précisément l’utilité du classement que de permettre de faire coexister dans des administrations des personnalités différentes, qui n’ont pas la même vision du monde et de leur propre métier. C’est une nécessaire richesse, alors que cette sorte de cooptation qui ne dit pas son nom, ou cette rencontre de l’offre et de la demande pour trouver une ressource humaine sera nécessairement un facteur de cohésion supplémentaire des corps et des métiers dans l’administration. Par conséquent, celle-ci se privera de beaucoup de richesse.
Monsieur le secrétaire d’État, s’il en est encore temps, revoyons cette question ; évitons, pour des raisons de circonstance, de nous diriger vers un mauvais cap et de créer des complexités entraînant des frustrations qui ne seront pas à l’honneur de l’École nationale d’administration.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – Mme Françoise Férat applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le sujet semble quasiment susciter une pensée unique ! Pour ma part, je voudrais souligner que le mode de recrutement des fonctionnaires est un bon indicateur de la conception de la place du fonctionnaire et de la fonction publique dans la société. Celle-ci fait référence à des valeurs, à des principes qui caractérisent le régime en place.
Dès 2007, le Président de la République a donné le ton d’une véritable offensive contre la conception républicaine de la fonction publique, à savoir la contestation de la loi par le contrat, de la fonction par le métier, de l’efficacité sociale par la performance individuelle.
Quant aux fonctionnaires, il a estimé qu’il n’y avait pas de véritable échappatoire au « carcan » des statuts si le concours continue d’être la seule et unique règle pour la promotion. La messe est dite, il en serait fini de la fonction publique républicaine, fruit d’une longue histoire depuis 1789 et que chacun a renoncé à rappeler faute de temps.
Le principe du recrutement par concours a été au cœur de cette construction, pour permettre l’égalité d’accès aux emplois publics et l’indépendance des fonctionnaires.
Les critiques à l’égard de la haute fonction publique et particulièrement de l’ENA, dont elle est largement issue, ne sont pas nouvelles. Dans Les Héritiers, publié en 1964, Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron ont décrit comment l’ENA, parmi d’autres écoles françaises, était monopolisée par les « héritiers de la culture dominante ». Les deux sociologues reprochaient à un tel mode de sélection de mettre à mal le fondement de démocratisation de l’accès à ces grandes écoles, car il privilégie les « héritiers », portés par une forte connivence entre l’école et leur propre culture familiale.
Je vous rappelle qu’une réforme importante a été votée en 1983, sur l’initiative de M. Le Pors, alors ministre, avec la création d’une troisième voie ouverte à des personnes ayant accompli huit ans de service dans des activités à vocation de service public. Elle a été combattue à l’époque par la droite, qui s’est empressée de la rendre inopérante en 1988. Dont acte ! Pas de démocratisation par cette voie-là disaient alors ses détracteurs.
Aujourd’hui, la question de la démocratisation de la haute fonction publique reste entière. Toutefois, soyons clairs : la critique de l’ENA participe d’interrogations bien plus générales sur la société, à savoir la sélection et la reproduction des élites, la bureaucratie, la centralisation et les relations entre l’État et les citoyens. Il n’y a pas qu’à l’ENA que l’on trouve les « héritiers », on les trouve aussi au Parlement…
Le Gouvernement a bien compris cette critique, toujours vivace, mais il l’utilise pour faire passer une réforme de l’école de formation de la haute fonction publique qui ne fera que renforcer l’élitisme ainsi que la reproduction sociale et culturelle.
L’une des mesures phares de votre projet, monsieur le secrétaire d’État, est la suppression du classement de sortie à l’issue de la scolarité. Se pose alors la question de savoir quelles seront les modalités d’affectation des élèves sur les postes disponibles. Supprimer le classement, c’est bien sûr développer des modes de recrutement discrétionnaires en fonction des réseaux et des allégeances, et ainsi promouvoir une nouvelle culture managériale dans la fonction publique. C’est d'ailleurs le but visé.
Prenons l’exemple de la promotion Aristide Briand, qui a été la première à expérimenter la nouvelle procédure de sortie. Les élèves ont rédigé un rapport sur le système qu’ils viennent de tester et, curieusement, on y relève le fait suivant : « Enfin, on est en droit de s’interroger sur les critères de choix de certains “employeurs” : il est remarquable que le ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire n’ait retenu qu’une candidature féminine sur une short list de six, alors que la proportion des candidates était bien plus élevée parmi les quinze élèves qui se sont présentés à lui. Ce ministère aurait par ailleurs indiqué à un élève qu’il cherchait un profil “plutôt masculin”. » Quel progrès dans l’adéquation des profils aux postes et dans la nécessaire féminisation des postes de responsabilité !
Outre la suppression du classement, vous préconisez une scolarité moins longue, complétée par une « junior administration » et des stages en entreprise plus longs pour ouvrir les élèves aux problématiques du secteur privé : en somme, une importation directe des dogmes patronaux dans l’École.
Ces méthodes sont d’ailleurs le décalque de celles qui sont en vigueur dans les grandes entreprises privées. Ces dernières années, on a vu se développer dans les grandes entreprises la caste des « gagneurs », entreprenants et audacieux, sur lesquels la droite a souvent appelé les hauts fonctionnaires à prendre exemple. La crise financière et sociale que nous traversons a pourtant montré que ces gagneurs n’étaient en réalité que des gagneurs pour eux-mêmes, pour leur carrière, leur rémunération, et n’étaient aucunement engagés dans le développement durable de leur entreprise.
Alors que ces comportements sont de plus en plus contestés et incompatibles avec la notion d’intérêt général, le Gouvernement les prend une fois de plus pour modèle dans cette nouvelle réforme de recrutement et de formation de la haute administration. L’acte de recrutement dans la fonction publique va devenir un marché où l’on va chercher à se vendre.
Une telle réforme renforce des pratiques de connivence et de dépendance des hauts fonctionnaires à l’égard du monde politique ou financier, car elle met en avant des valeurs qui se nourrissent du « savoir plaire » et du sens de l’opportunisme en fonction des politiques du moment. Un récent major de l’ENA, qui a choisi le Conseil d’État, ne disait-il pas : « moi, fils de menuisier, qui m’aurait choisi pour le Conseil d’État ? » Méditons sur cette remarque !
Enfin, la stabilisation annoncée à 80 élèves par promotion – alors qu’ils étaient encore 136 en 2002 – traduit quant à elle une vision comptable de la formation et du recrutement des cadres dans la fonction publique. La pénurie engendrée permettra sans doute plus facilement de légitimer le recours à des acteurs issus du privé en lieu et place des fonctionnaires.
Pour compenser le renforcement de l’homogénéisation sociale que va créer cette réforme, le Gouvernement propose d’ouvrir l’École à la « diversité des talents » et à « l’égalité des chances » en se dotant d’une « classe préparatoire spécifiquement réservée aux publics défavorisés, c’est-à-dire des candidats issus de milieu modeste et ayant effectué tout ou partie de leur scolarité en ZEP ».
Cette classe réunira quinze élèves qui se présenteront ensuite au même concours que les autres candidats. Les centres de préparation devront s’ouvrir également à des objectifs de diversification. De multiples questions sont posées : comment sélectionner les quinze élèves ? Comment sera validée la formation de préparation au concours de l’ENA ? Quel sera le débouché pour les candidats qui échoueront au concours ?
Nous ne pouvons que prendre acte de toute mesure, même modeste, allant dans le sens de l’égalité des droits. Cependant, le dispositif annoncé n’est, hélas ! qu’un alibi dispensant d’une véritable réflexion sur la démocratisation de la haute fonction publique et, plus largement, des élites.
Face à l’anachronisme que constitue l’importation des pratiques les plus critiquables du secteur privé dans le public, nous ne pouvons que contester ces méthodes et donc ce projet, et exiger le maintien des principes fondamentaux d’égalité d’accès aux emplois publics.
Si la procédure de classement actuelle de l’ENA est critiquée et doit être réformée avec la mise en place de nouveaux dispositifs d’évaluation, nous considérons que – et ce point me semble faire l’unanimité dans cette assemblée – les classements au concours et à la sortie de l’École doivent demeurer les critères principaux de sélection des candidats à un poste de la fonction publique.
Concernant le recrutement, c’est bien une réforme de fond qui est nécessaire, et non un saupoudrage social condescendant ! Il faut en effet créer de véritables centres de préparation aux concours administratifs en province, dotés de réels moyens afin d’assurer les mêmes conditions de réussite qu’à Sciences-Po Paris.
Ces centres pourraient préparer ainsi aux concours de catégorie A, à l’ENA, à l’Institut national des études territoriales, ou INET, au concours de directeur d’hôpital, et aux instituts régionaux d’administration, les IRA, avec une évaluation des matières enseignées.
Dans ce cadre, le système des bourses et des aides financières devrait être significativement développé. Par ailleurs, il serait particulièrement urgent de relancer la réflexion sur une troisième voie d’entrée qui permettrait de développer enfin le profil social et culturel des hauts fonctionnaires.
Enfin, nous ne saurions faire l’économie d’un nécessaire débat sur la hiérarchisation actuelle de l’encadrement supérieur et d’une réflexion sur les nommés « grands corps » qui attirent les privilèges. Se pose la question de l’égalité de carrière pour l’ensemble de la haute fonction publique, et, à tout le moins, celle d’une revalorisation de la carrière des administrateurs civils.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

M. Gérard Longuet. Pas du tout. Mais je m’en suis bien sorti, finalement…
Sourires.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, s’il n’est pas nécessaire d’être ancien élève de l’École nationale d’administration pour participer à ce débat, je constate que nous sommes à peu près 40 % des intervenants à venir de cette école. J’eusse préféré que le débat fût plus ouvert.
Je voudrais tout d’abord remercier Josselin de Rohan : dans un domaine qui est de nature réglementaire, sa demande de débat nous permet de traiter d’un sujet majeur. Il n’aurait pas été concevable que le Parlement, en l’occurrence le Sénat, ne puisse s’exprimer sur cette question qui, au travers du classement, pose, comme Mme Borvo Cohen-Seat l’a rappelé tout à l’heure, le problème général de l’image et du statut général de la fonction publique.
Je souhaite également remercier M. Éric Woerth qui, avec le décret du 29 mars dernier, a posé le problème de la réforme de l’ENA. Monsieur le secrétaire d’État, puisque vous avez la lourde mission de mettre en œuvre cette politique, sachez que, pour l’essentiel, elle me convient parfaitement. En effet, me semblent particulièrement appropriées la professionnalisation des études, la diminution de la durée des études et l’ouverture sociale avec une classe préparatoire destinée à des élèves ayant sans doute plus besoin de soutien que d’autres et qui, n’étant ni fils d’archevêque ni même fils d’évêque, méritent la considération par leur réussite et leurs perspectives.
Au-delà, je remercie l’ENA d’être ce qu’elle est, et à titre personnel, de ce qu’elle m’a apporté : non pas seulement un statut et une carrière mais surtout une ouverture d’esprit, un sens de la mesure, un sens de l’essentiel et, dans mon cas particulier, le fait d’échapper à la tentation du baroque intellectuel en replaçant le travail de l’étudiant que j’étais sur le thème majeur de l’intérêt collectif, du service public et du sens de l’intérêt général.
En effet, et c’est le premier thème que je veux aborder, l’ENA est d’abord une école professionnelle qui a pour objet de recruter les administrateurs au service de l’État. Ayant eu la chance de servir d’autres employeurs, y compris des employeurs privés, je puis l’affirmer avec force, il s’agit d’un métier particulier. Personne n’est contraint de servir l’État mais ceux qui le font acceptent librement certaines contraintes.
Cela a une conséquence très simple : il n’y a pas de scolarité, fût-elle professionnelle, qui ne soit sanctionnée par une évaluation, laquelle est toujours comparative.
Je comprends bien sûr le stress et l’inquiétude de mes jeunes camarades de l’ENA d’aujourd’hui. Nous sommes tous passés par ces sentiments d’injustice, d’incompréhension et par ces difficultés, en connaissant parfois d’heureuses, voire de divines surprises.
Mais revenons à l’essentiel : nous faisons une école professionnelle. Elle transmet une méthode pour pouvoir travailler ensemble, pour permettre à des administrateurs de l’État de se parler, de se comprendre et d’être utiles les uns aux autres, en dépit des différences de générations, d’expérience ou de conviction. Un considérable effort de méthode est effectué.
Or cette méthode ne s’apprend pas à l’université, en tous les cas pas dans la plupart des instituts d’enseignement supérieur qui préparent à l’École nationale d’administration.
Animer un groupe, prendre la parole, faire émerger un consensus dans une équipe de direction sont autant d’efforts méthodologiques que l’on peut désormais apprendre à l’ENA mais nulle part ailleurs. Cet aspect professionnel de l’enseignement est nécessaire et doit être évalué, à un moment ou à un autre.
J’ai écouté M. Fortassin avec beaucoup d’intérêt. De mon point de vue, le stage n’est pas une escapade touristique pour ouvrir les yeux sur monde inconnu. Il permet au contraire d’évaluer le caractère de l’élève et de savoir si, en situation de responsabilité, il a ou non naturellement des réflexes prédisposant à une bonne gestion de l’État, comme le sens de l’engagement, le respect de l’autre, la volonté du travail accompli jusqu’à son terme et tout simplement l’engagement personnel.
C’est la raison pour laquelle le travail méthodologique se poursuit par des stages qui sont non pas une découverte du monde offerte à des élèves sur les crédits de l’État, mais une façon pour l’État d’évaluer la résistance psychologique des élèves. Certains de mes camarades ont eu la chance d’être directeurs de cabinet de préfet par intérim en 1968. Ce fut pour eux une expérience unique mais cela a surtout donné à leur employeur l’occasion de les évaluer avec certitude.
Je vous le rappelle, par opposition au secteur privé, l’élève de l’ENA devient fonctionnaire dès qu’il entre à cette école et il est donc alors sous un regard professionnel.
Au-delà de la méthode et du stage, qui est une évaluation du caractère, du comportement et de l’aptitude au service des autres, la partie universitaire stricto sensu doit exister, sans être principale. En ce qui concerne les approfondissements, vous avez créé des sections. Cela me semble légitime puisque, malgré l’universalité des administrateurs civils, il existe des spécialisations.
Cette partie de l’enseignement consacrée à l’approfondissement ne sera jamais suffisante. On n’épuisera jamais la compétence du droit social, du droit hospitalier ou du droit international à l’ENA. Cela se fera sur le terrain.
En revanche, les sections diversifiées permettent d’approfondir tel ou tel sujet et constituent une autre façon d’évaluer l’élève et son aptitude à découvrir différents domaines.
L’ENA est donc une école professionnelle, qui exige un classement pour soutenir et pour mobiliser l’effort de l’élève. Sinon, comment sanctionner l’implication et l’effort personnels de l’élève ?
Le deuxième thème que je souhaitais évoquer est la contrepartie de celui-là. L’élève qui entre à l’ENA a le droit d’avoir des règles d’évaluation claires et stables. Il lui appartient ensuite, en fonction de ses capacités, de sa volonté personnelle, de ses ambitions et – pourquoi ne pas le dire ? – de ses talents, de construire sa liberté de choix, en écartant par exemple telle carrière exigeant une mobilité territoriale, ou internationale difficilement compatible avec une vie familiale et en choisissant au contraire une carrière plus technique.
C’est à l’élève, en deux ans, avec des règles claires, stables et transparentes de construire sa liberté et de constater, au fur et à mesure de sa scolarité, les champs possibles qui s’ouvrent à lui pour son premier poste.
Enfin, et c’est le troisième thème que je voulais aborder et sur lequel je conclurai, il appartient à l’État de se poser la véritable et la plus importante question : comment gère-t-il ses cadres supérieurs ? C’est sans doute la défaillance de l’État dans la gestion de ses cadres supérieurs qui est le problème majeur, beaucoup plus que celui du classement. En effet, gérer des cadres supérieurs suppose d’avoir du temps à leur consacrer, de faire preuve d’écoute et d’organiser des entretiens d’évaluation.
Éric Woerth, qui a fait carrière au sein du secteur privé dans le domaine du conseil, le sait parfaitement, dans une société de conseil, le temps consacré à chaque consultant par son mentor pour le juger et l’apprécier correspond à plusieurs journées de travail par an. Dans le cadre du conseil, un salarié doit à son employeur 220 journées par an, dont deux à trois journées d’évaluation.
Or l’État ne réalise jamais cette évaluation. En outre, l’État employeur ne maîtrise pas toujours ses effectifs, les pyramides des âges et les prévisions. Cela n’a pas été grave de très nombreuses années durant parce que les débouchés en dehors de l’administration étaient considérables.
Aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, vous avez à gérer des administrateurs tendus et préoccupés. Ils s’interrogent légitimement sur ce que l’on peut faire en dehors de l’État ou après l’État et se demandent s’il existe une autre carrière possible.
On peut l’imaginer, il y a des réussites, notamment dans les collectivités locales. Vous avez raison d’organiser cet échange. Mais force est de le reconnaître, la disparition de l’économie publique, l’économie mixte aboutit à priver l’État employeur de débouchés qui étaient suffisamment motivants pour que l’on ferme les yeux sur une gestion humaine parfois défaillante. Les récompenses venaient toujours à point à celui qui savait les attendre ! Ces récompenses n’existent plus.
La solution doit être trouvée soit à l’intérieur de l’État, soit en organisant des débouchés à l’extérieur de l’État, mais cela est de plus en plus difficile parce que le secteur privé s’est organisé pour se passer des énarques et cela lui réussit convenablement.
Ainsi s’explique la tension actuelle des élèves de l’ENA. Ce n’est pas la question du classement qui est en jeu. Les élèves se demandent comment ils seront considérés à long terme.
Ce premier rendez-vous sur dossier que vous proposez est lourd de menaces. Il ne règle pas la question de la gestion dans le temps et constitue en quelque sorte une concession à l’humeur ou à la mode ; il ne règle rien et laisse entièrement ouverte la question de la gestion des carrières pour des vies professionnelles construites autour d’un métier particulier, le service de l’État, exercé pendant une durée surprenante aujourd’hui.
En effet, pour diriger une grande entreprise, l’avocat d’affaire, le consultant, l’audit sait qu’il devra changer plusieurs fois de métier et d’employeur.
En revanche, dans la fonction publique, nous maintenons un système de carrière linéaire tout au long de la vie, ce qui entraîne des contraintes particulières.
Monsieur le secrétaire d’État, je ne suis pas certain que votre proposition aille dans le sens de la responsabilité et du respect du fonctionnaire désireux de consacrer sa vie au service de l’État. Cela pourrait donner le sentiment profond de remplacer une règle claire, même si elle est stressante et parfois injuste à la marge – mais quel le classement ne l’est pas ? –, par un système dont la confusion a été dénoncée à juste titre par MM. Josselin de Rohan, Yann Gaillard et Philippe Marini.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d’État, nous avons beaucoup de respect pour la quasi-totalité de votre réforme, mais nous vous demandons de bien réfléchir avant d’engager la suppression du classement de sortie, qui a au moins le mérite de la clarté et de la transparence.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, pour ma part, je voudrais approfondir un aspect du recrutement et de la formation des hauts fonctionnaires de l’État qui est, me semble-t-il, essentiel pour notre société. Je fais en effet référence à la démocratisation et à la diversité sociale. Je serais même tenté de parler de « démocratisation par la diversité sociale ».
Monsieur le secrétaire d’État, au mois de septembre 2007, la commission des affaires culturelles du Sénat m’a confié la rédaction du rapport de la mission d’information portant sur la diversité sociale et l’égalité des chances dans la composition des classes préparatoires aux grandes écoles, présidée par notre collègue Jacques Legendre.
L’orateur brandit un exemplaire dudit rapport.

Les constats sont sensiblement identiques, voire plus préoccupants, s’agissant du recrutement des hauts fonctionnaires. La diversité sociale dans les hautes écoles de l’administration est particulièrement faible. Comme vous le savez, à l’entrée en classe de sixième, le taux d’élèves issus des milieux populaires est de 45 %. Et cette proportion tombe à 13 % à l’entrée des classes préparatoires aux grandes écoles !
D’ailleurs, ce qui est vrai pour les grandes écoles l’est également pour l’enseignement supérieur en général, c’est-à-dire pour l’université. En effet, aujourd’hui, à peine 33 % des enfants issus des classes modestes accèdent à l’enseignement supérieur à la sortie du baccalauréat. Et seulement 16 % d’entre eux obtiennent les diplômes les plus élevés à l’université.
En d’autres termes, l’« ascenseur social » est en panne depuis trop longtemps, ce qui a des conséquences sur la motivation des élèves. Un phénomène d’autocensure s’est ainsi développé parmi les classes les moins favorisées s’agissant de l’accès aux grandes écoles ou aux plus hautes sphères de l’administration. Cette autocensure est d’ordre à la fois socioculturel et psychologique et elle renvoie à la défaillance de notre système d’orientation.
Et cela n’est pas sans conséquences pour notre pays. Le mode de reproduction des élites handicape les administrations et les entreprises, car celles-ci ne peuvent pas trouver au sein du vivier des jeunes diplômés la diversité des talents et des personnalités qu’elles souhaitent recruter. Notre pays ne peut pas être dirigé par des personnes qui sont pour l’essentiel issues des mêmes milieux socioculturels, au demeurant souvent éloignés du quotidien vécu par le plus grand nombre.
Notre administration tout comme nos entreprises doivent être dirigées par des personnes ayant, certes, des compétences exemplaires, mais connaissant également la réalité du monde dans lequel elles vivent. La mixité sociale est un devoir de justice au service de l’égalité des chances, mais c’est aussi une chance et un enrichissement pour notre société. Le phénomène d’endogamie de nos élites est au contraire injuste et pénalisant.
Nous devons avoir une volonté de fer pour que l’autocensure recule et que les instances dirigeantes de notre pays puissent refléter la France réelle, et non reproduire indéfiniment les mêmes élites.
Ainsi, la diversité sociale dans les classes préparatoires aux grandes écoles a nettement régressé ces dernières décennies. Le taux d’élèves issus des catégories sociales défavorisées est passé sous la barre de 10 %, contre 30 % d’enfants d’enseignants ou issus de milieux sociaux aisés. Entre 1945 et 1970, il y a eu une certaine démocratisation dans le renouvellement des élites. Mais, il faut le reconnaître, cette démocratisation s’est interrompue dans les années qui ont suivi.
Le constat est encore plus lourd dans les plus grandes écoles de formation des fonctionnaires : la diversité sociale y est pratiquement inexistante. Je vous en fournirai un seul exemple : cette année, à l’ENA, sur 162 parents d’élèves, seulement 4 sont ouvriers !
La conséquence est simple. Les futurs fonctionnaires actuellement scolarisés à l’ENA ne sont pas suffisamment représentatifs de la diversité de la population française.
M. Yves Pozzo di Borgo opine

En allant plus loin dans l’analyse, nous pouvons observer une déviance dans le recrutement actuel au sein de l’ENA. Comme cela a été rappelé, trois types de concours permettent d’intégrer cette grande école. Le concours externe s’adresse aux diplômés de l’enseignement supérieur, le concours interne concerne les fonctionnaires ou agents publics ayant au moins quatre années de services effectifs et le troisième concours est destiné aux salariés du secteur privé ou aux personnes exerçant un mandat électif local.
Ainsi, le concours interne et le troisième concours permettent, et c’est positif, à des personnes ayant un profil différent, c'est-à-dire n’ayant pas fait Sciences Po ou une autre grande école, de pouvoir tout de même accéder à l’ENA.
Pourtant, et cela a déjà été souligné, les statistiques établies depuis 2000 montrent que les élèves issus du concours interne et du troisième concours sont sous-représentés dans les grands corps de l’État. Ainsi, dans la promotion Copernic, en 2002, 93 % des élèves ayant intégré les grands corps étaient issus du concours externe. Et cette proportion était de 86 % dans la promotion Romain Gary, en 2005.
L’expérience professionnelle et le mérite des fonctionnaires ou des salariés concernés, qui préparent le concours, souvent le soir après leur travail, et cela pendant des années, ne sont donc pas reconnus à l’entrée à l’ENA, pas plus d’ailleurs qu’à la sortie !
En 2008, les élèves de la promotion Aristide Briand ayant intégré les grands corps étaient issus du concours interne à 27 % et du troisième concours à 14 % !
L’administration se prive ainsi de l’expérience professionnelle enrichissante et concrète qu’ont pu acquérir des personnes dotées d’une impressionnante motivation. Les affectations dans l’administration sont donc marquées par des discriminations, malgré les mérites et l’expérience reconnus des élèves.
Les conséquences dommageables pour la société française de cet état de fait ont été reconnues par les dirigeants des grandes écoles de notre pays. Petit à petit, et en particulier depuis la parution du rapport de notre commission des affaires culturelles, des expérimentations ont été mises en place dans plusieurs établissements importants.
Comme cela a été indiqué tout à l’heure, et j’ai plaisir à le répéter, l’Institut d’études politiques de Paris a signé des conventions d’éducation prioritaire avec sept lycées partenaires depuis 2001. Ce dispositif concerne aujourd'hui quatre-vingts lycées. Ces conventions permettent à des lycéens scolarisés en zones urbaines sensibles ou en zones d’éducation prioritaires d’accéder à cette école et, demain, peut-être à l’ENA.
De même, l’école des Hautes études commerciales, ou HEC, a mis en place des mesures visant à favoriser l’égalité des chances. Des conventions ont été signées avec plusieurs lycées, en particulier de la banlieue parisienne, afin d’organiser le « tutorat spécifique ».
Le lycée Henri-IV à Paris a également lancé une expérimentation à la rentrée 2006. Une « classe préparatoire aux études supérieures » accueillant une trentaine d’élèves boursiers méritants a été créée.
Les exemples que je viens de mentionner constituent seulement une petite partie de l’ensemble des initiatives qui naissent un peu partout sur le territoire et qui commencent à toucher le monde encore plus fermé du recrutement et de la formation des hauts fonctionnaires de l’État.
En effet, monsieur le secrétaire d’État, le 25 mars dernier, vous avez annoncé la création d’une classe préparatoire à l’ENA pour les jeunes de milieux sociaux défavorisés. Au mois d’octobre prochain, une classe préparatoire intégrée devrait être ouverte en vue des concours organisés en 2010.
Les jeunes qui pourront en bénéficier seront issus de milieux aux revenus modestes et devront avoir effectué au moins une partie de leur scolarité en zone d’éducation prioritaire, ou ZEP. Cette classe accueillera quinze élèves, soit plus de 35 % des postes ouverts au concours externe. Je salue cette initiative, qui va dans le bon sens et qui permet de favoriser l’égalité des chances.
D’ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, vous avez également incité les 169 directeurs d’écoles de la fonction publique à s’engager eux aussi dans la mise en place de classes préparatoires. Cette initiative devrait être réalisée au plus vite, car elle répond au souci que j’exprime depuis le début de mon intervention.
Cependant, de telles initiatives sont encore trop peu nombreuses. Pour les grandes écoles, les expérimentations ont été mises en place ; je viens de le souligner. Mais cela représente 5 % des lycées sur l’ensemble du territoire français. Cela semble beaucoup, mais c’est encore très peu. Un bilan est nécessaire et une généralisation devrait être envisagée pour éviter de nouvelles inégalités entre lycées « tutorés » et les autres. Mais cela est encore plus vrai dans notre système de recrutement et de formation des fonctionnaires.
Monsieur le secrétaire d’État, un rapport qui vous a été remis au mois de février dresse un bilan des écoles de formation de fonctionnaires et indique que ces dernières tendent « à privilégier certaines catégories sociales », ce qui « conduit à un système à faible renouvellement ».
La volonté du Gouvernement doit s’exprimer de manière plus forte, afin de permettre aux mesures que vous prendrez de modifier profondément une telle situation.
La France a besoin de fonctionnaires, notamment de cadres ayant acquis un haut niveau de connaissances, mais également une expérience professionnelle, une expérience de la vie et une connaissance de la société dans toute sa diversité. En ce sens, l’ENA doit devenir une véritable école d’application, en phase avec la réalité de notre monde moderne, avec la vie quotidienne de nos concitoyens et de tous ceux qui résident dans notre pays.
La France ne peut pas se permettre l’échec. Nous sommes tous en droit d’attendre que le recrutement et la formation de ses hauts fonctionnaires soient à la hauteur de la dignité de la tâche que notre pays attend d’eux. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, même si je n’ai pas encore eu le temps de bien poser ma réflexion – je me suis saisi de ce dossier seulement hier soir –, j’aimerais vous faire part de quelques éléments pour enrichir notre débat. Je remercie naturellement mon collègue Josselin de Rohan, président de la commission des affaires étrangères, d’en avoir pris l’initiative.
Tout d’abord, je voudrais exprimer un regret. Il est vrai que la question dont nous discutons fait l’objet d’un simple décret. Mais, compte tenu de son importance, je pense qu’elle devrait relever de la compétence de la représentation nationale.

En effet, la formation des administrateurs de la fonction publique a des conséquences non seulement sur la vie politique, mais également sur la vie quotidienne de tous nos concitoyens. Je regrette donc que les principes juridiques de répartition des pouvoirs fassent relever un tel sujet du décret.
Je le comprends, le débat sur une éventuelle suppression du classement de sortie part d’une réflexion que nous nous faisons tous. Les résultats obtenus par de jeunes fonctionnaires âgés de vingt-trois ou vingt-quatre ans lors de leur sortie de l’ENA façonnent la suite de leur carrière. En d’autres termes, leur perspective d’évolution professionnelle est déterminée dès cet âge. Je comprends donc que le Président de la République souhaite un réexamen, voire un changement, de cette situation.
De surcroît, le classement de sortie fige la carrière non seulement de ces jeunes fonctionnaires, mais également de tous les membres de l’administration. En effet, nombre de fonctionnaires, qui aimeraient bien occuper certains postes, savent d’emblée que les places convoitées seront certainement occupées par des diplômés de l’ENA.
Je comprends donc parfaitement les interrogations qu’un tel état de fait suscite et la position du Gouvernement. Je pense également qu’il était fondamental d’aborder le problème du classement de sortie pour envisager une réforme du système.
Évidemment, le classement de sortie de l’ENA conditionnait l’accès aux grands corps – la Cour des comptes, le Conseil d’État et l’Inspection des finances – ainsi qu’aux préfectures et au Trésor.
L’accès aux grands corps non seulement permettait d’exercer des responsabilités importantes, mais conférait aussi une promotion sociale. On appartenait à « l’énarchie », terme inventé à l’époque par Jean-Pierre Chevènement dans son livre L'Énarchie ou les Mandarins de la société bourgeoise. Souvenez-vous, on se moquait des jeunes provinciaux débarqués à Paris, qui réussissaient l’ENA et achetaient des Weston, s’habillaient chez Boston Brothers à New York, pour montrer qu’ils étaient dans le moule de l’ENA et avaient réussi socialement.
Les grands corps ont été mis en place en vertu d’une sorte de contrat social entre les hauts fonctionnaires et la nation.

Aux termes de ce contrat, ceux qui appartiennent à ces grands corps travaillent pour l'État, comme l’a souligné M. Fortassin, et non pas pour le Gouvernement, ce qui leur permet de conserver leur indépendance.
Or les grands corps connaissent depuis des années de très nombreux départs. Je prendrai pour exemple la situation de l’Inspection des finances.
Ainsi, je ne suis pas énarque moi-même, mais, dans le cadre de mes anciennes fonctions d’inspecteur général de l’éducation nationale, j’ai participé à une réunion de réflexion sur les inspections, menée conjointement entre mon corps et l’Inspection des finances.
À l’époque, le chef de service de l’Inspection des finances nous a fait part de sa préoccupation de voir ses effectifs composés exclusivement d’inspecteurs des finances âgés soit de vingt-quatre à trente-deux ans, soit de cinquante-cinq à soixante ou soixante-cinq ans. Autrement dit, les inspecteurs des finances se situant dans la tranche d’âge comprise entre trente-deux ans et cinquante-cinq ans étaient en fonction partout ailleurs, en particulier dans les entreprises.
Il convient donc de s’interroger au sujet de ces grands corps, d’autant que, ne l’oublions pas, ils constituent le modèle de promotion sociale proposé à l’ensemble de l’administration française, qui est puissante.
Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de rappeler que l’ENA a été créée après la guerre pour la reconstruction de la France et que les fonctionnaires qui en étaient issus exerçaient une mission de service public. C’était une valeur. Comme l’a dit M. Fortassin, ces fonctionnaires n’étaient pas corrompus, qualité fantastique, comparativement à d’autres pays en Europe ou au-delà.
Or que constate-t-on aujourd'hui ?
Je sais bien que ce n’est peut-être pas le moment pour soulever ce point, et je ne veux pas m’en prendre à l’Inspection des finances ni à ceux de nos collègues inspecteurs des finances présents dans cette enceinte ! Cependant, tout ce qui s’est passé, les excès de certains, devenus patrons de banques, les retraites « chapeau », ont des conséquences non pas uniquement sur l’opinion publique, mais sur le modèle social proposé aux jeunes fonctionnaires de toutes les catégories.
Dans ces conditions, je me demande, monsieur le secrétaire d'État, si nous avons intérêt à conserver ces corps dans leur structure actuelle, si nous ne devrions pas opérer des fusions comme le rapprochement intelligent qui a lieu entre le corps des Mines et celui des Télécoms. Ne conviendrait-il pas de mener une réflexion similaire appliquée à l’administration en imaginant, par exemple, les corps « économie et finances », les corps « droit et contrôle » et, peut-être, des corps opérationnels ?
Supposons que je sois vice-président du Conseil d’État et que je reçoive les jeunes stagiaires de l’ENA ou les élèves qui en sont issus, entre la fille d’un de mes amis et le jeune débarquant de province, serais-je suffisamment indépendant pour dire qui est le meilleur ? J’évoque cette situation parce que, sans aller jusqu’à rejoindre les propos de M. Bodin, je sais, en tant qu’élu du VIIe arrondissement – le quartier du pouvoir – que ce genre de dilemme intervient.
À mes yeux, le classement est une bonne chose, mais uniquement pour les fonctionnaires opérationnels. En effet, l’un des gros problèmes de l’administration française tient au fait qu’elle ne possède guère de directions des ressources humaines. Voilà une quinzaine d’années, lorsqu’un ministre de l’éducation nationale a créé des directions des ressources humaines dans ses rectorats, c’était une révolution ! Imaginez, ce ministère, qui gère des milliers de fonctionnaires, n’avait pas de DRH !
Quoi qu’on en dise, les services des ressources humaines constituent un atout intelligent pour le secteur privé.
En ce qui concerne les corps opérationnels, je rejoins votre raisonnement, monsieur le secrétaire d’État. Est-il normal, en effet, de s’en remettre au classement pour déterminer l’affectation dans les corps opérationnels ? Pour gérer des hommes, n’a-t-on pas besoin de personnes possédant du charisme, du tempérament, de l’imagination ? Combien de fois n’a-t-on pas vu des élèves à la sortie de l’ENA, même majors de promotion, se révéler incapables de gérer un simple service ! Il a fallu les changer d’affectation !
J’attire donc votre attention, monsieur le secrétaire d'État, sur la nécessité de tenir compte des qualités nécessaires pour assumer la gestion des hommes et des femmes.
Permettez-moi d’évoquer d’autres interrogations importantes, qui concernent non pas uniquement l’ENA, mais l’ensemble de la fonction publique.
Lors de sa création, au moment de la constitution de la Communauté économique européenne, la Commission européenne a souhaité recruter des fonctionnaires non pas nationaux, mais indépendants, et a mis en place à cet effet un corps de fonctionnaires spécifiques pour ses services et pour le Parlement européen.
Or force est de constater que, dans ces corps de fonctionnaires européens, l’emprise des pays est importante. Croyez-vous que les directives européennes qui ont dû être appliquées par la France depuis 1986, au début de la présidence de M. Jacques Delors, étaient dépourvues de toute influence anglo-saxonne ? En réalité, les Anglais et les Allemands ont été beaucoup plus malins que nous en plaçant leurs fonctionnaires aux postes élevés !
Je pose donc la question suivante : n’avons-nous pas intérêt à mener une réflexion, dans le cadre de la réforme de l’Europe, afin de faire en sorte que les hauts postes dans les structures européennes et les instances internationales soient occupés par des fonctionnaires français, et qu’ils ne soient pas réservés à ceux du Quai d’Orsay ?
Par ailleurs, les administrations des pays qui constituent l’Europe sont plus ou moins inégales. Celle de la France est forte et puissante, avec des fonctionnaires de qualité. Ne pourrait-on envisager de concevoir une sorte de programme d’échange de type Erasmus pour les administrateurs de l’Union européenne ? On peut comprendre qu’un fonctionnaire de l’ENA qui est enfermé dans son poste de l’éducation nationale pendant quarante ans puisse éprouver quelque frustration !
J’en viens au problème de la pyramide des responsabilités au sein de laquelle toute une énergie se trouve perdue.
En effet, pour les énarques atteignant l’âge de quarante ou quarante-cinq ans, les perspectives de devenir directeur sont faibles, les postes correspondants étant de moins en moins nombreux, d’où leur sentiment de frustration.
Certains d’entre eux se font nommer dans les inspections. Contrairement à ce qui se dit, ces dernières ne sont pas, à mes yeux, le « cimetière des éléphants ». Par expérience, je peux témoigner du fait que les inspections centralisent beaucoup d’intelligence et une grande capacité de travail lorsque les inspecteurs s’attellent à leur mission.
Cependant, lorsqu’on se rend dans les inspections des différentes administrations, on sent et on voit très bien que les hauts fonctionnaires, d’une grande compétence, n’ont pas de responsabilité opérationnelle : ils réfléchissent sur un sujet d’étude.
À cet égard, je me tourne vers vous, mes chers collègues, car il s’agit d’un débat que j’ai lancé dans mon groupe dès le début de mon mandat de parlementaire. En effet, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, le Sénat dispose d’une semaine de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, mais nos moyens ne sont pas suffisants pour exercer ce contrôle.
Or il existe une énergie extraordinaire au sein de la fonction publique, celle des inspections et de tous ces hauts fonctionnaires en pleine force de l’âge, pas encore en fin de carrière, mais qui ne peuvent pas travailler.
Monsieur le secrétaire d’État, je vous soumets la proposition suivante : pourquoi n’intégrerions-nous pas dans la réforme du Parlement le fait que les inspections puissent être saisies par les commissions du Parlement et l’idée que des hauts fonctionnaires qui ne savent pas comment utiliser leur énergie puissent être récupérés et mis à disposition du Parlement pour accompagner les parlementaires dans le travail de contrôle ?
Vous le savez par expérience, et je l’ai bien vu moi-même, les inspections des ministères sont les meilleures pour effectuer ces contrôles.
Derrière toute cette série de remarques à bâtons rompus, j’espère que vous aurez compris, monsieur le secrétaire d’État, que notre souhait est de retrouver une administration qui garde sa force et la compétence de ses administrateurs, mais surtout qui ne dérape pas et continue à rester au service du pays.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, n’étant pas issu du sérail de la fonction publique, je centrerai mes propos sur les principes du recrutement de la haute fonction publique.
Je viens d’une région dont l’identité a été façonnée non pas tant par ses contours géographiques, ses monts ou ses vaux, son relief ou son climat, que par les hommes.
En effet, la Bourgogne n’est devenue une unité économique, sociale, historique et politique qu’à force de volontés, qui ont fait de ce lieu de passage une terre chérie des hommes, dans un profond sentiment d’unité.
Je veux dire par là que, par-delà la diversité des territoires qui la forment, la diversité des traditions qui l’animent et la diversité des hommes qui y vivent, ce sont des volontés qui ont façonné la Bourgogne.
Quel est le lien avec notre présent débat sur le recrutement de la haute fonction publique ?
Laissez-moi vous rapporter l’un des combats fondateurs pour l’histoire de ma région, qui ne manquera pas de poser les termes du débat.
Un bourguignon fameux, Philippe le Hardi, premier des grands ducs de Bourgogne, a poursuivi un grand projet : celui d’unifier la Bourgogne en fortifiant sa vocation dans le royaume de France.
Or la lutte de Philippe le Hardi ne vit triompher cette vision de « la Bourgogne dans la France » qu’au prix d’un conflit farouche qui opposa le duc Philippe aux marmousets du roi, de proches conseillers qui tendaient alors à disposer de l’ensemble des leviers de pouvoirs dans le royaume.
Ainsi, le projet d’une Bourgogne dans la France soutenu par Philippe le Hardi avait une contrepartie pour Charles VI, celle de concevoir la France plurielle, ouverte à la Bourgogne. Ainsi, la naissance de cette entente féconde eut un prix : la renonciation à une certaine forme de privatisation du royaume de France au bénéfice des seuls praticiens du pouvoir central.
Il fallait que le roi renonce à laisser entre les mains des fameux marmousets l’ensemble des leviers de pouvoirs dont ses propres amis avaient alors la disposition.
Ce bref rappel historique ne manquera pas de jeter des lumières sur la manière dont il convient de poser les termes d’un débat sur le recrutement de la haute fonction publique. Tout État doit disposer d’une fonction publique performante, qui soit garante de sa continuité, de son indépendance et de son efficacité.
Cependant, à cette haute vocation, il convient d’opposer un vice pernicieux : la tendance à la privatisation de l’État au bénéfice de ses hauts fonctionnaires.
Ainsi, la France ne s’est grandie que lorsqu’elle s’est attachée à intégrer de nouveaux profils parmi ses décideurs.
Pour filer l’analogie, je dirais que la France a rayonné lorsqu’elle a su priver les marmousets d’une partie des leviers de pouvoirs dont ils avaient le privilège.
Aujourd’hui encore, la France doit se montrer grande en ouvrant davantage sa haute fonction publique à la diversité du pays. Il ne s’agit pas de dénoncer un corps de privilèges ni une absence de contre-pouvoirs. Il s’agit de faire de la France un pays d’intégration sociale et politique.
Les critiques sont excessives lorsqu’elles véhiculent les clichés suivant lesquels notre haute fonction publique n’est qu’un creuset de reproduction sociale. Ces critiques, quoique fondées à certains égards, sont excessives au sens où elles font peser sur les personnes qui forment l’honorable corps de la haute fonction publique le poids des malaises économiques et sociaux dont souffre le pays.
C’est pourquoi je vous proposerai de voir dans les mécanismes de recrutement de la haute fonction publique non pas un système de reproduction sociale, tant décrié, mais un système de production sociale.
Tout l’enjeu de ce débat n’est-il pas de prendre la mesure des représentations sociales qui se sont ordonnées autour des mécanismes de recrutement de la haute fonction publique, dans un État particulièrement centralisé, où le poids de l’administration réel ou supposé, historique et actuel, nourrit et fait enfler une vision qui est véhiculée de l’administration ?
Il faut savoir jouer des modalités de recrutement de la haute fonction publique comme de forts symboles.
Oui, il faut d’abord avoir conscience du rôle joué par l’administration auprès des jeunes, et par là même dans l’ensemble du corps social. Ce rôle est symbolique.
Aujourd’hui, 75 % des jeunes entendent devenir fonctionnaires.
Ces jeunes aspirent à intégrer la fonction publique, notamment la haute fonction publique, quelle que soit leur formation initiale : il s’agit de jeunes formés dans les Instituts d’études politiques, ou IEP, mais aussi de jeunes formés à l’université, dans des écoles d’ingénieurs, voire dans des écoles de commerce.
Oui, il n’a pas fallu attendre la crise pour que mêmes les plus grandes écoles de commerce préparent aux concours de la haute fonction publique. N’y a-t-il pas là un paradoxe ? La société civile française n’offre-t-elle donc pas aux jeunes la moindre réponse à leur attente de réussite sociale ? En France, la société civile est-elle donc synonyme d’échec social ?
Le véritable problème est que, dans notre pays, le poids de l’administration et ses modalités de recrutement ont fait de la haute fonction publique le moyen prépondérant de réussite sociale. Je veux dire qu’en France, bon gré mal gré, la réussite ne veut voir qu’un visage.
Réfléchir sur les modalités de recrutement de la fonction publique suppose de bien prendre la mesure des représentations sociales que véhicule, voire que renforce, la haute fonction publique elle-même.
Permettez-moi alors d’esquisser quelques pistes de réflexion.
Tout d’abord, les concours de la haute fonction publique doivent redonner une place aux filières universitaires.
Est-il normal que, en France, un jeune n’ait de réelles chances de succès à un concours de la haute fonction publique qu’en sortant des grandes écoles ?
Autrement dit, est-il normal que, en France, les concours d’accès à la haute fonction publique soient conçus de manière à n’offrir de réelles chances de succès qu’aux étudiants qui proviennent de ces grandes écoles ?
La crise actuelle que traverse le monde universitaire trouverait écho à adapter les concours d’accès à la haute fonction publique à des candidats issus de filières monodisciplinaires, telles que les filières universitaires.
Il faut que l’État reconnaisse le premier la qualité des formations universitaires délivrées en philosophie, en histoire, en sociologie, en gestion, en économie, en droit privé, en droit public, en mathématiques, en physique, en biologie, voire en médecine et en pharmacie.
Les étudiants issus de ces filières universitaires n’ont pas moins de capacités que ceux qui sortent de filières pluridisciplinaires des grandes écoles. Seulement, leur formation initiale ne leur permet pas d’atteindre le même degré de préparation dans chacune des disciplines par lesquelles sont aujourd’hui évalués les candidats aux concours de la haute fonction publique.
Ainsi, il serait plus républicain que les concours de recrutement de la haute fonction publique prennent la forme de trois épreuves dont les coefficients sont encore à fixer : une discipline forte, déterminée selon les catégories du Conseil national des universités ; une note de synthèse ; une langue vivante.
Voilà une proposition concrète qui tendrait à offrir à tout jeune une chance raisonnable de succès à un concours de la haute fonction publique sans qu’il y consacre pour autant un, deux ou, souvent, trois ans de préparation, en plus de sa formation initiale, généralement un master, mais aussi un doctorat.
En outre, il s’agit d’une proposition à moindre frais dans la mesure où il est aisément concevable d’intégrer une formation en note de synthèse et en langue vivante dans l’ensemble des parcours universitaires.
L’idée est bien de créer des parcours de formations communs aux hauts fonctionnaires et aux décideurs de la société civile.
Ensuite, une redéfinition des modalités de recrutement de la haute fonction publique doit être l’occasion de rapprocher la fonction publique des usagers.
En ce sens, ne serait-il pas souhaitable de supprimer tout bonnement le premier concours de recrutement pour ce qui concerne la haute fonction publique ?
Cela dégagerait plus de marge en faveur de la promotion interne au sein de la fonction publique dans le cadre du deuxième concours.
Cela inciterait les jeunes français à s’orienter davantage vers la création de richesse au sein de la société civile plutôt que de faire le choix de prolonger indéfiniment leurs études en vue de présenter des concours.
Cela favoriserait non seulement la promotion interne, mais encore le recrutement dans le cadre du troisième concours à destination des personnes ayant des parcours professionnels significatifs et remettrait en valeur les parcours professionnels.
La philosophie d’une telle proposition consiste à rendre plus efficace l’administration du pays en favorisant le recrutement de la haute fonction publique au sein de deux viviers : soit des fonctionnaires expérimentés dont la qualité du service aurait été reconnue, soit des professionnels issus de la société civile et du monde de l’entreprise afin de rendre plus sensible la haute fonction publique aux évolutions de la société.
La société évolue plus rapidement que l’État. Elle le précède toujours.
Oui, la philosophie de ces propositions est de faire de l’État le prolongement de la vie réelle, et non, comme cela semble trop souvent le cas aujourd’hui, de faire de la vie civile le prolongement de l’État.
Prenons l’exemple du recrutement des magistrats. L’affaire d’Outreau a largement démontré qu’il serait souhaitable que les juges connaissent le métier d’avocat et apprennent l’épaisseur de la vie aux côtés des victimes.
Procèdent de la même philosophie les difficultés posées par le projet de loi « hôpital, patients, santé et territoires » que nous examinerons prochainement ici même. Si l’on conçoit que le pouvoir administratif doit jouer un rôle dans la gestion des établissements de santé, on ne saurait pour autant concevoir qu’il y joue le rôle principal. Dans de tels établissements, le métier de base est la médecine ; la gestion administrative n’en est qu’une fonction « support ».
Enfin, la redéfinition des modalités de recrutement de la haute fonction publique doit prendre en considération quelques archaïsmes.
Le niveau de recrutement de la haute fonction publique ne doit pas non plus conduire à une surenchère des diplômes généralistes.
Il est nécessaire de réduire l’inflation des diplômes généralistes sans perspective professionnelle. Or les modalités actuelles de recrutement de la fonction publique ont pour conséquence directe de faire de l’inflation des diplômes généralistes une norme de réussite sociale.
Il semble donc temps de mettre fin au premier concours de recrutement, au profit des deuxième et troisième concours. Les modalités de recrutement de la haute fonction publique jouent un rôle éminent dans les canons de reconnaissance sociale, qui doivent aujourd’hui mettre à l’honneur des parcours professionnels civils.
Dans le même ordre d’idée, la fonction publique ne doit pas offrir de formation initiale à proprement parler, et ce pour plusieurs raisons.
Il n’appartient pas aux écoles de la fonction publique de délivrer une formation initiale en dehors du cadre normal de l’enseignement supérieur.
Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste.

Si toutefois le principe suivant lequel de telles écoles devraient délivrer une formation initiale était acquis, il semble évident qu’il ne faut pas assortir cette formation d’une rémunération au titre du statut de fonctionnaire stagiaire dans la mesure où la formation dispensée est une formation managériale.
Prenons l’exemple d’un amphithéâtre d’histoire à la Sorbonne.

Est-il normal qu’entre deux étudiants préparant l’agrégation, l’un étant normalien est rémunéré comme fonctionnaire stagiaire, l’autre ne l’étant pas doit travailler pour financer son année de préparation ?
Ce serait trop élargir le sujet des préparations aux concours de la haute fonction publique que d’examiner l’ensemble des verrous qui empêchent toute mobilité sociale dans notre pays.
Pour conclure, quand Yannick Bodin parle de classe sociale, je préfère parler de milieu social, car il est plus facile de s’extraire d’un milieu social que d’une classe sociale.

Je n’ai pas parlé de classe sociale ! J’ai parlé de milieu socioculturel !

Cependant, une telle extraction peut paraître presque impossible pour un certain nombre de jeunes français qui n’ont pas eu la chance de naître dans une bonne famille d’un beau quartier, de suivre une scolarité dans un bon collège, dans un beau lycée, de bénéficier d’une bonne classe préparatoire aux grandes écoles et d’une belle école.
Nos valeurs doivent être le pluralisme, l’égalité des chances et la mobilité sociale.
Lorsqu’on parle de recrutement de la haute fonction publique, on touche nécessairement aux symboles. Il est aujourd’hui plus que temps d’envoyer notamment aux filières universitaires des signes forts et de dire à tous les jeunes qui en sont issus qu’ils ont encore une place dans le camp de la liberté, et qu’il y a un sens à servir la France.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ma réponse sera un peu longue, par respect pour tous ceux qui se sont exprimés et compte tenu de la densité des interventions, je pense en particulier à celle de M. Josselin de Rohan.
Avant de répondre point par point à chacun des orateurs ayant bien voulu nous faire part de ses remarques sur la réforme de l’ENA, je souhaite en quelques minutes préciser les grandes lignes de cette réforme.
Il faut avant tout rappeler qu’il s’agit d’une demande du Président de la République, qui a souhaité cette réforme lors de ses vœux aux corps constitués, en janvier 2008.
Je veux redire, c’est un propos liminaire indispensable, l’attachement du Gouvernement à l’ENA, non parce que cette école est un symbole ou un emblème, mais parce que l’ENA est au cœur de notre construction républicaine d’après-guerre, au cœur également de notre fonction publique.
L’ENA a été créée en même temps que la Direction générale de la fonction publique et que le corps des administrateurs civils. Elle a même précédé la création du statut général des fonctionnaires de 1946. J’aime aussi à rappeler que la première promotion de l’ENA, « France combattante », était ouverte à tous, sans distinction de diplôme ou de classe sociale. Seuls comptaient, à l’époque, les titres de guerre.
Pourtant, au fil des années, de nombreuses critiques se sont élevées à son endroit : une provenance des élèves pas assez diverse, une scolarité de vingt-sept mois trop longue et trop académique, des recruteurs qui, paradoxalement, ne peuvent choisir leurs futurs collaborateurs – vous en conviendrez, c’est une véritable aberration.
Notre objectif n’est pas de porter une énième réforme de cette école en ignorant tout ce que nos prédécesseurs ont déjà fait. Notre objectif est de concevoir pour elle une nouvelle ambition s’appuyant sur ses atouts. De même, nous n’avons pas voulu élaborer une réforme uniquement polarisée sur la suppression du classement de sortie.
Cette suppression est un moyen, et non une fin en soi. Elle n’épuise pas l’ensemble des enjeux de l’État.
Pour élaborer de nouvelles orientations, nous avons conduit une concertation avec tous les acteurs du dossier. Nous avons réalisé de nombreuses auditions auprès d’employeurs, d’experts en recrutement, d’élèves, d’anciens élèves. Nous avons aussi réalisé un sondage auprès des trois dernières promotions d’étudiants et mené un groupe de travail avec la direction de l’ENA.
Ces travaux ont notamment mis en lumière une importante adhésion à la mesure de suppression du classement de sortie. Mais ils ont également mis en exergue les deux risques principaux qui s’y attachent, et que vous avez évoqués cet après-midi : la reconstitution des réseaux du favoritisme dans l’affectation des élèves, souvent décrits comme une caractéristique du système des concours particuliers d’avant-guerre ; la diminution de l’intérêt et de l’investissement des élèves de l’ENA au cours de leur formation à compter du moment où celle-ci ne serait plus sanctionnée par un classement final. Nous nous sommes donc attachés à construire un projet capable de prévenir ces deux risques.
À l’issue de ces mois de concertation, le Gouvernement a retenu plusieurs axes de réforme avec un double objectif. D’une part, nous avons voulu fournir à nos futurs hauts fonctionnaires la meilleure formation possible dans le respect des valeurs du service public et avec le souci d’une plus grande ouverture sur la société. D’autre part, nous avons souhaité « professionnaliser », le terme a été employé, le mode de recrutement des employeurs publics tout en garantissant la plus grande impartialité dans la procédure.
Quels sont les axes de la réforme ?
Le premier axe vise à ouvrir davantage l’ENA pour favoriser la diversité des talents et l’égalité des chances. Compte tenu de son statut, il est bien évident que l’ENA doit être exemplaire en la matière. Dès l’automne prochain, on l’a rappelé, l’ENA se dotera d’une classe préparatoire spécifiquement réservée aux publics défavorisés, c'est-à-dire des candidats issus de milieux modestes ayant effectué, par exemple, tout ou partie de leur scolarité en zone d’éducation prioritaire. Cette classe préparatoire réunira quinze élèves, soit plus de 30 % des places ouvertes au concours externe.
Je veux insister sur l’ambition du Gouvernement en la matière. Il ne s’agit pas de créer des voies parallèles qui seraient spécifiquement réservées à ces publics prioritaires. L’idée que nous trouvons plus porteuse, plus conforme à notre modèle méritocratique, c’est d’aider les candidats les plus méritants issus de la diversité sociale à réussir le même concours que les autres. C’est une belle ambition, qui nous permettrait de renouer pleinement avec les origines de l’ENA.
Le deuxième axe de la réforme porte sur la formation des élèves au sein de l’École. Nous n’ignorons pas que l’ENA a dû évoluer au cours de ses plus de soixante ans d’existence.
La réforme la plus récente a d’ailleurs permis de repenser le cursus des élèves en mettant l’accent sur certains points forts comme l’alternance entre les stages et les enseignements thématiques.
Nous ne sommes pas allés au bout de cette logique de professionnalisation. Nous voulons une formation à la fois plus courte et encore plus opérationnelle.
Les principes directeurs du nouveau cursus seront donc les suivants : la durée de formation commune, aujourd'hui de vingt-sept mois, sera réduite à vingt-quatre mois ; les stages représenteront au moins la moitié de la durée totale de formation, et l’un d’entre eux se déroulera sur plusieurs mois dans une entreprise ; l’aspect professionnel des enseignements sera renforcé ; enfin, après le recrutement, les élèves suivront une formation en alternance entre leur poste et l’ENA, et ce n’est qu’à l’issue de celle-ci qu’ils seront titularisés.
Le troisième axe de la réforme concerne évidemment la nouvelle procédure de sortie. Nous voulons sortir d’une logique, propre au classement, qui fait que les élèves sont affectés en fonction d’un rang, plutôt que recrutés par les employeurs pour leurs compétences et aptitudes.
Nous avons voulu tenir compte des conseils, parfois des craintes évoquées aujourd'hui aussi, en mettant en place une procédure qui réponde aux objectifs d’impartialité, de liberté de choix pour les élèves et de responsabilisation des employeurs.
Je souhaite donc répondre à la quasi-totalité des orateurs sur cette question.
La procédure de recrutement par les employeurs à la fin de la formation à l’ENA reposera sur de nombreux garde-fous.
La liberté de candidature est assurée pour les élèves. Ceux-ci pourront se porter candidat librement auprès de tous les employeurs, qui formaliseront et diffuseront une fiche de poste précise pour chaque poste ouvert au recrutement.
Le dossier d’aptitude de chaque élève sera étoffé : il comportera les notes obtenues ainsi que des appréciations littérales.
Les épreuves passées par les élèves conserveront donc toute leur importance, dans la scolarité comme dans le recrutement à la sortie de l’école.
L’anonymat sera respecté : les dossiers d’aptitude seront transmis sous une forme anonyme aux employeurs, ce qui constitue une garantie dans la phase de présélection sur dossiers.
C’est à partir des dossiers, en fonction des critères précisés dans les fiches de postes à pourvoir, que les employeurs pourront sélectionner les candidats qu’ils souhaitent auditionner.
À l’issue de la sélection sur dossiers anonymes, les employeurs conduiront des entretiens personnalisés. La décision de recrutement d’un candidat sera prise de manière collégiale. Enfin, un comité veillera à la régularité de la procédure de sortie.
La nouvelle procédure, encadrée par ces règles strictes, sera donc à même de limiter les risques d’arbitraire dans le choix des candidats.
Dernier point, vous parlez de « classement transparent et juste », mais permettez-moi de relativiser.
D’abord, pour un point de plus ou de moins à la note de stage – et Dieu sait quelle part d’arbitraire une telle note peut comporter –, un élève peut perdre jusqu’à dix places dans le classement, selon la confidence que je tiens de l’un de mes collaborateurs.
Ensuite, c’est négliger le côté guillotine — mot qui fleure bon la Révolution – de l’« amphi-garnison », méthode qui ne paraît pas particulièrement heureuse.
Je souhaite revenir maintenant plus en détail sur les différents points soulevés par les brillants orateurs de votre Haute Assemblée.
Monsieur de Rohan, la suppression du classement de sortie est une réforme profonde de l’accès à la fonction publique ; elle est guidée par le souci d’assurer aux administrations des recrutements d’énarques dont le profil correspond à leurs besoins spécifiques, et non seulement au prestige que reflète la place dans le classement.
Cette réforme suppose une professionnalisation de la part des employeurs : définition précise, objective, transparente de leurs critères de sélection ; conduite d’entretiens avec les candidats qui soient non pas des épreuves de classement, mais des tests permettant d’apprécier les aptitudes professionnelles ; collégialité dans les décisions.
Pour les élèves, comme l’a relevé Yann Gaillard, l’objectif est de les faire bénéficier non pas de vingt-sept mois d’épreuves visant à les classer, mais d’une formation, qui leur permette notamment de mieux exercer leurs fonctions, ainsi que d’un accompagnement qui les oriente vers les perspectives de carrière correspondant à leurs aspirations et à leurs talents.
Le rôle du comité ad hoc sera capital pour établir les règles assurant le respect des principes fondateurs de notre fonction publique et pour veiller à leur application.
S’agissant du dossier d’aptitude, il revient au comité ad hoc de le définir précisément. Toutefois, je le répète, il comportera non seulement des notes, mais aussi des appréciations littérales sur les candidats, ce qui constitue déjà une importante différence par rapport au seul classement. Par ailleurs, son élaboration sera entourée des nombreuses garanties mises en place pour assurer la transparence du processus.
Pour ce qui est de la mobilité à l’issue de l’ENA, il est tout à fait juste qu’elle doit être développée. Cette mobilité est, certes, prévue dans le parcours de tout énarque, mais le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, déjà voté par le Sénat et en cours d’examen à l’Assemblée nationale, permettra de renforcer cette tendance, encore trop faible, j’en suis d’accord.
Par ailleurs, je tiens à rassurer Yann Gaillard – brillant ancien élève de l’ENA
Sourires
Le Gouvernement entend maintenir l’accueil et la formation qui sont accordés aux stagiaires étrangers à l’ENA, notamment au travers du cycle international long. C’est en effet un gage de rayonnement de cette école, mais aussi, au-delà, de notre modèle d’administration et de nos valeurs républicaines.
À titre d’illustration, voilà quelques semaines, sur l’initiative de l’un de mes collaborateurs, énarque bien sûr, nous avons voulu vérifier combien d’ambassadeurs de pays étrangers en poste à Paris étaient issus de l’ENA. Eh bien, et c’est assez extraordinaire, ils sont dix ! Il y a parmi eux l’ambassadeur de Chine – par ailleurs authentique descendant de Confucius –, l’ambassadeur d’Allemagne, l’ambassadeur de Géorgie, l’ambassadeur de Tchéquie, l’ambassadeur de Singapour, l’ambassadeur de Mongolie, qui nous a assurés avoir été le premier Mongol à l’ENA, et qui sera sans doute le dernier…
Cela démontre que l’ENA a joué un rôle considérable et nous devons être fiers de l’action menée.
S’agissant de l’indispensable connaissance de la réalité du pays, monsieur Fortassin, elle sera renforcée par le développement de la place des stages, qui représenteront désormais la moitié de la scolarité et s’étendront sur douze mois. Les stages de préfecture, notamment de plus de quatre mois, devraient donner aux élèves une expérience concrète de nos territoires ; les stages en entreprise, que nous avons rajoutés et dont la durée sera également portée à quatre mois, déboucheront de même sur une expérience concrète.
À ce propos, je vous rassure, monsieur Sueur, la durée des stages sera équivalente pour les trois types de stage, Europe, territoire, gestion.
Concernant la connaissance, je ne suis pas très inquiet pour les élèves de l’ENA, souvent surdiplômés, d’où d’ailleurs le problème : lorsque l’on a fait Normal sup’ et Sciences Po, faut-il encore suivre un cycle de formation à l’ENA ? Vous soulevez la question par rapport à l’université : aujourd'hui, la difficulté est d’éviter la redondance entre les enseignements de l’ENA et ceux des formations précédentes.
Pour ce qui est du concours et de ses vertus pour assurer l’impartialité et l’objectivité, je tiens à dire que le Gouvernement y est très attaché et que le concours d’entrée à l’ENA constitue un exemple en la matière. Cependant, pour que la sortie de l’ENA soit juste, il est indispensable d’aller plus loin et de faire mieux correspondre les compétences et les aspirations des élèves avec le profil des postes et carrières qui leur sont offerts.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, avec l’autorisation de l’orateur.

Monsieur le secrétaire d'État, n’y a-t-il pas un risque – pour nous, ce risque est réel – qu’avec la suppression du classement de sortie s’instaurent des procédures qui ne donnent pas les garanties d’impartialité et d’objectivité nécessaires, ce qui aurait pour effet de réintroduire le népotisme et le favoritisme ?
Quelle réponse pouvez-vous apporter à cette question très simple et très précise qui a été posée par de nombreux orateurs ? Comment pouvez-vous garantir que la procédure à laquelle vous pensez sera équitable, et le sera au moins autant que le classement de sortie ?
Monsieur Sueur, permettez-moi de me répéter.
La liberté de candidature est assurée pour les élèves. Ceux-ci pourront se porter candidat auprès de tous les employeurs, qui diffuseront une fiche de poste précise.
Le dossier d’aptitude de chaque élève sera étoffé : il comportera les notes obtenues ainsi que des appréciations littérales.
Les épreuves passées par les élèves continueront à avoir leur importance dans la scolarité et le recrutement.
L’anonymat sera respecté : les dossiers d’aptitude seront transmis sous forme anonyme, ce qui constitue une garantie importante.
La décision de recrutement d’un candidat sera prise de façon collégiale.
Enfin, un comité veillera à la bonne régularité de la procédure de sortie.
Je ne peux rien ajouter à cela, monsieur Sueur, mais vos suggestions seront évidemment les bienvenues.
J’en viens aux bourses.
Avec Éric Woerthnous avons souhaité créer des bourses de parrainage qui doivent permettre d’attirer chaque année jusqu’à mille étudiants issus de milieux défavorisés et leur faciliter, notamment sur un plan matériel, l’accès aux concours de la fonction publique.
Les élèves de la classe préparatoire intégrée à l’ENA, qui sont en cours de sélection, représenteront 30 % des places ouvertes au concours externe ; bien sûr, ils pourront bénéficier de bourses de l’enseignement supérieur.
Grâce à ces deux mesures très concrètes, la diversité du recrutement de l’école sera améliorée, à l’instar de ce qui a été fait à Sciences Po, selon des modalités qui respectent l’égalité d’accès aux emplois publics.
Au dire de M. Marini, la procédure qui doit remplacer le classement de sortie deviendrait complexe. Il faut savoir ce que l’on veut ! Recruter quelqu’un est un exercice très difficile : il faut y mettre suffisamment de temps pour que le candidat et l’employeur soient sûrs de leur choix. Nous avons donc prévu deux mois pour cette procédure, qu’il faudra bien entendu tester et éventuellement ajuster.
La durée de la procédure tient aussi au fait que chaque élève peut être candidat à tous les postes : au regard des critères qui seront affichés par les employeurs et en fonction de ses propres envies, l’élève pourra limiter ses candidatures, mais nous avons souhaité lui laisser le choix, étant conscients des difficultés.
S’agissant des stages, je partage pleinement votre point de vue, monsieur Marini. C’est pourquoi nous avons voulu renforcer leur importance : ils représenteront désormais plus de douze mois sur les vingt-quatre mois de scolarité, et il s’agira bien sûr, pour répondre à votre interrogation, de stages de responsabilité.
D’une manière générale, vous avez adressé un message de confiance à l’ENA, message parfaitement justifié, au-delà des critiques dont cette école fait parfois l’objet. De la même façon, le Gouvernement est confiant dans la capacité des administrations à mieux recruter leurs principaux collaborateurs.
Pour Gérard Longuet, la réforme que nous défendons ne doit pas conduire à un désinvestissement ou à un désintérêt des élèves pour leur formation à l’ENA.
C'est la raison pour laquelle le dossier d’aptitude devra comporter les notes des élèves.
En ce qui concerne la gestion des cadres supérieurs, vous avez raison, monsieur Longuet : l’État doit consacrer plus de temps à la formation, à la gestion, à l’évaluation de ses cadres supérieurs et dirigeants. Je puis d’ailleurs vous dire qu’Éric Woerth et moi-même travaillons actuellement à des mesures pour que l’État puisse disposer d’une gestion des cadres supérieurs de premier ordre.
Je vous remercie de votre vibrant plaidoyer en faveur de l’ENA, telle que vous l’avez connue comme élève, mais aussi telle que vous l’avez décrite en tant qu’école professionnelle. Ce plaidoyer tranche avec le livre de Jean-François Copé Ce que je n’ai pas appris à l’ENA : L’aventure d’un maire
Sourires
Monsieur Bodin, le Gouvernement a, me semble-t-il, tiré toutes les conséquences du rapport, à l’élaboration duquel vous avez participé, sur la démocratisation du recrutement dans la fonction publique.
Vous souhaitiez en effet mettre fin à une forme de « délit d’initié » conduisant à une reproduction des élites. Les classes préparatoires intégrées, en particulier celle de l’ENA, visent précisément à inverser cette logique : il s’agit d’offrir un accès privilégié aux informations sur les concours, au plus près des écoles qui organisent les épreuves, pour assurer une diversification parmi les lauréats, dans le respect des principes de la méritocratie républicaine.
Quant à la part actuellement trop faible des lauréats du concours interne dans les grands corps, le classement de sortie ne l’a pas empêché, au contraire ! Notre conviction est qu’il la favorisait et que la nouvelle procédure de sortie, en amenant les élèves à valoriser davantage leurs expériences professionnelles auprès des employeurs, donnera une nouvelle chance aux lauréats du concours interne.
L’accès aux grands corps est quand même plus ouvert qu’on ne le dit, monsieur Bodin. On peut considérer qu’à peu près la moitié des inspecteurs des finances et des conseillers d’État ne sont pas directement issus de l’ENA ; c’est un chiffre qui n’est pas assez diffusé.
Parallèlement, faire partie d’un grand corps n’est pas une voie royale pour devenir directeur d’administration centrale. Sur les 188 directeurs d’administration centrale, à fin 2008, seuls 15 % proviennent des grands corps.
Effectivement !
Pour ce qui est de l’accès aux grands corps, monsieur Pozzo di Borgo, le Gouvernement a souhaité maintenir cet accès à la sortie de l’ENA, précisément parce que tant le Conseil d’État que l’Inspection générale des finances ou la Cour des comptes ont besoin d’avoir parmi leurs collaborateurs des énarques qui viennent de suivre la scolarité. La réforme doit en revanche les amener à s’interroger sur leurs besoins, à les exprimer de manière objective et transparente : ils ne doivent plus se contenter, comme c’est parfois le cas, de chercher à recruter les majors de promotion.
Concernant l’ouverture européenne, il s’agit en effet d’un enjeu majeur. Celui-ci se traduit, dans la réforme, par la confirmation de la place de l’enseignement et du stage communautaires et par le développement de la formation continue, dont les anciens élèves bénéficieront lors de leur accès aux postes de responsabilité.
Tous ces sujets sont abordés. Surtout, les sessions sont ouvertes aux administrateurs d’institutions européennes.
Je me permettrai, à titre personnel et j’allais dire « off », d’évoquer l’idée que j’ai eue.
À la suite de ma visite à Tokyo, je recevais hier le ministre japonais de la fonction publique. Celui-ci a commencé son séjour en France par une visite de l’ENA le matin. Voilà qui illustre une nouvelle fois l’envie que suscite l’ENA : bientôt, elle ne sera plus critiquée qu’en France !
Sourires
C’est la french touch !
Avant que les Vingt-Sept s’amusent à créer leur propre ENA, puisque c’est vers cela que nous nous acheminons, pourquoi ne pas créer une véritable ENA européenne ? Des unités de valeur, ou UV, seraient assurées par chaque pays…
… dans sa langue et, si possible, sa culture. Par exemple, une UV consacrée au fédéralisme ferait l’objet d’un enseignement en Allemagne et en allemand. Cela nous éviterait peut-être d’avoir à regrouper ensuite ce qui aura été péniblement mis au point. Je crois que la France peut, là encore, porter quelques grandes idées.
Enfin, monsieur Houpert, le Gouvernement est particulièrement favorable à l’existence de concours, lequel doit être équilibré entre candidats issus de l’interne, de l’externe et du troisième concours. Le concours à l’entrée demeure la façon la plus efficace de recruter les meilleurs. L’histoire le montre : les concours, tels celui de l’ENA – mais ce n’est pas le seul –, ont permis de construire une haute fonction publique de grande qualité. Il faut bien sûr veiller à ce que cela permette d’assurer la diversité de la société française. C’est toute l’ambition du Gouvernement dans sa réforme des concours.
Voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, que nous partageons en grande partie vos préoccupations.
Nous avons essayé de trouver des voies originales pour que la France, qui s’est illustrée, depuis la Révolution, par la création de cette fonction publique que le monde lui envie, puisse améliorer celle-ci dans le sens de l’innovation, de la diversité, en un mot de la démocratie.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

L’ordre du jour appelle le débat sur la politique de l’État en matière de gestion des ressources halieutiques et des pêches.
La parole est à M. Jean-Claude Étienne, premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPECST, est une structure originale qui fait désormais école au niveau de plusieurs parlements, à l’étranger et notamment chez nos voisins européens. Il évalue et contrôle les politiques gouvernementales dans le champ d’expertise qui lui est dévolu : s’assurer de la prise en compte du progrès scientifique et technique dans l’instruction de la décision politique.
Dans le cadre des nouvelles procédures parlementaires issues de la révision constitutionnelle de juillet 2008, l’office peut désormais, à la suite d’un rapport qui lui a été présenté, solliciter auprès de la conférence des présidents d’une assemblée l’organisation d’un débat visant au contrôle de l’action du Gouvernement sur la thématique concernée. C’est en cela que le débat d’aujourd’hui est une grande première au Sénat.
Je tiens, au nom des parlementaires membres de l’office et, singulièrement, au nom de mes dix-sept collègues sénateurs, à remercier le président Gérard Larcher et les membres de la conférence des présidents, qui ont accepté d’inscrire à l’ordre du jour de cet après-midi ce débat sur la politique de l’État en matière de gestion des ressources halieutiques et des pêches.
Si l’on s’en tenait à la seule étymologie, on pourrait penser que parler d’halieutique et de pêche est un pléonasme, puisque la signification des deux termes est la même. Cependant, c’est la notion de « ressource » qui, en l’occurrence, donne toute sa signification à ce rapport, le situant en pratique dans un écosystème de dimension planétaire déjà de la plus haute importance sur le plan socioéconomique, mais, surtout, particulièrement prometteur, en termes de développement durable, pour l’économie de demain.
L’ampleur et la vulnérabilité du gisement marin appellent, de la part des décideurs politiques, la vigilance la plus sophistiquée.
Nous avons besoin de colliger des données scientifiques rigoureuses en faisant la part de ce qui est assuré et de ce qui ne l’est pas. Pour ce faire, nous devons utiliser les moyens d’investigation les plus appropriés.
Le rapporteur, notre estimé collègue Marcel-Pierre Cléach, a suivi la rigoureuse méthode de travail consacrée par l’office, avec un comité d’experts et de scientifiques de renommée internationale lui permettant de présenter au Sénat les conclusions adoptées par les membres de l’office et les appréciations portées sur la politique de l’État en la matière.
Je souhaite rappeler ici que Marcel-Pierre Cléach a employé une méthodologie empreinte de rigueur scientifique pour rédiger ce rapport. Nous le savons tous, la connaissance des sciences est nécessaire à l’instruction de la décision politique, même si elle est toujours insuffisante, car souvent incomplète. Plus le champ des connaissances s’étend, plus s’impose l’immensité de l’inconnu. Attention à l’ostentation de celui qui croit savoir et qui ne mesurerait pas que, comme tout un chacun et par définition, il ne sait pas ce qu’il ne sait pas.
L’ampleur et la vulnérabilité du gisement marin requièrent une approche très sériée et particulièrement rigoureuse.
Dans notre société, l’opinion publique forge souvent son avis à partir d’un sentiment procédant lui-même d’une réalité qui n’est pas toujours bien cernée. Nous en avons eu la démonstration il n’y a pas si longtemps, à l’Office parlementaire, avec l’affaire des antennes relais téléphoniques.
Comme vous le savez, les troubles fonctionnels observés chez les populations établies aux alentours de ces antennes sont extrêmement variés : céphalées, insomnies, nausées, etc. Il n’en a pas moins été noté que, lorsque ces antennes cessent d’émettre, deux catégories de population apparaissent : l’une continue de souffrir de ces maux de la même manière, l’autre souffre moins. Une démarche scientifique rigoureuse accordera donc un intérêt tout particulier à ceux dont les troubles fonctionnels régressent.
L’office est saisi sans arrêt de problématiques exprimées en des termes très généraux. Ici, les pesticides donneraient le cancer. Là, les OGM seraient responsables de tous nos maux. Ailleurs, les pandémies virales nous menaceraient. Partout, les sources d’énergie – nucléaire, éolien, solaire – préoccupent. Les exemples foisonnent de sujets qu’il nous faut régulièrement aborder avec rigueur et méthode pour séparer la réalité objective de la subjectivité de l’interprétation et de l’idéation humaines. Malheureusement, ce sont bien souvent des déterminants subjectifs qui forgent les grands courants de l’opinion publique.
Aujourd’hui, il s’agit de la ressource halieutique. Au nom de l’Office parlementaire, je tiens avant tout à remercier et à féliciter une nouvelle fois Marcel-Pierre Cléach d’avoir emprunté les chemins de ce que j’appellerai la méthodologie « maison » de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, s’appuyant sur les consultations les plus pointues des experts les plus renommés pour dégager lignes de force et perspectives prometteuses, malgré le titre de son rapport dont les premiers mots sont un peu pessimistes : Marée amère : pour une gestion durable de la pêche.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

La parole est à M. Marcel-Pierre Cléach, auteur du rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sur la gestion durable de la pêche.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le sujet qui nous réunit aujourd’hui est grave : la politique de l’État en matière de gestion des pêches, c’est-à-dire la crise de la pêche, dont les récents événements dans les ports ont été l’illustration.
Depuis la publication du rapport de l’office, il y a six mois, de nombreux travaux sont venus confirmer l’amer diagnostic que je portais ; je voudrais citer les plus importants.
En mars, l’organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO, a rendu son rapport biannuel sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture. Elle a rappelé que les prises mondiales avaient atteint leur plafond et que la plupart des stocks halieutiques étaient exploités à la limite de la rupture ou au-delà. Plus encore, elle a démontré qu’au niveau mondial, et sans la partie aval de la filière, l’activité de pêche serait économiquement déficitaire.
À la fin du mois de mars, nous avons aussi appris que la France allait être placée sur la liste noire du Congrès américain pour sa gestion de la pêche au thon rouge de Méditerranée, et ce aux côtés de la Libye, de la Tunisie, de la Chine, de Panama et de l’Italie.
Plus récemment encore, à l’occasion de la publication du livre vert préparant la réforme de la politique commune de la pêche, la Commission européenne reconnaissait sa responsabilité et celle des États membres dans l’échec de la gestion des pêcheries communautaires, pointant du doigt une surpêche paradoxalement toujours plus subventionnée. Selon les propres mots du commissaire européen Joe Borg, chaque Européen paierait deux fois son poisson : une fois chez le poissonnier et une fois chez le percepteur !
Indéniablement, nous devons donc faire face à une crise grave et profonde de la pêche en France, en Europe et dans le monde.
L’enjeu n’est rien de moins que l’alimentation de la population mondiale. La pêche en mer fournit 20 % des protéines animales et en est la source majoritaire pour un milliard d’hommes.
Or, contrairement à ce qui est souvent avancé, l’aquaculture est loin de pouvoir résoudre le problème. Nous ne passerons pas de la pêche à l’aquaculture comme nous sommes passés de la chasse à l’élevage ou de la cueillette à la culture. Cela s’explique par deux raisons fondamentales.
D’une part, l’aquaculture dépend, pour le moment du moins, des ressources sauvages : les poissons d’élevage mangent des poissons sauvages, lesquels proviennent très majoritairement d’une seule espèce, l’anchois, pêché dans une seule région du monde, le Pérou. Heureusement, cette ressource cruciale est aujourd’hui très bien gérée avec l’aide trop méconnue d’halieutes français de l’Institut de recherche pour le développement, l’IRD.
D’autre part, la rentabilité de l’aquaculture est négative dans la mesure où, pour toutes les espèces carnivores, il faut environ cinq kilogrammes de poisson sauvage pour produire un kilogramme de poisson d’élevage.
Bien entendu, on peut fonder d’importants espoirs sur les progrès scientifiques dans l’alimentation des poissons et sur l’élevage de nouvelles espèces. L’aquaculture fournit dès aujourd’hui plus de 40 % de l’alimentation mondiale d’origine halieutique. Mais il s’agit d’une aquaculture très majoritairement d’eau douce et asiatique.
D’ici à 2030, l’aquaculture n’offrira aucune solution de remplacement à la nécessité de gérer rigoureusement les ressources mondiales, car, si elle peut permettre de répondre à un surcroît de demande, elle ne peut remplacer les pêches sauvages. Or la situation de ces dernières est aujourd’hui au cœur de la crise.
Nous avons vécu dans l’idée que les ressources de la mer étaient sans limite, que nous pourrions pêcher toujours plus et que nous n’étions pas contraints par des mesures de gestion. C’est cette vision, cet état d’esprit qu’il nous faut aujourd’hui abandonner.
Les travaux scientifiques conduits ces dernières années nous montrent que se produit en mer un phénomène qui n’avait pour l’instant été constaté que dans des lacs de dimension limitée, c'est-à-dire un changement de régime irréversible : la surpêche d’une espèce peut entraîner sa disparition définitive. Cela s’explique par le fait qu’en mer la prédation est fonction de la taille, non des espèces. Ainsi, la même espèce est à la fois proie et prédateur, selon son âge.
Un prédateur supérieur ne se maintient en haut de l’écosystème que par la régulation des prédateurs de ses larves ou des alevins. Que sa population vienne à s’affaiblir excessivement et il peut devenir une espèce dominée dans l’écosystème. Le risque que l’écosystème soit de moins en moins riche, de moins en moins productif au fur et à mesure de la descente dans l’échelle trophique, est alors très important.
Il existe déjà dans le monde de nombreux exemples d’effondrements de ressources et de changements de régimes, comme au Canada, après l’effondrement des populations de cabillauds, ou encore au large de la Namibie et du Maroc, voire en mer Noire.
En France, même si c’est loin d’être aussi catastrophique, notre attention doit être attirée par la situation de l’anchois dans le golfe de Gascogne ou par la prolifération des proies des thons en Méditerranée, qu’il s’agisse des méduses ou des petits pélagiques.
Ainsi, sans susciter inutilement d’inquiétude, il nous faut prendre conscience que les travaux scientifiques montrent que, si rien ne change dans la gestion des pêcheries, l’extinction de cette activité que l’homme pratique depuis ses origines est possible.
Mais les travaux scientifiques les plus récents, s’ils nous alertent et pointent du doigt les déficiences de gestion, ne sont aucunement une accusation vis-à-vis des pêcheurs. Toute opposition en la matière est inexacte et contreproductive.
Les travaux scientifiques récemment publiés soulignent aussi la dégradation continue du milieu côtier et maritime.
Aujourd’hui, malgré son immensité, la mer est envahie de pollutions d’origine terrestre. Ce sont les substances chimiques et autres pesticides. Ce sont aussi les macro-déchets et micro-déchets. C’est surtout l’anthropisation du milieu maritime, de plus en plus mité par les multiples activités humaines, qui, quand elles ne polluent pas, dérangent la faune et gênent son développement.
Il y a aussi les conséquences du changement climatique : la mer se réchauffe et conduit les espèces à se déplacer ; surtout, le réchauffement fragilise les ressources en désynchronisant les cycles naturels liés à la reproduction et aux migrations de toute la chaîne trophique.
De ces évolutions, les pêcheurs sont les premières victimes, souvent peu écoutées, tant sont importants les intérêts économiques et sociaux à terre.
La crise actuelle s’explique donc par la conjugaison de ce double phénomène : d’un côté, une gestion déficiente et une surpêche structurelle et ancienne ; de l’autre, l’affaiblissement du milieu marin par son anthropisation et par le réchauffement climatique.
La gravité de la situation ne doit cependant pas nous tétaniser, bien au contraire. Le rapport de l’OPECST tend plutôt à montrer que des solutions sont à notre portée et qu’il nous appartient de les mettre en œuvre. J’ai pu le constater dans le monde, aux États-Unis, au Canada, au Pérou ou en Norvège : ce sont toujours des crises que sont sorties les bonnes pratiques de gestion des ressources halieutiques.
La première d’entre elles est la réconciliation des pêcheurs et des chercheurs, à laquelle les décideurs politiques doivent s’associer. Rien ne sera possible si aucun consensus ne se dégage sur l’analyse de la situation. Le dialogue doit s’instaurer. Il faut y inciter les pêcheurs et les scientifiques, que ce soit par des opérations conjointes comme dans les contrats bleus ou par la modification des objectifs de l’IFREMER et de l’IRD dans le contrat qui les lie à l’État.
À cet égard, j’attends beaucoup de la mise en œuvre des aires marines protégées. C’est une formidable opportunité et je souhaite, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement s’engage dans une pédagogie active à ce sujet. Je crois que c’est dans notre pays l’occasion historique de réunir autour de la même table, de la même passion et pour le même objectif les pêcheurs, les chercheurs, les responsables politiques, notamment les élus locaux, et les autres usagers. C’est l’occasion pour les pêcheurs de se réapproprier la gestion d’espaces qu’ils sentent leur échapper. C’est l’occasion pour les scientifiques de travailler main dans la main avec les professionnels. Les exemples étrangers sont très encourageants. J’ai rencontré de nombreux professionnels volontaires. Il s’agit donc d’un sujet d’espoir pour l’avenir.
La deuxième voie de progrès est le développement de la recherche, la construction des outils de décision.
La science halieutique n’a peut-être pas été suffisamment prioritaire dans notre pays. C’est regrettable, car les défis scientifiques sont majeurs.
Aujourd’hui, les scientifiques sont pleinement conscients des limites des modèles démographiques monospécifiques de gestion. Ils ont pris conscience qu’il fallait développer une gestion écosystémique prenant en compte la complexité du milieu marin et l’ensemble des rétroactions. Mais cette demande politique, au sens noble du terme, est extraordinairement complexe, alors même que la biodiversité marine est encore largement méconnue.
Si nous n’apportons pas l’appui nécessaire aux scientifiques, le risque est grand que cette approche écosystémique ne soit qu’un leurre rassurant qui n’apportera pas les réponses attendues pour prendre les bonnes décisions de gestion.
La troisième voie de progrès est celle d’une modification de la relation entre l’État et les pêcheurs. Insuffisamment conscients des enjeux, nous avons trop souvent fermé les yeux sur des dérives, voire des fraudes connues. Trop longtemps, les tailles minimales de capture ou les quotas internationaux ne nous sont apparus que comme des guides, utiles certes, mais seulement indicatifs. Les pouvoirs publics français et européens ont eux-mêmes poussé les pêcheurs au suréquipement, au surinvestissement et à la surpêche, les plaçant dans une situation économique et sociale d’autant plus fragile que les quotas baissaient.
Dans la crise de la pêche, la responsabilité de l’État est importante. Se voulant protecteur et défenseur des pêcheurs dans le court terme, il a un peu oublié d’être stratège.
Je crois qu’il nous faut changer d’attitude. L’État doit proposer une vision de long terme, à savoir le développement d’une pêche durable profitable à la fois pour les pêcheurs et l’ensemble de la filière, mais aussi s’appuyant sur une ressource préservée.
L’État doit également assumer ses missions régaliennes de surveillance, de contrôle et de sanction de la fraude et de la piraterie. Les pêcheurs attendent cette action de l’État, car elle sera le socle de leur autodiscipline et la mise à l’écart de quelques-uns qui n’acceptent pas la règle commune, pour la pérennité de tous.
L’État doit aussi accepter et favoriser le fait que les pêcheurs prennent une part beaucoup plus active à la gestion de leur ressource. Plus que tous les autres, ils connaissent la mer. Ils doivent pouvoir être davantage écoutés et décisionnaires qu’aujourd’hui. Il faut favoriser leur responsabilisation individuelle et collective. Sur toutes les façades maritimes, les pêcheurs le demandent.
La question des quotas est ici centrale. Une fois définis sur un fondement scientifique, ceux-ci doivent être respectés.
À cet égard, je me félicite de la fermeté de Michel Barnier, qui a su être courageux face à des mouvements récents. La décision qui a été prise est aussi le reflet d’une évolution et d’une prise de conscience des nouveaux enjeux sur le littoral et au sein de l’administration.
Je souhaite que l’on aille au-delà et que l’on réfléchisse à la mise en place expérimentale des quotas individuels transférables. On les présente souvent comme un épouvantail, synonyme de financiarisation et de concentration de la pêche. A contrario, certains veulent y voir la recette miracle de la préservation des ressources. Ces deux approches me paraissent caricaturales. L’apport fondamental de l’instauration des quotas individuels transférables est le changement d’état d’esprit, l’arrêt de la course au poisson. Au lieu de pêcher le plus possible le premier, il faut optimiser la pêche de sa part réservée.
De fait, les études montrent que le principal effet des quotas individuels transférables est d’accroître la profitabilité de la pêche et les revenus des pêcheurs, tout en garantissant le plus souvent un bon respect des prescriptions scientifiques, donc une diminution très nette du risque d’effondrement des stocks.
Par ailleurs, en instaurant des quotas individuels transférables, l’État conserve tous les outils pour protéger la pêche artisanale et côtière, pour limiter la concentration et empêcher la financiarisation, en liant détention de quotas et action de pêche.
Pour conclure, j’ai d’abord voulu dans ce rapport, en me fondant sur les travaux scientifiques les plus récents, montrer la gravité, la profondeur et la complexité de la crise de la pêche. Parce qu’il n’existe pas une causalité unique, il ne doit pas y avoir de bouc émissaire.
J’ai ensuite voulu montrer que, si la crise était grave, elle n’était pas sans solution, bien au contraire. La pêche et les pêcheurs ont un avenir, qui passe par l’évolution de certaines pratiques. La recherche peut apporter une aide précieuse.
L’État lui-même doit favoriser cette évolution en facilitant l’émergence d’un cadre de dialogue et de décision, mais aussi d’autonomie et de responsabilisation.
À cet égard, madame la secrétaire d'État, votre responsabilité doit pouvoir trouver à s’exercer auprès du ministre de l'agriculture et de la pêche : nous devons pouvoir compter sur vous pour défendre les voies d’une pêche durable, qu’il s’agisse du problème des rejets, de l’amélioration des engins de pêche, du développement d’un écolabel ou de l’information des consommateurs.
La présence active du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire dans les réflexions et décisions du ministre de tutelle de la pêche constitue à mes yeux le support nécessaire à une action responsable commune pour sauver, à terme, la pêche française et la vie de notre littoral.
Madame la secrétaire d'État, vos efforts conjugués ne seront pas de trop pour mener les négociations internationales souhaitables : nouvelle politique européenne des pêches, accords entre les Communautés européennes et la Norvège, prise en compte des problèmes de surpêche et de pollution, particulièrement en Méditerranée, où vous devez, me semble-t-il, obtenir de l’Union pour la Méditerranée la définition d’une politique commune responsable.
Les élus, les pêcheurs de loisir et les citoyens sont concernés par ce grand enjeu. Madame la secrétaire d'État, le Sénat souhaite connaître le sentiment et les projets du Gouvernement en la matière.
La pêche n’est pas une activité comme une autre. Elle est essentielle à l’homme, parce qu’il la pratique depuis les origines et parce qu’elle continue de nourrir l’humanité. Elle mérite donc que l’on regarde l’avenir avec les yeux ouverts.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, ce débat sur la politique de l’État en matière de gestion des ressources halieutiques et des pêches intervient alors que nous sommes pris dans un tourbillon de « Grenelles ».
La multiplication des mesures gouvernementales vide un peu de son sens la démarche positive du Grenelle de l’environnement ainsi que les mesures liées aux ressources halieutiques, déjà traduites à l’article 30 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dont nous avons débattu voilà peu.
Certes, dans le domaine de la pêche et compte tenu de la mauvaise santé de la filière, nous pouvons comprendre que, face aux négociations à venir, le Gouvernement choisisse une formule qui prévienne les agitations du secteur.
Dans les deux mois à venir, deux cents experts, écologistes, syndicalistes, représentants de fédérations multiplieront les réunions pour proposer une politique nationale de la mer. Ce débat intervient aujourd’hui en amont, nous donnant l’occasion de montrer aux différents acteurs notre engagement et notre détermination.
Grâce à ses territoires d’outre-mer, la France possède le deuxième domaine maritime au monde. Il s’étend sur près de 11 millions de kilomètres carrés, dont seulement 3 % en métropole.
Au-delà de la dégradation générale des écosystèmes marins, deux défis doivent être relevés.
Le premier défi est économique. En Europe, la mer fait vivre environ 4 millions de personnes, dont 190 000 pêcheurs ; la richesse créée représente de 3 % à 5 % du PIB européen, soit 1 154 milliards d’euros.
Le second défi est vital : il convient de mesurer le risque pour l’avenir. Ainsi, 30 % des espèces sont surexploitées et l’augmentation des captures conduira inévitablement à l’épuisement des ressources. La surpêche est la menace principale qui guette la filière.
Toutefois, mes chers collègues, comment lutter contre un mal difficilement perceptible, alors que chaque mesure fragiliserait tout un pan de notre économie ?
Nous devons prendre nos responsabilités. Sans être manichéen, il est nécessaire de mettre un terme à cette « guerre des poissons » engendrant une course à la pêche, le premier à capturer étant le mieux rémunéré.
La politique des pêches – en particulier la question de la gestion des ressources halieutiques – est aujourd’hui élaborée et décidée au niveau européen, avec divers outils, dont, principalement, les totaux admissibles des captures, les TAC, et les quotas.
Cette approche a eu pour conséquence de faire diminuer notre flotte nationale de 21 % en dix ans. La demande a continué de croître et la France importe près de 85 % des produits de la mer qu’elle consomme.
S’agissant des quotas, vous souhaitez les réduire. Soyons raisonnables : ils étouffent nos pécheurs ! Appliquons déjà les limites de captures ; concentrons-nous également sur les contrôles, et alors les quotas pourront être adaptés et individualisés.
Seule une politique sérieuse de contrôle et d’individualisation des quotas réduira les effets de piraterie et incitera les pêcheurs à jouer le jeu de la réglementation européenne, en les encourageant à être davantage gestionnaires et responsables.
Notre rôle de parlementaire est de protéger notre patrimoine marin.
Un constat s’impose : 75 % de la biomasse pouvant être pêchée est concentrée dans 5 % de l’espace marin, le plus souvent côtier et très exposé. L’objectif à court terme, d’ici à 2012, est de valider et de protéger 10 % des aires maritimes. Aujourd’hui, seulement moins de 0, 1 % de ces aires sont protégées. C’est évidemment insuffisant.
La dégradation des ressources halieutiques ainsi que celle des écosystèmes marins conduisent à s’interroger sur les palliatifs aux captures.
Si l’aquaculture ne peut être présentée comme la solution miracle, elle peut, à court terme, constituer un palliatif, afin d’écarter les problèmes de ce secteur de façon provisoire.
Développer cette filière permettra d’assurer temporairement l’alimentation, mais je ne veux pas croire que la population se contentera, à terme, de se nourrir de carpes et de crevettes.
L’aquaculture est avant tout une culture d’eau douce. Elle ne pourra pas remplacer la pêche maritime et il est vain d’espérer qu’elle représentera une issue aux maux de la filière pêche. Elle soulève également le problème de l’alimentation des espèces, qui conduira, de toute façon, à l’épuisement des stocks.
La France est forte d’une flotte de 5 232 navires, de 63 ports de pêche, de nombreuses organisations de producteurs et de plus de 350 entreprises de mareyage et de transformation des produits de la mer. Le secteur de la pêche est important sur le plan économique, mais aussi en termes d’aménagement du territoire.
L’objectif contradictoire en matière de gestion des pêches est d’assurer la durabilité des ressources marines et des entreprises qui les exploitent, dans un contexte de demande croissante en produits de la mer, avec un marché évalué à 5 milliards d’euros en 2005.
La pêche n’est plus un secteur économique rentable. En France, par exemple, les subventions couvrent les trois quarts du chiffre d’affaires réalisé dans ce secteur. Il faut se mobiliser pour aider et diversifier la filière de la pêche.
Il convient, dans un premier temps, d’améliorer la commercialisation des produits de la mer. Une politique de labellisation, par exemple, ou encore d’incitation aux modes coopératifs permettrait d’encourager un commerce diversifié et d’accroître la professionnalisation d’un secteur par une meilleure reconnaissance de ses acteurs.
En effet, il me semble nécessaire de valoriser les métiers de la mer au travers de la création de l’éco-labellisation prévue à l’article 30 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, et de favoriser des produits éco-certifiés.
Il serait également opportun de diminuer les aides à la modernisation des navires, afin de réduire la surcapacité des techniques de pêche et de préserver en même temps une pêche artisanale.
Pour maximiser l’efficacité de cette politique de gestion halieutique, à l’autre bout de la chaîne, il ne faut pas négliger la sensibilisation du consommateur à une consommation responsable et éco-citoyenne.
Enfin, la situation des stocks fait l’objet de nombreux débats entre professionnels et scientifiques. Le rétablissement et le renforcement des coopérations entre ces acteurs sont également des enjeux majeurs des années à venir.
Les solutions permettant d’assurer la pérennité de la filière halieutique existent et sont multiples. D’autres approches sont expérimentées localement. Ainsi, dans mon département, l’Hérault, une réflexion stratégique a été menée ; elle cible l’enjeu majeur de l’accès aux ressources halieutiques. L’approche a consisté à développer la biomasse et non à subir sa raréfaction.
Ce département vient de s’engager dans un partenariat de recherche et développement d’une nouvelle génération d’habitats artificiels pour développer les ressources halieutiques. D’autres pistes innovantes sont également à l’étude, notamment la collecte de larves de poissons dans le milieu naturel pour le repeuplement de la bande côtière.
Il est donc intéressant aujourd’hui d’envisager d’autres approches, afin d’assurer la pérennité de la filière pêche et de garantir l’avenir de nos pêcheurs.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, après le débat sur la politique agricole commune qui a eu lieu la semaine dernière, nous abordons aujourd’hui la deuxième grande politique communautaire, dédiée à la pêche, dans un contexte de crise économique faisant suite à une année 2008 marquée par une forte augmentation des produits pétroliers.
Cette situation difficile, encore exacerbée par la gestion délicate des quotas – rappelons les problèmes récents survenus à Boulogne-sur-Mer –, est d’autant plus grave que l’examen des dossiers par le Fonds européen pour la pêche, qui aurait dû être engagé dès janvier 2007, n’a démarré qu’en juin 2008.
La crise économique actuelle ne fait donc qu’aggraver une situation qui n’a que trop duré, sans que soient proposées de véritables solutions pérennes : les contrats bleus devraient prendre fin en 2009 et des activités ont cessé en raison de la destruction des navires. Étant d’une région aimant beaucoup la mer et la pêche, c’est avec un pincement au cœur que je constate que quarante-sept navires bretons ont été sortis de pêche en 2008, et que cinquante autres devraient connaître le même sort en 2009.
Dans un contexte particulièrement tendu, le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre une réforme des structures professionnelles d’ici à 2011. Pourtant, chacune des crises de ces dernières années a mis en avant le manque total de visibilité de ces structures peu ou mal organisées, qui, sans véritable perspective, se tournent parfois vers des solutions qui risquent, à terme, d’être contraires à l’intérêt de la profession.
Le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, rédigé par notre collègue Marcel-Pierre Cléach, a bien posé le problème structurel traversé par le monde de la pêche : « captures stagnantes ou déclinantes, effort de pêche croissant, voilà l’équation fondamentale d’un secteur économique en crise profonde ».
Pourtant, la France, avec une production annuelle d’environ 600 000 tonnes pour un chiffre d’affaires de 1 milliard d’euros, est à la troisième place européenne pour ce qui concerne la pêche, derrière le Danemark et l’Espagne.
Le secteur regroupe environ 16 000 emplois à taux plein et concernerait 24 000 personnes embarquées. Mais, depuis plus de vingt ans, le nombre des navires métropolitains a chuté de plus de 50 %, passant de près de 12 000 à environ 5 000, tandis que la taille moyenne des navires s’est accrue de 6 % et la puissance moyenne de 19 %.
Les Français, pour leur part, consomment de plus en plus de poisson, environ trente-cinq kilogrammes par habitant et par an. On devrait s’en réjouir, mais la production nationale est loin de satisfaire la demande. Alors, comment mettre en adéquation demande et ressource ?
En 2008, le Conseil international pour l’exploration de la mer annonçait que, sur les cinquante-trois stocks communautaires de la façade Ouest, dix étaient en bon état, trente-trois étaient estimés à risque, et les dix restants étaient dans un état critique.
Au moment où se déroule le Grenelle de la mer, il convient de rappeler les objectifs spécifiques fixés pour la gestion des pêches lors du sommet mondial sur le développement durable de 2002, dont celui de ramener l’exploitation des stocks halieutiques à un niveau compatible avec leur production maximale d’équilibre d’ici à 2015. Vaste programme !
La responsabilité des États en général, et de la France en particulier, est donc majeure : au niveau mondial, ceux-ci contrôlent, grâce aux zones économiques exclusives, environ 90 % du potentiel halieutique, et la France détient le deuxième plus grand espace maritime du monde.
Dans ce cadre, la politique commune de la pêche devrait constituer un formidable levier de régulation, d’organisation et d’action.
À la suite de la réforme de 2002, la politique commune a aujourd’hui pour objet de garantir l’exploitation durable des ressources halieutiques et de tenter d’empêcher une pression excessive sur les stocks.
Vouloir abandonner des quotas et des outils communautaires de gestion, comme l’a évoqué le Président de la République, reviendrait à programmer, à terme, la mort de la pêche. D’autant que si la Commission européenne soumet des propositions au Conseil, ce sont bien les ministres des vingt-sept États membres qui décident en dernier ressort de la répartition par État des quotas de pêche par espèce et par zone maritime.
Le livre vert de la Commission sur la réforme de la politique commune de la pêche du 22 avril indique ainsi, à juste titre : « Une autre conséquence notable du cercle vicieux alliant surpêche, surcapacité et faible résilience économique réside dans les fortes pressions politiques exercées pour augmenter les possibilités de pêche à court terme, aux dépens de la viabilité future du secteur », en faveur d’« un nombre incalculable de dérogations, d’exceptions et de mesures spécifiques. »
Plus que dans tout autre secteur, nous nous retrouvons confrontés à la nécessité de maintenir l’équilibre entre l’économie, le social et l’écologie, et ce n’est pas la « marchandisation » maximale des quotas qui permettra le développement durable de la pêche.
Si les règlements communautaires déterminent les objectifs stratégiques de la politique commune de la pêche – répartition des fonds entre États membres, règles de cofinancement – ce sont bien les États membres qui mettent en place des programmes opérationnels et répartissent les fonds au niveau national. La responsabilité de chaque État est donc essentielle.
À l’échelon européen, tout d’abord, si le Fonds européen pour la pêche, instrument financier et structurel de la politique commune de la pêche qui a succédé à l’IFOP depuis 2006 pour sept ans, n’est doté que de 3, 8 milliards d’euros – soit une diminution de 33 % – c’est bien le Conseil des ministres de l’Union européenne qui l’a voulu.
Sur le plan purement national ensuite, à l’occasion de la discussion des projets de loi de finances de 2008 et de 2009, j’avais souligné l’insuffisance et, parfois, l’inadéquation des moyens déployés par le Gouvernement pour réconcilier compétitivité, durabilité et solidarité.
Ainsi, au-delà des plans conjoncturels, nous devons nous attendre à une baisse drastique des autorisations d’engagement de près de 20 % dans les deux prochains budgets du ministère de l’agriculture et de la pêche.
J’ai déjà évoqué la politique de casse des navires. Parmi les principales modifications apportées à la politique commune de la pêche en 2002 figurait l’abandon des objectifs obligatoires de réduction de la capacité, au profit de plafonds nationaux dans la limite desquels les États membres sont libres de décider de la manière dont ils mènent leur politique. Le livre vert de la Commission du mois d’avril dernier va dans le même sens, précisant bien que l’effort doit porter sur la capacité et pas nécessairement sur le nombre de bateaux.
Je réaffirme donc notre scepticisme à l’égard de la politique engagée par le Gouvernement et consistant en un plan de casse, certes commencé par d’autres gouvernements, notamment au travers du plan pour une pêche durable et responsable lancé au début de l’année 2008 et doté de 310 millions d’euros sur deux ans. Celui-ci a malheureusement révélé un profond malaise, car les demandes de destruction et de retrait ont été deux fois plus importantes que prévu. Cette politique comporte des effets pervers sur le prix de l’occasion et des effets néfastes sur l’installation et la sécurité des marins, y compris par le renchérissement du prix des bateaux.
Quitte à devoir sortir de la flotte des navires – et c’est souhaitable –, il semblerait plus pertinent de favoriser la sortie de vieux navires peu économes en énergie et peu sûrs, en permettant d’accorder une prime pour la construction de navires neufs, plus économes en énergie, le patron s’engageant à pratiquer une pêche responsable. Nombre d’entre eux préfèrent déjà « trier sur le fond et non sur le pont ». Car les quotas ne règlent pas le problème : si les marins ramènent au port les quotas autorisés, pour ce faire, des tonnes de poissons sont détruites !
À chaque conflit, le Gouvernement a tenté d’acheter la paix sociale, parfois au prix de mesures illégales au regard de la réglementation communautaire relative aux aides d’État. Nous avions ainsi pu le constater à la fin de l’année dernière concernant les aides versées entre 2004 et 2006 par le fonds de prévention des aléas pêche. Et même si le ministre nous a dit qu’il n’était pas envisageable que cette récupération des fonds mette en péril la pérennité des entreprises, il faudra bien payer, et ce à un moment où il semble que certaines clauses des contrats bleus ne soient pas non plus eurocompatibles.
Le rapport de l’Office parlementaire des choix scientifiques et techniques reconnaît par ailleurs que « Globalement, ce plan reste un ajustement conjoncturel qui ne traite pas les questions fondamentales qui expliquent le déficit de rentabilité de la flotte française ».
Vous le voyez, madame la secrétaire d'État, bien des clignotants sont au rouge dans le secteur de la pêche, et si je me fonde sur ce que les pêcheurs vivent dans ma région, je puis vous affirmer que la situation ne fait que s’aggraver depuis le début de l’année : mévente importante des produits, effondrement des cours en criée, quantités importantes de retrait, avec toutes les conséquences que l’on peut imaginer, et, bien sûr, fragilisation extrême d’un secteur déjà durement touché.
Il est donc grand temps d’envisager la future réforme de la politique commune, mais aussi de la politique nationale, non pas par petites touches, mais comme une véritable mutation permettant de venir à bout des raisons profondes qui sont à l’origine du cercle vicieux dans lequel la pêche se trouve emprisonnée depuis quelques décennies.
Il s’agit de promouvoir une activité économiquement rentable, socialement protectrice et écologiquement durable. Certains se sont déjà engagés résolument dans cette voie.
Pour cela, il faudrait favoriser le renouvellement de la flottille et la transmission des entreprises, adapter le secteur aux mutations économiques et énergétiques, soutenir la recherche sur les outils de pêche mieux adaptés à la sélection des espèces et, surtout, promouvoir l’adaptation et la généralisation de ces outils à bord des navires. Tout cela vaut mieux que les sorties de flotte !
Pour repenser la politique commune, il faut que, tous, nous portions un regard neuf sur la situation maritime globale et acceptions de lui consacrer les moyens financiers et humains nécessaires, en sortant de la logique de rationnement nationalisé dans laquelle se trouve enfermé le budget européen.
Je forme donc le vœu que nos futurs parlementaires européens, qui, à terme, disposeront des pouvoirs de la nouvelle procédure de codécision, portent la voix d’une politique commune de la pêche capable de préserver les ressources, de répondre aux besoins des consommateurs et de fournir une activité solide et pérenne à nos pêcheurs.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la semaine dernière, la Commission européenne a lancé, avec beaucoup d’avance sur le calendrier prévu, les premières réflexions sur la réforme de la politique commune de la pêche, qui doit aboutir en 2012.
Le livre vert qu’elle a adopté s’ouvre sur une page qu’il faut malheureusement qualifier de politique-fiction pour l’horizon 2020 :
« Presque tous les stocks halieutiques européens ont été reconstitués au niveau de leur production maximale équilibrée, ce qui signifie, pour nombre d’entre eux, un accroissement considérable des effectifs par rapport à ceux de 2010. Les pêcheurs tirent un meilleur revenu de ces populations de poissons plus nombreuses, composées d’individus matures et de plus grande taille. Dans les communautés côtières, les jeunes voient de nouveau la pêche comme un moyen stable et attrayant de gagner leur vie. »
Hélas, à l’heure actuelle, la réalité est tout autre... Ainsi, dans le département de la Vendée, les marins pêcheurs sont confrontés, pour la quatrième année consécutive, à la fermeture de la pêche à l’anchois.
C’est l’avenir même de la pêche qui est en jeu, notamment dans le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour les jeunes, s’installer et espérer pouvoir vivre du produit de leur pêche est aujourd’hui une pure gageure.
La pêche représente encore 16 000 emplois à temps plein, mais pour combien de temps ? D’importants efforts ont déjà été consentis par la profession, puisque, en vingt-cinq ans, le nombre des navires a chuté de 54 %. Toutefois, globalement, la situation reste toujours aussi difficile, comme l’attestent les blocages de ports de ces dernières semaines.
En effet, les quotas qui, chaque fin d’année, font l’objet d’âpres discussions entre les ministres des différents pays, sont très rapidement atteints, tout du moins pour certaines espèces. Or comment les marins pêcheurs peuvent-ils faire face à leurs charges s’ils ne peuvent aller pêcher ?
Je ne nie pas la situation très dégradée des ressources halieutiques et la nécessité d’instaurer une pêche durable, mais, pour résoudre les crises récurrentes auxquelles la profession doit faire face, il faut prendre en compte plusieurs points.
Tout d’abord, la flotte française, du fait de sa spécialisation chalutière, est beaucoup plus vulnérable à la hausse des coûts de l’énergie, comme on l’a vu l’année dernière.
Au début de 2008, le Gouvernement a mis en place un plan d’aide, à hauteur de 310 millions d’euros sur deux ans, afin, notamment, de diminuer la consommation d’énergie. Madame la secrétaire d'État, j’espère que nous disposerons bientôt d’un premier bilan de l’application de ce plan.
Par ailleurs, il me semble indispensable de revoir la procédure de fixation des quotas. En effet, celle-ci s’appuie aujourd’hui sur les préconisations des scientifiques, nullement sur les observations des pêcheurs. Les propositions de la Commission sont ensuite soumises en décembre aux ministres de la pêche des vingt-sept États membres. Ce sont eux qui décident de la répartition des quotas par pays. Les discussions sont souvent très longues et aboutissent à une décision votée à la majorité qualifiée. Les marins pêcheurs ne connaissent donc qu’au dernier moment les quotas qui leur sont alloués et ils ne peuvent, de ce fait, ni anticiper ni planifier leur saison de pêche.
Il est nécessaire que la profession ait une plus grande visibilité sur les nouvelles normes édictées par Bruxelles. Dans son livre vert, la Commission stigmatise d'ailleurs ce mode de décision, qui encourage une vision à court terme.
Enfin, il ne faut pas l’oublier, malgré tous les efforts déployés depuis plusieurs années, le marché français reste composé à 85 % de poissons d’importation.
L’état de la ressource halieutique explique pour une part importante cette situation. C’est du reste le constat établi et par la Commission et par notre collègue Marcel-Pierre Cléach dans son très intéressant rapport.
Aujourd’hui, pour la plupart des espèces, la pêche européenne dépend de poissons jeunes et de petite taille, qui sont le plus souvent capturés avant d’avoir pu se reproduire.
Si la surpêche se trouve sans conteste à l’origine de cette situation, elle n’est pas la seule responsable : le changement climatique et les pollutions marines ont également un impact non négligeable.
Ainsi, à la suite du réchauffement climatique, les zones désertiques de l’océan ont progressé depuis 1998 de plus de 6 millions de kilomètres carrés, soit douze fois la superficie de la France. Parallèlement, ce phénomène entraîne un déplacement des espèces vers le nord, mais aussi, ce qui est plus grave, des déphasages chrono-biologiques.
De même, l’impact de la pollution sur la faune marine, s’il reste mal connu, est incontestable.
Pour la Commission européenne, cette diminution des ressources halieutiques est due à cinq grands problèmes structurels : la surcapacité des flottes, des objectifs stratégiques flous se traduisant par un manque d’orientations pour la prise des décisions et leur mise en œuvre, un mécanisme décisionnel qui encourage une vision à court terme, un cadre qui ne responsabilise pas suffisamment le secteur, enfin un manque de volonté politique pour faire respecter la réglementation, qui n’est que faiblement appliquée.
Je souscris largement à ce diagnostic. Toutefois, il me paraît indispensable de mettre rapidement en place des mesures que je qualifierais de bon sens, et qui rejoignent largement l’analyse de Pierre-Marcel Cléach.
Tout d’abord, il importe de rouvrir le dialogue entre les pêcheurs et les scientifiques. Le passif entre ces deux parties est lourd, mais il leur faut impérativement travailler de concert dans l’avenir. Des relations continues permettront à chacun de bien appréhender la ressource halieutique, d’adapter au mieux les quotas et de faire accepter pleinement cette contrainte par les pêcheurs, qui y trouveront leur intérêt. Ne pas l’avoir fait par le passé a constitué une grave erreur.
Madame la secrétaire d'État, je me félicite de la tenue du Grenelle de la mer, qui permet à toutes les parties prenantes – élus, associations, pêcheurs et scientifiques – de se réunir, d’échanger, de mener une réflexion de fond et, je l’espère, de faire le point sur ce qui se passe véritablement sur le terrain.
Les assises de la pêche, annoncées par Michel Barnier pour le mois de décembre prochain, ne peuvent, elles aussi, qu’être bénéfiques. Par ailleurs, il me semble indispensable de mieux coordonner les ressources.
Le livre vert propose ainsi de recourir, partout où c’est possible, à des systèmes de gestion régionaux spécifiques mis en œuvre par les États membres et soumis aux normes et au contrôle de la Communauté. Je suis tout à fait favorable à cette proposition, qui vise à décentraliser la mise en œuvre de la politique européenne de la pêche au profit de régions marines, comme la Méditerranée, la mer du Nord, la mer Baltique ou l’Atlantique, qui seraient partagées entre plusieurs États.
Les conseils consultatifs régionaux pourraient ainsi voir leur rôle accru. La meilleure prise en compte des problématiques régionales à l'échelle européenne est nécessaire, car la politique commune de la pêche ne peut plus et ne doit pas être un bloc monolithique. Les relations de terrain avec Bruxelles seront ainsi beaucoup plus régulières.
Toutefois, au-delà des frontières des vingt-sept États, un renforcement de la coopération régionale est nécessaire. À ce titre, les organisations régionales de gestion des pêches restent jusqu’à présent les meilleurs instruments de gouvernance, notamment pour ce qui est des stocks chevauchants et des réserves de poissons grands migrateurs des zones économiques exclusives et de la haute mer.
Toutefois, leurs résultats sont inégaux, et elles n’ont pas toujours fait preuve d’efficacité dans l’adoption de mesures de conservation et de gestion rigoureuses, l’application de ces décisions ou la mise en œuvre des moyens de contrôle correspondants. Il y a donc lieu de renforcer l’engagement de ces organisations en la matière et d’améliorer leurs résultats globaux.
Dans cette perspective, la coopération avec nos partenaires internationaux continuera à jouer un rôle crucial.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au moment où se pose avec force la question de l’alimentation du monde, le problème des ressources maritimes revêt une importance capitale, sur notre planète, qui est couverte à 70 % d’océans, et dans notre pays, qui, avec 5 500 kilomètres de côtes, devrait théoriquement occuper une place prépondérante dans le monde de la pêche.
La France a délégué à l’Europe l’essentiel de ses prérogatives dans ce domaine en 1983, année de naissance de la politique commune de la pêche. Son rôle se limite donc, d’une part, à négocier les quotas par espèces et par secteurs, une fois les taux de capture admissibles établis, et, d’autre part, à accompagner les crises cycliques en proposant des plans financiers qui doivent être acceptés par la Commission européenne.
Dans le courant de l’année 2008, nous avons pu constater les difficultés créées par Bruxelles à la France au nom du sacro-saint droit européen et de la concurrence libre et non faussée, qu’il s’agisse du prix du carburant ou des 310 millions d’euros d’aides prévus en 2008, dont 40 millions d’euros au titre de l’aide sociale et 230 millions d’euros destinés à « moderniser » et restructurer la flotte de pêche au cours des trois années à venir. « L’euro-compatibilité » est toujours là pour jouer les gendarmes !
En ce moment même, la porte-parole de la Commission européenne tergiverse pour 4 millions d’euros destinés à aider les pêcheurs de Calais ou de Dunkerque. Mes chers collègues, où allons-nous ?
Nous pouvons donc globalement nous interroger sur les effets des politiques communautaires et nationales menées en matière de pêche depuis 1983.
Au travers de l’exemple de la Bretagne, le rapport de l’OPECST souligne l’augmentation de l’intensité capitalistique du secteur de la pêche depuis les années 1980. Il met en évidence l’augmentation du nombre des bateaux mesurant de 16 à 25 mètres, au détriment de ceux qui font moins de 10 mètres, en raison de la politique des subventions. Le même rapport établit un fort lien entre cette dernière et la crise de la pêche artisanale.
La casse des bateaux de pêche, appelée en langage politiquement correct « sortie de flotte », représente déjà 78 bateaux en 2009, dont 24 pour les départements bretons. Depuis vingt ans, c’est la moitié de la flottille qui a disparu en France !
La pêche artisanale côtière est menacée de disparition alors qu’elle contribue à maintenir le tissu social de nos ports, qu’elle constitue une sécurité face aux délocalisations et qu’elle est garante de qualité et de proximité. Existera-t-elle encore en 2013, au moment de la réforme de la politique commune de la pêche qui a été annoncée ?
Allons-nous faire comme pour la PAC, c’est-à-dire prendre conscience qu’il faut aider les petits agriculteurs au moment où ceux-ci ont disparu ? Il s'agit d’une véritable question au regard du parallélisme que nous pouvons établir entre la PAC et la PCP.
La France et l’Europe n’échappent pas à la situation mondiale de la pêche et de la ressource halieutique en ce qui concerne tant les capacités d’exploitation que la surexploitation des stocks. Aujourd’hui, les réserves des dix espèces les plus importantes sont surexploitées.
Les techniques et les périodes de pêche entraînent un volume de rejets qui représente entre 20 % et 50 % des quantités débarquées. La pêche minotière industrielle écume les mers pour environ 23 millions de tonnes. En comparaison, les rejets représentent 30 millions de tonnes.
Ce type de pêche non sélectif est certes utile pour l’aquaculture, mais il est dangereux pour la conservation des espèces. Selon l’INRA, des farines végétales pourraient remplacer les farines de poissons, mais Bruxelles ne semble pas avoir pris ce sujet à bras-le-corps !
La pêche française souffre certes des quotas, mais aussi d’un réel problème de revenu, qui n’est pas automatiquement lié aux quantités pêchées. La désorganisation logistique du marché et ses règles économiques conduisent à de multiples aberrations dans un pays qui importe près de 85 % de sa consommation de poissons.
Il est scandaleux de voir détruire quarante tonnes d’un produit aussi noble que les coquilles Saint-Jacques. C’est pourtant ce qui vient de se passer !
Ce seul exemple illustre toutes les imperfections du marché du poisson en France, depuis les criées, les pêcheurs et les mareyeurs jusqu’à la distribution.
Les produits sont divers, irréguliers, débarqués en de multiples points de l’Hexagone, les prix souvent élevés et instables, les consommateurs désorientés et dubitatifs devant une offre inorganisée.
Certaines des dix propositions formulées par M. Marcel-Pierre Cléach dans son rapport vont dans le bon sens.
Nous approuvons l’idée de développer les partenariats entre pêcheurs et scientifiques. Il ne serait pas inutile d’y associer les décideurs politiques, qui, le plus souvent, se contentent d’une approche très théorique du sujet.
En ce qui concerne la gestion des ressources, seuls ces partenariats permettront le respect des totaux admissibles de capture et des quotas, à condition que ceux-ci soient gérés de façon pluriannuelle.
La question des rejets et celle de la pêche minotière appellent respectivement à une aide technique et à une réglementation plus sévère.
Les quotas individuels transférables portent en eux-mêmes le danger de la concentration et de la délocalisation. Ils risquent fort d’être détournés de leur vocation initiale, à savoir la responsabilisation individuelle des pêcheurs.
La question de la rentabilité de la pêche est complexe et coûteuse, dans la mesure où des études sérieuses montrent que la perte annuelle au plan mondial est égale à 64 % de la valeur débarquée et représente un manque à gagner de 51 milliards d’euros. Les conclusions à en tirer seraient qu’il convient de réduire de 43 % le coût de la pêche, d’augmenter de 71 % le prix du poisson ou de réduire de 25 % à 50 % la capacité de capture.
Dans le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques est également évoqué le sevrage des aides publiques. S’il est vrai que ces aides ont parfois des effets négatifs pour la pêche artisanale – concentration et destruction de la flottille –, il conviendrait, dans un premier temps, de les cibler sur une assurance revenu pour compenser, d’une part, les périodes de non-pêche, et, d’autre part, les aléas du marché, qui engendrent une dégradation des revenus.
Les politiques actuelles de la pêche ressemblent davantage à une fuite en avant face à l’effondrement de la ressource qu’à la traduction d’une réelle volonté de rétablir les stocks et de restructurer le marché.
Il s’agit d’un problème qui appelle des décisions européennes et mondiales pour contrecarrer le braconnage, la surpêche, la falsification des chiffres réels, ainsi que le colonialisme de pêche.
L’acidification des océans, qui serait liée aux émissions de CO2, doit amener les scientifiques et les chercheurs à accélérer leurs investigations, à condition que les moyens financiers et humains nécessaires leur soient donnés pour conduire cette recherche vitale. C’est peut-être tout l’avenir de l’équilibre des océans et de la pêche qui en dépend.
Je conclurai en faisant miennes ces déclarations de Daniel Pauly, expert mondial de la pêche : « Il faut pêcher moins si l’on veut continuer à pouvoir pêcher. En ciblant la pêche industrielle, on réduirait beaucoup les capacités de pêche, sans affecter beaucoup de personnes. » M. Pauly ajoute : « On ne gère pas les stocks avec son estomac, mais avec sa tête. »
Je terminerai sur une réflexion personnelle : ne gérons pas la pêche pour capitaliser de l’argent, mais pour nourrir les hommes, sans oublier les pêcheurs !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et de l’Union centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la mer est une composante fondamentale de la vie terrestre, sur les plans tant géologique que physico-chimique ou biologique.
La principale problématique de la mer et des océans est celle de leur biodiversité et de leurs écosystèmes qui, rappelons-le, fournissent plus de 80 % de l’oxygène de notre planète.
De manière générale, on considère aujourd’hui que la biodiversité génétique des espèces marines excède celle des espèces terrestres. Tous ces écosystèmes relèvent de conditions environnementales qui sont, par essence, exceptionnelles et fragiles. La physiologie des espèces supérieures, comme les poissons, est adaptée à ces conditions si particulières : croissance lente, durée de vie longue, maturité tardive.
C’est pourquoi je préconise, à l’occasion du Grenelle de la mer, que l’IFREMER soit doté de moyens supplémentaires afin de créer un véritable laboratoire du fond des mers chargé d’étudier la dynamique des écosystèmes à l’échelle de la décennie et de détecter les événements sismologiques sous-marins, à l’instar de ce qui se fait aux États-Unis ou au Japon.
Cela est encore plus nécessaire pour l’environnement côtier, qui doit également faire l’objet d’une protection spécifique à cause de ses particularismes : une faible profondeur induisant des phénomènes sédimentologiques spécifiques, des apports continentaux importants, y compris sous forme de pollutions, des marées d’ampleur considérable sur des temps très courts, couplées à des vents locaux et à des courants intenses, une exploitation intensive et variée des ressources, un usage dense des espaces maritimes.
Or, on ne peut intervenir dans cet espace de manière parcellaire ou fragmentaire qu’au risque de le fragiliser encore plus : c’est pourquoi je défends, au-delà de la simple gestion intégrée de la zone côtière, la mise en place d’une nouvelle gouvernance. Celle-ci doit être économique, écologique, urbanistique, mais également sociale et politique, car sa mise en œuvre ne peut être couronnée de succès que si elle associe tous les acteurs du milieu côtier à l’échelle locale ou régionale au sein d’un véritable « parlement de la mer ».
La mer a toujours été l’école du partage et de la solidarité. C’est cet esprit que je souhaite voir souffler sur les travaux du Grenelle de la mer.
La mer est, également, un théâtre d’innovations techniques qu’il faut soutenir et encourager, notamment dans le domaine des pêches maritimes, où la dépendance énergétique est totale et où le manque d’innovation en matière de motorisations fait courir un trop grand risque à nos patrons pêcheurs.
Pourquoi ne pas faire passer le secteur des pêches d’une logique de déclin à une dynamique de développement durable, en s’appuyant sur l’utilisation d’engins de pêche plus sélectifs et, surtout, plus économes en énergie, en instaurant des périodes de fermeture pour permettre aux « poissons géniteurs » de procréer tout en permettant aux « juvéniles » de grandir ?
Pour cela, il faut mettre en place des quotas individuels de pêche attachés aux navires, afin de limiter la course à l’accroissement des armements de pêche. Il est urgent de donner aux pêcheurs des garanties s’agissant de leurs investissements et de leur avenir. Seul le quota de pêche individuel transférable peut le permettre et pérenniser une filière qui s’appuiera alors sur une meilleure valorisation des produits.
Cependant, pour fonctionner de manière satisfaisante, le système devra reposer sur une parfaite validité du droit de propriété acquis, ce qui supposera un contrôle sans faille par les services de l’État et l’interprofession.
Trois principes devront nous guider pour mettre en place un plan d’avenir pour la pêche, à savoir la durabilité, la stabilité et l’équité : durabilité, car des droits à pêcher bien gérés sont fondamentaux pour avoir une vision « écosystémique » des ressources ; stabilité, car des droits à pêcher définis sur des périodes moyennes de quatre à cinq ans permettent aux entreprises de la filière de planifier les investissements, rendus encore plus onéreux par le vieillissement de la flotte de pêche française ; équité, car des droits à pêcher répartis en fonction des armements, des métiers et des lieux de débarquement sont la garantie d’une pérennisation des acteurs en place, sans pour autant interdire l’accès aux ressources à des primo-arrivants.
Ces quotas individuels transférables, gérés selon le principe que je viens d’évoquer, permettront à la pêche française, qui est à 95 % une pêche artisanale, d’aborder avec sérénité les échéances à venir, principalement le renouvellement de la flotte, qui est déjà le deuxième poste de charges des armements après le carburant.
Dans cette perspective, je propose de sortir le plus rapidement possible du système de totaux admissibles de capture – les TAC – mis en place par la politique européenne des pêches et dont même la Commission européenne reconnaît l’échec.
Il faudrait aussi refonder intégralement l’organisation professionnelle de la pêche autour d’une gestion plus participative, plus anticipative et plus adaptative de la ressource et d’une montée en puissance de l’aquaculture et de la conchyliculture.
Il serait bon, également, de créer un système d’information géographique unique, commun à l’ensemble des acteurs de la mer et des océans. L’instauration de notre propre système d’information donnerait en outre l’occasion à la France de développer une expertise en ce domaine et de pouvoir exporter celle-ci.
Il serait par ailleurs judicieux de généraliser la mise en place d’un étiquetage et de labels écologiques, notamment en valorisant encore mieux les origines géographiques et les terroirs, le tout au sein d’une démarche HACCP – hazard analysis critical control point.
Enfin, il conviendrait de mener une grande étude sur l’incidence de la pêche de plaisance sur les ressources, aboutissant à un véritable Livre blanc sur la pêche de loisir et à l’instauration de quotas, pour les plaisanciers, concernant certaines espèces emblématiques aujourd’hui menacées.
Cependant, ces solutions, la France ne saurait les imposer seule, car la mer, les courants et les poissons ne connaissent pas de frontières. Elle doit s’appuyer sur l’Union européenne et sur les organisations relevant de l’ONU, notamment l’Organisation maritime internationale.
S’appuyer sur l’Union européenne, c’est faire en sorte que les espaces maritimes européens relèvent de la règle environnementale la plus audacieuse en vigueur dans l’un des États membres, car seule la pédagogie de l’exemple pourra favoriser une harmonisation vers le haut des réglementations maritimes.
S’appuyer sur le système onusien, c’est faire valoir et faire reconnaître que la voix de la France, c’est la voix du seul État présent sur tous les océans de la planète, disposant du deuxième territoire maritime au monde.
Je souhaite maintenant, en tant qu’élu des Alpes-Maritimes, aborder les problèmes inhérents à la mer Méditerranée.
La Méditerranée représente un enjeu crucial, car ses rives connaissent aujourd’hui une crise des ressources environnementales qui menace le développement économique et le bien-être des populations.
D’après le Plan bleu, organisme du PNUE, le Programme des Nations unies pour l’environnement, chargé d’étudier cette zone, la Méditerranée est un espace particulièrement exposé, où se concentrent les phénomènes constatés à l’échelle mondiale.
La situation appelle des réponses urgentes.
La Méditerranée est l’un des principaux « sites critiques » de la biodiversité mondiale. La croissance démographique est la principale cause de la surexploitation et de la dégradation de ses écosystèmes. Le manque d’intégration politique des pays riverains, inclus dans différents espaces géopolitiques – Union européenne, Ligue arabe, Union africaine notamment –, fait obstacle à l’adoption de politiques coordonnées. Les gouvernements commencent à se rendre compte que l’état de leurs ressources naturelles influence leurs perspectives économiques, mais cela ne se traduit pas en actes.
L’Union pour la Méditerranée, lancée en juillet 2008, se veut une réponse. Ne faut-il pas maintenant la mettre en œuvre ? Il n’est pas un de nos grands partenaires mondiaux – États-Unis, Brésil, Inde, Chine, Royaume-Uni ou Russie – qui ne développe une grande politique maritime. Comme l’a déclaré M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, « les espaces maritimes demeurent en effet l’enjeu géostratégique majeur du siècle qui débute ».
Les avantages géographiques dont bénéficie notre pays, avec un espace maritime qui est le deuxième au monde, ainsi que ses savoir-faire navals et maritimes, lui donnent une responsabilité majeure dans l’avenir des mers et des océans, particulièrement de la Méditerranée.
Aujourd’hui, 88 % des stocks souffriraient d’une pêche excessive, mettant en péril la reproduction de certaines espèces, comme le cabillaud en mer du Nord ou le thon rouge en Méditerranée. L’Union européenne en est donc réduite à importer plus de la moitié des poissons qu’elle consomme.
Bruxelles souhaite briser ce cercle vicieux, consistant à solliciter toujours davantage des ressources qui s’amoindrissent, ce qui conduit l’Europe à subventionner de manière croissante une activité de plus en plus déficitaire.
Il est donc vital de protéger cet espace fondamental pour l’homme qu’est la mer, parce qu’elle lui fournit des ressources vivantes, minérales et énergétiques et parce qu’elle est le lieu d’exercice d’activités aussi stratégiques que le transport, la défense et, bien évidemment, le tourisme.
C’est une responsabilité que nous avons à l’égard des générations futures, bien évidemment, mais plus encore des générations actuelles.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je conclurai en empruntant ces quelques mots à l’écrivain croate Predrag Matvejevic : « Il n’est pas question seulement d’histoire ou de traditions, de géographie ou de racines, de mémoire ou de croyances : la Méditerranée est aussi un destin. » J’adresse mes félicitations à mon collègue Marcel-Pierre Cléach pour son brillant rapport.
Applaudissements sur les travées de l’UMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, la pêche, qui a toujours été une activité essentielle pour l’homme, me semble emblématique du rapport de nos sociétés humaines à l’environnement.
La pêche peut aussi bien illustrer le pire des scénarios, comme c’est le cas aujourd’hui, y compris sur le plan social, que s’inscrire dans une vraie dynamique de développement durable, dans ses dimensions écologique et sociale, pour constituer alors une illustration parfaite de la valorisation économique de la biodiversité, à condition toutefois de s’en donner les moyens !
À cet égard, il est une réalité, peut-être difficile à faire entendre en ces temps où la crise frappe les pêcheurs et leurs familles, mais rigoureusement incontournable : pour pêcher toujours, il faut pêcher mieux !
Les États membres ont confié à l’Union européenne la gestion des ressources halieutiques. La politique commune de la pêche est la politique la plus intégrée, mais sa refonte globale est devenue indispensable : elle passe par la définition de plans d’action pluriannuels de restauration des populations des espèces pêchées, fondés exclusivement sur des données scientifiques, et non sur des marchandages.
Cela étant, j’insisterai surtout sur la manière dont notre pays remplit les missions qui lui ont été déléguées, notamment en ce qui concerne la gestion des stocks. À mes yeux, l’action du Gouvernement doit être réorientée selon deux axes prioritaires.
Il convient en premier lieu de mettre en place des contrôles plus rigoureux du respect de la réglementation en matière de capture, de taille des poissons pêchés, d’engins de pêche, de prise en compte des prises rejetées en mer afin de protéger les zones littorales.
En effet, la France s’est trop souvent distinguée par des retards importants dans les déclarations de capture à l’Union européenne, par l’insuffisance des moyens de saisie des fiches de pêche remises par les navires et par un système de contrôle manifestement peu efficace.
Des contrôles plus rigoureux impliquent le développement de brigades mobiles de contrôle à compétence nationale et – pourquoi pas ? – la mobilisation des services des douanes, dont les agents ne seraient pas mécontents de se voir confier des missions et compétences nouvelles, à condition, évidemment, qu’elles soient assorties des moyens correspondants.
L’amélioration des contrôles suppose également le renforcement de cet outil exceptionnel qu’est l’IFREMER, l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer. A contrario, le budget de 2009 se distingue par une baisse de la masse salariale et une réduction de 7, 5 % des moyens alloués aux programmes scientifiques.
Il convient en second lieu de retenir une approche diversifiée concernant l’appui aux unités de pêche.
En effet, la politique de soutien aux pêcheurs doit se concentrer sur les petites unités artisanales, tout en privilégiant l’aide aux groupements de pêcheurs. En contrepartie, l’appui aux grosses unités de pêche hauturière, notamment les aides directes, doit être abandonné.
Il s’agit d’une priorité absolue, car, du fait de leurs capacités de capture limitées, les petites unités de la pêche artisanale ont une moindre incidence sur l’environnement marin : la pérennité de cette activité est intrinsèquement et directement liée à la protection du milieu marin proche.
Inversement, les grosses unités appartiennent à des armateurs ou à des groupes financiers qui ne recherchent que la rentabilité immédiate et ne se sentent pas concernés par la gestion des stocks, car ils peuvent se permettre d’aller exploiter, pour ne pas dire piller, les stocks éloignés.
Au final, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, vous l’aurez compris, le soutien à la pêche artisanale est crucial, d’une part, pour contenir le développement inconsidéré de l’aquaculture, qui entraînerait, à terme, un appauvrissement de la diversité biologique et génétique, et, d’autre part, pour nous pousser à accorder, enfin, tout l’intérêt nécessaire à la conservation de stocks viables de poissons marins et à apporter l’aide de la collectivité à ceux qui la méritent. Oui, pour toujours pêcher, il faut pêcher mieux !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, les interventions brillantes des orateurs qui m’ont précédé ont porté en priorité sur les ressources des mers et des océans. Mon propos sera quelque peu différent, puisque, vivant à près de 1 000 kilomètres de la mer, je souhaite évoquer un autre sujet, celui des ressources halieutiques en eau douce.
Même si le problème peut paraître, bien entendu, mineur par rapport à ceux que rencontrent la pêche maritime, il a néanmoins beaucoup d’importance dans nos territoires ruraux : par exemple, nos trois départements de Franche-Comté comptent 4 200 hectares d’étangs.
La Bresse jurassienne est ainsi une importante région d’étangs, qui allie production piscicole significative et grande valeur du patrimoine naturel. Les étangs, de petite taille – souvent moins de 3 hectares –, y représentent 1 000 hectares. Je ne m’étendrai pas sur les bénéfices, que tout le monde connaît, liés à ces plans d’eau, en matière de régulation du régime des eaux et d’amélioration de la qualité de celles-ci. Les étangs constituent des écosystèmes d’intérêt majeur pour la conservation du patrimoine naturel et des sites de reproduction pour une grande variété d’espèces animales. Leur grand intérêt écologique est également reconnu, non seulement sur le plan national, que ce soit au travers de Natura 2000, des pôles relais ou des zones humides, mais aussi à l’échelon international, par le biais de la convention de Ramsar.
Or, les différents acteurs de la filière piscicole sont très inquiets pour l’avenir. Les problèmes relatifs à l’exploitation des étangs se multiplient et les revenus liés à l’activité chutent. La filière de la pisciculture d’étang est très hétérogène, puisqu’on y trouve une minorité de professionnels dont l’activité repose, pour l’approvisionnement et la vente, sur celle d’une majorité d’exploitants amateurs.
Cette filière rencontre des difficultés spécifiques, que je vais maintenant énumérer.
Elle supporte tout d’abord une forte pression fiscale : l’imposition forfaitaire est lourde au regard des revenus tirés de ce système de production.
Elle subit ensuite la concurrence des produits d’importation issus de la pêche professionnelle dans les pays de l’Est, notamment en mer Baltique. Ainsi, du filet de sandre est proposé à la restauration à partir de 6 euros le kilo, quand le même poisson vivant est vendu pour le repeuplement entre 10 euros et 20 euros le kilo. De même, la perche du Nil, en provenance du lac Victoria, que les restaurateurs commercialisent sous l’appellation « perche », est disponible, congelée bien entendu, à moins de 5 euros le kilo.
Un troisième problème, beaucoup plus spécifique encore, est posé par les cormorans §véritable fléau dont la pisciculture d’étang pâtit depuis plus de quinze ans. Certes, un certain nombre de progrès ont été réalisés en matière d’augmentation des quotas de tir et d’assouplissement des modalités de réalisation de ceux-ci, avec en particulier l’allongement de la période de tir au-delà de la période de frai du gardon, au mois d’avril, afin de protéger les géniteurs. Dans la pratique, les prélèvements imputables aux cormorans sont tout de même estimés à 120 tonnes de poissons d’étang dans la Bresse jurassienne, soit une valeur marchande de 300 000 euros par an, sans compter le surcoût dû au stockage hivernal, en termes d’unités de stockage et de main-d’œuvre, et à la mortalité chez les poissons que cela engendre. Des pisciculteurs me signalaient l’an dernier que les pertes pouvaient atteindre, dans certains de leurs étangs, plus du tiers de la production. En outre, les espèces envahissantes, comme le ragondin, le poisson-chat, l’écrevisse américaine, introduites à des fins scientifiques ou expérimentales, pénalisent aussi une gestion rationnelle des étangs.
Enfin, je soulèverai la question épineuse du repeuplement. La profession est en émoi, notamment le syndicat des aquaculteurs de Franche-Comté, du fait que le projet de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée pour la période 2010-2015 préconise « l’absence de recours aux repeuplements dans les masses d’eaux en très bon ou en bon état écologique ».
La profession s’étonne du manque de concertation et de débat entre les acteurs et déplore que l’on oppose bon état des eaux et pratiques de repeuplement, alors que la directive-cadre sur l’eau ne comporte aucun jugement négatif sur ces dernières. Il est surprenant de condamner ainsi de manière unilatérale le repeuplement, sur des bases scientifiques et techniques bien faibles, sans connaître la multiplicité des pratiques. Madame la secrétaire d’État, les professionnels craignent que cela n’accélère la disparition d’une partie des acteurs des milieux aquatiques, aménageurs de territoires ruraux et créateurs d’emplois. Ils souhaiteraient donc qu’une réflexion se mette en place à l’échelon national sur ces questions de repeuplement, traitées en dehors des SDAGE, et qu’un groupe de travail, piloté par les ministères de l’écologie et de l’agriculture, puisse regrouper les différents acteurs concernés – pêcheurs, pisciculteurs, associations, scientifiques.
Par ailleurs, il faut reconnaître que les dispositions réglementaires et les programmes environnementaux – loi pêche, loi sur l’eau, Natura 2000 – vont toujours dans le sens d’un durcissement des contraintes et entravent toujours un peu plus les pisciculteurs dans l’utilisation de leur outil de production. Devant l’accumulation de ces contraintes, on assiste souvent à un abandon des étangs par leurs propriétaires, qui se trouvent dans l’impossibilité de les gérer.
À propos de Natura 2000, je souligne au passage qu’un certain nombre de pratiques facilement quantifiables mériteraient d’être soutenues dans le cadre des mesures agroenvironnementales territorialisées, ou MATER : conservation des habitats remarquables par le maintien de la pratique du faucardage, l’entretien des digues, selon les situations, la technique de l’assec, c’est-à-dire l’assèchement des étangs tous les cinq ans, l’adaptation des structures.
Madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, de tout temps, les hommes se sont nourris de poisson. N’est-ce pas, du reste, souvent recommandé par le corps médical ? Au moment où l’on parle de diminution des volumes de prises en mer, convient-il de contraindre encore davantage la pisciculture en eau douce ?
Les professionnels de la pisciculture aimeraient être mieux reconnus et représentés au sein des groupes de travail dont les décisions ont des répercussions sur l’avenir de la filière et qui se réunissent dans le cadre, notamment, des SAGE, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, des contrats de rivière et des SDAGE.
La pisciculture d’étang, activité ancestrale, est l’une des rares activités agricoles qui reposent encore sur une production extensive, répondant parfaitement aux objectifs de développement durable. Elle demeure le premier garant du maintien d’écosystèmes riches et complexes, et participe à la vie des territoires ruraux. Pour toutes les raisons que je viens d’évoquer, elle mérite d’être mieux considérée et soutenue. Je conclurai moi aussi mon propos en félicitant notre collègue Marcel-Pierre Cléach de son excellent rapport ; je forme le vœu qu’il ne reste pas sans lendemain !
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je remercie le Sénat et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques d’avoir inscrit un tel débat à l’ordre du jour de la Haute Assemblée.
Le rapport de M. Cléach nous offre une vision renouvelée du débat sur la gestion des ressources halieutiques et de la pêche, à ce moment clef que constitue le lancement du Grenelle de la mer. Daniel Pauly sera d’ailleurs ici demain pour éclairer nos échanges sur la pêche.
L’organisation d’un Grenelle de la mer a été décidée parce que le premier Grenelle avait surtout consacré ses travaux aux problèmes de la terre. Or la France possède le deuxième espace maritime mondial et ses eaux se caractérisent par une forte biodiversité, notamment dans les territoires ultramarins : cela confère une responsabilité particulière à notre pays dans ce domaine. Il était donc indispensable qu’un Grenelle de la mer soit mis en place, et le présent débat permettra d’éclairer ses travaux.
Les ressources halieutiques sont essentielles, car elles représentent 20 % de l’apport en protéines animales de la population mondiale : il s’agit de la principale source protéique pour près d’un milliard d’individus.
Les prévisions contenues dans les rapports de la FAO que vous avez cités, monsieur Cléach, sont assez alarmantes : de 75 % à 80 % des ressources halieutiques mondiales sont surexploitées ou exploitées au maximum. En d’autres termes, si une crise écologique devait survenir, elle affecterait probablement, en tout premier lieu, non pas le climat, dont il est beaucoup question actuellement, mais la biodiversité, et elle serait liée à l’épuisement des ressources halieutiques.
En effet, comme vous l’avez rappelé, ces ressources naturelles sont spécifiques et fragiles. Certes, elles sont renouvelables – elles nous semblent même l’être indéfiniment –, mais ce sont aussi des ressources communes, et donc totalement partagées. Quant à leur extrême fragilité, elle tient à leur sensibilité aux pollutions, aux changements climatiques et à des évolutions des écosystèmes qui n’avaient pas été anticipées par les scientifiques.
Nous assistons donc aujourd’hui, comme l’ont rappelé les différents orateurs, à une sorte de « course au poisson », chaque pêcheur ayant individuellement intérêt, pour augmenter sa production et sa rémunération, à mobiliser un maximum de moyens de capture.
Nous sommes à un tournant majeur. Nous partageons tous, tant sur les travées du Sénat qu’au sein du Gouvernement, l’objectif de sauvegarder la pêche. Je souhaite vraiment que l’on cesse d’opposer préservation de l’environnement et pratique de la pêche, car cette vision des choses est totalement erronée : au contraire, l’une ne va pas sans l’autre ! La préservation de l’environnement permettra de sauvegarder les ressources halieutiques, et donc l’avenir des pêcheurs. Michel Barnier et moi-même sommes d’ailleurs parfaitement d’accord sur ce point.
La politique du Gouvernement s’oriente donc selon deux axes : agir pour adapter et moderniser le secteur de la pêche, d’une part ; agir pour préserver et améliorer la qualité de l’environnement marin, d’autre part.
En ce qui concerne l’action en faveur du secteur de la pêche, le plan pour une pêche durable et responsable, annoncé par le Président de la République le 16 janvier 2008 dans un contexte de crise dû à la forte hausse du prix du gazole, comprend quinze mesures et est doté de 310 millions d’euros.
Au-delà d’une réponse conjoncturelle, ce plan comporte de nombreuses mesures structurelles, visant en particulier à encourager le remplacement des bateaux anciens par des unités plus économes en énergie et moins polluantes.
À cet égard, il a été souligné à juste titre que la recherche sur les bateaux économes en énergie et sur l’utilisation de nouvelles sources d’énergie était actuellement un peu à l’abandon. Nous vous rendrons compte, bien évidemment, de l’avancement des recherches engagées dans ce domaine.
Comme l’ont indiqué MM. Étienne et Cléach, la première priorité est de renforcer la connaissance scientifique de l’état des ressources halieutiques, en incitant pêcheurs et scientifiques à travailler main dans la main.
Sur ce plan, deux axes de recherche doivent être privilégiés : l’intensification des observations en mer et l’augmentation de la capacité d’expertise scientifique en halieutique à l’échelon national. C’est dans cet esprit que nous travaillons avec l’IFREMER, dont nous révisons actuellement le contrat quadriennal. Une enveloppe supplémentaire de 8 millions d’euros a été mobilisée ; elle servira notamment à la création de seize postes supplémentaires, en CDI ou en CDD, au sein de l’IFREMER.
À partir de 2009, nous augmenterons de 300 % les observations en mer servant de base à l’élaboration des avis scientifiques : le nombre de jours d’observation passera ainsi de 1 400 en 2008 à plus de 4 500 en 2009.
Nous renforcerons également le rôle d’autres organismes scientifiques, comme l’Institut de recherche pour le développement, l’IRD, ou le Muséum national d’histoire naturelle, dans le traitement de questions particulières concernant les professionnels. Il s’agit donc bien de rapprocher le monde de la pêche de celui de la science. Scientifiques et pêcheurs doivent travailler de concert, car ils partagent les mêmes intérêts et les mêmes interrogations.
La deuxième priorité est de développer de nouveaux outils.
Vous avez évoqué, madame Herviaux, les « contrats bleus », démarche très innovante qui consiste à rémunérer les pêcheurs pour des activités telles que la récupération de déchets en mer ou l’accueil de scientifiques sur les bateaux. Cette mesure a été dotée de 30 millions d’euros pour les années 2008 et 2009, et le bilan de son application est extrêmement positif. Michel Barnier et moi-même sommes très favorables à la poursuite de la mise en œuvre de ces « contrats bleus ».
La troisième priorité est de valoriser l’offre française de produits de la mer au travers des écolabels, conformément aux conclusions du Grenelle de l’environnement. France Agrimer étudie également la création d’une marque collective nationale pour différencier l’offre française.
La réforme de la politique commune de la pêche constitue bien évidemment un autre grand chantier.
Ce n’est pas un secret : le bilan économique, social et environnemental de cette politique est assez mitigé. Si le dispositif a connu des améliorations depuis 2002, avec la mise en place de plans de gestion pluriannuels et la mise en œuvre de plans de reconstitution du stock de certaines espèces, son bilan est jusqu’à présent assez médiocre, en particulier sur deux points.
Tout d’abord, les mesures structurelles de réduction de la flotte ont échoué : la baisse du nombre de navires a été compensée par un accroissement de la puissance, et donc de l’effort de pêche, des unités restant en flotte.
Ensuite, si le principe de stabilité relative des quotas est favorable à la France, il ne permet pas une gestion durable des stocks. Là encore, je ne trahis aucun secret en disant cela !
Les réponses présentées dans le Livre vert de la Commission comportent des éléments positifs.
Premièrement, la Commission propose de fonder la gestion des rejets sur l’effort de pêche, et non plus sur les seuls TAC et quotas. Cela me semble positif.
Deuxièmement, il est envisagé de faire évoluer le système de stabilité relative des quotas, en assortissant son maintien de l’instauration de mécanismes de flexibilité. Il s’agit d’ouvrir le débat sur l’allocation de droits de pêche transférables, en écartant une financiarisation et une concentration à outrance du secteur de la pêche. Dans cet esprit, le principe serait de mettre en œuvre des systèmes spécifiques selon les types de pêche : des quotas individuels transférables pour les navires hauturiers et un système fondé sur le principe de stabilité pour la pêche côtière, avec les adaptations nécessaires. Deux systèmes différents pourraient donc coexister, des garde-fous devant être prévus, notamment pour les quotas individuels transférables.
Troisièmement, le Livre vert de la Commission préconise de soutenir la pêche artisanale et côtière. M. Muller a eu raison d’insister sur l’importance, dans notre pays, de cette pêche qui, outre sa dimension économique, joue un véritable rôle social. Il faut envisager la mise en place d’un traitement différencié pour la pêche côtière, d’une part, et la pêche hauturière, d’autre part, et faire bénéficier les flottes artisanales d’un soutien public en vue de leur adaptation à la politique commune de la pêche réformée.
Quatrièmement, le Livre vert propose la mise en place de systèmes de gestion régionaux. Nous y sommes très favorables, car il est nécessaire de fixer des règles adaptées aux différentes zones de pêche, selon leurs caractéristiques. Je fais mienne, sur ce point, la position de M. Merceron. Nous nous félicitons de ce que la Commission reconnaisse la spécificité de chaque zone de pêche. Il faudrait, par ailleurs, laisser jouer le principe de subsidiarité. En ce qui concerne la France, par exemple, l’outre-mer et la mer du Nord présentent des caractéristiques très différentes, qui doivent être prises en compte de façon distincte.
Globalement, il nous faut réfléchir à l’amélioration de « notre » modèle, en responsabilisant les entreprises, notamment les pêcheurs, et en améliorant la qualité des produits. Le pêcheur doit tirer profit du fait qu’il pratique une pêche durable. S’agissant des aides, la réforme de la politique commune de la pêche offre un cadre idéal pour les réformer : elles doivent être moins conjoncturelles et plus structurelles.
En ce qui concerne maintenant les mesures de contrôle, elles doivent être renforcées, qu’il s’agisse de la pollution ou des pêches.
Comme l’ont souligné plusieurs d’entre vous, les profits tirés de la pêche illicite s’élèvent à 10 milliards d’euros à l’échelle mondiale, ce qui en fait le deuxième fournisseur de produits halieutiques au monde. C’est là un véritable scandale, M. Le Cam a eu raison de le souligner. Le règlement INN, destiné à combattre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, a été adopté en juin 2008. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2010 et permettra d’intensifier la lutte contre ces pratiques.
S’agissant de l’aquaculture durable, s’il n’est pas envisageable qu’elle se substitue à terme à la pêche, monsieur Le Cam, elle n’en connaît pas moins une forte croissance dans de nombreuses zones et fournit près de la moitié du poisson consommé dans le monde. L’Union européenne importe de plus en plus de produits issus de l’aquaculture et provenant parfois de pays où les conditions sociales et environnementales de cette production sont plutôt opaques.
À propos de la question spécifique de la pisciculture, soulevée par M. Bailly, j’indique qu’un système de prélèvement donnant lieu à l’établissement d’un bilan annuel doit permettre de contrôler l’ampleur des dégâts causés par les cormorans. Il ne s’agit nullement de protéger ces oiseaux au détriment des pisciculteurs !
Par ailleurs, certains SDAGE envisageaient en effet de ne pas permettre le repeuplement piscicole dans les rivières dont les eaux sont en très bon état écologique. Cela ne me paraît pas justifié, et nous allons donc demander aux SDAGE, en concertation avec les acteurs de la filière, de laisser aux pisciculteurs la possibilité de procéder à des repeuplements piscicoles dans de telles rivières, l’objectif de parvenir en 2015 au bon état écologique des eaux, fixé par la directive-cadre sur l’eau, continuant néanmoins à s’imposer à nous.
En vue de promouvoir le développement de l’aquaculture, la France a confié à Mme Hélène Tanguy une mission qui a débouché sur l’élaboration, en juin 2008, d’un mémorandum. Signé par dix-huit États membres de l’Union européenne, ce document sur le développement de l’aquaculture s’articule selon quatre axes : mise en place d’une politique communautaire intégrée, promotion de l’image de l’aquaculture à l’échelle européenne, respect de normes sanitaires et environnementales, mesures de soutien économique à ce secteur.
Ce mémorandum a été à l’origine d’une communication de la Commission sur l’avenir de l’aquaculture en Europe, qui fera l’objet d’un débat au Conseil des ministres de juin 2009. La plupart des États sont assez favorables à un soutien au développement de l’aquaculture dans des conditions environnementales et sociales satisfaisantes.
L’Union pour la Méditerranée, particulièrement chère à M. Vestri, doit permettre à la France d’améliorer la gestion de la ressource halieutique dans cet espace extraordinaire, mais si fragile, qu’est la Méditerranée.
Je partage votre diagnostic, messieurs Vestri et Cléach : la coopération entre États riverains est indispensable pour parer au risque de surexploitation des ressources et d’effondrement des stocks. Sur ce point, nous ne partons pas de rien et nous pouvons nous inspirer, par exemple, du cas du thon rouge. Cependant, il faut aller plus loin et développer, dans le cadre de l’UPM, une gestion coordonnée de la pêche, à l’instar du système expérimental de surveillance conjointe des pollutions mis en place avec la plupart des États riverains et piloté par la France.
Bien entendu, on ne peut parler de la pêche et des ressources halieutiques sans évoquer la qualité de l’environnement marin, qui repose sur deux piliers : la mise en œuvre d’une approche écosystémique et la construction d’un réseau d’aires marines protégées.
Jusqu’à présent, les écosystèmes marins étaient assujettis à des politiques très différenciées répondant chacune à des problématiques spécifiques – la pêche, le transport maritime, la pollution des mers, le tourisme et les loisirs, etc. Or, parallèlement, les pêcheurs s’estimaient victimes des pollutions marines, qui sont d’ailleurs le plus souvent d’origine terrestre, de la destruction des zones de frai, des incidences du changement climatique…
Il est évident que la viabilité économique et sociale du secteur de la pêche repose sur une gestion intégrée de l’espace maritime. Telle est la logique qui sous-tend la directive-cadre portant stratégie pour le milieu marin, ainsi que le Grenelle I, en particulier son article 30, lequel développe une vision stratégique globale, fondée sur une gestion intégrée et concertée de la mer et du littoral. Le Grenelle de la mer reprendra cette même logique : il s’agit désormais de traiter conjointement les différentes problématiques.
Par ailleurs, l’article 60 du Grenelle II, dont vous aurez bientôt à débattre, met en œuvre cette approche écosystémique à l’échelle de chaque façade maritime.
Le cadre juridique nécessaire à la pratique de cette nouvelle approche des activités maritimes est donc déjà en place. Le Grenelle de la mer doit nous permettre d’élaborer des propositions concrètes dans cette perspective. L’un des enjeux majeurs, qui a d’ailleurs été rappelé par M. Vestri, est bien l’instauration de cette nouvelle gouvernance, qui fait l’objet de la quatrième table ronde du Grenelle de la mer.
En ce qui concerne maintenant la construction d’un réseau d’aires marines protégées, la France s’emploie à rattraper rapidement le retard qu’elle connaît dans ce domaine. Notre objectif est de parvenir à 10 % d’aires protégées. Monsieur Cléach, vous avez absolument raison d’affirmer que nous devons consentir un effort de pédagogie pour bien faire comprendre que les aires marines protégées n’interdisent pas toute activité. La constitution de ces zones ne s’inscrit nullement dans un tel esprit : l’activité de pêche, en particulier, y a toute sa place dès lors qu’elle est durable. Je tiens à le dire, car je m’entends souvent opposer que créer des aires marines protégées aboutirait à une « mise sous cloche ». Ce n’est pas de cela qu’il s’agit, au contraire ! Si tel était le cas, nous n’aurions aucune chance de développer les aires marines protégées en France.
La construction du réseau d’aires marines protégées, qui doit être l’une des pierres angulaires de la politique nationale de protection de la biodiversité marine, répond à deux objectifs.
Il s’agit, en premier lieu, d’établir des zones Natura 2000 en mer. Aujourd’hui, une centaine de sites sont en cours de notification auprès des autorités communautaires. Ils ont été choisis sur la base de considérations purement scientifiques, conformément aux préconisations de la Commission.
Il s’agit, en second lieu, de créer, d’ici à 2012, dix parcs naturels marins. Un premier parc, celui d’Iroise, existe d’ores et déjà, quatre autres verront bientôt le jour : ceux de la côte de Vermeille, de la baie de Somme, de Gironde-Pertuis-Charentais et de Mayotte.
Je prendrai l’exemple du parc naturel marin d’Iroise. Trois des dix orientations retenues pour l’élaboration du plan de gestion de ce territoire concernent les activités de pêche. Adoptées à la demande des structures professionnelles bretonnes, elles concernent le soutien au développement durable de la pêche côtière, l’exploitation durable des ressources halieutiques et l’exploitation durable des champs d’algues.
La création des parcs naturels marins s’inscrit donc bien dans une logique de concertation et de contractualisation.
En ce qui concerne les sites Natura 2000, nous sommes également sortis du « tout-réglementaire ». Natura 2000 obéit aujourd’hui à une logique contractuelle : on installe des comités de pilotage qui élaborent des documents d’objectifs. Les acteurs locaux édictent leurs propres règles de gestion durable de ces zones. Tout n’est plus imposé d’en haut, il me semble important de le souligner.
En conclusion sur ce point, il faudra faire preuve de pédagogie pour convaincre l’ensemble de nos partenaires, notamment les professionnels, que les aires marines protégées permettront aussi de préserver les ressources.
Parmi les objectifs du sommet mondial du développement durable figuraient le développement d’un réseau d’aires marines protégées d’ici à 2012 et la reconstitution générale des stocks à l’horizon de 2015.
Atteindrons-nous ce second objectif en 2015 ? J’avoue avoir encore quelques doutes à ce sujet – en 2010, nous serons d’ailleurs amenés, hélas, à constater que la dégradation de la biodiversité n’aura pas été enrayée.
Cela étant, nous sommes vraiment à un tournant : l’ensemble de nos partenaires internationaux se rendent compte que la situation actuelle n’est pas soutenable à terme et, au sein de l’Europe, on perçoit une évolution des attitudes.
En France, Michel Barnier et moi-même voulons sortir du coup par coup pour promouvoir une vraie politique structurelle. Notre objectif est de réconcilier la pêche, l’écologie et la science, notamment dans le cadre des aires marines protégées, et de redonner toute leur place aux pêcheurs, dans une logique de responsabilité et de responsabilisation.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

M. le président du Sénat a reçu de M. Éric Doligé, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le développement économique des outre-mer.
Le rapport sera imprimé sous le n° 379 et distribué.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 6 mai 2009, à quatorze heures trente :
1. Proposition de loi relative au transfert du contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile, présentée par M. François-Noël Buffet (n° 263, 2008-2009).
Rapport de M. Jean-René Lecerf, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale (n° 329, 2008-2009).
Texte de la commission (n° 330, 2008-2009).
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour le développement économique des outre-mer.
Rapport de M. Éric Doligé, rapporteur pour le Sénat (n° 379, 2008-2009).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures vingt-cinq.