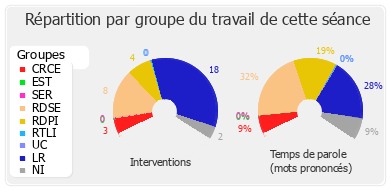Séance en hémicycle du 15 octobre 2012 à 22h45
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt-deux heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures quarante.

La séance est reprise.

L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires (proposition n° 576 [2011-2012], texte de la commission n° 11, rapport n° 10) (demande du groupe RDSE).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Françoise Laborde, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en juin 2011, le Parlement avait eu à débattre de la révision des lois de bioéthique. L'un des points fondamentaux du texte qui nous était alors soumis concernait la recherche sur les cellules souches embryonnaires : fallait-il l'autoriser ou continuer de l'interdire ? Le débat est récurrent depuis les premières lois de bioéthique.
En 1994, le législateur avait édicté un principe d'interdiction absolue, estimant que de semblables recherches portaient atteinte à une personne humaine potentielle. En 2004, il avait maintenu ce principe d'interdiction, tout en en atténuant la rigueur. Des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires pouvaient être menées à titre exceptionnel pour une durée de cinq ans sur les embryons surnuméraires, à deux conditions : d'une part, elles devaient permettre des progrès thérapeutiques majeurs et, d'autre part, elles ne pouvaient pas être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable. En d'autres termes, la recherche était interdite sauf dans les cas dérogatoires où elle était autorisée !
En juin 2011, lorsque nous avons eu à débattre de la question, nous étions assez nombreux dans cet hémicycle à souhaiter passer d'un régime d'interdiction avec dérogations à un régime d'autorisation encadrée.
Au demeurant, je tiens à saluer le courage du rapporteur Alain Milon, qui, à l'époque, a défendu cette position avec force. Il s'agissait avant tout de mettre fin à une certaine hypocrisie. Au terme d'une longue discussion, le Sénat a malheureusement capitulé en deuxième lecture.

Au nom de quoi ? Au nom d'une conception philosophique ou religieuse du statut de l'embryon.
Ceux qui prônent l'interdiction estiment que l'embryon est un être en devenir, et qu'à ce titre la recherche sur les cellules souches embryonnaires porte atteinte à la dignité humaine. Toutefois, dans ce cas, il fallait interdire complètement ces recherches : pourquoi les avoir assorties de dérogations ? Il y a là une logique qui m'échappe !
Par ailleurs, si l'embryon est une personne humaine potentielle, la seule potentialité ne suffit pas à constituer une personne humaine. Comme le rappelle notre collègue Gilbert Barbier dans son rapport, « [le] potentiel de vie [de l'embryon] n'existe pas en soi […] [Il] dépend de la nature et du projet du couple qui l'a conçu ou pour lequel il a été conçu. »
Qui plus est, les embryons concernés par la recherche sont conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation et ne font plus l'objet d'un projet parental. Autrement dit, ils seront détruits.
À l'époque, on nous a également objecté qu'il existait une solution alternative plus respectueuse de l'embryon : les cellules souches pluripotentes induites, les IPS, découvertes par le professeur Yamanaka, qui vient d'ailleurs de recevoir le prix Nobel de médecine. Ces cellules souches sont obtenues à partir de cellules adultes génétiquement reprogrammées pour se comporter comme une cellule souche embryonnaire. Si ces travaux ont indéniablement constitué une extraordinaire avancée scientifique, il est encore nécessaire de travailler en parallèle sur ces deux types de cellules, qui sont complémentaires.
En 2004, le manque de recul dont nous disposions pouvait expliquer le choix d'un régime d'interdiction avec dérogation. À l'époque, c'était surtout le moyen pour le législateur de surmonter un dilemme moral.
En revanche, je ne comprends pas la position choisie il y a un peu plus d'un an, d'autant que la disposition adoptée est bien plus restrictive que celle de 2004.

Ainsi, la nouvelle rédaction de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique prévoit que les chercheurs doivent expressément apporter la preuve qu'il leur est impossible de parvenir autrement au résultat escompté.
En d'autres termes, les scientifiques devront explorer toutes les hypothèses alternatives, même les moins vraisemblables, pour obtenir une autorisation. Ce nouveau dispositif est particulièrement ambigu et, surtout, impossible à mettre en œuvre. §
Nous avons cautionné l'immobilisme souhaité par le gouvernement d'alors : ignorant les propositions suggérées par la plupart des instances consultatives et les chercheurs eux-mêmes, nous avons opté pour une révision a minima. Nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux !
Pourtant depuis quelques années déjà, de nombreux rapports nous invitaient à modifier la législation pour faciliter le progrès de la science et de la médecine, tout en garantissant le respect des principes éthiques fondamentaux.
Ainsi, dans son bilan de l'application des lois de bioéthique remis au ministre chargé de la santé en octobre 2008, l'Agence de la biomédecine craignait que le régime d'interdiction ne bloque des projets fondamentaux permettant des avancées thérapeutiques et préconisait un régime d'autorisation pérenne.
Dans son rapport sur la révision des lois de bioéthique de mai 2009, le Conseil d'État proposait également de substituer au régime actuel d'interdiction assorti de dérogation, un régime permanent d'autorisation encadré par des conditions strictes.
C'est également la position de l'Académie nationale de médecine, qui estime depuis très longtemps qu'il serait inadéquat et même dangereux qu'une interdiction de principe soit maintenue au nom d'un antagonisme entre recherche et protection de la vie.
Plus récemment, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPECST, a rappelé qu'un tel régime était nuisible à la recherche en France et qu'il stigmatisait les chercheurs. Il a largement plaidé pour la levée du moratoire et la suppression de l'interdiction au profit d'un régime d'autorisation encadrée, plus adapté à la réalité scientifique et tout aussi protecteur de l'embryon.
Pourquoi avoir refusé de prendre en compte les avis de ces différentes instances ?
Le maintien d'un régime d'interdiction fragilise la position de la France au sein de la communauté internationale. Notre législation est, en effet, l'une des plus restrictives au monde. Elle handicape sérieusement les scientifiques et décourage les investisseurs étrangers. Pendant ce temps, dans plusieurs pays européens, aux États-Unis, au Japon, en Israël, au Canada, en Australie, la recherche progresse à grands pas. Face à cette concurrence, nous prenons beaucoup de retard et le risque est grand de ne jamais le rattraper.
Pourtant, sur le plan scientifique, il ne fait guère de doute que les recherches sur les cellules souches embryonnaires sont porteuses de grands espoirs. Ces cellules, dites « pluripotentes » proviennent de l'embryon humain au tout premier stade de son développement. Elles peuvent se répliquer indéfiniment et se différencier en plusieurs types de tissus. Au cours du développement, elles ont vocation à former tous les tissus de l'organisme. Contrairement aux cellules souches adultes, dont l'efficacité s'est révélée limitée, le potentiel thérapeutique des cellules souches embryonnaires est immense.
Un des enjeux majeurs de ces cellules est la thérapie cellulaire, que l'on appelle aussi médecine régénératrice. Cette perspective consiste à remplacer des cellules endommagées du fait d'une maladie ou d'un accident. Elle pourrait intervenir dans le traitement des grands brûlés, des leucémies ou des maladies génétiques et neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Il n'est pas exclu, à terme, que ces cellules puissent un jour se substituer à certaines greffes d'organes.
Les cellules souches embryonnaires devraient également permettre aux chercheurs de connaître des progrès majeurs dans la connaissance et le traitement des maladies génétiques et révolutionner la toxicologie prédictive.
La recherche doit progresser et faciliter le développement de nouvelles thérapeutiques. Nous ne devons pas empêcher les équipes scientifiques et les malades de mettre leurs espoirs dans cette voie nouvelle de la science. Ils ont déjà perdu beaucoup de temps et attendent un signal fort.
C'est l'objectif que cherche à atteindre notre proposition de loi. Nous voulons mettre un terme à l'insécurité juridique et à l'ambiguïté de la loi de 2011, fondée sur une décision absurde, et offrir une meilleure lisibilité de notre législation dans l'intérêt de tous. Je me félicite à ce titre de la position du Président de la République et de celle de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le sujet.
En matière de recherche sur l'embryon, on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est là le sens même du mot « éthique ». C'est pourquoi la nouvelle rédaction que nous vous proposons pour l'article L. 2151-5 du code de la santé publique substitue au régime actuel d'interdiction assorti de dérogations, un régime d'autorisation particulièrement encadré. Pour être autorisées, les recherches devront remplir quatre conditions sans lesquelles il ne sera pas possible de mener de recherche. Je rappelle d'ailleurs qu'à partir du moment où d'autres recherches offriront des capacités similaires à celles que présentent des cellules souches embryonnaires, la recherche sur celles-ci sera interdite.
Je tiens enfin à saluer l'excellent travail de notre rapporteur Gilbert Barbier, que je remercie pour les améliorations qu'il a apportées.
Le texte que nous vous proposons d'adopter n'est en aucun cas la remise en cause de la dignité humaine. Il s'agit avant tout de donner à nos scientifiques la possibilité de faire progresser la recherche médicale et de sauver des vies. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, il y a une semaine, le prix Nobel de médecine a été attribué à John Gurdon et à Shinya Yamanaka qui, à quarante-cinq ans de distance, ont démontré, d'abord chez l'animal puis chez l'homme, qu'il est possible de faire régresser des cellules adultes jusqu'au stade de la pluripotence.

L'importance de cette découverte scientifique majeure, aujourd'hui consacrée par l'Académie Nobel, n'a échappé ni aux scientifiques, ni à l'opinion publique. Depuis la publication des travaux du professeur Yamanaka en 2006, plusieurs équipes se sont lancées dans les recherches sur les cellules souches pluripotentes induites, les IPS. On entend souvent que ces recherches rendraient caduques celles qui sont menées sur les cellules souches embryonnaires humaines car ces IPS et les cellules embryonnaires auraient les mêmes caractéristiques. Les scientifiques que j'ai auditionnés me disent que pour l'instant tel n'est pas le cas.

Peut-être se trompent-ils, mais si demain l'équivalence est possible, alors la recherche à partir de cellules souches embryonnaires humaines ne sera plus autorisée en France. C'est expressément ce que prévoit la proposition de loi que nous examinons ce soir.
Cette proposition de loi modifie le texte de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique qui a fait, vous vous en souvenez tous sans doute, l'objet de débats approfondis dans cet hémicycle, débats intenses et parfois passionnés entre partisans de l'autorisation de ces recherches et tenants de leur interdiction. Dans un contexte préélectoral qui n'a pas été sans peser sur ses choix
M. Jacques Mézard opine.

La commission des affaires sociales, saisie au fond, avait pour sa part suivi les conclusions de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, du Conseil d'État et du rapporteur du projet de loi, Alain Milon. La commission s'était engagée résolument, et de manière transpartisane, dans la voie de l'autorisation encadrée des recherches.
Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que ce choix était le bon et nous proposent d'adopter un texte issu des travaux de l'Office parlementaire et très largement similaire à celui que nous avions adopté en première et, de nouveau, en deuxième lecture du projet de loi relatif à la bioéthique.
La commission des affaires sociales a examiné ce texte tant du point de vue éthique que du point de vue juridique. Je note qu'un an après ce texte la mobilisation des chercheurs et de ceux qui s'opposent aux recherches sur l'embryon n'a pas faibli. La question éthique s'analyse sous deux aspects : faut-il interdire par principe la recherche sur l'embryon ? Un régime d'autorisation encadrée est-il la voie ouverte à toutes les dérives ?
La nécessité d'un « interdit symbolique fort » a été souvent invoquée pour justifier le maintien de dispositions contradictoires au sein de l'article L. 2151-5. Le groupe de travail du Conseil d'État, que présidait notre collègue Philippe Bas, avait étudié cet interdit avant de l'écarter. En effet, l'interdiction de principe de la recherche sur l'embryon n'est pas une garantie éthique pertinente et ce n'est pas elle qui offre la meilleure protection contre les dérives potentielles de la science.
Pourquoi interdire la recherche sur l'embryon ? Parce qu'il est une vie humaine potentielle. Toutefois, ce potentiel de vie n'existe pas en soi, comme l'a rappelé Françoise Laborde. Il dépend de la nature et du projet du couple qui l'a conçu ou pour lequel il a été conçu. S'agissant des embryons conçus dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, qui sont les seuls visés par l'article L. 2151-5, les embryons dont un couple peut faire don à la recherche sont ceux qui sont voués à la destruction. En effet, soit ils ne sont pas implantables en raison d'un problème affectant leur qualité, soit ils sont porteurs d'une anomalie détectée à la suite d'un diagnostic préimplantatoire, soit, enfin, ils ne font plus l'objet d'un projet parental et, à moins d'être donnés à un autre couple, l'article L. 2141-4 du code de la santé publique prévoit qu'ils doivent être détruits au bout de cinq ans de conservation.

Il s'agit de faire de la recherche sur des embryons dont la vocation est la destruction.
L'alternative entre destruction et recherche à des fins de progrès de la médecine est la seule ouverte pour décider du devenir de ces embryons. Il me semble que la possibilité pour les parents de faire don d'un embryon sain ou porteur d'un défaut ou d'une pathologie pour l'amélioration du bien-être collectif plutôt que de le laisser simplement détruire est un choix éthique de la part de ce couple. Le texte de la proposition de loi prévoit la nécessité de confirmer le don après un délai de réflexion pour le don des embryons sains et, dans tous les cas, la possibilité de révoquer le don sans motif tant que les recherches n'ont pas commencé.
Plusieurs de nos collègues ont pourtant soutenu que la destruction était de toute façon préférable afin de limiter la tentation démiurgique de l'homme qui souhaite « créer la vie » et la modeler selon ses désirs. Il s'agit, bien sûr, d'éviter les dérives de la science ; cet objectif, nous le partageons tous et il est garanti par le texte de la proposition de loi.
En effet, le régime d'autorisation encadré n'est nullement un droit pour toute équipe de recherche de mener sans contrôle des expériences sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires. Les équipes de pointe qui élaborent des protocoles de recherche nécessitant l'étude de ces embryons ou de ces cellules doivent déposer une demande auprès de l'Agence de la biomédecine et obtenir le droit de mener leurs expériences. Tel n'est pas le cas pour les recherches sur les cellules souches dites « adultes » qui se trouvent dans les tissus humains ou pour les cellules orientées vers un retour aux cellules souches. Les équipes qui les utilisent n'ont de compte à rendre à aucune autorité publique.
Je rappelle que l'autorisation de l'Agence de la biomédecine ne peut être accordée que si quatre conditions cumulatives sont réunies.
Premièrement, le projet doit être scientifiquement pertinent. Le texte prévoit par ailleurs l'interdiction d'implanter à des fins de gestation les embryons sur lesquels une recherche a été effectuée, et je rappelle que la création de chimères ou d'embryons transgéniques est interdite en France.
Deuxièmement, le projet doit avoir une finalité médicale, ce qui exclut notamment les projets à visée purement esthétique.
Troisièmement, le projet ne doit pouvoir être conduit qu'avec des embryons humains ou des cellules souches embryonnaires humaines.
Quatrièmement, enfin, il doit respecter des garanties éthiques, ce qui signifie notamment que l'Agence exerce un contrôle sur la manière dont ont été conçues les lignées de cellules souches embryonnaires, notamment les cellules importées de l'étranger.
De ces quatre conditions cumulatives, la plus contraignante en pratique est la troisième. Elle a pour conséquence que les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires n'auront jamais qu'un caractère subsidiaire.
Je l'ai dit, s'il devient possible, demain, de mener, à partir des cellules souches induites, le même type d'expériences que celles qui peuvent être conduites avec les embryons humains et les cellules souches embryonnaires, ces recherches seront interdites. C'est l'état de la science et l'évaluation par un comité scientifique qui permettent à l'Agence de se prononcer sur cette question chaque fois qu'un protocole lui est soumis.
Cette disposition garantit la « protection adéquate de l'embryon » telle qu'elle est prévue par la convention d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine, que la France a ratifiée.
Les chercheurs que j'ai auditionnés soulignent qu'en pratique les différents types de recherche sont menés en parallèle et que les équipes ne prennent pas le parti de privilégier la recherche sur l'embryon humain. Je pense que nous pouvons accréditer cette assertion, mais cette condition est liée à la nature particulière de l'embryon humain et, interprétée à la lumière du progrès des connaissances scientifiques, il convient de la conserver.
Il me semble néanmoins important de souligner que les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires sont aujourd'hui, et sans doute pour plusieurs années encore, primordiales pour faire progresser les connaissances sur le développement de la vie, comme vient de l'indiquer notre collègue Françoise Laborde, ainsi que pour la modélisation des maladies génétiques.
Comme le soulignent les chercheurs, de nombreuses questions de génétique, mais aussi d'épigénétique, sont posées, qui impliquent, sans solution alternative crédible, le recours aux embryons humains et aux cellules souches embryonnaires qui en sont issus.
L'Agence de la biomédecine ne se fonde pas uniquement sur des avis scientifiques pour prendre ses décisions. Son comité d'orientation, qui réunit des scientifiques et des représentants de la société civile, et au sein duquel siègent désormais quatre sénateurs, dont moi-même, est appelé à se prononcer sur chaque dossier. Les considérations éthiques sont donc présentes pendant l'instruction même du dossier.
Par ailleurs, les avis de l'Agence sont susceptibles de faire l'objet d'un réexamen à la demande conjointe des ministres chargés de la recherche et de la santé.
Enfin, l'Agence reçoit des rapports annuels sur le progrès des recherches et conduit des inspections. Un amendement adopté en commission vise d'ailleurs à renforcer ces pouvoirs d'inspection.
J'en viens aux questions de droit.
Le Gouvernement soutenait à l'époque que l'interdiction de principe assortie de dérogation et l'autorisation encadrée étaient, de ce point de vue, équivalentes. Le juge administratif n'en a pas décidé ainsi.
La cour administrative d'appel de Paris a déduit de l'existence de l'interdiction de principe qu'il appartenait à l'Agence de la biomédecine de faire la preuve que des recherches employant des moyens alternatifs ne pouvaient parvenir au résultat escompté. Elle a, en conséquence, annulé l'autorisation accordée trois ans auparavant à un protocole de recherche.
En cas d'annulation, les scientifiques sont tenus d'arrêter immédiatement leurs travaux sous peine de sanctions pénales. Cinq recours en annulation, dont quatre concernent les travaux d'équipes de l'INSERM, sont actuellement en cours d'instruction par le tribunal administratif de Paris.
L'insécurité juridique à laquelle sont confrontés les chercheurs résulte des ambiguïtés de la loi de 2004, lesquelles ont été accentuées par le texte voté en 2011, qui consacre une ambiguïté morale et juridique.
En effet, l'actuel article L. 2151-5 du code de la santé publique porte la marque de ceux qui, à l'Assemblée nationale, à défaut de pouvoir obtenir l'interdiction des recherches, cherchaient à rendre quasiment impossible leur autorisation à force de conditions en pratique irréalisables : ainsi la nécessité d'établir « explicitement qu'il est impossible de parvenir au résultat escompté » autrement, ou celle d'informer le couple donateur de la nature des recherches projetées.
Il n'y a en réalité que deux possibilités : interdire complètement cette recherche, une position respectable aux yeux de certains, ou l'autoriser de manière encadrée. Dès lors que, en l'état de la science, la recherche sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires est nécessaire, elle doit être autorisée, tout en prenant les précautions indispensables afin de garantir l'absence de dérives.
La commission des affaires sociales, en adoptant la proposition de loi, amendée pour préciser que les recherches fondamentales sont possibles et pour renforcer les pouvoirs de contrôle de l'Agence, a clairement fait le choix de la clarté et de la responsabilité. J'espère que la Haute Assemblée fera de même. §
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, madame la sénatrice Françoise Laborde, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir pour discuter de cette proposition de loi relative à la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines.
Nous sommes aujourd'hui à un tournant important, non seulement pour la recherche et la communauté scientifique, mais aussi pour les patients et l'ensemble des citoyens.
Il nous revient de traiter ce sujet avec le sérieux, la rigueur et toute la probité intellectuelle et morale qu'il mérite. Aussi, permettez-moi, après la présentation de la proposition de loi et de votre rapport, de replacer ce texte dans une perspective historique et scientifique.
J'aborderai tout d'abord le contexte historique.
Les avancées de la recherche dans la seconde moitié du XXe siècle ont rendu possible avec la fécondation in vitro, la FIV, développée dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, l'AMP, pour pallier la stérilité d'un couple, de produire un embryon commençant à se développer, pendant quelques jours, dans un tube à essai, in vitro, en dehors du corps de sa mère, et avant son implantation dans le corps de sa mère.
Cette dissociation, à la fois dans l'espace et dans le temps, allait conduire, en 1978, en Grande-Bretagne, à la naissance de Louise Brown, puis, en 1982, en France, à la naissance d'Amandine. Ce sont les interrogations qui ont suivi ce bouleversement dû aux avancées de l'AMP dans notre pays qui ont conduit, au début de l'année 1983, à la création du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
La deuxième avancée est la capacité « technique » de suspendre le cours du développement in vitro au bout de quelques jours par le processus de congélation, ou cryopréservation, faisant aussi disparaître toute notion de limite de temps a priori entre le moment de la fécondation et le moment du début de la grossesse.
Il existe trois cas où ces embryons créés in vitro par AMP ne seront pas transférés dans le corps de la mère.
Il en sera ainsi lorsqu'une anomalie majeure ou une interruption du développement d'un embryon est manifeste in vitro avant l'implantation. Il en sera également ainsi lorsqu'un embryon se révèle porteur, au cours du diagnostic préimplantatoire, le DPI, de la séquence génétique dont la recherche a motivé la réalisation du DPI.
Dans ces deux cas, l'embryon humain est détruit.
Le troisième cas, très différent, qui conduit à ne pas transférer des embryons créés in vitro est la décision de les conserver par cryopréservation, en vue d'un transfert ultérieur. Toutefois si, ultérieurement, ces embryons cessent d'être inscrits dans le projet parental du couple qui a été à l'origine de leur création, se pose la question de l'arrêt de leur conservation, autrement dit la question de leur destruction.
C'est dans cette situation, c'est-à-dire en cas d'abandon du projet parental ou si le projet ne peut être satisfait pour des raisons médicales liées à l'embryon produit in vitro, que la question de la mise à la disposition de cet embryon pour la recherche est possible. La proposition de loi que nous discutons ce soir s'inscrit totalement dans ce contexte. De plus, la mise à la disposition de l'embryon pour la recherche n'est possible qu'après information du couple et obtention du consentement de celui-ci.
Venons-en au contexte scientifique.
L'embryon humain apparaît tout d'abord sous la forme d'une seule cellule, née de la fusion de deux cellules, un ovocyte et un spermatozoïde. Puis, cette cellule va donner naissance à de nouvelles cellules, et chacune des premières générations de cellules dites « totipotentes », qui constituent l'embryon, vont conserver une capacité, si on les isole de leurs voisines, de donner, à elles seules, naissance à un nouvel embryon. À mesure qu'elles vont donner naissance à de nouvelles cellules, elles vont perdre cette potentialité, et une frontière apparaîtra entre l'embryon en tant que tel et chacune des cellules qui le composent.
C'est en 1998, vingt ans après la naissance de Louise Brown, que sera posée de manière toute nouvelle la question de la possibilité et de l'intérêt scientifique de réaliser des recherches sur des cellules souches issues d'embryons humains qui seraient autrement destinés à être détruits.
Des travaux de recherche indiquaient alors que les cellules souches embryonnaires humaines pouvaient être isolées et cultivées in vitro, se renouveler in vitro, et donner naissance in vitro, en fonction de l'environnement qu'on leur fournit, à la quasi-totalité, voire à la totalité, des plus de deux cents familles différentes de cellules qui composent le corps humain adulte.
Ainsi, de manière schématique, une cellule souche est une cellule dotée à la fois d'une grande capacité de renouvellement d'elle-même et d'une grande plasticité, c'est-à-dire une capacité de donner naissance à des cellules différentes.
Pourquoi alors la question de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires reste-t-elle d'actualité et pourquoi devient-il urgent de passer d'un régime d'interdiction avec dérogation à une disposition d'autorisation encadrée ?
Tout d'abord, la proposition de loi que nous examinons ce soir a pour objet de modifier une disposition de la loi de bioéthique de 2011 et vise à autoriser, sous certaines conditions, la recherche sur l'embryon et les cellules souches.
Cette disposition concerne essentiellement la recherche et ne remet pas en cause la philosophie générale de la loi de bioéthique. Il n'est pas dans l'intention du Gouvernement d'aborder ici de manière plus générale les autres dispositions de la loi précitée, ce qui pourrait justifier un débat public auquel le Gouvernement n'aurait évidemment pas l'intention de s'opposer.
Toutefois, le changement prévu dans cette proposition de loi est significatif quant à ses implications pour la recherche et ses retombées potentielles, sur lesquelles je reviendrai. En ce sens, le Gouvernement souhaite que le débat puisse avoir lieu de manière approfondie, et le temps nécessaire devra y être consacré.
La proposition de loi mentionne la nécessité pour les chercheurs de montrer que la recherche nécessite de recourir à ces cellules souches embryonnaires. Les avancées les plus récentes montrent que nous n'avons pas de réelles alternatives à l'utilisation de ces cellules souches pour faire avancer la science.
Avant de discuter des alternatives potentielles aux cellules souches embryonnaires, j'aimerais ici préciser que les règles habituelles de la recherche scientifique conduisent un chercheur à établir, dans son protocole expérimental, les solutions alternatives qui constitueraient une voie plus efficace et pertinente permettant de parvenir au résultat escompté. L'exposé des motifs, si j'ose décrire ainsi le protocole expérimental, fait partie intégrante de l'analyse de la pertinence scientifique et éthique d'un projet de recherche quel qu'il soit.
Le respect de ces règles est assuré par l'autorité compétente, en l'occurrence l'Agence de la biomédecine, à qui je veux rendre hommage pour le travail difficile et admirable accompli ces dernières années.
Depuis 1998, à plusieurs reprises, des chercheurs ont cru pouvoir trouver une solution alternative aux cellules embryonnaires.
Ce fut d'abord la découverte de cellules souches adultes. Des chercheurs ont rapporté l'existence de ces cellules dans la plupart des tissus de l'organisme : la peau, la moelle osseuse, le foie... Ainsi, nous pouvons disposer de cellules souches sans recourir à des gamètes. Cependant, pour tester leurs propriétés, il a néanmoins fallu les comparer aux cellules embryonnaires, et leur potentiel a ainsi été revu à la baisse. Elles sont pluripotentes, certes, mais leur prolifération réduite et leur différenciation limitée ne leur permettent pas de rivaliser avec les cellules souches embryonnaires.
En 2006 et en 2007, une nouvelle avancée a de nouveau pu laisser croire que la question des cellules souches embryonnaires était dépassée avec la découverte des IPS, les cellules pluripotentes induites.
En réalité, – et c'est presque une règle en matière de découvertes scientifiques – ce progrès a soulevé de nouvelles questions éthiques, auxquelles il était plus difficile encore de répondre.
Deux généticiens ont découvert que les cellules spécialisées d'un organisme adulte pouvaient être reprogrammées pour recréer tous les types cellulaires de l'organisme, à l'instar des cellules souches de l'embryon. Cette découverte a valu à Sir John B. Gurdon et à Shinya Yamanaka de se voir attribué, la semaine dernière, le prix Nobel de physiologie et de médecine 2012.
Les IPS pourraient permettre de produire des modèles cellulaires jusqu'alors impossibles à créer pour des maladies génétiques. Elles offrent la possibilité de produire n'importe quelle cellule à partir d'une cellule prélevée sur un patient, ce qui laisse envisager de nombreuses applications en médecine personnalisée, car elles sont proches de la réalité physiologique du patient.
Pour autant, ces cellules IPS nous dispensent-elles de recourir aux cellules souches embryonnaires ?
La première difficulté est purement scientifique : les IPS ne sont pas complètement identiques aux cellules souches embryonnaires. L'expression non contrôlée des modifications génétiques induites dans ces IPS pourrait entraîner des cellules cancéreuses IPS. Ce type de phénomène s'est déjà produit.
La seconde difficulté se situe sur le plan éthique : dans la mesure où les cellules IPS conserveraient la mémoire de leurs tissus d'origine, on conçoit quels problèmes vertigineux se poseraient si certaines d'entre elles, issues de donneurs vivants, étaient utilisées en thérapie humaine, sans parler de leur capacité éventuelle à être clonées.
Ainsi, sur le plan scientifique, nous avons la confirmation que la recherche a besoin de cette fertilité croisée : elle doit reposer sur l'utilisation à la fois des cellules souches embryonnaires, des cellules souches adultes et des cellules IPS.
Pour l'ensemble de ces raisons, les cellules souches embryonnaires demeurent aujourd'hui le standard scientifique de référence.
Par ailleurs, les autres catégories de cellules souches ne permettraient pas les recherches sur l'embryon in toto, c'est-à-dire sur les premiers jours de la formation de l'embryon.
J'évoquerai maintenant la façon dont le contexte législatif a évolué en France et à l'étranger.
Vous connaissez comme moi l'histoire de la législation française dans ce domaine.
En 1994, la loi a interdit totalement la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
En 2004, alors qu'une libéralisation était attendue, l'interdiction a été maintenue, assortie d'un régime dérogatoire d'une durée de cinq ans. Chaque dérogation est obtenue après autorisation de l'Agence de la biomédecine pour des recherches susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs, faute d'une méthode alternative d'efficacité comparable.
En 2011, la révision des lois de bioéthique françaises a maintenu le statu quo décidé en 2004 : interdiction de réaliser des recherches sur l'embryon ou les cellules embryonnaires, tout en permettant à l'Agence de la biomédecine d'accorder des dérogations, qui ne sont toutefois plus assorties d'une durée.
Comme vous le savez, de nombreux pays ont, au contraire, autorisé la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines : c'est notamment le cas des États-Unis, du Canada, de l'Australie, de la Chine, du Japon et de Singapour, ainsi que de la majorité des pays européens comme le Royaume-Uni, l'Espagne et la Suède. L'Allemagne constitue l'une des exceptions notables.
Dans ce contexte législatif, les équipes françaises ont cependant fait la preuve de leur sérieux et de leur exigence, sur le plan éthique comme sur le plan scientifique.
En effet, sur les projets de recherche présentés depuis la loi du 6 août 2004, seuls quatre ont été rejetés par l'Agence de la biomédecine, qui en a autorisé soixante-quatre à ce jour.
La plupart des recherches autorisées depuis 2004 ont fait l'objet de publications, parfois dans des revues scientifiques aussi prestigieuses que Nature, le Journal of Clinical Investigation ou Molecular and Cellular Biology.
Deux projets français touchent à l'horizon des protocoles d'essais cliniques : l'un porte sur l'insuffisance cardiaque, grâce à la production de cellules musculaires du cœur, les cardiomyocytes ; l'autre, sur les ulcères de peau chroniques, grâce à la production de cellules de peau à partir de cellules souches embryonnaires. Cela démontre le continuum de la recherche la plus fondamentale jusqu'au lit du malade. Je prendrai à titre d'exemple le cas de l'essai clinique sur le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'équipe en est venue à utiliser des cellules souches embryonnaires après l'échec démontré de l'utilisation des cellules souches adultes et dix ans d'expérimentations.
La recherche se poursuit donc en France, mais son potentiel est évidemment freiné, en matière de structuration interne et de coopération internationale.
Les restrictions apportées par la loi en 2004 comme en 2011 ont, de toute évidence, freiné les échanges de savoir et la coopération scientifique internationale au détriment de notre pays.
Aujourd'hui, la France occupe seulement la huitième place en Europe et la quinzième dans le monde en matière de publications. C'est le résultat de sept années de retard par rapport à la concurrence : sept années sans formation de chercheurs et sans financement de travaux, alors que la Grande-Bretagne en est à son quatrième plan de développement.
Dès lors, devons-nous demeurer isolés dans notre position ? Pouvons-nous nous contenter d'être spectateurs des progrès de nos partenaires ?
Nous sommes une puissance scientifique motrice en Europe, dans bien des domaines. Le Président de la République a souhaité que l'enseignement supérieur et la recherche soient des leviers décisifs dans le redressement de notre pays et dans la mise en place d'une compétitivité guidée par la qualité. Nous avons un rôle à jouer dans la construction d'une Europe de la recherche.
Or, depuis le sixième programme cadre de recherche et de développement technologique de l'Union européenne, la Commission européenne ne nous a pas attendus pour se mettre en ordre de marche, en soutenant les projets de recherche sur les cellules souches, qu'elles soient adultes, embryonnaires, fœtales ou IPS.
Elle s'est fixé pour objectif de soutenir les actions et les initiatives qui contribueront à la coordination et à la rationalisation des lignées de cellules souches embryonnaires humaines en Europe.
Elle a aussi créé un « répertoire banque » de cellules souches embryonnaires pour optimiser l'exploitation des lignées existantes et faire en sorte qu'il soit moins utile d'en dériver de nouvelles par destruction d'embryons.
Elle a, de surcroît, élaboré un code de bonne conduite fondé sur des principes éthiques, pour définir très strictement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas.
La France doit-elle demeurer en retrait ? Notre position est peu lisible à l'étranger alors que la coopération internationale est essentielle dans ce domaine. Nos chercheurs doivent pouvoir collaborer avec nos partenaires étrangers pour profiter de l'expérience de pays plus avancés et bénéficier d'un effet de levier.
Après huit années de pratique de la recherche et soixante-quatre autorisations délivrées, notre position d'interdiction de principe assortie de dérogations, qui est isolée, est-elle encore justifiée ?
La recherche sur les cellules souches et l'embryon est une question très précise à laquelle nous devons apporter des réponses mûrement réfléchies ; elle engage, plus généralement, notre vision de la place de la science dans la société.
Pour ma part, c'est après une profonde réflexion que je me suis forgé une opinion sur cette proposition de loi : j'ai interrogé les associations de malades et les chercheurs, vérifié son applicabilité en liaison avec l'Agence de la biomédecine et discuté des aspects éthiques avec des membres du Comité consultatif national d'éthique.
Je suis parvenue à la conclusion que la proposition de loi présentée par le groupe RDSE permet, en clarifiant le régime juridique de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, de concilier l'éthique et la liberté de la recherche.
Nous devons, bien entendu, examiner nous-mêmes les enjeux éthiques, avec toute la vigilance nécessaire : c'est l'objet du débat de ce soir, que nous devons nourrir de nos réflexions respectives.
Par ailleurs, les auteurs de la proposition de loi ont su, tout au long de son élaboration, tenir compte de la réalité de la recherche, de ses contraintes, de ses objectifs, de sa démarche, de son rythme et de ses exigences : mesdames, messieurs les sénateurs, votre compréhension de ces enjeux donne un sens à vos propositions.
Cette proposition de loi nous paraît aller dans le bon sens en fixant un certain nombre de principes destinés à régir la recherche sur l'embryon.
D'abord, vous avez apporté une attention particulière à la nécessité de clarifier l'objectif de la recherche autorisée, qui doit s'inscrire dans une finalité médicale.
Vous avez également eu le souci de redonner à la recherche fondamentale toute sa place, puisque la finalité médicale peut être poursuivie par la recherche fondamentale ou par la recherche appliquée.
Les progrès de la connaissance, que l'on pourrait considérer comme la véritable finalité de la recherche, et la possibilité d'essayer de développer des applications éventuellement bénéfiques, que l'on pourrait considérer comme l'une de ses utilités, se déploient dans des espaces temporels différents.
Il est prioritaire d'essayer de développer les applications utiles, quand elles deviennent possibles ; mais il est illusoire et dangereux de penser que les applications futures ne viendront pas d'un mouvement de fond d'exploration de l'inconnu et de remise en cause permanente de nos concepts, qui est l'essence même de la recherche.
Ensuite, la recherche ne peut être menée que sur des embryons ne faisant plus l'objet d'un projet parental et le couple qui fait don des embryons à la recherche doit être informé et donner son accord.
En outre, un encadrement des règles assurant la pertinence scientifique et le respect des règles éthiques doit être assuré par une agence ayant la capacité de diligenter à tout moment un contrôle de l'avancée de la recherche et des équipes qui la mènent.
Enfin, la proposition de loi prévoit que les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation.
La proposition de loi fait référence, dans son alinéa 4, à des principes supérieurs à ceux-là : les principes fondamentaux du code civil que sont la non-rémunération, le respect du corps humain et la traçabilité des lignées de cellules souches garantissant l'information du respect des règles éthiques.
J'ajoute que la proposition de loi ne revient pas sur les règles de transfert : le transfert est permis uniquement entre des laboratoires ayant une autorisation d'effectuer des recherches sur les cellules souches embryonnaires. Elle ne revient pas non plus sur la nécessité d'obtenir des autorisations respectives pour l'importation des cellules souches, la conservation de celles-ci et la recherche.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la proposition de loi soumise à votre examen permet de modifier plusieurs dispositions de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique, qui placent les chercheurs et les institutions dans une hypocrisie qu'il convient de lever.
Il faut passer d'une recherche interdite par principe et nécessitant une dérogation à une recherche autorisée, mais contrôlée.
En supprimant le principe de l'interdiction, vous adresseriez un signe fort à la communauté scientifique, sur le plan de la liberté académique, mais aussi aux malades et à la société.
En outre, la loi du 7 juillet 2011 impose une sorte d'obligation de résultat au chercheur pour que celui-ci soit autorisé à commencer ses travaux : elle prévoit en effet que « la recherche est susceptible de permettre des progrès médicaux majeurs ».
Or aucun chercheur ne peut ainsi s'engager sur l'avenir. Serge Haroche, notre tout récent prix Nobel de physique, va peut-être permettre à la France de produire les premiers ordinateurs quantiques ; mais il ne l'aurait jamais promis en engageant ses recherches fondamentales sur les atomes de Rydberg et, aujourd'hui encore, il se garderait bien de faire une telle promesse.
II était scientifiquement illusoire, et par conséquent intellectuellement malhonnête, d'une certaine façon, de laisser croire à des progrès thérapeutiques majeurs lorsqu'une recherche située bien en amont recevait une autorisation.
Si donc la finalité médicale doit être mise en avant, la garantie de progrès thérapeutiques majeurs reste difficile à apporter a priori.
Mesdames, messieurs les sénateurs, les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires suscitent d'immenses espoirs chez des patients atteints de pathologies graves ; nous n'avons pas le droit de susciter de faux espoirs.
Cette proposition de loi a le mérite de renforcer les décisions de l'Agence de la biomédecine, d'améliorer la qualité juridique de la législation, d'afficher une position claire de la France dans ce domaine, de replacer la recherche française dans le réseau international des chercheurs et de placer les chercheurs dans une position juridique moins inconfortable.
Il est maintenant fondamental qu'un débat puisse avoir lieu.
Mme Geneviève Fioraso, ministre. Le sujet est suffisamment important et sensible pour que nous lui consacrions un temps approprié !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et au banc des commissions. –M. Guy Fischer applaudit également.

Mme Muguette Dini. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, comme beaucoup d'entre vous, je déplore – c'est un euphémisme – que cette proposition de loi soit examinée un lundi à vingt-deux heures quarante-cinq…
Applaudissements sur les travées de l'UCR et sur plusieurs travées de l'UMP. – Mme Patricia Schillinger applaudit également.

Tous ceux qui étaient présents dans cet hémicycle en juillet 2011, lors de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique, savent avec quelle gravité et avec quel sérieux la question de la recherche sur l'embryon avait été débattue.
Seulement, pour débattre gravement et sérieusement, il faut du temps. Nous n'en aurons pas assez ce soir.

Nos collègues du groupe RDSE le savent, mais ils ont préféré prendre ce risque plutôt que de ne rien faire, ce dont je les remercie malgré tout.
En effet, je considère que la confusion dans laquelle nous traitons ce sujet ne peut plus durer.
Je commencerai par quelques brefs rappels historiques.
En 1994, la première loi de bioéthique a interdit la recherche sur l'embryon.
En 2004, la deuxième loi de bioéthique a maintenu cette interdiction tout en autorisant des dérogations accordées par l'Agence de la biomédecine.
En 2011, cette interdiction a été maintenue et la dérogation, de plus, soumise à l'accord des parents donneurs.
Autant dire qu'on a essayé de revenir à l'interdiction absolue et, par conséquent, d'empêcher toute recherche sur l'embryon en France.

Entre 2004 et 2012, pourtant, comme Mme la ministre l'a rappelé, soixante-quatre protocoles de recherche sur l'embryon ont été autorisés par l'Agence de la biomédecine et mis en œuvre.
Aujourd'hui, on nous propose d'autoriser la recherche sur l'embryon en l'encadrant très strictement.
Quelle différence cela ferait-il par rapport au fait qu'actuellement, en France, des recherches sont menées sur l'embryon ? Aucune.
Quelle différence cela ferait-il sur les protocoles de recherche ? Une grande différence.
En effet, si les protocoles de recherche ne seraient pas automatiquement autorisés plus facilement par l'Agence de la biomédecine, les délais d'obtention de l'autorisation seraient considérablement raccourcis et les chercheurs français pourraient enfin travailler dans les mêmes conditions que les autres chercheurs, en particulier européens. §

Pourquoi ce sujet est-il aussi sensible ? Bien sûr, parce qu'il touche à l'humain et à la question toujours posée : un embryon est-il un être humain dès sa conception ?
La réponse à cette question est totalement personnelle ; elle dépend, pour chacun de nous, de ses conceptions éthiques, religieuses, philosophiques.
Les embryons sur lesquels les recherches sont conduites se définissent comme des « amas de seize cellules indifférenciées ayant au maximum cinq jours d'existence ».
Une autre question se pose : d'où viennent ces embryons ? La réponse, simple, mérite d'être une nouvelle fois rappelée : la recherche se pratique sur quelques embryons non réimplantés dans le cadre des procréations médicalement assistées.
Actuellement, en France, 160 000 embryons surnuméraires ne font plus l'objet d'un projet parental et ne seront pas réimplantés.
Au bout de cinq ans, on demande aux parents biologiques de décider du sort de leurs embryons. Ils ont le choix entre une nouvelle implantation, le don d'embryons à un ou des couples stériles, la destruction ou le don à la recherche.
Cela a été dit, ce sont donc des embryons destinés de toute façon à la destruction qui seront utilisés pour la recherche.
Il vaut mieux, d'ailleurs, ne pas savoir comment sont détruits les embryons abandonnés par les parents. L'une de nos collègues ayant eu recours à la PMA pour la naissance de ses enfants a été horrifiée quand elle a constaté que ses embryons avaient été, au bout de cinq ans, sortis du cryocongélateur, posés sur un coin de paillasse en attendant la décongélation et jetés dans l'évacuation de l'évier du laboratoire.
La recherche sur l'embryon est-elle nécessaire ?
Oui, car les recherches sur les cellules pluripotentes ne permettent pas encore d'apporter toutes les réponses aux questions médicales concernant le développement de la vie et les modélisations des maladies génétiques.
Je peux comprendre, et je respecte, nos collègues et concitoyens qui considèrent qu'on ne peut pas toucher à la vie humaine, même à son stade le plus élémentaire, celui de l'embryon.
C'est d'ailleurs la position de nombreux membres de mon groupe. Mais si l'on suit leur logique, il faut interdire de nouveau totalement la recherche sur l'embryon. Cessons donc l'hypocrisie et la supercherie qui consistent à dire : oui, la recherche sur l'embryon est interdite en France, mais des chercheurs sont tout de même autorisés à la mener.

Pour ma part, je souhaite que les choses soient claires : autorisons la recherche en étant d'une extrême vigilance sur les conditions de sa mise en œuvre, comme le prévoit le texte qui nous est soumis ce soir.
Le résultat sera le même, mais le dispositif aura le bénéfice de la clarté et permettra à nos chercheurs de travailler enfin à armes égales avec leurs collègues étrangers sur des sujets aussi douloureux et urgents que les maladies génétiques et les maladies rares.

Mme Muguette Dini. Comme je vous l'ai dit, certains collègues de mon groupe voteront cette proposition de loi. Ceux qui s'opposeront à ce texte s'exprimeront soit avant l'examen de son article unique, soit au moment des explications de vote sur l'ensemble.
Applaudissements sur certaines travées de l'UCR et du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste. – Mme Catherine Deroche et MM. Alain Milon, René-Paul Savary et Guy Fischer applaudissent également.

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est présentée ce soir relance un débat, particulièrement sensible, que nous avons déjà eu à plusieurs reprises dans cet hémicycle.
Le Sénat a voté à plusieurs reprises en faveur d'une modification des lois sur la bioéthique pour autoriser, avec encadrement, les recherches sur l'embryon et les cellules embryonnaires humaines.
De quoi s'agit-il quand on parle de recherches sur des embryons humains ? D'embryons surnuméraires issus de fécondations in vitro mais n'entrant pas dans un projet parental. Les recherches sont réalisées après consentement des parents, dûment informés de la procédure. De quoi s'agit-il quand on parle de recherches sur des cellules souches embryonnaires humaines ? De cellules issues d'un embryon non destiné à un projet parental, à un stade de développement très peu avancé. Levons ainsi toute ambigüité : on ne crée pas des embryons exprès ; on n'attente à la vie de personne.
Les conditions actuelles de la législation permettent-elles de mener à bien les recherches ?

La réponse est clairement « non ». Le fait que cette question soit débattue de manière récurrente témoigne de nos atermoiements : plutôt que de trancher positivement, on en arrive à la situation actuelle, qui est bancale, incompréhensible et illisible, pour ne pas dire ridicule.
Pourquoi vouloir travailler sur des embryons ou des cellules souches embryonnaires humaines ? Pour certaines recherches à finalité thérapeutique, les cellules souches adultes disposent d'un potentiel limité, leur degré de différenciation étant trop important.
Surtout, les embryons sont un support de la recherche fondamentale. Il est heureux que la révision de 2011 ait permis la recherche à finalité médicale, c'est-à-dire la recherche fondamentale, laquelle, justement, ne possède pas de finalité économique au moment du lancement des travaux. Par essence, la recherche fondamentale n'a ni finalités ni applications immédiates. Elle vise à mieux comprendre le fonctionnement de tel organe, tissu ou cellule. Les finalités, les bénéfices éventuels sont souvent insoupçonnés au démarrage du projet de recherche, soit parce qu'on envisageait éventuellement autre chose, soit parce que, parallèlement, d'autres avancées scientifiques et/ou industrielles ont permis de voir une finalité à des recherches qui n'étaient pas destinées à cela. Comme le dit François Jacob, « on mesure l'importance d'une découverte au degré de surprise qu'elle cause. »
À ce propos, je souligne que, pour se garder de dérives mercantilistes, il conviendrait sans doute de circonscrire la recherche sur embryon à la recherche fondamentale.
Quoi qu'il en soit, dans notre cas, la recherche sur l'embryon a permis de développer trois types de recherche : celles qui visent à comprendre la manière dont les cellules embryonnaires se transforment pour se spécialiser, celles qui ont pour objet de comprendre les mécanismes de survenue des maladies et celles qui tendent à tester l'efficacité ou la toxicité de certains médicaments.
Dans le même temps, le texte adopté en 2011 a maintenu l'interdiction de la recherche sur l'embryon, en l'assortissant de dérogations et a cadenassé les possibilités d'accéder à ces dernières, en adossant à la demande de recherche la contrainte dite de non-comparabilité : il s'agit de démontrer qu'il n'existe aucune alternative de recherche. Or il est très difficile financièrement et techniquement de conduire des études préalables sur toutes les populations cellulaires alternatives dans le seul but d'obtenir un résultat négatif justifiant secondairement une demande de dérogation pour des recherches sur des cellules souches embryonnaires.
Outre la difficulté pratique de démontrer une telle assertion, cette exigence méconnaît les fondements même de la recherche fondamentale. Bref, on ouvre une porte d'un côté pour la refermer de l'autre, si bien que, dans la pratique, le dispositif est tout simplement inopérant.
De fait, la procédure d'obtention de la dérogation est un parcours du combattant en elle-même. Comme vous le savez, c'est l'Agence de la biomédecine qui est chargée d'étudier les demandes. Elle décide pour chaque année civile des périodes de dépôt des demandes et doit donner une réponse dans les quatre mois suivant sa clôture. La compatibilité de cette procédure avec celle des demandes de financement par l'équipe scientifique peut soulever certaines interrogations, d'autant que les organismes sollicités peuvent être « refroidis » par l'absence d'assurance concernant l'obtention de la dérogation. Entre une équipe qui peut faire les recherches et une équipe qui peut peut-être faire les recherches, entre un projet dont on est sûr qu'il pourra se réaliser et un projet suspendu à une procédure potentiellement remise en cause, le choix paraît vite fait.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'on nous soutient, l'interdiction avec dérogation n'est pas équivalant à l'autorisation encadrée : il existe en effet une différence juridique dans la mise en œuvre du processus. Ainsi, avec une interdiction de principe, il revient à l'Agence de la biomédecine, qui délivre les dérogations, d'établir la preuve qu'aucune méthode alternative ne pourrait permettre d'aboutir au résultat escompté. Toutefois ce principe « en l'état actuel de la science » est diversement apprécié, et des personnes ou organisations défavorables aux recherches ont tôt fait d'attaquer l'Agence à propos des dérogations qu'elle a accordées. Faute de pouvoir faire la démonstration attendue, l'Agence a dû ainsi annuler certaines autorisations.
Tout cela ne donne pas confiance à nos partenaires et n'aide pas nos scientifiques à rattraper les retards accumulés.
Les retards sur les travaux ont entraîné des retards sur les acquis, la formation, les compétences, la constitution d'équipes opérationnelles, la crédibilité vis-à-vis de partenaires scientifiques et/ou financiers, ainsi que sur la prise de responsabilité – la France en est à sa première génération de responsables, alors que les États-Unis en sont à leur troisième. On est entré dans un cercle vicieux : seule la décision d'autoriser, avec encadrement, les recherches nous permettra d'en sortir.
C'est pourquoi les sénateurs et sénatrices écologistes, fidèles à la position qu'ils avaient adoptée lors des précédents débats qui se sont tenus au Sénat sur ce sujet, voteront cette proposition de loi. §

Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je suis heureux de pouvoir à nouveau débattre d'un sujet ô combien important pour la recherche, même si je déplore que le jour et l'heure de la séance qui y est consacrée ne permettent pas à bon nombre de mes collègues de participer au débat.
Je tiens à le souligner, je m'exprime en mon nom personnel, ce qui, vous en conviendrez, est tout à fait légitime sur des sujets qui engagent la conscience de chacun.
Je constate, pour m'en réjouir, que le groupe RDSE a repris la quasi-totalité des dispositions que j'avais proposées, en 2011, au moment de l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique.

À mon grand regret, ce texte n'avait pas passé le cap de la séance publique, le Sénat ayant voté conforme, en deuxième lecture, la rédaction issue de l'Assemblée nationale, qui prévoyait l'interdiction de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, interdiction assortie de dérogations permanentes. C'était prendre à la légère le rôle du législateur, et je n'ai pas changé d'avis sur ce point depuis l'année dernière.

L'un des enjeux fondamentaux de la révision, en 2011, des lois de bioéthique était la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires.
Je l'avais affirmé lors de nos débats, le texte adopté à l'époque était, j'en suis d'ailleurs toujours convaincu, en régression par rapport à la loi de 2004.
À mon sens, il cumulait nombre de travers reprochés aux lois contemporaines : ambiguïtés juridiques, dispositions incantatoires et conditions impossibles à remplir.
La révision de 2011 a, de fait, mis l'accent sur trois contraintes, qui ont donné des armes à certains ennemis déclarés de la recherche. Il s'agit de la « pertinence scientifique », de « l'intérêt médical majeur » et, enfin, de la « non-comparabilité ».

La pertinence scientifique paraît, à première vue, tout à fait indispensable et je suis, comme d'autres de mes collègues, le premier à la réclamer dans tous les travaux scientifiques. Malheureusement, cette contrainte possède un côté pervers, qui vient de faire perdre plus de neuf mois à l'un de nos programmes majeurs concernant l'autisme.
Nombre de scientifiques français souhaitaient aborder ce programme au travers de formes familiales détectées chez à peu près 1 % des patients, ce qui représente, vous en conviendrez, mes chers collègues, un nombre non négligeable, l'autisme touchant, selon les épidémiologistes, 1 % des enfants. Plusieurs gènes ont été directement associés à ces formes familiales, notamment par des chercheurs de l'Institut Pasteur. Une demande de dérogation a été rejetée dans un premier temps, « parce que l'autisme n'est pas considéré comme une maladie monogénique », ce qui est une véritable bêtise scientifique, que beaucoup contestent.
L'intérêt médical majeur a heureusement remplacé, en 2011, l'intérêt thérapeutique majeur, mais demeure un levier efficace pour ceux qui souhaitent bloquer la recherche sur l'embryon. Cela a été le cas l'an dernier pour un programme portant sur des cellules présentant une mutation du gène APC. Les patients porteurs de cette mutation déclenchent des cancers digestifs, mais aussi d'autres atteintes plus subtiles. Parmi celles-ci, les scientifiques s'étaient intéressés aux mécanismes d'une prolifération anormale de cellules rétiniennes car cela permettait de rechercher des étapes précoces des dysfonctionnements associés à la mutation, ce que bien évidemment ne permettent pas les études réalisées sur les cellules cancéreuses, dans lesquelles les désordres sont trop importants. Le conseil d'orientation de l'Agence de la biomédecine a refusé d'accorder une dérogation, considérant qu'il n'y avait pas d'« intérêt médical majeur », les études ne s'intéressant pas directement à ce qui tue les patients. Pour l'instant, ce programme est donc mis de côté…
La non-comparabilité, c'est-à-dire l'obligation qui est faite de démontrer qu'il n'existe pas d'alternative à l'utilisation des cellules souches embryonnaires, est un peu l'arme ultime contre les recherches. Il est évidemment impossible, financièrement et techniquement, de conduire des études préalables sur toutes les populations cellulaires alternatives dans le seul but d'obtenir un résultat négatif justifiant secondairement une demande de dérogation pour des cellules souches embryonnaires.
Ainsi, le texte de 2011 contredisait, en outre, la position de l'Académie de médecine. Comme celle-ci le rappelait dans son rapport du 22 juin 2010, « l'interdiction de principe de toute recherche sur l'embryon ne peut être justifiée par la protection d'embryons qui n'ont pas d'autre avenir que l'arrêt de leur vie ».
De façon plus générale, il allait à l'encontre des fondements communs à toute démarche scientifique. En effet, dans le cadre d'une démarche scientifique, les chercheurs apprennent par l'expérience et par l'échec. Il me semble faux de prétendre qu'un type particulier de cellules souches offre aujourd'hui des perspectives supérieures aux autres pour la recherche. Si cela était vrai, il faudrait interdire toutes les recherches, à l'exclusion de celles sur les cellules souches pluripotentes induites. Pour mémoire, il s'agit des cellules souches adultes, de type OGM.
D'ailleurs, dans une publication en date du 31 mars 2011, voici ce qu'écrivait le professeur Marc Peschanski :
« Il est, en parallèle, souvent compliqué d'interpréter des résultats obtenus à l'aide de cellules génétiquement modifiées qui ne reproduisent que partiellement les caractéristiques physiologiques.
« En tout état de cause, les difficultés associées à la diversité induite par le désordre épigénétique dans les lignées IPS nous obligent à les utiliser avec beaucoup plus de prudence et de contrôles que les lignées embryonnaires.
« Les cellules souches embryonnaires humaines se caractérisent par deux propriétés physiologiques qui permettent de surmonter ces obstacles. Elles sont capables à la fois de se diviser à l'infini en laboratoire et, une fois placées dans les conditions requises, de se spécialiser dans tous les types cellulaires de l'organisme. Elles donnent ainsi accès à des cellules parfaitement physiologiques, dans la quantité voulue, quelle qu'elle soit, et dans le type voulu, quel qu'il soit. L'intérêt de ces cellules est renforcé par l'accès ouvert par le diagnostic préimplantatoire à des cellules souches embryonnaires humaines porteuses d'une lésion du génome responsable de maladies génétiques. »
En 2011, au cours des débats, j'ai régulièrement entendu dire, pour justifier l'interdiction avec dérogations, que l'interdiction de principe était en continuité avec la loi de bioéthique de 2004.
Or je rappelle que l'interdiction de principe mise en place en 2004 avait été assortie de dérogations temporaires, alors qu'en 2011 nous avons acté un principe général d'interdiction, assorti de dérogations permanentes.
Ce faisant, nous avons prétendu concilier deux principes incompatibles. À mon sens, cela revient à refuser de trancher et à ne pas assumer ses choix. §
Les raisons essentielles pour lesquelles j'étais opposé au texte adopté par le Parlement sont toujours valables, mes chers collègues : inscrire que les recherches alternatives aux recherches sur l'embryon doivent être promues et que les parents doivent être informés de l'utilisation des embryons donnés à la science relève de l'idéologie, non du droit ; mettre en place un tel régime d'interdiction avec des dérogations particulièrement ambiguës et renoncer à établir des règles simples et compréhensibles par tous revenait à nous dessaisir de notre mission de dire le droit et à déléguer cette lourde tâche à l'Agence de la biomédecine, dont la mission n'est pourtant pas de découvrir notre intention cachée derrière les contradictions et les demi-mots.
Par ailleurs, il aurait été infiniment préférable de faire œuvre de pédagogie et d'expliquer en quoi consistent les recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur l'embryon. Nous savons que ces recherches ne peuvent être effectuées que jusqu'à cinq jours après la fécondation. Si nous l'expliquions aux Français, ils seraient certainement mieux disposés envers ces recherches.

Pour dire les choses encore plus clairement, j'estime que la loi élude les questions que les Français se posent.

Elle n'est qu'un rideau de fumée permettant de cacher à l'opinion l'absence de position claire du Parlement sur ces questions.
Je réaffirme que c'est l'encadrement de l'autorisation qui permettra de préserver la dignité humaine dès le début de la vie, bien plus que le régime hybride, confus et incohérent que nous avons mis en place.
Je respecte infiniment ceux qui ont défendu une interdiction totale : cela avait le mérite de lever toute ambiguïté.

Si l'une des conditions n'est pas remplie, la recherche n'est pas autorisée.
Mes chers collègues, je terminerai mon propos en affirmant que je crains les régimes où la loi dicte la vérité scientifique, mais je craindrais bien évidemment tout autant les régimes où la science dicterait le droit, même si je n'en connais pas, du moins pas encore. C'est exactement le propos que j'avais tenu à l'un de mes collègues de la majorité d'alors.
Pour toutes ces raisons, vous l'avez compris, je voterai des deux mains cette proposition de loi présentée par notre collègue Gilbert Barbier.
Applaudissements sur plusieurs travées de l'UMP et sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – MM. Pierre Jarlier et Guy Fischer applaudissent également.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, c'est avec conviction que le groupe socialiste s'associe à la proposition de loi de nos collègues Jacques Mézard et Françoise Laborde.
Je remercie à cette occasion Gilbert Barbier pour son rapport, qui correspond exactement à ce que nous attendions. Ce n'est pas tous les jours, mon cher Gilbert, que l'occasion m'est donnée de vous féliciter.
Sourires.

L'article concernant la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires a été le plus discuté de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
En première lecture, au Sénat, un texte consensuel, sous la conduite courageuse d'Alain Milon, fut dégagé. Il levait l'hypocrisie de l'interdiction de principe de la recherche sur l'embryon en France. Cette décision, de courte durée, fut saluée par l'ensemble de la communauté scientifique.
Malheureusement, dès sa deuxième lecture au Parlement, le conservatisme l'avait emporté, aussi bien sur cet article que sur le reste du projet.

M. Charles Revet . Allons, monsieur Fischer… Le rétrograde, c'est là-bas !
M. Charles Revet pointe du doigt les travées du groupe CRC.

Pis, certains ajouts de l'Assemblée nationale ont rendu encore plus difficile le travail des chercheurs en ce domaine.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui reprend le contenu amendé de l'article 23 du projet de loi relatif à la bioéthique adopté en première lecture au Sénat. Il est proposé, dans un article unique, de remplacer le dispositif juridique actuel d'interdiction, assortie de dérogations, par celui de recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires dans un régime « d'autorisation encadrée ».
En cela, ce dispositif renoue en fin de compte avec la philosophie de l'article 19 du projet de loi relatif à la bioéthique défendue à l'époque, en 2001, par le gouvernement de Lionel Jospin, qui légalisait l'étude scientifique sur l'embryon.
Il est regrettable que nous ayons perdu entre-temps onze ans. L'enjeu n'est pas mince. Du point de vue du droit, la majorité précédente soutenait avec force que l'interdiction de principe assortie de dérogations et l'autorisation encadrée étaient, de ce point de vue, équivalentes.
Nous disions alors que tel ne serait pas le cas et l'actualité judiciaire nous a donné raison. Puisque Gilbert Barbier a évoqué cet aspect des choses, je n'entrerai pas dans le détail des décisions rendues ou à rendre par la justice administrative, notamment la cour administrative d'appel de Paris. Ces recours ont placé les chercheurs dans une insécurité juridique.
Nous avons donc l'obligation de réagir maintenant en votant cette proposition de loi. Sur ce sujet, notre position a toujours été constante et cohérente : nous sommes partisans de l'autorisation encadrée de la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. Celles-ci intéressent scientifiques et médecins parce qu'elles sont capables de proliférer indéfiniment et de donner naissance à n'importe quelle cellule spécialisée de l'organisme. C'est pour cette raison qu'on les qualifie de totipotentes.
Ces cellules sont ainsi les meilleurs outils de la « médecine régénératrice » dans la lutte contre les maladies dégénératives.
En dépit des craintes qu'elles peuvent susciter, les perspectives de la recherche sur l'embryon humain demeurent aujourd'hui, pour l'essentiel, du domaine de la terra incognita.
On peut toutefois observer que, dans les pays où des travaux sur les cellules souches embryonnaires sont depuis quelques années déjà autorisés, les programmes engagés ont conduit à des résultats très prometteurs.
J'en veux pour preuve le procédé du « bébé double espoir » – l'espoir d'être indemne d'une maladie génétique familiale et l'espoir de guérir par une greffe de cellules souches contenues dans le sang du cordon de l'un de ses frères ou sœurs malades.
En 2000, la naissance, aux États-Unis, d'Adam, dont les cellules souches de la moelle avaient permis de sauver sa sœur, Molly, âgée de six ans et atteinte de la maladie de Fanconi, représentait un formidable espoir pour soigner des enfants atteints de pathologies incurables. Or il a fallu six ans pour que cette technique soit partiellement autorisée par l'Agence de la biomédecine dans notre pays, onze ans pour que la France « accouche » en 2011 d'un bébé conçu par ce procédé, bébé prénommé Umut.
Le professeur René Frydman déclarait d'ailleurs que s'il avait été alors soumis aux contraintes qui sont apparues par la suite, il n'aurait jamais pu donner naissance à Amandine, en 1982.
Alors, nous disent les opposants, d'autres techniques existent, comme celles qui sont basées sur les cellules souches pluripotentes, les IPS – Induced pluripotent stem cells –, fabriquées à partir de tissus génétiques adultes. Comme cela a été dit, leur découvreur, le professeur Shinya Yamanaka, a reçu le prix Nobel de médecine la semaine dernière.
Néanmoins, ce qu'oublient souvent de dire les partisans intéressés des IPS, c'est que les succès récents ont été rendus uniquement possibles par les connaissances accumulées dans le cadre de la recherche sur les cellules d'origine embryonnaire. Même les chercheurs travaillant sur les IPS nous le disent. Et pour cause, nous disposons de trente et un ans de retour d'expérience sur les cellules souches, de six ans seulement pour les IPS.
Les scientifiques s'accordent tous pour nous rappeler l'insuffisance du recul nécessaire pour évaluer les effets des IPS, la faiblesse de leur rendement et leur coût faramineux.
C'est d'ailleurs pourquoi les laboratoires scientifiques partout dans le monde ont centré leur activité de recherche prioritairement sur les cellules souches embryonnaires.
Dès lors, la seule question de bon sens qui doit être présente à notre esprit sur ce texte est la suivante : nos chercheurs ont-ils aujourd'hui la possibilité de lutter à armes égales dans le domaine des biotechnologies médicales ou devrons-nous nous contenter de payer dès à présent, pour notre santé, des royalties aux industries américaines, japonaises ou autres ? La réponse a trop tardé.
L'histoire de la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines est, en France, marquée par le combat que mènent contre elle les lobbies antisciences. Opposés à toute atteinte à ce qu'ils considèrent comme un être humain dès la fécondation, ils se sont successivement dressés contre le droit des femmes à l'avortement, la procréation médicalement assistée, puis les tests de dépistage génétique, avant de s'attaquer aux cellules souches.
Adoptées sous leur pression, les lois de bioéthique de 1994, 2004 et 2011 ont exclu la France de l'élan scientifique international autour des cellules souches embryonnaires. Notre pays était pourtant dans le trio de tête mondial de la recherche jusqu'au début des années 90.
Aujourd'hui, le poids de l'idéologie rétrograde et la frilosité des pouvoirs publics ont abouti à l'immobilisme dans notre pays. Nous sommes obnubilés par le statut de l'embryon ; c'est un tabou, et, comme vous le savez, derrière ce mot se cachent souvent l'idéologie et l'hypocrisie – cela a été démontré par plusieurs orateurs qui m'ont précédé à cette tribune.
On a ainsi créé une situation ubuesque dans laquelle la recherche sur l'embryon est interdite... sauf dans les cas dérogatoires où elle est autorisée ; et encore, lorsque les chercheurs respectent des conditions préalables quasiment impossibles à remplir.
Le vote de ce texte va libérer la recherche dans notre pays et donner aux chercheurs, à nos concitoyens un autre espoir pour demain. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'examen par notre assemblée de la révision des lois de bioéthique s'éclaire du prix Nobel de médecine qui apporte des perspectives au sujet dont nous débattons ce soir.
Avec mes collègues du groupe CRC, je m'étais opposé au projet défendu par l'ancien gouvernement, à savoir le maintien d'un principe d'interdiction de la recherche embryonnaire, assorti d'éventuelles dérogations.
Avec d'autres, au-delà des rangs de la gauche – je pense notamment à notre rapporteur d'alors, Alain Milon, qui très courageusement avait porté un texte honorant la position de la commission des affaires sociales –, nous avions soutenu le principe d'une autorisation encadrée de la recherche, une voie qui, faut-il le rappeler, était retenue à la fois par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et par le Conseil d'État.
Ayant soutenu cette démarche au sein de notre commission et en séance publique, vous comprendrez naturellement qu'aujourd'hui, comme il l'a fait voilà un an, le groupe CRC vote en faveur de cette proposition de loi. Nous sommes constants dans nos positions.

Ce vote, mes chers collègues, repose sur les deux principes fondamentaux et incontournables de ce qui deviendra, je l'espère, le nouveau régime légal : une recherche autorisée mais encadrée.
Le basculement d'un régime d'interdiction avec dérogations vers un régime d'autorisation encadrée met fin, cela a déjà été affirmé avec force par Mme la ministre et M. le rapporteur au sein de la commission placée sous l'autorité de Mme la présidente Annie David, à une situation absurde, inefficace et hypocrite.
Nous le savons tous, et les scientifiques que nous avons auditionnés en 2011 en ont témoigné, dans les faits, toutes les demandes de recherches qui ne soulevaient pas de problèmes éthiques et visaient une finalité thérapeutique étaient, à titre dérogatoire, autorisées.
Certains invoquent d'ailleurs cet argument comme prétexte pour ne pas basculer vers un régime d'autorisation encadrée. Or, nous le savons, cette position a fait perdre du temps aux scientifiques français et a rendu leur pratique plus complexe. Mais elle est aussi hypocrite et, d'une certaine manière, jette sur les scientifiques conduisant des recherches sur l'embryon une suspicion permanente. Si cette proposition de loi est adoptée, cette suspicion n'aura plus de raison d'exister, car les critères requis pour une autorisation sont tout aussi importants et contraignants que les critères existants.

Cela est bien normal lorsqu'on mesure l'importance de ces recherches sur l'avenir de la santé humaine et ce sur quoi elles portent.
Toutes les conditions sont réunies pour que, demain, aucun scientifique ne puisse se comporter comme un apprenti sorcier.
Je pense notamment, en disant cela, à la règle selon laquelle aucune recherche ne pourra être menée si celle-ci n'est pas pertinente et n'a pas de finalité médicale. Les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, parce qu'elles portent en quelque sorte sur les prémices de la vie humaine, ne doivent avoir qu'un objectif, faire en sorte que les conclusions auxquelles elles aboutissent profitent à l'humanité tout entière, en apportant des réponses à des patients qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucun traitement efficace. Je fais d'ailleurs toute confiance à l'Agence de la biomédecine.
Je pense également à la disposition qui prévoit que la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires doit être non pas une finalité en soit, mais une possibilité offerte à la science à un moment donné. Si, demain, des recherches identiques peuvent être menées sur d'autres modèles, notamment des animaux, alors cette recherche sera privilégiée à la recherche embryonnaire.
J'en viens enfin à une autre condition, qui me paraît être la plus fondamentale, celle de la limitation de la recherche aux seuls embryons surnuméraires et ne faisant plus l'objet d'un projet parental. Beaucoup l'ont déjà dit, à l'instar du généticien Axel Kahn, l'embryon est une potentialité de vie. Certains voient en lui la vie, quand j'y vois pour ma part ses prémices, une possibilité. Bien que ne partageant pas l'avis de mes collègues, je le respecte. D'ailleurs, nous pouvons tous convenir ici, malgré nos différences, que, compte tenu de la singularité de l'embryon, il faut le respecter.
Toutefois ce respect ne doit pas conduire à exclure la recherche. En effet, si le fait de conserver congelé un embryon surnuméraire pendant plusieurs semaines, voire des années, ne lui retire pas sa potentialité biologique de devenir un être humain, il faut encore, pour qu'il le devienne, qu'il fasse l'objet d'un projet parental, c'est-à-dire qu'un couple décide de faire en conscience d'une matière possiblement humaine un enfant. Or les recherches dont il est question ici porteront seulement sur des embryons qui ne font pas l'objet d'un projet parental, c'est-à-dire qui sont voués tôt ou tard à perdre toute potentialité humaine.
Mes chers collègues, cette proposition de loi me semble équilibrée : elle est le garant d'avancées scientifiques tout en maintenant un cadre éthique de nature à protéger les convictions de chacun. Elle pose le principe d'un régime d'autorisation qui, j'en suis convaincu à la lecture du dispositif juridique prévu, contient les conditions suffisantes pour éviter les errements redoutés par certains.
Ce texte permet également, et je sais que, au-delà de nos différences, nous y sommes tous particulièrement attachés, d'empêcher la marchandisation de l'embryon. La loi réaffirme le principe de l'interdiction de la fabrication d'embryons qui n'auraient pas initialement de finalité humaine. Seuls les embryons surnuméraires pourront être utilisés. Il sera donc interdit de fabriquer des embryons comme on fabrique des tissus humains ou des amas de cellules, précisément afin que l'embryon ne soit pas réduit à une structure « chosifiable ».
À cet égard, et parce nous, les membres du groupe CRC partageons pleinement la position de Lucien Sève, philosophe et ancien membre du Comité consultatif national d'éthique, qui affirmait : « La façon de traiter [l'embryon] engage […] inexorablement la façon de traiter l'humanité », nous considérons que, compte tenu des conditions et garanties qui sont posées dans cette proposition de loi, les conditions sont réunies pour permettre le développement d'une recherche profitable aux hommes et respectueuse de l'humanité. Aussi, nous voterons le présent texte. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, moi non plus, je ne me déjugerai pas par rapport au vote que j'ai émis voilà un an. En abordant ce texte, qui est essentiel, au sens étymologique du terme, je voudrais insister sur deux remarques préalables.
Première remarque : je m'étonne de cette sorte de « bougeotte » législative sur un sujet aussi grave, …

… pour lequel nous nous sommes certes opposés, mais toujours avec beaucoup de respect. Je suis heureux de voir ce soir dans quel état d'esprit sont les uns et les autres. Toutefois, honnêtement, mes chers collègues, le texte que nous avons voté voilà un an avait donné lieu à une préparation très sérieuse en termes de forums, de publications, d'auditions. Les débats au Sénat avaient été longs et parfois vifs, mais de très grande qualité. Pourquoi, tout juste un an après le vote de cette loi, sur un sujet qui mériterait un peu de constance – il n'en va pas ainsi de tous les textes – faut-il remettre l'ouvrage sur le métier, nuitamment et « à la sauvette » ?

De ce point de vue, vous en conviendrez, nous aurions pu examiner ce texte dans de meilleures conditions.
Mes chers collègues, je regrette cette instabilité juridique. Combien de fois avons-nous déploré dans cet hémicycle le trop grand nombre de lois et de règlements et, pis, leurs modifications incessantes ? J'estime, comme d'autres l'ont assuré avant moi, que trop de lois tuent la loi, et que toute forme d'instabilité normative est néfaste pour l'esprit public. Portalis, dont la statue est représentée dans cet hémicycle, rappelait qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante.
Seconde remarque : l'article 46 de la loi du 8 juillet 2011 dispose que toute réforme de ce texte – ce sera l'objet de la motion tendant à opposer la question préalable et qui sera présentée par mon collègue Dominique de Legge – doit, lorsqu'elle a une portée éthique, ce qui en l'occurrence est évidemment le cas, donner lieu à un débat public.

La loi précise même la forme du débat public puisqu'elle dispose qu'il s'agit d'un débat public « sous forme d'états généraux ».
Or non seulement il n'y a pas eu de débat public, mais notre discussion de ce soir est un moignon de débat, à la sauvette, en catimini, ce qui ne peut nous satisfaire. Quelle autorité peut avoir la loi si nous-mêmes ne respectons pas la lettre de la loi que nous avons votée voilà un an ?

C'est un point qu'il conviendrait de méditer
J'en viens au fond de la question, pour formuler trois objections.
Ma première objection est d'ordre général. Si j'ai bien lu l'exposé des motifs de la proposition de loi, nous sommes convoqués ce soir parce que les scientifiques s'impatientent. J'ai ainsi entendu les uns et les autres dirent que la communauté scientifique nous demandait de légiférer. Ce n'est pas ainsi que le Sénat fonctionne !
Existe-t-il, d'ailleurs, une seule communauté scientifique ?
J'ai relevé, comme vous avez aussi pu le faire, mes chers collègues, que la communauté scientifique n'était pas unanime sur ces dispositions. Un certain nombre de professeurs ont émis des avis différents. Par ailleurs, le Sénat n'est pas la chambre d'enregistrement de dispositions que telle ou telle communauté, fût-elle extrêmement experte, lui demanderait de voter.
Je pense, bien entendu, que la science est un facteur extraordinaire de progrès, ce dont nous devons nous féliciter, mais aussi qu'elle ne doit pas conduire à une forme d'emballement et à la mise en place d'une grande machinerie. Le siècle qui nous sépare d'Auguste Comte nous a montré que même les scientifiques les plus éminents doivent se soumettre à des conditions d'ordre éthique, sans lesquelles le progrès et la science ne peuvent pas servir les intérêts de l'humanité et de l'humanisme.
Ma deuxième objection, me semble-t-il plus importante, est quant à elle d'ordre pratique. On nous a dit jusqu'à présent qu'il n'existait pas de véritable alternative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Or, comme plusieurs d'entre vous l'ont indiqué à cette tribune, il se trouve, extraordinaire coïncidence, ...

... que le prix Nobel de physiologie et de médecine 2012 a été attribué, lundi 8 octobre, voilà exactement huit jours, conjointement à deux chercheurs, dont le professeur japonais Shinya Yamanaka, pour leurs découvertes sur les cellules souches adultes pluripotentes reprogrammées.
Dire que ces découvertes n'ont rien donné concrètement sur le plan médical est faux. Comme nous l'avait très bien expliqué notre ancienne collègue Marie-Thérèse Hermange l'an dernier, ici même, elles ont au contraire permis de modéliser une douzaine de pathologies.
Axel Kahn, auditionné il y a un an à l'Assemblée nationale, ...

... dans le cadre de la préparation du présent texte, avait indiqué qu'il s'agissait sans doute de l'une des méthodes les plus prometteuses pour l'avenir de la médecine régénérative, et concluait : « Aucune recherche sur l'embryon n'est donc nécessaire dans cette perspective ».
Ce débat n'est pas aussi simple, sur le plan scientifique, que l'on veut bien nous le dire. On veut en réalité nous inciter à franchir une limite anthropologique, alors qu'il existe d'autres solutions, d'ailleurs indiquées dans la proposition de loi. Ce texte prévoit d'ailleurs un régime non d'interdiction totale, mais d'interdiction avec dérogations.
D'autres pistes sont parfaitement valables, comme la reprogrammation des cellules souches adultes humaines, découverte par le professeur Yamanaka. On peut aussi citer, madame la ministre, car cela n'a pas fait jusqu'à présent, l'utilisation des cellules issues du sang de cordon et du sang placentaire.
Ces solutions donnent aussi des résultats puisque plus de 3 000 malades peuvent d'ores et déjà en bénéficier. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'elles ne posent aucun problème d'ordre éthique.
Ma troisième objection est d'ordre éthique.
Comme l'a dit Jean Desessard, et je le rejoins sur ce point, passer d'un régime d'interdiction avec dérogations à un régime d'autorisation encadrée, ce n'est pas du tout la même chose !

Il s'agit même d'une inversion complète, d'autant plus radicale qu'aucune nécessité scientifique absolue ne vient la justifier.
Comme l'ont dit d'autres intervenants, la question sous-jacente à notre débat est la suivante : quand devient-on un être humain ?
Il n'y a pas d'accord entre nous, que ce soit sur les différentes travées de cet hémicycle ou au sein même de nos familles politiques respectives, sur le moment précis où l'on franchit le seuil de la vie et de l'humanité. Mme Muguette Dini a eu parfaitement raison d'indiquer que cette question ne pouvait être tranchée qu'en conscience, selon notre conviction personnelle. Ne peut-il y avoir, pour autant, de consensus sur ce sujet ? Pour ma part, je pense que c'est possible.
Il existe d'ores et déjà une convergence de jurisprudences et de textes. Permettez-moi de citer, par exemple, la définition de l'embryon donnée par le Comité consultatif national d'éthique : « une personne humaine potentielle », ...

... ce qui signifie que chaque étape de son développement est contenue dans l'étape précédente, ce qui implique l'idée d'un continuum au sein duquel il serait bien malaisé d'intégrer des ruptures.

Par ailleurs, la convention internationale d'Oviedo sur les droits de l'homme et la biomédecine a posé le principe de la protection adéquate dont doivent bénéficier les embryons en matière de recherche.
Voilà tout juste un an, le 18 octobre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a spécifiquement exclu toute brevetabilité des techniques de recherche lorsqu'elles ont eu pour préalable la destruction de l'embryon.
Nous voyons bien que les choses ne sont pas simples. Une partie de la jurisprudence nous conduit finalement à poser cette question-ci : l'embryon doit-il être respecté ?
Nous pourrions trouver, de façon ultime, un consensus ou un accord, en décidant qu'en l'absence de certitudes – car il ne saurait y en avoir en la matière ! –, nous devons nous abriter derrière le doute.

Permettez-moi, à l'instar des orateurs précédents qui ont cité certains philosophes, de rappeler ces mots d'Alain : « Le doute n'est pas au-dessous du savoir, mais au-dessus ».
Mes chers collègues, le doute ne constitue-t-il pas, en l'occurrence, une raison suffisante de nous abstenir de traiter l'embryon comme un simple matériau de laboratoire ? Je pense, pour ma part, que nous n'avons rien à perdre à laisser la loi telle qu'elle est puisque, comme vous l'avez dit, madame la ministre, la plupart des demandes ont fait l'objet d'un accord de l'Agence de la biomédecine.
Nous n'y perdrons pas ! Je suis en revanche certain que nous y gagnerions beaucoup en nous abstenant de voter ce texte, car nous éviterions de commettre une transgression anthropologique qui ne me paraît absolument pas utile. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, certains nous disent qu'il n'y a pas lieu de légiférer sur le sujet de l'embryon et que les recherches sur les cellules souches embryonnaires n'ont plus d'utilité.
Autoriser ces recherches ne serait plus d'actualité au prétexte qu'un chercheur japonais, le professeur Yamanaka, prix Nobel de médecine 2012, a découvert une alternative à l'utilisation des cellules souches provenant des embryons.
Selon ce chercheur, les cellules souches spécialisées pourraient être reprogrammées, c'est-à-dire transformées en cellules souches non spécialisées pour devenir pluripotentes. Elles seraient donc dotées de la capacité de se différencier en plusieurs types de cellules.
Les résultats de cette recherche sont à l'évidence très prometteurs. Cependant, les scientifiques sont aujourd'hui unanimes pour dire qu'ils sont dans le doute : ils ne peuvent garantir que les cellules adultes reprogrammées sont rigoureusement identiques aux cellules souches embryonnaires. Les analyses comparatives entre les deux types de cellules n'ont pas encore permis de conclure au caractère identique de ces deux cellules.
Les chercheurs ont donc encore besoin de travailler sur les cellules souches embryonnaires pour progresser et faire avancer la science dans ce domaine.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2151-5 du code de la santé publique interdit les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, tout en instituant un régime de dérogation. La présente proposition de loi vise à substituer à ce principe d'interdiction avec dérogations, un principe d'autorisation strictement encadrée.
Entre ces deux principes, le fil peut paraître ténu. Il est en fait lourd de conséquences, car c'est au juge administratif qu'il est revenu, au final, de juger de la pertinence des programmes de recherche sur les cellules souches embryonnaires, dès lors que l'Agence de la biomédecine ne pouvait apporter la preuve que des recherches employant des moyens alternatifs ne permettaient pas de parvenir au résultat escompté.
Or comment l'Agence pouvait-elle apporter cette preuve, sinon à considérer que la découverte précède la recherche ?
Ce n'est pas au juge de dire ce que doit être la recherche scientifique, et ce rôle n'appartient pas davantage au législateur. La responsabilité du législateur consiste à exiger que toutes les précautions soient prises, à fixer les limites, à prévenir et, si nécessaire, à pénaliser les dérives. La responsabilité du juge est de garantir le respect de la loi. Ni le législateur ni le juge n'ont vocation à se substituer au chercheur, pas plus qu'ils n'ont à se prononcer pour établir ce qui est une vérité scientifique et ce qui ne l'est pas.
Albert Einstein a écrit : « La personnalité créatrice doit pouvoir penser et juger par elle-même, car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. »
Nous approchons là le fondement même de la recherche. La science n'est jamais figée. Comment concevoir qu'il puisse exister une recherche sans que soit accordée aux chercheurs la liberté de chercher, c'est-à-dire de penser et de créer ? On ne peut trouver que si l'on est libre de chercher.
Le rôle du législateur est de mettre à la disposition des scientifiques le cadre légal, strict mais protecteur, qui leur est nécessaire pour déployer leur recherche, en bénéficiant de cette confiance citoyenne sans laquelle il n'est pas d'avancées scientifiques partagées.
Le devoir du législateur est donc bien d'offrir aux acteurs de la recherche cette liberté dont ils ont besoin pour faire progresser la connaissance et, dans le cas qui nous occupe ce soir, pour inventer les thérapies qui, demain, permettront de faire reculer la maladie.
Il convient en effet toujours de distinguer la science des usages qui peuvent en être faits. Si la science est libre, les usages doivent être réglementés, car deux principes demeurent intangibles : le respect de la dignité humaine et la non-marchandisation du vivant.
Mais le rôle du législateur est aussi de veiller à ce que toutes les précautions soient prises, car il ne serait ni raisonnable ni acceptable d'autoriser des pratiques qui relèveraient plus d'« apprentis sorciers » que de chercheurs scientifiques.
Personne ne conteste que les cellules souches embryonnaires humaines présentent une singularité qui tient à leur nature même. Il ne s'agit pas là d'une matière organique inerte, d'un simple amas cellulaire, mais bien de cellules issues d'embryons humains, conçus lors d'une fécondation in vitro dans le cadre d'une procréation médicale assistée.
Faut-il pour autant considérer que ces embryons et ces cellules souches embryonnaires doivent être dotés d'un statut particulier ? Conviendrait-il de les protéger, dans leur intégrité comme dans leur dignité, à l'instar de toute personne humaine ?
La réponse à ces questions fait débat.
Pour ma part, j'estime que l'on ne peut revendiquer un statut de personne humaine pour un embryon qui ne s'inscrit pas dans un projet parental, ce qui est le cas des embryons surnuméraires, qui, rappelons-le, ont vocation à être détruits, conformément au code de la santé publique. En effet, après cinq ans de congélation, si les parents ont renoncé à leur projet parental, les cellules sont détruites.
N'y aurait-il pas là matière, au-delà des sensibilités philosophiques et religieuses qui peuvent parfois nous différencier, à substituer au concept de « projet parental » qui ferait défaut un concept de « projet sociétal » à visées médicales ou thérapeutiques ?
C'est sur la base de ce consensus qu'il paraît désormais possible d'autoriser, sous conditions, les recherches sur l'embryon humain et les cellules souches embryonnaires humaines, dès lors, bien sûr, que ces recherches s'inscrivent dans une finalité médicale.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. – Mme Muguette Dini applaudit également.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mardi 16 octobre 2012 :
À neuf heures trente :
1. Questions orales.
À quatorze heures trente et le soir :
2. Projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Philippines tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu (Procédure accélérée) (n° 788, 2011-2012) ;
Rapport de Mme Michèle André, fait au nom de la commission des finances (n° 29, 2012 2013) ;
Texte de la commission (n° 30, 2012-2013).
3. Projet de loi relatif à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme (Procédure accélérée) (n° 6, 2012-2013) ;
Rapport de M. Jacques Mézard, fait au nom de la commission des lois (n° 35, 2012-2013) ;
Texte de la commission (n° 36, 2012-2013).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séan ce est levée le mardi 16 octobre 2012, à zéro heure trente.