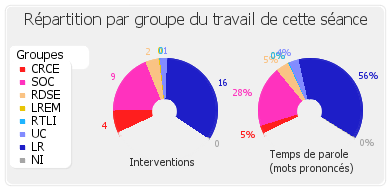Séance en hémicycle du 10 décembre 2014 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire
- Demande de retour à la procédure normale pour l'examen d'un projet de loi
- Communication d'un avis sur un projet de nomination
- Convocation de la conférence des présidents
- Expulsion des squatteurs de domicile (voir le dossier)
- Dépôt d'un rapport du gouvernement (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2015.
En conséquence, les nominations intervenues lors de la séance du 6 décembre prennent effet.

Mes chers collègues, par courrier en date du 9 décembre 2014, M. François Zocchetto, président du groupe UDI-UC, a demandé que le projet de loi autorisant la ratification de l’amendement au protocole de Kyoto du 11 décembre 1997, inscrit à l’ordre du jour du jeudi 18 décembre 2014, soit examiné en séance publique selon la procédure normale, et non selon la procédure simplifiée.
Acte est donné de cette demande.
Dans la discussion générale commune, le temps attribué aux orateurs des groupes politiques pourrait être d’une heure. Le délai limite pour les inscriptions de parole serait fixé au mercredi 17 décembre 2014, à dix-sept heures.
Il n’y a pas d’observation ?...
Il en est ainsi décidé.

Conformément à la loi organique n° 2010-837 et à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, et en application de l’article L. 5312-6 du code du travail, la commission des affaires sociales a émis un vote favorable – vingt-huit voix pour, une voix contre et un bulletin blanc – en faveur de la nomination de M. Jean Bassères aux fonctions de directeur général de Pôle emploi.
Acte est donné de cette communication.

La conférence des présidents se réunira aujourd’hui, à dix-huit heures.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion de la proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile (proposition n° 586 [2013-2014], texte de la commission n° 143, rapport n° 142).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Natacha Bouchart, auteur de proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, si j’ai l’honneur aujourd’hui de prendre la parole à cette tribune en tant qu’auteur de la proposition de loi qui est soumise à l’examen de la Haute Assemblée, c’est parce que j’ai voulu intervenir au plan législatif pour lutter contre une faille juridique que j’avais constatée en ma qualité d’élue locale.
Depuis que j’assume le rôle de premier magistrat de la ville de Calais – 2008 –, je connais les vicissitudes des squats qui se multiplient dans ma ville du fait de la présence des migrants.
Chacun le sait, Calais étant le point de passage le plus court vers la Grande-Bretagne, de très nombreux réfugiés, entrés dans l’espace Schengen à l’autre bout de l’Europe, y échouent dans l’espoir de passer outre-Manche.
Cette présence de réfugiés dans ma ville m’a rendue particulièrement sensible à la problématique des squats. Au-delà de la situation calaisienne, qui m’a amenée à réfléchir, j’ai constaté l’existence d’une faille juridique qui peut créer des difficultés dans toutes les communes de France.
De quoi s’agit-il ? Sur le terrain, nous sommes confrontés à un imbroglio au sein duquel se nouent le droit, le silence du droit, les limites de l’administration et celles de la justice.
De cet imbroglio est né ce que je qualifie d’ « hypocrisie juridique », à savoir le fameux délai de flagrance des quarante-huit heures.
Ce délai n’est inscrit nulle part dans la loi. Pourtant, il est devenu une sorte de loi d’airain à laquelle particuliers et pouvoirs publics sont soumis. On parle même sur le terrain, par abus de langage, de la « loi des quarante-huit heures »... une loi qui n’existe pas, bien entendu, mais qui est appliquée et respectée dans les faits. Comment en est-on arrivé là ?
Lorsqu’un squat se constitue, l’intervention immédiate de la puissance publique est soumise à la notion de flagrance. Rappelons les termes de l’article 226-4 du code pénal : « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Nous devons à notre collègue Catherine Procaccia, sénateur du Val-de-Marne – je la salue –, d’avoir introduit par le biais d’un amendement dans la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO », cette disposition en 2007.
Tant que le délit est flagrant, la force publique peut intervenir. Mais lorsque la notion de flagrance n’est plus applicable, s’installe une période d’incertitudes et de procédures qui peut durer des semaines, des mois, un an, voire plus, et pendant laquelle les squatteurs ne peuvent plus être délogés. Ils sont alors, dans les faits, « chez eux ».
L’usage, et non la loi, a fini par consacrer les « quarante-huit heures » comme un délai incontournable, au-delà duquel l’administration renonce à intervenir, de peur d’être censurée. Certes, l’article 38 de la loi DALO introduit une procédure durant laquelle le préfet peut intervenir sur saisine du propriétaire ou du locataire. Toutefois, il s’agit également d’une procédure susceptible de se prolonger dans le temps, pour deux raisons : tout d’abord, dans les faits, elle est aussi appliquée dans le délai de flagrance des quarante-huit heures, dont l’usage est d’autant plus facilement généralisé qu’il ne repose sur rien de tangible juridiquement ; ensuite, elle reste dépendante des aléas des décisions du juge ou du préfet.
Pendant la trêve hivernale, en particulier, cette disposition se révèle inopérante, notamment depuis que la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », a, en quelque sorte, inversé la logique concernant l’application de cette trêve aux squats. Auparavant, en effet, ces derniers étaient exclus de ce que la loi désigne comme le « bénéfice du sursis », c’est-à-dire la trêve hivernale.
Désormais, la loi dispose que, pendant la période du 1er novembre au 31 mars, « le juge peut supprimer le bénéfice du sursis […] lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. » Cette rédaction permet au juge d’appliquer aux squats la tolérance du sursis, et lui en laisse, en réalité, la libre appréciation.
À cela s’ajoute l’attitude des services de l’État, y compris lorsque la justice a ordonné une expulsion. On constate ainsi dans les faits que le préfet n’intervient pas toujours immédiatement, même lorsque le droit le lui permet, voire lorsque celui-ci l’y oblige !
Cet attentisme surprenant au regard du droit s’explique néanmoins : une fois qu’un squat est peuplé de centaines de personnes, la décision du préfet de l’évacuer ou non se pose alors en termes d’ordre public, d’hygiène, de sécurité, et non plus uniquement du point de vue du droit.
On le constate bien, la notion de flagrance est essentielle pour permettre une intervention rapide de la puissance publique. En dehors d’elle, non seulement la législation complique considérablement les expulsions, mais la situation de terrain, elle aussi, rend beaucoup plus difficiles les évacuations. Encore une fois, ce n’est pas la même chose pour la police, pour le préfet, de faire évacuer un squat de 4 ou 5 personnes, ou un squat de 250, 300 ou 350 personnes.
Le délai de flagrance de quarante-huit heures qui, je le répète, ne correspond à rien dans le droit, se prête à un véritable détournement de l’esprit de la loi.
En effet, derrière la difficulté et la complexité des procédures, il y a évidemment un sens : il convient de faire preuve d’humanité à l’égard des squatteurs. Tout l’arsenal législatif et administratif que je viens d’évoquer n’est pas anodin : il vise, bien entendu, à protéger la propriété et la vie privées, mais aussi, en même temps, à empêcher une application trop brutale de la loi, afin, par exemple, d’éviter que des femmes et des enfants ne soient expulsés du jour au lendemain sans solution de relogement.
L’esprit de la loi est de toute évidence détourné lorsque de véritables « stratégies » sont mises en place pour profiter de ce délai de quarante-huit heures, si court, et pour instrumentaliser les failles de la notion de flagrance.
Sur le terrain, à Calais, nous constatons que des militants du réseau No Borders, lesquels promeuvent l’accueil illégal des migrants, mais aussi les mafias de passeurs organisent, notamment, les intrusions pendant la période des week-ends : effectivement, une occupation illicite commencée un vendredi soir et poursuivie jusqu’au dimanche soir place les squatteurs en situation de ne plus être expulsés immédiatement.
Tenir quarante-huit heures dans un logement est d’ailleurs relativement aisé. Avec des vivres, des recharges de téléphone portable, en sachant être discret, il est assez facile de rester deux jours dans un logement sans se faire remarquer.
Ces manœuvres sont lancées par des organisations extrémistes qui n’agissent pas tant dans l’intérêt des réfugiés que pour des motifs idéologiques, et par des organisations criminelles – ces mafias dont je parlais à l’instant – qui rackettent et rançonnent les migrants, transformant cette activité en un véritable business dans lequel toutes les personnes sont manipulées.
Ce phénomène d’instrumentalisation se produit ailleurs en France, en région parisienne comme en province. Certes, les acteurs sont différents, mais ce sont toujours des personnes mal intentionnées, qui utilisent la faille des quarante-huit heures pour contourner la loi et mettre sous leur coupe des personnes fragiles, SDF ou sans-papiers.
À la problématique des quarante-huit heures s’ajoute un autre enjeu : la saisine par le propriétaire ou le locataire. En effet, pour engager la procédure d’expulsion, obligation est faite que le constat des faits soit demandé par le propriétaire ou le locataire des lieux. On comprend bien l’importance, pour la protection de la propriété privée, de l’intervention de l’occupant en titre.
En pratique, trouver cette personne en quarante-huit heures s’apparente parfois à une mission impossible. La municipalité met évidemment tout en œuvre pour retrouver les occupants légitimes, dès qu’une intrusion illégale est signalée ou détectée. Mais ce délai, surtout un week-end, complique la tâche : comment avoir accès aux données cadastrales lorsque le service municipal est fermé ?
Ce sont ces questions, très terre à terre, qui se posent et les squatteurs le savent pertinemment. Telle est la réalité : nous sommes souvent face à des organisations qui connaissent très bien la loi, le droit et surtout la façon de les utiliser. Voilà pourquoi j’ai voulu, à travers la présente proposition de loi, réagir face à cette situation inacceptable.
C’était tout le sens de l’article 1er de ce texte dans sa rédaction initiale. Porter à quatre-vingt-seize heures le délai permettant d’être en mesure de constater la flagrance résolvait le problème du week-end, qui est par excellence le moment de déploiement des stratégies d’occupation illicite.
C’était en outre un délai qui offrait plus de facilités pour retrouver le propriétaire ou le locataire, voire pour repérer le début de l’occupation illicite.
Enfin, rester quatre-vingt-seize heures, c’est-à-dire quatre jours, dans un logement sans en sortir afin de ne pas éveiller l’attention des voisins était beaucoup plus complexe et beaucoup plus rude que tenir quarante-huit heures.
Cette disposition permettait encore de répondre à une interrogation de nos concitoyens. L’enjeu est de garantir la propriété privée, ouvertement violée par les organisations militantes comme No Borders, par les mafias ou par tout type de squatteurs, et ce partout en France. Les citoyens ne comprennent plus que la loi permette à des squatteurs de « se déclarer chez eux » passé quarante-huit heures. Même si, juridiquement, ce n’est pas le cas, dans les faits, la complexité de l’expulsion est telle que les squatteurs sont installés durablement, comme s’ils étaient chez eux. C’est ce que retiennent nos concitoyens et c’est ce qui les scandalise, à juste titre.
La modification proposée de la loi allait aussi dans le sens d’une meilleure protection du contribuable. En effet, in fine, l’occupation se fait aux frais du contribuable local. À l’issue d’un squat, les occupants légitimes se trouvant parfois dans une situation sociale dégradée, la ville est régulièrement amenée à intervenir pour nettoyer les lieux, en utilisant les moyens publics. Bien sûr, rien n’y oblige, me répondrez-vous. Mais tout élu local le sait bien : face à l’urgence, on ne peut rester les bras croisés ! C’est donc sur les collectivités locales que reposent bien souvent les frais liés à la fin d’un squat.
Le travail du rapporteur, M. Jean-Pierre Vial, a permis de déceler les limites d’un délai de quatre-vingt-seize heures. Je conviens volontiers que la rédaction qu’il a proposée et que la commission des lois a adoptée permet de répondre à nos attentes. Elle a fait l’objet d’un accord entre le rapporteur et moi-même lors de mon audition, dans le cadre de la préparation du rapport.
Effectivement, placer sur le même plan et de manière très explicite le maintien et l’introduction dans le domicile dans la rédaction de l’article 226-4 du code pénal permet de sortir de l’ambiguïté, à l’origine de laquelle se trouve l’hypocrisie des quarante-huit heures que j’évoquais en préambule.
Actuellement, cet article laisse place à un doute dans lequel se sont engouffrés tous les renoncements. « L’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » : avec une telle rédaction, une interprétation, certes spécieuse, reste possible.
De ce point de vue, le texte de la commission convient parfaitement aux ambitions que je m’étais fixée en déposant cette proposition de loi. En dissociant, l’introduction et le maintien dans le domicile, il permet de placer, cette fois sans ambiguïté, les deux faits sur le même plan.
Il en ressort que la flagrance devient permanente, dès lors que le maintien dans le domicile est un délit continu. Cette mesure permet, je le répète, de sortir de l’hypocrisie juridique des quarante-huit heures. Voter cette nouvelle disposition serait une victoire pour nous tous, une victoire du droit sur toutes les manœuvres que nous subissons et qui portent atteinte à la propriété et à la vie privées.
En revanche, sur l’article 2, ma position et celle de la commission divergent, mais le débat en séance publique va nous permettre d’en discuter. La commission a souhaité supprimer cet article, essentiellement au motif que le maire ne pourrait se substituer au propriétaire ou au locataire. Personne ne conteste cela : nous comprenons bien la priorité qui doit être donnée à l’occupant en titre pour intervenir.
Néanmoins, dans les faits, sur le terrain, il est évident que le maire, dans son rôle de garant de l’ordre public, est amené à prendre la situation en main, s’il veut réellement assumer ses responsabilités. Ou alors nous restons les « bras croisés », pour reprendre l’expression que j’utilisais voilà quelques instants, impuissants devant l’inacceptable, ce qui, pour un élu local, ne peut être satisfaisant.
C’est pourquoi je propose le rétablissement de l’article 2, en indiquant explicitement cette fois dans la rédaction que je vous soumettrai, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, que le maire agit dans le cadre de ses pouvoirs de police, c’est-à-dire sous le contrôle administratif du préfet. Comme dans la version initiale du texte, je précise bien que la saisine du préfet par le maire ne peut avoir lieu que quand tout a été fait pour retrouver l’occupant légitime. J’aurai l’occasion de revenir sur cette question lors de l’examen des articles.
Enfin, au fil des discussions qui ont accompagné le travail préparatoire de cette proposition de loi, un élément est apparu. Au départ centré sur le domicile, ce texte gagnerait néanmoins à viser les autres types de logements ou d’immeubles d’habitation. En effet, si le plus choquant dans le fameux délai de quarante-huit heures concerne le domicile, il n’en reste pas moins que la question des commerces, des logements vacants, de tout type de locaux reste importante à nos yeux.
À Calais comme ailleurs, ce type d’immeuble d’habitation ou qui le devient de fait est la proie privilégiée des mafieux, des squatteurs et d’autres organisations dont l’intérêt n’est pas celui des personnes qu’ils souhaitent héberger. Il serait dangereux de l’ignorer, d’autant plus que le renforcement du dispositif légal autour de la notion de domicile risque d’accroître la pression sur les autres lieux de squat, depuis le terrain vague jusqu’au hangar ou à l’usine désaffectée, en passant par la maison abandonnée.
En conséquence, je propose par voie d’amendements d’élargir le périmètre de la proposition de loi à tout « immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait », et de modifier en ce sens l’article 226-4 du code pénal et l’article 38 de la loi DALO.
Là aussi, l’examen des articles permettra de revenir librement sur cette question, qui, j’en suis sûre, touche beaucoup d’élus locaux.
En conclusion de mon propos dans le cadre de la discussion générale, j’espère pouvoir trouver aujourd’hui auprès de vous, mes chers collègues, une écoute sans dogmatisme à l’égard de la situation de terrain que nous vivons dans toutes les villes de France. Nous avons besoin d’un débat sans idéologie pour parfaire notre droit et éviter que celui-ci ne soit l’objet des manipulations que j’ai décrites.
Aujourd’hui, au Sénat, dont la vocation est la représentation des collectivités territoriales, je souhaite parler certes d’expérience, ayant connu les aléas, mais je veux parler aussi au nom de tous les maires de France confrontés à l’atteinte à la vie privée et à la propriété que constituent les occupations sauvages du domicile et des immeubles d’habitation.
J’espère avant tout que nos débats permettront de faire admettre par tous que l’hypocrisie juridique des quarante-huit heures est nulle et non avenue, afin que des impasses juridiques dignes de Kafka ne puissent à l’avenir se reproduire systématiquement, comme c’est malheureusement trop souvent le cas. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui saisis de la proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile, présentée par notre collègue Natacha Bouchart, maire de Calais, et cosignée par plusieurs membres de la Haute Assemblée.
Ce texte tend à lutter contre le développement préoccupant de la pratique des squats, à savoir une occupation sans droit ni titre, de manière souvent violente, d’un local, voire d’une habitation. Ce type de procédé se caractérise par une grande simplicité d’installation pour l’occupant illégal, mais, à l’inverse, par d’importantes difficultés pour y mettre un terme.
La situation est particulièrement préoccupante dans des villes de transit frontalier, comme Calais, qui ne compte pas moins de 3 000 personnes en situation irrégulière, fréquemment proies de réseaux organisés de passeurs, où certains locaux sont squattés par plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de personnes. Tout cela vient de nous être décrit.
Aussi l’auteur de la proposition de loi a-t-elle voulu renforcer l’arsenal législatif existant de lutte contre un phénomène qui conjugue la protection du domicile et l’ordre public.
Dans sa rédaction initiale, le texte, qui comportait deux articles, avait pour objet de traiter la problématique non pas de l’ensemble des squats, mais seulement des occupations illicites de domicile. Les amendements déposés, nous y reviendrons lors de la discussion des articles, semblent sortir de ce périmètre.
L’article 1er prévoyait de modifier l’article 53 du code de procédure pénale, afin de porter de quarante-huit heures à quatre-vingt-seize heures la durée pendant laquelle le flagrant délit de violation de domicile, infraction sanctionnée à l’article 226-4 du code pénal, peut être constaté.
Pour tout dire, la demande d’allongement du délai pouvait conduire à s’interroger, car, selon l’interprétation constante du ministère de la justice confirmée par une circulaire, la violation de domicile est une infraction dite « continue ». En d’autres termes, la flagrance peut être constatée aussi longtemps que dure l’infraction, aussi longtemps que le maintien illicite dans le domicile se poursuit, ce qui peut représenter un délai bien supérieur à quarante-huit heures ou à quatre-vingt-seize heures...
Dans les faits, les choses ne sont pas si simples. Tout d’abord, la Cour de cassation n’a jamais été saisie de cette question et n’a donc pas confirmé cette interprétation du délit continu. En revanche, la cour d’appel de Paris, dans une décision du 22 février 1999, l’a écartée, considérant que la violation de domicile n’était pas une infraction continue, commencée lors de l’introduction dans le domicile et qui se poursuivrait par le maintien dans les lieux. Selon elle, cette infraction se commettrait lors aussi bien de l’entrée que du maintien dans le domicile, à chaque fois qu’il est fait usage de manœuvres, menaces ou voies de fait pour y parvenir. Cette précision est capitale pour distinguer l’introduction du maintien dans ces mêmes lieux.
Pour constater la flagrance, il serait donc nécessaire que le maintien comme l’entrée dans le domicile s’accompagnent de manœuvres, menaces ou voies de fait.
Or, si de telles pratiques sont couramment utilisées au moment de l’introduction dans les lieux, elles le sont plus rarement lorsqu’il s’agit du maintien dans ces lieux. Il suffit par conséquent aux squatteurs de se dissimuler pendant les quarante-huit premières heures d’occupation pour empêcher les forces de l’ordre de pouvoir intervenir, la flagrance de l’infraction ayant cessé, imposant alors un retour à l’action judiciaire, longue et coûteuse, de droit commun.
Pour autant, la solution proposée par le biais de la proposition de loi initiale – un allongement de la durée de la flagrance de quarante-huit heures à quatre-vingt-seize heures – n’a pas été jugée satisfaisante par la commission.
En effet, ni l’article 53 du code de procédure pénale, texte général qui définit la flagrance pour l’ensemble des crimes et délits, ni aucun autre texte pénal ne fixe une durée précise pour la flagrance. En réalité, le délai de quarante-huit heures est tiré de la pratique ; c’est un délai prétorien.
Selon l’article 53 du code susvisé, est flagrant « le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. » Cette définition est volontairement ouverte pour permettre de couvrir l’ensemble des situations.
La commission des lois a écarté l’idée de fixer, à ce même article, une durée précise et spécifique à la flagrance pour le délit de violation de domicile. De surcroît, limiter la durée de la flagrance à quatre-vingt-seize heures à compter de la commission de l’infraction pourrait se révéler contraire à l’intérêt de la victime. En effet, si celle-ci s’absentait pour une durée supérieure à quatre-vingt-seize heures – en cas d’hospitalisation, de vacances ou de voyage à l’étranger, par exemple – et si son domicile était toujours occupé à son retour, les forces de l’ordre ne pourraient pas davantage intervenir pour flagrant délit, car les quatre-vingt-seize heures seraient de toute façon passées.
En revanche, pour lever toute ambiguïté sur la nature continue du délit de violation de domicile et éviter les différentes interprétations du juge civil et de l’administration, quand l’occupant illégal se maintient dans les lieux, il a paru plus clair et efficace de modifier la rédaction de l’article 226-4 du code pénal en qualifiant le maintien dans le domicile au même titre que l’introduction dans les lieux.
Dès lors que l’introduction dans le domicile d’autrui s’est produite par le biais de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », les forces de l’ordre pourront désormais intervenir au titre du flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux, quelle que soit sa durée, sans qu’il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ». Cette précision permettra de sécuriser l’action du préfet et, par conséquent, de renforcer l’application de l’article 38 de la loi DALO, car tel est bien l’objectif.
Quant à l’article 2 de la proposition de loi, qui modifiait ce même article 38, il prévoyait que le maire ayant connaissance de la violation du domicile de l’un de ses administrés pouvait demander au préfet de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux.
La commission des lois a supprimé cet article. Elle a en effet considéré qu’il n’était pas opportun d’étendre le champ d’application de cette procédure dérogatoire au droit commun qui permet au préfet de faire usage de la force publique pour évacuer les squatteurs d’un domicile privé sans qu’il soit besoin de justifier d’une menace pour l’ordre public et d’une décision de justice.
Le caractère quelque peu hybride de cette procédure explique que les préfets fassent preuve d’une certaine prudence dans son application. Sur le plan contentieux, selon les services du Conseil d’État, l’article 38 de la loi DALO n’a donné lieu qu’à dix recours entre 2011 et 2014, dont quatre en référé-liberté, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire évacuer l’occupant.
Ces données sont assez révélatrices de l’utilisation limitée de cette procédure très particulière et des mesures de prudence qu’il convient de prendre pour la mettre en œuvre.
Or quand certains squats, en raison de leur importance et des conditions d’occupation des locaux qu’ils présentent, mettent en péril la sécurité publique, le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police, saisir directement le préfet. De surcroît, cette faculté qui serait ouverte au maire ne ferait naître aucune obligation pour le préfet.
En revanche, il existe un risque – nous l’avons longuement évoqué en commission – de voir la responsabilité du maire engagée s’il n’a pas agi alors qu’il avait connaissance de l’occupation du domicile de l’un de ses administrés ou, à l’inverse, s’il a agi de manière abusive, en déclenchant indûment l’expulsion de personnes, dans l’hypothèse où il n’aurait pas réussi à contacter le propriétaire ou le locataire du logement.
Enfin, par cohérence avec les modifications apportées à la proposition de loi, la commission a tenu à modifier le titre de celle-ci, afin de le rendre plus conforme à son contenu. Elle a proposé d’intituler ce texte : « proposition de loi tendant à préciser l’infraction de violation de domicile ».
En effet, il n’est pas question en l’espèce de mettre en place un nouveau dispositif d’expulsion dérogatoire au droit commun ni de revenir sur les garanties qui encadrent les procédures d’expulsion actuelles, comme le respect de la trêve hivernale. Il s’agit de renforcer l’efficacité des règles existantes en matière de violation de domicile et de sécuriser l’action du préfet au titre de l’article 38 de la loi DALO.
Au bénéfice de ces observations liminaires, la commission vous propose, mes chers collègues, d’adopter le présent texte, tel qu’il résulte de ses travaux. §

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée entame cet après-midi l’examen en première lecture de la proposition de loi déposée le 5 juin dernier par Mme Bouchart et cinquante-trois de ses collègues, et qui vise à répondre à la multiplication des occupations illicites de domicile, face auxquelles le droit pénal serait insuffisant, car il ne permettrait pas d’expulser un occupant sans titre passé le délai de quarante-huit heures suivant la pénétration dans les lieux, au motif que, au-delà de ce délai, le flagrant délit ne pourrait plus être évoqué.
Ce texte vise à porter de quarante-huit à quatre-vingt-seize heures le délai de l’infraction flagrante pour l’infraction d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, infraction réprimée par l’article 226-4 du code pénal.
Il tend également à modifier l’article 38 de la loi DALO du 5 mars 2007 qui permet au préfet, saisi par le propriétaire ou par le locataire des lieux occupés illicitement, de demander à l’occupant de quitter les lieux, afin que, en cas d’impossibilité de joindre le propriétaire ou le locataire, le maire puisse saisir le préfet aux fins d’évacuation des lieux.
Lors de l’examen de cette proposition de loi en commission le 2 décembre dernier, deux amendements déposés par votre rapporteur, M. Jean-Pierre Vial, tendant à modifier l’article 226-4 du code pénal et à supprimer la disposition relative à l’article 38 de la loi DALO ont été adoptés.
La proposition de loi se résume donc désormais à un article unique, qui a pour objet de rédiger comme suit l’article 226-4 du code pénal : « L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction visée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »
Ce faisant, la commission a introduit dans la loi une clarification. Pour que le maintien dans les lieux soit punissable, il n’est pas nécessaire qu’il soit assorti de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
Cette proposition clarifie également le fait que l’infraction de maintien dans les lieux est une infraction continue, c'est-à-dire qui se commet tant que la personne se maintient de manière continue et irrégulière dans les locaux. À ce titre, tant que dure l’occupation, il s’agit d’une infraction qui se commet actuellement, au sens de l’article 53 du code de procédure pénale, ce qui autorise le recours aux dispositions de l’enquête de flagrance, notamment l’expulsion de l’occupant des lieux.
La présente proposition de loi tenant compte des modifications apportées par la commission ne pose pas de difficulté sur le fond, car elle est conforme à l’interprétation actuelle de l’article précité par les juridictions. S’il n’existe, c’est vrai, aucune décision de la Cour de cassation en la matière, c’est que précisément cette question ne fait pas débat dans la pratique.
La circulaire d’application du nouveau code pénal du 14 mai 1993 précise ainsi que l’article 226-4 du code pénal étend la répression à l’hypothèse du maintien dans le domicile d’autrui, transformant ainsi cette infraction instantanée en délit continu. Elle indique que cette modification a principalement pour objet de rendre plus efficace les procédures engagées contre les squatteurs et qu’elle permettra de diligenter les enquêtes de flagrance à leur encontre, alors même que l’occupation sans droit ni titre a commencé depuis un certain temps.
Eu égard à ces éléments, et tout en soulignant le caractère insuffisant d’une approche exclusivement pénale des occupations illicites de domicile, qui sont le plus souvent le fait de personnes se trouvant dans le dénuement le plus cruel, le Gouvernement s’en remettra sur le texte adopté par la commission à la sagesse de la Haute Assemblée.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi, présentée par Mme Bouchart, que nous examinons aujourd’hui suscite de nombreuses controverses.
Compte tenu de la situation non seulement difficile, mais aussi particulière à laquelle Mme Bouchart est confrontée dans sa ville de Calais, s’agit-il là d’un texte visant réellement à apporter une solution pérenne aux occupations illicites de domicile ou bien d’une démarche à vocation purement médiatique et politicienne, ce qui serait bien entendu regrettable ?
Le texte qui nous est soumis, bien qu’il ait déjà été largement remanié par la commission, reste à mon sens insatisfaisant. Je tenais à intervenir sur ce sujet, que je ne connais que trop bien.
Pour commencer, j’évoquerai un exemple très explicite et fréquent : j’ai été saisie du cas d’une personne âgée qui, à l’issue d’un séjour à l’hôpital, s’est trouvée à son retour dépossédée de son logement. Les serrures avaient été changées, les meubles évacués, et les démarches qui se sont ensuivies pour parvenir à la restitution du logement ont été longues et complexes. Cette personne s’est de fait retrouvée dans une situation précaire, alors que tel n’était pas le cas à l’origine. §
Toutefois, nous devons rester lucides sur la réalité du squat. On squatte un domicile non par choix, mais par désespoir. La plupart du temps, les squatteurs sont des personnes qui avaient un logement social mais qui en ont été expulsées à la suite d’un défaut de paiement. Il s’agit souvent de femmes seules qui, pour conserver la garde de leurs enfants, doivent trouver un toit, quitte à se mettre dans l’illégalité. §
Comment pourrions-nous exiger du secteur locatif privé qu’il résolve les problèmes quand le secteur public n’a pas la capacité de le faire ?
Pourtant, le squat reste un acte de délinquance qui s’exerce le plus souvent au détriment des demandeurs de logement.
Il est en effet inacceptable que des personnes ayant déposé des demandes de logement en bonne et due forme, qui respectent les délais, en serrant les dents, pendant des années parfois, puissent avoir l’impression que ceux qui contournent les règles jouissent d’une impunité. Il n’est pas normal que ceux qui respectent les lois de la République soient moins bien traités que ceux qui les défient en squattant.
Il faut donc faire preuve de fermeté, afin de ne pas encourager les squatteurs parce que la démarche serait simple et la punition inexistante. Être en situation de précarité ne justifie pas de placer d’autres dans la même condition.
Par conséquent, c’est sur l’ensemble de la politique du logement que nous devons nous interroger. Nous ne pouvons pas nous contenter de répression. Nous devons assortir notre démarche de dispositifs crédibles. Les structures d’accueil existantes sont inadaptées à la plupart des situations. Elles ne conviennent pas aux réalités familiales. Enfin, elles sont insuffisantes.
Les trois quarts des personnes que je reçois au cours de mes permanences relèvent du dispositif DALO et répondent aux critères de priorité inscrits dans la loi. Nous n’avons pourtant pas de solution à leur offrir tant le parc de logements sociaux est saturé. Il faut donc appréhender ce problème de manière globale, lucide, sans tomber dans la caricature.
Néanmoins, il faut également prendre en compte une autre réalité : il existe aussi une activité organisée et lucrative d’occupation illicite de logements. À cet égard, je pense que votre proposition de loi a du sens, madame Bouchart.
Il est clair que les dispositions législatives en vigueur ne permettent pas d’apporter une réponse efficace à ce problème. Or les squatteurs ne connaissent malheureusement que trop bien les lacunes de la loi ! Ils s’introduisent dans le logement le vendredi, sachant pertinemment que les services administratifs sont alors fermés pour le week-end, et que le lundi il sera trop tard pour les expulser.
Quant à l’intervention du maire, qui figurait à l’article 2 du texte initial, lequel a été supprimé par la commission, elle me semble justifiée. Le préfet a toutes les prérogatives, de par la loi, pour faire respecter l’ordre public, dont il est le garant. Malheureusement, il ne les met pas toujours en œuvre – c’est peut-être là que se situe le problème. Il est de son devoir de faire respecter les droits des citoyens et l’intérêt des communes de manière équilibrée. Car c’est aussi de cela qu’il s’agit : d’ordre public et du mieux vivre ensemble.
Si cette proposition de loi reste très insatisfaisante et si l’on peut raisonnablement douter des intentions de son auteur, il n’en demeure pas moins que la question politique qu’elle soulève mérite d’être débattue.
La loi doit protéger les propriétaires, qui ont souvent consacré toutes les économies d’une vie à l’achat d’un logement, qui ne sont pas tous rentiers et qui doivent fréquemment honorer un crédit. De même, elle doit protéger les demandeurs de logement qui patientent dans le respect de la loi, afin qu’il n’y ait pas un déséquilibre entre eux et le squatteur qui, lui, enfreint la législation en toute connaissance de cause.
Monsieur le secrétaire d’État, une véritable réflexion doit être menée sur ces questions, qui relèvent du droit et de la loi, car elles peuvent complètement déséquilibrer notre pays. On ne peut pas donner le sentiment que le traitement des squatteurs varie selon les procédures. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de Natacha Bouchart visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile.
Le constat des auteurs du texte est clair : notre droit pénal est inadapté à la répression de ce qui est qualifié de « phénomène des maisons et appartements squattés ». Toujours selon les auteurs de cette proposition de loi, la notion de flagrant délit, censée permettre une expulsion rapide des occupants sans titre, est difficilement caractérisable et, de surcroît, ne peut plus être caractérisée passé un délai de quarante-huit heures suivant l’intrusion illicite. La police ne peut donc plus procéder à l’expulsion immédiate des squatteurs, et il revient au propriétaire ou au locataire du domicile de saisir la justice, afin d’obtenir une décision d’expulsion.
Pour pallier cette difficulté, le texte initial de la proposition de loi prévoyait non seulement de porter de quarante-huit heures à quatre-vingt-seize heures la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement pouvait être constaté, mais également de permettre au maire de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.
La commission des lois, considérant qu’il n’était pas opportun de confier au maire la compétence de défendre la propriété privée de ses administrés, a heureusement écarté cette dernière possibilité.
Reste un article unique qui modifie l’article 226-4 du code pénal, afin de lever toute ambiguïté relative à la nature continue du délit de violation de domicile lorsque l’occupant illégal se maintient dans les lieux. Dès lors que l’introduction dans le domicile d’autrui s’est faite « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », les forces de l’ordre pourront désormais intervenir au titre du flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux, sans qu’il soit besoin de prouver que ce maintien est également le fait de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».
Il ne s’agit finalement que de préciser l’infraction de violation de domicile et non, comme le titre racoleur de la proposition de loi le laisse entendre, de créer un régime dérogatoire pour faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile.
Le texte issu des travaux de la commission des lois est donc bien plus acceptable que le texte initial, …

… mais il n’en reste pas moins une proposition de loi d’affichage. Il n’aura échappé à personne que notre collègue Natacha Bouchart est également maire de Calais : ce sont donc non pas les squatteurs qui sont en l’occurrence visés, mais bien les migrants qui n’ont parfois pas d’autre choix, en plein hiver, que d’investir un bâtiment inoccupé.

L’amalgame ne peut être fait entre toutes les situations, mais c’est malheureusement un tel amalgame qui a présidé à l’élaboration de ce texte.
Il existe de véritables réseaux organisés qui repèrent des logements vacants, souvent des logements sociaux, en prennent possession dès que l’occasion se présente, puis les louent à des familles désespérées. Cette activité est lucrative et doit être combattue, d’autant plus qu’elle s’exerce très souvent au détriment des personnes vivant dans les situations les plus précaires.
Il est regrettable que le texte dont nous débattons aujourd’hui ne s’attaque pas aux organisateurs de ces occupations illicites. Il s’agit en l’espèce uniquement de protéger les domiciles privés, mais quid de l’occupation des immeubles et bâtiments vacants ? À Calais comme ailleurs, ce sont majoritairement des logements vides depuis longtemps qui sont utilisés par des personnes sans domicile pour se mettre à l’abri.
Tenter de faire croire, comme dans l’exposé des motifs, que « les exemples se multiplient de personnes qui, de retour de vacances, d’un déplacement professionnel ou d’un séjour à l’hôpital, ne peuvent plus ni rentrer chez elles, parce que les squatters ont changé les serrures, ni faire expulser ces occupants », relève pour le moins de la mauvaise foi.

Ces situations surviennent dans le département dont vous êtes élue, madame Benbassa !

L’arsenal juridique existe pour mettre fin aux occupations illégales, que personne dans cette enceinte ne songe à défendre. Il peut être précisé, amélioré, mais nous ne pouvons pas faire l’impasse sur la situation de centaines de personnes, hommes, femmes, nombreux enfants, qui n’ont pas d’autre choix que de squatter pour survivre.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la question de l’occupation illicite de domicile, couramment appelée « squat » ou encore « vol de domicile », est une dure réalité pour les familles et pour les élus.
Pour autant, nous regrettons que le texte de madame Bouchart, qui, il est vrai, revêt un caractère local particulièrement douloureux pour les maires et, bien sûr, pour la population, joue sur les peurs et sur les angoisses.
Mme Natacha Bouchart s’exclame.

Certes, celles-ci sont réelles, mais les solutions avancées ne sont malheureusement pas à la hauteur des enjeux. Cette question sensible aurait mérité mieux, à commencer par la prise en compte de l’ensemble des problématiques liées au logement des plus précaires. Les bonnes intentions ne suffisent pas, et la stigmatisation de cette population va crescendo.
Je salue néanmoins le travail de M. le rapporteur, qui a introduit une réelle rigueur juridique en réécrivant le texte en commission.
Il était nécessaire de supprimer l’article 2, véritable cadeau empoisonné pour les maires. De même, la réécriture de l’article 1er était bienvenue : alourdir l’arsenal répressif de manière imprécise et surtout contreproductive était une aberration. Je pense au délai de flagrance qui aurait été figé dans la loi, alors que, aujourd’hui, la rédaction de l’article 53 du code de procédure pénale permet une certaine souplesse.
Le phénomène d’occupation illicite de domicile, en particulier à Calais, où la situation est certes très complexe et très grave, est la conséquence de la fermeture de centres d’accueil de migrants, de la destruction systématique des campements plus petits, mais surtout d’une politique d’asile et de coopération frontalière insuffisante, voire inhumaine. Le présent texte propose de renforcer les mesures répressives, plaçant les réfugiés sous la pression policière permanente.
À cet égard, l’annonce de l’ouverture d’un nouveau centre de jour et d’un accord financier entre la France et la Grande-Bretagne de l’ordre de 15 millions d’euros nous laisse sceptiques. Rien n’est dit sur la question fondamentale du droit d’asile. Nous devons prendre la mesure de notre responsabilité, ce qui serait tout à notre honneur.
Pour faire face à cette réalité, nous avons besoin d’une réponse européenne, même si un réel effort national serait un signal déterminant. Comme le souligne justement le GISTI, le Groupe d’informations et de soutien des immigrés, au fil du temps, l’Europe a évolué négativement en repoussant les personnes migrantes, y compris celles qu’elle a l’obligation de protéger des persécutions. Pour les bénéficiaires du droit d’asile, c’est le brouillard administratif, tant les procédures sont longues, peu lisibles, bref, faites pour décourager celles et ceux qu’elles devraient protéger.
C’est une révision du règlement Dublin III qu’il faut promouvoir, afin que chaque demandeur d’asile en Europe puisse aller déposer son dossier dans le pays de son choix. C’est une orientation immédiate vers un centre d’accueil qu’il faut mettre en place pour les personnes qui souhaitent demander une protection à la France. C’est au renforcement de la protection des mineurs que nous devons travailler. Enfin, et surtout, c’est l’inconditionnalité de l’hébergement qui doit être la règle, ce qui ne peut se traduire que par la création de dispositifs d’accueil et d’orientation adaptés et en nombre suffisant.
Ces quelques propositions sont soutenues par de nombreuses associations qui ne sont pas forcément radicales, mais qui connaissent le terrain et gèrent tous les jours ces situations de détresse extrême.
La répression n’est pas la solution pour des personnes qui ont tout abandonné, qui ont connu des situations inhumaines de violence ou de privation de la dignité la plus élémentaire. Le constat est accablant : ce sont des personnes démunies, affligées, craintives, soumises au regard d’autrui et à la merci des réactions des autres.
Il y a urgence à faire preuve de réalisme dans la construction de solutions durables qui permettraient de prévenir les drames, mais aussi les situations de squats illicites, objet de la présente proposition de loi.
Sortons de la problématique de Calais, car la loi a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national.

La répression ne peut pas résoudre la crise du logement ni mettre fin à l’existence de filières organisées profitant du désarroi de nombreuses familles. En effet, près de 10 millions de nos concitoyens vivent sous le seuil de pauvreté. Les travailleurs dits « pauvres » ne peuvent se loger correctement. Quelque 150 000 personnes seraient sans-abri, contre 80 000 voilà dix ans. Autant d’hommes, de femmes et d’enfants dont le droit au logement est loin d’être garanti !
Les occupations illicites de domicile sont bien souvent une conséquence de la pénurie de logements accessibles pour tous et partout – en tout cas, une telle pénurie ne peut qu’aggraver la situation. Dès lors, la pénalisation des squatteurs n’est pas la solution ; notre arsenal juridique est déjà riche.

Ce n’est pas cette proposition de loi qui le rendra efficace, vous le savez très bien !

Comme le souligne le rapporteur, mais aussi les réponses tant du Gouvernement actuel que de la précédente majorité, le droit pénal en vigueur sanctionne déjà l’installation illicite d’individus dans le domicile d’autrui, notamment lorsque celle-ci est commise durant l’absence des légitimes occupants partis en vacances. En effet, l’article 226-4 du code pénal réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de s’introduire ou de se maintenir dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.
De surcroît, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement. Cette disposition permet d’accélérer la procédure d’expulsion dans les cas visés et de permettre au propriétaire ou au locataire de reprendre possession des lieux dans les délais les plus brefs, l’expulsion pouvant intervenir vingt-quatre heures après la mise en demeure adressée par le préfet aux occupants sans droit ni titre de quitter les lieux.

J’ai été aussi confronté au problème du squat, madame Bouchart, et je sais que c’est une dure réalité, mais la loi existe.
En matière de logement pour les migrants, le Gouvernement a décidé, au début de cette année, de solliciter l’opérateur Adoma pour contribuer à la mise en œuvre de la circulaire du 26 août 2012. Celui-ci peut, à la demande des préfets, recourir à son parc de logements vacants ou proposer des services d’ingénierie pour apporter des solutions.
Ainsi, comme vous pouvez le constater, des réponses à la question soulevée par Mme Bouchart existent déjà dans le droit positif ainsi que dans la jurisprudence de la Cour de cassation à propos de la notion de domicile. Et n’oublions pas non plus les leviers dont disposent les préfets et donc l’État.
C’est pourquoi nous pensons que c’est essentiellement un manque de moyens et de volonté politique qu’il faut aujourd’hui combattre, au lieu de promouvoir la répression et la pénalisation de personnes en grande détresse, quel que soit leur statut juridique. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi de Natacha Bouchart, maire de Calais, a été déposée dans un contexte particulier. Elle reflète les préoccupations d’une élue locale.
En effet, depuis de nombreuses années, cette ville du nord de la France fait face à un afflux massif d’immigrés de diverses origines – Afghans, Irakiens, Érythréens, Soudanais et Iraniens – en transit vers la Grande-Bretagne, ce qui crée des tensions avec les habitants.
Ces difficultés ne datent pas d’hier. Selon la Croix-Rouge, entre 1999 et 2002, plus de 67 000 personnes ont transité par le camp de Sangatte. Conçu pour accueillir 200 personnes, cet immense hangar en abritait 1 600 avant sa fermeture. Son démantèlement, loin d’apporter une solution durable, n’a fait que fractionner le problème sans le résoudre. Aujourd’hui, les migrants illégaux s’installent dans la zone forestière qui entoure Calais et qui est surnommée la « jungle ».
Les squats d’immeubles par ces populations se sont multipliés ces derniers mois. Depuis juillet, l’ancien site industriel Vandamme, situé en centre-ville, est l’objet d’un squat à la suite de l’évacuation, dix jours plus tôt, de 610 migrants installés dans un autre immeuble de la ville. Le tribunal a bien ordonné l’expulsion des squatteurs le 24 juillet, mais le préfet n’a pas souhaité la mettre en pratique pour des raisons d’ordre public.
Cet exemple illustre bien le dilemme auquel nous confrontent les squats de domicile et de locaux vides. Au drame humanitaire qui se joue au quotidien se surajoute la question du respect du droit de propriété. Les droits des uns s’opposent au respect de la dignité des autres, sans qu’il soit toujours possible de dégager des compromis acceptables et satisfaisants.
Si la situation des squatteurs est déplorable, celle des propriétaires lésés par l’occupation illégale n’est pas beaucoup plus enviable. On doit se garder de tout manichéisme en la matière. L’on sait, par exemple, l’investissement que représente l’achat d’un bien immobilier pour un particulier, ce dernier tablant souvent sur des revenus locatifs. Et nous pensons qu’il aurait fallu différencier en matière d’expulsion les logements vides des autres cas.
Par ailleurs, l’arsenal juridique à disposition de ces justiciables ne fait pas toujours preuve d’une grande efficacité.
L’expulsion des occupants illégaux est l’une des procédures les plus délicates à mettre en œuvre, car elle s’oppose directement à certains droits, notamment le droit au logement. Elle a été entourée par le législateur de maintes précautions d’exécution : si celles-ci sont nécessaires pour lutter contre les abus, elles sont aussi sources d’extrême lenteur.
Passé le délai de quarante-huit heures permettant de constater la flagrance de l’infraction, le propriétaire est contraint d’engager une procédure en justice. La décision juridictionnelle est un préalable à la procédure d’expulsion. Quand on connaît les délais habituels des juridictions, il est facile d’imaginer alors le parcours semé d’embûches que rencontre le requérant.
Ensuite, des délais permettant de retarder l’exécution sont prévus.
Je vise tout d’abord le délai de grâce, qui permet aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée par une juridiction d’obtenir des délais renouvelables qui peuvent excéder une année, sans toutefois pouvoir dépasser trois ans.
Je pense ensuite à la trêve hivernale, instaurée en 1956 après l’appel lancé par l’abbé Pierre, qui a pour finalité de surseoir à toute expulsion non exécutée au 1er novembre de chaque année, et ce jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement ne soit assuré.
Je songe enfin au délai de deux mois entre le commandement d’avoir à libérer les lieux et l’exécution effective de l’expulsion. Il permet à la personne menacée d’expulsion d’accomplir des démarches pour trouver un nouveau logement.
Les auteurs du texte dont nous discutons aujourd’hui tentent ainsi d’avancer des solutions à une difficulté réelle. Le travail de la commission des lois, qui a modifié la nature de l’infraction de l’article 226-4 du code pénal pour en faire une infraction continue, améliore sensiblement les moyens à la disposition des forces de l’ordre pour constater l’infraction.
En conclusion, la majorité des membres du groupe du RDSE voteront cette proposition de loi, mais seulement dans la forme adoptée par la commission des lois, en particulier à la suite de l’adoption des deux amendements de M. le rapporteur.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à donner plus d’efficacité aux dispositifs existants en matière d’expulsion des squatteurs de domicile. Elle pose la problématique du difficile équilibre entre la protection du droit de propriété et la prise en compte de situations sociales souvent très délicates.
Il n’est d’ailleurs pas étonnant que cette initiative émane de notre collègue Natacha Bouchart, maire de Calais : la ville compte plus de 2 000 personnes en situation irrégulière, dont la présence est parfois liée à des bandes organisées. Cet été encore, un certain nombre de nouveaux squats ont été révélés, si l’on en croit la presse – le squat Vandamme, le squat de l’impasse des Salines, etc. –, ce qui montre, de nouveau, l’ingéniosité des bandes organisées et l’impuissance du droit actuel à répondre au désarroi des propriétaires.
C’est à cette instrumentalisation du droit existant que la présente proposition de loi tend à remédier. Remanié en commission, le texte élude le débat sur la fixation d’une durée précise de la flagrance, considérant à raison qu’une telle fixation ne pourrait que porter préjudice aux victimes. Cette notion devra donc être appréciée en fonction des circonstances, toute rigidité nous semblant mal venue en la matière.
Cette position, que nous partageons, ne permet malheureusement pas de mettre fin à l’application récurrente par l’administration d’un délai de quarante-huit heures, par crainte de censure des tribunaux, alors que ce délai ne figure pas dans les textes et que la jurisprudence elle-même reconnaît, à travers son standard de « temps très voisin de l’action », l’application d’une durée adaptable et circonstanciée.
Il est en revanche proposé d’incriminer le « maintien dans le domicile d’autrui ». Ainsi, les doutes qui pouvaient demeurer quant à la nature continue de l’infraction, en cas d’introduction dans les lieux avec manœuvres, voies de fait ou contrainte, laquelle qui se poursuivait par le maintien dans les lieux, sont dissipés, et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui refusait dans une telle situation de caractériser une infraction continue, peut être abandonnée.
La modification ainsi introduite est d’autant plus bienvenue que les squats se multiplient dans les grandes agglomérations. Les offices d’HLM sont évidemment les premières cibles de cette délinquance lucrative, qui s’exerce le plus souvent au détriment des demandeurs de logements sociaux. Cette exploitation éhontée du dispositif législatif paraît aujourd’hui intolérable à nombre de nos concitoyens.
Je terminerai par quelques mots concernant la suppression par la commission de l’article 2 de la proposition de loi, lequel modifiait l’article 38 de la loi DALO en rendant également destinataires de la saisine du préfet les maires. Elle nous semble justifiée dans la mesure où, pratiquement, cette mesure paraît inutile, les maires et les préfets échangeant déjà sur le sujet. Une telle disposition ne ferait par conséquent que créer un risque de contentieux important en la matière : un propriétaire mécontent pourrait ainsi engager la responsabilité du maire qui aurait refusé de saisir le préfet.
Le dernier amendement adopté par la commission visait à modifier le titre de la proposition de loi. Le nouvel intitulé traduit mieux l’apport de ce texte, lequel ne crée pas de nouvelle voie de droit dans le domaine de l’expulsion des squatteurs, contrairement à ce que l’intitulé pouvait laisser penser, mais tente de renforcer l’efficacité de la procédure existante en matière de squat de domicile. Seuls ces derniers cas sont d’ailleurs visés par la présente proposition de loi.
En conclusion, au-delà de sa portée médiatique, ce texte repose sur une justification réelle. Nous soutenons donc cette initiative.
Nous saluons également la qualité du travail du rapporteur, Jean-Pierre Vial : les améliorations qu’il a proposées en commission permettent d’aboutir en effet à un texte équilibré.
Toutefois, pour répondre à l’ensemble des problèmes de squat, c’est-à-dire les squats de domicile, mais aussi les squats d’immeubles ou de bâtiments vacants, il faudra encore que de véritables décisions politiques soient prises, monsieur le secrétaire d’État.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, depuis 2007, c’est la troisième fois que je me retrouve dans cet hémicycle pour tenter de légiférer sur les squats. Les deux précédentes fois, nous avions, ensemble, parlementaires et ministres, réussi à progresser, lentement mais sûrement, après de très nombreux débats et même des manifestations.
La première fois, c’était en 2007, quand j’ai voulu que la loi DALO protège aussi ceux qui ont déjà un domicile ; la deuxième fois, c’était en 2010, lorsque le vol de domicile est devenu une infraction pénale.
Aujourd’hui, en 2014, c’est Natacha Bouchart qui prend le relais et tente d’aller plus loin pour protéger ceux qui subissent ces occupations illicites.
En France, il est souvent difficile de parler des squats ; il est plus facile de dénoncer le manque de logements sociaux. Certes, les squats sont la conséquence de la pénurie de logements, de la misère, des loyers élevés, mais ils sont aussi une atteinte inacceptable à la propriété, ce droit théoriquement reconnu par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
S’ils sont le fait de bandes organisées, comme cela a été dénoncé, ils sont aussi parfois le fait d’individus peu scrupuleux, de véritables voleurs qui abusent d’une loi qui protège avec excès ceux qui sont installés dans le logement, quelle que soit la façon dont ils s’y sont introduits.
Depuis 2007, je me bats pour protéger tout occupant, propriétaire ou locataire, qui se retrouve à la porte de chez lui à la suite du vol de son domicile.
Être mal logé n’autorise pas le squat. Le mal-logement ne doit pas être une prime à l’illégalité et à la légalisation des intrusions illicites.
Je suis fière d’avoir fait voter en 2007, à l’unanimité des groupes politiques, l’article 38 de la loi DALO – modifié par un sous-amendement socialiste et écologiste que vous aviez cosigné, monsieur le secrétaire d’État – qui accélère la procédure d’expulsion, pour éviter que ne se retrouve à la rue et sans logement quelqu’un qui en avait un.
Ce ne fut pas facile : la rédaction est issue de discussions dans cette enceinte, en pleine nuit, alors que des membres des associations Droit au logement et Jeudi noir manifestaient contre mon amendement. Si ces associations veulent loger les sans-abri, elles ne cautionnent pas pour autant le squat à tout-va.
Avec cette disposition, je croyais que la réintégration des occupants dans leur logement serait facilitée et accélérée. Mais il n’en est rien.
Ainsi, 2 047 condamnations ont été prononcées en 2004 et 2 050 en 2010. Contrairement à Mme la garde des sceaux, je ne me félicite pas de cette stabilité, car elle prouve que l’article 38 de la loi précitée n’est que peu ou pas appliqué depuis qu’il existe. M. le rapporteur, Jean-Pierre Vial, nous l’a dit : on dénombre dix recours seulement en l’espace de quatre ans.
Il suffit de lire la presse pour se rendre compte que ces actes ne s’arrêtent pas. Les victimes sont le plus souvent des personnes âgées, de retour d’une hospitalisation, ou alors parties en vacances ou en déplacement, c’est-à-dire les citoyens les plus modestes, ceux dont la maison n’est pas gardée par du personnel, ni sécurisée par une porte blindée ou par un digicode, des personnes qui ignorent l’existence de cet article 38 et que nul n’informera.
Je veux donc profiter de cette tribune pour vous demander, monsieur le secrétaire d’État, de rappeler aux préfets, avant que la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui ne soit définitivement adoptée, l’existence de cette procédure, qu’ils connaissent mal ou ne veulent pas appliquer.
Le délai de quarante-huit heures est trop souvent opposé alors qu’il ne s’applique pas lors d’une introduction illicite dans le domicile d’un particulier, sauf à détourner la volonté du législateur que je connais parfaitement bien.
La semaine dernière, l’Assemblée nationale a adopté un amendement sur la taxation des résidences secondaires qui précise justement les notions de résidence. Ce serait peut-être l’occasion de les rapprocher et de pouvoir lever le flou sur ces notions.
Je crois que Natacha Bouchart a raison de vouloir aller plus loin que l’article 38 de la loi DALO, et je soutiens son amendement, qui vise à permettre au maire d’intervenir. Celui-ci est un acteur de proximité qui connaît mieux que le préfet la réalité de l’occupation et réagira plus vite, d’autant que c’est lui qui aura le devoir de reloger la personne qui se trouve jetée à la porte de chez elle.
Je soutenais pleinement la proposition de ma collègue de porter le délai à quatre-vingt-seize heures, mais je me rallie à celle de la commission, qui semble donner plus de force au dispositif.
Toutefois, pourquoi appliquer un délai aussi court ? Pourquoi a-t-on voulu transformer les cambrioleurs de domicile en occupants légaux au bout de quarante-huit heures ? En 2010, sur l’initiative de l’Assemblée nationale, un amendement a été adopté. Il visait à allonger le délai de flagrance du délit d’effraction de domicile à la période variable durant laquelle l’occupant en titre du logement ignore qu’il est squatté, quand il s’agit de sa résidence principale. Je continue à penser qu’il s’agissait d’une disposition de bon sens.
Enfin, je voudrais conclure sur la question de la sécurisation des justificatifs de domicile, en l’occurrence les contrats d’électricité. C’est la première étape recommandée par tous les sites internet expliquant comment squatter en toute liberté !
M. le ministre de l’intérieur m’a répondu qu’EDF prévoyait de sécuriser par des codes-barres 2D une attestation de contrat valant justificatif de domicile. J’aimerais savoir si cette mesure est appliquée.
J’espère que, aujourd’hui, au Sénat, nous adopterons, dans une troisième étape, la présente proposition de loi, qui permet d’aller un peu plus loin.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la présente proposition de loi, telle qu’elle a été adoptée par notre commission des lois, ne concerne que les violations de domicile visées à l’article 226-4 du code pénal.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en droit pénal, le terme « domicile » désigne non seulement le lieu où une personne a son principal établissement, comme en droit civil, mais aussi le lieu où elle a le droit de se dire chez elle. C’est donc un lieu affecté à l’habitation réelle et effective d’une personne, qu’elle y réside en permanence ou non.
Dès lors, si je conçois que la question générale des squats suscite des émotions et des réactions passionnées, elle n’en est pas moins éloignée du texte qui nous réunit aujourd'hui. En effet, dans la plupart des situations évoquées par nos collègues, les difficultés qu’ils éprouvent dans leur circonscription tiennent à des immeubles vacants, des usines désaffectées, des hangars ou d’autres locaux qui ne sont en rien considérés comme des domiciles.
Contrairement à ces divers locaux inoccupés, le domicile est un élément de la vie privée protégé par notre droit positif, et en particulier par l’article 9 du code civil. Le respect du domicile de toute personne résidant sur notre territoire est constitutionnellement garanti en vertu des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Au niveau conventionnel, c’est l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Au titre de cette protection constitutionnelle et conventionnelle, le respect effectif du principe d’inviolabilité du domicile est d’ores et déjà assuré par plusieurs procédures juridiques, qui peuvent être rapides. Il existe actuellement une procédure civile, une procédure administrative et une procédure pénale.
La procédure civile protège les victimes, locataires ou propriétaires, des occupations illicites de leur domicile, et leur permet d’obtenir, par voie de référé ou de référé d’heure à heure, une décision du juge civil, qui statue à très brève échéance si l’urgence du retour de l’occupant légal dans les lieux est caractérisée.
La procédure administrative a été créée par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO », article que nous devons à Catherine Procaccia. Il s’agit d’une procédure dérogatoire au droit commun permettant au propriétaire ou au locataire dont le domicile fait l’objet d’une occupation résultant « de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte » de saisir le préfet pour qu’il procède à l’évacuation forcée des lieux. Il appartient aux victimes de déposer plainte, sans qu’il leur soit nécessaire d’avoir recours à un huissier pour constater l’occupation illégale. Le préfet adresse ensuite aux squatteurs du domicile une mise en demeure de quitter les lieux, assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures.
Toutefois, depuis la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », le préfet peut opposer aux locataires ou aux propriétaires la trêve hivernale, qui débute chaque année le 1er novembre et s’achève le 31 mars, pour refuser de faire procéder à l’expulsion des occupants illégaux au cours de cette période. Dans ce cas, les personnes seront contraintes de saisir le juge pour solliciter le prononcé de l’expulsion en référé. On peut légitimement s’interroger sur la justesse de cette évolution : s'agissant d’une installation par la force dans le domicile d’autrui, il semble surprenant que la trêve hivernale protège l’occupant illicite au détriment de l’occupant en droit.

Cependant, ce n’est pas le sujet du jour. Peut-être faudra-t-il, après l’hiver, faire rapidement le bilan de cette récente évolution législative, afin de voir si elle a permis de mieux protéger le droit au logement de chacun.
J’en viens à la procédure pénale. En cas de flagrant délit de violation de domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal, les forces de police ou de gendarmerie peuvent intervenir immédiatement et diligenter une enquête permettant notamment d’arrêter l’auteur de l’infraction sur les lieux et de le placer en garde à vue. Dans ce cadre, les interventions des forces de l’ordre se font sous l’autorité du procureur de la République, et non sous celle du préfet, comme le prévoit la circulaire du 26 août 1994 relative à la prévention des expulsions de locaux et à l’exécution des décisions de justice prononçant une expulsion de locaux d’habitation.
Aux termes de l’article 53 du code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. » L’article 226-4 du code pénal, dans sa rédaction en vigueur, punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet ».
La présente proposition de loi vise à modifier les dispositions de l’article 226-4 du code pénal afin de faire de la violation de domicile une infraction continue. Concrètement, dès lors que l’introduction dans les lieux aura été illicite, il ne sera pas nécessaire de caractériser de nouveaux comportements illicites durant le maintien dans les lieux pour que les forces de l’ordre puissent intervenir dans le cadre de la flagrance. Il s’agit d’ajouter à l’article 226-4 du code pénal un alinéa permettant aux forces de l’ordre de diligenter une enquête dans le cadre de la flagrance tant que les occupants se maintiennent dans le domicile. Peu importerait donc que l’intrusion ait eu lieu plusieurs jours ou plusieurs semaines auparavant.
Si ce texte venait à être adopté, il serait donc possible, à tout moment, y compris en période de trêve hivernale, d’avoir recours aux forces de l’ordre sans aucun contrôle juridictionnel et sans respect du principe du contradictoire. Si ce n’est pas la position actuelle de nos juridictions, c’est néanmoins ce qui ressort déjà d’une circulaire de la Chancellerie datant de mai 1993, qui précise que « le nouveau code pénal étend la répression à l’hypothèse du maintien dans le domicile d’autrui, transformant ainsi cette infraction instantanée en délit continu ».
Je souligne également que les dispositions de la proposition de loi, telles que corrigées par notre commission des lois, permettraient aux forces de l’ordre de qualifier pénalement un lieu de « domicile » ou une infraction de « maintien dans le domicile » au sens de l’article 226-4 du code pénal sans qu’aucun juge puisse se prononcer et, le cas échéant, requalifier les faits. N’y aura-t-il pas des cas où la police ou la gendarmerie, sur lesquelles le texte fait peser une lourde responsabilité, ne seront pas en mesure, par exemple parce que les faits remontent à plusieurs mois, de déterminer si l’introduction dans le domicile a bien eu lieu à l’aide de voies de fait ou de manœuvres ?
Il n’en demeure pas moins que la protection des victimes de violation de domicile, souvent fragiles et désemparées, exige des dispositifs rapides, lisibles et efficaces.
Madame Bouchart, nous connaissons la situation dont sont victimes les habitants de Calais : c’est un concentré de la misère et des conflits du monde, mais elle témoigne aussi, lorsque l’on regarde les migrants, de la force de l’espoir et de la volonté de s’en sortir de ces gens qui cherchent une terre accueillante pour eux, ou supposée telle.
Les difficultés doivent donc être appréhendées dans une vision globale, intégrant la crédibilité de notre politique d’asile et la gestion de l’immigration au niveau européen ; nous avons évoqué cette question la semaine dernière avec nos collègues britanniques, dans le cadre d’une audition de la commission des affaires européennes.
Nous nous en sortirons par une meilleure convergence européenne et une révision des règlements Dublin et Eurodac, afin que les pays européens les plus éloignés des zones d’arrivée des migrants ne rejettent pas toute la responsabilité de la gestion des flux et de l’accueil des migrants sur les pays qui constituent les frontières sud et est de l’Union européenne.
Nous nous en sortirons aussi en chassant résolument tous les réseaux et toutes les mafias qui prospèrent là où la misère et l’espoir des migrants convergent.
Cela étant, il ne faut en aucun cas légiférer dans l’émotion, en adoptant une loi de circonstance qui ne serait qu’un communiqué de presse ne résolvant en rien ces problèmes précis et tragiques.
La plupart des squats de Calais ne concernent probablement pas des domiciles. C’est donc une réponse beaucoup plus large qu’il faut apporter. Pour ce faire, vous avez besoin de la solidarité nationale et de la solidarité européenne, et non de remettre en cause, à travers deux amendements, l’ensemble de l’édifice destiné à protéger non seulement la propriété et l’inviolabilité du domicile, mais aussi le droit au logement des plus fragiles, des familles sans moyens pour lesquelles un toit volé est la seule option si elles veulent ne pas être à la rue avec leurs enfants.
Cette situation, indigne de notre pays, est la conséquence de la crise sociale, de la situation de l’emploi, de la crise du logement, des blocages de notre société et de la précarité rampante et croissante. Mas avons-nous vraiment le droit de déchirer, à la veille de l’hiver, les outils juridiques qui permettent de garantir à chacun l’indigne minimum, alors que nous n’avons rien d’autre à offrir ? Tel est bien l’objet de vos amendements, qui visent à étendre les dispositions de la proposition de loi à l’ensemble des locaux susceptibles d’occupations illégales, qu’il s’agisse d’habitations, d’usines désaffectées ou d’autres locaux abandonnés.
Le groupe socialiste du Sénat votera évidemment contre ces amendements, qui ne correspondent en rien aux dispositions adoptées par la commission.
Attachés au respect du droit des victimes de violation de domicile, nous avons décidé de nous abstenir sur le texte de la commission, mais nous voterons contre la proposition de loi si l’un des amendements que je viens d’évoquer est adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les squats soulèvent de nombreux problèmes, auxquels nous sommes tous confrontés dans nos départements : insalubrité, nuisances, colère des riverains, dégradations et parfois même violence.
Présidente de Côte d’Azur Habitat, le premier bailleur social des Alpes-Maritimes, je rencontre quotidiennement ces situations qui remettent en cause la justice sociale et le droit de propriété. Dans mon département, nous subissons même une accentuation de ce phénomène, notamment, mais pas seulement, au sein du parc social.

Depuis cinq ans, en raison de la transformation du profil type du squatteur, des réseaux mafieux qui connaissent les limites de la loi ont fait du squat une économie souterraine. Nous sommes passés du marginal sans domicile qui fait face à un accident de la vie, avec ou sans sa famille, à de véritables réseaux de crime organisé.
Les grands bouleversements géopolitiques des dernières années ont entraîné l’arrivée de nouvelles populations sur notre territoire. Ces dernières n’hésitent pas à repérer des logements vacants puis à les affecter moyennant finances à des familles en déshérence sociale, en utilisant des méthodes techniques qui nécessitent de gros moyens. Je pense notamment à l’utilisation de disqueuses thermiques, qui permettent la violation de logements, mais sont également utilisées pour des cambriolages de commerces d’informatique et de téléphonie ou d’habitations de particuliers.

Mme Dominique Estrosi Sassone. Côte d’Azur Habitat, qui gère un patrimoine de 20 000 logements, a engagé plus de 140 procédures devant les tribunaux sur les deux dernières années, alors que la moyenne annuelle des années précédentes se situait à environ 40 squats. Le coût d’une procédure s’élève en moyenne à 8 900 euros par squat : 1 900 euros de frais de procédure et approximativement 7 000 euros de perte de loyers. Sur les deux dernières années, le coût financier s’est donc élevé à plus de 1, 2 million d’euros ; cette dépense s’est faite au détriment de l’entretien du parc ou des logements des locataires en titre.
Mme Cécile Cukierman s’exclame.

En outre, lorsque les bailleurs réussissent à reprendre possession d’un logement squatté, ils le trouvent régulièrement saccagé, voire détruit, ce qui retarde son attribution à une famille qui a peut-être formulé sa demande plusieurs années auparavant. À cela s’ajoutent les nuisances, les portes défoncées, les raccordements sauvages à l’électricité, ainsi que la mise en danger des biens et des personnes qui résident dans le parc social. C’est le principe même de justice sociale qui disparaît, alors que certains demandeurs accomplissent le parcours du combattant pour obtenir un logement social.
Certaines situations montrent que l’usage juridique du délai dans lequel la flagrance peut être constatée est insuffisant et ne permet pas toujours de répondre aux besoins, notamment dans le parc social. En pratique, il est presque impossible d’obtenir l’intervention du préfet moins de quarante-huit heures après l’introduction de squatteurs. Même si la loi ne prévoit pas textuellement ce délai de quarante-huit heures, l’administration l’applique, par crainte d’une censure des tribunaux. Les organisateurs de squats le savent et en jouent !
Un logement squatté une veille de week-end a ainsi peu de chance de faire l’objet d’une intervention avant le début de la semaine suivante, car, même si la préfecture et les forces de l’ordre sont de bonne volonté, elles ne sont pas juges des conditions d’entrée dans les lieux. En outre, certains signes d’élection de domicile, comme un courrier préalablement envoyé par voie postale à ladite adresse, empêcheront tout simplement les forces de l’ordre d’intervenir et l’expulsion du squatteur relèvera du tribunal d’instance. Commence alors une véritable course pour connaître l’identité des occupants afin de pouvoir entamer la procédure.
Il existe un vide juridique relatif dans la mesure où, même si les juges ont la possibilité d’ordonner l’évacuation des locaux dans lesquels des personnes sont entrées sans titre ou par voie de fait, il arrive bien souvent que l’exécution des décisions de justice ne soit pas assurée. La procédure est donc largement perfectible.
Au vu des chiffres de mon département, les Alpes-Maritimes, il ne s’agit pas, avec cette proposition de loi, d’un texte d’affichage médiatique, mais bien de l’expression d’une volonté de renforcer nos moyens contre une forme de délinquance face à laquelle beaucoup d’élus, de propriétaires et de bailleurs se sentent impuissants.
Monsieur le secrétaire d'État, il serait également pertinent de s’attaquer, peut-être par voie réglementaire, aux sites internet de certaines associations qui font l’apologie du squat et encouragent le passage à l’acte en publiant un « guide du parfait squatteur ».
M. Jean-Patrick Courtois applaudit.

Nous espérons que cette proposition de loi permettra de mieux appréhender ces pratiques abusives et illégales. Nous nous devons en effet de venir en aide à nos concitoyens par l’écriture d’un texte lisible et efficace, afin que quiconque puisse laisser son domicile ne serait-ce que quelques jours en toute quiétude, sans risquer de se trouver démuni à son retour. Je terminerai en soulignant que la propriété, c’est la République ; sans propriété, il n’y a pas de République !
Vifs applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, madame Bouchart, mes chers collègues, je suis heureux d’avoir l’occasion d’expliquer devant vous les raisons qui me poussent à défendre cette proposition de loi.
Le principe de l’inviolabilité du domicile est le prolongement de la liberté individuelle, qui constitue l’un des principes fondamentaux du droit français. Il est garanti par la Constitution et figure explicitement dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 comme l’un des quatre droits naturels et imprescriptibles de l’homme.
Or, aujourd’hui, il est toujours plus facile d’occuper illégalement un domicile que de mettre un terme à une occupation illégale. En tant qu’élus, nous connaissons tous ces situations difficiles pour les propriétaires victimes de ces infractions.
Ce texte n’est pas problématique, comme certains se plaisent à le dire, en évoquant par exemple, à tort, la trêve hivernale, qui ne s’applique pas pour les logements squattés : il vise simplement à préciser l’infraction de violation de domicile et non pas à mettre en place une nouvelle procédure d’expulsion des squatteurs dérogatoire du droit commun.
C’est donc bien la sagesse de cette proposition de loi, telle que rédigée par la commission, qui m’engage.
J’en veux pour preuve la suppression de l’article 2, qui facilitait la procédure d’expulsion par voie de décision administrative en permettant au maire, lorsqu’il ne réussissait pas à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, de demander au préfet de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux.
Si cette écriture pouvait attribuer un droit nouveau au maire, il est vrai qu’elle engageait, une fois encore, la responsabilité des édiles, déjà bien mise à l’épreuve, et je parle en connaissance de cause. Cette disposition a donc été écartée, avec sagesse.
J’évoquerai ensuite, et tout simplement, la clarté et la précision qu’apporte l’article 1er de cette proposition de loi à la rédaction de l’article 226-4 du code pénal. Cette rédaction permet en effet de lever toute ambiguïté concernant la nature continue de l’infraction de violation de domicile. Ainsi, les forces de l’ordre peuvent intervenir au titre du flagrant délit tout au long du maintien dans les lieux, quelle qu’en soit sa durée.
La rédaction proposée aujourd’hui distingue deux phases de l’infraction de violation de domicile : l’introduction dans le domicile d’autrui et le fait d’y rester.
Si l’introduction dans le domicile d’autrui, pour être sanctionnée, doit se faire à l’aide de « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte », en revanche, le maintien dans le domicile à la suite de l’introduction illégale serait sanctionné en tant que tel, sans qu’il soit nécessaire que ce maintien soit le fait de nouvelles « manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ».
Cette proposition de loi, si elle est adoptée, permettra, tout simplement, de donner des moyens d’action plus précis aux propriétaires confrontés à ces situations.
Je voterai donc ce texte empreint de sagesse et de bon sens, et je vous encourage à faire de même.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC.

La discussion générale a été intéressante, car elle a montré que les points de vue n’étaient pas si éloignés. Même à la gauche de l’hémicycle, on convient qu’il y a bien un vrai problème juridique.
Certes, le problème est avant tout social, du fait du manque de logements, et la seule réponse pénale au problème que pose Mme Bouchart ne saurait être considérée comme suffisante.
Nous allons maintenant passer à la discussion des articles et des amendements ; il me semble qu’un consensus peut être trouvé sur ce texte amendé par la commission.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
L’article 226-4 du code pénal est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou le maintien » sont supprimés ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction visée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »

L'amendement n° 2 rectifié quater, présenté par Mme Bouchart, M. Duvernois, Mme Duchêne, M. J. Gautier, Mme Procaccia, MM. Gilles et Buffet, Mme Deroche et MM. Carle, Cambon et J.P. Fournier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 226-4. – L’introduction dans le domicile d’autrui ou dans un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le maintien dans le domicile d’autrui ou dans un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, à la suite de l’introduction visée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines. »
La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je présenterai en même temps les trois amendements que j’ai déposés sur le texte de la commission.
La commission des lois est connue pour sa grande sagesse, mais il y a la réalité du terrain, et elle s’impose à nous.
Je comprends bien les positions des uns et des autres, et, contrairement à certains, je ne verserai pas dans l’agressivité, car je sais trop ce que c’est, pour les populations, de subir au quotidien le phénomène des squats.
Même si, je le sais, ces amendements ne peuvent pas être votés en l’état aujourd’hui, je sais qu’un jour on ouvrira les yeux et on aura le courage, qui nous manque aujourd’hui, de faire face collectivement à ces situations réelles en reprenant les idées que je défends ici.
Je regrette aussi le procès instruit par certains contre les maires, dans l’exercice de leurs fonctions. On refuse de leur donner certaines responsabilités, alors qu’ils montrent au quotidien qu’ils sont capables d’en assumer beaucoup. Pour ma part, j’ai le sentiment de représenter les maires non seulement de mon département, mais également de toute la France, et je suis très fière, en leur nom, ou au moins au nom d’une grande majorité d’entre eux, de maintenir ces amendements ; leur adoption faciliterait bien la vie de nos édiles, notamment en ce qui concerne leurs relations avec le préfet, qu’il n’est pas bon de prendre pour cible en permanence, comme certains l’ont fait une bonne partie de l’après-midi.
J’en viens plus précisément à la présentation de mes amendements.
L’amendement n° 2 rectifié quater est tout à fait dans l’esprit de la proposition de loi. Nous avons évoqué, dans la discussion générale, l’élargissement du dispositif au-delà du seul domicile. Il est vrai que le domicile est le cœur de la vie privée, mais l’occupation illicite de logements ou d’immeubles vacants, comme des hangars ou des usines désaffectés, risque de devenir un problème aigu si le dispositif législatif visant à lutter contre la violation de domicile est renforcé sans prendre en compte ces autres types de locaux.
L’amendement n° 3 rectifié quater ans a pour objet de prévoir que, dans le cadre de ses pouvoirs de police, lorsqu’il aura connaissance de l’occupation du domicile de l’un de ses administrés ou de l’occupation d’un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, le maire pourra, après avoir cherché par tous les moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux.
Enfin, l’amendement n° 1 rectifié quater, qui tend à modifier l’intitulé de la proposition de loi, est la conséquence de l’amendement n° 2 rectifié quater.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 2 rectifié quater ?

L’amendement n °2 rectifié quater tend effectivement à étendre aux immeubles vacants le régime prévu à l’article 226-4 du code pénal pour le domicile.
À cet égard, je ne peux que reprendre les explications qui ont été données en commission.
Sur le fond, je comprends tout à fait la position de notre collègue. À la limite, on pourrait même souhaiter que cet article couvre l’ensemble du champ des bâtiments susceptibles de faire l’objet de telles intrusions.
En fait, la difficulté résulte purement et simplement de l’application du droit. Comme on l’a vu, il n’y a aucune difficulté sur le plan civil, l’interprétation faite par la Chancellerie dans sa circulaire étant parfaitement claire à cet égard. En revanche, force est de constater qu’une difficulté d’application est apparue à la suite du vote de la loi DALO, qui, dans son article 38, a créé un régime dérogatoire en passant de la compétence du juge judiciaire à celle du préfet, qui est une autorité administrative.
Or nous voyons bien que cet article 38 trouve son fondement dans les dispositions de l’article 226-4 du code pénal, lequel trouve lui-même son fondement dans la jurisprudence et la doctrine civile pour ce qui est de l’interprétation de la notion de « domicile ».
Face à cette forme d’emboîtement, si vous me permettez l’expression, ma chère collègue, soit nous en restons à une interprétation stricte, et nous aurons le bonheur de voir les préfets obligés d’appliquer le dispositif que nous nous apprêtons à adopter, alors que, aujourd’hui, ils se replient sur cette règle prétorienne des quarante-huit heures, soit nous étendons l’ensemble du dispositif, au risque de le fragiliser.
C’est la raison pour laquelle, tout en comprenant votre position au fond, je ne peux qu’en rester à la position exprimée par la commission en demandant le rejet de cet amendement.
Le présent amendement aurait pour conséquence, s’il était adopté, de dénaturer complètement la violation de domicile. Ce délit vise en effet, comme son nom l’indique, à protéger non la propriété, mais le domicile des individus, en tant qu’élément assurant, plus largement, la protection de leur vie privée.
Il figure du reste dans le livre II du code pénal, lequel réprime les atteintes à la personne, et non dans le livre III, qui sanctionne les atteintes aux biens. Plus précisément, il se trouve dans le chapitre VI de ce livre II, qui a pour objet de punir les atteintes à la personnalité, avec, par exemple, les délits d’atteinte à la vie privée ou de violation du secret des correspondances.
Il n’apparaît donc ni souhaitable ni cohérent d’étendre l’incrimination à l’occupation d’immeubles d’habitation qui ne seraient pas considérés comme des « domiciles », ou, à plus forte raison, de hangars ou d’usines désaffectés.
Il convient, en outre, de relever que la notion « d’immeuble d’habitation le devenant de fait » est particulièrement imprécise. Il en résulte que le texte proposé apparaît contraire au principe constitutionnel de légalité des délits, qui exige, vous le savez, une prévisibilité suffisante de la loi pénale.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Monsieur le président, je vais retirer cet amendement, ainsi que les suivants, non sans avoir souligné la qualité du travail réalisé en commun.
Je retiens la proposition, faite par Mme Procaccia, de rappeler à l’administration que le délai de quarante-huit heures est définitivement nul et non avenu.
J’aurais souhaité, il est vrai, aller plus loin, c’est-à-dire étendre le dispositif au-delà du seul domicile. J’avais également à cœur de préciser le rôle du maire, qui est important. Cependant, je dois admettre que je suis satisfaite de cette avancée, fruit du dialogue avec les uns et les autres.
Je retire donc l’amendement n° 2 rectifié quater.

L’amendement n °2 rectifié quater est retiré.
La parole est à Mme Samia Ghali, pour explication de vote sur l’article.

Je suis satisfaite du retrait de l’amendement. Mme Bouchart a bien compris que le texte de la commission visait le squat d’un logement, lequel n’est pas de même nature que le squat d’un lieu ouvert.
Vous avez déclaré bien connaître la situation, chère collègue, mais, croyez-moi, je vis ces questions au quotidien dans le territoire où je suis élue.
À mon sens, les problèmes sont surtout dus à l’application de la loi par les préfets, qui, malheureusement, même quand la justice demande des expulsions, font traîner les procédures en longueur, sous le prétexte d’enquêtes sociales, qui n’ont en fait jamais lieu, alors qu’elles seraient très utiles. Cette attitude contribue à cristalliser les tensions dans les quartiers, dans les villes, ce qui n’est bon ni pour les uns ni pour les autres.
En revanche, j’y reviens, le squat d’un logement et le squat d’une usine délaissée ne sont quand même pas du même ordre. Aussi, le retrait de l’amendement me satisfait et je voterai l’article ainsi rédigé.
L'article 1 er est adopté.
(Supprimé)

L’amendement n° 3 rectifié quater, présenté par Mme Bouchart, M. Duvernois, Mme Duchêne, M. J. Gautier, Mme Procaccia, MM. Gilles et Buffet, Mme Deroche et MM. Carle, Cambon et J.P. Fournier, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le premier alinéa de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses pouvoirs de police, lorsque le maire a connaissance de l’occupation du domicile d’un de ses administrés ou de l’occupation d’un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, dans les conditions déterminées au premier alinéa, il peut, après avoir cherché par tous moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. »
La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Je ferai trois observations, les deux premières reprenant les motifs qui ont incité la commission à supprimer l’article 2 et la troisième venant renforcer les arguments que j’ai développés pour demander à notre collègue de retirer l’amendement n° 2 rectifié quater.
Tout d’abord, ma chère collègue, vous proposez de confier au maire la possibilité de saisir le préfet au titre de l’article 38 de la loi DALO. Or, nous le savons très bien, dans le type de situation qui a été évoqué cet après-midi, les relations entre le maire et le préfet sont telles que l’on peut considérer que le préfet est déjà saisi sur interpellation du maire et qu’il n’est pas nécessaire de consacrer une disposition spéciale à cette saisine.
Ensuite, en voulant faire ce « cadeau » au maire, vous lui conférez certes un droit, mais vous lui faites surtout courir un risque. En effet, vous autorisez le maire à se substituer à un propriétaire qui n’a pas exprimé sa position, puisque c’est la raison même pour laquelle on accorde cette possibilité au maire. Imaginez les mises en cause auxquelles vous exposez le maire, en termes de responsabilité, soit parce qu’il aura agi, soit parce qu’il n’aura pas agi. Or nous pouvons considérer que, dans l’état actuel du droit, rien n’empêche le maire d’interpeller le préfet pour mettre en œuvre l’article 38 de la loi DALO.
Enfin, beaucoup plus grave, ma dernière observation a trait à l’extension de ce droit de saisine du maire non seulement aux domiciles et aux logements, mais aussi aux immeubles vacants. Sur ce point, je tiens à souligner les risques d’inconstitutionnalité que nous ferions courir au dispositif de l’article 38 de la loi DALO, qui nous paraît déjà relativement fragile.
Lors de la réunion de la commission, nous avons évoqué le fait que des dispositions très proches de celles dont nous discutons aujourd’hui ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel. Je suis convaincu que, si le Conseil constitutionnel était saisi aujourd’hui des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction actuelle, nous pourrions déjà nous interroger ; mais si nous modifiions l’article 38 dans le sens souhaité par l’auteur de l’amendement, il ne fait pas de doute que nous nous exposerions à une censure !
Nous pensons donc que le droit actuel, malgré ses limites, présente un réel avantage en raison de la possibilité déjà ouverte par la loi DALO, raison pour laquelle je demande à l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer, pour ne pas fragiliser davantage cette disposition.
Je souscris à l’ensemble des arguments que vient de développer M. le rapporteur et je n’ajouterai que deux observations.
En premier lieu, les conditions d’application des dispositions que vous proposez, madame la sénatrice, sont extrêmement floues. Votre proposition de loi ne détermine pas précisément les preuves que le maire devra fournir au préfet pour justifier sa demande.
En second lieu, il existe un risque d’atteinte aux droits de l’occupant légitime, dès lors que le maire aurait la possibilité de saisir le préfet sans l’accord du propriétaire ou du locataire.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Je tenais à remercier M. le rapporteur de ses explications juridiques, parce que nous n’appartenons pas tous à la commission des lois et que nous n’avons pas tous nécessairement les compétences de ses membres !
Si j’ai cosigné cet amendement, c’est parce que le maire est la personne vers laquelle on se tourne le plus rapidement. Imaginez des personnes âgées qui trouvent leur logement squatté en rentrant chez elles – un cas s’est encore produit récemment dans le Val-de-Marne ; à qui s’adressent-elles sinon à leur maire, faute de savoir quoi faire ? Dans ces conditions, permettre au maire de saisir le préfet ne me paraissait pas choquant.
Certes, le maire peut déjà aider les personnes concernées en leur indiquant qu’elles ont la possibilité de saisir le préfet dans le cadre de l’article 38 de la loi DALO, mais il me paraissait important de lui permettre de le faire lui-même, sans qu’il en ait l’obligation.
Dans un certain nombre de communes, il n’est pas rare de voir des personnes âgées partir plusieurs mois, ne serait-ce que pour séjourner chez leurs enfants. L’occupant peut donc ne pas être informé du fait que son logement est squatté et, même si l’on organise une veille entre voisins, on ne peut pas toujours savoir qui entre chez les uns ou chez les autres. Le maire est donc l’autorité la plus proche et la plus en mesure d’intervenir.
Cet amendement me paraissait donc aller dans le bon sens, mais M. le rapporteur nous a expliqué en quoi il était mal rédigé. Quoi qu’il en soit, il me semble que l’on ne peut pas balayer complètement l’idée que le maire doive jouer un rôle d’appui pour obtenir l’expulsion de squatteurs. Dans le cadre de l’article 38 de la loi DALO, c’est au propriétaire ou au locataire qu’il appartient de saisir le préfet. Or j’ai pu me rendre compte, au cours des derniers mois, que ces personnes ignorent le plus souvent que cette possibilité leur est ouverte.

Compte tenu des explications qui ont été données et pour ne pas fragiliser davantage le dispositif, je retire mon amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 3 rectifié quater est retiré.
L’article 2 demeure donc supprimé.

L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par Mme Bouchart, M. Duvernois, Mme Duchêne, M. J. Gautier, Mme Procaccia, MM. Gilles et Buffet, Mme Deroche et MM. Carle, Cambon et J.P. Fournier, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi visant à lutter contre la violation de domicile et l’occupation illicite d’immeubles d’habitation
La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Dans la suite logique des explications données sur les deux premiers amendements, je tiens à insister sur le fait que cette proposition de loi vise bien à préciser les modalités d’exécution du droit existant et non à changer ce dernier.
La commission souhaite donc que cet amendement soit retiré.

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Je tiens à saluer l’esprit qui a présidé à nos échanges. Mon intervention en discussion générale était très juridique, peut-être trop, parce que l’interprétation de la flagrance, telle qu’elle résulte de la circulaire de la Chancellerie, était relativement complexe.
Le texte de la proposition de loi, après les travaux de la commission et la discussion en séance publique, ne vise plus que la violation de domicile, dont il fait un délit continu. De ce fait, même si j’ai annoncé précédemment que le groupe socialiste s’abstiendrait, je sens qu’un certain nombre de mes collègues souhaiteraient pouvoir le voter en l’état.
J’ajoute cependant que mon intervention soulignait quelques fragilités qui, si cette proposition de loi devait prospérer, mériteraient malgré tout d’être étudiées dans la suite de la procédure parlementaire.
En tout état de cause, dans la mesure où cette proposition de loi se concentre sur la violation de domicile, délit qui mérite d’être combattu – sur ce point, j’ai indiqué que la loi ALUR avait peut-être fragilisé le dispositif que Mme Procaccia avait introduit avec l’article 38 de la loi DALO –, je crois pouvoir dire qu’un certain nombre de collègues du groupe socialiste voteront en sa faveur.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Je suis heureuse de pouvoir voter cette proposition de loi, puisque Mme Bouchart a accepté de retirer tous ses amendements, ce qui a contribué à éclaircir la situation.
Sur tous nos territoires, la situation vécue par ceux qui subissent des squats est bien douloureuse et les maires se trouvent démunis quand ils essaient de les aider. J’ai vu des élus de tous bords politiques qui, confrontés à cette situation, essayaient de trouver des solutions, parfois pour éviter des débordements.
Comme je l’ai dit, il serait sage que nous puissions avoir un débat plus large sur ce type de question. D’une part, les attentes des demandeurs de logements, qui sont sincères et vivent une vraie souffrance, ne peuvent pas trouver de réponse avec la loi DALO – c’est un leurre ! Or il faut que nous puissions agir en leur faveur. D’autre part, nous avons affaire à des squatteurs souvent organisés pour utiliser les faiblesses du droit français, et je rejoins en partie ce qu’a dit Mme Estrosi Sassone à cet égard.
Je le répète, les préfets ont une grande responsabilité dans l’application de la loi. J’insiste sur ce point, monsieur le secrétaire d’État. Certains ont évoqué le risque que cette proposition de loi n’alourdisse la responsabilité des maires, et ce n’est évidemment pas le but, mais il convient de rappeler aux préfets qu’il leur appartient de faire respecter la loi.
Je suis donc heureuse de pouvoir voter ce texte avec vous, mes chers collègues.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Ce texte nous satisfait, puisque les deux amendements introduits par M. le rapporteur en commission répondaient tout à fait à notre attente. Par ailleurs, Mme Bouchart a accepté de retirer ses amendements en séance publique et le texte adopté par la commission sera donc soumis à notre vote sans modification.
Mais ne cédons pas à la tentation du manichéisme. Dans la société où nous vivons, il faut faire preuve d’une grande prudence : il n’y a pas toujours les bons d’un côté et les mauvais, de l’autre, et nous savons que les problèmes qui nous occupent aujourd’hui sont très délicats à résoudre.
Le groupe du RDSE votera donc cette proposition de loi. Ce faisant, nous répondons à l’appel d’un maire, ce qui est de la mission du Sénat, représentant des collectivités territoriales, en particulier des communes.

Je souhaite indiquer à Mmes Bouchart et Procaccia que je transmettrai leurs suggestions et leurs demandes à mes collègues ministres de l’intérieur et de la justice, afin qu’ils donnent des instructions aux préfets, pour l’un, aux parquets, pour l’autre.
J’avais indiqué à la tribune que le Gouvernement s’en remettait à la sagesse de votre assemblée. Après avoir entendu Jean-Yves Leconte et Samia Ghali, je constate une fois de plus que la sagesse est vraiment très grande dans cet hémicycle ; par conséquent, le Gouvernement ne peut que se sentir conforté dans sa volonté de la laisser s’exprimer.

Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble de la proposition de loi visant à faciliter l’expulsion des squatteurs de domicile.
La proposition de loi est adoptée.

M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le huitième rapport du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire.
Acte est donné du dépôt de ce rapport.
Il a été transmis à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de cet après-midi étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures trente, est reprise à vingt-et-une heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.