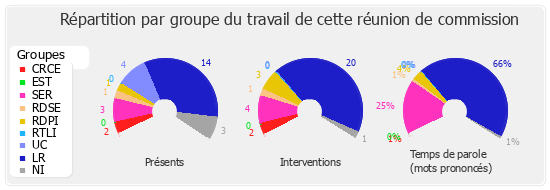Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 9 novembre 2016 à 10h10
Sommaire
- Communications diverses (voir le dossier)
- Nomination d'un rapporteur (voir le dossier)
- Création d'une commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures intégrant les mesures d'anticipation les études préalable les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée
- Création d'une commission d'enquête sur les frontières européennes le contrôle des flux des personnes et des marchandises en europe et l'avenir de l'espace schengen - nomination d'un rapporteur pour avis et examen de deux rapports pour avis (voir le dossier)
- Statut de paris et aménagement métropolitain
- Loi de finances pour 2017
La réunion

Nous recevrons le ministre de l'intérieur à propos du fichier des cartes nationales d'identité et des passeports mardi 15 novembre à 9 heures. L'audition sera ouverte aux membres des autres commissions, ainsi qu'à la presse.

La date de cet éventuel débat n'a pas encore été fixée. Ce débat répondrait à un souhait de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil), repris à son compte par le ministre de l'intérieur. L'audition de la semaine prochaine nous donnera déjà la possibilité d'approfondir la question.
J'ai également demandé à entendre le président du Conseil national du numérique et la présidente de la Cnil. Le Sénat a été à l'origine d'une proposition de loi adoptée en 2012 contre les usurpations d'identité, une tragédie qui touche un nombre croissant de nos concitoyens.

Sans compter les faux papiers utilisés par les arrivants sur le territoire national.

Dès 2005, le Sénat avait envisagé la création d'un fichier numérique fiable des documents d'identité. La proposition de loi sénatoriale déposée en 2010 a malheureusement été déséquilibrée par un amendement du Gouvernement après un accord en commission mixte paritaire qui a provoqué un dernier mot de l'Assemblée nationale et une censure du Conseil constitutionnel en 2012 ; il reste que notre travail a été, à mon avis, respectueux des libertés, consensuel et utile.

Nous devons désigner un rapporteur sur le projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Un grand nombre des articles de ce texte seront délégués au fond aux autres commissions permanentes, mais la nôtre est traditionnellement compétente sur les textes relatifs à l'outre-mer. Je propose la désignation de Mathieu Darnaud, qui a déjà rapporté plusieurs textes sur ce thème.
M. Mathieu Darnaud est nommé rapporteur sur le projet de loi de programmation n° 19 (2016-2017), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique.
Création d'une commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures intégrant les mesures d'anticipation les études préalable les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée
Création d'une commission d'enquête sur les frontières européennes le contrôle des flux des personnes et des marchandises en europe et l'avenir de l'espace schengen - nomination d'un rapporteur pour avis et examen de deux rapports pour avis
Philippe Bas est nommé rapporteur pour avis sur la proposition de résolution n° 75 (2016-2017), présentée par M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée, ainsi que sur la proposition de résolution n° 96 (2016-2017), présentée par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe Les Républicains, apparentés et rattachés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les frontières européennes, le contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et l'avenir de l'espace Schengen.

Nous sommes saisis d'une proposition de résolution, présentée par M. Ronan Dantec et les membres du groupe écologiste, tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réalité des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité engagées sur des grands projets d'infrastructures, intégrant les mesures d'anticipation, les études préalables, les conditions de réalisation et leur suivi dans la durée et d'une proposition de résolution, présentée par M. Bruno Retailleau et les membres du groupe Les Républicains, apparentés et rattachés, tendant à la création d'une commission d'enquête sur les frontières européennes, le contrôle des flux des personnes et des marchandises en Europe et l'avenir de l'espace Schengen.
Vous venez de me désigner comme rapporteur. J'ai constaté que les conditions juridiques requises pour la création de ces commissions d'enquête étaient remplies. Je vous propose donc d'adopter mes rapports pour avis et d'admettre que les propositions de résolution sont recevables.
La commission déclare recevables les deux propositions de résolution.
La commission poursuit l'examen des amendements sur son texte n° 83 (2016-2017) sur le projet de loi n° 815 (2015-2016) relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (procédure accélérée).
EXAMEN DE L'AMENDEMENT DU RAPPORTEUR
Article 10

Mon amendement n° 150 est un amendement de conséquence de la suppression de l'article 4 instituant une commission permanente.
La commission adopte l'amendement n° 150.
EXAMEN DES AMENDEMENTS DE SÉANCE
Articles additionnels après l'article 35

J'ai longtemps cherché le lien entre le texte initial et l'amendement n° 145 qui précise le statut juridique de l'établissement public du campus Condorcet. Toutefois, plutôt que de vous proposer de déclarer irrecevable cet amendement, j'en demande le retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 145 et, à défaut, y sera défavorable.

Reprenant la logique de deux amendements déposés en commission par nos collègues Sophie Primas, Alain Vasselle et Alain Richard mais déclarés contraires à l'article 40 de la Constitution, l'amendement n° 147 rectifié du Gouvernement autorise à titre expérimental la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) d'Île-de-France à exercer son droit de préemption sur la vente de parcelles forestières d'une superficie inférieure à 3 hectares, alors qu'aujourd'hui elle ne peut préempter que les surfaces inférieures à un demi hectare en petite couronne et à un hectare en grande couronne. Élargir le droit de préemption permettrait de lutter contre le mitage des parcelles constaté en Ile-de-France. Avis favorable.

J'y suis favorable à la condition que le droit de préemption prévu dans l'amendement soit parfaitement encadré. Depuis quelques années, les Safer ont tendance à agir comme des agences immobilières tout en jouissant de davantage de droits que ces dernières. Cela crée une situation inéquitable.

En Île-de-France, se multiplient les achats à bon compte de parcelles forestières abandonnées pour y faire ensuite de l'habitat dispersé. Ces opérations contribuent à la dégradation du patrimoine forestier et du cadre de vie. D'où la mesure proposée, que le Gouvernement a bien voulu reprendre dans cet amendement, qui vise à protéger le patrimoine forestier dans une région où la pression foncière est très forte. Les Safer n'auront le droit de préempter que dans certains cas.

Avant toute vente de parcelle forestière, le droit en vigueur impose aux notaires de consulter les propriétaires riverains, qui ont un droit d'acquisition prioritaire. Attention à ne pas les priver de ce droit en autorisant les Safer à préempter. En réalisant des acquisitions à droit minoré, ces dernières pourraient retirer un avantage financier de la revente des parcelles. Voilà le véritable problème.

L'amendement prévoit - je cite l'objet - que le droit de préemption des Safer « ne peut l'emporter sur les droits de préférence prévus par l'article L. 331-19 du code forestier bénéficiant aux propriétaires de terrains boisés contigus ». Cela ne répond-il pas à votre préoccupation ?
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 147 rectifié.
Article 37

Je comprends la logique de l'amendement n° 129 du Gouvernement qui sépare la fonction de directeur général de Grand Paris Aménagement de celle de président du conseil d'administration. Toutefois, il a été déposé trop tardivement pour me laisser le temps de mener les auditions et entretiens qui s'imposent. De plus, la répartition des sièges entre l'État et les collectivités locales et la date à laquelle un décret doit modifier un autre décret relèvent du pouvoir réglementaire.
À ce stade de la réflexion, avis défavorable.

Je partage les réserves du rapporteur. Cet amendement modifie substantiellement la gouvernance de Grand Paris Aménagement. Certes, la métropole n'y est pas représentée en tant que telle en l'état du droit, mais les territoires qui la composent le sont. Tout cela mériterait un examen plus détaillé.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 129.
Article additionnel après l'article 37

L'amendement n° 144 du Gouvernement, qui modifie des dispositions de la loi « liberté de la création, architecture et patrimoine » relatives à la publicité à proximité des monuments historiques, est un cavalier législatif. À ce titre, il est irrecevable.
L'amendement n° 144 est déclaré irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution.
Article additionnel après l'article 39

L'amendement n° 146 relatif à la desserte de l'aéroport de Roissy appelle la même remarque que l'amendement n° 129. Le Sénat a adopté lundi le projet de loi relatif au Charles-de-Gaulle Express... Il y a là un problème de méthode. Le CDG Express, le RER B et la ligne 17 du Grand Paris Express relieront, à terme, Paris à l'aéroport de Roissy. Il convient de les traiter ensemble. Or dans cet amendement, le Gouvernement revient sur la desserte assurée par le Grand Paris Express en prévoyant un arrêt de quatre minutes en gare de Pleyel. Dans ces conditions, retrait ou avis défavorable.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 146 et, à défaut, y sera défavorable.
Articles additionnels après l'article 41 (supprimé)

L'amendement n° 130 remédie à la censure par le Conseil constitutionnel, le 21 octobre 2016, de la procédure de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d'une commune nouvelle résultant de la fusion de communes appartenant à des EPCI distinctes, prévue au II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales. Il reprend une disposition adopté par le Sénat le 26 octobre dernier lors de l'examen de la proposition de loi sur la recomposition de la carte intercommunale. En l'absence de certitude sur l'adoption de cette dernière avant la fin de l'année, il me semble opportun d'adopter l'amendement.

Je me félicite que le Gouvernement se préoccupe de la cohérence des limites des communes nouvelles et intercommunalités ; mais cela doit s'inscrire dans une vision globale des circonscriptions administratives. Ainsi, dans le bouleversement actuel, rien n'est prévu pour aider les intercommunalités à éviter les chevauchements sur deux ou trois départements.

Je me rallie à l'avis du rapporteur, mais nous nous éloignons du coeur du texte. Attendons le bilan général de la mission de suivi et de contrôle de la mise en oeuvre de la loi NOTRe désignée par notre commission pour élaborer un texte global, plutôt que de corriger les dispositions de la loi au fil des textes.

Je partage votre analyse. Notre mission de suivi, qui a souhaité conduire un travail exhaustif, rendra son rapport avant de la fin de l'année. Je n'ai pas souhaité déclarer cet amendement irrecevable car il concerne les métropoles.

C'est un débat de gestion de la procédure législative. Nous avons adopté une proposition de loi rééquilibrant la répartition des conseillers communautaires par accord local, mais elle a peu de chances d'aboutir, n'ayant pas été inscrite en priorité à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel venait d'annuler une disposition permettant aux communes nouvelles de rejoindre l'intercommunalité de leur choix. C'est pourquoi le ministre Jean-Michel Baylet a proposé l'insertion de ces dispositions dans la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Gourault, afin de lui donner une petite chance d'être adoptée. Si, au lieu de cela, nous les transposons dans ce texte, il est probable que la proposition de loi de notre collègue finira dans un tiroir... Tactiquement, cela ne me semble pas judicieux.

Envisagez-vous, comme je crois le comprendre, une révision de la loi NOTRe ?

La mission de suivi et de contrôle a été constituée dans l'idée que son rapport final servirait de base à un texte global qui corrigerait la loi NOTRe et irait plus loin dans certains domaines, puisque nous examinons l'ensemble des lois de réforme territoriale depuis 2010. Des tendances lourdes se dégagent de notre travail, sur l'eau et l'assainissement, les intercommunalités - notamment la question de la revoyure - ou encore les communes nouvelles.

Je remercie nos collègues de la mission de suivi pour leur travail qui progresse rapidement.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 130.

Issus du comité interministériel aux ruralités, les amendements n° 131 et 132 du Gouvernement réduisent, pour le premier, la liste des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et élargissent, pour le second, la liste des attributions que le conseil municipal peut déléguer au maire. En dépit de leur intérêt, ces dispositions me semblent irrecevables car elles ne présentent pas de lien, même indirect, avec le projet de loi.
Les amendements n° 131 et 132 sont déclarés irrecevables au titre de l'article 45 de la Constitution.
AMENDEMENT DU RAPPORTEUR
Le sort de l'amendement du rapporteur examiné par la commission est retracé dans le tableau suivant :
AMENDEMENTS DE SÉANCE
La commission donne les avis suivants sur les amendements de séance :
La commission procède ensuite à l'examen du rapport pour avis de M. Jean-Yves Leconte sur le projet de loi de finances pour 2017 (mission « Direction de l'action du Gouvernement », programme « Protection des droits et libertés »).

Le programme 308 intitulé « Protection des droits et libertés » recouvre dix autorités administratives indépendantes (AAI) et une autorité publique indépendante (API), le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Le budget de ces organismes varie de 200 000 à 38 millions d'euros.
Le montant total des autorisations d'engagement pour ce programme s'élève à 101 millions, en hausse de 4 % par rapport à 2016, et celui des crédits de paiement, à 95 millions, en baisse de 7 %.
Le regroupement d'une partie des AAI dans l'ensemble immobilier Ségur-Fontenoy se poursuit : la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et le Défenseur des droits s'y sont déjà installés cet automne, la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) et la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) devraient les rejoindre dans un an. Ces mouvements ont pour conséquence un transfert des loyers versés du programme 308 vers le programme 129. Les conditions de réalisation de l'opération ayant été débattues à la commission des finances, je me contenterai de constater que la baisse des crédits du Défenseur des droits est liée à ce transfert.
Plusieurs évolutions sont à relever dans les périmètres de compétence des AAI. Conformément à la loi sur la République numérique, la CNIL se voit confier les attributions relatives au droit à l'oubli et à l'anonymisation dans le cadre de l'open data. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) sera chargée de traiter les déclarations de patrimoine des fonctionnaires et des magistrats et de contrôler la pratique du « pantouflage ». Le CSA passera, à sa demande, du contrôle de l'égalité du temps de parole des candidats à l'élection présidentielle à celui de l'équité.
La décision du Conseil constitutionnel relative aux communications hertziennes, en prévoyant la compétence de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) sur les techniques mises en oeuvre par ce moyen de communication, aura pour conséquence un accroissement de l'activité de cette dernière.
Les dispositions du projet de loi dit « Sapin II » prévoyant une aide financière sous forme d'une avance sur les frais de procédure et de secours financier temporaire des lanceurs d'alerte, supprimées par le Sénat, ont été réintroduites hier par l'Assemblée nationale en lecture définitive. Elles devraient engendrer pour le Défenseur des droits une dépense supplémentaire non prévue dans son budget. Le Secrétaire général du Gouvernement m'a indiqué que le financement de cette nouvelle compétence serait abondé par l'État une fois la loi promulguée.
Les autorisations d'engagement de la HATVP doublent, alors que les crédits de paiement sont en augmentation de 60 %. L'autorité, pour faire face à l'afflux de déclarations de patrimoine et d'intérêts que j'ai évoqué, recrute dix ETP supplémentaires. Toutefois, la mise en place de la procédure de déclaration en ligne, qui lui évitera la conservation de documents papier dont je ne perçois plus l'utilité, m'incite à penser que la HATVP est très bien dotée.

Le CSA, je l'ai indiqué, est favorable au contrôle de l'équité du temps de parole ; toutefois, constatant l'augmentation du nombre de chaînes de radio et de télévision, l'autorité estime que son budget ne suffit pas face à cette tâche plus complexe qu'un simple contrôle d'égalité. Le manque de moyens laisse à penser que le contrôle du CSA sera essentiellement basé sur les déclarations des médias.
Malgré le manque de moyens déploré par son président, Olivier Schrameck, le CSA souhaiterait étendre son rôle de régulateur aux sites internet des chaînes de radio et de télévision, alors que la loi ne le prévoit pas. Par ailleurs, le collège de l'autorité va être réduit, mais je ne dispose pas des chiffres du budget de cet organe.
La CNIL a signalé que le nombre de plaintes et de dossiers qu'elle avait à traiter avait été multiplié par deux entre 2012 et 2015 ; or ce ne sont pas des tâches que peut traiter un algorithme. De là une tension sur son budget. Le règlement européen sur la protection des données qui entrera en vigueur en 2018 prévoit un passage du régime de l'autorisation préalable à un régime de déclaration assorti d'une sanction en cas de non-respect des obligations. La CNIL, dans ce cadre, pourra prononcer des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise contrevenante. La conséquence sera double pour l'autorité : moins d'autorisations à délivrer en amont, et davantage de recettes qui abondent le budget de l'État.
La CNIL nous a aussi indiqué que le blocage des sites pédopornographiques ou faisant l'apologie du terrorisme était confié à une personnalité qualifiée qui n'a pas de suppléant, ce qui pose difficulté. En outre, il est difficile de trouver des agents à la fois volontaires et qualifiés pour visionner ces sites.
2016 a été la première année de plein exercice pour la CNCTR. Elle a pour mission de délivrer un avis préalable sur toutes les demandes de mise en oeuvre des techniques de renseignement, aux termes de la loi de juillet 2015. Elle assure également un contrôle a posteriori. D'après son président, la CNCTR est en mesure de délivrer les avis dans un délai raisonnable. La modification du contexte européen du renseignement appelle une réflexion sur le développement des coopérations entre les services de contrôle des différents États membres.
De taille très réduite, la Commission consultative du secret de la défense nationale (CCSDN) a néanmoins un rôle important, puisqu'elle émet des avis sur la déclassification et la communication d'informations protégées par le secret défense. Son président accompagne également toute perquisition dans des locaux abritant ce type d'informations. Le principal problème de cette autorité - nous en avons fait part, l'année dernière, au Secrétaire général du Gouvernement - est le fait que son fonctionnement est assuré par du personnel détaché du ministère de la défense, ce qui peut porter atteinte à son indépendance.
La Contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), Adeline Hazan, nous a annoncé son intention de mener à bien avant la fin de son mandat la visite de tous les établissements psychiatriques sur le territoire. C'est une mission essentielle qui permet de fixer un cadre aux hôpitaux psychiatriques en matière de privation de liberté. Enfin, Mme Hazan a souligné qu'il restait peu de temps aux contrôleurs pour participer aux questions qui agitent le débat public, comme la détention des mineurs ou la radicalisation. Cette frustration est compensée par des interventions publiques ciblées sur des sujets identifiés comme majeurs.
Malgré ces réserves - en particulier la situation anormale du CCSDN, que le projet de lois de finances pour 2017 ne règle pas en dépit des promesses formulées l'année dernière - je vous propose d'approuver les crédits du programme 308.

Je remercie notre rapporteur pour son travail qui démontre tout l'intérêt de veiller à l'évolution des budgets des autorités administratives dites indépendantes. Ce qu'il a dit sur la HATVP en est l'illustration : il n'a pas été convaincu par les financements octroyés à cette autorité dans le projet de budget. Attention aux dérives, ne serait-ce que financières.

Je m'interroge sur la capacité du CSA à juger en équité - et non plus en égalité - les temps de parole des candidats : disposez-vous d'informations plus précises ?

Notre rapporteur a évoqué le regroupement de plusieurs AAI dans un même site : quels sont les organismes concernés ? Le CSA en fera-t-il partie ?

La CNIL et le Défenseur des droits sont déjà installés dans l'ensemble immobilier Ségur-Fontenoy ; la CADA, le CCNE et la CNCDH devraient les rejoindre d'ici un an.
Je ne dispose pas d'information particulière concernant l'équité, monsieur Collombat : les radios et les télévisions devront déclarer les temps de parole des candidats mais je ne sais qui, in fine, sera juge. Le président du CSA nous a indiqué qu'il ne disposerait pas du personnel pour tout enregistrer et tout regarder. Certes, des logarithmes pourraient y parvenir mais je n'ai hélas pas le sentiment que le CSA dispose de tels outils. La notion d'égalité est objective alors que celle d'équité est beaucoup plus subjective et peut varier en fonction de la déontologie de chaque radio et de chaque chaîne de télévision. Il est paradoxal de prévoir des moyens à l'identique alors que les missions du CSA se sont complexifiées.
Compte tenu du rôle de « vigie » de certaines AAI en période d'état d'urgence (Défenseur des droits, CGLPL, CNCDH), il est surprenant de constater que la HATVP bénéficie de la plus forte augmentation de crédits. Certes, l'évolution de son périmètre et les élections à venir peuvent le justifier, mais de telles hausses ne sauraient être systématiques.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement ».
Enfin la commission procède à l'examen du rapport pour avis de Mme Catherine Di Folco sur le projet de loi de finances pour 2017 (mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines », programme « fonction publique »).

Pour cet avis budgétaire « fonction publique », je vous propose tout d'abord d'examiner l'évolution des effectifs de la fonction publique d'État.
Un rappel : la fonction publique représente plus de 5 millions d'équivalents temps plein (ETP), soit environ 20 % de l'emploi total. Ces effectifs sont répartis entre l'État (45 % des ETP), les collectivités territoriales (34 %) et les hôpitaux (21 %).
En 2012, l'objectif du Gouvernement était de stabiliser ces effectifs au cours du quinquennat. Des créations de postes étaient prévues dans des secteurs identifiés comme prioritaires (enseignement, justice, sécurité), tout comme une réduction à due concurrence des effectifs dans les autres domaines d'intervention de l'État.
S'agissant des créations, 60 000 postes supplémentaires dans le secteur de l'enseignement et 5 000 dans ceux de la sécurité et de la justice étaient annoncés pendant le quinquennat. À cet objectif initial se sont ajoutés l'actualisation de la loi de programmation militaire (LPM), avec la création de 2 300 postes au ministère de la défense en 2016, et le pacte de sécurité, annoncé par le président de la République à la suite des attentats de 2015, qui prévoyait la création de 8 500 emplois supplémentaires sur deux ans.
Durant ce quinquennat, un total de 75 800 postes supplémentaires a ainsi été annoncé pour les secteurs prioritaires. En prenant en compte les créations de postes prévues par le projet de loi de finances pour 2017, cet objectif devrait être dépassé avec 79 527 emplois créés depuis 2012. Cet écart s'explique principalement par des créations de postes supplémentaires dans les secteurs de la justice et de la sécurité.
Parallèlement, 36 447 postes ont été supprimés en cinq ans, notamment 15 000 postes au ministère de la défense en 2013 et 2014, 11 000 postes au ministère des finances et des comptes publics, etc.
Durant ce quinquennat, les créations nettes de postes dans la fonction publique d'État s'établiraient ainsi à 43 080. L'objectif initial de stabilité des effectifs n'a donc pas été tenu.
Corrélativement, la masse salariale de l'État a augmenté de 3,2 milliards d'euros par rapport à 2016, pour un total de 84,69 milliards en 2017, soit + 4 %. Cette augmentation s'explique notamment par la création de nouveaux postes, pour des dépenses supplémentaires estimées à 560 millions, et par l'augmentation de 0,6 % de la valeur du point d'indice pour un montant de 850 millions. Il s'agit de la deuxième hausse consécutive de cet indice, après six années de gel. Enfin, la mise en oeuvre du protocole « parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR) coûtera 687 millions en 2017.
En 2015, la Cour des comptes avait qualifié de préoccupante l'augmentation de la masse salariale de l'État, cette tendance contribuant à aggraver le déficit public et empêchant de dégager des marges budgétaires supplémentaires pour rénover la gestion de la fonction publique. Je ne peux que suivre cette position.
J'en viens maintenant à l'étude du programme 148 « fonction publique ».
Piloté par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), ce programme est intégré à la mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines ». Il comprend trois actions : la formation interministérielle, l'action sociale interministérielle et le développement de l'apprentissage. Ce programme ne concerne que les politiques interministérielles de ressources humaines : il vise à appuyer et à compléter les initiatives ministérielles, non à s'y substituer.
Au titre du projet de loi de finances pour 2017, le programme 148 est doté de 245,14 millions d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation de 4,57 % par rapport à 2016. Les crédits consacrés à l'action sociale interministérielle restent stables. Ceux alloués à la formation augmentent de 6,34 % et ceux alloués à l'apprentissage de 18,57 %.
Concernant la formation interministérielle des fonctionnaires, près de 90 % des crédits du programme 148 sont destinés à l'École nationale d'administration (ENA) et aux instituts régionaux d'administration (IRA). Les crédits se montent à 83,13 millions d'euros, soit une hausse de 4,96 millions par rapport à 2016. Cette augmentation est due à l'accroissement du nombre d'élèves accueillis au sein des IRA et à la création d'un fonds d'innovation RH doté d'un million. Ce fonds permettrait de financer des expérimentations en matière RH sur la base d'un appel à projet national.
Consacrée à l'apprentissage, la deuxième action du programme 148 a été créée en 2016 pour inciter les administrations de l'État à recruter des apprentis. Elle permet de prendre en charge la moitié des coûts de rémunération et de formation des apprentis recrutés en 2015 et 2016. Le montant de cette action augmente de 5,57 millions d'euros pour un total de 35,57 millions. Les objectifs fixés étaient ambitieux : le Gouvernement voulait recruter 4 000 apprentis en 2015 et 10 000 cette année. Les objectifs ont été dépassés pour 2015, avec 4 496 apprentis intégrés à la fonction publique d'État. En revanche, l'objectif pour 2016 n'est pas encore atteint puisqu'en octobre, seuls 7 700 apprentis avaient été recrutés.
Cette action ne s'adresse qu'au versant étatique de la fonction publique et non aux versants territorial et hospitalier, ce qui est regrettable. Les chiffres de recrutement d'apprentis dans la fonction publique territoriale sont d'ailleurs préoccupants : alors que les collectivités sont les principaux employeurs d'apprentis dans le secteur public, leur recrutement est passé de 7 218 en 2014 à 6 510 en 2015.
Je fais une parenthèse concernant l'apprentissage dans la fonction publique territoriale. Le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est missionné depuis l'an passé pour la formation des apprentis, malgré la baisse de la cotisation due par les collectivités territoriales à cet établissement public, cotisation qui est passée en 2015 de 1 % à 0,9 % de la masse salariale. Les réserves financières du CNFPT vont fondre rapidement, d'autant que le taux de 0,9 % est maintenu dans ce projet de loi de finances. Les délégations régionales du CNFPT vont devoir faire plus de formations avec moins de moyens. Nous en reparlerons certainement dans les années à venir.
Ce projet de loi de finances stabilise le montant de l'action sociale interministérielle - troisième composante du programme 148 - à 126,44 millions d'euros. Le programme finance neuf prestations d'action sociale interministérielles. Trois d'entre elles représentent près de 80 % du total : le chèque emploi-service universel (CESU), le chèque-vacances et la réservation de places de crèche.
En complément, j'ai souhaité approfondir l'examen des crédits alloués aux instituts régionaux d'administration (IRA).
Des IRA ont été créés dans cinq villes : Lille, Lyon, Nantes, Metz et Bastia. Outre la formation continue des fonctionnaires en poste, les IRA sont chargés de la formation initiale des attachés d'administration, corps interministériel de catégorie A. Le degré de sélectivité des IRA demeure élevé : 643 élèves ont été admis à la rentrée 2015 sur un total de 10 303 candidatures, soit un taux de réussite de 8,9 %. Je me suis rendue dans les établissements de Lille et de Lyon.

J'y viendrai avec grand plaisir !
Au cours de mes déplacements, j'ai constaté que les formations dans les IRA étaient très professionnalisantes, deux stages de longue durée étant réalisés durant la scolarité.
À l'issue de la formation, les élèves sont intégrés au corps interministériel des attachés d'administration de l'État (CIGeM). Ils sont chargés de fonctions de conception, d'expertise, de gestion ou de pilotage d'unités administratives et de fonctions d'encadrement. Le caractère transversal de ce corps permet aux attachés d'accéder à une grande diversité de postes, tant à la sortie des IRA qu'à l'occasion de mobilités ultérieures.
Le coût de formation d'un élève des IRA s'élève à environ 60 838 euros : il comprend notamment le traitement des étudiants et celui des 107 ETP employés par les IRA. S'agissant des recettes, 95 % des fonds sont issus de la subvention pour charges de service public prévue dans le programme 148. En outre, les IRA dispensent des formations payantes afin de diversifier leurs revenus.
Le montant du programme 148 augmente car 110 élèves supplémentaires seront formés par ces instituts à compter de la rentrée 2017. Les ministères ont besoin de plus d'attachés d'administration. Ils ont été obligés, jusqu'à présent, d'organiser des concours parallèles pour pourvoir à leurs besoins en personnel. Il est dommage que les agents recrutés par ces « concours directs » soient privés de la formation dispensée par les IRA, d'où l'idée d'accroître le nombre d'étudiants en IRA. Le Gouvernement a prévu une augmentation de 1,9 million d'euros de la subvention pour charges de service public des IRA afin de financer cette hausse des effectifs à compter de la rentrée 2017. Considérant que des économies d'échelle étaient possibles, le coût annuel de formation a été estimé à 52 000 euros par élève. Nous devrons vérifier si ces économies d'échelle ont été effectives et si les IRA n'ont pas pâti de cette estimation qui peut paraître optimiste.
Parallèlement, j'ai également effectué des déplacements dans des plates-formes régionales d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines (PFRH). Ces plates-formes ont été créées en 2010 dans le contexte de la révision générale des politiques publiques (RGPP). Vingt-quatre PFRH avaient été initialement constituées. Leur nombre a été ramené à quinze au 1er janvier 2016, les PFRH situées dans des régions fusionnées ayant été regroupées.
Chaque plate-forme est dotée de neuf agents et est rattachée au secrétaire général pour les affaires régionales (SGAR) de la préfecture de région. Initialement compétentes pour faciliter la mobilité des fonctionnaires de l'État, les plates-formes ont étendu leurs missions à l'ensemble du secteur RH. Elles traitent de la gestion des ressources humaines, de la formation et de l'action sociale interministérielles.
En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, les plates-formes soutiennent les agents souhaitant effectuer une mobilité au sein de leur corps ou d'un autre corps en animant un réseau de responsables RH des ministères. Elles alimentent également la bourse interministérielle de l'emploi public (BIEP) et appuient les ministères dans leur gestion prévisionnelle des ressources humaines (GPRH).
S'agissant de ce dernier point, la plate-forme d'Ile-de-France a développé un logiciel - intitulé PALO -, qui est partagé avec d'autres plates-formes. Sa mise à jour ne peut être réalisée, par manque de 30 000 euros de crédits. Cela est fort dommage pour un outil dont j'ai pu constater l'efficacité lors de mes déplacements.
Après avoir recensé les besoins en formation à l'échelle déconcentrée, les plates-formes RH élaborent le plan régional interministériel de formation (PRIF) qui dresse la liste des formations disponibles. Cette liste est ensuite publiée sur le site SAFIRE et tout fonctionnaire peut solliciter son inscription en ligne. En 2015, 27 360 agents ont suivi les formations proposées par les PRIF.
Sur un plan budgétaire, les actions sociales interministérielles des plates-formes RH ont plus de poids que les actions de formation. Toutefois, en pratique, ces actions sociales constituent souvent des activités de guichet, pour lesquelles les marges de manoeuvre sont réduites.
Malgré leur intérêt, ces plates-formes ne se sont pas encore imposées dans le paysage institutionnel. Le ministre de la fonction publique nous a annoncé la création d'une « DRH de l'État » en 2016. Sans doute les plates-formes en seront-elles la cheville ouvrière.
J'en arrive au dernier point de mon rapport : le fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP). Depuis 1987, toute personne publique ou privée employant plus de vingt agents doit compter au moins 6 % de travailleurs reconnus handicapés au sein de ses effectifs. Ce taux d'emploi légal est calculé en prenant en compte les recrutements d'agents handicapés effectués par concours ou par contrat, le maintien dans l'emploi d'agents handicapés et les dépenses réalisées en faveur de l'insertion et des conditions de travail de ces personnes comme par exemple les travaux d'accessibilité des locaux et les aménagements de poste.
Au 1er janvier 2014, seule la fonction publique territoriale respectait cette obligation avec un taux d'emploi des personnes handicapées de 6,22 %, contre 5,41 % pour la fonction publique hospitalière et 4,18 % pour la fonction publique d'État. Pour les trois fonctions publiques, le taux d'emploi des personnes handicapées s'élève à 5,17 %, soit 221 712 personnes, majoritairement de catégorie C.
Le FIPHFP a été créé en 2005 pour mettre en oeuvre cette obligation d'emploi. Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Il est financé par les contributions versées par les employeurs publics qui ne respectent pas leurs obligations d'emploi. En 2015, ces contributions se sont élevées à 126 millions d'euros. Parallèlement, le fonds finance de nombreuses actions pour insérer les personnes handicapées dans le secteur public, aides qui se sont montées à 160 millions en 2015. L'effet ciseaux est évident, et il faudra trouver de nouvelles sources de financement pour assurer la pérennité du FIPHFP. Les recettes du fonds diminuent corrélativement à la hausse du taux d'emploi des personnes handicapées, les personnes publiques carencées étant de moins en moins nombreuses. Parallèlement, les dépenses d'intervention augmentent, un nombre croissant de personnes handicapées travaillant au sein de la fonction publique.
En décembre 2015, le FIPHFP a créé un groupe de travail afin d'examiner sa trajectoire financière et les scénarios de réforme. Ainsi, les emplois réservés et les agents reclassés pourraient ne plus être pris en compte dans le calcul du taux d'emploi des personnes handicapées, ce qui entraînerait une augmentation de la contribution des collectivités territoriales de 170 millions. Autre solution, la modification de l'assiette des contributions au FIPHFP avec un prélèvement de 0,15 % sur la masse salariale des employeurs publics. Mais ce dispositif pénaliserait les collectivités territoriales ayant déjà satisfait à leurs obligations. Quoi qu'il en soit, nous devrons revenir sur le sujet dans les années à venir pour parvenir à une solution satisfaisante.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite à émettre un avis favorable à l'adoption des crédits du programme 148.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les concours d'entrée organisés par les IRA ?

Pour quelles raisons l'État est-il le « mauvais élève » de l'intégration des personnes handicapées dans la fonction publique ?
L'effet ciseaux que vous avez évoqué a-t-il d'autres causes qu'une augmentation des personnes handicapées dans les effectifs de la fonction publique ?

Vous avez mentionné la création d'une « DRH de l'État » : quelle serait sa mission à côté de celle de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ? Serait-ce un lieu de coordination des politiques des ressources humaines des ministères ? Aurait-elle autorité sur ces DRH ministériels ou bien ne serait-ce qu'un lieu d'échange d'informations ?

La masse salariale des effectifs de l'État aura augmenté de 3,2 milliards cette année. Cette progression est significative et contrevient aux préconisations de la Cour des comptes de 2015 qui estimait que la progression de cette masse salariale était préoccupante et contradictoire avec la nécessaire rénovation de la gestion des carrières des fonctionnaires.

Je salue l'effort considérable de l'État pour accueillir des apprentis. C'est une bonne façon d'aider les jeunes à se construire un avenir professionnel.

Quel est le montant des crédits alloués à la formation des personnels de l'État affectés dans les territoires ? Du fait de la fusion des régions, les besoins sont immenses.

Quel est le pourcentage de personnes handicapées parmi les créations de postes enregistrées depuis 2012 ? Quelle est la part contributive de l'État au FIPHFP ?

Madame Benbassa, le Gouvernement souhaite réduire le recours aux concours directs d'attachés d'administration organisés par les ministères au bénéfice du concours de l'IRA.
Monsieur Vasselle, plutôt que d'estimer que l'État est un mauvais élève en matière de recrutement de personnes handicapées, je préfèrerais dire que la fonction publique territoriale s'est montrée particulièrement performante. En outre, l'éducation nationale peine à recruter des personnels handicapés.

Je n'admets pas le raisonnement de l'éducation nationale selon lequel les fonctions enseignantes ne peuvent pas accueillir des personnes handicapées. L'excuse de la spécificité de ces carrières n'est pas acceptable.

Sans compter que l'éducation nationale est un mauvais contributeur : les universités ont été autorisées à ne verser qu'un tiers de leurs contributions au FIPHFP.
Monsieur Vasselle, l'effet ciseaux est effectivement dû à l'augmentation du nombre de personnes handicapées au sein de la fonction publique, d'où de moindres contributions. Parallèlement, le FIPHFP fournit de plus en plus d'aides pour le maintien des personnes dans l'emploi. Enfin, la loi relative à la déontologie, aux droits et obligations des fonctionnaires a ajouté quelques contributeurs au FIPHFP (Conseil d'État, Cour des comptes, etc.). Cela ne sera toutefois pas suffisant pour redresser les perspectives financières du fonds.
M. Richard m'a interrogé sur la DRH de l'État : l'objectif est de renforcer la direction générale de l'administration et de la fonction publique en consacrant son rôle de pilotage et de gestion des ressources humaines de l'État. Les plates-formes RH auront un rôle important à jouer dans cette nouvelle organisation administrative.
En réponse à M. Collombat, il n'est pas possible d'isoler les budgets formation des plates-formes RH car ils dépendent de plusieurs missions budgétaires.
Enfin, je rejoins M. Bonhomme sur le constat qu'il a dressé s'agissant de l'augmentation de la masse salariale de l'État.
La commission émet un avis favorable à l'adoption des crédits du programme « fonction publique » de la mission « gestion des finances publiques et des ressources humaines ».
La réunion est close à 11 h 40