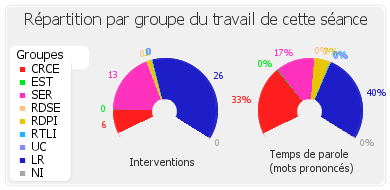Séance en hémicycle du 17 juin 2008 à 22h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à vingt heures vingt-cinq, est reprise à vingt-deux heures trente, sous la présidence de M Philippe Richert.

La séance est reprise.

M. le président du Sénat a reçu, transmis par M. le Premier ministre, le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie. Ce projet de loi sera imprimé sous le numéro 398 et distribué.
Je vous rappelle que nous avons constitué, au mois de février dernier, un groupe de travail intercommissions préfigurant une commission spéciale sur ce projet de loi.
M. le président du Sénat a reçu mandat de la conférence des présidents pour proposer au Sénat le moment venu, en application de l’article 16, alinéa 2, du règlement, la création de cette commission spéciale.
Nous pourrions donc inscrire â notre ordre du jour de demain après-midi, mercredi 18 juin, l’examen de la proposition du président du Sénat tendant à la création de la commission spéciale et la nomination des membres de cette commission.
Il n’y a pas d’opposition ?….
Il en est ainsi décidé.

Nous reprenons la discussion du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis l’instauration de l’élection présidentielle au suffrage universel direct, les diverses réformes constitutionnelles, ainsi que la pratique, n’ont fait qu’accentuer la dérive présidentialiste de notre régime.
Peu à peu, les pouvoirs de l’exécutif se sont renforcés, aidés en cela par le fait majoritaire, l’inversion du calendrier électoral et l’introduction du quinquennat présidentiel.
Le parlementarisme rationalisé aura fait son temps. Il est devenu un présidentialisme irrationnel : le pouvoir du Parlement s’est progressivement affaibli et, avec lui, sa représentativité des citoyens. D’où l’enjeu de cette réforme : mieux encadrer le pouvoir exécutif et revaloriser les pouvoirs du Parlement, en d’autres termes, rééquilibrer les pouvoirs.
Lors de son discours à Épinal, le 12 juillet dernier, le Président de la République a ouvert, de manière généreuse, le débat de la réforme des institutions. Le souci de modernisation y côtoyait celui du rééquilibrage des institutions : c’était un projet ambitieux et honorable. Le Président de la République s’exprimait alors en ces termes : « Je souhaite que l’on examine concrètement tous les moyens qui permettront à notre République et à notre démocratie de progresser ».
Il nous semblait alors que toutes les questions allaient être débattues, même les plus audacieuses.
Depuis lors, le principe de réalité a prévalu sur le discours. Beaucoup de bruit pour rien, finalement !
Entre les soixante-dix-sept propositions du comité Balladur et le projet de loi constitutionnelle qui nous est présenté aujourd’hui, un fossé inexplicable apparaît. Déjà initialement incomplètes, nombre de ces propositions ont été écartées dans l’avant-projet de loi, pour se trouver littéralement bannies du projet de loi soumis à l’Assemblée nationale.
Aujourd’hui, cette réforme ressemble à une peau de chagrin : sa substance rétrécit au fur et à mesure que le temps passe, et je crains qu’elle ne se voie administrer le coup de grâce lors de son examen par le Sénat.
Que de décalage entre la volonté exprimée voilà un an et la réalité du projet que vous nous proposez ! Notre déception est à la hauteur des espoirs que nous avions placés dans cette réforme. Il faut être sincère : du programme ambitieux, il ne reste plus que des avancées timides, pour la plupart insignifiantes, parfois impraticables et, souvent, cosmétiques ou apparentées à de simples affichages médiatiques. Les questions essentielles ont été écartées : la modernisation annoncée ne sera qu’un toilettage, un léger, sans grande incidence sur la répartition des pouvoirs.
Plusieurs collègues s’étant déjà s’exprimé sur ce projet de loi constitutionnelle dans son ensemble, j’ai choisi d’intervenir sur les trois points qui me semblent fondamentaux.
Je commencerai par le premier champ de cette réforme : les nouveaux pouvoirs accordés au Parlement.
Le projet de loi tente l’impossible : rééquilibrer sans toucher aux équilibres ! En conséquence, ce souci contradictoire débouche sur des consensus mous, sans effet véritable sur la réalité de la pratique du pouvoir ni sur le partage des pouvoirs exécutif et législatif.
Vous le savez autant que moi, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, ce qui relève de la loi relève de votre majorité et procède donc de votre bonne volonté ! Une telle équation ne nous permet pas d’envisager avec sérénité l’issue de ce débat. L’opposition restera impuissante à peser dans le débat démocratique, à l’image du sort qui lui est réservé par ce projet de loi constitutionnelle.
Quel est l’intérêt de renforcer les pouvoirs du Parlement si ce dernier est « pieds et poings liés » à l’exécutif ?
Quel est l’intérêt de donner plus de pouvoirs aux parlementaires, si les droits de l’opposition sont soumis à des lois dont on sait que l’issue est à la discrétion de la majorité ?
Où est le réel contre-pouvoir à l’exécutif, appelé de ses vœux par le Président de la République dans son intervention du 12 juillet dernier ?
Où sont, en fin de compte, les nouveaux pouvoirs du Parlement, gage de ce rééquilibrage ?
On lui accorde, ici et là, quelques facultés d’émettre un avis, tout en lui rappelant que ce dernier n’a aucune valeur contraignante.
On lui permet de contrôler une prérogative de l’exécutif qui n’a été utilisée qu’une fois dans l’histoire de la Ve République : l’exercice des pouvoirs exceptionnels du Président de la République.
On lui concède des droits théoriques, qu’il ne sera peut-être jamais amené à exercer en raison du corsetage lié au fait majoritaire.
On le tient informé des interventions à l’étranger et on lui permet d’en voter la prolongation. Soit, mais qu’en est-il de l’opportunité de contrôler le maintien des soldats ?
J’espère obtenir des réponses étayées sur ces points.
J’en viens au deuxième champ de cette réforme : l’encadrement du pouvoir exécutif.
On ne peut parler de réelles avancées sur ce terrain, sauf à considérer qu’entériner une pratique représente, en soi, une avancée décisive.
La possibilité donnée au Président de la République de s’adresser directement au Parlement réuni en Congrès constitue-t-elle l’une de ces avancées ?
Comment parler de limitation du pouvoir exécutif, quand la limitation la plus symbolique, c’est-à-dire la séparation physique, symbole de la séparation théorique des pouvoirs, est balayée d’un revers de main ?
La présente réforme ne doit pas être l’occasion pour le Président de la République de se réconcilier avec les parlementaires de sa majorité ! Nous ne construisons pas un pacte de non-agression entre les membres de la majorité au Parlement et ceux au Gouvernement.
Nous construisons, aujourd’hui, un pacte pour l’avenir démocratique de notre pays. Ce pacte passe par des concessions, de la part tant de la majorité que du Gouvernement. C’est à ce seul prix que la réforme aboutira, sans être vidée de son effet utile.
Sous le prétexte de ne pas toucher aux grands équilibres de la Ve République, nous ne devons pas nous limiter à réformer pour réformer, pour le symbole du geste, sans apporter aucune réponse qui soit à la hauteur de la crise démocratique actuelle, à la crise de confiance politique constatée chez nos concitoyens. Nous ne devons pas laisser le principe de la réforme l’emporter sur son contenu. Il nous faut passer de l’incantation à l’action, mes chers collègues !
Alors que la nécessité d’une modernisation des institutions est proclamée avec force et vigueur, pourquoi nous proposer un semblant de réformes ? Pourquoi se contenter d’actualiser la dérive de notre régime vers le présidentialisme, alors même qu’il s’agit précisément de la contenir ?
Cette réforme porte en elle-même toutes les contradictions de l’action du Gouvernement : l’empressement, les vœux pieux, la longue réflexion, pour finalement n’être que de la poudre aux yeux…
« J’ai une conviction : il ne faut jamais fuir le débat ; il ne faut jamais en avoir peur ! ». Mes chers collègues, j’espère que vous ferez vôtres ces propos tenus par le Président de la République lors de son discours d’Épinal.
J’aborderai à présent le troisième champ de cette réforme : les droits des citoyens.
Chaque groupe politique, chaque sensibilité représentée dans cet hémicycle a ses propres doléances.
En cet instant, permettez-moi de vous livrer ce qui constitue à nos yeux l’objectif principal de cette réforme : une meilleure prise en compte des aspirations des citoyens et de leur représentativité, au sein d’assemblées rajeunies, féminisées et métissées, qui soient à l’image de notre société et où chacun pourra se reconnaître !
Je prends bonne note de la création d’une exception d’inconstitutionnalité, ainsi que d’un Défenseur des droits. Mais qu’en est-il d’une meilleure représentation de tous les courants politiques dans les assemblées par le biais de l’introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives ?

Qu’en est-il du renouvellement de la classe politique par la voie de la limitation du cumul des mandats, y compris dans le temps ?
Qu’en est-il de la possibilité des citoyens de se saisir directement d’un projet touchant leur quotidien ou leur lieu de vie, grâce à un véritable référendum local d’initiative citoyenne ?
Sur ce volet de la réforme, notre principale revendication vise la reconnaissance du droit de vote des étrangers aux élections locales, afin de rendre justice à ces citoyens qui contribuent à la richesse et à la vitalité de notre pays depuis des années. La réponse qui sera donnée à cette revendication conditionnera le vote des parlementaires Verts sur cette réforme.
Certains d’entre vous objecteront que ce n’est pas le moment. Mais j’ai l’impression que ce n’est jamais le moment ! Nous avons trop attendu, je dirais même que nos parents ont trop attendu, que la société française dans son ensemble a trop attendu pour connaître ce nouvel élan démocratique, que nos voisins européens, eux, connaissent. Nous devons saisir l’occasion qui nous est offerte avec ce projet de loi constitutionnelle pour vaincre les peurs et donner à ces résidents permanents le droit fondamental de participer à la conduite de leur destin citoyen. Témoignons leur le respect, ainsi que le devoir de mémoire et de justice qu’ils méritent, au-delà des clivages et des appareils, au-delà des intérêts partisans et des luttes intestines.
Pour conclure, je me permettrai de vous dire en toute franchise : les libertés publiques reculent, la colère gronde, le discrédit plane ; j’en veux pour seule preuve les taux d’abstention aux élections…
L’histoire nous montre que, lorsque le peuple ne croit plus en ses dirigeants, la démocratie laisse place à l’autoritarisme et à la dictature.
Si nous voulons reconquérir la confiance de nos concitoyens, nous devons avoir le courage de mener de véritables réformes, nécessaires à la démocratisation de nos institutions, notamment du Sénat, dernier bastion du conservatisme. Il s’agit d’un enjeu démocratique pour l’avenir de notre société !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République, que le Sénat examine aujourd’hui, est un événement, n’ayons pas peur des mots !
La Constitution de la France est solide et moderne, elle le prouve chaque jour. Mais elle date tout de même de 1958 ! Dès lors, il n’est pas scandaleux de procéder à un toilettage global, à une révision générale, à une sorte de check-up qui nous confirment qu’elle a su bien vieillir, mais qu’elle a besoin d’être adaptée à un monde qui bouge.
En effet, le monde a changé. Rappelons-nous la période de tensions politiques nées de la guerre froide entre les blocs, du choc des idéologies, de notre présence en Algérie, de l’instabilité politique de la IVe République, et j’en passe. Dans de telles conditions, le nouveau pouvoir exécutif de la Ve République ne pouvait qu’être fort !
Depuis, la France a vécu l’alternance et même la cohabitation. L’Europe s’est construite, les distances se sont effacées ; la planète se rétrécit !
Mais, reconnaissons-le, les instances de décision de notre pays ont eu parfois du mal à prendre rapidement la mesure de ces bouleversements. Et cela me conduit au cœur du sujet que je souhaite développer. Les élus locaux – c’est d’eux qu’il s’agit – n’ont pas eu d’autre choix que de s’adapter.
Vous comprendrez l’intérêt toujours très fort qu’en ma qualité de président de l’Observatoire de la décentralisation j’attache aux questions touchant aux collectivités territoriales sous la Ve République, à leurs élus et au devenir de ces derniers.
Ces élus sont confrontés très concrètement aux problèmes de nos concitoyens et sont désireux de répondre à leurs attentes. Ils sont en prise directe avec les réalités quotidiennes du troisième millénaire. Ils n’ont pas d’autre choix que d’enregistrer toutes ces évolutions afin d’y faire face, au quotidien, à leur échelon.
Et pourtant, dans les vagues déferlantes des réformes successives, la situation des élus locaux est ignorée, il faut le reconnaître, sauf lorsqu’il s’agit de leur taper un peu sur les doigts, parce qu’ils dépenseraient trop, …

… sauf lorsqu’il s’agit de remettre en cause la commune, un jour, le département, le lendemain, …

… alors même qu’ils ne sont pas associés aux réflexions donnant lieu aux multiples rapports – vous savez lesquels je vise, notamment le plus récent d’entre eux –, qui les concernent pourtant directement !
En fait, de leur passion pour le territoire qu’ils administrent et de leur engagement pour la chose publique, on parle très peu. Du statut de l’élu local qui devrait être le leur, on parle encore moins.
Mes chers collègues, je pense que le moment est venu de réparer cette injustice. Accordons aux élus locaux la reconnaissance nationale que les Français leur témoignent déjà ! Ces femmes et ces hommes de terrain sont les meilleurs ouvriers de la démocratie.
La France a trop tardé à prendre la mesure de ce que représentent les collectivités territoriales dans notre démocratie. Année après année, au fil des lois de décentralisation arrachant une à une ses compétences à l’État central, les collectivités territoriales ont enfin trouvé leur vraie place, celle d’un moteur de l’action de proximité. Mais, il faut le reconnaître, nous avions pris beaucoup de retard sur les autres pays de l’Union européenne.
J’ai plaisir à rappeler combien le Sénat a fortement contribué à l’adoption de la réforme constitutionnelle de 2003, avec le plein et dynamique soutien du gouvernement de notre collègue Jean-Pierre Raffarin.

La décentralisation se trouvait enfin inscrite dans notre Constitution !
Aujourd’hui, les collectivités territoriales doivent gérer les transferts de compétences et de personnels et veiller à ce que les moyens budgétaires suivent, ce qui n’est pas toujours facile.

Mais, au-delà, qu’attendent aujourd’hui de l’État les collectivités territoriales ? À mon sens, il existe trois priorités.
Premièrement, les collectivités territoriales et leurs élus ont besoin que l’État leur fasse confiance. Trop souvent, le pouvoir central ne se départit de son rôle de conseil que pour tomber dans la tentation de la tutelle ; il devient contrôleur, oubliant l’esprit de partenariat. Cette évolution, je l’ai vue et je l’ai moi-même vécue.
Deuxièmement, la contractualisation ne doit pas être séparée de la mise en œuvre de la décentralisation. Pour cela, les élus locaux souhaitent un État organisé, avec, sur le terrain, un interlocuteur unique, légitime et responsable, qui devrait être le préfet, mais bien souvent celui-ci est court-circuité.
Troisièmement, les collectivités territoriales et leurs élus ont besoin de sécurité juridique, c’est-à-dire de règles stables, résultant de la concertation, consensuelles, ayant donc été négociées.
Ces trois exigences nous ramènent à la réforme constitutionnelle. En effet, aujourd’hui, alors que s’ouvre le chantier de la révision constitutionnelle, nos collectivités locales ne peuvent être absentes, ne serait-ce que parce que le Sénat, grand conseil des collectivités territoriales de France est concerné au premier chef, mais aussi parce qu’un maire, un conseiller général ou un conseiller régional doit chaque jour traiter des questions dépassant le cadre géographique qui est de son ressort. La décentralisation les a placés au centre du dispositif d’administration de nos communes, de nos départements et de nos régions.
C’est cet ensemble qui fait aussi la France réelle, la vraie France !
Dès lors, il me semble tout à fait légitime que les collectivités et leurs élus, qualifiés par l’expression démocratique, aient voix au chapitre dans ce débat. Au Sénat, en tout cas, nous n’esquivons pas cet aspect et nous ne l’avons jamais esquivé.
Les questions que nous formulons, aujourd’hui comme hier, sont très simples : qui fait quoi sur le territoire ? Qui est responsable de quoi ? C’est toujours l’élu qui est au cœur de ce débat.
La clarification des compétences entre les différents niveaux de collectivités territoriales est apparemment établie, mais elle n’est pas encore effective et, pour l’opinion publique, il ne suffit pas de la décréter : elle ne sera effective que lorsque les citoyens pourront identifier encore mieux, sans difficulté, celles et ceux qui décident en leur nom, qu’ils les approuvent ou les sanctionnent au terme du mandat qu’ils leur ont confié.

Les élus locaux doivent être revêtus d’une légitimité plus forte. Aussi la Constitution doit-elle intégrer – comme c’est le cas pour la décentralisation – la reconnaissance de cette légitimité. Il faut un véritable statut de l’élu local.

C’est le combat que nous devons mener.
Il s’agit de donner aux élus locaux les moyens de se consacrer à leur mandat comme l’exigent les nouvelles responsabilités qu’ils doivent assumer. Nous ne proposons pas une fonctionnarisation supplémentaire, mais il s’agit de leur permettre, par exemple, de retrouver plus facilement, et dans des conditions normales, au terme de leur mandat, une nouvelle activité professionnelle, il s’agit de leur accorder la protection sociale à laquelle a droit tout citoyen qui travaille, ni plus ni moins. Bref, il s’agit tout simplement de fixer les conditions d’exercice d’un mandat électif.
Cette ambition, je crois pouvoir le dire, est partagée par l’ensemble des membres de l’Observatoire de la décentralisation et par une très large majorité de notre assemblée, par-delà les différences politiques et la diversité des expériences.
Voilà pourquoi bon nombre de nos collègues ont souhaité cosigner l’amendement que j’ai déposé, qui vise à introduire une référence au statut de l’élu local dans notre Constitution en prévoyant qu’une loi déterminera les conditions d’exercice des mandats locaux et des fonctions électives.
Par cette disposition, nous reprenons des mesures qui, il est vrai, existent déjà, …

… mais que nous souhaitons améliorer en les rationalisant.
L’inscription d’une référence au statut de l’élu local constituerait l’aboutissement de notre réflexion sur la mise en œuvre de la République décentralisée. Ce serait un signe puissant adressé aux Français et aux élus locaux. Ces derniers ne comptent pas leur temps, ne ménagent pas leur peine et prennent des risques. Pourtant, ils ne demandent rien d’autre que la reconnaissance de leur pays.
La République, mes chers collègues, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, s’honorerait en les accueillant dans ce sanctuaire de la démocratie qu’est la Constitution.
Bien entendu, le fait que cette inscription soit proposée par le Sénat est significatif. Le Président de la République a souhaité, en engageant cette réforme, redonner confiance dans nos institutions et renforcer la légitimité des représentants du peuple. En adoptant cette proposition, le Sénat s’inscrirait tout à fait dans l’esprit de cette réforme.
En conclusion, je souhaite que la revalorisation du Parlement permette au Sénat de renforcer encore son rôle de représentant des territoires, de représentant de leurs élus, de représentant de la décentralisation. Les membres de l’Observatoire de la décentralisation se sont en tout état de cause prononcés en faveur d’une évolution renforçant les moyens du Sénat en matière de suivi des collectivités territoriales.
Une telle évolution permettra, j’en suis convaincu, d’affirmer et de conforter la place irremplaçable du Sénat au sein de nos institutions républicaines.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ UC-UDF et sur quelques travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je dispose de cinq minutes pour vous faire part – après d’autres – de ma déception devant le texte qui nous est proposé.

Ainsi que beaucoup d’autres, j’avais trouvé très positive l’initiative du Président de la République telle qu’elle apparaissait à la fin de l’été dernier.
J’avais fondé de réels espoirs dans les conclusions du comité Balladur et j’espérais vraiment que nous pourrions aboutir à un large accord politique pour rénover la vie politique française par un meilleur encadrement des pouvoirs du Président de la République et un renforcement du rôle du Parlement.
Cette perspective me paraissait réjouissante, car la situation actuelle est celle d’une démocratie simulée. Sans rien changer à la lettre de la Constitution, le Président de la République en a profondément modifié la pratique. Le Premier ministre fait de la figuration, le Président décide concrètement de tout et, par ses conseillers, mais aussi par la presse, il exerce de fait la totalité du pouvoir, sans être responsable devant quiconque, sinon devant le peuple, mais au bout de cinq ans, sans que soit intervenu entretemps le moindre contrôle.
Le Parlement, quant à lui, fait semblant d’exister. Pus que par le passé, il donne, lui aussi, dans la figuration. L’opposition, quoi qu’elle dise ou fasse, n’est jamais écoutée, et la majorité, quoi que dise ou fasse le Gouvernement, obéit au doigt et à l’œil.

Si ce n’est pas tout à fait votre cas, c’est vrai de la plupart de vos collègues !
Nous sommes bien dans un pouvoir personnel et dans un semblant de démocratie.
Deux solutions se présentaient pour corriger cette situation. La première n’est pas à l’ordre du jour et ne le sera sans doute pas de sitôt. Pourtant, c’eût été – je parle en mon nom personnel – la plus efficace, y compris, paradoxalement, pour redonner des couleurs à un Parlement actuellement largement inutile, tant il est devenu un théâtre d’ombres.
Il se serait agi de prendre acte de la situation actuelle et d’évoluer en direction d’un régime présidentiel au sein duquel le pouvoir du Président aurait été strictement encadré.
Pour le Parlement, cela aurait été le seul moyen de dépasser le blocage démocratique que constitue le fait majoritaire poussé à son extrême. Le Parlement se serait grandi en exerçant de façon rigoureuse un réel contrôle sur l’action de l’exécutif, ce qui n’est pas vraiment le cas actuellement.
Parallèlement, les pouvoirs du Président auraient été sérieusement rognés, ce qui supposait la fin du pouvoir de dissolution, de l’usage de l’article 49-3 et aussi, bien sûr, des nominations discrétionnaires aux postes stratégiques des grands corps de l’État.
Mais c’est l’autre solution qui a été choisie. Cette voie était possible, à condition que l’on joue réellement le jeu de la démocratie et que, en particulier, l’une des branches du bicamérisme soit plus en rapport avec la situation démographique et politique du pays.
Certes, la majorité de la commission des lois a renoncé à constitutionnaliser ce qui s’apparentera de plus en plus, vu la dépopulation en milieu rural, aux « bourgs pourris » de l’Angleterre du xviiie siècle, ce qu’elle se proposait de faire la semaine dernière.

Je sais parfaitement ce que je dis, monsieur le président de la commission des lois !
Mais c’est pour en rester à la situation présente, qui laisse au Conseil constitutionnel, dont on connaît la composition politique, le pouvoir de maintenir sa jurisprudence, qui interdit de fait toute alternance. Tel est le sens du refus d’intégrer dans le mode de désignation des sénateurs l’idée de représenter les collectivités territoriales « en fonction » de leur population, comme le proposait le comité Balladur. Cela, nous ne pouvons l’approuver.
Il y a encore bien d’autres points sur lesquels les espoirs issus des travaux du comité Balladur ne trouvent pas dans le présent texte de traduction démocratique. Je n’ignore pas les progrès que pourraient constituer le vote sur le texte issu des commissions ni les modifications du calendrier mensuel et du mode de fixation de l’ordre du jour. Mais, outre celui que je viens de développer, il existe pour nous d’autres empêchements qu’à une autre époque et sous un autre régime juridique on aurait pu qualifier de « dirimants ».
Pour aller vite, je n’évoquerai que trois exemples.
Le premier concerne l’institution du Défenseur des droits des citoyens, heureuse initiative dans son principe, madame la garde des sceaux.

Mais comment voulez-vous que nous votions cette disposition d’apparence sympathique sans connaître le périmètre des institutions qu’elle est appelée à regrouper ?
Interrogée avec insistance lors de votre audition par la commission des lois, vous n’avez pas répondu de façon claire, citant seulement à plusieurs reprises la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, au point que l’on est en droit de se demander si la création de ce Défenseur n’a pas pour but de faire disparaître les autres institutions de ce type, qui constituent un désagréable poil-à-gratter pour l’administration et le Gouvernement.
Le second exemple a trait au pouvoir de nomination, qui pose lui aussi problème. Dans un certain nombre de pays que nous avons visités, avec notre collègue Patrice Gélard, les nominations se font à la majorité qualifiée du Parlement ou de l’Assemblée, selon les cas. Au lieu de cela, vous nous proposez un veto des trois cinquièmes revenant en fait à une approbation par les deux cinquièmes ; c’est une mystification ! Ce point a déjà été longuement développé par notre collègue Bernard Frimat.
Nous dire, comme je l’ai entendu, qu’une nomination par le Parlement ou la seule Assemblée nationale à la majorité qualifiée revient à introduire la politique dans la haute administration, c’est une aimable plaisanterie. En vérité, c’est exactement l’inverse ! Si vous acceptiez ce que nous proposons – c’est-à-dire une réelle approbation à la majorité des trois cinquièmes –, vous créeriez au contraire l’obligation d’un large accord entre toutes les forces politiques, ce qui constituerait un gage de l’objectivité des choix.

Enfin, le droit d’amendement, qui est un droit fondamental des parlementaires, verrait ses modalités établies par les règlements des deux assemblées et vous ne semblez pas disposés à assouplir l’application de l’article 40. Or, il s’agit d’une lourde entrave au droit d’amendement. Je pense – même si tous mes amis ne partagent pas nécessairement mon sentiment sur ce point – que le droit d’amendement doit être mieux encadré.

En effet, il faut trouver du temps pour que le Parlement contrôle. Mais, très honnêtement, l’encadrement ne doit pas être conçu comme vous le faites. Voudriez-vous nous pousser à voter contre ce texte que vous ne vous y prendriez pas autrement !
Voilà donc comment, dans une République de l’apparence, les effets d’annonce les plus séduisants masquent en réalité un conservatisme profond
M. le secrétaire d’État manifeste vivement son désaccord
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, « une constitution n’est pas une tente dressée pour le sommeil », disait Napoléon Ier.
La Constitution française n’a pas été dressée pour le sommeil, puisque, en près de cinquante années, nous l’avons modifiée à vingt-trois reprises. Elle a ainsi démontré son adaptabilité aux bouleversements, aux crises, aux changements et sa capacité à se moderniser.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

La réforme qui nous est proposée aujourd’hui est mal comprise par certains d’entre nous.
Nouvelles exclamations sur les mêmes travées.

M. Patrice Gélard. Contrairement à ce que certains voudraient, ou ont imaginé, il n’est pas envisagé une réforme globale de la Constitution, mais une réforme qui se limite à un certain nombre de points qui ont été énoncés cet après-midi par le Premier ministre. Cette révision ne crée pas un épouvantail de régime présidentiel, mais préserve l’équilibre de la ve République, reposant sur un régime parlementaire mâtiné de présidentialisme. Je le répète, nous ne nous dirigeons pas vers un régime présidentiel ; au contraire, cette révision tend à limiter les pouvoirs du Président.
Protestations sur les mêmes travées.

Pour autant, il n’est pas envisagé d’en revenir aux vieilles lunes du régime d’assemblée…

M. Patrice Gélard. … pour lequel certains éprouvent de la nostalgie, regrettant que n’ait pas été adopté le projet de Constitution élaboré en avril 1946, projet qui aurait conduit à l’impuissance et à la dictature parlementaire, c’est-à-dire à l’inefficacité totale.
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Ce que vous appelez la dictature parlementaire est toujours préférable à la monarchie !

M. Patrice Gélard. Bien sûr que si ! Je pourrais vous citer une multitude d’exemples !
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Mes chers collègues, je vous prie d’écouter M. Gélard. Nous avons tous à apprendre de son expérience !

En réalité, le présent projet de loi constitutionnelle est mesuré et a notamment pour but d’améliorer, de rationaliser et de développer le rôle du Parlement.

Il importe de rechercher un équilibre global, d’autant que, jusqu’à présent, il n’a pas été tenu compte de l’adoption du quinquennat, qui, avec la coïncidence des élections présidentielle et législatives, a considérablement transformé la nature de nos institutions. Celles-ci ne peuvent continuer à fonctionner selon les mêmes règles que celles qui étaient en vigueur au temps du septennat, voire du quinquennat de Jacques Chirac.
À la suite des propos que vient de tenir Jean-Claude Peyronnet, je me félicite de ce que ce projet de loi constitutionnelle reprenne certaines des propositions que nous avions formulées dans nos deux rapports d’information, en particulier la discussion des projets et des propositions de loi en séance publique à partir du texte adopté par la commission, proposition que nous avions faite voilà plus d’une dizaine d’années. Je me félicite également de la constitutionnalisation, méritée, d’un comité chargé des affaires européennes au sein de chaque assemblée.
Pour l’essentiel, ce texte donne assez largement satisfaction à ceux qui attendaient de cette modification constitutionnelle qu’elle mette notre Constitution en conformité avec les nouvelles exigences du quinquennat. Nous avons atteint ce but, me semble-t-il.
Pour autant, j’exprimerai un certain nombre de regrets.
Premièrement, le champ du référendum, que nous avons élargi, doit être corrigé, parce que nous ne savons pas utiliser cet instrument en France.
Rires sur les travées du groupe CRC.

M. Patrice Gélard. Dans notre pays, il n’est jamais répondu à la question soumise à référendum, celui-ci n’étant utilisé que comme l’opportunité de se déclarer pour ou contre le gouvernement.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Cessez donc de m’interrompre à tout-va ! Je ne vous ai pas interrompus lorsque vous aviez la parole !
Pour remédier à cette situation, je propose que tout référendum qui n’aurait recueilli qu’une participation inférieure à 50 % des inscrits soit nul et non avenu.
Dès lors, nous rationaliserons l’usage du référendum…

M. Patrice Gélard. … et nous ferons en sorte qu’il y soit recouru à bon escient et non pour exprimer tel ou tel point de vue sans rapport avec la question posée.
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Deuxièmement, il faudra bien régler un jour la question du statut des anciens présidents de la République.
Leur qualité de membre de droit du Conseil constitutionnel n’est d’aucune utilité pour le fonctionnement de celui-ci. Or le Conseil constitutionnel va être conduit à examiner des recours dont il aura été saisi par voie d’exception ; par conséquent, les anciens présidents de la République pourraient être amenés à se prononcer sur des dispositions qui auraient été adoptées alors qu’ils étaient en fonction et dont ils auraient été les initiateurs. De fait, cela ne me paraît pas compatible avec le devoir de réserve auxquels sont tenus les membres du Conseil constitutionnel.
Cette situation est anormale. Pour autant, je ne reprendrai pas la proposition de loi constitutionnelle que j’avais déposée voilà trois ans visant à attribuer aux anciens présidents de la République le statut de sénateur à vie.

M. Patrice Gélard. Je laisse au Parlement le soin de trancher cette question, mais, par souci de transparence, je répète que j’estime anormal que les anciens présidents soient membres de droit du Conseil constitutionnel.
Murmures sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

M. Patrice Gélard. Je les énerve ! C’est normal, puisqu’ils ne comprennent rien au droit !
Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Vous m’interrompez en permanence ; il est bien normal que je vous réponde !
Sourires

Ce n’est pas ce que je vous demande ! Mais cessez donc cette cacophonie permanente !
Pas une seule fois je n’ai attaqué l’opposition !

J’en reviens donc au statut des anciens présidents qui existe, mais qui n’est pas public alors qu’il faudrait qu’il le soit.
Troisièmement, le Conseil constitutionnel va devoir faire face à une surcharge de travail en raison des nouvelles possibilités de recours. C’est la raison pour laquelle je préconise que le nombre de ses membres passe de neuf à douze. Ces trois membres supplémentaires, s’ajoutant aux neuf autres membres désignés par le Président de la République, le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, seraient systématiquement et respectivement choisis parmi le Conseil d’État, la Cour de cassation et la Cour des comptes.
Sourires

Ces questions sont importantes et il fallait les soulever.
Je conclurai mon propos par la réflexion suivante.
De nombreux articles du projet de loi constitutionnelle prévoient pour leur application l’adoption de lois organiques. De même, le règlement des assemblées devra être modifié. Or j’attire votre attention sur le fait que l’ensemble des mesures contenues dans ce texte devront entrer en vigueur au mois de mars 2009. Aussi, il sera nécessaire de procéder rapidement à l’adoption de l’ensemble des lois organiques et à la modification de notre règlement afin de rendre opérationnelle cette révision.
Il s’agit là d’un véritable enjeu, qui démontrera notre capacité à nous adapter rapidement à ce changement constitutionnel, qui, quoi qu’on en dise, représente un véritable progrès par rapport à la situation actuelle.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l’UC-UDF.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, Michel Debré, s’exprimant devant le Conseil d’État en août 1958, déclarait que le « parlementarisme rationalisé » organise la « collaboration des pouvoirs : un chef de l’État et un Parlement séparés, encadrant un Gouvernement issu du premier et responsable devant le second ; entre eux, un partage des attributions donnant à chacun une semblable importance dans la marche de l’État et assurant les moyens de résoudre les conflits qui sont, dans tout système démocratique, la rançon de la liberté. »
Ces propos expliquent cet ensemble de dispositions nombreuses, minutieuses et complexes que vous connaissez tous.
Plus clair et plus prosaïque, Alain Peyrefitte avouera plus tard : « Cette Constitution a été faite pour gouverner sans majorité. »
Conçue pour porter remède à un système parlementaire assis sur des majorités faibles et changeantes, la Constitution de la Ve République, du fait de la loi électorale puis de son calendrier, des réformes constitutionnelles successives, de l’évolution du système partisan et de la médiatisation de la vie politique, a fonctionné avec des majorités solides, sinon introuvables.
Or, aujourd’hui, les potentialités positives du « parlementarisme rationalisé » sont épuisées ; le « parlementarisme rationalisé » est devenu « parlementarisme lyophilisé ».
En règle générale, le pouvoir politique est tout entier à l’Élysée quand coïncident majorités parlementaire et présidentielle ; en cas de cohabitation, il est partagé entre le Président et le Premier ministre, sorte de maire du palais dont la puissance dépend de la discipline des troupes qui le soutiennent.
Le Parlement, lieu théorique de l’élaboration de la loi, du débat démocratique contradictoire et du contrôle de l’exécutif se satisfait de soutenir, de corriger les fautes de syntaxe et d’enregistrer. La manière dont la majorité aborde ici-même cette révision constitutionnelle, montre, s’il en était besoin, qu’il a pris goût à sa servitude.
Ce projet de loi constitutionnelle modifiera-t-il ces mœurs et rompra-t-il ce faux équilibre ? À l’évidence, non.
D’une part, contrairement à ce que préconisait le comité Balladur, le texte fait volontairement l’impasse sur la question de la loi électorale ; il n’est plus envisagé de proportionnelle à l’Assemblée nationale ni de permettre l’alternance au Sénat. Or, comme on l’a vu, le problème constitutionnel n’est pas séparable de celui du mode de scrutin. L’actuelle Constitution, associée à la proportionnelle d’arrondissement, par exemple, produirait des effets totalement différents.
D’autre part, abstraction faite de dispositions « décoratives », les pouvoirs du Président de la République ne sont en rien réduits par le projet, à peine le champ de ses caprices. Édouard Balladur lui-même en convient, qui déclarait au journal Le Monde : « On ne peut pas dire que, sauf sur quelques points – ce que j’appelle les dispositions « décoratives » –, il y ait une réduction des pouvoirs du Président. »
Vouloir un « rééquilibrage » au profit d’un acteur, le Parlement, sans affaiblir l’autre, le Président, est, par construction, contradictoire. Non seulement les pouvoirs du Président de la République ne seront pas réduits, mais ils seront renforcés. Ils le seront par la possibilité qui lui sera donnée, considérable en démocratie médiatique, de se présenter devant les parlementaires comme le véritable chef du Gouvernement et de la majorité.
Justifier cette mesure par l’exemple des États-Unis est une escroquerie intellectuelle. Je livre à ceux qui en douteraient cette analyse qu’a faite Élisabeth Zoller, professeur à l’université Paris II et directrice du Centre de droit américain, devant la commission des lois. Elle est intéressante : on ne peut être ni plus clair ni plus précis.
« Si le droit de message doit faire du Président français un législateur en chef, la France change de régime […]. Le Président n’est plus, comme son homologue américain, qu’un capitaine, c’est-à-dire un chef d’équipe, en l’occurrence un chef de parti politique, investi du pouvoir de mettre en forme législative le programme de gouvernement pour lequel il a été élu.
« Du coup, les fonctions d’arbitrage du Président n’ont plus de titulaire […]. En tout cas, elles ne sont plus entre les mains d’un arbitre. La phrase clé de la fonction présidentielle – Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics – ne trouve plus de raison d’être dans le jeu institutionnel.
« Le système américain échappe à ce dilemme parce que le Président n’exerce aucune fonction d’arbitrage et, en particulier, il n’a pas le droit de dissolution. Mais ce n’est pas le cas en France.
« Faire du Président un législateur en chef sans diminuer en aucune manière ses pouvoirs existants, c’est-à-dire en maintenant l’intégralité de ses pouvoirs d’arbitrage et sans toucher à ses pouvoirs de direction du travail des assemblées, par gouvernement et Premier ministre interposés, fait verser le régime dans un système consulaire. »
À l’évidence, dans une démocratie médiatique d’opinion, il n’est même pas besoin de baïonnettes pour faire des consuls. On a toujours besoin, cependant, de la complicité des parlementaires !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les révisions constitutionnelles ont cessé d’être une occasion rare et solennelle. M. le rapporteur en a rappelé le nombre exact. Depuis 1992, la Constitution aura été révisée dix-huit fois.

Nous risquons de perdre de vue à quel point ces révisions sont une affaire grave. C’est aux fondements du fonctionnement de l’État que nous touchons. Ce sont donc des questions de principe que nous devons trancher, ce qui exclut, ou devrait exclure, le bricolage et le marchandage.

En règle générale, les révisions ont porté jusqu’à présent sur des aspects précis de la Constitution. Nous sommes saisis, cette fois, d’un ensemble de modifications entre lesquelles le lien n’est pas toujours évident.
Une série de dispositions forment toutefois un ensemble cohérent : ce sont celles qui atténuent le parlementarisme rationalisé que la Ve République avait par réaction poussé très loin, sans doute trop loin. C’est une affaire dans laquelle il nous faut faire preuve d’un grand discernement. Laisser aux assemblées plus d’espace pour qu’elles remplissent leurs fonctions de législation et de contrôle est un rééquilibrage utile, voire indispensable. C’est d’ailleurs l’intérêt bien compris du Gouvernement que d’avoir face à lui un Parlement actif et vigilant, monsieur le secrétaire d’État.
Mais une Constitution ne doit pas être conçue seulement pour les temps ordinaires : elle doit aussi permettre de faire face aux circonstances extérieures et intérieures les plus difficiles et aux situations politiques les plus diverses.
Dans cette optique, il me paraît essentiel de ne pas trop encadrer l’usage de l’article 49-3, dans le sens que vous avez d’ailleurs indiqué, monsieur le rapporteur. Si vous m’autorisez une comparaison médicale – que les membres du corps médical ici présents me pardonnent !
sourires

Le projet de loi constitutionnelle contient par ailleurs diverses dispositions qui ne se rattachent pas directement au rôle du Parlement dans nos institutions. Ne pouvant les aborder toutes, je voudrais en évoquer deux, qui me paraissent poser des questions de principe importantes.
La première question de principe porte sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Vous le savez, madame le garde des sceaux, ce sujet a suscité à l’Assemblée nationale un vif débat, lequel se poursuit encore aujourd’hui, non pas dans l’hémicycle mais à travers la presse. Il s’agit d’un débat récurrent, très lié – peut-être trop – à des mouvements d’opinion suscités par telle ou telle affaire.

Que la méfiance s’abatte sur le monde politique et rien n’est de trop pour rassurer le public sur l’indépendance des juges. Mais que la justice échoue spectaculairement dans sa mission et l’opinion s’indigne que les responsables ne semblent pas avoir à rendre de comptes.
Pour sortir de tels débats, il faut, me semble-t-il, revenir à quelques principes de base. J’interviendrai d’ailleurs le moment venu sur l’article du projet de loi constitutionnelle concerné.
Tout d’abord, l’indépendance du juge ne signifie pas que celui-ci appartienne à un ordre privilégié. Elle est non pas une fin en soi, mais un moyen pour que la justice soit rendue de manière impartiale. Tel est son véritable but.
C’est pourquoi l’indépendance du juge ne s’exerce pas seulement à l’égard du pouvoir politique ou des intérêts économiques. Elle existe également à l’égard de ses propres préjugés, de ses propres choix politiques ou syndicaux, voire de ses tentations médiatiques. Il ne suffit pas que le juge soit indépendant du pouvoir politique pour qu’il juge bien. Notre objectif doit être aussi de l’inciter à toujours se remettre en question. Nous n’y arriverons pas en enfermant la magistrature dans une tour d’ivoire.

J’en viens aux magistrats du parquet, dont la fonction est de mettre l’action publique en mouvement. Dans leur cas, il serait contraire aux principes républicains de couper tout lien avec le pouvoir politique, car ce serait leur confier des choix de nature politique sans qu’ils soient ni élus ni responsables. Quelle serait leur légitimité ?
Évitons de faire de la magistrature une sorte de corps séparé de la société, ne rendant de comptes qu’à lui-même. Non seulement ce ne serait pas justifié, mais ce serait un mauvais service rendu aux magistrats.
Madame le garde des sceaux, sauf à minorer son rôle, le Conseil supérieur de la magistrature ne saurait être une sorte de comité technique paritaire. La composition retenue par la commission des lois reflète bien le rôle très particulier, spécifique et éminent donné à cet organe.
On ne peut accepter le procès en légitimité qui est fait par certains sur ce sujet. En quoi les non-magistrats, nommés par les plus hautes autorités de l’État républicain, seraient-ils moins légitimes que des magistrats élus sur des listes syndicales ? Que les formations proprement disciplinaires du Conseil supérieur de la magistrature soient composées à parité, soit ! Mais aller plus loin serait une erreur. Ce ne serait pas rehausser l’image de la magistrature que d’en donner l’image d’une corporation réglant elle-même ses affaires.
La seconde question de principe concerne le référendum obligatoire sur la Turquie. Je pourrais me contenter de reprendre à mon compte ce qu’a fort bien exposé le président Josselin de Rohan. Dans une Constitution républicaine, il ne peut y avoir de disposition ad hominem et pas plus de disposition ad nationem !

Viser un pays précis, sous une formulation qui ne trompe personne, c’est abandonner la généralité de la loi qui est au cœur même de l’idée républicaine.
Au demeurant, il faut être conscient de la manière dont est perçu ce débat en Turquie. Je m’y trouvais en mission avec Robert del Picchia lors du vote de l’Assemblée nationale. Alors qu’au cours de nos déplacements précédents nous avions discuté des relations entre la Turquie et l’Europe, cette fois, nos interlocuteurs en revenaient toujours aux relations entre la Turquie et la France. Ils ne pouvaient admettre qu’un pays ami et allié depuis des siècles introduise dans sa loi suprême une disposition qui les discrimine ; certains ont même ajouté, qui les humilient.
Mme Dominique Voynet applaudit.

Imaginons un instant que ce procédé soit employé par tel ou tel pays à l’égard de la France.

Quelle serait notre réaction ? Les hurlements viendraient de toutes parts : de gauche, de droite, du centre.
Je soutiens donc totalement la position de la commission saisie au fond et de la commission saisie pour avis, qui, avec beaucoup de discernement et de sagesse, proposent de revenir au texte initial du projet de loi constitutionnelle.
Il ne s’agit pas, je le précise, de savoir si nous sommes pour ou contre l’adhésion pleine et entière de la Turquie à l’Union européenne. C’est une décision qui, si elle est à prendre, ne le sera pas avant quinze ou vingt ans.
Nul ne sait où en seront l’Europe et la Turquie à ce moment-là. L’unique question qui se pose à nous aujourd’hui est de savoir si nous voulons faire figurer dans notre Constitution, dans le recueil de nos principes de base, une disposition qui stigmatise un pays précis, au demeurant partenaire et allié de la France.
Je ne peux conclure sans évoquer un instant les dispositions du projet de loi constitutionnelle qui concernent le traitement des affaires européennes. Sur ce sujet, je ne vois rien à changer au texte adopté par l’Assemblée nationale, mis à part la rédaction maladroite de l’article 88-6, laquelle n’a pas échappé à la sagacité de la commission des lois et de son rapporteur.
Une divergence terminologique risque toutefois d’opposer les deux assemblées. L’organe chargé des affaires européennes doit-il s’appeler « commission » ou « comité » ? À vrai dire, pour moi, le plus important est que disparaisse l’intitulé « délégation pour l’Union européenne », incompréhensible pour nos partenaires européens.

Je ne prendrai qu’un exemple, qui vous fera certainement sourire. J’ai reçu voilà quelques jours un courrier du Parlement européen adressé à « M. Hubert Haenel, délégué du Sénat auprès de l’Union européenne ». La personne qui m’écrivait a dû se demander pourquoi mon adresse ne se situait pas à Bruxelles !
Quelle que soit la solution retenue, ce sera de toute façon un progrès. Pour lever toute ambiguïté, je tiens à souligner qu’il n’est nullement question que l’organe chargé des affaires européennes empiète sur les compétences législatives des commissions permanentes. Cette précision s’impose. Les traités européens, comme les autres traités, doivent rester de la compétence de la commission des affaires étrangères, et la transposition des directives doit rester du ressort de la commission compétente saisie au fond.
Ces principes posés, il restera, lors de la révision du règlement du Sénat et de la loi qui régit les délégations, à définir la bonne articulation entre l’organe européen et les commissions permanentes.

Nous devrons le faire en nous efforçant d’avoir un dispositif efficace pour ancrer les questions européennes au Sénat et à l’Assemblée nationale et qui tienne compte de la spécificité des questions européennes.
Le Sénat a un rôle important à jouer en matière européenne et il doit se donner les moyens de le faire. J’ajoute que, si les parlements nationaux avaient été dans le passé mieux associés aux questions européennes, le vote irlandais aurait peut-être été autre.
Nous venons une fois de plus d’en avoir la preuve : un fossé s’est creusé entre les opinions publiques et l’Europe. Les parlements nationaux ont une responsabilité essentielle pour aider à le combler. Le Sénat ne doit pas se dérober devant la part qui lui incombe. Il s’agit là d’une exigence qui devrait l’emporter sur toute autre considération. Je fais confiance à la Haute Assemblée – j’espère ne pas être déçu ! –- pour aller dans ce sens.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je ne vous surprendrai pas en vous disant que, pendant les quelques minutes qui me sont imparties, je me concentrerai sur les dispositions de l’article 9 qui créent le principe de la représentation à l’Assemblée nationale des 2, 5 millions de Français établis hors de France.
C’est peu de dire que cette modification de l’article 24 de la Constitution représente une avancée démocratique importante, comme l’a été, en 1982, l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger au suffrage universel direct.
Elle vient en effet couronner un long chemin, qui a débuté voilà près de trente ans. Je rappelle à ceux qui l’auraient oublié que la proposition 48 des 110 propositions de François Mitterrand prévoyait que la représentation parlementaire des Français de l’étranger, comprenant non seulement des sénateurs mais aussi des députés, serait assurée.
C’est donc un grand progrès, qui était attendu.
Cette grande et belle idée a été portée par de nombreuses personnes, non seulement par les membres du parti socialiste, mais aussi par les candidats successifs à l’élection présidentielle. Pour ma part, en 2005, j’avais déposé, avec ma collègue Monique Cerisier-ben Guiga, une proposition de loi allant dans ce sens, mais elle n’a malheureusement jamais été examinée.
La situation actuelle soulève deux difficultés.
D’une part, les députés sont censés représenter la nation tout entière. Le fait que 2, 5 millions de Français ne le soient pas rend cette représentation incomplète. De ce point de vue, le système proposé est boiteux.
D’autre part, la plupart de nos collègues de l’Assemblée nationale méconnaissent la situation dans laquelle se trouvent leurs concitoyens établis à l’étranger. Ils en ont souvent une image fausse, biaisée, ce qui les conduit assez souvent à tenir des propos qui ne correspondent pas à ceux que nous sommes en droit d’attendre de représentants de la nation. Et je ne parle pas des propos blessants, « évadés fiscaux » ou autres gentillesses du même genre.
Il est donc temps que les Français établis hors de France soient représentés au Palais-Bourbon.
Je rappelle également que, si ce texte est adopté, la France rejoindra l’Italie et le Portugal, les deux États membres de l’Union européenne dont les citoyens expatriés sont représentés à la chambre basse, respectivement par douze et quatre députés.
Ce projet suscite deux craintes.
La première est que la droite soit consubstantiellement majoritaire dans ce groupe de douze députés, puisque tel est le chiffre avancé. Or, selon moi, la démocratie n’est pas divisible et ne se monnaye pas. Nous sommes prêts à en assumer le risque, dans le cadre du combat démocratique normal : si les règles de l’élection sont justes et transparentes, chacun doit faire ses preuves dans ce cadre.
La seconde crainte exprimée est de voir le Sénat perdre sa priorité lors de l’examen des textes concernant les Français établis hors de France, c’est-à-dire l’une de ses spécificités. En effet, s’il conserve la priorité pour l’examen des textes relatifs aux collectivités territoriales, en parallèle, il doit réaliser une « primo-lecture » des textes concernant les Français de l’étranger ; aucune raison ne justifie un traitement différent de ces deux domaines.
Mais il n’est, en l’espèce, question que des projets de loi, c’est-à-dire, une partie seulement des textes qui concernent les Français établis hors de France. Or, vous le savez comme moi, la très grande majorité des textes relatifs à ce sujet émane en réalité des parlementaires puisque ce sont des propositions de loi. Le « mal » est, par conséquent, relativement limité.
Je veux maintenant vous faire part de deux inquiétudes qui ne relèvent pas directement du débat constitutionnel, mais qui n’en portent pas moins sur deux questions majeures : la définition du mode de scrutin et le choix du découpage électoral.
Concernant la définition du mode de scrutin, les membres de mon groupe ont été surpris par les propos du rapporteur du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale, qui a refusé que les députés représentant les Français établis hors de France soient élus selon un mode de scrutin différent de celui auquel sont soumis les autres députés.
Quant à vous, monsieur le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, vous avez été encore plus précis en affirmant que ces parlementaires seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Voilà qui a le mérite d’être clair !
Or l’application d’un tel mode de scrutin supposerait la création de douze circonscriptions, si douze est bien le nombre retenu. Au vu de la répartition géographique des Français à travers le monde, six députés représenteront l’Europe et six députés représenteront les autres circonscriptions du monde, à savoir les États-Unis, le Canada, l’Amérique latine, le Maghreb et le Levant, l’Afrique et l’Asie-Pacifique.
Pour justifier le recours au scrutin uninominal, l’argument de proximité a été invoqué. Imaginez un député qui représentera toute la zone Asie-Pacifique, soit vingt-huit à trente pays et devra parcourir 5 000 kilomètres chaque fois qu’il voudra visiter une ville de sa circonscription ! Par conséquent, l’argument de la proximité ne vaut pas si l’on en tient pour le scrutin uninominal.
Nous pouvons également avoir des doutes sur la nature du découpage. Des exemples historiques nous ont appris à être prudents !
J’ajoute que le gel constitutionnalisé du nombre maximal de députés à 577 va sérieusement, et inutilement, compliquer les choses. Nous risquons de nous retrouver dans la même situation qu’en Italie, où la création d’une circonscription des Italiens de l’étranger avait entraîné une modification de la répartition des sièges à la Chambre des députés. Un scénario identique aurait pour fâcheuse conséquence de mettre les élus des circonscriptions nationales et les nouveaux élus de l’étranger dos à dos et de stigmatiser ceux qui représentent les Français de l’étranger. C’est là un argument supplémentaire contre le nombre de 577 figé dans le marbre de la Constitution.
Il n’en demeure pas moins que les membres du groupe socialiste sont sensibles à cette avancée importante, même si nombre de mes collègues ont signalé les difficultés importantes que soulève la réforme constitutionnelle qui nous est proposée et les doutes qu’elle suscite en nous. Il est évident que c’est un jugement global que nous serons amenés à porter sur les modifications qui nous sont soumises.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, mon temps étant limité, je vais aborder directement les deux observations que je tiens à formuler dans ce débat sur la réforme constitutionnelle.
Je veux en particulier insister sur le contrôle, aujourd’hui plus que jamais essentiel. À cet égard, deux aspects me paraissent devoir être soulignés.
Premièrement, il me semble impératif que tous les projets de loi qui nous sont soumis soient accompagnés d’une étude d’impact, qui devrait comporter, d’une part, un volet réglementaire, comprenant l’ensemble des décrets et mesures réglementaires prévus, d’autre part, un volet financier, pour les réformes qui ont besoin d’être chiffrées. J’avais d’ailleurs, avec mon collègue Hubert Haenel, déposé une proposition de loi sur ce sujet ; elle n’a jamais été examinée, mais j’ai noté avec satisfaction que l’Assemblée nationale avait repris l’esprit de cette proposition…

…en introduisant cette notion de contrôle, de telle manière que nous puissions y consacrer un temps suffisant.
Mes chers collègues, vous savez bien que nous examinons un certain nombre de lois ordinaires entre deux lois de finances et deux lois de financement de la sécurité sociale. Or, trop souvent, nous adoptons des mesures à caractère fiscal et social qui ont un impact sur les lois de finances et de financement de la sécurité sociale suivantes. Fréquemment, le Gouvernement lui-même éprouve des difficultés à trouver des solutions d’équilibre des comptes sociaux ou des finances parce qu’il a laissé adopter un certain nombre de mesures sans prendre en considération, au moment de l’examen du texte législatif, leur incidence au regard de l’équilibre des comptes publics ou des comptes sociaux.

Je ne fais d’ailleurs que relayer une remarque exprimée par la Cour des comptes dans un rapport récent et selon laquelle il faut aujourd’hui dépasser le stade du chiffrage global et volontariste des réformes pour parvenir à une évaluation plus affinée de l’impact des dispositifs envisagés sur l’ensemble des acteurs concernés. Je pense, notamment, à la loi sur les retraites de 2003 ou à la réforme de l’assurance maladie de 2004, dont les effets ont été évalués de façon très grossière et… optimiste. Nous avons négligé l’évolution des comportements et les interactions avec d’autres mesures.
Il ne faut pas s’étonner des difficultés d’application des lois, de leur insuffisante mise en œuvre ou de l’impasse financière à laquelle elles mènent si on n’a pas, au préalable, réfléchi à leurs conséquences et mesuré leurs implications.
Deuxièmement, en matière de contrôle toujours, nous ne pouvons plus nous contenter de grandes incantations et soutenir que le Parlement va s’investir de plus en plus dans cette mission, sans pour autant lui en donner les moyens. J’ai encore le souvenir des propos tenus sur ce sujet par l’ancien président de l’Assemblée nationale, M. Jean-Louis Debré, lors de l’ouverture d’une session, ainsi que des propos identiques tenus par le président Poncelet, demandant que le Gouvernement laisse au Parlement un peu plus de temps pour procéder au contrôle. Au-delà de ces belles déclarations, nous n’avons malheureusement jamais pu constater l’expression d’une véritable volonté politique, tant au sein de la conférence des présidents que de la part du Gouvernement, pour que le Parlement exerce effectivement cette mission de contrôle.
C’est pourquoi je suis assez satisfait que l’Assemblée nationale ait proposé d’inscrire cette idée à l’article 48 de la Constitution.
Toutefois, je ne suis pas certain que les modalités retenues, à savoir réserver une semaine sur quatre à l’action de contrôle, soient les meilleures. Selon moi, cela sera difficile à respecter en fin de session et avant l’interruption des travaux de la fin du mois de décembre. C’est pourquoi il me semblerait plus judicieux et plus opérationnel d’inscrire dans la Constitution que le quart du temps de travail parlementaire, apprécié globalement, sera réservé au contrôle.
Dans le même esprit, je propose que le Sénat puisse consacrer une séance par semaine aux questions d’actualité au Gouvernement. Pourquoi se contenter d’une séance tous les quinze jours, alors qu’une telle séance a lieu au moins une fois par semaine à l’Assemblée nationale ?
Ma deuxième série d’observations concerne plus particulièrement les finances publiques et sociales.
Je comprends parfaitement le souci de nos collègues députés qui les a conduits à inscrire dans la Constitution la question du respect d’un objectif d’équilibre des finances publiques. Nous « traînons » en effet depuis trop longtemps des déficits publics et sociaux qui viennent invariablement accroître chaque année la dette publique de notre pays.
Cette situation détestable revient, en fait, à reporter sur nos enfants et petits-enfants la charge de nos dépenses d’aujourd’hui, même si, dans le cadre de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale, nous avons adopté, pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES, une disposition qui ne permet plus désormais au Gouvernement de transférer l’ensemble de la dette sans prévoir les recettes qui permettront d’en assurer le financement et de ne pas reporter la dépense sur les générations futures.
Je ne suis cependant pas persuadé que la disposition générale qui a été introduite par l’Assemblée nationale soit réellement efficace, car elle ne tient pas suffisamment compte, à mon avis, des aléas extérieurs de tous ordres, notamment économiques, auquel notre pays peut se trouver soumis.
Il n’en reste pas moins que l’objectif doit absolument être atteint et qu’il convient de se donner les moyens de faire en sorte qu’il le soit. C’est dans cet esprit que le président de la commission des affaires sociales, Nicolas About, le président et le rapporteur général de la commission des finances, respectivement Jean Arthuis et Philippe Marini, ici présent, et moi-même avons déposé un amendement visant à encadrer constitutionnellement le vote des « niches » fiscales et sociales. Si cette disposition est adoptée, l’entrée en vigueur d’une mesure de réduction ou d’exonération d’impôt, de cotisation ou de contribution sociale, sera conditionnée à son approbation par la prochaine loi de finances, en matière fiscale, ou par la prochaine loi de financement, en matière sociale.
Je vous rappelle que le Sénat a adopté, au mois de janvier dernier, une proposition de loi organique allant dans ce sens. Nicolas About et moi-même étions à l’origine de cette initiative. On nous avait alors opposé un risque d’inconstitutionnalité. Nous souhaitons lever ce risque et c’est pourquoi nous estimons indispensable de faire figurer cette mesure dans la Constitution.
À l’époque, M. Xavier Bertrand avait beau jeu de dire qu’une telle disposition avait un caractère inconstitutionnel, mais qu’il n’y était toutefois pas opposé sur le fond. Eh bien, nous mettons aujourd’hui le Gouvernement devant ses responsabilités : puisqu’il y était à l’époque favorable, il s’agit désormais de passer à l’acte et d’introduire cette disposition dans la Constitution afin que nous ne soyons plus confrontés à cette difficulté.

Enfin, je dirai deux mots sur les propositions de certains de nos collègues qui visent à instaurer une loi financière unique, c’est-à-dire à rapprocher dans un même texte loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale.
Je ne suis pas favorable à cette idée. Un rapport de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS, que j’ai l’honneur de présider, a permis de faire le point sur cette question au mois d’octobre dernier. Je vous y renvoie pour une analyse détaillée des raisons qui nous ont conduits à repousser cette formule.
Je me contenterai ici de vous rappeler la différence de nature des recettes inscrites dans ces deux textes : dans la loi de finances, les recettes sont globalisées et ne sont pas affectées ; dans la loi de financement de la sécurité sociale, les recettes sont affectées à chaque branche de la sécurité sociale.
Comment pourrait-on expliquer la nécessité d’une réforme des retraites si l’on ne peut pas afficher un déficit de cotisations face à un montant donné de prestations ? Serait-il vraiment plus vertueux de tout mettre dans un pot commun, ce qui reviendrait à renvoyer chaque difficulté financière à la générosité de la solidarité nationale ? Améliorerait-on vraiment ainsi le pilotage de ces dépenses ? Nous ne le croyons pas et ne sommes donc pas partisans de cette solution, qui irait, selon nous, à l’encontre du besoin de transparence et de plus grande lisibilité de l’action publique régulièrement exprimé par nos concitoyens.
Tels sont les deux points sur lesquels je souhaitais attirer votre attention, mes chers collègues, ainsi que celle du Gouvernement.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre pays a un besoin profond de démocratie : démocratie politique, démocratie sociale, démocratie participative, démocratie médiatique.
La candidate socialiste à l’élection présidentielle l’avait bien compris en proposant une véritable démocratisation de notre République, de l’ampleur d’une refondation – la « VIe République » –, et non une prétendue modernisation qui masque mal la présidentialisation renforcée que vous nous proposez aujourd’hui.
Est-il moderne de continuer à fermer les yeux, comme vous le faites avec ce projet de loi constitutionnelle, sur le véritable déni de démocratie qui aboutit à exclure de toute participation à la vie démocratique des étrangers extra-communautaires installés régulièrement sur le sol de notre pays et y travaillant ?
Est-il moderne d’ignorer le « quatrième pouvoir », oublié depuis toujours par nos lois constitutionnelles ?
À l’heure d’Internet et de la dématérialisation des supports de communication et d’information, toutes les dimensions de la vie sociale et de la vie privée sont modifiées par le développement des médias de masse, notamment audiovisuels.
Cette intrusion dans le quotidien de tout un chacun ne soulèverait pas de question au regard du fonctionnement et de l’équilibre de la vie démocratique si les médias, en France, étaient réellement indépendants. Mais, de ce point de vue, la situation est plus qu’inquiétante.

Peut-on considérer comme anecdotique, dans notre République, que le chef de l’État affirme, devant des journalistes, rêver d’ « en finir avec le journalisme de dénigrement pour promouvoir un journalisme pédagogique de l’action gouvernementale » ?
Notre démocratie peut-elle encore accepter le fait du prince, qui met en danger la pérennité de la télévision publique pour permettre un accroissement des recettes publicitaires des chaînes privées, qui tend à autoriser les télévisions privées, sous leur pression, à diffuser une deuxième coupure publicitaire pendant les films, ou bien encore qui remet en cause le seuil anti-concentration dans l’actionnariat des chaînes numériques terrestres ?
Notre démocratie peut-elle fermer les yeux sur les amitiés « utiles » qu’entretient le chef de l’État avec les patrons de groupes détenant entreprises de presse et chaînes de radio et de télévision lorsque, plus grave encore, ces mêmes groupes tirent une part substantielle de leurs revenus de commandes publiques ?
Ainsi Arnaud Lagardère possède-t-il Europe 1, Paris Match, Le Journal du dimanche, tout en demeurant un actionnaire « stratégique » d’EADS au côté de l’État.
Le groupe Dassault, pour sa part, ne fabrique pas que le Rafale : il édite aussi Le Figaro et Le Journal des finances.
Quant à Martin Bouygues, actionnaire principal du groupe TF1, il est toujours à la tête du puissant groupe de BTP qui porte son nom, ce qui le conduit à être partie à de nombreux marchés publics.
Enfin, Vincent Bolloré a récemment diversifié ses activités dans les médias, avec Direct 8, Direct Soir, Matin Plus, mais aussi avec la Société française de production, achetée à l’État, il y a quelques années, à des conditions particulièrement avantageuses et qui consacre une partie significative de son activité à des commandes du groupe France Télévisions.
Pour terminer le tour d’horizon de ces « liaisons dangereuses », je citerai encore le groupe LVMH, dirigé par Bernard Arnault, qui est désormais propriétaire des Échos, au terme d’une longue bataille avec la rédaction du quotidien économique et avec l’appui direct du Président de la République.
Cette concentration de nombre de titres de la presse d’information ainsi que d’importantes chaînes de radio et de télévision entre les mains de puissants groupes industriels et de services – dont les patrons sont quasiment tous des « proches » du Président de la République et qui, pour la plupart, tirent une bonne part de leurs recettes des commandes publiques – est à la fois préoccupante et unique au monde.
Dans ce contexte, l’inquiétude de nombre de rédactions, aux Échos, à Europe 1, au Figaro ou à TF1, est proportionnelle à la gravité des pressions exercées sur elles, souvent en relation directe avec le pouvoir d’État, par les propriétaires de leur titre ou de leur station. Et je passe sur le récent remaniement intervenu à la tête de l’information et du journal télévisé du principal média audiovisuel de notre pays, ainsi que sur les interrogations qu’il soulève ...

Ces faits sont connus de tous : ils sont symptomatiques de pratiques fondamentalement antidémocratiques, mettant en cause l’indépendance et le pluralisme des médias.
Faut-il rappeler que le pluralisme est reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle, sur le fondement de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, par la jurisprudence du Conseil constitutionnel ?
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

On ne peut donc que s’étonner du silence assourdissant du projet de loi constitutionnelle sur ce sujet, et ce d’autant plus que le comité Balladur avait jugé nécessaire, dans sa proposition n° 77, de prévoir dans la Constitution une disposition créant un organisme chargé de veiller à la protection du pluralisme.
M. Roger Karoutchi, secrétaire d'État. Et la proposition n° 78 ?
Souriressur les travées de l’UMP.

Cette protection est d’autant plus urgente que l’expression politique sur les antennes de radio et de télévision est, depuis l’élection présidentielle, littéralement envahie par la parole du chef de l’État, et ce en dehors de tout contrôle.
Là encore, le comité Balladur avait conclu que l’état actuel du droit, qui résulte d’une recommandation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, n’était plus satisfaisant et exigeait une inflexion de l’application de la règle dite des trois tiers ou, à défaut, une modification de la loi du 30 septembre 1986. Pourtant, la majorité ne semble prête ni à l’une ni à l’autre. C’est pourquoi nous proposerons des amendements tendant à faire de la prise en compte du temps d’expression présidentielle sur les antennes de radio et de télévision une obligation constitutionnelle.
M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement sourit.

Dans le même temps, nous espérons convaincre la majorité sénatoriale – sur la sagesse de laquelle nous comptons, tout en regrettant son inamovibilité – de la nécessité de graver dans le marbre de notre loi fondamentale le principe d’indépendance des médias, qui doit être garanti par l’interdiction faite aux groupes dont une part substantielle du chiffre d’affaires est assurée par des commandes publiques de participer au capital d’entreprises audiovisuelles ou de presse.
Mes chers collègues, les rédactions et les journalistes de France attendent de la représentation nationale la protection constitutionnelle à laquelle ils ont droit dans une République démocratique. Ne les abandonnons pas !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

M. Robert del Picchia. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’aurais pu vous dire : l’Assemblée nationale s’étant prononcée, pour sa part, sur ce texte, la courtoisie parlementaire et républicaine veut que nous ne touchions pas à la rédaction issue de ses travaux. Pourtant, en tant que défenseur du projet d’institution de députés des Français de l’étranger et ayant soutenu les propositions du Président de la République en ce domaine, je me devais de prendre la parole pour évoquer ce sujet, d’autant que l’un de mes collègues l’a fait déjà fait avant moi !
Sourires
Nouveaux sourires sur les travées du groupe socialiste.

Je dois prendre mes responsabilités, m’expliquer devant vous, mes chers collègues, et tenter de répondre aux questions que vous êtes en droit de vous poser.
Je siège au Sénat depuis 1998 et il me semble que, pour les Français de l’étranger, cette intervention est l’une des plus importantes de mon mandat.
« Les Français établis hors de France sont représentés à l’Assemblée nationale et au Sénat » : le sixième alinéa de l’article 9 du projet de loi constitutionnelle résume, en quatre mots, soixante-deux ans d’attente ! Rendez-vous compte, mes chers collègues, de ce que cela signifie : des députés élus par les Français de l’étranger ! Un relais, dans l’autre chambre du Parlement, pour faire entendre une voix qui doit parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres ! Un Parlement plus représentatif, plus proche des préoccupations de ceux qui sont loin !
Je sais les réticences, voire le désaccord de certains d’entre vous : le deuxième « bonus constitutionnel » du Sénat, maison des Français de l’étranger, disparaîtrait avec ce texte. Pourtant, j’espère pouvoir vous convaincre de la nécessité d’une avancée réclamée par tous nos compatriotes, ou presque, et par leurs représentants à l’Assemblée des Français de l’étranger, cette assemblée d’élus locaux au suffrage universel direct qui représente 2, 2 millions de Français expatriés et qui a adopté ce projet à l’unanimité, moins neuf abstentions.
Mais permettez-moi de passer en revue les principales objections que j’ai pu entendre depuis quelques mois, et de tenter d’y répondre.
Une première interrogation revient souvent : pourquoi les Français de l’étranger devraient-ils élire des députés ?
La véritable question est en fait celle-ci : pourquoi n’est-ce pas déjà le cas ? Les Français de l’étranger sont les seuls citoyens à élire des représentants dans une seule chambre du Parlement. Pourquoi ce déni de représentation ?
Lorsque la proposition de représenter les Français établis hors de France s’impose, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en reconnaissance de leur rôle dans la Résistance, elle se heurte à l’impossibilité matérielle d’organiser des élections en territoire étranger. Les relations internationales sont en effet délicates au sortir du conflit mondial, notamment avec l’Est et les anciennes colonies.
Il faut bien comprendre que seules ces considérations matérielles empêchent la création de députés, aussi bien en 1946 qu’en 1958. Le scrutin au suffrage universel indirect s’impose alors comme la seule solution. Et c’est donc au Sénat, alors Conseil de la République, que les Français établis hors de France obtiennent huit représentants.
Mais le suffrage universel direct existe depuis 1976 pour nos compatriotes vivant à l’étranger. En effet, à cette date, la loi organique a autorisé l’organisation de l’élection du Président de la République et des scrutins référendaires dans les centres de vote ouverts à l’étranger. Les Français établis hors de France ont également pu voter dans les consulats pour élire les députés français au Parlement européen en 1979.
La dernière grande étape d’expansion du suffrage aura été la loi de 1982, qui institue l’élection des membres du Conseil supérieur des Français de l’étranger, le CSFE – devenu depuis l’Assemblée des Français de l’étranger, l’AFE –, au suffrage universel direct. La conséquence immédiate de ce nouveau mode de scrutin est que le CSFE devient, en 1983, le collège électoral à part entière des douze sénateurs des Français établis hors de France.
Aujourd’hui, les Français de l’étranger votent dans les 580 centres de vote ouverts à l’étranger. L’impossibilité matérielle d’organiser des scrutins au suffrage universel direct en territoire étranger a disparu.
L’obstacle étant levé, il nous faut franchir la dernière étape.
Accorder une représentation à l’Assemblée nationale aux Français établis hors de France, c’est énoncer une double affirmation : celle de l’appartenance des Français de l’étranger à la communauté nationale et celle du besoin que nous avons d’une présence française à l’étranger forte, mobile et attachée à son pays d’origine.
Deuxième objection fréquemment formulée : les Français établis hors de France sont déjà très bien représentés.
Sourires

C’est effectivement vrai, et la « représentation unijambiste » des Français établis hors de France, dont l’un de mes collègues parlait tout à l’heure, a permis d’avancer, souvent lentement, mais d’avancer quand même.
Est-ce à dire qu’il faut refuser la seconde jambe si l’on nous propose une greffe ?
Nouveaux sourires.

Mes chers collègues, étant élus de territoires où les échelons électifs se superposent, vous n’imaginez pas combien il est difficile de n’être représenté que dans une seule assemblée. Être absent d’une chambre, c’est être souvent méconnu, parfois réduit à l’état de caricature, c’est entendre, impuissant et frustré, les approximations et contrevérités proférées par des orateurs insouciants à des tribunes auxquelles on n’a pas accès.
Bref, les Français établis hors de France ne veulent pas, si j’ose dire, rester bancals.
J’aborde à présent un troisième point : l’Assemblée des Français de l’étranger va disparaître.
L’actuel article 39 de la Constitution dispose, dans sa dernière phrase, que « les projets de loi relatifs aux instances représentatives des Français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat ».
L’Assemblée nationale a considéré que cette partie de l’article 39 devait, en tant que « dommage collatéral » de la création des députés représentant les Français de l’étranger, être supprimée. On peut y voir un risque de disparition de la fameuse « instance représentative », à savoir l’Assemblée des Français de l’étranger.
Ce serait peut-être aller un peu vite ! Voté en 2003, soit cinquante-cinq ans après la création du CSFE, l’alinéa constitutionnel qui avait été proposé par notre collègue Christian Cointat institue seulement une prévalence du Sénat pour les Français de l’étranger.
La prévalence du Sénat a été la consécration de son propre rôle de « maison des Français de l’étranger », pas de celui de l’Assemblée des Français de l’étranger. En aucun cas, celle-ci n’a attendu cette priorité de la Haute Assemblée pour exister. L’Assemblée des Français de l’étranger n’était pas inscrite dans la Constitution et ne le sera pas plus demain. Soit !
Dès lors, pour apaiser les inquiétudes, il suffirait d’ajouter, à l’article 34, par exemple, un alinéa aux termes duquel il serait indiqué que la représentation élective des Français de l’étranger est assurée au sein des assemblées parlementaires et de l’Assemblée des Français de l’étranger. C’est vraisemblablement ce que nous allons faire, si M. le rapporteur le veut bien et si mes collègues adoptent ces propositions.
Mes chers collègues, la défense du Sénat et de ses prérogatives préoccupe nombre d’entre vous. Pourtant, il ne tient qu’à nous, sénateurs des Français de l’étranger, de garder l’avantage.
La prévalence du Sénat ne concernait que les projets de loi, que nous pourrons toujours modifier. À nous l’initiative des propositions ! Chacun sait que, de toute façon, la grande majorité des propositions de loi adoptées en la matière sont d’origine sénatoriale, et c’est tout à notre honneur.
Notre prévalence sera, à l’avenir, le fait de notre expertise, héritée de notre histoire, et d’une intimité avec les problématiques propres à nos compatriotes résidant à l’étranger, non d’une ligne dans la Constitution.
On ne nous enlève rien, finalement, on ne fait qu’ajouter ailleurs.
Aurions-nous si peur de la concurrence ? Je ne le pense pas, non plus que mes collègues représentant les Français établis hors de France.
On nous dit aussi que le nombre de sénateurs représentant les Français établis hors de France va être réduit.
Je rappelle les propos du Président de la République, qui a été très clair sur ce sujet : il y aura des députés et toujours des sénateurs. De six, ces derniers sont passés à douze en 1983, pour compenser, certes, l’absence de représentation à l’Assemblée nationale. Toutefois, depuis 1983, le nombre de Français résidant à l’étranger a plus que doublé, pour devenir le septième « département » en ordre d’importance électorale. Le nombre de douze sénateurs semble donc tout à fait approprié.
Enfin, on objecte que les circonscriptions seront trop grandes et que cela coûtera trop cher de permettre à certains députés des Français de l’étranger d’aller voir leurs électeurs ; l’argument a souvent été avancé à l’Assemblée nationale. Je réponds que mes onze collègues et moi-même sommes élus dans le cadre d’une circonscription qui s’étend au monde entier. Celle des députés sera beaucoup plus petite.
Au demeurant, à notre époque, un élu ne se rend plus sous les préaux des écoles : nous dialoguons avec les Français de l’étranger sur Internet, et cela fonctionne beaucoup mieux ! Les députés feront comme nous !
Nos collègues députés s’interrogent : combien seront-ils à être élus ? On le sait : douze. Comment seront-ils élus ? C’est là une question que nous nous poserons plus tard. Pour l’instant, l’objectif est que le présent projet soit adopté. Nous étudierons plus tard les modalités du découpage et du vote.
Murmures sur les travées du groupe socialiste.

Nous avons aujourd’hui l’occasion de remédier au caractère bancal de la représentation des Français de l’étranger, c'est-à-dire de leur donner l’opportunité d’être pleinement Français, et pas seulement des Français à l’étranger.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l’UC-UDF.

Je pensais vous poser la question suivante, madame la garde des sceaux : quel pays a révisé vingt-trois fois le texte fondateur de sa République en cinquante ans ? Mais la réponse a été donnée au moins dix fois depuis l’ouverture de ce débat, soulignant un fait qui n’est pas anodin.
Dès lors, on est fondé à s’interroger : notre Constitution est-elle si peu adaptée à l’évolution de notre société qu’il faille en réécrire régulièrement des passages significatifs ?
Au travers des trente-cinq articles de ce projet de loi constitutionnelle, il nous est proposé de retoucher un nombre équivalent d’articles de notre Constitution. Ce n’est pas un simple ajustement, c’est une véritable réorientation, positive, de l’équilibre du texte sur trois points majeurs : l’exécutif, le législatif, le droit des citoyens.
Nous irons donc à Versailles le 21 juillet, afin que vous posiez votre sceau sur une nouvelle écriture d’une Constitution qui devrait probablement, si le rythme observé jusqu’à présent est respecté, être revue et corrigée dans moins de deux ans... Je ne le souhaite pas, et je sais que vous ne le souhaitez pas non plus.
Puis-je me permettre de proposer que nous glissions dans notre Constitution un article précisant que l’on ne peut la modifier au maximum qu’une seule fois par quinquennat ?
Sourires

L’une des volontés affichées par le Président de la République lors de sa campagne était d’avoir la possibilité de s’exprimer devant chacune des assemblées parlementaires. Ce droit me paraît légitime et conforme aux usages internationaux. Selon un sondage fait en novembre, à l’issue des travaux du comité Balladur, 81 % des Français sont favorables à ce droit d’expression. Les modifications proposées à cet égard par l’Assemblée nationale me paraissent justifiées.
Le Président de la République avait pris un autre engagement fort : renforcer le pouvoir législatif.
Certaines propositions sont fort positives : plus de liberté dans la maîtrise de l’ordre du jour, plus de possibilités de contrôle et d’évaluation, une information plus transparente sur les grands sujets de politique de défense ; bref, une véritable revalorisation des fonctions.
Enfin, un troisième grand axe concerne les droits nouveaux donnés aux citoyens.
Dans le pays des droits de l’homme, il serait mal venu d’être critique sur ce point, même s’il y a eu une tendance, à l’Assemblée nationale, à traiter des problèmes spécifiques par le biais d’un texte général. Je pense au référendum sur le projet d’adhésion à l’Union européenne. Il nous faut revenir sur ce seuil de 5 % de la population européenne introduit, de manière particulièrement inopportune, comme l’a démontré Josselin de Rohan, par l’Assemblée nationale.
Au-delà de ces trois grandes orientations, je m’interroge sur l’introduction dans la Constitution de certaines précisions quant à l’organisation des travaux du Parlement.
Cette organisation ne relève-t-elle pas en grande partie du règlement de nos assemblées ? Les gouvernements n’ont-ils pas, de tout temps, fait preuve d’un certain manque de coopération, pour la fixation, par exemple, de l’ordre du jour ?
J’ai la très nette impression qu’il nous faut passer par une contrainte constitutionnelle pour compenser un certain manque de courage politique.
Marques d’approbation sur les travées de l ’ UMP.

À ce jour, nous ne nous sommes octroyé que des « niches ». Pour en sortir, il nous faut aller à Versailles. Qu’est-ce qui nous empêchait de trouver un accord pour donner plus d’espace à la maîtrise de l’ordre du jour ?
Je constate qu’il est finalement plus aisé de modifier la Constitution que le règlement des assemblées !
Même mouvement sur les mêmes travées.

Quelques points précis méritent d’être soulignés.
L’Assemblée nationale a fixé un nombre de députés : 577. Elle a défini le nombre des membres du comité économique et social et de l’environnement. Il me paraît que nous nous devons de fixer le nombre des sénateurs.
Le référendum sur le projet d’adhésion à l’Union européenne ne doit pas être lié à un pourcentage de population.
L’ajout précisant que le Sénat « assure la représentation des collectivités territoriales de la République en tenant compte de leur population » ne présente aucun intérêt, sauf à ce qu’il ne cache une volonté de changer la représentation du Sénat. Dans ce cas, je compte sur vous pour nous éclairer.
Il y a quatre ans, le Sénat a su se réformer. Il n’a pas besoin de pressions pour cela.
Dans l’article 11 du projet de loi, qui vise à modifier l’article 34 de la Constitution, apparaît une notion nouvelle : la loi qui « favorise », en l’occurrence « l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales ». Or, aux termes des deux premiers alinéas de cet article 34, la loi « fixe », et, aux termes des quatre suivants, « détermine ». Nous sommes là dans l’action et non dans l’incantation. En ajoutant donc que la loi « favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales », l’Assemblée nationale a modifié l’esprit, très précis, de cet article
Si cette notion nouvelle est jugée majeure, encore faudrait-il la placer au mieux au niveau d’une intention dans le préambule. Pour ma part, je suis très réservé.
L’imprécision de cet ajout est telle que toutes les interprétations seront possibles.
De même, fallait-il inscrire dans l’article 1er de la Constitution que « les langues régionales appartiennent à son patrimoine. » ? J’y suis opposé. De plus, cet ajout est placé avant l’affirmation selon laquelle la langue de la République est le français.
À juste titre, nous regrettons de ne pas pouvoir avoir communication d’évaluations préalables relatives aux projets de loi qui nous sont présentés.
Pour la Constitution, il en est de même : sur les deux sujets précités, nous allons avoir une profusion de demandes qui ouvriront un boulevard à l’interprétation par le Conseil constitutionnel.
Je suis également surpris de constater que ne soit pas reconnu dans la Constitution le statut de l’élu en ce qu’il concourt au fonctionnement de notre pays.

L’amendement de Jean Puech est à ce titre fort intéressant.
Comme vous le voyez, madame la garde des sceaux, je m’interroge sur quelques points, mais je suis certain que vous saurez répondre à mes interrogations, afin que je puisse ainsi émettre un vote éclairé et positif.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je me réjouis que le projet de loi constitutionnelle aujourd’hui soumis au Sénat nous offre l’occasion de mieux garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions de responsabilité, conformément au souhait exprimé à plusieurs reprises par le Président de la République.
En effet, l’Assemblée nationale, en adoptant un amendement présenté par Mme Marie-Jo Zimmermann, présidente de la délégation de l’Assemblée nationale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, a introduit dans ce texte la disposition suivante : « La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités professionnelles et sociales. »
Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, cette modification de la Constitution est aujourd’hui indispensable pour permettre au législateur d’adopter des dispositions en faveur d’une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les diverses fonctions de responsabilité.
À l’heure actuelle, en France, les femmes ne sont que très faiblement représentées dans les instances de décision des entreprises, du secteur public, des organisations syndicales et des associations.
Je ne citerai que quelques chiffres, qui parlent d’eux-mêmes : 7 % de femmes dans les conseils d’administration et conseils de surveillance des grandes entreprises cotées en bourse, 11 % de femmes au sein des équipes dirigeantes des grandes entreprises publiques, 16 % de femmes occupant des emplois de direction dans la fonction publique de l’État, 24 % de femmes dans les conseils de prud’hommes, 35 % de femmes élues au sein des comités d’entreprise – alors que, souvent, le personnel est très majoritairement féminin dans le tertiaire et, notamment, dans les services –, 31 % de femmes parmi les présidents d’association, alors qu’elles s’investissent énormément dans la vie associative.
Face à cette situation, le Parlement avait adopté, lors de la discussion du projet de loi relatif à l’égalité salariale, en 2005-2006, des dispositions imposant le respect de proportions minimales de représentants de chaque sexe dans diverses instances : au sein des conseils d’administration et de surveillance des sociétés privées et des entreprises du secteur public, au sein des comités d’entreprise parmi les délégués du personnel, dans les listes de candidats aux conseils de prud’hommes et aux organismes paritaires de la fonction publique. Par exemple, pour les conseils d’administration, il était prévu de parvenir, dans un délai de cinq ans, à un minimum de 20 % de femmes.
Cependant, le Conseil constitutionnel, se fondant sur le respect du principe d’égalité de tous devant la loi, avait alors censuré d’office ces dispositions, alors qu’elles n’avaient d’ailleurs pas été contestées par les parlementaires qui l’avaient saisi. Conformément à sa jurisprudence antérieure, il a en effet considéré que la disposition relative à la parité introduite dans la Constitution en 1999 ne s’appliquait qu’aux élections à des mandats et fonctions politiques. Inutile de vous rappeler, mes chères collègues, à quel point nous avions, à l’époque, été déçues !
La révision constitutionnelle de 1999 a rendu possible l’adoption des lois de 2001 et 2007 relatives à la parité en politique, qui ont permis – il faut bien l’avouer – de réelles avancées pour les femmes au sein des assemblées élues et de leurs exécutifs, même s’il reste encore beaucoup à faire, notamment s’agissant de l’intercommunalité.
Le moment est donc maintenant venu de compléter la révision constitutionnelle de 1999, en élargissant la portée de la disposition favorisant l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats politiques et fonctions électives.
C’est pourquoi, mes chers collègues, je me félicite du dépôt par la commission des lois d’un amendement, sur l’initiative, notamment, de M. Hyest, que je salue, tendant à inscrire à l’article 1er de la Constitution, parmi les grands principes de notre République, un principe général d’égal accès des femmes et des hommes aux responsabilités, tant politiques que professionnelles ou sociales. Pour ma part, je ne partage pas les propos tenus par mon prédécesseur à cette tribune, M. Doligé : je préfère cent fois qu’un tel principe soit inscrit dans le marbre de la Constitution plutôt que dans son préambule.
Le Sénat s’honorerait bien sûr de voter cet amendement qui permettra, s’il est adopté, de franchir une nouvelle étape en faveur d’une égalité qui deviendra réalité entre les femmes et les hommes.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à remercier l’ensemble des orateurs. La majorité d’entre eux a manifesté la volonté d’être au rendez-vous de cette réforme, qui peut modifier en profondeur le fonctionnement de notre démocratie.
Beaucoup de choses ont été dites, et je tiens, avant tout, à saluer le travail effectué par la commission des lois, notamment par son président, M. Jean-Jacques Hyest.
Très bien !
Ce travail prolonge l’examen attentif auquel s’est livrée l’Assemblée nationale, qui a apporté des améliorations substantielles au texte du Gouvernement.
Je vois dans la qualité des travaux parlementaires, dans la richesse des débats qui sont les vôtres, une preuve supplémentaire du bien-fondé de notre projet.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la question constitutionnelle est posée depuis très longtemps, quasiment depuis les origines de notre Ve République puisque, plusieurs d’entre vous l’ont souligné, la réforme la plus importante de la Constitution, l’élection du Président de la République au suffrage universel, est intervenue seulement quatre ans après l’adoption de notre loi fondamentale.
Je voudrais, après nombre d’entre vous, notamment M. de Rohan, saluer la lucidité et même la prescience du général de Gaulle, car il a su concevoir une Constitution qui s’est révélée à la fois durable et forte.
Chacun a sa sensibilité propre. MM. Baylet et Fauchon ont défendu avec conviction leur préférence pour un régime présidentiel. Je comprends leur logique, mais notre intention est claire depuis l’origine : évoluer dans le sens de la revalorisation du Parlement, qui est également une condition du changement plus profond que vous préconisez, mais sans remettre en cause les fondements de nos institutions.
Le Gouvernement est prêt à entendre tous les arguments et à évoluer sur certaines dispositions. Cependant, j’invite chacun au bon sens et à la responsabilité : aller beaucoup plus loin, ce serait ruiner l’équilibre du texte ; aller moins loin, ce serait en ruiner l’ambition.
Madame Borvo Cohen-Seat, il faut en avoir conscience, bien souvent, la surenchère est synonyme d’immobilisme. C’est une posture facile et confortable.
Permettez-moi, monsieur Bel, de vous retourner votre invitation à faire preuve d’audace !
Je constate que, sur plusieurs points du projet, nous approchons d’un compromis, même si des ajustements, des précisions sont toujours possibles ou nécessaires.
Cela est vrai des pouvoirs nouveaux conférés au Parlement. Il faut « sortir du carcan du parlementarisme rationalisé », a souligné M. Mercier. Le partage de l’ordre du jour, l’examen du texte de la commission en séance publique, innovation chère au doyen Gélard, l’accroissement des délais d’examen des textes sont autant de mesures qui modifieront en profondeur nos méthodes de travail ; du reste, le président About ne s’y est pas trompé. Le renforcement de la mission d’évaluation et de contrôle, souligné par le président de Raincourt, correspond également à une modernisation nécessaire du rôle du Parlement.
Ces réformes imposeront au Gouvernement d’associer le Parlement à ses projets encore plus en amont. Notre volonté réformatrice en sortira confortée.
Un Parlement aux pouvoirs renforcés est le gage d’un État qui rend des comptes et, donc, d’un État plus efficace, mieux géré, et d’une démocratie irréprochable.
Nous approchons également d’un compromis concernant l’encadrement du pouvoir de nomination du Président de la République, lequel sera assorti d’un contrôle parlementaire, au travers d’un droit de veto à la majorité des trois cinquièmes. Les modalités selon lesquelles cet avis sera rendu méritent sans doute d’être précisées ultérieurement, comme l’a souligné à juste titre le président Hyest.
L’encadrement des opérations extérieures est un autre élément majeur de la revalorisation du Parlement. L’examen attentif auquel s’est livrée la commission des affaires étrangères nous permettra d’ailleurs d’apporter des précisions utiles sur la façon dont s’exercera ce contrôle et, notamment, sur la manière dont les délais seront calculés. M. de Rohan a bien souligné les enjeux de cette mesure : il s’agit de concilier l’information indispensable du Parlement et la sécurité de nos forces armées.
Un consensus se dessine par ailleurs autour de plusieurs dispositions du projet renforçant les pouvoirs des citoyens, comme l’a rappelé M. Alfonsi. Je tiens d’ailleurs à remercier le président Hyest de sa contribution sur ces aspects du projet de loi constitutionnelle. Je pense plus particulièrement aux précisions apportées concernant le périmètre d’intervention et les pouvoirs du Défenseur des droits des citoyens, qui constitue l’une des innovations majeures de ce texte.
Je pense également à la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Sur ce dernier point, le Gouvernement sera ouvert aux préoccupations que vous avez exprimées quant à la composition des formations siégeant en formation disciplinaire. Il conviendra aussi de veiller, comme nous y invite le président Haenel, à la légitimité de cet organisme aux yeux de nos concitoyens.
Enfin, Mme la présidente Gisèle Gautier a eu raison de relever le progrès que constitue la reconnaissance de l’égalité entre les hommes et les femmes en matière professionnelle, même si nous avions souhaité que celle-ci soit plutôt inscrite dans le préambule.
Bien entendu, certains points suscitent encore des interrogations ou des inquiétudes.
Je comprends, tout d’abord, les interrogations exprimées avec beaucoup de conviction par le président de Rohan sur l’encadrement de l’article 49, alinéa 3. En en restreignant l’usage à un texte par session, les projets de loi relatifs aux finances publiques n’étant de toute façon pas concernés, nous avons recherché un équilibre. Je crois profondément que cet outil, s’il doit naturellement être préservé, ne peut devenir sans risque un instrument banalisé de gestion de l’agenda parlementaire : un gouvernement qui ne pourrait mettre en œuvre son programme législatif qu’au prix d’une contrainte permanente serait, dans la réalité, profondément affaibli. Un outil de dissuasion doit s’accommoder d’un usage parcimonieux.
MM. Frimat, Badinter et Mauroy me permettront de ne pas partager leur analyse : non, cette réforme ne renforce pas les pouvoirs du Président de la République. Vous contestez, messieurs, la faculté ouverte à ce dernier de s’exprimer devant le Parlement. Mais comment justifier la pratique désuète qu’a évoquée le président de Raincourt ? Le choix du Congrès permettra d’abandonner une formule inadaptée à notre temps, tout en marquant le caractère solennel et exceptionnel de cette intervention.
Je voudrais également apaiser la crainte qu’a pu susciter notre volonté de conférer des droits supplémentaires à l’opposition. Je suis persuadée qu’il s’agit d’un élément déterminant du rééquilibrage de nos institutions ; M. Badinter l’a d’ailleurs rappelé à juste titre. Il s’agit non pas de conforter un bipartisme imaginaire, mais d’aboutir à un meilleur partage des pouvoirs et prérogatives aujourd’hui concentrés entre les mains du parti majoritaire.
Notre projet s’efforce de lever les obstacles constitutionnels qui s’opposent actuellement à ce que des droits particuliers soient conférés à chacun des groupes parlementaires. Nous sommes également sensibles au souhait du président Mercier de voir figurer le terme de « pluralisme » dans le texte constitutionnel.
Murmures sur plusieurs travées de l ’ UMP.
S’agissant de la question de l’élargissement de l’Union européenne, mesdames, messieurs les sénateurs, je comprends le souci, qui s’est largement exprimé dans votre assemblée, d’éviter la stigmatisation d’un pays, quel qu’il soit. Le Gouvernement sera donc ouvert à votre proposition sur ce point. Je vous demande néanmoins de comprendre aussi, de votre côté, la volonté de certains députés de veiller à ce que les élargissements à venir ne puissent intervenir contre la volonté populaire. De ce point de vue, il me semble d’ailleurs que la possibilité de référendum d’initiative populaire, introduite à l’Assemblée nationale, peut constituer une réponse. Je suis persuadée qu’il sera possible de trouver, selon ces lignes, une solution qui convienne aux deux assemblées.
Nombre d’entre vous, à commencer par l’ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, n’ont pas manqué de relever combien cette réforme représentait un défi pour le Sénat. Vous avez très justement insisté sur votre spécificité institutionnelle. Je crois que personne ici n’entend la remettre en cause, ni dans la constitution du Sénat ni dans son apport particulier au travail législatif.
À ce titre, je voudrais naturellement évoquer la question du collège électoral, même s’il ne revient pas au législateur constituant de choisir un mode de scrutin. Je souhaite rappeler deux évidences.
La première, c’est que le Sénat doit conserver un collège électoral spécifique, différent dans sa nature de celui de l’Assemblée nationale ; sinon, le bicamérisme n’aurait plus de sens.
La seconde, c’est que le mode électoral du Sénat n’est pas figé ; celui-ci s’est d’ailleurs récemment réformé de manière assez profonde, au travers, notamment, de la réduction de la durée du mandat sénatorial.
Le Sénat continuera à évoluer, mais il le fera dans le respect de sa spécificité, qui est de représenter les territoires, comme l’a rappelé M. Puech. Voilà la ligne qui nous est tracée : je fais confiance aux parlementaires pour trouver une solution qui la préserve.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il y a un point sur lequel l’ensemble des orateurs se sont retrouvés.
Ce qui est en jeu, c’est l’essentiel : c’est la loi fondamentale ; ce sont les modalités de fonctionnement de nos institutions et, au-delà, la manière dont les citoyens sont associés à l’exercice du pouvoir.
Le texte qui vous est proposé est un texte d’équilibre.
À ceux qui craignent d’abandonner un régime qui a apporté, en cinquante ans, la preuve de son efficacité, je souhaite dire que nous ne changeons pas de République. Nous modernisons simplement nos institutions, à la fois pour tirer les conséquences des évolutions récentes, notamment l’institution du quinquennat, et pour donner au Parlement le rôle qu’il a dans toutes les grandes démocraties.
À ceux qui considèrent, au contraire, que notre projet ne va pas assez loin, je dis : songez qu’une révision constitutionnelle repose nécessairement sur un consensus. Exiger d’aller à un point où vous savez que la majorité ne peut pas vous suivre, c’est la certitude de n’obtenir aucun changement, de ne bénéficier d’aucun des progrès permis par ce texte et qui, souvent, constituent des évolutions que vous appelez de vos vœux depuis très longtemps.
Mesdames, messieurs les sénateurs, puisque vous incarnez, dans une certaine mesure, la permanence et la stabilité de nos institutions, j’en appelle à votre responsabilité : ne laissez pas passer cette chance, cette chance de revaloriser le Parlement, cette chance de donner à notre démocratie un souffle de renouveau.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
La parole est à M. le rapporteur.

Monsieur le président, au cours de la discussion des articles, à l’article 11 du projet, qui porte sur l'article 34 de la Constitution, nous aurons à examiner quarante-trois amendements en discussion commune – le seul énoncé de ce nombre donne la mesure du caractère irréaliste d’une telle manière de débattre –, du simple fait du dépôt, par nos collègues du groupe communiste républicain et citoyen, d’un amendement tendant à réécrire entièrement l’article 11, l’amendement n° 187 rectifié.
Dans la mesure où les quarante-deux autres amendements touchent à des sujets très divers, je souhaite que l’amendement n° 187 rectifié fasse l’objet d’un examen séparé, de manière que nous puissions étudier successivement les différents thèmes abordés. Je pense qu’il s’agit de la meilleure formule pour assurer la clarté de nos débats.

Monsieur le président de la commission des lois, nous avons régulièrement recours à cette manière d’organiser nos débats, et ce, me semble-t-il, à la satisfaction de l'ensemble des intervenants. Je pense que personne n’y verra d’objection.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en ainsi décidé.

Je suis saisi, par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, d'une motion n°2, tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 365, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Éliane Assassi, auteur de la motion.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la réforme de nos institutions, voulue par le Président de la République dès son arrivée à l’Élysée, nous a été présentée comme un rééquilibrage entre « un pouvoir exécutif mieux contrôlé, un Parlement profondément renforcé et des droits nouveaux pour les citoyens ».
En réalité, nous voici devant une proposition qui concentre encore plus le pouvoir exécutif entre les mains du Président de la République, qui réduit au strict minimum de nouveaux droits pour les citoyens, avec un Parlement qui ne serait plus que l’ombre de lui-même.
Cette réforme n’est pas bonne, car elle ne reflète pas les attentes et les besoins du peuple de France en matière de démocratie.
Nombreux sont celles et ceux qui, depuis longtemps, se penchent sur nos institutions. Cela fait ainsi plusieurs années que notre groupe porte une nouvelle vision de nos institutions et de notre République. Nous défendons l’idée d’une République démocratique, où le Parlement retrouverait sa légitimité et disposerait de pouvoirs renforcés ; une République sociale, où les salariés pourraient faire respecter leurs droits et leurs intérêts dans les entreprises ; une République participative, où les citoyens auraient des pouvoirs réels d’intervention directe.
Année après année, élection après élection, que constatons-nous, si ce n’est l’éloignement progressif du peuple par rapport a ses représentants et à ses dirigeants ?
Cette réforme répond-elle à ce constat, pourtant partagé à droite comme à gauche, au lendemain de scrutins électoraux ? Non : la réforme proposée n’est au service que d’un seul homme, le Président de la République ! Elle est l’alibi pour une seule chose, le discours devant le Parlement !
Or la satisfaction des désirs du Président pose un certain nombre de problèmes au regard du respect des principes fondamentaux qui régissent notre démocratie.
Mes chers collègues, au-delà de l’apparente incohérence à défendre une exception d’irrecevabilité sur un projet de loi constitutionnelle, il existe plusieurs raisons de rejeter ce texte.
Le premier motif d’inconstitutionnalité repose sur le fait qu’il ne respecte pas le principe de séparation des pouvoirs, principe essentiel de l’organisation des démocraties modernes, qui occupe une place particulière dans la hiérarchie des normes, au titre de l’article XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. »
Plusieurs auteurs de la doctrine considèrent en effet que le principe de la séparation des pouvoirs est une exigence de nature supra-constitutionnelle. Sous la IIIe République déjà, Maurice Hauriou, dans son concluait au caractère impératif pour le constituant de l’article 2 de la loi du 14 août 1884, relatif à la forme républicaine du gouvernement, tout en évoquant, en outre, une « légitimité constitutionnelle placée au dessus de la Constitution écrite ».
D’autres voient dans le principe de la séparation des pouvoirs l’une des composantes de la forme républicaine du gouvernement, à côté des principes comme le suffrage universel ou le régime représentatif. Or la forme républicaine du gouvernement, énoncée au cinquième alinéa de l’article 89 de la Constitution, ne pouvant faire l’objet d’une révision, constitue une limite d’ordre matériel opposable au pouvoir constituant.
Enfin, certains ont 1a tentation de se dégager de tout rattachement à la forme républicaine du gouvernement et de donner une sorte de prééminence à la Déclaration de 1789. Je crois savoir qu’en 1989, lors du bicentenaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notre collègue Robert Badinter s’était demandé s’il n’y avait pas « des libertés intangibles que le constituant même ne pourrait supprimer ». C’est pourquoi je crois pouvoir affirmer que cette motion d’irrecevabilité est parfaitement justifiée.
Après m’être expliquée sur la forme, j’en viens au fond.
Cette réforme accroît les déséquilibres déjà existants dans nos institutions entre le pouvoir exécutif, en particulier le Président de la République, et le Parlement.
Les parlementaires communistes n’ont eu de cesse, depuis les débuts de la Ve République, d’en dénoncer le caractère présidentialiste, caractère qui s’est petit à petit aggravé, notamment depuis 1962 avec l’élection du Président de la République au suffrage universel direct.
Le quinquennat et, plus encore, l’inversion du calendrier électoral ont accentué la présidentialisation du régime, apparentant notre démocratie à une sorte de monarchie élective où la séparation des pouvoirs s’estompe au profit de l’exécutif.
Ainsi, aujourd’hui, le Parlement est réduit au rôle de chambre d’enregistrement, sommé d’entériner des projets de loi émanant parfois directement du Président de la République, à l’instar de la loi sur les peines planchers. Nous sommes loin de l’idée que l’on pourrait se faire d’un Parlement représentant du peuple et non du chef d’un parti, et soucieux d’élaborer la loi dans l’intérêt général.
Mais, au-delà, c’est toute la vie politique qui est menacée, au nom du bipartisme.
Nos institutions ne sont plus en phase aujourd’hui avec les attentes de nos concitoyens, qui demandent plus de justice sociale, de redistribution des richesses et des pouvoirs : pouvoir de co-élaboration des décisions qui les concernent, grâce notamment au développement de la démocratie participative ; pouvoir de contrôle de l’action des parlementaires, par la possibilité de saisir directement un Conseil constitutionnel modernisé.
Au lieu de cela, le projet de réforme prévoit de limiter l’action du Parlement en assurant une domination du Président de la République. Ce dernier conserve non seulement tous ses pouvoirs, d’arbitrage, de dissolution, et de superviseur du travail parlementaire, via le Gouvernement, mais, de surcroît, s’en voit octroyer de nouveaux, et notamment un à sa demande expresse : la possibilité de venir s’exprimer devant le Parlement réuni en Congrès.
Même si les députés ont supprimé la possibilité pour le Président de venir devant « l’une ou l’autre des deux assemblées », le pouvoir présidentiel en sort considérablement renforcé. En effet, sa déclaration pourra donner lieu, hors sa présence, à un débat qui ne fera l’objet d’aucun vote.
Par ailleurs, et cela démultiplie la force symbolique de cette disposition, le Président pourra s’exprimer autant de fois qu’il le souhaitera devant le Parlement, puisque le projet de loi ne prévoit aucune limitation à ce pouvoir. Les parlementaires se retrouvent ainsi soumis au bon vouloir du Prince.
Il est donc étrange d’affirmer vouloir renforcer les droits du Parlement en commençant par permettre au Président de la République de venir s’exprimer devant celui-ci, puis de prévoir un débat facultatif – « la déclaration du Président peut donner lieu à un débat » –, à l’issue duquel il n’y aura aucun vote, et donc aucune contrepartie à l’immixtion présidentielle dans les travaux législatifs.
Le Parlement n’aura aucun pouvoir supplémentaire face au Président.
Ainsi, le Président de la République, qui ne voit pas remis en cause son droit de dissolution de l’Assemblée nationale, conforte sa prééminence institutionnelle, tandis que son irresponsabilité politique est symboliquement réaffirmée. Cette nouvelle possibilité accroît donc la confusion des pouvoirs exécutif et législatif.
La possibilité de venir s’exprimer devant le Parlement a une grande portée symbolique : le Président participe ainsi, physiquement, à la fonction législative. Jusqu’à présent, nul n’ignorait que, hors période de cohabitation, c’était lui qui déterminait l’organisation des travaux du Parlement. Mais c’était justement le principe de la séparation des pouvoirs qui interdisait sa présence dans l’hémicycle.
L’exemple du droit de message du Président des États-Unis est, en l’espèce, très intéressant, car si l’on comprend bien qu’il a inspiré le Président de la République lui-même, les membres du comité Balladur et, enfin, les rédacteurs de ce projet de loi, il est finalement bien éloigné de la nouvelle prérogative présidentielle prévue par l’article 7.
Lors de son audition par la commission des lois, Mme Elisabeth Zoller, professeur à l’Université de Paris II, directrice du centre de droit américain, a très bien expliqué comment le système américain parvenait à maintenir un certain équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Le message du Président se décompose en deux clauses, l’une portant sur l’état de l’Union et l’autre sur les recommandations. C’est évidemment cette deuxième qui nous intéresse plus particulièrement ici.
À l’instar de ce qui se passe en France, c’est le pouvoir exécutif qui rédige les projets loi. Mais Mme Zoller utilise les termes de « législateur en chef» pour parler du Président américain, en précisant toutefois que, « s’il participait de façon prépondérante à la préparation des textes législatifs, le Congrès en était totalement maître lors de leur examen », ce qui n’est même pas le cas en France.

M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. C’est bien d’admirer les institutions américaines !
Sourires

Par ailleurs, elle considère que la modification du droit de message opérée par le projet entraînerait un profond changement institutionnel, qu’elle a qualifié de changement de régime, par l’érection du Président français en législateur en chef et chef de parti, et la disparition, de ce fait, de sa fonction d’arbitrage. Elle constate que le système américain avait pu échapper à ce dilemme grâce, notamment, à l’absence de fonction d’arbitrage du Président et de droit de dissolution du Congrès.
Sa conclusion est sans appel : « La modification de l’institution présidentielle ainsi proposée par le projet de révision, sans diminuer ses pouvoirs actuels d’arbitrage et de direction du travail du Parlement, par gouvernement et Premier ministre interposés, basculerait le régime de la Ve République dans un système consulaire. »
Ce système qui, je le rappelle, se caractérise par une très forte concentration des pouvoirs au profit d’un seul homme, qui n’en est pas moins politiquement irresponsable, peut conduire à toutes les dérives autocratiques. En France, il a conduit à l’avènement de l’Empire. C’est certainement pour cette raison qu’Elisabeth Zoller a appelé à la mise en place, si le droit de message de l’article 7 était adopté, « des poids et contrepoids du système américain ».
Ce n’est pas exactement ce qu’a prévu le projet de loi, bien au contraire ! Le Président peut déjà s’exprimer comme il l’entend dans les médias – ne l’a-t-il fait récemment sur une chaîne de radio, qui n’était même pas une radio du service public ? – sans que son temps de parole soit décompté. Il convoque les parlementaires – certes, seuls ceux de la majorité ! – à l’Élysée et n’hésite pas à les sermonner lorsqu’ils n’ont pas obtempéré aux ordres présidentiels.
Qu’a-t-il besoin de venir s’exprimer devant le Parlement, si ce n’est pour conforter sa prééminence institutionnelle ?
Le problème est qu’il est pour nous impensable de sacrifier le principe de séparation des pouvoirs sur l’autel des désirs du Président de la République.
Deuxième motif d’irrecevabilité de ce projet de loi : la remise en cause du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, opérée par les députés à l’article 11 du projet de loi. En effet, s’il est prévu d’inscrire dans la Constitution le principe de non-rétroactivité de la loi, il est également inscrit que ce principe peut souffrir des exceptions, en cas de « motif déterminant d’intérêt général ».
Cette exception, ouvrant la voie à toutes les interprétations, me semble directement inspirée des récents problèmes rencontrés par le Gouvernement en matière de rétroactivité de la loi relative la rétention de sûreté. Il n’est, en effet, pas simple de vouloir contourner un principe constitutionnel, énoncé à l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
Lors de nos débats, madame la garde des sceaux, nous avons eu droit à des démonstrations hasardeuses dans le but de faire adopter la rétroactivité de cette loi, quitte à prendre quelques libertés avec notre droit. Il aura fallu une mise au point du président de notre commission des lois pour vous rappeler que la rétroactivité s’applique non pas à la condamnation – comme vous nous l’avez pourtant dit –, mais aux faits incriminés.
Cependant, le Président de la République ne reculant devant rien, il n’a pas hésité à demander au premier président de la Cour de cassation, Vincent Lamanda, de trouver les moyens de contourner la décision du Conseil constitutionnel qui, entre-temps, avait considéré que « la rétention de sûreté [...] ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement ».
Or M. Lamanda, dans son rapport intitulé « Amoindrir les risques de récidive criminelle des condamnés dangereux », qu’il vient de remettre au Président, ne vous offre toujours pas la possibilité d’appliquer la loi de façon rétroactive. L’occasion était donc toute trouvée pour qu’un amendement soit opportunément déposé lors de cette révision constitutionnelle afin de permettre qu’un « motif déterminant d’intérêt général », comme la lutte contre la récidive, par exemple, justifie qu’une loi soit rétroactive.
Si nous adoptions définitivement une telle disposition, notre Constitution abriterait finalement une disposition permettant l’adoption de lois contraires à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Enfin, dernier motif d’irrecevabilité, l’article 35 du projet de loi devait prévoir la modification du titre XV de la Constitution à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007.
Ce traité, aujourd’hui soumis aux États membres de l’Union, devait n’entrer en vigueur que lorsque ceux-ci l’auraient tous ratifié. Le « non » irlandais, dont je me félicite, mais que certains méprisent déjà comme ils ont méprisé le « non » du peuple français en 2005, devrait profondément remettre en cause non seulement le processus de ratification, mais également l’adoption de l’article 35 du projet, désormais dépourvu de fondement.
Toujours est-il que le projet de révision de la Constitution suspend le contenu de la Constitution révisée à la ratification du traité de Lisbonne par les autres États européens. Cette conditionnalité, qui renvoie à l’expression de la volonté d’autres États, est incompatible avec les fonctions des lois constitutionnelles régies par l’article 89 de la Constitution. En effet, le pouvoir constituant dérivé ne saurait subordonner le contenu des dispositions de la Constitution à la décision d’États étrangers.
Une telle technique revient à déléguer la fonction constitutionnelle dérivée – ou, en tout cas, à associer des États étrangers à son exercice –, ce qui est absolument incompatible avec la fonction exclusive de révision constitutionnelle mise en place par l’article 89 de la Constitution. Une telle délégation ne pourrait résulter, au mieux, que de la volonté du pouvoir constituant originaire.
Quant au pouvoir constituant dérivé exprimé par la voie des lois constitutionnelles de l’article 89 de la Constitution, il peut, certes, autoriser la ratification d’un traité contraire à la Constitution, mais il ne saurait subordonner l’entrée en vigueur d’une révision constitutionnelle à l’entrée en vigueur d’un traité et, par là, à une décision d’autorités étrangères qui seraient ainsi associées à l’exercice du pouvoir constituant dérivé.
Une telle altération de la technique de révision constitutionnelle aboutit à une délégation inconstitutionnelle du pouvoir constituant. Elle constituerait un précédent extrêmement dangereux si le « non » irlandais ne remettait pas en cause l’article 35.
La motion de renvoi en commission que mon collègue et ami Robert Bret défendra tout à l’heure sera l’occasion de revenir sur la question du traité de Lisbonne.
En tout état de cause, cette réforme constitutionnelle ne vise nullement à renforcer la démocratie, à rendre le pouvoir au peuple et à ses représentants, mais bel et bien à assouvir les désirs de prééminence institutionnelle d’un seul homme, au détriment des principes fondamentaux qui régissent notre démocratie.
Elle ne porte pas d’ambition moderne et progressiste, mais tend à faire survivre les archaïsmes de l’oligarchie conservatrice.
Mes chers collègues, nous vous proposons donc d’adopter cette motion tendant à déclarer irrecevable ce projet de loi de révision constitutionnelle.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Madame Assassi, vos efforts sont tout à fait méritoires, mais, comme vous en êtes d'ailleurs rendu compte, il est difficile d’opposer l’exception d’irrecevabilité à un texte qui vise, précisément, à réviser la Constitution !
Toutefois, vous avez évoqué plusieurs questions intéressantes.
S'agissant de la non-rétroactivité des lois, l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen pose un principe fondamental, même si, nous le savons, la rétroactivité peut s’appliquer dans certains cas en matière civile. Néanmoins, nous ne voulions pas introduire d’ambiguïtés en précisant ce point dans la Constitution. J’élimine donc cet argument !
En fait, la seule question qui pourrait être débattue est celle de la supra-constitutionnalité. Qu’y a-t-il au dessus du pouvoir constituant ? Personne ! Seul le dernier alinéa de l’article 89 de la Constitution limite notre faculté de réviser la Constitution. Il s’appliquerait si nous mettions en cause « la forme républicaine du Gouvernement ». Mais que se passerait-il alors ? Qui ferait respecter la Constitution ? Il s'agit là d’un débat tout à fait théorique. Laissons-le aux juristes et aux constitutionnalistes, qui en sont coutumiers !
Aujourd'hui, il s'agit de modifier la Constitution afin d’accorder des pouvoirs plus importants au Parlement. Et je vous renvoie à ce sujet au rapport de la commission des lois : au début de la IIIe République, l’intervention du Président de la République devant l’Assemblée nationale était encadrée par le « cérémonial chinois ». Cette procédure était tout à fait extraordinaire : le Président de la République informait l’Assemblée nationale de son intention de s’exprimer, puis intervenait devant elle, sauf si les députés en décidaient autrement.
Aujourd'hui, empêcher le Président de la République de venir s’exprimer devant les assemblées réunies en Congrès serait d’une incroyable chinoiserie ! Et d’un conservatisme proprement extraordinaire !
D'ailleurs, pourquoi les monarchistes s’opposaient-ils à la venue du président Adolphe Thiers devant l’Assemblée nationale ?

Parce qu’ils redoutaient son verbe, qui lui permettait d’influencer l’Assemblée nationale et de faire basculer la majorité. Si vous craignez que le Président de la République n’en fasse autant, vous avez sans doute raison, car il possède une force de conviction sans commune mesure avec celle de beaucoup d’autres hommes politiques !

Enfin, madame Assassi, vous affirmez que, depuis les débuts de la Ve République, vos amis ont combattu les institutions – c’était d'ailleurs leur droit –, et notamment l’élection du Président de la République au suffrage universel.
Mais permettez-moi tout de même de vous rappeler, à vous qui, tout comme moi, êtes démocrate, que cette disposition constitutionnelle a été approuvée par référendum, en 1962, par quelque treize millions d’électeurs, alors que moins de huit millions de voix la rejetaient ! Si l’on n’admet pas ce principe, on peut tout affirmer !
Exclamations sur les travées du groupe CRC.

Le peuple s’est prononcé par référendum et l’élection du Président de la République au suffrage universel fait donc partie, désormais, de notre patrimoine institutionnel, que cela vous plaise ou non !
Pour tous ces motifs, et ne serait-ce que parce que l’exception d’irrecevabilité ne peut être opposée à une révision constitutionnelle, la commission émet donc, bien sûr, un avis défavorable sur cette motion.
En vérité, monsieur le président, le Gouvernement partage totalement l’analyse de président Hyest sur cette motion.

Je mets aux voix la motion n° 2, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi constitutionnelle.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 96 :
Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi, par M. Sueur et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, d'une motion n° 1 rectifiée.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 365, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8 du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, auteur de la motion.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, j’ai le sentiment que mes arguments sont si forts que je vais pouvoir résumer mon propos ! Je me contenterai donc de développer trois points.
Premièrement, ce projet de loi constitutionnelle contient nombre de leurres et de faux-semblants. On nous affirme qu’il est porteur de « réformes profondes », mais, quand on y regarde de plus près, on s’aperçoit qu’il n’en est rien.
Bernard Frimat a brillamment exposé tout à l'heure ce qu’il en était du droit de veto des parlementaires sur les nominations. Celui-ci sera conditionné au vote des trois cinquièmes des membres des deux commissions compétentes de chaque assemblée. À l’évidence, la portée de cette disposition aurait été tout autre si la même majorité avait été nécessaire pour valider – et non écarter – la nomination. Le dispositif qui nous est présenté n’emportera aucun effet concret.
En ce qui concerne la déclaration d’urgence, vous savez, mes chers collègues, que le Gouvernement y recourt beaucoup trop souvent, au point que celle-ci devient pratiquement la procédure de droit commun, ce qui est fâcheux pour les droits du Parlement. On nous affirme que cet abus cessera parce que les conférences des présidents des deux assemblées auront la faculté de refuser conjointement l’urgence. Mais ce cas de figure ne se produira pratiquement jamais, tout le monde le sait !
J’en viens au droit d’expression du Président de la République devant les assemblées, dont il a encore été question à l’instant.
Mes chers collègues, comme vous, j’écoute la radio et je regarde la télévision. Or, tous les jours, j’entends le Président de la République s’exprimer. En la matière, on ne peut pas dire qu’il y ait un manque… C’est plutôt le trop-plein !

J’imagine nos futurs déplacements vers le Congrès, que certains orateurs ont évoqués : dans l’autobus, en route pour Versailles, nous écouterons la radio, qui nous informera de la déclaration du Président de la République de la veille et commentera déjà ses propos du lendemain, cependant que quelques journalistes bien informés nous livreront en avant-première la teneur de la déclaration que nous apprêterons à entendre.
Nous ne pourrons rien lui répondre, et nous nous trouverons donc, au final, en situation d’infériorité par rapport aux nombreux citoyens qui peuvent rencontrer le Président de la République lors de ses déplacements.
Tout cela sera donc bien formel et quelque peu désuet. Ce n’est pas franchement une révolution !
Et qu’en est-il des droits de l’opposition ? Celle-ci disposerait librement de l’ordre du jour du Parlement pendant une journée par mois. On prétend que c’est extraordinaire, mais le changement n’est pas si considérable !
Quant au 49-3, il est maintenu, alors qu’on aurait pu le supprimer ou en réduire encore davantage l’usage.
Enfin, l’exercice du droit d’amendement serait réformé. Mais ce qui constitue un droit imprescriptible des parlementaires, et même l’une des conditions de leur existence, se trouverait soumis à des dispositions réglementaires.
Ces six exemples – j’aurais pu en mentionner d’autres – montrent que bien des changements proposés dans ce texte sont autant de trompe-l’œil.
Deuxièmement, j’évoquerai, après beaucoup d’autres, la question de la réforme du Sénat.
Chers collègues de la majorité, je persiste à ne pas vous comprendre : pourquoi refusez-vous de poser le problème, très simple, des conditions de l’alternance dans une assemblée démocratique, préférant développer une laborieuse casuistique ?
Comme j’ai décidé de ne pas abuser de votre patience, je n’évoquerai pas l’excellent discours de Jean-René Lecerf qui, il y a quelques semaines, a soutenu à cette tribune une motion tendant à opposer la question préalable à la proposition de loi présentée par Jean-Pierre Bel, qui visait à réformer le mode d’élection des sénateurs.
M. Lecerf a affirmé que le moment n’était pas venu de débattre de ce problème et qu’il fallait attendre l’examen du projet de loi de révision constitutionnelle. Ce texte arrive au Sénat, le président de la commission des lois annonce que l’on va discuter du problème et… il présente un amendement qui bloque tout !

Puis le président de l’Assemblée nationale s’exprime et il apparaît que tout cela fait désordre. Alors, l’amendement disparaît et l’on revient au statu quo ante, qui fait que notre assemblée, malheureusement, ne peut pas refléter la respiration démocratique.

Or, dans tous les pays du monde, on considère que l’alternance est un bienfait pour une assemblée parlementaire.
Monsieur Raffarin, puisque vous avez parlé de Pierre Mendès France, je voudrais à mon tour citer plusieurs phrases de son livre La République moderne.
Ainsi peut-on lire, page 120 : « Les réserves qui ont pu être formulées contre le Sénat portent le plus souvent sur son mode de recrutement bien plutôt que sur son existence même. » Il s’agit là d’une affirmation très sage de Pierre Mendès France.
Quelques pages plus loin, il écrit : « Chacun connaît l’injustice choquante qui préside souvent à la répartition des sièges sénatoriaux. » Pierre Mendès France avait déjà le sentiment qu’il y avait là quelque chose d’anormal.

Je ne fais pas de Pierre Mendès France un comptable. J’éprouve un grand respect pour lui, car il a bien voulu m’apporter un jour son soutien, ce que je n’oublierai jamais.

Le troisième et dernier point que je voudrais évoquer concerne le vote des étrangers aux élections locales. Pour nous, il s’agit d’une condition importante de la bonne intégration des étrangers qui vivent et travaillent depuis très longtemps dans notre pays.
Nous sommes persuadés que c’est une condition essentielle pour que s’atténue tout ce qui s’apparente encore aujourd’hui au refus, à la négation, parfois à la ségrégation, à la brimade, à la haine et pour que ces étrangers participent pleinement à la vie républicaine au niveau local.
Cette fois, permettez-moi de recourir à deux autres citations émanant de M. Nicolas Sarkozy. (Je vois que cela fait plaisir à M. Karoutchi !
M. Nicolas Sarkozy, dans un ouvrage, que j’ai lu avec beaucoup d’intérêt, publié en 2001, et intitulé Libre – c’est tout un programme ! – écrivait : « À compter du moment où ils paient des impôts, où ils respectent nos lois, où ils vivent sur notre territoire depuis un temps minimum, par exemple de cinq années, je ne vois pas au nom de quelle logique nous pourrions les empêcher de donner une appréciation sur la façon dont est organisé leur cadre de vie quotidien. » C’est très clair !
M. Nicolas Sarkozy, devenu ministre de l’intérieur en 2005, déclarait : « À titre personnel, je considère qu’il ne serait pas anormal qu’un étranger en situation régulière qui travaille, paie ses impôts et réside depuis au moins dix ans en France puisse voter aux élections municipales. »
Enfin, le 24 octobre 2005, M. Nicolas Sarkozy ajoutait qu’il fallait renforcer la chance de l’intégration pour les étrangers en situation légale et que le droit de vote aux municipales en faisait partie.
Et là, puisqu’il a été fait allusion à François Mitterrand, je voudrais rappeler – chacun s’en souvient sans doute – l’attitude qui fut la sienne au sujet de la question de la peine de mort.
Pour le vote des étrangers aux élections locales, depuis des années et des années, on nous dit que ce serait une bonne chose, mais que l’opinion n’est pas prête, que ce n’est pas le moment, qu’il faut attendre !
Puisque M. le Président de la République le dit, nous aurions pu avoir aujourd’hui l’occasion de mettre les actes en accord avec les paroles. En tout cas, cela aurait été un signe très fort pour la République. Avec la démocratisation du mode d’élection des sénateurs, cela aurait pu être un argument qui aurait pesé lourd dans notre décision.
Pierre Mendès France a beaucoup réfléchi et écrit sur les méfaits de la IVe République. Il a également beaucoup critiqué les défauts de la Ve République. Notre collègue Robert Badinter, lorsqu’il parlait de monocratie, disait que les défauts existent toujours et que rien n’est plus urgent, dans une réforme constitutionnelle, que de les remettre en cause afin d’améliorer l’équilibre des pouvoirs.
En conclusion, je citerai, en l’honneur de Pierre Mendès France, une autre phrase de son livre La République moderne. Page 52, il écrit : « Tout homme qui a le pouvoir […] est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. »
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Vous avez reconnu Montesquieu. C’est donc au nom de ses principes que j’ai l’honneur de vous présenter cette motion tendant à opposer la question préalable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

J’aime que l’on cite Montesquieu, mais on pourrait aussi évoquer Montaigne sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent aujourd’hui.
Même s’il n’y a rien de plus dangereux que les citations, je reconnais le bien-fondé de celles qui viennent d’être faites. Il faut toujours s’en méfier, et cela vaut pour tout le monde, car souvent les affirmations qui sont contenues dans tel ou tel passage d’un texte sont tempérées dans le paragraphe suivant.
Je comprends l’admiration que Jean-Pierre Sueur, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, nourrit à l’égard de Pierre Mendès France, qui fut un homme politique éminent et qui n’a pas toujours été compris, surtout par ses propres amis.
Ce débat est très intéressant. En fait, depuis le début, vous posez des préalables à l’examen du projet de loi de modernisation des institutions de la Vè République. Je pense notamment à la proposition de loi relative aux conditions de l’élection des sénateurs. Aujourd’hui vous nous avez parlé du vote des étrangers aux élections locales ou encore de l’expression du Président de la République devant le Parlement.
Vous ne défendez pas une motion tendant à opposer la question préalable, monsieur Sueur, car cela signifierait que les conditions ne sont pas remplies pour examiner le projet de loi qui nous est soumis.
Franchement, si cela vous fait si peur que le Président de la République puisse venir devant le Parlement une fois de temps en temps, je vous rappelle que la Constitution de 1848 obligeait le Président de la République au moins une fois par an à exposer l’état général des affaires de la République devant l’Assemblée nationale !
Par conséquent, selon les régimes, on peut quelquefois obliger, quelquefois interdire. Tout cela est intéressant, mais assez secondaire.
Vous avez dit que le mode d’élection des sénateurs interdit l’alternance. Je ne vois pas au nom de quoi l’on se repaît de tels propos !

Attendez de connaître les résultats des prochaines élections sénatoriales qui auront lieu au mois de septembre !
Bien sûr, le rythme n’est pas le même au Sénat qu’à l’Assemblée nationale, puisque notre assemblée est renouvelée par moitié tous les trois ans. Patientez, messieurs, le pire n’est pas sûr pour nous !
Vous avez parlé de l’urgence en évoquant d’éventuels leurres.
En ce qui concerne l’avis du Parlement sur les nominations effectuées par le Président de la République, l’Assemblée nationale a estimé qu’il devait y avoir un veto des trois cinquièmes pour interdire la nomination. Honnêtement, même avec l’avis simple, …

Mais si, il y a un avis simple, je suis désolé !
Franchement, si l’avis simple n’est pas favorable, je ne vois pas comment le Président de la République persisterait à nommer le candidat qu’il a proposé.
Enfin, concernant le vote des étrangers aux élections locales, certains, dont le Président de la République, ont dit qu’ils souhaitaient que ce droit leur soit accordé. À titre personnel, je considère que nous sommes dans un pays où l’acquisition de la nationalité est l’une des plus faciles. Cinq ans de résidence régulière suffisent. Je regrette, à titre personnel, les obstacles qui sont mis par de nombreux services ; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle les procédures ont été simplifiées afin que les dossiers ne passent plus par plusieurs ministères.
À propos de l’acquisition de la nationalité, je vous renvoie au rapport très intéressant qui avait été rédigé il y a quelques années sur le thème : « Devenir Français » et qui semble avoir été oublié.
Notre modèle d’intégration, à partir du moment où des personnes venant de l’extérieur s’installent durablement dans notre pays…

Ce n’est pas la même chose. Car, s’il existe une citoyenneté européenne, il n’y a pas de citoyenneté pour les étrangers, sauf s’ils deviennent français !
Par conséquent, vous alléguez des prétextes. Nous devons continuer l’examen du projet de loi qui nous est soumis et qui peut fondamentalement changer, notamment, les relations entre le Gouvernement et le Parlement.
Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, je vous demande de rejeter cette motion tendant à opposer la question préalable.

Nous avons entendu beaucoup de citations ce soir.
À mon tour, je voudrais citer un homme fort célèbre, souvent mentionné ici, le général de Gaulle, qui disait avec beaucoup de mépris en parlant du Sénat, ce « truc », ce « machin ».

Il aurait également pu le dire du Sénat, vu le mépris qu’il nourrissait pour notre assemblée.
Notre collègue Jean-Pierre Sueur a évoqué la démocratisation des assemblées, notamment du Sénat, où l’alternance n’est pas possible. Il n’est que de rappeler la proposition de loi que nous avons nous-mêmes déposée sur les conditions de l’élection des sénateurs et qui n’a pas donné lieu à débat puisqu’elle a été repoussée d’un revers de main.
De la même façon, pour le vote des résidents non communautaires, nous avons, à plusieurs reprises, déposé une proposition de loi et l’avons réintroduite dans différents textes sous forme d’amendements. Or, là aussi, on nous a rétorqué que ce n’était pas le moment !
Par conséquent, monsieur Hyest, je ne comprends pas votre raisonnement, qui revient à dire qu’en France il y aurait des citoyens de « demi-zone » qui paient leurs impôts, participent à la vie économique et sociale, mais qui ne peuvent pas prendre part à la vie municipale.
Quant à nous, nous réitérerons nos propositions dans les textes à venir en faveur des résidents non communautaires.

Nous aurons l’occasion de revenir sur les éléments de réponse que M. Hyest a apportés à M. Sueur puisque nous avons déposé des amendements sur ces sujets. Je me limiterai donc à deux observations.
Tout d’abord, M. Hyest considère que le droit de message du Président de la République est tellement secondaire qu’il est essentiel de le conserver.
Ensuite, atteignant le summum de son art intellectuel, il dit qu’il est favorable au vote des étrangers aux élections locales à condition qu’ils soient français !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Je mets aux voix la motion n° 1 rectifié, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi constitutionnelle.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 97 :
Le Sénat n'a pas adopté.

Je suis saisi, par M. Bret et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une motion n°505, tendant au renvoi à la commission.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, le projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République (n° 365, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à M. Robert Bret, auteur de la motion.

M. Robert Bret. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, à cette heure matinale, mon propos sera bref.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF.

Avant toute chose, je tiens à protester contre le refus de M. le président du Sénat de me donner, au début de la séance de cet après-midi, la parole pour un rappel au règlement sur l’organisation de nos travaux, comme l’autorisent expressément les textes.
J’estimais nécessaire, avec mes collègues du groupe CRC, d’éclairer le débat, avant l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs, sur les conséquences constitutionnelles de la caducité du traité de Lisbonne. Or, cette question fondamentale fut éludée : « Circulez, il n’y a rien à voir ! »
Le dépôt de la présente motion tendant au renvoi à la commission n’est pas un acte de procédure, encore moins une manœuvre dilatoire pour refuser un débat que nous appelons de nos vœux. Il est la conséquence du résultat du référendum irlandais.
Les Irlandais, vous le savez, viennent de rejeter, à 53, 4 %, le traité de Lisbonne, avec un taux de participation qui s’est élevé à 53, 1 %. C’est un résultat sans appel dont il convient de tirer toutes les conséquences !
Chaque État membre détient, en principe, un droit de veto. Le défaut de ratification par un seul des États membres de l’Union européenne suffit à faire obstacle à l’entrée en vigueur du traité modificatif. Or, c’est précisément cette hypothèse qui vient de se réaliser !
En votant clairement « non », le 12 juin 2008, les Irlandais ont exprimé leur refus du traité de Lisbonne ! Ce « non » cinglant du peuple irlandais rend ce texte caduc !
Dans la mesure où le traité de Lisbonne a été rejeté par un État membre de l’Union européenne, il ne peut pas entrer en vigueur. En conséquence, l’article 88-1 de la Constitution française, faisant explicitement référence à un traité qui n’entrera pas dans l’ordre juridique interne, devient inopérant et non pertinent.
Ainsi, alors que nous débattons de la réforme constitutionnelle, il convient dès à présent d’abroger l’article 88-1 de la Constitution et la loi constitutionnelle du 4 février 2008, qui, dans son article 2, modifie le titre xv de la Constitution.
Je rappelle que l’article 88-1 de notre Constitution, modifié par la loi constitutionnelle du 4 février 2008, prévoit, dans son second alinéa, que la République « peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne, modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007. »
L’article 88-6 de la Constitution évoque les actes législatifs européens. Or, cette nouvelle catégorie de normes juridiques est créée par le traité de Lisbonne, aujourd’hui caduc. Il n’est donc pas possible d’en maintenir la référence dans notre Constitution. La commission des lois a-t-elle un avis sur ce point ?

Si c’est le cas, il serait temps de le donner.
Le droit des traités prévoit que l’entrée en vigueur d’un traité nécessite le consentement de tous les États ayant participé à sa négociation. La convention de Vienne de 1969 pose, dans l’article 24 de la section 3, le principe que « un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi par tous les États ayant participé à la négociation. »
D’un point de vue juridique, l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne est donc conditionnée par la ratification unanime des 27 États membres de l’Union européenne.
C’est pourquoi, au nom de mon groupe, je demande à la commission des lois d’examiner, avant le début de la discussion des articles du projet de loi de révision constitutionnelle, les conséquences du rejet du traité de Lisbonne sur notre Constitution.
Monsieur le rapporteur et président de la commission des lois, mes collègues et moi-même attendons, vous le comprendrez, une réponse claire et précise. Vous ne pouvez vous y dérober, comme vous l’avez fait en début d’après-midi à l’issue de notre rappel au règlement.
Par ailleurs, je tiens à rappeler que nous avions eu l’occasion de souligner en début d’année, lors de la discussion du projet de loi constitutionnelle modifiant le titre xv de la Constitution, que ces dispositions validaient par avance le traité de Lisbonne. Elles manifestaient de fait l’approbation du contenu du traité et méconnaissaient le pouvoir d’autorisation de ratification de la souveraineté nationale.
En 2008, pour le traité de Lisbonne, comme en 2005, pour le traité établissant une Constitution pour l’Europe, le même schéma a été retenu : valider par avance le traité en y faisant explicitement référence dans la Constitution française.
L’argument avancé pour justifier cette procédure est que la généralité de la formule a pour objet de lever l’ensemble des obstacles juridiques à la ratification du traité. En fait, il s’agit de forcer le destin, de prendre acte de l’entrée en vigueur d’un traité avant que tous les instruments de ratification n’aient été déposés.
Pourtant, faut-il le rappeler, en 2005, le peuple français, par le référendum du 29 mai 2005, avait clairement et massivement exprimé son refus à l’entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l’Europe.
Après la victoire du « non » au référendum, qu’est-il advenu de l’article 1er du projet de loi constitutionnelle de 2005 ? Comme nous l’avions prévu, il est resté inscrit dans la Constitution française, devenant lettre morte.
Oui, cet article est resté inscrit dans notre Constitution jusqu’à l’adoption, en 2008, d’un nouveau projet de révision constitutionnelle dont l’article 1er prévoyait de remplacer les dispositions du second alinéa de l’article 88-1.
Aujourd’hui, la même erreur ayant été commise dans la loi constitutionnelle de 2008, avec la validation anticipée du traité de Lisbonne, nous sommes confrontés à la même difficulté.
Une disposition inopérante est inscrite dans notre Constitution. Il convient donc de la supprimer. Il est pour le moins regrettable que le Gouvernement n’ait tenu aucun compte de ce qui s’est passé en 2005, qu’il n’en ait tiré aucune leçon !
Que signifie cette procédure, qui aurait pu être évitée, en 2005 et en 2008, par la notification expresse de l’inapplicabilité de ces deux lois constitutionnelles en cas de rejet du traité modificatif ? Ne s’agit-il pas, sous couvert de cohérence juridique, de valider par avance une disposition non acceptée par le peuple et, en conséquence, de passer outre la souveraineté nationale ?
Pour le traité de Lisbonne, le Gouvernement pensait qu’il n’avait pris aucun risque, cette fois-ci. En effet, Nicolas Sarkozy avait décidé de passer outre à la décision du peuple français de mai 2005 en l’annulant par un vote du Parlement.
Plus généralement, les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Union européenne s’étaient entendus pour contourner les peuples en s’assurant que les ratifications parlementaires seraient préférées aux consultations populaires. Seul le gouvernement irlandais a dû recourir au référendum, puisque la Constitution de la République irlandaise lui en faisait l’obligation. On connaît le résultat : il fait obstacle à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui était escomptée au 1er janvier 2009.
Aujourd’hui comme en 2005 – mêmes causes, mêmes effets ! –, le second alinéa de l’article 88-1 de la Constitution et la loi constitutionnelle du 4 février 2008 doivent être abrogés. Aussi, nous vous invitons, mes chers collègues à voter le renvoi en commission, afin que nous puissions analyser les conséquences du référendum irlandais.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur le président, renvoyer un projet de loi en commission, c’est estimer que celle-ci n’a pas bien fait son travail.
Or la commission a siégé mercredi dernier toute la journée et, même si certains ont claqué la porte, …

Pour ce qui est du débat sur l’article 88-1 de la Constitution, je rappelle, mon cher collègue, que la commission examinera demain les amendements que vous avez déposés sur ce sujet.

Il n’est donc pas nécessaire de lui renvoyer le texte, même si je peux comprendre que vous saisissiez l’occasion que vous fournit la discussion de cette motion pour faire écho à votre rappel au règlement.
Sur le fond, je ne me réjouis pas que l’Irlande n’ait pas suivi les autres pays.

Pour autant, le processus n’est pas parvenu à son terme puisque de nombreux autres États doivent encore ratifier le traité.
L’Europe devra déterminer comment faire face à de telles situations ; mais il serait assez imprudent, si l’on croit un tant soit peu à la construction européenne, d’avoir aujourd’hui des propos définitifs sur le sujet.
Je rappelle de surcroît, puisque vous vous êtes référé à la convention de Vienne, qu’il n’y a pas de hiérarchie entre les États et qu’il n’y a pas de hiérarchie des normes en matière de traités. Ce qui compte, dans les traités, c’est la souveraineté des États, c’est ce que nous faisons, c’est ce qui sera inscrit dans le texte que nous voterons.
Pour en revenir à la motion, vous aurez la réponse à vos questions demain matin, lorsque la commission examinera vos amendements. C’est pourquoi je pense que le renvoi en commission non seulement n’est pas indispensable, mais est inutile.
Je vous propose donc, mon cher collègue, de retirer votre motion. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
La motion n'est pas adoptée.

J’ai reçu de M. le président de l’Assemblée nationale une proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 399, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques.

J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3886 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3887 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 243/2008 instituant certaines mesures restrictives à l’encontre des autorités illégales de l’île d’Anjouan dans l’Union des Comores.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3888 et distribué.
J’ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l’article 88-4 de la Constitution :
– Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, en ce qui concerne les normes de commercialisation pour la viande de volaille.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3889 et distribué.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 18 juin 2008, à quinze heures et le soir :
1. Examen de la proposition du président du Sénat tendant à la création d’une commission spéciale sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, de modernisation de l’économie (no 398, 2007-2008) et, éventuellement, nomination des membres de cette commission spéciale.
2. Suite de la discussion du projet de loi constitutionnelle (no 365, 2007-2008), modifié par l’Assemblée nationale, de modernisation des institutions de la Ve République.
Rapport (no 387, 2007-2008) de M. Jean-Jacques Hyest, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale.
Avis (no 388, 2007-2008) de M. Josselin de Rohan, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 18 juin 2008, à une heure trente-cinq.