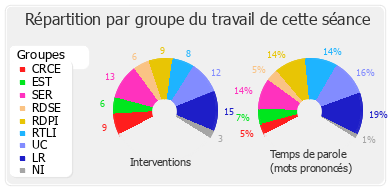Séance en hémicycle du 6 mai 2021 à 14h30
Sommaire
- Contrôle régulation et évolution des concessions autoroutières (voir le dossier)
- Écriture inclusive : langue d'exclusion ou exclusion par la langue (voir le dossier)
- Débat organisé à la demande du groupe les indépendants – république et territoires (voir le dossier)
- Association de taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales (voir le dossier)
- Ordre du jour (voir le dossier)
La séance
La séance, suspendue à douze heures quinze, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Pascale Gruny.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières, sur les conclusions de son rapport d’information.
Nous allons procéder au débat sous la forme d’une série de questions-réponses dont les modalités ont été fixées par la conférence des présidents.
Je rappelle que l’auteur de la demande dispose d’un temps de parole de huit minutes, puis le Gouvernement répond pour une durée équivalente.
À l’issue du débat, l’auteur de la demande dispose d’un droit de conclusion pour une durée de cinq minutes
Dans le débat, la parole est tout d’abord à M. Éric Jeansannetas, président de la commission d’enquête qui a demandé ce débat.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est avec une grande satisfaction que j’engage ce débat sur un sujet qui préoccupe nombre de nos concitoyens : les concessions autoroutières.
Depuis leur privatisation en 2006, les sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) sont l’objet de controverses, parfois légitimes, qui débouchent aussi sur des débats stériles, voire caricaturaux.
Dans quelles conditions la privatisation a-t-elle été réalisée ? Comment les tarifs sont-ils fixés ? Comment les nombreux avenants ont-ils été négociés ? Doit-on, en somme, mettre fin aux concessions ?
C’est pour apporter un éclairage documenté et objectif sur ces questions récurrentes dans le débat public que la commission d’enquête que j’ai eu l’honneur de présider a été créée sur l’initiative du groupe Union Centriste.
Il s’agissait, d’une part, de faire la lumière sur l’idée selon laquelle l’État serait, en quelque sorte, floué par les concessions en cours au profit des groupes concessionnaires et, d’autre part, d’anticiper la fin des concessions, qui interviendra dans dix ans pour les premières, ainsi que de formuler des propositions cohérentes et équilibrées pour que la répartition des profits futurs soit juste pour l’État, les usagers et les exploitants.
Tout au long de nos travaux, nous nous sommes donc attachés à analyser les relations entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes, et à retracer l’historique de la mise en place du réseau autoroutier.
Nous avons, par ailleurs, cherché à évaluer de manière rigoureuse le niveau réel de rentabilité de l’exploitation des autoroutes.
Enfin, nous nous sommes penchés sur l’effectivité des contrôles de l’État quant au respect des contrats en cours avec les concessionnaires.
Les autoroutes sont un bien commun. Elles constituent des infrastructures de grande ampleur et un outil d’aménagement du territoire. Pour réaliser de longs trajets en voiture, nos concitoyens sont quasiment obligés de les parcourir. On peut donc considérer qu’il s’agit à la fois d’un service public et d’un monopole économique. Était-il dès lors souhaitable de la part de l’État de les privatiser ?
Lorsque le Premier ministre Dominique de Villepin a décidé, en 2006, de privatiser les autoroutes, des ouvertures partielles du capital avaient déjà été réalisées depuis 2002. La situation budgétaire des SCA ne nécessitait pas d’intervenir en urgence et la majorité était d’ailleurs divisée sur le sujet – les auditions que nous avons menées nous l’ont confirmé.
Le choix qui a été fait à l’époque a été de récupérer en une fois un montant élevé – 14, 8 milliards d’euros – pour réduire la dette de l’État et financer de nouvelles infrastructures. Il s’agissait alors d’une décision politique. L’autre option était de continuer à percevoir, année après année, la rente que constitue l’exploitation des autoroutes, en assumant les aléas économiques : niveau du trafic, coût des travaux d’entretien…
Il n’est pas question ici de refaire l’histoire, mais d’envisager l’avenir. Notre commission d’enquête a estimé que les concessions en cours étaient trop longues d’environ dix ans : au-delà de 2022, les dividendes versés devraient atteindre 40 milliards d’euros, à comparer avec les coûts d’acquisition des sociétés.
Il apparaît donc impensable de prolonger les concessions en cours et si le choix est fait de les renouveler, lorsqu’elles arriveront à échéance, il faudra a minima en réduire la durée.
Je n’entrerai pas dans le détail de nos conclusions, car je vais laisser mon collègue rapporteur Vincent Delahaye s’en charger. Je souhaite simplement dire que le but du débat que nous avons aujourd’hui est de faire vivre le travail que nous avons mené. Nous ne voulons pas que notre rapport termine, comme bien d’autres avant lui, au fond d’un tiroir.
Dès maintenant, nous devons préparer la fin des concessions et faire valoir notre rôle de parlementaires, qui consiste à peser dans la décision publique sur un sujet d’intérêt général.

La parole est à M. Vincent Delahaye, rapporteur de la commission d’enquête.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux tout d’abord remercier le président Jeansannetas et tous les membres de la commission d’enquête sur les concessions autoroutières.
Je suis très heureux de ce débat, d’abord parce qu’il peut contribuer à faire en sorte que notre rapport ne finisse pas au fond d’un tiroir, comme c’est malheureusement trop souvent le cas en matière de rapports, ensuite parce qu’il nous donne l’occasion de vous accueillir, monsieur le ministre, et de débattre avec vous d’un sujet d’intérêt général, qui préoccupe nombre de nos compatriotes.
Notre but a toujours été d’aider le Gouvernement à mieux négocier avec les sociétés concessionnaires historiques pour favoriser l’intérêt général, celui de la collectivité et celui des usagers.
Dans cette affaire, le péché originel a consisté à ne pas modifier les contrats de concession des sociétés historiques d’autoroutes, conclus finalement entre l’État et lui-même. Ces contrats étaient assez mal ficelés et peu adaptés à une délégation de service public confiée au secteur privé. Ces contrats ont été modifiés, notamment en 2015, mais ces rectifications sont insuffisantes.
Nous aboutissons ainsi à une espèce de blocage juridique, que certains, il est vrai, contestent, notamment dans notre assemblée. Des juristes le contestent également. Néanmoins, le débat est légitime et il doit avoir lieu.
En tout état de cause, nous avons choisi d’adopter une autre stratégie, qui repose sur trois piliers.
Le premier pilier est la fin de la logique infernale consistant à compenser les travaux par un allongement de la durée des contrats. Les contrats, je viens de le souligner, sont mal ficelés et ne sont pas adaptés à des délégations de service public. Cessons donc de les proroger : tel est notre premier objectif. Nous avons pu constater lors de nos travaux que la rentabilité attendue par les groupes Vinci et Eiffage lors de la privatisation – et qui était d’un niveau considérable – était atteinte dix ans avant la fin des contrats. Cela signifie qu’il y a matière à négocier l’utilisation de ces surplus pour la réalisation de travaux complémentaires sans contrepartie, mais aussi pour des modulations tarifaires en fonction des usages – véhicules propres, covoiturage, etc.
Le deuxième pilier de notre stratégie est le sommet des autoroutes. Nous pensons qu’il faut inviter tous les protagonistes à s’asseoir autour de la table pour définir enfin l’équilibre économique et financier des contrats. C’est la pierre angulaire de toute discussion, c’est toujours sur ce sujet que l’on achoppe, il faut donc discuter.
Le troisième pilier, ce sont les pénalités. Le protocole de 2015 prévoyait en effet des pénalités pour le cas où le planning des travaux ne serait pas respecté, car des concessions ont été allongées à cet effet. Or le planning n’a pas été respecté pour les travaux prévus en 2015. Je précise par ailleurs que nous n’avons pas réussi à obtenir tous les détails que nous aurions voulu connaître sur ce point et que nous aimerions bien qu’ils nous soient communiqués. Les pénalités seront-elles appliquées ?
À mon sens, il ne faut pas oublier de préparer la fin des contrats et d’accélérer l’inventaire des biens de retour. Il importe également de s’assurer du maintien des investissements, notamment en matière d’entretien et de maintenance. Il convient aussi de réfléchir à des clauses visant à un meilleur équilibre des contrats de concession – revoyure et partage des gains – et impliquer les usagers, à travers leurs associations, sans oublier le Parlement.
Les parlementaires ne sont pas des empêcheurs de tourner en rond, mais peuvent être des aidants et des soutiens. C’est comme cela, monsieur le ministre, que nous serons ensemble plus utiles et plus efficaces !
Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, les autoroutes font partie de la vie des Français.
Beaucoup, les empruntent chaque jour pour aller au travail ou pour faire leurs courses. D’autres, les empruntent seulement quelques fois dans l’année, pour partir en vacances. Mais tous les Français ont une expérience de l’autoroute. C’est parce qu’elles sont si ancrées dans leur vie, si indispensables à leurs déplacements, si structurantes pour nos territoires, qu’elles méritent toute notre attention. Elles méritent plus que des raccourcis et des débats simplistes.
Il faut d’abord le rappeler, nos autoroutes sont un modèle de modernité, de confort et de sécurité. Oui, la France peut se targuer d’avoir l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur réseau autoroutier du monde.
Nous pouvons être fiers de ce modèle façonné il y a près de soixante-dix ans. La loi de 1955 portant statut des autoroutes, conçue en plein « boom automobile » de l’après-guerre, répondait alors au besoin d’équiper rapidement le territoire. Mais, depuis, le monde a changé et nos besoins aussi. Le paysage des acteurs autoroutiers, leur relation avec l’État et les contrats de concession sont bien différents de ceux qui prévalaient alors.
Les contrats actuels, justement, doivent prendre fin de 2031 à 2036. C’est l’occasion de faire un bilan critique de notre modèle de financement et de gestion des infrastructures, sans complaisance ni démagogie. C’est l’occasion de le changer en mieux, de se demander quel est le modèle que nous voulons.
Le Sénat s’est de nouveau saisi de cette question l’an passé en lançant une commission d’enquête sur les concessions autoroutières, dont M. Jeansannetas était président et M. Delahaye rapporteur. Je tiens à souligner la qualité de ses travaux et la pertinence d’une grande partie des analyses de son rapport.
Celui-ci fournit des éléments d’éclairage précieux, tant sur les modalités d’amélioration des clauses contractuelles que sur les perspectives d’évolution du pilotage des contrats pour les années à venir. Nous avons examiné ses propositions avec attention et nous partageons un grand nombre de ses trente-huit recommandations.
Pour preuve, près de 60 % d’entre elles sont déjà appliquées ou en cours de mise en œuvre. Mais – car il y a un « mais » – nous avons un point de divergence, voire de désaccord, qui concerne vos estimations de rentabilité des concessions.
Nous avons d’abord relevé des biais méthodologiques, puisque l’analyse s’écarte de la doctrine retenue par le régulateur, dont les équipes d’experts travaillent depuis six ans sur la question.
Il y a aussi des écarts dans les projections. Certes, le sujet est complexe en cette période d’incertitudes liées à la crise sanitaire, mais entre la réalité des comptes des sociétés et les chiffres proposés par votre analyste, on passe du simple au double, voire du simple au triple !
Les résultats sont, là aussi, très éloignés de ceux du rapport quinquennal de l’Autorité de régulation des transports.
Enfin, je regrette que le rapport installe une fausse polémique sur la question du plan de relance autoroutier entériné par le protocole de 2015, dont l’équilibre économique a pourtant été expressément validé en 2014 par la Commission européenne, laquelle n’est pas spécialement laxiste sur ces sujets !
En d’autres termes, comme chaque fois qu’un rapport a été produit sur les concessions autoroutières, il n’existe aucun calcul ni aucune analyse qui prouverait de manière robuste une « sur-rentabilité » des sociétés concessionnaires.
Plutôt que d’entrer dans cette polémique qui ne fait pas progresser le débat, il me paraît plus utile de concentrer l’action de l’État sur deux priorités : un meilleur encadrement des contrats et la projection de l’avenir du modèle des concessions.
La première de ces priorités est de mieux encadrer les concessions existantes jusqu’à leur terme. L’année 2015 a marqué une étape décisive en la matière. Le plan autoroutier et la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi Macron, ont permis de rééquilibrer les relations entre l’État et les SCA.
Un dispositif limitant les éventualités de surprofits a été introduit dans les contrats historiques : en cas de surprofit, les tarifs de péages sont revus à la baisse ou la durée de la concession est réduite.
L’État récupère toutes les économies faites par les SCA sur les investissements résultant des décalages de calendrier ou des abandons de projets.
Le Parlement a également vu ses moyens de contrôle, d’évaluation et d’information considérablement renforcés. C’est ainsi au législateur qu’il revient d’autoriser l’allongement de la durée des contrats de concession.
Les pénalités en cas de défaillance d’une société sur la sécurité, la performance ou l’état du réseau sont continûment renforcées.
Enfin, la loi du 6 août 2015 a créé une autorité de régulation indépendante en matière autoroutière. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), devenue depuis l’Autorité de régulation des transports (ART), rend des avis publics sur les projets de nouveaux contrats de concession, mais aussi sur tous les projets d’avenants ayant une incidence sur les tarifs de péage. Elle produit annuellement une synthèse des comptes des sociétés concessionnaires et tous les cinq ans un rapport sur la rentabilité des contrats. Le premier rapport quinquennal de l’autorité a ainsi été publié à la fin de juillet 2020.
Certes, les contrats historiques représentent la majorité du réseau, mais l’État a aussi passé de nouveaux contrats de concessions bien plus stricts. Tous ceux qui ont été passés depuis les années 2000 respectent globalement les recommandations de votre rapport.
Notre deuxième priorité est de nous projeter, d’anticiper et de réfléchir à l’avenir des contrats de concessions.
Je l’avais déjà rappelé en tant que député, je reste constant sur la question : l’enjeu principal est de penser à ce que nous en ferons demain de nos concessions. Nous devons nous y atteler avec méthode, sans préjugé ni précipitation. Pour cela, il nous faut commencer par cadrer les grands termes du débat.
Faut-il interrompre les contrats avant qu’ils n’arrivent à leur terme, c’est-à-dire renationaliser ? Très clairement, non. Ce serait une gabegie financière de plus de 47 milliards d’euros, une entrave au droit des contrats et, ce faisant, un affaiblissement de l’État de droit.
Faut-il, à l’inverse, les prolonger ? Je sais que certains d’entre vous y sont favorables. Je sais qu’intégrer de nouveaux projets locaux par adossement pourrait être intéressant pour certains territoires, le cadre européen étant, là aussi, particulièrement strict.
Mais je le disais, le monde a changé et nos besoins aussi. À trop vouloir prolonger les contrats du passé, nous risquerions d’accroître leur déconnexion avec les attentes des Français.
Assurément, les contrats anciens doivent être modernisés. Les moderniser, oui, mais comment ? Comment favoriser les nouvelles énergies peu émissives et mieux prendre en compte les questions environnementales ? Comment trouver des mécanismes pour une plus grande modération tarifaire ?
Je n’ai pas de vision arrêtée ou dogmatique sur le sujet. Ma conviction est que nous ne devons pas brider nos réflexions : nous avons eu l’occasion au cours des débats en commission d’évoquer les concessions multimodales, les concessions régionalisées, les tarifs segmentés. Bref, un nouveau modèle pourrait se construire de façon consensuelle.
Le « concession bashing » ne fera pas progresser le débat. N’oublions pas que les sociétés concessionnaires ont produit 50 milliards d’euros de recettes fiscales entre 2006 et 2018. En plus de cela, sur la même période, elles ont investi 20 milliards d’euros dans le patrimoine autoroutier. Sans le modèle concessif, des dizaines de projets d’infrastructures, au service des Français, n’auraient pu voir le jour.
Pour aborder toutes ces questions et définir les aménagements à réaliser d’ici là, vous plaidez, monsieur le rapporteur, pour l’organisation d’un sommet des autoroutes. Sur le principe, j’y suis favorable.
Il doit nous permettre de trouver comment gérer la « fin de vie » des contrats, sans les plonger dès maintenant dans un coma artificiel. Il me semblerait en effet insoutenable de ne procéder à aucun aménagement complémentaire dans les dix à quinze prochaines années. Nous avons déjà commencé à y travailler, en intégrant le déploiement de bornes électriques, les nouvelles mobilités ou l’expérimentation de péages en flux libre.
Par ailleurs, nous avons besoin d’un cénacle où débattre des perspectives de gestion du réseau concédé. Nous aurons ces débats aujourd’hui et je m’engage à ce que nous puissions les poursuivre dans un horizon qui reste à définir. Le Parlement sera évidemment associé à ces réflexions.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cette question de l’avenir des concessions autoroutières engage le pays pour les prochaines décennies…
Le débat doit donc impliquer toutes les parties prenantes : les usagers particuliers, les entreprises, les collectivités territoriales et l’État, bien sûr. Nos autoroutes doivent rester un atout pour la France, pour les Français, pour leurs déplacements. Elles doivent, mieux qu’avant, embrasser les enjeux écologiques et sociaux de notre temps.

Nous allons maintenant procéder au débat interactif.
Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente.
Dans le cas où l’auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires à condition que le temps initial de deux minutes n’ait pas été dépassé.
Dans le débat interactif, la parole est à Mme Christine Lavarde.

Monsieur le ministre, les travaux de la commission d’enquête ont montré que la rentabilité pour les actionnaires serait atteinte autour de 2022. J’entends que vous contestez ces chiffres.
Certes, comme vous l’avez souligné, les nouveaux contrats sont mieux conçus puisqu’ils comportent des clauses de retour et de partage cette sur-rentabilité.
Pour autant, ce n’est pas le cas des contrats historiques puisque rien n’a été prévu lors de la privatisation de 2006. Il a fallu attendre le plan de relance autoroutier de 2015 pour y insérer des clauses, mais elles sont beaucoup moins nombreuses – deux pour les contrats historiques contre quatre pour les nouveaux contrats. De surcroît, ces clauses ne sont applicables qu’à partir de seuils de déclenchement.
Or l’Autorité de régulation des transports, puisque vous donnez foi à ses documents, qualifie dans son rapport de juillet 2020 le seuil de déclenchement de « hautement improbable ». Cela m’amène à vous poser un certain nombre de questions, notamment afin de trouver des solutions pour parvenir à rééquilibrer le partage de cette sur-rentabilité.
Le Gouvernement va-t-il donner à l’ART les moyens de collecter auprès des sociétés d’autoroutes les informations nécessaires à l’analyse des variations de la rentabilité depuis 2002 ?
Le Gouvernement va-t-il soutenir la proposition de loi déposée par le président du groupe Les Républicains, qui vise à durcir les clauses prévues pour les contrats historiques, à savoir les clauses de « péage endogène » et de « durée endogène » ? Si tel n’était pas le cas, quelles sont les solutions du Gouvernement ?
Madame la sénatrice Lavarde, je vous répondrai en quelques points.
Je reviendrai d’abord sur l’hypothétique sur-rentabilité des concessions et citerai plus précisément les chiffres du rapport quinquennal de l’ART remis à l’été 2020, qui paraissent diverger avec les conclusions des travaux de la commission. Selon l’ART, les rentabilités des contrats des sociétés historiques, puisque c’est souvent à elles que l’on fait référence, sont estimées autour de 7, 8 %, dans une fourchette oscillant entre 6, 4 % et 9, 2 %. Il est aussi indiqué que les taux de rentabilité interne ont enregistré une évolution favorable, mais modérée depuis 2007 en raison de la situation macroéconomique.
Par ailleurs, et vous le savez, le plan de relance autoroutier de 2015 n’a pas engendré de surcompensation. Les investissements prévus, à hauteur de 3, 2 milliards d’euros, ont essentiellement porté sur des élargissements de sections et sur la construction ou la modification d’échangeurs. L’équilibre de la compensation dans le plan de relance autoroutier a été confirmé, je le soulignais dans mon propos liminaire, par la commission lors de sa décision du 24 octobre dernier.
C’est la sous-estimation du taux de rentabilité interne (TRI) par le rapport qui conduit à conclure à une surcompensation chiffrée à 4 milliards d’euros, soit plus que la valeur des investissements du plan, ce qui n’est pas compréhensible.
En ce qui concerne les mécanismes limitant les surprofits dans les contrats historiques, en cas de surperformance économique sur la période d’allongement du contrat soit les tarifs de péage sont revus à la baisse, soit la durée de la concession est réduite.
Par ailleurs, le gain financier issu de tout décalage dans l’exécution des investissements par ces sociétés est également et intégralement restitué au concédant. Nous avons donc là un dispositif qui nous permet de bien encadrer l’équilibre économique des contrats.
En ce qui concerne les moyens de l’ART, cette autorité embrasse aujourd’hui des compétences beaucoup plus larges et est tout à fait à la hauteur des missions qui lui sont assignées.

En préambule, j’avais pris la peine de souligner que M. le ministre ne partageait pas notre constat sur la sur-rentabilité, mais je l’ai invité à nous dire ce qu’il envisageait pour le futur. J’avoue que je n’ai eu absolument aucune réponse. Mes questions étaient pourtant assez précises, d’autant que je donnais des outils pour demain, qu’il s’agisse du renouvellement des concessions ou s’il s’avérait que les chiffres de la commission d’enquête soient exacts.
Je me suis appuyée sur le rapport de l’autorité de régulation de juillet 2020. Sur les clauses que vous nous avez décrites comme devant permettre de prévoir « un retour à meilleure fortune » du concédant et surtout de l’usager, l’autorité écrit elle-même que « le déclenchement des clauses de “péage endogène” apparaît plausible […] tandis que celui des clauses de “durée endogène” semble hautement improbable, c’est-à-dire qu’il se produit uniquement dans des cas que l’Autorité juge invraisemblables ». Il me semble donc que la lecture était perfectible !

Monsieur le ministre, mes chers collègues, l’évolution des concessions autoroutières est régulièrement évoquée en France depuis des décennies par des représentants de tous les bords politiques.
En 2015, alors membre du groupe de travail sur les sociétés concessionnaires d’autoroutes, j’ai refusé de signer les conclusions présentées par ce groupe pour une raison simple. Le calcul virtuel de la rentabilité à l’instant t par l’Autorité de la concurrence omettait deux éléments essentiels : le montant du rachat autour de 22, 5 milliards d’euros et la reprise de la dette pour plus de 17 milliards d’euros – excusez du peu ! Cette présentation était donc erronée et ne permettait pas d’évaluer la rentabilité réelle des concessions.
Je ne remets, bien sûr, pas en cause la rentabilité de ces dernières, mais je remets en cause les montants de cette manne financière. Le rapport de la commission d’enquête ne tient pas compte non plus de l’inflation depuis 2006. Doit-on rappeler que la privatisation date d’il y a quinze ans ? Il ne fait également pas référence aux pertes engendrées par les confinements successifs.
Je rappelle que le prolongement des concessions si décrié est dû à une volonté de l’État qui n’a pas pu honorer ses engagements en matière d’investissements pour l’extension du réseau.
Comme toujours on se pose la question de la fin des concessions et du retour de l’État dans la gestion des autoroutes. Le rapport d’enquête est clair : le rachat des concessions, vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, s’élèverait à environ 50 milliards d’euros !
Outre le fait que nous traversons une crise majeure, qui demande des moyens financiers importants, j’identifie deux problèmes supplémentaires : celui des recettes et celui du risque de non-affectation à l’entretien de notre réseau, qui est l’un des meilleurs d’Europe.
Rappelons que l’État, avant la privatisation, percevait une manne très faible de la part des sociétés publiques qui exploitaient ce réseau. La réflexion autour de contrats plus équilibrés me paraît ainsi être la proposition la plus juste. La crédibilité de l’État français et de sa parole est en jeu…

Vous avez épuisé votre temps de parole, mon cher collègue.
La parole est à M. le ministre délégué.
Monsieur le sénateur, un point d’abord sur le bilan objectif que vous avez partiellement tracé, mais qui est un bilan positif du modèle concessif. Nous sommes quand même passés en soixante-dix ans en France de 80 kilomètres d’autoroutes à plus de 9 000 kilomètres qui sont bien entretenus, sécurisés et qui ont permis de désenclaver et de moderniser avec succès un certain nombre de territoires au moment où la route était le moyen de transport plébiscité.
En ce qui concerne l’équilibre économique des contrats, je n’y reviendrai pas, car nous en avons discuté préalablement. Par ailleurs, j’ai essayé de dresser un bilan le plus complet possible lors de mon intervention liminaire. En plus de l’encadrement, le confinement et l’époque récente nous apprennent – mais nous savions déjà depuis 2008 – que le risque lié aux fluctuations du trafic est bien réel, y compris pour les concessions autoroutières.
Vous avez évoqué des points positifs comme la plus faible inflation ou l’environnement de taux bas. Mais des risques avaient également été soulignés, qui se sont révélés bien réels : c’est le cas du risque « trafic » qui a fait perdre aux sociétés plusieurs milliards d’euros à la suite du confinement.
Je veux redire combien nous sommes ouverts à la réflexion sur un futur modèle moderne de gestion des autoroutes concédées et des réseaux au sens large, ainsi que sur la place de l’État. Nous parlons là d’infrastructures à l’horizon de 2040 ou de 2050, avec un très grand rééquilibrage de la route et l’émergence d’autres modes de transport. Il n’est pas tout à fait impossible de concevoir de nouvelles concessions qui seraient davantage multimodales, et tournées vers les enjeux écologiques et sociaux auxquels j’ai fait référence.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, le verdissement de nos autoroutes est une nécessité qui, loin d’être nouvelle, s’impose aujourd’hui fermement.
Il est essentiel que les concessionnaires encouragent les mobilités à faible empreinte carbone, mais sans reproduire les erreurs passées. Le soutien à des mobilités écologiquement vertueuses doit se faire sans contreparties financières supplémentaires, car personne ne contestera la rentabilité économique des sociétés d’autoroutes. Ce n’est pas faire du concession bashing démagogique que de dire que la hausse de leurs profits pour la décennie à venir est indéniable. Selon les projections du rapport, la rentabilité « actionnaires » serait atteinte dès 2022. Les dividendes distribués pourraient atteindre la somme de 40 milliards d’euros d’ici à 2036.
Voilà l’argument que le concédant doit avancer au cours de la prochaine négociation pour « verdir » les tarifs et orienter les investissements vers la décarbonation sans compensation nouvelle. La prise en compte des enjeux environnementaux doit être une obligation contractuelle. C’est le principe même de l’écoconditionnalité.
Pour préparer l’avenir, il faut rééquilibrer les contrats en faveur de l’intérêt public. Il s’agit de définir concrètement la responsabilité sociale et environnementale des concessionnaires.
Dans le prolongement de la loi d’orientation des mobilités, le déploiement des bornes de recharge électrique doit passer à la vitesse supérieure. L’aménagement de voies réservées au covoiturage et aux transports collectifs doit nettement progresser, et des incitations tarifaires significatives être proposées aux véhicules les plus vertueux, en particulier pour les poids lourds. Sur les tronçons autoroutiers publics, une réduction tarifaire importante est d’ores et déjà proposée aux véhicules électriques.
Ma question est donc la suivante : comment amener les concessionnaires à un cahier des charges ambitieux de décarbonation pour garantir que ces acteurs incontournables prennent réellement en compte l’objectif de l’accord de Paris ?
En matière d’enjeu écologique, le tournant a été pris au début des années 2000 avec le paquet vert autoroutier. Dans les plans de relance de 2015 et l’avenant de 2018, plus de 400 millions d’euros cumulés ont été consacrés à ces investissements, qui étaient à l’époque historiques : ils ont permis de réaliser des ouvrages protégeant la biodiversité, d’améliorer l’assainissement ou encore de supprimer des points noirs du bruit.
Pour autant, vous avez raison de le dire, il faut aller plus loin. Des expérimentations sont aujourd’hui pleinement satisfaisantes : je pense notamment à celles sur les flux libres. Nous avons lancé, en lien avec les concessionnaires, un grand plan de déploiement des bornes de recharge électrique. À la fin de l’année, plus de 60 % des aires de recharge sur le réseau concédé seront dotées de bornes à grande puissance, à périmètre constant des contrats. Ce dispositif matérialise bien le co-investissement équilibré entre l’État et les sociétés concessionnaires dans cette grande transformation écologique que nous accompagnons aujourd’hui.
L’ensemble des propositions que nous avons reçues, tout comme les débats que nous avons pu avoir avec les élus, intègrent pleinement la dimension environnementale, et je sais les concessionnaires parfaitement engagés sur le sujet.

Avec un maillage autoroutier de près de 9 500 kilomètres, la France se situe, avec son voisin allemand, en pole position des pays européens en termes de longueur du réseau. Symbole du modernisme des Trente Glorieuses, ce réseau, concédé à 90 % à des sociétés à capitaux privés, a perdu de sa superbe.
En effet, notre parc autoroutier, s’il est nécessaire et performant pour nos usagers, doit se réinventer, notamment pour se conformer aux nouvelles exigences environnementales.
Pour autant, nous sommes défavorables à la renationalisation de nos autoroutes. L’État ne pourrait se permettre de gonfler son déficit de 50 milliards d’euros supplémentaires en rachetant les concessions, dont les premières arrivent à échéance en 2031.
Nous sommes en revanche favorables à un rééquilibrage des relations entre l’État et les sociétés concessionnaires, notamment en termes d’accompagnement vers les nouvelles mobilités.
Des investissements importants pourraient être mis en place en faveur du covoiturage, des parkings relais et des transports collectifs. Le projet de loi Climat et résilience, que nous examinerons prochainement, sera un véhicule pertinent pour proposer ces nouvelles alternatives durables.
Monsieur le ministre, comment comptez-vous accompagner les sociétés concessionnaires d’autoroutes pour qu’elles puissent se conformer à ces exigences ?
Madame la sénatrice, ce que nous faisons en matière de véhicules électriques est un bon exemple des exigences réciproques de l’État et des sociétés concessionnaires et du respect du droit des contrats.
Vous le savez, nous avons lancé un grand plan de déploiement des bornes électriques – je le disais à l’instant – à la fois sur les réseaux concédés et non concédés et, plus largement, partout en France, de manière à permettre l’itinérance, qui est un élément essentiel de la confiance des consommateurs.
D’ici à la fin de l’année, 60 % des aires des réseaux concédés seront couvertes et 100 % le seront d’ici à la fin de 2022. Dans le même temps, nous menons ce chantier sur le réseau routier non concédé. J’évoquais l’équilibre économique parce que, dans cette « petite affaire », l’État investit 100 millions d’euros du plan de relance, ce qui est important, et les sociétés concessionnaires 500 millions d’euros, et ce dans une durée très courte. Comme vous pouvez l’imaginer, cet investissement implique des textes réglementaires, la mise en place du raccordement physique de la distribution énergétique, etc.
Ce plan est vraiment, je le crois, l’illustration d’un équilibre contractuel opérationnel et d’une vision partagée avec les sociétés concessionnaires au service des Français et dans une temporalité très réduite. Cet équilibre augure de belles choses pour l’avenir.

Monsieur le ministre, le rapport de la commission d’enquête indique que les dividendes versés aux actionnaires des concessions autoroutières devraient atteindre 40 milliards d’euros au-delà de 2022, chiffre que vous contestez.
La privatisation de 2006 dont vous et nous héritons aujourd’hui s’est donc faite au détriment des contribuables, des usagers des autoroutes concédées, mais aussi des usagers des autres infrastructures de transport et du désenclavement des territoires. Cette manne aurait pu servir à financer une bonne partie du réseau routier national non concédé, à désengorger certains axes, à entretenir et développer nos infrastructures ferroviaires et à assumer des investissements qui nous ont fait tant défaut ces dernières années.
Dans son référé en date du 23 janvier 2019, la Cour des comptes a affirmé que les divers plans de relance autoroutiers décidés en faveur du réseau concédé présentaient un risque de surinvestissement qui contrastait « avec le sous-investissement constaté sur le réseau non concédé ». Aussi, j’adhère totalement à l’axe 3 du rapport de la commission qui vise à négocier une amélioration du service rendu aux usagers. La réflexion porte sur le verdissement des tarifs des péages, les véhicules les plus propres, les bornes de recharge électrique, auxquels j’aimerais inclure les points de ravitaillement en hydrogène.
En outre, il serait souhaitable que les sociétés concessionnaires d’autoroutes contribuent davantage au financement des autres infrastructures de transport, comme cela avait été décidé timidement en 2015 après l’abandon de l’écotaxe poids lourds, qui a engendré un manque à gagner de plus de 500 millions d’euros par an pour l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf).
Monsieur le ministre, comment le Gouvernement entend-il optimiser l’allocation des investissements dans les infrastructures de transport, en les réorientant prioritairement vers celles qui sont structurantes pour l’aménagement du territoire et en encourageant la transition écologique dans le domaine des transports ?
Monsieur le sénateur, je répondrai sur deux points.
D’abord, sur la contribution financière des sociétés concessionnaires au financement des infrastructures. Je l’ai rappelé dans mon propos liminaire, l’activité des concessions autoroutières a produit 50 milliards d’euros de recettes fiscales entre 2006 et 2018. Par ailleurs, une contribution de plus de 10, 5 milliards d’euros a été versée à l’Afitf, ce qui représentait un tiers du budget de l’agence, au bénéfice de nombreux autres projets, y compris ferroviaires.
Nous voyons bien là le caractère vertueux du financement du mode routier, autoroutier en l’occurrence, au bénéfice d’autres modes de transport, comme nos petites lignes ferroviaires, nos routes non concédées ou nos ponts.
Ensuite, le deuxième sujet que vous avez, à raison, abordé est le sous-investissement chronique qu’ont subi les réseaux dits secondaires ou le réseau non concédé s’agissant de la route. Or, depuis 2017 et de façon constante, nous avons progressivement, tant sur les nouveaux investissements que sur la régénération et l’entretien, augmenté ces budgets pour passer approximativement de 700 millions à 1 milliard d’euros. Nous avons lancé, il y a quelques semaines à peine, un grand appel à projets « Ponts connectés » afin de nous assurer que nous avons les capacités de connaître notre patrimoine et de veiller à ce qu’il soit bien entretenu.
Monsieur le sénateur, depuis 2017, nous avons adopté une loi d’orientation des mobilités qui est équilibrée et financée. Vous avez parlé du trou de 500 millions d’euros : il a été comblé depuis. Vous le savez, 11 milliards des 100 milliards d’euros du plan de relance ont été consacrés aux transports pour répondre à l’ensemble des enjeux de transition écologique et d’équité dans nos territoires. Je crois que nous avons répondu là précisément et de façon très volontaire à votre questionnement.

Le Sénat a fait œuvre utile avec cette commission d’enquête sur la régulation des concessions autoroutières, et j’en remercie son rapporteur et son président.
Mieux qu’un rapport, ces travaux constituent un point d’appui utile et étayé pour mener le combat permettant le retour d’un État stratège en matière d’infrastructures d’intérêt national et d’aménagement du territoire.
Depuis de trop nombreuses années, ce scandale perdure sans que rien s’oppose aux mastodontes privés. Les sociétés concessionnaires sont de véritables machines à cash puisque, même en temps de crise, même en 2020, les dividendes s’élèvent à 2 milliards d’euros.
Entre 2006 et 2019, ce sont 24 milliards d’euros qui ont été distribués. Un « pognon de dingue » qui aurait été plus utile à la solidarité nationale…
Pourtant, les pouvoirs publics ne sont pas démunis.
Je souhaiterais attirer votre attention, monsieur le ministre, et avoir votre avis sur un point précis. Il s’agit des obligations reposant normalement sur le concessionnaire au titre de l’article L. 3131-5 du code de la commande publique relatif notamment à l’inventaire du patrimoine. À ma connaissance, ce rapport n’a jamais été remis à l’autorité concédante, donc à l’État. Comment justifier cette opacité ? Comment, dans ce cadre, travailler à une reprise des concessions ? Comment comprendre que l’État, encore une fois, ne fasse pas respecter ses droits, au nom de l’intérêt public ?
Monsieur le sénateur, je vais essayer de répondre le plus précisément possible à cette question technique. Vous avez raison de dire que l’établissement de l’inventaire du réseau est un enjeu clé, indispensable, lié à la définition du bon état cible du réseau en fin de concession sur lequel je reviendrai.
Je tiens à rappeler un chiffre important, que nous avons déjà évoqué : celui de 150 milliards d’euros, qui représente la valeur du patrimoine autoroutier français. À défaut d’un entretien soigné et régulier, ce patrimoine se détériore sous l’action du trafic et des agressions naturelles et nécessite alors des travaux de régénération considérables.
La rénovation et le renouvellement de ce patrimoine se planifient et requièrent des travaux s’étalant sur plusieurs années dont les concessionnaires ont la responsabilité. En amont des fins de concession, l’action du concédant, c’est-à-dire l’État, en matière de contrôle du patrimoine et de politique d’entretien doit s’intensifier – c’est la fameuse clause des sept ans – afin d’éviter qu’un sous-investissement ne se traduise par une dégradation du patrimoine en fin de contrat.
Depuis plusieurs années, l’État élabore une stratégie et un plan d’action pour structurer et renforcer l’efficacité de son intervention dans ce domaine. Trois chantiers ont ainsi été engagés avec les concessionnaires. Il s’agit d’abord de dresser un inventaire du patrimoine autoroutier concédé, ensuite de définir les outils et les méthodes permettant de mieux connaître, contrôler et suivre l’état fonctionnel du patrimoine, et enfin d’établir le bon état cible de ce patrimoine en vue de la préparation de la fin de contrat.
Comme je l’évoquais précédemment, cet inventaire a été réalisé pour les ponts de Tancarville et de Normandie qui arriveront à échéance en 2027 et pour lesquels les échanges et les expertises techniques entre concédant et concessionnaire se sont déroulés sur près de deux ans entre la fin de 2018 et la mi-2020. La discussion n’a pas encore été engagée sur les contrats historiques puisque la clause des sept ans s’appliquera, par définition, sept ans avant les échéances de 2031 à 2036.
Je souhaite que mon ministère, qui dispose de compétences et de moyens propres, continue d’assurer ces missions, en s’appuyant le cas échéant sur les équipes techniques du Centre d’études des tunnels (CETU) et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Je suis comme vous particulièrement attaché à ce sujet important.

Monsieur le ministre, je ne pense pas avoir entendu de réponse précise concernant le défaut de transmission du rapport annuel par les concessionnaires à l’autorité concédante, donc à l’État. En fait, tout dans ce dossier est ubuesque, de la conclusion des contrats aux sous-délégations qui favorisent les ententes en passant par la définition du niveau des péages.
Dans une étude de 2020, deux universitaires français rappellent l’illégalité des surcompensations ainsi que celle du décret de 1995 indexant les péages sur l’inflation. Ces dispositifs pourraient être considérés soit comme des aides d’État au sens du droit européen, soit comme contraires aux règles définies par le code monétaire et financier, ce qui pourrait justifier une rupture anticipée. Pour cela, il faudrait une vraie volonté politique, dont je constate qu’elle est malheureusement absente.

Les conclusions de la commission d’enquête doivent permettre de préparer l’avenir, et c’est sur ce point que je souhaite vous interroger, monsieur le ministre.
À l’heure de la transition écologique, on peut regretter que notre pays soit en retard sur le passage au péage sans barrière, qu’il est coutume d’appeler « flux libre ». En effet, l’intérêt d’un tel modèle est d’abord écologique : un poids lourd consomme deux litres de carburant supplémentaires en s’arrêtant et en redémarrant aux barrières de péage. Et ce sont de surcroît autant de surfaces imperméabilisées qui pourront être rendues à la nature.
Monsieur le ministre, quels objectifs relatifs à ce modèle de péage du futur ont été fixés aux concessions autoroutières ?
Dans un second temps, comme vous le savez, de nombreux poids lourds en transit évitent les autoroutes et empruntent des itinéraires parallèles via les routes nationales ou départementales en raison de leur gratuité.
Or la surfréquentation induite par une telle pratique pose des problèmes de sécurité parfois dramatiques, de dégradation évidente des infrastructures ou encore de nuisances sonores, sans parler d’une pollution de l’air accrue, quand les autoroutes sont mieux adaptées pour accueillir ces poids lourds.
Alors qu’une mission d’information créée sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable doit prochainement rendre ses conclusions sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, quelles sont vos propositions pour éviter ce report de trafic sur le réseau secondaire ? Pourquoi ne pas imaginer un dispositif sur le modèle des zones à faibles émissions pour les poids lourds ? Pensez-vous qu’il faille renforcer davantage les dispositifs réglementaires en confortant les arrêtés préfectoraux ou bien recourir à une écocontribution régionale, telle qu’elle est prévue dans le projet de loi Climat et résilience prochainement examiné par notre assemblée ?
Monsieur le sénateur Longeot, je répondrai à vos deux questions.
Sur les flux libres d’abord, nous ne sommes pas en retard. Vous connaissez bien les expérimentations menées sur trois diffuseurs – l’A4, l’A837 et l’A10 : elles montrent, je le crois, la pertinence d’un tel dispositif. Le flux libre, pour les raisons écologiques que vous avez parfaitement citées, sera déployé à grande échelle, vous le savez, en 2022 à l’occasion de la mise en service de l’A79 et, plus tard, dans le cadre des nouvelles concessions et de la conversion de sections du réseau actuellement concédées. Ces expérimentations qui portent leurs fruits nous ont permis d’atteindre un bon niveau.
Sur le deuxième sujet, très large, que vous avez abordé, celui du report modal notamment des poids lourds, je citerai nos actions en faveur du report vers des modes par nature plus vertueux : je pense notamment au fret ferroviaire, sur lequel je ne reviendrai pas. Des zones à faibles émissions (ZFE) sont mises en place pour les véhicules légers, et un grand nombre de territoires seront bientôt couverts.
L’article 32 du projet de loi Climat et résilience permet de donner la possibilité aux régions d’instituer une contribution sur le transport routier de marchandises. C’est une demande des régions, notamment du Grand Est et de l’Île-de-France, à laquelle nous avons répondu. Les départements pourront également demander à l’appliquer sur certaines routes départementales pour éviter les reports de trafic. Les équipes de mon ministère travaillent actuellement à l’inventaire de ces routes au vu des demandes actuelles des élus.

J’ai deux questions sur ce sujet passionnant. Je salue la qualité des travaux de notre commission d’enquête, qui a bien mis en évidence un certain nombre de déséquilibres existant entre concédant et concessionnaires.
Ma première question est courte : le décret de 1995 relatif à la fixation annuelle du prix des péages est-il bien légal ? Dans l’hypothèse d’une abrogation, les conséquences seront importantes. Notre collègue députée Christine Pires Beaune attend toujours votre réponse à ses questions écrites : je ne doute pas que je vais l’obtenir.
Ma deuxième question vient d’être posée par mon collègue Éric Bocquet. Elle est relative à l’article L. 3131-5 du code de la commande publique aux termes duquel le concédant doit publier chaque année un rapport contenant un inventaire précis et actualisé des biens concédés. Or cette obligation n’est pas respectée. Pis, monsieur le ministre, dans votre courrier du 5 avril adressé au rapporteur, vous écrivez que « l’enjeu pour le concédant n’est pas de disposer au cours de la concession d’un inventaire précis à un instant donné ». Cette phrase est totalement contraire à la doctrine législative et réglementaire.
Vous n’avez pas répondu à mon collègue et ami Éric Bocquet, mais je ne doute pas que j’obtiendrai une réponse. Vous avez commencé votre propos introductif en déclarant que vous vouliez un meilleur encadrement des contrats. Pourtant, sur cette question qui n’est pas que technique, on donne les clés au concessionnaire et on ne le contrôle pas. Je ne veux pas d’un modèle concessif non contrôlé. Je vous remercie d’apporter des réponses à mes deux questions précises.
M. Jacques Fernique applaudit.
Je vois cela, madame la présidente ! Je vais donc essayer d’être précis, monsieur le sénateur, car je vous sais expert sur ces sujets.
Sur l’abrogation du décret de 1995 d’abord, vous savez qu’il est prévu, par dérogation aux dispositions du droit commun, que les rémunérations des cocontractants de l’État au titre des contrats de concession puissent être indexées sur le niveau général des prix. Les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de ces dispositifs établissent clairement qu’il s’agissait surtout de conforter juridiquement la pratique contractuelle de l’État et des sociétés concessionnaires de recours à un indice d’évolution plutôt favorable soit à l’État, soit aux usagers.
En outre, cette modification du code monétaire et financier avait le mérite de donner une accroche législative au décret de 1995 sur les péages autoroutiers. Cette dérogation ne nécessite pas forcément de décret d’application pour ces contrats administratifs. Il n’existe donc aujourd’hui plus de motif pertinent qui justifierait de remettre en cause le décret de 1995.
Sur le sujet du bon état des infrastructures en fin de concession, j’ai répondu à M. Bocquet que la stratégie de l’État en la matière était de structurer et de renforcer son intervention. Il s’agit de définir les bons outils et les bonnes méthodes qui permettent d’abord de connaître, puis de contrôler et de suivre, l’état fonctionnel du patrimoine afin d’établir le bon état cible en fin de concession. Je n’entre pas dans le détail, mais une grille des critères a été établie sur le sujet. Je le disais, nous avons déjà fait l’exercice pour les ponts de Tancarville et de Normandie, dont les concessions arrivent à échéance en 2027. J’ai évoqué la butée calendaire qui nous permet de préparer la fin de contrat sept ans avant.
De manière générale, la philosophie du ministère, monsieur le sénateur, est de connaître en tout temps l’état de santé des ouvrages. Je l’ai évoqué, nous avons lancé le plan « Ponts connectés », qui concerne les ponts du réseau concédé ou non concédé : il consiste à instrumenter les ponts, à connaître leur état de santé à l’instant t et à prévoir les travaux de façon beaucoup plus prédictive, en fonction de l’état des ponts et des sollicitations qu’ils subissent.

Je vous remercie, monsieur le ministre, mais c’est un demi-remerciement. Je prends acte de la réponse à la première question relative à la légalité du décret de 1995, mais je n’ai pas eu plus de succès qu’Éric Bocquet sur le bon état des infrastructures, puisque vous avez répondu à côté.
Je vous ai affirmé que, dans le code de la commande publique auquel nous sommes soumis, un rapport doit être remis chaque année. Nous n’avons pas ce rapport : comment contrôler alors le concédant et le bien public ? Vous ne m’avez pas contredit sur ce point. Vous avez parlé des ponts et d’autres sujets, mais, j’y insiste, vous ne disposez pas de ce rapport annuel. Comment voulez-vous améliorer la relation avec les concessionnaires ?
MM. Jacques Fernique et Éric Bocquet applaudissent.

Plus que le modèle concessif, son économie générale et son analyse, que mes collègues ont largement évoqués, je m’attarderai, pour ma part, plus particulièrement sur des considérations environnementales en écho à l’urgence dans laquelle nous nous trouvons actuellement et qui in fine s’insère dans l’axe 3 développé dans le rapport de la commission d’enquête, à savoir négocier une amélioration du service rendu aux usagers compte tenu de la rentabilité indiquée dans le rapport.
En 1970, la France était confrontée à un défi de développement économique des territoires : il s’agissait alors de « rattraper notre retard en matière de desserte des territoires par le réseau autoroutier », et le gouvernement d’alors avait fait appel au secteur privé. Dans la Sarthe, ce fut un succès, et nous l’avons constaté depuis les années 1970 avec l’A11 et depuis une vingtaine d’années avec l’A28. Cinq branches d’autoroute irriguent notre département et ont largement contribué à sa – modeste ! – prospérité économique.
Aujourd’hui, nous sommes confrontés à l’urgence climatique et à l’impérieuse nécessité de décarboner le secteur des transports, mais il faut rappeler que la route assure en France 87 % des déplacements de personnes et 86 % du transport de marchandises.
Par conséquent, décarboner le secteur des transports signifie tout simplement qu’il faut décarboner la route : c’est urgent et nous ne pouvons pas attendre encore dix ans pour agir.
Il me semble que nous sommes confrontés là aux exigences de nécessité et d’utilité prévues par l’article L. 122-4 du code de la voirie routière et la jurisprudence y afférente.
Ma question est donc la suivante : pensez-vous que les contrats de ces sociétés autoroutières qui avaient été au départ pensés dans un objectif de développement économique pourraient être rapidement réorientés vers cet objectif stratégique de décarbonation ? Et si oui, comment ?
Monsieur le sénateur, vous avez raison de dire que les contrats historiques correspondaient à des enjeux quelque peu différents. L’objectif, dans les années 1970, était de désenclaver les territoires avec des réseaux qui étaient peu construits et d’offrir des infrastructures adaptées pour un transport rapide et sûr. Je crois que, de ce point de vue, le bilan est objectivement bon cinquante ans plus tard.
Les enjeux d’aujourd’hui sont donc différents : préserver la cohésion de nos territoires, procéder à des investissements utiles pour les usagers, mais aussi décarboner nos routes, qui engendrent, vous l’avez dit, tant pour les passagers que pour les marchandises, l’essentiel des émissions de gaz à effet de serre.
Je les ai cités précédemment, les véhicules électriques sont un bon sujet non seulement d’étude, mais de déploiement d’une action de décarbonation. D’abord, parce que les véhicules concentrent la plus grande partie des émissions. Ensuite, parce que l’État doit définir les niveaux d’aide pour accompagner le secteur de la construction automobile. Je le redis ici, 16 % des véhicules vendus cette année sont électriques ou hybrides rechargeables : ce pourcentage montre la forte dynamique de ce secteur. Vous le savez, les États ont pris des engagements extraordinairement forts, et on estime que 50 % des véhicules vendus seront électriques en 2030.
Pour ce faire, il faut déployer des infrastructures, notamment des bornes de recharge rapide. C’est l’enjeu des 100 millions d’euros consentis ou investis par l’État dans ces infrastructures, qui seront complétés par les 500 millions d’euros des sociétés concessionnaires. Cela montre l’ambition conjointe de l’État et des sociétés concessionnaires en la matière.
Évidemment, le sujet est plus large. Le report modal du transport des marchandises, c’est aussi le report vers les modes les plus vertueux sur le plan environnemental. Je pense au fret ferroviaire ; je n’irai pas plus loin, mais comprenez que notre action est large et totalement engagée sur le sujet.

Monsieur le ministre, j’attire votre attention sur la question des péages périurbains et de l’injustice que leur existence induit.
Je pense en particulier à certains péages de la région Île-de-France, comme celui de Saint-Arnoult qui fut l’un des symboles de la crise des « gilets jaunes », ou encore celui de Dourdan que je connais bien.
Notre réseau autoroutier a été construit à une époque où le développement périurbain n’avait pas encore atteint son niveau actuel, et où le recours à l’autoroute pour les trajets quotidiens entre le domicile et le travail était rare.
Depuis, l’économie de services, c’est-à-dire des emplois urbains, s’est considérablement développée. Paris comme sa petite couronne ont attiré de plus en plus de travailleurs, de plus en plus éloignés, en raison notamment de l’explosion des prix de l’immobilier.
Résultat, ce qui était hier l’exception est devenu la norme. Des dizaines de milliers de Franciliens prennent quotidiennement l’autoroute pour aller travailler. Un grand nombre d’entre eux sont contraints de payer les péages périurbains à chaque trajet. Cette obligation de payer pour aller travailler ne touche pas nécessairement les plus aisés.
Devant la commission d’enquête, Jean-Claude Lagron, président de l’association « A10 gratuite » dont je salue l’engagement, indiquait qu’un travailleur régulier déboursait 1 300 euros par an.
Lorsqu’ils ne veulent, ou ne peuvent, pas supporter ce coût, les travailleurs pendulaires se reportent sur le réseau routier secondaire, ce qui n’est pas sans conséquence en matière d’accidentalité et de congestion.
Votre prédécesseur, Mme Borne, avait certes obtenu un geste des sociétés d’autoroutes : une réduction de 30 % pour plus de dix allers-retours par mois sur le même tronçon.
Si l’intention était bonne, l’opération a été un échec. Sur un million d’automobilistes prévus, à peine 100 000 ont finalement souscrit l’abonnement. Les concessionnaires ont peu communiqué sur cette offre et le geste n’était pas suffisant.
Monsieur le ministre, la réponse doit être plus ambitieuse. La suppression de certains péages urbains, en particulier celui de Dourdan, serait une réponse appropriée. Comme le soulignait la commission d’enquête, cela n’aboutirait d’ailleurs pas à remettre en cause l’équilibre économique et financier de la concession Cofiroute.
Négocier cette gratuité sans contrepartie tarifaire répondrait à une demande légitime d’équité.
Madame la sénatrice, vous évoquiez au fond le sujet bien connu des péages périurbains, fruit de la densification des aires urbaines et de leur impact sur le quotidien de leurs usagers.
Je vous ferai deux réponses.
Sur le pouvoir d’achat, vous avez très justement rappelé le dispositif demandé par l’État aux sociétés concessionnaires qui a permis de baisser de 30 % les tarifs des usagers effectuant plus de dix allers-retours par mois. Ce dispositif a connu un début de succès : 130 000 abonnements ont été répertoriés, avec une hausse significative de 60 % entre septembre 2019 et septembre 2020. Mais il est vrai que le confinement, qui a été propice au télétravail, ne lui a pas permis de prendre pleinement son envol.
J’ai donc demandé aux sociétés concessionnaires de relancer une opération de communication sur ce dispositif, afin de soutenir le pouvoir d’achat des usagers de la route.
Pour ce qui concerne, plus précisément, le péage de Dourdan, je rappelle ce que j’ai déjà indiqué : le tarif de 1, 70 euro TTC, est stable et relativement faible par rapport à d’autres axes routiers. En outre, des formules d’abonnement préférentiel sont proposées ; enfin, des aménagements, notamment en places de parking destinées à améliorer l’offre de transport collectif sur l’A10, ont été mis en place.
La suppression, ou le rachat, de ces péages ne peut être envisagée, car cela fragiliserait le modèle concessif. Par ailleurs, la section de l’A10 considérée, située entre Dourdan et La Folie Bessin, est empruntée par d’autres usagers effectuant des trajets en transit, en provenance ou à destination de l’A11. Ce scénario ne paraît donc pas aujourd’hui envisageable, d’autant qu’il risquerait d’entraîner le report d’une partie de la circulation sur la voirie locale, ce qui engendrerait d’importantes nuisances et, éventuellement, de l’insécurité.
Applaudissements sur des travées du groupe SER.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens d’abord à remercier le président de la commission d’enquête, Éric Jeansannetas, et son rapporteur, Vincent Delahaye, pour la qualité du travail accompli. Nous ne pouvons que nous féliciter de la production de ce rapport, qui a permis de mettre en évidence un assez grand nombre de points qui attestent des conditions, pénalisantes pour l’État, de la rédaction des conventions de concession.
Le rapport met en effet en évidence bien des insuffisances, observables au moment de la cession des sociétés concessionnaires d’autoroutes. Il semble notamment que celle-ci n’ait été précédée ni d’une révision des contrats dits « historiques » ni d’une définition de l’équilibre économique et financier des concessions. Ce rapport permet également de noter que les relations entre les concessionnaires et l’État concédant n’ont pas fait l’objet d’une révision.
Au-delà de la perte des recettes résultant, pour l’État, de la privatisation et du déséquilibre financier de la gestion de ces concessions autoroutières au profit des entreprises attributaires, le rapport souligne aussi la permanence des disparités dans les relations entre les sociétés concessionnaires du réseau autoroutier et la puissance publique, au détriment de cette dernière.
Cela étant dit, ces concessions ont été validées ; dont acte. En outre, la réaction et les mesures qui en ont découlé attestent que, d’un point de vue juridique, il serait hasardeux d’y mettre un terme de façon anticipée.
Pour autant, il faut nous donner l’assurance que vous serez en mesure, au terme de ces concessions, de mener l’analyse juridique, technique et financière permettant d’éclairer les choix qui seront à faire. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner la garantie que vous disposerez des moyens nécessaires pour ce faire, au sein des organismes d’ingénierie de l’État, notamment au Cerema ?
Je répondrai en deux points succincts, monsieur le sénateur, pour essayer de clarifier ce débat.
D’abord, l’État connaît l’état de son patrimoine, …
… de ses routes, de ses ponts. Nous avons eu, ici, des débats sur certains ouvrages ou éléments moins connus du patrimoine ; c’est pour cette raison que j’évoquais les ponts, puisque nous faisons un effort sur le patrimoine des collectivités territoriales, afin de procéder à son inventaire et d’en assurer un meilleur entretien. L’État connaît donc son patrimoine, dont l’inventaire est disponible.
Par ailleurs, l’État connaît, au travers des concessions, l’état du patrimoine routier concédé. À cet égard, l’enjeu était, à l’approche de la fin des concessions – d’où la clause des sept ans –, de bien connaître les ouvrages et le patrimoine concédés et d’exercer un contrôle renforcé. En gros, le but est – je le dis très directement – de ne pas avoir, pendant les sept dernières années de la concession, un sous-investissement qui ferait supporter par les finances de l’État d’éventuels travaux de régénération.
Je prenais ainsi l’exemple des ponts de Tancarville et de Normandie puisque, ces concessions arrivant à échéance en 2027, les travaux visant à bien appréhender l’état de ce patrimoine ont été conduits sept ans avant, entre 2018 et 2020.
Pour finir, monsieur le sénateur, je vous confirme que l’État – les services de mon ministère, appuyés par d’autres organismes disposant de compétences d’ingénierie technique et financière de très haut niveau, comme le Cerema – a les moyens de mener à bien les travaux destinés à établir l’état cible du patrimoine en fin de concession.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat autour des concessions autoroutières ne cesse de nous mobiliser.
Quinze ans après la privatisation des sociétés autoroutières, notre collègue Vincent Delahaye l’a rappelé, les résultats de ces entreprises atteignent un niveau élevé. Cela est lié à leur professionnalisme, à la qualité des services proposés, notamment en matière de sécurité, et à leurs capacités reconnues de gestion, mais cela est sans doute également dû aux conditions de la privatisation et aux négociations, qui apparaissent aujourd’hui assez avantageuses pour elles.
Si le rapport de la commission d’enquête rappelle que les clauses introduites en 2015 ont pu rééquilibrer les rapports entre l’État et les nouvelles SCA, il souligne néanmoins que ces clauses restent pour le moins inopérantes pour les SCA historiques.
Cette situation de défiance menace directement les projets d’investissement de ces sociétés et les éventuels partenariats avec l’État ; ce sont nos territoires et les usagers qui pâtissent le plus de cette situation. Six ans après ces négociations, vu le contenu du rapport de la commission d’enquête, il devient urgent de réunir tous les acteurs et de négocier des clauses solides et durables, en toute transparence.
Nous examinerons prochainement le projet de loi Climat et résilience ; à ce titre, il paraît indispensable – un certain nombre de collègues l’ont souligné – d’exiger davantage d’implication des SCA dans le développement durable, comme une contrepartie essentielle des contrats de concession : bornes de recharge des voitures électriques – vous venez de rappeler les engagements pris –, voies réservées, offres de covoiturage, plateformes multimodales.
Monsieur le ministre, de nouvelles négociations sont-elles envisagées pour instaurer des clauses portant tant sur la question financière que sur les exigences environnementales ?
Monsieur le sénateur Mandelli, votre question porte sur plusieurs points distincts.
D’abord, vous avez rappelé avec objectivité le bilan, notamment en matière de sécurité, de confort et d’aménagement du territoire, de ces sociétés concessionnaires d’autoroutes. Vous avez également souligné leur meilleur encadrement depuis 2015, avec notamment la création de l’ART, qui permet d’exercer un contrôle très précis sur l’équilibre économique des contrats. Je n’y reviens pas.
Ensuite, en ce qui concerne les partenariats entre l’État, les sociétés et les collectivités, je répondrai en deux points. Vous avez cité le sujet des bornes électriques, qui montre bien, me semble-t-il, que l’on sait mettre en œuvre des actions concrètes avec des volumes financiers importants : je le rappelais, en cumulé, 600 millions d’euros sont investis sur trois ans, partout sur le territoire, avec l’objectif de ne pas recréer les zones grises de la mobilité que nous avons pu connaître par ailleurs.
En outre, quand les collectivités se sont montrées motrices en la matière, nous avons pu signer des pactes localisés de relance autoroutière ; je pense notamment au pacte signé avec Renaud Muselier, il y a maintenant quelques mois, en plus du pacte portant sur les petites lignes ferroviaires.
Pour ce qui concerne l’avenir à moyen et à long terme, j’ai dit que nous étions disposés à organiser un sommet des autoroutes, qui permettra d’aborder justement les grands sujets structurants, les modalités de gestion – pilotage public ou délégation au privé – et de voir comment nous pouvons nous attaquer très concrètement aux grands enjeux écologiques et sociaux que vous venez de souligner.
Le Gouvernement est bien évidemment à la disposition du Parlement pour continuer d’avancer sur ce sujet important.

Évidemment, monsieur le ministre, nous sommes très intéressés par l’organisation d’un tel sommet des autoroutes. Je souhaiterais que vous y intégriez la représentation nationale, indirectement, au travers du Conseil d’orientation des infrastructures et de l’Afitf, mais également directement, afin que les parlementaires puissent participer à ces travaux en toute transparence.
Cela me paraît indispensable pour restaurer la confiance entre l’État et ses partenaires, mais aussi celle des usagers et de tous ceux qui sont intéressés par l’aménagement du territoire. Ces infrastructures sont essentielles pour l’ensemble du territoire national et il me paraît important que nous soyons associés de très près à cette réflexion.

Mon interrogation est double et porte sur les sous-concessionnaires, c’est-à-dire sur les aires de services.
En premier lieu, si les recommandations de l’ART ont permis, au cours des dernières années, d’éclaircir quelque peu les conditions d’attribution des sous-concessions par les SCA, quelques zones d’ombre subsistent. Des progrès ont été réalisés pour renforcer l’effectivité de la modération tarifaire sur le prix des carburants, mais la commission d’enquête préconise un renfort des contrôles des sous-concessions.
Deux mesures nous semblent souhaitables.
La première serait de prévoir explicitement que l’ART puisse collecter directement auprès des sous-concessionnaires toute information utile pour contrôler le respect des engagements des titulaires concernant la fixation des prix ou la durée des sous-concessions.
La seconde serait d’étendre l’obligation de modération tarifaire aux carburants alternatifs et de prévoir un suivi régulier, par les SCA, des prix réels du carburant. Un contrôle de second niveau, assorti d’un pouvoir de sanction, serait réalisé par l’ART. Cela permettrait à la fois de favoriser le recours aux carburants alternatifs et de contrôler le niveau des prix.
Ma première question, monsieur le ministre, est donc simple : comptez-vous appliquer ces deux recommandations ?
En second lieu, la crise sanitaire a mis en lumière le rôle des aires de services au sein du réseau autoroutier. Ce sont les sous-concessionnaires qui, par exemple, ont accueilli les routiers, les commerciaux et les autres usagers pour que ces derniers puissent se restaurer, se reposer et bénéficier de structures de confort, notamment en ce qui concerne l’hygiène.
La crise a toutefois causé des pertes importantes pour les magasins, la distribution de boissons chaudes et la restauration.
J’ai ainsi été alerté – vous aussi, monsieur le ministre – par une société creusoise, donc limousine – Picoty Autoroutes –, qui compte vingt-cinq sous-concessions. Cette entreprise a perdu 1, 2 million d’euros sur l’année 2020. Dans le même temps, les principaux concessionnaires ont enregistré 2 milliards d’euros de résultat net et de dividendes. Pourtant, ces derniers refusent de compenser le manque à gagner des sous-concessionnaires par des mesures économiques significatives.
Voici donc ma seconde question : est-il envisageable d’instaurer un mécanisme de solidarité exceptionnel entre concessionnaires et sous-concessionnaires, dans le contexte de la crise sanitaire ?
Monsieur le sénateur, allons droit au but : ma réponse aux deux volets de votre première question est « oui », puisque nous avons bien noté la recommandation, figurant dans le rapport, consistant à renforcer le rôle de l’ART dans le contrôle des sous-concessions. Je vous confirme donc que, à propos des deux sujets que vous avez évoqués, des discussions sont en cours avec l’Autorité, qui donneront lieu, le cas échéant, à des décrets destinés à organiser tout cela. La réponse est donc « oui ».
En ce qui concerne votre deuxième question, vous avez raison de dire que les sous-concessions ont joué un rôle clé au moment le plus aigu de la crise, puisque les transporteurs routiers ont fait face, lors des premiers jours, à des pénuries de services essentiels – je pense notamment aux douches, aux toilettes, aux services de restauration – et, tous ensemble, nous nous sommes mobilisés pour les rouvrir le plus rapidement possible. Cela avait permis la réouverture, au cours des jours suivants, de quelque 400 services de restauration un peu partout sur le territoire.
Par ailleurs, nous avons bien conscience des difficultés financières de ces sociétés. J’ai demandé à mes services, notamment à Marc Papinutti, qui œuvre sur tous ces sujets, d’organiser plusieurs réunions de concertation entre l’Association des sociétés françaises d’autoroutes et d’ouvrages à péages (ASFA) et l’Association des sous-concessionnaires d’autoroutes (ASCA), dont Picoty Autoroutes est membre, et ces réunions ont permis de définir les demandes et les contraintes de chaque secteur. Elles doivent maintenant permettre de faciliter les négociations contractuelles entre concessionnaires et sous-concessionnaires. J’ai bon espoir que cette situation s’assainira dans les semaines ou mois qui viennent.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de contournement ouest de Montpellier, c’est-à-dire le chaînon de six kilomètres manquant entre les autoroutes A750 et A709, présente un caractère hautement prioritaire.
L’enquête publique s’est déroulée en 2020 ; le commissaire enquêteur a rendu, le 22 décembre dernier, un avis favorable à la déclaration d’utilité publique de ce projet, sous réserve du financement de ce dernier, qui reste à finaliser.
Vous m’avez entendu défendre plusieurs fois, ici même, le principe du financement de ce projet par un adossement à la concession des Autoroutes du Sud de la France (ASF). Ce mode de financement présente un triple avantage : il ne coûte rien à l’État, rien aux collectivités locales, qui n’auraient de toute façon pas les moyens de le financer, et rien à l’usager, puisque le tronçon sera gratuit.
Dans ce dossier, mon interrogation est grande sur notre capacité et notre volonté à dépasser les polémiques infondées et les dogmatismes archaïques, afin de regarder la vérité en face et de prendre les bonnes décisions. L’importance économique de la mise en œuvre de ce projet de plus de 300 millions d’euros me semble s’intégrer parfaitement dans le plan de relance et l’aménagement de notre territoire.
Nous pourrions partager la conviction que, pour sortir de la crise actuelle, aux conséquences terrifiantes pour les finances publiques, notre pays aura besoin de recourir à l’investissement privé, afin de faire aboutir des projets d’infrastructures, en particulier routières. La concession est un cadre qui a largement démontré ses avantages.
La déclaration d’utilité publique du contournement ouest de Montpellier doit être signée au début du mois de septembre 2021. D’ici là, monsieur le ministre, aurez-vous acté son adossement à la concession d’ASF, seule et unique solution pour son financement et donc sa réalisation ?
Monsieur le sénateur Grand, vous avez rappelé les principaux éléments du projet du contournement ouest de Montpellier. Le coût total du projet est estimé, à ce stade, à 280 millions d’euros et des crédits ont été engagés à hauteur de 25 millions d’euros dans le contrat de plan État-région 2015-2020.
Ce projet est connu ; il a fait l’objet de nombreux échanges depuis de nombreuses années, mais la métropole de Montpellier a décidé de se désengager de son financement, demandant un adossement total à la concession autoroutière existante. Par conséquent, nous avons lancé, à la demande du Premier ministre, une étude fine des conditions de l’adossement du contournement ouest, qui pose de véritables questions de droit et qui rendra vraisemblablement nécessaire une saisine du Conseil d’État pour résoudre celles-ci.
Je connais bien votre position ; j’ai bien pris connaissance des éléments que vous nous avez transmis, ce dont je vous remercie. De notre côté, les travaux se poursuivent assidûment et l’ensemble des acteurs locaux seront informés, au cours des semaines qui viennent, afin de tenir compte de l’échéance que vous avez rappelée, se situant au mois de septembre, pour la déclaration d’utilité publique.
Soyez donc assuré, monsieur le sénateur, de notre plein investissement sur ce sujet.

Ce dossier ne me paraît pas devoir poser de problème.
Six kilomètres, cela ne bouleversera pas l’équilibre de la concession de l’autoroute A9, qui se termine en 2031. Il n’y a pas d’autre solution pour le Gouvernement que de signer la déclaration d’utilité publique avant le début du mois de septembre.
Je vous remercie, monsieur le ministre ; je suppose que le Conseil d’État manifestera toute la sagesse que nous lui connaissons pour aller dans le sens de l’intérêt général.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, les concessions autoroutières ont fait l’objet d’une contractualisation entre l’État et des sociétés privées, en prenant en compte des prévisions de dépenses et de recettes sur la durée du contrat ; c’est d’ailleurs la règle de base de tout contrat concessif. La règle est également de faire en sorte que le risque soit assumé par l’entreprise privée.
Néanmoins, nous avons pu regretter la pratique de l’adossement, qui a consisté à ajouter des investissements non prévus initialement au contrat, en les compensant par un allongement de la durée de la concession initiale. Ce principe a pour inconvénient majeur de transformer le contrat, pourtant très précis ab initio, en un sentiment de concession perpétuelle, difficilement explicable à nos concitoyens et de moins en moins acceptable par eux.
Si les extensions de réseau peuvent être mieux maîtrisées et faire l’objet de procédures spécifiques, certains autres investissements nécessaires ne peuvent pas être dissociés du contrat. Je pense notamment à l’intégration des évolutions technologiques, telles que le développement des véhicules électriques et l’impérieuse nécessité de disposer, sur le réseau autoroutier, de bornes de recharge rapide. Plus encore, comment pourra-t-on intégrer les investissements nécessaires au déploiement des véhicules connectés ? Outre le besoin de choix technologiques partagés entre tous les acteurs, le montant des investissements nécessaires est loin d’être négligeable.
L’urgence est pourtant là ; il serait irresponsable de repousser au terme des contrats les décisions d’investissement correspondantes. Aussi, je souhaiterais que vous puissiez m’éclairer sur ces points, monsieur le ministre.
Monsieur le sénateur Chaize, je vous remercie de cette question.
Je ne reviendrai pas sur la première partie de celle-ci ; je crois que nous avons déjà très largement débattu du modèle de la concession et de son équilibre économique. Nous sommes maintenant en mesure de nous projeter sur l’avenir des concessions.
Revenons toutefois sur un sujet important. Tout d’abord, j’ai précédemment dit un mot sur les bornes électriques. Je crois pouvoir dire que nous sommes au bon niveau de financement et d’avancement, ce qui est important pour accompagner le secteur automobile français et européen.
Pour ce qui concerne l’intelligence et la possibilité de faire advenir le véhicule connecté, en nous dotant des infrastructures de connectivité le long de nos routes, nous ne sommes pas en retard ; depuis 2014, plusieurs projets pilotes ont été lancés. Le ministère des transports a ainsi investi 14 millions d’euros dans différents projets qu’il coordonne et, au total, pour la France, 44 millions d’euros ont été investis en sept ans. Cela nous permet d’avoir, actuellement, 3 000 kilomètres de réseau routier équipé d’unités de bord de route pour échanger des données. L’idée est d’avoir, à l’horizon de 2024, environ 5 000 kilomètres de routes équipées.
Par ailleurs – c’est important –, la France préside la plateforme C-Roads Europe, qui pilote le groupe technique visant à définir les principales spécifications techniques. Jusqu’à présent, 95 % des spécifications françaises sont reprises à l’échelon européen, ce qui est une satisfaction ; nous sommes face à une « terre d’opportunités ». Ces projets sont mis en place dans le cadre des concessions actuelles, sans prolongation. À la fin des concessions, nos autoroutes continueront d’être à la pointe de l’innovation.
Nous pouvons donc nous retrouver, je crois, autour de cette ambition conjointe, monsieur le sénateur.

Je vous remercie, monsieur le ministre, de ces informations importantes.
Vous l’aurez compris, je suis très sensible à cette évolution technologique qui aura des conséquences du point de vue environnemental, mais encore faut-il que l’on puisse disposer d’informations permettant que, en fin de contrat, les choses soient transparentes. Il s’agit d’une demande unanime que vous avez pu entendre lors de ce débat. La transparence est la règle de base et le gage même de la confiance.

Monsieur le ministre, je suis, comme ma collègue Jocelyne Guidez, qui s’est exprimée précédemment, et le rapporteur de notre commission d’enquête, Vincent Delahaye, sénateur du département de l’Essonne, et notre présence commune dans l’hémicycle ne doit certainement rien au hasard.
En effet, depuis de nombreuses années, nous militons pour la gratuité des tronçons franciliens des autoroutes A10 et A11. Le périmètre de notre action est certes limité, mais parfaitement caractéristique et solidaire d’une problématique de dimension nationale.
Depuis près de vingt ans, de multiples études ont dressé un constat, souvent accablant, des rapports entre l’État et les sociétés concessionnaires d’autoroutes. Pourtant, rien n’a bougé, ou presque.
Heureusement, le rapport de cette commission d’enquête sénatoriale confirme avec pertinence une situation de plus en plus inacceptable et esquisse de potentielles réponses, car ce débat doit déboucher enfin sur des mesures significatives !
En quarante ans, dans les territoires périphériques franciliens, l’étalement urbain a provoqué un triplement de la population. Durant la même période, les investissements en transports collectifs ont été quasi exclusivement concentrés dans le cœur de l’agglomération. Or l’offre de transports collectifs s’est dégradée inexorablement dans la deuxième couronne francilienne, dans laquelle la funeste loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, veut continuer d’entasser, de façon aveugle et kafkaïenne, toujours plus de logements…
De ce fait, les autoroutes périurbaines ont dorénavant un rôle structurant pour les déplacements du quotidien, notamment les trajets domicile-travail. Pourquoi, alors, ne pas supprimer les péages sur les tronçons concédés des autoroutes périurbaines, à commencer par les plus iniques d’entre eux, sur l’A10 et l’A11, en Île-de-France ?
Deux propositions pour financer cette disposition, monsieur le ministre : l’application de la clause de plafonnement de la rentabilité des concessions, issue du protocole de 2015, mais jamais mise en œuvre, et l’instauration d’une taxe sur les copieux dividendes versés par les sociétés concessionnaires. Que pensez-vous de ces deux propositions ?
Nous connaissons bien ce sujet, que nous avons eu l’occasion d’évoquer à de nombreuses reprises. Je ne répéterai pas dans le détail ce que j’ai répondu à votre collègue précédemment. Simplement, nous avions évoqué les problèmes – la fragilisation du modèle concessif – qu’entraînerait l’emprunt, par d’autres usagers que ceux qui habitent ou qui travaillent à proximité du péage de Dourdan, de cette autoroute et nous étions également convenus du risque de report sur la voirie locale d’un trafic de contournement qu’engendrerait cette suppression.
Peut-être pouvons-nous tout de même nous projeter dans l’avenir. Des pistes d’amélioration sont évidemment à étudier ; je ne suis pas en mesure de répondre à votre question aujourd’hui, mais nous continuerons ces débats. Ainsi, des améliorations doivent être envisagées quant au trafic des poids lourds, qui pourrait se reporter sur la voirie locale. Je l’ai également évoqué, la contribution poids lourd régionale, que nous proposons dans le cadre de l’article 32 du projet de loi Climat et résilience, permettrait aux départements de se saisir de la possibilité d’étendre la contribution aux axes départementaux sujets au report de trafic. Je crois savoir que cette possibilité est étudiée en Île-de-France.
Par ailleurs, des aménagements sur les voiries départementales sont aussi envisageables pour améliorer la sécurité et la fluidité des circulations qui traversent les zones habitées.
Sur tous ces sujets, je reste évidemment à votre disposition, monsieur le sénateur, pour échanger et trouver les voies d’un avenir plus ensoleillé.

Monsieur le ministre, depuis vingt ans que je suis élu, vous êtes le neuvième à occuper ces fonctions.
Je vous remercie de votre disponibilité et de vos réponses ; je souhaite néanmoins donner quelques chiffres : le taux de profitabilité des sociétés concessionnaires s’établit à plus de 30 % et les dividendes versés à leurs actionnaires dépassent amplement leur résultat net. La crise sanitaire ne les affecte que marginalement, puisque, entre 2019 et 2020 la profitabilité de Cofiroute est passée de 31, 6 % à 35, 9 % ; le versement de dividendes a correspondu, pour cette société, à 115 % du résultat net.
Aussi, de grâce, monsieur le ministre, soyez celui qui fera bouger les choses ; nous vous en remercions par avance !

Pour conclure le débat, la parole est à M. le rapporteur de la commission d’enquête.

Monsieur le ministre, je vous remercie d’avoir consacré une heure et demie à notre rapport.
Je regrette quelque peu que le format du débat dans l’hémicycle ne permette pas d’aller au fond des choses ; on l’a constaté sur un certain nombre de questions. Pour ma part, j’avais demandé au président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, Jean-François Longeot, de vous solliciter pour organiser une audition en commission, afin que nous puissions échanger de façon un peu plus approfondie autour de ce rapport. Je reste demandeur de cette audition.
Au cours de ce débat, il y a des choses que l’on a entendues, des choses que l’on n’a pas entendues et des choses que l’on aurait aimé entendre.
J’ai entendu de votre part une forme de « ni-ni » : ni renationalisation ni prolongation, même si le « ni prolongation » était un peu plus timide que le « ni renationalisation ». J’ai également entendu parler de préparation du futur, d’un meilleur encadrement des contrats, d’une modernisation de ceux-ci, et c’est tant mieux !
En effet, il n’y a, ici, aucun concession bashing, en tout cas pas dans notre rapport. Je ne suis absolument pas opposé, comme la majorité de mes collègues, au principe de la concession de délégation de service public, qui a une efficacité. Nombre de sociétés, parmi les sociétés d’autoroutes, sont des sociétés françaises importantes, qui sont compétentes et qui font un travail de qualité. Par conséquent, il n’y a pas de raison de faire du concession bashing. Cela dit, quand on concède un service, il faut bien en suivre l’exécution, c’est très important.
Des progrès considérables ont été accomplis depuis 2015, mais beaucoup reste à faire. Nos collègues Éric Bocquet et Olivier Jacquin ont eu raison de poser la question des rapports d’inventaire. Ces rapports d’inventaire sont prévus dans les contrats, mais on ne les a pas – vous-même l’avez reconnu –, or ils doivent être mis à jour tous les cinq ans. Il n’est pas normal que l’on ne puisse pas avoir ces rapports d’inventaire, prévus dès le départ ! Donc, d’accord pour la concession, mais il faut la contrôler rigoureusement.
Ensuite, au-delà de la question de l’inventaire se pose un deuxième problème : les sous-concessions. Il y a une grande faiblesse du suivi en la matière. Notre commission d’enquête n’a pas eu le temps d’aller suffisamment loin dans ce domaine, mais il faudrait en approfondir l’analyse. Nous avons entendu des sociétés qui avaient du mal à obtenir l’attribution d’une ou l’autre de ces sous-concessions et nous nous demandons pourquoi. Il faudrait plus de transparence sur ce sujet.
En revanche, les études sur la rentabilité des concessions d’autoroute – celle de l’Autorité de la concurrence de 2013, celle de la Cour des comptes, celle du Sénat – font vraiment l’objet d’un dénigrement de la part des sociétés d’autoroutes. On se demande d’ailleurs si ces sociétés ont réellement lu notre rapport, parce que nous n’avons obtenu qu’une réponse, celle d’Eiffage ; les autres ne nous ont même pas répondu. Nous avons tenu compte des observations d’Eiffage et nous avons refait nos calculs sur ce fondement.
Notre méthode est fondée sur la rentabilité interne par rapport aux actionnaires, donc à l’investissement initial ; nous avons bien recouru à cette méthode, cher Pierre Médevielle. De son côté, l’ART étudie la rentabilité par projet, mais elle ne fournit pas d’éléments permettant de contrôler son travail. J’en suis désolé, j’aime beaucoup cette autorité, mais j’aimerais bien qu’elle soit plus transparente, que les valeurs d’actifs qu’elle évalue soient communiquées, car on ne les a pas. Nous avons donc des taux de rentabilité calculés sur une base que l’on ne connaît pas…
Pour ma part, j’apprécie la transparence et je pense que l’ART a un rôle à jouer dans le domaine des sociétés concessionnaires d’autoroutes, mais il faut travailler tous ensemble.
Ainsi, monsieur le ministre, si vous souhaitez – c’est ce que j’ai compris de vos propos – organiser un sommet des autoroutes, je voudrais que l’on aborde la question de la rentabilité des contrats, et non uniquement des futurs contrats. Il est important de travailler sur les futurs contrats, sur l’évolution et le verdissement des tarifs, mais la rentabilité est un sujet fondamental. Notre collègue Jean-Pierre Grand évoquait le contournement de Montpellier : mon cher collègue, la concession d’ASF prendra fin non en 2031, mais en 2036, c’est-à-dire dans quinze ans !
Nous avons finalement publié nos prévisions de rentabilité, mais, si j’avais écouté les sociétés d’autoroutes, nous n’en aurions publié aucune ; ces sociétés ont donné les leurs à l’ART et j’en ai eu communication, mais ces documents étaient couverts par le secret des affaires. Néanmoins, je peux vous le dire en toute confidence, monsieur le ministre, les prévisions que nous publions sont en ligne avec celles des sociétés d’autoroutes…

M. Vincent Delahaye, rapporteur. Je remercie tous les participants à ce débat ; j’espère que nous en aurons d’autres pour poursuivre notre discussion et notre travail.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes RDPI et SER.

Mes chers collègues, nous en avons terminé avec le débat sur les conclusions du rapport de la commission d’enquête sur le contrôle, la régulation et l’évolution des concessions autoroutières.
Nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures, est reprise à seize heures cinq.

L’ordre du jour appelle le débat, organisé à la demande du groupe Les Indépendants – République et Territoires, sur le thème : « Écriture inclusive : langue d’exclusion ou exclusion par la langue. »
Dans le débat, la parole est à M. Jean-Pierre Decool, pour le groupe auteur de la demande.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, pour autant qu’il m’en souvienne, lorsque j’étais au collège et que j’apprenais les différentes règles de l’orthographe de notre belle langue, je me demandais souvent : « Mais pourquoi ? » Alors, je prenais mon courage à deux mains et je demandais à mon professeur : « Pourquoi dit-on le soleil et la lune alors qu’en allemand le soleil est un terme féminin et la lune un mot masculin ? » Mieux encore, je lui demandais pourquoi les mots « orgue », « délice » et – plus tard – « amour » étaient masculins au singulier, mais féminins au pluriel. Mon professeur me répondait : « Parce que c’est comme ça ! »
La vérité, c’est qu’il ne le savait pas plus que moi. Personne ne le sait en définitive. Les grammairiens font un travail de fourmi et avancent des théories plus ou moins proches de la réalité, mais notre langue est ainsi faite. Oui, c’est ainsi. En revanche, je ne dis pas qu’il devait en être ainsi. En effet, une langue est la résultante d’un travail lent et laborieux, de son usage par ceux-là mêmes qui la pratiquent, l’idéalisent et la malmènent. Elle n’est pas créée théoriquement ; elle est l’osmose plus ou moins parfaite des usages. Une langue n’est pas un bloc de marbre froid. Elle est un corps, une glaise qui se modèle, se sculpte, se transforme, se patine au gré du temps et de ses évolutions.
Je ne suis ni linguiste ni philosophe. Je suis un humble sénateur inspiré par le bon sens. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je veux dire ici qu’une langue n’est pas le fruit de revendications identitaires et partisanes animées par une forme de militantisme bien désuet. Alors, quand j’ai découvert, indépendamment de toute idéologie, le sujet de l’écriture inclusive, j’ai cru à une fantaisie, à une sorte de caprice de l’esprit. Je vous le confie, tout cela me semblerait dérisoire s’il ne révélait pas l’expression d’une fracture de la société, raison pour laquelle notre groupe vous invite aujourd’hui à réfléchir sur l’écriture inclusive.
Avant tout, revenons aux réponses, loin d’être satisfaisantes, de mon professeur. Nombre d’entre vous ont dû entendre les mêmes de la bouche de leurs enseignants. Pourtant, cela ne vous a pas empêchés d’acquérir les rudiments de l’orthographe française.
Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux face à la langue. Je ne pense pas me tromper en observant une lente et pernicieuse dégradation de l’apprentissage de notre langue parmi les jeunes générations. Avant de s’intéresser à l’écriture inclusive, comme notre groupe vous y invite, commençons par apprendre la langue française à nos enfants !
Interrogez nos universitaires et nos enseignants : ils sont désespérés. Je veux vous lire le témoignage que j’ai recueilli auprès d’une professeure de faculté : « Mes étudiants comprennent un raisonnement, une démonstration, mais ils sont, pour la plupart, dans l’incapacité de retranscrire ce raisonnement, faute de savoir construire une phrase simple, avec un sujet, un verbe et un complément, voire, parfois, ne disposant que d’un vocabulaire d’une pauvreté abyssale. » Le linguiste Alain Bentolila corrobore ces propos avec un chiffre effrayant : « 20 % des jeunes possèdent moins de 500 mots pour dire le monde. »
Je crains que nous ne puissions parler de générations sacrifiées. Je présume que les nouvelles technologies, avec les « réseaux antisociaux », pour citer le président de notre groupe, Claude Malhuret, ne vont pas contribuer à améliorer les choses…
Même si notre ministre a décidé de réformer la pédagogie, il faudra des décennies pour rattraper le temps perdu et les dégâts occasionnés. Si les tentatives de pratique de l’écriture inclusive prêtent à sourire, cette vérité n’a rien d’amusant.
Revenons à nos moutons et tentons de comprendre l’origine du phénomène de l’écriture inclusive. Le mouvement est d’origine anglo-saxonne et serait l’initiative d’associations féministes dénonçant une masculinisation à marche forcée de la langue française ainsi que l’invisibilité de l’appartenance sexuelle et, bien entendu, celle du sexe féminin.
Le cœur de cette graphie se résume dans la mise en cause de la règle, datant du XVIIe siècle, selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin ». Le grammairien et académicien Nicolas Beauzée précisait : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin, à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. »

C’était en 1767 !
Vous le savez aussi bien que moi, mes chers collègues, l’écriture de l’histoire ne se regarde pas avec les yeux d’aujourd’hui, mais nous pouvons comprendre la colère que de tels jugements peuvent entraîner et tenter, à la demande de certains mouvements féministes, de corriger ce prétendu déséquilibre. Il n’est pas question d’interdire d’interroger l’orthographe.
Toutefois, l’écriture inclusive ne s’arrête pas là. Si j’ai bien compris, elle consiste à insérer des points médians à la fin des noms pour féminiser l’écriture. Cette pratique, loin d’être intuitive, peine à s’imposer. En mars 2017, un premier ouvrage destiné à des élèves de CE2 en écriture inclusive a été publié. Certaines écoles ou universités et même des collectivités territoriales auraient également lancé des initiatives destinées à encourager cette écriture. La polémique est désormais engagée.
Tout viendrait de la bien regrettable confusion, que certains entretiennent complaisamment, entre marques de genre grammatical et identificateurs de sexe : pour certains, la langue française a trouvé et trouve commode de détourner l’usage arbitraire des marques de genre pour obtenir une distinction entre les femmes et les hommes.
On peut discuter des règles, tenter de les comprendre. Mais, je le répète, seuls l’usage et le temps font finalement évoluer notre langue.
Cela me conduit à une réflexion : depuis combien de temps les partisans du langage inclusif n’ont-ils pas discuté avec nos concitoyens ? Il me semble que leurs préoccupations, aux allures superfétatoires, dépassent l’immense majorité des francophones, qu’ils n’effleurent aucunement. Quand je parle de cette graphie, on me regarde avec des yeux ronds, avant de balayer le sujet de la conversation pour se concentrer sur ce qui est important.
Ce débat semble s’autoalimenter dans des sphères dites « bien-pensantes », politiquement correctes, aussi appelées, à l’américaine, « éveillées ». Cette graphie, plus qu’une réelle revendication, serait devenue une sorte de marqueur idéologique, un signe extérieur de richesse culturelle, la Rolex de la bien-pensance. Comme le montre si bien Rachel Kahn dans son dernier ouvrage, c’est une manière d’écrire son curriculum vitae pour montrer patte blanche avant d’entrer dans des cercles, où des parangons de vertu prônant la diversité et l’inclusion font preuve d’une remarquable homogénéité de pensée, de genre ou de pigmentation de la peau.
Contrairement à ces derniers, je me refuse à parler de race ou même à réduire mes compatriotes à leur couleur de peau, leur genre ou leurs origines.
Quand Jacques Derrida disait « je n’ai qu’une langue, ce n’est pas la mienne », il mettait en avant un caractère essentiel de la langue : le fait qu’elle n’appartient à personne, qu’elle n’est donc pas un outil idéologique et qu’elle ne doit pas l’être.
La question de l’égalité entre les femmes et les hommes est, bien entendu, première. Dès lors, pourquoi ne pas poser cette question directement ? Reléguer la gent féminine à un « e » final séparé par un point ne serait-il pas aussi une manière de mettre un point, final cette fois, à la discussion ? J’y lis, entre les points, un violent renoncement à l’égalité. Je ne sais pas si je dois m’en offusquer ou m’en attrister.
Il est dit que l’écriture inclusive consiste à inclure toutes les personnes pouvant ne pas se sentir représentées, sur le plan du genre, de l’ethnicité ou de la religion. Est-ce à dire que, après avoir satisfait à la demande de certains groupes féministes, nous aurons à modifier notre langue sous la pression d’autres groupes de revendication ?
Mes chers collègues, voulons-nous nourrir cette archipélisation de la société française qu’a si bien décrite Jérôme Fourquet et qui amène Jacques Julliard à observer « le passage de la République des citoyens à la société des individus », inspirée par certains courants outre-Atlantique, que certains exportent ici ?
Nous ne pouvons pas admettre cette volonté d’asservir les droits de l’Homme au profit d’une dictature de minorités défendant des intérêts particuliers.
Je n’ai pas oublié, pour ma part, que les valeurs qui nous animent sont les principes de la République, de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, quatre termes féminins dont je ne revendique pas la masculinisation ! Ces valeurs sont trop précieuses, lumineuses et universelles.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDSE et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, l’écriture inclusive alimente régulièrement les polémiques en se faisant l’écho d’un sujet sociétal majeur : l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour autant, l’écriture inclusive caricature ce combat et, à mon sens, porte plusieurs dérives, que je veux rappeler ici.
La première est issue d’un présupposé : la pratique de la langue doit être une déclinaison des politiques sociales inclusives, donc inclure toutes les personnes qui peuvent se sentir non représentées. La langue refléterait ainsi fidèlement l’ordre du monde, la façon de penser d’une société. De facto, une langue qui invisibilise le féminin au profit du masculin serait celle d’un monde où les femmes sont cachées.
Aujourd’hui, l’écriture inclusive servirait donc les luttes féministes. Qu’en sera-t-il demain lorsque la langue devra servir une autre cause ? Faudra-t-il changer de langue au gré des combats sociétaux ?
Erik Orsenna, dans La Fabrique des mots, nous alerte sur les dangers de la confusion entre ordre linguistique et ordre social. Dans ce conte, il narre les aventures d’un dictateur qui, voulant lutter contre les bavardages pour hisser son pays au rang de puissance mondiale, bannit les mots inutiles. « Évidemment, c’était plus facile de déclarer la guerre aux mots que d’affronter le chômage ! », déclare son héroïne…
La deuxième dérive de l’écriture inclusive est sa vision de la masculinité dans le langage. Comme nombre d’entre vous, j’ai appris, dans les leçons de grammaire, que « le masculin l’emporte sur le féminin ». Cette règle concentre les attaques des partisans de l’écriture inclusive. Toutefois, les linguistes déconstruisent la thèse selon laquelle elle aurait été instaurée afin de soumettre les femmes. Depuis la première moitié du XVIIe siècle, ils débattent sur l’accord de voisinage, tel que « le cœur et la main ouvertes », qui, jusqu’au début du XXe siècle, est enseigné dans les manuels de grammaire.

Cette chronologie démontre qu’il n’y a pas de lien entre grammaire et place de la femme dans la société.
En fait, le masculin fonctionne en français comme le genre de base, portant la généralité. C’est au masculin qu’est formé le participe dans « j’ai écrit », même si le sujet « je » représente une femme.

C’est au masculin que l’on substantive les différentes catégories grammaticales, comme dans le froid, monsieur Sueur, le chaud, le pour, le contre et même le qu’en-dira-t-on. Il s’agit d’un principe d’organisation de la langue et non d’une vision de la société.
Dernière dérive : l’écriture inclusive entraîne l’exclusion. La multiplication des lettres muettes, la révision de la ponctuation, la complexité des règles d’accord, la fin de la linéarité de la chaîne écrite sont autant de difficultés nouvelles qui entraînent une perte de compréhension. Quel en sera le coût social ? Quels en seront les bénéfices ? Surtout, quels en seront les bénéficiaires ?
Au reste, lorsque l’on nous dit que l’écriture inclusive n’a pas vocation à être imposée aux écoliers, en particulier à ceux qui éprouvent des difficultés à entrer dans l’écrit, n’est-on pas à même de s’interroger sur la prétendue inclusivité de l’écriture inclusive ?
Pour ma part, je crois profondément que l’écriture inclusive ne répondra pas aux enjeux de l’égalité entre les femmes et les hommes. Au contraire, elle créera un fossé entre ceux qui la maîtrisent et ceux qui n’auront pas accès à cette complexité coupée du monde réel.
La langue est un vecteur de partage et de rassemblement. J’en veux pour preuve le rôle joué par notre école depuis près de cent cinquante ans, qui a permis à des enfants non francophones arrivés en France de parler français et, ainsi, de s’intégrer dans notre société et de faire Nation. La langue est bien l’un des facteurs premiers d’intégration.
En août 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, en rendant obligatoire l’usage du français dans les actes publics de justice et d’administration du royaume, précisait que les arrêts devaient être clairs et compréhensibles, afin qu’il n’y ait pas de raison de douter sur leur sens.
Dans une langue, les objectifs de clarté et de compréhension sont des défis perpétuels. Ils le sont particulièrement aujourd’hui. Il me paraît dangereux de sacrifier l’apprentissage de l’écriture et de la lecture sur l’autel de l’instrumentalisation de notre langue à des fins idéologiques.
Sans fondement historique, sans pertinence linguistique, loin d’être inclusive, cette écriture est, au contraire, facteur d’exclusion entre ceux qui maîtrisent et ceux qui subissent. Ni notre langue ni notre société n’en ont besoin.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et INDEP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, chers collègues, l’idée selon laquelle le pouvoir des hommes et, en l’occurrence, le pouvoir des femmes se refléteraient dans le choix des mots n’est pas nouvelle. La volonté de réformer une langue pour marquer un changement sociétal ne l’est pas non plus.
Jamais la langue française n’aura connu autant de changements que sous la Révolution française. Le français a été érigé comme langue nationale, arme défensive pour prémunir la République de tout morcellement. Trait d’union entre tous les citoyens, elle a contribué à cimenter l’identité républicaine, en offrant à chacun un égal accès aux lois, au droit, à l’instruction.
Dans le même temps, le français s’est considérablement enrichi et n’a jamais cessé de le faire, en intégrant des mots en patois, des mots étrangers, des innovations lexicales. La langue française est avant tout une langue vivante, à la fois chargée d’histoire et évolutive. L’écriture inclusive a déjà imprimé son empreinte à travers la féminisation des métiers et des fonctions, la suppression du « mademoiselle » dans les documents administratifs ou encore le choix spontané de certains mots neutres pour inclure l’ensemble des interlocuteurs, comme je l’ai d’ailleurs fait au début de mon discours en préférant le mot « collègues » à « sénateurs » ou « sénatrices et sénateurs ».
En la matière, le mieux est l’ennemi du bien, et il ne faudrait pas confondre les évolutions naturelles de la langue, partagées par la majorité des Français, et sa confiscation par une petite minorité porteuse de revendications égalitaristes.
Cette offensive lexicale se cristallise dans l’usage du point médian, qu’une poignée de militants tentent d’imposer dans les universités, certaines mairies ou dans les écoles. Cette écriture prétendument inclusive se révèle en pratique inaccessible pour un grand nombre de nos concitoyens, aveugles, déficients visuels, dyslexiques ou autistes.
J’ai auditionné hier, avec mon collègue Jean-Pierre Decool, l’Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées, présidée par Matthieu Annereau. Les témoignages que nous avons recueillis soulignent que, en modifiant la graphie des phrases, l’écriture inclusive rend les textes absolument incompréhensibles pour toute personne qui utilise la lecture d’écran par synthèse vocale. En cherchant à dégenrer la langue, nous fabriquons une langue d’exclusion, une langue discriminante.
Nous devons faire usage de bon sens et veiller par-dessus tout à l’accessibilité de la langue pour tous, avant de chercher à la rendre conforme à nos revendications idéologiques, justifiées ou non.
À l’heure où nous débattons de la symbolique des mots, des millions de femmes dans le monde sont prisonnières de sociétés profondément machistes, sexistes et violentes à leur égard. Alors que certains se hérissent au nom de la théorie du genre, des femmes sont lapidées, brûlées à l’acide au nom de la tradition ou pour avoir refusé une demande en mariage. Il faut choisir ses combats, ceux qui en valent la peine.
La journaliste d’origine turque, Claire Koç, a choisi la France précisément pour les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité que notre pays incarne et défend. Je dis bien « fraternité », mot féminin qui désigne le lien existant entre les membres de la famille humaine, que les mêmes défenseurs du point médian voudraient doubler du mot « sororité », quitte à modifier la devise républicaine au nom d’un faux féminisme revanchard. La différence, c’est que la sororité n’inclut pas les hommes, alors que la fraternité inclut les femmes et les hommes.
La galanterie est-elle toujours permise ou allons-nous bientôt chercher à en faire une marque de sexisme insupportable ? L’historienne Mona Ozouf plaide pour l’apprentissage de la nuance et défend l’idée qu’il existe un féminisme à la française, où la galanterie reste l’expression d’une élégance.
Vous l’aurez compris, chers collègues, je suis pour une société inclusive et une langue française universelle, qui facilite la lecture et la compréhension. C’est la raison pour laquelle je suis contre cette écriture d’exclusion que représente l’usage du point médian.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP et Les Républicains.

M. Thomas Dossus. Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à remercier le groupe Les Indépendants – République et Territoires de nous avoir proposé ce débat, d’une importance capitale pour traiter d’un péril civilisationnel aussi majeur que l’écriture inclusive, ou, plus exactement, le terrifiant point médian. Malgré la pandémie, l’explosion des inégalités, la crise sociale, malgré l’effondrement de la biodiversité et la catastrophe climatique qui s’annoncent, vous avez su garder la tête froide et remettre au cœur de la Haute Assemblée les vrais débats qui comptent. Cela doit être salué.
Sourires sur les travées du groupe SER.

Puisque nous devons débattre, faisons-le sérieusement.
La langue est une construction culturelle et sociale. Elle reflète notamment les évolutions et les rapports de force dans la société. À son tour, elle forge les esprits : elle détermine en partie la manière dont nous pensons et envisageons le réel.
Le langage porte en lui des questions politiques. Il est forcément l’objet d’évolutions et de tensions. L’écriture inclusive, ou plutôt le souci d’une communication inclusive, est une forme de travail sur ce langage. C’est un processus de réappropriation de la langue, pour plus d’égalité.
En France, ce débat s’est focalisé sur le point médian, comme nous le voyons aujourd’hui. Pourtant, celui-ci n’est pas l’alpha et l’oméga d’une communication inclusive.
Mme Marie-Pierre Monier applaudit.

Mais le niveau de débat actuel, qui ne permet aucune nuance ou réflexion, passe désormais par un processus bien rodé : des personnes, des chercheuses ou des militantes, réfléchissent sur un sujet, font une proposition, qui rompt parfois avec une forme d’ordre établi ; puis, les réactionnaires ou les conservateurs, paniqués par toute forme de progrès, montent le sujet en épingle pour nier l’exigence d’égalité. Les polémiques se cristallisent sur de faux problèmes et l’on finit par disserter ici sur de la typographie.
Oui, nous pouvons questionner notre communication, y compris dans nos administrations, quand elle invisibilise parfois 50 % de la population ! Non, le point médian, celui qui coupe les mots pour leur ajouter un suffixe, n’est pas le seul outil d’écriture inclusive ! Non, ce n’est ni un « péril mortel » ni un « risque civilisationnel », contrairement à ce que j’ai pu lire !
Comment diminuer les inégalités qui se trouvent au cœur même de notre manière de nous exprimer, donc de rendre compte du réel ?
La langue française est une langue vivante. Elle évolue avec les femmes et les hommes qui la parlent. Il en a toujours été ainsi. Il serait illusoire de vouloir inscrire dans le marbre des règles immuables et de fixer définitivement les usages. Les seules langues ainsi figées sont les langues mortes, comme le grec ou le latin. J’espère que personne ici n’a cette ambition pour notre langue nationale.
Parmi les arguments souvent cités à l’encontre du point médian, nous venons de l’entendre, un argument revient sans cesse, qui s’avère tout à fait exact : son usage rend la lecture difficile pour les personnes souffrant d’un handicap de lecture. C’est même en raison de cette difficulté que Jean-Michel Blanquer souhaite interdire son usage à l’école. C’est le bal des tartuffes ! Cette soudaine passion pour les enfants en situation de handicap disparaît soudainement quand il s’agit de revaloriser le salaire des accompagnants des élèves en situation de handicap, les AESH, qui sont mobilisés depuis des mois pour la reconnaissance de leurs missions.
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.

Au-delà du point médian, le fond du problème est la prédominance du masculin dans notre langue. Cela s’explique par l’histoire, par une évolution lente, depuis un latin qui reconnaissait trois genres – féminin, masculin et neutre – jusqu’à la progressive disparition du genre neutre au profit d’un masculin qui devint générique.
Force est toutefois de constater que cette histoire n’est pas linéaire. Au Moyen Âge, la langue, alors plus libre dans son usage, était habituellement épicène : elle faisait à de nombreuses occasions la part belle au féminin et au masculin de manière égale. Même lors de la fondation de l’Académie française par Richelieu et alors que les règles que nous connaissons aujourd’hui se sont stratifiées peu à peu, la règle de prédominance du masculin n’a jamais été aussi fortement affirmée qu’elle ne l’est aujourd’hui. On préférait ainsi, par exemple, l’accord de proximité, qui consiste à accorder le genre de l’adjectif avec le nom le plus proche qu’il qualifie.
Mes chers collègues, sachez ainsi que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui, je le rappelle, a valeur constitutionnelle, mentionne : « Tous les Citoyens […] sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics. » L’usage exigerait aujourd’hui que l’on emploie « tous » au lieu de « toutes » ! Ce texte, malgré son intitulé, était donc déjà plus souple que certains dans son usage de notre langue.
Il n’y a donc pas, d’un côté, un usage pur et traditionnel de la langue, qui s’opposerait, d’un autre côté, aux prétendus délires séparatistes d’une partie de la population. Il s’agit d’un processus d’évolution de la langue, nourri par un questionnement. Ce processus interroge et nous élève.
Oui, il est possible de communiquer en incluant toute la diversité de notre société ! Non, vous n’êtes pas et vous ne serez jamais obligés d’utiliser le point médian ! Notre langue est riche quand elle se réinvente. Soyez donc inventives et inventifs !
Pour conclure, je tiens à faire remarquer à cette assemblée que le discours que je viens de prononcer, comme tous ceux que prononcent les sénatrices et sénateurs de mon groupe, a été réalisé en suivant dans la mesure du possible les règles de cette langue épicène que vous fustigez tant. Chacun sera libre de constater si celui-ci a mis en danger la langue française !
Applaudissements sur les travées des groupes SER et CRCE.

… c’est un débat piège : on se sent pris en tenailles entre, d’un côté, les partisans d’une forme d’hypermodernité à la mode, consistant à défendre l’écriture inclusive partout, tout le temps, et, de l’autre, les tenants d’une croisade réactionnaire visant à l’interdire par la loi. C’est un débat de talk-show, de chaîne d’information en continu, dont on imagine bien les invités s’étriper durant une heure sur l’écriture inclusive
Je crois qu’il y a d’autres façons de faire avancer l’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat. Celle-ci est déjà passée par la langue, avec la féminisation des fonctions. Pour ma part, je suis choqué que l’on y résiste encore, notamment dans cet hémicycle, mais pas seulement. Quand j’ai commencé la politique à Paris, voilà longtemps, le maire commençait ses allocutions par « Parisiennes, Parisiens ». Que l’on dise aujourd’hui « Mme la présidente » et « Mme la maire » me semble bien évidemment indispensable et aller dans le bon sens.
Ces débats sont anciens et ne viennent pas seulement de l’étranger. Les théories qui conduisent à promouvoir l’écriture inclusive ont aussi été construites par des philosophes français. Sans vouloir faire de provocation, je citerai le début de l’allocution de Roland Barthes au Collège de France, en 1977, lors de sa leçon inaugurale : « La langue, comme performance de tout langage, n’est ni réactionnaire ni progressiste ; elle est tout simplement fasciste ; car le fascisme, ce n’est pas d’empêcher de dire, c’est d’obliger à dire. » Plus tard, Roland Barthes aura cette formule fameuse : « Tout d’un coup, il m’est devenu indifférent de ne pas être moderne. » Lui-même était traversé de ces contradictions…
Des raisons pratiques viennent compliquer, dans certaines circonstances, l’utilisation de cette écriture inclusive. Ces raisons ont été rappelées par différents orateurs, y compris parmi les promoteurs de l’écriture inclusive. À cet égard, je remercie M. Dossus d’avoir souligné que les associations défendant les personnes en situation de handicap mettaient en avant les difficultés liées à l’utilisation de l’écriture inclusive – notamment le point médian pour les personnes ayant recours aux synthèses vocales.
Certains linguistes, à l’instar de Bernard Cerquiglini, montrent que, sous prétexte de progressisme, on se dirige vers quelque chose qui complique. Paradoxalement, l’écriture inclusive vient ralentir le mouvement observé depuis le XVIe et le XVIIe siècle vers une plus grande lisibilité démocratique de la langue et la rend moins compréhensible. On voit combien le débat est complexe.
Comme cela a été rappelé, 10 % des élèves arrivant en sixième ont une maîtrise insuffisante du français. L’utilisation de l’écriture inclusive dans les apprentissages viendrait donc compliquer une situation déjà loin d’être parfaite en termes de maîtrise de la langue.
Par ailleurs, depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, on essaie d’établir une norme la plus partagée, la plus simple et la plus compréhensible possible. La circulaire de 2017 va également dans ce sens.
Enfin, le français est aussi un facteur de rayonnement, un outil de promotion de notre pays, dont l’écriture inclusive pourrait réduire la portée.
Je ne veux pas tomber dans le piège qui tendrait à dire qu’il faut voter des lois pour interdire à tous d’utiliser cette écriture. Même si c’est particulièrement difficile dans le cadre d’un tel débat, il me semble possible d’adopter une position un peu modérée – « Je veux vivre selon la nuance », disait Roland Barthes. À titre personnel, je ne suis ni favorable à l’utilisation maximaliste de l’écriture inclusive ni particulièrement favorable à l’adoption d’une loi visant, par exemple, à interdire de l’utiliser.

Regardons les difficultés que soulève cette question. Il y a d’autres façons de mieux répondre à l’objectif sous-jacent d’égalité entre les femmes et les hommes que poursuivent celles et ceux qui promeuvent l’écriture inclusive.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes, inscrit à l’article 1er de notre Constitution, est une juste cause. Il mérite une action résolue, ambitieuse et ininterrompue. En parallèle, l’article 2 de notre Constitution dispose que « la langue de la République est le français ». Il s’agit d’un facteur d’intégration, d’appartenance et de rayonnement de la culture française. Notre langue nationale constitue le socle fondamental de notre fraternité républicaine.
Le débat sur l’écriture épicène, dite « inclusive », met en jeu ces deux exigences constitutionnelles. Au-delà, elle interroge notre façon de « faire société » à travers le langage.
L’écriture inclusive repose sur deux grands principes. D’une part, il s’agit d’accorder les grades, fonctions, métiers et titres en fonction du genre – on écrira ainsi « une autrice », « une pompière » ou « une sénatrice ». Ce principe ne rencontre pas d’opposition, et l’Académie française en a d’ailleurs fait la promotion. Il s’agit de lutter contre l’invisibilisation des femmes. D’autre part, il s’agit d’inclure les deux sexes grâce à l’utilisation du point médian pour éviter que le masculin « ne l’emporte » sur le féminin – on écrira ainsi « les électeur.rice.s » ou « les citoyen.ne.s ». C’est ce principe qui attise aujourd’hui les passions.
Albert Camus disait : « J’ai une patrie : la langue française. » Or non seulement l’écriture inclusive conduit à une dénaturation de la langue française, mais le désir d’égalité n’excuse pas le façonnage des consciences. Cette écriture s’accompagne en effet d’une politisation du langage de la part d’une minorité loin d’être consensuelle. Elle n’est utilisée que dans des cercles militants très restreints, et sa généralisation semble au moins prématurée, au pire peu souhaitable.
Comme notre collègue Bargeton, je citerai Roland Barthes : « Dès qu’elle est proférée, fût-ce dans l’intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d’un pouvoir. » Oui, la langue entre au service d’un pouvoir, celui de la culture et de l’histoire dont nous sommes héritiers ! Le français est riche d’un passé glorieux. Nos écrivains, nos diplomates, nos figures illustres ont pensé dans cette langue prestigieuse dont l’influence est forte dans les pays de la francophonie.
Mais la langue française ne doit pas être instrumentalisée au service d’une repentance anachronique. L’écriture inclusive relève d’une idéologie militante dont ne doivent pas souffrir les élèves. Alors que ces derniers ont de plus en plus de mal à savoir lire et écrire, comme nous le démontrent les classements PISA, nous ne pouvons nous permettre d’alourdir et de complexifier l’apprentissage de la langue française.

L’Académie française a déjà alerté sur le risque d’aboutir à une langue désunie, disparate dans son expression et créant une confusion qui confine à l’illisibilité.

L’écriture inclusive consacre une rupture sans précédent entre la langue parlée et la langue écrite.
Si chacun est libre d’utiliser divers moyens de communication dans son espace privé, les services publics, ainsi que leurs agents, ne doivent pas communiquer par écrit dans une langue aussi incomprise que discriminante.

À cet égard, je ne peux que soutenir la décision du ministre de l’éducation nationale de rejeter l’usage de l’écriture inclusive dans les manuels scolaires.
Il s’agit d’un barrage à la transmission de notre langue pour tous, raison pour laquelle je m’inscris en opposition, ainsi que l’ensemble de mon groupe, avec cette écriture compliquée. Loin de tout discours réactionnaire, je ne peux me résoudre à lire un « roman épicène » – de grâce, épargnez-moi l’allongement des fameuses phrases de Proust !
Applaudissements sur les travées des groupes RDSE et INDEP.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mesdames les sénatrices, mesdames les sénateurs, messieurs les sénateurs, chères collègues, chers collègues, « nous voulons que doressenavant tous arrestz ensemble toutes autres procedeures soient […] enregistrez & delivrez aux parties en langage maternel francoys, et non autrement ».
Vous avez reconnu, chers collègues, l’une des prescriptions de l’ordonnance sur le fait de la justice, prise en 1539, à Villers-Cotterêts, par François Ier en un château où il reçut François Rabelais et Clément Marot.
Quatre siècles plus tard, l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 déclare toujours que « la langue de la République est le français », mais, pas plus que l’ordonnance de 1539, la Constitution ne précise de quel français il s’agit. Toutefois, dans sa sagesse, le procureur général du roi avait précisé, en 1539, qu’il s’agissait du français comme langue maternelle, c’est-à-dire de la langue telle qu’elle est parlée dans la diversité de ses pratiques, de ses emprunts et de ses assimilations. Cette langue a beaucoup évolué depuis le XVIe siècle, et ses transformations successives ont accompagné celles de nos sociétés pour qu’elle demeure, en ce début du XXIe siècle, « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ».
Dans le monde, le français est aujourd’hui la langue de près de 300 millions de personnes, qui l’utilisent, la font évoluer et l’adaptent à des réalités sociales en perpétuelles mutations. Ces locuteurs, peut-être parce qu’ils ont une relation avec la langue française moins sacramentelle que la nôtre, lui apportent beaucoup pour qu’elle demeure vivante.
Ainsi, le 28 juillet 1979, la Gazette officielle du Québec publiait une instruction de l’Office de la langue française qui recommandait l’utilisation des formes féminines dans tous les cas possibles, soit à l’aide du féminin usité – une infirmière –, soit à l’aide du seul déterminant – la ministre –, soit par un néologisme – une chirurgienne –, soit par l’adjonction du mot femme : une femme-ingénieur.
On sait qu’une circulaire gouvernementale du même esprit, proposée par Mme la ministre Yvette Roudy en 1986, suscita une vive réaction des geôliers de la langue, qui lui reprochèrent de vouloir « enjuponner le vocabulaire ». Pourtant, l’usage a tranché, et je note que notre assemblée compte quatre-vingt-dix femmes qui ont souhaité se faire appeler « sénatrices », alors que vingt-huit autres demandent qu’on leur donne du « sénateur ». En revanche, je n’ai pas trouvé d’homme revendiquant le titre de « sénatrice ».
Rires sur quelques travées.

Cette liberté donnée à la pratique de la langue doit être préservée, car elle fait toute sa richesse. Je note, avec malice, que la direction de la séance de notre assemblée n’applique pas à la lettre les rectifications orthographiques du français recommandées par l’Académie française en 1990. Ainsi, dans nos comptes rendus, le mot « événement » garde fièrement ses deux accents aigus, alors que l’Académie préconise de changer le second par un accent grave.

Néanmoins, ces franchises linguistiques doivent s’exercer dans le respect de l’esprit de la langue et de ses usages afin qu’elle demeurât…

… intelligible et maîtrisable par le plus grand nombre.
S’agissant de l’utilisation typographique du point médian, il nous faut écouter un autre Conseil de la langue française, celui de la communauté francophone de Belgique, qui recommande un « emploi parcimonieux de ces formules » afin de ne pas trop entraver la lecture et l’écriture.
Sans dénier tout intérêt à ce débat, nous eussions préféré qu’il portât plus largement sur le recul de l’emploi du français dans de nombreux domaines de nos activités.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.

Enfin, protéger et promouvoir avec intelligence le français impose de ne point figer son usage par des règles désuètes qui en réserveraient la pratique à une petite caste de scribes.
Sur ce point, je conclus par cette citation d’Ernest Renan dont l’intelligence des relations d’une langue avec la Nation demeure d’une grande actualité : « Les langues sont des formations historiques, qui indiquent peu de choses sur le sang de ceux qui les parlent. » Il ajoute qu’une considération exagérée donnée à la langue a ses dangers : « On se renferme dans une culture déterminée, tenue pour nationale ; on se limite, on se claquemure. On quitte le grand air qu’on respire dans le vaste champ de l’humanité pour s’enfermer dans des conventicules de compatriotes. »
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER, ainsi que sur des travées des groupes INDEP, UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues sénatrices et sénateurs, depuis les années 1960 et particulièrement depuis le début des années 2000, nos sociétés connaissent une évolution de la place des femmes en ce qui concerne leurs carrières professionnelles, les métiers et les fonctions auxquels elles accèdent sans que l’appellation correspondant à leur activité et à leur rôle réponde pleinement à cette situation nouvelle.
L’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la reconnaissance du rôle de ces dernières dans la société est un combat juste, qui me tient particulièrement à cœur en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes.
L’écriture inclusive, dont nous débattons aujourd’hui, se présente comme un des outils permettant d’offrir une meilleure visibilité aux femmes. Par l’écriture inclusive, on entend un ensemble de pratiques et d’annotations qui vise à donner une représentation égale des femmes et des hommes dans la langue écrite. Mais devons-nous penser qu’une modification des règles grammaticales de la langue française écrite sera un moyen de parvenir à une égalité entre les femmes et les hommes ? Je ne le crois pas.
Au-delà de l’objectif qu’elle poursuit, l’écriture inclusive pose plusieurs problèmes. Le premier est une réelle difficulté d’apprentissage : l’écriture inclusive rompt avec les règles de prononciation et de ponctuation, ainsi qu’avec les règles morphologiques que les jeunes élèves sont en train d’acquérir. De nombreuses associations de parents d’élèves ainsi qu’une large partie du corps enseignant se sont montrées hostiles à son application dans l’enseignement. Le ministre de l’éducation, Jean-Michel Blanquer, s’est d’ailleurs prononcé contre cette pratique dans l’éducation nationale en octobre 2017. Simultanément, l’Académie française alertait sur le risque d’aboutir à « une langue désunie, disparate dans son expression, créant une confusion qui confine à l’illisibilité ».
L’écriture inclusive pose ensuite un problème majeur pour les personnes souffrant de handicap, comme cela a déjà été souligné. Je pense, par exemple, aux personnes malvoyantes et aux élèves dyslexiques ou dyspraxiques.
Pour les personnes malvoyantes, le problème est insoluble : tous les systèmes d’écriture connus ont vocation à être oralisés. Or il est impossible de lire l’écriture inclusive : « cher.e.s » ne se prononce pas. Le décalage graphie-phonie ne repose plus sur des conventions d’écriture, mais sur des règles morales que les programmes de synthèse vocale ne peuvent traiter et qui rendent les textes inaccessibles aux malvoyants.

L’écriture inclusive devient donc, de fait, excluante pour une partie de la population. Elle se transforme en pratique complexe et élitiste.
Offrir une meilleure visibilité aux femmes dans nos sociétés est un but à poursuivre avec force et détermination, mais il ne me semble pas que l’écriture inclusive soit le meilleur moyen d’y parvenir. Je ne crois pas qu’une mutation d’ordre syntaxique puisse permettre d’accélérer une mutation sociale. C’est le sort fait aux femmes et l’usage de la langue qui doivent évoluer et non la langue elle-même.
Puisqu’il est question d’égalité au travers de ce débat, permettez-moi un hors sujet : ayons une pensée pour Chahinez Boutaa et les trente-huit victimes de féminicides depuis le début de l’année. Ces crimes inqualifiables démontrent notre incapacité à protéger ces femmes. C’est le triste constat d’une société inégalitaire au sein de laquelle, en termes de violences subies, le féminin l’emporte sur le masculin.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes INDEP et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « ce qui n’est pas nommé n’existe pas », écrivait le poète turc Ilhan Berk.
C’est incontestable : la langue que nous écrivons, que nous parlons, joue un rôle essentiel dans notre représentation du monde. Au cours des derniers siècles, elle a éludé, invisibilisé les femmes. Leur redonner leur juste place et ainsi ouvrir le champ des possibles, c’est tout le projet de l’écriture inclusive, que je préfère pour ma part qualifier d’écriture « égalitaire », et qui englobe en réalité un éventail de techniques.
Je nous invite, pour avoir un débat constructif, à la regarder telle qu’elle est, loin de toute caricature : accord de proximité, féminisation des noms de métiers, titres et fonctions, mots dits « épicènes », formes féminines et masculines pour parler d’un public mixte – abrégées ou non par le recours au point médian… Autant d’outils dont peuvent se saisir celles et ceux qui souhaitent encourager dans la langue une égalité de représentation entre les femmes et les hommes.
Parmi ces techniques, c’est le point médian, dernier symbole d’une logique typographique visant à faire ressortir les formes féminines, qui polarise le plus les critiques. Ce point médian suscite des troubles, des inquiétudes, quant à son maniement et à sa lisibilité, y compris au sein de mon groupe. Ces doutes, je les entends d’autant plus qu’ils peuvent être alimentés par de mauvais usages. Toutefois, lorsqu’on pratique bien l’écriture inclusive, on choisit ses formulations avec un souci permanent de lisibilité. Elle doit être pensée comme un outil pédagogique qui s’adresse à tout le monde.
Il est intéressant de constater que certains arguments qui lui sont opposés étaient déjà invoqués contre la féminisation des noms de métiers et fonctions. Je pense à l’argument subjectif de l’esthétisme, qui semble méconnaître la part que joue l’habitude dans notre appréhension des mots. Des termes comme « autrice » ou « poétesse » étaient encore d’usage jusqu’au XVIIe siècle : pourquoi ne pas se les réapproprier ? Je pense également à l’argument de la neutralité du masculin, qui repose sur l’idée qu’il y aurait une dualité : d’un côté, un masculin neutre générique ; de l’autre, un masculin spécifique désignant l’homme. Or les psycholinguistes qui se sont penchés sur cette question soulignent que le masculin dit « générique » s’efface toujours devant le masculin « spécifique » – lorsqu’on prononce le mot « sénateur », on se représente en premier lieu un homme.
La féminisation des noms de métiers et fonctions a longtemps été vivement décriée ; elle rencontre d’ailleurs toujours des résistances sur certaines travées de notre hémicycle. Appelée des vœux d’Édouard Philippe dans sa circulaire aux administrations de novembre 2017, elle apparaît désormais comme largement consensuelle, ce dont témoigne l’évolution récente de la position de l’Académie française sur le sujet. Cela sera peut-être l’avenir d’autres techniques d’écriture égalitaire – l’histoire en jugera.
Je souhaiterais préciser qu’il n’a jamais été question, ni pour moi ni pour la plupart de celles et ceux qui la défendent, d’obliger de recourir à l’écriture inclusive. Il ne s’agit pas de l’imposer, mais simplement de garantir la liberté de s’en emparer. A contrario, celles et ceux qui souhaitent l’interdire s’inscrivent dans une démarche coercitive rigide, se heurtant parfois à la réalité des usages.
Mmes Laurence Cohen et Michelle Meunier applaudissent.

Mme Marie-Pierre Monier. Je conclurai par une citation d’Éliane Viennot, professeuse émérite de littérature, dont la réflexion sur ces sujets est bien connue : « Réfléchir aux meilleures pratiques de l’écriture inclusive et aux moyens de la diffuser, mesurer sérieusement ses effets psychosociaux et son impact sur les inégalités, n’est-ce pas un programme plus utile que de la peindre, encore et encore, en péril mortel ? La langue est le ciment de notre culture. Réjouissons-nous de la voir pensée, discutée, négociée. »
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Laurence Cohen applaudit également.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, « la langue française est une femme. Et cette femme est si belle, si fière, si modeste, si hardie, touchante, voluptueuse, chaste, noble, familière, folle, sage, qu’on l’aime de toute son âme, et qu’on n’est jamais tenté de lui être infidèle », écrivait Anatole France.
Existe-t-il une langue, mes chers collègues, qui incarne mieux le respect de la féminité, le romantisme et la poésie que le français ? Cette langue magnifique, aussi présente dans la littérature que dans la diplomatie, est l’une des racines les plus profondes de notre civilisation et de notre culture. Être Français, c’est d’abord parler français, comme nous le rappelle l’article 2 de notre Constitution. C’est notamment ce qui faisait dire à Albert Camus : « Ma patrie, c’est la langue française. »
Aujourd’hui, fini les grands esprits et place aux idéologues et à la déconstruction de ce que nous sommes. Emmanuel Macron veut déconstruire notre histoire ; dans le même élan, on cherche à déconstruire la langue qui fait notre socle commun, qui protège le cœur de notre nation et relie, à travers la francophonie, ceux qui l’aiment et ceux qui s’y retrouvent.
Mme de La Fayette, la comtesse de Ségur et George Sand n’étaient pas au courant qu’elles utilisaient une langue sexiste. De cette idiotie est née – et maintenant prospère – l’écriture inclusive, qui n’est rien d’autre qu’une écriture de l’exclusion. En prétendant combattre les inégalités, cette nouvelle dérive met la langue française en grand péril et crée de nouvelles disparités : par la succession des points et des ruptures de mots, les malvoyants, les dyslexiques et les étudiants étrangers sont les premières victimes de ces saccades qui sont autant de saccages.
L’abolition du genre, l’obsession sexiste et l’apparition du neutre sont les fossoyeurs du français, alors que le niveau en orthographe des écoliers est déjà affligeant. Interdire l’écriture dite « épicène », que je qualifierai d’obscène, …

… dans les écoles est donc une évidence absolue. Elle doit également être bannie des universités et de toutes les institutions publiques.
Ces militants « linguicides » sont les mêmes qui refusent de commémorer le bicentenaire de la mort de l’empereur Napoléon Ier, les mêmes qui travestissent la réalité de notre histoire pour imposer aux Français le poison de la repentance perpétuelle, les mêmes qui veulent faire table rase du passé, de notre identité pour nous priver du futur commun. Tous sont porteurs de la même motivation, du même virus mortel : la haine de la France. Leur volonté de la combattre, de l’abattre, passe aussi par la destruction de sa langue, étape décisive pour nous plonger dans le chaos culturel et identitaire.
Certains d’entre vous connaissent peut-être L ’ Albatros de Charles Baudelaire, …

… dont voilà un passage façon écriture inclusive :
Le.a poète.sse est semblable au.à la prince.sse des nuées
Qui hante la tempête et se rit de l’archer.ère ;
Exilé.e sur le sol au milieu des huées,
Ses ailes de géant.e l’empêchent de marcher.
Inutile de torturer davantage cette œuvre, ces quelques mots ainsi défigurés suffisent à démontrer toute l’absurdité et le danger que représente l’écriture inclusive pour la beauté et la compréhension de dame ou damoiselle langue française.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, les difficultés supplémentaires introduites par l’écriture inclusive dans l’apprentissage et l’appropriation de la langue française, à l’écrit comme à l’oral, auraient dû, à elles seules, clore le débat. En effet, pour les personnes « dys » – dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques – et pour les non-voyants et les malvoyants, elle est sans aucune ambiguïté facteur d’exclusion.
La place des femmes dans la société constitue certes un défi éducatif, mais qui ne saurait occulter l’autre défi majeur que représente l’apprentissage de la lecture chez les jeunes enfants. Ce n’est pas faire injure aux immenses, mais inégales, capacités d’apprentissage des enfants que de reconnaître que la déconnexion entre la logique de la langue écrite et celle de l’oral rendra son appropriation moins fluide.
De ce point de vue, et forte de mon expérience d’enseignante, je dois dire d’emblée que j’approuve la ferme position du ministre de l’éducation en faveur de l’interdiction de l’écriture inclusive dans l’enseignement.
De fait, si une langue a vocation à évoluer avec la société, sa structure ne devrait ni se déconstruire ni se dénaturer pour s’enrichir. Par surcroît, jusqu’ici, la langue française a plutôt suivi un mouvement naturel, et inclusif, de simplification. Sa complexification conduira, au contraire, à renforcer le caractère élitaire de sa maîtrise.
Les femmes étant majoritaires au sein des populations illettrées, l’accès à la lecture et à l’écriture leur serait rendu encore plus difficile par un procédé qui ambitionne paradoxalement de les rendre plus visibles.
En outre, le recours au point médian vient détourner l’usage de ce signe de ponctuation qui indique la fin d’une phrase selon la règle « une phrase commence par une majuscule et se termine par un point » et qui sert la compréhension des textes. En détournant la ponctuation, l’écriture inclusive ne féminise pas seulement les mots, elle modifie les structures grammaticales et orthographiques de l’écriture.
J’observe d’ailleurs que l’effet dominateur des hommes sur les femmes, lequel résulterait de la règle selon laquelle « le masculin l’emporte sur le féminin », ne sera pas entièrement gommé : à bien y regarder, avec l’écriture inclusive, la féminisation procède généralement de l’adjonction du point médian et du « e » après un mot dans sa forme masculine. On pourrait dès lors en déduire la règle selon laquelle « le féminin vient après le masculin », ce qui nous fait revenir au point de départ !
Pourquoi, dès lors, ne pas faire évoluer la formulation de la règle ? Si l’on veut transformer les mentalités avec l’écriture, ce même objectif peut être atteint par l’enseignement de la distinction entre le genre des mots et le sexe des personnes, moins complexe et permettant d’éviter l’assignation au sexe de la personne.
De fait, un autre grand risque de l’écriture inclusive est à mon sens celui de l’essentialisation des femmes. Dans cette logique, la facteure, l’autrice, les défenseures, les actrices sont distinguées d’abord en tant que femmes, ce qui conduirait à terme au même effet pour les hommes. Mais à l’heure où notre époque refuse les déterminismes de genre, afin de permettre aux transgenres ou encore aux personnes qui ne souhaitent pas être déterminées de trouver pleinement leur place, il me semble qu’une reconfiguration de l’écriture à partir d’un axe binaire masculin/féminin irait à rebours de la société. Visuellement, le point n’inclut pas, mais établit une séparation entre la forme masculine et la marque du féminin.
De nombreux linguistes ont démontré le caractère en réalité « excluant » de ce mode d’écriture, qui déplace un sujet sociétal sur le terrain de la grammaire. Trente-deux d’entre eux ont ainsi publié une tribune collective pointant « outre les défauts fonctionnels » de l’écriture inclusive, l’absence de lien linguistique exclusif entre la féminisation des mots et la féminisation de la société et confirmant, en tout état de cause, l’effet d’éviction pour les personnes présentant des difficultés d’apprentissage.
Dans son ouvrage Le Sexe et la langue, l’un des signataires, Jean Szlamowicz, rappelle que l’expression « écriture inclusive » n’est pas née d’une évolution spontanée de la langue. Il s’agit d’un nom de domaine déposé en 2016 par une agence de communication, qui conduit à établir une distinction entre genre des mots et sexe des personnes.
Ce sont donc toutes ces raisons qui conduisent à considérer que l’écriture inclusive exclut plus qu’elle n’inclut. Dans cette optique, notre attention doit être concentrée sur les enfants. Nous devons nous garder de leur ajouter une contrainte supplémentaire, alors que les positions de la France au classement PISA nous éclairent sur les enseignements à conforter.
La féminisation des mots ou l’écriture épicène, qui privilégient les genres neutres, sont des vecteurs de visibilité pour les femmes, laissant à chacun le choix de les utiliser selon son appréhension de la langue. Le français est suffisamment riche pour offrir cette liberté, et l’esthétique particulière de la langue française dans l’imaginaire mérite d’être préservée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, avant d’entamer mon propos, je tiens à saluer le travail remarquable de ma collègue Annick Billon en tant que présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité entre les hommes et les femmes.
La reconnaissance des droits des femmes est un sujet universel, qui ne doit pas seulement être porté par les femmes. Ce combat nous concerne tous et doit aussi être mené dans la langue française. Par exemple, les titres et les fonctions se féminisent, car de plus en plus de femmes occupent des postes qui étaient autrefois détenus par les hommes.
La langue n’est pas figée et s’adapte à l’évolution de la société. Cependant, l’évolution de la visibilité des femmes ne doit pas se faire au prix d’une dénaturation de la langue. L’écriture inclusive est à ce titre une aberration.
Les défenseurs de l’écriture inclusive se fondent sur la règle du « masculin l’emporte sur le féminin » pour prouver que les femmes ont été exclues de la langue française. Or il ne s’agit ici que d’un masculin grammatical. Personne ne peut voir dans cette règle la transposition d’une supposée prédominance de l’homme sur la femme, comme ils voudraient nous le faire croire.
Il faut arrêter de voir dans la langue française la retranscription d’une société patriarcale où le mâle dominant l’emporterait sur la femelle dominée.

Si nous n’écrivons plus comme au XVIe siècle, à la manière du poète Ronsard, « la rose qui ce matin avait déclose », c’est parce que le peuple, dans sa sagesse, a fait prévaloir le masculin, à la manière d’un genre neutre, car le féminin était trop difficile à prononcer.
L’écriture inclusive constitue une atteinte à la mémoire collective et à la construction de notre langue, qui a été façonnée par le peuple français au fil des siècles.
Ceux qui croient que notre langue est misogyne parce qu’elle serait « genrée » oublient que c’est la marque des langues latines comme l’italien ou l’espagnol. D’ailleurs, les genres ne sont qu’arbitraires : les mots « une girafe », « un zèbre » ou « un éléphant » désignent aussi bien le mâle que la femelle.
Si le français exclut le féminin, comment expliquer que notre langue ait féminisé les piliers de notre société : la liberté, la démocratie, la République, la fraternité ? Il y en aurait tant d’autres à citer ! Les hommes devraient-ils à leur tour s’émouvoir et se sentir exclus lorsque les mots qui les caractérisent ont un genre féminin ? Un homme peut très bien être « une sentinelle », « une sage-femme » ou « une nouvelle recrue ». Cette écriture inclusive n’est pas seulement illisible et imprononçable ; elle est aussi un « péril mortel » aux yeux de l’Académie française. Dans la mesure où le parler sera différent de l’écrit, il n’y aura plus d’unité, car l’écriture ne retranscrira plus le langage.
Cette déconstruction par pure idéologie entraîne également de nombreuses difficultés pour l’apprentissage. Quand on sait que 25 % des élèves qui arrivent en sixième ont des difficultés pour lire et écrire, on se demande pourquoi il faudrait ajouter de la complexité à l’une des langues les plus difficiles au monde.
Ainsi, la députée Clémentine Autain écrivait le 29 mai 2018 sur Twitter : « Nous refusons que les droits de nos enfants, étudiant.e.s, élèves, soient à ce point bafoué.e.s. » « Bafoué » se rapporte ici à « droits » : c’est donc une erreur que de l’écrire au féminin. Si même les chantres de l’écriture inclusive se mettent à faire des fautes, comment voulez-vous que nos enfants s’y retrouvent ?
M. Stéphane Piednoir s ’ esclaffe.

Pensons également à nos amis francophones ! Si les pays du Maghreb, d’Afrique ou le Canada rejetaient l’écriture inclusive, il y aurait alors une rupture de la francophonie. Notre langue s’en trouverait désunie et de moins en moins parlée dans le monde.
Il y a donc une différence fondamentale entre une évolution imposée par l’idéologie politique et une évolution naturelle tenant compte des mutations de la société. En 2021, près de 150 mots sont entrés dans le dictionnaire, comme « black bloc », « dégagisme » ou « féminicide ». Greta Thunberg a même fait son entrée dans la catégorie des noms propres !
Ces mêmes idéologues nous expliquent depuis des années que le sexe ne doit pas être assimilé à l’identité de genre. Et voilà que, à propos de l’écriture, ils considèrent que le genre grammatical est le reflet de leur vision de la société, où la femme serait dominée par l’homme.
Pour terminer, je reprendrai un extrait de la tribune écrite par trente-deux linguistes dans le journal Marianne en septembre 2020 : « En introduisant la spécification du sexe, on consacre une dissociation, ce qui est le contraire de l’inclusion. En prétendant annuler l’opposition de genre, on ne fait que la systématiser. »
L’écriture supposément « inclusive » entraîne, en réalité, une exclusion réciproque entre les hommes et les femmes.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe INDEP.
Mme Marie-Pierre Monier applaudit.

Madame le président, madame le secrétaire d’État, chers collègues sénateurs…
Une telle introduction a dû vous faire dresser l’oreille. Vous vous êtes dit que la manière dont je m’adressais à notre assemblée en cet instant ne correspondait pas à la réalité de sa composition. Dans cette assemblée, en effet, il y a Mmes les sénatrices, Mme la présidente, Mme la secrétaire d’État et MM. les sénateurs. Or, il y a une quinzaine d’années, c’est ainsi que nous nous exprimions dans cette maison. Celles et ceux qui choquaient étaient celles et ceux qui féminisaient nos fonctions. Je fais ce rappel pour apaiser mes collègues.
Aujourd’hui, tout le monde trouve cette féminisation normale. Pourtant, au moment où cette évolution a eu lieu, elle a rencontré d’énormes résistances. Voilà seulement trois ans, à l’Assemblée nationale, un député a été sanctionné parce qu’il s’obstinait à dire « madame le président » à la femme qui présidait la séance. La langue évolue, parce que la société évolue.
En disant « mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs », je m’exprime en langage inclusif.

On n’utilise donc le langage inclusif que pour désigner les hommes, les femmes et les fonctions.
Le langage inclusif consiste aussi à rechercher les mots qui n’excluent pas les femmes. Le meilleur exemple est celui de l’expression « droits de l’homme ». On me dit que le masculin est générique avant d’être masculin et, donc, tout le monde devrait être bien content ! Or les femmes ne se reconnaissent pas quand on parle de « droits de l’homme ».
Je pourrais éventuellement suivre ceux qui me disent que les droits de l’homme concernent aussi les femmes. Ce serait vrai si les droits de l’homme avaient concerné les femmes. Or, dans la mesure où ils n’étaient pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes, j’en déduis que ce n’est pas totalement un hasard si on préfère parler de droits de l’homme, lesquels excluaient effectivement les femmes, qui n’avaient pas les mêmes droits.

Monsieur Brisson, je ne vous ai pas interrompu ! Pourtant, vous avez dit des choses qui m’ont écorché les oreilles !
Je préfère donc parler des droits humains, qui concernent les hommes et les femmes, sans exclure qui que ce soit.
Sur quoi porte le désaccord ? D’abord, peut-être, sur notre constat de l’effet du masculin générique. Je pense que le masculin générique, et des linguistes le pensent avec moi, excluent les femmes. Il ne permet pas de représenter et de visibiliser les femmes. Nous travaillons les uns et les autres à permettre une meilleure visibilité des femmes dans la langue. Nous avons les mots épicènes, qui ont été évoqués. Nous avons aussi le point médian.

J’ai entendu que le point médian était défendu par des féministes radicales et excessives. Je le souligne, les féministes du moment sont toujours radicales et excessives. Les bonnes féministes, celles qui ont eu raison, sont celles d’avant. Pourtant, à leur époque, elles étaient aussi qualifiées de radicales. Ainsi, les féministes radicales d’aujourd’hui seront les féministes dont tout le monde louera l’apport dans une dizaine d’années. Au reste, les féministes ne sont pas celles qui parlent le plus du point médian.
Il existe quatre propositions de loi visant à interdire l’écriture inclusive, nous avons ce débat aujourd’hui, il y a une circulaire du Premier ministre et une déclaration du ministre de l’éducation nationale… Ce n’est pas sérieux ! La bataille contre le point médian est devenue une bataille politique. C’est une bataille de résistance à l’évolution de la société.
Mes chers collègues, je conclurai sur ce point, qui, je le sais, va vous fâcher : il s’agit de la même résistance que celle de 2014 contre le mariage pour tous et la théorie du genre, contre la PMA pour toutes, contre l’allongement des délais d’IVG. Dans la mesure où ces batailles sont derrière nous et qu’elles ont été gagnées par le pays, les mêmes se retrouvent aujourd’hui sous une nouvelle bannière, celle du point médian. Bonne croisade, bonne bataille ! Pendant ce temps, la langue évolue.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – Mme Laurence Cohen et M. Thomas Dossus applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, si les langues ont vocation à permettre aux hommes de communiquer entre eux, il est permis de convenir que le français a poussé assez loin cette logique, jusqu’à l’universel. Après avoir été la langue de la diplomatie européenne, il a été celle de l’olympisme, et la France détient toujours le record du nombre de prix Nobel de littérature. En cela, c’est un bien collectif. Aucune faction ne devrait pouvoir le confisquer pour servir ses intérêts.
Le français est une langue syllabique, qui implique de pouvoir lire à haute voix sa forme écrite. C’est aussi une langue irrégulière, dont l’apprentissage est réputé difficile. Malgré cela, nous observons que certains militants s’activent pour la complexifier en ajoutant un nouveau mode grammatical : l’inclusif. Ils la parasitent de déclinaisons imprononçables et de pronoms fantaisistes, non pas pour la nourrir, puisque, après tout, la langue est un organe vivant, mais pour la refonder et substituer au français un idiome seulement compréhensible d’un groupe de locuteurs, qui, sous le masque de l’égalité, cultive l’entre-soi d’une avant-garde éclairée.
Un tel sabir visant à se démarquer pourrait nous divertir, comme le faisaient les vieux jargons français d’autrefois, tels le javanais, le louchébème ou même le verlan, qui remonte au XIIe siècle. Sauf qu’aujourd’hui les facéties des promoteurs de l’écriture dite inclusive ne nous amusent plus : nous sommes passés de Queneau à Orwell, de l’argot à la novlangue !
Du camp de ses partisans, j’entends monter le contentement de renverser les statues de linguistes distingués disparus il y a trois ou quatre siècles. Ce ne sont pas eux qu’ils touchent. En imposant leurs écrits indéchiffrables, ils sapent en réalité le patient travail de nos instituteurs et de nos professeurs de français, qui s’efforcent de transmettre à leurs élèves, dont le français n’est parfois pas la langue maternelle, l’autonomie dans la lecture et l’écriture, donc dans la vie.
Malgré cela, en fin de troisième, 15 % des collégiens ne maîtrisent pas le français ou le maîtrisent mal. En outre, 27 % des entreprises ou administrations interrogées déplorent régulièrement des problèmes causés par l’incompréhension de la langue écrite. Les orthophonistes nous alertent sur les difficultés bien réelles engendrées par l’inclusif pour la lecture des dyslexiques, sans parler de celles qui sont rencontrées par les malvoyants et les personnes âgées.
Alors, c’est vrai, en français, le genre neutre est porté par le masculin. Cette règle date du XVIIe siècle, époque à laquelle l’Académie a voulu encadrer l’usage d’une langue encore adolescente. Mais est-ce vraiment la grammaire qui a mis les femmes en état de minorité ? Lui faire porter cette responsabilité au nom de la « représentation mentale » induite ne me semble guère étayé. A contrario, le persan, le chinois ou le turc ne distinguent pas les genres : sont-ils pour autant des facteurs de libération pour leurs locutrices ?
Cependant, et par définition, une langue vivante n’est pas inerte. Je me réjouis en cela de la féminisation des métiers et des fonctions qui ont tant tardé à être exercés par des femmes. Mais n’embrigadons pas notre langue ! N’en faisons pas un ferment de division, alors qu’elle doit rester ce terrain d’entente et, donc, de dialogue.
Miner la structure même de la langue, c’est signifier aux individus d’une société qu’ils n’ont plus d’essence commune, qu’ils n’ont plus vocation à s’adresser les uns aux autres, qu’ils n’ont finalement plus rien à faire ensemble. Or, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, aujourd’hui, notre société a davantage besoin de traits d’union que de points médians.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureuse, après vous avoir attentivement écoutés, de m’exprimer au nom du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la question de l’écriture inclusive.
Si le sujet est aujourd’hui débattu dans cet hémicycle, c’est bien, et cela a été rappelé à plusieurs reprises, parce que nous ne parlons pas d’un petit sujet, d’une lubie de quelques personnes isolées qui se seraient prises de passion pour un nouveau jeu littéraire. L’écriture inclusive n’a rien à voir avec un exercice de style. Elle est un enjeu de société, un enjeu à la fois éducatif et politique, c’est-à-dire un enjeu qui nous préoccupe tous.
Que l’on ne s’y trompe pas. Je ne parle pas ici de l’évolution nécessaire de la langue et des usages consistant à accorder les métiers et les fonctions selon le genre. Cette évolution est un progrès évident, que nous saluons, salutaire pour les femmes et pour la société dans son ensemble. Je ne parle pas de la féminisation des noms, mais bien de l’écriture dite « inclusive », au sens où l’entend la circulaire du Premier ministre Édouard Philippe du 21 novembre 2017, à savoir en tant que « pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ». En clair, nous parlons bien aujourd’hui du point médian et des néologismes dits neutres, comme le pronom non binaire « iel », censé remplacer à la fois le « il » et le « elle ».
Cette écriture dite « inclusive » prend de l’essor et dépasse aujourd’hui très largement la sphère militante ou associative. On la retrouve désormais dans certains journaux, on la voit exploser sur les réseaux sociaux, on ne s’en étonne plus dans la communication des entreprises ni dans les publicités de marques grand public.
Nul n’ignore aussi combien son usage s’est répandu à l’université, dans certains intitulés de cours, de travaux dirigés ou de publications. Certains professeurs, que je crois volontiers peu nombreux, approuvent de telles pratiques et l’encouragent même, au détriment d’élèves ou d’étudiants qui ne voudraient ou, tout du moins, ne sauraient en faire usage.
De même, à l’université, et désormais à l’école, de plus en plus d’élèves l’emploient dans leurs copies, et nos professeurs se trouvent bien en peine de les corriger, souvent désemparés et dépassés par l’ampleur du phénomène. Leur embarras est légitime. Comment, en effet, s’opposer à une écriture qui prétend lutter pour l’égalité entre les femmes et les hommes et manifester la diversité du genre humain ? Pourquoi prendre le risque de se mettre à dos un, sinon plusieurs, élève ou collègue ? Comment ne pas plier face aux pressions, aux intimidations parfois, car elles existent, sommant d’y avoir recours ?
Face à cela, il est une réponse : l’institution. L’institution, c’est-à-dire l’État, doit se prononcer avec clarté et fermeté sur un tel sujet, car elle est la seule à pouvoir fixer la norme à laquelle chacun peut se référer en toutes circonstances.
Quatre ans après la circulaire de 2017 et l’avertissement de l’Académie française, je veux donc le redire avec la force et avec la conviction que seule donne l’évidence : l’écriture inclusive est un danger pour notre école ; elle est un danger pour notre langue ; elle est un danger pour les principes mêmes de notre République ; elle est donc un danger pour notre pays.
Je ne vous ai pas interrompue, madame la sénatrice !
Je commencerai par parler de l’école. L’écriture dite « inclusive » vient battre en brèche la mission première de tout système éducatif : apprendre à lire.
Nul ne peut contester les difficultés de lecture qu’entraîne déjà pour l’adulte une telle graphie. L’écriture inclusive nous fait buter sur les mots, nous contraint au bégaiement. Elle rend la marche d’un texte chaotique, elle disloque les mots en les fendant en deux. L’écriture inclusive nous contraint à la myopie : on ne voit plus que le mot écrit, on ne voit pas plus loin que le mot, on oublie le sens de la phrase, on perd finalement le sens tout court. L’écriture inclusive marque le retour au stade du déchiffrage ; elle est une régression de l’acte de lire.
Chacun peut donc imaginer combien ces difficultés de lecture sont décuplées chez le jeune enfant qui apprend à lire. Vous le savez sans doute, madame la sénatrice, en classe de CP, les élèves apprennent à associer les lettres, dont la combinaison produit des sons, qui se combinent en mots. Ces mots font ensuite des phrases, dont l’enfant comprend enfin le sens. Il ne faut pas moins que l’association de cinq étapes successives pour apprendre à lire.
Tous les enfants ont besoin de règles claires. Aucun élève n’apprend dans le flou. Pour l’apprentissage de la langue française, les programmes scolaires se réfèrent aux normes orthographiques et grammaticales en usage, et les mêmes règles sont enseignées à tous. La clarté de la norme est la condition indispensable de la transmission.
À l’opposé exact de cela, les militants de l’écriture inclusive font évoluer leurs propres règles syntaxiques au gré des semaines. On ne compte plus les querelles intestines pour décider à quel endroit exactement placer le point médian, quels accords privilégier, jusqu’où aller dans le démembrement de la phrase. L’écriture inclusive a ses radicaux et ses modérés, ses pacifistes et ses jusqu’au-boutistes.
En vérité, la question est simple : peut-on se payer le luxe, en France, d’aggraver les difficultés de lecture de nos élèves ?
Il suffit de regarder les résultats des évaluations nationales pour se convaincre du contraire.
Moi qui suis, semaine après semaine, au contact des élèves de l’éducation prioritaire, …
… je vous alerte sur ce point. En dépit d’un progrès indubitable depuis 2018, à l’entrée en sixième, un nombre encore trop important d’élèves présente des difficultés de déchiffrage manifestes, qui sont inquiétantes.
De fait, l’écriture inclusive constitue bien un obstacle pour l’acquisition de la langue et de la lecture pour la très grande majorité des enfants, sinon pour tous.
Comme l’a écrit récemment le professeur émérite Bernard Cerquiglini, l’écriture inclusive rompt avec le courant progressiste, qui, depuis le XVIe siècle, milite en faveur d’une lisibilité démocratique de l’écrit. Il est donc tout à fait exact de parler d’écriture excluante.
L’écriture inclusive est excluante au moins à un autre titre : elle est inadaptée aux élèves présentant des troubles d’apprentissage. Je pense en particulier aux enfants atteints de dyslexie, de dyspraxie ou de dysphasie.
Je pense aussi à tous les enfants en situation de handicap, enfants autistes, enfants malvoyants, qui dépendent de logiciels d’aide à la lecture incapables de reconnaître l’écriture inclusive et, donc, de restituer le texte lu.
Aussi, la typographie de l’écriture inclusive – une typographie qui ne se lit pas et ne se dit pas, une typographie instable, qui dépend du bon vouloir créatif de chacun, une typographie incapable de se choisir une règle orthographique plutôt qu’une autre – n’a en vérité aucunement sa place dans notre école.
Par conséquent, parce que nous défendons une école véritablement inclusive, …
… parce que nous mettons l’intérêt supérieur de l’élève au-dessus de tout, et parce qu’enfin nous croyons, comme l’a écrit Jean Zay…
… en 1936, que « l’école doit rester l’asile inviolable où les querelles des hommes ne pénètrent pas », le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports vient de publier une circulaire proscrivant son usage dans les enseignements.
Elle viendra conforter nos élèves dans leurs apprentissages et conforter nos professeurs dans leur travail.
… nous pourrions nous en tenir à souligner l’inadéquation fondamentale entre écriture inclusive et apprentissage de la lecture.
Autrement dit, nous pourrions nous en tenir à l’école. L’école est le creuset de la République. L’école a tout à voir avec la République, et ce qui touche aux principes fondamentaux de notre République touche nécessairement à notre école.
Beaucoup a déjà été dit cet après-midi sur les dangers que constitue l’usage de l’écriture inclusive pour notre langue et pour notre pays.
Vous avez ainsi parlé de la francophonie. En effet, comme s’en est inquiétée l’Académie française, je suis convaincue que la généralisation de l’écriture inclusive, qui complexifie abusivement notre grammaire et notre orthographe, qui ne sont déjà pas si simples, marquerait la mort annoncée de la pratique de la langue française dans le monde. Rappelons qu’il n’y a pas d’accord des adjectifs en anglais et quasiment pas d’accord des verbes non plus. Cette simplicité est un avantage compétitif évident pour la diffusion de l’anglais dans le monde. Tout autre est le cas des langues romanes, qui nécessitent connaissance du masculin et du féminin de chaque nom et accord des adjectifs.
Dans cet environnement linguistique déjà complexe, les tenants de l’écriture inclusive, en refusant d’accorder au masculin sa fonction de neutre, font le choix assumé d’accroître considérablement les difficultés préexistantes de notre langue par l’excroissance artificielle des mots.
Par conséquent, avec l’expansion de l’écriture inclusive, la langue anglaise, déjà en situation quasiment hégémonique à travers le monde, gagnerait à coup sûr et probablement définitivement sur la langue française. Je parle de l’anglais, mais je pourrais parler de bien d’autres langues. Mesdames, messieurs les sénateurs, l’écriture inclusive, je le crois, signe le déclin du français parlé dans le monde.
Vous avez aussi parlé du lien irréductible qui lie notre pays à sa langue. « L’histoire de France commence avec sa langue », nous dit Michelet. Nous sommes les dépositaires temporaires des mots, des voix, des âmes qui ont sculpté la langue française par le passé. Par nos vies, nous sommes les bâtisseurs de la langue que, à notre tour, nous devons transmettre. Notre langue ne s’est pas faite en un jour.
Elle est le résultat d’une longue histoire, d’une longue tradition faite d’enrichissements progressifs et d’apports successifs.
J’en suis heureuse, madame la sénatrice.
La langue est une chaîne de vie, dont nous ne sommes qu’un maillon.
Cette vérité appelle l’humilité et doit tempérer l’hubris de quelques-uns. Cette vérité doit aussi nous pousser à réfléchir par deux fois avant d’accepter des évolutions moins dictées par l’usage courant que par la nouvelle doxa du temps présent.
Cela a été dit, l’écriture inclusive participe d’une idéologie qui, comme toute idéologie, ne souffre pas la contestation et dont les partisans cherchent au contraire à imposer leurs vues à tous. Cette idéologie oppose les hommes et les femmes, les dominants et les dominés. Elle fait du terrain linguistique un champ de bataille où deux camps combattent face à face.
Sans doute vaudrait-il mieux éviter dans un cours de grammaire de dire que « le masculin l’emporte sur le féminin ». En revanche, on peut tout simplement dire qu’au pluriel le mot s’accorde au masculin, qui, dans la langue française, fait office de neutre.
L’écriture inclusive est donc le refus du neutre, c’est-à-dire de l’universel. L’écriture inclusive, c’est rendre visible le genre et rendre invisible l’universel. Ce mouvement d’inversion de la norme est en contradiction totale avec les principes mêmes de notre République, qui rassemble avant d’exclure, qui unit avant de séparer. Par conséquent, l’écriture inclusive n’est pas seulement illisible, inintelligible, impraticable et préjudiciable aux apprentissages, pas uniquement le choix délibéré d’exclure une partie de nos concitoyens, …
… elle est une méconnaissance absolue et, je crois, voulue de notre langue et de son histoire, une tentative d’appauvrissement de notre manière de penser et, plus encore, de nous penser.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’école de la République apprend à chaque élève à habiter sa langue, c’est-à-dire à être porté par une littérature qui a toujours célébré cet esprit de liberté et de partage qu’est l’esprit français.
Notre langue est davantage qu’un trésor : elle est notre destinée commune. C’est par la langue que nous devenons nous-mêmes et que nous nous projetons au-delà, vers cet universel qui caractérise le rapport si singulier que les Français entretiennent avec le monde.
Mme Nathalie Elimas, secrétaire d ’ État. Sachons donc la garder belle et l’énoncer clairement sans jamais cesser de l’enrichir. Les générations à venir nous en sont tributaires.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et INDEP.

Nous en avons terminé avec le débat sur le thème : « Écriture inclusive : langue d’exclusion ou exclusion par la langue. »

L’ordre du jour appelle, à la demande des groupes Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants et Les Indépendants – République et Territoires, l’examen de la proposition de résolution, en application de l’article 34-1 de la Constitution, en faveur de l’association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales, présentée par MM. Alain Richard, Joël Guerriau et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 493).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Alain Richard, auteur de la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite vous présenter brièvement le contexte et l’objet de notre proposition de résolution.
Nous sommes dans une situation marquée par la séparation de Taïwan et de la Chine continentale depuis 1949, à l’issue d’une guerre civile de plus de vingt ans qui s’est conclue par la prise de pouvoir du parti communiste chinois et l’instauration de la République populaire. La France, puis les États-Unis et, à leur suite, la plupart des États de la communauté internationale ont reconnu le régime de Beijing comme le représentant de toute la Chine. La République populaire de Chine a repris en 1971 le siège de cette puissance au Conseil de sécurité de l’ONU.
En conséquence, Taïwan a été ramenée à une entité non étatique, bien que l’île soit en fait dotée de tous les attributs d’un État sur son territoire de 36 000 kilomètres carrés – l’équivalent de la superficie des Pays-Bas – et peuplé de 23 millions d’habitants – une population comparable à celle de l’Australie.
Depuis lors, Taïwan a évolué de son côté en devenant, d’une part, une puissance économique significative qui prend toute sa part dans le décollage de l’Asie de l’Est et, d’autre part, une société de plus en plus libre et ouverte, avec des élections réellement libres et pluralistes, une presse libre, un développement scientifique et culturel débarrassé des censures. Du côté de la Chine continentale, nous savons que l’évolution est différente.
Les autorités de la Chine populaire ont toujours affirmé leur volonté de faire revenir Taïwan dans leur souveraineté. À cette fin, elles ont formulé dès les années 1980 la doctrine « un pays, deux systèmes », qui, on le sait, a été appliquée ensuite à Hong Kong, avec l’évolution ultérieure que nous observons.
À des périodes diverses, ces autorités ont exercé des pressions militaires à proximité de Taïwan, soutenues par des lois prévoyant l’emploi de la force au cas où Taïwan déclarerait formellement son indépendance. Ces pressions militaires se sont renforcées au cours des deux dernières années en cohérence avec la montée très prononcée des capacités de défense de la Chine populaire.
La France conduit toute son action internationale dans le cadre du multilatéralisme organisé et, donc, des institutions internationales où les États prennent ensemble des mesures de régulation ou de promotion destinées à améliorer le sort des citoyens du monde, au sein duquel priment leur sécurité et leur santé. Notre pays souhaite logiquement qu’une entité comme Taïwan, dont la contribution à la vie internationale est importante dans de nombreux domaines, puisse y être entendue.
Dans leurs textes organiques, les organisations que nous mentionnons dans la proposition de résolution autorisent la participation d’entités non étatiques dont l’intervention est utile à leur mission. Il est évident que c’est le cas de Taïwan dans bien des champs d’action, le plus emblématique étant bien sûr celui de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), compte tenu de l’expérience éclatante de l’île en ce qui concerne la gestion de la pandémie mondiale sur son sol. Mais cela est vrai aussi pour Interpol, pour l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et pour la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Les autorités françaises ont régulièrement réalisé des démarches au sein de ces enceintes internationales pour obtenir qu’elles consentent à la participation de Taïwan, certes avec un statut d’observateur, mais avec un accès aux informations et aux réflexions produisant un effet utile. Notre proposition de résolution se veut donc, monsieur le secrétaire d’État, une approbation et un encouragement adressés à notre exécutif pour qu’il continue ses interventions en partage avec d’autres puissances.
Le point saillant relevé dans notre texte est que les autorités de la République populaire de Chine ont accepté que Taïwan participe aux travaux de l’OMS pendant plusieurs années, estimant que ce concours ne contrevenait pas à leur politique nationale, qui a comme but ultime la réunification.
La position de Beijing a changé en 2016 à la suite de l’élection et de l’entrée en fonction de Mme Tsai Ing-wen. Celle-ci a pourtant bien déclaré qu’elle entendait respecter le statu quo entre les deux rives du détroit, ce qui se confirme dans les faits depuis cinq ans.
Nous sommes donc fondés à estimer respectueusement que la République populaire de Chine pourrait, sans infléchir ses positions de fond, accepter à nouveau une collaboration des représentants de Taipei à l’Assemblée annuelle de l’OMS et, par conséquent, aux outils concrets de coopération en faveur de la santé mondiale qui y sont discutés.
En sollicitant de tous nos collègues un soutien à cette proposition de résolution dont l’inspiration est constructive et conciliatrice, nous entendons – je veux le dire très clairement – respecter la loi internationale…

… et n’engager aucune initiative visant à perturber l’équilibre fragile qui prévaut dans cette région soumise à des tensions graves.

Je conclus, madame la présidente.
En cohérence avec la conduite constante de la France sur cette question, nous ne pouvons que recommander la retenue et la recherche de solutions pacifiques et négociées.
La proposition de résolution soumise à votre approbation, mes chers collègues, s’inscrit sans équivoque dans cette ligne. Nous vous la soumettons par conséquent avec confiance.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, SER, INDEP, UC et Les Républicains.

La parole est à M. Joël Guerriau, auteur de la proposition de résolution.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de résolution que nous présentons est conforme aux engagements de notre pays, qui consistent à défendre le bon fonctionnement de la santé pour tous dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé, à lutter contre la criminalité transnationale via Interpol, à assurer la sécurité aérienne civile internationale sous l’égide de l’Organisation de l’aviation civile internationale et, enfin, à trouver des solutions viables pour le changement climatique grâce à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Tous ces sujets impliquent nécessairement des efforts concertés de la part de toutes les nations et la participation de tous les citoyens du monde vivant sur notre planète. Les différences d’opinions politiques doivent être mises de côté, car ces questions essentielles dépassent les frontières.
S’agissant de la santé, cet état d’esprit est d’ailleurs bien retranscrit dans la Constitution de l’OMS : « La possession du meilleur état de santé qu’il est capable d’atteindre constitue l’un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. » Pourtant, Taïwan ne peut pas participer aux travaux de l’OMS ni à ceux des autres instances internationales spécialisées, ce qui ne se justifie pas.
La superficie de Taïwan est proche de celle des Pays-Bas et sa population équivalente à celle de l’Australie. L’île a un PNB légèrement supérieur à celui de la Suède ou de la Turquie.
Taïwan importe plus que la Russie, l’Australie ou le Brésil et exporte davantage que l’Espagne ou l’Inde. Les relations commerciales de Taïwan atteignent un niveau proche de celles de la Norvège, et, si l’on considère le volume d’échanges avec la France, ce pays est un partenaire plus important pour nous que la Thaïlande, le Nigéria, la Malaisie, l’Indonésie ou l’Australie.
La France a des intérêts dans cette partie du monde. Taïwan produit 84 % des semi-conducteurs les plus sophistiqués utilisés sur la planète. Comme vous le savez, mes chers collègues, notre industrie automobile en dépend.
En raison de l’importance des échanges internationaux que ces activités économiques engendrent, il est anormal que Taïwan, qui dispose de deux compagnies aériennes réputées mondialement, ne puisse pas participer aux débats concernant la sûreté aérienne, les services de navigation, la protection de l’environnement et les questions économiques.
De même, avec l’augmentation constante des passagers qui transitent par Taïwan, il est regrettable que ce pays soit exclu d’Interpol, alors que nous souhaitons accentuer nos efforts pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et toutes les formes de criminalité.
S’appuyant sur des valeurs démocratiques profondément ancrées, Taïwan a été largement saluée à travers le monde pour son excellente gestion de la crise sanitaire liée à la covid-19. À ce jour, on dénombre un petit millier de personnes infectées et on déplore seulement une dizaine de décès. Il convient de souligner que Taïwan a offert 54 millions de masques chirurgicaux et des fournitures destinées à contrer la pandémie à plus de 80 pays.
En effet, ce pays partage avec la France un attachement fondamental à la démocratie et aux valeurs universelles. Les principes démocratiques qui prévalent à Taïwan sont une source d’inspiration. À Taïwan, toute personne peut librement s’exprimer, et les journalistes ne connaissent pas la censure. Taïwan est considérée comme le pays le plus libre d’Asie, au même niveau que la France.
Les femmes ont un statut égal à celui des hommes. Non seulement c’est une femme qui a été élue à la présidence et qui dirige le pays depuis cinq ans, mais 42 % des sièges à l’Assemblée nationale taïwanaise sont occupés par des femmes.
Taïwan est tout à fait à même d’apporter une contribution efficace dans les domaines que j’ai évoqués. Encore faut-il laisser ce pays occuper la place qui lui revient dans les instances internationales.
Malgré la prospérité et la stabilité de cet État, le célèbre hebdomadaire britannique The Economist vient d’illustrer sa couverture du 1er mai 2021 en soulignant que Taïwan était l’endroit le plus dangereux de la planète en raison de la menace militaire de la Chine qui pèse sur l’île !
La paix et la prospérité de cette région sont importantes pour l’ensemble du monde. Nous devons travailler ensemble à les préserver. La question du bien-être de l’humanité est au cœur de nos préoccupations. C’est tout le sens de notre démarche aujourd’hui.
En 1965, André Malraux a dit à propos de l’établissement des relations diplomatiques avec la Chine populaire : « Marchons ensemble, mais sans mélanger nos drapeaux ! » Alors, oui, marchons, travaillons, coopérons avec la Chine, mais sans nous écarter de nos valeurs essentielles et en respectant chaque drapeau. Il convient de tous les inclure, celui de Taïwan compris, car il s’agit d’une question majeure qui concerne notre avenir commun.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDPI, SER, UC et Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je tiens à remercier nos collègues Alain Richard et Joël Guerriau de nous permettre de débattre de la situation de Taïwan.
Depuis que les forces communistes chinoises ont remporté la guerre civile et pris le contrôle du continent en 1949, ce pays essaie de préserver son autonomie.
Le développement économique de ce territoire a été et reste particulièrement remarquable. Avec un PIB comparable à celui de la Suisse ou de la Suède, Taïwan fait partie des premières puissances économiques asiatiques.
Taipei est en outre un acteur incontournable de la production mondiale des semi-conducteurs les plus avancés. Ces puces sont nécessaires aussi bien à l’industrie automobile qu’à celle du numérique ou à celle de l’armement. Ses entreprises conservent, dans ce domaine, une avance de près d’une décennie sur leurs concurrents.
Le miracle taïwanais a fait de l’île l’un des quatre dragons asiatiques et a permis à la population de bénéficier d’un niveau de vie équivalent à celui de la population de l’Union européenne.
Dans le domaine de la santé, l’île a démontré des compétences indéniables. Elle a fait face avec succès à plusieurs épidémies, dont celle de la covid-19. Alors que Taïwan compte plus de 23 millions d’habitants, le pays a su limiter les contaminations tout en préservant son économie : elle ne déplore ainsi qu’une dizaine de décès liés au coronavirus.
La communauté internationale aurait beaucoup à gagner à davantage coopérer avec ce territoire riche de savoir-faire.
La proposition de résolution que nous vous proposons de voter a pour objet d’inciter le Gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à renforcer l’intégration du pays au sein de différentes instances internationales. Cette initiative a été saluée par la Présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui a souligné la pertinence de telles coopérations. Le gouvernement français, par la voix du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a déjà eu l’occasion de témoigner de son soutien à ce texte.
Nous pensons qu’il est important que Taïwan puisse faire bénéficier la communauté internationale de ses compétences dans des matières aussi diverses que la santé, la coopération policière, le dérèglement climatique ou encore l’aviation civile.
Cette proposition de résolution est également l’occasion de réaffirmer notre attachement aux principes du multilatéralisme, du dialogue et de la coopération au sein de la communauté internationale. Ces principes sont au fondement d’une paix et d’une stabilité durables. Taïwan est en effet l’objet de vives tensions géopolitiques impliquant la Chine et les États-Unis. La région assiste depuis quelque temps à une importante montée en puissance des forces armées, et singulièrement des forces navales.
Ce climat de course aux armements laisse craindre l’éclatement d’un conflit ouvert dans les prochaines années. Un tel conflit serait bien entendu tragique pour les acteurs de la région. En outre, les effets néfastes de celui-ci s’étendraient certainement à l’ensemble de la communauté internationale.
Nous sommes convaincus que la paix et la coopération ont fortement contribué à la prospérité des pays de la zone. Il nous semble qu’il est donc dans l’intérêt de tous de veiller à les préserver.
Cette voie constitue également la suite logique des relations pacifiques qui prédominent jusqu’à présent et qu’il importe de perpétuer. Dans la mesure où cette proposition de résolution ne comporte aucune reconnaissance de l’indépendance de Taïwan, elle ne constitue pas une remise en cause de la position française.
Par ailleurs, ce texte nous semble tout à fait compatible avec la situation de Taïwan : les organisations internationales concernées acceptent en effet la participation d’entités n’ayant pas le statut d’État.
Renforcer l’intégration de Taïwan dans les instances internationales permettra de faire profiter de précieuses synergies. C’est aussi l’occasion d’éloigner un peu plus la perspective d’un conflit qui ne profiterait à personne.
Le dialogue et la coopération fourniront des réponses durables aux nombreuses tensions qui pèsent sur cette région.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants espère que ce texte recevra un large soutien de notre assemblée.
Applaudissements sur les travées des groupes INDEP, RDPI, SER, UC et Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis 1964, la France a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan en reconnaissant la République populaire de Chine. Depuis, elle ne conteste plus le principe d’une seule Chine imposé par Pékin, principe au cœur d’une politique qui a mené à l’isolement de Taïwan au sein de la communauté internationale.
En 1971, l’île perdait son siège à l’ONU. En 1980, elle était exclue du FMI. Depuis 2016, elle ne dispose plus de sa place d’observateur à l’Assemblée mondiale de la santé, en conséquence de quoi elle ne peut plus être associée aux réunions de l’Organisation mondiale de la santé.
Rien ne peut légitimer la mise à l’écart d’un système politique dont nous connaissons tous ici les mérites, tant en termes de vie démocratique que de politique sociale et éducative et de protection de l’environnement.
Le contexte pandémique actuel jette toutefois une nouvelle lumière sur l’exclusion de Taïwan des différentes instances de la communauté internationale. La gestion de la crise sanitaire par Taïwan est en effet un modèle pour bon nombre de gouvernements à l’échelon mondial. La densité de la population y est exceptionnellement élevée. Aussi peuplée que l’Australie, le risque d’une forte circulation du virus y était d’autant plus important.
Taïwan a toutefois tiré les leçons des épidémies liées au SRAS en 2003 et à la grippe H1N1 en 2009. Son gouvernement a géré cette pandémie de façon exemplaire, en exerçant un contrôle fondé sur l’anticipation et la réactivité. À cette date, seuls douze décès ont ainsi été enregistrés sur l’île.
Par ailleurs, la gestion taïwanaise de la pandémie a permis de démontrer, une fois de plus, l’inclination du pays à coopérer activement au niveau international, ce que rappellent les auteurs de cette proposition de résolution. Le pays avait ainsi alerté l’OMS dès décembre 2019 sur les risques d’une transmission humaine du virus. Début 2020, elle faisait un don de 5 millions de masques chirurgicaux à l’Europe, soit l’équivalent de la moitié des dons réalisés à l’échelon mondial, et ce à un moment crucial, c’est-à-dire quand nous en avions le plus besoin.
Nous considérons que cette attitude coopérative et pacifique, tournée vers le monde, est représentative de la volonté constante de Taïwan de participer aux organisations internationales en matière de santé, mais aussi à l’Organisation de l’aviation civile internationale, à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et à Interpol. Il nous semble évident que cette participation, qui est autorisée pour certaines entités non étatiques, serait éminemment profitable aux différentes organisations. Nous nous prononçons donc en faveur de la présente proposition de résolution.
Nous comprenons que cette perception est aussi celle qui sous-tend la position française à l’égard de Taïwan, comme l’a rappelé à plusieurs reprises le ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Nous sommes donc confiants dans l’accueil qui sera réservé à cette proposition de résolution et dans les démarches que la France poursuivra en ce sens, en amont de la soixante-quatorzième réunion de l’Assemblée mondiale de la santé qui se déroulera à partir du 24 mai. Nous resterons bien entendu vigilants sur ce point.
Toutefois, nous sommes tous conscients ici que ce sujet ne peut être débattu sans que nous abordions la question de l’attitude française vis-à-vis de la Chine et sans que nous nous interrogions sur la manière dont nous souhaitons la voir évoluer.
Le soutien français à l’association de Taïwan aux instances internationales, bien qu’il n’ait pas pour objectif de reconnaître un statut d’État à ce pays ou de remettre en cause le principe d’une seule Chine, ne sera pas sans conséquences sur nos relations avec Pékin, comme l’atteste la récente réaction de l’ambassade de Chine à un projet de voyage de sénateurs français à Taïwan.
Aujourd’hui, pourtant, l’objectif de préserver à tout prix une entente avec un régime qui, selon les termes employés par notre ministre des affaires étrangères fin février, exerce un « système de répression institutionnalisé » sur le peuple ouïghour, ne peut plus être défendu.
Alors, pour sauvegarder l’approche multilatérale et les valeurs démocratiques et humaines qui sont au fondement de notre politique étrangère, quel poids devons-nous accorder aux exigences de Pékin ?
Aujourd’hui, le refus de transiger sur nos propres exigences n’est plus une proposition idéaliste, mais une nécessité reconnue comme telle par l’Union européenne qui, après de premières sanctions, a annoncé avant-hier la suspension de la ratification de l’accord d’investissement avec la Chine.
C’est aussi un devoir pour la France, aux côtés d’une administration Biden qui fait preuve de fermeté à l’égard de la Chine et de la Russie, de replacer les droits humains et les valeurs démocratiques au cœur de son action diplomatique.
Après une présidence Trump tendue et conflictuelle, la responsabilité de notre pays est de s’associer à cette entreprise de reconstruction d’une culture démocratique internationale.
Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutiendra cette proposition de résolution.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI, INDEP et UC.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, tout d’abord, je tiens à remercier chaleureusement les présidents des différents groupes politiques du Sénat d’avoir facilité l’inscription de ce texte à l’ordre du jour de notre assemblée dans des délais très brefs. Ils témoignent ainsi de tout l’intérêt porté de longue date par notre assemblée à ce lointain territoire insulaire.
Située à quelque cent trente kilomètres des côtes chinoises, l’île de Taïwan est un carrefour stratégique qui entretient, depuis plusieurs siècles, des liens d’importance avec l’Europe et la France. C’est au nom de ces liens étroits que notre assemblée a, au milieu des années 1980, autorisé la création d’un groupe d’échanges et d’études entre le Sénat et Taïwan, groupe qui n’a cessé depuis d’être particulièrement actif. C’est d’ailleurs sur l’initiative de ce groupe que la proposition de résolution à l’étude aujourd’hui a été déposée par vingt-deux de nos collègues, issus de la plupart des familles politiques.
Au printemps de l’an passé, lors du confinement strict qu’a connu notre pays, nous étions déjà cinquante et un sénateurs à signer un appel international demandant à l’Organisation mondiale de la santé de collaborer pleinement avec Taïwan, une manière de reconnaître l’exceptionnelle maîtrise dont ce territoire a fait preuve face à la pandémie de covid-19. En un an et demi, cette île peuplée de plus de 23 millions d’habitants n’a en effet enregistré qu’une dizaine de décès liés à ce terrible virus, un exploit obtenu grâce à des mesures sanitaires rigoureuses et une expertise hors pair. Durement affectée par la crise du SRAS en 2003, Taïwan était certainement le pays le mieux préparé pour affronter cette nouvelle pandémie.
C’est en des termes parfaitement respectueux des équilibres diplomatiques que cette proposition de résolution vise à accorder à Taïwan un statut d’observateur au sein de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra prochainement. En effet, il n’y a là rien qui déroge au règlement de l’OMS, puisque Taïwan jouissait déjà d’un tel statut avant 2016.
Nous sommes persuadés que la communauté internationale ne peut que tirer avantage d’une telle efficience, car l’excellence sanitaire de Taïwan ne concerne pas seulement la lutte contre le covid-19, tant s’en faut. Pour la troisième année consécutive, Taïwan occupe le premier rang mondial selon l’indice des soins de santé publié par le site numbeo.com.
De nombreux pays, dont la France, ainsi que 1 700 parlementaires de plus de 80 pays se sont déjà exprimés en faveur d’une telle coopération avec les autorités de Taïwan.
C’est avec le même respect des cadres institutionnels internationaux que les auteurs de la proposition de résolution appellent à la participation de Taïwan aux travaux de l’Assemblée mondiale de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), instance placée sous l’égide des Nations unies. Taïwan en a été l’un des membres fondateurs de 1944 à 1971.
Là encore, il est possible de lui accorder un statut d’invité spécial puisque, en 2013, Taïwan a été autorisée à participer à la trente-huitième Assemblée de l’OACI. Ce n’est pas accessoire, car l’aéroport de Taoyuan à Taïwan se place au dixième rang mondial pour le trafic de passagers et au sixième rang pour le fret.
Pourtant, Taïwan demeure exclu des débats sur les questions de sûreté aérienne, de protection de l’environnement et les questions économiques. Or, parce qu’on lui refuse tout accès en temps réel aux informations globales et aux actualisations régulières de l’OACI, Taïwan met plus de temps que les autres pour se conformer aux standards et aux recommandations de l’Organisation.
Toujours dans le but de renforcer la coopération internationale, les auteurs de la proposition de résolution suggèrent de donner à Taïwan un statut observateur au sein d’Interpol, organisation qui compte 194 pays membres, soit la quasi-totalité des États de la planète, et qui vise à prévenir et à combattre la criminalité grâce à une coopération policière renforcée.
Taïwan accueille chaque année un nombre croissant de voyageurs : le pays est la trente-sixième destination la plus prisée au monde. Il s’agit en outre de la vingt et unième économie de la planète et du dix-huitième exportateur mondial. L’île est donc un maillon indispensable du système de sécurité globale, tant pour le combat contre la criminalité et la fraude internationales que pour la lutte contre les trafics illicites et la cybercriminalité. Pourtant, Taïwan n’a toujours pas accès au réseau mondial permanent de communication policière d’Interpol ni à ses dix-huit bases de données criminelles. C’est là un trou de taille dans la raquette sécuritaire internationale qu’il est urgent de combler.
Enfin, les auteurs du texte suggèrent que Taïwan puisse également participer aux travaux de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques.
Depuis 2015, Taïwan s’est fixé des objectifs ambitieux en matière de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre. Le pays investit beaucoup dans le secteur des technologies vertes et soutient activement les actions en faveur de la transition écologique, en particulier dans les pays en voie de développement. La participation de Taïwan aux prochaines sessions de la Conférence des parties serait, à n’en pas douter, bénéfique à tous.
Mes chers collègues, c’est parce que ses auteurs incitent à élargir le champ actuellement trop restreint des relations entre Taïwan et le reste de la communauté internationale que cette proposition de résolution s’inscrit pleinement dans la continuité d’un renforcement impérieux de la coopération internationale au service du bien-être de toutes les populations. C’est la raison pour laquelle l’intégralité des membres du groupe RDPI votera en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées des groupes SER et Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nos collègues auteurs de la proposition de résolution souhaiteraient voir relancées les démarches visant à faire participer Taïwan à de nombreuses organisations internationales. Comment ne pas souscrire à cet objectif ?
Oui, nous avons besoin de Taïwan à l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS, eu égard à sa gestion exemplaire de la pandémie de covid-19.
Oui, nous avons besoin d’intégrer le plus grand nombre possible de pays à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. La lutte contre le réchauffement climatique est un défi mondial qui doit agréger toutes les démarches volontaires. Comme vous le savez, bien que l’île n’ait pas de représentation légale dans le système onusien, elle s’est unilatéralement engagée à respecter les termes du protocole de Kyoto, ainsi que ceux de la COP21, avec une définition d’objectifs très ambitieuse. Il faut le saluer.
Ne faudrait-il pas également associer Taïwan à l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale, au bénéfice général de la sécurité et du fret ? Elle occupe une position clé dans la région de l’Asie-Pacifique et contrôle un trafic important avec plus de 1 750 000 vols répertoriés en 2018, partis de dix-sept aéroports taïwanais.
Enfin, l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol, ne doit souffrir d’aucune brèche. Comme souligné dans le texte de nos collègues, associer Taïwan à la lutte contre la criminalité organisée serait profitable à l’ensemble de la communauté internationale, grâce au partage des dix-huit bases de données policières que gère Interpol.
D’une façon générale, il est évident qu’il faut rassembler le plus largement au sein des grands outils de coopération internationale. On connaît les vertus du multilatéralisme : il fait progresser de grandes causes comme celles que je viens de décliner. Mais pas seulement ! Il fédère des pays autour d’objectifs communs : c’est aussi construire un monde de dialogue et d’échanges plus propice à la paix que les postures d’isolement.
Toutefois, soyons clairs, dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, il nous faut trouver un équilibre pour préserver les relations de notre pays avec les deux côtés du détroit de Formose. Nous connaissons l’enjeu géopolitique régissant les relations complexes et passionnelles entre Taïwan et la Chine.
Taïwan a un statut particulier. Elle est cependant un interlocuteur fiable pour l’Occident et un acteur économique de premier plan. Je rappellerai juste que son économie est classée au vingt-deuxième rang mondial. Pour la France, Taïwan a représenté un marché à l’exportation de 1, 8 milliard d’euros en 2019. Nous lui vendons des biens d’équipement, mais aussi de l’agroalimentaire, bien que Taipei impose à nos viticulteurs de regrettables et lourdes taxes sur le champagne – je tenais à le signaler !
De l’autre côté, mes chers collègues, il n’est pas besoin de démontrer que la Chine est un partenaire économique incontournable à l’échelle mondiale. Le Gouvernement l’a rappelé ici même en mars dernier.
Ce constat invite donc au compromis sans pour autant laisser tout passer. C’est ce que l’Union européenne a fait, le 22 mars dernier, en décidant de sanctions contre la Chine sur le dossier ouïghour, alors même que nous discutons de l’accord d’investissement.
Comme je l’ai dit, la diplomatie est l’art de l’équilibre ; c’est aussi celui de la désescalade. Dans ces conditions, il me semble – autant que faire se peut – que nous devrions trouver un juste milieu en activant les dispositions qui permettent d’associer Taïwan, en tant qu’entité, aux grandes organisations sans pour autant engendrer de provocations.
Mes chers collègues, à ce stade, le groupe du RDSE estime qu’il faut encore laisser du temps à la diplomatie et aux discussions. Un temps nécessairement plus long que celui du Parlement. C’est pourquoi nous ne prendrons pas part au vote.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cette proposition de résolution nous invite à soutenir la décision du Gouvernement d’appuyer le retour de Taïwan au sein de l’Organisation mondiale de la santé, son entrée à l’Organisation de l’aviation civile internationale, ainsi que dans la Convention des Nations unies contre la corruption et Interpol, dans un contexte de pressions internationales importantes de quelques pays.
L’île, qui, pour rappel, a joui du statut de membre observateur de l’OMS de 2009 à 2016, n’a plus été invitée par l’organisation onusienne depuis l’élection à sa tête de l’indépendantiste Tsai Ing-wen. Le problème qui semblerait se poser aujourd’hui est de savoir sous quelle forme se ferait le retour de Taïwan… En tant que région rattachée à la Chine ou en tant que pays souverain ? Sans même s’interroger sur les revendications territoriales de l’île ?
En 1964, la France avait su se distinguer des autres pays occidentaux en reconnaissant diplomatiquement la République populaire de Chine et en entretenant des relations privilégiées avec Pékin. C’était sept ans avant que l’Organisation des Nations unies ne reconnaisse la République populaire de Chine et lui réserve le siège au Conseil de sécurité occupé depuis 1950 par Taïwan. Des relations parfois difficiles, certes, mais tout de même suffisamment suivies pour que Paris fasse office d’interlocuteur exigeant et respecté.
Il convient de rappeler la participation de Taïwan sous la dénomination « Taipei-Chine » à de grands événements internationaux comme les jeux Olympiques et Paralympiques ou à des instances multilatérales comme l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, le GATT, ou la Banque asiatique de développement.
Il existe donc un espace politique de dialogue et de discussion avec Pékin, et non contre elle, qui doit être approfondi.
Il est vrai que Taïwan, de fait, existe et dispose d’un organe législatif, exécutif et administratif. De plus, le renouvellement des générations renforce la distance prise avec Pékin. En effet, 85, 6 % des Taïwanais sont nés après la séparation de l’île et du continent.
Cependant, je me permets de rappeler que, sur cette île, la Constitution de la République de Chine est toujours applicable et intègre dans son territoire la Chine continentale et des territoires russes, indiens ou encore mongols.
Le contexte de confrontation déclenchée par Donald Trump est stratégique, politique et commercial. Ce contexte n’est d’ailleurs pas étranger au regain des mobilisations sur Taïwan, à l’enjeu de la rivalité stratégique.
Toutefois, nous ne pouvons pas omettre non plus que la situation actuelle laisse craindre une escalade pékinoise qui pourrait aboutir à un conflit. Que gagnera la France à s’impliquer dans cette stratégie de confrontation ? La réponse occidentale doit-elle être de mettre de l’huile sur le feu ou d’apaiser la situation ?
Cette proposition de résolution, malheureusement, s’inscrit par ailleurs dans un alignement inquiétant de la France dans la roue des États-Unis. Son siège au Conseil de sécurité de l’ONU mais aussi son histoire avec Pékin lui donnent pourtant la responsabilité de se placer en conciliatrice. Les exemples du GATT ou du Comité international olympique montrent qu’un espace existe, d’autant plus que l’île et le continent sont particulièrement dépendants.
L’adoption d’une telle proposition de résolution serait-elle de nature à aplanir les tensions ou, au contraire, à les exacerber jusqu’à un point de non-retour ?
Au vu des réactions officielles de Pékin, on peut craindre une rupture franco-chinoise, qui à bien des égards nuirait à Paris.

Soutenir cette proposition de résolution serait s’inscrire dans l’agenda stratégique porté par les États-Unis et sortirait la France de sa position de neutralité dans le dossier. C’est pourquoi notre groupe s’abstiendra. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.)
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, mes chers collègues, le 1er janvier 2020, à Wuhan, en Chine, le docteur Li Wenliang de l’hôpital central était incarcéré avec sept de ses collègues. Deux jours plus tôt, il avait lancé l’alerte sur le fait que sept personnes travaillant sur le marché aux animaux de la ville avaient contracté un virus proche du SRAS. Le docteur Li Wenliang a été contraint de reconnaître qu’il perturbait l’ordre social. Le 7 février 2020, il comptera parmi les premiers morts du covid.
Fort de son expérience du SRAS en 2003, Taïwan a su anticiper l’épidémie.
Dès le 31 décembre 2019, elle alertait l’OMS sur la possibilité d’une transmission interhumaine du virus apparu à Wuhan. Elle n’a pas été entendue.
Il faudra attendre le 20 janvier 2020 pour que Pékin se résigne à reconnaître que le virus était transmissible entre humains, date à laquelle l’OMS a qualifié la situation « d’urgence de santé publique de portée internationale ».
Nous savons aujourd’hui que ces trois semaines perdues en janvier ont eu des conséquences tragiques pour la planète.
La mise à l’écart de Taïwan des réflexions et actions conduites par l’OMS nuit aux intérêts de la communauté internationale. C’est précisément ce qui apparaît dans l’exposé des motifs de la proposition de résolution que nous présentent aujourd’hui nos collègues Alain Richard et Joël Guerriau, que je remercie chaleureusement.
Le 20 février 2020, je déposais une question écrite interrogeant notre gouvernement sur les initiatives qu’il pourrait prendre afin d’intégrer Taïwan dans les discussions internationales sur le nouveau coronavirus. Des milliers de Français vivent à Taïwan ; je voulais éviter que ces compatriotes se retrouvent en dehors de la protection de l’OMS.
Ce 20 février, le monde dénombrait alors 2 012 morts du covid, dont 2 008 en Chine, un à Hong Kong, un à Taïwan et un en France. Un mois plus tard, le 31 mars 2020, avec quatre-vingt-quatre parlementaires, nous cosignions une tribune appelant à l’intégration de Taïwan au sein de l’OMS, sur l’initiative de notre collègue André Gattolin.
L’épidémie s’est répandue sur la planète, rebondit avec ses variants – britannique, brésilien, maintenant indien. Les ravages se poursuivent.
Le 20 février 2020, Taïwan comptait vingt-trois cas de covid et, je vous l’ai dit, un seul décès. À ce jour, l’île totalise 1 121 cas confirmés et seulement douze décès, pour 23 millions d’habitants.
Taïwan est le territoire qui compte le moins de cas et de décès recensés dans le monde.
Dès l’origine de l’épidémie, l’industrie taïwanaise a produit 13 millions de masques par jour. Résultat : pas de confinement et une vie sociale, scolaire et économique qui se poursuit normalement, mais sous précautions.
En juin 2020, en réponse à ma question écrite posée quatre mois plus tôt, Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, m’indiquait qu’il souhaitait que Taïwan puisse être associée aux travaux de l’Organisation mondiale de la santé afin d’éviter de créer un vide sanitaire. Force est de constater que, depuis, rien n’a changé. Taïwan ne sera même pas conviée en tant que membre observateur de la prochaine assemblée générale de l’OMS et se trouve au ban de nombreuses organisations internationales.
Voilà pourquoi il nous est apparu, au sein du groupe d’échanges et d’études avec Taïwan, présidé par notre collègue Alain Richard, que l’heure était venue de déposer une proposition de résolution en faveur de l’association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales. En effet, l’île est également exclue d’Interpol, ce qui crée des brèches considérables à l’heure où elle fait partie intégrante de la mondialisation et joue un rôle majeur dans la lutte contre les criminalités transnationales.
Taïwan n’est également plus en mesure de participer à l’OACI, alors qu’elle en a été membre fondateur et qu’elle occupe une position clé pour le transport et le contrôle aériens en mer de Chine.
En matière d’environnement, enfin, Taïwan ne peut pas participer aux réunions de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, et ce bien que la société taïwanaise soit à la pointe de la lutte contre le réchauffement climatique.
Tous ceux qui nous écoutent doivent s’interroger : pourquoi Taïwan ne fait naturellement pas partie de l’OMS, d’Interpol, de l’OACI et de tant d’autres instances de coopération internationale ? Comment en sommes-nous arrivés là ? La réponse se trouve de l’autre côté du détroit : la dictature du parti communiste chinois n’aime pas le régime démocratique en place à Taïwan.
Malgré l’animosité entretenue par le régime communiste de Pékin, la société taïwanaise s’est émancipée dans le progrès, la liberté d’expression et les valeurs démocratiques occidentales. L’évolution de la société taïwanaise, affranchie et connectée, avec un pouvoir d’achat équivalent aux régions les plus développées du monde, ne peut être compatible avec les pratiques du régime totalitaire chinois, dont le « système de répression institutionnalisé » à l’encontre des musulmans ouïghours dans la région du Xinjiang révolte le monde.
Comme nous, les Taïwanais observent avec effroi l’emprise du régime de Pékin sur tout le peuple chinois : un contrôle de masse, un contrôle de chaque instant que les nouvelles technologies permettent de perfectionner à l’infini, au point de vous retirer toute intimité.
Le pourcentage d’individus se définissant comme taïwanais est passé de 17, 6 % en 1992 à 67 % en 2020, avec une progression de 10 % l’an passé.
En octobre 1989, à l’occasion d’une visite en RDA, Mikhaïl Gorbatchev déclarait à son homologue est-allemand, ardent opposant aux réformes, « celui qui est en retard sur l’histoire est puni par la vie ». Quelques semaines plus tard, le mur de Berlin tombait. En clamant que Taïwan est une province intégrante de son pays, Xi Jinping est en retard sur l’histoire !
Taïwan, c’est un quart du PIB de la France. Avec 110 postes diplomatiques répartis dans 75 pays, c’est le trente et unième réseau diplomatique mondial, devançant des pays comme la Suède ou Israël. C’est la vingtième armée du monde, à niveau équivalent du Canada.
L’île est souveraine. Taïwan est indépendante de fait.
Certains diplomates soucieux de plaire à Pékin disent : « Moins on parlera de Taïwan, mieux cela vaudra. » Je pense tout le contraire. En effet, si, comme l’a indiqué mon collègue Joël Guerriau, la menace d’invasion militaire de la Chine fait titrer cette semaine à The Economist que c’est le lieu le plus dangereux de la Terre, il apparaît que l’île de Taïwan devient plus importante pour l’équilibre du monde que ne l’était Berlin-Ouest pendant la guerre froide.

Dix-huitième puissance commerciale et onzième économie la plus libre du monde, Taïwan agit conformément aux conventions des Nations unies sur les droits de l’homme. En matière de démocratie, elle en a fait autant que n’importe quel autre pays pour faire avancer l’égalité.
L’ONU a été créée pour les êtres humains. Je vous le demande, mes chers collègues, pourquoi l’universalité des droits de l’homme proclamée par les Nations unies ne s’appliquerait pas à Taïwan et à ses 23 millions d’habitants ?
« Unissons-nous dans une pensée commune, et répétez avec moi ce cri : Vive la liberté universelle ! », lançait Victor Hugo. En débattant de cette proposition de résolution, au moment où, à Londres, le G7 déclare dans un communiqué son soutien affirmé à la participation de Taïwan aux organisations internationales comme l’OMS, nous envoyons un signal fort à nos alliés, à tous les peuples libres du monde. Ensemble, ils doivent s’unir pour réintégrer Taïwan dans nos organisations internationales. C’est pourquoi je voterai cette proposition de résolution avec fierté, comme tous les membres du groupe Union Centriste.
Mes chers collègues, le jour où la Chine s’éveillera à la démocratie, la Chine sera Taïwan !
Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDPI et INDEP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’inquiétude va grandissante quant à la manière dont la diplomatie chinoise développe son influence dans le système onusien, notamment au détriment de Taïwan. La proposition de résolution qui nous est soumise cet après-midi est donc la bienvenue.
Je souhaite profiter de ce débat pour élargir mon propos à la problématique de Taïwan sur la scène internationale.
Après de longues années de bienveillance au nom d’un prétendu « partenariat stratégique », la diplomatie européenne commence à ouvrir les yeux sur la réalité chinoise. La crise du covid, bien sûr, mais aussi la répression de Hong Kong et des Ouïghours ont accéléré ce réveil de l’Europe. Alors qu’elle était restée jusqu’alors très mesurée dans ses réponses aux provocations chinoises, elle commence enfin à hausser le ton. Sa nouvelle stratégie sur la zone indopacifique et ses nouveaux projets de coopération avec l’Inde et l’Australie vont dans le bon sens, celui d’une lucidité sur la réalité chinoise. Je salue donc à mon tour la suspension par la Commission européenne, voilà deux jours, des négociations en cours sur l’accord d’investissement global entre l’Union européenne et la Chine.
Alors que la Chine remet en cause les intérêts économiques européens et qu’elle n’hésite pas à poursuivre son travail de proximité avec certains pays d’Europe centrale et orientale pour essayer de les détacher de la solidarité européenne, la prudence concernant Taïwan n’est plus de mise.
Aujourd’hui, Pékin s’éloigne manifestement d’une résolution pacifique, et le Président Xi se montre de plus en plus menaçant. À cet égard, l’omission des termes « réunification pacifique » dans le discours de mai 2020 du Premier ministre chinois à l’Assemblée nationale populaire ne fut pas accidentelle.
Outre ses déclarations agressives, la Chine multiplie les manœuvres militaires, maritimes notamment, et l’armée chinoise pratique l’escalade, aussi bien par l’ampleur et la fréquence de ses manœuvres qu’en termes d’incursion spatiale en mer de Chine méridionale. Cela ne signifie pas que la guerre sera déclenchée demain, mais une chose est sûre : la Chine se comporte comme si elle s’y préparait.
La puissance navale chinoise augmente, celle des États-Unis diminue. C’est la première fois depuis la chute de l’Union soviétique qu’une grande puissance est en mesure de rivaliser avec l’US Navy. Certes, les États-Unis ont commencé à réagir avec un plan de réarmement naval massif, mais, dans les simulations opérationnelles, ils semblent avoir de plus en plus de mal à pouvoir s’opposer militairement à une opération chinoise contre Taïwan.
De façon plus générale, et avec tous ses défauts, l’horrible Donald Trump a eu au moins un mérite : il a ouvert les yeux de l’Amérique, et les nôtres aussi, sur la réalité de la menace chinoise, menace économique et commerciale, bien sûr, mais aussi diplomatique et de plus en plus militaire.
Je reprendrai le parallèle de notre collègue Cadic, en comparant Taïwan des années 2000 à Berlin des années 1950. Pendant la guerre froide, Berlin avait une signification symbolique forte, mais ce n’était qu’un symbole ; en plus de sa portée symbolique, Taïwan a une véritable valeur économique et stratégique.
L’Europe doit donc modifier sa politique en exigeant que les relations entre les deux rives de la mer de Chine respectent le droit à l’existence de Taïwan. Nous devons clairement signifier à la Chine qu’elle encourrait de graves risques si elle s’orientait vers le recours à la force.
Face à la Chine, mes chers collègues, la naïveté n’est donc plus permise, et, nous le savons tous, la pusillanimité ne mène à rien, sauf à l’impuissance.
Soyons lucides : la Chine est un régime fort, qui ne respecte que la force et qui ne croit qu’aux rapports de force. Face à de tels régimes, on sait d’expérience, hélas, où conduit l’esprit munichois. Quand on croit éviter la guerre au prix du déshonneur, on finit toujours par avoir et la guerre et le déshonneur.
M. André Gattolin applaudit.

Alors, certes, personne ne veut la guerre avec la Chine, mais, si nous voulons sauver l’honneur, il faut soutenir Taïwan. C’est pourquoi nous devons soutenir la participation de Taïwan – démocratie exemplaire – à toutes les organisations multilatérales et voter la proposition de résolution qui nous est soumise.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI, INDEP, UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis que cette proposition de résolution sur Taïwan ait été inscrite à l’ordre du jour de notre assemblée. Je m’en réjouis d’autant plus que j’avais déposé une question écrite sur cette thématique en janvier 2020. C’était, autant que je le sache, la toute première question sur le sujet, plusieurs autres ayant été déposées ensuite sur le même thème par mes collègues de l’Assemblée nationale et du Sénat, dont certains se sont exprimés précédemment.
Outre une demande d’état des lieux sur les excellentes relations bilatérales entre nos deux pays, je m’interrogeais sur le bien-fondé de l’isolement imposé à Taïwan depuis la résolution 2758 de 1971, alors même que Taïwan, sous la direction de la Présidente Tsai Ing-wen, est un modèle de démocratie, applique à la lettre les recommandations de l’ONU, a un comportement et un bilan exemplaires – notamment en matière de protection de l’environnement, d’énergie verte, de soins médicaux, d’éducation, de lutte contre la pauvreté –, un PIB équivalent à celui de la France ou du Japon et un taux d’alphabétisation de 98, 7 %. J’y indiquais également qu’à l’heure de l’apparition en Chine de virus rappelant le SRAS de 2003 – ma question, j’y insiste, a été publiée en janvier 2020 –, une participation de Taïwan à l’OMS, ne serait-ce qu’avec un simple statut d’observateur, pouvait s’avérer très utile pour aider à juguler les risques d’épidémie.
Le jour même où je déposais ma question au Sénat, ce 20 janvier 2020, l’OMS se décidait enfin à qualifier l’épidémie de covid d’« urgence de santé publique de portée internationale ».
Seize mois plus tard, au regard des douze décès dus au covid-19 à Taïwan depuis le début de la pandémie, sur une population de près de 24 millions d’habitants, on ne peut que déplorer que la voix de Taïwan, voix de l’expérience, de la science et de la sagesse n’ait pas été entendue. Rappelons aussi que Taïwan a été exemplaire pendant toute cette pandémie et a fait don, avec beaucoup de générosité, de matériel médical et de masques. On l’a déjà souligné, ce sont 54 millions de masques qui ont été donnés à 80 pays, quand nous subissions une pénurie, notamment en Europe.
Aujourd’hui même, un laboratoire taïwanais a annoncé avoir mis au point un vaccin contre l’entérovirus 71, efficace notamment chez les enfants de moins de six ans et qui pourrait être extrêmement utile à toute l’Asie. De même, le transfert de technologie et le partage d’expérience en recherche et développement – je pense notamment aux tests rapides de diagnostic de covid-19 avec résultat en quinze minutes – pourraient nous être bénéfiques à tous.
Mais cette année encore, Taïwan ne sera pas représentée au sein de l’Assemblée mondiale de la santé qui se tiendra à la fin de ce mois à Genève. Ce n’est pas tolérable, d’autant moins que Taïwan avait été acceptée comme observateur à l’OMS de 2009 à 2016 et que refuser la participation de Taïwan à cette organisation, au regard des 150 millions de cas de covid aujourd’hui dans le monde et des 3, 5 millions de morts, serait criminel.
Si la France a toujours tenu une même position d’ouverture, le ministre Le Drian me répondant en 2020, ainsi qu’à tous ceux qui avaient posé les mêmes questions par la suite, que la France était favorable à la participation de Taïwan aux organisations internationales quand cette participation répondait aux intérêts de la communauté internationale – c’est le cas pour l’OMS –, la voix de la France est restée quelque peu isolée. Il est donc de notre devoir, bien sûr, d’appuyer cette démarche.
Aujourd’hui, la situation commence à évoluer. Ainsi, le G7 réuni à Londres a annoncé, hier, dans sa déclaration des ministres des affaires étrangères et du développement, son souhait que Taïwan puisse participer de manière significative au Forum de l’OMS et de l’Assemblée mondiale de la santé, car « la communauté internationale doit pouvoir bénéficier de l’expérience de l’ensemble des partenaires, y compris la contribution réussie de Taïwan dans la lutte contre la pandémie de covid-19 ». Votre portefeuille comprenant la francophonie, monsieur le secrétaire d’État, cher Jean-Baptiste Lemoyne, permettez-moi au passage de vous suggérer de faire en sorte que cette déclaration figure en français sur le compte Twitter du ministère des affaires étrangères – on ne la trouve pratiquement qu’en anglais !
Le problème reste évidemment l’opposition de la Chine et sa réaction, qui, suite à ce communiqué, ne s’est pas fait attendre. En effet, comme nous le savons tous, elle veut, en invoquant un principe de souveraineté nationale, contraindre Taïwan à un isolement diplomatique et multiplie les déclarations agressives, voire les menaces. Certains nous ont même conseillé d’être prudents pour éviter les foudres du pays et de son représentant à Paris, qui ne s’est pas privé, dans un passé récent, d’abreuver d’insultes les parlementaires français. Nous ne pouvons pas et nous ne devons pas nous laisser intimider.
Je sais combien nos intérêts, notamment économiques, avec ce grand pays qu’est la Chine sont imbriqués, combien nos liens sont forts. J’aime, je respecte la Chine et son peuple. La Chine continentale est un partenaire extrêmement important, comme l’est d’ailleurs Taïwan. La diplomatie est l’art de la prudence, du compromis et des tout petits pas. Nous ne saurions attendre de la France qu’elle avance seule contre ses propres intérêts économiques. Il serait trop facile d’agiter les bras pour faire des effets à cette tribune, et je m’en garderai.
Pour autant, je pense vraiment que ce serait tout à l’honneur de ce grand pays qu’est la Chine et de ce grand peuple de 1, 4 milliard d’habitants de faire preuve de magnanimité et de respecter les plus petits que lui. Je pense à Hong Kong ; je pense bien sûr à Taïwan, et ses 24 millions d’habitants, qui n’aspire qu’à vivre en paix et en bonne intelligence avec son grand voisin.
Les avancées et les richesses de Taïwan, avec un PIB en prévision de croissance de 4, 6 % pour 2021 – près de 8, 2 % de plus au premier trimestre par rapport à l’année dernière –, ses innovations technologiques et sa politique industrielle dynamique peuvent susciter envies, appétits, voire craintes chez ceux qui ne partagent pas notre vision de la démocratie et des droits de l’homme.
Cette semaine, cela a déjà été dit, The Economist titrait en couverture : « Taïwan, l’endroit le plus dangereux du monde. » Oui, les bruits de bottes se font entendre de plus en plus fortement ; oui, la Chine se réarme. Mais je crois profondément que l’honneur d’un parlementaire, c’est aussi de savoir faire preuve de courage et d’affirmer haut et fort ses convictions.
Alors, oui, madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux le dire haut et fort : c’est notre devoir d’aider Taïwan à retrouver la place que ce pays mérite sur la scène internationale.
L’équilibre géopolitique mondial implique que nous soutenions Taïwan, car, pour que nous puissions atteindre une paix, même relative, sur notre planète, pour que nous puissions travailler enfin à l’amélioration du climat, de la sécurité, des conditions de vie des citoyens du monde dans leur ensemble, nous devons développer notre coopération internationale et, surtout, nous devons inclure tous les acteurs dans les organisations internationales.
Pour nous, parlementaires, c’est aussi une question de courage.
Alors, oui, mes chers collègues, ayons le courage d’aller de l’avant, ayons le courage de ne pas nous laisser intimider par les gesticulations et les invectives, ayons le courage de dire ce que nous pensons être juste.
Renforcer nos partenariats en matière sanitaire et médicale est indispensable, mais Taïwan doit aussi avoir le droit de participer à toutes les organisations internationales où son expertise pourrait être utile. Je pense notamment à Interpol, à l’Organisation internationale de l’aviation civile, au débat sur le climat.
Je voudrais aussi dire à tous ceux qui, ici ou ailleurs, auraient la tentation de Munich qu’on ne respecte jamais un adversaire qui s’aplatit, mais que l’on craint et respecte celui qui, même s’il sait qu’il ne gagnera pas, a le courage de se battre pour ses convictions lorsqu’il les sait justes.
Je souhaiterais aussi m’adresser à mes amis chinois, parce que, nous le savons, ils nous écoutent ou ils nous liront.
Mais de quoi avez-vous peur ? Vous êtes un grand, vous êtes un magnifique pays, vous n’avez rien à craindre de Taïwan, qui ne veut que la paix ! Vous avez tout à gagner, au contraire, d’une coopération pacifique dans l’intérêt de vos peuples. Alors, s’il vous plaît, aidez Taïwan à vous aider, aidez-nous à vous aider, aidez-les à vous aider, ne serait-ce qu’en matière médicale ! Parlez-leur, écoutez-les, et le monde n’en sera que meilleur : il sera plus sûr, plus stable. Et c’est aussi votre intérêt, c’est l’intérêt de la Chine dans son ensemble.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC, RDPI et INDEP.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, étant la dernière intervenante, je crains que mon propos ne soit pas très original et reprenne de nombreux points déjà soulevés. Voyez-y finalement, monsieur le secrétaire d’État, la convergence de nos points de vue et l’expression d’un certain consensus qui règne sur ces travées.
La démocratie taïwanaise se construit à l’ombre de la Chine. Situé à moins de 200 kilomètres des côtes chinoises, ce territoire de près de 24 millions d’habitants dispose de son propre drapeau, de son hymne, de sa langue, de ses institutions judiciaires et de son Parlement, mais n’est reconnu que par seize pays et connaît un isolement diplomatique croissant. Pourtant, sa Présidente promeut une démocratie transparente que notre groupe sénatorial d’échanges et d’études a pu observer lors de sa visite en décembre 2019. Il est donc temps, deux ans plus tard, qu’une nouvelle délégation sénatoriale s’y déplace, d’autant que Taïwan représente un modèle d’acteur responsable dans de nombreux domaines, par exemple la lutte contre le changement climatique, comme le montre son adhésion aux principes fixés par la COP21.
Les progrès scientifiques de Taïwan en matière de technologies vertes sont remarquables et méritent d’être reconnus, tout comme son centre national des technologies et des sciences pour la prévention des sinistres, que nous avons visité.
Taïwan est un partenaire solide dans les domaines économique et de sécurité, et les plus de 2 300 Français qui y vivent dynamisent nos relations commerciales et nos actions de coopération.
Enfin, la loi sur le mariage pour tous, votée en mai 2019, ou la « révolution des tournesols », menée en 2014 par les jeunes étudiants du numérique contre l’ingérence chinoise, sont des marqueurs d’une démocratie bien vivante.
Son succès réside également dans sa gestion de l’épidémie de la covid-19. Taïwan, cela a été rappelé, a été le premier pays à prévenir l’Organisation mondiale de la santé des dangers d’une contamination humaine, alors même que ce pays reste exclu de cette organisation.
Dans sa réponse à mon courrier du 18 mars 2020, le ministre Le Drian précisait que la France soutenait la participation de Taïwan aux travaux de l’OMS et de l’Assemblée mondiale de la santé, une reconnaissance de fait de sa maîtrise exceptionnelle de la crise sanitaire. En effet, sa gestion épidémique est un modèle pour le monde entier. Le système de traçage a été consenti par la population sans obligation étatique. Cette responsabilisation collective alliée à la présence de masques chirurgicaux, à des quatorzaines ciblées et à un système de santé performant a permis de maîtriser très vite la diffusion du virus. Le pays n’a pas eu recours à un seul confinement ni couvre-feu et n’a pas mis son économie à l’arrêt.
Cette efficacité a aussi été rendue possible grâce à la transparence et à la confiante participation de la population dans sa gestion de la crise. Un exemple dont nous pourrions d’ailleurs utilement nous inspirer…
Mes chers collègues, vous l’aurez compris, le partage de son expérience et sa contribution ne peuvent qu’être bénéfiques à la communauté internationale dans tous les domaines cités par les auteurs de cette proposition de résolution, Alain Richard et Joël Guerriau. Comme l’a annoncé mon collègue André Vallini, tous les membres de notre groupe voteront cette proposition de résolution, pour que la France apporte un soutien clair à l’intégration de Taïwan au sein des instances internationales.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, RDPI, INDEP et UC. – Mme Joëlle Garriaud-Maylam applaudit également.

Madame la présidente, monsieur le président Richard, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, nous voici réunis autour de cette proposition de résolution en faveur de l’association de Taïwan aux travaux de plusieurs organisations internationales, présentée par Alain Richard, Joël Guerriau et nombre d’entre vous ici présents, que je ne saurais tous citer. C’est un moment effectivement utile et important.
Vous connaissez la politique constante de la France sur la question de Taïwan : elle reconnaît le gouvernement de la République populaire de Chine comme seul représentant de la Chine depuis 1964 et n’entretient pas de relations diplomatiques avec Taïwan. Cependant, la France développe des coopérations avec ce pays dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler « la politique d’une seule Chine ». Elle considère en outre que les relations entre les deux rives doivent reposer sur un dialogue constructif, dans la mesure où il est dans l’intérêt de tous que la voie du dialogue soit privilégiée, afin que la paix et la stabilité puissent être préservées dans le détroit de Taïwan.
Des échanges dynamiques, des coopérations riches se développent entre nos deux territoires, qui font de Taïwan un partenaire important de la France en Asie. Vous avez été nombreux à signaler la place dans l’économie mondiale de l’île – vingt et unième économie mondiale –, sa place dans les chaînes de valeur mondiales, en particulier dans l’industrie des semi-conducteurs. Ce pays est un membre actif dans les travaux de l’OMC.
Cette coopération tient compte aussi de la vitalité de la société civile taïwanaise, vous l’avez relevé les uns et les autres, de la remarquable réussite de la transition démocratique de l’île initiée dans les années 1980.
Taïwan accueille de surcroît une importante communauté française, évaluée à 4 000 personnes, qui font l’objet d’une attention de tous les instants de notre part.
À travers en particulier le bureau français de Taipei et le bureau de représentation de Taipei en France, la France et Taïwan entretiennent et développent des échanges soutenus dans les domaines économique, industriel, scientifique, de l’innovation et de la technologie, mais également en matière culturelle et éducative. Nous partageons avec l’île des valeurs démocratiques, une ambition commune pour la promotion des droits de l’homme. D’ailleurs, notre ambassadeur pour les droits de l’homme s’y est rendu en janvier 2020.
En matière culturelle, la France et Taïwan entendent poursuivre et approfondir leurs coopérations déjà très denses. Taïwan fait partie des trente-sept territoires identifiés en 2019 par le ministère comme prioritaires pour l’export des industries culturelles et créatives françaises.
J’ajoute que la coopération éducative et universitaire a pris une tournure significative : le nombre d’étudiants français à Taïwan a tout simplement triplé en dix ans ! Ils sont à ce jour 1 500. Ils sont donc une composante essentielle de la communauté française de Taïwan.
Bien que n’étant aujourd’hui reconnue sur le plan diplomatique que par quinze États, l’île développe une politique active sur la scène internationale, y compris auprès des pays avec lesquels elle n’entretient pas de relations diplomatiques. Parallèlement, Taïwan est membre d’une trentaine d’organisations intergouvernementales ; j’évoquais l’OMC, mais on pourrait citer l’APEC, la Banque asiatique de développement et tant d’autres. Elle participe, en tant qu’observateur ou membre associé, aux travaux d’une vingtaine d’organisations intergouvernementales ou d’organes subsidiaires ; je pense à l’OCDE, à la BERD ou à la Banque interaméricaine de développement.
S’agissant spécifiquement de l’objet de votre proposition de résolution et de la participation de Taïwan aux organisations internationales, notre position est claire et constante : nous y sommes favorables lorsque le statut des organisations le permet et que cette participation répond aux intérêts objectifs de la communauté internationale. Il y a donc là une convergence très claire. C’est manifestement le cas pour les organisations internationales que vous avez citées dans la proposition de résolution : l’OMS, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, mais également l’OACI, Interpol.
Je crois que la pandémie de covid rappelle chaque jour, cruellement, depuis plus d’un an, que la santé des femmes et des hommes du monde entier requiert l’engagement et la coopération. Sans la coopération, nous ne vaincrons pas cette épidémie.
Il en est de même pour les questions climatiques, pour les transports, pour la sécurité : soit nous réussissons ensemble, soit nous échouons ensemble. Cela appelle donc une réponse collective.
S’agissant plus spécifiquement de la santé mondiale, puisque nous sommes à quelques jours de cette réunion importante à l’OMS, les chiffres parlent d’eux-mêmes : Taïwan a remarquablement contenu l’épidémie. C’est pourquoi sa contribution et le partage de son expérience sont essentiels à l’ensemble de la communauté internationale, à l’heure où il faut œuvrer collectivement.
Vous avez rappelé les uns et les autres les chiffres : douze morts seulement sur une population de plus de 23 millions d’habitants. Indéniablement, Taïwan a su tirer tous les enseignements de l’épidémie de SRAS en 2003 pour réagir rapidement et efficacement dès les premiers signes d’apparition de la maladie.
Nous n’oublions pas qu’au printemps 2020 Taïwan a fait don d’équipements médicaux – masques, appareils respiratoires – à plusieurs de ses partenaires dans le monde, dont l’Union européenne et la France.
Jean-Yves Le Drian, qui, hélas ! ne pouvait être présent aujourd’hui dans l’hémicycle – il est au Liban –, a eu l’occasion de dire lui-même, en novembre dernier, que nous étions favorables à ce que Taïwan participe aux réunions de plusieurs organismes internationaux, dont l’OMS, car il est essentiel que tous les acteurs qui peuvent prendre part à la lutte contre les pandémies le fassent. Il déclarait : « Nous avons d’ailleurs regretté que Taïwan ne puisse pas participer aux travaux de la soixante-treizième Assemblée mondiale de la santé, qui s’est tenue du 9 au 13 novembre, et nous continuerons d’appeler à un accord entre Pékin et Taipei en vue de la participation de Taïwan à la prochaine Assemblée mondiale de la santé. […] Il ne doit pas y avoir de vide sanitaire dans la lutte contre la pandémie. »
Nous continuons donc à plaider pour que Taïwan soit associée aux travaux de l’OMS. Nous le ferons à titre national, nous l’encourageons au niveau européen, nous l’avons fait encore il y a quelques jours avec nos partenaires du G7.
Compte tenu de ces différents éléments, permettez-moi de souligner que la proposition de résolution portée par les membres du groupe d’échanges et d’études Sénat-Taïwan, sous votre conduite, monsieur le président Richard, présente de réelles convergences avec la position du Gouvernement que je viens d’exprimer. Je salue ici l’esprit constructif de votre initiative.
Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, la France ne veut pas que la question de la participation de Taïwan aux organisations internationales devienne un enjeu politique. L’enjeu est tout autre : répondre aux intérêts objectifs de la communauté internationale. C’est dans cet esprit que la France soutient cette participation de Taïwan aux organisations internationales lorsque leurs statuts le permettent. Je le souligne à nouveau : le fonctionnement optimal de ces organisations appelle une approche inclusive, condition d’un multilatéralisme efficace pour apporter des solutions aux grands défis de notre monde.
Au-delà de l’examen de cette proposition de résolution, vous me permettrez, puisque le sujet est au cœur des travaux de votre groupe d’études, monsieur le président Richard, de souligner que nous suivons de façon extrêmement précise l’évolution de la situation dans le détroit de Taïwan. Nous avons noté à cet égard que les incursions militaires dans la zone d’identification et de défense aérienne de Taïwan se sont multipliées depuis l’an dernier, jusqu’à devenir presque quotidiennes. Je le redis : la stabilité dans le détroit est essentielle pour la sécurité de la région ; c’est la raison pour laquelle nous réprouvons toute tentative de remise en cause du statu quo de même que toute action susceptible de provoquer un incident et de conduire à une escalade dans le détroit. Je crois pouvoir vous dire que nous partageons cette préoccupation avec l’ensemble de nos partenaires de l’Union européenne.
Voilà, madame la présidente, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, l’appréciation du Gouvernement sur ce sujet important. Encore une fois, permettez-moi de me réjouir du travail conduit cet après-midi dans cet hémicycle.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI et INDEP, ainsi que sur des travées des groupes UC, Les Républicains et SER.

La discussion générale est close.
Nous allons procéder au vote sur la proposition de résolution.
Le Sénat,
Vu l’article 34-1 de la Constitution,
Vu le chapitre XVI du Règlement du Sénat,
Vu l’article 7 de la Convention-cadre du 09 mai 1992 des Nations Unies sur les changements climatiques (CNUCC),
Vu la règle 5 du Règlement intérieur permanent de l’Assemblée de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI),
Vu l’article 4 des statuts de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol),
Vu l’article 8 et le h de l’article 18 de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),
Considérant que la France place le multilatéralisme au centre de sa politique étrangère et de la défense de ses intérêts ;
Considérant que la contribution de Taïwan à l’économie et aux échanges mondiaux de toute nature s’est amplement développée au cours des dernières décennies ;
Considérant que Taïwan observe de manière constante une attitude pacifique et coopérative à l’échelle mondiale et que ce territoire a développé une vie démocratique pluraliste reconnue ;
Considérant que les statuts de l’OMS, de la CNUCC, d’Interpol et de l’OACI offrent aux entités dépourvues de statut étatique des possibilités de participation ne portant pas atteinte aux droits des États membres ;
Considérant que Taïwan a bénéficié de ces modalités de participation à plusieurs reprises ;
Considérant que la participation de Taïwan à l’OMS, à la CNUCC, à Interpol et à l’OACI présente une utilité majeure au bénéfice de la coopération d’intérêt mondial que ces organisations soutiennent et que cette utilité est particulièrement confirmée à l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS ;
Souhaite la poursuite des démarches diplomatiques engagées par la France depuis plusieurs années en faveur de la participation de Taïwan à l’Assemblée mondiale de la santé de l’OMS et à l’OACI, ainsi que leur élargissement à la CNUCC et à Interpol, selon les modalités que prévoient leurs règles respectives ;
Constate que cette démarche constructive est rigoureusement conforme à la position constante de la France au regard des relations qu’elle entretient avec la République populaire de Chine depuis 1964 ;
Observe avec satisfaction que ce souhait est partagé par de très nombreux États membres des organisations précitées.

Mes chers collègues, je rappelle que la conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote.
Je mets aux voix la proposition de résolution.
J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 116 :
Nombre de votants323Nombre de suffrages exprimés304Pour l’adoption304Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, SER, UC et Les Républicains.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 10 mai 2021 :
À dix-sept heures trente et le soir :
Projet de loi constitutionnelle, adopté par l’Assemblée nationale, complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement (texte n° 449, 2020-2021).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.