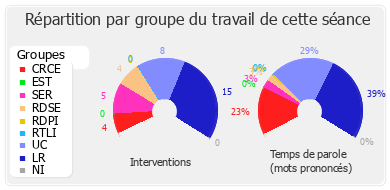Séance en hémicycle du 16 juillet 2009 à 15h00
Sommaire
- Questions d'actualité au gouvernement (voir le dossier)
- Allocution de m. le président du sénat (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à une délégation parlementaire de taïwan
- Rappel au règlement (voir le dossier)
- Orientation des finances publiques pour 2010 (voir le dossier)
- Décision du conseil constitutionnel
La séance
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que l’auteur de la question de même que la ou le ministre pour sa réponse disposent chacun de deux minutes trente.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Ma question s’adresse à Mme le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi.
Madame le ministre, au moment où vous recevez à Paris le secrétaire américain au Trésor, nous apprenons la remontée des cours de bourse de certaines banques américaines et la publication de résultats supérieurs aux attentes.
D’un côté, nous ne pouvons que nous réjouir de l’amélioration de la situation du secteur financier aux États-Unis et en Europe. Le Président de la République et le Gouvernement ont agi avec rapidité et efficacité, au plan tant national et européen que mondial, afin de sauver certains établissements financiers, rassurer les épargnants et, surtout, soutenir le financement de l’activité des entreprises.
De l’autre côté, nous sommes en droit de nous interroger sur les bénéfices et les bonus importants annoncés cette semaine par certaines grandes banques d’investissement américaines, ...

... celles-là mêmes qui sont largement responsables de la crise financière dont l’économie mondiale n’a pas fini de payer la facture économique et sociale.

La France a su imposer des conditions et des règles claires en matière de soutien de l’État et de rémunération des dirigeants. Elle plaide par ailleurs, au niveau européen comme devant le G20, en faveur d’un renforcement de la régulation du secteur financier.
Comment faire en sorte que les règles et les pratiques du secteur financier soient mieux harmonisées entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la zone euro ? Comment renforcer la régulation et améliorer la gouvernance, au plan européen comme au plan mondial ?
Vos conversations avec nos alliés américains vous permettent-elles de penser, madame le ministre, que le bon sens va enfin triompher des mauvaises habitudes ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Comme vous l’avez dit, monsieur le sénateur, M. le Premier ministre a reçu ce matin M. Timothy Geithner, secrétaire au Trésor des États-Unis, qui a ensuite participé à une réunion technique dans mes bureaux.
La tentation est très grande, pour les acteurs du secteur bancaire, de revenir à leurs vieilles habitudes, et vous avez raison de vous en émouvoir. Nous devons bien entendu lutter contre ces tentations.
Lors de la réunion du G20 à Washington, le 15 novembre dernier, des principes avaient été établis. Puis, le 2 avril, lors de la réunion du G20 à Londres, des décisions ont été prises, en particulier à la suite d’une initiative franco-allemande dont j’ai été le témoin privilégié.
Je peux vous assurer que nous avons réussi à convaincre les partenaires du G20 de l’utilité de toutes les mesures contracycliques, c'est-à-dire destinées à éviter l’accélération de la crise. Or on sait que les modes de rémunération, qui, conçus pour le court terme, sur la base de bonus garantis, ne prévoient aucun retour en cas de mauvaise performance, sont manifestement de nature à accélérer les phénomènes de crise.
Nous devons être très vigilants car la tentation naturelle est d’agir comme avant. Il nous faut donc nous en tenir aux principes arrêtés, aux décisions prises, et veiller à leur mise en œuvre.
Lors de la prochaine réunion du G20 à Pittsburgh, les 24 et 25 septembre, nous ferons un état des lieux des mesures qui auront été réellement engagées. Comme je l’ai évoqué ce matin avec Timothy Geithner, nous devons faire cause commune sur cette question.
J’ai été particulièrement satisfaite de constater que la Commission européenne avait proposé de modifier certaines directives relatives au capital des banques, notamment la directive dite « Capital Requirements Directive », afin de sanctionner les politiques de rémunération de nature à accélérer la crise dont nous avons été les témoins au cours des dernières semaines. La Commission a ainsi recommandé la mise en place de mécanismes de rémunération qui répondent de façon précise à nos exigences de mesure et de prise en compte de la performance, y compris jusqu’au remboursement des bonus, le cas échéant.
Croyez bien que nous serons extrêmement vigilants, monsieur le sénateur, sur la mise en œuvre de ces dispositifs.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Ma question s’adresse à Mme la ministre de la santé et des sports. Elle concerne l’appréciation de la pandémie de grippe A/H1N1 et l’état de préparation de notre pays face à celle-ci.
Mme la ministre de la santé a annoncé hier l’achat par la France de 94 millions de doses de vaccin, le tout pour un montant de un milliard d’euros, auprès de trois laboratoires pharmaceutiques. Si de tels chiffres peuvent laisser penser que le problème est maîtrisé par le Gouvernement, ils démontrent surtout que la propagation du virus au dernier trimestre de l’année 2009 représente une menace bien réelle pour la population française, contrairement à toutes les déclarations rassurantes entendues jusqu’à présent.

Bien que l’Organisation mondiale de la santé ait décidé de déclarer l’état de pandémie, la France maintient son niveau d’alerte actuel, compte tenu, nous dit le Gouvernement, du faible nombre de cas avérés de grippe A dans notre pays.
Or tout porte croire que la pandémie de grippe A est très largement sous-estimée. L’Institut de veille sanitaire indiquait hier, 15 juillet, que 628 cas avaient été identifiés sur le territoire français, dont 481 cas confirmés et 147 « probables ». Quel crédit accorder à ces données chiffrées ?
Selon une étude qui vient tout juste de paraître dans une revue médicale britannique, le nombre de cas de grippe A - de même que le taux de mortalité lié à cette maladie - serait bien plus élevé que ne l’indiquent les statistiques officielles. Nombre de malades infectés ne sont pas recensés comme tels. Dès lors, la propagation du virus serait bien supérieure aux annonces et les risques de voir s’étendre la pandémie sont multipliés d’autant, faute de précautions suffisantes et adaptées à la réalité.
Plus grave encore, l’absence de données fiables retarde la prise en compte de la mutation du virus.

Or nous sommes à quelques semaines de la fin de l’été et des premiers rhumes automnaux.
Dans ces conditions, comment notre pays entend-il emporter la course de vitesse qui s’engage entre propagation du virus et mise à disposition du vaccin ? Pour gagner du temps, Mme la ministre de la santé envisage-t-elle de mettre sur le marché un vaccin qui n’aurait pas été évalué selon les protocoles en vigueur ?
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Enfin, pourquoi ne pas admettre devant la représentation nationale que la grippe A est une pandémie très largement sous-estimée dans notre pays ?
Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Vous avez raison, monsieur le sénateur : il s’agit d’un sujet majeur de santé publique. Le passage en phase 6, décidé par l’Organisation mondiale de la santé, signifie que le monde est bel et bien confronté à une pandémie grippale, ce que le Gouvernement ne conteste absolument pas.
Où en sommes-nous ?
Depuis le début de la pandémie, notre pays a recensé environ 600 cas, principalement importés, sans aucun décès lié à cette maladie. Il faut sans doute y voir le résultat des mesures qui ont été prises et dont nous avons pu mesurer l’efficacité voilà quelques jours, lors de l’apparition de cas à Megève. Nous avions donné des instructions aux préfets quelques jours auparavant et leur mise en œuvre s’est soldée par un succès.
Que faisons-nous face à l’évolution de cette pandémie ? Nous avons pris trois mesures.
Tout d’abord, le dispositif de protection et de vaccination est activé.
Grâce aux décisions prises par Roselyne Bachelot-Narquin et Michèle Alliot-Marie, la France dispose d’ores et déjà de un milliard de masques anti-projections et de 723 millions de masques de protection. Par ailleurs, 33 millions de traitements antiviraux sont disponibles et 94 millions de doses de vaccin ont été commandées afin de couvrir, dès que le vaccin sera disponible, les besoins de la population. Ce dernier chiffre s’explique par le fait qu’il faudra procéder dans certains cas à deux vaccinations.
Ensuite, nous adaptons notre dispositif sanitaire à l’évolution de la pandémie.
La cellule interministérielle de crise a décidé hier que, dès le 23 juillet, les malades seront pris en charge par la médecine libérale, afin que soit assuré un suivi médical de proximité. Des instructions précises ont été adressées dès aujourd’hui aux préfets concernant la mise en place de cette mesure.
Enfin, nous mobilisons l’ensemble des acteurs de proximité.
Sous l’autorité de M. le Premier ministre et à la demande du Président de la République, j’ai réuni hier tous les préfets des départements ainsi que les préfets de zone. Je leur ai donné des instructions afin qu’ils s’assurent que les plans de continuité d’activité sont dès à présent opérationnels, car c’est notre principal défi à l’heure actuelle. Le deuxième objectif que j’ai assigné aux préfets est de prendre contact avec les élus locaux, et tout d’abord avec les maires, qui sont les premiers acteurs concernés.
Nous ne devons pas inquiéter inutilement la population, mais nous lui devons la vérité. C’est en agissant ensemble, en mobilisant l’État, les collectivités locales, les entreprises et la société civile que nous apporterons la réponse la plus efficace, indispensable pour lutter contre cette pandémie bien réelle.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

M. Yves Détraigne. Ma question s’adresse à M. le ministre de l’espace rural et de l’aménagement du territoire.
Applaudissements nourris sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

La manière dont sont prévus le déploiement de la télévision numérique et la coupure du signal analogique risque de se traduire, pour plus de un million d’habitants en milieu rural, par la suppression pure et simple de la télévision !
La loi du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur prévoit, en effet, une obligation de couverture TNT par les chaînes historiques à hauteur de 95 % de la population au niveau national et de 91 % seulement par département.
De ce fait, seuls 1 626 réémetteurs seront totalement ou partiellement mis aux normes TNT. Près de 2 000 autres réémetteurs, qui diffusent aujourd’hui la télévision analogique sur le territoire métropolitain, ne seront pas systématiquement équipés par les chaînes pour diffuser le numérique.
Si les habitants desservis par ces réémetteurs – au nombre de plusieurs centaines de milliers répartis sur une quarantaine de départements – veulent continuer à recevoir au moins une partie des dix-huit chaînes gratuites de la TNT, dont les chaînes du service public pour lesquelles ils seront de toute façon obligés de s’acquitter de la redevance, ils devront, soit, à titre individuel, passer par le réseau câblé, par l’ADSL ou par le satellite, soit, à titre collectif, par le biais de leur commune qui en aura la charge, financer la mise aux normes TNT du réémetteur local.
Ils seront condamnés, en quelque sorte, à une double peine : continuer à payer la redevance pour un service qui aura disparu, financer le maintien de ce service, et parfois à un coût très élevé.
Or il n’échappe pas à votre vigilance, monsieur le ministre, que les communes qui se trouvent dans cette situation n’ont évidemment pas de réseau câblé ; bien souvent, elles attendent encore l’ADSL ou, lorsqu’elles en disposent, le reçoivent à un débit inférieur à celui que nécessite la TNT. De plus, certains documents d’urbanisme concernant notamment des secteurs protégés et classés auxquels appartiennent une partie des communes concernées interdisent purement et simplement l’installation de paraboles satellitaires.

Nous sommes donc face à un risque avéré de nouveau recul du service public en milieu rural.
Étant donné la gravité de cette situation, pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, ce que le Gouvernement entend faire pour que le passage au « tout numérique » n’amplifie pas la fracture territoriale ?
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

La parole est à M. le ministre, notre ancien collègue Michel Mercier, que nous accueillons avec plaisir pour sa première séance de questions d’actualité en tant que membre du Gouvernement.
Monsieur le sénateur, le Gouvernement partage vos préoccupations. Je les fais bien volontiers miennes parce qu’elles ont trait au développement de tous nos territoires et au bien-être des populations qui y vivent.
Rires sur les travées du groupe socialiste.
Tout d’abord, je veux vous rappeler que la loi de 2007 a fixé un certain nombre de règles, prévoyant notamment que 95 % de la population doit être desservie. Compte tenu du fait que, dans les zones urbaines, pratiquement 100 % de la population est déjà desservie, on risquait une véritable fracture. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, le CSA, est donc allé plus loin et a exigé que 91 % de la population de chaque département soit desservie. Dès la semaine prochaine, le Sénat aura d’ailleurs l’occasion de consacrer dans la loi cette règle très judicieuse.
Il convient de relever que la desserte de 91 % de la population ne constitue pas un recul par rapport à la situation actuelle. En effet, aujourd'hui, la couverture analogique n’est pas assurée partout totalement, mais entre 90 % et 100 % de nos concitoyens sont desservis, en fonction des départements. L’objectif du Gouvernement est d’atteindre le plus rapidement possible cette couverture et de faire en sorte qu’elle soit la plus homogène possible.
Aux termes de la loi, un fonds devra aider les ménages les plus modestes à s’équiper en télévision numérique et en parabole.
Monsieur Détraigne, je veux être très clair : il n’est pas question de laisser s’établir une nouvelle fracture numérique. Ceux de nos concitoyens qui sont déjà confrontés à des difficultés en matière de téléphonie mobile ou d’ADSL ne doivent pas rencontrer de problèmes supplémentaires dans le domaine de la télévision numérique.
Le Gouvernement ne le veut pas et se mobilise sur ce sujet, afin d’éviter l’accumulation de handicaps dans certains territoires. C’est la raison même de la mission que m’ont confiée le Premier ministre et le Président de la République.
Monsieur le sénateur, la « double peine » à laquelle vous avez fait allusion est au cœur des réflexions et de l’action que le Gouvernement entend mener, notamment Mme Kosciusko-Morizet, chargée de ce dossier.
M. Michel Mercier, ministre. Cette mobilisation du Gouvernement sera démontrée la semaine prochaine : le Premier ministre, François Fillon, présidera le Conseil national du numérique. Il prendra à cette occasion des décisions dont il vous fera part.
Bravo ! et applaudissementssur les travées de l’Union centriste et de l’UMP.

M. David Assouline. Ma question s’adresse à Frédéric Mitterrand, au tout nouveau ministre comme à l’homme de culture, à l’homme de toutes les cultures. J’attends avec plaisir une réponse sincère et non conventionnelle.
Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, vous qui n’aviez pas hésité, au mois d’octobre 2001, en votre qualité de président de la commission d’avance sur recettes du cinéma français, à apporter votre soutien à une grève au Centre national de la cinématographie, le CNC, comprenez-vous aujourd'hui les raisons qui ont poussé les salariés de RFI à cesser le travail pendant deux mois pour protester contre une restructuration d’une rare brutalité ?
Exclamations ironiques sur les travées de l ’ UMP.

Après soixante jours d’interruptions régulières de l’antenne, le personnel de RFI n’a toujours pas été entendu et six programmes en langue étrangère – notamment en allemand et en polonais –, ainsi que 206 postes, soit 20 % de l’effectif de la radio, doivent toujours disparaître.
Mais, au-delà de RFI, serez-vous sensible, en tant qu’ancien directeur des programmes de ce formidable outil de promotion de la francophonie qu’est TV5 Monde, au sort que réserve la majorité à une autre voix essentielle de la France dans le monde, l’AFP, promise à la privatisation ?
Par ailleurs, vous qui dénonciez en 1990, dans un geste fort, en direct, devant huit millions de téléspectateurs, la paupérisation du service public, laisserez-vous résorber les 50 millions d’euros de déficit qu’aura accumulés France Télévisions en 2010 par la suppression de 500 emplois sur les 900 départs à la retraite prévus d’ici à 2012 ?
Vous qui avez quitté TF1 avec fracas en 1988, en affirmant, avec des mots d’une rare violence – mais l’époque a changé ! – « ils n’aiment ni les noirs, ni les Arabes, ni les pédés, ni les gens de gauche. Autant dire que je n’avais pas beaucoup d’avenir », aujourd’hui, en votre qualité de ministre, vous engagez-vous à agir pour que le service public reste au moins un lieu où la diversité et l’indépendance soient garanties et pas celui où l’on aime d’abord et toujours le président Sarkozy ?
Protestations sur les travées de l ’ UMP.

Allez-vous fermer les yeux devant la véritable catastrophe démocratique…

… que constitue la mise sous tutelle politique de notre télévision, illustrée par la scandaleuse et complaisante valorisation du Président de la République sur les antennes audiovisuelles les 13 et 14 juillet, …

M. David Assouline. Agirez-vous pour garantir la pérennité des actuelles éditions locales de France 3, auxquelles les Français sont très attachés, comme l’indépendance des rédactions nationales des antennes de France Télévisions ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
M. Frédéric Mitterrand, ministre de la culture et de la communication. Monsieur Assouline, votre question, à épisodes, comporte un certain nombre de citations datant de ma « carrière » antérieure. Aujourd’hui, ce n’est pas tout à fait la même personne qui est devant vous !
Bravo ! et applaudissementssur les travées de l’UMP.- Exclamations sur les travées du groupe socialiste.
De surcroît, ces citations sont effectivement en partie sorties de leur contexte.
Cependant, je suis très sensible à votre volonté de reconstituer un destin dans son intégralité. Vous savez à quel point de telles préoccupations me sont chères.
Sourires.
Pour ce qui concerne RFI, la réforme en cours vise non pas à éteindre une chaîne à laquelle tous les Français se doivent d’être attachés, comme vous avez l’air de le soupçonner, mais, au contraire, à la redéployer. Certaines zones couvertes par RFI méritent ce redéploiement, notamment celles dans lesquelles sont en usage des langues vernaculaires comme l’haoussa ou le swahili, encore insuffisamment pratiquées. En revanche, RFI, par le biais de ses émissions en langue arabe, collabore désormais de manière beaucoup plus intensive avec France 24 et TV5 Monde.
Cette réforme entraîne évidemment une réduction des effectifs – vous avez évoqué la suppression de 206 emplois – qui se déroulera conformément à un plan que nous avons voulu le plus juste possible, comme nous le faisons toujours. Par ailleurs, 34 nouveaux emplois vont être dégagés de manière à faciliter l’adaptation de RFI au numérique.
En vérité, la chaîne RFI a été abandonnée pendant longtemps. Comme toujours en pareil cas, ce sont les salariés qui payent la facture.
Pour ce qui concerne maintenant le service public, pour y avoir travaillé pendant très longtemps, j’en connais toutes les qualités et toute l’importance. Croyez bien que mon appui au service public est constant.

Monsieur le ministre, il ne vous reste plus que quelques secondes pour conclure !
M. Frédéric Mitterrand, ministre. D’ailleurs, une réponse vous a été donnée hier soir, avec la diffusion en prime time, grâce à la suppression de la publicité, de l’opéra La Traviata, regardé par 1, 2 million de téléspectateurs.
Bravo ! et applaudissementssur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.

Ma question s'adresse à Mme le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Mon intervention porte sur les rapports entre l’exécutif et la justice.
M. Marc Robert, procureur général de Riom, a été muté d’office à la Cour de cassation. Le Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, avait donné un avis défavorable à cette mutation, mais, le 23 juin, un décret du Président de la République procédait à la nomination de M. Robert « vu l’avis du Conseil supérieur de la magistrature du 4 juin 2009. ».
Or, lors de la réunion du 4 juin, Mme Dati, alors garde des sceaux, avait retiré sa proposition de mutation de l’ordre du jour, alors que M. Ouart, conseiller du Président de la République, était intervenu contre ce retrait.
Les conditions de cette mutation suscitent beaucoup d’émoi.
En effet, le décret de nomination paraît notoirement irrégulier, puisqu’il a été pris sans que l’avis du CSM, qui doit être explicite, ait été rendu. En tout cas, le procès-verbal n’a pas été communiqué.
Je constate que M. Robert lui-même conteste la légalité du décret et a saisi le Conseil d’État. Les syndicats de magistrats se sont d’ailleurs joints à sa requête.
Cette affaire constitue une atteinte extrêmement grave à l’institution judiciaire et au principe de séparation des pouvoirs.
J’ajoute que votre injonction à l’avocat général de Paris pour qu’il fasse appel du verdict de la cour d’assises dans l’affaire Fofana, …

… contrairement à ce que ce magistrat envisageait apparemment, renforce notre inquiétude.
Avec une telle injonction, les politiques qui, bien évidemment, ne participent pas au procès, interviennent directement en faveur de l’une des parties, ce qui ouvre la voie à toutes les dérives.
Madame le ministre d’État, je veux vous poser deux questions.
Premièrement, entendez-vous faire appel de toutes les décisions de justice qui ne seraient pas conformes aux réquisitions des avocats généraux ? Si tel n’est pas le cas, et je peux d’ores et déjà le constater, quels seront vos critères ?
Deuxièmement, ce type d’affaires intervenant en plein débat sur la suppression du juge d’instruction et l’indépendance du parquet et coïncidant avec la présentation en conseil des ministres du projet de loi organique réformant le Conseil supérieur de la magistrature, qu’entendez-vous faire pour sortir le CSM de la crise dans laquelle vous le plongez ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Madame Borvo Cohen-Seat, je vous remercie de cette double question.
Pour ce qui concerne le cas de M. Robert, dès ma prise de fonctions, j’ai reçu les présidents des trois formations du Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que les membres de la formation « parquet » du CSM. J’ai fait part aux uns et aux autres de ma volonté de travailler avec eux en toute transparence, en toute confiance, dans le respect des institutions, de la Constitution ainsi que des lois organiques.
Hier, le CSM s’est réuni en ma présence. Assistaient à cette réunion les trois membres du Conseil qui, à la suite de l’affaire, s’étaient retirés. C’est une première marque de la confiance retrouvée.
Comme je l’ai indiqué à cette occasion à mes interlocuteurs, parce qu’un recours a été formé devant le Conseil d’État, c’est à cette juridiction, et à elle seule, de se prononcer.
Sur l’affaire Fofana, et l’appel que j’ai fait interjeter, madame le sénateur, mes critères sont et seront toujours les mêmes : l’intérêt de la société et la paix publique.
Quand j’ai constaté que, du fait des procédures, les condamnations prononcées aboutiraient à la remise en liberté, d’ici à quelques mois, de certaines des personnes les plus engagées dans cet assassinat, qui se trouveraient donc de nouveau libres dans les quartiers et sur les lieux mêmes où les faits ont été commis, il m’a semblé qu’un problème se posait, qui n’avait peut-être pas suffisamment été pris en compte.
Je ne juge pas à la place de la Cour ; je demande simplement que l’on revoie le dossier à la lumière de cette considération.
En effet, je sais ce qui se passe dans un certain nombre de quartiers, que je suis attentivement, et je suis très préoccupée par la montée et la banalisation de la violence.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Remettre très rapidement en liberté des personnes qui ont commis un acte d’une telle barbarie, ce serait adresser un bien mauvais signal à tous ceux qui banalisent la violence.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.
De plus, le risque est grand que les victimes n’aient plus alors confiance en nos institutions et cherchent à se faire justice elles-mêmes.
Dès lors, en tant que garde des sceaux, j’ai estimé en conscience que l’intérêt de la société comme la paix publique exigeaient de demander au procureur général de faire appel.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée de l'écologie.
Madame la secrétaire d'État, je souhaite vous interroger sur le Grenelle de la mer lancé en avril dernier.
En effet, au regard de l’importance des enjeux maritimes, il est indispensable de mettre en œuvre une stratégie nationale pour la mer et le littoral qui s’inscrive pleinement dans une perspective de développement durable.
Dans la continuité du processus de concertation que le ministère a su mettre en place au cours de ces deux dernières années, des groupes de travail ont été constitués, qui ont abouti à des tables rondes finales réunissant les représentants des organisations composant les cinq collèges du Grenelle de la mer.
Par ailleurs, des « Grenelle de la mer régionaux » ont permis aux territoires de contribuer activement à ces débats.
Dix-huit régions, parmi lesquelles dix sont des régions littorales, ont ainsi pu faire partager leurs observations en cohérence avec la réalité du terrain. Ce fut en particulier le cas en juin dernier à Pornic, en Loire-Atlantique.
Le Grenelle de la mer a achevé hier sa troisième étape, celle de la négociation et des arbitrages collectifs, avec la tenue des tables rondes finales réunissant les cinq collèges.
Enfin, le Président de la République
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.

Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous nous éclairer sur cette étape décisive et sur les avancées majeures qui se dégagent de ces mois de débat ? Vous est-il possible de nous indiquer la façon dont vous entendez poursuivre ce projet indispensable à l’avenir de la planète ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame la sénatrice, je vous remercie de votre question.
Comme vous l’avez indiqué, Jean-Louis Borloo, Bruno Le Maire, Dominique Bussereau et moi-même étions présents ce matin au Havre pour assister à la présentation par le Président de la République de ses ambitions pour la politique maritime de la France.
Le chef de l’État a confirmé que notre pays devait, grâce au Grenelle de la mer, corriger un oubli historique, celui de son destin maritime.
Et quand nous évoquons un « oubli historique », il ne s’agit pas de mots : savez-vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qu’il n'y a même pas aujourd'hui d’ambassadeur français accrédité auprès de l’Organisation maritime internationale ?
Exclamations amusées sur les travées du groupe socialiste.

Ce n’est pourtant pas difficile à trouver ! Aucun ministre à la retraite ne veut s’en charger ? Mme Boutin, par exemple…
Or nous avons une responsabilité particulière dans ce domaine : nous possédons le deuxième domaine public maritime mondial, qui représente vingt fois la surface de la France.
Loin d’être vide, ce domaine constitue un potentiel énergétique et alimentaire considérable, en même temps, bien entendu, qu’une richesse en termes de biodiversité.
Le Président de la République a fait siennes les conclusions du Grenelle de la mer, qui ont trouvé leur aboutissement précisément hier et qui ont confirmé la nécessité de protéger la mer pour l’homme, notamment afin que les pêcheurs puissent poursuivre leur activité.
Aussi a-t-il été décidé que 20 % de nos eaux seraient classées « aires marines protégées » et que les pêcheurs seraient les premières sentinelles de la mer. Bruno Le Maire a d'ailleurs confié une mission à M. Louis Le Pensec afin de définir les conditions d’une pêche en haute mer.
Par ailleurs, le Président de la République a confirmé que la France devait être leader pour les énergies marines.
Vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, les énergies marines représentent un immense potentiel. Elles pourraient produire pas moins de 6 000 mégawatts d’ici à 2020, soit l’équivalent d’au moins 3 000 éoliennes…
Sachez aussi que le Président de la République a souhaité renforcer l’action de l’État en mer, en définissant une fonction de garde-côte à la française, afin de mieux lutter contre les pollutions.
Il s'agit d’une importante rupture dans nos politiques : la mer est désormais reconnue comme notre avenir ; la haute mer est considérée non plus comme une zone de non-droit, mais comme le bien commun de l’humanité.
La volonté de poursuivre le Grenelle de la mer était partagée par l’ensemble des acteurs, qui se sont enfin parlé, qui ont cherché à rapprocher leurs positions et qui souhaitent continuer leur action, au sein des comités opérationnels et à l’occasion d’un futur conseil interministériel de la mer.
La France doit assurer pleinement la responsabilité d’un domaine public maritime qui, je le répète, est le deuxième du monde ; vous voyez, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que cela peut représenter !
La mer est notre avenir. Elle représente un immense potentiel et une ressource gigantesque dont il est temps, aujourd'hui, que nous prenions en compte la dimension politique.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.
Les électeurs iraniens ont massivement participé à l’élection présidentielle du 12 juin.
Mahmoud Ahmadinejad, soutenu par le Guide suprême de la révolution et par les fractions les plus conservatrices de la République islamique, a été proclamé vainqueur.
Les soupçons de fraude massive, corroborés par de nombreuses observations directes, ont été écartés sans ménagement par le Guide suprême, qui a réaffirmé, après un simulacre de recomptage des voix, son soutien au président sortant.
Les candidats réformateurs, en faveur desquels la volonté populaire s’était clairement exprimée, ont contesté très fermement l’action du pouvoir. Pendant plusieurs semaines, le peuple iranien a manifesté son indignation et sa colère dans les rues de Téhéran et des autres grandes villes du pays.
« Où est mon vote ? », tel était le cri de ralliement des manifestants, qui ne toléraient pas que l’une des seules libertés qui leur étaient octroyées soit ainsi piétinée.
Des manifestants ont été blessés, tués parfois. Des opposants ont été arrêtés, maltraités, torturés, et ils continuent de l’être.
Les arrestations sont massives, la répression brutale. Elle touche les Iraniens, mais également les journalistes et les touristes étrangers, comme en témoigne l’arrestation arbitraire et révoltante de Clotilde Reiss, cette jeune étudiante française passionnée d’Iran qui est en prison depuis quinze jours.
En quelques semaines, l’Iran a été bousculé et le régime a été si contesté par le peuple que plus rien, probablement, ne sera comme avant.
La légitimité des dirigeants est en effet doublement écornée : ils ont perdu leur légitimité démocratique par la fraude ; ils ont perdu leur légitimité religieuse quand Ali Khamenei a exposé son autorité de guide pour justifier cette fraude.
Dans une situation si incertaine, la responsabilité de la France et de l’Europe n’en est que plus grande encore.
Monsieur le ministre, quelle sera la position de la France dans les prochaines semaines ? Reconnaîtra-t-elle le président iranien, qui n’est pas mal élu, mais non élu ? Exigera-t-elle la libération sans condition des milliers de personnes arrêtées ces dernières semaines, comme y invitent ce matin, dans le quotidien Libération, des dizaines de militants, d’artistes et d’intellectuels solidaires du peuple iranien ?
Enfin, monsieur le ministre, j’ai une autre question, un peu plus complexe, au regard des mutations à l’œuvre en Iran et dans la société iranienne.
Puisque nous sommes d’accord, je l’espère, pour réaffirmer avec force que la « guerre des civilisations » est une vision erronée de l’histoire ; puisque nous sommes favorables au renforcement des relations d’amitié et de reconnaissance mutuelle entre l’Orient et l’Occident, entre les mondes d’histoire judéo-chrétienne et les mondes d’histoire arabo-musulmane ; puisque ces idées, sans naïveté, doivent s’incarner dans des options stratégiques, dans des décisions politiques courageuses et dans une vision historique forte ; puisque nous sommes d’accord sur tous ces points, comment expliquez-vous, monsieur le ministre, que la France soit si réticente à envisager l’adhésion d’un autre grand pays de culture et d’histoire musulmanes au sein de l’Union européenne
Protestations sur les travées de l ’ UMP

Mme Dominique Voynet. Est-ce là, monsieur le ministre, la meilleure façon d’honorer un islam laïcisé, démocratique et pluraliste, comme l’espère, à cor et à cri, le peuple iranien ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Madame la sénatrice, vous avez posé au moins deux questions, qui ne se ressemblent guère et dont je dirais même qu’elles n’ont aucun rapport entre elles !
Toute la première partie de votre intervention, qui décrivait les tragiques et multiples répressions des manifestations en Iran, juste après l’annonce des résultats officiels du scrutin, était juste.
Il y a eu une réaction très spontanée de centaines de milliers, sinon de millions de personnes – personne ne les a comptées, en tout cas pas nous, malheureusement – et nous avons vu ce spectacle effrayant des arrestations et des nombreux morts.
S’y ajoute le cas de Clotilde Reiss. Cette jeune française qui, comme vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, enseignait à l’université d’Ispahan, a été arrêtée le 1er juillet dernier. Elle est encore détenue aujourd'hui, ce qui n’est pas acceptable et exige une action concertée des pays européens, qui a déjà commencé, d'ailleurs.
Malgré une première visite de notre ambassadeur - une deuxième étant prévue samedi prochain, si tout se passe bien, du moins aussi bien que cela peut se passer -, malgré des contacts téléphoniques qui nous rassurent sur la santé et l’état psychologique de Clotilde Reiss, nous ne pouvons accepter qu’une innocente soit emprisonnée
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Aussi, nous faisons tout pour qu’elle soit libérée, à travers le G8 et l’Union européenne ; les Vingt-Sept ont d'ailleurs manifesté, à deux reprises, leur réaction spontanée sur ce sujet.
Que pouvons-nous faire d’autre ? Les vingt-sept États de l’Union européenne, y compris la France, ont chacun convoqué leur ambassadeur d’Iran, et nous nous apprêtons, même si nous ne souhaitons pas y être obligés, à réagir de façon extrêmement violente sur ce dossier à chaque fois que nous en aurons l’occasion.
Toutefois, je vous le rappelle, le Gouvernement iranien a arrêté entre-temps une employée franco-iranienne de notre ambassade à Téhéran qui, heureusement, a été relâchée. Nous devons donc mesurer nos effets, parce que nous voulons obtenir la libération de Clotilde Reiss.
Madame la sénatrice, vous affirmez dans le même temps qu’il ne faut pas reconnaître le régime ainsi « issu des urnes ». Je crains hélas, que celui-ci ne soit pas le premier qui, en se maintenant, doive être reconnu…
Il y a eu, bien sûr, une contestation de l’élection, qui était forte et que nous avons ressentie politiquement, psychologiquement et même presque physiquement, compte tenu de notre affection pour ce peuple. Toutefois, si tout le monde en Iran proclame l’élection d’un président, il serait bien inutile et contre-productif d’aller, seuls, dans le sens contraire.
En revanche, nous pouvons soutenir le mouvement de contestation, multiplier les contacts avec lui, continuer à nous opposer à la politique menée par le régime iranien en matière d’énergie atomique, comme nous l’avons fait d'ailleurs avant que cela ne nous soit imposé.
Je vous le rappelle, nous avons maintenu les contacts directs avec les dirigeants iraniens, nous les avons maintes fois rencontrés. Moi-même je téléphone tous les deux jours à mon homologue à Téhéran pour faire pression afin que Mlle Reiss soit libérée. Cette attitude est la bonne pour le moment, me semble-t-il.
Quant à votre seconde question, permettez-moi de ne pas la mélanger avec la première !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Ma question s'adresse à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Madame le ministre, en décembre 2008, dans le cadre du plan de relance de l’économie française élaboré pour affronter la crise structurelle sans précédent qui nous a frappés, ainsi que de nombreux autres pays dans le monde, des mesures spécifiques ont été prises pour aider le secteur automobile, particulièrement touché.
Ainsi, une prime à la casse de 1 000 euros pour l’achat d’un véhicule neuf émettant moins de 160 grammes de CO2 a été instaurée. Ce dispositif, le plus populaire du plan de relance, est prévu pour durer jusqu’à la fin de 2009.
Je le rappelle, pour assurer l’avenir de notre outil industriel automobile et préserver ce secteur stratégique pour notre économie et nos emplois, un pacte automobile a été concrétisé dans le collectif budgétaire du mois d’avril dernier.
Or le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance et le ministre de l’industrie viennent d’annoncer que la prime à la casse ne pourrait être maintenue indéfiniment.
Nos voisins allemands font de même, Berlin ayant exclu d’étendre ce dispositif.
Certains journaux titrent déjà sur une fin trop rapide de la prime en rappelant les effets dommageables, dans le passé, de l’arrêt de la « Balladurette » et de la « Jupette ».
En outre, ces déclarations de nos ministres n’ont pas manqué de susciter de multiples réactions chez les constructeurs, chez les sous-traitants, nombreux dans les Vosges, ainsi que dans les réseaux de vente d’automobiles, réactions à la hauteur des résultats, qui semblent positifs.
Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quel est le premier bilan de ce dispositif, sachant qu’il a été conçu pour soutenir l’activité, écouler les stocks et faire repartir la production ?
D’autre part, pouvez-vous nous préciser dans quel délai et suivant quelles modalités vous envisagez de l’arrêter ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le sénateur, le bilan de la prime à la casse est positif.
Nous nous étions fixé comme objectif de maintenir si possible la production de 2009 au niveau de celle de 2008.
Nous constatons, au terme du premier semestre de 2009, une progression de 0, 2 % de la commercialisation des véhicules sur le territoire français.
Nous avions escompté que cette mesure remporterait un certain succès et nous avions prévu une enveloppe budgétaire de 220 millions d’euros. Or le succès rencontré par la prime à la casse – vous en avez rappelé les modalités : 1 000 euros pour le retour d’un véhicule de plus de dix ans d’âge en contrepartie de l’achat d’un véhicule qui ne consomme pas plus de 160 grammes de CO2 par kilomètre – a été tel que nous estimons le coût de la mesure à 390 millions d’euros pour le budget de l’État.
L’objectif que nous nous étions fixé est donc non seulement atteint, mais dépassé.
Ce résultat est bénéfique pour notre économie et pour la santé de nos entreprises, au point, d’ailleurs, qu’un certain nombre de constructeurs automobiles ont relancé la production.
Ainsi, les chaînes de fabrication des petits modèles de PSA se sont remises à tourner en horaires 2/8, et Renault a été contraint – nous en sommes heureux – de rapatrier de Slovénie à Flins une partie de la fabrication des petits véhicules.
La prime à la casse est de toute évidence un succès. Nous devons désormais absolument éviter une sortie du dispositif brutale qui se solderait, comme cela a déjà été le cas dans le passé, par une chute de la production et des ventes de véhicules de 20 %. Le retour à l’équilibre avait alors pris trois ans.
Nous étudions actuellement plusieurs dispositifs permettant une sortie « en sifflet », c’est-à-dire progressive, de ce mécanisme à partir de 2010.
Nous serons très attentifs aux modalités, au cadrage et au calendrier, et nous tiendrons compte à la fois de nos finances publiques et de la situation économique. Il est bien évident que la construction automobile est un secteur industriel que nous devons soutenir.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur certaines travées de l ’ Union centriste.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Ma question s'adresse à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.

Je ne poserai, moi, qu’une seule question, chère collègue.
Depuis plus d’un mois, le peuple iranien connaît une situation dramatique. Les règles élémentaires de la démocratie, comme le respect des droits de l’homme, sont bafouées.
Le 23 juin 2009, des ressortissants britanniques en poste diplomatique à Téhéran ont été expulsés du territoire iranien.
Depuis le 1er juillet 2009, une Française, Clotilde Reiss, établie depuis cinq mois en tant que lectrice de français à l’université technique d’Ispahan, est accusée à tort d’espionnage et retenue par les autorités iraniennes, lesquelles sont en passe de faire de cette jeune femme un symbole face à l’Occident.
Originaire de la région Nord-Pas-de-Calais et ancienne élève de l’Institut d’études politiques de Lille, la jeune française doit savoir que ses compatriotes ne l’oublient pas et la soutiennent.
Monsieur le ministre, pour la deuxième fois en dix jours, vous avez pu vous entretenir avec votre homologue iranien au sujet de Clotilde Reiss.
Pouvez-vous nous tenir informés de la situation de cette jeune femme, qui n’est en rien impliquée dans les faits dont on l’accuse et mérite de recouvrer la liberté ?
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Madame le sénateur, notre ambassadeur a joint plusieurs fois au téléphone Clotilde Reiss et l’a rencontrée une fois ; vous avez bien raison de réclamer la libération immédiate de la jeune femme, puisqu’elle est innocente.
Elle est dans une prison épouvantable, …
… celle d’Evin. Comme elle parle couramment le persan - elle était en effet lectrice de français à l’université technique d’Ispahan -, elle peut au moins s’entretenir avec ses codétenues.
Nous l’avons trouvé résistante, vive, et évidemment désireuse, avant tout, d’obtenir sa libération.
Nous faisons tout, au plan juridique, pour répondre aux cinq chefs d’accusation qui pèsent sur elle. L’un d’eux, invraisemblable, est celui d’espionnage : elle n’a pas vingt-quatre ans, était en Iran depuis cinq mois et faisait son travail, ce que tout le monde a constaté. Pourquoi est-elle accusée d’espionnage ? Parce qu’elle a pris des photos avec son téléphone portable et les a envoyées à un ami français à Téhéran !
Cette accusation est ridicule.
Nous continuons à peser le plus possible sur le gouvernement iranien.
Je réponds au passage à Mme Voynet : oui, nous sommes témoins d’un mouvement qui nous semble promis à un avenir au sein du peuple iranien ; oui, nous constatons, pour la première fois depuis une trentaine d’années, l’existence de désaccords majeurs au sommet de la hiérarchie chiite. Il s’agit d’une lutte de pouvoir comme il s’en trouve dans tous les pays.
Nous avons appris aujourd’hui l’arrestation, le licenciement ou le limogeage, je ne sais quel terme employer, du patron de l’agence iranienne de l’énergie atomique, M. Gholamreza Aghazadeh.
Que lui reproche-t-on ? Il a simplement fait savoir publiquement au peuple iranien quelles étaient les questions que posait l’Agence internationale de l’énergie atomique au gouvernement iranien.
Encore une fois, mesdames, messieurs les sénateurs, nous prenons des nouvelles de Clotilde Reiss le plus souvent possible. Nous sommes en contact deux à trois fois par jour avec notre ambassade, notamment avec les personnes chargées du dossier, pour, un jour, le plus vite possible, faire libérer Clotilde !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Le Gouvernement devait présenter publiquement, la semaine dernière, la réforme de la taxe professionnelle. Or cette annonce a été repoussée pour permettre au Président de la République ainsi qu’à M. le Premier ministre de rendre les derniers arbitrages.
Il est urgent de jouer franc-jeu avec les collectivités territoriales, qui vont commencer d’envisager leurs projets pour 2010, qui ont répondu largement présentes dans la mise en œuvre du plan de relance et qui ne peuvent rester plus longtemps dans l’incertitude face au devenir de leur budget.
M. le Premier ministre leur doit, ainsi qu’à nos concitoyens, des réponses claires.
Tenu par la promesse électorale du candidat Nicolas Sarkozy faite au MEDEF, le Gouvernement va procéder, coûte que coûte, à la suppression de la taxe professionnelle, malgré un contexte économique des plus défavorables et des finances publiques dans un état désastreux.
Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat réclame, dans un rapport que nous allons discuter cet après-midi, « d’attendre des jours meilleurs ». Les socialistes sont favorables à une réforme de la taxe professionnelle ambitieuse pour le développement des territoires et des entreprises, mais ils ne veulent pas qu’elle ait lieu dans la précipitation estivale.
Nous soutenons l’instauration d’un véritable impôt économique local, dynamique, à l’opposé de la réforme proposée.
Outre la contribution sur la valeur ajoutée, qui ne représente qu’à peine la moitié du montant de la perte de recettes fiscales, M. le Premier ministre prévoit de transférer aux collectivités territoriales des parties d’impôts nationaux et des dotations, sur lesquelles elles n’auront strictement aucune marge de manœuvre.
De plus, le Gouvernement, en proposant une réforme uniquement axée sur la taxe professionnelle, fait l’impasse sur une réforme globale de la fiscalité locale, notamment des impôts reposant sur les ménages.
Nous savons tous, ici, quelles que soient les travées sur lesquelles nous siégeons, que la suppression de la taxe professionnelle aura pour conséquence inéluctable la hausse des impôts payés directement par nos concitoyens : c’est inacceptable !

Cette réforme aura aussi un coût important pour l’État, et creusera un trou qu’il faudra de toutes les manières combler.
Or nous refusons que la taxe carbone serve de palliatif budgétaire. D’ailleurs, sur ce point, tous les ministres ne sont pas unanimes.
M. le Premier ministre ne juge-t-il pas dangereux de maintenir une telle réforme, incomplète et inadaptée en ces temps de crise, alors que nos collectivités ont besoin de visibilité ? Sans visibilité, en effet, elles feront moins de projets, donc moins d’investissements.
Quel scénario va-t-il donc proposer aux collectivités locales ? Alors qu’il les a fortement sollicitées pour le plan de relance, osera-t-il porter un coup d’arrêt à l’investissement local en réduisant ainsi leurs moyens financiers ?

M. Jean-Claude Frécon. A-t-il l’intention de profiter de la période estivale pour asphyxier nos collectivités territoriales ?
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.- Exclamations sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur Frécon, vous êtes un trop fin spécialiste…
… de ces questions de financement des collectivités locales et d’investissement pour ne pas être d’accord avec moi sur le constat : en France, l’investissement, qu’il soit public ou, surtout, privé, est insuffisant.
C’est précisément pour cette raison que le Président de la République avait pris l’engagement devant le pays, et non devant le MEDEF, …
… de stimuler l’investissement et, pour ce faire, d’éliminer la part de la taxe professionnelle assise sur les équipements et biens mobiliers, c’est-à-dire sur l’investissement productif.
Tous les gouvernements qui se sont succédé depuis vingt ans en ont parlé. La qualifiant d’absurde ou d’imbécile, tous étaient d’accord pour considérer que la taxe professionnelle, qui frappe les investissements productifs, qu’ils soient utilisés ou non, d’ailleurs, et quel que soit le degré d’amortissement, n’est pas un bon impôt
Qu’avons-nous fait ? Sur l’initiative du Président de la République et sous l’autorité du Premier ministre, le Gouvernement a engagé tout un processus.
Je tiens à m’arrêter quelques instants sur la méthode, importante à mes yeux.
J’ai, à trois reprises, rencontré en séance plénière les associations représentant les collectivités territoriales, toutes catégories confondues ; j’ai, à trois reprises, rencontré les représentants des entreprises. Je les ai écoutés, nous travaillons de concert à l’élaboration d’un projet de réforme, en partageant nos informations, notamment les données chiffrées.
En effet, je sais que la taxe professionnelle constitue une ressource très importante des collectivités locales et que nous ne réussirons une réforme fondamentale pour nos entreprises, pour notre économie et pour l’emploi, que si elle est le fruit d’une concertation intelligente.
Je vais continuer d’appliquer cette méthode, fondée sur la concertation et la consultation, que j’ai faite mienne depuis le 5 février dernier, date à laquelle le Président de la République a pris cet engagement devant le pays.
Quels sont les principes qui nous guident ? Ce sont toujours les mêmes.
Premièrement, nous entendons supprimer la taxe professionnelle sur les investissements productifs.
Deuxièmement, nous voulons maintenir un lien étroit entre les entreprises et les territoires par le biais des collectivités territoriales.
Troisièmement, nous souhaitons maintenir l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Quatrièmement – ce principe a été rappelé par M. le Premier ministre –, nous voulons maintenir le financement des collectivités locales par niveau de collectivités.
Nous travaillons en considération de ces quatre principes. Nous réfléchissons également à la reliaison des taux, indispensable, selon nous, pour parvenir à une fiscalité équilibrée, qui permettra d’attirer les entreprises dans une bonne intelligence fiscale.
Notre objectif est très clair : grâce à cette méthode, nous voulons encourager les entreprises et l’emploi, et soutenir l’investissement. Le projet de loi de finances pour 2010 sera élaboré selon ces mêmes principes, et tendra à répondre à cet objectif que – je l’espère – nous cherchons tous ensemble à atteindre.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, il y a un peu plus de neuf mois, je traçais devant vous ce qui, à mes yeux, devait être un « nouveau cap » pour le Sénat. J’articulais cette ambition collective autour de deux idées : le retour du politique, l’image de notre assemblée.
C’est autour de ces deux thèmes initiaux que je voudrais organiser ce point d’étape en forme de compte rendu des engagements pris avec vous.
Notre action collective a été intense. Je ne sais s’il faut s’en féliciter, mais nous avons battu cette année le record du nombre d’heures et de jours de séance depuis le début de la Ve République : 950 heures et 124 jours. §Nous avons crevé le plafond de 120 jours de séance !

Au nombre moyen habituel de 5 500 amendements s’est substitué le chiffre de 11 000, dont 3 000 en commission, depuis le 1er mars.
En outre, 94 % des amendements adoptés dans cet hémicycle ont été retenus par l’Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Parallèlement, le temps du contrôle en séance publique a été multiplié par trois depuis le mois de mars, sous l’effet notamment des possibilités nouvelles qui nous ont été données en matière d’ordre du jour.
Mme Nicole Bricq s’exclame.

Mais, au-delà de ces chiffres, qui ne me semblent pas éloignés d’un point de rupture, monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement, ce qui importe, c’est la qualité de notre bilan législatif.
Le Sénat a imposé sa marque.
Au cours de quelque 106 heures de débat, avec sa commission des affaires sociales, le Sénat a contribué à modifier de manière équilibrée l’efficacité de la gestion future de nos hôpitaux publics.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Le Sénat a confirmé son engagement de toujours en faveur de la défense des libertés publiques et de la vie privée. Il l’a fait, par exemple, avec sa commission des lois, dans la loi pénitentiaire et dans le rapport remarqué sur le développement du numérique.
Avec sa commission des finances, le Sénat a mis en exergue l’effort nécessaire en faveur des petites et moyennes entreprises et de la fiscalité environnementale.
Avec sa commission de la culture, le Sénat a réussi, dans des conditions difficiles, notamment au départ, à imposer un financement pérenne pour la télévision publique ; ce n’était pas évident.
Avec sa commission de l’économie, le Sénat a confirmé le principe de 20 % de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants.

Avec sa commission des affaires étrangères, le Sénat a mis en œuvre sur le Moyen-Orient – dossier ô combien sensible ! – les tandems de rapporteurs majorité-opposition que nous appelions de nos vœux.
Les trois secteurs privilégiés d’intervention que je vous avais invité à partager, le 14 octobre dernier, ont fait l’objet de missions communes d’information.
La mission commune d’information sur l’organisation et l’évolution des collectivités territoriales a permis au Sénat de jouer tout son rôle dans les réflexions préalables sur les réformes annoncées. Et ce n’est pas fini !
La mission commune d’information sur la situation des départements d'outre-mer a amorcé une action de longue haleine. Nous la poursuivrons.
La mission commune d’information sur la crise financière a pris la forme originale et sans précédent de ce que j’avais appelé un « groupe de contact paritaire », entre députés et sénateurs.
Je crois qu’il nous faut continuer à oser des initiatives inédites.
Nous avons, en outre, décidé de mettre en place une quatrième mission pour réfléchir aux possibilités d’insertion de notre jeunesse. Je pense qu’il s’agit là d’un défi majeur.
Mais, surtout, nous avons donné un sens quotidien à ce qui, pour moi, constitue l’un des points majeurs de la « noblesse » de la politique : les vertus de la collégialité.
Ensemble, au sein de notre bureau, nous avons institué une gouvernance refondée : clarté, responsabilité à l’égard des deniers publics, collégialité ont été parmi les mots-clés de l’action que nous avons conduite.
Nous nous sommes attachés à poursuivre l’auto-réforme en renforçant nos contrôles internes, mais aussi en recourant – quand cela est apparu utile – à l’apport d’expertises extérieures. Je citerai l’audit annuel de nos comptes, l’analyse de notre politique de communication, l’étude sur l’adéquation de nos moyens à nos missions, l’audit sur le musée du Luxembourg.
Nous nous sommes recentrés sur notre cœur de métier : la loi, le contrôle, la prospective.
Et, ensemble, nous avons commencé à faire évoluer nos méthodes de travail. Hier soir encore, la conférence des présidents y a consacré une grande part de son temps.
L’esprit de dialogue a prévalu au sein du groupe chargé de l’élaboration de notre règlement, sous l’égide des deux rapporteurs, Jean-Jacques Hyest et Bernard Frimat.
Préférant les équilibres négociés aux solutions imposées, nous avons fait le pari de l’intelligence collective pour l’exercice de nos nouveaux pouvoirs. Nous avons recherché une meilleure maîtrise de notre temps et, de ce fait, une plus grande lisibilité et un intérêt accru de nos débats pour nos concitoyens. Nous avons voulu que cette démarche n’affecte pas le droit d’amendement et qu’elle renforce la dimension politique de nos travaux.
Je souhaite que ce choix pragmatique et de principe puisse servir la démocratie parlementaire.
Le rôle accru de la conférence des présidents devient une évidence : les décisions y sont désormais prises à la proportionnelle des groupes.
Nous avons recherché des moyens pour que les propositions de loi de l’opposition soient effectivement discutées.
Le Sénat a, de manière très concrète, accompagné la présidence française de l’Union européenne avec sa commission des affaires européennes, en confortant différentes initiatives lancées par les présidents Christian Poncelet et Bernard Accoyer.
Ensemble, il nous faudra confirmer l’état d’esprit de concertation que nous avons mis en place.
Ensemble, il nous faudra franchir une étape de plus dans l’organisation de notre travail législatif.
Nous devons mieux lier le travail en commission et le travail en séance publique
Mme Fabienne Keller approuve

Ensemble, il nous faudra mieux équilibrer le travail du Sénat entre son rôle législatif et sa mission de contrôle.
Le Sénat n’a pas attendu la réforme pour faire du contrôle l’une de ses priorités permanentes. Il a su le faire par des moyens de plus en plus diversifiés. Il faudra qu’il puisse continuer de valoriser cette spécificité dans le contexte d’un accroissement de ses missions.
Ensemble, il nous faudra coordonner au mieux le rôle d’impulsion de nos groupes politiques – renforcé par la révision constitutionnelle – avec l’expertise et l’espace de dialogue propres à nos commissions permanentes.
Il faudra que, dans la concertation avec chacun, nos délégations trouvent toute leur place.
Où, sinon au sein de la conférence des présidents, pourrons-nous y parvenir?
Ayant mis l’accent sur notre travail, nous serons plus forts pour renforcer notre communication sur l’essentiel et pour tenter de gagner la bataille de l’image.
Nous devons veiller à renforcer les modes de communication sur le travail sénatorial. Notre bureau a ouvert ce matin la voie à la réalisation de cet objectif. Pour l’atteindre, il nous faudra la contribution de chacune et de chacun d’entre vous.
Dans un monde touché hier par la crise financière, aujourd’hui par la crise économique et sociale, le Sénat, s’il occupe toute sa place, me semble avoir un rôle important à jouer, celui de « passeur » entre le vécu quotidien dans les territoires et les décisions prises à l’échelon national.
Par son rapport particulier au temps et aux territoires, le Sénat est aussi le lieu naturel de la réflexion sur l’avenir, en particulier lorsque les événements obligent à repenser l’économie et la société et à sortir de nos habitudes. Notre rôle de passeur n’est pas à sens unique. Il ne s’agit pas de nous faire seulement l’interprète des attentes et parfois des angoisses des populations, nous devons aussi éclairer nos concitoyens.
Les 343 sénatrices et sénateurs sont donc, oui, les « passeurs », dans les décisions nationales, de ce que vous avez appelé ici, à l’occasion d’une mission commune d’information, « l’intelligence territoriale ».
Je souhaite rendre publiquement hommage à nos collaborateurs : fonctionnaires du Sénat, collaborateurs de nos groupes politiques, assistants parlementaires.
Tous, à la place qui est la leur, ils ont su – souvent au prix d’un considérable investissement personnel – faire preuve d’une parfaite conscience professionnelle, mais aussi d’adaptation et d’inventivité face au changement. Ils auront encore à le faire en fonction des orientations données ce matin par le bureau du Sénat.
J’adresse également mes remerciements à la chaîne parlementaire Public Sénat, à son ancien et à son nouveau président, aux correspondants de la presse écrite et audiovisuelle accrédités au Sénat et à tous ceux qui ont bien voulu observer ce que nous faisons et en rendre compte.
Je souhaite que nous poursuivions les actions qu’ensemble nous avons entreprises et que nous continuions comme nous avons commencé, en « jouant collectif », dans le respect, bien entendu, des convictions et des engagements de chacun.
Si nous y parvenons, alors, plus personne ne se demandera à quoi sert le Sénat. J’ai envie de vous faire partager cette conviction.

M. le président. Mes chers collègues, beaucoup vous a été demandé, je sais que le Gouvernement en a conscience. Encore quelques jours et vous tous, comme votre président, allez pouvoir prendre des semaines de vacances estivales amplement méritées : je vous les souhaite très sincèrement revigorantes !
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Marques de satisfaction sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, je vous ai écouté avec l’attention que requièrent tout à la fois l’important bilan que vous avez dressé et les perspectives que vous avez tracées.
Je me trouve en cet instant dans une situation assez singulière, puisque, à quelques semaines près, j’aurais pu, tirant le bilan de la session ordinaire qui s’est achevée, me reconnaître dans les acteurs qui ont nourri et fait vivre le travail du Sénat. Je me sens d’autant plus fier de pouvoir m’adresser, au nom du Gouvernement, à ceux qui étaient il y a peu encore mes collègues et qui tiennent toujours une grande place dans mon cœur.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, du fond du cœur, je remercie les sénatrices et les sénateurs, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.
Vous le savez, j’apprécie à la fois la qualité du travail qui est ici mené, le sens du dialogue, le respect mutuel et, ce qui est très important, l’écoute : chacun a sa sensibilité, ses engagements politiques, mais, sur l’idéal, pas grand-chose ne nous sépare, sinon, éventuellement, les voies et moyens. Mais n’est-ce pas cette divergence des points de vue qui nourrit la démocratie ?
Monsieur le président, je souhaite également – c’est la première fois que je puis le faire publiquement dans cette enceinte – vous remercier. Je sais la passion que vous nourrissez pour cette maison, je sais tout le travail que vous y accomplissez pour que le Sénat remplisse pleinement son rôle au service de la République. Au cours de la première session ordinaire de votre présidence, vous avez, avec les membres du bureau, avec vos collaborateurs, avec chacune et chacun, engagé un certain nombre de changements et de réformes qui ont tous pour ambition de mettre le Sénat aux avant-postes de la République.
Mes remerciements iront encore aux présidents des groupes et à leurs collaborateurs – je sais la difficulté de la tâche, je ne l’ai pas oubliée -, ainsi qu’aux présidents des commissions, à tous les commissaires, et à l’ensemble des fonctionnaires du Sénat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous venons de vivre une session parlementaire tout à fait inédite, et ce pour deux raisons.
D’abord, depuis le printemps, se met progressivement en place la réforme constitutionnelle qui a été votée par le Congrès en juillet 2008. Ensuite, le Parlement, singulièrement le Sénat, a su répondre présent dans la crise financière, économique et sociale que nous traversons.
Sans être liés, ces deux éléments ont néanmoins permis au Sénat, dans une période de transition quant à ses méthodes de travail, de montrer un nouveau visage, en alliant sa vocation naturelle d’approfondissement à une très grande réactivité par rapport aux événements.
En premier lieu, s’agissant de la réforme de la Constitution, avec la loi organique, avec la réforme du règlement du Sénat, ce qui est en jeu, conformément à la volonté du Président de la République, du Premier ministre et du gouvernement à l’époque, c’est de permettre au Parlement d’être véritablement la caisse de résonance, autant que possible en temps réel, des problèmes que rencontre notre société.
Il importe de supprimer le décalage souvent observé entre le moment où l’on constate une situation et celui où le Parlement s’en saisit, décalage qui pourrait être interprété comme une distance par rapport à nos compatriotes et qui ne donne pas une image fidèle de la démocratie telle que nous la concevons en ce début du XXIe siècle.
Certes, nous, Gouvernement et Parlement, sommes dans une période de rodage, où il nous faut inventer, imaginer de nouvelles méthodes de travail, accroître notre confiance mutuelle, faire en sorte que l’hémicycle soit véritablement le cœur du débat républicain. Le Sénat – j’ai quelques raisons de le savoir – s’est engagé résolument et efficacement.
À l’évidence, avec de la bonne volonté et cette confiance que j’évoquais, nous parviendrons à atteindre cet objectif, même si quelques ajustements sont encore nécessaires.
En second lieu, je tiens à saluer la réactivité du Parlement, en l’occurrence du Sénat, face à la crise.
J’en veux pour preuve les délais très brefs dans lesquels, une fois arrêtées à l’échelon national, des dispositions importantes, pour le Gouvernement comme pour tous les Français, ont été examinées dans cette enceinte. Je veux parler, notamment, du plan de sauvetage du secteur bancaire, du plan de relance, ou des mesures prises en matière de logement.
Le Parlement s’est montré très en phase avec les mesures indispensables qui devaient être prises rapidement pour que leur efficacité soit garantie.
Monsieur le président, vous avez également rappelé, illustrant la densité de cette session, certaines lois très importantes votées par le Sénat, notamment des textes économiques, les lois relatives à l’outre-mer et à l’hôpital, qui ont fait l’objet d’un travail approfondi dans cette maison, travail que je tiens à saluer.
J’ajoute, s’agissant singulièrement des dispositions du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, que la validation imminente du Conseil constitutionnel sera aussi comme un hommage au travail qui a été accompli par le Gouvernement et par le Parlement, en particulier par les commissions compétentes et leurs rapporteurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je veux vous dire – cela soulèvera chez vous beaucoup d’enthousiasme, j’en suis persuadé – que l’ardeur réformatrice du Gouvernement ne s’est pas éteinte avec l’achèvement de la session ordinaire !
Sourires sur les travées de l ’ UMP.
Je peux vous l’assurer, le Gouvernement a l’intention d’inscrire à l’ordre du jour du Sénat, dès cet automne, des textes de grande portée, dont certains sont attendus depuis longtemps, qu’il s’agisse du Grenelle II, de la formation professionnelle continue ou de l’indispensable réforme des collectivités territoriales, qui donnera certainement lieu ici à des débats passionnants et éclairants, sans parler du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà le travail qui nous attend !
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous souhaite à toutes et à tous de prendre un repos bien mérité
Exclamations sur les travées de l ’ UMP
Monsieur le président, à ceux qui se demanderaient encore à quoi sert le Sénat, je répondrai avec vous tout simplement qu’il sert la République, ce qui est déjà formidable !
Vifs applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste. - Certains sénateurs du groupe socialiste applaudissent également.

Je vous remercie, monsieur le ministre.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures vingt, est reprise à seize heures trente-cinq, sous la présidence de M. Roger Romani.

Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir de saluer, au nom du Sénat, la présence dans nos tribunes d’une délégation du groupe d’amitié parlementaire Taïwan-France, conduite par sa présidente, Mme Li-Huan Yang.
Cette délégation est accompagnée par notre collègue Monique Papon, présidente du groupe d’information et d’échanges Sénat - République de Chine-Taïwan.
Nous sommes très sensibles à l’intérêt et à la sympathie que nos hôtes témoignent à notre institution.
Je leur souhaite la plus cordiale bienvenue et je forme des vœux pour que leur séjour en France contribue à améliorer les liens qui nous unissent. Pour cela, nous faisons confiance à Mme Monique Papon !
Mmes et MM. les membres du Gouvernement ainsi que Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention se fonde sur les dispositions de l’article 36, alinéa 3, de notre règlement, relatif à l’organisation de nos travaux.
Alors même que nous allons entamer un débat sur l’orientation des finances publiques pour 2010, on nous annonce une nouvelle diminution du taux de rémunération du livret A, qui passerait de 1, 75 % à 1, 25 % dès le 1er août prochain.
Le Gouvernement, en s’appuyant sur les dispositions du code monétaire et financier, prétend d’ailleurs qu’il adresse un bon signe à l’épargne populaire car la stricte application de la formule prévue par le code aurait dû conduire à réduire plus encore le taux de rémunération du livret A et le porter à 0, 25 % !
Mais, à la vérité, un an après l’adoption de la loi de modernisation de l’économie – on ne sait pas, d’ailleurs, ce que sont devenues les promesses de croissance dont elle était porteuse –, qui comportait, entre autres mesures, la banalisation du livret A, cela fait deux fois que la rémunération de ce produit d’épargne populaire est réduite.
Nul doute que l’opération menée contre le livret A, dont la centralisation de la collecte au bénéfice de la construction de logements sociaux est de moins en moins garantie, vise à créer un appel d’air vers de nouveaux produits appelés à connaître un certain succès cet automne, tels l’« emprunt Sarkozy », dont ni le montant, ni les conditions de rémunération ne nous sont pour le moment connus !
Nul doute que les banques, pour le moment peu collectrices du livret A, vont vite trouver, avec ce nouveau produit financier, de quoi réorienter l’épargne des ménages et celle de leurs clients et déposants !
Une telle situation est d’ailleurs porteuse de récession économique car elle met clairement en cause l’équilibre de nombreuses opérations de construction ou de réhabilitation de logements.
De fait, le Gouvernement se montre bien plus empressé à réduire le taux du livret A, dont le rendement est inférieur, par exemple, à la progression du CAC 40, notamment si l’on se réfère aux trois dernières séances de la Bourse, qu’à légiférer sur les stock-options ou sur la rémunération des dirigeants des banques, y compris celles qui ont passé convention avec l’État, ou à lutter contre la spéculation financière et la fraude fiscale qui continuent de grever lourdement le budget de l’État.
Le Gouvernement, avec le recours immodéré aux bons du Trésor sur formule, c’est-à-dire de très court terme, comme nous l’avons vu hier, offre d’ailleurs à certains épargnants bien informés les moyens de réaliser rapidement de fructueuses opérations de placement.
Cela méritait d’être souligné, mes chers collègues, alors même que notre ordre du jour nous appelle aujourd’hui à débattre de l’orientation des finances publiques.

L’ordre du jour appelle une déclaration du Gouvernement, suivie d’un débat, sur l’orientation des finances publiques pour 2010.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires sociales, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le président de la commission de la culture, monsieur le rapporteur général de la commission des affaires sociales, mesdames, messieurs les sénateurs, avec la crise, la mission régulatrice de l’État vient de reprendre une vigueur nouvelle.
Jamais, en effet, la politique budgétaire n’a été autant au cœur du débat public ; jamais elle n’a été autant sollicitée. Chacun perçoit désormais que le séisme économique mondial actuel constitue tout à la fois un risque et, même si nous ne l’avons pas choisi, une chance.
Le risque serait de voir, à la suite de cette crise financière, se multiplier d’autres crises, à la manière de poupées gigognes. Le risque serait surtout, derrière cet enchaînement diffus et dangereux, de voir se propager une mentalité de retrait, ainsi qu’une tendance à se défausser de l’intérêt collectif sur les générations futures.
La chance, c’est de comprendre que cette période, avec son lot de bouleversements, peut être l’occasion de moderniser la France et de permettre à notre pays de conquérir une puissance économique digne de ses talents.
Les choix budgétaires que nous arrêterons dans les semaines et les mois qui viennent peuvent se révéler fondateurs.
Or nous sommes fermement décidés à préparer l’avenir et à utiliser encore plus cette période de difficultés pour développer les capacités de notre pays, en ne nous contentant pas d’essayer de le préserver.
Préparer l’avenir, c’est d’abord sortir de la crise.
Préparer l’avenir, c’est évidemment amplifier la lutte contre nos déficits structurels et poursuivre nos efforts pour faire de la France une démocratie financière moderne.
Préparer l’avenir, c’est enfin identifier les domaines stratégiques dans lesquels nous devons investir pour mettre la France à l’heure du monde.
Aujourd’hui, en matière budgétaire, il serait aussi irresponsable d’en appeler à une politique de resserrement immédiat qu’à un assouplissement permanent.
Notre crédibilité va reposer tout à la fois sur notre capacité à savoir dépenser dans les secteurs qui permettront à la France de conforter sa place dans le concert des nations les plus performantes et sur notre aptitude à tenir le cap de la raison économique.
Durant trente-cinq ans, nous avons produit du déficit. Si nous voulons rester crédibles sur le long terme, nous ne pouvons plus nous permettre le moindre relâchement dans notre volonté de maîtriser nos dépenses publiques.
Dépenser à bon escient, au bon endroit, tout en restant rigoureux et responsables vis-à-vis des générations futures, ce n’est pas hors d’atteinte.
Pour assainir nos finances publiques, encore faut-il faire des choix précis et concrets, sur le plan tant des politiques publiques que de la gestion publique. Il doit s’agir de vrais choix, et non d’un simple élagage aléatoire cumulant tous les inconvénients, notamment une faible efficacité budgétaire et le risque d’entraîner une paralysie décourageante pour les administrations.
De vrais choix, mesdames, messieurs les sénateurs : voilà qui nous ramène à la politique dans sa fonction et sa pratique véritables.
Vous vous souvenez peut-être que, dès 2007, j’avais pris soin de présenter le budget en privilégiant, dans sa construction, les dépenses d’avenir.
Aujourd’hui, c’est bien l’ensemble de la dépense publique que nous voulons orienter vers l’avenir.
Mais avant d’aller plus loin dans mon propos, mesdames, messieurs les sénateurs, je commencerai par faire le point de l’année en cours.
Si les déficits se creusent – nous l’avons souligné hier lors de l'examen du projet de loi de règlement –, c’est bien en raison de la crise, mais c’est tout à la fois le coût de la crise et le prix de la relance. Telle est l’idée qui mériterait d’être gardée à l’esprit, s’il ne fallait qu’en retenir une seule.
Le déficit public atteindrait 7 à 7, 5 points de PIB en 2009. Cette dégradation d’un peu moins de 4 points de PIB d’une année sur l’autre, c’est la facture de la crise sous l’action conjuguée de la baisse énorme des recettes et, bien évidemment, du coût inhérent aux mesures de relance elles-mêmes.
Notre prévision de baisse du PIB, identique à celle de l’INSEE, est de 3 %, soit près de 5 % en deçà de notre croissance potentielle. En temps normal, l’effet de baisse de l’activité se traduirait donc par une hausse des déficits non pas de 4 points de PIB, mais d’un peu moins de 2, 5 points. Or, précisément, nous ne sommes pas en temps normal et les recettes fiscales se replient en fait bien plus vite que le PIB, en raison d’une élasticité beaucoup plus importante.
Prenons l’exemple des recettes d’impôt sur les sociétés. Alors qu’elles ont atteint 50 milliards d'euros l’année dernière, elles retomberaient brutalement cette année, oscillant entre 20 et 25 milliards d'euros, soit une baisse supérieure à 50 %.
Cette « sur-réaction » à la baisse de certaines recettes par rapport à l’activité explique un peu moins de 1 point de PIB de déficit. Il nous faudra, bien sûr, en analyser les raisons dans les mois à venir.
Concernant l’impôt sur les sociétés, je crois pouvoir d’ores et déjà confirmer une intuition que j’avais avancée dès le début de la crise, à savoir que l’IS pâtit non seulement de la baisse des résultats d’exploitation des sociétés, mais évidemment aussi de celle de leurs résultats financiers.
La réalité est là : nombre d’entreprises ont passé des provisions pour dépréciation de leur portefeuille de participation financières, ce qui réduit leur résultat fiscal. C’est donc la chute brutale du prix des actifs financiers concomitante au ralentissement de l’activité qui explique, en grande partie, cette sur-réaction. Finalement, la baisse du produit de l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus rapide que celle du PIB.
À ce jeu des stabilisateurs automatiques, qui est sans précédent par son ampleur, s’ajoute naturellement le coût budgétaire des mesures de relance, pour environ 0, 75 point de PIB.
Cette dégradation de près de 4 points de PIB s’explique donc bien intégralement par l’effet mécanique de la récession, avec la « sur-réactivité » de la diminution des recettes fiscales et l'augmentation d’un certain nombre de stabilisateurs, notamment celle des dépenses sociales.
À l’inverse, M. le président de la commission des finances le notait hier à cette tribune, les dépenses ordinaires, en d’autres termes, les dépenses « hors crise », pour employer une expression qui tend à entrer dans le langage courant, sont parfaitement maîtrisées : les dépenses de l’État hors relance sont contenues au niveau voté par le Parlement ; l’objectif national de dépenses d’assurance maladie sera, cette année, pour la première fois depuis 1997, respecté ou quasi respecté.
Le déficit de l’État atteindrait 125 à 130 milliards d'euros en comptabilité budgétaire, au sein duquel le déficit « hors crise », c'est-à-dire le déficit structurel, représenterait un peu plus de 40 milliards d'euros, contre environ 85 milliards d'euros pour le déficit dû à la crise, c’est-à-dire les deux tiers. Il faut noter qu’une partie du déficit, autour de 15 milliards d'euros, ne pèse pas sur le déficit « maastrichtien » – tout cela est certes compliqué, mais le fait de disposer d’indicateurs au niveau européen permet les comparaisons avec nos voisins –, notamment les prêts au secteur automobile ou les fonds versés au Fonds stratégique d’investissement.
Sur le montant total du déficit du régime général de la sécurité sociale, de l’ordre de 20 milliards d'euros, 10 milliards d'euros doivent être directement imputés à la crise.
À ce stade, il est sans doute utile d’indiquer ce qui se passe au-delà de nos frontières.
L’Espagne vient de réactualiser ses prévisions de déficit à 9, 5 points de PIB cette année. D’après les dernières prévisions de l’OCDE, les États-Unis passeraient en 2009 à plus de 10 points de PIB, probablement 12 points, et le Royaume-Uni connaîtrait également un déficit proche des 12 points. Même le déficit allemand, qui est inférieur au déficit français, se dégrade au même rythme que le nôtre, c'est-à-dire, je le répète, de 4 points de PIB en 2009.
Chez nous, le déficit public serait globalement stable en 2009 et en 2010, l’amélioration du déficit budgétaire étant malheureusement compensée par la poursuite en 2010 de la dégradation des comptes sociaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le déficit budgétaire se réduirait donc en 2010.
Les recettes de l’État se rétabliraient quelque peu avec le retour – modeste – de la croissance, et l’amorce du retour de recettes d’impôt sur les sociétés à un niveau moins atypique.
De plus, pour une large part, les dépenses de relance disparaîtraient : elles seraient ramenées à 3, 5 milliards d'euros. La maîtrise des dépenses « hors relance » se poursuivra, puisque celles-ci respecteront la norme « zéro volume », malgré la révision à la baisse de l’inflation. Ces dépenses hors relance progresseront donc de 1, 2 %.
Je tiens à souligner le rôle majeur que la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a eu dans le cadre de l’élaboration du budget 2010. J’ai pu, avec mes collègues, et sous l’autorité du Premier ministre, concentrer mon attention sur les budgets qui étaient les plus concernés par la crise et ses impacts macroéconomiques.
Plusieurs budgets ont d’ailleurs été revus à la hausse. C’est le cas notamment de l’emploi – ce n’est pas une surprise ! –, pour faire face à la montée du chômage, mais aussi d’un certain nombre de dotations sociales, compte tenu du nombre de leurs bénéficiaires. Le prélèvement sur recettes au profit de l’Union européenne augmente également, mais cela s’explique justement parce que notre situation économique s’est relativement moins dégradée que celle de nos partenaires !
À l’inverse, la révision à la baisse de l’inflation a conduit à réduire certaines dépenses, parmi lesquelles figurent les pensions, qui sont indexées, les charges de la dette, ou encore, la défense, laquelle, faisant l’objet d’une programmation en euros constants, subit les aléas de l’inflation. La baisse des taux d’intérêt a en outre allégé la charge de la dette.
Pour la plupart des autres budgets, les modifications ont été marginales par rapport à la loi de programmation. Cela prouve que ma volonté de mener, avec vous, la discussion et le vote de cette loi pluriannuelle jusqu’à son terme se justifiait bel et bien, malgré les incertitudes économiques.
Je veux le redire, cette loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 a toute son importance : elle représente, au fond, l’une des rares boussoles à notre disposition dans le domaine des finances publiques, dans un monde terriblement incertain.
Par ailleurs, nous poursuivons évidemment la politique dite du « 1 sur 2 », à savoir le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, avec des réductions d’effectifs atteignant 34 000 emplois équivalents temps plein en 2010.
Toutefois, comme je le disais, l’amélioration du déficit budgétaire serait compensée par la poursuite de la dégradation des comptes sociaux. En effet, le recul de la masse salariale de 0, 5 % en 2010 pèserait de nouveau sur les recettes du régime général, des régimes complémentaires de retraite et de l’UNEDIC.
Au total, le déficit s’établirait de nouveau en 2010 entre 7 et 7, 5 points de PIB.
On ne peut évidemment pas s’en réjouir, c’est le moins que l’on puisse dire, mais ces déficits sont, face à la crise, la traduction très concrète du rôle d’amortisseur social de la politique budgétaire.
En particulier, selon l’INSEE, le pouvoir d’achat des transferts sociaux devrait croître de 4, 8 % en 2009. Il faut l’avoir en tête, c’est deux fois la moyenne de ces vingt-cinq dernières années ! Voilà qui, je l’espère, mettra finalement un terme aux passes d’armes quelque peu dépassées auxquelles nous avons assisté ces derniers mois entre les tenants de la relance par la consommation et ceux de la relance par l’investissement.
Cette dynamique des transferts aux ménages, c’est notre système social qui joue à plein pendant la crise. C’est aussi l’action du Gouvernement, qui ne perd pas de vue qu’une société avancée se doit d’être solidaire. Il faut le dire, jusqu’au plus haut du sommet de l’État, nous sommes convaincus qu’il faut apporter plus de justice sociale à ceux qui sont touchés directement par la crise. Nous le faisons et continuerons à le faire, parce que, à nos yeux, c’est un devoir autant qu’un bénéfice pour le pays tout entier.
Plus de justice sociale, c’est, par exemple, l’augmentation du minimum vieillesse et de l’allocation aux adultes handicapés, c’est la prime exceptionnelle de fin d’année, la prime de solidarité active et c’est, bien sûr, depuis le 1er juillet dernier, le versement du revenu de solidarité active, nouveau venu dans notre paysage social.
Naturellement, il existe d’autres urgences, en particulier le soutien à l’investissement et à la trésorerie des entreprises, pour préserver au mieux notre appareil productif.
Mon collègue Patrick Devedjian et moi-même avons mis en place le plan de relance dans toutes ses composantes : les lois ont été votées, les primes versées, les crédits d’impôt restitués, les chantiers engagés, les dispositifs d’aide à l’emploi activés. Aucun autre pays n’a agi aussi vite et aussi fort.
Aujourd’hui, il ne se trouve guère d’observateurs objectifs pour critiquer le plan de relance. Au contraire, le FMI et l’OCDE en saluent à la fois le ciblage et le calibrage.
La question qui nous préoccupe à présent est donc plutôt de savoir ce que nous faisons à partir de là pour préparer l’après-crise tout en poursuivant notre effort pour sortir de la crise. Tout le monde reconnaît l’incertitude du calendrier de la reprise. Quelle sera sa force après une telle récession ? Comment évolueront les prix des actifs ? Qu’escompter comme croissance potentielle au lendemain d’une telle bourrasque ?
Je voudrais m’arrêter un instant, comme le fait M. le rapporteur général dans son rapport, sur la question de l’évolution de la croissance potentielle, sujet majeur pour les années à venir.
La crise révèle que le potentiel de croissance de la France et, surtout, du monde était, à l’évidence, surévalué. Il y avait bien un excès de demande dû à des bulles – bulles d’endettement privé des ménages, bulles immobilières –, bien d’autres, d’ailleurs, ayant explosé par le passé. Nous avons donc révisé à la baisse l’évaluation de la croissance potentielle, qui passe ainsi d’un peu plus de 2 % à environ 1, 75 %.
Mesdames, messieurs les sénateurs, faut-il aller plus loin et dire que le terrain perdu dans la crise ne sera jamais reconquis ?
Les Anglais l’ont fait. Cependant, notre situation est, me semble-t-il, en bien des points différente. Nous avons moins d’endettement des ménages, moins de prêts risqués, moins de bulle immobilière, notre secteur financier n’est pas surdimensionné par rapport aux autres secteurs de notre économie, enfin, par le jeu des stabilisateurs économiques automatiques et de dispositifs comme le chômage partiel, nous avons mieux conservé le « capital humain » de notre économie.
Je vous le concède volontiers, cela prendra du temps, mais nous mettons tout en œuvre pour reconquérir le terrain perdu.
Le Conseil européen des 18 et 19 juin a intégré cette dimension d’incertitude dans son approche : le redressement des finances publiques doit se faire au rythme de la reprise de l’activité.
Il faudra continuer à mener une politique budgétaire souple et éminemment réactive. Tel a été mon mot d’ordre jusqu’ici, afin d’ajuster au mieux le rythme d’assainissement des finances publiques. Ne l’oublions pas, à vouloir consolider trop tôt, au milieu des années quatre-vingt-dix, après quelques rares signes positifs, le Japon avait tué sa croissance pour dix ans, en montant notamment les taux de TVA de façon prématurée.
Ce sont les grandes orientations de l’après-crise que le Président de la République a indiquées dans son discours devant le Congrès et que le Premier Ministre a eu l’occasion de préciser lors d’un séminaire gouvernemental qui s’est tenu il y a une quinzaine de jours.
Dans cette situation inédite, plusieurs conditions doivent être respectées.
Premièrement, pour réussir l’assainissement des finances publiques, il convient de conserver aux mesures de relance leur caractère temporaire. Le Gouvernement s’y est engagé, car il s’agit de ne pas répéter une erreur qui a été trop souvent commise dans le passé.
Deuxièmement, une hausse des prélèvements obligatoires est exclue. C’est une condition sine qua non et en aucun cas un a priori idéologique. L’augmentation des prélèvements obligatoires dans un pays où ceux-ci représentent déjà 43 points de PIB est tout bonnement inenvisageable quand ce même ratio avoisine les 37 points en Allemagne et au Royaume-Uni, voire moins de 30 points aux États-Unis. Oui, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est tout bonnement inenvisageable, sous peine d’obérer la compétitivité et la croissance potentielle françaises et de peser, in fine, sur la soutenabilité des finances publiques.
Comme vous le savez, nous avons défini une stratégie en trois axes pour nos finances publiques : sécuriser les recettes ; réduire le poids de la dépense courante ; investir massivement dans les projets d’avenir. Si la presse n’en retient souvent que le troisième, les trois objectifs ont à mes yeux la même importance, car ils sont indissociables.
Nous aurons ainsi un vrai débat dans les semaines et les mois à venir sur notre capacité à investir dans les projets d’avenir.
Il faut donc sécuriser les recettes. Afin de compenser les pertes de recettes dues à la dégradation de l’activité, le surcroît de recettes qui interviendra au rythme de la reprise sera intégralement consacré à la réduction du déficit.
La lutte contre les déficits structurels doit être évidemment poursuivie. Depuis deux ans, tout est mis en œuvre pour infléchir drastiquement la dépense courante. Même si la crise l’a occulté, nous avons tout de même obtenu un certain succès. L’effort sera d’autant plus soutenu aujourd’hui que le Président de la République vient de nous appeler à mettre les bouchées doubles en la matière.
Soyons clairs : la dépense courante, pour moi, ce ne sont pas seulement les gommes et les crayons, loin de là ; j’en ai une vision extensive, qui inclut notamment les dépenses d’intervention et celles des opérateurs. Sinon, rien ne fonctionne !
La méthode que nous avons utilisée jusqu’à maintenant a porté ses fruits - nous avons contenu la dépense publique à moins de 1 % en euros constants l’année dernière -, mais elle ne suffira pas face aux défis qui nous attendent, compte tenu notamment de l’ampleur du champ auquel il faut s’attaquer. Il faut donc l’élargir et la renforcer.
Avec l’aide du Parlement, dans la lignée des États généraux de la dépense publique, une identification systématique de toutes les dépenses inutiles sera, encore une fois, réalisée.
La réforme de l’administration sera poursuivie.
La réforme des collectivités locales sera menée à bien, notamment sur la répartition des compétences, afin que tous les échelons administratifs contribuent plus efficacement au redressement des finances publiques.
Toutes les options envisageables pour la réforme des retraites seront examinées, avec des décisions en 2010.
La maîtrise des dépenses de santé sera quant à elle amplifiée : l’ONDAM peut être, selon moi, ramené à 3 % dès 2010 compte tenu de la baisse de l’inflation ; nous allons travailler en ce sens avec Roselyne Bachelot- Narquin pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale à venir.
Les niches sociales feront l’objet d’un examen systématique. Leur montant global s’élève à 42 milliards d’euros : 33 milliards d’exonérations de cotisations sociales, 9 milliards d’exemptions d’assiette diverses.
Depuis deux ans, nous avons agi sur deux leviers : nous avons rationalisé plusieurs dispositifs d’exonérations peu efficients et mis à contribution les stock-options, les « parachutes dorés », ainsi que l’intéressement et la participation au financement de la sécurité sociale. J’entends poursuivre et accentuer cette action dans le PLFSS 2010, notamment sur les « retraites chapeaux ».
Je vais également conduire un examen aussi critique des dépenses fiscales dans les mois qui viennent. Nous avons déjà travaillé sur deux axes, en réduisant certaines niches spécifiques et en instaurant le plafonnement global.
Je souhaite poursuivre sur ces deux voies : continuer de questionner certains dispositifs dont la pertinence et l’efficacité ne sont franchement pas avérées ; réfléchir aussi à une manière plus transversale de réduire le poids de la dépense fiscale globale.
Si aucune niche prise isolément n’est illégitime, il faut bien dire que le véritable dédale que constituent les niches fiscales ou sociales, sans parler des débats infernaux qu’elles suscitent entre les uns et les autres, devient difficilement gérable pour les finances publiques. Il faut donc, là aussi, redoubler d’effort et certainement inventer de nouvelles méthodes.
Avec la sécurisation des recettes et la réduction des dépenses courantes, le troisième pilier de la stratégie présentée par le Président de la République consiste à réorienter de manière résolue la dépense publique vers des projets d’avenir.
Le débat s’est curieusement focalisé sur les modalités de l’emprunt. À mon sens, c’est un point assez accessoire. L’emprunt n’est qu’un moyen, une modalité, et pas une fin en soi.
Le but ultime, c’est bien le redéploiement de nos dépenses vers les projets d’avenir. Ces projets seront financés par un emprunt dédié, qui donc ne pourra financer que des projets d’avenir prioritaires et clairement identifiés. Alain Juppé et Michel Rocard y travaillent. Aucune fongibilité ne sera possible avec le financement de la dépense courante, dont l’objectif est évidemment l’équilibre.
J’ajoute que nous imposerons, et c’est crucial, de rendre compte régulièrement sur les dépenses ainsi financées, et d’apporter la preuve qu’elles ont un intérêt et un rendement important pour les générations futures.
Ce processus pourrait d’ailleurs débuter, soit par une loi de finance rectificative, soit, le cas échéant, par un mini-débat d’orientation budgétaire au début de 2010, puisqu’en fin de compte il vous reviendra à vous, représentants de la nation, de trancher à la fois sur les priorités et sur les modalités de l’emprunt.
Permettez-moi de revenir sur la définition même des dépenses d’avenir.
Leur nature est, de fait, très variée : il peut s’agir d’engagements financiers pour soutenir des entreprises dans des secteurs de pointe, d’investissements physiques dans de nouvelles technologies, ou encore de certains investissements en capital humain, comme l’enseignement supérieur ou la recherche. Toutes ont évidemment une légitimité en termes d’avenir.
Mais, à mon sens, l’emprunt étant, par définition, une opération ponctuelle, la raison devrait nous engager à ne financer par l’emprunt que des dépenses non récurrentes. Cela ne préjuge en rien, naturellement, du montant et des modalités de l’emprunt. Des dépenses, même d’avenir, qui se renouvellent chaque année ont vocation à être financées par des recettes qui se renouvellent également.
Par ailleurs, je le disais en introduction, pour être efficace, il faut faire des choix. D’où le préalable de la grande consultation qui commence pour pouvoir choisir et hiérarchiser nos priorités nationales, tant il est vrai, mesdames, messieurs les sénateurs, que l’on ne peut pas tout traiter sur le même plan.
À la demande du Premier ministre, cette consultation devra déboucher dans la première quinzaine de novembre sur des projets forts et structurants, mais en nombre restreint. Ils devront apporter la preuve qu’ils ont une rentabilité financière et socio-économique élevée et devront associer le plus possible des cofinanceurs externes pour démultiplier les efforts de l’État.
L’enjeu, c’est donc bien de parvenir à faire le tri dans les dépenses publiques. En tant que ministre du budget, je tiens à souligner que je ferai preuve de la même détermination dans l’identification des dépenses les plus productives pour notre pays que dans la suppression, déjà entamée, de celles qui ne sont pas ou plus efficaces.
Ces réformes permettront de réorienter l’effort public vers les dépenses d’avenir, la progression de l’ensemble des dépenses publiques restant limitée à environ 1 % par an en volume sur l’ensemble de la dépense publique, c’est-à-dire sur quelque 1 000 milliards d’euros.
En ce qui concerne l’évolution globale de nos finances publiques à l’horizon 2011, on peut raisonnablement miser sur une reprise de la croissance plus forte, et, surtout, sur des recettes plus dynamiques lors de la reprise de l’activité.
Je prends à nouveau l’exemple de l’impôt sur les sociétés : passer du niveau 2009, c'est-à-dire de 20 à 25 milliards d’euros, pour simplement retrouver le niveau de 2007- 2008, c'est-à-dire 50 milliards d’euros, soit 100 % de plus, cela permet déjà de retrouver plus de un point de PIB, et ce sans augmentation d’impôt, juste par la reprise de l’activité et le retour du prix des actifs à une valeur plus en rapport avec leurs fondamentaux.
Entre la maîtrise de la dépense et ce dynamisme des recettes, on peut ainsi espérer une amélioration du déficit public de l’ordre de deux points de PIB en deux ans, à moitié par les recettes et à moitié par la dépense. Nous irons plus vite si la croissance est plus forte, mais l’important, c’est bien de marquer une inflexion forte par la dépense.
Donc, nous misons sur deux points de PIB en deux ans à partir de la reprise, à moitié financés par une augmentation des recettes et à moitié financés par une diminution des dépenses, soit 20 milliards d’euros au titre de la maîtrise de la dépense, ce qui n’est pas mince.
Selon les informations actuellement disponibles, nous ne pourrons donc revenir à trois points de PIB de déficit en 2012 sans un rebond extrêmement fort de la croissance, qui ne peut être exclu, mais que l’on ne peut prendre comme référence dans un débat d’orientation budgétaire.
La dette atteindrait 88 points de PIB à l’horizon 2012. C’est un niveau très élevé, mais qui resterait encore inférieur à celui que connaissent déjà actuellement plusieurs de nos partenaires.
Dire tout cela, ce n’est pas renoncer au pacte de stabilité, c’est prendre en compte la réalité des effets de la crise. Nous conservons l’esprit du pacte : nous ferons le meilleur effort d’assainissement possible des finances publiques, sans casser le retour de la croissance et tout en préparant la croissance de demain, pour retourner au plus vite sous les trois points de PIB, et réduire la dette. Dans leur quasi-totalité les pays européens sont confrontés à la même situation.
Intéressez-vous aux débats sur les finances publiques dans les autres pays européens : vous verrez que ce sont les mêmes qu’en France !
Même l’Allemagne a annoncé qu’elle ne pourrait revenir sous les trois points de PIB de déficit qu’en 2013 au mieux, voire en 2014.
Vous l’aurez compris, nous voulons que la France sorte de la crise plus grande et plus forte qu’elle n’y est entrée. Dans cette perspective, nous restons fidèles à ce que nous sommes et à ce que nous voulons.
Nous sommes convaincus que, si le renouveau de l’État doit passer aussi par une logique défensive, conjoncturelle, cette logique ne doit surtout pas éclipser, bien au contraire, notre devoir d’anticipation. La priorité, c’est évidemment de préparer l’avenir, c’est de poursuivre la modernisation de l’État et de convertir ou de reconvertir le modèle économique français.
Ce sont les réformes d’aujourd’hui qui créeront la croissance de demain et le pouvoir d’achat d’après-demain.
Contre la démagogie, contre la facilité, nous tiendrons donc bon sur les réformes, en particulier - j’en prends l’engagement - dans le domaine de la maîtrise de nos dépenses publiques.
À terme, il me semble en effet impossible de laisser perdurer une situation dans laquelle plus de un euro sur deux de richesse produite dans ce pays passe par la sphère publique. Revenir sous 50 points de PIB de dépenses publiques - hors relance et effets de la crise -, c’est trouver environ 60 milliards d’euros d’économies. Telle est l’ampleur exacte de notre déficit structurel.
Mesdames, messieurs les sénateurs, maîtriser la dépense est bien la voie à suivre pour durablement réduire nos déficits.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je m’exprime en cet instant à la fois comme remplaçant du rapporteur général de la commission des finances et comme président de la commission. Par conséquent, je vais bénéficier d’un double crédit de temps – soit deux fois dix minutes –, comme je m’empresse de le préciser à ceux qui seraient impatients.
Sourires

Notre séance d’aujourd’hui nous permet de débattre des grandes orientations des finances publiques, la loi organique relative aux lois de finances l’a prévu, l’a programmé, et je m’en réjouis. Ainsi, nous pouvons entendre les contributions respectives de la commission des affaires sociales et de la commission des finances, et nous sommes heureux de pouvoir en débattre avec le ministre chargé de l’ensemble des comptes publics.
Nous débattons aujourd'hui sur la base du rapport que le Gouvernement nous a transmis relatif à l’évolution de l’économie nationale et des finances publiques.
Mes chers collègues, je n’ai pas vraiment trouvé dans ce document la « description des grandes orientations de [notre] politique économique et budgétaire au regard des engagements européens de la France », pour reprendre les termes de la LOLF. Au fond, ce n’est peut-être pas plus mal, car, même si la France fait toujours l’objet d’une procédure pour déficit excessif, de tels développements auraient pu paraître artificiels, voire tout bonnement irréels.
En effet, lorsque l’on extrait des documents préparatoires les principaux chiffres, le vertige saisit : un déficit des administrations publiques de 7 % ou 7, 5 % du PIB, c’est deux fois plus que le maximum autorisé par nos engagements européens et trois points de plus que l’objectif que nous avons voté en février dans la loi de programmation des finances publiques !
Pour l’État, le Gouvernement envisage un déficit de l’ordre de 130 milliards d’euros en 2009 et en 2010, contre 56 milliards d’euros en 2008.
Côté recettes, celles de l’impôt sur les sociétés, qui rapporte théoriquement à l’État environ un cinquième de ses ressources fiscales annuelles, soit une cinquantaine de milliards d’euros, le produit sera divisé par deux cette année ! C’est une moins-value de 25 milliards d’euros.
Dernier exemple pour illustrer la profondeur de la crise, on constate un déficit de 20 milliards d’euros du régime général de la sécurité sociale, alors même que 27 milliards d’euros ont été transférés l’année dernière à la CADES, la Caisse d’amortissement de la dette sociale !
L’addition des deux déficits, 130 milliards d’euros pour l’État et 20 milliards d’euros pour la protection sociale, nous amène, mes chers collègues, à un total de 150 milliards d’euros !
Dans la tourmente, il nous faut un cap, un horizon au-delà de la préparation des textes financiers de l’automne. Nous devons évaluer l’impact durable de la crise une fois l’onde de choc passée, et nous demander quelle conduite tenir dans la situation nouvelle qui nous attend.
Mes réflexions me conduisent toujours vers les deux mêmes constats.
Premièrement, avec la crise, notre pays s’appauvrit. La question est de savoir comment on peut inverser la tendance et retrouver compétitivité et attractivité.
Deuxièmement, le poids de la dette risque d’asphyxier nos finances publiques. Comment retrouver des marges de manœuvre ?
La thématique de la dette a beaucoup occupé nos travaux préparatoires, mais, lorsque son montant dépasse les 1000 milliards d’euros, lorsque la perspective d’une France qui vivrait durablement avec un endettement stabilisé autour de 100 % du PIB n’est plus un scénario de science-fiction, il n’est pas étonnant que les parlementaires s’intéressent de plus près encore à son mode de financement.
Lorsque la dette atteint un tel volume, sans que cela – miracle de « l’insoutenable légèreté de la dette publique » – provoque la moindre tension sur le niveau des dépenses, il est légitime que nous recherchions les instruments qui permettraient une plus grande pédagogie sur les conséquences de l’endettement.
Je veux le souligner, ces préoccupations ont été partagées par les membres de la commission des finances bien au-delà des limites de la majorité sénatoriale.
Sans refaire le débat que nous avons eu hier à l’occasion de l’examen des amendements portant sur le projet de loi de règlement, je veux réaffirmer ici ma conviction qu’il faut assumer les conséquences de ses choix.
Nous avons fait le choix collectif, depuis 1975, de dépenser chaque année un montant supérieur à celui des recettes. Je rappelle que le dernier budget présenté en équilibre par un ministre des finances l’a été, à l’époque, par Jean-Pierre Fourcade !

Il faut assumer les conséquences d’un tel choix.
J’ai la faiblesse de penser que les termes du débat sont un peu faussés. Notre système de financement de la dette favorise la préférence pour le présent et anesthésie l’opinion en repoussant l’heure des vraies décisions.

Plus on repousse cette heure, plus les décisions seront difficiles à prendre.
C’est pourquoi j’ai la conviction qu’il convient, d’une manière ou d’une autre, de faire peser sur les dépenses du budget général le poids de l’amortissement du capital de la dette de l’État à raison, pourquoi pas ? de 2 % par an, c'est-à-dire l’amortissement de la dette en cinquante ans par tranche annuelle de 20 milliards d’euros.
Mes chers collègues, je citerai un exemple : la loi de finances rectificative pour 2007 a réglé le problème du service annexe de la dette de la SNCF. Le gouvernement précédent avait eu l’idée fantastique, pour désendetter la SNCF, de sortir une partie de la dette et de la placer dans un satellite n’apparaissant dans aucun compte public : de la pure magie !
L’État s’était engagé à verser chaque année une dotation dont le montant correspondait à l’annuité, capital plus intérêts, soit à peu près 677 millions d’euros.
En 2007, vous êtes chargé du dossier, monsieur le ministre, et vous prenez la décision qu’il fallait prendre, à savoir la reprise par l’État de la dette de la SNCF.
En 2008, bonne affaire, les intérêts sont repris, mais pas le capital. Autrement dit, sur les 677 millions d’euros de charges constatés en 2007, soit 400 millions d’euros au titre des intérêts et 277 millions d’euros au titre de l’amortissement du capital, on ne retrouve plus, en 2008, que les seuls intérêts !
C’est dire combien de tels procédés peuvent paraître anesthésiants et combien il est nécessaire de trouver, monsieur le ministre, les moyens de pratiquer une bonne pédagogie.
Avant de clore ce chapitre, il me faut vous remercier, monsieur le ministre, des engagements que vous avez pris hier en matière d’information du Parlement sur la politique de financement de l’État. Aujourd’hui, si le Parlement a conquis ses galons d’interlocuteur incontournable en matière de gestion budgétaire, il reste, convenons-en, un acteur plus marginal de la politique de financement de l’État.
La LOLF a posé les premiers jalons en prévoyant un vote sur le tableau de financement et sur la variation de la dette à plus d’un an. Mais quelle est la portée effective de ce vote ? Monsieur le ministre, j’ai consulté, sur le site internet de l’Agence France Trésor, la rubrique consacrée aux textes de référence. On y trouve une entrée « Loi organique relative aux lois de finances » qui fournit une liste des articles de la LOLF concernant l’Agence France Trésor, soit les articles 10, 19, 22, 25 et 26.
Curieusement, l’article 34, qui vise spécifiquement la première partie de la loi de finances initiale, avec l’autorisation des emprunts, et qui fixe le plafond de la variation de dette nette à plus d’un an, n’est pas mentionné. Est-ce un oubli ou un acte manqué ? Le rapporteur général, qui a lu Kundera, aurait peut-être parlé de plaisanterie !
Au-delà de l’anecdote, il faut remédier au déséquilibre institutionnel qui apparaîtrait s’il y avait durablement contradiction entre l’intérêt financier du pays, servi avec talent par l’Agence France Trésor et qui la conduit à privilégier le financement à moins d’un an, et la portée du vote de la représentation nationale, qui a trait à la variation nette de la dette à plus d’un an. Votre proposition, monsieur le ministre, va dans le bon sens, et nous tenons à vous en remercier.
Mes chers collègues, l’obsession de la lutte contre l’endettement n’est pas une lubie ou une tocade. Elle vient de la conscience aiguë qu’a la commission des finances des menaces que la dette fait peser sur notre modèle social en nous contraignant à sacrifier au service de la dette une part importante des dépenses de transfert, auxquelles les Français sont attachés, et une part tout aussi importante des dépenses d’investissement, si nécessaires à la préparation de notre avenir.
Lorsque le produit de l’impôt sur le revenu ne suffit plus à payer la charge de la dette, on ne peut que s’inquiéter de notre capacité financière à relever les défis qui sont devant nous.

Or ces défis sont immenses. La crise cause à notre pays des dommages irréparables. Sur ce point, monsieur le ministre, je rappelle que, selon les calculs de la commission des finances du Sénat, la perte potentielle de PIB pourrait atteindre 5 points.
Le Gouvernement a révisé à la baisse son estimation du taux de croissance potentiel, le ramenant de 2, 2 % à 1, 75 %.
De fait, nos perspectives de croissance sont inférieures à la moyenne de la zone euro. L’Allemagne, qui subit en 2009 une récession près de deux fois plus sévère que la nôtre, retrouverait la croissance dès le début de 2010.
Après la crise, notre pays ne sera plus le même que ce qu’il était encore l’année dernière. Nous devons malheureusement anticiper un nouveau « coup de torchon » sur les entreprises productrices de biens et de services ainsi que sur l’économie. Il y aura de nouvelles délocalisations, des industries auront disparu, le chômage sera plus élevé, la population sera plus âgée, certains comportements économiques seront peut-être transformés.
Le potentiel de croissance ne sera malheureusement sans doute pas ce qu’il était avant le déclenchement de la crise.
Cependant, notre pays, vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, a la capacité d’absorber les effets de ces mutations profondes, à condition que l’on y voie clair sur la voie à suivre et que l’on prenne les décisions structurelles qui, en rendant possible ce qui est souhaitable, permettront de reconstituer notre croissance potentielle.
Je vois quatre domaines dans lesquels nous avons besoin de prendre des décisions courageuses.
Le premier domaine est la maîtrise des dépenses.
Le Gouvernement confirme qu’il tiendra bon sur la stabilisation en volume des dépenses dans le cadre d’enveloppes pluriannuelles qui, conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, offrent de la visibilité aux gestionnaires de crédits. Il projette le non-remplacement d’un départ en retraite sur deux dans la fonction publique. Il annonce une deuxième phase de la révision générale des politiques publiques.
Je forme le vœu que cette deuxième phase soit très ambitieuse, car, du fait de notre niveau d’endettement, nous ne pourrons plus longtemps nous satisfaire d’une stabilisation en volume des dépenses : nous devrons nous fixer l’objectif d’une stabilisation en valeur.
Il faudra une réforme administrative profonde pour parvenir à stabiliser les dépenses en valeur tout en maintenant les exigences d’un service public de qualité. Il faudra un effort de l’ensemble de la sphère publique. En l’état actuel des prévisions, le besoin de financement des administrations publiques resterait, en 2012, compris entre 5 % et 7 % du PIB.
Évidemment, en période de récession, il convient avant tout de s’assurer que la machine économique continue de fonctionner. Le plan de soutien au financement de l’économie joue ce rôle en assurant que le crédit continue d’être distribué.
La relance budgétaire a aussi les effets positifs que l’on attend, surtout lorsqu’elle prend la forme de dépenses non récurrentes et qu’elle sert au financement d’infrastructures dont la réalisation est de nature à redresser notre taux de croissance potentiel.
Le plan de relance engagé depuis la fin de l’année dernière produira ses effets en 2009 et en 2010. L’injection dans l’économie des sommes prélevées au titre de l’emprunt national prendra alors sans doute le relais.
S’agissant de cet emprunt, vous savez, monsieur le ministre, que la commission des finances a des idées sur la façon dont il pourrait être souscrit et rémunéré. Nous serons heureux de vous les faire partager !
Nous pensons, notamment, qu’il faudrait, pour que cet emprunt ait du sens, qu’il soit l’expression d’une nation désireuse de renverser les tendances et d’accepter, sans doute, un taux d’intérêt inférieur au taux du marché, faute de quoi l’emprunt sera probablement assez banal.
Le deuxième domaine dans lequel une action structurelle doit être engagée est la réforme territoriale, qui nous occupera à l’automne. Elle doit, selon moi, s’accompagner d’une réforme de l’État déconcentré.
J’appelle, à ce sujet, votre attention sur la treizième des vingt propositions contenues dans le rapport Balladur, passée trop inaperçue à mon avis, qui préconise de supprimer les services déconcentrés dans les domaines où les compétences sont exercées non plus par l’État, mais par les collectivités territoriales.
Sur le plan économique, il est indispensable de préserver la capacité d’investissement des collectivités territoriales, qui sont le poumon de l’investissement public.
En préparation de ce débat, nous avons auditionné le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance, M. Devedjian. J’ai cru comprendre qu’il appelait à une forme de pérennisation de la mesure de versement anticipé des attributions au titre du Fonds de compensation pour la TVA. Il n’est pas douteux que les collectivités territoriales, qui assument les trois quarts de l’investissement public, participent à la relance, que 2009 ne suffira pas et qu’il faudra soutenir cet effort également en 2010.
En 2009, les collectivités auront perçu les versements du Fonds de compensation pour la TVA au titre de deux années, 2007 et 2008. Peut-être pourront-elles percevoir en 2010 les recettes pour 2009 et 2010 ? Nous aurons l’occasion d’en reparler à l’automne.
Le troisième domaine est la protection sociale. Mme Dini et M. Vasselle en parleront mieux que moi. La commission des finances évoque les dépenses sociales dans son rapport, où elle aborde, notamment, la question du déficit de la branche vieillesse, les effets attendus de la réforme de l’hôpital ou encore les enjeux de la prise en charge de la dépendance.
Cependant, il ne faut pas éluder la question du mode de financement de ces dépenses. Les cotisations sociales sont des « droits de douanes à l’envers » qui, par exemple, fragilisent les efforts que nous déployons par ailleurs pour améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises, ainsi que celle du travail.
Cette situation, monsieur le ministre, ne peut pas durer. Il n’y a pas de fatalité à ce que le financement de la protection sociale – famille et santé – soit un obstacle à notre compétitivité et à notre attractivité, sinon, mes chers collègues, comment retrouverons-nous notre potentiel de croissance ?
Cela me conduit au quatrième domaine que je souhaitais évoquer et qui est le vrai sujet, celui dont dépendent à la fois notre capacité à endiguer la spirale de la dette et la restauration de notre compétitivité, je veux parler des prélèvements obligatoires.
Notre pays dispose de nombreux atouts. Les agences de notation lui conservent leur confiance en relevant la diversification de son économie et son « leadership mondial », mesuré par le nombre de ses grandes entreprises. Mais les grandes entreprises participent peu à la croissance du PIB ici, en France.
Notre pays fait partie des quatre ou cinq « champions » de l’Union européenne en termes de poids des prélèvements obligatoires, derrière la Suède, le Danemark et la Belgique.
Au-delà du niveau des prélèvements, nous devons restaurer la cohérence de notre système fiscal pour le mettre au service de la compétitivité de notre pays. Nous réfléchissons à un « triptyque » qui permettrait d’aller dans ce sens en remettant à plat l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune et le bouclier fiscal.
Plus largement, nos choix collectifs changent, leur mode de financement doit s’adapter.
À cet égard, je veux saluer le travail du groupe de réflexion présidé par Fabienne Keller au sein de la commission des finances, dont le rapport doit, à mon avis, servir désormais de référence préalable à toute réflexion sur la fiscalité écologique.
Je note, en tout cas, que la notion de « sécurisation des recettes » fait son chemin, même si elle n’est pas encore une règle absolue, pour le bonheur des restaurateurs, par exemple… À titre personnel, je regrette que l’on ait abaissé la TVA de 19, 6 % à 5, 5 %.
Il faudra, en tout état de cause, que cette règle de sécurisation trouve à s’appliquer lors de la réforme de la taxe professionnelle.
À terme, nous arriverons, j’en suis sûr, à rendre obsolète la distinction entre les impôts qui reposeraient sur les ménages et ceux qui seraient à la charge des entreprises. En effet, in fine, seuls les ménages, qu’ils soient contribuables, consommateurs, salariés ou épargnants, supportent le poids de la fiscalité. Si nous voulons éviter que les phénomènes de délocalisation ne se prolongent encore, rendant ainsi plus difficile le rétablissement de notre potentiel de croissance, il nous faut ouvrir ce débat devant l’opinion publique en vue de faire émerger les solutions d’avenir et d’engager des réformes en profondeur.
Nous retrouverons tous ces sujets à l’automne, en particulier lors du débat sur les prélèvements obligatoires et de la discussion de la première partie du projet de loi de finances. Je voulais les évoquer dès aujourd’hui car la stratégie économique de notre pays, dont les finances publiques constituent une composante importante, doit être globale. En dépenses comme en recettes, l’heure n’est plus aux rustines ni aux colmatages, elle est aux décisions qui engagent résolument notre avenir.
Vous nous avez dit, monsieur le ministre, que vous espériez que la France sorte plus grande et plus forte de cette crise qui l’affecte depuis maintenant plus d’un an. Nous vous soutenons pour qu’il en soit ainsi. Pour cela, nous devrons faire œuvre de pédagogues, afin que la lucidité s’impose à tous les esprits et que l’on se prépare aux réformes. Pour que celles-ci aboutissent, nous devrons faire preuve à la fois de courage et d’esprit de justice !
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat d’orientation des finances publiques prend place cette année dans un contexte que je n’hésite pas à qualifier de particulièrement préoccupant pour les finances sociales. Ma première intervention dans cet hémicycle en tant que présidente de la commission des affaires sociales sera donc empreinte d’une certaine gravité.
Notre débat d’aujourd’hui me paraît en effet crucial : il s’agit de déterminer les meilleures orientations possible pour nos finances publiques et sociales compte tenu d’une situation extrêmement dégradée – un déficit de 20 milliards d’euros pour le régime général en 2009 et d’environ 30 milliards d’euros en 2010 – et de perspectives encore très incertaines pour les années suivantes. Certes, la crise explique une partie de nos difficultés. Mais, au total, il faut surtout retenir qu’une dégradation d’une telle ampleur est inédite pour notre pays. Elle signifie que, n’ayant pas réussi à résorber un déficit d’environ 10 milliards d’euros par an depuis 2004, nous devrons bientôt faire face à un socle de déficit annuel de l’ordre de 30 milliards d’euros. Un tel changement d’échelle est sans précédent pour nos comptes sociaux. Ni les discours ni les recettes du passé ne pourront nous permettre d’y porter remède. Il y a pourtant urgence, car notre système de protection sociale ne pourra survivre à de tels déficits.
Nous avons souvent dit dans cet hémicycle, en particulier à l’occasion de ce rendez-vous annuel sur les perspectives des finances publiques, qu’il fallait cesser de reporter les dépenses d’aujourd’hui sur les générations de demain !

Or nous n’avons jamais dépassé le stade de l’incantation ni traduit par de réelles mesures d’assainissement ce que nous pensions constituer un engagement. Nous ne pouvons donc plus nous contenter de décisions ponctuelles, que ce soit pour nous permettre de revenir à l’équilibre – un immense défi à soi seul ! – ou, plus encore, pour faire face à l’enjeu que constitue le vieillissement de la population. Celui-ci, vous le savez, est bien réel : en matière de retraites, de santé et de dépendance, il pourrait se traduire par au moins trois points de PIB de dépenses supplémentaires d’ici à 2050.
Je vous présenterai les principaux éléments du diagnostic établi par la commission des affaires sociales. Alain Vasselle, nouveau rapporteur général de cette dernière, mais déjà rapporteur-président de la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale, la MECSS, et expert éprouvé et reconnu des comptes sociaux, vous décrira tout à l’heure les conditions que la commission des affaires sociales estime indispensables pour parvenir à un vrai retour à l’équilibre.
Où en sommes-nous aujourd’hui ? La commission des comptes de la sécurité sociale a publié les chiffres définitifs pour 2008 : le déficit du régime général s’est finalement élevé à 10, 2 milliards d’euros, en phase avec les dernières prévisions. Les recettes de la sécurité sociale sont restées relativement dynamiques, le ralentissement économique n’ayant commencé à produire ses effets qu’en toute fin d’année.
La branche maladie a poursuivi son redressement avec un déficit ramené de 11, 6 milliards d’euros en 2004 à 4, 4 milliards d’euros. La réduction très importante de ce dernier est un résultat positif incontestable, surtout si l’on songe que les dépenses de santé, par nature extrêmement dynamiques, progressent toujours à un rythme supérieur à celui de la richesse nationale.
En revanche, la branche vieillesse a vu son déficit se creuser fortement pour atteindre 5, 6 milliards d’euros sous l’effet à la fois du départ à la retraite des générations du baby-boom et de la poursuite des départs en retraite anticipée pour carrière longue.
Pour 2009, la situation est tout autre, puisque le déficit du régime général devrait doubler et s’établir, selon les dernières prévisions, à 20, 1 milliards d’euros. Si l’on y ajoute le déficit du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV, ce montant pourrait même atteindre 22, 2 milliards d’euros.
L’essentiel de cette évolution est dû à l’arrêt brutal de la croissance des recettes, alors que celles-ci progressaient régulièrement au cours des dernières années : les cotisations sociales devraient ainsi stagner en 2009, et les recettes de la contribution sociale généralisée, ou CSG, diminuer.
Ce constat inspire deux réflexions à la commission des affaires sociales.
Premièrement, nous avions exprimé notre scepticisme quant aux hypothèses économiques très volontaristes qui sous-tendaient la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009. Je ne prendrai qu’un exemple : le projet de loi tablait sur une croissance de la masse salariale de 2, 75 % ; or, celle-ci devrait diminuer de 1, 25 %. Il y aurait donc, au minimum, quatre points d’écart entre la prévision et la réalité, ce qui bouleverse naturellement les équilibres initiaux.
Deuxièmement, la commission s’interroge sur l’absence de projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. N’aurait-il pas été justifié de demander au Parlement de prendre acte, à défaut de mesures correctrices, de la caducité totale des équilibres votés en fin d’année dernière ? Je souligne au passage que, dans le même temps, pas moins de deux collectifs ont été votés en matière budgétaire...
Quoi qu’il en soit, ces pertes de recettes font s’effondrer les comptes de chacune des branches – elles affichent désormais toutes un déficit –, malgré une croissance des dépenses relativement maîtrisée. La branche maladie pourrait ainsi connaître un déficit de 9, 4 milliards d’euros, la branche vieillesse de 7, 7 milliards d’euros, la branche famille de 2, 6 milliards d’euros et la branche accidents du travail–maladies professionnelles de 0, 3 milliard d’euros.
Pour la branche maladie, je vous rappelle que le comité d’alerte du 29 mai 2009 n’a pas constaté de dérapage de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM. Il a seulement noté un dépassement de l’ordre de 300 à 500 millions d’euros. Il a mis en exergue la progression dynamique des indemnités journalières et des frais de transport, ainsi que le retard pris sur certaines mesures d’économie, comme les baisses de tarifs ou de médicaments, la limitation du nombre de séances de soins paramédicaux, l’encadrement des transports sanitaires par taxis ou l’augmentation du ticket modérateur en cas de non-respect du parcours de soins. La commission des affaires sociales estime que tout doit être fait pour corriger cette situation et pour revenir à un respect strict de l’ONDAM pour 2009.
Pour la branche vieillesse, je note un motif de satisfaction : la maîtrise des charges liées aux départs en retraite anticipée grâce à un meilleur encadrement de cette mesure. En revanche, le FSV, qui avait retrouvé une situation excédentaire en 2007 et en 2008, renoue avec un déficit massif en 2009 – de l’ordre de 2, 1 milliards d’euros –, sous l’effet de l’augmentation du chômage et du transfert d’une partie de ses ressources vers la Caisse d’amortissement de la dette sociale, la CADES. Alain Vasselle vous fera part de la position de la commission des affaires sociales sur ces « tuyauteries » qui, si elles apportent une solution à un instant donné, constituent rarement de bonnes réponses à moyen terme, ainsi que nous l’avons trop souvent constaté.
S’agissant de 2010, nous disposons encore de trop peu d’éléments. Les premières prévisions font état d’un déficit du régime général s’élevant à environ 30 milliards d’euros, chiffre évidemment considérable, sans précédent et, je n’hésite pas à le dire, très inquiétant. Ce rapide tableau des comptes sociaux montre en effet l’ampleur des difficultés à résoudre et donne la mesure du chemin à parcourir non plus pour revenir à l’équilibre, mais simplement pour stabiliser nos déficits.
À cet égard, monsieur le ministre, nous regrettons – nous l’avions malheureusement déjà souligné les années précédentes – que le document préparatoire au débat d’aujourd’hui soit aussi succinct s’agissant des finances sociales. En particulier, il ne mentionne toujours pas la trajectoire pluriannuelle détaillée de l’évolution de l’ONDAM, comme le prévoit pourtant la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. C’est dommage, car la définition d’objectifs clairs que tous pourraient s’approprier est désormais une priorité : c’est à cette seule condition que les modalités concrètes de leur respect pourront ensuite être déterminées.
Vous nous apportez néanmoins l’assurance que la nouvelle discipline issue de la loi de programmation des finances publiques en matière de recettes et de niches sociales sera respectée. Nous le souhaitons vivement, car nous éprouvons à nouveau quelques inquiétudes quant à cette nécessité, affirmée depuis longtemps par la commission des affaires sociales.
À ce sujet, permettez-moi, monsieur le ministre, de formuler deux séries de remarques.
En premier lieu, la commission des affaires sociales présente régulièrement des propositions raisonnables et concrètes trop souvent écartées par le Gouvernement. J’en veux pour preuve notre vote d’il y a trois ans pour taxer les stock-options ou celui d’il y a deux ans pour instituer une flat tax sur les niches sociales. Dans les deux cas, vous nous avez contraints à revenir sur ces dispositions pour, un an après, les proposer vous-même dans le cadre des lois de financement de la sécurité sociale. Nous avons perdu, au passage, une année... M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales va à nouveau vous présenter aujourd’hui un certain nombre de mesures que je souhaite voir retenues dans le cadre de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.
En second lieu, permettez-moi de vous redire combien il nous paraît important que le Parlement soit pleinement et parfaitement informé sur la situation des finances sociales. À cet égard, je renouvelle des demandes plusieurs fois formulées par la commission des affaires sociales : un chiffrage précis de l’incidence de toutes les mesures nouvelles envisagées, ce qui exige d’enrichir l’exposé des motifs ainsi que l’annexe 9 du projet de loi de financement de la sécurité sociale ; un cadrage pluriannuel plus étayé, avec des scénarios d’évolution plus solidement établis à partir d’hypothèses crédibles et différenciées. Nous devons disposer d’éléments aussi transparents et précis que ceux qui sont désormais disponibles en matière de loi de finances.
En conclusion, je voudrais insister sur le caractère stratégique de l’année 2010. Des décisions majeures, peut-être douloureuses, devront être prises pour inverser les tendances actuelles et pour permettre, dans un premier temps, une stabilisation de nos déficits, puis, dans un deuxième temps – c’est ce que nous espérons –, un retour à l’équilibre à moyen terme de nos comptes sociaux.
Nous ne pouvons plus repousser encore les échéances. Je souhaite que, dès le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, les décisions du Gouvernement traitent réellement et en profondeur l’ensemble des questions qu’Alain Vasselle et moi-même évoquons aujourd’hui devant vous.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales.

M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, me voilà élevé à une fonction quelque peu plus solennelle : celle de rapporteur général de la commission des affaires sociales, notamment pour la loi de financement de la sécurité sociale ! Je ne peux que m’en réjouir.
M. Jean-Jacques Jégou s’exclame.

Les propos que je vous tiendrai ne vont cependant pas changer au motif que j’ai été élevé à ce rang !
Exclamations sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Je tiens ici à remercier publiquement M. le président du Sénat d’avoir, avec la réforme du règlement du Sénat, permis à la commission des affaires sociales de démontrer, par son action et par son suivi des finances sociales, que la commission des finances n’a pas le monopole de la rigueur dans la gestion des dépenses et des recettes. S’agissant des dépenses prévues par la loi de financement de la sécurité sociale, les membres de la commission des affaires sociales sont animés du même souci de rigueur et d’analyse que les membres de la commission des finances lorsqu’ils examinent le projet de loi de finances.

Cela dit, mes chers collègues, je voudrais vous rappeler que nous espérions encore, voilà moins d’un an, un retour à l’équilibre des comptes sociaux en 2012. Malheureusement, comme l’ont indiqué tout à l’heure la nouvelle présidente de la commission des affaires sociales, Mme Dini, et M. Woerth, dans son propos liminaire, le déficit atteindra fort probablement un montant de 20 milliards d’euros à la fin de l’année 2009, si ce chiffre n’est pas dépassé en raison de l’évolution de la conjoncture et de la situation économique, de la situation de nos entreprises et de l’éventuelle progression du chômage.
Cela n’augure guère d’un avenir réjouissant puisque la probabilité de voir le déficit de l’année 2010 atteindre le montant de 30 milliards d’euros est forte.

Le déficit cumulé des années 2009 et 2010 pourrait donc atteindre 50 milliards d’euros. Comme M. le ministre l’a rappelé tout à l’heure, si aucune réforme structurelle n’est engagée, le déficit cumulé des comptes sociaux pourrait ainsi s’élever à 80 milliards d’euros, montant inédit qui fait froid dans le dos.
Bien sûr, la dégradation massive des comptes sociaux résulte, cette année – M. le ministre des comptes publics l’a rappelé tout à l’heure –, des effets de la crise économique. Cela dit, il faut bien reconnaître que, si la sécurité sociale avait affronté cette crise sans le handicap considérable d’un déficit structurel de 10 milliards d’euros, elle aurait pu y faire face dans des conditions tout à fait différentes de celles que nous allons connaître. Le retard que nous avons pris dans l’engagement de réformes structurelles, dont chacun sait depuis longtemps qu’elles sont absolument indispensables, pourrait être payé fort cher dans le contexte de la récession actuelle.
Il faut, mes chers collègues, prendre dès à présent conscience de la chose suivante : le retour de la croissance au niveau antérieur à la crise permettra seulement de stabiliser le déficit à son niveau d’après-crise, soit, peut-être, 30 milliards d’euros. Or, si la sécurité sociale a pu supporter, depuis 2003, des déficits annuels de l’ordre de 10 milliards d’euros au prix d’un accroissement important de la dette sociale, elle ne résistera pas à plusieurs années d’un déficit qui se stabiliserait à 30 milliards d’euros.
Sans vouloir aucunement dramatiser les enjeux, je crois que la situation actuelle menace la pérennité de notre système de protection sociale et que nous devons agir avec vigueur, sans attendre et sans croire que le retour de la croissance arrangera tout.
Mme la présidente de la commission des affaires sociales ayant détaillé tout à l’heure la situation des comptes, je n’y reviendrai pas. Qu’il me soit cependant permis, monsieur le ministre, d’insister sur la nécessité d’une présentation par le Gouvernement, lors de l’examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, d’hypothèses économiques réalistes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 était effectivement caduque dès son adoption ! Il vous a fallu corriger un certain nombre d’éléments au cours de son examen pour essayer de vous rapprocher de la réalité de la situation !
Sur la base des prévisions inscrites dans cette loi, nous avons transféré des ressources de CSG du FSV vers la CADES, pour permettre à cette dernière de faire face à une nouvelle reprise de dette. Le résultat, c’est que le FSV, qui avait renoué avec les excédents, sera en déficit de plus de 2 milliards d’euros cette année.
De même, M. Fillon, alors ministre des affaires sociales, avait pris le pari que nous pourrions transférer des cotisations chômage vers les cotisations vieillesse pour un montant non négligeable de l’ordre de 10 milliards d’euros, selon les estimations de l’époque. La crise étant passée par là, cette mesure n’a pu être mise en œuvre.
Nous aurions peut-être intérêt à nous inspirer de certains pays qui construisent leur budget sur des hypothèses économiques pessimistes pour être sûrs de les atteindre, voire de les dépasser.
Quoi qu’il en soit, deux dangers, parmi ceux que comporte la situation actuelle, me paraissent devoir être particulièrement soulignés.
Il y a, tout d’abord, un risque de découragement de tous les acteurs de notre système de protection sociale : « pourquoi s’acharner à rechercher des économies de 50 ou 100 millions d’euros quand les déficits atteignent de telles profondeurs ? », peuvent-ils se dire. Certains peuvent légitimement se demander si nous connaîtrons un jour de nouveau l’équilibre des comptes sociaux.
La dette est bien sûr le deuxième danger qui nous guette, car – je ne vous apprends rien – le déficit d’aujourd’hui est la dette de demain. Jusqu’à présent, contrairement à la dette de l’État, la dette sociale est restée à des montants d’un niveau relativement maîtrisé et en rapport avec les ressources affectées à son remboursement. En principe, à ce jour, la dette sociale devrait être entièrement éteinte en 2021, c’est-à-dire dans douze ans. Qu’adviendra-t-il cependant si les comptes sociaux demeurent plusieurs années dans les zones de déficit vers lesquelles nous nous dirigeons ? D’ores et déjà, la question est posée : dans quelles conditions la dette sociale résultant de la crise en cours, qui pourrait atteindre 50 milliards d’euros à la fin de l’année 2010 alors même que la CADES vient à peine de reprendre une dette de 27 milliards d’euros, sera-t-elle portée ?
Voilà peu, monsieur le ministre, vous avez indiqué que les décisions relatives à une éventuelle reprise de dette n’interviendront pas dans l’immédiat et que l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, aura les moyens de faire face, en 2009 et en 2010, aux besoins découlant des déficits.
Cette situation, vous le savez, ne sera cependant pas tenable très longtemps.
En effet, l’ACOSS a deux sources principales de financement : d’une part, la Caisse des dépôts et consignations, la CDC ; d’autre part, l’émission de billets de trésorerie. L’ACOSS et la CDC mettent actuellement la dernière main à un avenant à la convention qui les lie depuis 2006, dont il résulterait notamment que la CDC ne s’engagerait à prêter à l’ACOSS, à des conditions prédéterminées, qu’à hauteur de 25 milliards d’euros et qu’elle ne pourrait en tout état de cause prêter plus de 31 milliards d’euros.
En ce qui concerne les billets de trésorerie, les émissions de l’ACOSS sont actuellement plafonnées à 11, 5 milliards d’euros ; mais, en réalité, l’ACOSS, lorsqu’elle a recouru aux billets de trésorerie, n’a jamais dépassé le montant de 5 milliards d’euros. Parfois, l’État lui-même achète des billets de trésorerie. Nous pouvons aujourd'hui nous poser la question suivante : l’État le fera-t-il à nouveau et, le cas échéant, à quelle hauteur ? Je serais heureux que M. le ministre puisse nous répondre sur ce point.
Pour faire face aux déficits, le plafond des ressources non permanentes de l’ACOSS a été fixé pour 2009 à 18, 9 milliards d’euros par le Parlement, plafond que vous allez relever par décret de près de 10 milliards d’euros, monsieur le ministre. Jusqu’à ce montant, l’ACOSS devrait pouvoir se financer sans trop de difficultés. En revanche, l’année prochaine, si aucune reprise de dette n’est intervenue, l’ACOSS risque de devoir faire face à un besoin de trésorerie compris entre 50 et 60 milliards d’euros. Les 25 à 31 milliards de la Caisse des dépôts et consignations n’y suffiront pas, même si vous y ajoutez les 11, 5 milliards de billets de trésorerie.
Quelles solutions le Gouvernement envisage-t-il donc pour faire face à cette situation ? L’État ou d’autres entités publiques pourraient-ils se porter acquéreurs de billets de trésorerie ? Nous serions heureux de le savoir, M. Jégou n’étant pas le moins intéressé par votre réponse, monsieur le ministre.
M. Jean-Jacques Jégou acquiesce.

En tout état de cause, il est essentiel d’affirmer clairement l’engagement de l’État à l’égard de l’ACOSS pour éviter que la crédibilité de celle-ci ne soit remise en cause sur les marchés.
Quoi qu’il en soit, il faudra bien trouver une solution pérenne pour porter cette nouvelle dette. Il existe, à mon sens, trois possibilités : premièrement, la reprise de la dette par l’État, idée dont j’ai cru comprendre que le Gouvernement l’avait abandonnée ; deuxièmement, la création d’une caisse chargée de porter la dette de crise, idée dont j’ai également cru comprendre qu’elle était abandonnée ; troisièmement, la reprise de la dette par la CADES, idée à laquelle le Gouvernement, ne souhaitant ni allonger la durée de vie de la CADES ni, dans l’immédiat, augmenter les prélèvements obligatoires, ne semble pour l’instant pas favorable.
J’admets que toutes ces solutions ont des inconvénients ou entraînent des difficultés.
La reprise de la dette par l’État mettrait fin au principe très sain du cantonnement de la dette sociale, et je n’y suis donc moi-même pas très favorable. Le transfert à la CADES pose, pour sa part, le problème des ressources et de l’augmentation de la durée de vie de la caisse.
Comme vous le savez, le législateur organique a décidé en 2005 qu’aucune reprise de dette ne pourra plus être effectuée sans que soit accordée à la CADES la ressource nécessaire. Or nous avons vu les résultats du transfert, l’an dernier, de 0, 2 point de CSG au FSV : ce dernier se retrouve dans la situation que j’évoquais tout à l’heure.
Si vous ne voulez pas augmenter la durée de vie de la CADES, il n’est d’autre solution que d’augmenter les ressources. Or la caisse doit achever sa mission en 2021, soit dans douze ans.
Il faut savoir – peut-être M. Jégou en dira-t-il quelques mots tout à l’heure – que, comme M. Patrice Ract Madoux, président du conseil d’administration de la CADES, l’a confirmé devant le comité de surveillance de celle-ci et lors d’un entretien que j’ai eu avec lui, plus on approche de l’échéance de 2021, plus les transferts de dette vont nécessiter la fourniture de recettes importantes.
Par exemple, si nous transférons 50 milliards d’euros de dette au début de l’année 2011, cela impliquera de fournir 0, 425 point de CRDS à la CADES, ce qui représenterait quasiment le doublement de la contribution actuelle. Plus on attendra, plus le coût de la reprise sera élevé, dans la mesure où nous voulons respecter l’échéance de 2021.
Dans ces conditions, je me demande si nous pourrons éviter un débat sur une éventuelle prolongation de la durée de vie de la CADES ; mais le risque serait alors très grand d’abandonner toute perspective d’extinction de la dette et de reporter celle-ci sur les générations futures, ce que nous avons toujours voulu éviter, et ce qu’a également voulu éviter le législateur organique en prenant la disposition que j’ai rappelée voilà quelques instants. J’ai cru comprendre, monsieur le ministre, que tel était aussi votre état d’esprit. Or, reporter l’extinction de la dette à 2030, à 2040 ou à 2050, c’est bien faire porter le poids de la dépense sur nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, face à cette situation sans précédent, que pouvons-nous faire ? La priorité me semble être de comprendre que nous devons agir tout de suite, qu’il s’agisse d’accroître les recettes ou de maîtriser les dépenses. Tout ce que nous ne ferons pas maintenant coûtera plus cher ultérieurement.
La priorité des priorités est aujourd’hui de préserver et d’accroître les ressources de la sécurité sociale – j’ai cru comprendre que le Gouvernement partageait cet état d’esprit –, qui devront, après la crise, être plus dynamiques que les dépenses.
Cela passe, d’une part, par une meilleure évaluation des dispositifs d’exonération de charges, qui devront être compensés à l’euro près, ce qui n’est pas le cas pour le moment.
Mais il faut surtout, d’autre part, accroître l’assiette des cotisations en remettant en cause ou en limitant, dans toute la mesure du possible, les niches sociales, qui mitent les recettes de la sécurité sociale. Comme vous l’avez rappelé tout à l’heure, monsieur le ministre, la perte de recettes potentielles représentée par ces mécanismes est estimée à 9, 4 milliards d’euros. Ce chiffre, même s’il doit être relativisé – les employeurs procéderaient sans doute à des arbitrages différents si les sommes concernées étaient soumises aux cotisations sociales –, montre qu’il est possible d’agir dans le sens d’un encadrement de ces dispositifs. Quelques progrès ont déjà été faits avec la taxation des stock-options ou la création du forfait social de 2 %, idée dont Mme Dini a rappelé tout à l’heure qu’elle avait été émise par le Sénat et que le Gouvernement n’y avait tout d’abord pas été favorable, jusqu’à ce que M. le député Yves Bur dépose un amendement à une loi de financement de la sécurité sociale ; le Gouvernement, reprenant cet amendement à son compte, a alors finalement considéré que l’idée émise par le Sénat un an plus tôt n’était pas si mauvaise et qu’il y avait lieu de la mettre en œuvre. Ne désespérons donc jamais d’être suivis dans nos propositions, mes chers collègues, même si cela prend et fait perdre un peu de temps : il n’est jamais trop tard pour bien faire !
Nous pourrons donc aller plus loin. Plusieurs pistes devront être explorées, que je suggère à M. le ministre : l’élargissement de l’assiette du forfait social, le relèvement du taux de ce forfait, le relèvement du taux spécifique applicable aux attributions de stock-options et d’actions gratuites, la remise à plat de la taxation des indemnités de rupture, la taxation des retraites chapeau. Voilà toute une série de recettes potentielles de nature à améliorer la situation de nos comptes sociaux !
Cette remise en cause de certains mécanismes devra aussi s’accompagner du respect des nouvelles règles fixées par la loi de programmation des finances publiques, selon laquelle une création ou une extension de niche fiscale ou sociale doit être compensée par la suppression ou la diminution d’une autre de ces niches.

Or, pas plus tard que la semaine dernière, monsieur le ministre, le Gouvernement a créé une nouvelle niche sociale en faisant voter l’extension des chèques-vacances. Ce n’est pas le meilleur moyen, à mon avis, de parvenir à une meilleure maîtrise de l’évolution des niches sociales ! Dès lors, où allez-vous trouver des ressources nouvelles pour permettre cette compensation ?
Il y a les droits sur le tabac ou sur l’alcool. Il ne serait pas choquant de taxer davantage les alcools forts.
Une autre piste que nous avions avancée voilà quelques années mais que le Gouvernement n’a pas voulu prendre en considération est la taxation des produits gras ou sucrés. Il me paraîtrait opportun d’y réfléchir de nouveau.
De même, alors qu’une réflexion est en cours sur la création d’une contribution climat-énergie, ne serait-il pas légitime qu’une partie du produit de cette « taxe carbone » revienne à l’assurance maladie, compte tenu des conséquences néfastes des pollutions sur la santé ? Je ne pense pas que nous allons nous disputer avec la commission des finances pour le partage de cette recette, mais je considère qu’une telle disposition serait légitime dans la mesure où cette taxe a pour objet de ramener à la raison certains consommateurs.
Enfin, il conviendrait à mon avis d’engager une réflexion sur la CSG, pour laquelle coexistent aujourd’hui quatre barèmes, tandis que certains éléments d’assiette sont exonérés. Il y a là une marge d’harmonisation qui permettrait d’accroître les recettes de la sécurité sociale.
J’en terminerai par les réformes indispensables.
La première, dont on a beaucoup parlé ces dernières semaines, est celle des retraites. Le rendez-vous de 2008 a été largement manqué, monsieur le ministre. Souhaitons que celui de 2010 ne le soit pas.
Certes, des efforts significatifs ont été accomplis sur l’emploi des seniors et sur la solidarité envers les personnes aux revenus les plus modestes. Cependant, le dossier de la pénibilité est bloqué ; il n’a pas été abordé, pas plus que ne l’a été la question de la compensation de la hausse des cotisations vieillesse par la baisse des cotisations chômage.
Je vous rappelle, mes chers collègues, que les besoins de financement de la branche vieillesse vont continuer à s’accroître rapidement. En 1960, le France comptait quatre cotisants pour un retraité ; aujourd’hui, le rapport s’établit à 1, 43.
Dans ces conditions, le rendez-vous de 2010 ne doit pas être l’occasion de reporter les réformes structurelles à 2012. Il devra déboucher sur une véritable réforme, et je laisse le soin à Dominique Leclerc, rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse, d’en dire quelques mots tout à l'heure.
Le report de l’âge légal du départ à la retraite, qui est évoqué comme l’une des pistes possibles, impliquerait un changement profond de mentalité dans notre pays sur la question de l’emploi des seniors.
Il faut en outre avoir à l’esprit que l’augmentation de l’âge de la retraite n’est pas la panacée. Elle ne comblera pas à elle seule les besoins de financement des régimes de retraite. Nous devons donc réfléchir à une réforme globale.
Monsieur le ministre, il serait heureux également que vous nous éclairiez sur l’évolution du régime de retraite des exploitants agricoles, aucune solution pérenne n’ayant accompagné la suppression du Fonds de financement des prestations sociales agricoles, le FFIPSA. Si nous avons réglé le problème concernant le volet de la branche maladie, nous ne l’avons pas fait pour le volet des retraites. Vous avez annoncé qu’il le serait dans le cadre du PLFSS pour 2010. Pourriez-vous nous en dire plus à ce sujet ?
J’en viens à la maîtrise des dépenses de santé. On le sait, ces dépenses ont naturellement tendance à croître plus vite que la richesse nationale. Il faudra faire preuve, me semble-t-il, de plus de volontarisme pour contenir les dépenses, notamment en améliorant l’efficacité du système et en utilisant toutes les marges de manœuvre existantes.
Comme je le disais tout à l’heure, les niveaux de déficit que nous allons connaître cette année risquent de provoquer une certaine démobilisation chez les différents acteurs. Les propositions que vient de présenter la CNAM sont utiles, mais à mon avis insuffisantes.
En matière d’efficacité de la gestion hospitalière, il reste des marges de manœuvre importantes, des gisements de productivité dont la mobilisation ne remettrait pas en cause la qualité des soins dispensés.
Lors de l’examen du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, défendu avec ténacité par Mme Bachelot, nous avons créé les agences régionales de santé, ou ARS, alors présentées comme les solutions miraculeuses devant permettre de maîtriser les dépenses de santé tant en ville qu’en milieu hospitalier. J’ose espérer que les résultats seront au rendez-vous. Les agences régionales de l’hospitalisation, pour leur part, n’ont pas démontré leur pertinence dans la maîtrise des dépenses de santé à l’hôpital, des rapports assez édifiants ayant d’ailleurs été publiés sur le sujet. Je souhaite donc que les ARS permettent d’obtenir le résultat escompté.
Enfin, j’espère que Mme Bachelot avancera sur la question de la convergence tarifaire, qui est au point mort. On nous dit que des études complémentaires restent à faire. Je souhaite qu’elles fassent l’objet d’un calendrier précis et que nous puissions aller réellement vers la convergence tarifaire.
Tels sont, mes chers collègues, les quelques éléments que je voulais soumettre à votre réflexion. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais le PLFSS sera à mon avis l’occasion pour nous d’aller encore un peu plus loin quant aux solutions à retenir afin de préserver l’avenir de notre régime de protection sociale.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
M. Roland du Luart remplace M. Roger Romani au fauteuil de la présidence.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention portera sur quelques points qui préoccupent la commission de la culture, de l’éducation et de la communication dans la perspective de la préparation du projet de loi de finances pour 2010.
Ces points concernent des dépenses inéluctables. Je crains de ne pas être tout à fait dans l’esprit qui nous rassemble aujourd'hui mais, monsieur le ministre, soyez rassuré, je ne dispose que de cinq minutes !
Sourires

Le premier point dont je voudrais parler concerne notre politique culturelle extérieure, aujourd’hui illisible, profondément handicapée par la multiplicité de ses opérateurs et par l’absence d’un pilotage stratégique clair.
Dans un rapport d’information commun aux commissions de la culture et des affaires étrangères, adopté à l’unanimité de tous les groupes politiques – cela mérite d’être souligné –, nous avons formulé dix propositions opérationnelles afin de réunir les conditions d’un sursaut de notre diplomatie culturelle.
Un document budgétaire transversal regroupant l’ensemble des crédits consacrés à l’action culturelle extérieure nous semble indispensable pour garantir la lisibilité et la cohérence de la dépense publique dans ce domaine.
De plus, la création d’un opérateur unique en charge de la coopération culturelle et linguistique permettrait de sanctuariser les moyens de notre réseau au sein d’une ligne budgétaire clairement identifiée et d’éviter ainsi que cette action ne serve trop systématiquement de variable d’ajustement.
Compte tenu des baisses sans précédent des crédits de l’action culturelle extérieure, notre réseau culturel, d'ailleurs réuni aujourd'hui à Paris, est en profonde restructuration, navigue à vue et se trouve en proie à une démobilisation préoccupante.
Alors que nos partenaires et concurrents britanniques, allemands, espagnols et chinois, malgré la crise, augmentent fortement les moyens consacrés à leurs établissements culturels à l’étranger, n’est-il pas étonnant que notre pays restreigne aussi sévèrement les financements consentis à sa diplomatie culturelle ? Il vient un moment où les diminutions de crédits sont totalement contreproductives puisque les dépenses restantes n’ont plus aucune efficacité.
L’ouverture de 40 millions d’euros de crédits annoncée au début de l’année 2009 demeure très insuffisante au regard des défis qui se posent et ne devrait pas permettre de couvrir les baisses de crédits programmées pour les deux prochaines années.
Dans ces conditions, nous estimons que la réforme annoncée par le ministre des affaires étrangères en mars 2009 sera compromise si aucun effort budgétaire substantiel n’est consenti.

Le deuxième point sur lequel je souhaite attirer votre attention est la situation de l’enseignement agricole.
L’an dernier, à la suite de négociations longues, parfois tendues mais finalement fructueuses, nous étions parvenus à nous entendre sur une augmentation de 38 millions d’euros des crédits du programme 143.
Mais ce geste s’est malheureusement révélé insuffisant. Contrairement à ce qu’espérait le Sénat, ces 38 millions d’euros ne comprenaient aucun crédit de personnel et ne s’accompagnaient d’aucun emploi. Aussi, si la situation de l’enseignement privé ne pouvait que s’améliorer, celle de l’enseignement public, largement concerné par ces suppressions d’emploi, s’est dégradée dans de fortes proportions.
Il a fallu que s’engage un mouvement d’ampleur dans les lycées agricoles publics pour que chacun finisse par prendre la mesure du problème. Avec votre accord, le ministre de l’agriculture et de la pêche a finalement rétabli 132 postes en équivalent temps plein et ouvert une enveloppe de 90 000 heures supplémentaires, ce qui devrait permettre d’apaiser la tension qui montait dans les établissements publics.
J’attire cependant votre attention sur le point suivant : les acquis du budget 2009 tel qu’il s’exécute aujourd’hui constituent une forme d’étiage pour l’enseignement agricole. Toute suppression d’emploi supplémentaire dans l’enseignement public et toute aggravation des reports de charge dans l’enseignement privé ne pourraient que déclencher à court terme l’apparition de nouveaux problèmes.
À l’évidence, cela n’est pas souhaitable, car l’enseignement agricole, s’il ne jouit pas toujours de la considération qu’il mérite à l’échelon national, fait l’unanimité dans nos régions en raison de son efficacité. C’est de l’argent bien dépensé ! Tous ceux qui l’approchent ont pu constater qu’il fait merveille en matière de « remédiation » et qu’il parvient à assurer à l’immense majorité de ses élèves une insertion professionnelle durable. N’est-ce pas une nécessité du moment ?
Le troisième point concerne l’entretien de notre patrimoine monumental. Pouvez-vous nous assurer, monsieur le ministre, que les engagements pris dans le cadre du plan de relance de le doter d’une enveloppe supplémentaire de 100 millions d’euros seront poursuivis en 2010 ?
Nous sommes par ailleurs préoccupés par le financement de l’archéologie préventive.
Depuis la loi de 2001 qui lui a donné une base légale, de fortes tensions se sont fait jour, nées des exigences parfois contradictoires du développement économique local et de la recherche scientifique, et qui font à intervalles réguliers l’objet de débats au sein de notre assemblée.
Le dispositif expérimental de « contrats d’opération » que nous avons voté en janvier ne vaut que pour la part concurrentielle de l’activité de l’Institut national de recherches et d’applications pédagogiques, l’INRAP, c’est-à-dire pour les fouilles ; mais il ne résout pas la question des délais d’intervention pour les diagnostics, qui trouvent leur origine dans la faiblesse du rendement de la redevance d’archéologie préventive.
Ce rendement conditionne le niveau des moyens que l’INRAP et les services agréés de collectivités territoriales peuvent consacrer aux diagnostics, mais aussi la capacité à mutualiser le coût des fouilles à travers le Fonds national d’archéologie préventive, le FNAP, au profit de certains aménageurs, et, enfin, l’activité de recherche et de diffusion de l’INRAP, qui constitue la finalité même de ses travaux.
Certes, le Parlement a déjà décidé, dans le cadre de la loi pour l’accélération des programmes de construction et d’investissement publics et privés, une hausse progressive des taux de la redevance pour un montant total estimé à 20 millions d’euros en année pleine 2010. Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 20 millions d'euros a été allouée en 2009 à l’INRAP. Mais la subvention versée par le ministère de la culture et de la communication sera supprimée en 2010, et la subvention exceptionnelle du plan de relance n’a évidemment pas vocation à être reconduite.
Dans ce contexte, l’archéologie préventive devra faire face l’an prochain à une diminution de ses moyens d’origine publique de plus de 15 millions d’euros, alors que ses besoins de financement resteront très soutenus.
Afin de sortir de façon définitive de ce débat, nous devons réfléchir à la mise en place d’un dispositif de financement à même de garantir de manière pérenne le bon déroulement des opérations d’archéologie préventive, sans doute à travers une réforme en profondeur de l’assiette de la redevance d’archéologie préventive. La réforme envisagée de la taxe locale d’équipement devrait en être l’occasion. J’insiste sur ce point, car ces problèmes d’archéologie préventive sont un obstacle à la réalisation de certains travaux, même décidés dans le cadre du plan de relance.
Je souhaiterais enfin évoquer des questions touchant au secteur de l’audiovisuel.
S’agissant du service public, nous avons adopté l’an dernier des dispositions garantissant un financement pérenne à France Télévisions à hauteur de 450 millions d’euros. Or selon certains échos, ces sommes n’auraient pas encore été versées faute de réponse de la Commission européenne sur cette aide. Qu’en est-il exactement, monsieur le ministre ?
Quant au secteur privé, la commission de la culture tient à vous faire part de sa préoccupation. Nous avions voté des taxes visant, en quelque sorte, à compenser « l’effet d’aubaine » dont les chaînes privées auraient pu bénéficier du fait de la suppression de la publicité sur le service public. Or la situation du marché publicitaire s’est effondrée, comme leur chiffre d’affaires. Il serait opportun de procéder aux adaptations nécessaires dans la prochaine loi de finances. Je vous rappelle l’attachement de la commission de la culture à un secteur audiovisuel équilibré.
Telles sont, monsieur le ministre, les quelques pistes que je soumets à votre réflexion au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat d’orientation, que nous engageons dans un contexte particulièrement contraint, est le second volet de notre diptyque annuel sur les finances publiques, après la discussion du projet de loi de règlement.
Les orientations de fond mises en œuvre ces dernières années ne doivent pour l’instant pas être modifiées, particulièrement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010 : la norme de progression de la dépense publique et les choix d’évolution des recettes fiscales, que l’on retrouve notamment dans la loi TEPA, doivent rester inchangés.
Le paquet fiscal, dont nous avons déjà dit tout le bien que nous en pensions, continuera à fonctionner, malgré la crise et la détérioration sensible des comptes publics.
Quant à la norme de dépense, c’est encore une fois au travers d’une nouvelle saignée d’emplois publics qu’elle sera tenue coûte que coûte. Il est par ailleurs fort probable que quelques judicieuses mesures législatives ou réglementaires viendront comprimer autant que possible la croissance des dépenses sociales.
Tout cela doit évidemment permettre de prendre en charge le coût grandissant et toujours plus préoccupant de la dette. Celle-ci agit de plus en plus comme un redoutable poids mort dans les comptes publics, en tout cas comme une contrainte qui va sérieusement mettre en question toute politique de réduction des déficits, toute politique fiscale et toute politique budgétaire originale pour quelques années.
Chers collègues de la majorité, vous pouvez fort bien manifester votre inquiétude devant la croissance de cette dette publique, mais vous ne parviendrez pas à nous faire oublier deux éléments.
Premier élément, la dette publique est une bonne affaire et un placement satisfaisant pour une certaine épargne, qui n’est pas toujours celle des ménages les plus modestes ou des petites et moyennes entreprises.
Parler de dette publique en oubliant un peu vite qu’une bonne part de celle-ci est souscrite par des résidents – ménages, compagnies d’assurance et autres structures de même nature –, c’est en effet mentir délibérément aux Françaises et aux Français.
Second élément, il y a bien évidemment plusieurs manières de faire croître et embellir la dette publique. Celle qui est aujourd’hui à l’œuvre consiste, pour l’essentiel, à gager le prix des réductions de recettes fiscales décidées politiquement par l’émission de nouveaux titres de dette publique.
Dans les faits, cela n’apporte absolument rien au développement économique et social de la nation, les initiatives privées ainsi libérées de l’impôt ne se mobilisant apparemment pas pour se substituer à l’intervention publique.
Si nous nous endettions pour réaliser les infrastructures de transport dont nous avons besoin, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, relier les territoires et favoriser le développement harmonieux de l’ensemble des bassins de vie de notre pays, cela pourrait se comprendre.
Si nous choisissions de nous endetter pour renforcer l’équipement éducatif du pays, pour développer le logement social ou pour répondre aux nécessités de l’égalité d’accès aux soins, cela pourrait aussi se comprendre.
Mais tel n’est pas le cas ! Nous nous endettons pour payer la facture des cadeaux fiscaux, l’importation de la récession américaine, celle qui découle de choix de gestion d’entreprises françaises de moins en moins responsabilisées. En un mot, c’est un « mal-endettement » de l’État qui se développe.
La même observation vaut d’ailleurs pour la sécurité sociale, victime d’une sensible réduction de ses recettes du fait de l’accroissement du chômage, et pour laquelle, là encore, la logique favorable aux revendications corporatistes de certains syndicats de médecins a été, en dépit du bon sens, prise en compte.
Quant aux prestations servies par les régimes de retraite, comme par l’assurance maladie, elles ont continué de subir les effets des choix inscrits dans les lois de financement de la sécurité sociale.
Cette situation n’a toutefois pas empêché la Cour des comptes de ne pas valider les comptes de l’assurance vieillesse, comme ceux de l’assurance maladie, au motif de leur absence de sincérité.
Ce cadre général, qui demande toujours plus au contribuable ou à l’assuré social modeste – plus de cotisations et d’impôts, pour moins de service en retour –, est, une fois encore, celui qui sera fixé par le Gouvernement dans les prochaines loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale.
Le cadre est d’autant plus contraint que plusieurs annonces ont déjà été faites quant à l’évolution de nos prélèvements.
La croissance de 0, 5 % prévue pour 2010, croissance qui relève, de notre point de vue, de l’incantation, est d’ores et déjà consommée. Il faut tout à la fois supporter les effets du paquet fiscal de 2007, la réduction de la TVA sur la restauration et la réforme de la taxe professionnelle.
A contrario, a été annoncée la création d’une taxe carbone, sur laquelle nous avons une position très simple : nous sommes contre ce qui contribuera, une fois encore, à extraire une partie de l’impôt du lieu de création des richesses, c’est-à-dire l’entreprise, et à taxer une consommation déjà largement obérée par un grand nombre de taxes et de droits divers.
La fiscalité environnementale rapporte déjà aujourd’hui quelque 50 milliards d’euros. Mais la plus importante recette de cette fiscalité, c’est-à-dire la taxe intérieure sur les produits pétroliers, ou TIPP, ne sert aucunement la cause écologique : elle est reversée soit au budget général, soit aux collectivités locales pour leur permettre de faire face aux charges transférées au titre de la décentralisation.
Nous sommes partisans d’une rénovation de notre système de prélèvements fiscaux : il faudrait par exemple s’interroger sur le bien-fondé de la prise en charge par les collectivités des compétences transférées depuis la décentralisation « à la sauce Raffarin », mais également prévoir le transfert d’autres recettes fiscales pour favoriser cette éventuelle prise en charge.
Pourquoi ne pas décider dès 2010 de cette orientation nécessaire au retour à la cohérence et à l’équilibre des dépenses publiques ? Pourquoi ne pas faire de la collecte de la TIPP le moyen d’alimenter un fonds d’investissement écologique permettant, par exemple, de faciliter le financement des travaux pour rendre les logements anciens moins gourmands en énergie ou de développer la recherche sur l’utilisation d’alternative aux carburants pétroliers ?
Pour le moment, si nous nous en tenons à ce qui figure dans la presse, la taxe carbone, au motif de favoriser la préservation de l’environnement, risque avant tout de servir, d’une part, à compenser la réforme de la taxe professionnelle et, d’autre part, à augmenter le prix de l’essence et du chauffage pour les ménages les plus modestes. Cela revient à accroître les défauts inhérents à notre système de prélèvements obligatoires, qui sont trop fondés sur des dispositions régressives, pénalisant lourdement les plus modestes au bénéfice des plus aisés et des grandes entreprises.
Selon nous, une réorientation des finances publiques doit participer de ce nécessaire examen de l’état des lieux, de la mise en cause des choix fiscaux et sociaux adoptés ces dernières années et de la valorisation de choix budgétaires plus conformes à l’intérêt général.
Nous l’avons vu, l’état des lieux est particulièrement préoccupant : de 125 à 130 milliards d’euros de déficit en 2009 et sans doute pas beaucoup moins en 2010. Dans le rapport annexé, il est indiqué que le déficit public devrait encore atteindre de 7 à 7, 5 points de PIB en 2010 et qu’il ne devrait baisser que d’un point en 2011 et d’un autre point en 2012.
En clair, nous devrions atteindre en 2012 un magnifique taux de déficit de 5, 5 %, bien au-delà des limites autorisées par l’Union économique et monétaire, et un niveau de dette publique proche des 90 % du PIB.
Cette situation – faut-il le dire ? – justifie pleinement qu’on réfléchisse à la mise en place d’un emprunt obligatoire pour les entreprises comme pour les ménages les plus aisés, emprunt dont nous souhaiterions ici caractériser certains principes.
Une telle initiative ne serait pas nouvelle puisque le gouvernement de M. Mauroy, auquel participait M. Delors, avait fait adopter en 1983 un projet de loi d’habilitation, d’ailleurs rejeté par le Sénat de l’époque à la suite des conclusions du rapport de notre ancien collègue Maurice Blin. C’est sur la base de ce texte, devenu la loi du 22 avril 1983, qu’avait été prise l’ordonnance du 30 avril 1983 relative à l’émission d’un emprunt obligatoire.
Cet emprunt, souscrit auprès des contribuables de l’impôt sur les grandes fortunes et des ménages acquittant les plus importantes cotisations d’impôt sur le revenu, était assorti d’un taux actuariel de 11 % – l’inflation était à l’époque d’une autre nature qu’aujourd’hui ! –, et sa durée de remboursement avait été fixée à trois ans.
Compte tenu de la situation, nous devrions nous orienter vers les mêmes caractéristiques, à une nuance près : l’inflation devrait conduire à mettre en œuvre un emprunt obligatoire à taux nul ou quasi nul.
Nous devons également nous pencher sur la question de la dette des entreprises publiques, puisque la controverse née de la situation d’EDF semble bel et bien montrer la nécessité de pousser la réflexion sur le sujet.
Les entreprises publiques sont endettées, parfois de manière importante, et ne sont pas véritablement en situation de faire face aux exigences du développement futur de leur activité.
Il est manifeste que nous devons réfléchir à la mise en œuvre d’une vaste opération d’échange de titres de dette, transformant en dette complémentaire de l’État la dette des entreprises publiques, et permettant de délivrer ces dernières du fardeau de leurs charges financières.
Dans le même ordre d’idées, permettez-moi d’évoquer les problématiques européennes. Il est plus que temps que la Banque centrale européenne, plutôt que de délivrer des bons et des mauvais points aux élèves de la « classe euro », prenne une initiative forte pour aider au développement de chacun des pays de l’Union européenne.
La Banque centrale européenne, jouissant de la position dont elle bénéficie au regard des marchés financiers, doit souscrire un emprunt destiné, entre autres, à faire face aux dépenses d’infrastructure et d’équipement nécessaires à la cohésion du projet européen, singulièrement en matière d’infrastructures ferroviaires, d’infrastructures de transport ou de développement de l’économie numérique.
Il faut que M. Trichet mette enfin au service des États de l’Union européenne les moyens d’un développement économique peu coûteux, en levant ces ressources pour permettre aux États de mettre en œuvre leurs choix politiques.
Revue générale de la dépense fiscale, remise en question des choix opérés depuis 2007, emprunt obligatoire et gestion active de la dette publique : voilà quelques-unes des orientations que nous devrions privilégier.
Et il ne faut pas oublier la question de l’avenir de notre système de sécurité sociale, sur lequel plusieurs orateurs sont intervenus.
D’aucuns pourront toujours gloser sur l’allongement de la durée nécessaire pour ouvrir droit à la retraite ou sur la faiblesse du taux d’emploi des seniors ; mais en réalité, il faut le dire, les comptes sociaux sont aujourd'hui dans le rouge ! Tout comme les comptes de l’État, ils pâtissent de l’insuffisance des recettes liée à la dégradation de la situation économique.
En parallèle, les comptes de l’assurance chômage sont particulièrement dégradés.
Pour répondre à ces problèmes, le Gouvernement a conçu différentes solutions.
D’une part, il a fait adopter un projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, qui va conduire à la dégradation du service rendu, pour des économies de bout de chandelle.
D’autre part, il va tenter, avec le texte sur le devenir de la formation professionnelle, de faire main basse sur l’argent des salariés – celui de leurs cotisations – pour financer son propre désengagement en matière de préservation de l’emploi productif.
Avec un gouvernement qui a mis en place un fonds de soutien au secteur automobile payant les plans sociaux et un fonds stratégique d’investissement pour alimenter les opérations spéculatives de quelques entreprises, il faut s’attendre au pire !
Dans le champ de la protection sociale, il est temps que l’on s’interroge une bonne fois pour toutes sur les politiques d’allégement de cotisations sociales et leurs effets pervers, de la même manière qu’il faudra sans doute un jour prendre les mesures qui s’imposent contre les professionnels de médecine refusant les bénéficiaires de la CMU.
Tels sont tous les points que nous souhaitions ici soulever, en regrettant par avance – faut-il le répéter ? – que les choix désastreux ayant conduit les finances publiques au plus mal ne soient pas remis en cause.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les finances publiques, sujet complexe et technique, prennent, avec la crise internationale, une dimension politique essentielle. Ainsi, depuis plus de six mois, les débats budgétaires ne cessent de se succéder. Entre les rendez-vous traditionnels et ceux qui sont imposés par les turbulences de la crise, nous avons examiné pas moins de quatre projets de loi de finances rectificative depuis novembre dernier !
Aujourd’hui, nous tentons de préparer un budget pour 2010 dans un contexte d’une difficulté inconnue. En effet, jamais l’état de nos finances publiques n’a été aussi dégradé. Dans cette situation préoccupante, considérant la très faible visibilité à court, à moyen et à long terme, il est particulièrement ardu d’apporter des réponses.
La situation est particulièrement délicate, puisque, pour la première fois depuis 1945, notre pays devrait connaître cette année une croissance négative de 3 %. Espérons que cette dernière se hissera à 0, 5 % en 2010. Compte tenu de tels déficits et de la baisse très forte des recettes fiscales, les marges de manœuvre du prochain exercice budgétaire seront quasi inexistantes. De plus, à la crise conjoncturelle se juxtapose une crise structurelle où un État boursouflé s’épuise à cacher son incapacité à s’adapter à un contexte mondial nouveau, tout en gérant une société conservatrice.
La cause principale de la crise est un endettement accéléré sur les dix dernières années. M. le rapporteur général, employant une image poétique qui souligne d’ailleurs l’apathie des gouvernements successifs, a évoqué le « monde étrange des déficits sans pleurs ». Dire que nous sommes le troisième État le plus endetté de la zone euro, avec une dette publique qui risque de se stabiliser à près de 100 points de PIB et un déficit public supérieur à 7 points de PIB, me semblerait cependant plus approprié pour décrire la réalité. Toujours est-il que le désendettement des acteurs économiques prendra beaucoup de temps.
L’État réalise des efforts, mais il est condamné à en faire encore davantage. L’effort ciblé et temporaire mis rapidement en place s’illustre par le plan de relance engagé par la France. Celui-ci est judicieusement axé sur les investissements. Néanmoins, quand serons-nous en mesure d’avoir un retour sur ceux-ci ? Contrairement à nos voisins, mais à l’instar de la Grande-Bretagne, nous avons orienté ce plan essentiellement sur l’année 2009. Les résultats en seront-ils plus rapidement perceptibles ?
Nous connaissons la difficulté de votre tâche, monsieur le ministre. Votre choix de privilégier l’investissement plutôt que la consommation fut de toute évidence le bon, malgré la forte augmentation du chômage.
La consommation se tient en raison des divers garde-fous sociaux et des différentes allocations que vous avez accordées aux ménages les plus fragiles. Au-delà de l’aspect social, celles-ci leur ont permis – espérons-le pour une majorité d’entre eux – de ne pas sombrer dans un découragement contagieux. Compte tenu de la forte propension de nos compatriotes à épargner – la Chine mise à part, la France constitue une exception dans l’économie mondiale avec un taux d’épargne de 15 % –, les ménages font face relativement bien à la crise. La TVA liée à la consommation représente 61 % de cette recette et résiste donc bien.
Il n’en va pas de même pour les recettes résultant de l’activité économique. Pour maintenir celle-ci, vous ne pouviez pas faire beaucoup plus que garantir les dépôts des ménages auprès des banques et inciter ces dernières, grâce à l’action des médiateurs, à tenir des lignes de crédit aux entreprises.
Les entreprises françaises sont en effet en mauvais état : elles perdent de leur compétitivité, elles suppriment des emplois et contribuent deux fois moins aux recettes de l’État dans le cadre de l’impôt sur les sociétés, dont les rentrées ont diminué de plus de 50 % en un an. On estime la baisse de leurs investissements à 9, 4 % en 2009 et à 1, 2 % en 2010 avec une chute de l’ordre d’un tiers des achats de logements neufs par les ménages.
La situation financière des collectivités est également en dégradation constante : à la fin de 2008, le déficit de ces dernières a atteint 7, 5 milliards d’euros avec un endettement global de 113 milliards d’euros. Ce montant est certes faible en regard de l’endettement de l’État, qui s’élève à plus de 1 000 milliards d’euros. Néanmoins, avec le déficit des collectivités territoriales, c’est aussi l’endettement de la France qui augmente.
Le Premier président de la Cour des comptes a indiqué que la dette des administrations publiques locales représente environ 10 % de la dette publique. L’état des finances locales est d’autant plus inquiétant que, en 2008, nous avons assisté à une augmentation des dépenses et à un tassement des recettes de fonctionnement.
Les collectivités subissent d’importantes pertes de recettes en raison du ralentissement de l’activité immobilière, qui vient fortement réduire les droits de mutation – de 30 % à 40 % dans certains départements –, entraînant une sérieuse diminution des recettes. Quelle sera la situation à la fin de 2009 ? L’activité sur le marché immobilier restant faible, les droits de mutation le seront tout autant. Les recettes des collectivités diminueront et leurs dépenses sociales, qui concernent au premier plan les départements, exploseront.
La prochaine réforme de la taxe professionnelle, bien que souhaitée par les entreprises, doit impérativement faire l’objet d’une juste et intégrale compensation financière pour les collectivités territoriales. Dans ce domaine, le Sénat devra jouer son rôle. La compensation sera bien sûr versée par l’État, ce qui implique de trouver de nouvelles ressources évolutives sans porter atteinte au principe d’autonomie financière des collectivités.
Dans ce contexte de déficit, la question centrale reste donc celle des recettes fiscales. Comme je le soulignais hier, il est urgent de relancer leur dynamique, tant par les entreprises que par les ménages, sans alourdir l’impôt. Or nous avons fort peu de gisements de ressources. Le plus important reste celui des niches fiscales. Il en existe plus de 400 et nous évaluons le manque à gagner entre 50 et 70 milliards d’euros. Dans la mise en place de dispositions tendant à plafonner certaines de ces exceptions fiscales, un grand pas a été franchi l’année dernière avec la loi de finances pour 2009. Pour 2010, cette piste doit être poursuivie. Peut-on imaginer que l’on en récupère 50 % d’ici à la fin de la législature ?
Je dirai maintenant un mot de la fonction publique dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, la RGPP. On estime l’économie réalisée avec le non-remplacement d’un fonctionnaire sur deux à près de un milliard d’euros annuel, somme à laquelle s’ajoutent les dépenses de fonctionnement inhérentes aux postes. Je rappelle à nouveau les propos du Président de la République qui soulignait que l’État, en France, dépensait proportionnellement 150 milliards d’euros de plus que l’Allemagne sans que les citoyens s’en trouvent mieux servis.
Nous ne sommes pas un îlot de déficit dans un monde prospère. Les États-Unis ont des déficits publics situés entre 10 % et 13 % de leur PIB et l’épargne des ménages y est nulle, comme en Grande-Bretagne où l’épargne des entreprises est souvent négative.
Avec Jean de La Fontaine, je dirai : « Ils ne mourraient pas tous, mais tous étaient frappés » ! Un chômage dépassant les 10 %, une perte de recettes fiscales de 30 milliards d’euros, des droits de mutation en baisse de plus de 30 %... J’arrête là cette énumération. Ce paysage cataclysmique touche aujourd’hui tous les acteurs économiques, mais, demain, ces chiffres peuvent être inversés.
Soyons optimistes pour l’évolution de la crise. Imaginons que, en 2012, elle soit derrière nous et que les entreprises voient leurs carnets de commandes remplis, que l’immobilier soit relancé et que les droits de mutation suivent par conséquent, que les collectivités aillent mieux, que les Français consomment. Mais qu’en sera-t-il de l’État ? Comment fera-t-il face à une dette qui dépassera sans doute 80 % du PIB et à une charge induite augmentant en proportion ?
Le budget prépare l’avenir, mais pas uniquement à court terme. Le plan de relance s’inscrit dans le court, le moyen et le long terme. Monsieur le ministre, comment préparez-vous la sortie de crise ? Quand pouvons-nous escompter réintégrer les critères de Maastricht ? Y aura-t-il une action concertée des pays de la zone euro ? Y aura-t-il une initiative européenne ?
Toutes ces interrogations ont trait au moyen terme, mais on ne peut imaginer que les mesures prises aujourd’hui se résument à un sauve-qui-peut ; elles s’inscrivent dans le temps.
Suivons donc le conseil de Raymond Barre : « Un avenir, cela se façonne, un avenir cela se veut. » Demain se prépare aujourd’hui ! C’est en tout cas la certitude partagée par tous les membres du groupe du RDSE.
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Monsieur le ministre, que nous réserve l’année 2010 sur le plan économique et financier ? Vos pronostics ne sont pas faits pour nous rassurer.
Vous avez parlé d’un taux de croissance terriblement comprimé. J’ai cru comprendre que la France serait moins réactive que l’Allemagne.
Vous avez évoqué un déficit de 130 milliards d’euros en 2009 et en 2010, sans oublier les 30 milliards d’euros de déficit des comptes sociaux, ce qui représente donc une somme gigantesque.
Vous avez aussi dit que la dette, dont le taux est aujourd’hui de 70 %, atteindra rapidement 80 %, voire 86 % en 2010, puis très vite 100 %. Si nous continuons sur le même rythme, nous serons à 130 % en 2020.
M. le président de la commission des finances a parlé de « vertige », d’ « asphyxie », et il a souligné à quel point la politique de communication du Gouvernement anesthésiait l’opinion. Nous partageons bien sûr cette façon de voir, même si nous souhaitons aller plus loin que lui dans l’analyse des responsabilités politiques.
De fait, la crise systémique apparue dans un premier temps dans la sphère bancaire frappe désormais tous les secteurs économiques. Notre inquiétude se porte évidemment sur la question du pouvoir d’achat et du chômage.
Nous n’oublions pas non plus la question vitale de l’environnement et du climat, qui impose de placer la conduite des politiques publiques, et donc de leurs financements, sous le signe du développement durable. Peut-on à cet égard parler de développement durable lorsqu’on laisse filer l’endettement comme le fait le Gouvernement ? Assurément non, mais j’y reviendrai.
C’est donc dans une situation tendue à l’extrême que s’inscrit la préparation du budget pour 2010. Le rapporteur général, Philippe Marini, parle ainsi de « la France en état d’apesanteur financière ».
Pourtant, malgré les risques qui pèsent sur l’avenir, et non content de poursuivre une politique budgétaire dangereuse, le Gouvernement s’autorise à lancer des réformes hasardeuses dont l’impréparation le dispute à la démagogie. Il en va ainsi de la réforme territoriale, dont nous avons bien compris qu’elle a surtout vocation à renforcer le poids du parti présidentiel. C’est également le cas de la suppression de la taxe professionnelle, qui conduira inévitablement à l’étouffement financier des collectivités locales.
Complètement désarçonné par la crise financière, le Gouvernement abuse des effets d’annonce, comme, par exemple, le « grand emprunt » annoncé à Versailles par le chef de l’État sans qu’il y ait eu au préalable la moindre réflexion sur le montant, le taux, la durée et encore moins l’usage ! À ce jour, une chose est sûre : faute d’avoir clairement expliqué aux Français le sens de cet emprunt, le Gouvernement l’a d’ores et déjà rendu impopulaire à 82 % de nos concitoyens, si l’on en croit un récent sondage.
Monsieur le ministre, en 2010, la situation économique et financière sera très difficile en France comme dans la plupart des autres grands pays ; chacun ici en convient. Il est incontestable que les marges de manœuvre seront très étroites pour les gouvernants. Raison de plus pour veiller à appliquer la bonne politique au bon moment de manière à préparer au mieux l’avenir de notre pays ! À cet égard, je suis véritablement inquiet ! En effet, comme beaucoup de mes collègues sénateurs, de tous bords d’ailleurs, j’ai le sentiment que la politique de recette conduite en France depuis 2002 mène à une véritable catastrophe !
Nous avons le sentiment, monsieur le ministre, que vous vous trompez lourdement dans votre politique fiscale. J’aimerais ici vous le démontrer, de façon à vous convaincre de changer profondément vos orientations budgétaires pour 2010. En effet, l’état calamiteux de nos finances publiques provient fondamentalement non pas seulement de la crise mais aussi, en grande partie, de votre mauvaise politique de recettes.
La Cour des comptes ne dit d’ailleurs pas autre chose. Dans son rapport sur l’exécution du budget 2008, la juridiction financière insiste sur le fait que la dégradation des comptes publics n’a été provoquée qu’à la marge par la crise, qui représente seulement 4 milliards d'euros de moins-values fiscales, alors que le Gouvernement a accordé, dans le même temps, 7, 8 milliards d'euros de nouveaux cadeaux fiscaux pour la seule année 2008.
Ces cadeaux fiscaux, cumulés à ceux des années précédentes, portent le montant total des dégrèvements et remboursements d’impôt à 92, 2 milliards d'euros ! Ce chiffre, qui paraît presque incroyable, fait véritablement froid dans le dos !
Il est vrai que cette stratégie n’est pas nouvelle. Nous l’avons vu apparaître dès 2002, avec le gouvernement Raffarin, avant d’être poursuivie par M. de Villepin, notamment au travers de son fameux « bouclier fiscal ».
Les effets néfastes étaient tels que, à peine M. Sarkozy élu, Mme Lagarde appelait de ses vœux un plan de rigueur, avant d’être tancée par l’Élysée. Puis ce fut au tour de M. Fillon d’indiquer que les caisses de l’État étaient vides et que la France était en « faillite ». Malheureusement, ce constat lucide ne l’a pas empêché d’appliquer les consignes de l’Élysée, tout en accentuant les choix de ses prédécesseurs ; la loi TEPA et son paquet fiscal, adoptés en 2007, ont ainsi coûté au budget général 3, 3 milliards d'euros en 2008.
Ces mesures ne sont pas seulement dispendieuses, elles portent aussi, à nos yeux, gravement atteinte au principe de progressivité de l’impôt.
Rappelons en effet que la loi TEPA a introduit une quasi-suppression des droits de succession, l’exonération d’impôt sur le revenu des heures supplémentaires, la déduction de 75 % du montant de l’ISF pour certains investisseurs et, pour couronner le tout, elle a abaissé le bouclier fiscal à 50% ! Ajoutez-y des restitutions d’impôt sur les sociétés et de TVA, coûtant au total 9, 5 milliards d'euros en 2008, et vous obtenez une situation explosive au profit des contribuables favorisés.
Dans son rapport de juin 2009, la Cour des comptes pointe « un mouvement ancien d’allégements fiscaux ». Les magistrats de la rue Cambon relèvent en effet que la baisse des impôts de l’État depuis quatre ans a contribué à accroître le déficit de 39 milliards d'euros en 2009. Pis, le déficit structurel s’aggravera en 2010 à cause de la baisse de la TVA sur la restauration, qui coûtera au moins 2, 5 milliards d'euros, …

…à laquelle s’ajoutera une charge résiduelle d’au moins 6 milliards d'euros due à la future compensation de la taxe professionnelle.
Lors de son audition au Sénat, M. Séguin estimait qu’il était urgent de trouver 70 milliards d'euros d’économies pour endiguer le déficit structurel. Nul doute que ces 39 milliards d'euros gaspillés indûment y contribueraient efficacement !
Il est aussi possible de chercher du côté des niches fiscales, car ces exonérations, déductions ou réductions diverses occupent aujourd'hui une place considérable dans les politiques publiques. Leur nombre a été estimé en 2008 à 483, soit un manque-à-gagner pour l’État de 73 milliards d'euros, ou 27 % des dépenses et 21 % des recettes fiscales. La perte de recettes qu’elles génèrent s’élève au total à 3, 8 % du PIB. Or, malgré les critiques unanimes, une quinzaine de niches fiscales sont créées chaque année.
Si l’on additionne les 39 milliards d'euros d’allégements et les 73 milliards d'euros de niches fiscales, mes chers collègues, on aboutit à un total de 112 milliards d'euros, que l’on peut aisément rapprocher du déficit annoncé pour 2009. C’est un chiffre effrayant à lui seul, et le constat est accablant.
Néanmoins, il y a plus grave, me semble-t-il. En effet, si la politique menée par le Gouvernement avait un sens sur le plan économique, si elle était efficace et produisait des effets positifs, nous pourrions, même en désaccord sur la perception des choses, convenir de ses bienfaits. Mais en l’occurrence, c’est loin d’être le cas, car cette politique fondée sur un idéologique, sur une certaine doctrine de l’offre, révèle ses limites.
Quelles intentions et quelle stratégie nous a-t-on annoncées ? Depuis 2003, on nous disait qu’il fallait moderniser l’État devenu impotent, baisser les prélèvements pour libérer les énergies, attirer les investisseurs afin de retrouver le chemin de la croissance. Le Gouvernement affirmait que la politique fiscale et sociale de la France était un fardeau pénalisant et qu’il fallait mettre fin à l’exode des capitaux pour une fiscalité attrayante.
Cette promesse faite par M. Sarkozy devant l’université d’été du MEDEF en 2007 est sans doute le péché originel de toute la politique économique menée depuis deux ans. Ce que l’un de nos collègues, sur les travées de l’UMP, qualifiait de « cocktail gagnant » s’est conclu par un échec cuisant qui n’a aucunement rendu plus compétitif le territoire national.
Ces baisses d’impôt avaient vocation à améliorer la croissance. Qu’en est-il aujourd'hui ? Les choses sont simples : le taux de croissance de la France, qui était au début des années 2000 supérieur à la moyenne européenne, est aujourd'hui inférieur à celle-ci. Les baisses d’impôt n’ont donc pas du tout produit les effets escomptés.
À ce sujet, une étude récente sur le comportement des contribuables dits « à fort potentiel économique », autrement dit les riches, montre que ceux-ci orientent leurs placements vers la rente – livrets, assurance-vie, immobilier – plutôt que vers l’investissement productif, forcément risqué. Un quotidien économique ne titrait-il pas récemment, monsieur le ministre : « Même les riches ont le blues » ? Ces derniers ne croient en effet plus à la politique économique du Gouvernement.
Le deuxième objectif visé était de rendre de la compétitivité à notre pays. « La France a une situation calamiteuse sur le plan fiscal, nous disait-on ; il faut attirer les investissements et empêcher que ne fuient à l’étranger un certain nombre d’investisseurs ».
À vrai dire, si l’on se fie aux études comparatives internationales – la dernière en date, celle d’Ernst & Young présentée récemment en commission des finances, l’établit clairement –, la fiscalité n’est en rien un argument dissuasif pour l’investissement et les choix d’implantation des investisseurs.
La situation est donc catastrophique, avec un déficit considérable, et le Gouvernement s’échine à poursuivre une politique qui ne produit pas les effets annoncés !
La situation de la dette mérite que l’on s’y penche sérieusement. En vingt-cinq ans, elle n’a cessé de croître, à l’exception d’une courte embellie de 1997 à 2002, quand la gauche gouvernait. À ce rythme, la dette devrait atteindre 86 % en 2010, puis 100 %, voire 130 % en 2020. Actuellement, un montant équivalent au produit de l’impôt sur le revenu est avalé par le remboursement des intérêts, qui représente 2 000 euros par actif ! Il faudra bientôt parler non plus d’effet boule-de-neige, mais d’un risque d’avalanche de niveau 5 !
Cette dette, aussi pharaonique soit-elle, aurait pu servir à préparer la France du XXIe siècle par des investissements dans les infrastructures utiles, dans la connaissance, la recherche et l’innovation. Malheureusement, le sous-investissement récurrent dans ces domaines mine les fondations du pays, notamment l’industrie et l’enseignement supérieur. Et ce n’est pas votre plan de relance qui a changé cet état de fait !
La dette provoque aussi des tensions sur la trésorerie de l’État, obligé de se financer sur les marchés.
Nous savons tous que cette situation dans laquelle vous avez mis la France depuis 2002 est impossible à tenir. Il faudra tôt ou tard relever les prélèvements obligatoires et réduire les dépenses. Deux voies s’offrent à vous : ou bien vous abrogez les privilèges consentis à quelques-uns, ou bien vous lancez un plan de rigueur en cassant le service public et la protection sociale.
Pour notre part, nous pensons que le plus urgent est de retrouver une politique de recettes conforme à l’idéal républicain de solidarité, en réhabilitant l’impôt progressif. Monsieur le ministre, vous êtes en quelque sorte au pied du mur : vous devez changer au plus vite de cap pour ne pas entrer dans les manuels d’histoire comme le ministre d’un gouvernement ayant causé la banqueroute de notre pays !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, n’oublions pas que nous traversons une crise profonde ! Dans une telle situation, la définition d’une ligne claire pour orienter les finances publiques est d’autant plus nécessaire que l’année 2009 va connaître un recul historique de notre produit intérieur brut, associé à un déficit budgétaire de l’ordre de 7 % du PIB et à un endettement record dépassant 1 400 milliards d’euros.
Monsieur le ministre, vous avez précisé, avec l’honnêteté et le talent qui vous caractérisent, les perspectives de l’année prochaine.
Je voudrais rappeler, notamment à MM. Marc et Foucaud que je viens d’écouter avec intérêt, que le Président de la République, dans le discours qu’il a prononcé à Versailles, a clairement reconnu que la France avait un problème de finances publiques.

Il a esquissé la théorie des trois déficits : le mauvais déficit qu’il faut ramener à zéro ; le déficit conjoncturel qu’il faudra résorber en y consacrant l’intégralité des recettes de la croissance ; enfin, le déficit qui finance les dépenses d’avenir. À cet égard, il a annoncé le lancement d’un emprunt affecté exclusivement à des priorités stratégiques que plusieurs commissions vont déterminer.
J’approuve ce discours ainsi que le recours à un emprunt, mais celui-ci ne peut être une simple addition à la dette actuelle. Mes chers collègues, cet emprunt doit marquer une rupture, et c’est dans cette perspective que s’inscrit mon intervention. J’estime en effet qu’il n’est pas possible de laisser dériver plus longtemps les finances publiques de notre pays et que nous devons donner dès le budget de 2010un signal à tous ceux qui nous observent.
S’il est facile d’expliquer pourquoi il faut entreprendre de réduire le déficit budgétaire, il sera plus difficile d’expliquer comment nous devons le faire. Je vais m’y employer.
Pourquoi faut-il réduire le déficit des finances publiques ? Pour trois raisons.
D’abord, les déficits de l’État et de la sécurité sociale engendrent un endettement public qui va, cette année, atteindre 80 % du PIB et nécessitent une charge financière de l’ordre de 50 milliards d’euros, soit l’équivalent de l’impôt sur le revenu. Cette charge, déjà lourde en période de taux de crédit relativement faibles, risque de devenir insupportable si les taux augmentent. De plus, n’oublions pas que près de 10 % de la dette de l’État est portée par des obligations du Trésor indexées sur l’inflation. Nous avons mesuré en 2008, à concurrence de plusieurs milliards d’euros, les conséquences de cette indexation.
Ensuite, ce déficit chronique détériore nos relations avec nos partenaires de l’euro et risque de remettre en cause l’euro lui-même. Certes, le danger n’est pas encore perceptible, car le marché financier international accueille favorablement nos emprunts à court, à moyen et à long terme ; mais la Cour des comptes, dans son rapport, évoque le risque d’explosion de la dette. Chacun se souvient de la crise financière de l’année dernière : tout peut arriver très vite dans le cas d’une crise financière et les marchés peuvent se fermer sans préavis.
Enfin, et c’est la raison qui me paraît la plus importante, la mauvaise situation de nos finances publiques et plus particulièrement le déficit du régime général de la sécurité sociale, longuement évoqué par Mme Dini et M. Vasselle, créent une divergence grave avec notre principal partenaire européen, l’Allemagne. Le bon fonctionnement du couple franco-allemand est, on le sait, nécessaire à la poursuite de la construction européenne. Or, le gouvernement allemand vient de s’engager avant les élections – c’est courageux de sa part – dans la voie d’une réduction programmée de son déficit budgétaire : 6 % du PIB en 2010, 5 % en 2011 et 4 % en 2012.
Il n’est donc pas envisageable d’accroître la dette actuelle avec un grand emprunt national sans mettre à profit cette émission pour entamer, nous aussi, une réduction programmée de notre déficit, en préalable à la stabilisation de l’endettement. Il nous faudra bien nous résoudre à engager une telle réduction dès que la crise économique sera en voie de résorption.
J’en viens à ma seconde question, la plus difficile : comment amorcer la réduction du déficit dès 2010 ?

Je ne sous-estime pas, monsieur le ministre, les efforts entrepris par le Gouvernement depuis le début de la crise : réduction des effectifs de la fonction publique – décision courageuse, contestée par tout le monde –, maîtrise de la croissance des dépenses de l’État – contestée par tous ceux qui dépensent –, révision générale des politiques publiques – révision qui n’a pas encore porté tous ses fruits –, diversification des modalités de financement du Trésor. Je n’aurai garde de proposer des impôts supplémentaires, à l’exception toutefois de la contribution climat-énergie.
Toutefois, mes chers collègues, je suis quelque peu perturbé par le fait que, alors qu’on nous dit que tout le monde doit consentir les efforts nécessaires pour sortir de la crise, seuls les travailleurs privés d’emploi et les jeunes dans l’impossibilité d’en trouver un supportent aujourd'hui les conséquences de cette crise. Nos autres concitoyens se contentent de les observer, parfois avec compassion, souvent avec indifférence, comme si le retour de la croissance à partir de 2011 devait nous dispenser de tout effort et de toute réforme.
Monsieur le ministre, alors que, dans son rapport préalable à notre débat, la Cour des comptes prévoit que le déficit public sera encore supérieur à 6 % du PIB en 2012, il me paraît possible d’engager dès maintenant un processus de réduction du déficit analogue à celui que nos voisins d’outre-Rhin mettent en œuvre. Ce dernier vise, en taillant dans les dépenses inutiles ou répétitives, à faire passer leur déficit public de 7 % du PIB en 2009 à 4 % en 2012.
Trois secteurs doivent faire l’objet de soins particuliers. Le premier est celui des dégrèvements – le budget le plus important de l’État –, qui représentent 90 milliards d’euros, soit 73 milliards d’euros pour l’État et 17 milliards d’euros pour les collectivités locales. Le deuxième secteur est celui des dépenses fiscales, soit 69 milliards d’euros. Enfin, le troisième secteur est celui des allégements de charges sociales, à hauteur de quelque 40 milliards d’euros. L’ensemble de ces secteurs représente au total une masse de l’ordre de 200 milliards d’euros.
L’objectif pour 2010 est d’économiser 20 milliards d’euros, soit un point de PIB, le fameux point qui nous permettrait de réduire le déficit de 7 % à 6 % du PIB.
Les exemples de ce qui pourrait être entrepris sont nombreux, mais je me contenterai de n’en citer que quelques-uns, monsieur le ministre.
Certains programmes d’allégements fiscaux pourraient être suspendus
Mme Nicole Bricq s’exclame.

Le seuil d’exonération en matière d’allégements de charges sociales pourrait être réduit. L’abaisser à 1, 4 SMIC ou à 1, 3 SMIC rapporterait de 6 milliards à 7 milliards d’euros.
On pourrait également développer le financement de la dette en jouant davantage sur le court terme, comme nous l’avons vu hier, …

… ce qui représenterait un gain de 2 milliards à 3 milliards d’euros.
On pourrait aussi, à l’occasion de l’emprunt national de 20 milliards, 30 milliards ou 40 milliards d’euros que l’État s’apprête à lancer pour financer les priorités d’avenir, ressusciter l’activité de la Caisse de la dette publique, organisme qui ne sert pas à grand-chose aujourd'hui – mais loin de moi l’idée d’attaquer ses honorables membres ! Cette caisse pourrait porter cet emprunt, le produit de la taxe climat-énergie pouvant lui être affecté pour l’amortir. Ce serait là une bonne façon d’utiliser le produit de cette taxe.

Par ailleurs, l’examen des dégrèvements et des niches fiscales et sociales nous permettrait sans doute de gagner un autre point de PIB en 2011, lorsque les recettes fiscales seront de nouveau plus solides et permettront de réduire un peu le déficit.
Si vous persévérez dans la maîtrise de la dépense, comme vous nous en avez donné l’assurance, monsieur le ministre, et si vous fixez des plafonds à l’ensemble des administrations dans une loi pluriannuelle, nous pourrons alors gagner un point en 2011 et un point en 2012.
Parviendrons-nous à revenir à un déficit de 3 % du PIB en 2013 ? Nul ne peut le savoir aujourd'hui. Cela dépendra de la conjoncture. Je ne pense pas que l’on puisse réduire le déficit de plus de 1 % du PIB par an, mais nous devons nous y efforcer, afin d’envoyer ainsi un signal à nos partenaires et de nous engager dans la voie de la stabilisation de notre endettement.
Il ne s’agit là bien évidemment que de pistes de réflexion. Il conviendra ensuite, avec le président et les membres de la commission des finances, d’examiner chacune de ces niches sociales et fiscales, ainsi que chacun des dégrèvements.

En conclusion, monsieur le ministre, comme l’a rappelé tout à l’heure M. le président de la commission des finances, j’ai été le dernier ministre de l’économie et des finances à présenter un budget en équilibre, celui de 1975.

Je rappelle que, cette année-là, la dette publique représentait 13 % du PIB.

M. Jean-Pierre Fourcade. Je m’étais alors fait tancer très vivement par Fernand Icart, alors président de la commission des finances de l’Assemblée nationale – il fut d’ailleurs mon successeur au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire –, qui trouvait dramatique que la dette de l’État passe de 9 % à 13 % du PIB !
Sourires

Monsieur le ministre, loin de moi l’intention de sous-estimer la qualité du travail que vous effectuez, l’honnêteté avec laquelle vous traitez ces différents sujets et l’effort que vous faites pour tenter de résorber notre déficit, qui représente un poids considérable ; mais je me dois de dire clairement dès aujourd'hui que je ne pourrai pas voter le projet de loi de finances pour 2010 s’il ne marque pas le début de la réduction du déficit et donc de l’endettement de notre pays.

Le moment est venu d’agir. Je pense qu’un certain nombre de mes collègues partagent mon sentiment : nous ne pouvons plus nous laisser aller à la dérive ! (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.)

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je viens d’écouter avec intérêt M. Jean-Pierre Fourcade. Mais, mon cher collègue, cessez donc de voter tous les jours des diminutions de nos ressources fiscales, car c’est bien à cela que nous sommes confrontés !
Le Sénat siège aujourd’hui en session extraordinaire– c’est une pratique devenue habituelle pour notre assemblée – pour débattre des orientations des finances publiques pour 2010.
Il est une autre habitude, monsieur le ministre : nous débattons bien sûr sans connaître toutes les conséquences budgétaires des décisions des conseillers du Président de la République ! Peut-être d’ailleurs ne les connaissez-vous pas encore vous-même ? C’est le tonneau des Danaïdes !
Est-il besoin de rappeler que nous avions élaboré voilà à peine sept mois un projet de loi de finances pour 2009 alors même que le Président de la République annonçait de façon concomitante un plan de relance aux conséquences forcément réelles pour les finances publiques ?
Aujourd’hui, nous débattons des orientations des finances publiques pour l’année 2010 alors même que les modalités de la révision de la fiscalité locale ne sont pas actées et que l’on ne connaît rien du projet de grand emprunt national annoncé en grande pompe à Versailles par le Président de la République.
Le Premier président de la Cour des comptes, lors de son audition le 24 juin dernier, avouait n’avoir aucune information sur le montant, les modalités ou la destination de ce grand emprunt, que le Président de la République lui-même avait pourtant écarté quelques mois auparavant. Comprenne qui pourra !
Les Français – cela fera plaisir au président de la commission des finances – sont, si l’on en croit le baromètre BVA-Les Échos, bien plus informés qu’on ne le pense sur l’état de nos finances publiques. Près de 55 % d’entre eux ne soutiennent pas le lancement en 2010 d’un grand emprunt national pour financer les dépenses dites « d’avenir ». Ils ont bien compris que cet emprunt n’avait pour autre vocation que de différer après 2012 un certain nombre de mesures nécessaires !

Il s’agit en effet de faire diversion.
La communication politique du Président de la République et du Gouvernement a beau se déployer comme jamais, nous savons bien que, depuis plusieurs années – cela a été déjà dit par nombre de nos collègues, notamment François Marc –, la baisse de la fiscalité des ménages les plus aisés – grâce à la multiplication des niches fiscales, conjuguée à de nouvelles mesures, telles la réduction du taux de TVA sur la restauration ou la suppression annoncée de la taxe professionnelle – diminue les ressources fiscales de l’État et augmente l’effet de ciseau entre les recettes et les dépenses.
Le Premier président de la Cour des comptes estime ainsi que l’adoption de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et le dégrèvement actuel de la taxe professionnelle – je ne parle pas du dégrèvement à venir – ont entraîné une diminution des ressources publiques de près de 10 milliards d’euros.
Aujourd’hui, alors même que la crise sévit, que le taux de chômage enfle, les collectivités locales assument, aux côtés de l’État, un double rôle, celui d’investisseur public et celui d’amortisseur social.
Il n’est pas loin le temps – un an à peine – où le Gouvernement ne cessait de pointer du doigt les dépenses des collectivités locales, qu’il accusait d’être les seules responsables des déficits. Depuis qu’il a pris conscience de la crise qui frappe notre pays, le Gouvernement a redécouvert le caractère vertueux de leurs dépenses d’investissement – elles représentent, comme chacun le sait, près de 75 % de l’investissement public total – et a signé avec près de 20 000 d’entre elles, dans le cadre du pacte de relance, une convention portant augmentation de leurs investissements en contrepartie d’un remboursement anticipé de TVA.
À cet égard, il est regrettable qu’aucune mesure d’encouragement à l’investissement n’ait été mise en œuvre en faveur des établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI – la commission des finances avait pourtant fait des propositions en ce sens –, alors qu’ils sont bien souvent aujourd’hui les relais de nos communes en matière d’investissement public local.
Les EPCI à taxe professionnelle unique, les départements et les régions ont récemment appris par le Président de la République que la taxe professionnelle serait supprimée à la fin de l’année 2009 – ils ne savent toujours pas aujourd'hui par quoi elle sera remplacée –, ce qui creusera encore le déficit de l’État, déjà qualifié par tous d’abyssal, de 10 milliards ou 11 milliards d’euros supplémentaires, nul ne le sait exactement.
Avouez, mes chers collègues, que ces éléments sont de nature à inquiéter les excellents gestionnaires que sont dans leur très vaste majorité les élus locaux. Dans une période où, crise oblige, les collectivités locales ont besoin de visibilité pour investir de manière soutenue, c’est là, selon moi, une rupture du pacte de confiance qui doit les unir à l’État. Et je n’évoquerai pas, car ce n’est pas le moment, le souhait du Président de la République de diviser par deux le nombre d’élus départementaux et régionaux, ce qui ajoute encore à la confusion.
Quand on sait la bonne image que les Français ont de leurs élus locaux, quand on sait à quel point l’excellence de ces derniers est reconnue par nos concitoyens, qui apprécient leur proximité et l’efficacité des politiques menées et des services offerts, je souhaite bien du plaisir à ceux qui défendront une réforme que l’on ne peut que qualifier d’électoraliste et de populiste !
Nous pensons que les collectivités locales sont de meilleures gestionnaires que l’État, qu’elles investissent plus dans les domaines de compétences transférées, comme on l’a vu, par exemple, avec les lycées, les collèges et les TER. Nous ne laisserons donc personne les disqualifier, comme on a tenté de le faire en les accusant d’augmenter les impôts et les dettes.
D’ailleurs, c’est vers ces mêmes collectivités locales que les Français se tournent en dernier recours lorsque tout va mal. Les fonds d’aide des conseils généraux ou les secours apportés par les centres communaux d’action sociale, ou CCAS, jouent un rôle d’amortisseur social.
Par conséquent, nous ne pouvons pas, me semble-t-il, supprimer la taxe professionnelle sans jeter les bases – c’est le cas de le dire – d’une fiscalité locale plus juste et d’une véritable autonomie fiscale.
Les transferts de compétences n’étant que partiellement compensés, la croissance des dépenses locales est plus forte que celle des dépenses de l’État. Cela se traduit par un déplacement de pression fiscale de l’État vers les collectivités locales. Se pose donc la question de la réforme des impôts locaux attendue depuis des années.
Monsieur le ministre, lorsque je vous avais interrogé sur la réforme des bases, vous m’aviez indiqué qu’une concertation était engagée, en liaison avec la suppression de la taxe professionnelle. Nous voulons savoir où cela en est aujourd'hui.
Par comparaison avec d’autres réformes extrêmement coûteuses pour les finances publiques, notamment la baisse de la TVA sur la restauration, l’effort de péréquation du Gouvernement est dérisoire. En exerçant une contrainte sur l’évolution de la DGF – la norme de croissance de l’enveloppe globale des dotations est chaque année plus restrictive –, l’État se défausse de ses responsabilités en la matière.
Chacun le comprend, les collectivités locales ont besoin de recettes dynamiques, mais également de prévisibilité financière et de lisibilité. Or cette exigence n’est plus satisfaite aujourd'hui. Il est donc temps, me semble-t-il, que le Gouvernement cesse de considérer les finances locales comme une variable d’ajustement du budget de l’État.
Faute d’une prise de conscience de l’ampleur des difficultés, la crise des collectivités risque de venir aggraver la situation économique nationale soit par une hausse obligatoire ou inéluctable des impôts locaux et de l’endettement, soit par une panne de l’investissement local.
Comment dès lors réinstaurer une véritable confiance ? Nous pensons que l’État serait bien inspiré de s’appuyer sur le dynamisme local, au lieu de l’étouffer. Ne pas aggraver la situation pour 2010 relèverait du bon sens, et l’améliorer serait conforme à l’intérêt national.
À mon sens, le Gouvernement devrait comprendre que la concertation avec les collectivités locales est un bienfait, et non une contrainte. En effet, au lieu de « travailler plus pour gagner plus », les Français devront bientôt « payer plus pour rembourser plus » !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat d’orientation budgétaire pour 2010 nous amène à examiner l’état actuel de nos finances publiques, ainsi que les perspectives à venir et les orientations du Gouvernement.
Le Premier président de la Cour des comptes a présenté devant la commission des finances des perspectives inquiétantes non seulement pour les finances publiques et sociales, mais également pour la croissance de demain et la sortie de crise.
Ce débat est aussi l’occasion de nous assurer que la politique budgétaire suivie par le Gouvernement prépare notre pays à sortir de la crise : elle doit non seulement accompagner la reprise, mais également favoriser la croissance de long terme tout en consolidant la « soutenabilité » de nos finances publiques.
Certes, personne ne peut nier que nous vivons une situation exceptionnelle, la pire crise économique depuis la libération, avec une récession de près de 3 % en 2009. Mais ayons l’honnêteté de reconnaître que la situation de nos comptes publics était dégradée avant même que la crise ne produise ses effets ! La Cour des comptes, qui réclame justement un effort de vérité accru sur l’état de nos finances publiques, vient d’établir clairement que nous assistons à une accélération de la dégradation des déficits depuis 2007. Ainsi, le déficit de l’État s’est aggravé en 2007, alors que la croissance était de 2, 3 %, et il a augmenté de 47 % en 2008. La crise n’explique donc pas à elle seule l’aggravation des déficits.
Nous devrions regarder courageusement nos propres insuffisances. Nous payons aujourd’hui le laxisme budgétaire dont les gouvernements successifs ont fait preuve depuis des années. Et nous le payons cher, car notre pays, en entrant dans la crise avec des comptes dégradés, n’a pas pu consacrer autant de moyens que ses voisins aux actions du plan de relance.
S’agissant des perspectives budgétaires pour 2010, personne ne sait vraiment aujourd’hui quel sera l’état de l’économie mondiale et quelles seront les répercussions de la crise mondiale à cette date. Pour ma part, je pense que nous devons nous attendre à une sortie de crise lente.
L’hypothèse de croissance retenue par le Gouvernement pour construire le budget pour 2010, c'est-à-dire 0, 5 %, doit nous inciter à la prudence sur le niveau des recettes fiscales pour l’année prochaine. Celles-ci sont en forte baisse, en recul de 20 % au 30 avril dernier par rapport à la même période en 2008, alors que le volume des dépenses reste stable.
Monsieur le ministre, notre débat a lieu dans un contexte incertain, comme vous l’avez d’ailleurs vous-même reconnu. Où en est le projet du Gouvernement de suppression de la taxe professionnelle, qu’il faudra bien compenser ? Quid de la taxe carbone, qu’un membre éminent du Gouvernement veut déjà rembourser aux Français sous la forme de « chèques verts » ? Voilà autant de recettes incertaines pour le budget 2010. Dans ces conditions, il est illusoire d’imaginer réduire le déficit.
En effet, Philippe Séguin, a fait une description détaillée et alarmiste, mais malheureusement réaliste, de la situation des comptes de l’État. Le déficit budgétaire « tangente » les 140 milliards d’euros, soit 7, 5% du PIB, et la dette atteint 1 327 milliards d’euros, ce qui représentera 80 % du PIB à la fin de l’année 2010.
La situation des comptes sociaux est tout aussi préoccupante, puisque l’on prévoit 25 milliards, voire 30 milliards d’euros de déficit pour 2009. Nous devons nous attendre à ce que ce dernier se creuse encore davantage : l’aggravation du chômage et la contraction de la masse salariale qui en découle réduiront de fait les recettes, alors que les dépenses augmenteront.
Il s’agit malheureusement non pas d’un déficit conjoncturel, mais bien d’une insuffisance de recettes structurelles de nos dépenses sociales, que ce soit en matière de santé ou de vieillesse. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, Mme Dini, présidente de la commission des affaires sociales, et M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales, ayant été très clairs.

Permettez au président du comité de surveillance de la CADES que je suis d’exprimer une position que M. le ministre connaît bien. La CADES devra bien reprendre une telle dette, qui s’élèvera peut-être à plus de 50 milliards d’euros à la fin de l’année 2010.
En 2008, la dette publique brute de la France a progressé de 10 %, passant de 1 209 milliards d’euros à 1 327 milliards d’euros, soit 20 600 euros par habitant et 47 400 euros par actif. La charge d’intérêts a atteint 54, 6 milliards d’euros, soit 850 euros par habitant et 1 950 euros par actif.
En matière de déficit, la France fait moins bien que la moyenne de ses partenaires européens : 3, 4 % contre 1, 5 %. Elle est également le seul pays de la zone euro dont les dépenses publiques ont été supérieures à 50 % du PIB en 2008. Enfin, la France est devenue le quatrième État le plus endetté de la zone euro par rapport à son PIB, alors qu’elle se classait au huitième rang en 2004. Nous faisons donc moins bien que nos voisins européens.
Il va sans dire que, à ce stade, l’objectif d’un retour à l’équilibre en 2012 est abandonné. Vous nous l’avez d’ailleurs confirmé, monsieur le ministre. Et même si je suis conscient des efforts que vous réalisez, je constate que l’objectif d’un déficit à 3 % du PIB en 2012 s’éloigne lui aussi progressivement, du fait de la crise.
Avec cette crise, l’économie française ressemble à une machine à fabriquer de l’endettement. Au total, la dette publique de l’État, des collectivités locales et de la sécurité sociale s’élève à 1 413 milliards d’euros, soit 72, 9 % du PIB. L’endettement atteint donc des proportions abyssales.
Hormis en temps de guerre, jamais l’état de nos finances publiques n’a été aussi dégradé.
Si la situation est inquiétante, elle pourrait vite devenir catastrophique. Selon les simulations de la Cour des comptes, le déficit dépasserait les 6 % en 2012. Philippe Séguin évoque le risque d’un emballement de la dette, qui pourrait atteindre 100 % du PIB en 2018. À ce rythme, je me demande si nous ne serons pas amenés dans les prochaines années à examiner un projet de loi visant à lutter contre le surendettement de l’État !

En outre, le recours à l’endettement de court terme rend la France très vulnérable à une hausse des taux d’intérêt – je ne m’étends pas sur le sujet, sur lequel M. Jean-Pierre Fourcade s’est montré parfaitement clair –, qui pourrait survenir prochainement. Si nos déficits perdurent après la crise, le risque à terme est bien que la signature de la France perde de sa crédibilité. Nous en avons d’ailleurs discuté hier à l’occasion de l’examen du projet de loi de règlement.
Nous devrons garder à l’esprit cette réalité des chiffres lorsque nous examinerons la question du grand emprunt.
Devant un tel constat, comment ne pas être surpris, voire inquiets, en entendant le Président de la République préconiser devant le Parlement réuni en Congrès à Versailles de s’endetter davantage pour résoudre le problème de la dette, et lancer l’idée d’un grand emprunt ? En d’autres termes, il est proposé de combler le trou en le creusant davantage. En effet, le grand emprunt, qui servira, nous dit-on, à financer « les priorités nationales », aura pour premier effet mécanique d’augmenter la dette et la charge d’intérêts sur celle-ci.
Si le chef de l’État a évoqué la « grave question des déficits de nos finances publiques », son discours à Versailles a donné le sentiment que la maîtrise des déficits publics et le désendettement n’étaient plus une priorité pour le Gouvernement et que, avec la crise, on pouvait au contraire rouvrir peu ou prou les vannes de la dépense.
Je crains également que, en lançant l’idée d’un grand emprunt national, le président n’ait en quelque sorte fait sauter un « verrou psychologique ». Je trouve cela très dommageable dans un pays où nombre de nos concitoyens pensent encore que les ressources de l’État sont inépuisables et que l’on peut dépenser sans compter. D’ailleurs, en ouvrant grand les vannes de la dépense publique et en faisant sauter la digue des 3 % de déficit, la crise a accrédité cette idée.
Pourtant, depuis la dernière campagne présidentielle – c’était voilà deux ans à peine –, au cours de laquelle plusieurs candidats, notamment un, avaient placé les dangers de l’envolée de la dette publique dans notre pays au premier rang des préoccupations nationales, j’avais le sentiment que beaucoup de nos concitoyens avaient pris conscience de la gravité de nos déficits et de notre dette publique. Sans parler d’un « parti de la dette », chacun prenait conscience du fait que nous laissions une ardoise de plus en plus grosse aux générations futures. Je crains que la crise et l’idée du grand emprunt ne viennent anéantir tous nos efforts en la matière.
L’idée que leurs enfants, voire leurs petits-enfants, auront à régler l’addition de nos dépenses inquiète beaucoup les Français. Le Président de la République évoque un emprunt pour « préparer l’avenir du pays ». Je ne suis pas sûr que les générations futures, qui auront à rembourser nos emprunts, aient à se réjouir de cette annonce.
Une telle fuite en avant dans le surendettement finit par devenir anxiogène. Plusieurs économistes ont décrit le mécanisme dans lequel la hausse de la dette incite les gens à moins consommer – il suffit de considérer le taux d’épargne actuel des Français – pour mettre de l’argent de côté en vue d’inéluctables hausses d’impôts. Si c’était le cas, on ne voit plus très bien ce qu’il resterait à la France pour alimenter sa croissance, puisque notre balance commerciale est en grave déséquilibre.
Pour justifier le recours à l’emprunt, le chef de l’État explique que, à chaque fois qu’une politique de rigueur a été menée, on s’est retrouvé avec moins de croissance, plus d’impôts, plus de déficits et plus de dépenses.
A contrario, si les déficits et la dette créaient de la croissance et permettaient de lutter contre le chômage dans notre pays, nous le saurions depuis longtemps. La France est l’unique pays industrialisé à ne pas avoir connu un seul excédent budgétaire depuis le milieu des années soixante-dix. M. Fourcade, qui a été le grand témoin de cet après-midi, fut le dernier ministre de l’économie et des finances à connaître un budget en équilibre, en 1975 !
L’addiction de notre pays au déficit ne l’a pas empêché de connaître une croissance nettement plus faible et un chômage beaucoup plus élevé que la moyenne.
Il faut rappeler une réalité qui semble avoir été oubliée depuis le discours de Versailles : en empruntant sur les marchés chaque année plus de 150 milliards d’euros, la France fait le grand emprunt tous les jours !

Depuis l’annonce du grand emprunt, tous les efforts du Gouvernement se concentrent sur un seul objectif : préparer l’avenir. C’est ce que vous avez indiqué, monsieur le ministre, et nous vous croyons.
Mais, pour être honnête, je ne suis pas sûr que nous préparions l’avenir en contractant un nouvel emprunt ! Si cette idée est habile politiquement, est-elle bien raisonnable économiquement dans un État aussi surendetté et incapable de se désendetter que le nôtre ?
Je le rappelle, l’État peut emprunter des montants très élevés sur les marchés financiers à un coût très faible – d’ailleurs, il le fait –, alors que l’emprunt auprès du public est beaucoup plus coûteux. M. le président de la commission des finances indiquait tout à l’heure que le taux du grand emprunt devrait finalement être inférieur aux conditions du marché. Cela risque de ne pas le rendre forcément très attractif auprès des éventuels souscripteurs…
Compte tenu de ses coûts de réalisation et des avantages fiscaux qui y sont associés, cet emprunt, dont l’objet est plus politique que financier, coûtera cher aux contribuables et aux finances publiques. Il aura également des conséquences sur l’endettement, puisqu’il consiste à reporter une partie du financement sur les générations futures.
Vous l’aurez compris, mes chers collègues, je crains que, avec une telle opération, nous ne passions du « travailler plus pour gagner plus » à la deuxième phase du quinquennat, c'est-à-dire « emprunter plus pour dépenser plus » !
En effet, concernant l’utilisation de l’emprunt, malgré les engagements répétés du Gouvernement et votre rigueur, que je salue, monsieur le ministre, je m’interroge sur l’affectation – on parle de 80 à 100 milliards d’euros ! – des sommes empruntées aux « dépenses d’avenir » prioritaires.
Il est particulièrement délicat de définir ce que sont exactement les dépenses d’avenir, ce « bon déficit », selon la distinction désormais établie entre bon et mauvais déficit ! Or, pour moi, qu’il soit bon ou mauvais, le déficit s’aggrave et la dette augmente ! On sent d’ailleurs bien qu’il existe un certain flottement à la tête de l’État. Aujourd’hui, chacun – le chef de l’État, le Premier ministre, le conseiller du président inspirateur du grand emprunt, la ministre de l’économie, vous-même, monsieur le ministre, ... – essaye d’en donner une définition et d’en établir une liste à la fois exhaustive et limitative.
N’est-il pas surprenant, à ce propos, de décider d’emprunter avant de savoir pourquoi ? Surtout, les finances publiques sont indivisibles et l’emprunt, comme les autres ressources de l’État, contribuera en réalité à financer l’ensemble des dépenses publiques, sauf à prévoir un mécanisme spécifique du type d’une commission de suivi des investissements dits d’avenir.
J’ai une autre interrogation, monsieur le ministre. On ne peut qu’approuver la volonté d’investir dans l’innovation, la recherche et développement qui prépare l’économie de demain, surtout quand on sait que l’État, du fait de son appauvrissement, investit très peu : 20 milliards d’euros. Mais je ne suis pas sûr que les sommes empruntées iront spécifiquement à ces investissements dans l’avenir. J’en veux pour preuve le récent rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE, sur la part de l’innovation dans les plans de relance face à la crise. Il montre que le plan de relance français ne consacrait que 46 millions d’euros à la recherche et développement, et 4, 7 milliards d’euros aux ponts et aux routes. La France fait figure de mauvais élève là où la Finlande ou la Corée du Sud sont en haut du classement. Ne risque-t-on pas de reproduire ce schéma ?
Je serai donc particulièrement attentif, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative, au début de 2010, aux conditions de l’emprunt, et notamment à son coût pour les finances publiques.
C’est pourquoi plusieurs de nos collègues, et non des moindres puisqu’il s’agit notamment des deux rapporteurs généraux, doutant de l’opportunité de ce grand emprunt, proposent un emprunt obligatoire. Celui-ci ne me semble pas raisonnable et doit faire au moins l’objet d’un examen attentif. Peut-être est-ce de leur part une façon habile de contourner le bouclier fiscal ? Dans ce cas, l’objectif serait intéressant.
On ne peut donc, à mon sens, accepter l’idée de grand emprunt que dans une seule perspective : le financement des réformes structurelles que vous avez appelées de vos vœux, monsieur le ministre, et qui seront nécessaires pour enrayer le dérapage chronique des finances publiques. Les réformes structurelles apportent des gains à long terme, même si le coût budgétaire est initialement élevé. Un tel emprunt permettrait d’annoncer les priorités claires, d’en estimer les coûts et les bénéfices attendus, et d’ancrer ainsi les réformes. Vous nous avez dit tout à l’heure, monsieur le ministre, qu’il en irait ainsi. Nous ne pourrons accepter cet emprunt que si les réformes et les investissements sont identifiés, chiffrés, et les bénéfices escomptés, c’est-à-dire s’ils sont créateurs de richesses.
Dans ce contexte, quelles politiques budgétaires devons-nous engager ? Un tel niveau de déficit public n’est pas rattrapable par le seul effet de la reprise de la croissance économique en 2011 : même avec un rythme annuel de 2 % à 2, 5 % par an, le déficit public en 2012 serait encore de 5, 5 % du PIB, soit un niveau toujours très élevé au regard des engagements européens et de la capacité de financement du pays. Cela veut dire que nous devons engager le redressement durable de nos finances publiques et le retour à la viabilité budgétaire, comme le demande le Fonds monétaire international, le FMI. Cela nécessite des efforts d’une tout autre ampleur, notamment en matière de réforme de l’État, que ceux qui sont réalisés jusqu’à présent. Nous devons tous en avoir conscience.
Il s’agit, tout d’abord, de maîtriser et de réduire nos dépenses publiques. Je crois cette politique indispensable. Il faut la poursuivre de façon beaucoup plus profonde et tenir en 2010 les dépenses courantes, dont certaines – les dépenses sociales et celles de la mission « Emploi » – augmenteront du fait de la crise. Cependant, elle n’est pas suffisante : d’abord, parce que force est de constater que la Révision générale des politiques publiques ne permettra d’économiser que 7 milliards d’euros, alors que l’objectif était de 20 milliards d’économies ; ensuite, parce que, même en serrant à fond la vis des économies budgétaires, jamais l’État ne pourra réduire en deux ans ses dépenses en volume de 60 milliards d’euros, alors que les charges financières de la dette vont grossir chaque année d’ici là de 4 à 5 milliards d’euros sous l’effet de la remontée inévitable des taux.
Il me semble enfin inutile de maîtriser les dépenses publiques si, dans le même temps, on multiplie les dispositifs d’exonérations fiscales. Si nos comptes publics se dégradent, c’est aussi parce que les ressources de l’État diminuent.

Le rapport Pébereau préconisait déjà de ne pas diminuer le niveau global des prélèvements obligatoires pendant la phase de retour à l’équilibre.
Il nous faut, ensuite, sécuriser nos recettes. S’il faut éviter d’augmenter les prélèvements obligatoires, il faut au moins ne pas réduire les ressources fiscales. La conjoncture ne nous permet pas des allégements d’impôts. Je crois nécessaire, pour ma part, de garantir nos recettes pendant cette période, en évitant de mettre en place de nouvelles baisses d’impôts, comme celles du paquet fiscal de 2007 que nous payons très cher aujourd’hui, et de créer au cours des prochaines lois de finances de nouvelles dépenses fiscales ou crédits d’impôts, comme nous avons eu la fâcheuse habitude de le faire au cours des dernières années.
Sans les mesures d’allégements de ces dernières années, les recettes fiscales auraient progressé de 2, 7 %, alors qu’elles ont diminué de 0, 5°%. En moyenne, ce sont quatorze mesures supplémentaires de dépenses fiscales qui sont créées chaque année depuis 2003. En 2008, elles représentent 27 % des dépenses du budget en atteignant 73 milliards d’euros. Cette politique est, à la longue, suicidaire pour nos finances publiques. C’est la raison pour laquelle j’ai refusé d’approuver la baisse de la TVA sur la restauration – je reviendrai d’ailleurs à la charge lors du projet de loi de finances pour 2010 ! –, car je la crois inefficace économiquement et purement électoraliste.
Nous devons aussi imposer que toute nouvelle dépense fiscale soit compensée à due proportion par la réduction d’autres dépenses, ce qui n’a malheureusement pas été fait pour la baisse de la TVA dans la restauration ou la réforme de la taxe professionnelle, pour lesquelles nous attendons des réponses. Beaucoup de progrès restent donc à accomplir dans ce domaine.
Il faut aussi, dans cette perspective, revoir l’ensemble des niches fiscales et sociales qui se sont accumulées au cours de ces dernières années. On en compte aujourd’hui 400, qui représentent un manque à gagner estimé entre 50 et 70 milliards d’euros. Certes, nous avons commencé l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances, à travailler sur le plafonnement des niches fiscales, mais nous devons aller plus loin. Il faut examiner l’ensemble des dispositifs, évaluer leur efficacité, leur pertinence et leur caractère juste pour l’ensemble des contribuables.
La France, en ne réduisant pas son déficit structurel et en multipliant les dettes de crise et les emprunts, ne prépare pas la sortie de crise. C’est le devoir du Gouvernement et du Parlement que de prévoir l’après-crise.
Je voudrais, en conclusion, rappeler une réalité. Si l’on peut retarder le moment de la facture, on ne saurait – j’en suis sûr – la faire disparaître. Pour les Français, le réveil risque d’être douloureux après 2012, car ce sont eux qui paieront ! Comme l’a dit le Premier président de la Cour des comptes, le report des réformes indispensables impliquerait des ajustements encore plus douloureux. Il leur faudrait alors « payer plus pour rembourser plus » !
Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste, ainsi que sur certaines travées de l’UMP et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat d’orientation des finances publiques offre l’occasion au rapporteur de la commission des affaires sociales pour l’assurance vieillesse que je suis de faire un point sur les comptes de cette dernière.
Vous ne serez pas étonnés que je qualifie la situation de cette branche financière de préoccupante. En dépit de la réforme de 2003, son déficit n’a en effet cessé de se creuser depuis quatre ans, passant de 1, 9 milliard d’euros en 2005 à 5, 6 milliards d’euros en 2008. La branche vieillesse est aujourd’hui la plus déficitaire des quatre branches de la sécurité sociale.
Cette dégradation continue des comptes ne s’explique pas seulement par les facteurs démographiques que nous connaissons bien désormais : l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom et l’augmentation de l’espérance de vie. Elle résulte aussi de la montée en charge du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue, instauré par la loi du 21 août 2003. Depuis sa mise en œuvre, 560 000 retraites anticipées ont été accordées par le régime général. Cette mesure a coûté sans cesse davantage à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, sur la période 2004-2008, pour atteindre 2, 4 milliards d’euros en 2008, soit trois fois plus qu’on ne le prévoyait voilà cinq ans.
Fort heureusement, l’année 2009 devrait être marquée par une nette diminution des départs anticipés en raison des nouvelles conditions d’éligibilité au dispositif et des mesures réglementaires prises pour encadrer le recours aux arriérés de cotisations. Pour la première fois, le coût du dispositif pour le régime général diminuerait cette année, ce qui expliquerait, pour une modeste part, le ralentissement de la croissance des charges de la CNAV en 2009.
Pour autant, cette tendance n’empêcherait pas le déficit de la branche vieillesse de continuer à se creuser, puisqu’il atteindrait 7, 7 milliards d’euros cette année.
L’aggravation des comptes est d’autant plus inquiétante que les projections font état d’une dégradation financière accrue des régimes de retraite à l’horizon 2020-2050, principalement due au choc démographique. En conséquence, notre système de retraite devra faire face à un besoin de financement croissant, estimé à 24, 8 milliards d’euros pour 2020 et à 68, 8 milliards d’euros pour 2050.
Malgré la nécessité et l’urgence du retour à l’équilibre des comptes de la branche vieillesse, le rendez-vous de 2008 n’a apporté aucune réponse au problème du financement des retraites. Certes, il y a bien eu quelques avancées louables sur l’emploi des seniors ou la solidarité envers les retraités les plus modestes, mais des questions essentielles sont restées en suspens : le dossier de la pénibilité est bloqué et la hausse des cotisations vieillesse, qui devait être compensée par une baisse des cotisations chômage, a été reportée sine die.
Comme le Président de la République s’y est engagé devant le Congrès, le bilan d’étape de 2010 devra absolument déboucher sur des solutions pérennes à même de garantir la viabilité financière des régimes de retraite. Il ne doit pas être un rendez-vous manqué comme l’a été celui de 2008.
Les différents instruments de pilotage sont bien connus. Jusqu’à présent, le levier privilégié a été l’augmentation de la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Celle-ci, actuellement de 40 annuités, sera de 41 annuités en 2012. La question qui se pose aujourd’hui est donc la suivante : cette durée ne doit-elle pas être portée à 42 annuités, voire à 43 ou plus ? Une telle réforme nécessite cependant de surmonter l’obstacle du dossier de la pénibilité. Les syndicats n’accepteront pas l’augmentation de la durée de cotisation si, parallèlement, la pénibilité au travail n’est pas prise en compte.
Une autre piste, de plus en plus souvent évoquée, est le report de l’âge légal de départ en retraite qui, en France, a été abaissé à soixante ans en 1983. Ce qui a été vécu, à l’époque, comme un progrès social entre aujourd’hui en totale contradiction avec les évolutions démographiques en cours. Alors que l’espérance de vie ne cesse d’augmenter, la période consacrée au travail au cours d’une vie est de moins en moins longue !
La logique voudrait donc que l’âge légal de départ en retraite soit repoussé, comme l’ont fait plusieurs pays européens. Mais l’utilisation de ce levier se heurte, en France, à un obstacle de taille : le taux d’emploi des seniors, qui se situe autour de 38 %, est l’un des plus bas des pays développés. Retarder l’âge de la retraite sans favoriser le maintien dans l’emploi des seniors aboutirait à créer des demandeurs d’emplois supplémentaires.
Par ailleurs, il faut avoir à l’esprit que l’augmentation de l’âge de la retraite ne peut à elle seule résoudre le problème du financement des régimes de retraite. Pour le régime général, le report à soixante-deux ans apporterait 6, 6 milliards en 2020, sur 13 milliards d’euros de besoins, mais seulement 5, 7 milliards sur un besoin total de 46 milliards d’euros en 2050. Il s’agirait en définitive d’une mesure de court terme.
C’est pourquoi, au-delà de la nécessité d’une nouvelle réforme paramétrique à brève échéance, il est indispensable de préparer l’étape suivante : réfléchir à d’autres modes de gestion de l’assurance vieillesse. Le pilotage actuel des régimes de retraite ne pourra en effet enrayer le mouvement de dégradation de la situation financière de la branche vieillesse ni proposer de solution solide face au défi démographique à l’horizon 2020-2050.
Cette situation rend impératif l’engagement d’une réforme de type structurel ou systémique, seule à même d’assurer la survie de notre système de retraite.
Un rapport sur ce sujet du Conseil d’orientation des retraites, le COR, commandé par le Parlement sur l’initiative de la commission des affaires sociales du Sénat, sera rendu au début de l’année 2010. Il sera l’occasion d’engager un vaste débat public sur l’avenir des retraites.
Monsieur le ministre, certes, ce soir, je n’ai évoqué que la branche vieillesse, mais l’évolution des pensions civiles et militaires connaît depuis quelques années dans notre pays une dérive de l’ordre de 6 % à 8 %. Le poids de ces dernières devient lui aussi très lourd pour le budget de l’État. Mais nous aurons l’occasion d’aborder ce sujet au cours des prochains mois.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.

Monsieur le ministre, voilà quelques jours, à l’Assemblée nationale, vous affirmiez ceci : « tous les efforts du Gouvernement tendent à un seul but : préparer l’avenir. » C’est à l’aune de ces propos que je vais prendre en considération les finances sociales.
La situation de nos comptes publics est catastrophique. Nous ne sommes pas les seuls à le dire. M. le rapporteur général de la commission des affaires sociales a déclaré que ce débat prend place « dans un contexte qui peut être qualifié de dramatique pour les finances sociales ». Il estime même qu’« il ne s’agit plus d’une aggravation du “trou de la sécu” […], mais d’un changement d’échelle, d’une situation totalement inédite ».
Certes, la crise qui frappe l’ensemble des économies n’a pas épargné notre pays. Cependant, une observation plus fine fait apparaître que cet état de fait préexistait avant même que les effets de la crise ne se fassent sentir.
Mon collègue François Marc a parlé fort justement des déficits et de l’endettement, points sur lesquels je ne reviendrai donc pas.
Mais, monsieur le ministre, tout n’est pas la faute de la crise ! Le rapporteur général de la commission des affaires sociales, que je citerai une fois encore, constate que « si la sécurité sociale avait affronté cette crise sans le handicap sévère d’un déficit structurel de 10 milliards d’euros, elle aurait pu y faire face dans des conditions très différentes ».

La Cour des comptes démontre, dans son dernier rapport, que la dégradation du déficit en 2008 n’est que très peu due à la crise économique : elle estime que seuls 4 milliards d’euros sur 14 milliards d’euros résultent de ladite crise. Les 10 milliards d’euros restants proviennent donc des mesures fiscales et sociales décidées par l’actuelle majorité. François Marc ayant traité ce sujet, je ne m’y attarderai pas.
Voilà quelques semaines, lors du débat sur la défiscalisation des heures supplémentaires, je pronostiquais un déficit du régime général de la sécurité sociale de l’ordre de 20 milliards d’euros pour 2009. Le secrétaire d’État chargé de l’emploi semblait particulièrement dubitatif. §Malheureusement, la réalité est là : ce déficit est historique, et ce à plusieurs titres. Il l’est non seulement en raison du volume sans précédent qu’il atteint, mais aussi parce qu’il est organisé et programmé sciemment.
Pour ce qui concerne les comptes sociaux, il en est de même que pour les comptes de l’État. Rappelons-nous que le Gouvernement promettait une croissance de la masse salariale de l’ordre de 3, 5 % pour cette année et de 4, 6 % pour les années suivantes. Nous en sommes bien loin ! Le nombre de demandeurs d’emploi a crû de 18, 4 % cette année. Il nous faut maintenant nous préoccuper du financement de cette dette sociale.
Le Gouvernement a choisi de ne pas relever le taux de la CRDS ; c’est donc à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale que reviendra la mission de porter cette dette, dont la charge ne pèse pas moins de 10 milliards d’euros par an. Cet accroissement de la dette pénalise les générations à venir qui devront l’acquitter.
Monsieur le ministre, depuis 2002, votre majorité n’a eu de cesse de s’en remettre au seul viatique qui vaille à vos yeux : la réduction des dépenses.
En matière de santé, nos concitoyens ont dû faire face à l’augmentation du forfait hospitalier, aux déremboursements massifs, à la mise en œuvre de la franchise médicale… Le Gouvernement, non content de culpabiliser les assurés sociaux puis les malades, leur a fait supporter en plus un poids croissant des dépenses évalué à plus de 3 milliards d’euros.
Cette politique pénalise l’ensemble des citoyens, notamment les plus modestes, mais, à plus long terme, elle ne manquera pas d’avoir des conséquences lourdes sur la santé publique.
Pour s’en persuader, il suffit de considérer les effets de la réduction du panier de soins de l’aide médicale d’État sur les ayants droit. Il s’agit bel et bien d’une diminution de l’accès aux soins. Le fait que notre pays soit passé de la première place à la onzième place pour la qualité de son système de santé signifie que votre bilan est très inquiétant.
Venons-en aux branches de notre système de protection sociale.
Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, que la majorité a adopté, le déficit prévu pour la branche vieillesse s’élevait à 5 milliards d’euros. Selon toute vraisemblance, il atteindra 7, 7 milliards d’euros, avec un fonds de solidarité vieillesse déficitaire de 2, 1 milliards d’euros, et ce malgré une remise à zéro de ses comptes via le transfert de ses déficits cumulés à la CADES.
Il s’agit là de l’illustration de l’échec de la réforme Fillon de 2003. À l’époque, nous avions dit que cette réforme ne constituait pas une réponse aux besoins de financement pérenne de nos retraites par répartition et qu’elle allait immanquablement en appeler d’autres. Mais une fois de plus, peu vous importe : vous maintenez le cap. Vous évoquez un départ à la retraite à soixante-sept ans, puis vous rectifiez le tir en parlant d’une durée de cotisations portée à quarante-deux ans, voire à quarante-trois ans.
Mais, monsieur le ministre, vous êtes-vous rendu compte que le taux d’emploi des personnes âgées de cinquante-cinq ans à soixante-quatre ans n’est que de 38 % dans notre pays, alors qu’il atteint 70 % en Suède, par exemple ?
Vous rendez-vous compte que, si le comportement des employeurs ne se modifie pas, vos propositions aboutiront à un abaissement drastique du montant des retraites par répartition, lequel est déjà bien bas ?
Avez-vous pris la mesure de ce qui se passe ? L’UNEDIC, qui affichait un excédent de 4, 5 milliards d’euros en 2008, se retrouve dans le rouge à hauteur cette année de 1, 3 milliard d’euros et probablement, l’année prochaine, de 4, 6 milliards d’euros. Dans ce contexte, quelle incidence ont vos propos alors que vous affirmiez, voilà un an, que, grâce à la baisse du chômage, une diminution des cotisations chômage et une hausse des cotisations de retraite pouvaient voir le jour ?
Pensez-vous sérieusement que des dispositions aussi contestables que l’auto-entreprise soient à même de constituer une solution pour des millions de nos concitoyens ? N’est-il pas temps de reconsidérer cette problématique essentielle dans son ensemble et, au moins, de conclure enfin les négociations relatives à la pénibilité que le patronat bloque, avec votre assentiment, depuis 2003 ?
À ce titre aussi, il ne suffit pas de rappeler à Versailles que le programme du Conseil national de la Résistance entendait « assurer une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours » ; il faut passer aux actes, et les vôtres sont loin de satisfaire à cet objectif.
J’en viens à la branche maladie, qui, si les prévisions se vérifient, devrait enregistrer un déficit record de 9, 4 milliards d’euros en 2009, contre 4, 4 milliards d’euros en 2008, soit une augmentation de l’ordre de 120 %. Face à cette situation, qu’allez-vous faire ?
Allez-vous encore une fois procéder à des coupes budgétaires qui n’auront comme seule vertu que de conforter une analyse comptable sans lien avec les besoins sanitaires de nos concitoyens ?
Allez-vous mettre en scène de nouveaux boucs émissaires, tels que semblent l’être devenus depuis quelques jours les salariés en arrêt de travail ? Non seulement ce procédé est détestable, mais, en plus, il instaure le culte de la défiance au plus haut niveau de l’État. En lieu et place, nous aurions préféré, tout comme les Français, que la réforme de l’hôpital s’accompagne d’une augmentation tant du numerus clausus que du nombre de médecins du travail. Mais peine perdue ! Vous n’avez visiblement que faire des conditions de travail, qui se dégradent très sensiblement. Les conclusions de la CNAM, chargée d’élaborer des référentiels portant sur les pathologies les plus fréquemment observées dans le monde du travail, seront un excellent témoin de cette précarisation.
Votre politique comptable s’applique aussi aux transports sanitaires. Ce poste budgétaire connaît effectivement une croissance rapide, et ce depuis quelques années. Mais au lieu de vous contenter d’un simple constat, pourquoi ne vous posez-vous pas la question de l’incidence directe des fermetures d’hôpitaux et de services, par exemple ?
Cette situation appelle un sursaut. Nous vous le demandons depuis des années, projet de loi de financement de la sécurité sociale après projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Or, comme l’indique le rapporteur général de la commission des affaires sociales, « le retour de la croissance au niveau d’avant la crise permettra seulement de stabiliser le déficit à son niveau d’après-crise, soit peut-être 30 milliards d’euros. » Nous ne pouvons qu’être d’accord avec lui lorsqu’il pronostique ceci : « Le retour d’une croissance modérée […] des dépenses ne permettra en aucun cas – ou de manière marginale – de résorber les déficits massifs qui auront été atteints. Leur résorption ne pourra passer que par une croissance des recettes durablement plus forte que la croissance des dépenses » Mais il n’y a rien concernant l’augmentation des salaires qui aurait une incidence directe sur les recettes de la sécurité sociale, rien concernant la hausse de la taxation sur les stock-options, rien sur les fonds spéculatifs, rien sur les 6 milliards d’euros que coûte la défiscalisation des heures supplémentaires, rien, enfin, concernant une réorientation de votre sacro-sainte politique d’exonération de cotisations sociales !
Pourtant, à plusieurs reprises, notamment au mois de septembre dernier, la Cour des comptes a pointé le fait qu’elle était peu efficiente en matière d’emploi. Pourquoi ne pas procéder au réexamen des conditions d’exonération ? Pourquoi ne pas les lier très directement à la politique menée par les entreprises en matière de salaires et d’emploi ?
Les sommes en jeu sont colossales : 42 milliards d’euros par an, soit un peu plus du double du déficit de la sécurité sociale cette année.
Dans le même ordre d’idée, pourquoi ne vous attaquez-vous pas aux niches fiscales, que la Cour des comptes n’hésite désormais pas à qualifier d’« obsolètes, injustes et inefficaces » ?
Pourquoi ne veillez-vous pas à appliquer le principe d’universalité de la CSG ?
Enfin – mais le sujet est une véritable arlésienne –, pourquoi ne pas remettre à plat l’assiette de cotisations, afin d’intégrer justement le rapport entre le capital et le travail ? Rappelons que le financement de la protection sociale dépend aux deux tiers des revenus du travail.
Mes chers collègues, derrière l’aridité des chiffres se fait jour non seulement le quotidien, mais aussi l’avenir de nos concitoyens. Il conviendrait de se fixer comme objectif de tout mettre en œuvre pour que la société souffre le moins possible et que la dépense publique, en période de crise, puisse sinon annihiler, du moins atténuer les conséquences des décisions prises par le secteur privé.
Malheureusement, ce débat d’orientation budgétaire nous démontre que le Gouvernement a choisi de réduire son effort, alors que nous n’avons pas rattrapé le niveau de 2006.
Monsieur le ministre, il s’agit d’une faute politique qui sera lourde de conséquences et empêchera de relever les défis que pose une société de plus en plus inégalitaire.
Pour notre part, nous sommes prêts à contribuer à redéfinir et à réorienter cette politique, notamment dans les domaines de la fiscalité et de l’emploi. C’est ce que commande la recherche d’une plus grande justice sociale et d’une plus grande efficience économique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention sera un peu différente des précédentes, dans lesquelles ont été cités des chiffres que vous connaissez tous et qu’il est donc inutile de rappeler.
Il serait à mon avis plus judicieux d’élever ce débat et de s’interroger sur les raisons directes et indirectes de la crise. La conjoncture actuelle a en effet plusieurs origines.
Notons d’abord la crise mondiale du crédit, qui affecte tous les pays du monde, à la suite de la faillite de nombreuses banques, et sur laquelle on ne peut agir directement, sauf à essayer d’en atténuer les effets.
Relevons aussi les contraintes multiples qui nous ont été imposées par différents gouvernements, en particulier socialistes, contraintes qui paralysent nos entreprises et compromettent notre économie. Je m’y attarderai quelques instants.
Si la crise a plusieurs origines, peut-être pouvons-nous agir sur celles qui nous sont propres. La hausse de nos coûts de production n’est pas seulement due à la baisse des crédits disponibles. Notre perte de compétitivité a d’autres causes, telle la politique démagogique menée pour favoriser la politique sociale, dite « justice sociale », sans se soucier aucunement de la politique économique et des possibilités de financement de cette politique sociale. En effet, toute décision politique, quelle qu’elle soit, doit d’abord tenir compte des recettes avant d’envisager les dépenses. Or certains gouvernements ne procèdent pas ainsi.
Il est certes très agréable de partir à la retraite plus tôt – pourquoi pas ? –, de travailler moins en gagnant autant ou même plus, d’augmenter les aides en tous genres. Toutefois, au final, on aboutit à la situation que nous observons aujourd'hui, c'est-à-dire à une aggravation considérable de notre déficit budgétaire.
En effet, de telles dépenses sociales ne peuvent être financées autrement. Dès lors que l’on n’a pas les moyens nécessaires pour les couvrir, on emprunte ! Cette solution est peut-être pratique, mais elle est aussi dangereuse.
Ainsi, les 35 heures
M. Bernard Angels s’exclame.

Ce régime est très pratique pour les salariés, mais l’instauration des 35 heures a été la plus grave décision qui ait jamais été prise par un Gouvernement pour notre économie, et nous en subissons encore aujourd'hui les conséquences. Il faut le savoir et en tenir compte.
Mes chers collègues, nous ne pouvons travailler moins que les habitants des autres pays, qui produisent bien plus que nous et à des coûts moins élevés !
De même, en France les congés sont trop nombreux, bien que, naturellement, il soit agréable de partir en vacances et de profiter de nombreux jours fériés, et les charges sur les salaires sont trop élevées.
Nous avons évoqué tout à l'heure le financement de la sécurité sociale. Pour ma part, je serais tout à fait partisan de ne plus le faire peser sur les charges salariales et de le reporter sur d’autres facteurs. Je crois d'ailleurs que M. le président de la commission des finances, lui aussi, a quelques idées sur ce sujet, qu’il faudrait tenter de mettre en application.

La retraite à soixante ans, obtenue grâce au président Mitterrand, est sans doute une « conquête sociale », mais on constate qu’elle est de plus en plus difficilement financée par la répartition, car sans cesse le nombre des actifs diminue et celui des inactifs augmente, ce qui empêche d’équilibrer ces dépenses.
Par ailleurs, les conflits sociaux sont trop nombreux et paralysent la production. Ils nuisent autant aux salariés, qui, soi-disant, défendent leur activité, qu’aux entreprises, car ils risquent de faire disparaître les clients. En effet, quand des grèves éclatent, la production cesse, les clients s’en vont et l’entreprise capote…
Aussi, compte tenu de l’évolution très préoccupante de nos finances, il conviendrait de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour rendre à nos entreprises leur compétitivité. En effet, si celles-ci ne sont pas concurrentielles, elles ne vendront rien et n’embaucheront pas, mais, au contraire, licencieront.
Il faudrait appliquer les règles de la gestion participative, que je m’efforce de promouvoir, et instaurer dans toutes les entreprises un véritable consensus social qui permette de motiver les salariés, en égalisant chaque année la réserve de participation au montant des dividendes distribués.

Pour ma part, je continuerai de porter cette proposition.
Les syndicats doivent cesser de pousser les salariés à la grève à la moindre occasion.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Il faut encadrer le droit de grève. La Constitution le permet, mais on ne le fait pas !
En effet, les arrêts de travail n’ont jamais résolu aucun problème et ils sont nuisibles à tous. Pas plus que les processions religieuses n’ont jamais fait tomber la pluie, aucune grève n’a jamais fait pleuvoir les euros !
Rires sur les travées de l ’ UMP, ainsi qu’au banc des commissions.

Une autre mesure de bon sens consisterait à limiter dans le temps les dépenses de fonctionnement, pour lesquelles on ne fixe jamais de terme, avec pour résultat une addition sans fin des emprunts destinés à les couvrir.
Seule la diminution des emprunts de fonctionnement récurrents permettrait de réduire peu à peu le déficit. Il faudrait commencer tout de suite, mais on ne le fait pas, malgré les propositions que j’ai formulées en ce sens…
En revanche, comme l’a souligné M. le ministre, les emprunts nouveaux destinés à des investissements d’avenir sont absolument nécessaires afin d’accroître notre production de richesses.
Enfin, mes chers collègues, permettez-moi une dernière remarque, que personne n’a encore formulée.
Notre système capitaliste a montré ses limites en raison de la spéculation réalisée par les détenteurs d’actions de sociétés anonymes dépourvues de « noyau dur ». Ceux-ci ne se préoccupent que du prix des titres et les revendent immédiatement avec une plus-value ; ils n’ont pas le moindre souci de l’avenir de l’entreprise en cause.
Pour éviter ces va-et-vient destructeurs, il serait bon, me semble-t-il, d’obliger tout acquéreur d’actions à conserver celles-ci pendant au moins cinq ans. Une telle décision éviterait des mouvements spéculatifs qui sont fortement nuisibles et ne coûterait rien.
Il faut aussi remarquer – j’y insiste – que seules les actionnaires des sociétés familiales conservent leurs titres, sans se préoccuper des cours de la bourse, car ils veulent préserver le patrimoine familial.
Il faudrait donc soigner ces actionnaires familiaux, d'ailleurs de moins en moins nombreux, car ils sont des facteurs de stabilité économique, au lieu de les pénaliser par des impôts spécifiques qui les découragent et les poussent à s’expatrier, privant ainsi la France à la fois de leurs capitaux et de leurs talents.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, voilà quelques-unes des propositions que je tenais à formuler devant vous.
Il faudrait aller encore plus loin dans la politique de réformes courageuses que le Président de la République a entreprise et que j’approuve, en prenant en compte, si possible, les quelques points que je viens d’indiquer.
Rien n’est simple dans ce domaine. Je connais les résistances multiples qui se manifestent en France à la moindre réforme, car notre pays est conservateur et prêt à se paralyser contre n’importe quelle tentative de changement. Cet état d’esprit ne facilite pas la tâche des gouvernements, qui tentent de faire des efforts mais se heurtent toujours à des grèves.
Rien ne pourra se faire sans le consensus de tous, me semble-t-il. Pour l’obtenir, il faudrait lancer une vaste opération d’explication en direction de l’opinion, pour que chacun prenne conscience de la gravité de la situation et pour faciliter les réformes.
Au lieu d’affirmer que tout va bien, que la situation n’est pas si grave et qu’elle va s’arranger, il faut souligner une fois pour toutes l’ampleur des difficultés qui se présentent à nous ! C’est d'ailleurs ce que nous faisons ici depuis plusieurs heures.
Les Canadiens ont mené cette réforme avec succès voilà quinze ans. Aujourd’hui, ils ont réussi ce miracle d’obtenir un budget équilibré, sinon excédentaire, mais aussi de réduire leur dette. Rien ne nous empêcherait de faire pareil !

M. Serge Dassault. C’est à ce prix que nous commencerons à sortir de la crise, mais il faut en avoir la volonté, le courage et savoir ce que nous voulons.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ Union centriste.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, bien des questions ont été évoquées au cours de ce débat, et je constate que certaines préoccupations sont communes aux différents orateurs.
Monsieur Dassault, nous ne sous-estimons pas les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous n’embellissons pas la situation et l’envisageons telle qu’elle est. J’espère en tout cas que mes propos pourront vous rassurer.
Monsieur le président de la commission des finances, vous avez décrit les défis qui nous attendent et vous nous avez appelés à voir au-delà du court terme. Je souscris tout à fait à cet appel.
Je ne reviendrai pas sur notre débat d’hier relatif à la politique de financement de l’État. Nous devons en effet être plus transparents et donner davantage d’informations, notamment en ce qui concerne les emprunts levés à court terme. C’est précisément ce que nous avons l’intention de faire.
Je fais miennes vos préoccupations sur la dette, qui sont d'ailleurs partagées par l’ensemble des sénateurs, quelle que soit leur tendance politique.
Toutefois, on affirme souvent que le produit de l’impôt sur le revenu serait aujourd'hui inférieur au montant des charges d’intérêt de la dette, mais ce n’est pas exact : il lui est toujours supérieur, d’environ huit milliards d'euros, du moins si nous prenons seulement en compte le coût de l’endettement de l’État. En revanche, l’affirmation est vérifiée si nous considérons l’ensemble de la dette publique.
Certes, monsieur le président de la commission des finances, mais l’impôt sur le revenu a vocation à financer le budget de l’État ; il faut comparer ce qui est comparable. J’y insiste, car j’entends souvent cette assertion.
Pour réduire la dette, j’estime, tout comme vous, monsieur le président de la commission des finances, que nous n’avons d’autre solution que de mettre l’accent sur la maîtrise des dépenses. Je me suis d'ailleurs efforcé de le montrer dans mon intervention liminaire.
D'une part, il faut revenir à un niveau satisfaisant de recettes fiscales grâce à la reprise économique ; d'autre part, nous devons maîtriser la dépense.
Certaines dépenses disparaîtront toutes seules ; ce sont celles qui sont destinées à la relance, et dont vous avez pu vérifier qu’elles étaient réversibles.
Comme je l’ai indiqué dans la préparation du budget pour 2010, ces dépenses tomberont l’an prochain à 3, 5 milliards d'euros environ. Certes, elles ne disparaîtront pas complètement et la rupture en la matière ne sera pas totale, parce que nous devons accompagner la reprise, une crise ne cessant pas du jour au lendemain ! Toutefois, elles retrouveront un niveau raisonnable.
L’accompagnement de la reprise économique passera par les systèmes de formation professionnelle et d’aide à l’emploi, ces 3, 5 milliards d'euros servant, notamment, à financer le FISO, le Fonds d’investissements social.
Monsieur le président de la commission des finances, nous lancerons également une deuxième phase de la révision générale des politiques publiques.
Certains ont estimé que les sept milliards ou huit milliards d'euros dégagés jusqu’ici par ces mesures n’étaient pas suffisants, compte tenu des enjeux. Toutefois, il ne s’agit là que des sommes économisées immédiatement. À moyen terme, cette politique qui transforme l’approche culturelle des administrations permettra de dégager des montants bien plus considérables !
La RGPP doit cependant rebondir. Tel est l’objet de la « deuxième phase » que nous sommes en train de lancer ; ce matin encore, je présidais d'ailleurs une réunion sur ce sujet.
Nous voulons, d'une part, aller plus loin dans la réorganisation des services de l’État, et, d'autre part, examiner les politiques d’intervention, ce qui n’avait pas été fait dans la « première phase ».
En effet, la RGPP vise à maintenir, sinon à accroître, la qualité du service public en affectant plus justement les moyens de l’État. C’est ainsi que nous devons la concevoir. Nous sommes tout près de cette logique d’évaluation qui a fait l’objet de tant de débats.
Monsieur le président de la commission des finances, vous préconisez également de passer au « zéro valeur » en ce qui concerne les dépenses de l’État.
D'ores et déjà, cet objectif est pratiquement atteint si nous ne prenons pas en considération l’accroissement des charges de la dette, qui, aujourd'hui, est largement incompressible, ni les charges de retraites et de pensions.
Le véritable enjeu serait d’arriver au « zéro valeur » pour l’ensemble de la dépense publique, au lieu de l’augmentation de 1 % en volume que nous connaissons aujourd'hui.
Toutefois, il est extrêmement difficile d’atteindre un tel objectif, notamment en raison du rythme d’évolution des dépenses des organismes de sécurité sociale, qui, même si elles sont maîtrisées, progressent bien plus vite que le PIB…
J’en viens à la réforme territoriale, qui est indispensable.
Les structures de l’État suivent le mouvement que la RGPP a initié. Nous devrons également donner vie aux préconisations de la commission Balladur, qui devraient déboucher sur un certain nombre de décisions dans le courant de cette année. Je ne doute pas que le débat sur cette question sera très animé, et c’est une litote, mais je crois que cette réforme est au cœur des préoccupations des Français.
En ce qui concerne la protection sociale, j’ai bien noté que son mode de financement constituait une inquiétude constante. Il s’agit d’une question essentielle pour Mme la présidente de la commission des affaires sociales, mais aussi pour le nouveau rapporteur général, qui travaillait déjà auparavant sur ces sujets et qui n’a pas changé d’idées en prenant sa nouvelle fonction…
Pour leur répondre, ainsi d'ailleurs qu’à Serge Dassault, Dominique Leclerc et Jean-Jacques Jégou, je voudrais évoquer la question de la bonne information du Parlement en matière de finances sociales, car il s'agit là d’un point essentiel, me semble-t-il.
Comme M. Dassault l’a souligné à juste titre, nous ne devons pas nous raconter d’histoires. Tel n’est pas d'ailleurs mon objectif, car une telle méthode serait ridicule et inutile. Nous devons mener un débat responsable.
Or le niveau d’information du Parlement a été augmenté considérablement ces dernières années, me semble-t-il.
Madame la présidente de la commission des affaires sociales, vous regrettez, si je vous ai bien compris, l’absence de projets de loi de financement de la sécurité sociale rectificative.
Mme la présidente de la commission des affaires sociales acquiesce.
Cependant, vous savez parfaitement, madame la présidente, que, lorsqu’on vote un projet de loi de financement de la sécurité sociale, on vote non pas sur un budget précis, mais sur des intentions budgétaires, sur des objectifs de dépenses. Point n’est besoin, donc, de le rectifier : les objectifs se rectifient par eux-mêmes, il suffit de constater.
Au demeurant, tout PLFSS comporte une partie consacrée aux comptes de l’année en cours : lors de son examen, on remet les choses à l’équerre. La démarche est donc construite et cohérente. Cela donne régulièrement lieu à des débats nourris. J’imagine que, cette année, ils seront particulièrement animés.
Nous donnons aussi une information sur la trajectoire des finances sociales.
La loi de programmation pluriannuelle ne concerne pas uniquement l’État ; elle porte aussi sur l’ensemble des finances publiques. Les indications données sont en pourcentages. Elle tend, notamment, à fixer l’ONDAM, l’évolution de chacun des risques concernés, ainsi que les sous-objectifs de l’ONDAM, le secteur médico-social, l’hôpital et la médecine de ville.
Nous disposons là d’un assez bon outil pour voir comment les choses se construisent les unes par rapport aux autres.
M. Jean-Jacques Jégou et M. le rapporteur général Alain Vasselle ont évoqué le financement de la dette de la sécurité sociale.
Le prochain conseil des ministres examinera un projet de décret tendant à relever le plafond d’emprunt de l’ACOSS de 18, 9 milliards d’euros à 29 milliards d’euros.
Par ailleurs, l’ACOSS vient de conclure avec la Caisse des dépôts et consignations un avenant à la convention financière qui vise à redéfinir les conditions tarifaires des emprunts auprès de la Caisse.
Pour 2010, chacun connaît les solutions. Il n’y a pas de magie à espérer. Faire reprendre la dette de la sécurité sociale par l’État serait, à mon avis, la pire des solutions, parce que tout retour en arrière serait impossible.
Ce serait donc la pire des solutions, et, de surcroît, elle ne serait pas du tout conforme aux conclusions auxquelles nous sommes parvenues au terme des débats que nous avons eus depuis deux ou trois ans. Je m’opposerai farouchement à une telle solution.
Transférer la dette sociale à la CADES signifierait augmenter la durée de vie de cette dernière, ce qui serait également à mes yeux, une solution assez irresponsable, en ce qu’elle reviendrait à la prolonger indéfiniment. Il ne faut pas augmenter la durée de vie de la CADES.
Augmenter la CRDS n’est pas dans l’optique du Gouvernement : il n’a pas comme politique d’augmenter les prélèvements obligatoires.
Une telle solution n’est donc pas, elle non plus, envisageable.
Monsieur Fourcade, vous évoquez la création d’une caisse particulière alimentée par les revenus de la contribution climat-énergie. Je me bats pour que les revenus de la contribution climat-énergie financent tout ou partie du manque à gagner, en termes de recettes fiscales, de la suppression d’une taxe absurde, mais productive, la taxe professionnelle.
Nous avons un certain nombre de choix à faire.
Nous avons donc fait le choix d’une solution qui ne peut, selon moi, être que transitoire : donner à l’ACOSS les moyens de financer en 2010 l’intégralité des besoins de trésorerie, qui devraient s’élever, en moyenne, à une quarantaine de milliards d’euros. Elle ne pourra pas durer, mais elle offre le mérite d’éviter de les faire financer par l’État.
Nous sommes en train d’examiner toutes les possibilités, avec l’aide d’une mission de l’inspection générale des finances.
Nous réfléchissons ainsi à l’augmentation des émissions de billets de trésorerie sur les marchés, à la possibilité et la capacité pour d’autres acteurs publics d’acheter des billets de trésorerie de l’ACOSS, au recours aux banques, sous réserve que la dette soit cantonnée.
Le schéma vous sera précisé le moment venu, mesdames, messieurs les sénateurs, à savoir lors de l’examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Cette solution a beau être transitoire et provisoire, elle a néanmoins le mérite d’être claire. Cette dette devra finir par être épongée. Nous trouverons d’autres sources de financement après la sortie de crise.
Aujourd’hui, nous devons prévoir un financement spécifique via l’ACOSS.
L’opération sera neutre pour les finances de l’État, car l’écart de financement entre l’État, l’ACOSS ou la CADES est faible. De plus, le niveau actuel des taux rend même plus intéressant un financement à court terme, comme le fait l’ACOSS, qu’un financement à long terme.
Sur la préservation des recettes sociales, je suis bien d’accord avec ce qui a été dit.
Je tiens tout de même à préciser – M. Fourcade et M. Dassault ont abordé ce point – qu’il est assez difficile de réduire les 23 milliards d’euros des aides à l’emploi. Je ne dis pas qu’il ne faut pas le faire. Le Gouvernement, après réflexion, prendra probablement des décisions sur ce sujet.
Les réductions de charges directes sur le SMIC – 1, 6 SMIC – ont permis une baisse des charges des entreprises et ont donc des conséquences immédiates sur l’emploi.
Beaucoup d’idées peuvent être émises. Les sommes en jeu sont énormes.
Je rappelle à Mme Christiane Demontès que près de la moitié des niches sociales – dix sur vingt-trois, précisément – résultent de la compensation des 35 heures. Il faut l’assumer ! Je le fais, pour ma part, sans problème. Mais je tenais à le préciser. Comment s’alarmer du nombre de niches sociales, quand chacun y a contribué d’une certaine manière ?
Nous devrons prendre garde, et ne pas oublier que réduire les niches sociales reviendrait, pour parler un langage simple, à augmenter les charges sociales. Or, les charges sociales sont violemment décriées, car accusées d’être la cause du manque de compétitivité française et d’entraver notre capacité à créer de l’emploi à long terme. Il nous faut veiller à préserver la bonne cohérence de nos choix politiques. Ils ne doivent pas être en contradiction avec nos propos.
Sur les retraites, j’ai bien entendu ce qu’ont dit MM. Alain Vasselle, Dominique Leclerc et Mme Christiane Demontès.
Nous nous saisirons de ce dossier en 2010, comme M. le Président de la République l’a annoncé. L’idée est de procéder à une réforme structurelle, le problème étant structurel.
Je trouve l’exercice de dénonciation de Mme Demontès tout à fait intéressant, mais il n’y a là que des effets de tribune. Où sont les propositions ? Le parti socialiste est un grand parti démocratique, un parti de gouvernement qui appelle à débattre. Aussi, plutôt que de dénoncer les projets gouvernementaux en matière de retraites, que ne formule-t-il des propositions à la hauteur de l’enjeu ! Certes, ce serait beaucoup plus difficile que de renvoyer le dossier à une énième commission ou de reconnaître qu’il faudra bien en venir à une réforme.
Il y a peu de solutions. Nous allons toutes les explorer, et nous prendrons alors des décisions.
Monsieur Legendre, j’ai écouté avec attention votre discours, qui détonait un peu parmi les autres. §
Nous devons changer un peu de logique. Nul ne saurait affirmer que les affaires culturelles ne sont pas importantes. Nul, dans cette enceinte, ne professerait une telle opinion.
Cependant, il va nous falloir apprendre à les gérer avec les mêmes crédits, voire parfois un peu moins. Telle est la base de mon argumentation : quand je demande une baisse du rythme d’augmentation des dépenses, c’est de cela qu’il s’agit.
On en arrive très vite à parler de choses concrètes : de la politique culturelle de l’État à l’étranger, de notre capacité à entretenir notre patrimoine monumental, du difficile financement de l’architecture préventive. Certes, 20 milliards d’euros ont, à titre exceptionnel, été dégagés, mais l’ampleur de la somme ne doit pas faire oublier l’adjectif « exceptionnel ». Parce que l’enjeu était d’importance, des crédits ont été momentanément débloqués.
J’appelle chacun à bien mesurer que la réduction du rythme d’évolution des dépenses concerne tous les domaines. Il faut finir par l’accepter.

L’enseignement du français à l’étranger ! Les frais de scolarité à l’étranger !
Si l’on avait retenu une évolution « zéro valeur », le niveau de réduction serait supérieur à ce qu’il est.
J’ai écouté attentivement le discours de M. Foucaud. Si je ne partage pas son analyse de notre système fiscal, je lui accorde bien volontiers qu’il est évidemment perfectible, c’est le moins que l’on puisse dire.
Cependant, je ne saurais le laisser prétendre que nous ne nous attaquons pas à ses défauts.
Réformer la taxe professionnelle est un travail de fond. Cela fait vingt ans que les défauts de cette taxe sont dénoncés. Nous nous employons à y remédier.
Par ailleurs, nous créons une fiscalité verte, preuve s’il en est de notre volonté de nous orienter vers une fiscalité différente, de nous organiser différemment, de penser différemment. L’avenir nous dira quels auront été les réels progrès accomplis, mais il s’agit là, d’ores et déjà, d’avancées marquantes.
J’ai évidemment apprécié la formule de M. de Montesquiou : « façonner l’avenir ». C’est ce que nous essayons de faire.
Pour « façonner l’avenir », il faut avoir confiance en l’avenir et, en même temps, regarder le présent avec lucidité, comme nous le faisons ; il faut se garder de raconter des histoires aux Français, mais les persuader que notre pays a de l’avenir, quelles que soient les difficultés financières auxquelles il est confronté.
Le débat qui s’ouvrira, à partir des propositions de MM. Alain Juppé et Michel Rocard, sur les dépenses d’avenir, sera fondamental. Ces dépenses d’avenir valent bien un emprunt – puisque ce sont, justement, des dépenses d’avenir ! – à condition, toutefois, comme l’a précisé M. Fourcade, de ne pas oublier les autres éléments de la donne, à savoir, d’une part, l’équilibre des dépenses de fonctionnement et, d’autre part, l’affectation des recettes supplémentaires au remboursement de la dette.
Monsieur Marc, votre discours est empreint de cohérence, et je n’ai pas d’objection à formuler sur la forme, mais, si les recettes que vous préconisez ont le mérite de la constance, elles n’en sont pas moins assez artificielles.
Les solutions que vous envisagez, comme par exemple l’arrêt de la loi TEPA, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Elles sont mêmes contreproductives. La loi TEPA et le dispositif sur les heures supplémentaires produisent de la valeur, j’en ai l’intime conviction. La vôtre est différente. Je la respecte.
Je vais maintenant me hâter de vous apporter quelques éléments de réponses supplémentaires, mesdames, messieurs les sénateurs, car je devine – il est dans mon dos, je ne le vois pas ! – que M. le président commence à perdre patience et surveille l’heure.
Sourires

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La statue du Commandeur !
Sourires sur le banc de la commission.
Il ne dit rien, mais il n’en pense pas moins.
Monsieur Rebsamen, vous déplorez l’imprévisibilité budgétaire dont souffrent aujourd’hui les collectivités. Je ne l’ignore pas, pour être moi aussi maire. Ce soir, j’avais d’ailleurs une réunion au sujet du budget pour 2010.
Je vous accorde qu’une telle imprévisibilité n’est pas très bonne, mais il ne peut pas y avoir d’un côté de la prévisibilité pour les collectivités locales et une imprévisibilité totale pour l’État.
Certes, l’imprévisibilité est un peu plus importante pour les collectivités, compte tenu de leur mode de gestion et de financement, mais, dans une crise comme celle que nous traversons, l’imprévisibilité budgétaire est le lot commun, pour les systèmes privés comme pour les systèmes publics. C’est ainsi ; il faut composer avec cette situation.
M. Jégou a beaucoup parlé de l’emprunt annoncé par le Président de la République. Il ne s’agit pas d’un grand emprunt. L’emprunt sera réservé au financement des dépenses d’avenir. Nous devrons observer la plus grande rigueur quant à la notion de « dépenses d’avenir ».
Quant à Mme Demontès, elle a préféré dénoncer, plutôt que formuler des propositions. C’est là un exercice qui n’est pas satisfaisant, surtout s’agissant des retraites.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l’Union centriste.

Je constate que le débat est clos.
Acte est donné de la déclaration du Gouvernement.

M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.
Acte est donné de cette communication.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures trente, est reprise à vingt-deux heures trente.