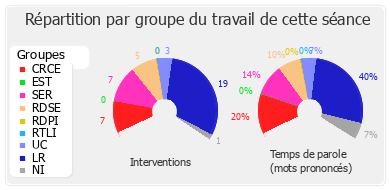Séance en hémicycle du 21 octobre 2014 à 21h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Pierre Caffet.

La séance est reprise.

M. le Premier ministre a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître le nom d’un sénateur pour siéger au sein du Conseil supérieur des programmes.
La commission de la culture, de l'éducation et de la communication a été saisie de cette désignation.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l’article 9 du règlement du Sénat.

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 21 octobre 2014, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le second alinéa de l’article L. 621-12 du code de commerce
C essation de paiement d’une société

Le texte de cette décision de renvoi est disponible à la direction de la séance.
Acte est donné de cette communication.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion du projet de loi organique, adopté par l’Assemblée nationale, portant application de l’article 68 de la Constitution (projet n° 288 [2011-2012], texte de la commission n° 30, rapport n° 29).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le secrétaire d'État.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, votre assemblée a souhaité inscrire à l’ordre du jour le projet de loi organique mettant en œuvre les dispositions de l’article 68 de notre Constitution, tel qu’il résulte de la loi constitutionnelle du 23 février 2007. Ce texte, déposé en 2010, a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale en janvier 2012.
La loi constitutionnelle du 23 février 2007 faisait suite à de longs débats sur le statut pénal du chef de l’État. Le constituant avait alors voulu rappeler que le Président de la République bénéficiait d’une irresponsabilité générale pour les actes accomplis en tant que président et d’une inviolabilité temporaire quant à sa personne, mais que ce principe pouvait connaître une exception en cas de « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». Cette formule, volontairement laconique, devait permettre de faire face à toutes les situations, même les plus imprévues.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’article 68 de notre Constitution a été conçu pour répondre à une situation grave et exceptionnelle : celle dans laquelle un Président de la République commettrait des « manquements à ses devoirs » si graves qu’ils dépasseraient la légitimité qu’offre l’élection au suffrage universel direct.
L’article 68 est extrêmement clair. Il prévoit que le Parlement réuni en Haute Cour peut destituer le Président de la République ; il prévoit aussi que tous les votes exprimés pour cette destitution ne sont considérés comme positifs que s’ils atteignent une majorité des deux tiers.
Au-delà de ces principes généraux, il va très loin dans les précisions. Il prévoit ainsi que c’est le président de l’Assemblée nationale qui préside la Haute cour. Il fixe également les délais et les modalités du vote.
Les marges de manœuvre du législateur organique sont donc limitées. Malgré tout, elles ne sont pas inexistantes, comme en témoigne la proposition de loi organique adoptée par le Sénat en novembre 2011. Comme vous le savez, elle différait sur plusieurs points du texte qui vous est soumis ce soir. Des amendements ont été déposés visant à aligner les dispositions du projet de loi organique sur celles de la proposition de loi organique que la Haute Assemblée avait adoptée il y a trois ans. En conséquence, je ne me livrerai pas, à ce stade de nos débats, à de longs développements sur les différences entre les deux textes : j’aurai l’occasion d’y revenir au cours de la soirée. Néanmoins, je tiens dès maintenant à rendre un hommage appuyé aux deux sénateurs qui avaient, dès 2009, rédigé cette proposition de loi organique, portée par l’ensemble du groupe socialiste : François Patriat et Robert Badinter. Ce sont eux qui, les premiers, avaient pris les devants pour accélérer la mise en application de l’article 68 de la Constitution. Je salue la grande qualité de leurs travaux et leur implication personnelle pour faire aboutir la révision de 2007. Nous pouvons tous tomber d’accord sur ce point, et je ne doute pas que chacun, sur l’ensemble des travées du Sénat, s’associera à cet hommage.
Avant d’en venir au contenu du projet de loi organique, permettez-moi de revenir un instant sur les origines de la révision de 2007. Dans son rapport, Hugues Portelli rappelle brillamment les événements et les réflexions qui ont mené à la réécriture de l’article 68. Je me permettrai donc d’être bref.
L’ancienne rédaction de l’article 68 prévoyait que le Président de la République n’était responsable des actes « accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison ». Comme l’a souligné la commission présidée par Pierre Avril chargée, en 2002, de proposer une nouvelle rédaction de l’article 68, la haute trahison posait un double problème : il s’agissait en effet d’un concept flou, qui, de plus, n’épuisait pas l’ensemble des possibilités en matière d’incapacités à exercer le mandat présidentiel.
Par ailleurs, l’article 68 avant 2007 prévoyait que, « en cas de haute trahison », le Président de la République était « mis en accusation » et « jugé » par la Haute Cour de justice. La loi organique prévoyait qu’une commission d’instruction composée de magistrats était chargée d’éclairer cette Haute Cour. Sur cette base, il appartenait à la Haute Cour de justice, composée de parlementaires, de « juger » le Président de la République, et elle pouvait prononcer des sanctions pénales.
Cette procédure, mi-parlementaire, mi-juridictionnelle, était une source de confusion et d’instabilité. En instituant une procédure entièrement parlementaire, dénuée de tout caractère juridictionnel, le constituant a souhaité autoriser la destitution du Président de la République dans un cadre particulier. Comme l’a expliqué M. Jean-Jacques Hyest dans son rapport sur la révision constitutionnelle de 2007, « le Parlement ne se prononce pas sur la nature ou la qualification pénale des manquements commis par le chef de l’État, mais sur la compatibilité de ces manquements avec la fonction. Le Président destitué redevient un citoyen ordinaire et peut alors, si ce manquement constituait par ailleurs une infraction, être poursuivi devant les juridictions de droit commun ».
Il appartient donc au Parlement, constitué en Haute Cour, non plus de juger le Président de la République, mais d’estimer si des « manquements » qu’il aurait commis sont manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat présidentiel. Aucune précision n’est donnée sur ces manquements, qui peuvent être liés à la fonction présidentielle ou de nature privée.
Il s’agit là d’une procédure d’exception, purement politique, qui repose uniquement sur l’appréciation de faits ou d’actes par les parlementaires eux-mêmes. Le projet de loi organique pose, à cet égard, quelques garde-fous. J’y reviendrai.
Dans l’esprit du constituant, le caractère exceptionnel d’une telle procédure ne fait guère de doute. Le rapporteur du projet de loi constitutionnelle à l’Assemblée nationale, Philippe Houillon, parlait à l’époque d’une crise grave qui menacerait « la continuité de l’État et la stabilité des institutions ». Je ne peux que souscrire à une telle opinion.
J’en viens à présent aux dispositions du projet de organique que vous allez examiner ce soir.
Ce texte prévoit une procédure rapide, motivée et publique.
La réunion de la Haute Cour est la conséquence du vote, par les deux assemblées, d’une proposition de résolution motivée. Cette dernière doit être signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée ayant pris l’initiative de cette saisine. Elle n’est pas amendable, et elle est transmise au Président de la République et au Premier ministre. Le projet de loi prévoit également que chaque parlementaire ne peut signer qu’une proposition de résolution, et une seule, durant un mandat présidentiel. Il s’agit là d’une précision utile, introduite par l’Assemblée nationale en 2012.
Le bureau de l’assemblée saisie en premier lieu se prononce sur la recevabilité de la proposition de résolution, notamment au regard de sa motivation, afin d’écarter tout motif manifestement abusif. Si la proposition de résolution est recevable, elle est transmise à la commission des lois, dont le projet de loi organique consacre la compétence exclusive en la matière.
L’assemblée saisie se prononce dans les quinze jours suivants les conclusions de la commission.
Pour être adoptée, la proposition de résolution doit ensuite réunir les votes de deux tiers des membres de l’assemblée. Si elle atteint cette majorité renforcée, elle est transmise sans délai à l’autre chambre qui se prononce, là encore, dans un délai de quinze jours, comme le prévoit la Constitution.
À l’issue du vote de la résolution par les deux assemblées, il appartient à la Haute Cour de se prononcer sur la destitution. Pour ce faire, elle est éclairée par les travaux d’enquête d’une commission ad hoc composée de parlementaires et respectant les équilibres politiques. Cette commission est tenue d’entendre le Président de la République s’il en fait la demande. Elle établit ensuite un rapport, sur la base duquel la Haute Cour doit statuer. Les débats de la Haute Cour sont publics. Seuls deux représentants du pouvoir exécutif peuvent y participer : le Président de la République et le Premier ministre.
Nous sommes donc face à une procédure équilibrée, qui concilie l’indispensable protection du mandat présidentiel et la nécessité d’une procédure d’exception en cas de circonstances graves. En respectant la composition politique des assemblées à toutes les étapes de la procédure, en instaurant des garde-fous, en introduisant du contradictoire, la procédure telle qu’elle est prévue par ce texte permet le respect non seulement de la lettre, mais aussi de l’esprit de l’article 68.
Malgré tout, le Gouvernement appelle l’attention du Sénat sur un point particulier. L’Assemblée nationale avait soulevé le cas de la clôture de la session parlementaire, qui pourrait faire obstacle à l’examen et au vote de la résolution par la seconde assemblée saisie. Le texte prévoit désormais que, dans ce cas de figure, « l’inscription à l’ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante ». Or l’article 68 de la Constitution prévoit que « la proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. » Cette disposition pourrait donc être jugée contraire à la Constitution, et il appartiendra au Conseil constitutionnel de se prononcer sur ce point.
Au-delà d’une possible réserve des juges de la rue de Montpensier, il sera sûrement nécessaire, dès ce soir ou à l’occasion d’une modification ultérieure de la loi organique, de préciser cette disposition pour le cas où la clôture de la session viendrait interrompre la navette de la résolution entre les deux assemblées.
Mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, votre commission des lois a adopté le projet de loi organique sans modification. Si aucun amendement n’était retenu en séance publique, ce texte serait immédiatement soumis au Conseil constitutionnel, avant d’être promulgué quelques semaines plus tard. Dans un tel cas, je me féliciterais de voir, plus de sept ans après son adoption par le Parlement réuni en congrès, l’article 68 de notre Constitution recevoir enfin un texte d’application. En dépit de cette satisfaction, je ne pourrais que regretter que d’autres options, inspirées de la proposition de loi organique de François Patriat et de Robert Badinter, n’aient pas été retenues.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur quelques travées de l’UDI-UC et de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le texte que nous examinons ce soir, s’il est adopté, mettra fin à un vide juridique qui remonte à 2001. À cette date, la Cour de cassation a retenu une interprétation de l’article 68, tel qu’il était alors rédigé, différente de celle formulée par le Conseil constitutionnel deux ans plus tôt. En 1999, ce dernier avait répondu – sans qu’on lui pose la question –, dans une décision relative au traité portant statut de la Cour pénale internationale, que, en vertu d’un privilège de juridiction, le Président de la République ne pouvait être jugé, même pour des actes accomplis en dehors de l’exercice de ses fonctions, que par la Haute Cour de justice, composée à l’époque de douze sénateurs et de douze députés.
Deux ans plus tard, dans l’arrêt Breisacher, relatif à l’affaire des emplois fictifs de la ville de Paris, la Cour de Cassation adoptait un point de vue diamétralement opposé : elle considérait qu’on ne pouvait pas attribuer à la Haute Cour de justice une compétence autre que celle pour laquelle elle avait été créée, à savoir la haute trahison du chef de l’État. Pour le reste, on devait s’en remettre aux tribunaux ordinaires, sauf que la Cour de cassation a aussi estimé que, du fait de son rang et de sa fonction, le Président de la République devait bénéficier, durant son mandat, d’une immunité, d’une inviolabilité temporaire qui l’empêchait d’être poursuivi ou entendu comme témoin. Il fallait donc attendre la fin de son mandat pour que son éventuelle responsabilité soit examinée par les tribunaux ordinaires compétents.
Deux des trois principales hautes juridictions françaises défendaient ainsi des points de vue opposés sur cette question clé de l’application de l’article 68.
Pour sortir de cette impasse, le Président de la République de l’époque a confié à des experts – c’était la fameuse commission présidée par Pierre Avril – le soin de lui soumettre une nouvelle mouture des articles 67 et 68 de la Constitution. À la suite de leurs conclusions en décembre 2002, un projet de loi constitutionnelle a été adopté en conseil des ministres. Reprenant les recommandations de la commission Avril, qui avait elle-même suivi les analyses de la Cour de cassation, ce texte octroyait au Président de la République une inviolabilité temporaire le temps de son mandat, tout en prévoyant qu’il ne pourrait être jugé que par une juridiction différente de la Haute Cour de justice telle qu’elle existait jusqu’alors. La Haute Cour de justice était en effet une juridiction d’exception, mi-politique, mi-juridictionnelle, composée d’hommes politiques et de magistrats. Or une juridiction de ce type – si elle avait un jour fonctionné – qui aurait été conduite à juger le chef de l’État et à prononcer d’éventuelles peines sur la base, non seulement du code pénal, mais également d’autres dispositions qu’elle aurait pu inventer, n’aurait pas été compatible avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui affirme le droit à un procès équitable. Il fallait donc agir.
Comme vous le savez, la loi constitutionnelle a été votée quelques années plus tard… Il aura fallu attendre quatre ans avant que le projet de loi constitutionnelle ne soit adopté par le Parlement réuni en congrès et plus longtemps encore avant que le projet de loi organique permettant d’appliquer l’article 68 ne soit rédigé. Rappelons en effet que l’article 67, qui accorde au Président de la République une inviolabilité totale pendant la durée de son mandat, était d’application immédiate, alors que la mise en œuvre de l’article 68, qui traite de la responsabilité du chef de l’État, nécessite une loi organique.
Compte tenu de ce déséquilibre fâcheux, une proposition de loi organique visant à combler le vide juridique avait été déposée au Sénat en 2009, puis adoptée en 2011, soit quelques jours avant que la commission des lois de l’Assemblée nationale n’examine le projet de loi organique finalement déposé par le Gouvernement.
Le fait que le Sénat débatte en premier du sujet a eu des conséquences sur les travaux des députés : beaucoup d’amendements adoptés par la commission des lois ont été inspirés par nos travaux. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si l’actuel président de la commission des lois de l’Assemblée nationale a été l’auteur de nombreux amendements.
En janvier 2012, les députés ont adopté le texte. Depuis lors, nous en sommes là.
Ce projet de loi organique constitue l’aboutissement d’un cheminement. Il opère une synthèse entre toutes les dispositions qui ont pu être rédigées en vue de mettre en œuvre l’article 68 tel qu’il a été voté en 2007. Son objet est cependant très restreint, tout simplement parce que l’article 68 prévoit clairement les conditions dans lesquelles la destitution pourrait être votée par chacune des assemblées, puis prononcée par la Haute Cour. Ainsi, il précise que les décisions doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour ou bien que toute délégation de vote est interdite. La Haute Cour doit donc fonctionner, non pas comme une assemblée qui examine un texte de loi – aucun amendement n’étant possible, il n’est pas prévu de faire de navette –, mais comme une assemblée politique prenant une décision politique, à savoir celle de destituer le chef de l’État si elle estime qu’il n’est plus en état de pouvoir exercer ses fonctions.
Je rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a été saisie en 2011 d’une affaire concernant une procédure d’impeachment engagée à l’encontre du Président de la République de Lituanie, procédure guère éloignée de celle dont nous discutons ce soir. Or la CEDH s’est estimée incompétente, car il ne s’agissait pas d’une procédure judiciaire, mais d’une procédure politique. Tel est le sens du présent projet de loi organique : aller plus avant dans la définition et la mise en œuvre de cette procédure politique par laquelle le Parlement, dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, se prononce sur la destitution du chef de l’État.
Le texte du projet de loi organique est très bref : il a surtout pour but d’organiser la procédure, les conditions dans lesquelles la proposition de résolution est déposée puis examinée par la commission des lois.
L’Assemblée nationale, en commission, puis en séance publique, avait rejeté un amendement du Gouvernement de l’époque visant à accorder à la commission des lois un droit de veto sur le texte. Puisque le texte est motivé, il est normal que la commission des lois soit saisie, mais elle ne peut que donner un avis sur celui-ci, en aucun cas bloquer son examen par l’assemblée qui devra se prononcer.
La deuxième série de dispositions contenues dans le projet de loi organique vise à aménager les conditions dans lesquelles on passe d’une assemblée à l’autre, à indiquer les délais, à réaffirmer les règles du contradictoire pour l’audition du Président de la République et à prévoir que la Haute Cour fonctionne véritablement comme une Haute Cour, et non comme une Haute Cour de justice, comme c’était le cas avant la révision de 2007. Le projet de loi organique se contente donc très simplement de préciser un certain nombre d’éléments contenus dans l’article 68. C’est la raison pour laquelle la commission des lois l’a adopté à l’unanimité.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC. – Mme Esther Benbassa applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’ai envie de commencer mes propos par un adverbe : « Enfin ! ». Enfin, nous sommes saisis d’un projet de loi organique mettant en œuvre l’article 68 de la Constitution !
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur – je salue une nouvelle fois la qualité de votre travail, mais nous y sommes habitués –, les questions autour de la procédure de destitution se posent depuis 2001. Or, depuis cette date, c’est le silence.
Rappelons, comme vous l’avez d’ailleurs fait devant la commission des lois, l’origine de ce questionnement. Comme souvent dans notre pays, malheureusement, c’est un scandale, celui des emplois fictifs de la ville de Paris, qui a conduit le Président de la République à créer une commission. Il est en effet habituel que notre pays ne fonctionne que par les scandales et l’émotion qu’ils suscitent, notamment en matière institutionnelle. À l’époque, nous pouvions toutefois craindre que cette commission, selon la formule de Clemenceau, ne soit qu’une façon d’enterrer l’affaire. Cela aurait pu être le cas, et nous sommes en effet passés tout près de l’enterrement. En tout cas, nous avons dû patienter sept ans – un septennat ! – depuis la révision constitutionnelle de 2007 pour voir apparaître les prémices d’une mise en œuvre de la procédure de destitution. Au cours de cette longue période, le chef de l’État a pu bénéficier de la protection de l’article 67, sans être soumis à sa contrepartie, inscrite à l’article 68. Dès lors, le Président de la République pouvait à peu près faire tout ce qu’il souhaitait.
Je me rappelle fort bien les propos tenus ici par Robert Badinter, qui nous disait que nous vivions dans une drôle de République car la seule femme française qui ne pouvait pas divorcer sans le consentement de son mari était l’épouse du Président de la République – certains, sur ces travées, se rappellent sans doute de cette formule. De surcroît, si le chef de l’État avait été responsable d’un accident de la circulation, les victimes n’auraient pas pu être dédommagées. On voit bien que la situation était intenable ; elle reposait sans doute sur une vision très monarchique de la présidence de la République et sur l’adage bien connu que le roi ne peut mal faire. Or si le roi ne peut mal faire, il n’est peut-être pas nécessaire d’encadrer son action et de préciser sa responsabilité…
Il faut saluer, comme M. le secrétaire d’État l’a fait, le coup d’accélérateur dans cette course de lenteur donné par la proposition de loi organique déposée par François Patriat et Robert Badinter, dont le sort a varié au gré des majorités sénatoriales : une majorité ancienne l’avait renvoyée devant la commission des lois, considérant sans doute qu’il fallait donner du temps au temps, …

… avant finalement qu’une majorité plus récente ne l’adopte. On en a bien vu l’effet : après l’adoption de la proposition de loi organique, le gouvernement Fillon a enfin déposé un projet de loi organique, qui, si j’ai bonne mémoire, avait été préparé par Michel Mercier.
Quelles sont les différences et ressemblances entre la proposition de loi organique et le projet de loi organique ? Les deux textes s’accordent sur un point, auquel nous souscrivons totalement : la destitution d’un Président de la République est un acte grave. La procédure doit donc être strictement encadrée, et la destitution doit nécessiter une majorité allant au-delà des clivages politiques, c'est-à-dire une majorité qualifiée.
En vertu de cette logique, des filtres puissants ont été instaurés. Cela a été rappelé, l’article 68 de la Constitution dispose que les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres composant l’assemblée concernée ou la Haute Cour. Le projet de loi organique prévoit des conditions encore plus rigoureuses : la proposition de résolution devra être motivée, ce qui est évidemment une nécessité ; elle devra être signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée ; un député ou un sénateur ne pourra – je me félicite de cet amendement de l’Assemblée nationale – être signataire de plus d’une proposition de résolution au cours du même mandat présidentiel.
Tout cela est du bel et bon ouvrage. Cependant, le projet de loi organique va encore plus loin. De ce fait, on a l’impression d’un long chemin enfermé dans des délais stricts : la proposition de résolution est d'abord transmise au bureau de l’assemblée devant laquelle elle a été déposée, qui vérifie sa recevabilité – ce point ne prête pas à discussion –, la commission des lois émet un avis, puis l’assemblée adopte ou rejette la proposition de résolution ; la commission des lois de l’autre assemblée est ensuite saisie du texte, puis cette autre assemblée l’adopte ou le rejette. Si la proposition de résolution a été adoptée par les deux assemblées, elle est examinée par une commission ad hoc, avant qu’enfin la Haute Cour ne se prononce.
Avouons que c’est tout de même un chemin difficile. Il est normal de se soucier du statut du Président de la République, mais on peut se demander si ce n’est pas trop. Songeons à la procédure d’impeachment qui existe aux États-Unis. Certes, la procédure française est purement politique et non juridictionnelle, mais, justement, elle pourrait être plus simple qu’une procédure juridictionnelle. Dans le système américain, c’est la Chambre des représentants qui engage la procédure en mettant en accusation le Président. Le Sénat, présidé par le président de la Cour suprême, décide à la majorité simple s’il faut y donner suite. Le cas échéant, il se prononce sur la destitution à la majorité des deux tiers. Il n’y a donc pas d’intervention de commissions permanentes ou ad hoc qui ajoutent des séquences aux séquences.
La procédure d’impeachment est simple. Elle est en même temps éminemment protectrice, puisqu’elle n’a jamais abouti à une destitution. Elle a été engagée deux fois – il y aurait pu en avoir une troisième –, la première à l’encontre d’Andrew Johnson, au XIXe siècle, et la seconde à l’encontre de Bill Clinton. Elle aurait pu aboutir à la destitution de Richard Nixon, mais celui-ci a démissionné avant la saisine de la Chambre des représentants.
Je pense que nous aurions pu concevoir une procédure plus simple et plus rapide sans pour autant mettre en péril le statut du chef de l’État. À travers l’un de mes amendements, je poserai la question suivante : est-il vraiment utile que le bureau de chaque assemblée renvoie la proposition de résolution devant sa commission des lois ?

Je ne le crois pas : nous ne sommes pas dans le cadre d’un processus législatif. On pourrait imaginer que la proposition de résolution soit renvoyée directement devant l’assemblée une fois sa recevabilité vérifiée par le bureau. Je ne vois pas en quoi le filtre de la commission des lois est nécessaire.
Je souhaite insister sur deux autres points.
Le premier est qu’il me paraît surprenant, même si le président de la commission des lois m’a donné des explications tout à l'heure, que le Président de la République puisse se faire représenter. Qu’il puisse se faire assister, rien n’est plus normal ; il pourra choisir le conseil de son choix. En revanche, s’il peut se faire représenter, cela signifie que la Haute Cour ne pourra pas l’interroger, alors même qu’il a manqué à ses obligations. On aura le droit de dialoguer avec maître Durand ou Dupont, mais on n’aura pas le droit de dialoguer avec la personne directement concernée. Il me semble étonnant que le Président de la République puisse être le grand absent des débats qui le concernent personnellement. Nous aurions pu être plus audacieux sur ce point.
Le second point est un peu plus complexe. La destitution prononcée par la Haute Cour n’entraînera pas l’inéligibilité du Président destitué, pour des raisons que nous comprenons. Il pourra en résulter des situations assez particulières. Le Président destitué pourra se représenter devant le peuple lors de l’élection présidentielle qui aura lieu trente-cinq jours au plus après sa destitution. Il pourra même être réélu.

Que se passera-t-il alors ? Le Président réélu bénéficiera de nouveau de l’immunité. Si des faits d’ordre pénal lui sont reprochés, une nouvelle procédure de destitution pourra-t-elle être engagée malgré sa réélection ? Cette question ne me semble pas réglée par le texte qui nous est proposé.
En tout état de cause, espérons qu’il ne s’agit là que de discussions théoriques. Je crois qu’aucun d’entre nous ne souhaite qu’une procédure de destitution soit un jour engagée, ni a fortiori qu’une telle procédure aboutisse, compte tenu des conséquences catastrophiques que cela aurait pour nos institutions.
Vous le voyez, ce projet de loi organique nous inspire des observations. Nous avons beaucoup réfléchi à ce que nous devions faire. Nous avons beaucoup souhaité qu’un texte portant application de l’article 68 de la Constitution soit présenté ; nous l’avons même tellement souhaité que nous avions déposé une proposition de loi organique, rédigée par François Patriat et Robert Badinter. Nous sommes en désaccord avec certains aspects de la procédure de destitution proposée aujourd'hui, mais nous sommes d'accord sur le principe, qui marque une grande évolution de notre droit constitutionnel. C'est pourquoi nous voterons le projet de loi organique.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du RDSE, ainsi que sur plusieurs travées de l’UDI-UC et quelques travées de l’UMP.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le statut pénal du Président de la République a été profondément bouleversé par la révision constitutionnelle du 23 février 2007, qui a réécrit les articles 67 et 68 de notre Constitution afin de clarifier le régime de responsabilité des actes accomplis par le chef de l’État.
L’article 67, d’applicabilité directe, traite notamment de l’irresponsabilité et de l’inviolabilité provisoires du chef de l’État pour les actes étrangers à la fonction présidentielle. L’article 68, qui crée la Haute Cour et la procédure exceptionnelle de destitution, doit, pour être applicable, faire l’objet d’une loi organique. Plus de sept ans après la réforme constitutionnelle, cette loi organique n’a toujours pas été adoptée par le Parlement. Le déséquilibre entre la protection dont bénéficie le Président de la République et sa responsabilité est donc patent. Le projet de loi organique que nous examinons aujourd’hui a pour objet d’y mettre un terme.
Avant d’entrer dans le détail du texte, je voudrais revenir rapidement sur l’article 67 de notre Constitution. Selon cet article, le Président de la République « ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action, d’un acte d’information, d’instruction ou de poursuite ». Le Président de la République est donc « injusticiable », quoi qu’il ait fait avant d’être élu et quoi qu’il fasse pendant son mandat, sans exception aucune.
Les écologistes sont loin d’adhérer à ce principe d’irresponsabilité provisoire du chef de l’État. Certains de nos collègues députés ont d’ailleurs déposé, en octobre 2011, une proposition de loi constitutionnelle visant à préciser le statut pénal du chef de l’État. Nous ne souhaitons pas que le Président de la République puisse être mis en cause pour n’importe quel fait et par n’importe qui, mais nous avons la conviction que l’inviolabilité judiciaire ne protège en rien la dignité de la fonction ; elle risque simplement d’aggraver les soupçons contre son titulaire et de conduire à des dénis de justice.
Revenons maintenant au texte qui nous réunit aujourd’hui. Celui-ci détaille la procédure exceptionnelle de destitution du chef de l’État. Cette procédure, au terme de laquelle le Président de la République ne peut être destitué « qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat », est confiée au Parlement.
Il s’agit bien d’une responsabilité politique du Président, qui doit être clairement dissociée d’une responsabilité pénale ou civile, afin d’échapper aux perversions de la judiciarisation du politique, dont on a pu mesurer, depuis une dizaine d’années, les effets délétères. Cependant, si cette dissociation apparaît nécessaire, son effectivité semble pour le moins douteuse, faute de considération de la dimension éventuellement judiciaire des griefs portés contre le Président, et l’on peut craindre que ce qu’on appelle pudiquement « les affaires » soit opportunément utilisé pour détourner la procédure de destitution et régler des conflits d’ordre exclusivement politique.
Je veux rappeler à mon tour que, au XXe siècle, la procédure américaine d’impeachment présidentiel a toujours été précédée d’une procédure judiciaire. La procédure lancée contre Nixon avait pour origine un procès pénal conclu par un arrêt de la Cour suprême – United States v. Nixon, 24 juillet 1974 –, tandis que la procédure visant Bill Clinton avait pour origine un procès civil conclu lui aussi par un arrêt de la Cour suprême – Clinton v. Jones, 27 mai 1997 – et l’enquête du procureur indépendant Kenneth Starr. À cette occasion, la Cour suprême avait d’ailleurs très clairement démontré l’inanité d’une injusticiabilité présidentielle pour les actes détachables de ses fonctions, l’absence d’atteinte à la séparation des pouvoirs lorsque la justice se saisit des agissements « privés » du Président et la capacité du pouvoir judiciaire à défendre mieux que quiconque la dignité de la fonction présidentielle.
Une fois constatée cette injusticiabilité présidentielle, la question est de savoir si la procédure de destitution mise en place est entourée des garanties suffisantes. Le groupe écologiste croit pouvoir répondre par l’affirmative, car, comme le rappelle notre rapporteur, la mise en cause doit être votée par les deux tiers des membres de chaque assemblée, puis par les deux tiers des membres du Parlement constitué en Haute Cour, ce qui signifie qu’elle ne peut être manipulée par l’opposition, ni même par la majorité : elle nécessite un quasi-consensus entre les forces politiques.
Si nous avons émis quelques réserves, nous n’en considérons pas moins que le projet de loi organique contribue à rétablir un certain équilibre et constitue une avancée notable. Nous lui apporterons donc notre soutien.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, sept ans et demi après le vote par le Parlement réuni en congrès d’un nouveau statut juridictionnel du chef de l’État, le chemin tortueux de la loi organique nécessaire à son applicabilité reprend son cours. J’oserais dire que sept ans de réflexion, c’est long… Les citoyens pourraient légitimement s’interroger sur les raisons qui ont retardé sans cesse l’adoption des règles pratiques de mise en œuvre de cette procédure nouvelle de destitution du Président de la République, inscrite à l’article 68 de la Constitution.
En son temps, soit en janvier 2012, Nicolas Sarkozy avait permis l’adoption d’un texte à l’Assemblée nationale, et ce, faut-il le rappeler, sous la pression du Sénat de gauche.
Aujourd’hui, ironie de l’histoire, c’est la nouvelle majorité de droite du Sénat qui donne l’impression de forcer la main à François Hollande, qui n’a pas jugé bon, durant les deux premières années de son mandat, de conclure ce débat. Ainsi, le groupe UMP de notre assemblée a décidé de nous soumettre le texte voté par l’Assemblée nationale.
Soyons honnêtes, il n’a que très peu de différences avec le texte adopté au Sénat, après moult péripéties, le 15 novembre 2011. Le principal intérêt réside, de toute évidence, pour les partisans de cette procédure, dans la possibilité d’un vote conforme permettant l’adoption définitive de ce projet de loi organique, déposé à l’Assemblée nationale le 22 décembre 2010, et adopté par les députés le 24 janvier 2012.
Ce texte concerne le statut juridictionnel du chef de l’État. Depuis la loi constitutionnelle du 23 février 2007, l’article 68 de la Constitution permet au Parlement constitué en Haute Cour de destituer le chef de l’État en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
Le projet de loi organique a donc deux objets : les conditions de présentation des propositions de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour et la nature de l’examen de ces propositions par les commissions permanentes compétentes des deux assemblées.
Avant de faire une remarque plus générale, critique, sur le fond et sur le contexte de ce débat, je tiens à porter à votre connaissance quelques réflexions.
Tout d’abord, cette procédure de destitution est bien timide. Elle l’est même excessivement, comparée à la procédure d’impeachment en vigueur aux États-Unis : la Chambre des représentants américaine vote à la majorité simple la procédure de mise en accusation ; le Sénat, dans un second temps, se saisit de l’instruction en devenant, de fait, la Haute Cour, et statue finalement à la majorité des deux tiers. Le texte qui nous est soumis tend d’emblée à limiter la mise en œuvre même de la procédure en posant la règle des deux tiers à chaque étape de la procédure.
Ensuite, force est de s’interroger sur le pouvoir donné au Sénat, assemblée qui est, ne vous en déplaise, élue au suffrage indirect par un corps électoral de moins de 200 000 grands électeurs. Il est pourtant placé sur le même plan que l’Assemblée nationale, élue, elle, au suffrage universel direct. Un tel dispositif peut poser question au regard des principes démocratiques.
En outre, pourquoi la commission des lois intervient-elle ? En effet, il ne s’agit pas d’un texte législatif. Pour les propositions de résolution discutées dans le cadre de l’article 34-1 de la Constitution, cette intervention de la commission, a priori compétente, n’est pas prévue.
Enfin, la composition de la commission ad hoc chargée d’éclairer le Parlement constitué en Haute Cour mérite attention. À notre sens, elle porte atteinte au pluralisme, à l’instar de la composition actuelle de la Cour de justice de la République. En effet, prévoir six membres par chambre exclut de fait un certain nombre, non seulement de sensibilités, mais aussi de groupes parlementaires de la participation à un organisme qui détiendra les clefs de l’instruction. Il s’agit d’une atteinte grave au pluralisme et d’un encouragement à une répartition bipartite.
Le 15 novembre 2011, le Sénat, à notre demande, avait porté ce chiffre à dix représentants par assemblée. Nous regrettons fortement que ce choix n’ait pas été retenu. Nous défendrons d’ailleurs un amendement pour rectifier ce qui s’apparente à une faute démocratique.
Plus généralement, nous nous interrogeons sur la faiblesse de la portée de ce projet de loi organique au regard de la grave crise des institutions et du politique que traverse notre pays. L’UMP, en ravivant cette procédure de destitution, désuète avant même d’avoir existé, espère mettre un peu plus en lumière la fragilité politique de l’actuel chef de l’État. Ce faisant, la droite sénatoriale met surtout en lumière, peut-être involontairement, les excès du présidentialisme à la française.
Ce projet de loi organique, je l’ai déjà indiqué, souligne le caractère quasi impossible de la mise en œuvre de la procédure de destitution. C’est donc la force du statut présidentiel qui est en fait mise en exergue.
Le Constitution de 1958, rédigée par Michel Debré, renforcée par l’instauration en 1962 de l’élection au suffrage universel direct du Président de la République, a rompu avec les IIIe et IVe République en plaçant au centre de nos institutions le Président de la République.

Dès 1995, avec l’élargissement du champ référendaire, puis en 2000, avec l’instauration du quinquennat, et, enfin, en 2001, avec l’inversion du calendrier, qui soumet l’élection législative à l’élection présidentielle, la présidentialisation du régime s’est encore accentuée.
Nous sommes donc arrivés aujourd’hui à un point de blocage institutionnel. Le Président de la République est une forme de monarque au mandat limité.

Pendant cinq ans, il est « irresponsable » : il n’est responsable ni devant le peuple ni devant le Parlement. Cet homme, ou peut-être un jour, du moins l’espérons-nous, cette femme, est exonéré de tout contrôle démocratique. C’est une question essentielle. Nous savons tous que l’exaspération populaire, la perte de crédibilité du politique provient en grande partie des désillusions successives, nées pour beaucoup de promesses de campagne non tenues.
Le président monarque, une fois élu, peut s’affranchir des promesses ; il n’est plus contesté. À la différence du Gouvernement, il ne peut être remis en cause par le Parlement.
Le temps est trop court aujourd’hui pour revenir sur les conséquences dévastatrices sur le plan démocratique de ce déséquilibre institutionnel.
Présidentialisation rime avec médiatisation et « pipolisation ». Croyez bien que nous le regrettons. Elle s’oppose à la réflexion, à la critique ; elle sclérose le débat en plaçant le pays en état de campagne électorale permanente. Il est temps de s’interroger sur l’existence même d’un Président de la République élu au suffrage universel direct doté de tant de pouvoirs.
M. Jacques Mézard applaudit.

Les limites de cette procédure de l’article 68, la quasi-impossibilité de la mise en œuvre de la procédure de destitution mettent en évidence un statut présidentiel proche, durant le mandat, de celui du monarque d’Ancien Régime : « La personne du roi est inviolable et sacrée », écrivaient les constituants de 1791.
Pour conclure, je rappellerai que l’article 68 de la Constitution est le corollaire de l’article 67, qui fixe le statut pénal du chef de l’État. Ce dernier est irresponsable pénalement durant son mandat ; il l’est définitivement pour les faits relatifs à sa fonction et, pour les autres, les poursuites sont renvoyées à plus tard au péril, en particulier, de la préservation des preuves.
La destitution à la française constitue une sorte de garde-fou pour éventuellement sanctionner des actes particulièrement graves du Président. En l’occurrence, une responsabilité politique se substitue à la responsabilité juridique.
Les sénateurs du groupe CRC – c’est une constante – sont pour un traitement de droit commun des actes du Président de la République, à l’exception de ceux liés à l’exercice de sa fonction. Ils ont d’ailleurs déposé une proposition de loi constitutionnelle en ce sens en 2011. Nous regrettons que le texte voté en 2001 par l’Assemblée nationale instaurant la compétence de droit commun pour les actes privés n’ait pas inspiré le constituant de 2007.
La Constitution de la Ve République n’est plus à la hauteur des enjeux. Elle prive fondamentalement le citoyen des moyens d’action face à ceux qui détiennent aujourd’hui le véritable pouvoir, à savoir les marchés financiers. Rendre le pouvoir au peuple et assurer un contrôle citoyen permanent constituent des objectifs prioritaires d’une nouvelle République, la VIe République. Nous érigeons en priorité démocratique la mise en place d’une assemblée constituante, démocratique, pluraliste pour remettre la République sur les rails, pour redonner un sens à notre démocratie.
Le projet de loi organique dont nous débattons aujourd’hui relève, et ce n’est pas un jeu de mots, d’une fin de règne ; il vise à masquer la réalité de la toute-puissance du Président de la République dans nos institutions. Pour toutes ces raisons, les élus du groupe CRC ne l’approuveront pas.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

Le Président de la République, madame Assassi, est un monarque qui ne guérit pas les écrouelles…
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la saga de la réforme du statut pénal du Président de la République semble toucher à sa fin avec l’adoption vraisemblable par notre assemblée du projet de loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution. En tout cas, nous l’espérons, car le cheminement a été très long. Cependant, force est de constater que la responsabilité de ce retard est largement et équitablement partagée.
Faut-il rappeler que cette réforme était une promesse du Président Chirac, alors candidat à sa réélection, en mars 2002 ? Plus de douze années se sont écoulées sans qu’aucune majorité, malgré l’alternance, ne mette un point final à cette question. Le contexte, il est vrai, n’était pas simple en 2002, puisque le Président de la République avait fait l’objet d’une tentative de mise en cause devant une juridiction d’instruction. Au-delà d’un aspect purement médiatique, constitutionnalistes et pénalistes s’affrontaient sur l’interprétation à donner aux textes en vigueur et sur la manière de les réformer.
Une commission présidée par Pierre Avril a été nommée en juillet 2002 pour proposer un nouveau statut du Président de la République, mais il a fallu attendre près de cinq années pour que ces propositions soient consacrées par le pouvoir constituant avec la révision constitutionnelle du 23 février 2007.
L’Assemblée nationale a examiné, en janvier 2012, le projet de loi organique qui est aujourd’hui, 21 octobre 2014, l’objet d’une première lecture au Sénat. La Haute Assemblée, quant à elle, avait examiné une proposition de loi de notre collègue François Patriat à deux reprises : en janvier 2010, puis, après un renvoi en commission pas forcément nécessaire, en novembre 2011.
Aujourd’hui, pour le RDSE, l’heure est venue qu’un point final soit mis à cette réforme.

Non pas que la procédure de l’article 68 de la Constitution ait vocation à être utilisée prochainement – en tout cas, ce n’est pas notre souhait –, mais tout simplement parce qu’il s’agit de mettre fin à une polémique juridique et politique sur la responsabilité pénale du chef de l’État, ainsi que de clarifier, à toutes fins utiles, les règles procédurales.
Le Président de la République n’est pas et ne sera jamais, quoi que l’on en dise, un justiciable comme les autres.

Ce statut est justifié par la place même de cette fonction au sein des institutions, tout comme par le mode d’élection du Président de la République au suffrage universel direct, quoi que l’on puisse penser de ce système que la sensibilité que je représente a toujours combattu depuis 1962.
Les constituants de la Ve République avaient placé le Président de la République au-dessus des partis et des luttes politiques, en tant qu’arbitre national chargé d’assurer le fonctionnement régulier des institutions.
Les rédacteurs de la Constitution de 1958 n’avaient certes pas ignoré la responsabilité du chef de l’État, mais ils avaient opéré une confusion entre responsabilités juridique et politique en le soumettant à la compétence d’une Haute Cour de justice, composée de parlementaires, en cas de haute trahison. Cette incrimination ne constituait pourtant pas une véritable infraction, puisqu’elle n’était pas prévue par le code pénal, ne faisait l’objet d’aucune définition et n’était assortie d’aucune peine.
Le rapport Avril a d’ailleurs bien insisté sur le caractère ou trop étroit ou trop large de cette expression, et de nombreux constitutionnalistes ont tenté d’énumérer les hypothèses de haute trahison : trahison au profit d’une puissance étrangère, intelligence avec l’ennemi, abstention d’un acte auquel le Président est tenu, usage abusif de l’article 16 de la Constitution, accaparement d’un pouvoir qu’il ne tient pas de la Constitution. Qui trop embrasse mal étreint !
A contrario, l’irresponsabilité du Président de la République pour ses actes privés était insatisfaisante, voire choquante. L’immunité juridictionnelle constitue un privilège protégeant la fonction et non pas l’homme, afin de permettre à celui-ci d’exercer aussi sereinement que possible le mandat que les électeurs lui ont confié.
La réforme constitutionnelle de 2007 a rompu avec cette imprécision, l’objectif étant de veiller à ce qu’il n’existe plus aucune ambiguïté et à ce que la protection du premier personnage de l’État soit désormais totale à l’égard de toute action pénale ou civile concernant des actes détachables de sa fonction. Le constat de la surmédiatisation du Président de la République, sous toutes les coutures de sa vie, même privée, rendrait toute protection vaine si l’on offrait à des tiers la possibilité d’un acharnement judiciaire à son égard. L’actualité aurait d’ailleurs pu le laisser imaginer...
Il faut dire que le passage au quinquennat a contribué à enlever à la magistrature suprême beaucoup de sa superbe…

Par un nouveau paradigme de la fonction, il a rendu encore plus nécessaire l’instauration de règles relatives à la procédure de destitution. Napoléon Bonaparte disait : « On ne conduit le peuple qu’en lui montrant un avenir : un chef est un marchand d’espérance. » Manifestement, l’espérance n’est plus au rendez-vous. À chacun d’en tirer les conclusions…
Le présent texte constitue un compromis équilibré, dépassant largement les clivages politiques. La procédure, qui, certes, n’est pas simple, fait intervenir le Parlement constitué en Haute Cour, sur proposition de l’une des assemblées parlementaires confirmée par l’autre, chacune statuant à la majorité des deux tiers de ses membres. Sont fixés des délais d’inscription à l’ordre du jour des assemblées, ainsi que de traitement de la proposition, afin d’éviter toute obstruction procédurale.
Toutefois, comme notre ancien collègue Nicolas Alfonsi en 2007, j’émettrai une réserve. Je regrette que n’ait pas été introduite l’impossibilité pour le Président de la République de siéger au Conseil constitutionnel après sa destitution, car c’est un curieux paradoxe.

Cette question ne pourra rester sans suite. Mon groupe a ainsi déposé une proposition de loi constitutionnelle réformant la composition du Conseil constitutionnel, afin de rendre plus démocratique et d’harmoniser la composition de cette cour suprême avec son rôle au cœur de la Ve République – elle pourra donner un certain nombre d’idées à ceux d’entre nous qui ont assisté à la réunion de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.
Les membres du groupe du RDSE voteront à l’unanimité en faveur du présent projet de loi organique, point final historique attendu à la longue affaire de la responsabilité pénale du chef de l’État. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en écoutant les précédents orateurs, j’avais l’impression de rêver. On nous a expliqué que l’histoire était longue. C’est vrai, mais rien n’a été fait depuis 2012. Or de 2012 à 2014, nous aurions eu le temps de légiférer !
On nous a aussi expliqué que le projet de loi organique n’était pas très bon. Une proposition de loi portant sur le même sujet, jugée meilleure par certains, avait été adoptée par le Sénat deux mois avant que l’Assemblée nationale n’adopte le texte dont nous discutons ce soir. Qu’est-ce qui empêchait le Gouvernement d’inscrire cette proposition de loi à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale ? Rien !

C’est donc que le Gouvernement a choisi le présent projet de loi ! Il disposait en effet de tout le temps nécessaire pour faire voter la proposition de loi précitée, et l’affaire aurait été terminée.
En fait, on a choisi de parler de cette affaire, ce dont M. Anziani s’est fort bien acquitté. In fine, il faudra en retenir qu’il y a eu ceux qui ont parlé de cette réforme et ceux qui l’ont faite ! C’est simple, mais c’est ainsi que le Sénat peut l’envisager.
Sourires sur les travées de l’UDI-UC et de l’UMP.

En réalité, par le biais du texte que nous examinons ce soir, il s’agit d’achever la révision constitutionnelle du 23 février 2007 qui a permis de réécrire les articles 67 et 68 de la Constitution et d’encadrer, comme l’a fort justement souligné M. le secrétaire d’État, très strictement le législateur organique. Celui-ci dispose de peu de latitude pour écrire le droit : le constituant l’a déjà fait, et il s’agit simplement de mettre son texte en musique.
Les articles 67 et 68 de la Constitution, révisés en suivant les recommandations de la commission présidée par le professeur Pierre Avril, dotent notre pays d’une procédure certes difficile à mettre en œuvre, mais moderne, permettant la destitution d’un Président de la République qui manquerait manifestement à l’exercice de sa fonction, au point qu’il se rendrait indigne de poursuivre l’exercice du mandat qui lui a été confié par le peuple.
Cette procédure est encadrée, et c’est normal ! On ne peut accepter que certains demandent à tout bout de champ au Parlement de se constituer en Haute Cour, comme la tactique du harcèlement politique pourrait les y conduire.
Je rappelle que l’objet de cette procédure ne saurait en aucun cas être la mise en cause pénale du chef de l’État, même si sa destitution peut ouvrir la voie, dans un second temps, à l’engagement de poursuites pénales à son encontre, dans les conditions du droit commun. Le Président de la République se trouverait en effet soumis au droit commun si, outre les fautes qui ont justifié sa destitution, il avait également commis des infractions pénales. En tout état de cause, seule la représentation nationale est légitime pour interrompre le mandat confié par le peuple.
Le législateur organique a prévu un certain nombre de modalités d’application de l’article 68 de la Constitution. Je ne reviendrai pas sur les détails qui ont été fort bien exposés par l’ensemble des orateurs et par M. le rapporteur.
Le rôle du bureau de chaque assemblée est réaffirmé et il me semble tout à fait positif que cet organe politique, et non la conférence des présidents, statue sur la recevabilité de la proposition de résolution, puisque l’ensemble des forces politiques présentes au Parlement y sont représentées à la proportionnelle.
Il me semble aussi naturel et nécessaire que la commission des lois soit saisie, puisqu’une appréciation technique doit être portée sur les actes du Président de la République qui motivent la réunion de la Haute Cour.
Cette dernière devra enfin se prononcer dans des délais très stricts, afin d’éviter qu’une procédure dilatoire ne dure plusieurs mois, puisqu’il y va de l’exercice même de la fonction présidentielle dans notre pays.
Le présent projet de loi organique, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale au début de l’année 2012, garantit l’équilibre et le bon fonctionnement de nos institutions. Il a fait l’objet d’une discussion approfondie par la commission des lois du Sénat. Son adoption permettra de mettre en œuvre concrètement, si cela s’avérait un jour nécessaire, la procédure de destitution du Président de la République, tout en conservant son caractère exceptionnel voulu par le constituant, car il est le seul compatible avec l’esprit de nos institutions. Pour l’ensemble de ces raisons, les membres du groupe de l’UDI-UC voteront ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC et de l'UMP, ainsi qu’au banc des commissions.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je me réjouis particulièrement, ayant été rapporteur du projet de loi constitutionnelle en 2007, que nous aboutissions enfin à l’adoption d’un projet de loi organique permettant de mettre en œuvre des articles de la Constitution que nous avions alors modifiés.
Je note d’ailleurs que le Président de la République veut réformer l’article 67 de la Constitution – un projet de loi constitutionnelle a été déposé à cet effet – ainsi que l’article 68-1 relatif à la responsabilité des ministres, mais qu’il ne veut pas réviser l’article 68. Nous pouvons donc considérer que nous disposons déjà du feu vert du chef de l’État avant d’avoir adopté le projet de loi organique…

C’est quand même une satisfaction, avouez-le ! J’allais même dire une satisfaction rare, en ce qui me concerne !
L’article 68 de la Constitution institue une procédure de destitution du Président de la République « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat » ; la formule est bien précise.
Tout à l’heure, notre éminent rapporteur, le professeur Portelli, a dit qu’il s’agissait de l’hypothèse où le Président de la République ne serait plus « en état de pouvoir exercer ses fonctions ». Il me semble que ce n’est pas exact, puisque, si le Président n’est plus en état d’exercer ses fonctions, il se trouve empêché et c’est alors le Conseil constitutionnel qui intervient pour constater la situation. Je tenais à insister sur cette nuance…

J’ai dit que le Président de la République n’était plus en état « politique » d’exercer ses fonctions !

Je n’ai pas entendu le mot « politique », monsieur le rapporteur. Quoi qu’il en soit, dans les cas visés par l’article 68 de la Constitution, le Président de la République est toujours en état politique d’exercer son mandat, mais il a manqué à ses devoirs au point de ne plus pouvoir exercer ses fonctions. Ce n’est pas tout à fait pareil !
On peut toujours reparler de la notion de « haute trahison », qui figurait auparavant dans le texte constitutionnel et permettait des gloses infinies. Certains orateurs précédents ont rappelé ce que pouvait recouvrir la haute trahison, mais cette notion était devenue incompréhensible pour la grande majorité de nos concitoyens et n’a jamais été appliquée. Cette non-application était d’ailleurs peut-être due non à l’absence de définition de la notion, mais au fait que la procédure était impossible à mettre en œuvre.
Monsieur le rapporteur, vous avez excellemment rappelé la controverse entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation. C’est assez extraordinaire : la commission Avril et le constituant ont fini par donner raison à cette dernière, puisque c’est une procédure largement prétorienne qui a été retenue. Bien entendu, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 octobre 2001, en refusant de reconnaître l’existence d’un éventuel privilège de juridiction du chef de l’État, a porté un coup fatal à la Haute Cour de justice.
Il a donc fallu trouver une solution. L’article 68 de la Constitution est extrêmement précis. Peu de choses doivent y être ajoutées, même si l’adoption d’une loi organique est nécessaire pour permettre sa mise en œuvre, en précisant notamment le déroulement des travaux précédant le vote tendant à la destitution du chef de l’État.
L’examen, au mois de janvier 2010, de la proposition de loi de notre collègue François Patriat nous avait permis d’anticiper largement les débats d’aujourd’hui, le Gouvernement n’ayant à l’époque pris aucune initiative sur ce sujet. Je me permets de rappeler que, si nous avions, à ce moment, décidé de renvoyer ce texte à la commission, c’est parce qu’un projet de loi venait d’être déposé. On peut toujours faire se croiser des projets de loi et des propositions de loi, ils ne se rencontrent jamais ! C’était donc la seule raison motivant cette demande de renvoi à la commission. Nous avons ensuite de nouveau examiné cette proposition de loi en séance publique et je crois que nos travaux ont permis d’éclairer la réflexion des députés.
Le texte qui nous est soumis aujourd’hui vise à préserver la dignité de la fonction présidentielle. Ses dispositions s’inspirent très largement des préconisations formulées au mois de décembre 2002 par la commission de réflexion sur le statut pénal du Président de la République, présidée par le professeur Avril, qui ont servi de base à la révision constitutionnelle de 2007.
Concernant le nombre de signataires et, plus généralement, les conditions requises pour le dépôt d’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour, le choix de la signature de ce texte par le dixième des membres de l’assemblée concernée, quantum évoqué par la commission Avril, et reprenant les anciennes dispositions des règlements du Sénat et de l’Assemblée nationale me paraît cohérent. Cette commission suggérait aussi qu’un membre du Parlement ne puisse être signataire que d’une seule proposition de réunion de la Haute Cour au cours du même mandat présidentiel. La question reste posée dans le cas où la procédure de destitution n’aurait pas abouti.
Faut-il prévoir d’autres mécanismes, telle la possibilité qu’une assemblée ne soit pas appelée à délibérer d’une motion si le bureau s’y oppose à l’unanimité ? Cette question, je l’avais déjà soulevée lors de l’examen de la proposition de loi de notre collègue Patriat.
Je tiens, par ailleurs, à saluer la position de l’Assemblée nationale, qui a rejeté la version initiale du projet de loi organique confiant à la commission des lois de la première assemblée saisie le soin de vérifier que la proposition de résolution n’était pas dénuée de tout caractère sérieux et, le cas échéant, de s’opposer à sa mise en discussion. C’était aller trop loin !
Ce rôle de filtrage ne paraît pas compatible avec l’institution d’un droit de veto donné à une formation restreinte de l’une des deux chambres statuant à une majorité simple.
En revanche, le remplacement de cette version par une procédure en quatre temps me semble plus cohérent : contrôle de recevabilité, envoi de la proposition de résolution pour examen à la commission des lois – disposition à mon sens indispensable, l’expertise de la commission des lois s’imposant, même si ce n’est pas un texte législatif –, inscription de la proposition de résolution à l’ordre du jour et vote de cette dernière.
Pour ce qui concerne la composition du bureau et le rôle de la Haute Cour, l’option retenue par l’Assemblée nationale de fixer le nombre des membres du bureau à vingt-deux – onze sénateurs et onze députés – évitera la constitution d’une assemblée pléthorique.
De plus, il est précisé que la constitution du bureau de la Haute Cour s’efforcera « de reproduire la configuration politique de chaque assemblée », précision qui s’accorde tout à fait à l’attention que notre assemblée attache traditionnellement au pluralisme sénatorial. Elle donne, comme l’indique l’excellent rapport de notre collègue Hugues Portelli, pour la première fois un fondement organique à un principe qui, jusqu’à présent, ne trouve sa source directe que dans les règlements des assemblées.
Le dernier point de mon intervention portera sur l’organisation des débats de la Haute Cour et sur la possibilité pour le Président de la République de se faire représenter.
L’ancienne Cour de justice de la République, comme le prévoyait l’article 31 de l’ordonnance du 2 janvier 1959, pouvait exceptionnellement siéger à huis clos. Cette possibilité n’est pas offerte à la Haute Cour, bien que ce caractère exceptionnel n’aurait pas eu pour effet, selon moi, de nuire à cette instance. Il pourrait arriver des cas où il n’est pas forcément nécessaire d’exposer sur la place publique les turpitudes d’un Président de la République !
De plus, je souhaite rappeler, car c’est important, que, bien que la procédure ne revête aucun caractère juridictionnel – c’est bien ce qui la différencie de l’ancienne procédure –, on respecte parfaitement le principe du contradictoire.
J’en viens aux modalités des débats et de décision. Je note que le projet de loi organique reprend dans leur intégralité les préconisations formulées par la commission Avril fixant la durée des débats, déterminant les membres autorisés à participer – les ministres sont exclus, mais la possibilité offerte au Premier ministre de prendre part au débat est préservée et la faculté est ouverte au Président de la République de se faire représenter –, cette procédure – selon l’explication de la commission précitée – ne suspendant pas de fait les fonctions de chef de l’État du Président de la République.
Je me réjouis que mon groupe ait inscrit l’examen du présent projet de loi organique dans la niche parlementaire qui lui est réservée, lui donnant la préférence sur quantité de propositions de loi pourtant extrêmement intéressantes. Au début de cette nouvelle session, il nous a semblé qu’il appartenait au Sénat de conforter la réforme qui avait été votée dès 2007.
Au regard de toutes ces remarques, les membres du groupe UMP voteront bien entendu en faveur du projet de loi organique, tel que l’a transmis l’Assemblée nationale au Sénat, donc sans modification. §

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’article 68 de la Constitution prévoit une procédure de destitution du chef de l’État qui peut être mise en œuvre en cas de manquement de celui-ci à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat.
Il substitue à une procédure de mise en accusation une procédure de destitution fondée sur une appréciation politique – disons-le, car c’est la vérité – de la nature du manquement reproché au chef de l’État.
La révision constitutionnelle de 2008 a ainsi rompu avec l’ambiguïté d’un système qui laissait la Haute Cour de justice déterminer souverainement la sanction encourue par le Président de la République coupable de haute trahison. Dans le rapport qu’il a rédigé sur le projet de loi constitutionnelle, Jean-Jacques Hyest …

C’est la raison pour laquelle je vous cite, mon cher collègue !
Vous écriviez alors que l’article 68 « établit une nette distinction entre les champs institutionnel et juridictionnel : après avoir sanctionné l’incompatibilité entre un acte ou un comportement et la poursuite du mandat, la destitution rend le Président de la République à la condition de citoyen ordinaire, passible des juridictions de droit commun. »
Vous poursuiviez : « La destitution répondant à une logique politique, elle ne peut être prononcée que par un organe suffisamment légitime pour sanctionner le représentant de la nation. » Seul le représentant du peuple souverain peut, en effet, apprécier les manquements dont serait responsable une autorité issue du suffrage universel. Vous indiquiez également, monsieur Hyest: « Aussi le projet de loi constitutionnelle prévoit-il que ″la destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour″. »
Contrairement au dispositif antérieur – j’insiste sur ce point –, les parlementaires sont non des juges politiques, mais des représentants prenant une décision politique afin de préserver les intérêts supérieurs de la nation.
Mes chers collègues, j’ai lu avec beaucoup d’intérêt le rapport de M. Portelli, qui nous appelle – comme vient de le faire M. Hyest – à un vote conforme.
Permettez-moi de m’interroger quelque peu. En effet, il est vrai que l’adoption de ce projet de loi organique a beaucoup tardé. Chacun d’entre nous a fait des efforts, qu’il s’agisse du Gouvernement – M. Michel Mercier en a parlé – ou du Sénat, puisque, si la proposition de loi organique Patriat-Badinter, dont j’ai eu l’honneur d’être le rapporteur devant la Haute Assemblée, avait été votée par l’Assemblée nationale, une disposition absolument nécessaire aurait été adoptée. Malheureusement, tel n’a pas été le cas.
Cela étant, je suis quelque peu étonné que réapparaisse aujourd'hui ce culte du vote conforme, que j’ai connu en d’autres temps.

Il y a des circonstances de toute nature, madame Assassi, vous le savez bien !

Vous me donnerez acte que je me suis souvent exprimé sur le vote conforme.
Je pense qu’il eût été possible d’améliorer le présent texte en reprenant certaines des dispositions de la proposition de loi organique Patriat-Badinter.

Certaines ont été reprises, pas toutes ! Je vais vous en donner l’illustration, ce qui sera une sorte de prélude aux excellents amendements de notre collègue Alain Anziani, dont je ne doute pas qu’il les défendra avec la compétence, la fougue et l’ardeur que nous lui connaissons.
D’abord, pour ce qui est de la procédure d’inscription et d’examen de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour, il me semble utile de considérer que son inscription à l’ordre du jour est de droit. Et je ne vois pas ce qu’apporterait le passage de cette proposition de résolution devant une commission, fût-elle la commission des lois, pour laquelle, monsieur Bas, j’ai un considérable respect.
Ensuite, pour ce qui est de la composition de la commission chargée de recueillir toutes informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour, il est proposé de reprendre un dispositif issu de l’Assemblée nationale selon lequel cette commission est composée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat. Ce n’est pas satisfaisant : comme il y a huit vice-présidents du Sénat, il faudra choisir parmi eux pour en désigner six.
De plus, comme le règlement du Sénat permet de constituer des groupes comptant au moins dix sénateurs, le dispositif prévu par le projet de loi organique ne garantit pas que tous les groupes soient représentés au sein de la commission parlementaire ad hoc. J’ai d’ailleurs écouté attentivement les propos de Mme Éliane Assassi sur ce sujet.
Monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, j’y insiste, un dispositif a été adopté très largement par le Sénat, dont la commission des lois avait émis un vote unanime. Il prévoyait dix représentants du Sénat et dix représentants de l’Assemblée nationale, de sorte que tous les groupes étaient nécessairement représentés. La proposition de loi organique Patriat-Badinter adoptée par le Sénat présente quand même une supériorité sur le texte que vous nous soumettez !
Vous pourrez invoquer – j’ignore si vous le ferez – ce qu’a décidé l’Assemblée nationale, travail auquel a contribué mon collègue et ami, Jean-Jacques Urvoas. Je le sais quelquefois très bien inspiré, parfois légèrement moins, et je le dis en toute amitié.
Dans le texte que vous allez nous demander de voter, il est écrit : « La composition de la commission s’efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée. » L’emploi dans un projet de loi de ce verbe « s’efforce » me paraît étrange, car il est peu normatif.
Je le vois bien, monsieur le secrétaire d'État, cela vous contrarie aussi ! Or il eût été tellement simple, monsieur le rapporteur, pour le fin connaisseur du droit constitutionnel et du droit en général que vous êtes, de choisir qu’il y eût dix représentants de l’Assemblée nationale et dix représentants du Sénat. Ainsi, de ce fait, toutes les formations politiques, tous les groupes politiques eussent été derechef associés !
Enfin, troisième et dernier point, dans la proposition qui nous est faite, il n’est pas possible pour la commission d’entendre le Président de la République à la demande soit de la commission elle-même, soit du chef de l’État lui-même. Mes chers collègues, quelqu’un dans cette enceinte peut-il justifier cela ?
Si l’on parle de la destitution du Président de la République, n’est-il quand même pas juste, en vertu de toutes les règles du droit que vous connaissez parfaitement, que celui-ci puisse être entendu ?
De même, il est prévu, dans le texte qui nous est soumis, qu’il puisse se faire représenter. Ne pensez-vous pas que, dans de telles circonstances, il serait plus judicieux que le Président de la République aille lui-même s’expliquer devant l’instance qui devra prendre ou préparer la décision ?
Par ces quelques remarques, je souhaitais dire qu’il était possible d’adopter un texte qui soit encore meilleur.
Cela étant, les membres de mon groupe voteront en faveur du présent projet de loi organique, Alain Anziani l’a dit avec talent. Mais il est dommage de se priver des apports de la proposition de loi organique Patriat-Badinter. Nous serons donc tous satisfaits, quoique nous eussions pu l’être davantage, que le dernier texte d’application de la révision constitutionnelle issue du vote de 2008 fût enfin adopté. §
L’ensemble des intervenants ont évoqué la nécessité de permettre, enfin, l’entrée en application de l’article 68 de la Constitution. Notre discussion rétablira ainsi l’équilibre, en donnant tout son sens au statut juridique du chef de l’État tel qu’il est défini par la révision constitutionnelle du 23 février 2007, prévoyant la protection de la fonction présidentielle, d’un côté, et un mécanisme de destitution en cas de manquement du Président de la République à ses devoirs, de l’autre.
Les orateurs qui connaissent, et même très bien – n’est-ce pas, monsieur Mercier ? –, le texte que nous examinons ce soir ont relevé que celui-ci avait été inscrit à l’ordre du jour du Sénat avant que la proposition de loi sénatoriale ne le soit à celui de l’Assemblée nationale. Le Gouvernement le constate et ne peut pas interférer à ce niveau, en tout cas s’agissant du groupe concerné.
À cet égard, il me semble que le président Mézard a trouvé les mots justes. Dans le très long cheminement de la mise en application de l’article 68 de la Constitution, les torts sont évidemment partagés. Permettez-moi d’ajouter, presque en forme d’hommage, que, en cette matière des modalités d’examen au Parlement d’une proposition de réunion de la Haute Cour, il est finalement logique que les assemblées aient repris la main. Dont acte !
Le Sénat fait en l’espèce un usage pertinent de la semaine d’ordre du jour dont il a la maîtrise, et nous allons ainsi pouvoir avancer.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
(Non modifié)
La décision de réunir la Haute Cour résulte de l’adoption d’une proposition de résolution par les deux assemblées du Parlement, dans les conditions fixées par l’article 68 de la Constitution.
La proposition de résolution est motivée. Elle justifie des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l’article 68 de la Constitution. Elle est signée par au moins un dixième des membres de l’assemblée devant laquelle elle est déposée.
Un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour au cours du même mandat présidentiel.
La proposition de résolution est communiquée sans délai par le Président de cette assemblée au Président de la République et au Premier ministre.
Aucun amendement n’est recevable à aucun stade de son examen dans l’une ou l’autre assemblée.
L’examen de la proposition de résolution ne peut faire l’objet de plus d’une lecture dans chaque assemblée.

L’amendement n° 10, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 2, dernière phrase
Après le mot :
membres
insérer les mots :
ou par un groupe parlementaire
La parole est à Mme Éliane Assassi.

L’article 51-1 de la Constitution reconnaît explicitement l’existence des groupes d’opposition et des groupes minoritaires ; par là même, le statut des groupes parlementaires est élevé au rang constitutionnel.
Le Sénat, lors de la première lecture du texte portant révision constitutionnelle, avait accepté l’une de nos propositions, laquelle tendait à accorder aux groupes parlementaires le droit de saisine du Conseil constitutionnel. La majorité de l’époque, qui ressemblait étrangement à celle d’aujourd’hui, avait reculé in fine, et cette avancée démocratique a été abandonnée. Ainsi, un simple citoyen peut saisir le Conseil constitutionnel par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité et contester, même a posteriori, une loi, alors qu’un groupe parlementaire, institution à la compétence constitutionnelle, ne peut le faire.
La problématique est la même dans le cas qui nous intéresse aujourd’hui. Pourquoi trente-quatre sénateurs pourraient-ils déclencher une procédure de destitution, alors que les groupes parlementaires ne le pourraient pas ?
Chacun peut le reconnaître, nous sommes dans le cadre d’une mise en œuvre de la responsabilité politique du chef de l’État. Il paraîtrait donc logique que la première institution politique des assemblées, les groupes politiques, puisse déposer une proposition de résolution tendant à la destitution du chef de l’État.
Enfin, le présent amendement vise à faire respecter le pluralisme.
La démocratie est une question non de nombre, mais de respect du débat d’idées. Le seuil d’un dixième des membres d’une assemblée parlementaire pour déclencher une procédure est institué pour prévenir une forme d’irresponsabilité ou d’utilisation malveillante de la procédure.
Pour ce qui me concerne, je considère que les groupes parlementaires, de par leur statut, apportent toutes les garanties au sérieux du processus de destitution.

M. Hugues Portelli, rapporteur. La commission Avril avait proposé cette procédure pour une raison très simple : c’était celle qui était prévue jadis dans les règlements du Sénat et de l’Assemblée nationale pour les propositions de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice.
M. Jean-Jacques Hyest opine.
Dans un domaine de nature très constitutionnelle et nécessitant beaucoup de précautions du point de vue de l’unité de la nation, accorder le droit de déposer une proposition de résolution aux groupes politiques pourrait donner une idée fausse de ce dont il s’agit.
Qui plus est, nous pensons qu’il est nécessaire qu’un nombre minimal de parlementaires signent la proposition de résolution, pour éviter le dépôt trop fréquent de tels textes.
Pour constituer un groupe au Sénat, il faut dix sénateurs. Si nous vous suivions, madame Assassi, presque trente propositions de résolution pourraient être déposées en cinq ans, chacune d’entre elles devant être inscrite à l’ordre du jour. Voilà pour l’aspect procédural.
De plus, la philosophie du texte dont nous débattons s’inscrit non pas dans la logique propre d’un groupe parlementaire, mais, d’une façon plus générale, dans la logique du travail des parlementaires devant des cas qui ne sont pas d’ordre politique, mais qui ressortent du fonctionnement des institutions de la République.
Outre les problèmes techniques que son adoption poserait, cet amendement me semble être un facteur de politisation. Je propose donc que nous en restions au seuil d’un dixième des parlementaires, lequel avait été retenu par le Sénat au mois de novembre 2011.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er est adopté.
(Non modifié)
Le Bureau de l’assemblée devant laquelle la proposition de résolution a été déposée vérifie sa recevabilité au regard des conditions posées à l’article 1er.
Si le Bureau constate que ces conditions ne sont pas réunies, la proposition de résolution ne peut être mise en discussion.
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet. Sans préjudice des dispositions de l’article 48 de la Constitution, la proposition de résolution est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard le treizième jour suivant les conclusions de la commission. Le vote intervient au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l’application des deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa, l’inscription à l’ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.

L’amendement n° 1, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Si le Bureau constate que ces conditions sont réunies, la proposition de résolution est inscrite de droit à l’ordre du jour de l’assemblée concernée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours à compter du dépôt de cette proposition.
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
des deux dernières phrases de l’avant-dernier alinéa
par les mots :
de l’alinéa précédent
La parole est à M. Alain Anziani.

Il s’agit d’un amendement de simplification.
Nous ne parlons pas en l’espèce de procédure législative, et il n’y a pas de possibilité de déposer des amendements. Dès l’instant que le bureau a vérifié la recevabilité de la proposition de résolution, il me semble donc beaucoup plus simple et rapide qu’il puisse faire inscrire de droit cette proposition à l’ordre du jour, sans qu’il faille en passer par la commission permanente, c’est-à-dire la commission des lois.

La commission a émis un avis défavorable, pour deux raisons.
Dans la rédaction initiale du projet de loi organique présentée à l’Assemblée nationale, la commission compétente en matière de lois constitutionnelles disposait d’un véritable droit de veto sur le texte, puisqu’elle pouvait rejeter celui-ci.
Les députés ont estimé, suivant ainsi leur commission des lois, qu’une telle disposition ne pouvait pas être introduite, car elle n’était pas prévue par l’article 68 de la Constitution.
Par ailleurs, à partir du moment où un texte est soumis à l’une des assemblées et que celui-ci est motivé, il est normal que la commission compétente donne son expertise à cet égard, ainsi qu’un avis, simple, que l’assemblée est tout à fait libre de suivre ou non.
L’amendement de M. Anziani présente l’avantage d’assurer un examen rapide de la proposition de résolution par la première assemblée saisie. Mais, dans le même temps, il prive le Sénat ou l’Assemblée nationale de l’expertise, pourtant utile, de la commission des lois.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 2 est adopté.
(Non modifié)
La proposition de résolution adoptée par une assemblée est immédiatement transmise à l’autre assemblée. Elle est envoyée pour examen à la commission permanente compétente en matière de lois constitutionnelles, qui conclut à son adoption ou à son rejet.
La proposition de résolution est inscrite de droit à l’ordre du jour de l’assemblée au plus tard le treizième jour suivant sa transmission. Le vote intervient de droit au plus tard le quinzième jour.
Lorsque la clôture de la session du Parlement fait obstacle à l’application du deuxième alinéa, l’inscription à l’ordre du jour intervient au plus tard le premier jour de la session ordinaire suivante.

L’amendement n° 3, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 1, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Alain Anziani.

La commission émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons que celles j’ai exposées précédemment.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, également pour les mêmes raisons.
L'amendement n'est pas adopté.

L’amendement n° 2, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le vote des assemblées sur la proposition de résolution tendant la réunion de la Haute Cour fait l’objet d’un scrutin public.
La parole est à M. Alain Anziani.

À l’Assemblée nationale, le vote sur la proposition de résolution tendant à réunir la Haute Cour fait obligatoirement l’objet d’un scrutin public. Ce n’est pas le cas au Sénat. Or, à l’occasion de ce type de vote, chacun doit assumer sa responsabilité, c’est-à-dire exprimer publiquement son vote.
Je pense que l’ensemble du Sénat sera d’accord pour adopter ce principe de responsabilité.

Le vote par scrutin public est déjà de règle pour le vote de projets de loi organiques. L’avis est donc défavorable.
Sur cet amendement qui concerne le fonctionnement du Sénat, le Gouvernement émet un avis de sagesse.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 3 est adopté.
(Non modifié)
Le rejet de la proposition de résolution par l’une des deux assemblées met un terme à la procédure. –
Adopté.
(Non modifié)
Lorsqu’une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour a été adoptée par chacune des assemblées, le Bureau de la Haute Cour se réunit aussitôt.
Le Bureau de la Haute Cour est composé de vingt-deux membres désignés, en leur sein et en nombre égal, par le Bureau de l’Assemblée nationale et par celui du Sénat, en s’efforçant de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
Il est présidé par le Président de la Haute Cour.
Le Bureau prend les dispositions nécessaires pour organiser les travaux de la Haute Cour.

L’amendement n° 4, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le Bureau organise les conditions du débat et du vote et prend toute décision qu’il juge utile à l’application de l’article 68 de la Constitution.
La parole est à M. Alain Anziani.

Le présent amendement vise à préciser et à élargir le champ des attributions du bureau de la Haute Cour.

Cet amendement est satisfait par le quatrième alinéa du présent article. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
Il peut sembler utile de compléter les dispositions du projet de loi organique pour garantir que le bureau dispose de toutes les marges de manœuvre dont il a besoin dans les circonstances graves et exceptionnelles qui justifient la réunion de la Haute Cour. Il me paraît en effet judicieux de préserver une certaine souplesse et de ne pas insulter l’avenir.
J’émets donc un avis de sagesse enthousiaste. §
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
Une commission constituée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat est chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. La composition de la commission s’efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée.
La commission dispose des prérogatives reconnues aux commissions d’enquête aux II à IV de l’article 6 de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dans les mêmes limites que celles fixées au deuxième alinéa de l’article 67 de la Constitution.
Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
La commission élabore, dans les quinze jours suivant l’adoption de la résolution, un rapport qui est distribué aux membres de la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 5, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
Une commission constituée de vingt membres est chargée de recueillir toute information nécessaire à l’accomplissement de sa mission par la Haute Cour. Ses membres sont élus, selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, dans le respect du pluralisme des groupes, en leur sein et en nombre égal, par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Elle élit parmi ses membres son président et désigne un rapporteur.
La parole est à M. Alain Anziani.

Il s’agit à la fois d’un amendement d’affirmation du Sénat et de cohérence par rapport au principe de représentativité politique qui figure dans le texte.
Le projet de loi organique prévoit une commission parlementaire ad hoc composée de six vice-présidents de l’Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat. Mais il y a un hic : la composition du bureau du Sénat diffère de celle du bureau de l’Assemblée nationale.
Par conséquent, si nous voulons affirmer la singularité du Sénat, il faut modifier cette disposition et prévoir que la commission comprendra vingt membres. Qui plus est, cela permettra d’assurer la représentativité politique, car, avec six vice-présidents pour l'Assemblée nationale et six vice-présidents pour le Sénat, il n’est pas du tout certain que tous les groupes puissent être représentés. Or le texte lui-même se fixe cet objectif.

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
six vice-présidents de l'Assemblée nationale et de six vice-présidents du Sénat
par les mots :
dix membres du Bureau de l’Assemblée nationale et de dix membres du Bureau du Sénat
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Cet amendement va dans le même sens.
Nous proposons de remplacer les vice-présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat par dix membres du bureau de l’Assemblée nationale et dix membres du bureau du Sénat. Il nous semble en effet qu’une telle disposition permettra de garantir au mieux le pluralisme au sein de ce qui constituera de fait une véritable commission d’instruction.
Aux termes de l’article 5 d’ailleurs, « la composition de la commission s’efforce de reproduire la configuration politique de chaque assemblée ». Le passage à vingt membres permettra de s’approcher de cet objectif. Il n’est qu’à voir la composition de la Cour de justice de la République : six sénateurs en font partie et, de fait, les groupes minoritaires au sein de cette instance ne sont pas représentés.
Par conséquent, si l’on souhaite réellement que l’article 5 prenne toute sa force et ne reste pas un vœu pieux, il faut étendre la composition de la commission à dix membres par assemblée.

La commission émet un avis défavorable.
Je rappelle que la commission visée à l’article 5 doit travailler et se prononcer dans des délais extrêmement restreints. Il s’agit donc d’une structure qui doit faire preuve d’efficacité et de rapidité. De fait, son effectif doit être limité. Ce n’est pas une commission parlementaire traditionnelle.
Par ailleurs, l’article 5 prévoit déjà que sa composition doit respecter le pluralisme politique des assemblées.
Enfin, rappelons que les députés, tout en respectant le bicamérisme, veillent à ce que les effectifs des structures paritaires n’augmentent pas excessivement.
La question du pluralisme est évidemment importante et, de ce point de vue, l’amendement n° 5 me semble mieux y répondre que l’amendement n° 11. J’entends toutefois l’argument de M. le rapporteur.
Néanmoins, comme il juge toujours très délicat d’intervenir dans le fonctionnement des assemblées, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l’amendement n° 5.

Monsieur le rapporteur, je m’interroge sur les arguments que vous venez d’avancer, notamment sur ceux qui sont relatifs à l’efficacité et à la rapidité.
Perd-on de l’efficacité quand on assure le pluralisme ? Si oui, disons-le clairement et mettons un frein à cette tendance.
Ne gagne-t-on pas, y compris en rapidité – je ne parle pas de la rapidité à court terme –, en assurant justement la représentation la plus pluraliste possible ?
Il ne faut pas à mon sens faire de raccourcis. Que vous émettiez un avis défavorable sur ces deux amendements, je veux bien le concevoir. En revanche, je ne partage pas votre argument selon lequel augmenter légèrement le nombre des membres de cette commission et assurer un véritable pluralisme sur des enjeux de cette taille, qui concernent le Président de la République, ne seront pas un gage d’efficacité, de rapidité et de qualité pour cette instance.

Monsieur le rapporteur, je reste moi aussi sur ma faim après avoir entendu vos explications.
Certes, je comprends que votre mandat consiste à parvenir à un vote conforme de ce projet de loi organique. Pour autant, je ne suis pas convaincu par les arguments que vous venez d’avancer.
D’abord, comme Cécile Cukierman, je pense que soutenir ici, au Sénat, qu’une instance de douze membres est plus rapide et plus efficace qu’une instance de vingt membres est quelque peu paradoxal. Cet après-midi, nous avons travaillé de manière extrêmement sérieuse sur le projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

Combien de membres de la commission spéciale étaient présents ? Peut-être une quarantaine.

Personne ne peut défendre une telle position, sauf à avancer de nouveaux arguments, mais je pense que M. Hyest en a trouvé et nous allons l’entendre avec intérêt. §
Ensuite, monsieur le rapporteur, vous affirmez que l’Assemblée nationale est attachée au bicamérisme. Je veux bien le croire, mais confortons le bicamérisme en jouant pleinement notre rôle dans l’élaboration du présent texte.
Enfin, selon vous, avec douze membres, on pourra garantir le pluralisme. J’ai rappelé tout à l’heure la présence d’un verbe tout à fait singulier dans un texte normatif, puisqu’il est précisé que l’on « s’efforce » de représenter les différents groupes.

Si on multiplie dans la loi les assertions telles que « on fera en sorte que », « on fera tous nos efforts pour que », « on tendra à ce que », « on s’efforcera à ce que », la législation deviendra floue. D’ailleurs, le Conseil d’État s’est interrogé sur cette tendance dans un récent rapport.
À mon sens, de nombreux arguments plaident en faveur de l’amendement n° 5 : une commission de vingt membres – dix par assemblée – permettra la parité entre les assemblées et, à coup sûr, la représentation de tous les groupes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Mon cher collègue, ce matin s’est réunie une commission mixte paritaire, instance composée de sept députés et de sept sénateurs et chargée – vous savez à quel point c’est important – de proposer un texte commun sur des dispositions restant en discussion d’un projet de loi ou d’une proposition de loi. Cela prouve donc bien que l’on peut travailler avec un effectif plus faible. Certes, certains groupes ne sont pas représentés ou le sont par le biais des suppléants, mais ceux-ci ne votent pas. Cela ne signifie nullement qu’ils ne participent pas au débat. Je rappelle qu’il s’agit uniquement d’un travail préalable de commission ! Le Parlement se prononce ensuite sur les conclusions.
J’en reviens au texte qui nous occupe. Préciser que l’on doit veiller à une représentation équilibrée de chaque sensibilité politique suffit. Cela figure d’ailleurs déjà dans un certain nombre de textes. C’est pourquoi je pense qu’il faut s’en tenir au texte de l’Assemblée nationale.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 6, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission.
La parole est à M. Alain Anziani.

J’ai envie de faire un appel au bon sens.
Je rappelle la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article 5 : « Sur sa demande, le Président de la République ou son représentant est entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix. »
Nous sommes dans l’hypothèse où le Président de la République fait l’objet d’une procédure, parce qu’il a manqué à ses obligations de façon suffisamment nette pour que cela devienne incompatible avec sa fonction.
S’il s’agissait d’une procédure juridictionnelle, nous dirions que le Président de la République est accusé ou qu’il est mis en examen. En l’occurrence, nous ne pouvons employer ces termes.

En l’espèce, le Président de la République est mis en cause de façon forte par un acte motivé et recevable, puisque le bureau l’a jugé tel.
La situation devient ensuite tout à fait extraordinaire. Alors que le Président de la République fait l’objet de cette procédure, ceux qui vont devoir le « juger » et déterminer si oui ou non il est véritablement responsable n’ont pas le droit de lui poser la moindre question. Cette commission, c’est la Grande Muette !
C’est tout bonnement invraisemblable ! Comment concevoir que le Président de la République puisse vouloir être entendu – il peut l’être à sa demande –, mais que ceux qui vont le juger et décider n’aient pas le droit de l’entendre ?
Pour ma part, je n’arrive pas à comprendre la cohérence ce dispositif.

Ce sera pareil, puisque, comme nous le verrons dans quelques instants, le Président de la République pourra se faire représenter !
Par conséquent, et c’est un appel au bon sens, je le répète, il faut faire en sorte que la commission puisse entendre le Président de la République. C’est le minimum. Sinon, je le répète également, les membres de cette commission auront devant eux le grand absent, la personne qui n’existe pas dans la procédure, un fantôme de Président de la République. Comment avoir alors un débat franc sur des faits qui, par définition, sont graves et qui donneront évidemment lieu à une crise de la République ? Or, dans une telle situation, il est normal que la République puisse entendre le Président de la République.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Anziani devrait envisager la situation du point de vue du Président de la République. Lorsqu’une telle procédure démarre, celui-ci exerce pleinement ses fonctions de chef de l’État. Une commission commence alors à enquêter ; elle doit d’ailleurs le faire dans des délais très brefs.
Le Président de la République a-t-il intérêt à comparaître et à se défendre devant cette commission ? C’est à lui d’apprécier. Il peut avoir d’excellentes raisons de s’y refuser. Il faut donc lui laisser la liberté de choisir.
Certains l’accusent d’avoir commis une forfaiture, un acte grave. Encore faut-il que ce fait soit prouvé. C’est justement le rôle de la commission que de recueillir les informations nécessaires à cette fin et le Président de la République peut très bien se contenter d’envoyer un représentant, qui parlera en son nom. En tant que chef de l’État en fonction, il n’est peut-être pas obligé de se commettre immédiatement devant une telle commission.
J’entends tout à fait la spontanéité de votre demande, monsieur Anziani, qui semble compréhensible au premier abord.
Je reprendrai cependant l’argumentation du rapporteur, avec une nuance importante toutefois. En effet, ce n’est pas parce que c’est le Président de la République que je défends la possibilité qu’il puisse ne pas se présenter devant la commission, mais c’est parce qu’il est en posture d’accusé, ce qui n’est pas la même chose. En d’autres termes, ce n’est pas son statut de Président de la République qui justifie une telle faculté, c’est parce qu’il est accusé et peut, à ce titre, avoir la stratégie de défense qu’il souhaite, d’autant que nous ne sommes plus dans une situation où il peut y avoir confusion avec le juridictionnel.
Votre raisonnement est tellement naturel, monsieur Anziani, que, pour dire les choses comme elles sont, dans beaucoup de cas, l’absence du Président de la République ne plaidera pas en sa faveur. A contrario, il pourra choisir d’être présent. Tout cela relèvera de sa liberté. Voilà quel est mon sentiment.
Cela dit, on peut aussi comprendre l’intérêt qu’il y aurait à ce que le Président de la République ne soit pas sans arrêt mis en cause si ce type d’attaques devait se multiplier. Cependant, pour l’heure, et sans préjuger les évolutions à venir, ces mœurs politiques ne sont pas les nôtres.
Dans ces conditions, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Monsieur le président, je comprends que l’on veuille faire aboutir ce texte ce soir, en obtenant de la Haute Assemblée un vote conforme.
Toutefois, je pense que repousser, comme la majorité du Sénat vient de le faire, les derniers amendements ne participe pas d’une justice sereine et éclairée.

Le sujet est grave : ce n’est quand même pas tous les jours que l’on aura à juger un Président de la République pour décider ou non de sa destitution !

J’espère, d'ailleurs, que cela n’arrivera jamais.
Premièrement, le fait que tous les groupes politiques ne puissent pas être représentés dans les instances de jugement ne me paraît pas être un élément de sérénité.
Deuxièmement, indépendamment de la stratégie choisie par l’accusé, il me semble être de l’intérêt de la justice qu’elle puisse être parfaitement éclairée. Je pense que la meilleure façon de le lui permettre est de l’autoriser à poser des questions à celui qui est mis en cause.
Dès lors, je ne comprends pas que, dans une situation aussi grave, on puisse envisager que le Président de la République n’aurait qu’à se faire représenter s’il ne veut pas se rendre devant la commission. Je trouve que c’est abaisser complètement l’institution que l’on est en train de créer. Pour juger si le Président de la République peut continuer ou non à exercer ses fonctions, ce qui n’est quand même pas rien, il faut une institution de justice très forte et très sereine.
C’est pourquoi il me semble important d’affirmer que le Président de la République mis en cause doit effectivement se présenter si la commission veut l’entendre, à partir du moment où les délibérations pourront aboutir à une décision, extrêmement grave, de destitution.
Je voterai donc l’amendement présenté par M. Anziani.

Je veux simplement rappeler que, à ce moment de la procédure, une proposition de résolution aura déjà été jugée recevable par le bureau de l’une des deux chambres et votée, au-delà des majorités partisanes, par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Puisque la procédure aura été jugée sérieuse par les deux chambres du Parlement, à la majorité des deux tiers, qui pourra dire qu’elle est fantaisiste, qu’elle ne repose sur rien et qu’elle est humiliante ? Et pourquoi, dans ces conditions, s’empêcher de demander des comptes à celui qui a été mis en cause ? Je n’arrive toujours pas à le comprendre. Le bon sens voudrait que l’on puisse entendre le Président de la République !

J’ai l’impression que les explications données par les défenseurs de cet amendement ne correspondent pas à la rédaction de celui-ci.
Il est demandé que le Président de la République puisse, en quelque sorte, être convoqué par la commission. Néanmoins, le présent amendement prévoit seulement : « Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission. »
Je reconnais que cette rédaction est ambiguë, parce qu’elle pourrait laisser supposer une obligation. En tout état de cause, les propos qui ont été tenus ne sont, eux, pas ambigus : leurs auteurs estiment que la commission devrait pouvoir réellement entendre le Président de la République et, même, que celui-ci ne pourrait pas se faire représenter.

Or, d’une part, ce n’est pas ce que signifie la rédaction actuelle de l’amendement. D’autre part, ce serait tout à fait contraire à la Constitution elle-même, car nulle contrainte par corps ne pourrait être exercée sur un Président de la République qui refuserait d’être entendu par la commission parlementaire. Le Président de la République exerce pleinement sa fonction jusqu’au moment où il est destitué, s’il est destitué.
Par conséquent, il ne me semble pas possible de prévoir, dans le texte, une obligation, pour le Président de la République, de se présenter en personne. Au demeurant, si l’amendement ne vise pas à instaurer une telle obligation, c’est qu’il est rédigé de manière quelque peu ambiguë : l’utilisation du verbe « pouvoir » laisse supposer que c’est une simple faculté qui est ouverte… Mais, dans le même temps, dans la rédaction actuelle, on peut penser, au fond, que, si le Président de la République demande à être entendu, la commission ne peut le lui refuser, et que, si la commission demande à l’entendre, le Président de la République ne peut pas non plus le refuser.

Entre demander et exercer une contrainte par corps, il y a une différence !

Je crois donc que l’adoption de cet amendement poserait, en réalité, beaucoup plus de problèmes qu’elle n’en résoudrait et que vouloir empêcher le Président de la République d’être représenté par quelqu’un qui pourrait exposer des arguments en faveur de sa non-destitution, c’est le priver d’un moyen de se faire comprendre par la commission.
Eu égard à son ambiguïté et au risque d’inconstitutionnalité de son dispositif, il me paraît y avoir de nombreuses raisons de rejeter cet amendement !
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 7, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le rapporteur établit, dans les quinze jours suivant l’adoption de la résolution, un rapport écrit qu’il soumet à la commission. Après approbation de la commission, ce rapport est transmis à la Haute Cour, communiqué au Président de la République et au Premier ministre et rendu public.
La parole est à M. Alain Anziani.

Cet amendement a une ambition plus modeste que le précédent. Il tire simplement les conséquences de la désignation d’un rapporteur au sein de la commission.

La commission a estimé qu’il appartenait au bureau de la Haute Cour de prévoir ce genre de dispositions.
Par conséquent, son avis est défavorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 5 est adopté.
(Non modifié)
Les débats de la Haute Cour sont publics.
Outre les membres de la Haute Cour, peuvent seuls y prendre part le Président de la République et le Premier ministre.
Le temps de parole est limité, dans des conditions fixées par le Bureau de la Haute Cour. Le Président de la République peut prendre ou reprendre la parole en dernier.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, le Président de la République peut, à tout moment, se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
Le vote doit commencer au plus tard quarante-huit heures après l’ouverture des débats.
La Haute Cour est dessaisie si elle n’a pas statué dans le délai d’un mois prévu au troisième alinéa de l’article 68 de la Constitution.

L'amendement n° 8, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Alain Anziani.

Nous venons d’évoquer le bureau de la Haute Cour, en convenant qu’il fallait lui octroyer un certain nombre de pouvoirs.
Dans cet ordre d’idées, le présent amendement tend à donner au bureau, et à lui seul, le pouvoir de fixer le temps des débats devant la Haute Cour.

Le texte prévoyant que la Haute Cour n’a que quarante-huit heures pour délibérer, il est peut-être préférable de limiter la durée des interventions.
L’avis de la commission est donc défavorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 9, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
ou représenter
La parole est à M. Alain Anziani.

Cet amendement procède de la même inspiration que celui qui a donné lieu à débat tout à l'heure.
J’insiste sur le point que nous avions alors évoqué : l’article 68 de la Constitution laisse-t-il place à l’hypothèse que le Président de la République n’est pas entendu personnellement par la Haute Cour ? Rien, ni dans le texte de cet article ni dans les autres dispositions de la Constitution, ne laisse imaginer que le Président de la République puisse ne pas être interrogé personnellement par la Haute Cour.
C’est donc nous qui allons préciser, au travers du projet de loi organique, que le Président de la République peut ne pas venir et qu’il peut demander à Mme Unetelle ou à M. Untel de bien vouloir le représenter. Le débat aura alors lieu entre, d’un côté, la Haute Cour, saisie de charges certainement importantes – je le rappelle, une majorité des deux tiers aura estimé la procédure sérieuse –, et, de l’autre, Mme Unetelle ou M. Untel. Pendant ce temps, le Président de la République pourra, finalement, se désengager. Or il est évident que, dès lors qu’il a manqué à ses obligations, il doit lui-même venir s’en expliquer !
Imaginons que, dans les procédures d’impeachment qui ont été engagées aux États-Unis, les présidents n’aient pu être entendus directement. Je pense que chacun d’entre nous se serait étonné d’une telle procédure ! Pourtant, c’est cette procédure que nous proposons d’instaurer pour notre propre République. Je trouve qu’elle n’est pas du tout convenable.

La commission émet un avis défavorable.
Je rappelle que la procédure que nous instituons n’est pas judiciaire. Dès lors, la comparaison avec le système américain de l’impeachment, qui est une procédure judiciaire, ne vaut pas.
Lorsque le Sénat des États-Unis se transforme en Haute Cour pour juger le président américain, il est présidé par le président de la Cour suprême fédérale. On est vraiment dans une procédure judiciaire. Le cas dont nous débattons ce jour est très différent. D’ailleurs, l’article 68 de la Constitution ne dit absolument rien sur ce point.
Au reste, de manière intéressante, le projet de loi organique prévoit que le Président de la République peut intervenir à plusieurs reprises et qu’il a le dernier mot. Dans ces conditions, même si la procédure est ramassée dans le temps, le Président de la République peut très bien ne pas être présent en permanence et se faire représenter.
Bien entendu, s’il juge qu’il a tout intérêt à s’exprimer, il le fera ! Cependant, il n’est pas cité à comparaître. Il lui appartiendra d’apprécier librement si son intérêt politique et personnel est d’assister en permanence aux travaux de la commission ou pas.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat, pour les raisons que j’ai déjà explicitées.

Je dois le dire, je suis quelque peu étonné par les propos de M. le rapporteur relatifs à la prise en compte de l’intérêt de la personne mise en accusation.
La représentation nationale est là pour défendre l’intérêt du peuple ! Sans cela, elle ne représente plus la nation. Dès lors, un problème fondamental se pose : doit-on comprendre de vos propos, monsieur le rapporteur, que le Président de la République est, d’une certaine manière, au-dessus des autres citoyens et que, mis en cause, il est libre de faire ce qu’il veut ?
Je rappelle que la décision de faire siéger la Haute Cour n’a pas été prise dans n’importe quelles conditions : elle émane des deux tiers, au moins, des membres du Sénat et des deux tiers, au moins, des membres de l’Assemblée nationale, donc de plus des deux tiers de la représentation nationale prise dans son ensemble. Comment envisager que celle-ci n’ait pas le droit de défendre les intérêts de la nation ? Si elle saisit la juridiction en vue d’une mise en cause, d’un jugement, voire d’une destitution du Président de la République, c’est bien parce que le comportement du chef de l’État pose un problème, et ce au regard du peuple de France.
Par conséquent, je ne comprends pas !
Monsieur le rapporteur, est-ce à dire que le Président de la République est une sorte de « monarque républicain », placé au-dessus de la loi, et que la représentation nationale doit se contenter d’un rôle quelque peu réduit ? Je ne suis pas de cet avis ! Rien, me semble-t-il, n’est au-dessus de la représentation nationale et du suffrage universel dans une république !

Je remercie M. Néri d’avoir suivi le débat de A à Z. Il a tout compris !
Monsieur Anziani, on ne peut pas contraindre le Président de la République à se présenter. C’est impossible dans la mesure où, vous le savez très bien, il existe un principe d’inviolabilité. Quant à lui interdire de se faire représenter, cela me paraît constituer, d’une certaine manière, une atteinte aux droits de la défense.
C’est une forme d’équilibre qui est installée en laissant la liberté de venir ou de ne pas venir, de se faire représenter ou pas au Président de la République qui, à ce stade, serait mis en cause. D’ailleurs, mieux vaut ne pas dire « accusé » – si l’on commence à employer des termes tirés de procédures judiciaires alors qu’il est question de tout autre chose… – et veiller aux mots que l’on utilise. Que certains m’excusent, mais, vraiment, il ne faut pas dire n’importe quoi !
Donc, croyez-vous qu’interdire au Président de la République de se faire représenter soit respectueux des droits de la défense ? En revanche, celui-ci aura tout intérêt à se présenter, s’il le souhaite évidemment, devant la commission ou devant la Haute Cour.
Le dispositif est selon moi équilibré, et je remercie M. Anziani d’avoir contribué à éclaircir le débat !
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 est adopté.
(Non modifié)
L’ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice est abrogée. –
Adopté.

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi organique portant application de l’article 68 de la Constitution dans le texte de la commission.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 22 octobre 2014, de quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
- Proposition de loi autorisant l’accord local de représentation des communes membres d’une communauté de communes ou d’agglomération (n° 782, 2013-2014) ;
Rapport de Mme Catherine Troendlé, fait au nom de la commission des lois (n° 33, 2014-2015) ;
Texte de la commission (n° 34, 2014-2015).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.