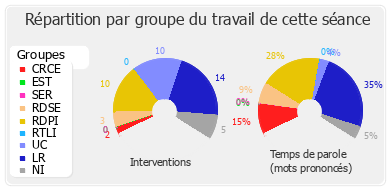Séance en hémicycle du 22 juin 2015 à 16h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi
- Candidature à une commission
- Renvoi pour avis unique
- Dialogue social et emploi (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à seize heures cinq.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 18 juin 2015 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

En application de l’article 45, alinéa 2, de la Constitution, le Gouvernement a engagé la procédure accélérée pour l’examen du projet de loi relatif au droit des étrangers en France, déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale le 23 juillet 2014.

J’informe le Sénat que le groupe Les Républicains a fait connaître à la présidence le nom du candidat qu’il propose pour siéger à la commission des affaires européennes, en remplacement de M. Jean-René Lecerf, démissionnaire de son mandat de sénateur.
Cette candidature a été publiée et la nomination aura lieu conformément à l’article 8 du règlement.

J’informe le Sénat que le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense (n° 494, 2014-2015), dont la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est saisie au fond, est envoyé pour avis, à sa demande, à la commission des finances.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et à l’emploi (projet n° 476, texte de la commission n° 502, rapport n° 501, avis n° 490 et 493).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

Monsieur le président, madame la rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, il m’est agréable de me trouver devant vous pour vous présenter le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. Ma collègue Marisol Touraine abordera, dans quelques instants, les dispositions de ce texte qui se rapportent à la création de la prime d’activité ; je traiterai donc de ses autres aspects.
Ce projet de loi répond à deux exigences : il vise, sur le plan de la démocratie, à développer notre démocratie sociale et, sur le plan de l’efficacité économique, à instaurer un cadre favorable à l’emploi. Il comporte à mon sens de vrais progrès sociaux, tant pour les salariés que pour les employeurs.
Le premier de ces progrès consiste en un dialogue social revivifié et plus vivant.
« Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. » Tel est le principe, énoncé dans le préambule de la Constitution de 1946, qui fonde notre démocratie sociale, c’est-à-dire la participation des salariés aux décisions touchant à leur emploi, à leurs conditions de travail et à leur formation.
S’il est source de justice sociale – de fait, les études prouvent qu’un dialogue social plus performant améliore considérablement la qualité de vie au travail pour les salariés –, ce principe est aussi un facteur d’efficacité économique : en effet, ce sont la coopération, l’engagement, le travail en équipe et l’amélioration des compétences qui fondent la compétitivité d’une entreprise.
C’est pourquoi j’ai proposé aux partenaires sociaux, au mois de juillet dernier, d’examiner la question de l’efficacité du dialogue social dans l’entreprise. Vous le savez, leurs discussions n’ont malheureusement pas abouti à la conclusion d’un accord. Reste que les parties ont toutes affirmé la nécessité de moderniser le dialogue social et que de nombreux sujets de consensus ont pu être dégagés au cours des négociations.
Le Gouvernement a donc légitimement repris la main, toujours avec le souci de trouver un point d’équilibre entre les positions des représentants des salariés et des chefs d’entreprise. Dans cette perspective, j’ai mené de nombreuses consultations avant de présenter le présent projet de loi, qui me paraît être un texte d’équilibre ; s’il n’est pas le fruit d’un accord des partenaires sociaux, il respecte les principaux acquis des négociations.
Pour renforcer le dialogue social, j’ai souhaité agir dans trois directions.
D’abord, j’ai entendu mettre en place une représentation universelle des salariés, adaptée, bien sûr, à la taille des entreprises.
De ce point de vue, j’ai dressé un constat simple : une grande partie des salariés des petites et moyennes entreprises sont aujourd’hui exclus du dialogue social. J’ai voulu remédier à cette situation en offrant une représentation de qualité aux 4, 6 millions de salariés des très petites entreprises, les TPE. Cette grande avancée prendra la forme de commissions paritaires régionales, composées à la fois d’employés et d’employeurs issus des TPE. Ces instances ont été conçues comme des lieux de dialogue, de conseils et de médiation ; en permettant de vrais échanges, elles seront utiles aux TPE de notre pays. D’ailleurs, l’instauration de telles structures avait été proposée par les organisations patronales dans la dernière ligne droite des négociations, à la lumière des expériences menées avec succès depuis des années, notamment dans le secteur de l’artisanat.
J’ai également dressé le constat que les institutions représentatives du personnel devaient incontestablement être mieux adaptées aux spécificités des entreprises. C’est pourquoi je propose, outre la mise en place des commissions dont je viens de parler qui intéressent les TPE, une délégation unique du personnel élargie pour les entreprises comptant jusqu’à trois cents salariés. Quant aux entreprises de plus de trois cents salariés, elles pourront, par un accord majoritaire, c’est-à-dire signé par les syndicats totalisant au moins 50 % des voix aux élections professionnelles, regrouper les instances.
Ensuite, j’ai souhaité encourager l’engagement au cœur des entreprises.
Chacun, quelle que soit sa sensibilité, constate que, en France, trop peu de personnes font le choix de l’engagement syndical, qui est pourtant un formidable moyen de participer à la vie de son entreprise, d’exercer des responsabilités et de gagner en compétences. Pour susciter des vocations, j’entends reconnaître et valoriser l’engagement de ceux qui font vivre le dialogue social dans l’entreprise.
Ainsi, parce que l’engagement au service des autres salariés ne saurait être un frein à son propre parcours professionnel, le projet de loi prévoit, au bénéfice des salariés exerçant un mandat lourd, une garantie de maintien de salaire et un entretien de fin de mandat destiné à mieux anticiper la suite de la carrière, ainsi que, pour tous les titulaires de mandat, un système de valorisation des compétences acquises dans l’exercice de leurs fonctions syndicales. Nous espérons que ces mesures inciteront davantage de salariés, notamment de jeunes salariés, à choisir de s’engager au sein de leur entreprise.
Favoriser l’engagement au sein de l’entreprise, c’est aussi agir en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes. Or, texte de progrès social, ce projet de loi est également un texte de progrès pour les femmes.
Faire progresser l’égalité professionnelle au sein des entreprises est l’une des priorités du Gouvernement depuis 2012. Dans cet esprit, le projet de loi instaure une exigence de représentation équilibrée, voire de parité, dans les institutions représentatives du personnel et les conseils d’administration des entreprises. En particulier, il prévoit l’obligation d’une composition équilibrée des listes électorales lors des élections professionnelles et une représentation paritaire des salariés au sein des conseils d’administration et des commissions régionales paritaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, voilà de grandes avancées, concrètes, pour une meilleure reconnaissance de la place de la femme dans les entreprises !
Enfin, j’ai voulu rendre le dialogue social dans les entreprises plus vivant, plus performant et plus efficace.
Parmi les sujets sur lesquels j’ai indiqué que les négociations avaient fait émerger un consensus figure le constat que le formalisme des obligations de consulter et de négocier nuit, à n’en pas douter, au dialogue social. Il faut donc faire en sorte que le cadre de ces discussions soit propice à l’efficacité et qu’il permette aux salariés de peser réellement et de manière constructive sur les orientations stratégiques de l’entreprise.
Il convient ainsi de regrouper les obligations de consulter et de négocier. C’est pourquoi le projet de loi prévoit de remplacer les dix-sept obligations d’information et de consultation actuelles par trois consultations annuelles, et les douze obligations par trois blocs de négociation cohérents. Bien entendu, cette réforme s’accompagnera d’une plus grande latitude accordée aux partenaires sociaux pour organiser, dans l’entreprise, l’agenda social. De plus, le fonctionnement des réunions sera simplifié : les rôles respectifs des différences instances seront clarifiés et il sera possible de tenir des réunions communes à plusieurs instances, ainsi que de recourir, si nécessaire, à des moyens comme la visioconférence.
Donner plus de sens, recentrer les réunions sur les enjeux clés, mieux articuler les négociations : voilà de vraies innovations.
Le deuxième progrès social consiste à proposer une meilleure prise en compte des questions de santé.
À ce sujet, l’accord national interprofessionnel de 2013, dont je rappelle l’importance, identifie la qualité de vie au travail comme étant un facteur non seulement de meilleure santé des travailleurs, mais aussi, et cela va de pair, de performance des entreprises. Il faut restaurer des espaces de dialogue consacrés au travail et agir sur la santé au travail pour prévenir la désinsertion professionnelle.
Mon action est orientée vers la prévention, et je voudrais sur ce point saluer le formidable travail réalisé par les partenaires sociaux pour ce qui concerne la préparation du troisième plan Santé au travail. Je souligne d’ailleurs qu’il est rare d’arriver à un tel consensus pour mettre la prévention au cœur des orientations. Je souhaite que cet esprit prévale également au cours des débats dans les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, CHSCT, que ce projet de loi propose de généraliser dans les entreprises de plus de cinquante salariés.
La prise en compte de la pénibilité est justement un encouragement à favoriser la prévention et à réduire les expositions liées à l’exercice de certains métiers. De ce point de vue, le compte pénibilité constitue un nouveau droit pour les salariés ; il se traduit d’abord par un droit à la formation et une incitation à l’amélioration des processus de production pour résorber autant que faire se peut les causes de pénibilité. Le Gouvernement a souhaité en faciliter la mise en œuvre, et j’ai proposé en ce sens des amendements importants à l’Assemblée nationale. Je suis convaincu qu’un droit effectif pour les salariés est un droit simple et compréhensible dans sa mise en œuvre.
Le travail parlementaire a aussi permis d’avancer sur la question du burn-out, ou syndrome d’épuisement professionnel, fait de société que l’on ne peut masquer. À ce sujet, je souhaite saluer le travail de diffusion des bonnes pratiques de prévention, à travers un guide spécialement conçu à cet effet, qui a reçu un accueil favorable des partenaires sociaux. La prévention doit constituer notre priorité.
Enfin, à la suite à la mission que Mme Touraine et moi-même avons confiée au député M. Michel Issindou, plusieurs dispositions de ce projet de loi visent à redonner de la lisibilité et de l’efficacité à la médecine du travail.
Vous le constatez, mesdames, messieurs les sénateurs, santé et travail sont pleinement au cœur du présent texte.
Le troisième progrès social consiste à proposer de nouvelles avancées pour la sécurisation des parcours professionnels et la création d’emplois.
De ce point de vue, l’instauration du compte personnel d’activité marque la volonté du Gouvernement de sécuriser les parcours des salariés. Depuis 2012, nous avons mis en place de nouveaux outils en ce sens : le compte personnel de formation, le compte personnel de prévention de la pénibilité, la généralisation à venir de la complémentaire santé et le portage de la prévoyance. Le nouveau défi est de protéger le salarié dans sa trajectoire, c’est-à-dire d’attacher les droits à la personne, et non plus seulement au contrat de travail, de faire en sorte qu’ils la suivent quels que soient les changements intervenant au cours de sa vie professionnelle.
Pour répondre à cet objectif ambitieux, le Président de la République a annoncé la création du compte personnel d’activité, qui sera en quelque sorte le capital des travailleurs. Ce compte concentrera tous les droits individuels des salariés, notamment les droits à la formation, le compte épargne-temps et le compte pénibilité, pour qu’ils soient ainsi réunis. Au-delà de l’accès aux droits, le compte personnel d’activité devra permettre de rendre les droits entièrement portables, quelle que soit l’évolution de la situation professionnelle de l’individu, comme le changement d’employeur ou le chômage.
Par ailleurs, est réaffirmé dans le projet de loi le rôle de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, l’AFPA, dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi. L’AFPA est, je le rappelle, un acteur majeur de la formation et de l’insertion professionnelle. Depuis la reconstruction de l’après-guerre qu’elle a accompagnée, elle fait partie du patrimoine économique et social de notre pays. Certes, elle est un organisme de formation dans le champ concurrentiel, mais elle est aussi un opérateur du service public de l’emploi.
Dans cet esprit, avec les partenaires sociaux, les régions et mes collègues chargés de l’économie et des finances, nous avons travaillé afin de dégager des solutions durables quant aux missions et au statut de l’AFPA. Ces solutions marquent l’engagement de l’État pour la pérennisation de cette association et la volonté de conforter les missions de service public de cette dernière qui sont précisées dans le cadre, bien sûr, des règles nationales et communautaires de la concurrence.
Enfin, le projet de loi est l’occasion de mettre en place plusieurs dispositifs favorisant la création d’emplois.
En effet, il comporte de nouveaux outils d’accompagnement des demandeurs d’emploi de longue durée. Ce dernier point correspond à l’un de mes combats au ministère, car nous savons bien que lorsque la conjoncture économique devient plus favorable, les personnes qui sont depuis longtemps au chômage ont plus de mal à retrouver un emploi.
En outre, je présenterai des amendements visant à concrétiser la volonté du Gouvernement de faciliter la création d’emplois dans les TPE. Nous le savons tous, les TPE et les PME de notre pays constituent un gisement d’emplois et de croissance. C’est pourquoi le Gouvernement a lancé le plan Tout pour l’emploi, dont deux des dix-huit mesures présentées par le Premier ministre dernièrement constituent l’objet d’amendements déposés au présent projet de loi.
La première mesure concerne l’apprentissage. Elle porte la durée de la période pendant laquelle le contrat peut être rompu unilatéralement à deux mois de présence effective de l’apprenti dans l’entreprise. Ce laps de temps est nécessaire pour qu’une relation de confiance réciproque puisse s’établir entre l’employeur et l’apprenti et permettra aux deux parties de s’assurer de la pertinence de leur engagement.
La seconde mesure concerne le renouvellement des contrats à durée déterminée, ou CDD, et des contrats d’intérim. En effet, dans un contexte de reprise économique, les entreprises peuvent éprouver le besoin de renouveler de tels contrats le temps que leur carnet de commande se consolide. Actuellement, ces contrats ne peuvent être renouvelés qu’une seule fois, y compris lorsque l’employeur et le salarié ne sont pas allés au bout de la durée maximale cumulée prévue par le code du travail. L’amendement qui vous sera présenté, mesdames, messieurs les sénateurs, vise donc à permettre à un travailleur en contrat de courte durée de travailler plus longtemps et par conséquent à autoriser deux fois le renouvellement des CDD ou des contrats d’intérim sans que la durée totale des trois contrats puisse dépasser dix-huit mois, comme la loi le prévoit aujourd’hui.
Toutes ces mesures complètent la mobilisation du Gouvernement en faveur de la création d’emplois.
Le quatrième et dernier progrès social consiste à conforter et à réaffirmer la spécificité du statut des intermittents du spectacle.
À chaque renégociation du régime d’assurance chômage, les annexes 8 et 10, spécifiques aux intermittents du spectacle, sont débattues et remises en cause. Il en résulte des crises successives, de l’inquiétude et de l’insécurité pour les professionnels concernés. Ces règles particulières visent pourtant à prendre en compte la discontinuité de carrière particulière aux artistes et aux professionnels de la création. C’est pourquoi le projet de loi prévoit d’inscrire dans le code du travail l’existence de ces règles spécifiques d’indemnisation. Cette inscription au plan législatif est un signal de confiance très attendu par les centaines de milliers de salariés du milieu du spectacle.
À travers ce projet de loi, il est aussi proposé d’améliorer la méthode de négociation, en permettant aux partenaires sociaux représentatifs du secteur du spectacle de négocier ces règles spécifiques, dans un cadre défini à l’échelon interprofessionnel. Ces avancées n’auraient pas été permises sans le travail, que je salue, accompli par Hortense Archambault, Jean-Denis Combrexelle et Jean-Patrick Gille dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Mesdames, messieurs les sénateurs, sur l’ensemble de ces volets, les débats en commission ont fait évoluer le projet de loi. Je tiens à saluer le travail constructif qui a été mené et les membres de la commission qui se sont impliqués dans les discussions. Néanmoins, certains ajouts et certaines suppressions ont, à mon avis, considérablement transformé l’équilibre du texte.
M. François Rebsamen, ministre. Or vous connaissez ma méthode : je suis attaché au respect des positions tant des représentants des salariés que des employeurs. Aussi, je présenterai des amendements visant à rétablir des points essentiels du projet de loi que j’ai proposé et à revenir à ce que je considère être l’équilibre de ce texte. J’ai défendu d’ailleurs la même position à l’Assemblée nationale. Ces amendements seront l’occasion de débats de fond, afin que l’examen de ce projet de loi par la Haute Assemblée soit le plus constructif possible.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le président, madame la rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, avant d’aborder la prime d’activité, j’indiquerai en quoi ce dispositif s’inscrit dans l’action que le Gouvernement mène pour la rénovation de la protection sociale.
Le soixante-dixième anniversaire de la sécurité sociale – nous aurons l’occasion d’en reparler, même si celui-ci sera principalement célébré en dehors des hémicycles – sera l’occasion non seulement de rappeler l’attachement des Français à cet instrument de solidarité, mais aussi de montrer en quoi la sécurité sociale est non pas simplement une vieille dame alerte, mais profondément en phase avec les enjeux de la présente période.
La force de notre protection sociale est d’avoir toujours su s’adapter aux nouveaux défis auxquels doivent faire face nos concitoyens. En effet, protéger les Français eu égard aux risques auxquels ils sont exposés suppose de prendre en considération l’évolution de ceux-ci et de ne pas ignorer les changements de notre environnement. Cette nécessité est d’autant plus vraie compte tenu de la période actuelle, puisque la France de 2015 connaît encore les effets de la crise, même si les moteurs de son économie redémarrent.
La France, frappée en son cœur par le terrorisme, a refusé de céder aux sirènes de la division. Même si elle doute parfois, elle sait se rassembler pour aller de l’avant. Dans cette France qui se remet en mouvement, notre sécurité sociale est porteuse d’espoir, puisqu’elle est l’incarnation quotidienne des valeurs de la République.
Depuis maintenant trois ans, nous agissons pour adapter la sécurité sociale aux besoins de tous, et telle est bien la finalité de la mise en place de la prime d’activité, figurant au titre IV du présent projet de loi. Afin de mieux valoriser le travail, il faut proposer à nos concitoyens un dispositif qui réponde à leurs préoccupations.
Cependant, et je le dis d’emblée, il ne s’agit pas d’entrer dans un débat qui conduirait à opposer les Français les uns aux autres ou de « surfer » sur la rengaine de l’assistanat, que l’on entend trop souvent par les temps qui courent, car les Français veulent travailler, ils veulent que leur travail leur permette de vivre dignement.
Cela étant, reprendre un emploi, passer du temps partiel au temps plein permet, certes, d’avoir des revenus supplémentaires, objectif recherché et élément positif, mais cela peut aussi représenter des coûts supplémentaires, parfois importants, tels que les nouveaux frais de déplacement, d’équipement ou de garde d’enfant, ce au moment même où les aides sociales diminuent de manière logique, car elles doivent bénéficier à nos concitoyens les plus pauvres.
Lors de la reprise d’une activité, un certain nombre de Français ont parfois le sentiment que le travail ne rapporte pas ce qu’ils en espéraient en termes de valorisation et de revenus. C’est pourquoi nous avons l’ambition, avec la prime d’activité, de garantir que le travail soit toujours valorisé, en accompagnant en particulier ceux qui ne percevront plus le revenu de solidarité active, ou RSA, car ils reprennent un emploi ou en soutenant ceux qui, travaillant à temps partiel, augmentent la durée de leur travail parfois jusqu’à un temps plein.
Les dispositifs qui existent aujourd’hui à cet égard – le RSA activité et la prime pour l’emploi – fonctionnent mal. La prime pour l’emploi est perçue un an après par des salariés qui ne savent pas toujours pour quelle raison et qui ne l’ont pas forcément identifiée. Le décalage d’une année empêche d’ailleurs d’établir le lien entre l’activité à un moment donné et la perception de la prime. Quant au RSA activité, il n’est demandé que par moins d’un tiers de ceux qui pourraient y prétendre, et son appellation même entraîne une confusion entre soutien au travail et lutte contre la pauvreté.
Le présent texte prévoit donc de supprimer la prime pour l’emploi et le RSA activité, et les sommes qui étaient allouées à ces deux mécanismes seront dédiées au financement de la nouvelle prime d’activité.
Le dispositif proposé s’adresse à ceux qui ont parfois le sentiment de donner sans recevoir beaucoup, à ceux qui, comme nous l’entendons parfois exprimer, ont le sentiment de ne pas « cocher les bonnes cases » : d’un côté, leurs revenus étant trop élevés, ils ne peuvent prétendre aux aides sociales, logiquement et nécessairement ciblées en direction des ménages les plus pauvres ; de l’autre, ne gagnant pas assez pour être imposables, ils ne sont pas concernés par les allégements de l’impôt sur le revenu. Ce mécanisme a été pensé et organisé pour eux. Ce sont nos concitoyens qui perçoivent entre 900 euros et 1 300 euros par mois qui auront le gain de pouvoir d’achat le plus important par rapport à ce qui existe aujourd’hui.
J’y insiste, la prime d’activité n’est pas un dispositif de lutte contre la pauvreté. Des mesures ont déjà été prises à cette fin – d’autres seront envisagées –, qu’il s’agisse de la revalorisation exceptionnelle de 10 % du RSA socle en faveur de ceux qui n’ont aucune activité d’ici à la fin du quinquennat, de la revalorisation de 25 % à 50 % de certaines allocations familiales versées aux ménages pauvres, ou encore d’autres dispositifs qui concernent l’éducation, le logement ou le travail.
Cette prime vise en réalité à accompagner la reprise d’une activité ou l’augmentation du temps de travail du salarié. Par conséquent, cette prestation est principalement individuelle – j’y insiste également –, même si elle tient compte de la situation familiale de la personne concernée. Aujourd’hui, les parents dont l’activité est réduite ou qui perçoivent le RSA bénéficient d’une revalorisation de leur allocation. Refuser de considérer la situation familiale en l’espèce reviendrait à pénaliser les parents, en particulier les parents isolés. Concrètement, une mère seule ayant un enfant à charge touchera, si elle travaille à temps plein et perçoit le SMIC, 290 euros supplémentaires par mois, alors qu’une personne seule sans enfant mais percevant des revenus identiques verra sa prime d’activité avoisiner les 130 euros par mois.
Aider les familles monoparentales, notamment les mères seules, à reprendre le travail ou à augmenter leur temps d’activité et à concilier vie professionnelle et vie familiale fait aussi partie des engagements du Gouvernement.
La prime d’activité traduit enfin notre engagement en faveur de la jeunesse. Actuellement, seuls 5 000 jeunes bénéficient du RSA activité. Cette prime constitue donc un droit nouveau pour les jeunes actifs, puisqu’ils pourront y prétendre dans les mêmes conditions que tous les autres salariés actifs. L’âge ne sera plus un facteur discriminant : c’est le travail qui représentera la porte d’entrée à l’obtention de la prime d’activité, quel que soit l’âge du salarié de plus de dix-huit ans.
Environ un million de jeunes pourront demain être accompagnés par cette prime, y compris certains étudiants et apprentis dont le temps d’activité est suffisamment important pour qu’ils puissent être considérés plus comme des actifs étudiants que comme des étudiants ayant une activité.
Avec cette réforme, nous démontrons que la protection sociale contribue bien à reconnaître des droits au travail.
Certains estiment, je l’indiquais tout à l’heure, que la protection sociale « flirte » – pardonnez-moi cette expression – avec l’assistanat. Au contraire, il s’agit de renforcer les liens existants entre l’activité et la protection face aux risques de notre environnement.
Tel est aussi le sens d’autres mesures figurant dans le présent texte.
Je me contenterai maintenant pour ma part de souligner l’importance des dispositions prises afin de préciser les contours du compte pénibilité qui représente une avancée sociale majeure, en ce qu’il permet aux salariés exposés à des conditions de travail pénibles, dont l’espérance de vivre en bonne santé est plus courte que celle des autres, de partir à la retraite avant ces derniers. C’est ce que l’on appelle la justice : permettre à des hommes et à des femmes se trouvant dans des situations plus exposées de pouvoir bénéficier d’un départ à la retraite anticipé.
Je le rappelle, le dispositif est déjà entré en vigueur, contrairement à ce que certains croient parfois : dès cette année, 1 million de salariés seront couverts par le compte pénibilité ; l’an prochain ce nombre passera à 3 millions, lorsque les dix facteurs identifiés pourront être pris en considération.
Grâce aux mesures de simplification proposées dans ce projet de loi, la mise en œuvre du dispositif par les entreprises à l’égard de leurs salariés les plus exposés sera facilitée, et je m’en réjouis.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous avons besoin d’une protection sociale innovante, dynamique, modernisée, afin de répondre aux attentes de nos concitoyens.
La prime d’activité représente en ce sens une avancée majeure pour celles et ceux qui travaillent mais perçoivent des revenus modestes, situés entre 0, 5 SMIC et 1, 3 SMIC environ, c’est-à-dire entre à peu près 700 euros et 1 350 euros par mois ; elle sera particulièrement concentrée autour des revenus de l’ordre de 900 euros à 1 300 euros.
L’examen de ce texte par la commission des affaires sociales a montré que le dispositif lui-même rassemble très largement. C’est donc collectivement que nous pouvons nous adresser à nos concitoyens qui pourront en bénéficier. Nous leur garantissons qu’ils pourront eux aussi, quels que soient les secteurs dans lesquels ils travaillent, compter sur la solidarité collective.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que notre pays est frappé par un chômage de masse et une stagnation de l’activité, le projet de loi qui est aujourd’hui soumis par le Gouvernement à la Haute Assemblée marque une rupture par rapport aux textes qui l’ont précédé.
Jusqu’à présent, les réformes reposaient sur un principe essentiel et une base incontestable : un accord des partenaires sociaux. L’échec de la négociation avec ceux-ci, au mois de janvier dernier, a souligné les limites du modèle français du dialogue social et contraint le ministre du travail à proposer des mesures que je qualifierai de « limitées ».
Pourtant, un dialogue social apaisé et efficace constitue, pour les entreprises, un facteur de compétitivité et, pour les salariés, une source de bien-être au travail. Il faut le reconnaître aujourd’hui, la France n’arrive pas à établir un niveau de dialogue social constructif tel qu’il existe dans de nombreux pays voisins. Il est peut-être temps de faire évoluer le modèle, apparemment à bout de souffle, qu’a tenté de faire fonctionner Gérard Larcher.
Pourtant, le présent texte est loin de cet objectif : les six volets de ce projet de loi ne sont pas vraiment marqués du sceau de la cohérence et de la concertation, et les apports de l’Assemblée nationale ont parachevé ce patchwork.
Comment qualifier le contexte législatif dans lequel le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi arrive au Sénat ? « Confus » me paraît être un terme un peu faible !
Alors que nous débattons en ce moment en séance publique, la commission spéciale se réunit pour examiner en nouvelle lecture le projet de loi Macron, qui contient non seulement de très nombreuses dispositions relatives au droit du travail, mais aussi d’autres, et pas des moindres.
Dans un mois, la commission des affaires sociales examinera, elle, le projet de loi de modernisation de notre système de santé, alors que des dispositions relatives à la santé au travail ont été introduites au dernier moment, et avec l’accord du Gouvernement, à l’Assemblée nationale et que nous n’avons pu, pris au dépourvu et par le temps, procéder à des auditions.
Cet enchevêtrement de dispositions éparpillées dans plusieurs textes, ajoutées sans prévenir, nuit à la lisibilité et renforce l’impression que le Gouvernement n’a pas vraiment de cap et navigue à vue, au gré des ministres, en matière de droit du travail.
Après ces considérations générales, j’aimerais revenir sur les travaux de la commission des affaires sociales, qui a adopté soixante-six amendements afin de tenter de faire de ce projet de loi un véritable texte de simplification et de dissiper les craintes qu’il a suscitées et que j’ai entendues au gré de très nombreuses auditions.
En examinant l’article 1er, qui prévoit la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI, nous avons cherché à trouver un point d’équilibre acceptable par tous dans la lignée de la position qui est celle du Sénat depuis l’examen de la loi du 15 octobre 2010 : construire un modèle de représentation des salariés des TPE qui ne soit pas conçu contre l’avis des acteurs concernés mais constitue l’aboutissement du dialogue social.
Tout de même, monsieur le ministre, un projet de loi, dont l’intitulé comporte les termes « dialogue social », débutant par une disposition qui a conduit à l’échec des négociations, c’est un peu provocateur !

La commission des affaires sociales a décidé de confier non pas à la loi, mais à un accord interprofessionnel la constitution de ces commissions : il appartiendra aux partenaires sociaux, par accord national, ou à défaut régional, de les mettre en place. Elle a également rétabli le texte initial du Gouvernement en ôtant à celles-ci toute mission de médiation et en réaffirmant le principe selon lequel leurs membres ne peuvent accéder à l’entreprise, sauf autorisation expresse de l’employeur et moyennant un délai de prévenance de huit jours.
La commission s’est également employée à corriger des fragilités juridiques et à faire disparaître les facteurs de complexité pour les entreprises et les partenaires sociaux présents dans le texte, résultant en partie de l’initiative de nos collègues députés, dont je tiens à saluer, sur certains points, une ténacité... quasi obsessionnelle.
Ancienne salariée d’entreprise, je me bats depuis quarante ans pour l’égalité professionnelle, car je sais ce qu’il en est. Je suis heureuse de voir que cet objectif est enfin partagé ; mais de là à faire abstraction de toute considération juridique ou pratique, il y a un fossé.
De même, quant à la présence de représentants des salariés dans les conseils d’administration ou de surveillance des grandes entreprises, nous avons souhaité en revenir à l’esprit et à la lettre de l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013. Je pense que M. le ministre du travail nous en sera reconnaissant.
Les modifications apportées aux institutions représentatives du personnel, ou IRP, sont très largement acceptées, qu’il s’agisse de l’extension de la délégation unique du personnel, la DUP, ou de l’ouverture de la possibilité de regrouper, par accord, dans les grandes entreprises, les différentes IRP au sein d’une instance unique. Sur ces points, la commission a limité la présence des suppléants aux réunions. En outre, elle a renforcé l’encadrement du cumul et de la mutualisation des heures de délégation.
Un sujet omniprésent dans le débat public était toutefois absent du texte : celui des seuils. J’étais pourtant bien là, lorsque M. Macron a affirmé à mes collègues, et de manière systématique, que la place de ces seuils était bien dans ce projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi.

Pour chercher à réduire, en matière d’emploi, l’impact de ces seuils qu’une récente étude commandée par la délégation sénatoriale aux entreprises a mis en lumière, la commission propose de mettre en place, à titre expérimental, un mécanisme de lissage sur trois ans des obligations qui s’imposent aux entreprises franchissant les seuils fatidiques de onze et de cinquante salariés.
La commission a également pris acte de la rationalisation des procédures d’information et de consultation du comité d’entreprise, tout en donnant la possibilité à ses membres titulaires de conclure un accord avec l’employeur pour les adapter aux spécificités de l’entreprise.
Nous avons en outre simplifié les règles de calcul encadrant la création et la suppression du comité d’entreprise. Ainsi, nous assurons la mise en œuvre, avec diligence, de l’une des mesures du programme en faveur des TPE et des PME annoncé par le Premier ministre le 9 juin dernier.
J’en viens au volet consacré à la santé au travail et à la pénibilité, que l’Assemblée nationale a ajouté au présent texte.
Nous ne pouvons que nous féliciter des mesures de simplification et de sécurisation juridique du compte personnel de prévention de la pénibilité : l’actuelle majorité sénatoriale n’a cessé de dénoncer les aberrations du dispositif initial.
Mais toutes les craintes ne sont pas dissipées, tant s’en faut. Il faut éviter de recréer à terme des régimes spéciaux, lesquels entraîneraient une dérive des dépenses que chacun sait insoutenable. Aussi, l’homologation par l’administration des référentiels élaborés par les branches ne devra pas porter préjudice à la soutenabilité financière du fonds chargé de gérer les droits liés aux comptes pénibilité.

Les dispositions relatives à la médecine du travail ont laissé la commission circonspecte. À nos yeux, ces mesures sont parcellaires et inabouties : quel projet de réforme le Gouvernement porte-t-il ?
Monsieur le ministre, vos explications sont attendues sur ce sujet, qui intéresse un grand nombre de nos concitoyens, alors que le troisième plan Santé au travail devrait bientôt voir le jour.
Je regrette la méthode employée, et je déplore que les rapports censés éclairer la réflexion du Gouvernement, et surtout des parlementaires, aient été remis tardivement. De ce fait, ces dispositions n’ont pas pu être examinées sereinement.
Sur l’initiative de notre collègue Jean-Marc Gabouty, la commission a supprimé l’article 19 bis, qui visait à faire adapter par décret les conditions dans lesquelles les pathologies psychiques pouvaient être classées maladies professionnelles par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, les CRRMP. Selon la commission, ce sujet doit être débattu dans le cadre du projet de loi de santé, sur lequel elle se penchera prochainement.
J’en viens à l’article 20, sur les intermittents du spectacle. Alain Dufaut, rapporteur pour avis de la commission de la culture, abordera ce sujet beaucoup plus en détail.
À l’origine, cet article prévoyait un dispositif permettant aux partenaires sociaux représentatifs de l’ensemble des professions de la production cinématographique, de l’audiovisuel et du spectacle, de négocier eux-mêmes les règles des annexes VIII et X, relatives à l’indemnisation du chômage des intermittents.
Or ce dispositif a été critiqué de toutes parts – j’insiste sur ce point. Il était entaché de nombreuses incertitudes juridiques, qui auraient pu, le cas échéant, fragiliser l’édifice de l’indemnisation chômage. De plus, ce système posait une question de principe, car il dépossédait les partenaires sociaux chargés de négocier la convention d’assurance chômage d’une part de leurs prérogatives et risquait de créer un précédent fâcheux.
La commission a donc remplacé ce dispositif par un mécanisme de concertation renforcée, afin que les partenaires sociaux concernés communiquent leurs propositions avant l’ouverture, et avant la conclusion, de la négociation sur l’assurance chômage.
Par ailleurs, nous avons souhaité que le ministère du travail prenne ses responsabilités et fixe par voie réglementaire la liste des partenaires sociaux qui seront consultés, afin d’éviter toute polémique au sujet de leur légitimité.

Au surplus, en accord avec Alain Dufaut, nous avons conféré au comité d’expertise une nouvelle mission, à savoir le suivi statistique de la mise en œuvre des annexes VIII et X.
Le Gouvernement a cherché à sauver les festivals de l’été 2015. Pour notre part, nous avons tenté de rendre ce mécanisme durable et pérenne.
Le titre IV du présent texte crée, à compter du 1er janvier 2016, la prime d’activité, en remplacement du RSA activité et de la prime pour l’emploi, la PPE. Mme la ministre vient d’en parler.
Si chacun peut souscrire, dans le principe, à cette réforme, les modalités de cette dernière doivent être étudiées avec précaution.
Le Gouvernement insiste sur le caractère novateur de cette prestation, censée dépasser les limites des dispositifs qu’elle remplace. C’est en partie vrai : la prime sera ouverte dès l’âge de dix-huit ans. Elle reposera sur une base ressources légèrement simplifiée et les sommes allouées chaque trimestre le seront définitivement.
Pour autant, cette prestation n’est qu’une version simplifiée et plus individualisée du RSA activité. Au reste, atteindre un taux de recours de 50 % l’an prochain suppose d’engager des efforts substantiels pour communiquer auprès des bénéficiaires potentiels et simplifier leurs démarches.
Cette volonté et la réalité de cette simplification me laissent, personnellement, dubitative. Je souhaite que ce débat nous apporte des réponses claires quant au contenu de la base ressources, notamment les pensions alimentaires, quant aux obligations déclaratives qui pèseront sur les demandeurs et à la manière dont l’administration fiscale et les caisses d’allocations familiales, les CAF, travailleront ensemble à la mise en œuvre de la réforme.
La commission s’est contentée de réécrire les modalités de calcul de la prime, afin de les rendre plus précises, je dirais même plus compréhensibles. Grâce à un amendement présenté par Albéric de Montgolfier, elle s’est également assurée d’un suivi plus fin de l’évolution du coût de la prime d’activité.
L’Assemblée nationale avait étendu le bénéfice de la prime aux étudiants et aux apprentis, à partir d’un certain niveau de rémunération. Nous ne sommes pas revenus sur ce point et n’avons pas non plus restreint aux seuls apprentis le bénéfice de la prime d’activité, comme le proposait la commission des finances.
Pour ma part, j’espère que la prime d’activité pourra être un outil de soutien au pouvoir d’achat de ces jeunes, mais je crains qu’elle ne les incite à travailler plus, au détriment de leurs études. Je redoute également un effet d’aubaine pour les étudiants qui ont fait le choix pédagogique d’une année en alternance. C’est le cas des masters 1 et 2, à la fois étudiants et apprentis qui ne sont pas réellement dans une situation de précarité. Tel est le sens d’un amendement que je défendrai en séance publique s’il est adopté par la commission.
Afin de ne pas prolonger excessivement mon propos, j’indique simplement que j’interviendrai, au fil de la discussion des articles, sur toutes les dispositions diverses, un peu hétéroclites, figurant dans le présent texte. Si j’étais animée d’un mauvais esprit, ce qui n’est pas le cas, je qualifierais même certaines de ces mesures de « cavaliers »... §D’autresrelèvent d’un simple affichage politique, comme le compte personnel d’activité.
En revanche, monsieur le ministre, certains des amendements que vous venez de déposer au Sénat sont d’une portée plus adaptée à ce texte. Ils ont pour objet le contrat de travail. Nous en débattrons, je l’espère, sereinement.
Ma conclusion ne devrait pas vous surprendre : ce projet de loi n’est pas la réforme structurelle tant attendue, c’est un texte de simplification qui comporte quelques mesures bienvenues pour surmonter le caractère formel des règles actuelles. Il ne comble pas la principale insuffisance du modèle français : la faible représentativité des partenaires sociaux.
Il faut espérer que la commission Combrexelle aboutira à clarifier et à simplifier durablement les relations de travail et les relations entre partenaires sociaux.
Mes chers collègues, la commission des affaires sociales n’a pas apposé de prisme idéologique sur ce projet de loi.
Sourires sur les travées du groupe écologiste et du groupe socialiste et républicain.

Elle a cherché à l’améliorer, pour le rendre conforme à son ambition initiale. Le texte qui est issu de ses travaux facilitera les relations dans l’entreprise.
Je vous invite donc à ne pas remettre en cause cet équilibre, et j’espère que nos collègues députés sauront apprécier ce travail !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication s’est saisie du titre II de ce projet de loi, lequel prévoit de « conforter le régime d’assurance chômage de l’intermittence », et en particulier son article 20.
Voilà de nombreuses années que notre commission se consacre au sujet. Je peux même dire que nous y avons travaillé continûment depuis la grande crise de 2003, marquée par l’annulation de nombreux festivals, dont celui d’Avignon. Celui qui vous parle était à l’époque premier adjoint, chargé des finances, de la ville d’Avignon. Autant vous dire que je sais le traumatisme que peut causer la suppression d’un festival !
En la matière, de nombreux travaux ont été menés depuis dix ans. Je songe au comité de suivi, réuni à l’instigation de Jack Ralite et d’Étienne Pinte. Je pense aux nombreuses auditions, aux tables rondes, aux rapports d’information qui se sont succédé. Le dernier de ces rapports date de 2013 ; il a été remis par notre collègue Maryvonne Blondin, et j’ai modestement participé à sa réalisation.
Tous ces travaux nous l’ont appris, la réalité du monde des intermittents est bien éloignée de ce qu’en disent trop facilement les médias. La réforme des règles d’indemnisation est certes nécessaire, mais – il faut en convenir – elle se révèle particulièrement délicate à mettre en œuvre.
C’est bien pourquoi nous avons choisi, à propos de ce texte, une position constructive, au nom de la concertation sociale engagée l’été dernier, dans l’intérêt de l’activité culturelle et du développement de nos territoires.
La réforme est nécessaire, nous le savons tous. Oui, le déséquilibre des comptes de l’assurance chômage des intermittents du spectacle est exorbitant : 1, 2 milliard d’euros de dépenses pour 200 millions d’euros de recettes, soit un delta de 1 milliard d’euros, qui correspond, au total, à un quart du déficit de l’UNEDIC depuis dix ans…
Nous sommes bien face à un véritable problème, même si l’on peut accepter l’idée que les comptes de ce secteur soient déséquilibrés, comme ils le sont pour les intérimaires ou pour les salariés en contrat à durée déterminée.
Nous savons également que les règles d’indemnisation spécifiques, fixées aux annexes VIII et X, sont devenues un régime, et même un « statut » des intermittents. Cette situation arrange les employeurs comme les salariés du spectacle, aussi bien que les donneurs d’ordre que sont les pouvoirs publics. Nous sommes tous, peu ou prou, élus des collectivités et, dans nos territoires, nous nous battons tous pour le développement culturel, pour nos festivals, pour le spectacle vivant qui, c’est vrai, est devenu dépendant des annexes VIII et X.
Le problème, nous le savons bien, c’est que l’on fait trop peser sur l’assurance chômage. L’UNEDIC est devenue le premier mécène culturel de notre pays, et cette charge est trop lourde pour la solidarité interprofessionnelle. Cela ne peut pas durer !
Mes chers collègues, vous savez comme moi ce qu’il advient quand une catégorie professionnelle s’arc-boute sur son statut, et que tout un pan d’activité en dépend : il faut rétablir la confiance, évaluer, négocier et, surtout, responsabiliser.
C’est ce qu’a fait avec bonheur la mission de concertation confiée à Jean-Patrick Gille, Hortense Archambault et Jean-Denis Combrexelle l’été dernier, alors que nous nous acheminions vers de nouvelles annulations de festivals et de tournages, vers un nouveau séisme dans le dossier des intermittents.
Pendant plusieurs mois, dans l’enceinte du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, les partenaires sociaux ont identifié les pistes de réforme. Ils ont commencé à les évaluer à l’aide d’un outil statistique commun. L’État et l’UNEDIC ont pris leur part de ce travail.
C’est parce que le titre II institutionnalise cette négociation et qu’il permet d’espérer une réforme plus profonde du régime des intermittents, c’est parce qu’il fait avancer les choses que notre commission des affaires culturelles l’a accepté dans son principe.
La reconnaissance légale de l’existence de règles spécifiques d’indemnisation du chômage des intermittents est un geste d’apaisement social, qui inscrit clairement cette indemnisation dans la solidarité interprofessionnelle.
S’agit-il d’une sanctuarisation, comme on l’entend dire ? Ouvre-t-on une brèche dans laquelle s’engouffreraient d’autres catégories professionnelles en demandant, à leur tour, la sanctuarisation de leurs annexes ?
Mes chers collègues, faites attention aux vocables utilisés et relisez le texte : la loi ne fait ici que reconnaître l’existence de règles spécifiques visant à « tenir compte des modalités particulières d’exercice des professions » du spectacle.

L’article 20 ne dit pas ce que doivent être ces règles !
D’autres professions pourraient-elles demander à en bénéficier ? Leur situation est souvent très éloignée de celle dont il s’agit ici. Quand bien même le demanderaient-elles, la reconnaissance légale de règles spécifiques ne conduit pas à sanctuariser un contenu, lequel, au demeurant, fait même l’objet en principe d’une négociation périodique.
S’agissant de cette négociation, nous avons convenu avec notre collègue Catherine Procaccia de remplacer le mécanisme de délégation de « l’accord » à l’échelon professionnel, par une concertation approfondie avec l’interprofession. Cela nous semble plus stable, plus crédible et, surtout, juridiquement plus sûr. Les auditions ont en outre montré que cette démarche était conforme à l’attente des professionnels, qui demandent à être entendus pour la définition des règles qui les concernent.
Enfin, je remercie tout spécialement Catherine Procaccia d’avoir tenu compte de nos avis et d’avoir repris nos suggestions. Nous renforçons le comité d’expertise, qui apportera son aide durant la concertation en évaluant les propositions de réforme. Tous nos interlocuteurs considèrent cette mesure comme un réel progrès.
L’article 20 prévoit, autre avancée, un réexamen des listes d’emploi et une négociation sur les conditions de recours au contrat à durée déterminée d’usage, le CDDU. Ce sujet est déterminant. La négociation peut conduire à mettre fin à de trop nombreux abus et, par voie de conséquence, à réduire le déficit, satisfaisant ainsi en partie aux exigences du document de cadrage.
Enfin, l’article 20 contient une demande de bilan concernant la couverture sociale des intermittents et la situation particulière des « matermittentes » – les femmes enceintes intermittentes, dont les droits sociaux sont moindres que ceux des autres salariées. C’est un autre motif de satisfaction. Depuis 2013, notre commission s’est saisie plusieurs fois de ce sujet et nous veillerons aux suites données à ces bilans.
Mes chers collègues, pour ces raisons, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a accepté le titre II, c’est-à-dire l’article 20, de ce texte. Après des décennies de dérive comptable des annexes VIII et X, après des années de divergence entre les partenaires sociaux, ce texte peut faire avancer la négociation et apporter enfin une réforme plus profonde, allant au-delà de la seule assurance chômage. Sachons saisir tous ensemble cette occasion !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste et républicain

La parole est à M. Francis Delattre, en remplacement de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur pour avis.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, monsieur le président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, il me revient donc de vous présenter, au nom de M. Albéric de Montgolfier, qui n’a pu être présent ce jour, l’avis de la commission des finances : après tant de louanges, la belle sérénité qui s’est installée dans notre hémicycle risque d’être troublée !
La commission des finances s’est saisie pour avis du titre IV de ce projet de loi, qui instaure la prime d’activité. Cette nouvelle prestation sociale, créée en remplacement de la prime pour l’emploi et du RSA activité, représente un enjeu financier majeur, de l’ordre de 4, 1 milliards d’euros. Elle sera entièrement financée par le budget de l’État. La commission des finances s’est déjà intéressée au premier jalon de cette réforme : la suppression du crédit d’impôt qu’est la PPE par la seconde loi de finances rectificative pour 2014.
Dans l’ensemble, la prime d’activité proposée par le Gouvernement semble corriger certains défauts des dispositifs antérieurs. Elle répond notamment aux problèmes de saupoudrage et de décalage dans le temps de la PPE, que rappelait à l’instant Mme la ministre. De plus, elle a le mérite de remplacer deux dispositifs par une seule et même aide.
Toutefois, la commission a souhaité attirer l’attention sur certaines limites comme sur les éléments qui appelleront notre vigilance.
Premièrement, le Gouvernement nous indique que l’objectif de la prime d’activité est à la fois d’encourager la reprise ou la poursuite d’une activité professionnelle et de soutenir le pouvoir d’achat des travailleurs modestes.
Il est toutefois permis de douter que la prime d’activité ait un impact notable sur le niveau d’emploi, surtout dans un contexte de chômage de masse.
De même, les temps partiels, notamment les plus petits, sont souvent subis par les travailleurs. Ce n’est donc pas la prime d’activité qui, tout incitative qu’elle soit, les conduira à travailler davantage, mais bien une politique économique différente de celle qui est conduite depuis trois ans, c’est-à-dire une politique efficace de lutte contre le chômage.
Deuxièmement, le dispositif législatif est très vague, alors même que le mécanisme de la prime est extrêmement complexe. Le projet de loi se borne, en effet, à fixer le cadre général. De nombreux éléments, pourtant substantiels, sont renvoyés au pouvoir réglementaire, par exemple, le rythme de versement et les règles de calcul.
Je m’étonne que l’ancien sénateur que vous êtes, monsieur le ministre, ne nous fournisse pas un aperçu plus clair des décisions à venir, en plus des formules très complexes émanant de différents rapports, s’agissant de dispositifs engageant profondément les finances publiques.
De plus, la complexité de la formule de calcul est telle que sa définition législative est pratiquement illisible ! Je salue à cet égard la proposition de notre collègue rapporteur de la commission des affaires sociales, qui vise à améliorer la rédaction, très elliptique, de l’article 24 du présent projet de loi pour la rendre plus compréhensible.
Troisièmement, la simplification proposée par le Gouvernement paraît bien relative.
Tout d’abord, la formule de calcul de la prime d’activité, à la fois « familialisée » et individualisée, intégrant différents bonus, est si complexe qu’il sera toujours malaisé, voire impossible, pour un bénéficiaire d’anticiper le montant qui lui sera versé sans faire usage d’un ordinateur !
Ensuite, la base des ressources prises en compte n’est désormais plus identique à celle qui s’applique au RSA socle. L’exclusion de certaines aides, utilisées par ailleurs pour le calcul d’autres prestations sociales, introduit également de la complexité, ce qui emportera des effets sur les conseils départementaux, dont il n’est pourtant pas fait mention, monsieur le ministre.
Enfin, la prime d’activité continue de reposer sur un système déclaratif, qui exigera, des bénéficiaires, la fourniture d’un certain nombre de justificatifs et, des caisses d’allocations familiales, un important travail de vérification et de gestion. Les CAF semblent prêtes à gérer cette nouvelle prestation, mais il est permis de penser que le calcul des primes d’activité sera un exercice complexe et que le risque d’erreurs restera élevé. Certes, des échanges d’informations entre l’administration fiscale et les CAF sont annoncés, mais ils ne devraient être automatisés qu’à la fin de l’année 2016.
Monsieur le ministre, le Gouvernement manque d’ambition dans ce projet. Au lieu de « replâtrer » le RSA activité existant, il aurait pu proposer une véritable réforme reposant sur un mécanisme automatique de soutien financier aux travailleurs modestes, lié à l’imposition des revenus.
Paradoxalement, au moment même où le Gouvernement annonce la mise en œuvre progressive du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, il abandonne toute orientation en ce sens dans ce texte. Il s’agirait pourtant d’une simplification majeure par rapport aux simples aménagements qui sont ici proposés.
Quatrièmement, l’ouverture de la prime d’activité aux étudiants et aux apprentis soulève au moins une question de principe, que nous voulons introduire dans ce débat afin qu’elle soit tranchée, même notre lecture diverge ici de celle qu’en fait la commission des affaires sociales. Compte tenu des seuils d’éligibilité retenus – environ 900 euros –, ne risque-t-on pas d’encourager les étudiants exerçant une activité professionnelle à travailler davantage, au détriment de leurs études ? D’autres avant moi ont souligné que la population étudiante était très composite et que les situations étaient d’une très grande diversité.
Pour la commission des finances, accorder le bénéfice de la prime d’activité aux étudiants est un mauvais signal et constitue une réponse inadaptée aux difficultés que certains d’entre eux rencontrent. Nous reconnaissons, en revanche, l’effort engagé s’agissant des bourses, qui constitue, selon nous, une bonne solution.
De plus, cette extension du champ de la prime, adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement, est paradoxale au regard de son objectif principal : inciter et encourager l’exercice ou la reprise d’une activité professionnelle.
Concrètement, très peu d’étudiants et d’apprentis devraient finalement pouvoir y prétendre, compte tenu des critères très restrictifs envisagés. La somme prévue, de l’ordre de 100 millions d’euros, illustre mieux que tous les discours la limite du dispositif.
Le Gouvernement est ainsi prisonnier de ses propres contradictions : tout en affirmant que la prime a pour objectif d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle, il annonce l’ouverture de son bénéfice aux étudiants et aux apprentis et propose, finalement, un dispositif très circonscrit ciblant les étudiants les plus susceptibles de privilégier une activité professionnelle par rapport à leur scolarité !
L’intégration des étudiants dans ce dispositif relève d’ailleurs d’une décision politique, les études préparatoires à ce projet n’en faisant pas mention.
Notre commission des finances a par conséquent adopté un amendement qui tend à restreindre l’ouverture du bénéfice de la prime aux seuls apprentis répondant aux conditions de rémunération et de durée d’activité prévues par le texte. Nous avons souhaité déposer à nouveau cet amendement afin que le débat puisse avoir lieu en séance publique.
Enfin, d’un point de vue financier, l’enveloppe de 4, 1 milliards d’euros prévue repose sur des hypothèses de taux de recours et des paramètres de calcul difficiles à vérifier.
Le Gouvernement estime que seulement 50 % des personnes éligibles demanderont effectivement à bénéficier de la prime, mais ce taux paraît très incertain, en l’absence d’expérimentation locale préalable. Un aléa majeur pèse donc sur le coût réel du nouveau dispositif : si la totalité des personnes éligibles y avait recours, son coût atteindrait 6 milliards d’euros !
Par ailleurs, je souligne que cette enveloppe représente déjà un effort financier de 300 millions d’euros supplémentaires par rapport à ce qu’auraient coûté la PPE et le RSA activité en 2016. Or le Gouvernement propose d’élargir à nouveau le champ des bénéficiaires aux étudiants et aux apprentis, pour 100 millions d’euros de plus.
Il conviendra donc d’être très vigilant au cours de l’examen de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » du budget de l’État dans les prochaines années, sur le coût de cette nouvelle prestation. Nous avons connu les débuts – et la fin ! – du RMI, un dispositif dont le coût a été multiplié par huit ou par dix par rapport aux prévisions initiales.
Dans cette perspective, et afin d’identifier de façon plus précise les déterminants de la dépense, la commission des finances a adopté un amendement, intégré au texte issu des travaux de la commission des affaires sociales, visant à compléter le rapport d’évaluation du Gouvernement prévu à l’article 28. Ces informations pourraient, en effet, se révéler utiles pour réfléchir à des ajustements visant à contenir le coût de ce nouveau dispositif.
Pour conclure, si la prime d’activité a le mérite de gommer certains défauts de la PPE et du RSA activité, le mode de calcul et les modalités d’attribution de cette nouvelle prestation sociale restent très complexes. On peut donc regretter que le choc de simplification n’ait pas inspiré le calcul du montant, de la prime d’activité, à la fois « familialisée », individualisée et agrémentée de bonus individuels. Ces mots indiquent bien que les choses ne seront pas simples !
Sous réserve de l’adoption des amendements qu’elle a proposés, la commission des finances a émis un avis favorable à l’adoption du titre IV du présent projet de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur certaines travées de l’UDI-UC.

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, réformer le dialogue social s’impose aujourd’hui comme une absolue nécessité. Vous l’avez dit, monsieur le ministre : « Le renforcement du dialogue social en entreprise répond à une exigence démocratique, mais aussi à une exigence d’efficacité économique. Un dialogue social efficace, c’est un climat social qui favorise l’engagement et une motivation plus forte des salariés. Et c’est aussi une entreprise plus compétitive. »
Le dialogue social est en effet l’un des leviers de la performance de nos entreprises, et ce plus encore dans un contexte de crise économique extrêmement violent.
Depuis trois ans, le Gouvernement privilégie le dialogue social comme méthode de travail, ce dont nous devons bien évidemment nous réjouir.
Si nous voulons que la France surmonte cette crise sociale et économique, insupportable pour bon nombre de Français, nous devons nous engager dans la voie d’un dialogue apaisé et faire confiance aux partenaires sociaux, selon les vœux du Président de la République, qui avait déclaré : « Le temps de la négociation n’est pas un temps perdu. C’est un temps gagné sur les malentendus, sur l’immobilisme, sur les conflits. » En témoignent les trois grandes conférences sociales et les cinq accords nationaux interprofessionnels signés depuis 2012.
Certes, les partenaires sociaux n’ont pas, cette fois-ci, trouvé de compromis ; cependant, quatre mois de négociations ont mis en exergue la nécessité d’une réforme. Vous avez rencontré les représentants des organisations syndicales et patronales, et ce texte résulte d’un équilibre trouvé avec les partenaires sociaux.
Cette réforme – je le répète – est indispensable. Vous avez rappelé, monsieur le ministre, que les formes actuelles du dialogue social sont issues des lois Auroux, adoptées il y a plus de trente ans Si ces lois ont permis, pour reprendre les propos de Jean Auroux, que l’entreprise ne soit plus « le lieu du bruit des machines et du silence des hommes », notre économie et nos entreprises ont changé et le dialogue social doit effectivement évoluer.
Ce texte constitue une avancée. La création des commissions paritaires régionales permettra aux 4, 6 millions de salariés des très petites entreprises d’être enfin représentés. C’est une très bonne chose, même si je doute que les délégués puissent exercer leurs missions dans des conditions satisfaisantes avec seulement cinq heures de délégation par mois. Mais c’est un bon début !
La mise en place d’institutions représentatives du personnel mieux adaptées mènera à plus d’efficacité. Reconnaissons que les règles applicables en la matière, élaborées par stratification au fil des années, sont nombreuses et complexes. La délégation unique du personnel, la possible fusion des instances de représentation ou encore la clarification de leurs compétences vont dans le bon sens, tout comme la baisse du nombre de consultations et de négociations obligatoires.
Je me réjouis également des dispositions relatives au compte personnel de prévention de la pénibilité. Il était important de simplifier ce dispositif, dont l’application entraîne un certain nombre de difficultés pour les entreprises. Il représente un progrès social majeur pour les salariés exposés à des travaux pénibles et qui arrivent à l’âge de la retraite dans des conditions physiques dégradées.
S’agissant de l’emploi, il faut saluer la création du compte personnel d’activité, celle du contrat de professionnalisation « nouvelle chance » et, surtout, la mise en place de la prime d’activité, destinée à renforcer le pouvoir d’achat des travailleurs aux revenus modestes.
Le député Christophe Sirugue l’a démontré dans son rapport, la prime pour l’emploi est trop faible, mal ciblée et versée trop tardivement. Le RSA activité, quant à lui, est une véritable usine à gaz : seul un tiers des bénéficiaires potentiels le demande ! Enfin, la coexistence de ces deux dispositifs est un facteur de complexité ; leur fusion en une prime d’activité unique nous semble donc être une bonne chose. Trop de travailleurs restent, malgré leur activité, en deçà du seuil de pauvreté, ce qui n’est pas acceptable.
Je terminerai mon propos en évoquant le régime des intermittents du spectacle, sujet que la commission de la culture connaît bien et sur lequel nous avions beaucoup travaillé en 2013, sous l’égide de notre collègue Maryvonne Blondin.
L’article 20 du présent projet de loi vise à pérenniser ce régime en inscrivant dans le code du travail le principe de l’existence de règles spécifiques d’indemnisation du chômage des salariés intermittents du spectacle. À chaque renégociation de l’assurance chômage, les artistes et les techniciens du spectacle redoutent que les annexes VIII et X ne soient remises en cause. Aussi, je souscris pleinement à cette avancée sociale pour les centaines de milliers de salariés du spectacle vivant qui, je le rappelle, participent largement au rayonnement de la culture française.
Mais nous aurons aussi l’occasion d’évoquer la modernisation du dialogue social au sein même de nos assemblées parlementaires, autour du statut de nos collaborateurs.
Vous l’aurez compris, la position que les membres de mon groupe et moi-même adopterons sur l’ensemble du texte dépendra, bien évidemment, des débats que nous aurons toute la semaine dans cet hémicycle.
Applaudissements sur les travées du RDSE et du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi a certes une portée limitée au regard de l’ensemble du domaine qu’il pourrait couvrir ; il contient néanmoins quelques dispositions importantes.
Le texte initial du Gouvernement, monsieur le ministre, aurait pu constituer une base sérieuse de discussion ; il a malheureusement été rigidifié et complexifié lors de son examen à l’Assemblée nationale. C’est la raison pour laquelle la commission des affaires sociales du Sénat a introduit un certain nombre d’améliorations et d’assouplissements.
Il me paraît indispensable, pour l’examen de ce texte, de conserver comme fil conducteur le souci de simplification et de flexibilité nécessaire au bon fonctionnement des entreprises, en particulier des PME et des TPE.
La responsabilisation des partenaires sociaux passe aussi par l’acceptation d’objectifs de simplicité et de performance.
Parmi les grands sujets abordés, la simplification du dialogue social, la création d’un compte personnel d’activité, le renforcement de la médecine du travail, la simplification du compte pénibilité et la création d’une prime d’activité peuvent permettre, sans doute, de progresser vers des dispositifs largement consensuels dans les domaines de l’amélioration du fonctionnement des entreprises et de la prise en compte des intérêts des salariés.
Ainsi, la création de la prime d’activité, qui vise à fusionner deux aides existantes, le RSA et la prime pour l’emploi, nous semble une orientation intéressante ; il faudra toutefois surmonter quelques difficultés de mise en œuvre, comme la référence aux revenus réels et la bonne coordination des intervenants, mais aussi assurer la stabilisation de l’enveloppe financière, fixée à 4, 1 milliards d’euros.
Les simplifications apportées au compte pénibilité et aux instances de représentation du personnel des établissements de plus de cinquante salariés répondent, quant à elles, à l’allégement des contraintes et à la modernisation que nous avions fortement encouragés.
Les modifications envisagées quant à la gestion du « 1 % logement » me laissent plus sceptique. En effet, même si une gestion centralisée, sous prétexte de mutualisation et d’un meilleur contrôle, semble avoir l’aval des partenaires sociaux, ce dispositif ne suscitera pas nécessairement plus d’efficacité et de réactivité au regard des besoins des territoires. L’expérience passée de la Foncière logement, lancée il y a une quinzaine d’années, n’est pas un modèle probant en termes de production adaptée de logements sociaux.
Le sujet qui génère parmi nos collègues le plus d’inquiétude, voire d’opposition, est la création, prévue à l’article 1er, de commissions régionales interprofessionnelles, ou CPRI, pour les entreprises de moins de onze salariés.
Elles ne détenaient dans le texte gouvernemental qu’un vague rôle d’information et de proposition ; cependant, l’Assemblée nationale a élargi leurs prérogatives, leur a offert un rôle de médiation, voire de négociation, et a donné à leurs membres la possibilité d’intervenir dans les entreprises.
La commission des affaires sociales du Sénat est partiellement revenue au texte initial et a soumis la possibilité de création de ces instances à des accords de branche nationaux. Sur ce modèle, il existe d’ailleurs déjà des commissions interprofessionnelles régionales dans les secteurs de l’artisanat et de l’agriculture.

Fût-elle issue d’une bonne intention, l’institution de ces commissions perpétue un mal bien français, présent dans presque chaque projet de loi : la création constante de nouvelles structures administratives – haute autorité, haut comité, commission ceci ou cela – dénuées de tout rôle opérationnel, ce qui en fait de vrais comités Théodule !
Les missions que l’on voudrait donner à ces commissions régionales doivent plutôt être directement assurées par les branches professionnelles. Celles-ci ont en effet la possibilité de créer des instances régionales de ce type pour tout ce qui concerne les négociations collectives, l’organisation du travail ou la formation continue.
Les autres fonctions à caractère promotionnel de ces nouvelles commissions, notamment la mise en valeur des métiers, peuvent aussi relever des compagnies consulaires.
Ainsi, beaucoup de dirigeants et de salariés de ces établissements de moins de onze salariés jugent ces CPRI inutiles, voire déconnectées des réalités du travail au quotidien. Il s’agit en quelque sorte d’un dialogue social fictif. On peut assez raisonnablement estimer que, dans des entreprises de cette taille, le dialogue social doit s’instaurer directement entre le chef d’entreprise et les salariés : dans la grande majorité des cas, ils se côtoient et ont des échanges quotidiens.
Enfin, quel paradoxe que d’assurer – c’est en théorie l’objectif de ce dispositif -, une meilleure représentation du personnel pour les TPE de moins de onze salariés que pour celles de onze à vingt-cinq salariés, dont un quart seulement ont des délégués du personnel !
C’est la raison pour laquelle certains membres de notre groupe et de la majorité sénatoriale ont déposé un amendement de suppression de l’article 1er.
On pourrait aussi s’interroger sur certaines mesures – vous n’en êtes pas responsable, monsieur le ministre – telles que la possibilité pour un salarié de refuser de faire valoir ses droits à la retraite jusqu’à l’âge de soixante-dix ans, alors qu’il dispose déjà de tous ses droits pour percevoir une retraite à taux plein. Encore une fois, quel paradoxe au vu de la situation actuelle de l’emploi et, surtout, vis-à-vis des nouvelles générations !
À l’heure où l’on attend encore des résultats tangibles du choc de compétitivité, même si nous avons quelques espoirs en la matière, il est important, monsieur le ministre, d’envoyer des signes encourageants aux acteurs économiques, en particulier à ceux qui travaillent dans les PME et les TPE, et de leur apporter certaines garanties de simplicité et de stabilité qu’il est peut-être encore possible de renforcer dans ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme la rapporteur applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte présenté aujourd’hui s’inscrit dans la continuité des actions du Gouvernement en faveur du dialogue social. Le Gouvernement n’a cessé, ces trois dernières années, d’accorder une place centrale au dialogue social dans l’élaboration et la mise en œuvre de ses politiques en matière d’emploi, de travail et de formation professionnelle.
Ces trente dernières années, le processus constant de mondialisation dans lequel notre économie est engagée a placé ses acteurs en situation de concurrence accrue et les encourage à rechercher une rentabilité des capitaux à court terme.
Comme nous l’avions souligné, avec mon collègue Joël Bourdin, dans notre rapport sur le pacte social, ce libéralisme a engendré une plus grande flexibilité du travail, et a ainsi profondément bouleversé le pacte social dans l’entreprise. Bien souvent, les jeunes et les seniors sont les premiers à subir les mécanismes du marché. Un véritable malaise s’est installé progressivement dans l’entreprise : d’un côté, les inégalités salariales qui se creusent ; de l’autre, les salaires stagnent.
Cette situation est liée au développement d’emplois atypiques, à la persistance du chômage, à l’effet des restructurations du tissu d’entreprises et à l’envolée des plus hautes rémunérations salariales.
Dans le même temps, en France, trop peu de salariés adhèrent à un syndicat ; ils sont donc peu représentés.
Face à ce constat, le Gouvernement, dès sa prise de fonctions, s’est attaché à mettre en œuvre les mesures de nature à favoriser le marché du travail, avec la loi relative à la sécurisation de l’emploi, qui comprend, par exemple, le compte personnel de formation, les droits rechargeables pour les demandeurs d’emploi et la modulation des cotisations patronales selon les contrats, ainsi que la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Il a également pris des mesures concernant la lutte contre la concurrence sociale déloyale, ainsi que plusieurs dispositions relatives aux conseils de prud’hommes et à l’inspection du travail. Par ailleurs, il a créé le pacte de responsabilité et de solidarité.
Le projet de loi actuellement en discussion s’inscrit dans la continuité des précédentes mesures en ce qu’il apporte un renouveau dans le dialogue social. Il vise, en effet, à accorder de nouveaux droits aux salariés et à leurs représentants, à simplifier le dialogue social, à le rendre plus efficace et, surtout, à valoriser le travail ; on ne peut que s’en féliciter.
En outre, le Gouvernement considère que le dialogue social dans l’entreprise peut être réformé dans une logique gagnant-gagnant. Moderniser le dialogue social, c’est, ne l’oublions pas, permettre à l’entreprise de réaliser de meilleures performances.
Le projet de loi comporte donc un certain nombre d’avancées, notamment pour les 4, 6 millions de salariés des TPE, auxquels il offre – enfin ! – une représentation au travers des commissions paritaires régionales. Celles-ci permettront d’encadrer le dialogue social dans toutes les entreprises, même les plus petites, de le rendre effectif, plus clair et, globalement, responsable. Lors de la discussion de ce texte, nous défendrons des amendements visant à rétablir l’obligation de créer ces commissions, et non de les rendre facultatives.
Une commission régionale interprofessionnelle, composée de dix salariés et de dix employeurs de TPE, sera instaurée dans chacune des treize futures grandes régions et outre-mer. Ces commissions pourront donner des conseils aux salariés et aux employeurs en matière de droit du travail et auront également des fonctions d’information et de concertation en matière d’emploi et de formation. Elles n’auront évidemment aucun droit d’ingérence dans la marche des entreprises, mais permettront aux salariés de très petites entreprises de bénéficier, eux aussi, d’une forme de représentation.
Cette disposition suscite des inquiétudes auprès de certains employeurs, au motif que des personnes étrangères pourraient accéder à l’entreprise. Aussi, je souhaite rappeler que les membres de ces commissions n’auront accès à l’entreprise que sur autorisation de l’employeur : le dernier mot revient donc bel et bien à ce dernier.
Ce texte reconnaît l’engagement des syndicalistes et de tous les élus.
Les taux de syndicalisation relevés par l’OCDE pour les années 2012 et 2013 sont très révélateurs : plus de 50 % en Belgique et dans les pays du Nord, 37 % en Italie, 18 % en Allemagne et en Espagne contre, malheureusement, 7, 5 % en France, soit à peine plus qu’en Estonie…
Pour lutter contre la crise des vocations syndicales, laquelle est, comme vous le savez, préjudiciable au dialogue social, il est donc prévu de valoriser les parcours professionnels des élus et des délégués syndicaux dans les entreprises, en élargissant les heures de délégation, mesure dont on ne peut que se féliciter.
Le dialogue social sera également plus paritaire : la parité hommes-femmes est renforcée, ainsi que le respect des obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle, mais ma collègue Anne Emery-Dumas développera plus longuement ce point.
Je salue l’avancée réalisée par nos collègues de l’Assemblée nationale quant à la présence des salariés dans les conseils d’administration. En effet, en supprimant la condition de la mise en place du comité d’entreprise pour les entreprises de plus de cinquante salariés, le dispositif relatif aux administrateurs sera réellement effectif, car ceux-ci pourront être présents dans les holdings employant moins de cinquante salariés, qui sont souvent le haut lieu des décisions.
En ce qui concerne la participation des administrateurs salariés, certains d’entre nous proposeront de revenir sur le seuil retenu par l’Assemblée nationale, c’est-à-dire mille employés, contre cinq mille.
Autre avancée de ce texte, un minimum de vingt heures de formation par an est prévu pour les administrateurs salariés.
De plus, ce projet de loi permet de rendre le dialogue social plus efficace. Les dix-sept obligations en matière d’information et de consultation du comité d’entreprise seront désormais regroupées en trois grands rendez-vous, qui porteront sur la situation économique et sociale de l’entreprise, ainsi que sur les orientations stratégiques.
Ce projet de loi prévoit aussi d’adapter les règles de la représentation au nombre de salariés de l’entreprise. Ainsi, la délégation unique du personnel, qui permet déjà de regrouper les délégués du personnel et le comité d’entreprise dans les entreprises comprenant entre cinquante et deux cents salariés, sera élargie aux entreprises comptant moins de trois salariés et englobera le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT. Il s’agit bien d’un regroupement et non d’une fusion : chaque institution conserve l’ensemble de ses attributions. Ainsi, le CHSCT garde la personnalité morale et aura toujours la capacité d’ester en justice.
Autre avancée concernant la santé au travail et la pénibilité, je citerai la suppression de la transmission, chaque année, à compter de 2020, de la fiche individuelle de pénibilité à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV. Cette fiche sera transformée en une fiche d’exposition : des référentiels de branche seront négociés et élaborés par poste de travail et par métier. C’est la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, la CARSAT, qui comptabilisera les droits.
Je tiens également à saluer le vote de l’Assemblée nationale concernant la reconnaissance du burn- out. La commission des affaires sociales ayant supprimé cette reconnaissance, nous proposerons un amendement tendant à préserver la possibilité de reconnaître certaines pathologies psychiques comme maladies professionnelles.
Une autre grande avancée de ce texte tient également à la création d’une prime d’activité à compter du 1er janvier 2016, afin d’encourager l’activité et le retour à l’emploi. Ce sont 5, 6 millions de personnes, dont 1, 2 million de jeunes, qui seront éligibles à cette prime. Cette nouvelle prime cible les travailleurs dont le revenu est compris entre 900 et 1 300 euros par mois. Un suivi de l’impact de cette mesure est également prévu. Ainsi, la nouvelle prime, qui est ouverte aux jeunes et dont l’accès sera plus simple, sera versée chaque mois. Ceux qui travaillent, mais qui ne gagnent pas assez pour vivre correctement, pourront alors assumer les charges nouvelles entraînées par une reprise d’activité.
La mesure concernant le compte personnel d’activité scellera l’avènement de la sécurité sociale professionnelle réclamée par les syndicats depuis trente ans. Ce compte d’activité regroupera tous les droits reconnus au salarié, c’est-à-dire les comptes formation, pénibilité, épargne-temps, ainsi que le suivi tout au long de la carrière professionnelle.
Pour en finir avec les crises successives relatives au statut des intermittents du spectacle, le Gouvernement reconnaît la légitimité du caractère exceptionnel de l’intermittence et créer un nouveau mode de négociation des règles en matière d’assurance chômage, de manière à prévenir, au travers du dialogue social, la survenance de nouvelles crises.
Pour lutter contre le chômage de longue durée, le Gouvernement met en place le contrat « nouvelle chance ». Ce nouvel outil, mieux adapté aux demandeurs d’emploi peu qualifiés, constituera une passerelle pour le retour à l’emploi, après une formation de vingt-quatre mois maximum.
En matière de dialogue social, j’ajouterai l’importance d’une formation pour les managers. Monsieur le ministre, il faut insister sur le dialogue et la confiance. Il convient de mettre du dialogue social là où il n’y en a pas, et, pour ce faire, les directions des ressources humaines doivent avoir une vision stratégique du dialogue social. Il faut accompagner les managers et les salariés en leur donnant des informations, des explications pour une bonne compréhension des objectifs et de la stratégie d’entreprise, en somme, pour un rêve partagé. C’est essentiel.
Par ailleurs, nous devons aussi, au Sénat et à l’Assemblée nationale, promouvoir le dialogue social pour faire avancer la situation des collaborateurs des parlementaires. Ceux-ci n’ont toujours pas de convention collective, alors que le dialogue social permet principalement d’édicter des conventions collectives. En tant qu’employeur, il est crucial d’organiser notre représentation collective. Monsieur le ministre, vous connaissez très bien cette question, et il nous faudra bien un jour avancer en la matière.
Pour conclure, ce texte constitue un véritable progrès social : il garantit la représentation de tous les salariés ; il vise à soutenir l’activité des travailleurs modestes, avec la création de la prime d’activité ; il tend à favoriser le retour à l’emploi et poursuit l’effort engagé pour sécuriser les parcours professionnels des travailleurs, qu’ils aient un emploi ou qu’ils soient en recherche d’emploi.
Notre pays doit se moderniser en matière de dialogue social.
Le dialogue social n’est pas un frein à la compétitivité, et simplification ne signifie pas recul des droits des salariés.
Contrairement à ce que l’on constate chez nos voisins européens, en Allemagne ou dans les pays d’Europe du Nord, le dialogue social et la participation des salariés aux instances de décision sont souvent perçus par les employeurs français comme des contraintes, et non pas comme une plus-value. Nous devons donner un nouvel élan aux relations avec les partenaires sociaux. Cette démarche est d’autant plus pertinente que la Commission européenne a récemment annoncé qu’elle souhaitait, au lendemain de la crise, redonner une impulsion aux relations avec les partenaires sociaux. Ces relations sont déterminantes dans la mise en place d’une nouvelle gouvernance économique.
Ce projet de loi a, je le sais, suscité des inquiétudes dans les TPE et les PME. Mais, je le répète, ce qui prime dans ce texte, c’est la volonté du Gouvernement de favoriser l’activité et l’emploi dans les entreprises. Les mesures permettant de faciliter l’embauche du premier salarié, d’assouplir l’utilisation des contrats de travail, de lever les inquiétudes liées au recours aux prud’hommes, de lutter contre la fraude et d’encourager à franchir les seuils, sont autant de dispositions en faveur des entreprises et de l’emploi.
Jamais auparavant on n’avait vu un gouvernement s’engager si fortement en ce domaine. Alors, oui, ce texte marque véritablement un progrès !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’interviendrai sur le début du projet de loi, laissant mon collègue Jean Desessard s’exprimer sur la suite du texte.
Alors que nous connaissons une situation économique et sociale très difficile, le texte dont nous débattons aujourd’hui nous semble fondamental, car il définit les cadres de la démocratie en entreprise, du dialogue entre salariés et employeurs, garant de la qualité de vie au travail et de la bonne santé de tous, y compris des entreprises.
Ce dialogue doit pouvoir concerner tous les salariés. À cet égard, nous saluons la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, qui, bien que dotées de modestes moyens, permettront à 4, 6 millions de travailleurs de pouvoir être représentés. Nous nous félicitons également des articles visant à sécuriser les parcours syndicaux et, plus généralement, à développer la démocratie sociale.
Nous sommes, en revanche, bien plus réservés, pour deux raisons au moins, sur les modalités de création des délégations uniques du personnel, les DUP : les comités d’entreprise, les délégués du personnel et les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail vont être rapprochés, pour ne pas dire fusionnés.

Tout d’abord, il nous semble paradoxal de permettre la création des DUP sur la seule volonté de l’employeur dans les entreprises de moins de trois cents salariés et de la conditionner à un accord d’entreprise dans celles de plus de trois cents salariés. Pourquoi prévoir la possibilité d’une décision unilatérale, alors que nous parlons de favoriser le dialogue social ? Comment peut-on confier une mission de dialogue et de concertation à une instance qui serait créée sans dialogue ni concertation ?
Dans toutes les entreprises, salariés et employeurs doivent pouvoir se mettre d’accord sur le fonctionnement de l’instance représentative. Nous souhaitons donc que la création de cette DUP dépende d’un accord d’entreprise, quel que soit le nombre de salariés.
Ensuite, la dilution des capacités d’action du CHSCT nous inquiète. Cette instance nous semble pourtant indispensable ; ces dernières années, les exemples de son utilité n’ont pas manqué dans tous les secteurs d’activité comme l’hôtellerie, l’industrie ou encore le service public. Qu’il s’agisse de conditions de travail trop difficiles, qui entraînent, notamment, des troubles musculo-squelettiques, qu’il s’agisse de cadences trop élevées, de contacts mal protégés avec des substances chimiques ou dangereuses, le CHSCT joue un rôle fondamental de lanceur d’alerte et de protecteur contre les risques au travail, qui peuvent être, par ailleurs, mal évalués.
Je le répète, le mieux-être au travail et la santé des salariés ne peuvent que favoriser la qualité du travail et la bonne santé de l’entreprise.
Le regroupement en DUP ne doit pas se faire au détriment des prérogatives spécifiques, et essentielles, du CHSCT. On le sait bien, les trois instances concernées n’ont pas les mêmes objectifs, et le CHSCT ne doit pas être le parent pauvre de ce regroupement.
Vous l’avez compris, nous tenions à souligner les points positifs de ce projet de loi, mais aussi les sujets d’inquiétude. Nous nous prononcerons sur l’ensemble en fonction du débat.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte que nous examinons s’inscrit dans la lignée de l’accord national interprofessionnel sur la compétitivité et la sécurisation de l’emploi et du projet de loi Macron : il conduit, en effet, à de nouveaux reculs pour les droits des salariés !
Ce projet de loi vient en débat alors que le Gouvernement annonce de nouvelles mesures qui visent notamment à davantage exonérer les employeurs de leurs responsabilités, telles que la suppression de certains seuils sociaux, privant ainsi les collectivités territoriales de 500 millions d’euros de versement transport – qui paiera d’ailleurs cette générosité ? –, ou encore le gel pendant trois ans des effets du franchissement des seuils de cinquante salariés.
Monsieur le ministre, derrière la volonté apparente de moderniser le dialogue social dans les entreprises, qui se traduit ici par la modification des règles de représentation des salariés, vous affaiblissez davantage encore les droits des salariés, notamment celui de se défendre au sein de l’entreprise.
Lorsque vous mettez en avant la création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les 4, 6 millions de salariés travaillant dans les très petites entreprises, vous oubliez de préciser que ces commissions seront extrêmement éloignées géographiquement des salariés et que les membres de ces commissions auront, en réalité, très peu de pouvoirs.
En outre, vous portez un coup supplémentaire aux salariés en étendant la délégation unique du personnel, la DUP, aux entreprises de moins de trois cents salariés ! En effet, ceux-ci verront probablement disparaître, à terme, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le CHSCT, au profit de cette délégation unique.
À tout le moins, le rôle des comités sera affaibli, car, au sein de la nouvelle DUP, les mêmes élus, pourtant moins nombreux et dotés d’un crédit d’heures de délégation moins élevé, devront tenir tous les rôles : celui de délégué du comité d’entreprise, de délégué du personnel et de membre du CHSCT. Chacun devra donc acquérir des compétences dans des domaines aussi techniques et divers que l’analyse du budget d’une entreprise, la maîtrise du droit du travail, de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
Le risque est donc grand que ces différents sujets, particulièrement la santé, la sécurité et les conditions de travail, soient traités d’une manière moins approfondie qu’auparavant.
Enfin, en renvoyant à un décret le détail des moyens alloués aux différentes instances représentatives du personnel, vous ne nous rassurez pas sur la réalité de vos objectifs !
Par conséquent, nous déposerons des amendements visant à inscrire dans le texte que le nombre d’heures de délégation et de représentation des salariés sera le même dans le cadre de la DUP qu’avant le regroupement.
Nous souhaitons également nous opposer fortement à la suppression de l’autonomie et de l’indépendance des CHSCT. C’est un véritable enjeu pour les employeurs que de restreindre les possibilités et les moyens dont dispose ce comité pour mettre en évidence les risques qu’encourent les salariés.
Actuellement, le CHSCT ne dispose d’aucun budget propre. En conséquence, c’est à l’employeur qu’il revient de fournir au comité les moyens nécessaires à son fonctionnement dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Demain, ce ne sera plus le cas, puisque le budget du CHSCT sera intégré au budget de la délégation unique, et les prérogatives nécessairement limitées. À titre d’exemple, les missions d’expertise, qui sont actuellement réalisées, soit à l’initiative du comité d’entreprise, soit à l’initiative du CHSCT, seront soumises à des délais restreints et limitées par la prise en charge financière de l’employeur, à hauteur de 20 %.
Monsieur le ministre, en rassemblant les négociations obligatoires en trois séquences – rémunération et temps de travail, qualité de vie au travail, et emploi –, vous avez écarté de facto des sujets importants comme celui de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes !
Malgré la mobilisation des associations féministes et de personnalités politiques, le rapport annuel de situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, obligatoire depuis 1983 pour les entreprises de plus de cinquante salariés, a été supprimé et n’a pas été rétabli pour le moment. Ce n’est pas avec la création d’une simple rubrique sur l’égalité professionnelle dans la base de données économiques et sociales que les droits des femmes avanceront véritablement dans l’entreprise. Nous déposerons donc des amendements qui visent à créer des dispositifs en faveur de l’égalité professionnelle, notamment le rétablissement de la négociation consacrée à l’égalité professionnelle, accompagnée de sanctions.
Ce texte prévoit aussi la création d’une prime d’activité, dont l’enveloppe financière, qui reste pourtant constante, doit couvrir un nombre plus élevé de bénéficiaires que pour la prime pour l’emploi et le RSA activité, auxquels elle se substitue. Cette prime, qui tient compte des ressources du foyer fiscal, est considérée comme un soutien au pouvoir d’achat et un encouragement à la reprise d’emploi. Toutefois, sa montée en charge financière nous semble aléatoire, car elle dépendra du taux de recours, dont on sait qu’il est très bas pour le RSA actuel et dont il faut souhaiter qu’il remonte, évidemment !
Nous sommes convaincus que cette mesure sera en fait d’une portée limitée, et qu’elle ne pourra pas régler la question, fondamentale, de la progression de la pauvreté dans le salariat, le phénomène des travailleurs pauvres. Or l’explosion des contrats courts et atypiques, le nivellement par le bas des salaires sont une réalité, aujourd’hui, de plus en plus prégnante !
Nous pensons, pour notre part, que le Gouvernement aurait dû donner la priorité à la revalorisation des salaires, en premier lieu à celle du SMIC, et à la reconnaissance par les entreprises des compétences, des diplômes et des qualifications, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui, en particulier pour les jeunes.
Enfin, en ce qui concerne le régime d’indemnisation des intermittents du spectacle, lors de l’examen du texte en commission, la droite sénatoriale a supprimé le dispositif prévu pour l’élaboration des règles des annexes VIII et X, en votant un dispositif de concertation renforcée, ce qui ne correspond pas à l’accord trouvé par les organisations du spectacle. Sur ce point comme sur d’autres, nous avons trop souvent pu constater la proximité idéologique entre la droite et le Gouvernement !
Si nous sommes favorables à une modernisation de la représentation des salariés au sein des entreprises, elle ne peut conduire qu’à des droits nouveaux pour les représentants des salariés ! Nous montrerons, tout au long des débats, notre volonté de nous opposer à toutes les tentatives – d’où qu’elles émanent ! – de réduire les droits des salariés et leur pouvoir d’intervention. C’est pourquoi nous avons déposé 85 amendements sur ce projet de loi.
Sur le fond, nous combattrons la posture idéologique qui veut que la participation des salariés à la vie de leur entreprise, leur consultation et leurs droits d’intervention, soient, eux aussi, des contraintes, alors qu’il s’agit au contraire de leviers incontournables de la performance économique !
Je regrette sur ce point les revirements du groupe socialiste et du ministre, sous le prétexte, trop facile, de la simplification ou de la rationalisation.
Pour notre part, nous resterons fidèles aux idées de la gauche et voterons contre ce texte qui, en l’état, consacre des reculs graves en matière de droit d’information et d’intervention des salariés dans les entreprises.
Applaudissements sur les travées du CRC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, alors que les enjeux économiques et sociaux n’ont jamais été aussi prégnants, compte tenu de la fragilisation de la cohésion sociale et, donc, de la cohésion nationale, nous voici réunis autour de ce projet de loi relatif au « dialogue social et à l’emploi » !
L’intitulé de ce texte, monsieur le ministre, reconnaissons-le, est à la fois un peu réducteur et assez pompeux, car nous sommes, en réalité, en présence d’un projet de loi portant diverses dispositions d’ordre social, comme Mme le rapporteur l’a souligné dans son rapport.
D’un point de vue méthodologique, on aurait d’ailleurs pu penser que vous « muscleriez » ce projet de loi en intégrant la plupart des mesures annoncées le 9 juin dernier. Il n’en est rien ! Ce texte ne constituera que le vecteur accessoire de ces annonces – vous n’avez déposé que deux amendements, l’un sur le renouvellement des contrats à durée déterminée, l’autre sur les deux mois de période d’essai des apprentis –, puisque nombre des dispositifs que le Gouvernement a annoncés figureront dans la loi dite « Macron ».
On a même l’impression que le Gouvernement n’a peut-être pas tout programmé. En effet, au-delà des titres des mesures et de leur déclinaison au travers de quelques formules-chocs dans le dossier de presse, il n’y a pas toujours de dispositif concret ! Je pense, en particulier, aux volets relatifs à « l’accompagnement de la gestion des ressources humaines » ou à « l’entrepreneuriat des jeunes », dont la formulation reste très générale par rapport aux annonces du 9 juin dernier.
Si je souligne ce décalage, c’est parce que nous vivons une période marquée par une atmosphère de défiance vis-à-vis de la parole publique. Communiquer ou présenter ce qui semble être un beau package, c’est bien, mais gare à la déception et au retour de manivelle si les actes ne suivent pas les paroles !
Je prendrai un exemple très concret, celui de la communication gouvernementale orchestrée autour de la neutralisation des seuils pendant trois ans. En y regardant de plus près, cela ne concerne en réalité que les prélèvements fiscaux et sociaux. Toutes les autres obligations qu’entraîne le franchissement des seuils demeurent… On risque ainsi d’induire en erreur un certain nombre de nos concitoyens !
Tout cela pour vous dire, monsieur le ministre, que les salariés, les chefs d’entreprises et les chômeurs attendent beaucoup de notre part sur ce dossier de l’emploi et du dialogue social. Les enjeux sont importants au regard de la situation de l’emploi. Notre pays compte en effet 3, 5 millions de demandeurs d’emploi – pour ne parler que des chômeurs de catégorie A –, dont 615 000 chômeurs supplémentaires enregistrés depuis 2012, soit l’équivalent de mille « Florange » : ce n’est pas rien !
Il est donc urgent d’introduire de la souplesse dans le fonctionnement des TPE, des PME et des ETI, c’est-à-dire les entreprises qui créent de l’emploi.
En effet, plus le temps passe, plus le marché du travail se segmente entre ceux qui ont un emploi et ceux qui n’en ont pas.

Oui, mais tout de même ! Les premiers sont de mieux en mieux protégés, au détriment des seconds, qui connaissent des difficultés grandissantes à retrouver le chemin de l’emploi. Le statut de ceux que l’on appelle les insiders s’améliore peu à peu, mais cela accentue les difficultés d’insertion des outsiders. C’est ainsi que l’on fabrique de la précarité ou que naît la crainte de tomber dans le chômage sans jamais pouvoir rebondir. Chacun d’entre nous a pu le constater dans sa circonscription, dans son département ou même dans son entourage.
Cette situation aurait dû inciter les partenaires sociaux à trouver un accord pour rénover le dialogue social. Or il n’en a malheureusement rien été puisque, le 22 janvier dernier, les syndicats de salariés et les syndicats patronaux ont acté l’échec de leurs négociations. Lorsque le dialogue social au niveau interprofessionnel ne peut aboutir sur le thème… du dialogue social, on se trouve tout de même dans une situation hallucinante ! Si l’on veut filer la métaphore professionnelle, c’est un peu comme si un garagiste avait renoncé à réparer des voitures, ou un médecin à soigner ses patients !
Triste symbole, en vérité, qui montre combien le renouvellement démocratique, que les Français semblent pourtant appeler de leurs vœux, est une nécessité qui ne concerne pas que la classe politique – loin de là ! – et qu’un certain nombre d’instances seraient également bien inspirées de tenir compte des attentes de nos concitoyens !
En effet, le dialogue social au niveau interprofessionnel nous rappelle la formule que le regretté Edgar Faure, sans doute trop sévère à l’égard de nos assemblées, appliquait au Sénat ; je veux parler du fameux triptyque : litanie, liturgie, léthargie.
Oui, il y a bien une liturgie du dialogue social – je le dis, monsieur le président, pour celles et ceux qui n’ont pas eu le bonheur de participer aux réunions de commission et qui nous rejoignent aujourd’hui ! – avec ses portes claquées, ses accords trouvés, ou non. Ce qui signifie qu’il peut y avoir accord…pour ne pas trouver d’accord ! Car « c’est compliqué, tu sais », nous dira-t-on sur le ton de la confidence.
M. Roger Karoutchi sourit.

De ce fait, au niveau interprofessionnel, tout accord est souvent trouvé sur la base du plus petit dénominateur commun : il est donc sans ambition véritable. À l’inverse, lorsqu’il y a désaccord, le dialogue est bloqué.
Cette situation n’est pas satisfaisante et, au-delà des mesures ponctuelles que vous proposez, monsieur le ministre, il est temps de repenser le dialogue social « de la cave au grenier » ! Mener à bien un tel chantier prendra sûrement les deux ans à venir. Les Français devront trancher, mais cela ne doit pas nous interdire d’en tracer les perspectives pour alimenter le débat.
(Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.) Il s’agit d’un clin d’œil, mes chers collègues !
Sourires.

Alors que faire, pour reprendre l’interrogation de Vladimir Ilitch Oulianov? §
Nouveaux sourires.

Pour ma part, je pense que le temps des décisions verticales, partant du haut vers le bas, est révolu. Cela correspondait à l’ancien ordre social, celui du XXe siècle. Aujourd’hui, dans la société « horizontale » qui est la nôtre, la priorité doit être au contraire donnée à la base, au terrain, et ce dans tous les domaines. Du reste, l’échec du 22 janvier dernier ne doit pas masquer les 36 000 accords d’entreprises conclus en 2014.
Inversons donc le paradigme ! Laissons en priorité le dialogue social se renforcer à la base en lui confiant un champ toujours plus vaste. Mieux vaut, en effet, un bon accord au niveau local qu’un mauvais accord au niveau national. De ce point de vue, je trouve la notion de subsidiarité intéressante : elle peut aussi bien s’appliquer à l’organisation politique qu’à la démocratie sociale. Il me faut évoquer ici Pierre-Joseph Proudhon, penseur disparu voilà cent cinquante ans dont nous pouvons regretter la richesse et la fécondité de l’œuvre.
C’est surtout un penseur pour la classe ouvrière !

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Vous le voyez, monsieur le ministre, mon socialisme ne pouvait être qu’autogestionnaire !
Nouveaux sourires.

Pierre-Joseph Proudhon a tenu sur le fédéralisme des propos qui peuvent nourrir aujourd'hui notre réflexion sur la démocratie sociale, au prix d’une certaine adaptation – nous ne sommes plus au XIXe siècle.
Le code du travail comprend un appareil de normes très dense. Retenons-en les principes fondamentaux –l’Organisation internationale du travail indique bien la voie de ce point de vue – et permettons, dans le cadre du dialogue au sein de l’entreprise, des dérogations sur des sujets lourds par accord majoritaire.
D'ailleurs, ce débat sur un code du travail plus accessible, plus efficient et mieux adapté aux réalités du terrain a été relancé récemment par l’essai rédigé par l’éminent Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen. Selon notre ancien collègue, « si nous ne parvenons pas à dissiper la défiance actuelle et si nous continuons à penser que c’est à coup de lois successives qu’on réduira le chômage, nous continuerons sur la voie où nous sommes. Une voie qui nous mène, hélas, vers un avenir politique et social menaçant. » Ces paroles me semblent empreintes de sagesse !
Vous le voyez, monsieur le ministre, il s’agit non pas de lubies, de dogmatisme, mais d’efficacité économique et sociale, au travers d’un renouveau du dialogue social.
Le projet de loi, à l’aune de ces perspectives révolutionnaires, au sens où l’on inverse totalement la méthode, reste un peu conservateur.
Ainsi, comme Mme la rapporteur l’a souligné, la question des seuils a été effleurée, mais pas traitée au fond. Pourtant, j’ai en tête les propos volontaristes tenus par le Président de la République lors de sa rentrée sociale du 20 août 2014 : il avait alors appelé chacun à « admettre la nécessité de lever un certain nombre de verrous ». Vous-même et votre collègue le ministre de l’économie étiez d’ailleurs initialement très ambitieux en matière de rehaussement et de simplification des seuils…
Aujourd’hui, qu’en est-il ? Certes, la délégation unique du personnel, la DUP, est rendue possible pour les entreprises de 200 à 300 personnes, mais cela ne concerne potentiellement que 3 000 entreprises et 600 000 salariés. Certes, un organe sui generis pourra voir le jour pour les entreprises employant plus de 300 personnes, mais rien n’est prévu pour les entreprises de 50 à 300 salariés. Quant aux entreprises comptant moins de 11 salariés, la création législative des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, les CPRI, est un peu perçue comme un chiffon rouge.
On le voit, la souplesse introduite pour les entreprises de plus de 200 salariés a pour contrepartie l’immobilisme ou la création de nouveaux dispositifs s’appliquant aux entreprises en deçà de ce seuil.
Les entreprises de 1 à 50 salariés auront à faire face à pas moins d’une soixantaine de nouvelles obligations, aux termes du dossier de presse distribué lors de votre conférence du 9 juin dernier, monsieur le ministre. Ce « changement de monde » effraie légitimement de nombreux chefs d’entreprise.
En outre, soyons attentifs à ne pas alourdir les dispositions relatives à la DUP. Je pense en particulier au fait que les suppléants pourront siéger aux côtés des titulaires, à la suite de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale. Tout cela a un coût, à la charge de l’employeur. Il ne faudrait pas « tuer le produit » avec des dispositions qui constitueraient des freins. Pour ma part, je proposerai, au contraire, d’accélérer la mise en place des DUP, au travers d’un amendement qui a été adopté par la commission des affaires sociales.
Venons-en aux commissions paritaires régionales, dispositif dont l’introduction dès l’article 1er du projet de loi a valeur de symbole, y compris pour les chefs d’entreprise concernés. Nombre d’entre eux conduisent le dialogue social au quotidien et accompagnent même volontiers leurs salariés dans leurs démarches pour se loger ou régler des questions administratives. En effet, il est dans leur intérêt de contribuer au bien-être de salariés dont le savoir-faire est précieux et qu’ils ont souvent formés.
La création des commissions paritaires régionales est perçue comme une contrainte supplémentaire par 66 % de ces chefs d’entreprise. Si, sur le papier, le dispositif que vous avez imaginé semble imposer peu de contraintes, reste le problème de l’effet cliquet ! Toute nouvelle instance cherche à établir sa légitimité et à renforcer ses pouvoirs. Le législateur peut tout à fait décider demain de leur attribuer des prérogatives qu’il n’entend pas leur confier aujourd'hui… Cette situation explique les inquiétudes des chefs d’entreprise.
D'ailleurs, la CFDT, à l’issue de la présentation de votre projet de loi, a publié un communiqué de presse, dans lequel elle se réjouissait de la création des commissions paritaires, mais demandait qu’une mission de médiation leur soit confiée. Et voilà que, par le biais de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, cette demande a été satisfaite… De la même manière, le texte prévoit désormais l’accès aux locaux de l’entreprise.
À cet égard, j’ai eu la surprise de recevoir un courrier recommandé avec accusé de réception adressé par une centrale syndicale, qui entendait porter ainsi à la connaissance du parlementaire que je suis ses arguments dans la perspective de l’examen du présent projet de loi. J’ai trouvé la méthode un peu spéciale… Si c’est ainsi que l’on s’adresse aux parlementaires, je n’ose imaginer comment sont traités les chefs d’entreprise !
Nous défendrons un amendement de suppression de l’article 1er. À tout le moins, cet article devra être récrit totalement. D'ailleurs, Mme la rapporteur s’est attelée à cette tâche, en élaborant une rédaction qui fait confiance aux partenaires sur le terrain.

M. Jean-Baptiste Lemoyne. J’évoquerai brièvement cet objet législatif non identifié qu’est le compte personnel d’activité. L’article qui en traite est très déclaratif. En réalité, il n’était pas nécessaire de recourir à la loi : il s’agissait plutôt en l’occurrence d’obtenir un effet d’annonce, lié à la préparation d’un certain congrès…
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Roger Karoutchi s’esclaffe.

Les considérations tactiques qui ont inspiré cet article ne nous ont pas échappé !
Plus sérieusement, je pense qu’il faut faire attention à ne pas créer une usine à gaz. En outre, un certain nombre de questions demeurent en suspens : qui va payer la portabilité de ces droits ? Comment le partage va-t-il se faire entre l’entreprise quittée par le salarié et celle qui l’accueille ? On le voit, beaucoup de points restent à éclaircir, au-delà de la déclaration de principe.
Un économiste qui n’est pourtant pas connu pour des prises de position libérales ou droitières a déclaré, lors de son audition par la commission, que ce texte marquait un « pas de fourmi ». Il nous revient de vous aider à allonger le pas, monsieur le ministre ! Le travail précis accompli par la commission des affaires sociales, sous la houlette de son président et de Mme Procaccia, va dans ce sens. Nul doute que les débats feront émerger des avancées pour donner à ce texte l’ambition qu’il aurait dû avoir dès le début.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI -UC.

Monsieur le ministre, il y a près d’un an, vous invitiez les partenaires sociaux à ouvrir une négociation pour revivifier le dialogue social au sein des entreprises. Vous aviez pour but de renforcer la qualité du dialogue social, pour en faire un outil encore plus efficace, au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation des salariés.
Cinq mois plus tard, devant l’échec des négociations entre partenaires sociaux, vous voulez imposer par la loi votre vision de la modernisation du dialogue social.

M. Olivier Cadic. Voilà qui est bien emblématique d’une vision totalement dépassée du dialogue social
M. Jean Desessard s’exclame.

Lorsque l’on sait que le Gouvernement interviendra pour imposer ses vues en cas d’échec des négociations, que se passe-t-il ? Soit les accords sont bâclés, soit c’est l’échec. Nous nous situons dans ce second cas de figure.
Une fois de plus, dans notre pays, le jacobinisme prend le pas sur le dialogue décentralisé. Cette conception rigide et contrainte du dialogue social a pour corollaire que l’on se trompe totalement sur la vitalité de ce dernier.
On a tendance à croire que le nombre d’accords collectifs conclus en France est la marque de cette vitalité.

Non, car en fait, paradoxalement, c’est parce qu’il y a beaucoup de contraintes législatives que beaucoup d’accords sont signés : pour être en règle, les entreprises sont obligées de négocier tous azimuts.
Le grand nombre d’accords conclus ne signifie pas que ceux-ci sont de bonne facture ni, surtout, qu’ils sont de nature à produire un dialogue social fructueux et apaisé, bien au contraire !
Le résultat, c’est qu’il ne se passe plus une semaine sans qu’une personnalité politique ou du monde des affaires ne s’alarme publiquement de l’obésité sclérosante du code du travail. Pas plus tard que ce week-end, c’est notre ancien collègue, estimé de tous, Robert Badinter qui s’en est pris au sacro-saint code du travail.

Le présent projet de loi ne déroge pas à la règle : force est de constater qu’il a été considérablement allongé et politisé, le nombre de ses articles passant de vingt-sept à cinquante-sept à l’issue de son examen par l’Assemblée nationale.
Représentation des salariés des TPE, modernisation des institutions représentatives du personnel, dispositions relatives à la santé des travailleurs et au compte personnel de prévention de la pénibilité, indemnisation des intermittents du spectacle, sans parler de diverses mesures comme la création de la prime d’activité : ce catalogue de dispositions fourre-tout, dont on discerne mal la cohérence, n’est pas exempt, nous l’avouons, de mesures de souplesse et de simplification, que nous soutiendrons.

Le voilà au moins simplifié : nous ne pouvons que nous en réjouir.
Néanmoins, l’article 1er demeure inacceptable pour un certain nombre de membres du groupe UDI-UC. Alors que notre économie se meurt littéralement, alors que nos entreprises sont proprement asphyxiées par les règles, les contraintes et les taxes, alors que les PME, qui représentent 95 % du tissu des entreprises françaises, ne réclament qu’une chose, de la simplification, que faisons-nous ? Nous créons des commissions paritaires régionales interprofessionnelles… Alors que les TPE-PME ne nous demandent qu’une chose, de la souplesse, nous voici réunis pour créer un nouveau « machin ». On marche littéralement sur la tête ! C’est le monde des Shadoks !
À quoi vont servir les CPRI ?
Si elles interviennent dans le dialogue social, ce sera catastrophique. En effet, dans les PME, le dialogue social doit se tenir directement et exclusivement entre le dirigeant et les salariés.
Si elles n’ont qu’un rôle d’information, pourquoi imposer leur création ? Les branches peuvent déjà volontairement les créer.

C’est là un nouveau choc de complexification… On crée encore une nouvelle structure représentative pour des syndicats qui, rappelons-le, ne représentent que 5 % des salariés du privé !

En somme, on vient rajouter des contraintes dans la gestion des très petites entreprises, tout en déresponsabilisant les acteurs sociaux. Une fois encore, nous sommes totalement à côté de la plaque ! Que l’on ne vienne pas s’étonner ensuite que la courbe du chômage ne s’inverse pas…
Si cela suffisait à inverser la courbe du chômage…

M. Olivier Cadic. Dirigeant d’une PME depuis plus de trente ans, si cet article 1er devait être maintenu, je ne pourrais me résoudre à voter un texte qui s’éloigne des valeurs fondant la liberté d’entreprendre, sans lesquelles nous ne sortirons jamais la France de l’ornière.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Croyez-vous vraiment, monsieur le ministre, que toutes les mesures que vous prenez en faveur des syndicats pour accroître leur présence dans les TPE et les PME vont pousser les entrepreneurs à embaucher ? C’est pourtant la principale préoccupation du Président de la République et la vôtre, si j’en crois l’intitulé de votre texte : « projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi ».
Le nombre des demandeurs d’emploi a augmenté de plus de 600 000 depuis l’élection du Président Hollande, et cette tendance se poursuivra, malgré la multiplication des emplois aidés, des contrats d’avenir et la création de la prime d’activité, toutes mesures qui nous coûtent chaque année plus de 5 milliards d’euros, financés par l’emprunt, sans compter les aides diverses proposées aux chefs d’entreprise, qui n’embaucheront pas tant qu’ils n’auront pas suffisamment de commandes. Comprenez cela une fois pour toutes !
Quant à cette loi, elle va accroître les charges et les contraintes, déjà trop élevées, qui pèsent sur toutes les entreprises. Les TPE ne veulent pas voir des délégués syndicaux s’immiscer dans leur activité et venir les contrôler ! La CGPME et l’Union professionnelle artisanale vous ont pourtant alerté sur cette situation, mais vous ne voulez pas les entendre !
Vous ne savez sans doute pas que les entreprises, petites et grandes, demandent avant tout qu’on les laisse travailler et gérer leur personnel comme elles l’entendent, c’est-à-dire en embauchant quand elles en ont besoin et en licenciant quand la charge de travail diminue. C’est ainsi que les choses se passent aux États-Unis, où les contrats de travail ne comportent jamais de mention de durée. C’est ce que l’on appelle la flexibilité du travail, dont les syndicats et vous-même, monsieur le ministre, ne voulez pas entendre parler, croyant que la limitation des licenciements entraînera une diminution du chômage.
Or c’est le contraire qui se produit, car plus vous augmentez les contraintes pour les licenciements, moins les entreprises embauchent. C’est la cause principale de la croissance du chômage en France, qui ne s’arrêtera que lorsque vous mettrez en place des CDD illimités et des contrats de mission ou de projet. Tout le reste ne sert à rien ! Ces contrats pour la durée d’un chantier ont fait leur preuve dans le secteur du bâtiment. Il n’appartient qu’à vous de les généraliser, sans aucun coût pour les finances de l’État.
Le Sénat a profondément amendé votre texte pour le rendre plus susceptible de satisfaire les entreprises. J’espère que, cette fois, l’Assemblée nationale ne le modifiera pas. Dans le cas contraire, cela signifierait que le Gouvernement « gouverne » avec les syndicats, non avec les entreprises et encore moins avec les salariés.
Les syndicats refusent en effet toutes les initiatives pouvant favoriser les embauches. Ils refusent, par exemple, le relèvement des seuils sociaux, mesure que vous avez pourtant proposée et qui permettrait de procéder immédiatement à des milliers d’embauches. Ils refusent la flexibilité de l’emploi et préfèrent le recours à des contrats aidés, prétendument d’avenir, qui nous coûtent des milliards et ne servent à rien. Il en va de même de la nouvelle « prime d’activité » dont vous faites grand cas et qui résulte de la fusion de la prime pour l’emploi et du RSA activité : elle ne créera pas le moindre emploi. Inutile d’espérer une quelconque inversion de la courbe du chômage dans ces conditions ! Vous oubliez que, pour créer des emplois, il faut des entreprises qui embauchent. Il ne suffit pas de donner une prime aux chefs d’entreprise pour qu’ils recrutent.
Je veux aussi vous rappeler, monsieur le ministre, que le dialogue social dans une entreprise ne se fait pas uniquement avec les syndicats, qui ne cherchent qu’à empêcher les entreprises de licencier et à obtenir des augmentations, sans se demander si cela risque de compromettre l’activité de l’entreprise. Monsieur le ministre, ce sont les salariés, et non les syndicats, qui sont les véritables acteurs du dialogue social. Mais cela, vous ne voulez pas l’entendre !
Il faudrait que les chefs d’entreprise puissent répondre directement aux quatre besoins essentiels de leurs salariés : le besoin de savoir, le besoin de pouvoir, le besoin de considération et le besoin d’avoir. Telle doit être la gestion normale des salariés dans une entreprise. Vous ne connaissez pas l’entreprise, monsieur le ministre ; moi, j’y évolue depuis plus de cinquante ans, et je connais d’expérience les problèmes liés aux relations avec les syndicats et le personnel.
Le besoin de savoir des salariés doit être satisfait par l’information sur la situation exacte de l’entreprise, sur le compte d’exploitation, sur le bilan, sur l’utilisation du bénéfice, sur l’autofinancement restant, sur les dividendes distribués et sur le montant de la réserve de participation, dont on ne parle jamais. Seuls les chefs d’entreprise peuvent dispenser cette information. C’est ce que je faisais lorsque j’étais président de Dassault Électronique : chaque année, je réunissais les 600 membres du personnel pour leur présenter les détails des comptes d’exploitation et du bilan, avant de donner ces informations aux actionnaires et aux syndicats. Pour mieux appréhender les décisions liées au fonctionnement et à la gestion de l’entreprise, les salariés devraient pouvoir bénéficier d’une véritable formation économique.
Le besoin de pouvoir des salariés doit être satisfait par une répartition des responsabilités permettant à chacun de jouer un rôle dans l’entreprise, de participer à son fonctionnement et à son résultat.
Le besoin de considération est primordial pour les salariés. Chacun aime que l’on s’intéresse à lui, que l’on s’occupe de lui, qu’on le consulte, qu’on le récompense ou qu’on le sanctionne, qu’on lui dise bonjour, …

… qu’on lui procure un environnement et des outils de travail à sa convenance : tout cela relève de la fonction de chef d’entreprise.
Enfin, le besoin le plus important, celui d’avoir, ne peut être satisfait qu’au travers des trois autres.
Monsieur le ministre, il est de bon sens que les augmentations de salaires soient accordées en fonction de la situation économique de l’entreprise, et non parce qu’un syndicat l’a décrété. Il en faudrait davantage, bien évidemment, mais encore faut-il que les entreprises soient à même d’en supporter le coût.
Les augmentations de salaires peuvent aussi résulter de la participation, en fonction des résultats de l’entreprise. Pour être efficace, cette participation devrait être beaucoup plus importante que ne le permet la formule obligatoire, inchangée depuis 1967 et accordant au personnel une part beaucoup trop faible des bénéfices. Heureusement, il existe des formules dérogatoires permettant aux entreprises de distribuer à leur personnel une part beaucoup plus importante de leur bénéfice. Trop peu de chefs d’entreprise en ont compris l’intérêt aujourd’hui.

Croyez bien que je déplore cette situation, mon cher collègue !
Un partage des bénéfices plus équitable entre dividendes et participation permettrait pourtant de transformer une situation de lutte des classes en un consensus social dans les entreprises.
Il serait utile d’aller jusqu’à l’égalité entre les dividendes versés aux actionnaires et la réserve spéciale de participation. C’est la formule que j’ai décidé d’appliquer voilà plus de vingt ans dans la société Dassault Aviation, à la grande satisfaction de tout le personnel, qui gagne ainsi de trois à quatre mois de salaire en plus du treizième mois.
Il faudrait supprimer la pénalité instaurée par le Gouvernement au travers du forfait social au taux de 20 %. En s’appliquant aux entreprises qui distribuent de l’argent à leur personnel, ce forfait social diminue mécaniquement la part versée aux salariés, ce qui n’est guère social…
Il existe deux façons d’améliorer le dialogue social, monsieur le ministre : en renforçant le pouvoir syndical, ce qui ne résout rien, ou en favorisant l’information directe des salariés par les cadres, ce qui est très apprécié de tout le personnel.
En conclusion, monsieur le ministre, pour améliorer le dialogue social, il serait plus efficace de permettre que toutes les entreprises interviennent directement auprès de l’ensemble de leur personnel pour satisfaire ses besoins de savoir, de pouvoir, de considération et d’avoir, plutôt que de multiplier les contraintes syndicales qui bloqueront toutes les initiatives, ne résoudront rien et conduiront à supprimer encore davantage d’emplois.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, enfin ! Nous allons, au cours de la discussion de ce projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, examiner un titre II intitulé « Conforter le régime d’assurance chômage de l’intermittence ».
Pour en arriver là, que de temps et de mobilisations de salariés et d’élus il aura fallu ! Que de souffrances aussi ! Il aura fallu que le Gouvernement se saisisse de cette question pour permettre une sortie de crise, remettre du lien entre partenaires et faire en sorte que les employeurs et les salariés du secteur culturel ne soient plus exclus lors de chaque renégociation de la convention UNEDIC.
Les intermittents du spectacle sont, aujourd’hui plus que jamais, les garants de notre richesse et de notre diversité culturelles. La culture constitue l’un des piliers indispensables du pacte républicain : elle contribue à la cohésion sociale, à l’ouverture d’esprit et au « mieux vivre ensemble » ! Au-delà, n’oublions pas qu’elle participe à la vitalité économique de notre pays et de nos territoires.
Que deviendrait la culture sans celles et ceux qui la font et qui nous font vivre tant d’émotions ? Or leur situation, pour la majorité d’entre eux, est plus que précaire. Leurs droits sociaux sont peu ou mal appliqués et les faire respecter relève d’un véritable parcours du combattant !
Conscient du rôle essentiel de la culture, le Gouvernement a réaffirmé son engagement à travers l’annonce de la sanctuarisation du budget de la culture jusqu’à la fin du quinquennat. La stabilisation de l’avenir social de ces professionnels participe aussi de la volonté politique culturelle de ce gouvernement.
L’article 20 du texte, en inscrivant dans la loi les spécificités des annexes 8 et 10, s’attache non seulement à reconnaître les particularités de ce secteur, mais aussi à pérenniser les règles de ce régime d’assurance chômage. L’engagement du Président de la République trouve ainsi une traduction concrète.
Cet article marque aussi l’aboutissement d’une série de travaux menés par le Parlement sur ce sujet depuis 2003, qu’a évoqués M. le rapporteur pour avis, dont le rapport que j’ai rédigé, au nom de la commission de la culture du Sénat, avec Marie-Christine Blandin et intitulé « Régime des intermittents : réformer pour pérenniser ».
Nous avions formulé douze recommandations, inspirées par les nombreuses auditions que nous avons menées durant plus d’un an. Certaines ont été reprises dans le présent projet de loi. La mission d’experts a permis de bâtir un cadre stable, de partager les diagnostics et d’étudier les différentes propositions entre personnes concernées. Cela ne s’était jamais fait ! Cette avancée était très attendue. Nous y reviendrons lors de l’examen de l’article en question.
Permettez-moi de souligner, avec beaucoup de satisfaction, l’avancée intervenue s’agissant du dossier des « matermittentes ». J’avais déposé, lors de l’examen de la loi du 4 août 2014 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, un amendement qui avait été adopté par le Sénat, mais rejeté par l’Assemblée nationale. Je constate que son dispositif a été introduit par les députés dans le présent texte : cela montre que le Sénat fait tout de même de bonnes propositions !
Je voudrais, pour ma part, évoquer deux points.
Tout d’abord, si les contrats à durée déterminée d’usage, les CDDU, permettent de répondre aux besoins spécifiques du milieu du spectacle, ils sont encore trop souvent utilisés abusivement.

Lors des auditions auxquelles nous avons procédé, nous avons entendu des témoignages ahurissants, concernant notamment le secteur de l’audiovisuel, même si quelques améliorations sont intervenues.
Ne pourrait-on moduler les cotisations d’assurance chômage pour les employeurs en fonction du taux de recours aux CDDU ? Ou alors, pourquoi ne pas envisager la mise en place de contrats à durée indéterminée intermittents, ou CDII, dans la lignée de l’expérimentation sur le travail discontinu menée à la suite de l’accord national interprofessionnel de 2013 ? Toujours est-il, monsieur le ministre, que je salue la décision du Gouvernement d’organiser à l’automne une conférence pour l’emploi dans les métiers du spectacle.
J’évoquerai ensuite les difficultés et la complexité des relations avec Pôle emploi.
Encore une fois, les témoignages recueillis relèvent parfois de l’univers kafkaïen : agents peu ou mal informés des spécificités de ces contrats, rejet des dossiers non motivés, application des règles variant d’une région à l’autre, définitions multiples de ce qu’est un spectacle… Que de temps perdu et d’argent gaspillé !
Mes chers collègues, la particularité du fonctionnement de ce milieu professionnel ne doit pas servir de prétexte à la précarisation de ce dernier. La disposition juridique introduite offre aux intermittents une reconnaissance officielle et une valorisation de leur travail. Le vote de cet article est indispensable à la sécurisation de leur avenir social et à la poursuite d’une politique culturelle forte dans notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – Mmes Aline Archimbaud et Françoise Laborde applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je compléterai l’intervention d’Aline Archimbaud sur le titre Ier du projet de loi en évoquant les titres suivants, notamment le compte personnel d’activité et la prime d’activité. Ces deux mesures constituent des avancées. S’agit-il de pas de fourmi ou de grands pas en avant ? Quoi qu’il en soit, les écologistes tiennent à les saluer.
En matière sociale, le mouvement écologiste a un objectif constant : regrouper et rendre universels les droits. L’émiettement de nos politiques sociales a prouvé son inefficience et son manque de visibilité auprès de nos concitoyens. Plutôt qu’un saupoudrage, avec une allocation pour tel public, un crédit d’impôt pour telle classe sociale, nous souhaitons l’avènement d’un revenu de base universel versé de façon inconditionnelle à tous les citoyens.

Nous le nommons pour notre part revenu universel ou revenu citoyen. Il constitue selon moi le meilleur moyen pour éviter à la fois la pauvreté et la concurrence entre les différentes classes sociales.

Dans cette optique, la fusion de la prime pour l’emploi et du RSA activité est une bonne mesure. Nous proposerons un amendement visant à individualiser la prime, pour qu’elle dépende non pas des ressources du foyer, mais de celles des bénéficiaires.
Donner des droits tout au long de la vie, cumulables et qui se maintiennent indépendamment des situations professionnelles : c’est l’objectif du compte personnel d’activité. Les écologistes saluent la démarche amorcée par le Gouvernement, qui permettra de regrouper le compte personnel de formation, le compte épargne-temps et le compte de prévention de la pénibilité. À une certaine époque, on aurait pu parler de « passeport social ».
Un autre article important du projet de loi concerne l’assurance chômage des intermittents. Il tient compte de la situation particulière de ces derniers, en définissant le niveau professionnel comme lieu de négociation des accords, dans le cadre défini par le niveau interprofessionnel. Toutefois, mes collègues Marie-Christine Blandin et Corinne Bouchoux présenteront un amendement tendant à clarifier l’articulation entre ces deux niveaux, qui nous semble malgré tout un peu floue, à tout le moins à préciser.
Si le cadre imposé pour les négociations est trop contraignant, il peut y avoir une remise en cause du régime de l’intermittence. L’activité des intermittents du spectacle rayonne sur de nombreux secteurs de l’économie. La solidarité interprofessionnelle doit donc être conservée. Voilà pourquoi nous proposerons de clarifier le cadre des négociations.
Nous proposerons également de rétablir un article supprimé en commission, qui visait à reconnaître les pathologies psychiques comme maladies professionnelles. Depuis trente ans, le monde du travail a fortement évolué. Burn-out : tel est le nom du mal du XXIe siècle, symptôme d’un marché qui met de plus en plus les salariés sous pression. Reconnaître le burn-out comme une maladie professionnelle, c’est commencer à réfléchir sur la finalité de notre système productif.
Telle est, présentée en quelques mots, notre analyse, globalement positive, de cette partie du projet de loi. Toutefois, notre vote final dépendra de l’équilibre du texte à l’issue de nos débats.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste et sur quelques travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi marque la volonté du Gouvernement de persévérer dans une logique de réforme mise en œuvre depuis 2012 et qui s’est déjà traduite dans les textes relatifs à la sécurisation de l’emploi et dans le projet de loi, toujours en débat, pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.
L’incapacité des partenaires sociaux à parvenir à un accord lors des négociations de janvier dernier a obligé le Gouvernement à prendre l’initiative de légiférer pour répondre à la nécessité de moderniser le dialogue social et d’améliorer l’efficacité économique. En effet, comme vous l’avez rappelé devant la commission des affaires sociales du Sénat, monsieur le ministre, « le dialogue social n’est pas seulement source de progrès pour les salariés, c’est aussi un gage de meilleur fonctionnement de l’entreprise et un facteur d’efficacité économique ».
Nous partageons l’idée que la démocratie sociale n’est pas l’ennemie de l’efficacité économique ; nous croyons même qu’elle en est l’alliée.
Sans revenir sur l’architecture du projet de loi, que mes collègues intervenus précédemment ont évoquée dans le détail, je souhaite insister sur un point particulier, qui a pu susciter des d’inquiétudes : l’impact de ce texte sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Je souhaite tout d’abord rappeler que ce projet de loi s’inscrit dans la poursuite de l’action engagée par ce gouvernement en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et pour rendre effective l’égalité professionnelle, au travers notamment de la loi du 4 août 2014.
L’un des apports majeurs de ce texte est la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des institutions représentatives du personnel. C’est une avancée notable et incontestable en direction de l’égalité professionnelle et de la juste représentation.
À partir du constat que les femmes sont aujourd’hui sous-représentées parmi les élus du personnel – selon l’INSEE, la proportion d’élues s’élèverait à un peu plus de 36 % si l’on se réfère aux procès-verbaux du premier tour, alors que les femmes représentent 47, 9 % des personnes occupant un emploi –, l’article 5 du projet de loi tend à préciser que les listes de chaque collège électoral pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise devront comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur représentation sur la liste électorale. Pour assurer son efficacité, cette mesure est assortie d’une sanction. En effet, la constatation par le juge du non-respect de ces prescriptions induira une perte de sièges pour les organisations réfractaires.
L’Assemblée nationale, sur proposition de sa délégation aux droits des femmes, avait ajouté un article 5 bis visant à étendre cette obligation de parité à la désignation des conseils de prud’hommes. La commission des affaires sociales du Sénat en ayant voté la suppression, le groupe socialiste et républicain présentera un amendement tendant à le rétablir, car il considère que le principe de parité doit pouvoir s’appliquer aux conseils de prud’hommes dans toutes les sections et tous les collèges, afin de tenir compte des évolutions sociétales, qui induisent une représentation de plus en plus importante des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris l’industrie et l’agriculture.
Les articles 13 et 14, qui simplifient et regroupent les informations et consultations annuelles obligatoires du comité d’entreprise et les négociations obligatoires en entreprise, ont fait débat, des craintes étant apparues s’agissant du maintien de l’obligation, pour les entreprises, de produire un rapport de situation comparée faisant le point sur les salaires et la situation professionnelle des femmes et des hommes dans les entreprises.
En effet, l’accord national interprofessionnel du 19 juin 2013 ayant prévu la simplification et l’amélioration de l’efficacité des négociations portant sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et le développement de l’utilisation du rapport de situation comparée, ce dernier a été intégré dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
Afin que l’effort, unanimement salué, de regroupement des consultations périodiques en trois consultations obligatoires n’amoindrisse pas la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes, une rubrique spécifique a été créée, par le biais de l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, au sein de la base de données unique. Elle devra reprendre notamment le diagnostic et l’analyse qui figuraient dans le rapport de situation comparée. De plus, les informations transmises au comité d’entreprise devront inclure toutes les informations sur l’égalité professionnelle existantes.
Par ailleurs, la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée intégrera la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Quant à la nouvelle négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle, elle s’appuiera sur les données relatives à la situation comparée incluses dans la base de données unique.
Enfin, la négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prend en compte la mixité des métiers et reprend la mention explicite de l’obligation d’établissement d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle, en l’absence d’accord collectif sur ce sujet.
Considérant que ces dispositions, améliorées par les apports de l’Assemblée nationale, lèvent les réserves qui avaient pu être émises et que ce projet de loi permettra d’améliorer de manière significative la qualité du dialogue social et constitue une avancée notable en faveur de l’égalité professionnelle, nous le soutenons sans réserve.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, du groupe écologiste et du RDSE.

Je tiens tout d’abord à saluer la qualité de l’ensemble des interventions et à me féliciter du ton employé par les uns et les autres.
Madame la rapporteur, je vous sais gré du soutien que vous apportez à certaines des mesures de ce texte, telles que l’élargissement du périmètre de la DUP et du champ des entreprises concernées. Cette disposition nouvelle, pragmatique, qui relève d’une volonté commune de simplification, permettra de regrouper certaines instances représentatives du personnel, afin de rendre plus lisible le dialogue social.
Vous avez évoqué une absence de cap. Au contraire, ce projet de loi maintient le cap fixé par le Gouvernement, en faisant confiance aux partenaires sociaux, que certains gouvernements précédents avaient pu négliger. Le dialogue social, je le redis, est la marque de fabrique de ce quinquennat.
Vous avez également évoqué un manque de vision et de cohérence. Pourtant, ce texte répond à des exigences claires. Nous entendons renforcer le dialogue social. C’est pourquoi nous permettons au personnel des entreprises de moins de onze salariés d’être représenté. Vous nous accusez de provocation : la véritable provocation serait de ne pas respecter le Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel la représentation de tous les travailleurs doit être assurée. Le dialogue social doit être plus efficace, plus vivant et porter sur la stratégie de l’entreprise.
Nous avons beaucoup simplifié le compte pénibilité. En effet, pour qu’un droit soit efficace, il faut qu’il soit simple et compréhensible. Il s’agit d’une mesure de justice, au regard des inégalités entre salariés en matière d’espérance de vie.
Madame Laborde, je vous remercie de votre soutien : nous partageons la volonté de faire du dialogue social un moyen de renforcer notre démocratie sociale et la compétitivité de nos entreprises ; ce n’est pas du tout contradictoire.
Monsieur Gabouty, vous avez reconnu que certaines mesures allaient dans le bon sens. Votre réserve principale porte sur les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, mais c’est justement parce qu’elles fonctionnent dans le monde de l’artisanat que nous avons souhaité les étendre aux TPE. J’ajouterai – c’est une divergence que j’ai avec Mme la rapporteur – que ce n’est pas sur ce point que les négociations ont achoppé. Au contraire, cette mesure figurait parmi les propositions faites par les organisations patronales. Il s’agit de mettre en place non pas des comités Théodule, mais des instances modernisées pour discuter de stratégie d’entreprise, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, afin de remédier à ce « mal français » que constitue l’inefficacité du dialogue social.
Je vous remercie, madame Schillinger, de votre soutien. Vous avez évoqué la transformation du marché du travail. Je pense moi aussi que renouveler le dialogue social, c’est donner de nouveaux droits aux salariés. À cet égard, la création des CPRI constitue une grande avancée. Cela fait longtemps que les partenaires sociaux essaient de moderniser le dialogue social, sans toujours y parvenir. En cas d’échec des négociations, il est normal que la démocratie politique reprenne la main. Les partenaires sociaux n’y ont d’ailleurs pas vu une provocation. Vous avez observé à très juste titre que si, en France, le dialogue social est vu comme une contrainte par certains chefs d’entreprise, il est valorisé dans d’autres pays. J’espère que nous parviendrons à changer les pratiques et les mentalités.
Monsieur Watrin, je ne suis pas du tout d’accord avec vous, ce qui ne vous surprendra pas. Non, il ne s’agit pas d’un texte consacrant un recul des droits des salariés. Les CPRI représentent au contraire un grand pas en avant. Je reconnais être partisan des évolutions plutôt que de la révolution.
Il est faux de prétendre que le présent projet de loi fait quasiment disparaître les CHSCT. Au contraire, les enjeux de santé au travail seront mieux pris en compte. Ainsi, tous les salariés des entreprises de plus de cinquante salariés seront couverts par un CHSCT, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. À l’heure actuelle, comme vous le savez, trois représentants des salariés, dont un cadre, siègent au CHSCT. Le projet de loi vise également à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’entreprise. Je le dis, être de gauche, ce n’est pas se contenter de l’existant, être conservateur
Mme Laurence Cohen proteste.

Concernant toujours le CHSCT, madame Archimbaud, cette instance est et restera bien le lieu privilégié de discussion des questions relatives à la qualité de vie et à la santé au travail. Il conservera, même au sein de la DUP, toutes ses prérogatives, notamment la possibilité d’ester en justice et celle de commander des expertises. Comme vous, je suis convaincu qu’une bonne qualité de vie au travail est un atout pour l’entreprise. Il s’agit d’un enjeu majeur pour la santé des travailleurs comme pour la compétitivité des entreprises. C’est d’ailleurs pour cela que la qualité de vie au travail devient un sujet à part entière d’une des trois négociations obligatoires. Il n’y aura pas de recul sur cette question.
Monsieur Cadic, l’échec des négociations ne marque pas la fin du dialogue social comme méthode. Je pense que le président du Sénat serait d’accord avec moi sur ce point. Il est légitime que le Gouvernement reprenne la main en recherchant un point d’équilibre au travers de ce projet de loi. Votre défiance envers les syndicats me semble un peu caricaturale. Il faut savoir raison garder !
Votre intervention, monsieur Lemoyne, fut de qualité. Il semble que vous soyez partisan de la révolution dans le domaine social. §Pour ma part, je le répète, je préfère les évolutions à la révolution. Dans mon esprit, il n’est pas du tout question d’inverser la hiérarchie des normes. Le dialogue social dans les entreprises est riche, bien vivant : 36 000 accords ont été signés dernièrement. Il existe aussi une négociation interprofessionnelle. En la matière, c’est la règle de droit qui rassure et l’absence de loi qui inquiète. Il est donc nécessaire de définir un cadre.
Si nous avons placé l’article concernant les CPRI en tête du projet de loi, c’est parce que ces instances répondent au principe constitutionnel de représentation de tous les salariés. Elles sont adaptées aux spécificités des très petites entreprises. Des missions de médiation ont été mises en œuvre, à titre expérimental, par les commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l’artisanat, les CPRIA, dans deux grandes régions, dont Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cela fonctionne plutôt bien. Peut-être faut-il préciser la formulation du dispositif afin d’apaiser les inquiétudes des chefs d’entreprise pour ce qui concerne l’accès aux locaux des entreprises. La commission s’est attelée à cette tâche.
En ce qui concerne le compte personnel d’activité, l’annonce de sa mise en place n’a rien à voir avec la préparation du congrès du parti socialiste ! Il s’agit plutôt d’inventer ensemble, comme l’a dit M. Desessard, une forme de droit universel ouvert tout au long de la vie professionnelle et portable.
Si je partage la volonté de M. Dassault de faire bénéficier les salariés d’un intéressement et de meilleures rémunérations via la participation, je n’entends pas nier le rôle des corps intermédiaires.
Mme Blondin a prononcé un véritable plaidoyer pour la culture. Le Gouvernement partage sa préoccupation.
Monsieur Desessard, nous souhaitons comme vous regrouper et rendre universels les droits des salariés : c’est le sens de la mise en œuvre du compte personnel d’activité.
En ce qui concerne les intermittents, j’aurai l’occasion d’apporter des précisions sur la manière dont la négociation « enchâssée », selon la formule désormais consacrée, est menée. Avec la ministre de la culture, j’ai réuni l’ensemble des partenaires sociaux, à l’échelon tant interprofessionnel que professionnel. L’équilibre que nous avons trouvé est fragile, mais il est réel.
Je remercie Mme Emery-Dumas d’avoir rappelé un aspect du texte qui avait échappé même aux plus grands défenseurs des droits des femmes : l’accord national interprofessionnel de 2013 a effectivement prévu l’intégration du rapport de situation comparée au sein de la base de données économiques et sociales unique. Il n’est bien sûr pas question de porter atteinte à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Tous les items figurant dans le rapport de situation comparée seront étudiés ; le texte le prévoit expressément. La pénalité encourue par les chefs d’entreprise qui ne s’engageraient pas dans la voie de la promotion de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est maintenue. Des progrès ont été faits dans cette direction, il n’est pas question de reculer.

La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable.

Je suis saisi, par M. Watrin, Mmes Cohen, David et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d’une motion n° 186.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44 alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, après engagement de la procédure accélérée, relatif au dialogue social et emploi (n° 502, 2014-2015).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n’excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour la motion.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, chers collègues, une nouvelle fois, nous nous retrouvons pour discuter d’un projet de loi censé simplifier la vie des entreprises et des salariés et favoriser l’emploi.
La situation économique et sociale de notre pays est telle qu’un seul texte ne peut tout résoudre. Il est à mettre à l’actif du gouvernement auquel vous appartenez, monsieur le ministre, que l’empilement des dispositifs successifs, qui peut donner une impression d’improvisation, de tâtonnements, de fébrilité, suit en réalité une orientation politique très cohérente.
En effet, toutes ces mesures, dont celles contenues dans le présent projet de loi, ne simplifieront en rien la vie des salariés, mais elles réduiront à coup sûr leurs droits. Je pourrais citer, pêle-mêle, celles du projet de loi transcrivant l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation des parcours professionnels, le fameux crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, présumé booster l’emploi, les dispositions de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, censées permettre d’atteindre l’égalité professionnelle, enfin celles du projet de loi Macron, destinées à dynamiser la croissance et l’activité.
De surcroît, les quelques mesures positives que ces textes renferment – je pense à la fixation à vingt-quatre heures par semaine de la durée minimale de travail pour le temps partiel ou au compte de prévention de la pénibilité – voient leur champ se réduire comme peau de chagrin.
Les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC et, au-delà, la majorité des syndicats dénoncent le nivellement par le bas des droits des salariés, au nom de la simplification, sans qu’aucune amélioration sur le front de l’emploi ou sur celui du pouvoir d’achat ne se fasse jour.
Plus de 5, 3 millions de chômeurs sont inscrits à Pôle emploi, d’après les statistiques de votre ministère publiées au début de juin : c’est un bien triste record. En un mois, la hausse est de 1 %, ce qui représente 54 100 personnes de plus n’ayant pas ou peu travaillé. Le chômage et la précarité touchent principalement les jeunes, les seniors et les femmes.
Vous comprendrez, monsieur le ministre, que nous ayons de sérieux doutes sur la capacité de ce texte à inverser la tendance, même si nous notons quelques avancées, comme le contrat de professionnalisation « nouvelle chance » ou les contrats aidés pour les seniors.
Mais, pour relancer l’emploi, il faut des carnets de commandes remplis. La première mesure à prendre serait donc de stopper l’hémorragie que connaissent les dotations aux collectivités, singulièrement celles qui sont destinées aux municipalités. L’Association des maires de France, l’AMF, présidée par notre collègue François Baroin, a confirmé une baisse de l’investissement du bloc communal de 12, 4 % en 2014. Ainsi, outre la dégradation des services à la population, c’est tout le tissu économique local qui a enregistré une perte sèche de 4, 3 milliards d’euros, toujours selon les chiffres de l’AMF.
Par ailleurs, faire des économies sur le budget de la nation pour financer 100 000 contrats aidés, sans distinction de secteurs d’activité, suppose que les entreprises manquent de liquidités. Or cela est difficile à croire compte tenu de toutes les facilités dont bénéficient les grands groupes, depuis les taux d’emprunts particulièrement bas sur les marchés obligataires aux divers crédits d’impôt octroyés par le Gouvernement, CICE en tête. Prenons un seul exemple, emblématique, celui de Total : avec 22, 1 milliards d’euros de liquidités, ce groupe préfère grossir les dividendes de ses actionnaires plutôt qu’embaucher ou investir !
Comme vous pouvez le constater, nous n’avons pas déposé cette motion tendant à opposer la question préalable parce que nous considérerions qu’il n’y a pas lieu de débattre de l’emploi, bien au contraire ! Nous l’avons déposée pour les raisons suivantes.
Tout d’abord, nous regrettons qu’il ait été recouru une fois de plus à la procédure accélérée. Nous dénonçons une nouvelle fois le caractère peu démocratique et peu respectueux du travail des parlementaires de cette méthode. Sur un projet de loi de cette ampleur, une seule lecture par chambre, de surcroît avec une discussion générale de seulement une heure trente, c’est insuffisant ! Pour mémoire, notre groupe avait demandé que la durée de la discussion générale soit fixée à deux heures, ce que la conférence des présidents a hélas ! refusé.
Ensuite, ce projet de loi a vu le jour en raison de l’échec des négociations entre les partenaires sociaux au mois de janvier dernier. En effet, des mois de discussion ont débouché sur une impasse totale. Il est pour le moins paradoxal – ce serait même cocasse si les conséquences n’étaient pas aussi graves – de ne pas parvenir à un accord et de ne pas réussir à dialoguer sur un texte censé améliorer le dialogue social au sein des entreprises !
S’il n’y a pas eu d’accord, c’est bien que, pour la majorité des organisations syndicales, le contenu du texte représente tout sauf une rénovation du dialogue social et une amélioration des conditions de représentation des salariés !
En fait, c’est un peu l’inverse que pour l’accord national interprofessionnel sur la sécurisation des parcours. Ainsi que vous vous en souvenez sans aucun doute, mes chers collègues, le MEDEF était parvenu à obtenir un accord, et nous parlementaires n’avions quasiment pas eu le droit de toucher au texte. Ici, c’est le Gouvernement qui choisit de transposer dans la loi ce qui devait figurer dans un accord ! C’est là une drôle de conception du débat démocratique !
Alors que l’intitulé de votre projet de loi fait référence au « dialogue social » et à l’« emploi », non seulement la partie consacrée à ce dernier thème n’est pas à la hauteur des enjeux, mais le texte ne va pas du tout, à nos yeux, dans le sens d’une amélioration du dialogue social. Comme l’a indiqué mon collègue Dominique Watrin, la création de la délégation unique du personnel, censée être un facteur de simplification, restreindra au final les espaces de dialogue et d’échange et réduira les pouvoirs des représentants élus du personnel.
À l’heure où les conflits se durcissent, face à un patronat bien souvent arrogant, et où les droits des salariés sont sans cesse attaqués, à l’heure où la criminalisation de l’action syndicale est forte, on lamine les outils permettant aux salariés de se défendre : suppression des élections prud’homales, réduction des moyens des inspecteurs du travail, remise en cause de la médecine du travail, dans un contexte d’attaques contre le code du travail !
La pression sur les salariés est telle, la menace du chômage est d’une si cruelle acuité que le dialogue à égalité entre employeurs et employés est difficilement possible.
La fameuse phrase : « si vous n’êtes pas contents, vous pouvez partir ; d’autres n’attendent que votre place » illustre bien le malaise de notre société. Nous n’arriverons pas à y remédier si nous n’accordons pas plus de place et de moyens aux représentants des salariés pour jouer leur rôle d’intermédiaires et de défenseurs des salariés !
Les salariés de notre pays ont largement le sentiment de ne pas être entendus lorsqu’ils se mobilisent. Je pense par exemple aux agents hospitaliers de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui dénoncent depuis plusieurs semaines une dégradation de leurs conditions de travail, à travers la remise en cause des 35 heures et des RTT. Combien faudra-t-il d’actions ou de manifestations pour que se noue un semblant de dialogue ?
Au-delà des salariés, ce sont aussi les associations féministes et les nombreuses personnalités qui se sont mobilisées, par le biais d’une pétition, pour maintenir les acquis issus de la loi Roudy sur le rapport de situation comparée qui ont le sentiment de ne pas avoir été entendues. Bien sûr, les discours ont pris en compte leur indignation. On a tenté de faire oublier que, dans les faits, le Gouvernement supprime l’un des dispositifs phares permettant de mesurer l’égalité professionnelle, ou plutôt les inégalités professionnelles.
Monsieur le ministre, vous avez déclaré en commission qu’« un dialogue social qui fonctionne, c’est le gage d’un climat apaisé et d’une motivation plus forte des salariés ». Nous partageons entièrement ce point de vue et l’ambition qui en découle. Malheureusement, nous ne percevons pas de cohérence entre une telle affirmation et le contenu du projet de loi. Vous vous justifiez en nous expliquant que les milliers de salariés des TPE seront désormais représentés. Certes, mais dans quelles conditions ? En dégradant la représentation des autres salariés ? Je pense notamment à la création des commissions paritaires régionales. En toute logique, avec l’émergence des futures grandes régions, elles ne seront plus que treize et les représentants des salariés seront au nombre de 130, soit six secondes de temps de discussion par salarié ! Peut-on sérieusement parler de « dialogue social » dans de telles conditions ?
Dans ce texte, comme dans de nombreux autres, nous retrouvons des mots-clés empreints de valeurs humanistes que nous partageons. Hélas, les dispositions prises produisent des effets qui vont à leur encontre.
Selon la définition du Larousse, le dialogue est une « discussion entre personnes, entre partenaires ou adversaires politiques, idéologiques, sociaux, économiques, en vue d’aboutir à un accord ». Comment ne pas voir que le recours à un système de visioconférence, sous couvert de modernité et de technologie, est un pas vers un dialogue virtuel et des relations distancées ? Comment ne pas voir que la moindre fréquence des différentes négociations est également source d’amoindrissement du dialogue ? Va-t-on proposer de recourir à la visioconférence pour les débats du Sénat ou de l’Assemblée nationale ?
Tous ces arguments expliquent que nous ayons déposé la présente motion. Nous espérons qu’elle sera adoptée, ne serait-ce que pour faire respecter le Préambule de la Constitution de 1946, qui place le dialogue social au cœur de notre contrat social : « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises. »
Applaudissements sur les travées du groupe CRC.

L’avis de la commission est naturellement défavorable.
Je doute que les chefs d’entreprise et les salariés attendent du Sénat qu’il ne débatte pas du présent projet de loi. Il nous appartient d’examiner chaque article pour améliorer le dispositif. Ne pas débattre serait renier notre raison d’être !
L’avis du Gouvernement est, bien entendu, également défavorable. J’ai relevé un certain nombre d’inexactitudes, que je ne peux pas laisser passer.
Selon l’objet de la motion tendant à opposer la question préalable, le projet de loi serait « néfaste » et comporterait « de graves dangers pour le droit syndical ». À mon avis, si tel était le cas, de grandes manifestations se tiendraient aujourd’hui devant le Sénat !
Il faut faire preuve de mesure dans le choix des termes ! Notre objectif n’est nullement de faire disparaître les organisations syndicales. Nous voulons au contraire renforcer l’attractivité des mandats syndicaux. Aujourd'hui, on compte seulement 7, 5 % de salariés syndiqués. Il est essentiel de rendre le dialogue social plus vivant, plus intéressant, de susciter des vocations. À cet égard, le texte garantit le maintien des salaires pour les titulaires de mandats lourds, met en place des dispositifs de valorisation des compétences, ainsi que de nouvelles possibilités – c’était du moins le cas dans la version initiale du projet de loi – d’utiliser les heures de délégation : ce n’est tout de même pas rien ! Certains ont parfois perdu leurs heures de délégation, faute de pouvoir se réunir au mois d’août ; avec le système de mutualisation, cela ne se produira plus.
Les auteurs de la motion indiquent aussi que l’adoption du projet de loi conduirait à la « coexistence d’instances de représentation aux attributions différentes ». Or c’est déjà le cas aujourd’hui, avec par exemple les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le CHSCT.
Enfin, je n’ai pas entendu de responsables d’organisations syndicales évoquer, comme vous l’avez fait, une « dégradation » de la situation, même quand ils n’étaient pas très favorables à ce texte.
Quant au rapport de situation comparée, les représentantes du mouvement de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes que j’ai reçues ont convenu que leurs préoccupations avaient été prises en compte.
Concernant les chiffres du chômage, je ferai observer que la catégorie C regroupe des personnes qui ont une activité. En France, elles sont comptabilisées parmi les demandeurs d’emploi, mais ce n’est pas forcément le cas ailleurs, dans des pays où l’on propose des contrats « zéro heure » ou des mini-jobs… Chez nous, certaines personnes travaillant à plein temps sont considérées comme des demandeurs d’emploi ; c’est tout de même une particularité qu’il convient de souligner !

Naturellement, le groupe socialiste et républicain est défavorable à cette motion. Ce projet de loi apporte de réelles améliorations, notamment en termes de représentation des salariés.
Nous voterons contre la motion tendant à opposer la question préalable, pour les raisons précédemment évoquées et pour celles qu’a avancées M. le ministre.

Le groupe Les Républicains votera contre cette motion, dont les auteurs, aux termes de son objet, « estiment que ce projet de loi participe d’un projet néfaste aux droits des salariés à pouvoir s’exprimer et être représentés au sein des entreprises ». Je ne crois pas que telle soit la finalité de ce texte, qui comporte un certain nombre de dispositions dont nous espérons, monsieur le ministre, qu’elles permettront d’améliorer la situation.
Les auteurs de la motion ajoutent que « ce projet comporte de graves dangers pour le droit syndical et conduirait à la coexistence d’instances de représentation aux attributions différentes ». Pourquoi cela serait-il forcément préjudiciable aux salariés ? Je pense, en particulier, à l’extension de la DUP.
Pour autant, monsieur le ministre, cela ne signifie pas que nous soyons complètement en phase avec vos propositions, s’agissant notamment de la création de la prime d’activité, dont je ne suis pas sûr qu’elle constituera une véritable incitation au travail. La question de l’emploi doit être notre première préoccupation.

Le groupe UDI-UC ne votera pas cette motion.
J’indique à M. le ministre que la délégation sénatoriale aux entreprises remettra prochainement un rapport élaboré à la suite de son déplacement à Londres, où elle a rencontré des chefs d’entreprise. Ce rapport comportera notamment des développements sur les contrats « zéro heure », dont l’appellation ne signifie pas que leurs titulaires travaillent zéro heure !

Je mets aux voix la motion n° 186, tendant à opposer la question préalable.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 210 :
Le Sénat n'a pas adopté.

La parole est à M. le président de la commission des affaires sociales.

Pour la clarté des débats, la commission des affaires sociales souhaite, à l’article 8, que l’amendement n° 159 rectifié soit disjoint de la discussion commune.

Je consulte le Sénat sur cette demande de disjonction de la discussion de l’amendement n° 159 rectifié, à l’article 8.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.