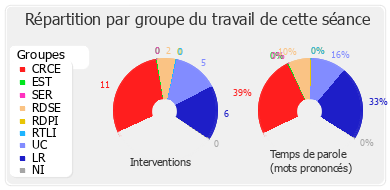Séance en hémicycle du 12 mai 2009 à 9h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Décès d'un ancien sénateur
- Questions orales (voir le dossier)
- Avertissement de l'employeur en cas de perte de permis de conduire d'un employé ayant des obligations de conduite (voir le dossier)
- Tranports scolaires et interprétation de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (voir le dossier)
- Coordination entre projets de traitement des déchets et plans départementaux en cours de révision (voir le dossier)
- Projet de décret relatif à la création d'un répertoire national commun de la protection sociale (voir le dossier)
- Situation financière des communes engagées dans des opérations de renouvellement urbain (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Raymond Dumont, qui fut sénateur du Pas-de-Calais de 1978 à 1984.

La parole est à Mme Françoise Férat, auteur de la question n° 488, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai souhaité attirer votre attention sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la nécessité d’avertir automatiquement les employeurs en cas de perte de permis de conduire d’un employé ayant des obligations de conduite.
Si l’employeur peut licencier son salarié au motif que celui-ci a perdu son permis, il n’existe à ce jour aucune procédure préventive permettant d’avertir automatiquement l’entreprise que l’un de ses employés s’est vu retirer son permis de conduire.
On constate de plus en plus souvent que le salarié qui perd son permis du fait d’infractions au code de la route au volant de son véhicule personnel dissimule cette situation à son employeur. Je pense notamment au drame survenu en février dernier à Grigny.
Une telle anomalie juridique peut entraîner des situations aberrantes, le salarié pouvant continuer à conduire durant plusieurs mois dans le cadre de son travail, sans posséder de permis.
Monsieur le secrétaire d’État, avez-vous l’intention de mettre en œuvre un système permettant d’informer l’employeur en cas de perte de permis de conduire de l’un de ses employés ?
Madame la sénatrice, vous avez raison de poser cette question compte tenu de l’accident qui s’est produit récemment et aussi parce que vous connaissez bien le monde de l’entreprise et que vous avez sans doute eu à connaître une telle situation.
En l’état actuel de la réglementation, les employeurs n’ont pas la possibilité de se voir communiquer les informations nominatives relatives à la situation du permis de conduire de leurs salariés. Le code de la route limite très précisément les personnes pouvant se voir divulguer ce type d’information.
Pour autant, à la suite de l’émoi provoqué récemment par un accident ayant fait cinq blessés et causé par un chauffeur de car faisant l’objet d’une invalidation de permis de conduire, le Gouvernement a décidé de mettre en place un groupe de travail, non pas pour enterrer cette question, mais pour étudier l’opportunité de la mise en place d’un dispositif d’information des employeurs concernant la situation du permis de conduire de leurs salariés, au regard des protections individuelles et des libertés publiques.
Ce groupe de travail sera composé des services dont relèvent ces questions au sein des ministères chargés des transports, de l’intérieur, de la justice et du travail. Les représentants des secteurs professionnels des transports y seront associés.
Les réflexions porteront notamment sur la possibilité d’annexer au contrat de travail une déclaration sur l’honneur, dans laquelle le salarié préciserait sa situation au regard du permis de conduire. De même, pourrait être mis en place un système d’alerte informant l’employeur que l’un de ses salariés fait l’objet d’une interdiction de conduire ou que le nombre de points de son permis de conduire – nous en avons débattu dans cet hémicycle la semaine dernière – est passé sous un seuil déterminé.
Je souhaite que ce groupe de travail nous fournisse des solutions avant l’été, afin que nous puissions les mettre en œuvre le plus rapidement possible.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai en effet rencontré une telle situation dans mon entreprise. Pendant plusieurs mois, un chauffeur a conduit un camion d’un gros tonnage, avec deux ouvriers à son bord. Rétrospectivement, nous avons réalisé que nous ne pouvions imaginer une telle situation !
Je me réjouis de la mise en place du groupe de travail que vous venez d’évoquer. Pour vous connaître, monsieur le secrétaire d’État, je sais qu’il n’est pas destiné à enterrer le sujet !
Sourires

La parole est à M. Jacques Blanc, auteur de la question n° 497, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Je m’adresse à la fois au secrétaire d’État chargé des transports et à l’ancien ministre de l’agriculture ayant signé la loi relative au développement des territoires ruraux.
Monsieur le secrétaire d’État, mon intervention porte sur la sécurisation de l’organisation des transports scolaires dans nos départements.
La loi relative au développement des territoires ruraux, qui a modifié la LOTI, la loi d’orientation des transports intérieurs, a permis de créer une situation favorable, dans la mesure où il est désormais précisé que, « en cas de carence de l’offre de transports, notamment suite à une mise en concurrence infructueuse, il peut être fait appel à des particuliers ou des associations inscrits au registre des transports, dans des conditions dérogatoires aux dispositions de l’article 7 prévues par décret […] ».
Il s’agit non pas de remettre en cause le rôle des professionnels et des « taxiteurs », mais de permettre à un département, confronté à un seul adjudicataire ou à des pratiques tarifaires témoignant réellement d’une carence de concurrence, de bénéficier d’une certaine sécurité lorsqu’il traite avec des particuliers ou des associations.
Qui est juge de la carence de l’offre de transports ou d’une mise en concurrence infructueuse ? Dans un département comme la Lozère, cette question revêt une importance particulière, car les sommes en jeu sont très importantes. Les départements qui ne reçoivent qu’une seule offre de transports, provenant le plus souvent de grandes sociétés extérieures, sont confrontés à d’incontestables difficultés. Ils ont besoin d’une interprétation de la disposition précitée, ce qui permettra de sécuriser leurs décisions.
Monsieur le sénateur, vous avez raison de poser cette question, qui m’intéresse également en tant que président d’un exécutif départemental.
Vous avez appelé mon attention sur l’interprétation de l’article 29 de la loi d’orientation des transports intérieurs.
La notion de carence de l’offre, notamment à la suite d’une mise en concurrence infructueuse, s’applique à tous les marchés relevant du code des marchés publics. La situation que vous évoquez ne peut donc faire l’objet d’une interprétation propre au secteur du transport scolaire ou du transport à la demande. Elle doit être appréciée au regard du droit général des marchés publics.
Ainsi, dans le cadre d’une mise en concurrence, lorsque l’unique offre remise est appropriée, régulière et acceptable au sens du code des marchés publics et qu’elle répond aux besoins exprimés par l’autorité publique, deux possibilités s’offrent à cette dernière. Elle peut soit conclure le marché, soit pour un motif d’intérêt général déclarer la procédure sans suite. La collectivité ne peut pas, en revanche, déclarer la procédure infructueuse, puisqu’il n’y a pas carence de l’offre.
En revanche, il y a carence lorsque les prix proposés sont prohibitifs ou abusifs. L’offre est alors considérée inacceptable et la procédure déclarée infructueuse.
C’est donc le contenu de l’offre unique, et non le fait que cette offre soit unique qui détermine la situation de carence et autorise l’autorité organisatrice des transports scolaires, par exemple un département ou une communauté de communes, à recourir aux particuliers ou aux associations pour ces services essentiels aux populations des départements ruraux. Je pense notamment au département de la Lozère, monsieur Jacques Blanc.
Je précise enfin qu’il appartiendrait au juge administratif, s’il était saisi par les professionnels d’un recours contre une situation de carence, d’apprécier la légalité de la mesure prise par l’autorité organisatrice. Comme vous pouvez le constater, une certaine souplesse existe, puisque l’offre peut être considérée comme inadaptée. La délicate décision finale revient aux commissions d’appel d’offres et au président de la collectivité organisatrice.

Monsieur le secrétaire d’État, la disposition que j’évoque a été introduite dans la LOTI lors de la discussion de la loi relative au développement des territoires ruraux par le secrétaire d’État à l’agriculture de l’époque, M. Forissier.
Si la notion de carence de l’offre s’applique à tous les marchés, il s’agit toutefois d’un cas d’espèce.
Si je comprends bien, monsieur le secrétaire d’État, c’est l’appréciation du montant de la proposition qui permet à l’autorité départementale en l’occurrence de déclarer la procédure sans suite. Elle considère alors que la mise en concurrence s’est révélée infructueuse, ce qui lui permet ipso facto de traiter avec des particuliers, sans prendre le risque d’une condamnation par le tribunal administratif. C’est ce qui inquiète les responsables.

La parole est à M. Michel Teston, auteur de la question n° 512, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Ma question porte sur la nécessaire sécurisation des réseaux de distribution d’électricité.
Au cours des derniers mois, la France a été touchée par plusieurs épisodes de fortes intempéries dans diverses parties de son territoire : très fortes chutes de neige dans le Massif central entre le 15 décembre 2008 et la fin du mois de février 2009 ; chutes de neige en région marseillaise début janvier 2009 ; passage de la tempête Klaus dans le sud-ouest le 24 janvier 2009 et de la tempête Quentin dans le centre et le nord le 10 février 2009.
Chaque fois, ces intempéries ont engendré de gros dégâts sur les réseaux de distribution d’électricité, privant, parfois pendant plusieurs jours, des milliers de foyers d’électricité et de chauffage, en dépit de la formidable mobilisation du personnel d’Électricité Réseau Distribution France, ERDF, et de ses prestataires, dont il faut une nouvelle fois saluer la qualité du travail.
L’importance de ces dégâts s’explique par le faible taux d’enfouissement – 37 % seulement – des réseaux de distribution d’électricité en France, combiné à la dégradation de leurs performances relevée dans le rapport annuel 2008 de la Commission de régulation de l’énergie.
Or, en dépit des annonces faites par M. le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance le 6 mars dernier, il semble que les investissements de rénovation et les prévisions d’enfouissement des réseaux ne soient pas à la hauteur des besoins de sécurisation. Ils ne permettraient pas notamment d’atteindre avant longtemps le taux souhaitable de 50 %.
À titre de comparaison, il n’est pas inutile de rappeler que l’Allemagne a enfoui plus de 75 % de son réseau de transport et de distribution.
Aussi, je souhaite connaître quels enseignements le Gouvernement a tiré des récents épisodes d’intempéries en matière de sécurisation du réseau de distribution d’électricité et quelles mesures il entend mettre en œuvre pour renforcer, en période de crise, les dispositifs de communication entre, d’une part, le concessionnaire et, d’autre part, les autorités concédantes et les usagers.
M. Jean-Louis Borloo, ministre d'État, vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser son absence.
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, la fin de l’année 2008 et le début de l’année 2009 ont été marqués par des épisodes climatiques exceptionnels : le 14 décembre 2008, à la suite d’un épisode de neige collante, 100 000 de nos concitoyens ont été privés d’électricité dans le Massif central ; le samedi 24 janvier 2009, le passage de la tempête Klaus sur le sud-ouest de la France a laissé 1 700 000 particuliers sans électricité ; enfin, le mardi 10 février, 900 000 foyers ont été privés d’électricité après le passage de la tempête Quentin sur l’ouest et le nord de la France.
Face à ces événements, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, RTE, et le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité, ERDF, ont mobilisé nombre de leurs collaborateurs, qui, malgré des conditions d’accès difficiles, ont rétabli en moins de cinq jours l’alimentation de plus de 90 % des usagers privés d’électricité, conformément aux engagements pris dans le contrat de service public conclu entre l’État et le groupe EDF.
Jean-Louis Borloo a demandé aux présidents de RTE et d’ERDF d’établir un « retour d’expérience » concernant chacun de ces événements, afin de prévenir et limiter à l’avenir leur ampleur. Par ailleurs, le ministre d’État a décidé de lancer prochainement une mission d’inspection générale afin de tirer tous les enseignements de ces événements et de proposer un plan d’action visant à sécuriser durablement les réseaux de distribution d’électricité.
L’entreprise ERDF a déjà lancé plusieurs actions de long terme. Elle s’est engagée depuis 2005 à construire plus de 90 % des nouvelles lignes moyenne tension en technique souterraine, un objectif que l’entreprise a, depuis lors, chaque année dépassé. Elle a lancé en 2006 un plan d’action « Aléas climatiques », qui prévoit notamment l’enfouissement de plus de 30 000 kilomètres de réseau moyenne tension en dix ans, ainsi qu’un programme d’élagage ciblé. Ce plan sera complété et, si nécessaire, accéléré en fonction des résultats des différents « retours d’expérience » et des travaux de la mission d’inspection.
Le gestionnaire du réseau de transport, RTE, a, lui aussi, lancé des actions de long terme.
Il a pris des engagements importants pour la mise en souterrain des lignes nouvelles dans le cadre de son contrat de service public avec l’État. En 2008, 60 % des lignes à haute tension créées ou renouvelées l’ont été en souterrain.
À la suite des deux tempêtes de 1999, RTE a lancé un vaste programme de sécurisation mécanique de son réseau dont le montant annuel sera porté de 113 millions d’euros à 180 millions d’euros.
Plus généralement, les futurs tarifs d’utilisation des réseaux permettront à leurs gestionnaires d’investir davantage, ce qui contribuera à sécuriser l’alimentation en électricité de nos concitoyens.
Je conclus mon intervention en précisant que, pour ERDF, Jean-Louis Borloo a demandé à la Commission de régulation de l’énergie, la CRE, de retenir un programme d’investissements ambitieux, intitulé « Redressement ciblé de la qualité », qui prévoit le doublement des dépenses d’investissements entre 2008 et 2012. Pour RTE, le Gouvernement a demandé à la CRE de modifier sa proposition tarifaire afin de respecter l’échéance de son programme de sécurisation mécanique, fixée en 2017.
Enfin, en ce qui concerne les dispositifs de communication en cas de crise, j’ai pu moi-même constater que le Président de la République avait, lors d’un déplacement dans le Médoc au lendemain de la tempête de janvier dernier, demandé au Secrétariat général de la défense nationale d’établir un plan de gestion de crise nationale et de mieux informer nos concitoyens.

Je vous remercie de votre réponse, monsieur le secrétaire d’État.
Les constats effectués lors des très longues et très fortes chutes de neige qui ont touché la partie montagneuse de l’Ardèche au cours de l’hiver dernier me conduisent à formuler deux séries de remarques.
La première porte sur la sécurisation des réseaux. Il convient selon moi d’aller plus loin que les prévisions du plan d’action « Aléas climatiques » de 2006, qui ne prévoit d’enfouir que 30 000 kilomètres de réseau moyenne tension en dix ans. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies demande, à juste titre, que ce programme soit porté à 50 000 kilomètres de lignes enfouies. Elle demande aussi la suppression des « fils nus », techniquement très vulnérables, qui correspondent à environ 70 000 kilomètres de lignes en basse tension. Je considère pour ma part que ces programmes devraient être intégrés dans le plan de relance.
Ma seconde remarque porte sur la gestion des crises. Là encore, les demandes de la Fédération me paraissent tout à fait fondées. Parmi celles-ci, deux me semblent particulièrement essentielles : en premier lieu, la nécessaire optimisation de la gestion des groupes électrogènes ; en second lieu, l’instauration d’un lien de proximité – par exemple un interlocuteur privilégié – avec les usagers privés d’électricité et les élus. En effet, quels que soient les efforts effectués pendant ces périodes d’intempéries, c’est toujours en matière de communication que les craintes de nos concitoyens sont les plus grandes.

La parole est à M. Alain Vasselle, auteur de la question n° 513, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Madame la présidente, je me permets tout d’abord de saluer la polyvalence des membres du Gouvernement, qui sont capables de répondre à toutes les questions, y compris à celles qui ne relèvent pas de leur compétence directe. Il faut dire qu’ils sont entourés par des conseillers de qualité ! Monsieur le secrétaire d’État, je ne doute pas que vous saurez répondre avec pertinence à la question que je vais vous poser.
Je voudrais attirer votre attention sur les désaccords et les tensions que nous constatons de plus en plus fréquemment entre les collectivités locales compétentes en matière de traitement des déchets ménagers et les conseils généraux, au moment de la révision des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés.
L’échelon intercommunal assume le plus souvent l’entière responsabilité de la gestion de la collecte et du traitement des déchets, et ne comprend pas l’attachement de certains conseils généraux à exercer ce qui s’apparente de plus en plus à un contrôle d’opportunité des projets, pourtant légitimes, des collectivités.
Je voudrais citer à titre d’exemple le cas d’une collectivité, qui aurait délibéré unanimement pour recourir à un mode de valorisation multi-filières associant le tri, la méthanisation et l’incinération avec valorisation énergétique pour le traitement de ses déchets ménagers résiduels, qui aurait choisi un cadre juridique pour l’élaboration de son projet, qui aurait retenu le site d’implantation, qui aurait recruté son assistance technique à maîtrise d’ouvrage pour l’aider à constituer le dossier de consultation des entreprises, et qui pourrait, in fine, voir son projet écarté par un conseil général chargé du plan départemental – celui-ci étant en cours de révision, c’est-à-dire non arrêté –, alors même que l’ensemble des documents préparatoires à cette révision recensent clairement l’existence du projet de la collectivité concernée.
Si, en outre, le projet en question permet à la collectivité légitimement compétente en matière de traitement des déchets de respecter, voire de dépasser les objectifs réglementaires, notamment ceux qui sont définis dans le cadre du Grenelle de l’environnement – cher à M. Borloo comme à vous-même, monsieur le secrétaire d’État –, sur quels fondements constitutionnel et juridique un conseil général pourrait-il s’appuyer pour exclure le projet de la collectivité du futur plan révisé ?
Une circulaire, pourtant récente, d’avril 2007, précise que « ce serait une interprétation erronée des textes de voir la planification comme un instrument pour imposer des projets aux collectivités compétentes en matière de collecte ou de traitement des déchets ménagers ».
Je m’interroge donc sur la légalité constitutionnelle d’un plan départemental, alors qu’avant même son élaboration définitive le conseil général s’opposerait aux décisions, pourtant conformes à l’esprit et à la lettre de la réglementation, prises en amont par un établissement public de coopération intercommunale pour la mise en œuvre des installations de traitement, et exercerait par là même une tutelle d’une collectivité sur une autre !
Je souhaiterais donc, monsieur le secrétaire d’État, que vous puissiez nous éclairer sur les moyens que le Gouvernement compte employer pour remédier à cette situation pour le moins néfaste à la mise en œuvre des projets et des installations qui doivent, notamment, permettre de répondre rapidement aux objectifs retenus dans le cadre du Grenelle de l’environnement.
Je vais essayer, au nom de M. Borloo, de répondre avec pertinence à cette question, d’autant qu’elle porte sur un sujet qui ne m’est pas inconnu : en effet, en tant que président d’une communauté d’agglomérations, j’ai demandé au président du conseil général, qui n’est autre que votre serviteur, de mettre au point un plan départemental.
Rappelons tout d’abord que le législateur communautaire a rappelé son attachement à la question de la planification de la gestion des déchets ménagers et assimilés en lui consacrant le chapitre V de la nouvelle directive-cadre sur les déchets du 19 novembre 2008.
Ce chapitre précise le contenu des plans, qui doivent notamment comporter des indications assez précises sur les nouveaux projets – type de traitement, capacité, critères de localisation, etc.
De même, le renforcement de la planification, dans son rôle de déclinaison territoriale et opérationnelle des politiques nationales en matière de gestion des déchets, constitue un engagement du Grenelle de l’environnement.
Nous vous rejoignons sur le fait que, d’un côté, le renforcement de la planification ne doit pas heurter le principe constitutionnel de libre exercice de leurs compétences par les communes. C’est précisément cette question complexe de l’articulation des compétences qui doit être posée comme point de départ de la réflexion sur une réforme de la planification en matière de gestion des déchets.
Jean-Louis Borloo a demandé aux services de son ministère d’engager d’ici à l’été les travaux relatifs à cette réforme, pour répondre à la fois aux objectifs du Grenelle et aux dispositions de la nouvelle directive-cadre sur les déchets.
Bien entendu, ces travaux associeront l’ensemble des acteurs concernés, notamment les représentants des différentes collectivités. M. Borloo souhaite que cette question complexe donne lieu à un travail de fond largement concerté, et pour lequel le temps de la réflexion serait pris.
En ce qui concerne les déchets relevant de la compétence des communes ou de leurs groupements – communautés de communes ou communautés d’agglomérations –, une piste pourrait être celle d’une meilleure formalisation des programmes et projets de ces derniers, en amont de l’élaboration ou de la révision d’un plan départemental. Dans une telle configuration, le rôle du conseil général serait d’agir en coordonnateur des programmes et projets des personnes compétentes en matière de gestion des déchets et, ce faisant, de veiller à la mise en œuvre d’une politique efficace et respectueuse des objectifs et programmes nationaux et communautaires.
Pour avoir récemment interrogé le préfet de mon département à ce sujet, j’ajoute que, dans l’ancien système, ce n’était pas au département d’agir, mais que c’était l’État qui conservait la responsabilité de tout processus engagé en la matière, même, entre-temps, interrompu. Sur le plan juridique, l’action du conseil général s’exercera donc différemment selon que l’État est ou n’est pas déjà intervenu dans ce domaine.
Nous nous efforcerons de traiter cette question de coordination des compétences avant l’été, monsieur Vasselle. En termes de gestion de l’argent public, on voit bien qu’il est utile, surtout dans les grands départements comme le vôtre ou le mien, de coordonner l’action des différentes collectivités. Il est également légitime que les acteurs locaux puissent poursuivre leurs projets.

Je voudrais remercier M. Dominique Bussereau de l’éclairage qu’il vient de m’apporter sur la manière dont il convient d’interpréter les dispositions législatives concernant la nécessaire coordination entre le plan départemental relevant de la responsabilité des conseils généraux, et les projets des collectivités ou groupements de collectivités.
J’ai écouté avec un intérêt particulier la fin de son propos, s’appuyant notamment sur son expérience et les éléments de réponse obtenus du préfet. Je retiens la volonté du Gouvernement de clarifier les compétences exercées par les uns et par les autres. Il s’agit de veiller au respect du principe constitutionnel selon lequel une collectivité locale ne peut exercer de tutelle sur une autre. Même si une loi ordinaire a prévu qu’une collectivité locale pouvait être responsable de la réalisation d’un plan départemental, les principes constitutionnels doivent être respectés.
J’ai noté que, lorsqu’un plan a été engagé par l’État, il est valable jusqu’au prochain plan, qui devra tenir compte des engagements précédemment réalisés.
J’attends avec intérêt les éléments de réponse complémentaires qui nous seront prochainement apportés.

La parole est à M. Guy Fischer, auteur de la question n° 511, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi d’attirer votre attention sur le projet de décret relatif à la création du répertoire national commun de la protection sociale, ou RNCPS, institué par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007.
Il aura vocation à regrouper des données d’état civil et d’affiliation, ainsi que les montants et la nature de toutes les prestations servies – en nature et en espèces –, les coordonnées géographiques, téléphoniques et électroniques déclarées par les assurés, allocataires et retraités, et leurs revenus. Il offrira simultanément un service de gestion des échanges informatisés aux organismes de protection sociale et aux administrations fiscales.
La conservation de données sensibles et privées sur une période de cinq ans, renouvelable indéfiniment tant que l’on reste assuré social, est prévue. Le RNCPS concernerait les données centralisées par les organismes contributeurs chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, les caisses assurant le service des congés payés et le pôle emploi.
L’article R. 114-26 précise que le droit d’opposition ne s’appliquerait pas à ce dispositif.
L’article R. 114-28 renvoie à un arrêté à venir pour fixer la liste des très nombreux risques, droits, prestations et organismes présents dans le RNCPS.
Selon la direction de la sécurité sociale, « une soixantaine d’organismes sont concernés par l’alimentation du RNCPS » et « un nombre bien plus important encore de structures y aura accès ». Un certain nombre de nos collègues de la commission des affaires sociales ont entendu ces propos, qui ont été tenus lors d’une audition par la mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale. N’est-ce pas, monsieur Vasselle ?

Combiné à d’autres dispositifs similaires, ce système contribuerait à amplifier de façon considérable les divers croisements de fichiers de données sociales, fiscales et territoriales, hors de l’assentiment et de la connaissance des assurés sociaux, des familles et des retraités.
Il est clair que nous assistons là à une nouvelle attaque contre les personnes en grande difficulté, c’est-à-dire les personnes précaires, les chômeurs et les smicards. Lors du transfert de la gestion du RMI aux départements, une véritable chasse aux fraudeurs avait déjà été instaurée.

Ensuite, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait instauré un contrôle systématique du train de vie des allocataires des minima sociaux et fait du numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques, ou NIR, la clé d’accès au futur dossier médical personnel, ou DMP.

M. Guy Fischer. Je m’étais déjà élevé, à l’époque, contre ces dispositions scandaleuses, fondées sur l’idée que tout allocataire de prestations pourrait être fraudeur parce qu’il est propriétaire de son logement ou de son véhicule. Je prédisais d’ailleurs que ce gouvernement envisageait d’aller plus loin et d’interconnecter tous les fichiers.
M. Alain Vasselle s’exclame.

C’est quasiment chose faite, et vous parachevez aujourd’hui ce « super-contrôle » informatisé de nos concitoyens. Il s’agit là d’une atteinte inacceptable à la liberté de l’individu, doublée d’un cynisme stigmatisant les plus défavorisés.
Pour toutes ces raisons, je vous demande, monsieur le secrétaire d’État, le retrait du projet de décret concernant le RNCPS.
Monsieur le sénateur Guy Fischer, je vous prie, tout d’abord, d’excuser l’absence de mon collègue Brice Hortefeux, qui m’a demandé de me faire son porte-parole auprès de vous.
La création du répertoire national commun de la protection sociale résulte non pas du décret mais de la loi. Plus précisément, il est issu d’un amendement à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui avait été adopté sur l’initiative de votre collègue le député Pierre Morange.
Le décret que vous évoquez est donc préparé par le Gouvernement pour mettre en œuvre cette disposition législative.
Je voudrais rappeler les deux objectifs de la création de ce répertoire.
Il s’agit, tout d’abord, d’améliorer le service aux usagers. Le monde de la protection sociale étant complexe, il est utile de disposer d’une vue globale de la situation d’un assuré pour l’orienter au mieux vers l’organisme ou le guichet compétent.
Il s’agit, ensuite, d’améliorer les outils dont disposent les organismes de protection sociale pour maîtriser les risques d’erreur et de fraude. C’est un enjeu essentiel auquel, j’en suis sûr, tous les sénateurs, gestionnaires de l’argent public attachés au principe d’égalité, sont sensibles.
La maîtrise de ces risques doit constituer une préoccupation permanente dans un secteur qui verse, je le rappelle, 550 milliards d’euros de prestations par an.
Je voudrais également, monsieur Fischer, vous apporter plusieurs précisions.
Il n’est pas exact que les montants des prestations figureront dans ce répertoire, qui ne comprendra que les données relatives à l’état civil ainsi que la qualité de bénéficiaire ou non d’une prestation. De même, je souhaite vous rassurer sur un autre point : les revenus des intéressés ne figureront nullement dans ce répertoire.
J’ajoute que le travail mené conjointement avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, nous a permis d’avoir des échanges approfondis avec elle à propos des finalités de ce répertoire et des modalités de sa mise en œuvre. Grâce à la CNIL, dont toutes les préconisations seront respectées, nous avons également pu améliorer le projet de décret.
Me fondant sur mon expérience d’élu local, j’ajoute que nous sommes tous très attentifs à toutes les tricheries possibles, que ne supportent pas nos concitoyens.
M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Je pense que tout ce qui peut assurer l’équité et la justice va dans le sens voulu par tous les groupes politiques du Sénat.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l’UMP.

Monsieur le secrétaire d’État, vous venez, je le déplore, de me confirmer la volonté du Gouvernement d’utiliser les technologies informatiques, de plus en plus puissantes et performantes, au détriment de la liberté des personnes et du respect de leur intimité et de leur vie privée.
Le RNCPS croisera bientôt les innombrables données qui concernent les populations les plus modestes. C’est cette stigmatisation des plus faibles, des chômeurs et des précaires que je dénonce. Ce n’est cependant pas tout : vous préparez un autre mauvais coup
M. Alain Vasselle s’exclame.

Toujours selon votre conception du « chômeur-fraudeur », vous poursuivez la stigmatisation…

… et la discrimination des plus démunis.
Dès lors, pour percevoir quelques dizaines d’euros supplémentaires, il faudra tout dire de soi, de sa vie, de ses ascendants et descendants, de ses pauvres ressources et de celles de sa famille. Je juge cela particulièrement indigne et je tiens à le souligner solennellement.
Je ferai toujours en sorte de faire entendre la voix des plus pauvres, à l’heure où la France voit apparaître un nouveau concept, qui est aussi une réalité, celui de la pauvreté laborieuse. Or ce sont ces personnes et non pas les bénéficiaires de retraites-chapeaux et autres avantages qui sont l’objet des recherches les plus fouillées.

L’ordre du jour appelle la question n° 501, de M. Jean-Claude Danglot, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
La parole est à M. Guy Fischer, en remplacement de M. Jean-Claude Danglot.

Je remplace effectivement M. Danglot, qui vient de perdre son père.
M. Jean-Claude Danglot appelle l’attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l’engagement du Président de la République de mettre un terme aux inégalités de traitement qui perdurent entre les retraités des mines partis en retraite avant 1987 et les retraités des mines partis en retraite après 1987.
En effet, l’accord de 2001, qui n’a pas été signé par deux syndicats de salariés, induit une discrimination entre les retraités et veuves de mineurs résultant de la mise en place d’un rattrapage différencié selon l’année de départ en retraite. Par exemple, la revalorisation des pensions va de 0 % pour ceux partis en retraite avant 1987, soit 80 % des pensionnés, à 17 % pour ceux partis en 2001, et 25, 5 % pour ceux partis en 2008. Les écarts entre les pensions résultant de ce système s’accroissent tous les ans.
Les veuves de mineurs sont encore plus touchées. Le montant de la pension de réversion étant de 54 % du montant de la pension de retraite, elles subissent encore plus ce système injuste. La plupart d’entre elles vivent désormais avec des revenus inférieurs au seuil de pauvreté.
M. Danglot demande donc à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement envisage de prendre pour rétablir l’équité entre les retraités des mines et, c’est moi qui l’ajoute, pour tenir les promesses du Président de la République.
Je vous prie, monsieur Fischer, de bien vouloir transmettre toutes nos amicales condoléances à M. Danglot.
Mon collègue Brice Hortefeux m’a prié de bien vouloir répondre en son nom à cette question des retraites des assurés relevant du régime des mines, auquel M. Danglot est très attaché.
Il s’agit d’un régime spécial dans lequel les pensions sont calculées sur une base forfaitaire en multipliant le nombre de trimestres par la valeur du trimestre. Cette situation a progressivement conduit, à partir de 1987, année depuis laquelle les pensions sont indexées sur les prix, à un décalage entre les prestations servies par ce régime et celles du régime général.
Il s’agissait de corriger ce décalage. Un accord a été conclu par l’État avec trois organisations syndicales représentatives des mineurs en 2002. Il prévoit plusieurs mesures en faveur des assurés du régime minier et de leurs ayants droit. Cet accord a visé à offrir à chaque génération une amélioration de ses conditions de liquidation pour tenir compte de l’amélioration de sa carrière.
Toutefois, ce dispositif n’a pas été suffisamment expliqué ni compris ; je pense que cela explique la question de M. Danglot.
Aussi, comme le Gouvernement l’a écrit à M. le sénateur Danglot, nous avons décidé de réexaminer la situation des retraités du régime des mines. Je rappelle d’ailleurs que, comme vous le savez, dans cette attente, le régime des mines n’a pas été concerné, en 2008, par la réforme de régimes spéciaux de retraite. Il est resté à l’extérieur du champ de celle-ci.
Une première phase de concertation s’est déroulée au cours de l’été 2008. Elle a permis d’identifier plus précisément les positions et les propositions des uns et des autres et d’échanger informellement sur les mesures susceptibles d’améliorer le pouvoir d’achat des retraités les plus modestes et les plus âgés, tout en tenant compte de la situation financière du régime.
Ces premières discussions se prolongent dans le cadre d’un groupe de travail qui réunit l’ensemble des acteurs et des administrations concernées. Ce groupe s’est réuni pour la première fois le 9 mars dernier. Il a tenu, depuis lors, plusieurs réunions techniques.
Nous souhaitons que ces concertations s’achèvent au cours de ce printemps sur un consensus réunissant un nombre suffisant d’organisations syndicales. Brice Hortefeux m’a prié de souligner l’esprit de responsabilité dont témoignent toutes ces organisations dans le cadre des discussions en cours.
Ses propositions vont maintenant être mises sur la table. Le Gouvernement en tiendra informé la Haute Assemblée, particulièrement M. le sénateur Danglot.

Monsieur le secrétaire d’État, les organisations syndicales ont été reçues en 2008 par l’ensemble des groupes politiques de l’Assemblée nationale, qui ont reconnu la discrimination dont faisaient l’objet les mineurs retraités selon la date de leur départ à la retraite et l’injustice de cette situation. Depuis lors, de très nombreux parlementaires de toutes tendances sont intervenus à ce sujet.
Par la suite, la Président de la République a adressé une lettre aux syndicats les informant qu’il comprenait leur demande et qu’il s’investirait personnellement pour tenter de résoudre ce problème.
À cet effet, des groupes de travail ont été mis en place. La dernière réunion, qui a eu lieu le 6 avril, n’a débouché, à ma connaissance, sur aucune proposition concrète.
Par conséquent, il s’avère que le traitement de ce problème dépasse une dimension purement technique et qu’il conviendrait donc de confirmer une volonté politique, afin de respecter les positions des parlementaires et du Président de la République, pour que cesse rapidement cette discrimination, reconnue par tous les interlocuteurs du dossier.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat, auteur de la question n° 489, adressée à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Monsieur le secrétaire d'État, l’université connaît deux grands chantiers : la mise en place du plan licence et le passage à l’autonomie.
Elle est confrontée aussi à l’une des crises les plus graves qu’on ait connues depuis des décennies. Cette crise, les Français voient bien qu’elle s’enlise par la faute du Gouvernement.
Cette situation n’est plus acceptable. Dans certaines universités, on entre dans la quinzième semaine de grève et la délivrance des diplômes est compromise. Le Gouvernement a beau jeu de prétendre que les enseignants-chercheurs préfèrent refuser l’évaluation et pénaliser les étudiants plutôt que d’accepter les diktats auxquels ils sont soumis.
La réalité, c’est que vous préférez jouer le pourrissement plutôt que d’admettre l’inanité de réforme !
Monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement avançait que l’autonomie allait s’accompagner d’un effort financier massif de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros en direction des universités. Au final, selon les premières études réalisées, ce ne sont que 175 millions d’euros qui vont finir effectivement dans le budget de fonctionnement des universités au titre du plan licence et pour le passage à l’autonomie.
Ces 175 millions d’euros sont répartis de manière très inégale et surprenante. On est tellement loin des sommes promises que la Conférence des présidents d’université, qui avait soutenu cette réforme, la dénonce maintenant avec force.
Comme si cela ne suffisait pas, vous vous attaquez aussi au statut des enseignants-chercheurs. Avec le système d’évaluation que vous proposez, vous voulez ainsi faire entrer l’université dans l’ère des managers, comme si elle était une entreprise comme les autres !
Le pire, c’est que vous ne savez même pas comment réaliser efficacement cette évaluation. Le décret qui est paru en catimini pendant les vacances sur le statut des universitaires l’atteste : c’est un tel embrouillamini que personne n’y comprend plus rien ! Il en est de même de la modulation des heures, dont les conditions de répartition sont si obscures qu’on ne sait pas quand les heures modulées commencent ni quand elles sont payées. La seule chose à peu près claire, c’est que ce sont bien les présidents d’université, ces nouveaux managers, qui auront le dernier mot dans la plupart des cas.
Mais ces derniers font face aujourd’hui à une véritable fronde, comme à Caen, à Paris ou même à Bordeaux. Et si certains jouent le jeu du délitement en menaçant les universitaires de sanctions financières, comme à Lille II, beaucoup expriment leur crainte devant la bombe à retardement qui menace désormais d’exploser à chaque instant.
Monsieur le secrétaire d’État, quand admettrez-vous que cette réforme ne correspond ni aux besoins des étudiants ni à ceux des universitaires ? Que comptez-vous faire pour mettre fin à un conflit qui dure maintenant depuis trop longtemps, à un conflit qui pénalise les étudiants et les chercheurs, à un conflit qui, pour tout dire, est indigne de l’université française ?
Monsieur le sénateur, vous parlez d’indignité ; encore faudrait-il savoir à qui elle incombe réellement !
Je vous prie d’excuser Valérie Pécresse, qui en ce moment accompagne le Président de la République à Nancy.
Vous interrogez le Gouvernement sur les conditions financières de réalisation du plan « Réussir en licence » et du passage à l’autonomie des universités.
Pour 2009, des moyens importants ont été attribués aux universités. Au total, elles disposeront de 300 millions d’euros de moyens nouveaux en 2009, contre simplement 78 millions d’euros en 2008 et 58 millions d’euros en 2007. C’est une augmentation de 17 % des moyens que l’État consacre au budget des universités.
À quoi sont destinés ces crédits ? Pour 67 millions d’euros en 2009, et 730 millions d’euros en cumulé pour la période 2008-2011, ces crédits serviront à aider toutes les universités à « booster » la réussite des étudiants de licence, dont on sait qu’ils sont les plus fragiles, en particulier ceux qui ont besoin d’être mieux orientés et plus accompagnés.
Ces crédits serviront également à mettre en œuvre un nouveau système d’allocation des moyens, qui repose sur un financement équitable valorisant tant la réalité de l’activité des universités que leurs performances.
Ils serviront aussi à rénover leurs bâtiments, ce qui n’est pas du luxe. Ainsi, 150 millions d’euros transitent directement par leur budget pour la mise en sécurité de leurs locaux. C’est trois fois plus qu’en 2008 ! Cela s’ajoute aux moyens directement financés par l’État via les contrats de projet État-région, à l’opération « campus » et aux projets « campus », qui sont prometteurs et innovants.
Enfin, ces crédits serviront à accompagner les universités qui passent aux compétences élargies. Ainsi, 5 millions d’euros en 2008 et 16 millions d’euros en 2009 leur ont été spécifiquement dédiés pour les accompagner dans cette évolution importante, afin de leur permettre de former les personnels particulièrement engagés dans ce processus et de rétribuer le travail de ceux-ci.
Quant aux 18 universités qui sont passées à l’autonomie, elles ont vu leurs crédits augmenter de 96 millions d’euros en 2009, ce qui représente une progression moyenne de 15, 5 %, contre 12, 6 % pour la moyenne des universités. Elles ont ainsi capté 33 % des moyens nouveaux des universités.
Monsieur le sénateur, je suis élu d’un département sur le territoire duquel se trouve l’université de La Rochelle, qui est devenue autonome. Je puis vous dire que ses professeurs sont à la fois d’excellents enseignants, mais aussi d’excellents managers. Cette université poursuit son développement et tout le monde travaille à ce qu’elle réussisse son passage à l’autonomie. D’ailleurs, les examens se dérouleront normalement.
Le Gouvernement souhaite que, partout ailleurs, le défi de l’autonomie soit relevé. Il donne les moyens pour ce faire. Ainsi, ce n’est pas à lui qu’il faut poser la question de l’échec, mais c’est à ceux qui ne relèvent pas ce défi.

Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse ne me satisfait pas. Même si certaines décisions ont quelque peu changé le paysage universitaire, tout n’est pas revenu dans l’ordre. Et il est quelque peu cavalier, voire irresponsable, d’en attribuer la responsabilité aux étudiants et aux universitaires.
Étudions de près les chiffres. Le Gouvernement avait annoncé un effort sans précédent de près d’un milliard d’euros par an en faveur de l’université. En réalité, les chiffres sont les suivants : 175 millions d’euros pour le budget de fonctionnement des universités, 68 millions d’euros pour le plan licence et 107 millions d’euros pour le passage à l’autonomie.
Plus encore, la très forte disparité entre ces chiffres surprend. Ainsi, personne ne comprend pourquoi la dotation de l’université Lyon II progresse de 27 %, tandis que celle de l’université Montpellier II ne progresse que de 0, 5 %. Il s’ensuit un certain nombre d’inégalités.
Enfin, monsieur le secrétaire d'État, au-delà des chiffres, il existe un vrai mécontentement à la fois des chercheurs et des présidents d’université. Vouloir que le monde de l’université et le monde de l’entreprise se rapprochent en faisant désormais de l’évaluation l’alpha et l’oméga de la mesure du travail, cela me semble excessif. Comment peut-on sortir de cette crise, alors que certains s’inquiètent de leurs examens, de la validité de leur diplôme ? Bref, la responsabilité de cette situation incombe bien au Gouvernement, et non aux étudiants.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, auteur de la question n° 507, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Monsieur le ministre, ma question porte sur l’évolution des crédits alloués au Conservatoire de la forêt méditerranéenne, le CFM, et sur l’usage qui en est fait.
Je vous avais déjà interrogé à ce sujet lors de la discussion budgétaire, comme je l’avais fait avec vos prédécesseurs. Jusqu’à présent, je n’ai obtenu qu’une réponse rhétorique. J’espère donc qu’il en ira différemment ce matin.
Pour son premier exercice, en 1987, le CFM disposait d’un budget de 100 millions de francs, alimenté par des ressources propres : une taxe nouvelle sur les briquets et une hausse de la fiscalité sur les tabacs. Ces 100 millions de francs de 1987 représentent 22, 8 millions d’euros en 2009, soit presque trois fois plus que les 8 millions d’euros budgétisés cette année. En conclusion, les deux tiers de ces fonds servent à autre chose qu’à la préservation de la forêt méditerranéenne.
Il s’agit là d’un premier détournement.
Second détournement : l’essentiel des ressources résiduelles a été affecté à un autre objet que celui qui était assigné au CFM lors de sa création, à savoir financer, en partenariat avec les collectivités locales, dans quinze départements du sud de la France, les travaux de défense des forêts contre l’incendie, DFCI, – pistes, pare-feux, coupures agricoles, etc. –, leur entretien, et préfinancer l’exécution d’office du débroussaillement obligatoire, qui relève de la responsabilité des maires.
Comme l’observait déjà la Cour des comptes dans son rapport de l’année 2000, ces ressources servent aujourd’hui à financer tout autre chose : le carburant de la surveillance aérienne, des patrouilles et des guets, l’achat de véhicules ou des constructions. Entre 2003 et 2007, pour 90 %, ces crédits ont financé des missions à la charge de l’État et, pour 10 %, des opérations concernant directement les collectivités.
Or la plupart des communes forestières, qui sont des communes rurales, n’ont les moyens ni de préfinancer le débroussaillement d’office ni de faire face aux obligations découlant des plans de protection des risques d’incendies de forêts, les PPRIF, qui leur sont imposés.
Lors de la discussion budgétaire, j’avais évoqué l’exemple de la commune varoise de Collobrières, que je connais bien, située au cœur du massif des Maures, et qui compte un peu plus de 1 700 habitants. À Collobrières, le simple entretien des pare-feu et des pistes de DFCI coûterait 300 000 euros par an, soit 15, 5 % du budget de fonctionnement de la commune. Je vous laisse deviner le coût des investissements imposés par les PPRIF aux 17 communes varoises concernées par cette obligation !
J’ai donc deux questions à vous poser, monsieur le ministre.
Premièrement, estimez-vous légal ce détournement massif de deux tiers des ressources attribuées en propre au CFM lors de sa création vers d’autres missions que la protection de la forêt méditerranéenne ?
Deuxièmement, s’agissant des crédits résiduels, qui relèvent de votre responsabilité directe, envisagez-vous de les réorienter, conformément à la vocation du CFM, vers le financement d’opérations menées en partenariat avec les communes, notamment pour leur permettre de faire face aux obligations découlant des PPRIF qui leur sont imposés ?
Monsieur le sénateur, je vous remercie d’aborder de nouveau ce sujet.
Comme vous l’avez rappelé, le CFM a été créé en 1987. Dans la mesure où je ne suis en fonctions que depuis deux ans, il serait sans doute injuste de me rendre seul fautif d’une évolution budgétaire que vous avez qualifiée de détournement et aux termes de laquelle les fonds initialement prévus ont été consacrés à d’autres actions que celles en faveur desquelles ils étaient destinés. Depuis 1987, de nombreux gouvernements, de droite et de gauche, se sont succédé, et chacun doit sans doute assumer une part de responsabilité dans cette situation. Néanmoins, je prends note de vos propos, qui m’offrent l’occasion de revenir sur un certain nombre de points.
À la suite de votre première interpellation du 3 décembre dernier, je vous avais écrit en mars, comme je m’y étais engagé, pour vous apporter quelques précisions, que je suis heureux de compléter aujourd’hui.
À cette occasion, je vous ai confirmé que, en dépit de la diminution globale des crédits qui lui sont consacrés, la dotation réservée en 2009 aux actions de DFCI en zone méditerranéenne a été maintenue à un niveau à peu près équivalent à ce qu’elle était en 2008, soit 8, 9 millions d’euros contre 9, 1 millions d’euros.
Le Conservatoire de la forêt méditerranéenne est un instrument financier particulier qui a été mis en place en 1987, lorsque le ministère de l’agriculture et de la pêche a dégagé des moyens financiers supplémentaires pour la prévention des incendies de forêts à la suite des très graves incendies de l’été 1986.
Le CFM est venu compléter la gamme des outils de financement dont disposait déjà le ministère en matière de prévention des incendies de forêts : les contrats de projets État-région, la convention-cadre avec l’Office national des forêts ou les conventions annuelles avec les départements dotés d’unités de forestiers-sapeurs.
Les capacités d’expertise que nous avons accumulées à la suite de ces grands incendies sont également mises à contribution dans le cadre des actions de coopération menées à l’étranger, par exemple en Grèce, où je me suis rendu voilà deux ans, après les dramatiques incendies qui ont touché ce pays.
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi organique de 2001 relative aux lois de finances, les crédits du CFM relevaient d’une ligne budgétaire spécifique du ministère. Depuis, la programmation de ces crédits est déléguée par le ministère au préfet de la zone de défense sud, qui est chargé de l’harmonisation et de la coordination des politiques de prévention et de lutte contre l’incendie dans les quinze départements méditerranéens. Monsieur Collombat, ces crédits, désormais inclus dans le budget opérationnel de programme déconcentré « Forêt », ont été, comme je vous l’avais indiqué, maintenus en 2009 à un niveau équivalent à celui de 2008.
Vous m’interrogez aujourd’hui sur leur utilisation. À cet égard, plusieurs points méritent d’être confirmés devant la Haute Assemblée.
Les priorités de la programmation annuelle du Conservatoire sont fixées après avis du Conseil d’orientation de la forêt méditerranéenne, qui est présidé par le préfet de la zone de défense sud et qui rassemble l’ensemble des intervenants dans la prévention des incendies de forêts, notamment les collectivités territoriales et les services des autres ministères.
Ces dépenses doivent toutefois être éligibles à la liste arrêtée par circulaire du 2 juillet 2007 : prévision et connaissance de l’aléa ; stratégie, coordination et harmonisation ; surveillance ; équipements de défense des forêts contre les incendies ; traitement des causes ; prévention des dommages ; information et formation ; recherche et expérimentation.
En matière d’équipements de défense des forêts contre les incendies, le Conservatoire de la forêt méditerranéenne participe aux investissements, mais le financement de l’entretien incombe aux maîtres d’ouvrage.
En ce qui concerne la prévention des dommages, le Conservatoire ne finance pas les travaux de prévention rendus obligatoires. Il apporte son expertise ou son concours aux préfets, mais son rôle s’exerce dans les limites des dispositions du code forestier, qui stipule que le maire est chargé du contrôle des débroussaillements obligatoires.
Enfin, les mesures de prévention décidées dans le cadre des plans de prévention des incendies de forêts concernant les zones urbanisées sont quant à elles éligibles au Fonds de prévention des risques naturels majeurs, géré par le ministère de l’écologie, qui est responsable de la mise en œuvre de ces plans.
Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments complémentaires que je pouvais vous apporter. J’espère qu’ils répondront, au moins partiellement, à vos interrogations et qu’ils vous rassureront quant à la mobilisation du ministère de l’agriculture et de la pêche en faveur de la prévention des incendies de forêts dans la zone méditerranéenne. Cette mobilisation demeure entière. Nous travaillons non pas de façon isolée, mais avec d’autres administrations, les collectivités locales, qui sont en première ligne sur le terrain, et de nombreuses associations, ainsi que les sapeurs-pompiers, volontaires ou professionnels.

Monsieur le ministre, je vous concède bien volontiers que vous n’êtes pas responsable de tout. Néanmoins, vous êtes complice, et l’existence de circonstances atténuantes ne vaut pas absolution !
Cela étant, j’apprécie que vous soyez venu au Sénat ce matin, malgré votre emploi du temps chargé, pour répondre personnellement à ma question. Je salue cet effort, que tous vos collègues ne consentent pas…
Sur le fond, toutefois, votre réponse ne comportait pas d’élément nouveau. Vous avez rappelé la situation actuelle, qui me chagrine !
Les élus qui participent au Conseil d’orientation de la forêt méditerranéenne se plaignent d’être considérés comme des plantes vertes – forestières ! – et de ne pas avoir voix au chapitre. En réalité, le préfet de région fait ce qu’il veut, à savoir détourner les crédits – je maintiens le mot – au bénéfice de missions d’État qui ne sont pas celles en vue desquelles le Conservatoire de la forêt méditerranéenne avait été créé, voilà déjà longtemps, par Jacques Chirac.
Monsieur le ministre, vous ne serez sans doute plus en fonctions dans quelque temps, mais j’insiste sur le fait que la forêt méditerranéenne exige une action sur le long terme. Il faut s’appuyer sur les communes, en les aidant à conduire des actions qui relèvent certes de leur responsabilité, mais qu’elles n’ont pas, aujourd’hui, les moyens de financer.

La parole est à Mme Bernadette Bourzai, auteur de la question n° 476, adressée à Mme la ministre du logement.

Ma question porte sur l’aide à la gestion locative sociale des résidences sociales, l’AGLS. Instituée en 2000, elle constitue un des moyens de la politique de lutte contre les exclusions.
Au moment où elle a été mise en place, les réflexions menées avaient mis en évidence la nécessité d’un suivi individualisé des personnes en situation d’exclusion afin de les réinsérer dans la société et dans le droit commun.
L’AGLS se distingue de cette approche personnalisée et lui apporte un complément indispensable. Elle consiste à garantir et à financer la présence d’intervenants, qui sont attachés non pas à une personne, mais à une résidence sociale. Leurs compétences et leurs contacts leur permettent de répondre aux difficultés communes que rencontrent les résidants dans leur parcours vers un logement banalisé et vers l’emploi. Le rôle de ces intervenants est ainsi de fournir un soutien aux habitants des résidences sociales, au travers d’un accueil, d’une médiation et d’une orientation. Il s’agit toujours de viser le retour au droit commun des publics les plus en difficulté, mais en rapprochant le droit des personnes et, d’une certaine façon, en appliquant déjà une démarche de droit commun à tous les résidants.
Aujourd’hui, une des fonctions de l’AGLS est de faciliter la mise en œuvre de la loi instituant le droit au logement opposable, dite loi DALO, qui doit fluidifier et sécuriser les parcours résidentiels des structures d’hébergement vers des logements de droit commun.
Née en 2000, l’AGLS a toujours toute sa place. On sait que, dans le domaine de l’insertion, l’effort doit être global. Aucune réalité ne doit être contournée.
Pour être efficace, l’AGLS doit reposer sur une mise en réseau, donc s’inscrire dans la durée. L’aide aux personnes en grande difficulté est un domaine où le mot « rupture » n’a pas sa place : il y est synonyme d’échec et de gâchis.
L’aide à la gestion locative sociale est une aide d’État. Elle n’est pas obligatoire. La circulaire de 2000 fixe des plafonds, mais aucun plancher.
J’ai été alertée récemment par le directeur du foyer de jeunes travailleurs de Tulle, lui-même informé par l’Union pour l’habitat des jeunes du Limousin de risques de réduction, voire de suppression, de l’AGLS dans certains territoires en 2009. Les décisions seraient prises par les préfets de région dans le cadre du budget opérationnel de programme 177 pour la période 2009-2011.
Si elles devaient vraiment être mises en œuvre, de telles mesures ruineraient les efforts des associations et des centres communaux d’action sociale concernés, aussi bien pour les projets en préparation que pour les actions en cours.
Confrontées à la défaillance de l’État, les associations se retournent vers les collectivités territoriales en raison de leur caractère public et de leur proximité. Ces dernières, déjà très sollicitées depuis l’entrée en vigueur des dernières lois de décentralisation, se mobilisent aujourd’hui pour faire face à la crise économique. Contraintes d’assumer leurs responsabilités, elles sont parfois critiquées par certains membres de la majorité, qui les accusent d’augmenter les impôts…
Ma question est très simple : comment l’État va-t-il assumer ses responsabilités en matière d’aide à la gestion locative sociale ? Quelles instructions allez-vous donner aux préfets de région pour assurer l’efficacité de ce dispositif, dans cette période où la crise aggrave la situation de précarité vécue par certains de nos concitoyens ?
Madame le sénateur, avec plus de 70 000 places, les résidences sociales jouent en effet un rôle important dans le champ du logement social.
Comme vous le soulignez, ce dispositif a prouvé son efficacité en tant que support d’une démarche d’insertion sociale et il constitue une étape importante dans un parcours vers le logement autonome pour des personnes qui, à un moment donné, ont pu rencontrer des difficultés particulières.
Depuis sa mise en œuvre au travers des décrets de décembre 1994, ce dispositif a été adapté aux enjeux et évolutions de la société : la force de la résidence sociale est d’être un produit évolutif et vivant. Grâce à sa souplesse, il a pu répondre à de nombreux besoins qui n’avaient pas été identifiés voilà quelques années, notamment ceux qui sont liés à la mobilité professionnelle. La résidence sociale remplit pleinement sa fonction dès lors qu’elle prend bien sa place dans la gamme des réponses en matière d’hébergement et de logement.
Le très bon travail accompli par les gestionnaires depuis plusieurs années est à saluer et à encourager. Le secteur s’est fortement professionnalisé, dans des conditions pas toujours faciles, et la qualité des prestations aujourd’hui offertes aux résidants, qu’il s’agisse des locaux, de l’accueil ou du suivi personnalisé, s’est notablement améliorée, même si des efforts, mobilisant également les pouvoirs publics, restent à poursuivre.
C’est pour aider les gestionnaires dans cette tâche qu’a été mise en place l’aide à la gestion locative sociale, par une circulaire du 31 août 2000. La gestion locative sociale permet notamment d’assurer la bonne intégration des nouveaux résidants, la médiation au sein de la résidence, la liaison avec le comité de résidants et avec les services sociaux, et surtout la fluidité des parcours vers le logement ordinaire.
Il n’est donc pas question, à l’heure où les services de l’État sont mobilisés, notamment pour le développement de l’offre de logement adapté, en particulier dans le cadre du plan de relance de l’économie, de supprimer ni même de diminuer le soutien financier apporté aux gestionnaires de ces structures en vue de la réalisation de leurs missions.
D’une part, le budget pluriannuel pour la période 2009-2011 du programme 177 « Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables » ne prévoit nullement la disparition de cette aide, qui y est inscrite pour chacune des trois années considérées.
D’autre part, s’agissant du budget opérationnel de programme pour 2009 du programme 177, les crédits ouverts au titre de l’AGLS sont identiques à ceux de l’exercice 2008, soit 5, 716 millions d’euros.
Par ailleurs, il faut rappeler que le montant de l’AGLS peut être modulé en fonction des difficultés constatées dans le secteur de la résidence sociale et des moyens en personnel consacrés à la gestion sociale. L’AGLS ne revêt pas de caractère d’automaticité et est accordée en fonction de la validité du projet social qui est présenté. Cela signifie que son montant et son principe peuvent être revus si les conditions de mise en œuvre du projet social viennent à changer.
J’ajoute, madame le sénateur, que, dans le cadre du plan de relance, 12 millions d’euros supplémentaires sont prévus pour financer des mesures d’accompagnement social dans et vers le logement.
Il faut enfin préciser que l’AGLS, comme les mesures d’accompagnement social, vient en complément des aides existantes, apportées par les caisses d’allocations familiales et le Fonds de solidarité pour le logement, par exemple, auxquelles elle n’a pas vocation à se substituer.

Madame la ministre, je vous remercie de ces assurances, que je ne manquerai pas de transmettre à mes interlocuteurs. J’espère qu’elles se vérifieront sur le terrain.
Il aurait été dommage de supprimer un dispositif dans lequel les associations et les collectivités locales se sont beaucoup investies. À titre personnel, j’ai travaillé pendant deux ans, à l’échelon d’une commune de 5 000 habitants, sur un projet de résidence sociale. Celle-ci accueille aujourd’hui vingt-cinq jeunes travailleurs et dix personnes en grande difficulté sociale, cinq chambres étant en outre réservées à des personnes sans domicile fixe de passage. Il aurait été scandaleux que l’aide à la gestion locative sociale soit supprimée pour cette structure.
Vous nous avez apporté des apaisements, madame la ministre, mais sachez que nous resterons vigilants.

La parole est à Mme Bernadette Dupont, auteur de la question n° 500, transmise à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Je souhaite attirer l’attention de Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi sur les effets de l’article 2 du décret n° 2008-608 du 26 juin 2008 relatif à l’aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l’habitation, qui élargit le champ des ressources prises en compte pour déterminer l’éligibilité à l’aide personnalisée au logement.
L’article 81 quater du code général des impôts, introduit par l’article 1er de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, a notamment posé le principe d’une exonération de l’impôt sur le revenu des salaires versés au titre des heures supplémentaires et complémentaires.
Or l’article 2 du décret susvisé intègre précisément ces mêmes éléments de rémunération dans les ressources prises en compte pour le calcul de l’APL.
Cette modification aboutit donc au paradoxe que si, d’un côté, la loi fiscale encourage les salariés à travailler davantage pour améliorer leur pouvoir d’achat, de l’autre, ces mêmes salariés voient finalement diminuer l’aide sociale dont ils peuvent bénéficier.
Cette situation apparaît particulièrement pénalisante pour les salariés rémunérés au SMIC, le gain net après exonération d’impôt sur le revenu de ces rémunérations et nouveau calcul de leur APL étant quasiment nul dans leur cas. Il en résulte que ce type de disposition risque de créer une trappe à inactivité en décourageant, au final, les salariés de travailler davantage.
Je souhaiterais donc savoir, monsieur le secrétaire d’État, si le Gouvernement entend mettre en œuvre des mesures destinées à assurer aux salariés les plus modestes une juste prise en charge sociale sans pénaliser leur activité. Je pense que tout cela est lié au versement du revenu de solidarité active, le RSA.
Madame la sénatrice, je vous prie tout d’abord d’excuser Mme la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, qui ne pouvait être présente ce matin dans l’hémicycle.
Je vous rappelle que la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat a pour objet, en ce qui concerne les heures supplémentaires réalisées par les salariés, d’établir des mesures d’exonération de l’impôt sur le revenu et de réduction des cotisations sociales.
Ces mesures ont été voulues par le Gouvernement et la majorité pour renforcer le pouvoir d’achat des salariés. Ainsi, les salariés qui effectuent des heures supplémentaires perçoivent, en contrepartie, une rémunération majorée de 25 % ou de 50 % sur laquelle ils ne paient pas d’impôt sur le revenu. Ils bénéficient en outre d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale : c’est une disposition importante et incitative. C’est la première fois que les cotisations salariales de sécurité sociale font l’objet d’une réduction.
Cette rémunération supplémentaire participe ainsi aux capacités contributives des salariés concernés par cette disposition de la loi TEPA, qui, selon la dernière enquête du ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, étaient près de 5, 5 millions en 2008. En moyenne, leur salaire net a augmenté de 10 %.
Il est justifié que cette augmentation soit prise en compte pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement. Je comprends bien votre préoccupation, madame la sénatrice, mais l’intégration de ces revenus dans la détermination du droit à l’aide personnalisée au logement répond à un souci d’équité. Pourquoi, en effet, devrions-nous traiter différemment des salariés qui perçoivent le même montant de revenus selon que ces revenus correspondent ou non à des heures supplémentaires ? Aux yeux du Gouvernement, il ne serait ni justifié ni équitable de ne pas prendre en compte la totalité des revenus perçus par un salarié pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement sous prétexte qu’ils sont, pour une part, la contrepartie d’heures supplémentaires, d’autant que celles-ci sont assorties, par ailleurs, d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale.
Telle est, madame la sénatrice, la position du Gouvernement sur la question légitime que vous venez de poser.

Je voudrais préciser que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés payés au SMIC, travaillant notamment dans des entreprises d’insertion, n’atteint pas le montant de l’APL, même majorée de 25 % ou de 50 %. En effet, cela représente en général très peu d’heures, une dizaine par mois environ, ce qui ne compense pas la perte de l’aide personnalisée au logement.
Je maintiens donc que des effets pervers risquent d’apparaître : un certain nombre de salariés préféreront continuer à toucher l’aide personnalisée au logement plutôt que d’effectuer des heures supplémentaires. Celles-ci sont pourtant gratifiantes sur le plan de la dignité humaine : elles prouvent que l’on est capable de travailler.
Par conséquent, pour inciter ces salariés à travailler davantage et leur permettre d’asseoir leur position dans l’économie française, il vaudrait mieux ne pas les priver de l’aide personnalisée au logement, d’autant que, en tout état de cause, leurs revenus resteront modestes.

La parole est à Mme Catherine Dumas, auteur de la question n° 502, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Depuis plusieurs semaines, les médias mettent en exergue le développement d’un nouveau mode de commerce, par le biais de magasins dits « de déstockage alimentaire ».
Installés principalement dans les quartiers les moins cotés de nos villes, dans des locaux sans apparat et avec une décoration réduite à sa plus simple expression, ils se sont fait une spécialité de présenter à leurs clients des produits à peine sortis de leurs cartons d’emballage et dont la date limite de consommation est près d’expirer et celle d’utilisation optimale fréquemment dépassée.
Ces nouveaux centres d’approvisionnement « d’occasion » se multiplient notamment aux abords de Paris. Alors que le hard discount propose déjà, à meilleur marché que le commerce traditionnel, des produits identiques du 1er janvier au 31 décembre, les rayons des spécialistes du déstockage alimentaire dépendent, quant à eux, des « opportunités ». En effet, ils ne vendent que des produits en fin de vie commerciale, voire presque périmés, qu’ils rachètent aux industriels de l’agroalimentaire ou au réseau classique de distribution à des prix cassés.
Ce nouveau mode de commerce vend aujourd’hui ce que l’on donnait hier aux associations humanitaires de proximité. Il met donc en difficulté les associations d’aide aux sans-abri qui, par exemple à Paris, trouvaient auprès de la grande distribution implantée dans les divers arrondissements un approvisionnement régulier et gratuit en produits certes proches des dates limites, mais qu’elles se chargeaient de distribuer rapidement par le biais de leur réseau d’entraide.
Par ailleurs, l’arrivée de ces nouveaux commerçants aux frontières du cadre légal contribue à dévaloriser sensiblement les notions de date limite de consommation – DLC – ou de date limite d’utilisation optimale – DLUO –, initialement conçues par le législateur en vue d’une meilleure information du consommateur.
Monsieur le secrétaire d’État, quelle valeur pourra-t-on durablement accorder à ces indications d’aide à la bonne consommation, obligatoires pour tous les produits alimentaires, si peuvent être commercialisées des denrées atteignant leur DLC, voire dépassant très nettement leur DLUO ?
Vous le savez, la confusion est déjà réelle parmi les consommateurs, y compris dans la gestion personnelle de leur réfrigérateur. J’ajoute que les médias font également état de pratiques de « réétiquetage sauvage » ayant pour objet de prolonger la durée de vie de produits périmés.
Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous indiquer les résultats des enquêtes spécifiques déjà réalisées sur ce circuit d’approvisionnement souvent opaque, ainsi que les mesures envisageables pour réaffirmer l’utilité d’un respect strict des dates limites de vente ?
Madame le sénateur, votre question sur le développement d’un nouveau mode de commerce par le biais de magasins dits « de déstockage alimentaire » est tout à fait importante et légitime. Il convient en effet de clarifier l’ensemble des données pour que le consommateur puisse s’y retrouver.
L’apposition sur l’emballage des denrées alimentaires d’une date limite d’utilisation optimale ou d’une date limite de consommation est une obligation instaurée par le 5° de l’article R. 112-9 du code de la consommation, dans les conditions fixées par l’article R. 112-22 du même code.
Ces articles sont la transposition du paragraphe 5 de l’article 3 et de l’article 9 de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires.
La DLC est une date impérative, tandis que la DLUO est une date indicative. Un produit dont la DLC est dépassée est considéré impropre à la consommation et doit être retiré du marché, tandis que la sécurité d’un produit dont la DLUO est dépassée n’est pas mise en question. Pour autant, prolonger la DLUO d’un produit en fin de vie serait constitutif du délit de tromperie.
Une enquête couvrant onze régions et portant sur les produits vendus en fin de vie commerciale, près d’atteindre leur DLC ou dont la DLUO est dépassée, a été réalisée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, au cours de l’année 2008.
Des prélèvements microbiologiques ont été réalisés. Sur 557 produits analysés, tous se sont révélés conformes à la réglementation microbiologique. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait qu’il s’agissait de produits préemballés, présentant un faible risque de contamination par des manipulations.
Par ailleurs, sur 378 établissements visités, 1, 8 % ont fait l’objet de suites, soit pour mise en vente de produits à DLC dépassée indépendamment de leur conformité à la réglementation microbiologique – deux procès-verbaux ont été relevés à ce titre –, soit pour température de stockage non réglementaire, ce qui est dans la moyenne des constatations opérées par les services de contrôle, toutes formes de distribution confondues.
Cette année, une enquête explicitement ciblée sur les commerces de déstockage alimentaire vient d’être lancée à l’échelon national. Elle doit couvrir l’ensemble de ces commerces. Ses résultats ne sont pas encore disponibles, mais ils devraient l’être dans les semaines à venir.
À l’occasion des discussions en cours à l’échelon communautaire sur la révision de la directive sur l’étiquetage et sur les questions d’hygiène, les autorités françaises s’attachent à ce que l’importance des informations apportées au consommateur par la DLC et la DLUO soit pleinement reconnue.
Au-delà de la vente de produits en fin de vie commerciale, les services de contrôle sont particulièrement attentifs aux pratiques de « remballe » de produits avec prolongement illicite de DLC. Les infractions constatées dans ce domaine sont lourdement sanctionnées.

Je voudrais tout d’abord remercier M. le secrétaire d’État de cette réponse particulièrement détaillée, qui intéressera notamment les Parisiens, que je représente ici.
Je me permets d’insister, monsieur le secrétaire d’État, sur les conséquences de l’apparition de ce nouveau mode de commerce pour les associations humanitaires de proximité. Pour m’être rendue voilà quelques jours dans le quartier des Halles en compagnie du maire du Ier arrondissement, M. Legaret, je puis témoigner une fois encore de l’engagement total de nombreux bénévoles en faveur des plus démunis.

La parole est à M. Hervé Maurey, auteur de la question n° 503, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite vous interroger sur le devenir des contrats d’assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires.
L’assurance vie est un produit d’épargne très populaire auprès des Français. Ainsi, au 1er janvier 2009, près de 12 millions de nos concitoyens avaient souscrit un tel contrat, pour un encours total de 1 147 milliards d’euros, c’est-à-dire deux fois la capitalisation boursière du CAC 40.
Cependant, les contrats d’assurance vie non réclamés par leurs bénéficiaires à la suite du décès du souscripteur représentent un problème récurrent. Les montants en jeu atteindraient aujourd’hui 5 milliards d’euros, et plusieurs centaines de milliers de Français sont concernés.
Cette situation n’est pas tolérable d’un point de vue éthique, parce qu’il est normal que les sommes souscrites profitent à leurs bénéficiaires, ni d’un point de vue économique et fiscal, puisqu’il serait beaucoup plus utile que cet argent soit réinjecté dans l’économie plutôt qu’inscrit dans les comptes des sociétés d’assurances.
Une loi a été adoptée en 2007 – il me semble même que le Sénat l’a votée à l’unanimité –, faisant obligation aux assureurs de s’informer de l’éventuel décès des souscripteurs et de rechercher, le cas échéant, les bénéficiaires. Elle prévoyait également que le Gouvernement remettrait un rapport au Parlement avant le 1er janvier 2009, ce qui n’a pas été fait.
Monsieur le secrétaire d’État, quand recevrons-nous ce rapport ? Êtes-vous d’ores et déjà à même de nous donner quelques éléments d’information sur la situation actuelle et les effets de la loi de 2007 ? Les dispositions de celle-ci vous paraissent-elles avoir été efficaces et suffisantes, ou conviendrait-il d’aller un peu plus loin ? Encore une fois, il est plus que jamais nécessaire que ces sommes soient réinvesties dans l’économie.
Monsieur le sénateur, la question que vous soulevez est importante. L’encours des contrats d’assurance vie non réclamés fait l’objet à la fois de nombreuses estimations et de nombreux débats : le chiffre de 5 milliards d’euros que vous mentionnez n’en est qu’un parmi d’autres, diverses hypothèses faisant varier le montant desdits contrats entre 1 milliard et 10 milliards d’euros.
Comme vous l’avez relevé, monsieur le sénateur, des évolutions législatives sont intervenues sur cette question ces dernières années.
Ainsi, la loi du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance et la loi du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier constituent un ensemble aujourd’hui cohérent visant à réduire très sensiblement le phénomène des contrats non réclamés. Ces textes permettent en effet de faire converger, sur ce sujet, les incitations des assureurs, celles des assurés et celles des bénéficiaires.
La loi du 17 décembre 2007 représente, de ce point de vue, une étape très importante. Vous le savez, l’une des principales dispositions de cette loi a pour objet de permettre aux organismes d’assurances d’effectuer des traitements de données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques, tenu par l’INSEE, et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites.
Or cette disposition n’a été rendue opérationnelle que récemment, grâce à l’entrée en vigueur des textes d’application nécessaires. L’arrêté relatif au transfert des données issues du répertoire national d’identification des personnes physiques à l’Association de gestion des informations sur le risque en assurance, l’AGIRA, a en effet été publié au Journal officiel le 29 janvier 2009, après l’avis rendu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés le 18 décembre 2008.
Du fait du caractère récent de la publication de ces autorisations et compte tenu du rôle central de l’outil ainsi mis à la disposition des organismes d’assurances pour la détection des situations de non-réclamation de contrats, il est apparu souhaitable de prendre quelques mois de recul, le temps de vérifier le bon fonctionnement et l’efficacité de ce mécanisme, avant de rendre compte au Parlement. La remise du rapport prévue à l’article 4 de la loi du 17 décembre 2007 pourrait ainsi intervenir au terme du premier semestre de cette année, soit dans quelques semaines.
La remise de ce document sera l’occasion de procéder à une analyse complète du dispositif adopté en 2007. L’utilisation des moyens de recherche mis à la disposition des entreprises par l’intermédiaire de leurs organismes professionnels, le nombre de cas qu’ils auront permis d’identifier et les encours associés seront ainsi détaillés. Sera également abordé le sujet du versement au Fonds de réserve des retraites des contrats d’assurance vie dont les actions sont prescrites du fait de l’écoulement d’un délai de trente ans depuis le décès de l’assuré ou le terme du contrat.

Je me réjouis d’apprendre que nous n’avons plus que quelques semaines à patienter avant de pouvoir disposer de ce rapport tant attendu !
Le chiffre de 1 milliard d’euros que vous avez évoqué, monsieur le secrétaire d’État, est effectivement cité par les sociétés d’assurances, mais il paraît peu vraisemblable dans la mesure où il correspond à une estimation réalisée voilà déjà dix ans. Or on sait bien que l’encours des contrats d’assurance vie n’a fait qu’augmenter ; en outre, avaient alors été pris en compte uniquement les contrats dont les souscripteurs étaient nés voilà plus de cent trois ans !
Sourires

Par ailleurs, s’il est acquis que, désormais, les assureurs pourront accéder au fichier de l’INSEE et identifier les souscripteurs décédés, cela ne réglera pas toutes les questions puisque ce fichier n’indique pas, évidemment, les bénéficiaires des contrats d’assurance vie ! De surcroît, il suffit par exemple d’une erreur de saisie pour que le fichier ne soit pas pertinent.
Il conviendra bien sûr d’examiner le rapport qui nous sera prochainement remis, mais j’ai aujourd’hui le sentiment que la loi n’a pas vraiment permis d’atteindre les objectifs assignés et qu’il faudra sans doute aller plus loin. En particulier, un meilleur suivi des souscripteurs par les sociétés d’assurances serait nécessaire. Nous resterons bien entendu vigilants.

La parole est à M. Jean-Jacques Mirassou, auteur de la question n° 506, adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

M. Jean-Jacques Mirassou. Je ne doute pas que M. Novelli remplacera avantageusement Mme Lagarde !
Sourires

Monsieur le secrétaire d’État, ma question est relative à la situation de l’entreprise Molex, sise à Villemur-sur-Tarn, dans le département de Haute-Garonne.
Il est important de préciser que la direction de Molex avait déclaré, pour l’exercice 2008, un bénéfice de 1, 2 million d’euros. Pourtant, cette direction, elle-même délocalisée aux États-Unis, a annoncé très rapidement aux trois cents salariés de l’entreprise une délocalisation à très court terme. Trois cents salariés licenciés, ce sont trois cents familles touchées, c’est un nouveau coup porté à un bassin d’emploi déjà sinistré, la direction justifiant cette délocalisation par l’anticipation de pertes éventuelles…
Du reste, la direction de Molex est restée longtemps incapable de justifier économiquement son choix. De surcroît, un cabinet d’expertise mandaté par le comité d’entreprise n’a pas réussi, malgré une décision du tribunal compétent, à obtenir qu’elle produise des éléments comptables permettant d’apprécier clairement la situation de l’établissement. S’abritant derrière le droit américain, la direction de Molex s’est livrée à une véritable obstruction, empêchant tout contrôle de la réalité de la situation économique et adoptant à l’égard des trois cents salariés une attitude inqualifiable.
Mme Lagarde avait alors été interrogée sur les moyens d’intervention dont dispose l’État pour assurer le simple respect du droit du travail. Cependant, en un mois et demi, les choses ont évolué très vite, et le cas de l’entreprise Molex, d’abord de portée locale, a pris pour différentes raisons une dimension nationale.
En effet, les salariés de Molex ont eu accès à des informations leur permettant de prouver que, au moment même où la direction américaine envisageait une délocalisation pour le moins erratique, d’abord en République tchèque, puis en Chine, une autre chaîne de production de connectique fonctionnait déjà aux États-Unis, pour un résultat d’une qualité très discutable.
Tout cela tend à montrer que la décision de supprimer le site de Villemur-sur-Tarn était programmée de longue date, et justifie pleinement la procédure pour délit d’entrave engagée par les salariés de Molex.
Or, monsieur le secrétaire d’État, il faut savoir que le principal client de Molex est le groupe PSA Peugeot Citroën, qui a reçu de l’État, au titre du pacte automobile, une somme très importante. Compte tenu des quatre mois de sursis qui ont été accordés au site de Villemur-sur-Tarn, l’urgence est désormais de rétablir des relations directes et préférentielles, en matière de commandes, entre ce dernier et PSA Peugeot Citroën. Étant donné l’aide financière consentie par l’État, j’estime que le Gouvernement doit obtenir satisfaction sur ce point auprès de ce groupe. Est-il disposé, monsieur le secrétaire d’État, à agir en ce sens ? C’est un passage obligé : ce n’est qu’à ce prix que nous parviendrons à apporter la preuve que l’outil de Villemur-sur-Tarn peut être pérennisé.
J’ajoute que d’autres informations font peser une incertitude sur l’avenir de la production aux États-Unis. Si d’aventure le site de Villemur-sur-Tarn était rayé de la carte et si, par la suite, la direction décidait de supprimer sa production en Amérique, cela signifierait tout simplement que l’industrie automobile française, privée de fournisseurs de cet élément essentiel que représente la connectique, courrait un véritable danger. J’aimerais savoir, monsieur le secrétaire d’État, si vous en êtes bien conscient.
Monsieur le sénateur, la question de la fermeture du site que vous avez évoqué préoccupe aujourd’hui les quelque trois cents salariés de l’entreprise Molex et, au-delà, l’ensemble du bassin de Villemur-sur-Tarn.
Cette décision a été perçue comme totalement injustifiée par la plupart des salariés de l’établissement et a donné lieu à l’expression d’un profond désarroi, qui a été par la suite, et cela est tout à fait regrettable, instrumentalisé par certains leaders. Cela a mené, on le sait, à la séquestration de dirigeants de la société, action que le Gouvernement a très fermement condamnée parce qu’elle ne peut en aucun cas déboucher sur le règlement de la situation, si difficile soit-elle. Rien ne peut remplacer le dialogue entre les organisations syndicales et la direction de l’entreprise.
Le secrétaire d’Étatchargé de l'industrie, Luc Chatel, ses collaborateurs et les services de l’État en région ont été impliqués vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans la résolution d’une crise qui, de jour en jour, gagnait en intensité. Grâce à l’engagement total du Gouvernement, le dialogue entre les organisations représentatives des salariés et la direction a été renoué et un accord de fin de crise a pu être trouvé.
Vous connaissez, monsieur le sénateur, les principaux points de cet accord : le report au 31 octobre de l’arrêt d’activité ; la reprise d’activité à un niveau satisfaisant avec une période de montée en charge progressive de quinze jours ; la mobilisation d’importants moyens supplémentaires pour la revitalisation de ce territoire, la priorité étant donnée aux projets « internes » de réindustrialisation à partir des compétences des équipes et des matériels présents sur le site.
Notons que cet accord aurait pu être obtenu plus tôt si la direction et les syndicats ne s’étaient pas enfermés pendant des semaines dans un dialogue de sourds. Aujourd’hui encore, des actions en justice menées par le comité d’entreprise le fragilisent, alors qu’il aurait pu, j’en suis convaincu, constituer la base d’une relance des négociations de fond entre les représentants des salariés et la direction de Molex.
Les demandes des salariés rejoignent l’inquiétude que vous manifestez quant aux motivations économiques de la décision prise par le groupe Molex. Lorsqu’elle envisage un plan de sauvegarde de l’emploi, et a fortiori la fermeture d’un site de production, une entreprise doit fournir aux représentants des salariés les arguments économiques qui justifient sa décision. Les salariés de Molex estiment, en l’espèce, que l’information qui leur a été transmise n’était pas loyale. La justice a été saisie. Comme l’a indiqué M. le Premier ministre, si le délit d’entrave dont le comité d’entreprise accuse Molex est confirmé par la justice, alors l’entreprise sera condamnée, et nous veillerons à ce que toutes les conséquences de cette condamnation soient tirées. Néanmoins, vous le savez, nous devons attendre le résultat de la saisine du juge des référés, le 19 mai prochain, avant toute déclaration péremptoire.
La situation de Molex, dont le principal client est effectivement français mais dont la production est délocalisée dans d’autres pays, fait également écho au problème des relations entre les constructeurs automobiles et leurs sous-traitants.
L’État a mis en place un pacte automobile très ambitieux pour répondre à la grave crise qui secoue le secteur et tenter de pallier ses effets. La mise en œuvre de ce pacte a été conditionnée notamment à une amélioration du comportement des constructeurs à l’égard de leurs sous-traitants. En l’espèce, PSA Peugeot Citroën est mis à l’index pour avoir contribué à la délocalisation d’une production stratégique.
Vous m’avez interrogé, monsieur le sénateur, sur l’action du Gouvernement dans cette affaire. Je vous indique que l’attitude du constructeur fera l’objet d’un examen et, si nécessaire, donnera lieu à un rappel à l’occasion du comité que Luc Chatel, secrétaire d'État chargé de l'industrie et de la consommation, réunit tous les mois pour piloter la mise en œuvre du pacte automobile. Des règles ont été collectivement fixées, qui s’imposent donc à toute la filière automobile. En effet, seule l’implication de tous les partenaires, en particulier des producteurs et des sous-traitants, permettra de maintenir dans la durée une filière automobile qui se trouve aujourd'hui affectée par la crise mais qui demain, j’en suis convaincu, pourra être de nouveau performante et pourvoyeuse d’emplois dans nos territoires.

Monsieur le secrétaire d’État, nous attendrons avec au moins autant d’impatience que vous la date fatidique du 19 mai !
Par ailleurs, je vous laisse toute la responsabilité du jugement que vous avez porté sur les dérapages ayant eu lieu dans cette entreprise. Vous avez désigné des coupables supposés, mais je vous rappelle que ces incidents ont été engendrés dans une large mesure par le mépris affiché par la direction de Molex à l’égard des salariés, ainsi que par certaines déclarations plus qu’intempestives du dirigeant local, selon lesquelles les salariés manquaient de moyens intellectuels et de discernement pour se rendre compte qu’ils étaient manipulés à des fins médiatiques… En ce qui les concerne, l’ensemble des élus de Haute-Garonne ont choisi leur camp !
Dans votre réponse, vous ne niez pas, bien au contraire, la nécessité, à travers le fameux pacte automobile, de renforcer les liens entre le groupe PSA Peugeot Citroën et le site de Villemur-sur-Tarn. C’est là une sorte d’euphémisme, car le retour de l’activité à son niveau normal dépend bien plus du premier que du second !
Enfin, je souhaite attirer l’attention sur le paradoxe suivant : comment la direction peut-elle envisager des pertes en 2009 tout en demandant aux salariés une productivité encore bien plus forte pendant les quatre mois de sursis accordés qu’avant la crise ? S’il est nécessaire de travailler autant, c’est bien que les débouchés existent !
Nous serons très vigilants pour éviter que, passé le cap de la crise, la direction de Molex ne procède à ce que l’on appelle, dans le jargon du rugby, un « cadrage-débordement ».

La parole est à M. Michel Boutant, auteur de la question n° 483, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Monsieur le secrétaire d’État, je souhaite ce matin attirer l’attention sur la situation financière des communes engagées dans des opérations de renouvellement urbain, en particulier sur celle de la ville d’Angoulême.
Les villes concernées voient leur population diminuer, car ces opérations de renouvellement urbain entraînent la destruction de logements, la reconstitution de l’offre s’opérant presque exclusivement dans les communes périphériques. Tel est le cas d’Angoulême, dont le dernier recensement a révélé la perte de 1 193 habitants.
Cette situation entraîne une diminution des dotations de l’État – dotation forfaitaire, dotation de solidarité urbaine, Fonds de péréquation de la TVA –, qui sont établies en fonction du nombre d’habitants, tandis que la destruction de logements se traduit par des pertes de bases de taxe d’habitation et de taxe sur le foncier bâti, ainsi que par un moindre rendement de la fiscalité pesant sur les ménages.
Dans le même temps, la signature de conventions entre les villes et l’Agence nationale de renouvellement urbain, l’ANRU, fige les recettes affectées par cette dernière et par les autres cofinanceurs aux opérations de renouvellement urbain, ce qui conduit la commune, maître d’ouvrage, à devoir assumer seule l’augmentation systématique des budgets affectés aux opérations.
À l’image d’Angoulême, c’est l’ensemble des communes engagées dans des opérations de renouvellement urbain qui vont devoir supporter une hausse des dépenses pour financer ces opérations, tout en subissant une diminution des dotations de l’État et de leurs ressources fiscales propres.
Telle est la raison pour laquelle il est absolument indispensable de maintenir le pacte de stabilité au profit des collectivités engagées dans des opérations de renouvellement urbain pour une durée de cinq ans au moins, correspondant à la durée de la réalisation matérielle et financière de celles-ci.
Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous, d’une part, préciser les intentions du Gouvernement à l’égard de ce pacte de stabilité s’agissant des collectivités engagées dans des opérations de renouvellement urbain, et, d’autre part, confirmer son maintien pour une durée de cinq ans ?
Monsieur le sénateur, la question que vous soulevez reflète des difficultés bien réelles, mais je souhaiterais que celles-ci puissent être replacées dans un contexte un peu plus large.
Des communes engagées dans des opérations de rénovation urbaine peuvent, en effet, pâtir d’un transfert de population, généralement limité, qui a pour effet mécanique de réduire la dotation globale de fonctionnement. Toutefois, s’il s’agit là d’un réel manque à gagner, cela ne doit pas faire oublier le soutien financier dont ces communes bénéficient au titre du programme national de rénovation urbaine : plus de 12 milliards d’euros sont consacrés au total par l’État, au travers des dotations de l’ANRU, aux collectivités porteuses de projets. Celles-ci peuvent, en outre, bénéficier de nombreux autres dispositifs de soutien.
En ce qui concerne la ville d’Angoulême, elle est concernée par deux projets de rénovation urbaine, situés l’un dans le quartier « Ma campagne », l’autre dans le quartier « Basseau Grande Garenne », les subventions de l’ANRU s’élevant, respectivement, à 31 millions d’euros et à 20 millions d’euros, soit un effort financier total de 51 millions d’euros.
Au-delà de ces chiffres, je rappelle que la finalité des projets de rénovation urbaine est de réintégrer des quartiers dans une dynamique de développement urbain et de revitaliser un tissu économique et social. À terme, ces projets visent à permettre un plus fort développement, ce qui apportera un surcroît de recettes aux collectivités territoriales concernées, même si, dans un premier temps, il arrive que les communes-centres subissent une baisse de leurs dotations forfaitaires. Cependant, pour faire face à cet effet mécanique de baisse, elles peuvent bénéficier de différents dispositifs.
Le premier, inscrit dans la loi de finances de 2009, permet de lisser l’incidence d’une diminution de la population sur le montant des dotations de l’État. Cela renvoie à la problématique générale de l’incidence sur les finances locales de fortes variations de population. La loi de finances de 2009 introduit un dispositif de lissage sur deux ans des pertes de dotations pour les communes connaissant une variation de population de plus de 10 % entre 2008 et 2009. Le bénéfice de ce dispositif est ouvert quelle que soit l’origine de la diminution de la population.
En outre, le renforcement de la péréquation, au travers d’une dotation de solidarité urbaine rénovée, est également un instrument de soutien important à des communes engagées dans des projets de rénovation urbaine. La DSU est devenue un outil majeur de solidarité grâce à la réforme engagée depuis 2005 et accentuée encore récemment pour 2009. Du reste, son montant a quasiment doublé entre 2004 et 2009, selon les engagements pris dans la loi de programmation pour la cohésion sociale en 2005 : la DSU a été abondée chaque année de 120 millions d’euros !
Par ailleurs, le Gouvernement a lancé en 2009 la première étape d’une réforme de la DSU : l’intégralité de sa hausse, soit 70 millions d’euros, a été partagée, en 2009, entre les communes les plus défavorisées de la catégorie des villes de plus de 10 000 habitants. Angoulême fait partie des 476 communes les plus démunies qui bénéficient d’une DSU majorée de 2 % en 2009 : cela représente 1, 7 million d’euros supplémentaires à ce titre pour la ville d’Angoulême. Cette réforme de la DSU doit se poursuivre sur la base des réflexions du groupe de travail du comité des finances locales.
Je citerai également la nouvelle dotation de développement urbain créée en 2009. Cette dotation de 50 millions d’euros est destinée à soutenir les 100 villes comportant les quartiers les plus défavorisés.
Au total, la loi de finances initiale de 2009 consacre 120 millions d’euros supplémentaires, par rapport à 2008, au dispositif de solidarité en faveur des villes urbaines. C’est la somme maximale prévue dans le plan de cohésion sociale.
Monsieur le sénateur, j’espère que ces rappels vous auront convaincu de la largeur de l’éventail des mesures d’ores et déjà mises en œuvre au profit de nos villes engagées dans des opérations de rénovation urbaine, à l’instar de la ville d’Angoulême.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai pris bonne note de vos indications.
Toutefois, s’agissant des financements de l’ANRU, il faut souligner que des aménagements initialement prévus dans les quartiers que vous avez cités ont été sortis de la convention en cours de contrat. Leur réalisation repose aujourd’hui entièrement soit sur le département, soit sur la ville d’Angoulême. Je pense notamment aux centres médico-sociaux, destinés aux populations les plus fragiles.
Certes, la DSU augmentera, mais il n’en demeure pas moins que, dans les faits, la collectivité maître d’ouvrage est confrontée à des dépenses qu’elle n’avait pas prévues, tandis que ses rentrées fiscales connaissent malgré tout une baisse considérable.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 505, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

La France connaît l’un des plus forts taux de suicide en Europe. Entre 35 ans et 44 ans, le suicide constitue la première cause de mortalité, et la deuxième entre 15 ans et 24 ans.
Sous-estimé, le suicide des adolescents est devenu aujourd’hui un grave problème de santé publique. Il est, bien sûr, dû à des facteurs psychologiques, liés à l’angoisse inhérente à la période de transition qu’est l’adolescence.
Cependant, il peut aussi être lié aux addictions, bien souvent révélatrices de souffrances psychiques chez les jeunes. De nouvelles pratiques comme les scarifications, l’alcoolisme allant jusqu’au coma éthylique, les poly-addictions, la cyberdépendance expriment le profond mal-être que connaissent près de 900 000 adolescents âgés de 11 ans à 18 ans.
Par ailleurs, la question du suivi psychologique des jeunes ayant fait une tentative de suicide est préoccupante. En effet, aux dires des associations, des carences existeraient dans le suivi post-hospitalier de ces adolescents, en dépit de l’action des maisons des adolescents, qui doivent être présentes dans tous les départements.
L’accompagnement socio-éducatif et le suivi médico-psychologique de ces jeunes sont indispensables pour écarter le risque de récidive. Il est donc de notre devoir de dire à ces jeunes qu’ils ont leur place dans notre société et que si la vie n’est pas facile, elle vaut la peine d’être vécue.
Quelles mesures concrètes le Gouvernement compte-t-il mettre en place, au titre du plan national d’action face au suicide 2008-2012, dans les domaines de la prévention des addictions et de l’accès aux soins psychiques pour les jeunes ?
Madame la sénatrice, vous avez interrogé Mme Bachelot-Narquin sur la question du suicide chez les jeunes.
Le suicide reste en France, après les accidents de la route, la deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 ans à 24 ans. Cette situation n’est pas admissible. C’est pourquoi la prévention du suicide chez les jeunes constitue l’un des enjeux majeurs de la politique de prévention de Mme Bachelot-Narquin.
Même si les données de l’INSERM, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale, confirment que la mortalité des jeunes par suicide est en recul depuis dix ans, la France est l’un des pays européens les plus frappés par ces morts prématurées.
L’addiction représente un facteur de co-morbidité fréquent lors de la « crise suicidaire ». De 20 % à 60 % des jeunes concernés présentent en effet une dépendance alcoolique. Ce constat amène à s’interroger sur le lien entre comportement suicidaire, comportement addictif et comportement à risques. Tous sont révélateurs d’une souffrance psychique.
Pour renforcer les capacités de repérage précoce de la souffrance psychique des enfants et des adolescents, le ministère de la santé soutient une action de formation, en liaison avec l’École des hautes études en santé publique, l’EHESP. Il s’agit, depuis 2006, de former les professionnels de santé de première ligne, c'est-à-dire les médecins de la protection maternelle et infantile, les médecins de santé scolaire, les pédiatres.
Les interlocuteurs du monde de la santé, de l’éducation, de l’insertion sociale, familiale et professionnelle sont également impliqués dans une logique de réseau et de pluridisciplinarité.
Cet effort de formation a été confirmé dans le cadre du plan « Santé des jeunes » que Roselyne Bachelot-Narquin a présenté en février 2008.
Ce plan, qui s’attaque aux addictions chez les jeunes, particulièrement aux phénomènes d’alcoolisation aiguë, repose également sur des actions de prévention et de prise en charge.
Ainsi, des contrats-cadres de partenariat en santé publique entre le ministère de la santé et des sports et ceux qui sont chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de l’agriculture ou de la justice sont signés en vue de mettre en œuvre des actions communes d’information, de repérage des situations difficiles et de formation des professionnels.
Quant au projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, il prend en compte, dans son titre consacré à la santé publique, une partie du problème, en interdisant la vente d’alcool aux moins de 18 ans, ainsi que les open bars.
Concernant l’amélioration du repérage et de la prise en charge, Mme la ministre de la santé et des sports soutient la création de maisons des adolescents : soixante-cinq structures bénéficient ainsi d’aides financières.
Enfin, Roselyne Bachelot-Narquin a confié en juillet 2008 à David Le Breton, sociologue à l’université de Strasbourg, la mission de proposer une stratégie de prévention du suicide, avec des experts, acteurs institutionnels et associatifs. Il a remis récemment son rapport, et les services ministériels déclinent actuellement en mesures les propositions que celui-ci comporte, en particulier à destination des jeunes.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, le ministère de la santé et des sports accorde à ces douloureux problèmes l’attention qu’ils méritent.

Je tiens à vous remercier de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État.
Dans l’attente de la création des soixante-cinq maisons des adolescents annoncées, il faudrait prévoir, dans le cadre de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires, que chaque centre hospitalier universitaire soit doté d’un service de prise en charge des addictions et du suicide pour mener une véritable politique de prévention. Actuellement, c’est loin d’être le cas, car de tels services ne sont pas considérés comme « nobles », au contraire par exemple des services de chirurgie hépatique ou de chirurgie cardiaque, et rapportent également moins d’argent à l’hôpital. Là aussi, il faut mener une réforme des mentalités !
Monsieur le secrétaire d'État, je me permettrai de poser une autre question dans quelque temps pour savoir si les CHU ont progressé en la matière.

La parole est à M. Marc Laménie, auteur de la question n° 493, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Monsieur le secrétaire d'État, ma question a trait à la formation des infirmiers et infirmières.
Le programme des études conduisant à cette profession est actuellement en cours de réorganisation, avec l’entrée en vigueur d’un nouveau référentiel de formation proposé par la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins du ministère de la santé et des sports.
Cette réforme, qui doit entrer en vigueur à la rentrée de septembre 2009 et permettrait d’intégrer le diplôme dans la filière LMD, licence-master-doctorat, semble poser un certain nombre de problèmes.
Tout d’abord, le nombre important d’heures de travail personnel prévu dans le cursus d’enseignement ne correspond pas forcément au mode d’enseignement le plus approprié dans ce type d’études ni en tout cas au profil d’études défini par les directives européennes.
Ensuite, il serait sans doute préférable de substituer aux stages de terrain, d’une durée relativement longue, à savoir huit semaines, des stages plus courts, d’une durée de l’ordre de cinq semaines, mais répartis entre davantage de services.
Enfin, certaines unités d’enseignement sont moins intéressantes que d’autres, voire peu intéressantes, en termes d’unités de valeur, pour l’obtention du diplôme, alors qu’elles correspondent à des préoccupations très importantes, voire prioritaires, comme les soins relationnels, les soins éducatifs et préventifs ou les soins palliatifs.
À l’heure où le Parlement procède à une intense réflexion sur le nouveau paysage médical que l’on souhaite offrir aux Français, notamment sur l’exécution par les infirmiers et infirmières d’actes jusqu’alors réservés aux médecins, il importe que la formation initiale de ces professionnels soit la meilleure possible.
Je me permets donc de vous demander, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir nous préciser les orientations définitives du ministère de la santé et des sports en la matière.
Monsieur le sénateur, vous avez appelé l’attention de Roselyne Bachelot-Narquin sur le programme des études conduisant à la profession d’infirmier et d’infirmière.
Cette profession est au cœur de notre système de santé. La confiance que nos concitoyens lui témoignent, le dévouement et le professionnalisme des infirmiers appellent une juste reconnaissance des compétences liées à l’exercice de leurs missions. Cela commence par la reconnaissance de leur formation initiale.
Ainsi, la ministre attend de leur programme de formation qu’il valorise les infirmiers et les prépare mieux encore qu’aujourd’hui aux défis de demain, c'est-à-dire au vieillissement de la population et à la prise en charge des pathologies chroniques. C’est pourquoi l’élaboration du nouveau programme des études conduisant à la profession d’infirmier a fait l’objet d’une très large concertation avec l’ensemble des représentants de la profession et des étudiants.
Cette concertation, également menée avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, ainsi qu’avec la conférence des présidents d’universités, a abouti à un programme d’études fondé, pour la première fois en France, sur l’élaboration d’un référentiel des compétences. C’est sur cette base qu’a été conçu le référentiel de formation dont il est aujourd’hui question et qui répond aux attentes des infirmiers.
De plus, et conformément à l’engagement du Gouvernement d’intégrer la formation des infirmiers au cursus européen licence-master-doctorat, ce nouveau programme sera reconnu par l’université.
Le diplôme d’État d’infirmier, fondé sur cette formation rénovée, sera reconnu au grade de licence dès 2012. Il s’agit là d’une avancée historique pour cette profession. Grâce à cette intégration universitaire, les infirmiers de demain pourront se spécialiser et combler le manque de professionnels situés entre les soignants et les médecins que connaît notre système de soins.
Dans cette perspective, le niveau de la formation a été amélioré, notamment en renforçant les matières scientifiques et en axant beaucoup plus sur la clinique le contenu des programmes.
De surcroît, pour répondre aux critères du cursus LMD, l’organisation du diplôme sera fondée sur la notion de crédit européen, qui tient compte de l’ensemble de la charge de travail de l’étudiant, y compris le travail qu’il réalise chez lui. Il ne s’agit donc pas tant de faire travailler les étudiants chez eux plus qu’aujourd’hui que de comptabiliser les heures de travail personnel qu’ils effectuent déjà. La nouvelle maquette répond ainsi aux exigences des directives européennes en la matière.
Par ailleurs, conformément à la demande des professionnels et des étudiants, la durée de chacun des stages cliniques a été augmentée afin de renforcer l’apprentissage auprès des malades, indispensable dans une formation professionnelle.
Enfin, la durée prévue pour les soins relationnels, les soins éducatifs et préventifs, ainsi que les soins palliatifs, n’a jamais été aussi élevée.
Il n’y a donc pas d’ambiguïté sur le fait que ce nouveau programme répond bien à la demande des professionnels et des étudiants infirmiers, qui pourront ainsi envisager de poursuivre leur cursus en master, voire en doctorat. J’en veux pour preuve le fait que ce nouveau programme de formation a fait l’objet, le mois dernier, d’un vote très largement majoritaire au sein du Haut Conseil des professions paramédicales.
In fine, c’est surtout aux besoins des usagers que répondra ce nouveau programme de formation, en mettant à disposition du système de soins des infirmiers mieux formés, plus autonomes et en mesure de poursuivre leur formation à l’université tout au long de leur vie.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse, qui permettra de rassurer les étudiants, alors que la profession à laquelle ils se destinent est de plus en plus difficile et exigeante en termes de disponibilité et de dévouement. Il convient que leur formation soit pleinement reconnue et débouche sur la délivrance d’une licence.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, auteur de la question n° 479, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Je souhaiterais revenir sur les grandes difficultés rencontrées par les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH, pour obtenir de l’État les moyens humains et financiers initialement prévus lors de la signature des conventions de mise en place.
L’esprit de la loi de février 2005, qui a véritablement redonné espoir à de nombreuses personnes en situation de handicap et à leurs familles, se trouve aujourd’hui menacé par les graves problèmes de fonctionnement auxquels les MDPH sont confrontées.
Mme la secrétaire d’État chargée de la solidarité a déjà été interpellée à plusieurs reprises sur ce sujet, mais les éléments de réponse qu’elle nous a transmis n’ont pas suffi à faire disparaître nos inquiétudes : il est de fait que l’État ne respecte pas ses engagements initiaux en la matière, remettant en cause le versement de sa quote-part financière au fonctionnement des MDPH. C’est notamment le cas pour celle du Finistère, à qui l’État a décidé de ne pas verser sa quote-part pour 2008, indiquant qu’il en irait probablement de même pour les années à venir.
Ce désengagement de l’État ne peut que nuire au fonctionnement des MDPH et à la qualité des services proposés, alors que ces établissements se voient régulièrement confier de nouvelles missions : je pense à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au versement de la prestation de compensation du handicap pour les enfants ou encore au financement du transport pour les adultes et les enfants.
Aujourd’hui, la continuité et la qualité des actions entreprises en faveur des personnes handicapées ne sont maintenues que grâce à un effort financier supplémentaire des conseils généraux, ainsi que par l’engagement de personnels dévoués et le bénévolat de nombreux militants associatifs.
Plus inquiétante encore est la non-compensation des départs d’agents de l’État mis à disposition, compensation à laquelle l’État s’était pourtant engagé. Encore un transfert de charges sans juste compensation financière qui porte atteinte au principe de l’autonomie et de la libre administration des collectivités locales, pourtant inscrit dans notre Constitution !
Cette situation n’est ni acceptable ni supportable pour les maisons départementales des personnes handicapées. Ainsi, le 19 mars dernier, les membres de la commission exécutive de la MDPH du Finistère, à l’exception bien entendu des représentants de l’État, ont voté en faveur d’un recours contre l’État devant le tribunal administratif, visant à obtenir près de 156 000 euros en compensation du départ des quatre agents de l’État qui ont voulu regagner leur administration d’origine. Ceux-ci ont été remplacés par des contractuels payés par le conseil général du Finistère, qui n’avait guère le choix : quatre postes laissés vacants sur soixante, c’est énorme !
Il faut savoir qu’en 2008 la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a examiné plus de 35 000 demandes de prestation, soit près de 115 dossiers par jour !
Je rappelle aussi que, globalement, le conseil général consacre quelque 90 millions d’euros au handicap et qu’il a en outre financé la dizaine de nouveaux postes créés à la MDPH depuis son ouverture en 2006.
Je me dois également de souligner que de nombreux conseils généraux se sont déjà engagés bien au-delà de leurs obligations. Cependant, si l’État ne respecte pas réellement ses engagements initiaux, la situation des MDPH continuera inexorablement de se détériorer, ce qui aura pour conséquence un allongement des délais de réponse et d’instruction des dossiers.
Depuis leur création, les MDPH n’ont eu de cesse de prouver leur utilité. Elles parviennent à gérer efficacement les problèmes quotidiens des personnes en situation de handicap en mettant en place un accompagnement individualisé et en amenant chacune d’elles à construire son projet de vie.
Nous nous devons de continuer ensemble à faire de la compensation du handicap une action prioritaire et à permettre aux personnes handicapées de trouver pleinement leur place dans la société.
Monsieur le secrétaire d’État, c’est la demande que je vous adresse au nom de toutes les personnes handicapées et de leurs familles : l’État va-t-il pleinement respecter les engagements qu’il a pris lors de la signature des conventions de mise en place des MDPH, au travers de sa contribution au financement du Fonds de compensation du handicap et de la compensation du départ des personnels mis à disposition, personnels dont il faudra bien clarifier les statuts ?
Enfin, permettez-moi, en tant qu’élue de la Bretagne, de vous demander si vous avez apprécié la soirée de samedi dernier, sur les plans tant sportif que festif, et particulièrement l’ambiance bretonne qui a régné au Stade de France !
Sourires
Madame la sénatrice, j’ai effectivement beaucoup apprécié l’ambiance extraordinaire dans laquelle s’est déroulée cette rencontre !
Je vous prie d’excuser Mme Valérie Létard, secrétaire d'État chargée de la solidarité, qui m’a demandé de vous communiquer la réponse suivante.
Je ne peux pas vous laisser dire que l’État ne s’est pas investi dans la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées, qui sont effectivement un élément clé de la réforme de 2005.
Aujourd’hui, un millier d’agents de l’État sont mis à disposition des MDPH et, depuis la création de ces dernières, l’État et la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, la CNSA, ont consacré 245 millions d’euros à leur fonctionnement, ce qui en fait les premiers financeurs, à hauteur de 60 % du budget.
L’État s’était engagé à mettre à disposition des MDPH l’ensemble des moyens, humains et matériels, qui étaient jusque-là affectés aux services de l’État accomplissant les mêmes missions. Cet engagement sera tenu en 2009 : tout sera mis en œuvre pour que les postes devenus vacants depuis la création des MDPH en 2006, pour quelque motif que ce soit, soient effectivement pourvus, et ceux qui ne le seraient pas donneront systématiquement lieu à une compensation financière. Un premier versement provisionnel sera opéré avant l’été selon les besoins constatés, et le solde sera versé en fin d’année en fonction des postes encore vacants à cette échéance.
Par ailleurs, c’est bien parce que les MDPH ont des missions plus larges que celles qui étaient auparavant dévolues aux services de l’État que le législateur avait prévu une contribution de la CNSA à leur financement. Fixée au départ à 30 millions d’euros, elle a été portée l’an passé à 45 millions d’euros, pour tenir compte de la charge de travail réellement engendrée.
Récemment encore, de nouvelles réformes ont été décidées : extension de la prestation de compensation du handicap aux enfants, réforme de l’allocation aux adultes handicapés. Pour les mettre en œuvre, il fallait donner aux MDPH des moyens supplémentaires ; nous les avons prévus. C’est ainsi que la CNSA a de nouveau augmenté de 15 millions d’euros sa dotation aux MDPH. Quant à la dotation de chaque département, elle a été recalculée et la régularisation est intervenue le 5 mai dernier.
Mais, vous en conviendrez, on ne peut en rester là : améliorer réellement et durablement le fonctionnement des MDPH suppose désormais de faire évoluer leur statut et celui de leur personnel. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à donner aux MDPH les moyens de remplir leurs missions, le Gouvernement a engagé une réflexion en ce sens.
En tout état de cause, cette évolution se fera en concertation avec les différents partenaires concernés, au premier rang desquels les conseils généraux, afin de s’assurer que tout est mis en œuvre pour permettre aux MDPH de jouer correctement et efficacement leur rôle auprès des personnes handicapées.

Vous m’avez apporté une bonne nouvelle, monsieur le secrétaire d’État, puisqu’il semble que les sommes dues vont être versées aux conseils généraux ! Je vous en remercie !
Dans l’intérêt des personnes en situation de handicap et de leurs familles, l’État devra continuer à assumer ses responsabilités, d’autant que le champ du dispositif va s’étendre, d’autres compétences et d’autres missions étant confiées aux MDPH. Les conseils généraux ne pourront assumer seuls le financement de ces dernières.

La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 498, transmise à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question fait suite à celle que M. Teulade avait posée sur le même sujet le 31 mars 2009, et je me servirai d’ailleurs des éléments de réponse que vous lui aviez alors communiqués pour établir certains constats.
Il est question de supprimer quarante-quatre tribunaux des affaires de sécurité sociale en France : ceux qui traitent moins de 550 dossiers par an. En Auvergne, trois tribunaux sur les quatre existant actuellement sont concernés ; seul celui de Clermont-Ferrand subsisterait.
Une telle suppression aurait des conséquences tout à fait néfastes pour les justiciables, qui doivent se présenter au tribunal, la procédure étant orale : par exemple, il faut cinq heures de trajet aller et retour, dans des conditions très difficiles, pour se rendre d’Aurillac à Clermont-Ferrand. Je souligne qu’il s’agit souvent de personnes fragilisées, dont la mobilité peut être réduite.
Le 19 février dernier, le Conseil national des barreaux s’est d’ailleurs prononcé contre cette réforme et a transmis à la Chancellerie un avis en ce sens. Il serait tout à fait incohérent de supprimer cette juridiction de proximité, à l’instar d’un certain nombre de tribunaux d’instance, alors même que l’on a créé, voilà quelques années, le juge de proximité !
Monsieur le secrétaire d’État, dans la réponse que vous avez faite le 31 mars 2009 à M. Teulade, vous indiquiez que la suppression de ces tribunaux ne serait pas un problème pour les personnels, « qui seraient affectés aux directions régionales ou départementales du secteur social, sans mobilité géographique obligatoire », mais surtout que, « afin que la consultation soit la plus large et la plus complète possible, il a été décidé de prolonger la période de concertation jusqu’au 3 avril prochain. À cette fin, il a notamment été demandé aux préfets de région de porter une attention spécifique à la consultation des parlementaires et des élus locaux. »
Monsieur le secrétaire d’État, contrairement à ce que vous annonciez vous-même dans cet hémicycle le 31 mars dernier, nous n’avons été aucunement consultés ! J’ai interrogé sur ce point mes collègues parlementaires du département du Cantal ainsi que, tout à l’heure, Mme Anne-Marie Escoffier, sénatrice de l’Aveyron : nous partageons les mêmes inquiétudes et déplorons tous l’absence de concertation.
Cette situation est tout à fait désagréable : en tant que parlementaires, nous avons un avis sur ce projet qui vise une juridiction proche des citoyens, souvent saisie par des personnes démunies. Faute de concertation, nous ne savons même pas où en est aujourd’hui ce dossier…
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord d’excuser M. Brice Hortefeux, ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui m’a demandé de vous communiquer la réponse suivante.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les TASS, au nombre de 115, sont chargés de régler les litiges d’application de la législation de la sécurité sociale. Chacun de ces TASS est présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire, assisté de deux assesseurs et d’un secrétariat composé d’agents administratifs. Les TASS constituent, à ce titre, une juridiction sociale.
Afin d’obtenir une meilleure affectation des moyens de la justice et d’améliorer la qualité du service public rendu aux justiciables, un avant-projet de réforme, élaboré conjointement par les ministères de la justice, du travail et de l’agriculture en octobre 2008, envisage de rassembler, au sein de tribunaux de taille plus importante, les TASS saisis de moins de 550 requêtes nouvelles en moyenne annuelle. Leur nombre est estimé à quarante-quatre à l’échelon national, dont trois sont situés en Auvergne, à Moulins, à Aurillac et au Puy-en-Velay.
Cet avant-projet de réforme a été conçu dans la perspective d’une diminution, grâce à la récente simplification des procédures administratives, du nombre de requêtes émanant d’institutions publiques, qui va réduire sensiblement la charge de travail des TASS et avoir un effet positif sur les délais de jugement, parfois trop longs.
Je tiens néanmoins à préciser qu’il ne s’agit que d’un avant-projet : rien n’est encore décidé.
Afin de vérifier l’adéquation des propositions envisagées aux réalités locales, notamment en matière d’accessibilité des tribunaux pour les justiciables, cet avant-projet a fait l’objet, durant les mois de février et de mars derniers, d’une large consultation locale menée, d’une part, par les premiers présidents de cours d’appel et les procureurs généraux près les cours d’appel, et, d’autre part, par les préfets de région. Il a été demandé à ces derniers de porter une attention spécifique à la consultation des parlementaires et des élus locaux, et d’examiner en profondeur la question de l’accessibilité pour les justiciables, qui sont souvent des personnes fragilisées. Dans le même esprit, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, la FNATH, a été reçue par les directions des ministères concernés.
En fonction des résultats de la concertation menée à l’échelon local qui viennent de nous parvenir et qui vont faire l’objet d’une analyse approfondie au cours du mois de mai par les ministères concernés, cet avant-projet pourra être mis en œuvre totalement ou partiellement, ou encore faire l’objet d’un réexamen. Ainsi, vous l’aurez compris, il ne s’agit ni d’un projet définitivement entériné, ni d’une réforme visant à remettre en cause l’existence et la spécificité des TASS.

Monsieur le secrétaire d'État, la consultation dont les résultats vont être analysés par les ministères concernés n’a pas eu lieu ! Il est facile de s’auto-consulter : cela permet de simplifier l’examen des problèmes ! Toutefois, je ne pense pas que ce soit la bonne solution.
Je ne doute pas, monsieur le secrétaire d’État, que vous vous ferez notre porte-parole pour expliquer combien il est pénible d’effectuer un aller et retour de cinq heures sur les routes difficiles de notre région. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’une très bonne réforme !

Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à midi, est reprise à seize heures cinq, sous la présidence de M. Gérard Larcher.