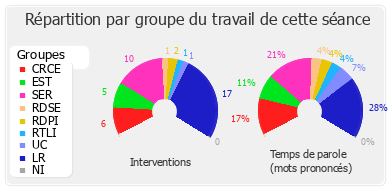Séance en hémicycle du 21 juillet 2021 à 21h00
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-huit heures quarante, est reprise à vingt et une heures, sous la présidence de M. Pierre Laurent.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (projet n° 771, texte de la commission n° 779, rapport n° 778).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.
Monsieur le président, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, le Gouvernement, en responsabilité, maintient la ligne qui n’a cessé d’être la sienne depuis 2017 : garantir l’équilibre entre efficacité de l’action antiterroriste et préservation des libertés individuelles. Fort de cette constance, il revient aujourd’hui devant vous, en nouvelle lecture, déterminé à défendre des positions – mûrement réfléchies, travaillées, pensées – visant à soutenir un texte essentiel pour renforcer l’arsenal législatif en matière de lutte antiterroriste, s’agissant singulièrement du suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme.
Ce sont des considérations d’efficacité opérationnelle, de pragmatisme, de respect de l’équilibre initial et de recherche du plus large consensus qui continuent à nous animer collectivement. Je souhaite, à cet égard, remercier particulièrement, au nom du Gouvernement, les membres de la commission des lois du Sénat, mais aussi ceux de la délégation parlementaire au renseignement (DPR) et de la mission d’information sur l’évaluation de la loi Renseignement, ainsi que les rapporteurs, pour la qualité du travail commun mené depuis plusieurs mois avec le Gouvernement, en dépit, parfois, de certaines divergences. Je souhaite que ce travail commun se poursuive, tant il est important que nous agissions ensemble et avec responsabilité sur ces questions.
Je voudrais également saluer nos services de renseignement, nos policiers, nos gendarmes, qui, chaque jour, font un travail exceptionnel pour identifier les menaces, suivre les individus dangereux et mettre en péril leurs projets meurtriers.
Nous sommes en nouvelle lecture donc, après l’échec de la commission mixte paritaire (CMP). Alors même qu’un consensus, dont nous devons tous nous féliciter, s’est dégagé sur la majorité des dispositions de ce texte relatif à la prévention des actes de terrorisme et au renseignement, une divergence de vues sur le dispositif de suivi des sortants de prison condamnés pour terrorisme a conduit à cet échec, que nous assumons.
Vous le savez, 188 condamnés terroristes islamistes sortiront de détention d’ici à 2025, dont beaucoup demeurent ancrés dans une idéologie radicale. Ces individus, qui constituent le « haut du spectre » des objectifs suivis par les services de renseignement, présentent des enjeux sécuritaires multiples à la sortie de la détention : prosélytisme, menace à court terme, représentée par certains profils impulsifs, menace à moyen et long terme relative à des projets d’attentats ou encore tentatives de redéploiement vers des zones de djihad à l’étranger.
L’expérience acquise au cours des dernières années nous permet aujourd’hui d’affirmer que le placement sous Micas (mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance) constitue, pour ces profils, un outil particulièrement utile et adapté : il permet de faciliter la surveillance d’individus sortant de prison, d’observer leurs relations habituelles, leur pratique, leur activité sur les réseaux sociaux, leurs efforts de réinsertion, etc., quand la mise en place d’une surveillance physique ou technique à temps plein se révélerait difficile, en raison des ressources humaines qu’elle nécessiterait de mobiliser. Pour ces profils présentant une dangerosité élevée, la limite de douze mois se révèle toutefois inadaptée.
D’ores et déjà, un certain nombre de Micas – dix-neuf depuis 2017 – sont arrivées à échéance, alors même que les services sont en mesure de justifier de la persistance de la menace constituée par le comportement des individus concernés. C’est pourquoi le projet du Gouvernement, voté par l’Assemblée nationale, prévoit, dans des conditions strictement encadrées, un allongement de ces Micas à une durée de deux ans.
Je rappelle que cet allongement est accompagné de garanties fortes, qui permettent de sécuriser la mesure sur le plan constitutionnel. Ainsi, la Micas ne pourra être prolongée jusqu’à vingt-quatre mois qu’à l’encontre d’individus condamnés pour des faits de terrorisme à au moins cinq ans de détention, ou trois ans en cas de récidive. En outre, au-delà de douze mois, le renouvellement de la mesure sera soumis à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires.
En 2018, le Conseil constitutionnel a, il est vrai, fait de la limitation à douze mois l’un des éléments du bilan de la constitutionnalité des Micas. Il s’est cependant prononcé sur une population différente et bien plus large que celle qui est visée par l’amendement du Gouvernement : étaient ainsi concernées, de manière générale, les personnes présentant des signes avérés de radicalisation, y compris celles qui ne sont pas passées à l’acte et qui n’ont donc pas pu faire l’objet d’une judiciarisation. Il s’agit donc de cas différents.
En revanche, le juge constitutionnel n’a pas été saisi du cas spécifique des individus ayant fait l’objet d’une condamnation pour des faits de terrorisme, qui présentent une différence objective de situation pouvant justifier des mesures plus contraignantes. Le Conseil constitutionnel a indiqué que la Micas ne pouvait se prolonger indéfiniment, aussi longtemps que dure cette menace, mais il n’a pas interdit au législateur d’allonger sa durée pour les profils les plus dangereux, dès lors que celle-ci continue à être bornée dans le temps.
Tels sont les éléments que je souhaitais une nouvelle fois, au nom du Gouvernement, porter dans cet hémicycle.
La mobilisation du Gouvernement pour lutter contre le terrorisme depuis 2017 ne serait pas possible sans le soutien constant du Parlement : renforcement des moyens humains, budgétaires et aussi – surtout, oserais-je dire ici – juridiques, au profit de l’ensemble des services de renseignement, des forces de sécurité, des magistrats et de l’ensemble des services de l’État qui mènent ce difficile combat sans relâche.
M. Alain Richard applaudit.
M. Philippe Mouiller applaudit.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, chacun ici dans cet hémicycle souhaite mettre en place le dispositif le plus efficace de prévention des actes de terrorisme. Nous nous associons d’ailleurs à l’hommage que Mme la ministre a rendu à nos services de police, en général, et à nos services de renseignement, en particulier, dont l’abnégation est exemplaire. Reste que les moyens pour y parvenir sont multiples.
Après l’échec de la commission mixte paritaire, le 9 juillet 2021, l’Assemblée nationale a achevé, le 13 juillet, l’examen en nouvelle lecture de ce projet de loi.
Sur les trente-six articles du texte, dix-neuf restaient en discussion. L’Assemblée nationale en a adopté six sans modification et a confirmé une suppression. Elle a voté les douze articles restant avec des modifications substantielles par rapport au texte du Sénat, pour la partie relative au terrorisme, notamment aux articles 2, 3 et 5.
Nous étions très proches d’un accord avant la commission mixte paritaire, mais l’intransigeance du Gouvernement a rendu son échec inévitable. Cette intransigeance s’est confirmée en nouvelle lecture, alors que les points de vue s’étaient fortement rapprochés entre députés et sénateurs juste avant la CMP.
Je rappelle que notre principal point de désaccord porte sur les modalités de suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme sortant de détention. Nous sommes d’accord sur le constat : les dispositifs existants ne permettent pas d’assurer leur suivi de manière satisfaisante, puisque près de deux cents d’entre eux vont sortir, dont un quart sont considérés par le parquet comme très dangereux et susceptibles de récidiver. Nous sommes en désaccord, en revanche, sur les voies de réponse.
Le Gouvernement et l’Assemblée nationale proposent d’allonger la durée des Micas à deux ans, afin d’assurer la surveillance de ce public, tout en instaurant une mesure judiciaire qui se concentrerait sur leur réinsertion. Nous proposons, quant à nous, de remettre la loi votée en juillet dernier sur le métier, en instaurant une mesure judiciaire à visée non pas seulement de réadaptation sociale, mais également de surveillance de l’individu.
Nous étions éventuellement prêts à envisager une évolution sur les deux ans des Micas, à condition de conserver cette mesure de sûreté, avec une dimension d’ensemble. Les mesures de suivi judiciaire nous semblent présenter plusieurs avantages : prononcées par un juge, elles offrent des possibilités de surveillance plus longue et potentiellement plus contraignante ; elles présentent des garanties plus importantes pour les individus concernés, car elles sont prononcées à l’issue d’une procédure contradictoire ; elles permettent, enfin, d’associer aux mesures de surveillance des mesures sociales visant à favoriser la réinsertion de la personne.
L’Assemblée nationale n’a pas souhaité donner suite à nos multiples propositions de compromis sur l’article 5. Je rappelle que nous en avons pourtant fait douze et que nous avions beaucoup travaillé.
Face à cette position intransigeante de la majorité gouvernementale, nous vous proposerons de supprimer les prolongations des Micas à l’article 3, mais d’adopter, à l’article 5, une rédaction qui avait été discutée avec les députés préalablement à la CMP. Il s’agit, afin d’assurer la bonne articulation entre mesure judiciaire et mesure administrative, de prévoir que, lorsque la mesure de sûreté comprend des obligations qui sont similaires à celles prononcées dans le cadre des Micas, les premières ne peuvent entrer en vigueur que lorsque les secondes sont levées.
Nous vous proposerons également de rétablir le texte du Sénat à l’article 2. Notre texte permet une caractérisation plus précise des locaux annexes au lieu de culte qu’il sera possible de fermer s’il existe des raisons sérieuses de penser que ceux-ci seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de la mesure de fermeture du lieu de culte.
Dans une perspective de conciliation avec l’Assemblée nationale, nous vous proposerons de supprimer la mention de l’accueil habituel de réunions publiques, étant entendu que les mesures de police administrative ne peuvent concerner des lieux privés, cette mention semble redondante.
Voilà l’essentiel pour la partie terrorisme ; je cède maintenant la parole à ma collègue Agnès Canayer pour le volet renseignement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Alain Richard applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, concernant la partie renseignement, la priorité du Sénat a été de doter les services des moyens adaptés pour faire face à l’évolution, notamment technologique, des pratiques terroristes et criminelles qui menacent la sécurité intérieure de notre pays. Notre travail a été guidé par le respect des libertés constitutionnelles, en nous assurant notamment de la protection de la vie privée, par un réel encadrement législatif doublé de contrôles suffisants.
En première lecture, le Sénat avait abouti à un juste équilibre entre liberté et sécurité. Après des discussions très constructives avec mon homologue, le député Loïc Kervran, et grâce aux nombreux échanges menés au sein de la DPR, nous étions parvenus à nous entendre sur la partie relative au renseignement. Cet accord n’a malheureusement pas survécu à l’échec de la CMP.
Les députés ont rétabli l’accès des services du second cercle à l’expérimentation relative à l’interception des données satellitaires, mais cela ne constitue pas pour nous un point de blocage. L’Assemblée nationale a en effet précisé que les services du second cercle concernés seront ceux dont les missions le justifient et seront déterminés « par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». Dès lors, les conditions de participation de ces services nous paraissent satisfaisantes et suffisamment précises.
En revanche, à l’article 13, les députés ont supprimé le caractère expérimental de l’extension du traitement par l’algorithme des URL, prévu par le Sénat jusqu’au 31 juillet 2025. Or, d’un point de vue tant technique que juridique, cette extension ne nous paraît pas possible sans une expérimentation préalable.
Je rappelle que les URL sont des données de nature mixte, qui relèvent à la fois des données de connexion et du contenu des communications et qu’elles font donc légitimement l’objet d’une protection renforcée. La nécessité d’une expérimentation avait été soulignée par la DPR dans son dernier rapport, et je regrette que nous n’ayons pas trouvé d’accord sur ce point. Nous vous proposerons donc de rétablir la version du Sénat à l’article 13.
Outre des modifications purement rédactionnelles, les députés sont revenus sur une précision que nous avions introduite à l’article 15 sur la conservation des données de connexion.
Vous le savez, le régime français a été clairement remis en cause par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui pourrait avoir des incidences potentiellement très importantes sur les enquêtes judiciaires.
Nous souhaitions inscrire dans la loi que les catégories de données conservées par les opérateurs dans le cadre de leur obligation de conservation permanente, c’est-à-dire les données relatives à l’identité, les coordonnées de contact et de paiement, les comptes et les adresses IP, devaient rester accessibles aux autorités judiciaires lors des procédures de réquisition habituelles. Une telle mesure est conforme à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne et faciliterait le travail des enquêteurs. C’est pourquoi nous vous proposerons de la rétablir.
Enfin, alors que le Sénat avait adopté deux amendements rédactionnels sans modifier la teneur de l’article 7 portant sur la communication d’informations aux services de renseignement par les autorités administratives, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de fond visant à apporter des garanties supplémentaires pour tenir compte de la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 9 juillet dernier, c’est-à-dire après la réunion de la commission mixte paritaire.
Plus précisément serait supprimée la possibilité offerte aux autorités administratives de transmettre des informations aux services de renseignement de leur propre initiative. La transmission des données les plus sensibles serait par ailleurs encadrée et les exigences de traçabilité renforcées. Ces dispositions me semblent de nature à mieux encadrer cette transmission d’informations. Je vous propose donc de ne pas les modifier.
À l’inverse, les députés ont adopté conforme l’article 19 relatif aux archives classifiées. En première lecture, nous avons eu des débats très approfondis sur le sujet : le dialogue doit se poursuivre entre les représentants de la profession et les ministères et services concernés, mais nous ne sommes pas appelés à en rediscuter en nouvelle lecture.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Maryse Carrère ainsi que MM. Franck Menonville et Alain Richard applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l’actualité nous prouve que les outils de renseignement les plus puissants et les méthodes d’intrusion les plus élaborées sont susceptibles d’être développés et utilisés par des acteurs privés. Les nouvelles technologies, les constellations satellitaires, la 5G, mais aussi, plus prosaïquement, les applications mobiles nous le démontrent également, et tout indique que nous allons poursuivre dans cette voie.
Il me semble qu’il y aurait un certain paradoxe à laisser des opérateurs privés mener des actions de renseignement, tout en n’habilitant pas les services publics, que l’on encadrerait, à agir dans ce domaine. Il me semble qu’il y aurait un certain paradoxe à l’accepter pour des acteurs privés, mais pas pour ceux qui ont vocation à nous protéger.
En effet, la maîtrise des techniques de renseignement est aujourd’hui essentielle pour protéger les Français, physiquement comme dans leur vie privée. Les débats que nous avons et les constats que nous dressons à propos de l’affaire Pegasus depuis quelques jours le montrent bien. C’est la raison pour laquelle il est indispensable d’encadrer les services de renseignement : cette précaution est primordiale dans une société démocratique.
De ce point de vue, la loi de 2015 a constitué une rupture. Je pense à la création de la CNCTR ou des moyens accordés au GIC, qui permettent d’encadrer la manière dont les techniques de renseignement sont utilisées par la puissance publique en France.
Aujourd’hui, les nouvelles technologies exigent que nous améliorions et élargissions la portée des dispositifs existants. C’est ce que prévoit ce texte. C’est pourquoi nous soutenons les propositions de la rapporteure. Je pense notamment à la nature intrusive des URL – nous aurons ce débat tout à l’heure –, qui nous impose de rendre expérimentale la possibilité de les inclure parmi les données traitées par algorithme.
Il nous faut toutefois regretter, en particulier compte tenu de l’actualité, que le texte ne prenne pas en compte l’arrêt de la CEDH du 25 mai dernier, qui appelle à un encadrement des relations avec les services étrangers. L’affaire actuelle montre que ce qu’il n’est pas possible de faire dans un pays peut être sous-traité ailleurs, si bien qu’en l’absence d’encadrement des échanges il y a problème et, donc, potentielle fuite. Autrement dit, l’encadrement ne sert finalement à rien.
Par ailleurs, si les échanges de nos propres services avec l’étranger ne sont pas encadrés, un certain nombre de pays et de partenaires proches, qui se conforment, eux, à l’arrêt de la CEDH, ne pourront plus travailler de la même manière avec nous. Cette évolution est donc indispensable.
Pour ce qui est du terrorisme, les menaces au Levant, en Afghanistan et en Libye ainsi que l’évolution de ces menaces nous obligent à continuer de disposer d’outils pour protéger les Français. Le recours à ces instruments doit néanmoins se faire conformément à nos valeurs. Si nous en changions, nous offririons la victoire aux terroristes. C’est la raison pour laquelle, depuis le début, le groupe socialiste considère que la prévention relève du pouvoir administratif, mais que, dès que c’est possible, il faut judiciariser les modalités de suivi des condamnés pour terrorisme, de manière à placer les éventuelles mesures de privation de liberté sous le contrôle du juge. Cette réponse repose sur une bonne coopération entre le parquet et les services administratifs, ainsi que sur la conviction que les moyens à la disposition des services de renseignement, de la police et de la justice jouent toujours un rôle plus déterminant que les lois dans la protection des Français.
Les Micas, particulièrement intrusives, sont peut-être nécessaires. Nous avons d’ailleurs dit à plusieurs reprises que nous n’étions pas opposés à leur maintien, même si nous avons rappelé notre souhait d’un contrôle régulier du Parlement et de validations législatives régulières au cas où nous les prolongerions. Ce n’est toutefois pas la version qu’avait retenue la commission mixte paritaire.
Même si celle-ci a finalement échoué, il existe tout de même un certain nombre de convergences entre le Sénat et l’Assemblée nationale que nous ne partageons pas. C’est pourquoi, pour nous assurer que les dispositions votées par le Parlement seront conformes aux garanties qu’offre notre Constitution, notamment sur le volet relatif au terrorisme, nous saisirons le Conseil constitutionnel. Nous voulons lever tout doute quant au texte adopté par le Parlement.
Je terminerai en faisant deux remarques.
En premier lieu, je veux m’arrêter sur l’article 15 et la manière dont le Parlement et le Gouvernement proposent de sortir de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés depuis que la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt qui impose aux opérateurs de communications électroniques de conserver les données de connexion, ce qui empêche la justice de faire son travail et les opérateurs de répondre aux près de 2 millions de réquisitions judiciaires qu’on leur adresse chaque année. Les parquets craignent vraiment de ne pas être capables de poursuivre leurs enquêtes avec la même fiabilité et robustesse.
Cet article 15, qui a été conçu sans que l’on s’intéresse à ce que font nos partenaires européens, pourtant soumis à la même législation, et sans que l’on se demande s’il ne faudrait pas changer la règle au niveau communautaire, dès lors que l’ensemble des pays européens sont susceptibles de rencontrer une difficulté en la matière, nous paraît quelque peu hasardeux. La question que je posais précédemment au ministre de la justice montre que le sujet est peut-être traité avec un peu trop de désinvolture, alors même que, pour donner confiance en la justice, il faut la doter de moyens robustes et fiables.
En second lieu, j’évoquerai l’article 19 sur les archives. Excusez-moi de le dire ainsi, mais il est vraiment scandaleux, alors que nous examinons de nouveau ce projet de loi aujourd’hui, que nous ne puissions pas présenter des amendements, tout cela parce qu’il y a eu accord entre l’Assemblée nationale et le Sénat et que cet article a été adopté conforme.
Le groupe socialiste veut exprimer son désaccord absolu avec la méthode qui consiste à nous faire voter aujourd’hui un texte qui modifiera la base légale du régime de communicabilité des archives et qui rendra obsolète l’arrêt du Conseil d’État du 2 juillet dernier, qui annule les procédures de déclassification de chaque archive.
Ce n’est pas un petit sujet, car le fait de construire l’histoire de notre pays, non pas sur des mythes, mais sur la réalité, et de donner la possibilité à nos chercheurs de construire notre récit national sur les faits est essentiel. Or cela ne sera plus possible s’il n’est pas envisageable de déclassifier certains documents.
Nous savons bien qu’il est nécessaire de continuer à protéger un certain nombre d’archives qui peuvent encore présenter une utilité opérationnelle, mais nous considérons que la manière dont le débat a été mené en première lecture et ce à quoi il a abouti sont un réel scandale. C’est la raison pour laquelle, malgré notre accord sur un certain nombre de points, nous nous abstiendrons sur ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.
Applaudissements sur des travées des groupes RDSE et Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire n’est pas parvenue à élaborer un texte commun sur les dix-neuf articles restant en discussion. Je le regrette d’autant plus que l’exercice a échoué de peu. En effet, un compromis avait été trouvé sur les objectifs à atteindre en matière de renseignement. Ce ne fut malheureusement pas le cas pour les autres dispositions. L’un des points d’achoppement concernait l’articulation des mesures de suivi des sortants de prison. En effet, les membres de la commission mixte paritaire n’ont pas divergé sur le principe selon lequel ces sortants de prison condamnés pour des faits de terrorisme doivent faire l’objet d’un suivi, mais plutôt sur la nature et le contenu de ces mesures.
Je voudrais revenir sur quelques chiffres que j’ai déjà mentionnés à cette tribune il y a peu.
Dans les prisons françaises, 469 personnes sont détenues pour des actes de terrorisme islamiste ; 253 sont condamnées et purgent une peine ; 162 devraient être libérées dans les quatre prochaines années et risquent réellement de réitérer leurs actes. Ce risque, nous le savons tous, n’est pas théorique, et ces chiffres ne sont pas équivoques : il faut donc agir vite pour mieux protéger nos concitoyens.
La question des sortants de prison illustre de façon emblématique l’évolution d’une menace de plus en plus endogène. Aussi, il est de notre devoir de tout mettre en œuvre pour garantir la protection de nos concitoyens.
Ce projet de loi est primordial à bien des égards.
Tout d’abord, il touche au droit à la sûreté. Il nous permet de lutter avec plus d’efficacité contre les ennemis de la France, qui veulent nous toucher au cœur. À chaque attaque, c’est la République française tout entière qui est atteinte.
Ensuite, ce projet de loi est indispensable à tous ceux dont l’activité, bien souvent dans l’ombre, est de lutter au quotidien contre la menace terroriste.
Le terrorisme constitue un défi majeur de notre temps. C’est – il faut le dire – une nouvelle forme de guerre. Chaque jour qui passe nous rappelle à quel point la menace est omniprésente. Elle prend des formes diverses et variées et se nourrit des progrès technologiques.
Plus que l’obligation, nous avons le devoir d’y faire face. Nous devons donner aux services de renseignement les moyens de s’adapter à une nouvelle donne à la fois juridique, technologique et opérationnelle. Dans un autre contexte, l’actualité nous le rappelle.
Si une menace existe, elle doit être prise en compte. S’il existe un vide juridique, il doit être comblé.
Nous avons aussi le devoir d’éviter tout risque constitutionnel. Je pense notamment à la question de l’allongement de la durée des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance. À cet égard, je salue véritablement le travail de la commission des lois du Sénat, et je me félicite que le Sénat ait privilégié la voie du renforcement des dispositifs de suivi judiciaire.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte modifié par notre commission. Il fixe le cadre législatif dont nous avons besoin pour améliorer la défense de notre nation contre toutes les formes de terrorisme et, ainsi, garantir la sécurité de nos concitoyens.
Comme le disait si justement le général de Gaulle : « La défense ! C’est la première raison d’être de l’État. Il n’y peut manquer sans se détruire lui-même. »
Applaudissements sur des travées des groupes RDSE et Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires l’a affirmé clairement et à de nombreuses reprises : la menace terroriste existe et nul ne peut prétendre s’en désintéresser ou ne pas vouloir doter les pouvoirs publics des moyens nécessaires pour y faire face. Mais à quel prix ?
Au prix de l’affaiblissement des droits et libertés garantis par notre Constitution ? Au prix d’atteintes à la liberté d’aller et venir, au secret des correspondances, au secret professionnel ou encore au droit au respect de la vie privée et familiale ? Au prix de l’instauration d’une surveillance généralisée de nos concitoyens au moyen d’IMSI catcher, de captage des données de communication satellitaires et de recueil des URL ? Au prix d’un dessaisissement du juge dans sa mission de protection des libertés individuelles par la pérennisation, dans notre droit commun, du recours intensif à des procédures administratives relevant du cadre de l’état d’urgence ? À quel prix, donc ?
Par ailleurs, nous avions posé la question lors de l’examen de la proposition de loi Justice de proximité et réponse pénale : de quels moyens parlons-nous quand la justice pâtit d’un manque de ressources humaines et matérielles importantes, qui l’empêchent de mener à bien sa mission ?
Nous ne cesserons de le marteler, madame la ministre, le maigre budget global de la justice, couplé au manque de personnel, est au cœur des difficultés de notre système judiciaire. Et si la seule réponse que souhaite apporter ce gouvernement à la menace djihadiste est d’ordre sécuritaire, il signe dès aujourd’hui l’échec de la politique de prévention des actes terroristes en France.
Un tel projet de loi est disproportionné au regard des besoins des services de renseignement et, plus encore, si on l’envisage sous l’angle de son efficacité en matière de lutte contre le risque terroriste.
Le Gouvernement, dont le texte avait pour objectif initial de renforcer notre arsenal pénal, a perdu de vue cet objectif et tombe dans le piège de toutes les précédentes lois attentatoires aux libertés individuelles.
Le projet de loi traite par ailleurs de la question des archives : il prévoit de restreindre l’accès à celles-ci – notre collègue Leconte vient d’en parler –, ce qui contrevient à un autre droit consacré au niveau constitutionnel en vertu de l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le but recherché nous échappe et nombre de chercheurs, d’historiens, d’archivistes, mais aussi de responsables politiques se sont opposés à cette disposition.
Aucune réponse de fond n’a encore été apportée au problème réel que constitue la radicalisation, particulièrement en détention. À la place, le choix est arbitrairement fait de s’attaquer aux archives et d’inscrire dans notre droit des procédures exorbitantes du droit commun, qui viennent affaiblir peu à peu notre État de droit.
Comme nombre de défenseurs des libertés publiques, nous tirons la sonnette d’alarme : pouvons-nous réellement concevoir une société vivant dans un état d’urgence permanent ? L’accumulation et la pérennisation des lois d’exception – il s’agit là du huitième texte de cette nature depuis 2015 – ne sont jamais de bon augure.
Je regrette de surcroît l’absence totale de concertation préalable, tout comme je dénonce le recours à la procédure accélérée dont le Gouvernement a pris l’habitude : tous deux privent le Parlement d’un véritable débat.
S’agit-il réellement d’une manœuvre politicienne consistant à cranter les thématiques régaliennes dans le débat public à l’approche de l’élection présidentielle ? Chacun se fera son opinion sur la question.
En ce qui concerne le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, nous ne saurions l’accepter. Comme en première lecture, nous voterons contre ce texte.
MM. Patrick Kanner et Jean-Pierre Sueur applaudissent.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous nous approchons de la conclusion d’un accomplissement législatif qui répond globalement aux défis persistants, presque devenus permanents, des menées terroristes qui continuent à être ourdies dans notre pays.
Le présent projet de loi conduit à consolider les outils principaux de surveillance antiterroriste que sont les Micas, les contrôles des lieux de culte, les visites domiciliaires et les périmètres de protection, en leur garantissant, à force de réflexion, une conformité constitutionnelle éprouvée.
Ce texte conduit aussi, dans son état actuel, grâce à la quantité de points sur lesquels nous convergeons, à un renforcement et à une sécurisation juridique de la technologie des algorithmes. Nous y avons également introduit un dispositif de brouillage des ondes émises et reçues par les drones malveillants. Enfin, nous avons perfectionné les méthodes de transmission de données de sécurité entre services.
Nous apportons une réponse – même s’il est vrai qu’elle est partielle – au défi légal posé par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la conservation des données, telle que l’a interprétée le Conseil d’État il y a quelques semaines. Nous avons encore un doute, en tout cas une insatisfaction, quant à son efficacité dans la lutte contre la criminalité.
L’ensemble de ces dispositions font l’objet d’un assentiment général. Je crois donc que nous avons accompli un travail législatif parfaitement correct, qui nous rassemble sur une base politique large.
Il subsiste en revanche un désaccord sur la méthode de suivi la plus adaptée aux anciens condamnés pour actes de terrorisme ayant purgé des peines d’un certain niveau de gravité. Nous sommes en présence de deux thèses juridiques que je crois, l’une et l’autre, assez étayées ; mais je m’exprime avec d’autant plus de mesure sur ce sujet que nous avons tous, les uns et les autres, vécu en la matière quelques mésaventures constitutionnelles.
À la réflexion, il me semble donc, compte tenu de la spécificité du groupe d’individus en cause, comme l’a souligné Mme la ministre, et au vu de l’expérience désormais prolongée des services compétents, que la durée de la mesure administrative, même portée à deux ans, est adaptée à la situation et qu’elle peut être sécurisée juridiquement – nous le verrons bien dans quelques semaines. C’est la raison pour laquelle nous défendrons cette formule aux côtés du Gouvernement.
Je veux insister sur ce point pour conclure : nous avons, me semble-t-il, fourni à l’État et, donc, à la société française des outils de protection et de prévention contre la menace terroriste qui sont désormais, je crois, de bonne qualité. Je le dis tout en m’associant, comme l’ont fait plusieurs de mes collègues au cours de cette discussion générale, à l’hommage rendu à tous les personnels engagés dans la prévention du terrorisme et tout en leur apportant tout notre soutien moral.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Philippe Bonnecarrère et Franck Menonville applaudissent également.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, d’abord, permettez-moi de dire mon regret que, sur un texte abordant des thématiques si fondamentales, notre parlement ne soit pas parvenu à élaborer un texte commun. Je le regrette d’autant plus que, sur de nombreux points, nous partons des mêmes constats.
Le premier est celui de la nécessité légale. Comme cela a largement été souligné au cours de la navette, à défaut d’une intervention du législateur, bon nombre de dispositions du code de la sécurité intérieure, issues notamment de la loi SILT, arriveront à échéance en 2021.
Le second est, bien entendu, l’objet de toutes ces lois : répondre à la menace terroriste et notamment au risque que représente la sortie de détention, dans les prochaines années, de détenus condamnés pour des faits en lien avec le terrorisme. Ce point spécifique doit faire l’objet d’une réponse législative en raison de la particulière dangerosité que présentent ces détenus, pour lesquels le risque de récidive est significativement élevé.
C’est sur ce point que se cristallise le désaccord du Parlement, et plus précisément sur l’article 5 du projet de loi, qui prévoit d’instituer un dispositif de suivi des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.
De son côté, l’Assemblée nationale n’a pas changé de position. Elle estime qu’il revient au tribunal de l’application des peines d’ordonner des mesures judiciaires de prévention et de la récidive terroriste et de réinsertion. Ce dispositif aurait pour spécificité de ne contenir que des obligations tendant à la réinsertion des individus concernés, laissant ainsi à d’autres mesures – les Micas prévues à l’article 3, en l’occurrence – le soin d’exercer un contrôle administratif et de surveillance.
Notre chambre, quant à elle, prévoyait une mesure de nature administrative, dont le contenu serait mixte : il s’agissait d’un dispositif tant d’accompagnement à la réinsertion que de surveillance, susceptible d’être davantage contraignant.
De ce point de vue, donc, la position du Sénat paraissait cohérente et claire dans sa mise en œuvre. Je crois que l’argument n’était pas qu’accessoire : il compte pour que notre droit fasse preuve de clarté face à l’épreuve que lui impose le terrorisme.
Toutefois, notre commission a démontré sa capacité à élaborer un compromis en adoptant, lors de ce nouvel examen, une version remaniée du texte. Elle s’est montrée soucieuse de l’articulation des mesures administratives et de la nouvelle mesure judiciaire qui semblait préoccuper le Gouvernement et l’Assemblée nationale.
Dans ces conditions, la disposition proposée par le Sénat offre des garanties suffisantes au regard du but à atteindre. Surtout, elle ne devrait pas faire l’objet d’une censure de la part du Conseil constitutionnel, ce qui, je le rappelle, est l’une des raisons pour lesquelles nous devons encore nous réunir sur ces questions.
En dernier lieu, je veux rappeler notre inquiétude concernant l’article 19 du projet de loi, qui vient définir le régime juridique de la communicabilité applicable aux archives intéressant la défense nationale.
Notre groupe avait défendu des amendements, afin de proposer des solutions que nous considérions plus adaptées. Malheureusement, ils n’ont pas été adoptés. Nous regrettons que perdure l’impression d’une minimisation des enjeux liés à ces sujets.
Malgré tout, le groupe du RDSE se prononcera majoritairement en faveur de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – Mme Catherine Di Folco applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en abordant l’examen en nouvelle lecture d’un texte dont les mesures nous sont désormais, hélas, plus que familières, je dois vous faire part de l’inquiétude doublée d’amertume que nous ressentons au sein de notre groupe, nous qui, comme d’autres, sommes mobilisés pour lutter contre le terrorisme et le risque terroriste dans notre pays et au-delà de nos frontières.
Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité d’une multitude de lois sécuritaires, dérogatoires au droit commun, votées sans véritable évaluation préalable des dispositifs existants, de leur nécessité et de leur efficacité.
En votant ce projet de loi, mes chers collègues, vous pérenniserez les dispositifs issus de la loi SILT, c’est-à-dire des dispositifs semblables à des assignations à résidence et à des perquisitions contrôlées par l’administration qui, contournant la procédure judiciaire et les droits de la défense, ont des conséquences particulièrement lourdes pour les personnes visées, jugées sous couvert d’un motif flou, celui de leur « dangerosité ». Je pense notamment aux Micas, l’un des points d’achoppement ayant conduit à l’échec de la commission mixte paritaire.
Madame la ministre, madame, monsieur les rapporteurs, vous êtes pourtant d’accord sur la philosophie globale de ce genre de mesures. En réalité, quels que soient l’issue de ce texte et les micro-aménagements sur lesquels vous vous entendrez en pérennisant toutes ces mesures, vous faites le choix d’opérer un tournant radical en matière de police administrative, inspiré par un principe de précaution incompatible avec nos principes démocratiques, fondés sur un droit pénal d’interprétation stricte.
Concernant le volet renseignement, ce projet de loi consacre ce qui émergeait déjà dans la loi de juillet 2015 relative au renseignement, qui avait été déférée devant le Conseil constitutionnel par François Hollande lui-même : l’extension du champ des activités du renseignement et la légalisation de techniques de surveillance intrusives, en parallèle d’un maintien à distance de l’autorité judiciaire.
Avec l’ensemble de ces techniques, le Gouvernement se dote d’un arsenal de surveillance de masse. Pourtant, je vous le redis, nos concitoyennes et concitoyens ne veulent ni renoncer à leur liberté individuelle ni échanger leur vie privée contre un État sécuritaire sans faille, illusoire.
Nous nous interrogeons toujours sur l’utilité de ces mesures de durcissement de l’arsenal répressif et administratif antiterroriste, alors même que notre législation en la matière est déjà substantielle.
Nous avons par ailleurs appris, dans un journal du soir – comme on dit –, qu’un rapport confidentiel du Gouvernement sur la surveillance numérique, remis aux membres de la DPR, montrait que l’utilisation des algorithmes – les boîtes noires – n’avait permis d’atteindre aucun objectif opérationnel, et ce alors même que vous ne cessez de nous expliquer que toutes les mesures prises en matière de renseignement sont absolument efficaces et nécessaires pour le travail de nos services de renseignement.
Je le redis ici, nous considérons pour notre part que, s’il y a lieu de réformer le renseignement, c’est pour accroître ses personnels et non pour recourir de façon irrationnelle et déraisonnable à des techniques de surveillance massive qui n’ont jamais fait la preuve – l’actualité le démontre – de leur efficacité en matière de lutte contre le terrorisme.
Pour toutes ces raisons, auxquelles j’ajoute l’article 19 sur lequel la commission mixte paritaire a trouvé un accord, mais dont nous persistons à dire qu’il tourne le dos à la communauté des historiens, des scientifiques et des archivistes, je réaffirme notre opposition déterminée à ce projet de loi. Nous défendrons de nouveau notre point de vue en présentant quelques amendements sur les articles restant en discussion qui nous semblent les plus problématiques.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées du groupe SER.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la France fait face depuis 2015 à de nombreuses attaques terroristes, certaines d’origine endogène et perpétrées par des personnes se radicalisant sur le territoire national. Outre le risque djihadiste, les services de renseignement s’inquiètent de l’émergence de radicalités multiformes : politiques, religieuses, survivalistes ou encore conspirationnistes.
Face à ces menaces, plusieurs textes de loi ont permis d’assurer la sécurité de nos concitoyens tout en garantissant les droits et libertés que leur octroie la Constitution. Il s’agit notamment de la loi de 2015 relative au renseignement et de la loi de 2017, dite SILT.
Le présent projet de loi vise à adapter notre droit à la menace terroriste en apportant une réponse légale et proportionnée aux menaces auxquelles nous continuons de faire face aujourd’hui. Le texte entend ainsi pérenniser – le Sénat avait même envisagé de le faire plus tôt – et adapter certaines mesures de lutte antiterroriste introduites à titre expérimental dans notre droit par la loi SILT, comme la fermeture administrative des lieux de culte, des mesures de surveillance ou encore un renforcement des pouvoirs de police administrative. Il crée, de plus, une mesure judiciaire de réinsertion sociale antiterroriste et renforce la loi sur le renseignement de 2015. Mais, tout cela, les orateurs précédents l’ont largement expliqué.
La mise en œuvre de l’ensemble de ces mesures a été évaluée dans le cadre d’une mission de la commission des lois, qui s’est inscrite dans le moyen terme et a démontré l’utilité opérationnelle pour l’autorité administrative, ainsi que le caractère finalement complémentaire entre l’intervention de l’autorité administrative et celle de l’autorité judiciaire – ce n’était pas forcément acquis initialement.
Aussi, réunie hier matin, notre commission des lois a examiné le rapport de nos collègues Agnès Canayer et Marc-Philippe Daubresse, dont j’aimerais ici saluer le travail conjoint.
Nous regrettons bien sûr, comme les collègues qui se sont exprimés avant moi, comme l’a fait également à diverses reprises le président de la commission des lois, que la CMP n’ait pu aboutir sur ce texte. C’est dommage ; l’objectif était à notre sens atteignable.
L’article 3 du projet de loi prolongeant à vingt-quatre mois la durée maximale des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, les Micas, a été modifié par le Sénat, lequel a créé une mesure de sûreté prononcée à l’issue de la détention de la personne qui comporterait des obligations tant d’accompagnement à la réinsertion que de surveillance. Cette mesure figurait à l’article 5. Or l’Assemblée nationale et, semble-t-il, le Gouvernement n’ont pas souhaité aller au-delà des obligations de réinsertion que nos collègues députés avaient adoptées en première lecture.
En réintégrant les articles 3 et 5 dans leur intégralité, articles pourtant modifiés par le Sénat, l’Assemblée nationale a pris la responsabilité de ne pas permettre un accord entre nos deux chambres. Elle n’a conservé que quelques-uns de nos apports, essentiellement la suppression de l’article 4 bis, qui posait des questions en matière de droit à un recours juridictionnel effectif.
En définitive, nous constatons principalement trois points de divergence entre les deux chambres.
Le premier est l’extension à vingt-quatre mois des Micas, dont la suppression par notre commission était motivée par les fortes interrogations demeurant sur la constitutionnalité de la mesure, au regard de la première appréciation portée par le Conseil constitutionnel.
Le deuxième point de divergence est l’article 5, également modifié par la commission pour prévoir la possibilité de prononcer tant des mesures de surveillance que des mesures de réinsertion.
Le troisième point de divergence est l’article 13, pour lequel la commission a retenu que les incertitudes tant techniques que juridiques liées à l’atteinte aux libertés représentée par la possibilité d’utiliser les URL parmi les données traitées par algorithme imposent de rendre cette extension expérimentale. Accessoirement, cela permettrait de vérifier la faisabilité technique du dispositif, celle-ci n’étant pas tout à fait acquise.
Sur ces trois points, deux avaient déjà fait l’objet de décisions du Conseil constitutionnel, indiquant qu’une prudence particulière était nécessaire. Comme Alain Richard l’indiquait précédemment, chacune des deux assemblées avait pu recevoir quelques observations à ce propos.
Sur le troisième point, les problèmes de conventionnalité, ce sont non les décisions du Conseil constitutionnel, mais les arrêts de la CJUE et du Conseil d’État qui nous invitent à être vigilants. Chacun, dans cet hémicycle, connaît les efforts remarquables que ce dernier réalise pour éviter le conflit entre droit interne et droit européen. Alors que le « chemin de crête », pour employer une formule maintenant classique, avait été complexe à tracer, on avait fini par trouver une solution pour faire converger les deux droits. Il ne nous semble pas forcément opportun de remettre cela en cause.
L’ensemble de ces points montre que la rédaction retenue par notre assemblée présentait de nombreux avantages. C’est pourquoi le groupe des sénateurs UC votera en faveur du projet de loi, dans la version issue des travaux de notre commission des lois.
M. Franck Menonville applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, à l’heure où nous évaluons la dangerosité du logiciel Pegasus sur notre sécurité nationale, nous abordons l’ultime lecture de ce projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement, après l’échec de la commission mixte paritaire du 9 juillet. Cet échec est fort regrettable tant l’accord était atteignable, suite aux discussions constructives entre les rapporteurs de l’Assemblée nationale et nos deux rapporteurs, spécialistes de ces sujets – Agnès Canayer, membre de la délégation parlementaire au renseignement, et Marc-Philippe Daubresse, qui assure le suivi et l’évaluation depuis trois ans de la loi SILT.
Comment expliquer cet échec, alors que nous partageons, avec nos collègues députés et le Gouvernement, le constat selon lequel nous ne disposons pas d’outils techniques et juridiques suffisants pour lutter contre le terrorisme ? Ce projet de loi avait vocation à combler ces carences.
Je tiens à saluer la position de la commission des lois du Sénat, qui a choisi, non pas de présenter une motion tendant à opposer une question préalable, mais de poursuivre la discussion du texte. En effet, un certain nombre de modifications apportées par le Sénat ont été retenues par la CMP, notamment sur le volet renseignement.
Notre collègue rapporteur Agnès Canayer et son homologue à l’Assemblée nationale, Loïc Kervran, étaient parvenus à un accord sur un grand nombre d’articles, afin de donner aux services de renseignement les moyens de lutter contre les nouvelles menaces.
Pour cette dernière lecture, notre rapporteur a également accepté les ajustements opérés par l’Assemblée nationale à l’article 7 en matière de communication d’informations aux services de renseignement par les autorités administratives, à la suite d’une décision du Conseil constitutionnel. Elle a cependant tenu à réintroduire l’expérimentation du traitement des URL par l’algorithme, et nous la suivons dans cette voie de prudence.
Les rapporteurs ont tenté de trouver un accord, en proposant des solutions acceptables. Il s’avère que leur volonté d’aboutir à un compromis s’est heurtée à l’intransigeance du Gouvernement. Celui-ci ne semble pas apprécier à sa juste valeur l’expertise de la Haute Assemblée et, surtout, sa détermination à apporter de vraies réponses, robustes, efficaces, pour faire face aux menaces qui gangrènent la sécurité de nos concitoyens.
Quels sont les principaux sujets qui cristallisent les désaccords entre nos deux assemblées ? Nous les relevons dans le volet relatif à la prévention du terrorisme, domaine ô combien préoccupant.
À l’article 2, nous considérons que la formulation retenue par les députés pour définir les lieux annexes aux lieux de culte est insuffisamment précise et comporte un risque constitutionnel qui fragilise le dispositif. En effet, les députés prévoient que ces lieux soient définis comme des locaux dépendants du lieu de culte, alors que nous tenons à préciser qu’il s’agit des locaux gérés, exploités ou financés directement ou indirectement par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte. Nous considérons que la fermeture de ces locaux annexes permettrait de lutter contre le phénomène de déport de certains prédicateurs, qui utilisent ces lieux pour échapper aux mesures de police administrative, ce que soulignait notre rapporteur Marc-Philippe Daubresse dans son rapport d’information sur le suivi de la loi SILT en février 2020.
Notre divergence majeure, à l’origine de l’échec de la CMP, porte sur les articles 3 et 5. Nous l’avions déjà bien perçu lors de la première lecture, madame la ministre, puisque vous aviez déposé des amendements pour rétablir le texte de l’Assemblée nationale.
Nous ne sommes pas favorables à l’allongement de la durée des Micas. Faut-il rappeler une fois de plus la décision du Conseil constitutionnel, qui a considéré que, compte tenu de leur rigueur, les Micas ne sauraient excéder, de manière continue ou non, une durée totale de douze mois ? J’ai du mal à comprendre pourquoi les députés et le Gouvernement ne comprennent pas cet arbitrage et s’entêtent à vouloir passer cette durée à vingt-quatre mois, et ce malgré les arguments, madame la ministre, que vous avez développés lors de votre intervention en début de séance.
Nous soutenons nos rapporteurs, qui ont réintroduit, à l’article 5, la proposition de loi du président Buffet que le Sénat avait adoptée en mai dernier, créant une mesure judiciaire de suivi et de surveillance. Cette dernière semble constituer une voie juridiquement plus adaptée que la proposition initiale du Gouvernement, reprise en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale. Elle offre des possibilités de surveillance plus longue, plus contraignante et permet d’associer aux obligations de surveillance des mesures sociales de réinsertion.
Cette mesure reprend le principe du dispositif adopté par le Parlement en juillet 2020, instaurant un régime de sûreté à l’encontre des sortants de prison condamnés pour terrorisme, tout en y apportant les aménagements nécessaires pour répondre aux objections du Conseil constitutionnel. Elle constitue, selon nous, la voie à suivre pour répondre à cette problématique d’une importance toute particulière.
Ces dispositions nous paraissent être les plus efficaces et les plus respectueuses des libertés.
Tout au long de l’examen de ce projet de loi, nos rapporteurs ont veillé à assurer un équilibre entre les mesures de sécurité et le respect des libertés constitutionnelles. L’enjeu de ce texte est majeur. Il faut renforcer notre arsenal législatif pour assurer la protection de nos concitoyens, qui aspirent à vivre dans un État de droit en toute sécurité.
Nous pensons que le texte de l’Assemblée nationale ne répond pas complètement à ces enjeux. C’est pourquoi nous sommes satisfaits que le Sénat imprime sa marque et réaffirme sa volonté de fermeté et d’efficacité, mais aussi d’humanité. Les membres du groupe Les Républicains voteront le texte proposé par nos rapporteurs.
Après l’échec, hier, d’un accord sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République et de lutte contre le séparatisme, les divergences fondamentales d’aujourd’hui constituent un nouvel acte manqué pour lutter contre le séparatisme et le terrorisme islamiste, et nous pouvons le regretter.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

La discussion générale est close.
Madame la ministre, mes chers collègues, afin de permettre à la commission des lois de se réunir pour examiner les amendements déposés sur ce texte, je vais suspendre la séance ; elle sera reprise à vingt-deux heures dix.
La séance, suspendue à vingt et une heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures dix.

La séance est reprise.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
Chapitre Ier
Dispositions renforçant la prévention d’actes de terrorisme
L’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° A Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en œuvre de ces vérifications ne peut se fonder que sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. » ;
1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « responsabilité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif » ;
b) À la dernière phrase, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « et le contrôle effectif et continu » ;
2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’arrêté concerne un lieu exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, il ne peut être renouvelé qu’une seule fois, pour une durée ne pouvant excéder un mois, dès lors que les conditions prévues au premier alinéa continuent d’être réunies. »
L ’ article 1 er bis est adopté.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture, selon les modalités prévues aux deux derniers alinéas du I, des locaux gérés, exploités ou financés, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale gestionnaire du lieu de culte dont la fermeture est prononcée sur le fondement du même I et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés aux mêmes fins pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte. » ;
2° À l’article L. 227-2, les mots : « d’un lieu de culte » sont supprimés. –
Adopté.
I. – Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 228-2 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b) Après le même 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation prévue au 1° du présent article peut être assortie d’une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés se trouvant à l’intérieur du périmètre géographique mentionné au même 1° et dans lesquels se tient un événement exposé, par son ampleur ou ses circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de trente jours. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante-huit heures avant son entrée en vigueur. » ;
c)
Supprimé
d) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
e) Aux première et dernière phrases du dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° L’article L. 228-4 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « Déclarer », sont insérés les mots : « et justifier de » et le mot : « et » est remplacé par les mots : « ainsi que de » ;
b)
Supprimé
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
3° L’article L. 228-5 est ainsi modifié :
aa) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation tient compte de la vie familiale de la personne concernée. » ;
a)
Supprimé
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de saisine d’un tribunal territorialement incompétent, le délai de jugement de soixante-douze heures court à compter de l’enregistrement de la requête par le tribunal auquel celle-ci a été renvoyée. La mesure en cours demeure en vigueur jusqu’à l’expiration de ce délai, pour une durée maximale de sept jours à compter de son terme initial. La décision de renouvellement ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. » ;
c)
Supprimé
4° Après la première phrase de l’article L. 228-6, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La définition des obligations prononcées sur le fondement de ces articles tient compte, dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire. »
II. – Les mesures prononcées sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure qui sont en cours à la date de promulgation de la présente loi et dont le terme survient moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée de sept jours à compter de ce terme si le ministre de l’intérieur a procédé, au plus tard le lendemain de la publication de la présente loi, à la notification de leur renouvellement selon la procédure prévue aux septième et huitième alinéas de l’article L. 228-2, aux sixième et avant-dernier alinéas de l’article L. 228-4 et aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 228-5 du même code.

L’amendement n° 15, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

L’article 3 procède à un renforcement du régime des Micas, déjà particulièrement attentatoires aux libertés publiques, qui avait été mis en place à titre expérimental et avec clause de revoyure, étant donné son caractère particulièrement exorbitant du droit commun.
Je ne reviendrai pas, ici, sur les caractéristiques de ces Micas. Chacun les connaît, comme chacun sait qu’une personne faisant l’objet d’une telle mesure peut se voir imposer deux séries d’obligations alternatives : d’une part, l’assignation géographique et l’obligation de pointage auprès des services de police ou des unités de gendarmerie ; d’autre part, l’interdiction de paraître dans certains lieux et le signalement de tout déplacement à l’extérieur d’un périmètre défini. Dans les deux cas, le ministre de l’intérieur peut également prononcer une interdiction d’entrer en relation avec une ou plusieurs personnes, ainsi qu’une obligation de déclarer son domicile.
La durée des Micas est, à ce jour, strictement encadrée. Comme cela a été dit, ces mesures sont renouvelables uniquement dans la limite d’une durée cumulée de douze mois. Au-delà de six mois, des éléments nouveaux ou complémentaires sont requis pour les prolonger.
Prétendant que, pour des profils présentant une dangerosité élevée, la limite de douze mois se révèle inadaptée, le Gouvernement et la majorité gouvernementale ont souhaité rétablir le texte de l’Assemblée nationale, soit un possible allongement à vingt-quatre mois. Selon eux, si le Conseil constitutionnel a fait de la limitation à douze mois un des éléments du bilan de la constitutionnalité de la Micas, il n’a pas été saisi de la différence objective de situation entre les personnes radicalisées n’ayant pas été condamnées pour des faits en lien avec le terrorisme et celles qui ont fait l’objet d’une condamnation.
Pour notre part, nous restons convaincus que, comme l’a exprimé le Conseil constitutionnel dans le commentaire de sa décision, « quelle que soit la gravité de la menace qui la justifie, une telle mesure de police administrative ne peut se prolonger aussi longtemps que dure cette menace ».
Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article 3.

Cet amendement de suppression a déjà été débattu lors de la précédente lecture. Nous avions alors expliqué que l’article 3 apportait des compléments utiles au régime des Micas. Mais, parce que nous partageons votre analyse, madame Assassi, nous avons réécrit cet article pour réintroduire la limitation à un an.
C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur votre amendement.
Le Gouvernement est bien sûr opposé à la suppression de l’article 3, comme il l’est d’ailleurs à la suppression des dispositions du code de la sécurité intérieure relatives aux Micas.
L’article 3 de ce projet de loi apporte plusieurs ajustements au régime des Micas pour en accroître l’efficacité, dont la possibilité de prononcer une interdiction temporaire de paraître pour les personnes placées sous Micas au titre de l’article L. 228–2 du code de la sécurité intérieure, donc celles qui sont, en outre, soumises à une obligation de ne pas quitter un périmètre déterminé.
À ce jour, cette possibilité n’existe pas, la mesure d’interdiction de paraître ne pouvant être prononcée qu’à l’égard de personnes astreintes aux obligations les plus légères. Or il peut arriver que se tiennent, à l’intérieur du périmètre au sein duquel une personne est astreinte à résider, des événements ponctuels exposés, par leur ampleur ou par leurs circonstances particulières, à un risque de menace terroriste. Je pense, par exemple, à un procès d’auteurs d’actes de terrorisme qui aurait lieu au tribunal judiciaire de Paris, auquel une personne astreinte à résider à Paris pourrait se rendre en toute légalité.
Actuellement, lorsqu’une telle situation se présente, il est nécessaire de modifier le régime sous lequel est placée la personne pour la placer sous celui de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, qui permet de prononcer une interdiction de paraître. Dans ce cas, la personne n’est plus astreinte à résider au sein d’un périmètre de résidence et peut le quitter sans encourir aucune poursuite pénale.
La mesure proposée dans l’article 3 corrige cette anomalie, en permettant de cumuler l’astreinte à résidence dans un périmètre déterminé et l’interdiction de paraître dans un lieu précis inclus dans ce périmètre et dans lequel se tient un événement particulièrement exposé à raison, soit de son ampleur, soit des circonstances particulières, au risque de menace terroriste.
L’article 3 permet aussi de renforcer l’efficacité de l’obligation de déclarer son domicile, en imposant à la personne de fournir le justificatif de domicile.
Enfin, sur un plan vraiment très concret, il prévoit que les Micas en cours à la date de promulgation de la loi dont le terme surviendrait moins de sept jours après cette promulgation demeurent en vigueur pour une durée supplémentaire de sept jours, s’il est procédé à la notification de leur renouvellement au plus tard le lendemain de la publication de la loi.
Cet allongement du délai répond à la nécessité de procéder au renouvellement de nombreuses mesures qui seront en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi et seraient susceptibles d’être déférées au juge.
Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 15.
Je vous prie de bien vouloir excuser la longueur de mon intervention, mesdames, messieurs les sénateurs ; je serai plus brève par la suite, puisque nous avons déjà largement débattu des points qui seront abordés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 3 est adopté.
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230-19 est complété par un 19° ainsi rédigé :
« 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 du même code prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté prévue à l’article 706-25-16 du présent code. » ;
2° Le titre XV du livre IV est ainsi modifié :
a) À l’intitulé, les mots : « et du jugement des » sont remplacés par les mots : «, du jugement et des mesures de sûreté en matière d’ » ;
b) Au quatrième alinéa de l’article 706-16, la référence : « à l’article 706-25-7 » est remplacée par les références : « aux articles 706-25-7 et 706-25-19 » ;
c) L’article 706-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures de sûreté prévues à la section 5 du présent titre sont ordonnées sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris ou, en ce qui concerne les mineurs, par le tribunal pour enfants de Paris. » ;
d) Au premier alinéa de l’article 706-22-1, après la référence : « 706-17 », sont insérés les mots : « et concernant les personnes astreintes aux obligations prévues à l’article 706-25-16 » ;
e) Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
« Art. 706 -25 -16. – I. – Lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, d’une durée supérieure ou égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code, ou d’une durée supérieure ou égale à trois ans lorsque l’infraction a été commise en état de récidive légale, et qu’il est établi, à l’issue d’un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l’exécution de sa peine, que cette personne présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, faisant ainsi obstacle à sa réinsertion, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République et dans les conditions prévues à la présente section, ordonner à son encontre, aux seules fins de prévenir la récidive et d’assurer la réinsertion, une mesure de sûreté comportant une ou plusieurs des obligations mentionnées aux 1° à 4° et 6° de l’article 132-44 du code pénal et aux 1°, 8°, 14° et 20° de l’article 132-45 du même code.
« Lorsque les obligations mentionnées au premier alinéa du présent I apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive de la personne concernée, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut également, par une décision spécialement motivée au regard de la situation et de la personnalité de cette personne, la soumettre à une ou plusieurs des obligations prévues au 5° de l’article 132-44 du code pénal et aux 2°, 9°, 12°, 13° et 19° de l’article 132-45 du même code. Ces obligations entrent en vigueur, le cas échéant, dès que les obligations similaires auxquelles est soumise la personne en vertu d’une mesure prévue au chapitre VIII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure sont levées, pour quelque raison que ce soit.
« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d’insertion et de probation du lieu de résidence de la personne, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.
« II. – La juridiction régionale de la rétention de sûreté ne peut prononcer la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion qu’après s’être assuré que la personne condamnée a été mise en mesure de bénéficier, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge adaptée à sa personnalité et à sa situation, de nature à favoriser sa réinsertion.
« III. – La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I peut être ordonnée pour une durée maximale d’un an. À l’issue de cette durée, la mesure peut être renouvelée sur réquisitions du procureur de la République et après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, pour au plus la même durée, dans la limite de trois ans ou, lorsque le condamné est mineur, deux ans. Cette limite est portée à cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, à trois ans, lorsque la personne a été condamnée à une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à dix ans. Chaque renouvellement est subordonné à l’existence d’éléments actuels et circonstanciés qui le justifient précisément.
« IV. – La mesure prévue au I ne peut être ordonnée que si elle apparaît strictement nécessaire pour prévenir la récidive et assurer la réinsertion de la personne concernée. Elle n’est pas applicable si la personne a été condamnée à un suivi socio-judiciaire en application de l’article 421-8 du code pénal ou si elle fait l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire prévue à l’article 723-29 du présent code, d’une mesure de surveillance de sûreté prévue à l’article 706-53-19 ou d’une mesure de rétention de sûreté prévue à l’article 706-53-13.
« Art. 706 -25 -17. – La situation des personnes détenues susceptibles de faire l’objet de la mesure prévue à l’article 706-25-16 est examinée, sur réquisitions du procureur de la République, au moins trois mois avant la date prévue pour leur libération par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité et leur probabilité de récidive.
« À cette fin, la commission pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa du présent article demande le placement de la personne concernée, pour une durée d’au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, aux fins notamment d’une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité.
« À l’issue de cette période, la commission adresse la juridiction régionale de la rétention de sûreté et à la personne concernée un avis motivé sur la pertinence de prononcer la mesure mentionnée à l’article 706-25-16 au regard des critères définis au I du même article 706-25-16.
« Art. 706 -25 -18. – La décision prévue à l’article 706-25-16 est prise, avant la date prévue pour la libération du condamné, par un jugement rendu après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Elle doit être spécialement motivée au regard des conclusions de l’évaluation et de l’avis mentionnés à l’article 706-25-17 ainsi qu’au regard des conditions prévues aux II et IV de l’article 706-25-16.
« La décision précise les obligations auxquelles le condamné est tenu ainsi que la durée de celles-ci.
« La décision est exécutoire immédiatement dès la libération du condamné.
« La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, sur réquisitions du procureur de la République ou à la demande de la personne concernée, selon les modalités prévues à l’article 706-53-17 et, le cas échéant, après avis du procureur de la République, modifier la mesure ou ordonner sa mainlevée. L’exercice de cette faculté ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le juge de l’application des peines, d’adapter à tout moment les obligations auxquelles le condamné est tenu.
« Art. 706 -25 -19. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706-53-15.
« Art. 706 -25 -20. – Les obligations prévues à l’article 706-25-16 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la durée de la détention excède six mois, la reprise d’une ou de plusieurs des obligations prévues au même article 706-25-16 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans un délai de trois mois à compter de la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure.
« Art. 706 -25 -21. – Le fait pour la personne soumise à une mesure prise en application de l’article 706-25-16 de ne pas respecter les obligations auxquelles elle est astreinte est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Art. 706 -25 -22. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application de la présente section. »
II
III

L’amendement n° 1, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.

Cet article est celui qui a cristallisé le plus d’oppositions. Il reprend les dispositions de la proposition de loi instaurant des mesures de sûreté à l’encontre des auteurs d’infractions terroristes à l’issue de leur peine, censurée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 7 août 2020.
Auparavant, le Conseil d’État s’était déjà interrogé sur l’utilité d’une telle mesure de sûreté. Dans son avis publié le 23 juin 2020, il a énoncé que « la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit permet l’application de presque toutes les mesures de la proposition de loi ».
En effet, de nombreux dispositifs permettent d’ores et déjà d’assurer un suivi post-détention : le suivi sociojudiciaire, prévu aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, la surveillance judiciaire, prévue aux articles 723-29 et suivants du code de procédure pénale ou encore le suivi post-libération, prévu à l’article 721-2 du même code.
Si nous prenons très au sérieux la nécessité de prévenir la commission d’actes à caractère terroriste, la gravité de ces actes ne dispense pas d’apprécier la stricte nécessité des mesures prévues. Or, en l’état, la présente disposition est d’application rétroactive et porte une atteinte excessive aux libertés individuelles. Le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires s’oppose à la création de cette nouvelle mesure de sûreté.
Nous regrettons également que ne soit pas prise en compte la situation des détenus de droit commun qui se radicalisent au cours de leur détention.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer l’article.

Une fois de plus, il s’agit d’un amendement de suppression qui est contraire à la position de la commission, d’autant qu’il tend à supprimer le suivi judiciaire, lequel est précisément le point nodal de la réflexion sénatoriale. Nous nous sommes inscrits dans la voie que le Conseil constitutionnel a tracée pour rendre constitutionnelle cette mesure de sûreté.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 3211-12-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3211-12-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211 -12 -7. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police ainsi que les représentants des services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés à cette fin par un décret en Conseil d’État et qui exercent une mission de renseignement à titre principal peuvent, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement, se voir communiquer les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212-5, L. 3212-8 et L. 3213-9 du présent code et de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Ces mêmes données ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. »

L’amendement n° 16, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

L’article 6 autorise la communication aux préfets et à certains services de renseignement des données à caractère personnel issues du fichier relatif au suivi des personnes en soins psychiatriques sans consentement (Hopsyweb), lorsqu’un patient représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste.
Le décret du 6 mai 2019 autorise déjà l’interconnexion du fichier Hopsyweb avec le fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste (FSPRT).
Cet article poursuit la fuite en avant vers un amalgame entre folie et terrorisme. Il privilégie la logique sécuritaire par rapport à la logique sanitaire.
L’extension du nombre de personnes ayant accès aux informations médicales contrevient aux principes du droit au respect de la vie privée et au secret des informations médicales. Comme l’indique le Syndicat de la magistrature, « la lutte antiterroriste, dotée d’un arsenal législatif pléthorique, continue à servir de prétexte à la création de toutes sortes de dispositifs exorbitants, tels que le fichage et le traçage des personnes atteintes de troubles mentaux, sans qu’aucune corrélation ait été établie entre radicalisation à caractère terroriste et troubles psychiatriques ».
Dans la droite lignée des textes sur l’irresponsabilité pénale et des mouvements de l’opinion publique sur le sujet, cet article vient entériner l’idée que même les fous doivent être jugés, et si possible plus sévèrement que les autres, dès lors que leur passage à l’acte se cristallise autour du terrorisme islamique.
Pour notre part, nous considérons que ce débat n’est pas à la hauteur de l’enjeu ; nous y reviendrons lorsque le Gouvernement présentera le projet de loi sur l’irresponsabilité pénale. Pour l’heure, nous vous proposons de supprimer cet article, dont la teneur devrait être éclairée par des travaux divers et pluralistes, encore inexistants.

Il s’agit de nouveau d’un amendement de suppression. En première lecture, nous avions expliqué que, de notre point de vue, il n’existait pas d’amalgame entre troubles psychiatriques et terrorisme, et qu’il était possible de trouver une voie propre à améliorer le dispositif existant.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 6 est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) À la première phrase, les mots : « ou extraits » sont remplacés par les mots : «, extraits ou transmis » ;
c) La seconde phrase est supprimée ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 obtient, à la suite de la mise en œuvre d’une technique mentionnée au titre V du présent livre, des renseignements utiles à la poursuite d’une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil, il peut les transcrire ou les extraire pour le seul exercice de ses missions, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« II. – Sous réserve du deuxième alinéa et des 1° et 2° du présent II, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, si cette transmission est strictement nécessaire à l’exercice des missions du service destinataire, dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3.
« Sont subordonnées à une autorisation préalable du Premier ministre délivrée dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement :
« 1° Les transmissions de renseignements collectés, lorsqu’elles poursuivent une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
« 2° Les transmissions de renseignements collectés, extraits ou transcrits qui sont issus de la mise en œuvre d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission.
« Ces transmissions sont sans effet sur la durée de conservation de chacun des renseignements collectés, qui court à compter de la date de leur recueil. À l’issue de cette durée, chaque service procède à la destruction des renseignements, selon les modalités définies à l’article L. 822-4.
« Le responsable de chaque service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 ou de chaque service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 désigne un agent chargé de veiller, sous son contrôle, au respect de l’application du présent II. Cet agent est informé par ses homologues dans les autres services de la destruction, dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent II, des renseignements que son service a été autorisé à recueillir. Il rend compte sans délai au responsable de son service de toute difficulté dans l’application du présent II. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) À la fin, les mots : « de ces finalités » sont remplacés par les mots : « des finalités mentionnées au I » ;
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les opérations mentionnées aux I à III sont soumises au contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
II et III. –
Non modifiés
IV. – L’article L. 854-6 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 peut, dans les conditions définies aux deux premiers alinéas et au 2° du II de l’article L. 822-3, transmettre tout renseignement transcrit ou extrait à un autre de ces services ou à un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4. » ;
1° bis Au troisième alinéa, les mots : « au même article » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les opérations de destruction des renseignements collectés, les transcriptions, les extractions et les transmissions sont effectuées dans les conditions prévues à l’article L. 822-4. »
V et VI. –
Non modifiés
VII. – L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« Art. L. 863 -2. – Les autorités administratives, autres que les services de renseignement, mentionnées au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives peuvent transmettre aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du présent code et aux services désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4, à la demande d’un de ces services, toute information, même couverte par un secret protégé par la loi, strictement nécessaire à l’accomplissement des missions de ce service et susceptible de concourir à la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811-3.
« Les données à caractère personnel mentionnées au I de l’article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des données génétiques, peuvent faire l’objet de cette transmission.
« Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités administratives mentionnées au premier alinéa du présent article assurent la traçabilité des transmissions, en précisant leur date et leur finalité, la nature des données transmises ainsi que les services qui en ont été destinataires.
« Toute personne qui est rendue destinataire de ces transmissions est tenue au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
« Le service destinataire des informations transmises les détruit dès lors qu’elles ne sont pas ou plus nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« L’agent mentionné au dernier alinéa du II de l’article L. 822-3 du présent code est chargé d’assurer la traçabilité de ces transmissions et de veiller au respect de l’application du présent article. »
VIII et IX. –
Non modifiés

L’amendement n° 2, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Benarroche.

Le présent article acte la fin du principe selon lequel les renseignements ne peuvent être utilisés pour des finalités autres que celles qui motivent la procédure de surveillance. En effet, il prévoit la transmission de renseignements entre services et étend par là-même la communication d’informations aux services de renseignement.
Autant le dire clairement : cet article est attentatoire aux libertés publiques. En permettant à des services de contourner les restrictions quant à l’usage des dispositifs de surveillance, et en signant la fin du principe de « finalisation », il contrevient au droit au respect de la vie privée.
De même, l’absence de contrôle préalable aux mesures de surveillance est problématique. De ce fait, l’article 7 s’inscrit dans la longue liste des dispositions qui poussent à la déjudiciarisation du contrôle en matière de sécurité intérieure. La traçabilité et la durée de conservation des informations, une fois qu’elles ont été transmises, posent notamment question.
L’équilibre à trouver entre le maintien de l’ordre public et le respect des libertés publiques n’est pas atteint. Dès lors, notre groupe propose la suppression de l’article.

Nous considérons que l’article 7 met en place un équilibre satisfaisant pour la transmission d’informations aux services de renseignement et entre ces services. Les contrôles internes et externes suffisent à garantir le respect des libertés, d’autant que l’Assemblée nationale a renforcé cet article pour le rendre conforme à la décision du Conseil constitutionnel du 9 juillet dernier.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 6, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces transmissions sont subordonnées à une autorisation du Premier ministre après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dans les conditions prévues aux articles L. 821-1 à L. 821-4.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Il est bien logique que les informations circulent entre les services de renseignement. Toutefois, lorsque la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) donne son accord préalablement au recueil d’une information via une technique de renseignement, cet accord est délivré pour une finalité précise et donnée.
Nous considérons que l’équilibre actuel n’est pas bon dans la mesure où les informations transmises, même après l’accord de la CNCTR, peuvent circuler entre les services sans être soumises au même niveau de contrôle. Dès lors, nous proposons que la transmission de renseignements entre services soit elle aussi assujettie au contrôle de la CNCTR.

L’amendement n° 3, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 9
1° Remplacer la référence :
L. 821-4
par la référence :
L. 821-3
2° Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à M. Guy Benarroche.

Il est regrettable que l’avis de la CNCTR ne soit pas un avis conforme. Compte tenu du caractère particulièrement intrusif des techniques utilisées, il est indispensable qu’une autorité administrative indépendante délivre un avis contraignant ; la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a souligné cette nécessité. Renforcer le contrôle de la CNCTR, afin de le rendre effectif, est primordial pour que celle-ci dépasse son rôle de faire-valoir des décisions de l’exécutif.
Considérant le caractère extrêmement attentatoire aux libertés et à la vie privée des pouvoirs qui seraient donnés aux services de renseignement, des garanties doivent être prévues pour protéger les libertés individuelles de nos concitoyens.
C’est pourquoi nous souhaitons préciser que l’avis de la CNCTR doit être conforme.

L’amendement n° 19, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme
La parole est à Mme Éliane Assassi.

La CNIL a relevé que les dispositions de cet article permettent formellement au Premier ministre d’autoriser la mise en œuvre immédiate d’une technique de renseignement, même après un avis défavorable de la CNCTR. Elle recommande donc, sauf dans certains cas d’urgence absolue, qu’il soit interdit au Premier ministre d’autoriser cette mise en œuvre après un avis défavorable de la CNCTR.
Le Conseil d’État, dans un arrêt du 21 avril 2021, a exigé qu’il soit procédé à « un contrôle préalable par une autorité administrative indépendante, dotée d’un pouvoir d’avis conforme ou une juridiction ». Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, rendu le 25 mai dernier, a requis que les activités d’interception en masse soient soumises à l’autorisation d’une autorité administrative indépendante dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération.
Suivant l’ensemble de ces recommandations, nous proposons d’inscrire dans la loi l’exigence d’un avis conforme de la CNCTR.

L’amendement n° 6 vise à subordonner toute transmission d’informations à des services de renseignement à une autorisation du Premier ministre, après avis de la CNCTR.
Cet amendement est contraire à la position que nous avions adoptée en première lecture. En effet, nous avions considéré que l’article 7 assurait un équilibre entre les renseignements « bruts », dont les finalités peuvent être différentes de celles qui ont justifié le recueil des informations, et les renseignements transmis au titre d’une technique de renseignement que le destinataire ne peut mettre en œuvre. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Avis défavorable également à l’amendement n° 3, qui est satisfait dans l’esprit. En vertu de l’article 16, si le Premier ministre délivre une autorisation contre l’avis de la CNCTR, alors le Conseil d’État est immédiatement saisi.
Même avis défavorable à l’amendement n° 19, pour les mêmes raisons.
Concernant l’amendement n° 6, nous considérons qu’il convient de préserver l’équilibre du texte qui a été adopté par l’Assemblée nationale et la commission des lois du Sénat, et de concilier le droit à la vie privée et l’efficacité opérationnelle.
Seront soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la CNCTR, les transmissions de renseignements « bruts » motivées par une finalité différente de celles qui ont justifié la mesure de surveillance. Il en ira de même des transmissions de renseignements « bruts », transcrits ou extraits, dans tous les cas où le service destinataire n’aurait pas pu mettre en œuvre lui-même la mesure de surveillance. À nos yeux, le verrou que constitue cette procédure renforcée se justifie pleinement.
Madame Assassi, l’article 7 concerne non pas le principe même de mise en œuvre d’une technique de renseignement, mais bien la transmission de renseignements entre services, et entre l’administration et ces mêmes services.
Quant à l’amendement n° 3, à la différence de certaines techniques de renseignement, les échanges d’informations entre les services échappent totalement au droit de l’Union européenne : les exigences posées par le Conseil d’État au titre de l’application du droit de l’Union européenne concernant les différentes prérogatives de la CNCTR, ainsi que la portée de l’avis, n’ont pas à être transposées au stade de ces échanges.
Dès lors, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 7, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
et au plus tard dans un délai de six mois
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Les services de renseignement ne sont pas des services d’archives ; les informations qu’ils recueillent auprès des administrations sont parfois couvertes par le secret professionnel. Dès lors, il convient que ces informations soient utilisées dans un délai court : les services de renseignement doivent agir rapidement, faute de quoi ils ne seraient plus dans leur rôle.
Aussi, nous proposons que les renseignements sensibles obtenus auprès d’autres administrations soient détruits au plus tard dans un délai de six mois. Les services de renseignement n’ont pas vocation à constituer une administration parallèle qui conserverait des dizaines d’informations sensibles, alors qu’elles ne sont pas de leur ressort.

L’article 7, tel qu’il a été modifié, prévoit désormais que les renseignements sont transmis par les autorités administratives uniquement sur l’initiative de celles-ci.
Lorsque les renseignements transmis sont « bruts », leur destruction peut intervenir dans un délai inférieur à celui de six mois que vous proposez, car ils n’ont plus d’utilité. D’autres renseignements peuvent en revanche être conservés pour une durée plus longue parce qu’ils sont nécessaires à la mission des services de renseignement.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 9, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 811-… ainsi rédigé :
« Art. L. 811 -… – Dans le respect du droit et des conventions internationales auxquelles la France est partie, le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement et des services étrangers ou des organismes internationaux. »
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.


Je les appelle donc en discussion.
L’amendement n° 10, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 833-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « à l’exclusion » sont remplacés par les mots : « y compris » et les mots : « ou qui pourraient donner connaissance à la commission, directement ou indirectement, de l’identité des sources des services spécialisés de renseignement » sont remplacés par les mots : « dans le cadre des orientations fixées par le Premier ministre » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elle remet un rapport annuel à la délégation parlementaire au renseignement relatif aux échanges avec les services étrangers. »
L’amendement n° 8, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Concernant les échanges avec les services étrangers, le Gouvernement remet un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2022 afin de travailler à la définition d’un cadre légal sur ces échanges et de se conformer aux exigences européennes.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

Ces amendements ont pour objet une mesure appelée à devenir cruciale, le contrôle a posteriori des échanges d’informations entre les services de renseignement français et étrangers.
Le Président de la République, lors de son discours devant le Collège du renseignement en Europe, le 5 mars 2019, s’étonnait que, dans notre pays, les coopérations entre services soient parfois méconnues des décideurs politiques eux-mêmes.
Aussi, l’amendement n° 9 vise à ce que le Premier ministre fixe des orientations relatives aux échanges entre les services spécialisés de renseignement français et des services étrangers ou des organismes internationaux.
Dans ce cadre, il paraît judicieux d’étendre les compétences de la CNCTR afin qu’elle puisse contrôler le respect des orientations qui auront été prises par le Premier ministre. Elle remettrait un rapport annuel relatif aux échanges entre les services de renseignement français et étrangers à la délégation parlementaire au renseignement (DPR). Tel est l’objet de l’amendement n° 10.
L’amendement n° 8 est un amendement de repli – j’espère qu’il pourra être adopté à défaut des autres. Il vise à ce que le Gouvernement remette un rapport sur les échanges entre les services de renseignement français et étrangers, avant le 31 décembre 2022, afin de travailler à définir un cadre légal pour ces échanges en conformité avec les exigences européennes.
Je rappelle que la Cour européenne des droits de l’homme a statué sur la question ; notre pays risque d’être condamné, faute d’avoir institué un contrôle a posteriori sur les échanges entre les services de renseignement français et étrangers. La France est le seul pays européen à ne pas disposer d’une autorité de contrôle a posteriori sur les échanges entre ces différents services. Il serait regrettable d’attendre, pour fixer un minimum d’orientations, que notre pays soit condamné par la Cour européenne des droits de l’homme.

La question soulevée par notre collègue Vaugrenard est essentielle. Nous considérons que, sur un sujet d’une telle ampleur, nous ne pouvons pas légiférer par simple voie d’amendement, mais qu’il faut mener une réflexion approfondie sous le contrôle du président de la délégation parlementaire au renseignement. Celle-ci va s’emparer de la question en vue d’alimenter un travail législatif ultérieur.
C’est pourquoi la commission a sollicité le retrait des amendements n° 9 et 10, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 8, il est satisfait par le rapport que remettra la DPR. Là encore, retrait ou avis défavorable.
L’article 7 porte uniquement sur les échanges d’informations entre les services de renseignement français, ainsi qu’entre les administrations françaises et ces services.
Le Gouvernement sollicite lui aussi le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. Alain Richard. La présentation qu’a faite Yannick Vaugrenard de la méconnaissance par les autorités politiques des mécanismes d’échange et de coopération internationale entre services spéciaux est un peu réductrice. Il existe de nombreux moyens pour s’assurer que ces coopérations, qui sont la plupart du temps bilatérales et accomplies sur la base d’une expérience du travail partagé, sont soumises au contrôle des autorités politiques, et en tout cas connues d’elles.
Mme la ministre déléguée approuve.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 7 est adopté.
(Non modifié)
I. – Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 822-2, la référence : « et L. 852-2 » est remplacée par les références : «, L. 852-2 et L. 852-3 » ;
2° Le chapitre II du titre V est complété par un article L. 852-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 852 -3. – I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre et pour les seules finalités prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3, peut être autorisée l’utilisation, par les services spécialisés de renseignement et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, d’un appareil ou d’un dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin d’intercepter des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire, lorsque cette interception ne peut être mise en œuvre sur le fondement du I de l’article L. 852-1 du présent code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs ou des personnes mentionnés à l’article L. 851-1. Les correspondances interceptées dans ce cadre sont détruites dès qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation, et au plus tard au terme du délai prévu au 1° du I de l’article L. 822-2.
« II. – Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. Elle vaut autorisation de recueil des informations ou documents mentionnés à l’article L. 851-1 associés à l’exécution de l’interception et à son exploitation.
« III. – Un service du Premier ministre organise la centralisation des correspondances interceptées et des informations ou documents recueillis en application des I et II du présent article. Cette centralisation intervient dès l’interception des communications, sauf impossibilité technique. Dans ce cas, les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective au sein du service du Premier ministre mentionné au présent alinéa. La demande prévue à l’article L. 821-2 précise les motifs faisant obstacle à la centralisation immédiate des correspondances interceptées.
« Les opérations de transcription et d’extraction des communications interceptées, auxquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat, sont effectuées au sein du service du Premier ministre mentionné au premier alinéa du présent III.
« IV. – Le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 821-2 ainsi que le nombre d’autorisations d’interception délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
« V. –
Supprimé
II. –
Non modifié

L’amendement n° 17, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Par cet amendement, nous souhaitons réaffirmer notre opposition à l’expérimentation, pour une durée de quatre ans, de l’interception des communications qui empruntent la voie satellitaire. L’expérimentation de cette nouvelle technique risque de conduire au recueil d’informations qui, compte tenu du champ d’interception des communications rendu possible, n’auraient aucun lien avec la prévention d’actes terroristes.
Nous considérons que l’article 11 ne présente pas de garanties suffisantes pour empêcher le recueil de données sensibles à caractère personnel concernant des citoyens qui ne seraient pas visés par une mesure d’interception de conversations – leur vie intime s’en trouverait violée.
En effet, le recueil des données est prévu dans un périmètre qui serait élargi à tout type d’individu, sans distinctions. La mise en œuvre de mesures de filtrage en amont pour empêcher toute intrusion serait plus respectueuse de la vie privée des personnes qui ne sont pas visées par la recherche de renseignements.
Nous ne sommes pas forcément opposés à l’expérimentation de cette technique dans le seul cadre de la prévention d’actes terroristes. En revanche, nous appelons votre attention sur le risque d’intrusion trop important, au détriment du droit au respect de la vie privée. Le manque de mesures préventives pour empêcher toute atteinte de ce type est inquiétant. Pourquoi ne pas prendre le temps d’affiner l’expérimentation de ce dispositif, pour éviter tout risque de surveillance de masse, laquelle contreviendrait à l’objectif recherché et susciterait l’inquiétude de la population ?
Il est évident que cette expérimentation, comme toutes celles qui ont déjà eu lieu en matière de renseignement et de sécurité intérieure, finira par être pérennisée. En effet, comme l’indique l’Observatoire des libertés et du numérique (OLN), « il n’y a jamais de retour en arrière sur les expérimentations et mesures liberticides mises en place, aucun retour plus favorable aux libertés », et cela quand bien même des demandes légitimes et mesurées seraient avancées, comme l’augmentation des pouvoirs de la CNCTR, le contrôle des échanges avec des services étrangers, la garantie d’un réel pouvoir de contrôle parlementaire ou la possibilité de contestation individuelle.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous proposons de supprimer le présent article.

Puisqu’il s’agit d’un amendement de suppression, la commission a émis un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 12, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Supprimer les mots :
et les services mentionnés à l’article L. 811-4 désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement,
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Nous proposons, par cet amendement, de rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Compte tenu de l’état des techniques d’interception des correspondances par voie satellitaire, il semble plus prudent d’autoriser pour l’instant uniquement les services « du premier cercle » à les utiliser, car ceux-ci disposent d’une capacité technique robuste et sans risque.
C’est la raison pour laquelle nous tenons à rétablir la rédaction de l’article telle qu’elle a été adoptée en première lecture.

L’accord qui a été trouvé et les précisions qui ont été apportées par l’Assemblée nationale sur la limitation des services « du second cercle » concernés par ces expérimentations satellitaires ont permis d’atteindre un équilibre qui satisfait véritablement les attentes des services.
En conséquence, la commission a sollicité le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 11, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Un lien avec la personne concernée par l’autorisation est établi lorsqu’il est utile à la poursuite de l’une des seules finalités mentionnées au présent I.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

L’amendement est satisfait par l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit les finalités encadrant le recours à cette technique de renseignement.
La commission a donc demandé le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 11 est adopté.
I. – L’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « il peut être imposé aux opérateurs et aux personnes mentionnés à l’article L. 851-1 la mise en œuvre sur leurs réseaux de » sont remplacés par les mots : « à la demande des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2, peuvent être autorisés, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851-1, des » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 851-1 », sont insérés les mots : « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » et la seconde occurrence des mots : « ou documents » est remplacée par les mots : «, documents ou adresses » ;
2° Au III, les mots : « pour cette mise en œuvre » sont supprimés ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « délai », la fin de la seconde phrase est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les données non détectées par les traitements comme susceptibles de révéler une menace à caractère terroriste sont détruites immédiatement. » ;
4° Sont ajoutés des VI et VII ainsi rédigés :
« VI. – Un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement des I et IV, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
« VII. – Le traitement automatisé des adresses complètes de ressources utilisées sur internet est autorisé jusqu’au 31 juillet 2025. »
II. –
Non modifié

L’amendement n° 18, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Par cet amendement, nous nous opposons à l’extension de la portée des « boîtes noires » au-delà des données de connexion, pour intégrer des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, soit les URL.
Je souhaite rappeler notre ferme opposition à la pérennisation des « boîtes noires ». Leur extension est ici orchestrée sans aucun argument précis ni information chiffrée, et sans que soit pris en compte l’avertissement du Conseil d’État. Celui-ci a en effet souligné que cette extension ouvrait un champ nouveau d’investigations potentiellement attentatoires à la protection de la vie privée et des données personnelles. Juge et partie, il a tout de même approuvé cette disposition.
C’est ignorer la décision du Conseil constitutionnel du 23 juillet 2015, par laquelle celui-ci avait validé les « boîtes noires », en prenant en compte l’impossibilité qu’elles traitent le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées, sous quelque forme que ce soit, dans le cadre de ces communications. Or ces URL – en fait des adresses – sont des informations consultées.
Enfin, la CNIL estime que le recueil des URL est susceptible de faire apparaître des informations relatives au contenu des éléments consultés ou aux correspondances échangées qui ne respecteraient pas la vie privée de la personne – par exemple l’orientation sexuelle, l’état de santé, etc.
Finalement, l’extension aux adresses internet complètes de la possibilité de traiter les données par les algorithmes élargit le champ d’investigation et, par conséquent, apparaît plus attentatoire à la protection de la vie privée et des données personnelles.
Pour toutes ces raisons, et par cohérence avec l’amendement de suppression déposé à l’article 12, nous souhaitons supprimer cet article 13, qui pérennise la mise en œuvre des « boîtes noires », sans qu’un bilan ait été présenté au Parlement. Pourtant, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement prévoyait que ce serait le cas avant le 30 juin 2021.

L’avis est défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 13, qui prévoit donc d’étendre les algorithmes aux URL.
Nous pensons, au contraire, d’une part, que la pérennisation des algorithmes est nécessaire, d’autre part, que son extension aux URL est une mesure prometteuse, quoiqu’elle doive être soumise à un certain nombre de contrôles. C’est la raison pour laquelle nous avons rétabli dans le texte son caractère expérimental.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 5, présenté par MM. Leconte et Vaugrenard, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. – Après le mot :
internet
insérer les mots :
, à l’exclusion de celles pouvant figurer au sein de contenus de correspondances électroniques.
II. – Compléter cet alinéa par le mot :
précitées
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

C’est un amendement de précision. Étendre les algorithmes aux URL, on le comprend bien, c’est aussi les étendre aux liens hypertextes de connexion à une page de données. Nous souhaitons donc exclure des algorithmes les liens hypertextes qui seraient contenus dans les correspondances, les SMS ou les liens dans les pages consultées.
Il nous semble très important d’encadrer de façon effective ce qui pourra faire l’objet d’un traitement algorithmique.

L’avis est défavorable. Lors du débat en première lecture, le Gouvernement nous avait apporté les garanties nécessaires.
En effet, monsieur le sénateur, nous avons déjà eu ce débat. Au demeurant, aucune donnée, quelle qu’elle soit, contenue dans une correspondance électronique, y compris une URL, ne peut faire l’objet d’un traitement algorithmique. D’ailleurs, votre amendement, je le crains, pourrait se révéler contre-productif : la précision selon laquelle les URL contenues dans un courrier électronique ne peuvent pas faire l’objet d’un traitement algorithmique donnerait à penser que les autres données de ce courrier pourraient être traitées ainsi, ce qui n’est pas prévu, à l’heure actuelle, dans le projet de loi.
Votre amendement étant donc parfaitement satisfait, j’en demande le retrait.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 13 est adopté.
I. – L’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du II, les mots : « anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des III, IV, V et VI » sont remplacés par les mots : « anonymes, sous réserve des II bis à VI, les données relatives aux communications électroniques » ;
2° Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
« 1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ;
« 2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
« 3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Pour des motifs tenant à la sauvegarde de la sécurité nationale, lorsqu’est constatée une menace grave, actuelle ou prévisible, contre cette dernière, le Premier ministre peut enjoindre par décret aux opérateurs de communications électroniques de conserver, pour une durée d’un an, certaines catégories de données de trafic, en complément de celles mentionnées au 3° du II bis, et de données de localisation précisées par décret en Conseil d’État.
« L’injonction du Premier ministre, dont la durée d’application ne peut excéder un an, peut être renouvelée si les conditions prévues pour son édiction continuent d’être réunies. Son expiration est sans incidence sur la durée de conservation des données mentionnées au premier alinéa du présent III. » ;
4° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les données conservées par les opérateurs en application du III peuvent faire l’objet d’une injonction de conservation rapide par les autorités disposant, en application de la loi, d’un accès aux données relatives aux communications électroniques à des fins de prévention et de répression de la criminalité, de la délinquance grave et des autres manquements graves aux règles dont elles ont la charge d’assurer le respect, afin d’accéder à ces données. » ;
5° À la première phrase du V, les mots : « et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires » sont supprimés ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « III, IV et V » sont remplacées par les références : « II bis à V » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, détermine, selon l’activité des opérateurs et la nature des communications, les informations et catégories de données conservées en application des II bis et III ainsi que les modalités de compensation des surcoûts identifiables et spécifiques des prestations assurées à ce titre, à la demande de l’État, par les opérateurs. »
(Non modifiés) –
Adopté.
II et III. – §
(Non modifié)
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 832-3, après la référence : « L. 821-2 », sont insérés les mots : « et des avis rendus en application de la dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure » ;
2° Le premier alinéa du I de l’article L. 853-3 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase, les mots : « l’autorisation ne peut être donnée » sont remplacés par les mots : « la mise en place et l’utilisation de ces dispositifs ne peuvent être autorisées » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La maintenance et le retrait de ces mêmes dispositifs peuvent être autorisés après avis exprès rendu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 832-3. » –
Adopté.
(Non modifié)
La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-105-1 ainsi rédigé :
« Art. 706 -105 -1. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application de l’article 706-72-1, communiquer aux services de l’État mentionnés au second alinéa de l’article L. 2321-2 du code de la défense, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leur mission en matière de sécurité et de défense des systèmes d’information. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.
« II. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République de Paris peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence des juridictions mentionnées au dernier alinéa de l’article 706-75 et portant sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706-73 ainsi que sur le blanchiment de ces infractions, communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du même code désignés, au regard de leurs missions, par décret en Conseil d’État, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées au premier alinéa du présent II, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République de Paris.
« III. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « renseignement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : «, évalue la politique publique en ce domaine et assure un suivi des enjeux d’actualité et des défis à venir qui s’y rapportent. » ;
b) Après le 6°, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur une base semestrielle, la liste des rapports de l’inspection des services de renseignement ainsi que des rapports des services d’inspection générale des ministères portant sur les services de renseignement qui relèvent de leur compétence, produits au cours du semestre précédent. » ;
c) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation peut, dans la limite de son besoin d’en connaître, solliciter du Premier ministre la communication de tout ou partie des rapports mentionnés au 7° du présent I ainsi que de tout autre document, information et élément d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de sa mission. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« III. – La délégation peut entendre :
« 1° Le Premier ministre ;
« 2° Les membres du Gouvernement et leur directeur de cabinet ;
« 3° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ;
« 4° Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme ;
« 5° Le directeur de l’Académie du renseignement ;
« 6° Les directeurs en fonction des services mentionnés au I, accompagnés des collaborateurs de leur choix en fonction de l’ordre du jour de la délégation, ainsi que toute personne placée auprès de ces directeurs et occupant un emploi pourvu en conseil des ministres ;
« 7° Toute personne exerçant des fonctions de direction au sein des services mentionnés au même I ou du service du Premier ministre mentionné à l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, en présence de sa hiérarchie, sauf si celle-ci y renonce ;
« 8° Les directeurs des autres administrations centrales ayant à connaître des activités des services de renseignement. » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au début du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La délégation » ;
d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du dernier alinéa du I du présent article, la délégation peut inviter chaque année le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme à lui présenter le plan national d’orientation du renseignement. » ;
3° À la seconde phrase du second alinéa du VI, le mot : « transmet » est remplacé par le mot : « présente ».

L’amendement n° 13, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Les recommandations et observations que la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement adresse au Premier ministre en application des articles L. 833-6 et L. 855-1 C du même code. »
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

Il est essentiel que la délégation parlementaire au renseignement dispose chaque année d’un bilan des recommandations adressées par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement à l’exécutif.
En leur qualité de législateur et au regard de leur mission de contrôle de la politique publique du renseignement, les membres de la DPR doivent disposer de ces éléments pour savoir si des contournements au cadre juridique qu’ils ont posé ont été constatés afin, le cas échéant, d’apporter les modifications législatives nécessaires.

Retrait ou avis défavorable. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture : il faut veiller à ce que la DPR ne soit pas destinataire d’informations relatives à des opérations en cours ou à des opérations précises ; nous sommes donc parvenus à un compromis quant au rôle de la DPR dans la rédaction de l’article 17 bis et, par conséquent, ces précisions ne nous paraissent pas opportunes.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 4, présenté par M. Benarroche et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de mener ces missions sus-citées, la délégation peut donner des instructions générales aux services de renseignement, notamment en ce qui concerne les stratégies d’alliance avec d’autres services de renseignement. » ;
II. – Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « quatre députés et de quatre sénateurs » sont remplacés par les mots : « dix députés et de dix sénateurs » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les groupes d’opposition et minoritaires doivent être représentés. » ;
La parole est à M. Guy Benarroche.

Cet amendement, qui s’inspire du travail mené sur le sujet à l’Assemblée nationale, tend à modifier la composition de la délégation parlementaire au renseignement et à renforcer ses prérogatives.
La DPR n’est actuellement composée que de quatre députés et de quatre sénateurs, dont les présidents des commissions permanentes chargées des affaires de sécurité intérieure et de défense, qui en sont membres de droit.
Par le présent amendement, nous souhaitons renforcer son effectif en le portant de huit à vingt membres, afin d’accroître le pluralisme politique de cet organe et de permettre la représentation des groupes minoritaires et d’opposition.
Pour gagner en effectivité, la délégation parlementaire au renseignement doit également disposer d’un pouvoir d’injonction renforcé et être en mesure de donner des instructions générales aux services de renseignement.

L’avis est défavorable. D’une part, la DPR est composée de manière équilibrée ; d’autre part, la possibilité de donner des instructions aux services de renseignement serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 14, présenté par MM. Vaugrenard et Leconte, Mme S. Robert, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Durain et Bourgi, Mme Harribey, MM. Kerrouche, Marie et Sueur, Mmes Carlotti, Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Roger, Temal, Todeschini, M. Vallet, Vallini et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La délégation entend le Premier ministre, chaque année, sur le réexamen périodique de l’existence d’une menace pour la sécurité nationale justifiant la conservation généralisée des données de connexion. » ;
La parole est à M. Yannick Vaugrenard.

Voilà six ans, le Parlement avait prévu une disposition particulière permettant à la délégation parlementaire au renseignement d’auditionner chaque semestre le Premier ministre sur l’application des dispositions de la loi Renseignement de 2015.
En première lecture, l’Assemblée nationale a supprimé cette disposition, considérant qu’elle était obsolète – ce qu’on peut entendre. Néanmoins, il serait utile de la remplacer par une audition annuelle du Premier ministre sur le réexamen périodique de l’état de la menace qui sous-tend le maintien de la conservation généralisée des données de connexion, comme l’exigent, du reste, la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État.
En effet, il est important qu’un contrôle parlementaire puisse s’exercer sur le sujet et que l’exécutif motive sa position. À ce titre, il est donc proposé que la DPR, seule instance bicamérale habilitée à connaître d’informations classifiées, puisque ses membres et son secrétariat sont habilités au secret-défense, puisse s’enquérir de l’évolution de la menace à l’occasion d’une audition annuelle du chef du Gouvernement couverte par le secret de la défense nationale.

Retrait ou avis défavorable. La DPR peut déjà auditionner le Premier ministre quand elle le souhaite et exercer ainsi son contrôle.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 17 bis est adopté.

Chapitre III
Dispositions relatives à la lutte contre les aéronefs circulant sans personne à bord et présentant une menace
Chapitre IV
Dispositions relatives aux archives intéressant la défense nationale
Chapitre V
Dispositions relatives aux outre-mer
Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture

Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les raisons qui conduisent les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain à s’abstenir sur ce texte, raisons qu’ont exposées mes collègues Jean-Yves Leconte et Yannick Vaugrenard. Toutefois, madame la ministre, je tiens à revenir, dans cette explication de vote, sur l’une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas voter ce texte, et qui porte sur la question des archives, objet de l’article 19.
Celui-ci ayant malheureusement été voté dans les mêmes termes par les deux assemblées, il ne nous a pas été possible d’y revenir ce soir. Mais je veux redire avec force, au nom de notre groupe, que cet article soulève des problèmes considérables.
D’abord, il étend la possibilité de non-délivrance de documents à quatre domaines importants, vaguement définis, larges dans leur champ, et ce en contradiction avec la loi de 2008 relative aux archives, qui avait l’avantage d’être très claire sur ce sujet, et que nous avons votée, comme beaucoup d’entre vous, mes chers collègues.
Ensuite, il est prévu que le refus de communication pourra être perpétuel, sans limite : non, ce sera non !
Enfin, toute communication sera même interdite pour certains dispositifs tant qu’ils demeureront opérationnels. Tout cela est très flou…
Nous nous faisons une nouvelle fois les interprètes de tous les universitaires, de tous les historiens – en particulier les spécialistes de l’histoire contemporaine –, de tous les archivistes qui nous ont encore écrit aujourd’hui pour nous demander de faire quelque chose. De fait, nous considérons que cet article porte atteinte à des principes fondamentaux tels que le droit à l’histoire, le droit à la mémoire, le droit au savoir, nonobstant son caractère arbitraire. C’est bien pourquoi nous avions déposé un amendement tendant à ce que ce refus de communication soit exceptionnel, justifié, limité à dix ans, et à des cas où les intérêts de notre pays seraient véritablement en jeu ou si des menaces graves pesaient sur lui. Nous l’aurions très bien compris. Or nul compte n’en a été tenu.
Dans la mesure où des principes essentiels sont en cause, nous saisirons le Conseil constitutionnel.

Personne ne demande plus la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, l’ensemble du projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 163 :
Le Sénat a adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, jeudi 22 juillet 2021 :
À vingt et une heures trente :
Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire (discussion générale ; procédure accélérée ; texte A.N. n° 4386).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures.
La liste des candidats désignés par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d ’ administration générale pour faire partie de l ’ éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la gestion de la crise sanitaire a été publiée conformément à l ’ article 8 quater du règlement.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :
Titulaires : MM. François-Noël Buffet, Philippe Bas, Mme Chantal Deseyne, M. Philippe Bonnecarrère, Mmes Marie-Pierre de La Gontrie, Laurence Rossignol et M. Martin Lévrier ;
Suppléants : Mmes Catherine Deroche, Florence Lassarade, Catherine Di Folco, MM. Hervé Marseille, Jean-Yves Leconte, Mmes Véronique Guillotin et Éliane Assassi.