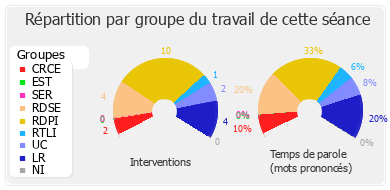Séance en hémicycle du 3 février 2009 à 10h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Questions orales (voir le dossier)
- Contrats d'assurance vie et contrats de prévoyance souscrits par des français établis à l'étranger (voir le dossier)
- Projet d'avenant à la convention fiscale franco-suisse de 1966 contre les non-doubles impositions (voir le dossier)
- Prise en charge par les collectivités des coûts de renforcement du réseau de distribution publique d'électricité (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à dix heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, auteur de la question n° 391, adressée à M. le ministre des affaires étrangères et européennes.

Du fait de l’organisation de nos débats, j’ai déposé ma question voilà plusieurs semaines. Le contexte ayant évolué, vous me permettrez, monsieur le secrétaire d’État, de modifier légèrement le contenu de ma question.
Je souhaite appeler l’attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la décision du tribunal de première instance des Communautés européennes concernant l’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran, l’OMPI, principal mouvement d’opposition iranienne, membre de la Commission du Conseil national de la Résistance iranienne présidée par Mme Maryam Radjavi. Cette décision du 4 décembre 2008 a annulé la décision du Conseil des ministres de l’Union européenne du 15 juillet 2008, qui réinscrivait l’OMPI, à la demande de la France, assumant alors la Présidence de l’Union européenne, sur la liste des organisations terroristes.
Cet arrêt, assez sévère, précise que le Conseil des ministres a violé les droits de la défense et porté atteinte au droit fondamental de l’OMPI à un contrôle juridictionnel effectif et qu’il n’a pas pu démontrer que l’OMPI était impliqué dans le terrorisme. Il est ajouté que les éléments du dossier fourni par la France au Conseil ne sont pas fondés sur des données « exactes et pertinentes » qui satisferaient aux exigences de preuve et qu’en outre le Conseil n’a pas expliqué les raisons spécifiques pour lesquelles les actes imputables à des individus prétendument membres de l’OMPI doivent être imputés à cette organisation.
Aussi, l’appréciation donnée par le Conseil des ministres proviendrait, selon le tribunal de Luxembourg, non pas d’une autorité judiciaire compétente et indépendante, mais du ministère des affaires étrangères français. De plus, la France, sous prétexte de confidentialité, n’a pas accepté de soumettre ses preuves au tribunal. On verra tout à l’heure pourquoi !
Cet arrêt fait suite à de nombreux autres, notamment à l’arrêt prononcé par la plus haute juridiction britannique, qui a enjoint à son gouvernement de supprimer l’OMPI de sa liste des organisations terroristes, disposition que la Chambre des Communes a adoptée à l’unanimité. Ces multiples décisions ont affirmé sans exception que l’OMPI n’était pas une organisation terroriste et qu’elle n’entendait pas le devenir.
Enfin, le 17 décembre dernier, le tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que la demande du Conseil était irrecevable et que sa décision du 4 décembre était exécutoire.
Le Conseil des ministres a maintenu l’OMPI sur la liste des organisations terroristes, et ce jusqu’à lundi dernier. Entre-temps, la France a fait savoir par la voix de M. Kouchner, notamment lors de son audition devant la commission des affaires étrangères du Sénat, qu’elle n’entendait pas se soumettre à la décision des autorités judiciaires européennes.
Aujourd’hui, le Conseil des ministres a dû se plier, sur un plan tant juridique que politique, car tous les États membres n’étaient pas du même avis, aux décisions de la justice européenne. C’est bien le moins !
L’OMPI a donc été radiée, le 26 janvier dernier, de la liste des organisations terroristes. M. Kouchner, ministre des affaires étrangères et européennes, et M. Bruno Le Maire, secrétaire d’État chargé des affaires européennes, ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’il s’agissait d’une décision d’ordre judiciaire, qu’ils n’approuvaient pas cette décision, que le problème politique restait entier et que la France se réservait le droit de faire appel de cette décision. On est d’ailleurs en droit de se demander auprès de qui. Peut-être pourrez-vous me répondre sur ce point, monsieur le secrétaire d’État ?
Ma question, qui n’a pas changé sur le fond, est la suivante : quelle est vraiment la position de la France ? Pourquoi s’acharne-t-elle à demander que l’OMPI demeure inscrite sur la liste des organisations terroristes, nonobstant toutes les décisions judiciaires, notamment européennes ? S’agit-il vraiment de satisfaire les demandes du régime iranien ?
Je comprends, monsieur le sénateur, que vous ayez légèrement modifié le texte de votre question, car ce dossier évolue d’une semaine à l’autre.
La France a pris note de l’arrêt du tribunal de première instance des Communautés européennes, le TPICE, du 4 décembre 2008, annulant la décision du Conseil de l’Union Européenne du 15 juillet 2008, qui inscrivait de nouveau l’Organisation des Moudjahidines du peuple d’Iran, l’OMPI, sur la liste européenne des personnes et des entités impliquées dans des actes de terrorisme.
La France a cependant estimé, et peu de changements sont intervenus depuis lors, que l’inscription de l’OMPI sur la liste européenne, en juillet dernier, était fondée puisqu’elle s’appuyait sur une instruction devant une juridiction nationale. Notre pays a donc souhaité que l’OMPI soit de nouveau inscrite sur la liste antiterroriste européenne dans le cadre de la révision de cette liste, qui intervient à chaque semestre.
Cette demande de réinscription n’ayant pu recueillir le consensus des États membres, le Conseil a adopté, le 26 janvier dernier, une liste révisée n’incluant pas l’OMPI. La France s’est abstenue, afin de ne pas bloquer l’adoption de la liste sur laquelle figure l’ensemble des entités et des groupes terroristes faisant l’objet de mesures restrictives de la part de l’Union européenne.
Par ailleurs, la France a déposé, le 21 janvier dernier, un pourvoi contre l’arrêt du TPICE du 4 décembre 2008 devant la Cour de justice des Communautés européennes.
L’inscription ou non de l’OMPI sur la liste antiterroriste européenne n’affecte pas notre évaluation, à titre national, de cette organisation. À cet égard, il convient de rappeler qu’une information judiciaire a été ouverte en 2001 par le parquet antiterroriste du tribunal de grande instance de Paris, à l’encontre de membres présumés de l’OMPI, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cette procédure est toujours pendante devant le parquet. À ce jour, vingt-quatre personnes ont été mises en examen.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous remercie de votre réponse, qui, bien entendu, ne me satisfait pas.
La procédure que vous mentionnez a été ouverte en 2001, il y a huit ans !
Ayant été magistrat dans une vie antérieure, je ferai plusieurs remarques.
Soit ce dossier contient des éléments à l’encontre des personnes mises en examen, auquel cas le parquet, dont on nous répète assez qu’il n’est pas une autorité indépendante, doit demander au juge d’instruction une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, qui rendra un jugement.
Soit il n’y a rien dans le dossier, et chacun sait que c’est le cas en l’occurrence. Les personnes mises en examen ont d’ailleurs toutes été remises en liberté et se sont dispersées un peu partout en France à la suite d’arrêtés d’expulsion rendus à leur encontre, qui ont ensuite été invalidés par le tribunal administratif. Ils sont tous revenus aujourd’hui à Auvers-sur-Oise, où ils sont installés depuis 1981.
Il est donc choquant que le Gouvernement se fonde sur cette procédure, par ailleurs couverte par le secret de l’instruction, pour justifier sa position. Il serait bien inspiré de prier le procureur de la République de Paris, M. Jean-Claude Marin, qui n’est pas homme à refuser ses sollicitations, de demander un renvoi devant le tribunal.
En outre, la demande de retrait de l’OMPI de la liste des organisations terroristes est soutenue par de nombreux parlementaires dans toute l’Europe, y compris français, en l’occurrence par une majorité de députés, toutes tendances confondues, et par une centaine de sénateurs, et non des moindres, de toutes sensibilités, dont je ne citerai pas les noms par respect pour la parole qu’ils ont donnée à l’OMPI.
Le Gouvernement est dans une situation assez paradoxale vis-à-vis du régime iranien. Il compte parmi ses rangs une secrétaire d’État chargée des droits de l’homme et rend service à un régime qui, on le sait, ne cesse de bafouer les droits de l’homme. En soutenant un régime qui applique la peine de mort de façon intensive et fait exécuter sur la place publique des femmes, des jeunes gens et des enfants, un régime qui ne reconnaît aucune liberté publique, nous faisons fausse route, même si nous partageons des intérêts commerciaux avec ce pays !

La parole est à M. Bernard Piras, auteur de la question n° 392, adressée à M. le ministre de l’éducation nationale.

Je souhaite attirer l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale sur la prise en charge des enfants handicapés au sein des écoles primaires.
L’objet de ma question n’a pas, bien évidemment, pour finalité une remise en cause de l’accueil de ces enfants, lequel constitue un progrès social indiscutable, dont nous devons tous nous féliciter. La problématique porte, au contraire, sur les conditions d’accueil de ces enfants handicapés, qui méritent une prise en charge adaptée à leurs besoins.
Or tel n’est pas toujours le cas. Un cas frappant mérite d’être signalé : celui des classes d’intégration scolaire, les CLIS, telles que celles de type 4 en faveur des enfants handicapés moteurs. Ces classes accueillent des enfants de plus en plus lourdement handicapés.
En périscolaire, ces enfants sont gérés par des personnels communaux. Au regard des actes de nature médicale que sont potentiellement amenés à réaliser ces personnels – médicament par injection annale, pour les crises d’épilepsie, ou dans l’épiderme de la cuisse, en cas de choc anaphylactique, par exemple –, des qualifications importantes sont exigées. Il est très difficile pour les communes de trouver ces personnels en raison, notamment, du peu d’intérêt des contrats proposés, qui ne portent souvent que sur huit à douze heures par semaine.
Cette problématique n’est pas réservée aux CLIS, mais concerne l’ensemble des classes primaires, à travers les projets d’accueil individualisés, les PAI. Ces derniers ont pour objet de permettre la scolarisation des enfants malades. Se pose également le problème de la qualification des personnels amenés à intervenir dans le cadre de ces PAI.
Au-delà des risques encourus par ces enfants, qu’il faut réduire au minimum, la responsabilité de ces personnels, et donc de leur employeur, à savoir le maire, est clairement engagée.
Ainsi, de manière globale, il est nécessaire que des moyens suffisants soient accordés par le ministère pour une prise en charge correcte et sûre des enfants handicapés scolarisés, d’une part, et qu’une clarification des responsabilités soit rapidement apportée, d’autre part.
Êtes-vous en mesure, monsieur le secrétaire d’État, d’apporter une réponse à ces deux questions ?
Monsieur le sénateur, je vous prie de bien vouloir excuser M. ministre de l’éducation nationale, qui ne peut être présent et m’a demandé de vous répondre à sa place.
Les enfants ou adolescents accueillis en milieu scolaire ordinaire peuvent présenter des troubles de la santé justifiant la mise en place de dispositifs particuliers distincts : le projet personnalisé de scolarisation, le PPS, ou le projet d’accueil individualisé, le PAI.
Si un élève est porteur d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, les modalités de sa scolarité sont précisées dans un PPS arrêté par la commission des droits et de l’autonomie siégeant au sein des maisons départementales des personnes handicapées, MDPH.
Le PPS répertorie les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers de cet élève.
Il peut ainsi prévoir, le cas échéant, le bénéfice d’un auxiliaire de vie scolaire pour l’aide et les soins éventuels nécessaires à l’enfant, que ce soit pour une scolarisation en classe d’intégration scolaire, CLIS, en classe ordinaire ou mixte. Cet auxiliaire reçoit une formation spécifique pour certains gestes dont la réalisation est réglementée : à titre d’exemple, l’aspiration endo-trachéale dans les cas de maladies respiratoires invalidantes.
Si cet élève est porteur d’un trouble de la santé évoluant sur une longue durée, d’une allergie ou d’une intolérance alimentaire, il est parfois nécessaire de mettre en place une organisation qui permet à cet élève de bénéficier des soins, voire des mesures d’urgence nécessaires au maintien de sa santé.
Ces modalités sont décrites dans un projet d’accueil individualisé, PAI, élaboré à la demande de la famille ou avec son accord, du directeur d’école, du chef d’établissement ou du directeur du service d’accueil, en association, le cas échéant, avec les services municipaux en charge du service de la restauration. Le but est de faciliter l’accueil de cet enfant. Il ne s’agit en aucun cas de substituer ce projet à la responsabilité des familles.
Le médecin de l’éducation nationale ou le médecin de la protection maternelle et infantile, PMI, définit avec les différents intervenants autour de l’élève les adaptations apportées à la vie de l’enfant, les modalités particulières et les conditions d’intervention des partenaires, dans le respect des compétences de chacun.

Monsieur le secrétaire d’État, sans vouloir vous blesser, c’est à un exercice théorique que vous venez de vous livrer. La théorie est une chose, la pratique en est une autre !
Dans la réalité, la situation est bien différente, car le personnel n’a pas une formation suffisante. Ma question portait sur les moyens à mettre en œuvre pour une prise en charge adaptée aux besoins des enfants handicapés scolarisés.

La parole est à Mme Mireille Schurch, auteur de la question n° 399, transmise à M. le secrétaire d'État chargé des sports.

Ma question, adressée à M. le secrétaire d’État chargé des sports, est portée depuis samedi matin, à la suite d’une réunion que nous avons tenue dans l’Allier, par les quatre députés de ce département, MM. Jean Mallot, Bernard Lesterlin, Gérard Charasse, Guy Chambefort, ses deux sénateurs, M. Gérard Dériot et moi-même, le président du conseil général, M. Jean-Paul Dufreigne, le président du conseil régional, M. René Souchon, le président de Vichy Val-d’Allier, M. Jean-Michel Guerre, et le maire de Vichy, M. Claude Malhuret.
Au lendemain de la réunion du comité mixte paritaire ministériel qui s’est tenue le 16 décembre dernier au secrétariat d’État aux sports, à la jeunesse et à la vie associative, les élus locaux, départementaux, régionaux et les personnels du centre régional d’éducation populaire et de sports, CREPS, de Vichy Auvergne sont particulièrement inquiets.
Le CREPS de Vichy Auvergne est l’un des quatre établissements pour lesquels une réévaluation conduirait à une décision de maintien ou de fermeture avant le 31 mars 2009.
Pourtant, il est un établissement récemment modernisé : une nouvelle salle de sports dédiée à la pratique du haut niveau vient d’être achevée pour un montant de 1, 6 million d’euros, deux bâtiments d’hébergement ont été réhabilités et l’amphithéâtre de 120 places vient d’être inauguré. C’est un investissement de 7, 5 millions d’euros de l’État, de l’Europe, de la région Auvergne, du département de l’Allier et de la communauté d’agglomération de Vichy Val d’Allier.
Le CREPS de Vichy Auvergne est un établissement que sa gestion saine, avec un taux d’autofinancement de 75 %, place dans les établissements les moins dépendants du ministère de tutelle. Les résultats d’exploitation sont excédentaires, le fonds de roulement représentant une année de fonctionnement.
Il assure 65 emplois publics et privés, sans compter les vacataires et les prestataires de services. Sur cet établissement, l’agglomération de Vichy Val d’Allier fait reposer un positionnement stratégique ambitieux en faveur de l’économie du sport.
Le CREPS de Vichy Auvergne accueille cinq pôles « espoirs » réunissant 75 athlètes et reçoit chaque année près de 1 000 jeunes préparant des diplômes professionnels. Un contrat d’objectifs, signé le 20 novembre 2008 entre l’État, la région Auvergne, les partenaires académiques et les partenaires sociaux, positionne de manière nette l’établissement sur le grand Massif central. Ainsi, le CREPS assure, depuis cette date, la formation des moniteurs de l’École nationale d’administration pénitentiaire d’Agen.
Cet établissement a obtenu le renouvellement pour trois ans de la certification ISO 9001 version 2000 pour ses activités de formation et d’accès au haut niveau.
Je m’interroge donc sur cette décision du 16 décembre dernier, qui suscite l’incompréhension de mes collègues élus, aux côtés desquels l’État s’était engagé jusqu’à une période récente, mais aussi des partenaires économiques, académiques et des agents de votre ministère, à tous les niveaux de la hiérarchie.
Les investissements importants effectués, la bonne gestion financière, la défense de l’emploi public et privé, l’importance économique et sociale régionale, la place reconnue dans le paysage de la formation professionnelle plaident en faveur de cet établissement. Pouvez-vous nous confirmer aujourd’hui que ces indicateurs seront pris en compte pour le maintien du CREPS de Vichy Auvergne sous la tutelle de votre ministère ?
Madame la sénatrice, je vous remercie de bien vouloir excuser l’absence de mon collègue Bernard Laporte, actuellement retenu par d’autres obligations.
Vous appelez son attention sur la réorganisation du réseau des centres régionaux d’éducation populaire et de sport et, plus précisément, sur le cas du CREPS de Vichy.
Les décisions annoncées au comité mixte paritaire ministériel du 16 décembre 2008 ont été prises dans le prolongement de deux réflexions engagées au cours de l’année 2008.
La première est liée à la démarche de révision générale des politiques publiques, RGPP, appliquée à tous les ministères.
Le comité de modernisation des politiques publiques a préconisé une évaluation permettant d’identifier les établissements dont la contribution à la mise en œuvre des politiques publiques est essentielle.
Une commission représentant les divers acteurs du monde du sport, de la jeunesse et de l’éducation populaire, constituée à cet effet durant l’été 2008, a rendu ses conclusions.
Ces dernières nous ont montré que les deux missions principales confiées aux CREPS en matière de sport de haut niveau et de formation aux métiers du sport et de l’animation n’étaient que partiellement assurées.
Un nombre significatif d’établissements n’a aujourd’hui qu’un rôle très marginal dans le dispositif du sport de haut niveau, notamment dans l’accueil de pôles « France » ou « espoirs », et une activité limitée en matière de formation.
Par ailleurs, en concertation avec le mouvement sportif, une réflexion d’ensemble sur le sport français, en particulier le sport professionnel et le sport de haut niveau, a été conduite.
Comme vous l’avez observé, le bilan des jeux Olympiques et Paralympiques de Pékin, globalement satisfaisant, a néanmoins mis en évidence certaines faiblesses que nous devons prendre en considération dans la perspective des Jeux de 2012.
Le secrétariat d’État chargé des sports a décidé de proposer une réforme de fond de son dispositif de soutien au sport de haut niveau et à ses structures.
L’objectif est de le tirer vers le haut, de le mettre vraiment en situation d’être concurrentiel sur le plan international.
Cette réforme concerne, au premier chef, les établissements placés sous la tutelle du ministère. L’ambition du Gouvernement est d’en faire de véritables campus sportifs, bien équipés et en pointe dans tous les domaines qui sont la clé de la réussite de nos athlètes : la préparation physique, le suivi médical, la recherche, le . La rénovation de l’Institut national des sports et de l’éducation physique, INSEP, répond à cette ambition.
Nous cherchons à atteindre les mêmes objectifs pour les CREPS. C’est dans cet esprit que Bernard Laporte a annoncé, en décembre dernier, la réorganisation du réseau selon les principes que je vais décliner.
Quatorze CREPS ont d’ores et déjà vocation à devenir des « campus de l’excellence sportive ». Six CREPS feront, en septembre 2009, l’objet d’une profonde restructuration en concertation avec les principaux acteurs locaux.
Enfin, quatre CREPS, dont la place dans la politique ministérielle en faveur du sport de haut niveau est moindre, feront l’objet d’une évaluation beaucoup plus approfondie, en totale concertation avec les élus et le mouvement sportif.
Le CREPS de Vichy entre dans cette dernière catégorie. Son niveau d’activité, dans le domaine tant du sport de haut niveau que de la formation, sans être négligeable, n’est pas le même que celui des quatorze établissements déjà retenus pour devenir nos futurs campus sportifs.
Il accueille un nombre limité de pôles « espoirs » labellisés par le secrétariat d’État chargé des sports. Certes, vous avez raison, madame la sénatrice, la structure de son budget est excédentaire. Mais on doit nuancer cette observation en précisant qu’il n’en serait pas ainsi si l’on prenait en compte la rémunération de l’ensemble des agents de l’établissement.
M. Laporte a demandé au préfet de la région Auvergne d’engager, au cours du premier trimestre 2009, une concertation avec le mouvement sportif régional et les collectivités territoriales.
Les potentialités du site sont actuellement évaluées compte tenu des orientations données à la fin de 2008 par le secrétariat d’État chargé des sports en ce qui concerne le sport de haut niveau.
Il conviendra, notamment, de déterminer si les pôles sportifs actuellement présents à Vichy entrent dans le projet de chaque fédération pour la préparation des Jeux de Londres en 2012.
Vous comprendrez, madame la sénatrice, que je ne puisse pas encore vous donner les résultats de cette phase de concertation. Soyez toutefois assurée que nous trouverons, avec toutes les parties prenantes, la solution la mieux adaptée.

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez annoncé une concertation. Nous la réclamons vivement, nous, les élus et le mouvement sportif, pour évaluer les capacités de ce CREPS à devenir un campus sans pour autant le pénaliser d’entrée.
Comme cette concertation, que nous souhaitons vivement, n’a pas encore eu lieu, je suis porteuse, de la part de tous les élus précédemment cités, d’un courrier demandant une rencontre avec M. Laporte.

La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 373, transmise à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

Monsieur le secrétaire d’État, ma question porte sur les difficultés rencontrées par certains Français établis hors de France qui ont souscrit un contrat d’assurance vie ou un contrat de prévoyance avant de partir à l’étranger.
Certaines notices d’assurance comportent des clauses qui excluent les Français résidant à l’étranger et annulent l’exécution du contrat d’assurance notamment « en cas de décès » - clause pour le moins paradoxale dans un contrat d’assurance vie ! - « ou de perte totale et irréversible d’autonomie survenue hors des pays de l’Espace économique européen, de la Suisse, des États-Unis et du Canada ».
Cette situation est particulièrement pénalisante pour nombre de nos concitoyens vivant dans ces zones géographiques fort étendues puisqu’elles couvrent le reste du monde. En effet, s’ils décèdent en cours de contrat, le capital constitué ne peut pas être versé aux bénéficiaires qu’ils avaient désignés lors de la signature du contrat.
Or, pour le Français expatrié peut-être plus encore que pour tout autre, le fait d’avoir souscrit un contrat d’assurance vie ou d’assurance décès est un facteur rassurant : il sait avoir mis à l’abri du besoin ceux qui lui sont chers et qui sont restés en France..
Plusieurs expatriés dans cette situation se sont ouverts à moi de cette question, également soumise à des collègues députés. Avant de questionner un membre du Gouvernement, j’ai évidemment saisi la Fédération française de l’assurance avec laquelle je pensais pouvoir ouvrir un débat.
La réponse, de nature très administrative, ne permet pas d’aller très loin. On m’explique en effet qu’il s’agit d’une question complexe dont le règlement dépend d’un certain nombre d’éléments techniques !
Je souhaiterais donc obtenir, monsieur le secrétaire d'État, des éclaircissements sur les motifs à l’origine de cette situation vécue ou en tout cas perçue comme une discrimination à l’égard de ceux qui continuent de cotiser à de tels contrats d’assurance vie.
Quelles raisons justifient que ces contrats soient suspendus ? Ne faudrait-il pas prévenir les souscripteurs et, le cas échéant, leur reverser, avec des intérêts, les cotisations déjà payées ?
Enfin, où iront les fonds s’ils ne sont pas versés aux ayants droit après le décès du souscripteur ?
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser Christine Lagarde, qui n’a pu être parmi nous aujourd’hui.
Vous l’interrogez sur les difficultés rencontrées par les Français établis hors de France en matière de contrats d’assurance couvrant les risques de décès, incapacité, invalidité souscrits antérieurement à leur départ à l’étranger et particulièrement sur certaines clauses d’exclusion géographique.
La réponse sera assez longue, monsieur le sénateur, car nos compatriotes en faveur de qui vous avez plaidé seront amenés à l’invoquer.
Votre question rappelle aux Français qui partent à l’étranger qu’ils doivent être attentifs aux exclusions géographiques qui sont prévues dans les contrats d’assurance.
Les assureurs sont amenés à exclure certains pays de leur champ de couverture géographique pour plusieurs raisons.
En premier lieu, lorsqu’un assuré, quelle que soit sa nationalité, réside à l’étranger, le contrat peut se trouver soumis à un droit étranger que l’assureur ne maîtrise pas.
Ce droit peut d’ailleurs exiger dans certains pays que l’assureur soit agréé par une autorité locale de contrôle. L’assureur commettrait alors une infraction au droit étranger dont il s’agit si son contrat était valide sans condition à l’étranger.
En deuxième lieu, dans certains pays, il peut être difficile d’évaluer l’état de l’assuré pour mettre en jeu les garanties incapacité, invalidité, voire décès.
En troisième lieu, compte tenu aussi des conditions sanitaires et d’accès aux soins de certains pays, les assureurs ne peuvent pas tarifer aux conditions standard les assurés en partance pour ces pays.
Prévoir les conditions standard pour ces pays conduirait à augmenter le tarif des assurances pour tous les assurés sur le territoire français. La limitation de territorialité permet ainsi aux Français et résidents européens de bénéficier des meilleures conditions d’accès à l’assurance prévoyance.
En quatrième lieu, enfin, la société d’assistance qui exécute les prestations d’assistance, en particulier le rapatriement, prévues au contrat peut elle-même exclure certains pays de son champ d’action.
Pour toutes ces raisons, les exclusions territoriales sont aujourd’hui nombreuses dans les contrats d’assurance. Il s’agit non pas d’une discrimination mais, en réalité, d’une différence objective de situations qui appelle des réponses adaptées.
Les solutions existent d’ailleurs.
Un assuré peut demander à son assureur l’extension des garanties prévues au contrat de base, par exemple l’inclusion d’un pays non couvert dans la police standard.
Dans ce cas, l’assureur examinera sa capacité à répondre à la demande d’extension présentée par l’assuré, en la conditionnant le cas échéant au paiement d’une surprime représentative des risques supplémentaires pris par l’assureur pour couvrir la garantie demandée par l’assuré.
Là encore, il faut dire aux Français qui partent à l’étranger d’être attentifs à faire jouer la concurrence : les personnes souhaitant souscrire de tels contrats ont tout intérêt à démarcher plusieurs assureurs et courtiers pour trouver le contrat répondant le mieux et au meilleur prix à leurs attentes.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de cette réponse.
Elle apporte quelques éléments qui permettront peut-être d’avancer. Nous demandons qu’il soit fait pression sur les sociétés d’assurance, d’une part, pour qu’elles fassent un véritable effort d’information afin que les Français qui partent à l’étranger n’aient plus soudain la surprise de découvrir, dans la plupart des cas de bonne foi, que le contrat qu’ils avaient souscrit n’est plus valable, d’autre part, pour qu’elles proposent davantage à leurs assurés les solutions que vous avez évoquées, y compris si nécessaire en contrepartie du paiement d’une surprime, encore qu’il y aurait sans doute à débattre du niveau que devrait atteindre celle-ci.

La parole est à M. Jacques Mézard, auteur de la question n° 397, transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

La question que j’ai adressée à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi concerne La Française des jeux.
Cette société d’économie mixte, dont les résultats financiers sont très positifs, fournit, sans contrat spécifique, à de très nombreux commerçants – souvent des buralistes et des papetiers, en particulier dans les zones rurales – des jeux de grattage.
Ces commerçants perçoivent une rémunération de 5 % sur le chiffre d’affaires réalisé.
Or, à la fin de l’année 2008, La Française des jeux a averti plusieurs centaines et mêmes plusieurs milliers d’entre eux qu’elle cesserait au début de l’année 2009 ses livraisons à tous ceux qui ne réalisent pas 600 euros de chiffre d’affaires par semaine, soit environ 2 500 euros par mois.
Ce sont essentiellement les commerçants des petites communes qui sont donc concernés par cette décision, dont l’effet sera de leur faire perdre un revenu souvent significatif puisqu’il peut représenter plus d’un mois de bénéfices. Ainsi, dans mon département, quinze buralistes sont touchés.
Bien évidemment, j’ai interrogé le président de la Française des jeux : dans une quasi-circulaire, il m’a été répondu que cette société était consciente du rôle que son réseau, qui est deux fois supérieur par la taille à celui de La Poste, jouait pour l’animation du commerce de proximité et que j’aurais ensuite des nouvelles.
Ces nouvelles, nous les attendons toujours et les livraisons ne sont en tout cas plus effectuées, ce qui pose, bien sûr, le problème du maintien des commerces de proximité, en particulier en zone rurale.
La raison invoquée par cette société, qui a pourtant manifestement les moyens de faire face, est la mise en place d’un système informatique dont la gestion serait, semble-t-il, trop coûteuse s’agissant des commerces faisant moins de 600 euros de chiffre d’affaires par semaine.
On peut estimer que l’addiction aux jeux de grattage de nombre de nos concitoyens n’est pas forcément positive, mais, en l’espèce, nous sommes confrontés à une décision unilatérale qui, à mon avis, institue une discrimination concurrentielle inacceptable.
Monsieur le sénateur, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser l’absence d’Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui ne pouvait être présent ce matin.
Le réseau de La Française des jeux est composé, d’une part, de points de vente dits « tirage » qui commercialisent les jeux de tirage, de pronostics sportifs, de grattage et/ou le jeu Rapido et, d’autre part, de points de vente qui commercialisent exclusivement les jeux de grattage.
Les points de vente « tirage » sont tous équipés de terminaux de prises de jeux. Ils font l’objet d’un contrat signé entre La Française des jeux et le détaillant.
Le contrat stipule, entre autres dispositions, que la mise en place gratuite de matériels chez le détaillant fait peser sur La Française des jeux des coûts liés notamment à l’achat, l’installation et la maintenance de ces matériels ainsi que les coûts de télécommunications que seule la réalisation d’un chiffre d’affaires minimum par semaine permet de couvrir.
Ce chiffre d’affaires minimum est déterminé en fonction du type. Il est par exemple de 1 300 euros pour un détaillant équipé d’un terminal de prises de jeux.
Afin de ne pas aggraver la situation, parfois délicate, que connaissent actuellement certains points de vente, principalement du fait des difficultés rencontrées par les marchés du tabac et de la presse, La Française des jeux a mis en place en 2008 un moratoire sur les retraits d’agrément « tirage » liés à la non-atteinte du chiffre d’affaires contractuel du point de vente.
Depuis lors, l’entreprise a ainsi maintenu l’agrément d’environ 2 000 points de vente alors que les minima de chiffre d’affaires n’étaient pas atteints.
La gestion des points de vente qui commercialisent exclusivement des jeux de grattage relève, quant à elle, de la responsabilité des courtiers-mandataires, qui évaluent notamment leur potentiel commercial et les conditions d’exploitation qui en découlent.
Le courtier-mandataire est un professionnel lié par un contrat d’exclusivité avec La Française des jeux ; son rôle est d’approvisionner les points de vente en jeux de grattage, de mettre en place les dispositifs promotionnels et d’assurer l’encaissement des sommes provenant de la vente de ces jeux.
Toutes ces prestations ont un coût, supporté par l’entreprise de courtage, qui est rémunérée par une commission sur les mises.
Dès lors, la desserte d’un point de vente n’est économiquement viable que si celui-ci dégage un chiffre d’affaires suffisant pour couvrir les charges correspondantes. Si le point mort n’est pas le même pour tous les points de vente et pour tous les courtiers, il est généralement bas et se situe quasi systématiquement en deçà de 500 euros de chiffre d’affaires par semaine.
Même si La Française des jeux a pour mission d’assurer une proximité suffisante avec les Français qui souhaitent avoir l’accès à son offre sur l’ensemble du territoire national, dans l’accomplissement de cette mission, elle doit néanmoins prendre en compte certaines réalités économiques qui s’imposent à toute entreprise soucieuse du développement de son efficacité.

La réponse de M. le secrétaire d'État, qui annonce la fermeture de plusieurs points de vente dans les zones rurales, ne m’a pas paru très positive. Après les bureaux de poste, les trains, les écoles, ce sont maintenant les jeux que l’on supprime !
Vous allez donc priver nos concitoyens de l’espoir de gagner et leur laisser le droit de ne pas perdre !
Sourires

La parole est à Mme Patricia Schillinger, auteur de la question n° 396, adressée à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Je souhaite attirer l’attention de M. Woerth sur les inquiétudes des frontaliers suscitées par le projet d’avenant à la convention fiscale franco-suisse de 1966 contre les non-doubles impositions.
L’article 4 de cet avenant concerne les travailleurs frontaliers et plus particulièrement la fiscalité applicable lors du rapatriement du deuxième pilier, c’est-à-dire la retraite complémentaire.
Avec cet article, la Suisse conserverait la totalité de l’impôt prélevé lors du rapatriement en France, alors que jusqu’à maintenant elle le remboursait au travailleur frontalier.
Ainsi, ledit avenant prévoit la suppression de ce remboursement, étant considéré que le capital est non imposé en France et que, à ce titre, la Suisse a le droit de conserver par subsidiarité l’impôt prélevé.
Cette mesure injuste conduit à une double imposition des transfrontaliers et risque d’avoir de lourdes conséquences sur l’économie locale.
Les transfrontaliers ne peuvent accepter que la Suisse les impose davantage. Un bouleversement fiscal ne ferait qu’entraîner un déséquilibre supplémentaire pour nos départements frontaliers.
Notre pays n’a aucun intérêt à ratifier ce projet d’avenant : l’impôt resterait acquis à la Suisse et diminuerait le pouvoir d’achat des travailleurs frontaliers. Cette mesure est injuste !
Je souhaite souligner qu’en 2007 une pétition a été organisée par le groupement transfrontalier européen et a recueilli 14 000 signatures. De plus, M. Bernard Accoyer, président de l’Assemblée nationale, s’est engagé fermement à soutenir les frontaliers. Lors du vingt-septième congrès du groupement transfrontalier européen, il a déclaré : « Concernant la double imposition du deuxième pilier, il ne s’agit que d’un accord entre administratifs auquel je me suis farouchement opposé. J’ai décidé, affirmé et demandé que le Gouvernement sursoie à cette mesure. »
M. Accoyer a raison : il s’agit bien d’un accord entre administratifs, car ce sont les services fiscaux des deux États, la France et la Suisse, qui ont décidé d’une modification de la convention fiscale, sans aucune consultation ou même information des élus.
Monsieur le secrétaire d'État, comment la France a-t-elle pu accepter qu’une prestation versée sous forme de capital, non imposable en droit interne de la France, devienne un revenu en convention fiscale, et attribuer l’imposition à la Suisse ?
Quelle est la position du Gouvernement sur ce sujet ? Quel est l’état des discussions entre les deux pays ? Le Gouvernement envisage-t-il de ratifier ce projet d’avenant ou à tout le moins de faire retirer l’article 4, qui crée une situation injuste pour les travailleurs frontaliers ?
Madame la sénatrice, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence d’Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui ne peut être présent ce matin.
Vous interrogez le Gouvernement sur les modalités d’imposition des pensions de source suisse perçues par les travailleurs frontaliers résidant en France, dans le cadre du nouvel avenant à la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966.
Vous précisez que cette convention attribue actuellement à la France l’imposition des pensions, autres que publiques, perçues par les résidents français, l’impôt prélevé à la source par la Suisse étant remboursé par celle-ci après justification par le bénéficiaire de sa résidence française.
Selon vous, le nouvel avenant à cette convention conduira à une double imposition des travailleurs frontaliers.
Je suis en mesure de vous apporter les précisions suivantes.
L’actuelle convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 prévoit une imposition exclusive des pensions, autres que les pensions publiques, dans l’État de la résidence du bénéficiaire. Or le droit fiscal français n’a pas prévu l’imposition des pensions en capital versées par des institutions de prévoyance suisses au bénéfice de résidents français. Ces pensions échappent ainsi à toute imposition, en France comme en Suisse.
Afin de mettre un terme à cette situation de double exonération, l’article 4 de l’avenant signé le 12 janvier 2009 autorise la Suisse à imposer ce type de pensions aussi longtemps que le droit interne français n’aura pas été modifié pour permettre à la France de les imposer.
En pratique, à la suite de l’entrée en vigueur du nouvel avenant, ces pensions de retraite de source suisse versées en capital à des résidents français ne seront imposées qu’en Suisse. Je peux donc vous assurer que les craintes au sujet d’éventuelles doubles impositions sont infondées.
En outre, cet avenant ne constitue en aucun cas un abandon de souveraineté de la part de la France. Si la France décidait à l’avenir d’instaurer un régime d’imposition des pensions en capital, ce qui est une décision qui dépasse le seul cas des frontaliers, la Suisse perdrait automatiquement et immédiatement le droit d’imposer les prestations en capital perçues par des résidents de France.
Par ailleurs, ce projet d’avenant, dont le Premier ministre avait confirmé la signature lors de son déplacement en Suisse le 28 novembre dernier, marque une avancée majeure en termes d’accès aux informations fiscales suisses, notamment bancaires, et donc dans la lutte contre la fraude fiscale. Il est à ce titre conforme aux intérêts français et aux positions défendues par la France sur la scène internationale, notamment dans le contexte actuel, où la nécessité d’assurer une meilleure transparence fiscale et de renforcer la lutte contre l’évasion fiscale prend un relief particulier.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de votre réponse. Il est important de rassurer les associations, qui répercutent auprès des élus l’inquiétude des futurs retraités quant à leur pouvoir d'achat, en ces temps où la pauvreté ne cesse d’augmenter.

La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 386, adressée à Mme la ministre de la santé et des sports.

Je souhaite attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de proposer une solution de remplacement au recyclage des médicaments à envoyer à l’étranger.
En effet, en 2007, la France a légiféré sur diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. L’une des mesures adoptées a mis fin au dispositif de collecte et de tri de médicaments inutilisés en vue de leur expédition vers les pays en voie de développement, à compter du 31 décembre 2008. À la suite de la transposition de cette directive, des centaines de milliers de malades, dans des pays où l’accès aux soins n’est pas garanti, sont privés de médicaments.
Certes, personne n’ignore que le Gouvernement a essayé de trouver des réponses adéquates à l’échelon national pour remplacer le recyclage des médicaments à destination des plus démunis par une réelle politique de soutien, avec des mesures d’accès au médicament pour tous.
Cependant, la question reste ouverte pour ce qui est de l’envoi de médicaments aux pays qui en ont besoin. Au mois de janvier 2007, ici même, au cours d’un long débat, le Gouvernement s’est formellement engagé à aider les organisations qui procédaient à la collecte des médicaments en vue de leur expédition à l’étranger et à trouver de nouvelles sources d’approvisionnement. Ainsi, le ministère des affaires étrangères et européennes, en lien avec l’Agence française de développement, tente d’élaborer des solutions à long terme.
En revanche, pour ce qui est des deux à trois prochaines années à venir, les associations, qui expédiaient jusqu’à présent des dizaines de tonnes de médicaments, ont besoin du Gouvernement pour fournir des médicaments neufs à ces pays. Si le problème du recyclage est réglé, celui de l’envoi de médicaments neufs pendant cette période ne l’est pas.
En revanche, cela ne peut se faire qu’au moyen d’une coopération étroite entre le ministère de la santé et des sports, les laboratoires pharmaceutiques et les associations, afin que ces dernières obtiennent des dons, bénéficient d’achats de génériques et obtiennent des subventions.
Comment le Gouvernement compte-t-il remédier à cette situation, afin que la France continue à œuvrer de manière solidaire pour les pays dans lesquels l’accès au médicament des populations défavorisées n’est pas assuré ?
La réponse du Gouvernement est attendue par de nombreuses associations, qui m’ont sollicitée, comme elles ont dû saisir un certain nombre de parlementaires. Elles se demandent comment elles pourront poursuivre leur mission, qui consiste à envoyer des médicaments aux pays qui en ont besoin.
Madame la sénatrice, vous appelez l’attention de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, dont je vous prie d’excuser l’absence aujourd'hui, sur les inquiétudes des organisations non gouvernementales concernées par la mise en œuvre de l’interdiction de disposer des médicaments non utilisés, les MNU, entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Il faut tout d’abord rappeler que cette interdiction était nécessaire. Elle a été préconisée tant par un rapport de l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS, du mois de janvier 2005 que par une recommandation de l’Organisation mondiale de la santé. En effet, outre les risques liés à la rupture de la chaîne pharmaceutique, les MNU exportés constituent un danger potentiel, principalement en raison de leur inadaptation fréquente aux besoins, du risque de détournement qu’ils présentent et de l’obstacle qu’ils peuvent constituer à la mise en place des politiques nationales de santé.
Le Gouvernement est tout à fait conscient de l’effet important de cette décision d’interdiction sur l’organisation des associations humanitaires s’approvisionnant en MNU pour mener, en France comme dans les pays en développement, l’aide médicale au profit des populations défavorisées qu’elles exercent habituellement. Il partage naturellement les préoccupations de ces associations.
Afin de respecter l’engagement pris par les précédents ministres de la santé, le Premier ministre a décidé de prendre des mesures comportant deux volets, l’un international, l’autre national.
Ces mesures font suite aux travaux du groupe de travail mis en place au mois de juin 2007 par la direction générale de la santé, en lien avec le ministère des affaires étrangères et européennes, la direction générale de l’action sociale, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les entreprises du médicament et les représentants de la filière pharmaceutique – ordre des pharmaciens, grossistes et pharmaciens d’officine –, afin d’accompagner les principales associations vers de nouvelles sources d’approvisionnement en médicaments, pérennes, rationalisées, mieux adaptées et sécurisées.
À l’échelon international, il est nécessaire d’intégrer ce travail à la politique de coopération internationale de notre pays, qui a énormément évolué ces dernières années. La politique française appuie les pays en développement dans la mise en place de politiques pharmaceutiques nationales, dans le renforcement de leurs capacités à mieux acheter, notamment par un appui à l’Association africaine des centrales nationales d’achat de médicaments essentiels, qui regroupe environ vingt pays d’Afrique subsaharienne. Cette association a conduit de nombreuses actions de formation dans le but d’améliorer les procédures d’appels d’offres internationaux, la gestion de la chaîne du médicament, la logistique liée à l’approvisionnement des structures de soins, l’harmonisation des statuts des différentes centrales d’achat, de façon à promouvoir leur capacité de gestion autonome et de rendre leurs actions plus transparentes vis-à-vis des donateurs en médicaments essentiels.
Dans ce cadre, le ministère des affaires étrangères et européennes a rencontré récemment les organisations non gouvernementales concernées. Il les a invitées notamment à présenter à l’Agence française du développement, organisme sous sa tutelle, des demandes de subventions pour des projets bien identifiés, qui doivent émaner des pays demandeurs, et pouvant inclure une composante « dons de médicaments ». Ces projets devront respecter les bonnes pratiques de dons de médicaments prévues par un arrêté du 18 août 2008.
Pour ce qui est des besoins nationaux, le Premier ministre a décidé de soutenir la mise en place d’un dispositif de remplacement des MNU, afin de permettre aux organisations non gouvernementales de continuer leur travail d’aide médicale et de dispensation aux populations les plus démunies et trop désocialisées pour consulter un médecin ou entrer dans une pharmacie, nonobstant le bénéfice d’une protection sociale.
Une convention a ainsi été conclue au mois de décembre dernier entre la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés et l’association Pharmacie humanitaire internationale, afin de financer, à hauteur de 3 millions d’euros, la mise en place par Pharmacie humanitaire internationale d’une procédure d’approvisionnement pérenne opérationnelle au 1er janvier 2009, incluant fourniture de médicaments et logistique, dans des conditions offrant un circuit pharmaceutique sécurisé de distribution et de dispensation.
Le ministère de la santé et des sports a prévu un dispositif juridique permettant d’encadrer, dans un souci de sécurité sanitaire, les modalités de délivrance de médicaments par les structures de soins aux personnes en situation de précarité gérées par des associations caritatives.
Ces structures sont autorisées par la loi du 15 avril 2008 à délivrer des médicaments, après déclaration préalable auprès du représentant de l’État dans le département. Le décret d’application du 18 août 2008 relatif à la distribution humanitaire de médicaments précise les conditions de délivrance de médicaments par ces structures de soins sous la responsabilité d’un pharmacien ou, à défaut, d’un médecin.
Enfin, le ministère de la santé et des sports a conclu une convention de partenariat avec Réseau médicaments et développement, qui s’appuie sur de nombreux partenaires dans le milieu associatif. Un financement associé a permis l’engagement d’actions d’information des petites associations françaises de solidarité internationale, utilisant occasionnellement des MNU sans être spécialisées dans le médicament.
Madame la sénatrice, j’espère que cette réponse circonstanciée vous satisfera, ainsi que les associations concernées.

Si je peux concevoir le point de vue de l’IGAS – nous avons d’ailleurs eu, dans cette enceinte, un débat sur le recyclage des médicaments, en janvier 2007 – j’estime cependant que cette instance se réveille un peu tard : voilà longtemps que les médicaments recyclés étaient envoyés dans les pays qui en sont privés.
Par ailleurs, si un certain nombre de procédures sont mises en place, les associations n’ont pour l’instant aucune garantie que, demain ou dans les prochains mois, elles pourront faire parvenir des médicaments neufs à ces pays, tout en bénéficiant de subventions.

La parole est à Mme Patricia Schillinger, en remplacement de M. Michel Teston, auteur de la question n° 332, adressée à M. le secrétaire d'État chargé des transports.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, M. Michel Teston ne pouvant être présent ce matin en raison d’un problème de transport – il s’agit en l’occurrence du retard de nombreux trains au départ de la gare de Lyon Part-Dieu –, il vous prie de bien vouloir l’en excuser et m’a demandé de bien vouloir poser sa question à sa place
Les débats du Grenelle de l’environnement ont confirmé la nécessité de développer des modes alternatifs au transport routier.
L’objectif a été fixé d’augmenter, d’ici à 2012, la part du fret ferroviaire de 25 %. Réseau ferré de France, RFF, a ainsi défini un certain nombre de corridors de fret où le trafic pourrait fortement augmenter au cours des prochaines décennies, grâce à des trains plus nombreux, plus longs et forcément plus bruyants. C’est notamment le cas de la ligne de la rive droite du Rhône entre Lyon et Nîmes, particulièrement si le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise par l’Est est réalisé.
M. Teston appelle l’attention du Gouvernement et de RFF sur le fait que cette ligne passe au cœur de villes et de villages, notamment lorsqu’elle traverse l’Ardèche. Elle comporte, en outre, de nombreux passages à niveau, dont six au moins en Ardèche sont dits « préoccupants » par le ministère des transports, eu égard à des critères de dangerosité.
Aussi, l’augmentation du trafic fret sur cette ligne ne pourra être acceptée par les riverains que si d’importants aménagements de sécurité sont réalisés, à savoir la suppression des passages à niveau dits « préoccupants », la pose dans toutes les zones géographiques urbanisées de protections phoniques et d’un troisième rail diminuant les risques de renversement des wagons en cas de déraillement – ce sont d’ailleurs deux mesures nécessaires dès à présent –, ainsi que l’installation d’un nombre plus important de détecteurs de boîtes chaudes mesurant la température des essieux.
Enfin, la priorité donnée au fret sur cette ligne ne doit pas interdire la réouverture éventuelle de cette dernière au trafic de voyageurs, comme le souhaitent le conseil général de l’Ardèche et la région Rhône-Alpes.
Pour cela, il est indispensable que le trafic fret soit à l’avenir équitablement réparti entre cette ligne et la ligne classique de la rive gauche du Rhône, où de nombreux sillons ont été libérés depuis la mise en service de la ligne à grande vitesse Méditerranée.
M. Michel Teston souhaite donc savoir si le Gouvernement et RFF sont en mesure d’apporter des garanties quant à la prise en compte de l’ensemble de ces préoccupations.
Madame le sénateur, à mon tour, je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de mon collègue M. Dominique Bussereau, en déplacement avec le Président de la République dans le département du Val-d’Oise. Je vous répondrai donc à sa place.
Comme vous l’avez rappelé, le Grenelle de l’environnement a dégagé une dynamique forte en faveur des modes non routiers pour le transport de marchandises. Des objectifs volontaristes de report modal ont été affichés.
Le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, que vous examinez actuellement, mesdames, messieurs les sénateurs, prévoit en effet de mobiliser des moyens importants pour augmenter la part du non-routier – fer et voie d’eau – de 25% d’ici à 2012. Dans ce cadre, le principe d’un réseau ferroviaire assurant la priorité au fret a été posé pour garantir les capacités et la qualité des sillons dont le fret a besoin.
La vallée du Rhône constitue le principal axe de transport de marchandises en France par lequel transitent de forts volumes et grâce auquel de longues distances sont parcourues. C’est un axe stratégique pour le développement du fret ferroviaire.
Pour faire face à la progression attendue des trafics ferroviaires, les deux lignes « classiques » longeant le Rhône ont été intégrées dans ce réseau accordant la priorité au fret. La ligne située sur la rive droite est, comme vous l’avez rappelé, madame le sénateur, utilisée exclusivement par le transport de marchandises.
La sécurité du transport ferroviaire constitue un atout et doit rester une valeur cardinale de ce mode de transport. C’est pourquoi le Gouvernement a lancé un plan d’action pour sécuriser les passages à niveau les plus dangereux. Les investissements en faveur de la sécurité du réseau ferroviaire approcheront ainsi les 450 millions d’euros au cours des cinq années à venir.
Par ailleurs, Réseau ferré de France vient d’engager avec les collectivités locales les études en vue de la sécurisation de la ligne de la rive droite du Rhône, afin de concilier le développement du trafic et la sécurité.
Je souhaite vous rassurer, madame le sénateur, à propos de la prise en compte des préoccupations des élus ardéchois qui demandent la réouverture du trafic de voyageurs sur cette ligne.
Des expérimentations de mixité de circulation du fret et des TER sur cet axe vont être engagées prochainement pour une période de trois ans. Un bilan de ces expérimentations et des trafics concernés permettra de tirer les conséquences nécessaires du point de vue du développement de cet axe.

Je remercie M. le ministre de sa réponse. Néanmoins, mon inquiétude demeure : le fait qu’une expérimentation soit prévue signifie que rien n’a encore été fait en matière de sécurité. J’espère qu’aucun incident ne sera à déplorer au cours des trois prochaines années sur la ligne en cause.

M. le président. Il y a encore le petit train du Vivarais et, dans une autre région, le train des Pignes ; mais cela coûte vraiment cher aux collectivités territoriales !
Sourires

La parole est à M. Gérard César, auteur de la question n° 382, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Au mois de mars 2008, j’ai interrogé M. le ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire sur le financement des installations de collecte et de traitement des eaux usées. J’ai appelé particulièrement son attention sur le désengagement de l’agence de bassin Adour-Garonne qui obligeait les communes à ajourner leurs projets.
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire d’État chargé de l’écologie, m’a répondu avoir donné des instructions aux agences de bassin en vue de financer ces installations. Un emprunt de 2 milliards d’euros devait alors être souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
À ma connaissance, ce prêt à taux préférentiel – il devait être consenti à taux zéro – n’est toujours pas mis à la disposition des agences. De ce fait, les communes et les syndicats intercommunaux ne peuvent terminer aussi rapidement qu’ils le voudraient les travaux de raccordement aux stations d’épuration. La situation est la même pour d’autres collectivités qui envisagent de mettre leurs installations aux normes.
Le conseil général de la Gironde ne peut à lui seul suppléer le désengagement de l’agence Adour-Garonne, cette dernière apportant un complément de financement non négligeable.
À l’heure où le Sénat examine le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il me paraît important que les communes, quelle que soit leur taille, puissent rapidement mettre leurs installations aux normes européennes.
Par ailleurs, le plan de relance du Gouvernement pourrait selon moi être l’occasion d’accorder le financement nécessaire aux agences de bassin.
Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de bien vouloir faire le point sur ce sujet, de nous indiquer les raisons du retard pris par ce dossier et de nous donner quelques espérances pour ce qui concerne son financement.
Monsieur le sénateur, vous avez bien voulu attirer l’attention de M. Jean-Louis Borloo, ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sur le financement des installations de collecte et de traitement des eaux usées dans le bassin Adour-Garonne.
L’agence Adour-Garonne met en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour réaliser le programme de mise en conformité des stations d’épuration à la directive européenne relative au traitement des eaux résiduaires urbaines. Cette mise en conformité est une priorité du Gouvernement, qui s’est engagé auprès de la Commission européenne à obtenir l’achèvement des travaux dans des délais stricts, inscrits dans le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, que la Haute Assemblée examine actuellement, mesdames, messieurs les sénateurs.
Un prêt de la Caisse des dépôts et consignations aux agences de l’eau, proposé par le Gouvernement, devrait donner à ces dernières des moyens supplémentaires nécessaires pour aider les collectivités territoriales à respecter leurs engagements contractualisés avec l’État et pour passer le pic d’investissements.
Comme M. Jean-Louis Borloo l’avait annoncé, un projet de convention-cadre d’un montant de 2 milliards d’euros a été soumis aux agences de l’eau. À cette occasion, il a été demandé à ces dernières d’évaluer précisément leurs besoins de financement complémentaires. À la suite de ces évaluations, le montant du prêt a été fixé à la hauteur demandée, soit 1, 5 milliard d’euros. Cette somme permettra de financer en métropole et outre-mer, d’une part, les travaux d’assainissement, et, d’autre part, les futurs travaux de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
La convention a maintenant été adoptée par l’ensemble des conseils d’administration des agences de l’eau. Elle sera signée le 20 février prochain, en présence du ministre d’État. Ainsi, les moyens rendus disponibles pourront être mobilisés par les agences de l’eau dès le mois de mars 2009.

Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie de cette annonce, attendue avec beaucoup d’impatience par les collectivités qui ont lancé des programmes de stations d’épuration mais n’ont pas aujourd'hui les moyens de financer les travaux de raccordement à ces stations. J’espère que le prêt de 1, 5 milliard d’euros sera consenti à taux zéro, afin que les syndicats intercommunaux et les communes puissent financer leurs travaux.

La parole est à M. Jean-Pierre Bel, auteur de la question n° 402, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question se situe dans le droit-fil de celle que vient de poser notre collègue Gérard César sur les surcoûts que doivent aujourd'hui supporter les collectivités.
Je voudrais attirer votre attention, monsieur le secrétaire d’État, sur la prise en charge par les collectivités des coûts de renforcement du réseau de distribution publique d’électricité.
Depuis le 1er janvier dernier, certains gestionnaires du réseau de distribution publique d’électricité, notamment ERDF, peuvent mettre en application un nouveau dispositif de financement des raccordements, appelé à remplacer la facturation selon le système forfaitaire du « ticket ». L’abandon de ce mode de tarification au « ticket », devenu illégal au regard de la loi « Urbanisme et habitat » du 2 juillet 2003 et du décret du 28 août 2007 précisant les modalités de facturation des branchements et des extensions, rend désormais la commune débitrice de la contribution relative aux travaux réalisés dans le cadre d’une opération d’urbanisme.
Ainsi, toute nouvelle demande de raccordement d’une opération d’urbanisme autorisée qui nécessite une extension ou un renforcement du réseau électrique, voire les deux opérations, doit faire l’objet d’une prise en charge financière par la collectivité. Cela conduit à opérer un transfert des coûts liés aux travaux de renforcement aux dépens des finances de nos collectivités.
Si les dispositions de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité distinguent clairement les notions d’extension et de renforcement, a contrario le décret du 28 août 2007 définit la notion d’extension par référence à des ouvrages « créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de raccordement et nouvellement créés dans le domaine de tension supérieur », incluant du même coup, à tort selon moi, les renforcements.
Cette définition d’ordre réglementaire a pour effet, selon l’expression employée par la Commission de régulation de l’énergie dans son avis du 23 mai 2007, « d’élargir considérablement le périmètre de facturation des raccordements », c’est-à-dire d’alourdir les charges pesant sur le budget des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
Un tel régime de facturation est de nature à grever les finances des collectivités locales, notamment rurales, à un moment où celles-ci sont déjà mises à rude épreuve, comme chacun ici peut en témoigner et comme je le constate dans le département dont je suis l’élu.
Aussi, monsieur le secrétaire d'État, si ce décret devait être appliqué tel quel, il conduirait à facturer deux fois les coûts de renforcement : d’une part, via le tarif d’acheminement que tout usager acquitte à travers sa facture d’électricité, et, d’autre part, via le budget de la collectivité, donc le contribuable local, voire le pétitionnaire, selon les cas.
Fort de ce constat, monsieur le secrétaire d'État, comment le Gouvernement compte-t-il modifier des dispositions qui, je le répète, viennent alourdir les budgets des collectivités territoriales alors qu’une conjoncture difficile impose justement que celles-ci possèdent tous les moyens financiers nécessaires pour agir efficacement ?
Monsieur le sénateur, les modalités de raccordement des consommateurs aux réseaux électriques, en particulier le mode de financement, ont été mises en conformité avec les dispositions du code de l’urbanisme issues des lois « Solidarité et renouvellement urbains » et « Urbanisme et habitat ».
Ces nouvelles dispositions, qui ont vocation à s’appliquer aux autorisations d’urbanisme déposées après le 1er janvier 2009, prévoient, conformément au code précité, la prise en charge financière d’une partie – en l’occurrence 60 % – des travaux d’extension par la collectivité qui délivre l’autorisation d’urbanisme ; les 40 % restants sont pris en charge par les tarifs d’utilisation des réseaux, et donc mutualisés entre les consommateurs à l'échelle nationale.
Compte tenu des conséquences financières qu’entraînent ces dispositions pour les collectivités, il convenait de définir précisément la consistance d’une opération d’extension du réseau électrique dans le cadre du raccordement d’un nouveau consommateur. Tel est l’objet du décret du 28 août 2007, que vous avez mentionné, monsieur le sénateur.
Vous signalez une divergence d’appréciation, de la part des collectivités débitrices de la contribution, quant à la qualification, par le décret, de certains travaux d’extension, que vous considérez plutôt comme des renforcements de réseaux électriques. Ces travaux auraient alors vocation à être pris en charge intégralement par le tarif d’utilisation des réseaux.
Ce sujet mérite une attention rigoureuse dans la mesure où il détermine, en définitive, le montant de la contribution due par la collectivité.
La frontière entre, d’une part, les travaux d’extension, liés directement ou indirectement à une opération d’urbanisme, et, d’autre part, les travaux de renforcement des réseaux doit être clarifiée entre tous les acteurs : les collectivités et leurs représentants, les gestionnaires de réseaux, les services du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire et la Commission de régulation de l’énergie, qui est la gardienne des tarifs de transport et de distribution.
Cette question – cela n’aura échappé à personne ! – est par nature très technique. Elle a d’ailleurs été soulevée lors du dernier Conseil supérieur de l’énergie, le 20 janvier 2009. Le président de ce dernier, M. le député Jean-Claude Lenoir, a indiqué qu’il comptait demander au ministre d’État, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire la mise en place d’un groupe de travail.
Compte tenu de la complexité de ces questions, le ministre d’État est favorable à cette proposition. Il a chargé ses services de constituer, en lien avec le Conseil supérieur de l’énergie, un groupe de travail réunissant toutes les parties intéressées, afin de trouver dans les meilleurs délais une solution consensuelle à cette question technique difficile.

Monsieur le secrétaire d'État, votre réponse laisse ouvertes bien des portes. Elle permettra peut-être d’apporter des solutions au problème que j’ai soulevé, et elle me satisfait donc partiellement.
J’espère que le groupe de travail chargé de traiter cette question très technique prendra en compte la difficulté que nous éprouvons à distinguer les travaux d’extension des travaux de renforcement, comme vous l’avez vous-même souligné. Surtout, je souhaite qu’il apporte des solutions au problème posé aux collectivités territoriales.
Si tel n’était pas le cas – j’attire votre attention sur ce point, monsieur le secrétaire d'État –, nous serions en contradiction avec les orientations du Grenelle de l’environnement, aux termes desquelles le renforcement des réseaux existants participe à la densification de l’habitat et à la lutte contre l’étalement urbain. Si nous ne permettons pas aux communes de répondre à cette nécessité, qui s’impose à tous, nous contredirons la volonté exprimée par le Grenelle !
Toutefois, votre réponse contient, me semble-t-il, des éléments susceptibles de résoudre dans l’avenir cette question qui est technique, mais aussi politique, et importante pour nos collectivités territoriales.

La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 393, adressée à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.

Madame le secrétaire d'État, cette question, que j’avais adressée à M. le ministre chargé du travail, entre tout à fait dans le champ de vos compétences. Elle concerne la possibilité pour les conseils généraux de percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH, attribuée aux mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE.
Cette allocation, introduite par la loi du 11 février 2005, est destinée à compenser le surcoût causé par le handicap dans l’éducation et la scolarisation de certains mineurs. Lorsque ces derniers ont été confiés au président du conseil général, par le biais de son service de l’aide sociale à l’enfance, le surcoût est à la charge du budget départemental, à travers des indemnités de sujétions exceptionnelles versées aux assistantes familiales ou aux lieux de vie, telles que des frais exceptionnels de transport, voire des équipements particuliers pour la prise en charge du handicap.
Actuellement, et selon des directives de la CNAF, la caisse nationale d’allocations familiales, cette prestation n’est pas versée aux départements au motif que l’accueil à l’ASE est « assimilé à un internat pris en charge par l’État, l’assurance maladie ou l’aide sociale », conformément à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
L’application de ces dispositions au cas d’enfants confiés à l’ASE est étonnante, dans la mesure où l’AEEH est une prestation familiale non soumise à condition de ressources, et où, à ce titre, elle devrait être versée à ceux qui ont la charge du mineur, comme les allocations familiales proprement dites, selon l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, l’aide sociale doit toujours être considérée comme substitutive au droit commun et, en l’espèce, au régime de sécurité sociale.
Enfin, l’article R. 541-1 du code de la sécurité sociale précise les conditions de l’orientation en internat, qui est « accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’État, soit par l’aide sociale à l’enfance sur décision de la commission pour le droit et l’autonomie des personnes handicapées ».
Ces dispositions ne concernent pas le cas de l’orientation vers l’aide sociale à l’enfance.
Aussi, madame la secrétaire d'État, quelles mesures entendez-vous adopter pour que les conseils généraux ne supportent pas indûment et sans compensation – une fois de plus ! – une charge relevant des régimes de sécurité sociale, et pour qu’ils puissent, à ce titre, percevoir l’AEEH ?
Monsieur le sénateur, comme vous le savez, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est une prestation familiale. Or, à ce titre, elle ne peut être versée qu’à la personne physique assumant la charge effective et permanente de l’enfant.
Ainsi, la qualité d’allocataire, personne physique, ne peut être reconnue aux services de l’aide sociale à l’enfance, personne morale. C’est la raison pour laquelle l’AEEH ne peut être versée aux services de l’ASE.
Comme vous l’avez rappelé, il n’existe qu’une seule dérogation à cette règle : les allocations familiales versées à la famille pour l’entretien de l’enfant.
Pourquoi cette exception ? Parce que les parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leur enfant et que, en application de cette obligation, leur participation aux frais d’entretien de l’enfant placé ne peut être inférieure à la part des allocations familiales auquel celui-ci ouvre droit.
Par ailleurs, une règle vient renforcer cette impossibilité : l’AEEH ne pourrait être versée aux enfants accueillis dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance parce qu’elle ne peut être attribuée aux enfants pris en charge en internat, comme vous l’avez rappelé, les charges liées au handicap de l’enfant étant alors incluses dans le budget de fonctionnement de l’établissement.
Au surplus, il est difficile de considérer qu’il s’agit, pour les départements, d’une charge indue : l’extension de la prestation de compensation du handicap aux enfants, effective depuis avril 2008, donne compétence aux conseils généraux pour intervenir dans le domaine de la compensation du handicap pour les enfants.
Nous sommes donc engagés dans une phase de transition entre la PCH, la prestation de compensation du handicap, et l’AEEH. Dans un second temps, l’AEEH a vocation à être remplacée progressivement par la prestation de compensation du handicap « enfants », dont bénéficieront tous les enfants concernés.
Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, et compte tenu en particulier des difficultés que votre proposition susciterait pour les enfants placés en internat, le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ces dispositions. Je le répète, nous sommes engagés dans un régime transitoire, qui vise à transformer l’AEEH en PCH « enfants ».

Il est dommage que le Gouvernement ne puisse suivre nos propositions, mais c’est ainsi !

La parole est à Mme Nicole Bricq, auteur de la question n° 378, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Madame la secrétaire d’État, je souhaite ce matin vous interroger sur les moyens qui sont affectés par l’État aux ESAT, les établissements et services d’aide par le travail, notamment lors de leur ouverture.
Vous connaissez mieux que moi encore les paroles fortes prononcées par le Président de la République qui, le 10 juin 2008, lors de la conférence nationale du handicap, faisait du droit à l’emploi la composante fondamentale de la citoyenneté des personnes handicapées.
Le programme « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » vise à augmenter la capacité d’accueil dans le secteur protégé, à un rythme de 1 400 créations de places chaque année dans les établissements et services d’aide par le travail.
Pourtant, qu’il s’agisse du soutien aux structures existantes ou des créations en suspens, nous constatons que les moyens ne suivent pas.
En Seine-et-Marne, département dont je suis l’élue, ce sont plusieurs ouvertures d’ESAT qui restent bloquées, paralysant ainsi le travail des associations et des élus, lesquels se sont engagés fortement dans cette action et en ont fait l’une de leurs priorités, compte tenu des nombreuses demandes qu’ils reçoivent. Naturellement, cette situation suscite la déception des familles.
J’évoquerai un cas quelque peu emblématique, dans le sud du département de la Seine-et-Marne, celui de Champagne-sur-Seine, où toutes les conditions sont pourtant réunies pour avancer.
La fondation Léopold Bellan, acteur associatif reconnu et expérimenté, travaille de longue date avec la municipalité, qui a intégré ce projet d’ESAT dans sa politique de renouvellement du tissu économique fragilisé de la commune.
En effet, cette ville, comme toute la vallée en amont de la Seine où de nombreuses industries étaient autrefois implantées, a beaucoup souffert des restructurations économiques. Son tissu urbain et économique doit donc être renouvelé.
En mai 2007 – j’insiste sur cette date ! –, le projet a reçu un avis favorable du CROSMS, le comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, d’Île-de-France. Pourtant, le dossier a pris un retard considérable, alors que les demandes d’intégration sont nombreuses.
Il existe donc un décalage très important entre les autorisations délivrées par les administrations compétentes et les budgets qui devraient leur correspondre.
Madame la secrétaire d'État, ma question découle de ce constat : quelles actions envisagez-vous pour résorber ce décalage et, plus précisément, pour répondre à l’initiative prise par les élus et les associations à Champagne-sur-Seine ?
Madame la sénatrice, vous savez tout l’attachement du Gouvernement – vous l’avez d’ailleurs rappelé – à l’outil original que constituent les établissements et services d’aide par le travail, les ESAT. Grâce à la combinaison, unique en Europe, d’une activité à caractère professionnel et d’un accompagnement médico-social, ils permettent à des personnes dont la capacité de travail est faible de s’épanouir dans une forme d’activité correspondant à leurs possibilités.
Avec 116 811 places financées et plus de 2 milliards d’euros consacrés au fonctionnement de ces structures et à la rémunération des personnes handicapées qu’elles accueillent, l’État apporte un soutien important aux ESAT.
Depuis mon arrivée au Gouvernement, 6 900 places nouvelles ont été financées pour un montant total de 103 millions d’euros et, dans le cadre du plan de créations de places annoncé par le Président de la République le 10 juin dernier, 10 000 places supplémentaires seront financées.
Vous appelez plus précisément mon attention sur le projet d’ESAT porté par la fondation Léopold Bellan. Ce projet est effectivement intéressant, d’autant plus que l’activité envisagée s’inscrit dans la filière de l’écologie et du développement durable. Son financement est programmé pour 2009.
Vous avez raison sur un point, madame la sénatrice : notre procédure de programmation et d’autorisation de places nouvelles n’est plus satisfaisante. En effet, les porteurs de projet ne savent pas, au moment où ils déposent leur dossier, si leur projet s’inscrit bien dans l’approche collective des besoins et les choix stratégiques des pouvoirs publics et s’il a une chance d’être financé. Comme vous l’avez rappelé, même lorsqu’il obtient l’avis favorable du comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale, le CROSMS, il n’est pas aujourd’hui assuré d’être retenu et financé.
C’est bien la raison pour laquelle Roselyne Bachelot-Narquin et moi-même avons décidé de réformer cette procédure dans le cadre du projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires ».
Le CROSMS sera supprimé et remplacé par une procédure d’appel à projet permettant de sélectionner les meilleurs projets grâce à une programmation concertée avec l’ensemble des acteurs. Les dossiers retenus pourront alors être autorisés et financés sans délais.
Vous avez évoqué la situation actuelle, madame la sénatrice. Effectivement, aujourd’hui, l’avis rendu par le CROSMS sur un dossier ne peut être qu’un avis de principe si le volume des projets présentés est dix ou quinze fois supérieur à l’enveloppe financière et aux besoins constatés. Il peut être favorable d’un point de vue technique, mais ne déboucher sur aucune autorisation de financement.
Comme vous l’indiquez, il n’y a donc pas d’adéquation entre les besoins, le montant des financements et les demandes des porteurs de projet. Par exemple, on peut trouver, sur un même territoire, dix projets de création d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et un projet de service de soins infirmiers, alors que les besoins sont inverses. Il existe alors un décalage certain entre les projets portés et les besoins effectifs.
Le projet de loi « Hôpital, patients, santé et territoires » a bien pour objectif de mettre en adéquation ces deux éléments. Les projets retenus lors des appels à projet seront financés parce qu’ils correspondront réellement aux besoins et à l’enveloppe budgétaire nécessaire à la satisfaction de ces besoins.
Comme vous le voyez, madame la sénatrice, l’engagement que le Gouvernement a pris pour améliorer l’offre de places en ESAT et, plus largement, pour accélérer la création de places dans le secteur médico-social est en train de se concrétiser. Nous avons bon espoir non seulement de continuer à répondre à l’appel des porteurs de projets, mais surtout de le faire dans un délai plus court et en répondant mieux aux besoins des territoires.

Je note que, s’agissant du point précis de Champagne-sur-Seine, vous annoncez une réalisation pour 2009. Nous sommes déjà en février…

Je vérifierai, avec le maire de Champagne-sur-Seine, que vous tiendrez parole, et j’espère que vous le ferez dans le courant du premier semestre. Cela fera tout de même deux ans de retard pour ce projet !
Par ailleurs, je note que la procédure sera réformée à l’avenir. Le cas que j’ai évoqué est effectivement emblématique, madame la secrétaire d’État. §Si vous interrogez certains de mes collègues, ils vous feront part des mêmes interrogations. Ces évolutions seront donc profitables aux nouveaux projets, mais il existe tout un stock de projets à gérer.

Au moment où plusieurs dizaines, voire des centaines de milliards d’euros sont injectés dans l’économie – c’est en tout cas ce que l’on nous dit ! –, l’effort que vous déclarez avoir fourni en faveur des ESAT porte sur une petite centaine de millions d’euros. Alors, vraiment, s’il s’agit d’une priorité, l’effort doit être très manifeste en 2009 ! Cela participera aussi à l’emploi et au soutien des personnes handicapées.

La parole est à M. Claude Jeannerot, auteur de la question n° 381, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Madame la secrétaire d’État, à l’instar de mon collègue Alain Fouché, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés rencontrées par les conseils généraux en matière de financement de la prise en charge du handicap.
En effet, les moyens mobilisés par la loi de finances pour 2009 dans ce domaine s’avèrent tout à fait insuffisants.
Dans la réalité, comme vous le savez, les collectivités territoriales sont contraintes de financer sur leurs ressources propres, c’est-à-dire sur l’impôt local, des politiques qui relèvent de la solidarité nationale. Vous comprendrez que cette situation met en péril ces politiques.
À cet égard, deux points retiennent tout particulièrement mon attention.
En premier lieu, aucun crédit n’a été prévu par la loi de finances pour 2009 afin d’abonder les fonds départementaux de compensation du handicap, qui, je le rappelle, ont été créés par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Cela s’étant déjà produit en 2008, c’est donc la deuxième année consécutive que, dans nombre de départements, ces fonds seront principalement financés par les conseils généraux. C’est notamment le cas dans mon département, le Doubs.
Vous conviendrez pourtant avec moi, madame la secrétaire d’État, que les départements ont relevé avec efficacité le défi de la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées. Or, depuis 2005, force est de reconnaître que la dotation de l’État s’est chaque année révélée insuffisante.
Dans un tel contexte, il va devenir impossible pour les départements de prendre en compte certains besoins en raison de leur coût. Je pense notamment – ce n’est qu’un exemple – à l’interprétariat et à l’interface en faveur des enfants sourds dans le cadre de leur scolarité.
C’est pourquoi je veux attirer votre attention sur deux points. D’une part, il faut maintenir toutes les dotations et compensations de l’État consacrées au financement des maisons départementales des personnes handicapées. D’autre part, il est impératif que l’État verse les crédits correspondants aux besoins réels de ces structures, notamment pour pouvoir stabiliser leurs activités initiales.
En second lieu, un décret tendant à plafonner le versement aux départements des montants qu’ils ont réellement dépensés dans le cadre de la prestation de compensation du handicap avait été envisagé. Les sommes ainsi dégagées seraient susceptibles d’être attribuées à la vingtaine de départements pour lesquels le montant des dépenses cumulées est supérieur aux recettes versées par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Il aurait été indispensable de tout mettre en œuvre pour que ce décret puisse être signé et publié avant la fin de l’année 2008.
Je prends l’exemple de mon département, madame la secrétaire d’État. La charge nette du département du Doubs au titre de la compensation des déficiences passera de 6 millions d’euros à la fin de l’année 2005 à 11 millions d’euros pour l’exercice 2010.
Or, il n’existe aucune garantie que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie abonde les crédits de manière à compenser cette évolution de la charge pour les départements. Par conséquent, je souhaite que le montant de la recette versée par cette caisse au titre de la prestation de compensation du handicap soit corrigé de manière à prendre en compte l’effort global des conseils généraux pour les prestations de maintien à domicile et la création de places en services et en établissements spécialisés.
En résumé, madame la secrétaire d’État, je vous demande de nous informer des mesures que vous envisagez de prendre pour corriger ces situations d’iniquité.
Monsieur le sénateur, la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées avait prévu la création des fonds départementaux de compensation du handicap afin de préserver la mutualisation des aides extra-légales qui était opérée jusqu’alors par les sites pour la vie autonome et qui permettait la prise en charge de techniques ou d’aménagements du logement particulièrement coûteux.
L’État a joué le jeu de cette mutualisation, puisqu’il a participé, en 2006 et en 2007, à l’abondement des fonds à hauteur de 14 millions d’euros pour chacune de ces années.
Mais l’État a également la responsabilité des deniers publics ! Le bilan de l’activité des fonds, réalisé à la fin de 2007 et, à nouveau, à la fin de 2008, ayant montré un excédent global de ces derniers, il a donc décidé de faire une pause dans leur abondement.
Toutefois, le Gouvernement est conscient du fait que la participation de l’État à ces fonds a un effet de levier important sur la participation d’autres financeurs. C’est la raison pour laquelle il souhaite intégrer l’abondement des fonds au règlement financier global qui accompagnera l’évolution du statut des maisons départementales des personnes handicapées prévue dans le cadre du projet de loi sur le « cinquième risque ».
Vous avez également appelé mon attention sur le concours que la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse aux conseils généraux afin d’aider ces derniers à financer la nouvelle prestation de compensation du handicap, la PCH.
Vous soulignez à juste titre que ce concours a été, depuis l’origine, très supérieur aux dépenses réelles des conseils généraux, compte tenu d’une montée en charge très progressive de la prestation. Au total, les départements disposent d’un excédent de près de 700 millions d’euros au titre du financement de cette prestation.
Une réflexion a bien été conduite pour plafonner le versement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à hauteur des dépenses qui sont réellement engagées par les conseils généraux. Mais nous avons rapidement conclu que le principe de libre administration des collectivités locales s’opposait à une récupération de ces excédents.
Pour autant, je vous rejoins sur un point, monsieur le sénateur. Il est sans doute nécessaire de revoir à l’avenir les critères de répartition de l’enveloppe consacrée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie à la prestation de compensation du handicap, afin de les faire davantage coïncider avec les charges réelles des départements.
Une expertise a été menée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et les services de l’État à ce sujet. Elle nous conduira à proposer une disposition qui pourrait, une fois de plus, être intégrée au projet de loi sur le « cinquième risque ». Celui-ci comprendra effectivement tout un volet sur le handicap, particulièrement sur le statut et le financement global des maisons départementales des personnes handicapées, sur le statut de leurs personnels, mais aussi sur l’ensemble de la problématique que je viens d’évoquer dans la seconde partie de mon propos.
Comme vous pouvez le constater, monsieur le sénateur, le Gouvernement est particulièrement vigilant sur l’ensemble des sujets qui touchent à la compensation du handicap. Après trois ans de mise en œuvre de la loi de 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, nous opérons une évaluation à mi-parcours et nous procéderons à tous les ajustements qu’exige nécessairement une loi aussi ambitieuse.
Nous sommes toutefois attentifs à toutes les préconisations qui viennent d’être exprimées.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, pour les perspectives d’ouverture que vous avez bien voulu nous donner.
Je note que le projet de loi qui est en préparation sur le « cinquième risque » porte les deux préoccupations dont je viens de faire état. Mais je veux simplement souligner qu’il faut absolument éviter le développement sur nos territoires de situations d’iniquité.
Mme le secrétaire d’État acquiesce.

J’insiste sur ce point : il est totalement anormal que les départements soient aujourd’hui contraints de relayer la solidarité nationale. S’agissant de la seconde problématique, en particulier, certains départements se trouvaient en situation excédentaire alors que d’autres manquaient de fonds pour pouvoir s’acquitter de cette mission de première nécessité. Il n’est pas normal qu’une telle situation perdure !

En tout cas, j’ai noté avec beaucoup d’intérêt les assurances que vous avez données pour l’avenir. Je souhaite bien sûr que ce texte puisse être examiné le plus tôt possible par notre assemblée, puis que ses dispositions soient rapidement mises en œuvre.

La parole est à Mme Catherine Procaccia, auteur de la question n° 395, adressée à Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité.

Madame la secrétaire d'État, ma question porte sur la pérennité du service de néonatalogie de l’hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne, service qui revêt une grande importance pour toute une partie du Val-de-Marne.
L’hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne est un établissement participant au service public hospitalier, ou EPSPH. Situé à une extrémité du Val-de-Marne, il accueille la population du nord de ce département, ainsi que celle de départements limitrophes, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.
Je tiens à préciser que cet établissement hospitalier est implanté dans un lieu assez particulier du Val-de-Marne : il est en effet coupé du reste de ce département par l’autoroute A4 et par la Marne, soit deux barrières difficiles à traverser. Cette situation particulière mérite d’être soulignée, cet hôpital devant assurer un service d’accueil des urgences.
Je citerai quelques chiffres pour illustrer l’activité de l’hôpital Saint Camille : en 2008, le service d’accueil des urgences a enregistré 60 000 passages, c'est-à-dire plus que les grands hôpitaux du Val-de-Marne, dont 25 000 passages au titre de la pédiatrie, activité qui correspond normalement à 350 lits, alors que cet hôpital n’en compte que 250.
Le service de pédiatrie abrite un pôle mère-enfant, au sein duquel dix lits sont consacrés à la néonatalogie de niveau IIB, c'est-à-dire les grossesses à risque.
Pour se mettre en conformité avec les textes, dans lesquels il est prévu que tout service de néonatalogie doit être adossé à une maternité, la direction de l’hôpital a sollicité voilà quelques années ses organismes de tutelle. En 2005, l’agence régionale de l’hospitalisation, l’ARH, a autorisé la création d’une maternité de niveau IIB comptant 35 lits de gynéco-obstétrique, ainsi que l’extension du service de néonatalogie à dix-huit lits, soit six lits supplémentaires et six lits dédiés aux soins intensifs.
En mars 2006, ce projet a été inscrit dans les annexes du schéma régional de l’organisation sanitaire. Puis, en avril de la même année, un contrat de retour à l’équilibre financier, ou CREF, a été conclu avec l’agence régionale de l’hospitalisation, qui a alors demandé le différé de la mise en œuvre du projet de maternité.
L’hôpital Saint Camille a profité de cette période pour lancer des études fonctionnelles, architecturales et budgétaires, toujours en liaison avec l’ARH, pour permettre l’inscription du projet de maternité au plan Hôpital 2012.
Or, l’annonce par Mme Roselyne Bachelot-Narquin, voilà moins d’une semaine, de vingt-neuf nouveaux projets dans le cadre du plan Hôpital 2012 a fait prendre conscience aux élus et aux équipes de l’hôpital Saint Camille du fait que le projet de maternité ne figurait pas parmi les projets retenus pour la première et la seconde tranche du plan Hôpital 2012.
Il faut déplorer, outre les conséquences financières – des frais d’étude avaient été engagés –, la déception des équipes qui s’étaient investies dans ce projet et l’apparition d’un problème juridique : comme je l’ai dit, selon les textes en vigueur, un service de néonatalogie, pour exister, doit être adossé à une maternité.
Que va donc devenir l’actuel service de néonatalogie de l’hôpital Saint Camille si, contrairement à ce qui était prévu, aucune maternité n’est créée ?
Madame la secrétaire d’État, au nom de tous les élus du Val-de-Marne, quelle que soit leur tendance politique, je veux attirer votre attention sur l’avenir de ce service de néonatalogie, obtenir des certitudes quant à sa survie et savoir pourquoi une maternité de niveau IIB ne peut être créée sur ce site, proche de la Seine-et-Marne et de la Seine-Saint-Denis.
Madame la sénatrice, vous avez interrogé Mme Roselyne Bachelot-Narquin sur la pérennité du service de médecine néonatale de l’hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne.
Votre interrogation fait suite à la remise en cause du projet de construction d’une maternité dans cet hôpital.
Je tiens à le préciser, l’ajournement de ce projet n’aura aucune conséquence sur le maintien du service de néonatalité, qui fonctionne parfaitement et offre des prestations de grande qualité à la population.
Le projet de construction de la maternité n’a, à ce jour, pas été retenu dans le plan Hôpital 2012 par l’agence régionale de l’hospitalisation d’Île-de-France, car il ne correspond pas à un besoin de la population du territoire et risquerait de déstabiliser l’hôpital Saint Camille.
En effet, le projet de nouvelle maternité risquerait de mettre en difficulté les maternités voisines et d’accroître les difficultés financières de l’établissement en question.
Ainsi, au terme d’une étude récente, il est apparu que le seuil de viabilité de la maternité, qui se situe à 2 500 accouchements par an, était susceptible de ne pas être atteint. Ce serait, par conséquent, un préjudice supplémentaire pour l’établissement, qui connaît des difficultés financières. En 2008, l’hôpital Saint Camille a affiché un déficit de 300 000 euros. Ce déficit est certes en diminution par rapport à l’année précédente, mais les démarches de l’établissement doivent être encouragées et poursuivies.
L’offre de soins en matière d’obstétrique se développe, dans ce même territoire, avec l’ouverture de la nouvelle maternité de l’hôpital Esquirol en mars 2008, l’extension de la maternité du centre hospitalier intercommunal de Créteil et l’ouverture prochaine de l’hôpital privé de Marne-la-Vallée. Ce nouvel hôpital regroupe les deux cliniques actuelles de Noisy-le-Grand et de Neuilly-sur-Marne.
Vous le voyez, madame la sénatrice, l’offre de soins en matière d’obstétrique n’est pas diminuée sur ce territoire, bien au contraire.
L’hôpital Saint Camille ne manque d’ailleurs pas de projets : il doit faire face à une activité très importante d’accueil des urgences. Avec 60 000 passages par an, il a besoin d’augmenter en priorité ses capacités en lits de médecine.
C’est donc dans ce sens que ma collègue Mme Roselyne Bachelot-Narquin souhaite que s’oriente le projet de l’établissement, qui pourra ainsi développer son activité et mieux répondre aux besoins de la population de son territoire. Telles sont les réponses qu’elle m’a priée de vous communiquer. Pour ma part, je lui rappellerai tout l’intérêt et toute l’attention que les élus de votre territoire portent à ce dossier.

Je vous remercie, madame la secrétaire d’État, des assurances que vous m’avez données quant à la pérennité de ce service de néonatalité. Toutefois, je suis étonnée : en effet, juridiquement, tout service de néonatalité doit être adossé à une maternité, et cet hôpital n’en a plus.
Votre réponse satisfera au moins les équipes de l’hôpital.
En revanche, nous, élus, n’avons pas la même approche : les statistiques prouvent que les femmes du Val-de-Marne vont accoucher à Paris, les maternités de leur département n’offrant pas un nombre suffisant de lits.
Enfin, l’hôpital Esquirol, situé sur la commune de Saint-Maurice, est relativement loin de l’hôpital Saint Camille. De surcroît, l’autoroute A4, dont on sait qu’elle connaît les pires embouteillages de France, oppose une véritable barrière, alors qu’il s’agit de répondre à des urgences en matière de maternités.
Vous vous faites l’écho des propos de Mme Roselyne Bachelot-Narquin quant au nouvel hôpital privé de Marne-la-Vallée : ce dernier n’est, en fait, que le regroupement de deux maternités qui existent déjà.
J’espère que, concernant la maternité, les prévisions ne sont pas fausses et qu’aucun contretemps ne surviendra. Je persiste à estimer que l’hôpital Esquirol est un peu loin de l’hôpital Saint Camille, dont le service de néonatalité demeure de qualité.
Les élus regrettent sincèrement que ce projet, sur lequel l’hôpital Saint Camille s’était engagé à la demande de l’ARH, soit remis en cause, et espèrent que le plan Hôpital 2012, grâce à la création des agences régionales de santé, permettra d’éviter, à l’avenir, ce type de démarche.

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier, auteur de la question n° 385, adressée à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche.

Madame la secrétaire d’État, j’aborderai un autre domaine de la solidarité, la solidarité territoriale dans le monde agricole.
Les haras nationaux sont, parmi les fleurons de notre patrimoine, une institution à laquelle les Français sont particulièrement attachés, et ce non pas seulement parce que ces haras occupent des lieux prestigieux – Pompadour, Compiègne, notamment –, mais aussi parce que, loin d’être des institutions inertes, ce sont des espaces de vie où l’homme et le cheval écrivent, chaque jour, une nouvelle page de leur histoire commune.
Au-delà de la seule logique comptable qui, de nos jours, préside, hélas ! trop souvent à la gestion du patrimoine de l’État, les haras nationaux ne sont pas seulement les derniers reliquats de notre glorieux passé, civil ou militaire ; ils sont bel et bien des acteurs essentiels de l’aménagement du territoire, dont le rôle ne devrait pas être négligé, tant ils font œuvre utile en de nombreux domaines.
Ainsi, en matière agricole, ils favorisent le maintien et le développement des races équines ; dans le domaine écologique, ils contribuent à la maintenance des paysages de pâturages ; dans le domaine culturel, ils contribuent à la conservation des techniques traditionnelles de monte ou de conduite des équipages ; enfin, dans le domaine artistique, ils participent à la préservation et à la transmission des métiers de la maréchalerie et de la sellerie.
Je n’ignore pas que, à l’instar d’autres secteurs, alors que sont engagées des réflexions relatives à la RGPP, la révision générale des politiques publiques, la restructuration des haras fait actuellement l’objet de débats.
Cependant, devant l’absence d’information officielle concernant le devenir de certains d’entre eux, des rumeurs parfois contradictoires et des affirmations réelles ou infondées circulent, ce qui n’est bon ni pour les haras ni pour les territoires. On entend régulièrement dire, ici ou là, que sept des dix-neuf haras nationaux seraient aujourd’hui menacés de fermeture, à l’occasion de la prochaine fusion de l’École nationale d’équitation Le Cadre Noir de Saumur avec les haras nationaux.
Si cette information était exacte, cette fermeture devrait intervenir au mois de juillet prochain. Ce serait là une échéance assez rapide, pour ne pas dire brutale, puisque, à ma connaissance, aucune concertation n’a eu lieu à ce jour.
Ma première question, madame la secrétaire d’État, porte sur la position du Gouvernement face à l’avenir des haras nationaux et aux grandes lignes qui vont définir leur restructuration.
Ma seconde question, connexe à la précédente, porte – vous le comprendrez aisément, puisque je suis élue de l’Aveyron – sur le haras de Rodez.
Cet établissement de grande renommée ne manque pas d’atouts, puisqu’il permet, notamment, l’entretien d’une ancienne chartreuse des XVIe et XVIIe siècles et d’un parc botanique exceptionnel de six hectares, le maintien d’une importante activité d’étalonnage et d’identification ; il apporte une incontestable contribution à l’intérêt touristique de la région, une assistance régulière au complexe hippique voisin, et permet bien entendu la préservation de l’emploi et de l’économie locale liés à son activité.
Depuis l’été 2004, un comité technique local réfléchit à l’avenir de ce haras, qui ne veut ni disparaître ni mourir. Il est ordonné en divers groupes de travail rassemblant de nombreux interlocuteurs, issus du conseil général, de la municipalité de Rodez, de la communauté d’agglomération du grand Rodez, des milieux socio-professionnels de la filière équine, ainsi que des représentants des divers partenaires institutionnels.
Ce comité a défini trois axes de développement : le premier concerne le tourisme et la culture, le deuxième porte sur la médiation sociale – notamment par la possible adéquation entre cheval et handicap, à laquelle vous ne manquerez pas d’être sensible, madame la secrétaire d’État, et par la réinsertion sociale des jeunes adultes pouvant se former aux métiers du cheval –, et le troisième touche au soutien à la filière équine, par la revalorisation des chevaux, le partenariat avec le domaine hippique de Combelles, la reproduction, l’identification et les formations.
Je ne puis, faute de temps, développer ici l’ensemble des conclusions proposées par ce comité, dont j’approuve les orientations, mais je les tiens à votre disposition, madame la secrétaire d’État, et à celle de M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche.
Je souhaitais seulement, ce matin, vous interroger sur l’avenir des haras nationaux, plus spécifiquement sur celui de Rodez.
est fort de 67 000 emplois. C’est un secteur important pour le ministère de l’agriculture et de la pêche. Les activités équestres sont d’ailleurs reconnues comme des activités agricoles depuis 2005. Ce secteur doit par conséquent poursuivre son développement et exprimer tout son potentiel.
Pour permettre à la filière de continuer à se développer de manière dynamique, il nous faut donc une politique de soutien adaptée.
Les principes qui guident Michel Barnier par rapport à cette politique sont les suivants : optimiser les moyens dans un contexte où les budgets ne sont pas en croissance ; responsabiliser les bénéficiaires dans la gestion des moyens afin d’accompagner la professionnalisation du secteur ; enfin, intégrer l’élevage équin dans la politique de l’herbe, ce qui est souhaité dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune.
Dans le cadre de la révision générale des politiques publiques, le Gouvernement a retenu, par ailleurs, le principe du rapprochement des haras nationaux et de l’École nationale d’équitation – c’était là votre première interrogation –, afin de constituer à terme un véritable office national du cheval et de l’équitation, qui sera porteur d’une ambition forte pour le développement de la filière d’élevage et pour le sport équestre en France.
Afin de mener à bien ce regroupement, Michel Barnier a décidé, avec le ministre en charge des sports, la mise en place d’un comité de préfiguration, qui élaborera un projet de nouvel établissement et son contrat d’objectif pour le 1er juillet 2009. Les orientations qui seront proposées dans le nouveau contrat d’objectif feront l’objet d’une concertation avec le personnel des deux établissements d’ici au 1er juillet 2009. Cela devraitrépondre à votre interrogation sur la consultation et la concertation nécessaires à l’élaboration de ce projet de regroupement.
En attendant la création du nouvel établissement, la direction générale des haras nationaux poursuivra son travail de gestion en respectant les moyens financiers disponibles pour 2009, mais aucune décision ne sera prise avant juillet 2009 concernant de nouvelles fermetures de haras nationaux. Seules les fermetures déjà programmées se poursuivront, c’est-à-dire à Blois, à Annecy et à Compiègne.
Cette annonce devrait apaiser vos craintes pour l’avenir immédiat du haras de Rodez. Pour la suite, je rappellerai à M. Barnier de prendre en compte l’attention que vous portez à ce haras dans le cadre des réflexions futures sur l’organisation de l’ensemble des haras nationaux sur le territoire.
Tels sont, madame la sénatrice, les éléments d’information que mon collègue Michel Barnier m’a chargée de vous apporter sur ce dossier qu’il suit très attentivement.

Je vous remercie, madame la secrétaire d'État, et à travers vous M. Michel Barnier, de l’intérêt que vous portez à la filière équine, qui a vraiment besoin de vivre et d’être valorisée.
J’ai bien entendu les objectifs que vous vous fixez d’optimisation des moyens, de professionnalisation du secteur, ce qui est essentiel, et d’intégration complète de cette filière au sein de notre problématique agricole, et je sais l’importance que M. le ministre de l’agriculture et de la pêche attache, en particulier, à la politique de l’élevage à l’herbe.

La parole est à M. Roland Courteau, auteur de la question n° 390, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Comme vous le savez, la viticulture, souvent considérée comme le fleuron de l’agriculture française et même de l’économie nationale, est aujourd’hui confrontée à des évolutions qui la fragilisent considérablement.
Il convient de rappeler que la viticulture constitue un secteur essentiel de notre agriculture – c’est la deuxième production nationale – et de la balance commerciale – elle représente le premier poste des exportations agroalimentaires de la France. Quant à son impact en matière d’emploi et d’aménagement du territoire, il est également considérable.
Or la situation actuelle, sur certains segments du marché, a tous les aspects d’une très sévère crise. Je n’insisterai pas sur les causes de cette dernière, ayant eu l’occasion de les évoquer, dans cette même enceinte, à de multiples reprises.
Depuis de trop nombreuses années, les clignotants sont au rouge dans maintes exploitations, alors que les viticulteurs n’ont jamais cessé d’investir et de jouer la carte de la qualité.
Aujourd’hui, la saignée économique est immense dans notre région. Nombre de situations individuelles sont dramatiques : sachez que les pertes peuvent atteindre jusqu’à 1 000 euros par hectare !
Je souhaite donc convaincre M. le ministre de l’agriculture et de la pêche que, dans une telle situation, il est impossible de ne pas prendre en compte la demande formulée auprès de l’un de ses conseillers, le 1er décembre 2008, par le Syndicat des vignerons du Midi.
Ce syndicat estime que l’attribution des droits à paiement unique, les DPU, est une question vitale pour les exploitations viticoles.
Mon collègue Marcel Rainaud et moi-même, les députés audois, très certainement l’ensemble des parlementaires du Languedoc-Roussillon, ainsi que, je l’imagine, de nombreux sénateurs de toutes sensibilités – j’aperçois M. Gérard César et M. Michel Doublet dans cet hémicycle – partageons ce sentiment et soutenons cette demande, qui est particulièrement légitime.
En effet, l’attribution des DPU en zone viticole constitue d’abord, et surtout, une véritable et indispensable mesure de soutien à ce secteur, mais aussi une mesure de justice, de simple équité par rapport aux autres productions qui reçoivent déjà cette aide. Sachez-le, nos viticulteurs ont parfois le sentiment d’être les oubliés de la politique agricole commune !
Nous le savons tous, notre viticulture a les moyens de ses ambitions. La diversité et la complémentarité de ses productions, ainsi que son image d’authenticité constituent ses meilleurs atouts.
Il faut donc, pour l’heure, permettre à nos viticulteurs de franchir le cap difficile de l’une des crises les plus sévères. L’attribution des DPU peut les y aider considérablement.
Depuis que la demande en a été faite au ministère de l’agriculture et de la pêche, le 1er décembre dernier, les choses ont-elles évolué, et M. Michel Barnier entend-il satisfaire cette demande et dans quels délais ?
Monsieur le sénateur, la question de l’attribution des droits à paiement unique, les DPU, aux surfaces en vigne se pose actuellement à l’occasion de la discussion en cours sur la réorientation de la politique agricole commune en France dans le cadre du « bilan de santé ».
Mon collègue Michel Barnier souhaite vous rappeler que la possibilité d’attribuer des DPU aux surfaces en vigne a été ouverte en 2008 dans la nouvelle organisation commune du marché vitivinicole : la possibilité était alors donnée de le faire en utilisant à cette fin l’enveloppe budgétaire attribuée à la France pour le soutien à son secteur vitivinicole, soit 172 millions d’euros dès 2008-2009 et 280 millions d’euros à partir de 2014.
La filière viticole française n’a pas souhaité retenir cette option, préférant mobiliser ces fonds en faveur d’actions structurantes, notamment les aides à la reconversion et à la restructuration du vignoble, les aides aux investissements, les aides à la promotion.
Compte tenu de ce choix, il est délicat, au regard des autres filières, de plaider maintenant la dotation de la vigne en DPU intégralement financés par redéploiement à partir des aides communautaires des autres secteurs.
Or il faut également préciser que l’attribution de DPU à la vigne ne permet pas, compte tenu de la réglementation actuelle, de traiter diversement les différents vignobles et que l’attribution d’aides découplées présenterait des avantages très inégaux selon le niveau de revenus générés à l’hectare par l’activité viticole.
Enfin, dans les différentes évolutions permises par le bilan de santé, il existe d’autres outils que les DPU qui pourraient pleinement profiter à la viticulture : Michel Barnier pense à l’assurance récolte ou à la mise en place de fonds sanitaires.
Par ailleurs, M. le ministre de l’agriculture et de la pêche tient à souligner tous les efforts qui ont été réalisés depuis deux ans en faveur de la viticulture française, qu’il s’agisse de plans d’urgence, dans les moments de grande difficulté, ou d’actions structurantes sur les moyen et long termes, comme c’est l’objectif du Plan de modernisation de la viticulture française adopté par le Gouvernement le 29 mai 2008.

Si j’ai bien compris, la réponse donnée à ma question est négative !
Quant aux autres mesures de compensation que vous avez citées, madame la secrétaire d'État, si elles ont le mérite d’exister, elles ne sont cependant pas suffisamment importantes pour sortir la viticulture de la crise dans laquelle elle est plongée.
Je n’ai rien à ajouter pour le moment, mais nous aurons vraisemblablement l’occasion de revenir sur ce dossier.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet, auteur de la question n° 380, adressée à Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

Ma question porte sur les conditions de séjour outre-mer des gendarmes originaires d’un département d’outre-mer.
L’instruction n° 24.700 du ministère de la défense stipule qu’un gendarme originaire des départements d’outre-mer a la possibilité d’être affecté dans son département sous deux statuts.
Il peut choisir le statut général, propre à tout personnel, quelle que soit son origine. À ce titre, il est alors muté outre-mer pour une durée de trois ans, avec possibilité de prolonger son séjour d’un an.
Il peut également opter pour le statut spécifique : le gendarme est alors muté pour six ans, avec une prolongation possible du séjour de trois ans.
S’il atteint l’âge de cinquante ans au cours de son séjour, il bénéficie d’une mesure lui permettant de rester sur l’île jusqu’à la fin de sa carrière.
Sinon, à l’issue de son séjour, il est réaffecté dans une unité en France métropolitaine. Possibilité lui est offerte de formuler une nouvelle demande de séjour outre-mer après deux années d’affectation en métropole, mais, dans le meilleur des cas, cette nouvelle mutation intervient dans les trois ans.
Je tiens à souligner, monsieur le secrétaire d'État, que ce système engendre des situations difficiles pour de nombreux gendarmes d’outre-mer : je pense, notamment, aux problèmes de gardes partagées pour les couples divorcés, à la présence de parents malades sur leur île natale. Pour y faire face, nombreux sont les gendarmes qui choisissent la retraite anticipée.
Au moment où il est question du rapprochement entre la gendarmerie nationale et la police nationale, il apparaît tout à fait justifié que les gendarmes originaires des départements d’outre-mer puissent bénéficier du même statut que leurs homologues de la police nationale, qui ont la possibilité, quant à eux, d’être affectés définitivement sur leur île natale après avoir passé une certaine période – environ quinze ans – sur le territoire métropolitain.
Par ailleurs, un gendarme originaire d’un département métropolitain peut choisir d’effectuer la totalité de sa carrière dans sa région d’origine ou dans une autre région française. Il n’est pas acceptable qu’une telle inégalité de traitement perdure entre les gendarmes de métropole et ceux de l’outre-mer.
C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d'État, je vous demande de bien vouloir me faire part des mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.
Madame le sénateur, vous avez interrogé le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conditions de séjour outre-mer des gendarmes originaires d’un département d’outre-mer.
Le Gouvernement attache une importance toute particulière à la situation des agents de l’État originaires d’un département d’outre-mer et, parmi ces derniers, à celle des sous-officiers de gendarmerie nationale.
Mme Michèle Alliot-Marie et moi-même nous sommes efforcés de vous apporter des réponses concrètes qui, même si elles ne sont pas exhaustives, devraient vous satisfaire.
Premièrement, afin de tenir compte de leurs attaches personnelles et familiales, les dispositions spécifiques que vous venez de rappeler permettent d’ores et déjà à ces sous-officiers de gendarmerie d’effectuer des séjours prolongés dans leur département d’origine.
En effet, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2009 du décret portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie va améliorer notablement ces dispositions.
Un arrêté d’application, actuellement en cours d’élaboration, précisera dans les meilleurs délais les mesures de gestion qui s’appliqueront aux gendarmes servant dans les départements d’outre-mer.
Il est cependant prévu que les sous-officiers originaires des départements d’outre-mer pourront bénéficier d’un dispositif spécifique qui leur permettra, sous certaines conditions, de servir dans leur département d’origine, sans que la durée de leur séjour soit limitée. C’est là, je pense, une réponse claire à la question précise que vous avez posée.
Deuxièmement, conformément aux recommandations de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, la HALDE, la notion de personnel « originaire » des départements d’outre-mer sera remplacée par celle de militaire dont la « résidence habituelle » est située dans ces départements.
La jurisprudence administrative définit cette notion de « résidence habituelle » comme étant, pour les agents de l’État, le « centre de leurs intérêts matériels et moraux ».
Bien que tous les militaires de la gendarmerie, quel que soit leur département d’origine, soient soumis au statut général des militaires, auquel il n’est pas question de déroger, ces nouvelles dispositions répondent très largement aux préoccupations que vous avez exprimées dans le cadre de votre question.

Je tiens à remercier M. le secrétaire d'État de sa réponse.
Il est absolument nécessaire de revoir cette réglementation injuste et discriminatoire.
Le gendarme originaire d’outre-mer, qu’il choisisse le statut général ou le statut spécifique, ne pouvait prétendre à aucune bonification pour le calcul de sa retraite quand il exerçait outre-mer, contrairement à ses collègues métropolitains.
Par ailleurs, le statut de personnel « originaire » des départements d’outre-mer mérite d’être redéfini.
Je suis donc vraiment très satisfaite de votre réponse, monsieur le secrétaire d'État, car ce statut est refusé à tout gendarme ultramarin dont les parents résident aujourd'hui en métropole, même si ce dernier est né en outre-mer de parents ultramarins. Ce n’est pas logique !

La parole est à M. Michel Doublet, auteur de la question n° 401, adressée à M. le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance.

M. Michel Doublet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, ma question ressemble comme deux gouttes d’eau, si j’ose dire
Sourires

Je souhaite attirer votre attention sur les difficultés de financement des investissements relatifs à l’eau potable et à l’assainissement.
Les collectivités en charge des services publics de l’eau et de l’assainissement doivent engager des investissements importants : protection et diversification des ressources, amélioration de la qualité de l’eau distribuée, modernisation des stations d’épuration existantes et création de nouveaux systèmes d’assainissement dans les communes non équipées.
Ces investissements publics répondent aux critères du plan de relance économique, au programme d’investissement publics et, parallèlement, aux objectifs du Grenelle de l’environnement.
Dans le domaine de l’assainissement, les agences de l’eau sont aujourd’hui contraintes d’opérer des arbitrages de plus en plus sévères entre les dossiers de demande d’aide déposés par les collectivités.
Une part importante des crédits affectés aux politiques de bassin est orientée vers les mises en conformité des stations d’épuration de grande capacité.
De ce fait, nombre de dossiers déposés par des collectivités rurales, bien qu’éligibles au neuvième programme des agences de l’eau et prêts à être exécutés, sont reportés faute de crédits suffisants.
Les conséquences économiques sont très lourdes pour ces collectivités et les usagers, mais aussi pour l’ensemble des entreprises de travaux publics spécialisées dans la pose de canalisations.
Depuis le début de l’année 2008, beaucoup d’emplois intérimaires n’ont pas été renouvelés et des plans de licenciement sont à craindre dans les prochains mois.
À l’occasion de la révision du neuvième programme des agences de l’eau, qui doit intervenir en 2009 en concordance avec l’approbation de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux, les SDAGE, il serait utile de dégager des capacités de financement complémentaires qui permettraient de répondre aux exigences de la directive relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et de la directive-cadre sur l’eau, de garantir la solidarité financière entre les territoires urbains et ruraux tout en contribuant significativement au plan de relance économique.
Dans son rapport sur le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, dit « Grenelle I », notre collègue M. Sido a exprimé des craintes similaires quand à la disponibilité des crédits des agences de l’eau : « De manière générale, votre commission juge impératif que toutes les mesures envisagées soient mises en œuvre dans des conditions permettant de maîtriser le prix de l’eau et garantissant une solidarité entre le monde urbain et le monde rural. Elle constate également que l’essentiel des aides financières passera par les agences de l’eau et attire l’attention sur la nécessité de maintenir actif l’ensemble des programmes aidés des agences en dehors des actions ciblées par le Grenelle. »
En outre, ce même rapport fait état d’un prêt de 1, 5 milliard d’euros de la Caisse des dépôts et consignations aux agences de l’eau pour répondre aux attentes du Grenelle.
Il conviendrait de s’interroger sur la réalité de ces chiffres, aussi bien pour le montant que pour la période de réalisation.
Enfin, l’essentiel des aides financières devant passer par les agences de l’eau, il est nécessaire de maintenir actif l’ensemble des programmes aidés des agences en dehors des actions ciblées par le Grenelle.
Ainsi, concernant l’agence Adour-Garonne, on peut estimer que les travaux sur l’ensemble du bassin qui ne peuvent pas être financés en 2009 seraient de l’ordre de 120 millions d’euros, ce qui correspond grossièrement à 30 millions d’euros d’aides de l’agence.
Il convient de noter que l’agence de l’eau ne pourrait disposer de crédits supplémentaires que par une augmentation sensible de ses redevances – ce n’est pas, à mon sens, dans l’esprit d’une évolution contrôlée du prix de l’eau –, ou par un prêt supplémentaire qui devrait être remboursé, ce qui revient au cas précédent.
En conséquence, monsieur le secrétaire d'État, quelles assurances pouvez-vous nous apporter sur l’effectivité des financements de ces projets indispensables ?
M. Alain Marleix, secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales. Je répondrai en même temps, si je comprends bien, à la question de l’éminent sénateur Michel Doublet et du non moins éminent sénateur Gérard César, qui, élu du Bordelais, s’intéresse aussi à l’eau…
Sourires
Mais il n’y a bien sûr aucune contradiction entre les deux !
Nouveaux sourires.
Monsieur Doublet, vous avez interrogé le ministre chargé de la mise en œuvre du plan de relance, M. Patrick Devedjian, qui vous prie de bien vouloir excuser son absence, sur le financement par certaines communes rurales de leur système de collecte et de traitement des eaux usées.
Ce problème récurent est régulièrement soulevé dans les assemblées générales de maires. Je vais donc essayer de vous apporter des éléments de réponse concrets.
Une mobilisation a été engagée à partir de 2006 pour rattraper les retards accumulés en France pour la mise aux normes des systèmes d’assainissement. Cette dernière a conduit les collectivités intéressées à contractualiser avec les agences de l’eau les travaux de mise aux normes, provoquant dans certains bassins un afflux de demandes de subventions aux agences de l’eau.
Comme vous le soulignez, les agences de l’eau ont dû donner la priorité, pour leurs aides, aux travaux ayant la plus forte incidence environnementale, et donc naturellement aux plus grosses stations d’épuration. C’est notamment le cas du bassin Adour-Garonne, qui connaît depuis deux ans un contexte financier particulièrement tendu. Les listes d’attente se sont allongées.
Anticipant ce phénomène, un mécanisme de compensation dit de « solidarité urbain-rural », contractualisé par les agences de l’eau avec les conseils généraux, a été inscrit dans la loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques.
Ce mécanisme garantit que, pour la période 2007-2012, les communes rurales bénéficieront de financements supplémentaires de 1 milliard d’euros pour leurs travaux dans le domaine de l’eau, conformément aux directives européennes qui les obligeaient à se mettre aux normes dans ces délais.
De plus, le Gouvernement a obtenu de la Caisse des dépôts et consignations un prêt bonifié de 1, 5 milliard d’euros aux agences de l’eau sur la période 2009-2012 pour leur permettre de financer ces travaux sans accroître les taux de redevances. Ce prêt sera signé dans les tout prochains jours.
Les agences de l’eau ont d’ores et déjà contractualisé avec la plupart des conseils généraux. Les dossiers s’inscrivant dans le cadre de ces conventions bénéficient d’un traitement prioritaire.
Par ailleurs, la modification du régime de versement du fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, mesure phare du plan de relance, à hauteur de 2, 5 milliards d’euros, représente une aide budgétaire et de trésorerie très importante pour les collectivités en 2009. Pour celles qui s’engagent à augmenter même d’un euro leurs investissements par rapport à la moyenne 2004-2007, les remboursements relatifs aux investissements de 2007 et de 2008 seront payés en 2009.
Tels sont les éléments de réponse concrets que je pouvais vous apporter aujourd’hui.

Je tiens à remercier l’éminent secrétaire d'État de sa réponse.
J’insiste lourdement sur le fait qu’il faut, dans le cadre du plan de relance, donner aux agences des crédits de consommation immédiate.
Nous avons tous dans nos tiroirs des dossiers importants. Président d’un syndicat départemental qui regroupe 472 communes, je suis capable de dépenser l’ensemble de l’enveloppe attribuée à l’agence de bassin !
J’ai reçu la fédération du bâtiment et des travaux publics de mon département. Faute d’une rallonge financière, une centaine d’emplois seront supprimés dans le secteur. Il est donc extrêmement important et urgent de débloquer les crédits.

L’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.