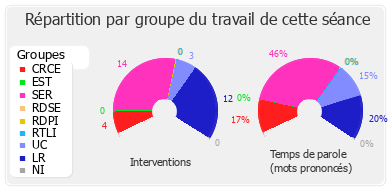Séance en hémicycle du 1er avril 2008 à 21h45
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq, sous la présidence de M. Guy Fischer.

La séance est reprise.

Nous reprenons la discussion du projet de loi relatif aux contrats de partenariat.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Daniel Dubois.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, depuis l'ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, seuls vingt-neuf contrats ont été attribués - vingt-deux par les collectivités territoriales, sept par l'État -, représentant un montant de 3, 3 milliards d'euros. Il convient d'ajouter que cent trente-cinq autres contrats sont aujourd'hui en cours de négociations, pour 7, 5 milliards d'euros.
Pourquoi ces contrats de partenariat ne connaissent-ils pas le développement escompté, alors qu'ils présentent, par leur approche globale qui va de la conception à l'exploitation, un gage de réelle efficacité ? Celle-ci repose à la fois sur une expertise préalable complète et sur une maîtrise globale de la chaîne de réalisation. De plus, elle est le gage d'économies financières dans le montage des projets, par la mise en oeuvre de process innovants et optimisés.
Ces contrats de partenariat favorisent également l'étalement de la dépense dans le temps et, sans aucun doute, une réelle maîtrise des coûts.
Toutefois, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, au-delà de ces principes, je suis intéressé par ce nouveau type de contrat parce que le projet de partenariat mené actuellement par Voies navigables de France - la construction du canal Seine-Nord Europe - traverse le département de la Somme sur près de la moitié de son parcours.
Ce projet est estimé à 4 milliards d'euros. Je rappelle à cette occasion que j'avais déposé un amendement lors de l'examen du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports, afin de permettre à Voies navigables de France de recourir au contrat de partenariat. Cet amendement a été adopté et permet à Voies navigables de France de financer le développement des infrastructures de transport fluvial, alors que, auparavant, cette possibilité était limitée à l'entretien des écluses et des barrages à gestion manuelle.
Le canal Seine-Nord Europe à grand gabarit est le maillon central du projet de liaison fluviale Seine-Escaut. Il est inscrit au rang des trente projets prioritaires européens en matière de transports. Ce canal reliera, à terme, les bassins de la Seine et de l'Oise au réseau fluvial nord-européen.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'ai souhaité prendre cet exemple pour illustrer l'importance des contrats de partenariat pour ce type de projets, dont l'envergure participera à l'équipement de la France, à son développement durable ainsi qu'à sa croissance.
Le projet de loi que vous nous présentez aujourd'hui, madame la ministre, participe à ce même objectif. Pour autant, il ne doit pas oublier le cadre fixé par le Conseil constitutionnel, qui précise que ce type de contrat, qui déroge au droit commun de la commande publique, doit rester exceptionnel.
En effet, je viens de le souligner, il suscite aujourd'hui un très faible engouement. Je passerai rapidement sur les raisons de ce déficit, le rapporteur, les rapporteurs pour avis et les différents orateurs qui m'ont précédé les ayant déjà excellemment rappelées. Toutefois, au nombre de ces causes se trouvent notamment un problème de concurrence avec les autres types de partenariat public-privé, des critères d'ouverture très contraignants, un régime juridique désavantageux, un régime fiscal peu attractif et, sans aucun doute, un réel frein administratif lié bien souvent à une mauvaise connaissance de ce montage et peut-être à un excès de prudence des services de l'État.
Quelles sont les solutions que prévoit ce projet de loi pour relancer ce partenariat public-privé ? Elles portent à la fois sur l'élargissement du champ d'application de ce contrat de partenariat et sur la clarification de son régime juridique et fiscal.
D'une part, l'élargissement du champ d'application concerne la possibilité d'utiliser les partenariats public-privé quand les conclusions de l'évaluation préalable présentent un bilan avantageux. Il est vrai que nous pouvons néanmoins nous interroger sur la constitutionnalité d'un tel ajout, dans la mesure où ce cas d'ouverture peut être éloigné du principe d'intérêt général, qui est une condition indispensable du Conseil constitutionnel pour déroger au droit commun de la commande publique.
D'autre part, le projet de loi ajoute de nouvelles voies d'accès sectorielles. Il s'agit notamment de l'enseignement supérieur, de la recherche, des infrastructures de transport s'inscrivant dans un projet de développement durable - je viens de l'évoquer -, la rénovation urbaine, l'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Une modification de l'ordonnance en ce sens était d'ailleurs très attendue. Elle permet de tenir compte de l'une des critiques les plus fréquentes, à savoir le champ d'application trop restreint d'un tel contrat.
S'agissant des voies d'accès sectorielles, elles permettent de recourir au contrat de partenariat avec beaucoup plus de facilité, puisqu'elles dispensent le maître d'ouvrage d'en justifier l'utilisation. Permettez-moi toutefois, madame la ministre, d'émettre une réserve sur l'échéance de 2012, qui sera sans aucun doute un frein majeur à la mise en oeuvre de ces projets.
Le projet de loi prévoit également de clarifier le régime juridique des contrats de partenariat et d'améliorer leur régime fiscal.
L'ensemble de ces propositions va incontestablement, là aussi, dans le sens d'une plus grande attractivité de ces contrats.
Le rapporteur saisi au fond et les deux rapporteurs saisis pour avis proposent différentes modifications. Je souhaite à cette occasion relever l'intérêt du travail qu'ils ont effectué, chacun apportant un éclairage complémentaire dans l'analyse globale de ce texte. Je pense, en particulier, à la proposition de notre collègue Charles Guené, rapporteur pour avis de la commission des finances, qui insiste sur la nécessité de faire de la consolidation des engagements financiers liés aux partenariats public-privé dans la dette publique le principe et la déconsolidation l'exception. Ainsi prendrons-nous en compte l'impact financier et comptable réel, ce qui permettra d'éviter toute fuite en avant et un accroissement excessif de l'endettement des collectivités et de l'État.
Plus généralement, nous souscrivons à l'ensemble des propositions émises, qu'elles émanent du Gouvernement ou des rapporteurs. Mais nous savons aussi, madame la ministre, que ce nouvel outil de commande publique doit trouver rapidement son rythme de croisière : 2012, c'est demain ! Il doit, pour cela, être accompagné dans sa mise en oeuvre par un réel service après-vente.
C'est pourquoi nous demandons qu'un cadre méthodologique de référence soit rapidement déterminé et mis à disposition des décideurs publics. Il devra non seulement comporter des formations spécialisées à destination des agents publics, notamment des maîtres d'ouvrages publics, mais aussi s'appuyer sur un réseau de retour d'expérience. En outre, il sera indispensable de mettre en oeuvre des outils adaptés pour l'évaluation préalable. Ce sera difficile.
Ce point constitue, en effet, la phase la plus délicate et la plus compliquée, en particulier pour les collectivités territoriales, qui ne disposent pas des services et des compétences suffisantes pour procéder à une évaluation pertinente susceptible de conditionner le recours au contrat de partenariat. Or, il faut le rappeler, les collectivités territoriales représentent 73 % de l'investissement public et sont donc des acteurs incontournables de la croissance.
Enfin, comme le proposait le rapporteur, Laurent Béteille, il serait très certainement utile de créer un code de la commande publique. Cela permettrait non seulement d'avoir une meilleure lisibilité du droit en la matière, mais aussi de distinguer plus clairement les différents types de partenariats publics-privés et la réglementation qui s'y rattachent pour chacun d'eux.
C'est pourquoi il est impératif, madame la ministre, d'accorder une attention particulière à l'organisation d'un réseau d'information et de soutien logistique à la mise en oeuvre des contrats de partenariat. Depuis le mois de décembre 2007, un programme de formation spécifique a été mis en place, ce dont nous nous réjouissons. Cependant, nous devons encore redoubler d'efforts si nous voulons rendre intelligible et accessible le droit de la commande publique et, surtout, si nous voulons que le contrat de partenariat représente une part significative de cette dernière.
Enfin, et je conclurai sur ce point, il me semble important de privilégier ce mode de partenariat comme outil d'accompagnement d'un programme d'équipement d'intérêt national, qui n'oublie pas le développement local.
En effet, si la globalisation des marchés permet une meilleure gestion et une meilleure efficacité dans la conduite des projets, elle ne doit pas se faire au détriment des entreprises locales.

Lors de l'examen du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notre groupe avait, à maintes reprises, exprimé son inquiétude sur l'accessibilité des entreprises locales à ce type de contrat.

...puisque, parmi les critères de choix du candidat, doit figurer la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans. Il me semble important d'insister sur ce critère d'attribution dans les différents documents explicatifs. À défaut, ces projets n'auront aucun impact sur l'économie locale. En outre, la croissance escomptée, via un programme de projets d'intérêt national, serait limitée.
Telles sont, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les remarques dont je souhaitais vous faire part, en indiquant que le groupe UC-UDF soutiendra l'ensemble des mesures proposées.
Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelles sont les raisons qui, en définitive, justifient le dépôt de ce projet de loi ? Je me souviens que, dans cet hémicycle même, on nous a d'abord expliqué que la loi d'habilitation qui constitue le fondement de l'ordonnance du 17 juin 2004 était fort bien faite, puis que cette ordonnance était elle-même de bonne qualité. La question - nous la connaissons tous et elle doit être examinée de manière très objective - est de savoir si les contrats de partenariat doivent être une formule à caractère dérogatoire ou s'il faut tendre à leur généralisation.
Les membres du groupe socialiste du Sénat s'étaient donné beaucoup de mal en saisissant, et à deux reprises, le Conseil constitutionnel pour obtenir, notamment, la décision du 26 juin 2003, que vous avez bien voulu qualifier en commission, madame la ministre, d'« admirable », ce dont je vous remercie. C'est une bonne appréciation.
Nous nous sommes aussi donné beaucoup de mal en saisissant le Conseil d'État, qui a rendu un arrêt très intéressant sur le sujet.
Pourquoi avons-nous agi ainsi ? Parce que les contrats de partenariat présentent la spécificité de permettre le choix entre des « paquets » de prestations très importantes et très diversifiées. Lorsque l'on désigne l'opérateur qui va être titulaire du contrat de partenariat, on choisit un groupe, lequel groupe va faire le choix non seulement de l'architecte et de toutes les entreprises représentant l'ensemble des corps de métiers nécessaires à la réalisation envisagée, mais aussi du banquier, qui assurera le financement, ainsi que des entreprises qui seront respectivement chargées de l'exploitation, de la maintenance et de l'entretien.
La première question que je veux poser est toute simple. Est-il raisonnable, est-il bénéfique, madame la ministre, d'effectuer tous ces choix en une seule fois ?
Concrètement, comment cela se passe-t-il ? Vous avez des « paquets » de prestations. Le major, puisque tel est le terme consacré, va présenter le premier « paquet » incluant tel architecte ; il a recours à telles entreprises représentant différents métiers, à tels exploitants, à telles sociétés assurant la maintenance et l'entretien. Toutes les prestations doivent être choisies « en bloc ». On ne peut pas soutenir que tel banquier est meilleur ou que le projet de tel architecte est plus adapté. On ne peut pas plus mettre en concurrence plusieurs entreprises du bâtiment pour chaque corps de métier.
Madame la ministre, pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi ?
Dans toute notre tradition des marchés publics ou des délégations de service public, la concurrence est favorisée. Eh bien, mes chers collègues, je suis à cette tribune pour plaider en faveur de la concurrence.
Une fois retenu tel ou tel major, le major n° l, le major n° 2, le major n° 3, le choix est définitif, aucune mise en concurrence n'est plus possible. C'est le major qui choisit tout !
Nous avons tous connaissance des remarques qui ont été formulées par les différentes parties prenantes.
Relevons, tout d'abord, celles des architectes. Vous savez bien que la loi actuelle prévoit qu'à partir d'un certain seuil de travaux un concours d'architecture doit être organisé. En quoi est-ce néfaste ? D'aucuns rétorqueront que le major retenu est remarquablement intelligent et qu'il ne manque pas de choisir un bon architecte, de surcroît bien vu dans la région ou le département considéré. Soit, mais il n'en reste pas moins que c'est le choix du major, et de lui seul. Les autres architectes n'ont ni la liberté ni même la possibilité de présenter leur candidature.
Quant aux entreprises, c'est également le major qui, seul, va les choisir toutes. Bien sûr, il aura l'intelligence de retenir telle ou telle entreprise locale, peut-être même une, deux ou trois PME. Si un travail de gros oeuvre, de plomberie, de chauffage, d'éclairage doit être effectué, les différentes entreprises susceptibles d'être candidates ne pourront en aucun cas présenter leur candidature. Elles n'en ont pas le droit, elles n'en ont pas la possibilité. Le Syndicat national des entreprises de second oeuvre, le SNSO, qui lutte contre ce projet de loi, souhaite que les entreprises de second oeuvre puissent avoir accès aux différents marchés. Or, dans cette formule, c'est impossible.
De la même manière, nous avons reçu de nombreux représentants des PME. Mon cher collègue, vous avez indiqué, voilà quelques instants, que l'ordonnance, dans sa grande libéralité, prévoit un certain pourcentage accessible aux PME. Certes, mais qu'est-ce que cela signifie ? Le titulaire du contrat de partenariat choisira tout simplement de manière discrétionnaire la ou les PME, tandis que, avec les marchés que nous connaissons, toute entreprise peut faire acte de candidature et entrer en concurrence avec les autres. Voilà qui n'existe plus avec les contrats de partenariat.
Nous avons également reçu des représentants de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB. Il ressort de leur expérience que, soit ils réussissent par hasard à être retenus par un groupe ou plutôt par le sous-traitant d'un sous-traitant de ce groupe, mais aux conditions par lui fixées, soit ils n'existent pas.
Je conçois qu'un tel système soit retenu, mais seulement lorsqu'une circonstance impose d'agir ainsi. Ainsi, dans sa grande sagesse, le Conseil constitutionnel a estimé qu'en cas d'urgence ou de complexité on peut admettre de recourir au contrat de partenariat.
Nous ne sommes pas par principe défavorables à ce type de contrat. Nous pensons que cet outil doit exister, mais - et tel fut l'objet de l'action que nous avons menée par deux fois auprès du Conseil constitutionnel et une fois auprès du Conseil d'État - à condition que le recours à un tel outil soit encadré par des conditions strictement précisées.
Madame la ministre, comme je le rappelais au début de mon propos, vous avez qualifié la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 d'« admirable ». Or le Conseil a considéré que « la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ». Je suppose, madame la ministre, que vous êtes en accord avec le Conseil, et, d'ailleurs, il ne pourrait pas en être autrement, puisque, comme il a été indiqué dans une autre circonstance que je ne ferai qu'évoquer en cet instant, les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités publiques. Par conséquent, la décision précitée s'impose à vous comme à nous.
À cet égard, je suis quelque peu inquiet de certains des propos qui ont été tenus cet après-midi. Si l'on considère en effet que le projet de loi tend à expliciter les conditions fixées par le Conseil constitutionnel, on pourrait plaider, de manière purement formelle, que la décision du Conseil serait respectée. Mais un certain nombre d'orateurs, que vous avez entendus comme moi, madame la ministre, nous ont affirmé que cette décision du Conseil constitutionnel était trop restrictive et que d'autres critères devaient être fixés, d'autres circonstances prévues. Si telle est votre interprétation, madame la ministre, alors la décision du Conseil constitutionnel n'est pas respectée, ce qui vous place dans une situation assez problématique.
Encore une fois, on ne peut pas tout à la fois prétendre respecter la décision du Conseil et soutenir que d'autres circonstances doivent être ajoutées, puisque, selon le Conseil constitutionnel, le système n'est conforme à la Constitution que dans les deux cas d'urgence et de complexité.

Mon cher collègue, vous citez des exemples ; vous n'avez pas lu le principe général !

Je vais vous répondre en analysant les deux circonstances que l'on nous propose d'ajouter.
La première est très générale. Si j'ai bien compris, il suffit que l'évaluation montre que le recours au contrat de partenariat est « plus avantageux » pour que l'on soit fondé à faire appel à un contrat de partenariat plutôt qu'aux autres formes de marché public qui existent. Mes chers collègues, il s'agit d'un dévoiement de la décision du Conseil constitutionnel, car ce « plus avantageux » est très vague et, en quelque sorte, ne signifie rien.

D'un point de vue philosophique, la notion est peut-être difficile à appréhender, mais, sur le plan financier, c'est facile !

Monsieur Doligé, je suis très intéressé par votre remarque, car, précisément, loin de faire ici de la philosophie, je demande simplement que l'on m'explique comment on prouve qu'un tel système est plus avantageux financièrement, économiquement pour les finances publiques. L'ordonnance prévoit une évaluation préalable. Pour ce qui est de l'État, cette évaluation doit être réalisée soit par la mission présidée par M. de Saint-Pulgent, soit par d'autres organismes agréés par l'État. Rien de tel n'étant prévu pour les collectivités locales, ces dernières peuvent faire appel à tout évaluateur de leur choix.
Mes chers collègues, je veux vous démontrer, et ma tâche sera aisée, qu'il est impossible de prouver que le recours au contrat de partenariat est plus avantageux économiquement et financièrement.

Je m'explique, mon cher collègue.
Prenons le cas d'une collectivité qui opte pour un contrat de partenariat. Dans un premier temps, elle est bénéficiaire d'une réalisation qu'elle ne paie pas : c'est magnifique ! Mais cette même collectivité devra verser un loyer pendant dix ans, vingt ans, trente ans ou quarante ans. Qui, aujourd'hui, en 2008, peut prouver que, dans trente ans, le calcul économique penchera en faveur du contrat de partenariat ? Qui pourra démontrer que les sommes ainsi supportées par la collectivité auront été moindres que si elle avait contracté un emprunt et recouru aux procédures classiques des marchés publics ?
Rien ne permet aujourd'hui de le faire, le nombre des variables indéterminées qui interviendront au cours des trente prochaines années et qui pèseront dans le calcul est bien trop élevé. Quid du coût de l'énergie, du prix de la construction ? Quid des innovations ? Quid des modifications de la fiscalité ou de la législation ?
À celui qui pourra démontrer qu'en l'an 2030 ou en l'an 2040 le contrat de partenariat aura été bénéfique pour la collectivité considérée ou pour l'État, j'adresse toutes mes félicitations, mais je prétends, moi, qu'il ne démontrera rien. Finalement, pour cette fois faire de la philosophie, mes chers collègues, on fait ici le pari, un pari pascalien, que ce sera plus avantageux pour la collectivité.
Donc, je mets en cause ce caractère avantageux ou plus avantageux posé comme le fruit d'une éventuelle démonstration et qui, en fait, n'est qu'une assertion.
J'en viens à la seconde circonstance introduite par le projet de loi.
Il est proposé d'inscrire dans la loi que, jusqu'en 2012, sont urgents les projets relatifs à la police, à la justice, aux implantations du ministère de la défense, aux universités, à l'enseignement, à l'environnement, à la politique de la Ville, aux réalisations urbaines, aux transports, aux hôpitaux, et j'en passe. Franchement, qui peut penser que de tels projets présentent un caractère d'urgence lié à des circonstances imprévisibles ? En réalité, vous organisez clairement le dévoiement de la décision du Conseil constitutionnel.
Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Madame la ministre, mes chers collègues, le dispositif de ce projet de loi est vraiment très ambigu : soit on en reste à la logique de l'ordonnance de 2004 et ce dispositif est dérogatoire, soit on veut le généraliser de facto, tout en prétendant respecter la logique du Conseil constitutionnel, mais il suffit d'analyser le texte pour constater, c'est patent, que l'on est sorti de cette logique. De surcroît, pour ce qui concerne l'évaluation, personne, vraiment personne, ne peut dire ce qu'il en est.
Puisque nous allons revenir sur tous ces points lors de la discussion des articles, mes chers collègues, je terminerai mon intervention en citant la Cour des comptes, puisqu'elle a eu à examiner quelques réalisations. Chacun reconnaît l'autorité et la hauteur de vues de M. Philippe Séguin. Je tiens donc à citer les propos qu'il a tenus lors de la présentation du rapport public annuel 2008 de la Cour des comptes au Sénat, le 6 février dernier. Selon le Premier président, « le recours à des montages dits ?innovants?, sortes de partenariats public-privé », a pour résultat que « ces ?innovations? ne visent en fait le plus souvent qu'à faire face à l'insuffisance de crédits immédiatement disponibles » et entraînent « des surcoûts très importants pour l'État ». C'est ce que montre, en tout cas, le rapport de la Cour des comptes que nous avons en notre possession.
En ce qui concerne le financement, M. Séguin ajoute que, dans les contrats de partenariat, beaucoup de surcoûts sont liés au fait que « l'on semble avoir oublié que l'État emprunte à un taux plus faible que les sociétés privées auxquelles il est fait appel pour ce type de montage ». Ce n'est pas négligeable, monsieur Doligé, mais je pense que vous allez me répondre et je vous écouterai avec beaucoup d'attention, comme toujours !
Sourires

Je lis avec beaucoup d'intérêt les productions des officines qui démontrent de manière péremptoire que les collectivités ont un intérêt manifeste à recourir à ce type de procédure, mais je constate qu'il ne s'agit en rien de démonstrations ! Quant à moi, je plaide devant vous, mes chers collègues, pour que l'on reconnaisse la spécificité des métiers, comme celui d'architecte : il n'est pas sain que les majors décident de tous les projets d'architecture. Il est sain de pouvoir organiser des concours d'architecture ; il est sain de pouvoir mettre en concurrence les entreprises, qu'il s'agisse de construction, d'entretien, de maintenance ou d'exploitation, comme il est sain de pouvoir mettre en concurrence les banques !
Voyez-vous, mes chers collègues, j'ai l'impression - mais peut-être ai-je tort - de tenir un discours tout à fait libéral par certains aspects...

M. Jean-Pierre Sueur. ... parce que le ressort principal du libéralisme, c'est la concurrence !
Mme Janine Rozier s'exclame.

Le ressort du libéralisme, c'est le respect de la concurrence, qui doit être favorisée au maximum. Si vous prétendez que la concurrence est respectée lorsque trois entités régentent tout et décident de tout pendant trente ans dans la poursuite d'un objectif qui relève manifestement de l'intérêt public, j'y vois, quant à moi, une singulière réduction et un véritable appauvrissement de la concurrence ! Si vous pensez que j'ai tort, expliquez-moi pourquoi.
Ce texte représente un véritable appauvrissement de la concurrence auquel on ne peut consentir que face à des situations complexes, urgentes et imprévues. Dans ces cas-là seulement, il est bon de disposer de tels outils dans la panoplie des dispositifs envisageables. Sinon, je pense que la généralisation de ces procédures exceptionnelles est tout à fait injustifiée.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, j'ai l'impression de m'insinuer dans un dialogue entre nos collègues Sueur et Doligé...
Sourires

M. Paul Girod. Nous avons pu, à l'occasion de ces échanges, découvrir la richesse de la vie politique du Loiret.
Nouveaux sourires.

Je suis d'autant plus confus de venir exprimer dans ce débat quelques idées quelque peu différentes, mais je vais tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles je trouve, moi, que ce projet de loi est bon, même si, ici ou là, un certain nombre de corrections ou d'améliorations mériteraient d'y être apportées.
En écoutant les interventions de cet après-midi, à commencer par celle de notre ami du groupe CRC M. Billout, puis celle de M. Sueur, il y a un instant, j'ai eu l'impression que se prolongeait ici le vieux débat qui résumait l'organisation des sociétés humaines à la fatalité de la lutte des classes.

Vous ne parlez certes plus de lutte des classes, puisqu'elle est un peu passée de mode - un certain nombre de nos collègues ont mis du temps à s'en apercevoir -...

M. Paul Girod. ... mais de la lutte du bien contre le mal, le bien étant incarné par le public et le mal, par le privé !
Exclamations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Toute tentative de compromis ou de collaboration entre l'un et l'autre est marquée de l'héritage de la condamnation d'Ève au jardin d'Éden et tout ce qu'on peut dire sur le sujet doit être considéré avec une extrême prudence.
On peut toujours conserver ses positions de principe, mais le rôle des élus, me semble-t-il, consiste à faire en sorte que la gestion des intérêts de notre peuple soit assurée au mieux, le plus efficacement possible.

Regardons ce qui se fait à l'étranger : nous observons beaucoup d'exemples de collaboration entre les forces économiques du privé et les soucis politiques et altruistes du public.

Je sais bien que rien n'est comparable d'un pays à l'autre et que, dans notre pays, un certain nombre de dispositions anciennes, telles que la délégation de service public, ont déjà introduit certaines facilités qui peuvent expliquer que ces fameux partenariats public-privé ou contrats de partenariat - selon la nouvelle terminologie - se soient moins développés qu'ailleurs. C'est vrai, mais il n'empêche qu'un certain nombre de réussites observées à l'étranger sont fondées sur l'idée que des complémentarités existent entre les deux secteurs. Peut-être faut-il faire un effort pour les trouver, tout en examinant les difficultés que pourrait soulever l'application du texte qui nous est présenté.
Certaines de ces difficultés sont véritables, en particulier celles que rencontrent les PME pour trouver leur place dans ce système : un certain nombre de dispositions réglementaires devront être envisagées pour que les PME puissent être présentes dans les réalisations résultant de contrats de partenariat.
Le projet de loi soulève un autre problème et la commission des lois, me semble-t-il, l'a convenablement résolu : il s'agit du désengagement - autrement dit, de la cession de créance - du partenaire privé en cours de contrat. La solution proposée par le rapporteur de la commission des lois me paraît raisonnable, et ce n'est pas parce qu'elle date de notre ami Étienne Dailly qu'elle devrait être rejetée.

Outre le fait qu'il est l'un de ceux qui m'ont guidé dans cette maison, et le président de la commission des lois l'a également bien connu pour des raisons évidentes, Étienne Dailly savait de quoi il parlait en matière de pactes financiers. Je pense donc que la solution de la « cession Dailly » est intéressante.
Mais - je monte tout doucement dans l'échelle des difficultés - il est une objection qui me soucie plus, dans la mesure où j'ai l'honneur d'être le rapporteur spécial de la dette publique et du service de la dette au sein de la commission des finances : il s'agit du problème de la consolidation.
On peut concevoir, il est vrai, le partenariat public-privé comme un paravent destiné à dissimuler aux autorités européennes la réalité du montant de la dette publique. Sur cette question, l'office statistique de la Commission européenne, Eurostat, a rendu une sorte de jugement de Salomon, pas toujours convaincant dans la totalité de ses considérants, disant qu'à partir de l'instant où l'essentiel des risques est supporté par le partenaire privé, les engagements ne relèvent pas de la dette publique, mais que, si l'essentiel des risques est du côté public, ces engagements doivent être intégrés à la dette publique, avec la prise en compte d'une notion de performance... Très honnêtement, madame la ministre, je ne suis pas absolument certain que les décisions d'Eurostat offrent une base suffisante qui nous garantisse d'échapper à certains procès d'intention !
Je souhaite donc que l'on puisse disposer, hors bilan de l'État, d'un état régulier des engagements de celui-ci. Ce souci est encore plus grand lorsqu'il s'agit de partenariats souscrits par des collectivités territoriales : je souhaite là très ardemment que les textes réglementaires définissent de quelle manière une collectivité territoriale sera amenée à présenter à l'ensemble de ses mandants, hors compte administratif, notamment la réalité et la totalité de ses engagements ainsi que leur durée, afin qu'une publicité minimale soit respectée.
Je voudrais en revenir à l'essence même de la nécessité du partenariat public-privé, et vous faire part d'une réflexion tirée de l'expérience que j'ai vécue. Je suis malheureusement obligé d'évoquer ici - il faut choisir les mots avec prudence - ce que j'ose à peine appeler la suffisance de certaines de nos administrations qui, notamment parce qu'elles sont des services de l'État, pensent qu'elles savent tout, sont capables de tout concevoir et que le reste ne relève plus que de modalités d'exécution, comme le choix d'un architecte, notamment. Cette prétention est infondée et c'est sur ce point que je m'oppose totalement à notre collègue Jean-Pierre Sueur !
La preuve est très facile à apporter lorsqu'une collectivité territoriale s'attelle à une oeuvre très originale pour elle, par sa dimension ou par le domaine d'intervention dans lequel elle veut se lancer. Dans ces cas-là, il n'est pas vrai que nos administrations disposent des compétences nécessaires pour faire face à tous les types d'investissement ou à tous les types de programme qui nécessitent, pendant des années et des années, un entretien, des innovations permanentes, entre autres choses.
Je fais plus confiance aux entreprises, exposées en permanence à la concurrence et au marché international, pour avoir la souplesse d'esprit et l'inventivité qui permettent l'adaptation à une situation évolutive et pour présenter aux collectivités publiques - et en collaboration avec elles - un certain nombre de solutions originales que celles-ci seraient incapables de concevoir ni de mettre en oeuvre de manière autonome. C'est vrai pour l'État, je pourrais vous donner quelques exemples que j'ai vécus, mais c'est vrai aussi pour les collectivités territoriales.
Récemment, notre ami Gérard Larcher nous donnait l'exemple de sa commune de Rambouillet qui, souhaitant réaliser un équipement culturel de grande importance, ne peut y parvenir avec les moyens de ses seuls services, si compétents soient-ils. Ou alors, cela signifierait qu'une collectivité territoriale qui a l'ambition de développer un projet original par son ampleur et son objet est tenue de recourir à la tutelle de l'État pour y parvenir : cela n'est pas compatible avec l'esprit dans lequel nous concevons la décentralisation !
Je suis donc de ceux qui pensent que ce système de contrats de partenariat, élargi, assoupli, peut ouvrir à nos collectivités locales comme à l'État un certain nombre de possibilités d'action que, pour des raisons non strictement budgétaires, elles ne pourraient pas envisager sans ce texte.
Madame la ministre, vous aurez le soutien du groupe auquel j'appartiens pour faire en sorte que cette réforme que vous souhaitez et qui va dans le bons sens - peut-être améliorée sur un certain nombre de points importants par le travail des commissions ou par l'apport de tel ou tel de nos collègues - puisse voir le jour le plus rapidement possible.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quand on considère le nombre et la variété des possibilités offertes aux partenaires publics et privés de nouer des liens contractuels, des plus anciens, banals et balisés, comme les marchés publics, les délégations de service public, les sociétés d'économie mixte, les baux emphytéotiques - et j'en passe - aux plus acrobatiques, telle « l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public assortie d'une convention de location » qui vient, comme l'a rappelé Jean-Pierre Sueur, d'avoir les honneurs du rapport de la Cour des comptes ; quand on parcourt la liste des opérations en cours ayant fait l'objet d'un contrat de partenariat au sens de l'ordonnance de 2004, qui vont de la construction de collèges, de réseaux d'éclairage public ou de fourniture d'énergie à un hôpital - opérations routinières s'il en est - à des projets aussi complexes que le grand stade de Lille, pour des montants qui s'échelonnent de 2 à 765 millions d'euros, on peut se demander s'il est nécessaire d'étendre à d'autres situations que celles caractérisées par l'urgence et la complexité l'usage de ce type de partenariat !
La réponse à cette question est suggérée dans le projet de loi : pourquoi se priver de recourir à une telle formule quand elle présente « un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d'autres contrats de la commande publique » ? Imparable ! Vive donc la modernisation et l'innovation juridique !
À cela près que, comme l'a dit Jean-Pierre Sueur, un tel bilan comparatif est illusoire. Tout au plus, une fois prise la décision politique de recourir à un contrat de partenariat plutôt qu'à une autre formule, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, peut-on tenter d'établir le coût final du montage pour la collectivité, sans possibilité sérieuse d'y parvenir lorsque les situations sont très complexes et les engagements de très longue durée.
Le biais rédhibitoire de ces études, c'est qu'elles comparent, dans un environnement dont on ne sait comment il va évoluer, l'option du PPP à une autre solution hypothétique, pour laquelle on ne dispose d'aucune donnée. Et puis, que compare-t-on ? Par exemple, s'agissant de la construction et de l'exploitation d'un hôpital, les seuls prix de journée, ou ceux-ci eu égard à la qualité des soins et à la qualification du personnel employé ?
De tels bilans sont aussi sérieux que ceux qui montraient, voilà une vingtaine d'années, la supériorité de la gestion déléguée du service public de l'eau sur sa gestion en régie. Avec le recul, on sait à quoi s'en tenir sur ce point, mais le but a été atteint : le marché français de l'eau est à 72 % confié à des opérateurs privés, ce qui est, paraît-il, l'un des taux les plus élevés au monde.
Ces bilans sont aussi sérieux que l'étaient la certification des comptes d'Enron par le cabinet Andersen, la certification de ceux de L&H par le cabinet KPMG ou la notation des « paquets » de titres par les agences internationales les plus prestigieuses, comme vient de le montrer la crise des subprimes.
Avant d'inventer de nouvelles formes de partenariat public-privé, la logique voudrait que l'on procède à une évaluation des formules existantes.
En France, le recul est insuffisant pour que l'on puisse le faire sérieusement. Là où les partenariats public-privé « new look » sont utilisés depuis longtemps, au Royaume-Uni notamment, les jugements sont pour le moins partagés. La littérature et les sites officiels - du gouvernement et des grands groupes privés - vantent évidemment les mérites des partenariats public-privé ; ailleurs on les tient pour des opérations risquées, onéreuses, rendant aux usagers un service de moindre qualité.
Si l'on ajoute à cela que la France, comme l'a rappelé tout à l'heure Charles Guené, ne souffre pas d'un manque d'investissements publics, il devient clair que la volonté d'étendre le champ d'application des PPP ne procède pas d'une démarche technique. La modernisation a bon dos ! Beaucoup de formules éprouvées existent déjà, et les nouvelles représentent encore un pari. La raison de cette volonté d'extension des PPP est non pas technique mais idéologique, pour ne pas dire quasiment théologique. Je m'explique.
Certains orateurs l'ont déjà souligné, les PPP ont d'abord le pouvoir incomparable de transformer la mauvaise dette publique en inoffensive dette privée - inoffensive tant que l'édifice tient debout, évidemment, mais qu'en sera-t-il à l'issue de la crise actuelle ? En l'absence d'urgence ou de complexité du projet, la vertu essentielle des PPP est et demeure de permettre d'améliorer le ratio national d'endettement et de calmer Bruxelles, ce qui n'est tout de même pas un mince avantage. Cela représente 10 milliards d'euros de gagnés à cet égard, nous a dit M. Charles Guené.
Pour les collectivités territoriales aussi, le PPP est un moyen de limiter la dégradation de leur ratio d'endettement et de réduire les inconvénients correspondants, notamment en période d'élections. Si remplacer des charges de remboursement d'emprunt par des frais de fonctionnement ne change rien à la situation financière réelle des collectivités territoriales ou de l'État, le « look » est bien meilleur, et surtout la vulgate idéologique est honorée.
Selon les « tables de la loi », en effet, les acteurs privés font forcément mieux que les acteurs publics. Cela nous a été encore affirmé tout à l'heure. La gestion privée est, par essence, plus efficace que la gestion publique. Il faut donc réduire au minimum le champ d'action de cette dernière, et les PPP constituent un instrument adapté à cette fin.
Les incroyants, dont je suis, ont certes du mal à comprendre comment des opérateurs qui empruntent à des taux plus élevés que les personnes publiques, qui supportent des frais de structure importants, qui doivent distribuer des dividendes à des actionnaires de plus en plus gourmands et des rémunérations à la hauteur des compétences hors normes de leurs dirigeants, qui, dans le cas des PPP, se font payer au prix fort pour les risques qu'ils acceptent de prendre peuvent, au final, obtenir des coûts de gestion inférieurs à ceux des opérateurs publics. S'ils ne comprennent pas, c'est précisément parce que ce sont des incroyants. S'ils ne l'étaient pas, ils « sauraient », ce qui les dispenserait de comprendre et de s'épuiser à interroger les faits. Ce n'est pas aux faits de justifier la doctrine, c'est à la doctrine de dire le fait.
Ainsi, en juillet 2001, Andrew Smith, alors Chief Secretary to the Treasury au pays des merveilles des PPP, déclarait devant la Chambre des communes que, selon un rapport du National Audit Office intitulé PFI and value for money, c'est-à-dire PPP et compétitivité, les partenariats public-privé, objet de tous les soins du Gouvernement, permettaient de faire une économie de 20 % par rapport aux autres formules de gestion du service public. Fâcheusement, il apparut qu'un tel rapport comparatif de synthèse n'existait pas ; le ministre l'avait tout simplement inventé et s'était contenté de citer deux rapports favorables aux PPP, dont l'un avait été rédigé par le cabinet Arthur Andersen, avant qu'il ne ferme boutique, en ignorant les études qui leur étaient défavorables.
La vérité, dira un député de l'opposition, est que les PPP n'apportent pas plus d'avantages au service public, sont souvent plus coûteux et aboutissent à la fourniture d'un service de moindre qualité.
J'ai donc tendance à douter qu'ils auraient eu jadis la faveur de Colbert, dont vous avez invoqué les mânes, madame la ministre. Vous aurez d'ailleurs noté que, derrière moi, il est resté de marbre !
Sourires

La banalisation des PPP n'a en tout cas pas notre faveur, comme vous l'a déjà dit mon collègue Jean-Pierre Sueur et comme je me suis efforcé de vous l'expliquer une nouvelle fois.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j'avais préparé quelques notes en vue de vous faire part de mon opinion sur les partenariats public-privé, mais les propos que j'ai entendus jusqu'à présent m'ayant souvent « hérissé le poil », je m'en écarterai quelque peu pour leur répondre !
Je suis à peu près persuadé que tous ceux qui se sont exprimés n'ont jamais expérimenté le partenariat public-privé, ne sont donc pas entrés dans le détail du mécanisme pour voir comment il fonctionne et pour appréhender les difficultés et les avantages du dispositif.
Je voudrais tout de même rappeler que notre pays, comme beaucoup d'autres, évolue dans une conjoncture internationale et dans un environnement particulièrement difficiles et qu'il est de notre responsabilité d'élus d'explorer toutes les voies pouvant permettre d'améliorer la situation et, si possible, de conduire à des économies et d'accélérer les procédures.
Je pense que nous n'avons pas vraiment, dans notre société, le sentiment de l'écoulement du temps. Or le temps, c'est de l'argent ! Quand il faut de cinq à sept ans pour construire un collège alors que cela pourrait être fait en trois ans, quand la réalisation d'une route prend de quinze à vingt ans alors qu'elle devrait être achevée en cinq ou dix ans, cela engendre un coût non seulement financier, mais aussi administratif, qui est considérable. De surcroît, cela a une incidence au regard de l'aménagement de notre territoire, qui perd de sa compétitivité par rapport à d'autres. Si nous observons bien notre société, nous constatons l'existence d'un certain nombre de difficultés que nous devons surmonter.
Mme la ministre a déclaré, dans son intervention liminaire, qu'il faut moderniser notre économie corporelle et incorporelle. C'est effectivement, à mon sens, un vrai problème. Or en abordant le thème du PPP, nous entrons véritablement dans la modernisation de notre économie incorporelle.
À ce propos, je voudrais relativiser des chiffres qui ont été donnés tout à l'heure. Il est vrai que 73 % des 60 milliards d'euros annuels d'investissements publics proviennent des collectivités territoriales. Cela représente certes des sommes très importantes, mais l'objectif visé, comme cela a été dit lors de différentes réunions de commission, est que la part des PPP atteigne 15 % du montant total. En conséquence, les 60 milliards d'euros que j'évoquais à l'instant ne constituant qu'un sixième de l'investissement à l'échelon national, ce n'est que de 2, 5 % de ce dernier dont il s'agit ici. Voyez donc de quoi nous discutons aujourd'hui !
Je trouve quelque peu dommage de consacrer du temps à saisir le Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État sur un sujet qui ne représentera, à terme, que 2, 5 % de l'investissement national. J'estime qu'il y a mieux à faire.

Par ailleurs, je comprends fort bien le lobbyingdes architectes : il est normal. On se plaignait récemment dans la presse que les parlementaires soient approchés par tels ou tels lobbyistes représentant des professions souhaitant que nous les prenions en considération et que nous les protégions. De telles démarches me semblent légitimes, mais il faut aussi, à mon sens, protéger le citoyen en modérant les coûts. La réalité indépassable, c'est le coût de ce que l'on fait.

Certains orateurs ont pris l'exemple de réalisations à l'horizon de trente à quarante ans, disant qu'il était impossible de prouver quoi que ce soit à cette échelle de temps. Peut-être, mais le PPP n'est pas conçu pour que toutes les opérations soient à échéance aussi lointaine.
À cet instant, je voudrais évoquer un exemple qui me paraît intéressant, bien qu'un peu délicat parce que le tribunal administratif doit se prononcer sur cette opération. Cela étant, le collège en question est construit, il est en service, on ne le fera pas raser et donc tout va bien hormis ce problème administratif. Je vous invite d'ailleurs, très amicalement, monsieur Sueur, à faire un stage au conseil général du Loiret, invitation que j'ai adressée également à M. Attali, qui en aurait bien besoin !
Sourires
Nouveaux sourires.

L'exemple que je vais donc vous présenter me semble assez parlant. J'ai fait construire parallèlement deux collèges, le premier ayant fait l'objet d'un partenariat public-privé, le second, de même capacité, étant réalisé selon le schéma classique.
Le premier collège est achevé. Il est ouvert depuis la rentrée de septembre 2007. Le second collège ouvrira ses portes, si tout va bien et que nous ne rencontrons pas d'obstacle tel que par exemple un appel d'offres déclaré infructueux, à la rentrée de 2009 : deux ans plus tard donc, alors que les deux projets ont été lancés en même temps.
Par ailleurs, si les coûts de réalisation des deux collèges sont équivalents, dans le premier cas sont inclus, pour la durée du contrat et pour le même prix, l'entretien, la fourniture des fluides, les impôts, la maintenance, le chauffage et le gardiennage : le collège qui ouvrira en 2009 coûtera au conseil général environ 20 millions d'euros, l'autre 21 millions d'euros sur dix ans, soit 2, 1 millions d'euros par an tout compris. Je peux vous dire que l'économie aujourd'hui démontrée est de 15 %.
Les citoyens devraient, me semble-t-il, être satisfaits d'une telle économie, car ils nous élisent afin que nous employions le mieux possible les deniers qu'ils mettent à notre disposition. De surcroît, nous avons rendu service à la communauté éducative, aux élèves, en un mot nous avons amélioré la situation scolaire.
Je ne voudrais pas prolonger exagérément mon intervention, mais je tiens à revenir sur les propos tenus tout à l'heure par M. Collombat, qui a affirmé que le partenariat public-privé relevait de l'idéologie. Eh bien non ! il s'agit de la réalité économique du terrain : ce dispositif nous permet d'essayer de faire le plus possible avec les moyens dont nous disposons, en dépensant le moins possible. Je peux vous dire que la comparaison entre les deux établissements que j'ai évoqués est à l'avantage de celui qui a fait l'objet d'un partenariat public-privé, dont la réalisation est d'une qualité exceptionnelle.
Pour conclure, j'énumérerai un certain nombre d'avantages du partenariat public-privé que j'ai pu relever et qu'il me paraît intéressant de préciser. J'espère que le tribunal administratif m'entendra, on ne sait jamais !
Sourires

Le coût du collège et de l'internat - c'était la première fois que nous réalisions un collège doté d'un internat, l'opération était donc assez complexe - construits dans le cadre d'un PPP était inférieur de 11 %, et même de 15 % à la suite des révisions de prix, à celui de la réalisation du collège de Courtenay.
Le risque de non-livraison à l'échéance prévue est entièrement supporté par le partenaire privé. C'est un point important : en termes de responsabilité, lorsqu'une entreprise privée construit un collège, tout doit être prêt pour la rentrée scolaire, alors que, dans le public, on ne fait qu'essayer d'y parvenir.
La disponibilité immédiate sur le site de l'entreprise permet d'assurer une maintenance courante et les travaux d'entretien, y compris des espaces verts. Pour l'entretien d'un collège, une entreprise privée va s'arranger pour atteindre l'objectif qui lui est fixé, alors que, dans le public, un tel résultat ne peut pas toujours être garanti si les moyens en personnel ne sont pas suffisants. Les règles ne sont pas les mêmes.
Le gardiennage du site est assuré tout au long de l'année, alors que, pour un collège classique, ce n'est le cas que pendant la période scolaire.
Enfin, la qualité du projet ainsi que celle des matériaux et procédés de construction utilisés reflètent l'engagement du partenaire à long terme et son implication dans le choix de la durabilité.
Je vais vous narrer une petite anecdote, pour égayer quelque peu les travaux de notre assemblée.
Dans mon département, lorsque j'ai annoncé, lors de la réunion annuelle des principaux de collège, le projet de collège en PPP, beaucoup ont crié au scandale : le privé allait intervenir dans un domaine public et, qui plus est, dans l'éducation nationale ! L'année suivante, lorsque les principaux ont appris que le collège en question serait repeint au bout de cinq ans, la façade ravalée et la toiture remise à neuf au bout de dix ans, comme le prévoit le contrat, ils voulaient tous que des PPP soient lancés pour leurs établissements. Et pourtant, ils n'étaient pas tous de ma sensibilité politique ! Ils ont donc certainement été quelque peu convaincus.
C'est la raison pour laquelle, monsieur Sueur, je vous invite à venir faire un stage dans mon département : cela permettrait peut-être de rapprocher nos points de vue !
Sourires

Madame la ministre, les orientations que vous avez prises dans ce texte vont tout à fait dans le sens que l'on pouvait souhaiter : aux deux voies classiques de recours au PPP, s'ajoutent deux voies supplémentaires qui me paraissent indispensables.
La situation actuelle montre bien que le régime des PPP souffre de quelques difficultés d'appréciation. Il ne faut pas, par exemple, en rester à la notion d'urgence telle qu'on la définissait après la guerre, c'est-à-dire lorsqu'il y a un risque que le bâtiment s'effondre. Aujourd'hui, notre société est confrontée à d'autres formes d'urgences, notamment en termes de qualité ou de services. Je souhaite donc que votre texte soit voté en totalité, avec les quelques petites améliorations qui permettront d'éviter certaines difficultés.
Pour conclure, j'espère que le collège du Loiret sera classé au patrimoine de l'humanité, puisque j'ai cru comprendre que, pour en faire partie, c'est l'originalité - dans ce cas, dans le choix des procédures - qui prime !
Sourires

Mon collège est en effet le premier de France à avoir été construit en PPP. J'ai été à cet égard très vexé que vous ne l'ayez pas mentionné dans votre propos liminaire, mais je continuerai à le citer en exemple, en espérant qu'un jour vous ferez état des réalisations de mon département !
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.
Monsieur le président, messieurs les présidents de commission, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de la richesse de ce débat, qui prouve à quel point les PPP, loin d'être un sujet purement technique, sont importants pour notre pays et pour sa modernité.
Monsieur Doligé, c'est avec grand plaisir que je range le collège du Loiret dans la catégorie des ouvrages d'art réalisés grâce à un instrument juridique de qualité !
Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.
Messieurs les rapporteurs, je voudrais remercier chacun d'entre vous de la qualité de vos rapports et de vos interventions, ainsi que de la modernité dont vous avez fait preuve dans l'appréhension des questions soulevée par le PPP. Monsieur le président de la commission des lois, je salue la façon dont vous avez conduit des travaux parlementaires de grande qualité.
Je vous ai parlé tout à l'heure de Pierre-Paul Riquet - nous sommes au moins deux, monsieur Dubois, à nous préoccuper des voies navigables ! - l'architecte génial du canal du Midi, qui a été le vecteur de ce nouvel instrument juridique qu'était la concession. J'ai oublié de vous préciser que M. Riquet avait également été un visionnaire en matière sociale : le mécanisme qu'il avait mis en place - il y a plus de trois cents ans - pour permettre une prise en charge du risque des salariés peut être considéré comme l'ancêtre de la sécurité sociale. Cette anecdote me renforce dans la conviction que la commande publique se trouve à la frontière de l'économique et du social, et qu'elle est certainement aussi un déterminant de l'attractivité du territoire.
Comme l'a souligné M. Béteille, les PPP répondent sans aucun doute à une exigence de rendement en permettant à un même acteur privé d'assurer une prestation dans toutes ses phases, du début jusqu'à la fin. Le cas qu'évoquait M. Doligé en est la parfaite illustration, tant les éléments comparatifs étaient convaincants ! Cependant, si la commande est globale, le paiement est scindé. L'État gagne ainsi sur les deux tableaux : sur le caractère global de la commande, y compris au regard des règles de la concurrence, et sur le caractère scindé du paiement, qui est parfaitement légitime pour une utilisation efficiente des deniers publics.
La fiabilité et l'ambition du service public trouvent, quant à elles, leur traduction dans la diversité des travaux lancés : l'éclairage public de la ville de Rouen en février 2007, l'informatisation des collèges d'Eure-et-Loir à la même époque, la billetterie électronique du château de Versailles en janvier 2007, ou la construction d'un troisième lot d'établissements pénitentiaires en sont le témoignage. Mais elles supposent également un strict respect de la procédure, notamment en ce qui concerne l'évaluation préalable. Non seulement notre projet de loi ne revient pas sur cette exigence, mais, bien au contraire, il la renforce en procédant à certains aménagements de la procédure de passation pour les adapter aux spécificités du contrat de partenariat.
Je voudrais rappeler à M. Sueur que le PPP doit rester une procédure exceptionnelle.
Nous ne revenons pas sur ce point, mais il peut se trouver que, pour des périodes limitées ou pour répondre à certains critères, l'exception tende à être prolongée ou étendue, au-delà en tout cas de ce que permettrait la condition d'exceptionnalité entendue trop strictement, c'est-à-dire de manière excessivement rigoriste.
Pour ceux d'entre vous qui s'en soucieraient, il s'agit donc non pas d'une privatisation du service public sous quelque forme que ce soit, mais bien plutôt d'une utilisation des compétences privées dans un cadre juridique moderne au service du public.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais à présent répondre à vos questions de la manière la plus précise possible, vos commentaires et vos interrogations ayant été particulièrement exhaustifs et de qualité.
Le partenariat entre le public et le privé vise un objectif : celui de favoriser l'investissement public qui, comme l'a relevé M. Guené, est un facteur d'attractivité pour notre pays. Lorsque l'on interroge les investisseurs directs étrangers - ils classent toujours la France comme troisième destination au monde -, l'un des critères fréquemment évoqués pour justifier l'attractivité de la France est la qualité des infrastructures publiques et le contexte dans lequel elles se trouvent. Or un mécanisme qui est intelligent à la fois sur le plan juridique et sur celui du financement contribue grandement à la qualité de ces infrastructures.
Monsieur Billout, je relève que vous partagez le souci du Gouvernement de favoriser l'investissement public. Je vous indique que, loin de constituer l'importation en France d'un concept britannique, il s'agit simplement, avec le PPP, de généraliser sur notre territoire un système juridique qui existe actuellement dans des pays aussi peu anglo-saxons sur le plan de l'application du droit que l'Espagne, le Portugal ou même l'Allemagne. On cite souvent le private finance initiative, ou PFI, parce qu'il est le mécanisme le mieux connu et le plus ancien, mais le PPP est également utilisé dans des pays de droit continental.
Monsieur Houel, vous avez évoqué la nécessité d'aborder les PPP avec pragmatisme et vigilance. Je ne peux qu'être d'accord avec votre approche. Je suis ainsi sensible à vos propositions qui visent à développer l'évaluation préalable des grands projets. L'État doit en effet être exemplaire en la matière. L'extension de la pratique de l'évaluation favorisera, d'une part, la réflexion en amont et donc la maîtrise ou, en tout cas, la bonne appréciation des risques et, d'autre part, des économies en aval, en tout cas nous l'espérons !
Je crois également souhaitable, comme l'a proposé M. Béteille, de préciser davantage encore les conditions dans lesquelles l'urgence peut être regardée comme établie. Nous y reviendrons dans le courant de la discussion.
La méthodologie des organismes-expert doit également être affinée. Ce projet de loi sera l'occasion d'une mise à jour du guide des bonnes pratiques - certains d'entre vous y ont fait référence - rédigé par les services de mon ministère. La mission d'appui aux PPP assurera ainsi la diffusion de la méthodologie qu'elle a pu développer, en particulier en matière d'analyse des risques.
Plusieurs d'entre vous, dont M. Girod, ont mentionné le fait qu'il était bien agréable de pouvoir se reposer sur la compétence et l'expertise de partenaires privés, dont le métier est de mettre en place des solutions complètes comportant à la fois le financement, les propositions de réalisation, la mise en oeuvre et la gestion.
Il est aussi important de disposer en parallèle d'un centre d'expertise et de comparaison des meilleures pratiques. À cet égard, la mission d'appui aux PPP peut être une ressource tout à fait utile au service de toutes les collectivités locales. En tout cas, j'y veillerai lors de la mise en oeuvre de ce texte, s'il est adopté.
J'ai également été interrogée sur les moyens susceptibles de favoriser le caractère attractif du régime juridique du contrat de partenariat.
La question du régime spécifique de la cession de créance propre aux contrats de partenariat a ainsi été évoquée, notamment en comparaison avec le système de cession Dailly. Le projet de loi vise à accroître l'intérêt de ce régime pour les collectivités publiques comme pour les partenaires privés, en incluant dans son assiette certains des frais financiers jusque-là exclus et en prévoyant une sécurisation analogue à celle produite par le mécanisme de l'acceptation en cession Dailly. J'entends bien prendre en compte les remarques qui m'ont été adressées ; nous en reparlerons donc plus en détail lors de l'examen des amendements portant sur ce sujet.
Certains d'entre vous - notamment M. Houel - ont évoqué la question du rôle que peut jouer le PPP à l'égard des PME et de la manière d'encourager ces dernières à y participer.
Le Gouvernement est particulièrement soucieux dans toute son action du sort des PME, en l'espèce en leur permettant d'être parties prenantes du développement souhaité des PPP. J'aurai bientôt l'occasion de soumettre un certain nombre de dispositions à votre assemblée dans le cadre du projet de loi de modernisation de l'économie. Le Sénat pourra ainsi constater que le Gouvernement prévoit de nombreuses dispositions pour encourager les PME.
En matière de PPP, cet encouragement se traduit de deux façons. Les PME ont d'abord la possibilité de participer aux PPP en premier rang pour les opérations de taille petite ou moyenne. J'en profite pour indiquer à cet égard qu'il ne me paraît pas souhaitable d'exclure le PPP des petites opérations : c'est précisément là que les PME peuvent intervenir. Les PME peuvent aussi contribuer à l'exécution des contrats en tant que prestataires du groupement choisi pour des opérations plus importantes en volume et en gestion de risques.
Pour la participation en tant que titulaires du contrat, une forte proportion des projets en contrat de partenariat ont été développés par des collectivités locales. Cela a été souligné à plusieurs reprises lors de la discussion : plus des trois quarts d'entre eux sont passés par ces collectivités, pour des projets qui sont, en général, de taille limitée, c'est-à-dire de moins de 30 millions d'euros d'investissement. Ces contrats sont à la portée des PME, soit seules quand elles sont moyennes, soit à plusieurs quand elles sont petites. En outre, l'ordonnance ne prévoit aucun seuil minimum d'engagement pour recourir à un contrat de partenariat.
Par ailleurs, vous vous êtes interrogés sur la situation des architectes, la question étant de savoir si les PPP les pénalisent. L'architecture est évidemment d'intérêt public. Ainsi les bâtiments publics, qui participent à l'identité de la ville, ont-ils besoin de l'intervention d'architectes de qualité. Fort heureusement, il en est de nombreux en France.
C'est pour ces raisons que les responsables des collectivités publiques, lorsqu'ils ont recours à des partenariats pour la construction, puis, ultérieurement, l'exploitation de leurs équipements, conservent, je l'ai déjà rappelé, la liberté de désignation du concepteur et de choix du projet architectural. Le mécanisme prévu dans le projet de loi permet bien entendu de reprendre l'ensemble des contrats qui ont été passés pour retenir tel ou tel concepteur d'ouvrage. Les responsables des collectivités publiques pourront donc déterminer le meilleur projet architectural puis, dans un second temps, consulter en contrat de partenariat, garantissant la qualité du projet et favorisant la transparence de la consultation.
Aussi a-t-il été expressément prévu dans l'ordonnance que la personne publique, préalablement à la procédure de choix d'un partenaire privé, puisse garder tout ou partie de la conception des ouvrages et la confier au concepteur, en particulier à l'architecte, qu'elle aura choisi en pleine responsabilité.
Cette clause a déjà été mise en oeuvre. Nous disposons donc d'un retour d'expérience. Sur la vingtaine d'avis relatifs à des projets à caractère « bâtimentaire » rendus par la mission d'appui à la réalisation des partenariats public-privé depuis l'origine, trois concernent des projets pour lesquels la conception a été dissociée de la réalisation, confiée à un partenaire privé. Pour votre information, il s'agit de la rénovation du zoo de Vincennes, dans une première version, et des théâtres de Perpignan et de Rambouillet, dont M. Gérard Larcher nous a parlé lors de la réunion de la commission.
Certains d'entre vous, en particulier M. Dubois, ont suggéré que, compte tenu de la complexité et de la multiplicité des modes de passation de la commande publique, on envisage un véritable code de la commande publique, à des fins de simplification. Cela me paraît être une excellente initiative, à condition qu'un tel code soit non pas simplement l'accumulation de tous les textes existants, mais le résultat d'un travail d'harmonisation et de consolidation. Dans ces conditions, un tel code serait opportun.
Je vous signale à cet égard qu'Éric Besson a été chargé par le Premier ministre d'une mission sur l'articulation entre eux des différents instruments de la commande publique. Il doit remettre son rapport au Premier ministre très prochainement. Un code de la commande publique pourrait ensuite parfaitement être envisagé.
Je répondrai maintenant très précisément à M. Guené concernant les cinq règles d'or de la commission des finances du Sénat pour la réussite financière des PPP.
La première règle d'or que vous avez fixée, je la rappelle, est de limiter les possibilités de recours aux PPP, à la lumière en particulier de l'expérience du Royaume-Uni.
Il est évidemment un peu tôt pour se fonder simplement sur le bilan de l'expérience française. L'expérience britannique est bien sûr précieuse, et nous devons nous en inspirer. Compte tenu des enseignements britanniques, il faut renforcer l'exigence de vigilance. Ils ne doivent toutefois pas nous conduire à fixer hâtivement des règles générales dont l'application au cas français, et au droit continental, ne serait pas nécessairement adaptée. Je précise que, dans le cadre de la mission que lui a confiée le Premier ministre, Éric Besson a également examiné en Grande-Bretagne la manière dont fonctionnent les, les fameux PFI, et vérifié si les collectivités publiques britanniques sont ou non satisfaites des résultats de l'expérience.
Votre deuxième règle d'or, monsieur le rapporteur pour avis, est de mesurer la performance de l'investissement public grâce à des indicateurs spécifiques mesurant eux-mêmes le respect des délais et des budgets initiaux. Les résultats seraient ensuite présentés au Parlement dans le projet de loi de finances.
Vous avez raison : il est effectivement impératif de se doter d'instruments de mesure de l'efficacité économique de l'investissement public, notamment dans le cadre de contrats complexes. Mais ces indicateurs ne seront pas adaptés s'ils sont génériques : ils doivent être, me semble-t-il, construits par secteurs, par exemple l'immobilier ou les technologies de l'information et de la communication. Les indicateurs de performance pourraient également différer selon qu'ils s'appliquent à du corporel ou à de l'incorporel. Certains indicateurs mentionnés existent déjà dans le cadre de la procédure dite de « justification au premier euro ». Cette démarche doit être poursuivie, car elle me semble aller dans le sens de la deuxième règle d'or proposée par la commission des finances.
J'en viens à la troisième règle d'or : la construction d'un référentiel d'évaluation commun aux administrations publiques et à la Cour des comptes. Une telle démarche me paraît en effet tout à fait souhaitable à moyen terme.
La quatrième règle d'or est d'étoffer les équipes de maîtrise d'ouvrage des différents ministères.
Le Gouvernement est parfaitement conscient de la nécessité de doter les différents ministères des compétences permettant de professionnaliser l'acheteur public et d'ouvrir l'accès à une expertise indépendante. On peut à cet égard noter que le projet en cours de réforme des achats de l'État vise précisément à créer au sein de chaque ministère un pôle « achats », avec un niveau accru de compétence. Ce pôle pourrait également servir pour les opérations de maîtrise d'ouvrage publique.
La direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, et la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat public-privé remplissent déjà une mission interministérielle d'expertise publique et de conseil. Le fait de conférer la maîtrise d'ouvrage à des partenaires privés ne doit pas conduire - c'est crucial - à une perte de compétences au sein de l'administration. Au contraire, l'expertise des financements de projets doit être renforcée.
Le plan de stimulation des contrats de partenariat dont le présent projet de loi constitue le volet législatif comporte également un programme de formation intensive d'une sorte de corps d'élite spécialisé dans les partenariats public-privé, auquel viendront s'ajouter dans chacun des ministères un certain nombre de spécialistes, formés par la mission d'appui et l'ensemble des corps spécialisés dans ces matières.
Votre cinquième règle d'or, monsieur le rapporteur pour avis, est que les contrats de partenariat ne doivent pas être utilisés comme un outil d'optimisation de la dette budgétaire. Je ne peux que souscrire à cette exigence.
Vous avez rappelé que si 15 % des investissements publics étaient réalisés en partenariats public-privé et déconsolidés, on parviendrait à diminuer de 0, 6 point de PIB par an la dette publique au sens de Maastricht.
M. Girod a évoqué la distinction établie par la norme Eurostat, dont la clarté, j'en conviens, peut parfois échapper aux plus aguerris d'entre nous. Il me paraît tout à fait légitime d'établir la liste des engagements hors bilan qui seraient conformes aux critères d'Eurostat et néanmoins extraits de la dette de l'État. En outre, une telle mesure serait conforme à la sincérité budgétaire que j'appelais de mes voeux au début de la discussion générale.
Je ne rappellerai pas les critères de distinction d'Eurostat, vous l'avez fait, monsieur Girod. Il est vrai qu'ils présentent un degré d'incertitude parfois bien délicat lorsqu'il s'agit de classer telle ou telle opération de tel ou tel côté. En l'espèce, la grande vigilance dont fait généralement preuve l'INSEE est de nature à nous rassurer. L'INSEE a en effet toujours plutôt tendance à classer un engagement dans la dette, au sens maastrichtien, plutôt que hors la dette.
Je répondrai maintenant à M. Sueur, qui a évoqué le pari de Pascal. À défaut de vous convertir, monsieur Sueur, permettez-moi au moins de tenter de vous convaincre de la constitutionnalité des dispositions que nous vous soumettons.
Sourires
La création d'un troisième cas de recours aux contrats de partenariat que vise à introduire dans l'article 2 de l'ordonnance l'article 2 du projet de loi a été validée par le Conseil d'État et présente les garanties de constitutionalité au regard de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003.
J'ai pris soin de relire les deux décisions du Conseil constitutionnel, car vous êtes tous ici de fins juristes, et de vérifier avec exactitude les termes qui y étaient utilisés, en ayant à l'esprit les arguments que vous avez avancés. Je souhaitais une nouvelle fois m'assurer de la constitutionnalité du dispositif que nous vous soumettons, même si, bien évidemment, le Conseil d'État, qui l'a examiné à la lumière des deux décisions du Conseil constitutionnel, nous a déjà donné des assurances en ce sens.
Permettez-moi de vous faire part de certains des éléments qui plaident en faveur de la conformité aux décisions du Conseil constitutionnel des deux possibilités supplémentaires de recours aux contrats de partenariat prévues dans le projet de loi.
Lorsque le Conseil constitutionnel fait référence aux notions d'urgence et de complexité, il n'énumère pas de manière exhaustive et limitative les cas dans lesquels il est possible d'avoir recours à un contrat de partenariat. Il les cite à titre d'exemple. C'est ainsi qu'il parle de « situations répondant à des motifs d'intérêt général » - ces termes sont importants - « tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable ».
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel précise que « l'urgence qui s'attache à la réalisation du projet envisagé est au nombre des motifs d'intérêt général pouvant justifier la passation d'un contrat de partenariat ».
L'utilisation par le Conseil constitutionnel dans les deux considérants des termes « tels que », dans le premier, et « au nombre de », dans le second, me paraît donc indiquer que le Conseil constitutionnel a simplement souhaité donner deux exemples d'un principe - le motif d'intérêt général, qui recouvre celui du bon usage des deniers publics.
Dans ces conditions, l'extension des possibilités de recours au contrat de partenariat prévue dans ce projet de loi - le critère étant, d'une certaine manière, l'efficience, et donc la bonne gestion des deniers publics, à la lumière d'une évaluation nécessaire et renforcée - me paraît répondre aux exigences de constitutionnalité que le Conseil d'État nous a indiquées.
Je n'ignore pas, par ailleurs, que nous allons beaucoup discuter du quatrième cas d'ouverture d'un contrat de partenariat prévu dans ce texte, notamment des trois critères que sont la limitation dans le temps, la limitation dans les matières et le caractère non manifestement défavorable de l'évaluation préalable.
Telles sont, monsieur le président, les réponses que je souhaitais apporter aux intervenants dans la discussion générale.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.

Je suis saisi, par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, d'une motion n°96, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l'article 44, alinéa 2, du règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif aux contrats de partenariat (n° 211, 2007-2008).
Je rappelle que, en application de l'article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l'auteur de l'initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d'opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
En outre, la parole peut être accordée pour explication de vote, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, à un représentant de chaque groupe.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, auteur de la motion.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les contrats de partenariat sont apparus dans le paysage de la commande publique avec l'ordonnance du 17 juin 2004.
Je ne remonterai pas le cours de l'histoire avec vous, madame la ministre, ni d'ailleurs le cours du temps. Je rappellerai simplement que les ébauches de partenariats public-privé avaient été instaurées en 2002 par deux lois, respectivement la loi d'orientation et de programmation pour la justice et la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. Ces textes permettaient déjà à l'administration de signer de tels contrats dans le but de construire ou de rénover des prisons et des gendarmeries.
Néanmoins, c'est avec la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit que le Gouvernement a officialisé les contrats de partenariat et décidé de généraliser cet outil nouveau de la commande publique.
Seulement voilà, un obstacle, et non des moindres, est venu briser l'élan gouvernemental : le Conseil constitutionnel, saisi de la loi d'habilitation, a certes validé le principe des contrats de partenariat, mais il en a en revanche refusé la généralisation prévue à l'époque.
Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que les contrats de partenariat étaient non pas des outils juridiques équivalents aux marchés publics, aux délégations de service public ou aux concessions, mais des dérogations. Il a ainsi estimé que « la généralisation de telles dérogations au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics ».
À ce titre, les contrats de partenariats doivent être réservés, toujours selon le Conseil constitutionnel, « à des situations répondant à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. »
La décision du Conseil constitutionnel est ainsi venue quelque peu bouleverser les plans du Gouvernement qui, sans y renoncer, a tout de même dû intégrer dans l'ordonnance de 2004 les réserves d'interprétation du Conseil.
Le recours aux contrats de partenariat n'est donc possible que pour les projets qui relèvent de l'urgence et pour ceux dont la complexité le justifie.
Mais, malgré un régime fiscal intéressant, les partenariats public-privé n'ont pas connu l'essor escompté. Vingt-deux contrats de partenariat ont été signés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, et sept par l'État.
Ainsi, dans une lettre adressée au Premier ministre au mois d'octobre dernier, le Président de la République a exprimé sa volonté de redynamiser et de relancer les partenariats public-privé.
Madame la ministre, en présentant le projet de loi en conseil des ministres, vous avez indiqué que celui-ci visait à « faire du contrat de partenariat un instrument qui trouve pleinement sa place dans la commande publique, et non plus un simple outil d'exception ». Vous l'avez d'ailleurs répété ici-même.
À première vue, cette seule affirmation semble contraire à la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003. Jugeant les réserves d'interprétation des sages trop rigides et trop restrictives, le Gouvernement a décidé de développer le recours aux partenariats public-privé.
Votre volonté de contourner la décision du Conseil constitutionnel est à peine masquée. Elle nous est d'ailleurs confirmée par la lecture du projet de loi, dans lequel deux nouveaux cas d'ouverture de contrats de partenariat apparaissent.
Premièrement, le projet de loi prévoit le recours à ces contrats lorsque l'intérêt économique et financier est démontré à l'issue d'une évaluation des différents modes d'action dont la personne publique dispose pour répondre à ses besoins. En d'autres termes, si le bilan est manifestement avantageux au regard des autres outils de commande publique, le recours aux contrats de partenariats devient possible.
Deuxièmement, ce texte envisage également le recours aux partenariats public-privé jusqu'au 31 décembre 2012 pour les secteurs de l'action publique présentant un besoin immédiat en investissements.
En clair, dès qu'une décision du Conseil constitutionnel est gênante, il faut la contourner !
Madame la ministre, avec ce projet de loi, vous ne respectez ni la lettre ni l'esprit de la décision du Conseil constitutionnel. D'ailleurs, vous ne vous en cachez même pas, puisque vous avez clairement l'intention d'ôter aux contrats de partenariat leur statut d'exception et de les banaliser.
Examinons d'un peu plus près le contenu du projet de loi.
La première nouvelle voie de recours présentée par le texte concerne le bilan positif entre les coûts et les avantages par rapport aux autres outils de la commande publique.
Un tel choix est étrange, car l'évaluation préalable prévue aux articles 2 et 14 de l'ordonnance du 17 juin 2004 est déjà destinée à exposer les motifs, notamment économiques et financiers, ayant conduit la personne publique ou la collectivité territoriale à retenir le projet envisagé après une analyse comparative en termes de coût global, de performance et de partage des risques.
Cette évaluation préalable constitue déjà une sorte de bilan entre les coûts et les avantages. C'est la loi. Il s'agit d'une une étape préliminaire qui ne sort pas du cadre défini par le Conseil constitutionnel. De toute façon, les projets faisant l'objet d'une telle évaluation doivent être complexes ou présenter un caractère d'urgence.
Et votre objectif est précisément de rendre les contrats de partenariat systématiquement plus avantageux que tous les autres outils de la commande publique. C'est d'ailleurs le seul intérêt pour vous. Il s'agit essentiellement de faire apparaître les marchés publics et les autres outils de la commande publique comme ceux qui sont toujours les plus onéreux.
La deuxième nouvelle voie de recours aux contrats de partenariat est, quant à elle, sectorielle. Jusqu'à la fin de l'année 2012, elle est réservée à certains secteurs réputés présenter un caractère d'urgence, tels que l'enseignement supérieur et la recherche, la justice ou la santé publique.
Mais lorsque de tels besoins urgents existent - et, en l'occurrence, c'est effectivement le cas ! -, l'ordonnance de 2004 prévoit déjà la possibilité de recourir aux contrats de partenariat. Alors, quel besoin serait plus impérieux ?
Une fois de plus, pour comprendre la finalité d'une telle mesure, il faut lire entre les lignes. L'article 2 énumère certes avec précision les secteurs dans lesquels les projets seront réputés présenter un caractère d'urgence, mais il ouvre un champ plus vaste encore. En effet, les besoins sont grands en matière de rénovation urbaine et d'amélioration des conditions d'étude et de vie étudiante, d'accessibilité des personnes handicapées ou d'efficacité énergétique des bâtiments publics.

Ce sont quasiment tous les champs des marchés publics habituellement utilisés par les administrations dans de tels domaines qui sont ici mentionnés. Or ces projets seront a priori à même de présenter un caractère d'urgence - on peut effectivement parler d'« urgence » en la matière - et pourront donc faire l'objet d'un contrat de partenariat.
En procédant de la sorte, le Gouvernement permet, voire impose, aux administrations concernées de ne signer que des contrats de partenariat pour les projets énumérés à l'article 2. De fait, il exclut a priori les autres outils de la commande publique pour ces projets. Ou comment faire encore progresser les contrats de partenariat dans le droit de la commande publique !
Ainsi, vous pensez discrètement parvenir à généraliser les contrats de partenariat, qui sont théoriquement cantonnés au rôle d'exceptions, à l'ensemble des projets qui auraient dû aboutir, pour les uns, à des marchés publics et, pour les autres, à des délégations de service public ou à des concessions.
Or le Conseil constitutionnel s'est précisément opposé à une telle généralisation et a justifié l'énoncé de sa réserve d'interprétation par les principes d'égalité devant la commande publique, de protection des propriétés publiques et de bon usage des deniers publics.
S'agissant de l'égal accès à la commande publique, le risque que les petites et moyennes entreprises ne disposent pas de la taille nécessaire pour se porter candidates à de tels contrats globaux a été soulevé en 2003.
Si l'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit prévoit « un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats prévus » par cet article, une telle précaution n'atténue en rien l'atteinte portée au principe d'égal accès à la commande publique, tant elle relève d'un voeu pieux plus que d'une obligation.
Nous le savons parfaitement, les entreprises les mieux placées pour répondre aux critères de ces contrats globaux sont les grandes entreprises de travaux publics. Elles n'ont d'ailleurs pas démérité ces dernières années pour encourager le développement des partenariats public-privé.
La généralisation des contrats de partenariat, telle qu'elle est prévue par le projet de loi, prive les petites et moyennes entreprises, les artisans et les architectes d'accès direct à la commande publique.
Le risque d'atteinte au principe d'égal accès à la commande publique était déjà justifié en 2003 - c'est ce qui a motivé le Conseil constitutionnel à limiter le recours aux contrats de partenariat -, et il le sera encore plus avec cette loi. À n'en pas douter, une telle disposition encourt toujours la censure du Conseil constitutionnel.
Les contrats de partenariat présentent pour vous un autre intérêt, celui de masquer artificiellement l'endettement des personnes publiques. Pourtant, malgré tout ce que vous pouvez prétendre, leur coût est particulièrement élevé pour l'État et les collectivités locales.
Dans sa décision du 26 juin 2003, le Conseil constitutionnel a consacré pour la première fois le principe de « bon usage des deniers publics ». Si ce principe est bien présent dans le code des marchés publics, où il est fait référence à la « bonne utilisation des deniers publics », le Conseil constitutionnel semble l'avoir fait découler de l'article XIV de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui dispose ceci : « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi ».
Or les partenariats public-privé représentent un coût élevé pour la collectivité en raison de leur mode de financement. Si ces contrats prévoient que le cocontractant assure le financement, ou plutôt le préfinancement, de l'ouvrage objet du contrat, il n'est pas envisagé de rémunération par l'usager. De fait, les deniers publics couvrent in fine la totalité des frais engagés par le contrat de partenariat.
En effet, c'est la personne publique qui rémunère le cocontractant privé par des loyers sur la durée du contrat. Or la phase de l'exécution du contrat la plus onéreuse étant évidemment non la maintenance, mais la construction même de l'ouvrage, le cocontractant privé devra, pour l'honorer, prendre en charge le préfinancement de l'ouvrage en faisant appel à des organismes bancaires. Cela revient donc à autoriser le paiement différé de tels contrats.
Le paiement différé a toujours été prohibé par le code des marchés publics. Cette formule contractuelle représente un endettement indirect qui pèsera sur les contribuables à plus ou moins long terme. Elle permet également de contourner les règles d'endettement maximum des collectivités locales.
Le rapport de la Cour des comptes pour l'année 2008 illustre parfaitement ces effets pervers. À propos du Centre des archives diplomatiques du ministère des affaires étrangères et européennes, qui a d'ailleurs été évoqué tout à l'heure, la Cour dresse le constat suivant : « De manière générale, cette opération pose la question des conséquences budgétaires et financières des opérations de partenariat public-privé, notamment dans le cas des autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Cette formule apparaît inopportune s'agissant d'un service public non marchand puisqu'en l'absence de recettes elle fait entièrement reposer sur les finances de l'État une charge disproportionnée au regard de l'allégement de la charge budgétaire immédiate qu'elle permet sur le montant du déficit comme sur celui de la dette publique. »
En guise de conclusion, la Cour des comptes « invite à une réflexion approfondie sur l'intérêt réel de ces formules innovantes qui n'offrent d'avantages qu'à court terme et s'avèrent finalement onéreuses à moyen et long termes ».
La généralisation de la formule du partenariat public-privé entraînera donc d'importantes conséquences financières tant pour l'État que pour les collectivités territoriales. Ainsi, l'atteinte portée au principe de bon usage des deniers publics est ici incontestable.
Qu'est-ce qui pousse le Gouvernement à tenter vaille que vaille d'imposer les contrats de partenariat dans le paysage de la commande publique ? Certainement pas la valorisation du bien commun ! Le partenariat n'est pas un mode de cofinancement entre la personne publique et la personne privée, qui sera intégralement remboursée de ses frais.
L'idée de partenariat traduit surtout le mouvement croissant de sous-traitance au secteur privé de la définition des besoins de l'administration, de leur financement et de la gestion ultérieure des équipements, mouvement qui ira peut-être un jour jusqu'à la privatisation des services publics concernés !
Il n'y a pas d'autre explication. En effet, il n'existe ni insécurité ni vide juridiques justifiant le recours à ces contrats de partenariat. Avant la création de ces derniers, la jurisprudence a justement comblé le vide qui pouvait exister entre marché public et délégation de service public. Le champ des marchés publics s'est ainsi étendu, de telle sorte que les deux régimes juridiques du marché et de la délégation étaient bord à bord.
L'objectif est donc de modifier les relations entre l'administration et son cocontractant, et ce pour des raisons non pas juridiques, mais bien politiques. Il s'agit, d'une part, d'échapper aux règles du code des marchés publics et à la législation sur la maîtrise d'ouvrage publique et, d'autre part, de disposer de possibilités accrues de privatisation de certains services publics.
Le projet de loi élargit donc la voie, déjà ouverte par l'ordonnance de 2004, de contournement du code des marchés publics et de ses règles, qui sont certes contraignantes, mais qui garantissent l'égalité d'accès et l'équité de la mise en concurrence.
Théoriquement, le régime des partenariats ne peut être utilisé que dans les deux séries d'hypothèses exceptionnelles prévues par le Conseil constitutionnel. C'est pourquoi ce projet de loi contourne sciemment cette décision.
Par conséquent, mes chers collègues, je vous invite à adopter cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

La commission émet un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Nous nous sommes déjà, me semble-t-il, longuement exprimés sur la constitutionnalité du présent projet de loi dans le cadre de la discussion générale.
De mon point de vue, la lecture du texte, telle qu'elle a été faite par les différents orateurs, montre bien que nous ne sommes pas dans un cas d'inconstitutionnalité. Le dispositif proposé s'inscrit parfaitement dans le cadre des principes rappelés par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003.
En effet, et nous avons été plusieurs à le souligner aujourd'hui, si le Conseil constitutionnel a souhaité encadrer le recours au contrat de partenariat, il n'a pas interdit la création de cas d'ouverture autres que l'urgence et la complexité, dans la mesure où ces deux critères ne constituent que des exemples de « motifs d'intérêt général » justifiant le recours à un tel contrat, l'expression « tels que », contenue dans la décision du 26 juin 2003, prouvant d'ailleurs qu'il s'agit seulement d'exemples.
En outre, si le projet de loi ouvre significativement la possibilité de recourir au contrat de partenariat, il ne la généralise pas pour autant. En effet, en réalisant un bilan, l'évaluation préalable doit prouver que le contrat serait effectivement le meilleur outil pour mener à bien le projet concerné.
La personne publique ne peut pas décider de recourir librement à ce contrat, à l'instar du marché public ou de la délégation de service public, pour laquelle - je vous le rappelle - aucune évaluation n'est nécessaire. Vous pouvez très bien conclure un marché public, même lorsque son évaluation éventuelle serait défavorable. Il n'y a aucune restriction. En revanche, il y en a une dans le dispositif présenté aujourd'hui. Nous sommes donc bien dans un cas de dérogation, conforme à la décision du Conseil constitutionnel.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cette motion tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité, et ce pour les raisons que M. le rapporteur vient d'évoquer et que j'avais déjà soulevées dans le cadre de la discussion générale.

Je voudrais soutenir l'exception d'irrecevabilité présentée par Mme Mathon-Poinat à l'instant et revenir, madame la ministre, sur les arguments que vous avez avancés.
Si j'ai bien compris, toute votre démonstration s'appuie sur l'expression « tels que ». Pour ma part, j'ai entendu l'argument de Mme la ministre, repris par M. le rapporteur, selon lequel l'utilisation des termes « tels que » par le Conseil constitutionnel prouverait que l'urgence et la complexité ne seraient que des exemples et que, par conséquent, nombre d'autres circonstances pourraient être ajoutées.
Si ce raisonnement est juste, je ne comprends pas pourquoi, madame la ministre, vous avez commencé par dire que, selon vous, le contrat de partenariat devait rester exceptionnel. S'il est exceptionnel, cela signifie qu'il peut y avoir quelques exceptions, mais, convenons-en, l'exception n'est pas la règle.
Donc, même si l'on peut imaginer que la complexité et l'urgence ne soient pas des critères exhaustifs, l'on ne saurait pour autant considérer que la généralisation des contrats de partenariat soit conforme à la décision du Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel indique d'ailleurs que « la généralisation de telles dérogations [...] serait susceptible de priver de garanties légales les exigences constitutionnelles ». Or, par ce projet de loi, vous procédez à une véritable généralisation.
Au risque de fâcher notre collègue Paul Girod
M. Paul Girod lève les bras au ciel

En réalité, nous ne savons pas évaluer ces contrats sur une période de dix ans. J'espère que nous serons tous vivants dans dix ans : nous pourrons alors porter un jugement sur ce qui s'est passé.
Je ne reprendrai pas l'argument que vous avez invoqué, madame la ministre, en vous fondant sur l'expression « au nombre de » figurant dans l'avis rendu par le Conseil d'État. Il s'agit du même raisonnement, que je ne développerai pas. Les termes « tels que » et « au nombre de » sont les pierres philosophales qui expliqueraient que ce texte est conforme à la Constitution...
Vous ajoutez encore deux arguments.
D'abord, vous dites que, si le bilan est « plus avantageux », on doit pouvoir conclure un contrat de partenariat. Je viens tout juste d'expliquer que personne ne peut prouver ce qui sera le plus avantageux dans trente ans ; il y a trop de variables. Il s'agit donc d'un pari.
Plusieurs collègues ont évoqué les cas où il est « prouvé » que le contrat de partenariat est plus avantageux. Mes chers collègues, je comprends ce que signifie le verbe « prouver » en mathématiques et dans certaines sciences, mais là, il ne s'agit pas de preuve, il s'agit simplement d'un acte de foi !
Par conséquent, à chaque fois que je vais déclarer que c'est avantageux, je vais pouvoir établir un contrat de partenariat ! C'est exactement la généralisation du recours à ces contrats, donc le contraire de l'exception et de l'exceptionnel que vous défendez, madame la ministre, nonobstant l'expression « tels que ».
Ensuite, vous prévoyez un deuxième critère : « jusqu'au 31 décembre 2012 ». On se demande pourquoi... Jusqu'à cette date, presque tout sera déclaré urgent !
Il me paraît évident que le Conseil constitutionnel, s'il est saisi, aura l'impression que son texte est interprété de façon pour le moins extensive !
Je vous donne acte, madame la ministre, que les expressions « tels que » et « au nombre de » vous eussent permis d'ajouter un troisième cas exceptionnel. Mais comme vous étendez le recours au contrat de partenariat à chaque fois que celui-ci est plus avantageux, et pour un très grand nombre de domaines jusqu'en 2012, je ne sais pas comment vous allez plaider que ce n'est pas, de facto, une généralisation.
C'est pourquoi je soutiens la démonstration de Mme Mathon-Poinat.

Je mets aux voix la motion n° 96, tendant à opposer l'exception d'irrecevabilité.
Je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de loi.
La motion n'est pas adoptée.

En conséquence, nous passons à la discussion des articles.
CHAPITRE IER
Dispositions modifiant l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat

L'amendement n° 97, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est abrogée.
La parole est à M. Michel Billout.

Une fois n'est pas coutume, monsieur le président, nous allons commencer la discussion des articles en retirant cet amendement quelque peu provocateur.
Nous voudrions entamer le débat non pas sur cette note, mais plutôt, avec l'amendement n° 98, sur une proposition d'amélioration du projet de loi, gage de notre volonté de nous inscrire le plus positivement possible dans ce débat.

L'amendement n° 97 est retiré.
L'amendement n° 98, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Toute identification de projet public susceptible d'être mis en oeuvre sous la forme d'un contrat de partenariat doit être notifiée préalablement à son lancement.
Pour l'État, cette notification est faite devant la Mission d'appui des partenariats public-privé, qui en assure la publicité sur son site.
Pour les collectivités territoriales, la notification est faite devant l'assemblée plénière et sur le portail « marchés » de la collectivité ou de son prestataire attitré.
La forme minimale de l'information sur le projet doit contenir son objet, ses enjeux, ainsi que qu'une évaluation financière globale du montage envisagé.
Cette publicité préalable est assurée pendant quarante-cinq jours avant tout lancement des procédures de contrat de partenariat.
La parole est à M. Michel Billout.

Par cet amendement, nous proposons d'encadrer les contrats de partenariat, de façon à éviter certaines dérives.
Cet amendement constituerait, s'il était adopté, une avancée significative par un apport au projet de loi dans sa forme actuelle.
Il s'agit en effet d'assurer la plus grande transparence sur les projets de contrats de partenariat, de sorte que la concurrence entre les opérateurs intéressés soit exacerbée. J'ose penser que je vais obtenir l'assentiment de la Haute Assemblée, mes chers collègues, puisqu'il s'agit, finalement, d'aller dans le sens d'une protection de la concurrence libre et non faussée à laquelle vous êtes, je le sais, très attachés.
Rappelons que, tant pour les marchés publics que pour les contrats de délégation de service public, les projets d'investissement sont soumis, pour l'État, à la présentation des autorisations de programme et, pour les collectivités territoriales, au vote formel des projets en assemblée plénière.
Or, dans l'ordonnance de juin 2004 que nous complétons aujourd'hui, un dispositif similaire d'information préalable a, semble-t-il, été omis.
En l'état, et compte tenu de la multiplication annoncée du recours à la procédure du contrat de partenariat, cela risquerait de jeter la suspicion sur toutes les procédures, alors même que d'autres écueils guettent son utilisation, comme l'accusation d'être un outil approprié pour masquer l'endettement par la déconsolidation.
Aussi est-il souhaitable que tous les projets se mettent en place avec le maximum de transparence. Les actuels projets de l'État sont certes soumis à l'examen de la mission d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, la MAPPP. Mais lorsque cette dernière publie sur son site le contenu de l'avis qu'elle a rendu, la procédure est déjà lancée, et cela interdit tout exercice légitime du contrôle démocratique.
Pour les collectivités locales, la situation actuelle est pire puisque le projet n'est soumis à aucune autorité indépendante - cela fera l'objet d'un autre amendement - et sa publicité n'est opérée que lorsque les commissions appropriées doivent en prendre connaissance.
Aussi, imposer la publication des projets ex ante, comme le prévoit cet amendement, garantit leur transparence et renforce la pression concurrentielle, puisque l'un des leviers du libre jeu de la concurrence est l'accès entier et gratuit à l'information.
J'invite donc le Sénat à adopter cet amendement, que je qualifierai de « sage ».

La commission est défavorable à cet amendement. Celui-ci alourdit la procédure par un dispositif nouveau, inconnu du droit de la commande publique, et m'apparaît d'autant moins nécessaire qu'il existe déjà des règles de publicité pour les contrats de partenariat à même d'assurer une concurrence efficace.
Quoique je salue la proposition constructive, j'émets également un avis défavorable.
En effet, des règles de publicité préalable sont déjà prévues de manière substantielle, en particulier la publication d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne, qui donne une information complète sur le projet et semble suffisant pour l'information de tous les candidats éventuels titulaires de ces marchés.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 117, présenté par MM. Sueur, Collombat, Frimat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 1er de l'ordonnance 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est ajouté un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les contrats de partenariat sont des contrats dérogatoires au droit commun de la commande publique et à la domanialité publique. La généralisation de telles dérogations ne saurait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. »
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Madame la ministre, j'ai été mortifié que vous ayez complètement ignoré mes questions dans vos réponses. Il me semblait pourtant que certaines d'entre elles n'étaient pas complètement anodines.
Par exemple, pourquoi ajouter encore à l'arsenal dont nous disposons en matière de commande publique, y compris d'ailleurs des contrats de partenariat autorisés par l'ordonnance de 2004 ? Je n'ai pas eu de réponse.
Je m'interrogeais également sur la possibilité réelle de réaliser des bilans sérieux. D'ailleurs, hormis la jurisprudence Loiret - cela ne concerne d'ailleurs, à mon avis, que le Loiret, car je connais d'autres endroits où l'on construit des collèges en trois ans -, nous n'avons guère eu d'explications sur ce sujet.
Cet amendement vise à préciser que les contrats de partenariat tels que vous nous les présentez sont dérogatoires au droit commun de la commande publique, ce qui est aussi, ai-je cru comprendre, votre sentiment. Je pense donc que nous obtiendrons un avis favorable de votre part.
Nous ajoutons que « la généralisation de telles dérogations ne saurait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. »
Je serai très attentif au jugement qui sera porté sur notre proposition qui, je le rappelle, est à la fois de bon sens et conforme au droit en vigueur.

La commission émet un avis défavorable.
Cet amendement tend à inscrire dans la loi une partie de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 encadrant le recours au contrat de partenariat.
La commission des lois a été attentive au respect de ces dispositions du Conseil constitutionnel ; elle a essayé de s'assurer de l'existence de garanties suffisantes dans le projet de loi pour que les contrats de partenariat restent une exception, en tant qu'ils sont dérogatoires au droit commun de la commande publique.
Elle considère pour autant qu'il n'est pas nécessaire de rappeler un principe de droit qui a été énoncé par le Conseil constitutionnel. La décision du Conseil constitutionnel se suffit à elle-même, et elle n'a pas besoin d'être reprise dans la loi.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable, monsieur le président.
Je voudrais répondre à l'interpellation de M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le sénateur, il s'agit simplement d'ajouter un élément nouveau, sous la forme de ce contrat de partenariat public-privé, dans la boîte à outils dont dispose la puissance publique lorsqu'il s'agit de passer une commande publique. Cela concourt à la concurrence : plus on dispose d'instruments juridiques, plus on peut choisir. Il n'y a donc là rien de contraire au principe dérogatoire que vous avez justement rappelé.
Il sera tout à fait possible de tirer un bilan en temps utiles. Mais, depuis 2004, trop peu de commandes ont été passées selon les modalités de partenariat public-privé. Il est donc encore un peu tôt. En revanche, je ne doute pas que, avec les développements qui résulteront de l'application du texte que nous examinons ce soir, la puissance publique étant alors en mesure de recourir au partenariat public-privé dans des conditions facilitées quoique exceptionnelles, nous pourrons tirer un bilan.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifié :
1° Il est inséré un : « I » au début de l'article ;
2° Au troisième alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission, notamment des contrats passés en application du code des marchés publics et de la loi n° 85-504 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. » ;
3° Il est ajouté un alinéa et un II ainsi rédigés :
« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière. »
« II. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »

Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 99, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

L'article 1er prévoit un assouplissement du régime des contrats de partenariat passés par l'État.
L'État, qui aurait passé des contrats, en particulier des marchés de maîtrise d'oeuvre, pourrait ainsi céder ces contrats au titulaire du contrat de partenariat. Les marchés de maîtrise ne sont en effet pas nécessairement intégrés au contrat de partenariat.
Nous comprenons bien la logique de cet article, qui, du point de vue des architectes, s'explique par le souhait de ces derniers de conserver la maîtrise d'oeuvre durant toute la durée du contrat. Néanmoins, le fait de céder un marché de maîtrise d'oeuvre entraîne une situation qui, si elle peut sembler évidente, a cependant des conséquences importantes dans les faits : l'interlocuteur du maître d'oeuvre change, et ce dernier a alors affaire non plus à la personne publique, mais à son partenaire, personne privée.
Si ce changement d'interlocuteur n'a pas beaucoup d'importance pour des maîtres d'oeuvre privés, il en va différemment lorsque la maîtrise d'oeuvre est assurée par la filière technique de la fonction publique territoriale par exemple. Les cadres et les ingénieurs de la DDE pourraient eux aussi être directement concernés. Or leurs rapports avec le maître d'ouvrage risquent de changer du jour au lendemain si le marché de maîtrise d'oeuvre est cédé par la personne publique à son partenaire privé. Ce dernier n'a en effet pas la même conception du service public qu'un fonctionnaire.
L'article 1er prévoit également que les personnes publiques pourront se regrouper pour signer un contrat de partenariat.
Si l'on peut aisément deviner que certains projets, en raison de leur envergure, se prêtent bien à ce genre de montage, une question se pose néanmoins. En effet, les destinées politiques de chaque personne publique seront forcément divergentes durant l'exécution du contrat, qui, je le rappelle, peut durer plusieurs dizaines d'années.
Que se passera-t-il en cas de changement de majorité dans un exécutif local ou à la tête d'une administration après une élection ? Les contrats en cours seront-ils remis en cause ? Quelle sera la liberté de l'élu de revenir sur un projet qu'il estime inopportun ?
Il devient également impératif que la collectivité ait fixé avec précision les contours du projet et qu'elle ne change plus d'avis. On le sait, les pénalités sont lourdes en cas de non-exécution du contrat de partenariat et si des clauses de réversibilité n'ont pas été prévues dans le contrat initial. Cela signifie-t-il que les contrats de partenariat, une fois signés par un groupement de personnes publiques, deviennent immuables ? C'est une situation qui devient soudain très intéressante pour le partenaire privé...
Vous l'aurez compris, mes chers collègues, cet article pose plus de problèmes qu'il n'en résout, notamment au détriment de la personne publique. C'est pourquoi nous en demandons la suppression.

L'amendement n° 118, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :
« Art. 1 er - I. - Les contrats de partenariat sont des contrats administratifs par lesquels l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, à la construction ou transformation des ouvrages ou équipements, ainsi qu'à leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion, et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« Il ne peut être conclu de contrat de partenariat que si le montant des travaux et prestations à réaliser en vertu du dit contrat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe.
« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir confier tout ou partie de la conception des ouvrages. Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.
« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement, par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat.
« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle peut être liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement, qui vise à une nouvelle rédaction de l'article 1er, apporte deux modifications. Je n'en aborderai qu'une seule pour le moment, car j'interviendrai sur la question des architectes à la faveur d'un sous-amendement.
Je veux limiter mon propos à l'alinéa visant à instaurer un seuil de 50 millions d'euros en dessous duquel aucun contrat de partenariat public-privé ne pourrait être conclu. Pour défendre ce seuil, je serai bref, car je m'appuierai essentiellement sur l'excellent rapport pour avis de M. Guené, fait au nom de la commission des finances.
Dans ce rapport, monsieur Guéné, vous évoquez les différents risques liés à la déconsolidation de la dette, parmi lesquels figure celui du rétrécissement des conditions de mise en concurrence. Force est de souligner que la généralisation des contrats de partenariat conduira de fait à une diminution de la concurrence par l'exclusion des nombreux artisans, TPE et PME qui n'auront plus accès aux marchés publics du fait de leur incapacité à pouvoir rivaliser avec les majors du BTP.
Dans votre rapport pour avis, qui se réfère à l'expérience ayant eu lieu au Royaume-Uni, vous faites judicieusement remarquer ceci : « Le Trésor britannique considère que les opérations inférieures à 20 millions de livres, comme celles concernant les systèmes d'information, ne présentent pas en général un bilan coût/avantage suffisant. » Puisque l'on parle beaucoup en ce moment du Royaume-Uni, où notre Président de la République a effectué récemment un voyage très remarqué, et que l'on ne cesse de nous vanter l'exemple britannique en matière de contrats de partenariat, on pourrait tout à fait s'inspirer, me semble-t-il, de cette constatation.
L'article 6 prévoit, conformément à la directive européenne, que, en deçà de 5, 150 millions d'euros, les contrats puissent être attribués sous une simple forme négociée. En deçà de ce même seuil, ils échappent également à la procédure de dialogue compétitif.
Aujourd'hui, le risque est réel de voir se multiplier des contrats de partenariat d'un faible montant, économiquement peu efficients et dont la seule motivation tient à quelques accommodements budgétaires, et ce pour de nombreux ouvrages banals qui constituent actuellement le marché des artisans et des PME.
J'ajoute que M. Philippe Marini, rapporteur général, s'est demandé, lors de la réunion de la commission des finances, « s'il ne convenait pas de poser un seuil en deçà duquel il ne serait pas possible de recourir aux PPP ».
Il serait effectivement sage, à mon avis, de prévoir un tel seuil : ce serait un moyen de ne pas généraliser le système des partenariats public-privé.

Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par M. Béteille, au nom de la commission des lois.
L'amendement n° 48 est présenté par M. Houel, au nom de la commission des affaires économiques.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger comme suit cet article :
A. L'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi rédigé :
« I. - Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l'État ou un établissement public de l'État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d'amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.
« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« II. - Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir céder, avec l'accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l'exécution de sa mission.
« La rémunération du cocontractant fait l'objet d'un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière.
« III. - Lorsque la réalisation d'un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d'entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l'exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »
B. En conséquence, la même ordonnance est ainsi modifiée :
1° Dans le dernier alinéa de l'article 8, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
2° Dans les c, e, f et k de l'article 11, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » et dans le d du même article, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
3° Dans les a et c et dans le dernier alinéa de l'article 12, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels ».
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 1.

Cet amendement vise à une nouvelle rédaction de l'article 1er afin de distinguer plus nettement, dans la définition du contrat de partenariat, les critères facultatifs des critères obligatoires du contrat de partenariat, de clarifier le champ du contrat de partenariat en indiquant qu'il recouvre aussi bien les ouvrages, les équipements que les biens immatériels, et de préciser que la rémunération du partenaire privé est nécessairement liée aux objectifs de performance.

L'amendement n° 1 est assorti de quatre amendements.
Le sous-amendement n° 119, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être conclu de contrat de partenariat que si le montant des travaux et prestations à réaliser en vertu du dit contrat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Le sous-amendement n° 120, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement, par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Ce sous-amendement traite de l'architecture. Ce que l'on nous dit rituellement sur l'architecture n'est pas plus satisfaisant que ce que l'on nous dit sur les PME, en nous indiquant que l'on pourra toujours faire appel à ces dernières.
Rien n'interdit de faire appel aux PME. Certes ! Mais toutes les PME auront-elles le droit de concourir ? Bien sûr que non !
De la même manière, on nous dit que la collectivité locale ou l'État pourra organiser un concours d'architectes. Certes !
On nous dit que l'opérateur titulaire du contrat de partenariat pourra mettre en oeuvre une concurrence entre les architectes si la collectivité locale ou l'État le lui demande. Certes !
Aujourd'hui, vous le savez bien, la législation en vigueur oblige à mettre en concurrence les architectes pour la construction de bâtiments publics à partir d'un certain seuil
Or nous sommes ici non pour décider de préconisations vagues et générales, mais pour élaborer un texte de loi. Si l'on accepte la formulation du projet de loi, on rend possible le fait qu'il n'y ait pas de concours d'architectes pour des ouvrages de grande dimension si la collectivité ou l'opérateur en décide ainsi.
Si ce texte est adopté en l'état, vous rendrez possible le choix discrétionnaire d'un architecte par la collectivité ou par l'opérateur. C'est pourquoi j'espère que notre amendement et nos sous-amendements seront retenus. Le fait de rétorquer qu'un concours pourra être organisé n'est absolument pas un argument. Pour une construction de très grande dimension, l'État, la collectivité ou l'opérateur, si l'État ou la collectivité en sont d'accord, pourra parfaitement désigner M. X ou Mme Y comme architecte.
Il nous paraît donc essentiel d'inscrire dans la loi que, « lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement, par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat ». Le conseil national de l'ordre des architectes et les syndicats d'architectes le demandent !
À l'argument qui consisterait à dire qu'il s'agit de lobbies ne représentant qu'eux-mêmes, je répondrai que c'est au contraire une profession parfaitement respectable, que nous devons respecter et qui s'exprime par toutes ses instances.
J'ajoute que ce n'est pas du corporatisme. La demande des architectes va vraiment dans le sens de l'égal accès des membres de cette profession à la commande publique. Le fait qu'il y ait une vraie concurrence organisée avec de véritables concours est aussi une garantie pour la qualité et l'évolution architecturales dans notre pays. Je vous en supplie, ne répondez pas que l'on pourra toujours organiser un concours d'architectes, comme si cette procédure allait de soi ! Je ne cherche pas à prévoir une injonction, mais j'aimerais mieux que l'on précise qu'un concours devra être organisé. Ce principe est très important.

Le sous-amendement n° 121, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le dernier alinéa du II du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Selon le dernier alinéa du paragraphe II du texte proposé par l'amendement n° 1, « le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l'usager final de prestations revenant à cette dernière ».
Cette rédaction est ambiguë et aurait mérité d'être précisée, car elle fait courir le risque d'une remise en cause fondamentale du service public. Selon le droit en vigueur, à savoir l'ordonnance du 17 juin 2004, le partenaire peut se voir confier la gestion d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public et, à titre facultatif, d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
On me dira qu'il est difficile de distinguer mission de service public, gestion de bâtiments ou prestations de services concourant à l'exercice de la mission de service public.
Ce qui nous chagrine, c'est que certains cas sont pour le moins « limites ». Je pense à l'Institut national du sport et de l'éducation physique, l'INSEP, qui offre l'exemple d'un contrat préoccupant.
Dans ce système, des dizaines de fonctionnaires, de personnels ATOSS ont vu leurs missions externalisées. Des missions logistiques ont été cédées au privé.
Où s'arrêtera-t-on ? Finalement, pourquoi ne pas externaliser les missions des professeurs ?
Nous souhaiterions donc que la deuxième partie de cet alinéa disparaisse.

Le sous-amendement n° 122, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le II du texte proposé par l'amendement n° 1 pour l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat par un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Nous attachons une particulière importance à cet amendement, car nous pensons qu'il nous faut être clairs.
Il s'agit de savoir si la gestion d'un service public peut être déléguée ou non au titulaire d'un contrat de partenariat.
On nous a souvent répondu : ne vous inquiétez pas - il n'y a pas lieu de s'inquiéter, d'ailleurs -, la gestion d'un service public relève de l'autorité publique.
Il est bien précisé, dans l'ordonnance, que le partenaire peut se voir confier « une mission globale relative au financement d'investissements immatériels, d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public », ce qui n'est pas le service public, « et, le cas échéant, à d'autres prestations de services concourant à l'exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée ».
Les missions de service public peuvent concerner la justice, la police, l'état civil, la pédagogie, etc. Il serait très important, pour éviter toute ambiguïté, d'inscrire simplement dans la loi que, si tout ce qui concourt au service public peut donner lieu à un contrat de partenariat, la gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.
J'espère que cet amendement bénéficiera d'un avis favorable de la part de la commission et du Gouvernement.
S'il n'était pas adopté, cela signifierait de facto que la gestion d'un service public pourrait être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.

L'amendement n° 123, présenté par MM. Sueur, Collombat, Masseret et Todeschini, Mme Printz et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être conclu de contrat de partenariat que si le montant des travaux et prestations à réaliser en vertu dudit contrat est supérieur à 50 millions d'euros hors taxe. » ;
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

L'amendement n° 124, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer le deuxième alinéa du 3° de cet article.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Cet amendement a déjà été présenté sous la forme du sous-amendement n° 121.

L'amendement n° 100 rectifié, présenté par Mme Mathon-Poinat, M. Billout, Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa du 3° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Dans ce cas, le délai de reversement des sommes perçues ne peut excéder trente jours. En cas de dépassement du délai, le retard de versement donne lieu au paiement d'intérêts composés calculés sur la base fixée au d) du 1 de l'article 3 de la directive 200/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
La parole est à M. Michel Billout.

Le présent amendement, qui est un texte de repli, a pour objet de régler la délicate question des flux de trésorerie laissés à la disposition des prestataires privés, notamment dans le cadre des mandats de collecte de l'argent public.
En l'espèce, il s'agit de garantir que, lorsque le contrat de partenariat autorise le cocontractant privé à encaisser, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, le paiement par l'usager de tout ou partie de la prestation qui lui est rendue, les masses collectées, qui lui reviennent de droit, soient restituées dans les meilleurs délais.
À ce titre, et pour être en parfaite cohérence avec la volonté affichée du Gouvernement - rappelons, pour mémoire, la communication du secrétaire d'État, M. Hervé Novelli, en direction des acheteurs publics, le 14 février dernier -, nous vous proposons d'inscrire dans la loi le délai maximum de reversement au pouvoir adjudicateur des sommes collectées par le titulaire du contrat.
Nous savons d'expérience que seule la réduction drastique des délais de paiement doit permettre aux entreprises de retrouver de la compétitivité.
Cette question des délais de paiement, je vous le rappelle, a fait l'objet depuis de nombreuses années de toute l'attention de la Commission de Bruxelles, qui a publié un Livre vert, puis un Livre blanc et enfin, en juin 2000, une directive fixant à la fois des limites de délais de paiement et les modalités des pénalités pour le non-respect desdits délais.
Pour que la réglementation, quelle qu'elle soit, soit appliquée, il convient que les sanctions pour non-respect soient suffisamment dissuasives.
C'est la raison pour laquelle le projet d'amendement qui est soumis à votre approbation vise à prévoir le régime général de sanction issu de la directive, et non sa version possiblement édulcorée par les textes nationaux.
Il n'y aurait, en effet, aucune justification à ce que les entreprises titulaires de contrats de partenariat puissent, parce que la loi serait muette sur cet aspect, conserver pendant de longs mois des volumes de trésorerie parfois importants, volumes qu'elles n'oublieraient pas, j'en suis sûr, de faire fructifier pour leur plus grand profit.
Pendant ce temps, les pouvoirs adjudicateurs seraient, pour leur part, confrontés à des difficultés de trésorerie, alors que l'argent qui est de droit le leur ne pourrait revenir dans leurs livres de comptes.
C'est pour éviter de copier les précédents fâcheux sur ces questions observés par la Cour de comptes et par les cours régionales des comptes dans nombre de contrats de délégation de service public que vous est soumis cet amendement, qui vise à fixer à un mois le délai de reversement des sommes en question.

L'amendement n° 125, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa du 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

L'amendement n° 99 tend à supprimer l'article 1er de l'ordonnance, qui vise à faciliter la cession de contrats de maîtrise d'oeuvre.
Or, sur ce sujet, le projet de loi confère une base juridique à une pratique assez répandue consistant dans le transfert du contrat de maîtrise d'oeuvre déjà attribué au nouveau titulaire du contrat de partenariat.
Cette démarche répond à un souci d'efficacité de la commande publique, le maître d'oeuvre agissant dès lors comme un prestataire du titulaire du contrat de partenariat appelé, lui, à construire l'ouvrage.
Il faut insister sur le fait que le maître d'oeuvre est en position de force dans le cadre de cette cession puisque le transfert est juridiquement subordonné à son accord.
Il n'y a pas lieu selon nous de supprimer cette possibilité. La commission est donc défavorable à cet amendement.
L'amendement n° 118 tend à réécrire l'article 1er et à introduire le fameux seuil de 50 millions d'euros en dessous duquel il ne serait pas possible de conclure des contrats de partenariat.
La commission des lois n'est pas favorable à l'introduction d'un seuil. Nous avons constaté que de petites collectivités territoriales - je pense notamment à la commune d'Auvers-sur-Oise - avaient conclu d'ores et déjà des contrats de partenariat de faibles montants - il s'agissait en l'occurrence de 2 millions d'euros -, à la satisfaction de cette collectivité et, sans doute, de son partenaire privé, qui est une PME.
Par conséquent, pourquoi introduire un seuil qui pénaliserait les petites collectivités territoriales et les PME ?
J'ajoute que les entretiens que j'ai eus avec la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, la CGPME, et avec la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, m'ont prouvé que ces deux entités étaient plutôt favorables à l'idée de conclure des contrats de partenariat.
De la même manière, s'agissant de l'interdiction de conclure un contrat de partenariat global, incluant la maîtrise d'oeuvre, je suis au regret de dire à M. Sueur qu'il faut à mon avis en laisser le libre choix à la collectivité ou à l'État.
Selon la nature du projet, la collectivité ou l'État estimera nécessaire ou non d'ouvrir un concours de maîtrise d'oeuvre. Dans le fond, il s'agit de contrats globaux. Il est donc assez logique que soit également incluse la mission de maîtrise d'oeuvre dans ce contrat global. Ce n'est pas une obligation, mais la possibilité doit en être laissée à la personne publique.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° 118 et, par cohérence, aux sous-amendements n° 119 et 120.
Le sous-amendement n° 121 tend à supprimer les dispositions de l'amendement n°1 de la commission relatives au mandat d'encaissement, qui vise à autoriser la personne publique à confier un mandat au partenaire privé pour encaisser, pour son compte, le paiement par l'usager final des prestations revenant à cette dernière.
Il s'agit d'une clarification importante dont l'objet est d'éviter une confusion avec la « gestion de fait ». La commission est donc défavorable à ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 122 soulève une question intéressante sur l'articulation entre la mission de service public et le contrat de partenariat.
Il est clair que certaines missions de service public ne peuvent en aucun cas être confiées aux partenaires privés - je pense à tout ce qui relève du domaine régalien.
Pour le reste, nous nous interrogeons sur ce point. C'est la raison pour laquelle la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.

La commission est défavorable aux amendements n° 123 et 124.
L'amendement n° 100 rectifié vise à éviter que, dans le cadre d'un mandat d'encaissement, la personne privée ne conserve trop longtemps les sommes qu'elle perçoit pour le compte de la personne publique, sauf à verser à cette dernière des intérêts. Sur ce point, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Quant à l'amendement n° 125, la commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
Le Gouvernement ne peut pas être favorable à l'amendement n° 99 dans la mesure où l'article 1er du projet de loi apporte davantage de sécurité aux personnes publiques qui souhaitent recourir à un contrat de partenariat, en confirmant, notamment, la possibilité de céder à son cocontractant un marché de maîtrise d'oeuvre préalablement passé.
Je partage l'avis de la commission concernant la clarification qu'apporte une telle disposition, particulièrement en matière de contrats conclus avec des architectes.
Par ailleurs, le projet d'article apporte une précision importante en permettant à plusieurs personnes publiques ayant un intérêt commun de se grouper pour passer ensemble un contrat de partenariat.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 118 et les sous-amendements n° 119 et 120, je partage l'avis de la commission.
L'institution d'un seuil ne me paraît pas souhaitable, et ce pour des raisons tout simplement pratiques. Comme l'a évoqué M. le rapporteur, un certain nombre de contrats de très faible montant ont été conclus sous forme de partenariat public-privé. Il en est ainsi d'un ensemble constitué, à Saint-Raphaël, d'un parking souterrain, d'une gare routière et d'un complexe cinématographique, conclu pour un montant qui n'excède pas 20 millions d'euros, et des pôles énergie des hôpitaux de Roanne et d'Alès, pour des montants respectifs de 5 millions et 7 millions d'euros, ces contrats ont néanmoins été passés sous forme de partenariat public-privé, à la satisfaction à la fois du partenaire et de la puissance publique.
Par ailleurs, je souligne qu'il y a une certaine contradiction à vouloir, d'une part, proposer un seuil et, d'autre part, encourager les PME. Nous souhaitons vivement encourager les PME et les faire ainsi participer à des opérations collectives qui sont à la fois de préfinancement, de construction et d'exploitation.
Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 1 et 48. À cet égard, il remercie les rapporteurs d'avoir proposé, au nom de leurs commissions respectives, une clarification extrêmement utile de la rédaction de l'article 1er.
En revanche, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement n° 121, qui tend à supprimer la possibilité pour la personne publique de mandater son cocontractant dans l'encaissement des recettes issues du paiement par les usagers du service public, objet du contrat. Nous souhaitons en effet que subsiste cette disposition qui a pour objet d'accorder des facilités de gestion à la personne publique.
J'en viens au sous-amendement n° 122 et à l'amendement n° 125. M. le rapporteur, qui a souhaité connaître l'avis du Gouvernement, me permettra de lui apporter, sur ce sujet important, une réponse un peu longue.
Monsieur Béteille, l'ajout que vous proposez à l'ordonnance du 17 juin 2004 et au code général des collectivités territoriales ne me paraît pas utile. Il risque en outre d'être source d'ambiguïtés.
Il ne me paraît pas utile d'abord parce que l'article 1er de l'ordonnance du 17 juin 2004 définit très clairement ce qu'est un contrat de partenariat. Par ce contrat, la personne publique confie au cocontractant une mission globale de financement d'ouvrages ou d'équipements nécessaires au service public, leur construction, leur maintenance et, le cas échéant, la fourniture de prestations de services concourant à l'exercice par la personne publique de la mission de service public dont elle est chargée.
Le cocontractant du partenariat public-privé participe, certes, au service public, mais il ne le gère pas. Le contrat de partenariat public-privé n'a pas en effet pour objet de gérer un service public, d'abord, parce que tout ce qui est activité régalienne ne peut se déléguer - c'est ce qu'a confirmé d'ailleurs le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice à propos des prisons - et, ensuite, parce que la délégation de gestion de service public se fait dans le cadre d'un autre instrument que nous connaissons bien : la délégation de service public.
Il ne s'agit donc pas de faire l'amalgame entre les deux, car ce sont deux catégories distinctes. C'est la raison pour laquelle cette précision ne me paraît pas utile.
Au regard du droit communautaire, au demeurant, le contrat de partenariat est clairement un marché. Le Conseil d'État l'a confirmé, et ce sont les procédures de passation des marchés que le Gouvernement a adoptées pour la passation des contrats de partenariat public-privé.
La loi française et le droit communautaire distinguent donc clairement entre le contrat de partenariat de l'ordonnance de 2004 et la délégation de service public. Dans ces conditions, le sous-amendement proposé ne me paraît pas utile.
J'observe en outre qu'il est source d'ambiguïtés. Tel qu'il est rédigé, en effet, il interdit à tout titulaire d'un contrat de partenariat d'être par ailleurs délégataire d'un service public. Je ne pense pas que cette interdiction absolue, contraire au principe de libre accès à la commande publique, ait été voulue délibérément par l'auteur de l'amendement. Si ce dernier a seulement souhaité signifier par là qu'un contrat de partenariat ne peut avoir pour objet même la gestion d'un service public, je dois alors constater que la loi le prévoit déjà, comme je viens de le rappeler, et, dans ces conditions, la précision ne me paraît pas utile.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable à l'égard tant du sous-amendement n° 122 que de l'amendement n° 125.
Il est également défavorable aux amendements n° 123 et 124.
Sur l'amendement n° 100 rectifié, le Gouvernement émet un avis défavorable. Dès lors que le mandat d'encaissement est une mission confiée contractuellement par la personne publique au titulaire, c'est au contrat de fixer les modalités de reversement des sommes perçues pour le compte de l'administration, notamment le délai imposé au titulaire pour s'acquitter de cette tâche.
À ce titre, la personne publique pourra d'ailleurs décider, si elle le souhaite, d'infliger des pénalités de retard si le délai contractuel n'est pas respecté.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de prévoir un encadrement législatif pour régler les rapports entre la personne publique et son cocontractant.
L'amendement n'est pas adopté.

La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur l'amendement n° 118.

Je souhaite revenir sur le problème des seuils, qui me paraît important.
Le seuil qui a été fixé dans les amendements est de 50 millions d'euros. Je crois qu'il faut quand même tenir compte de ce qui se passe sur le territoire national : sachant que le coût d'un collège est environ de 20 millions d'euros, cela signifie que, globalement, aucun département ne pourrait accéder au partenariat public-privé, ni d'ailleurs la plupart des grandes villes.
À Orléans, ville que vous connaissez bien, monsieur Jean-Pierre Sueur, l'un des plus grands investissements réalisés ces dernières années concerne la gare. Vous avez considéré que le coût était très élevé ; or il n'a pas dû dépasser 40 millions d'euros. Vous voyez donc bien qu'il n'aurait même pas été possible de conclure un partenariat public-privé.

Cela signifie que la plupart des investissements ne pourraient pas donner lieu à un partenariat public-privé. Or, il me semble qu'on ne peut pas interdire à l'ensemble des collectivités d'y recourir.
Pour les architectes, c'est un peu la même chose, dans la mesure où il ne faut pas exagérer les conséquences. Permettez-moi de rappeler quelques chiffres.
On a évoqué tout à l'heure, à propos de l'investissement public des collectivités et de l'État, le chiffre de 60 milliards d'euros, et il a été dit que l'on voulait atteindre 15 % ; or on en est à peine à 3 %. On veut atteindre 15 % alors que les 60 milliards des collectivités représentent un sixième de l'investissement global en France, ce dernier s'élevant à 360 milliards d'euros. Quand on arrivera à 15 %, soit 9 milliards d'euros, cela fera 2, 5 % de l'investissement en France. Par conséquent, il restera aux architectes 97, 5 % qui seront tout à fait disponibles sur le marché.

Je me permets de vous rappeler, monsieur Sueur, puisque vous connaissez bien le dossier dont j'ai parlé tout à l'heure, que le travail a été confié à un architecte local par une major.

Cela montre bien que ces dispositifs fonctionnent.
Pour finir, je rappelle que, lorsque j'avais proposé cette disposition, les sept sénateurs socialistes présents avaient voté pour et les deux sénateurs du groupe CRC s'étaient abstenus. Cela prouve que ce n'est pas aussi idiot qu'on le pense, et que cela marche.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.

Monsieur le rapporteur, quel est, en définitive, l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 122 ?

Il était tout à fait nécessaire de bien préciser que la gestion d'un service public ne peut pas relever du cocontractant d'un contrat de partenariat.
Cela dit, madame la ministre, les longues précisions que vous avez apportées ne seront pas inutiles pour la compréhension du texte et la jurisprudence, et elles permettront d'éviter un certain nombre de dérives qui seraient fâcheuses.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
Les amendements sont adoptés.

En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé, et les amendements n° 123, 124, 100 rectifié et 125 n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 126, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - L'attributaire du contrat de partenariat est soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 dès lors que la personne publique y est soumise. »
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Puisque l'on nous dit que le partenariat public-privé ne fait obstacle ni à la concurrence, ni à l'équité, ni à l'accès des PME au contrat de partenariat, nous proposons tout simplement d'assujettir l'attributaire du contrat de partenariat, au même titre que la personne publique, aux règles d'équité dans la mise en concurrence, règles qui sont édictées par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Ainsi, le cocontractant se verra appliquer les règles que nous connaissons bien et qui sont en vigueur dans les marchés publics pour le plus grand bien des PME.
Je n'ai pas du tout compris l'argument relatif au seuil : vous estimez, madame la ministre, si j'ai bien saisi votre raisonnement, que l'absence de seuil est très bénéfique en ce qu'elle va permettre aux petites entreprises et aux PME d'accéder à tous les contrats de partenariat.
Cependant, si lesdits contrats n'existaient pas, les PME ne s'en trouveraient pas pour autant privées d'accès aux marchés ! Pour tous ces petits marchés, ces petits travaux d'un montant relativement faible, il serait alors fait appel au marché ordinaire, à savoir au marché public, qui donne les plus grandes garanties aux PME.
Le marché public tel que nous le connaissons offre aux PME de plus grandes garanties qu'un contrat de partenariat.
À ceux qui m'objecteraient que la mesure que nous proposons est irréaliste, je répondrai qu'il existe de nombreux précédents et que cet amendement tend tout simplement à instaurer une symétrie avec la loi sur la maîtrise d'ouvrages publics, c'est-à-dire la loi MOP, du 12 juillet 1985, dont l'article 4-4 vise à assujettir le maître d'ouvrage mandataire, même privé, au régime applicable à la personne publique.

Il est pour le moins curieux, sur le plan juridique, de soumettre le partenaire privé au code des marchés publics ou à l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Une telle disposition nous paraît être un alourdissement, voire une curiosité juridique.
En tout cas, l'intérêt du partenaire privé sera de faire jouer la concurrence s'il le souhaite, de confier à une plus petite entreprise une partie de sa mission : par conséquent, la mesure proposée ne me paraît pas utile.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
Le Gouvernement partage tout à fait les réserves de M. le rapporteur et émet lui aussi un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n° 127, présenté par MM. Sueur, Collombat et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le titulaire d'un contrat de partenariat sont celles applicables à la personne publique ».
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Il est identique à celui qu'il a donné sur l'amendement précédent.
L'amendement n'est pas adopté.

J'ai reçu de MM. Jean-Pierre Bel, Thierry Repentin et les membres du groupe socialiste une proposition de loi pour un logement adapté à chacun et abordable pour tous.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 247, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Richard Yung, Mme Michèle André, MM. Robert Badinter, Jean Besson, Mme Marie-Christine Blandin, M. Didier Boulaud, Mme Claire-Lise Campion, MM. Roland Courteau, Yves Dauge, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Christiane Demontès, Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Serge Lagauche, Roger Madec, François Marc, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Mme Gisèle Printz, MM. Thierry Repentin, Jacques Siffre, Jean Pierre Sueur, Mme Catherine Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés une proposition de loi relative à l'enregistrement des pactes civils de solidarité à l'étranger.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 248, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. Claude Biwer une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le rôle des centrales d'achat dans la fixation des prix à la consommation et les délocalisations d'entreprises.
La proposition de résolution sera imprimée sous le n° 249, distribuée et renvoyée à commission des affaires économiques et pour avis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale en application de l'article 11, alinéa 1, du règlement, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3817 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « État de droit » de l'Union européenne pour l'Irak, Eujust Lex.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3818 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3819 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États du CARIFORUM, d'autre part.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-3820 et distribué.

J'ai reçu de MM. Jean Arthuis, Philippe Marini et Mme Nicole Bricq un rapport d'information fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur les conditions d'évolution de l'actionnariat d'EADS.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 251 et distribué.
J'ai reçu de Mme Christiane Hummel un rapport d'information fait au nom de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur le projet de loi n° 241 (2007-2008) portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 252 et distribué.

Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, mercredi 2 avril 2008, à quinze heures et, éventuellement, le soir :
1. Suite éventuelle de la discussion du projet de loi (n° 211, 2007-2008) relatif aux contrats de partenariat.
Rapport (n° 239, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Avis (n° 240, 2007-2008) de M. Michel Houel, fait au nom de la commission des affaires économiques.
Avis (n° 243, 2007-2008) de M. Charles Guené, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
2. Discussion du projet de loi (n° 156, 2007-2008) ratifiant l'ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Rapport (n° 242, 2007-2008) de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 2 avril 2008, à zéro heure trente.