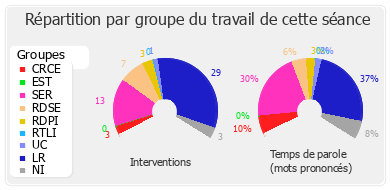Séance en hémicycle du 11 octobre 2018 à 10h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à dix heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.
Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc les mettre aux voix successivement.
Conventions internationales
Projet de loi autorisant l'approbation du protocole entre le gouvernement de la république française et le conseil des ministres de bosnie-herzégovine portant sur l'application de l'accord du 18 septembre 2007 entre la communauté européenne et la bosnie-herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier
Est autorisée l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (ensemble deux annexes), signé à Sarajevo le 3 juillet 2014, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (projet n° 615 [2017-2018], texte de la commission n° 5, rapport n° 4).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté définitivement.
Conventions internationales
Projet de loi autorisant l'adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu de leurs pièces éléments et munitions additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale organisée adopté à new york le 31 mai 2001
Est autorisée l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 (projet n° 645 [2017-2018], texte de la commission n° 7, rapport n° 6).
La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées est favorable à l’adoption de ce texte.
Le projet de loi est adopté définitivement.

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (projet n° 463 [2017-2018], texte de la commission n° 13, rapport n° 11, tomes I et II).
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 3 du chapitre II du titre IV, à la sous-section 2.
TITRE IV
DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Chapitre II
Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
Section 3
Dispositions propres à l’instruction
Sous-section 2
Dispositions relatives au déroulement de l’instruction
I. – Le début de la quatrième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 81 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « La déclaration au greffier peut également être faite au moyen d’une lettre … (le reste sans changement). »
II. – La seconde phrase du sixième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque l’ouverture et la reconstitution du scellé fermé n’exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d’instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de l’avocat de la personne ou celui-ci dûment convoqué. »
III. – L’article 142-6 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou au vu des réquisitions écrites du procureur de la République, dont il est donné lecture à la personne mise en examen, et après avoir entendu ses observations et celles de son avocat » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire ou recueil préalable des observations de la personne et de son avocat, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté, ou décidant d’une mise en liberté d’office.
« Le juge statue après avoir fait vérifier la faisabilité technique de la mesure par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, qui peut être saisi à cette fin à tout moment de l’instruction.
« En matière correctionnelle, cette saisine est obligatoire si elle est demandée par la personne détenue ou son avocat un mois avant la date à laquelle la détention peut être prolongée, sauf décision de refus spécialement motivée du juge d’instruction. »
IV. – L’article 142-7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Au cours de l’instruction, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises est maintenue ou demeure sous assignation à résidence conformément aux articles 179 et 181, la durée totale de la mesure, compte tenu de celle exécutée au cours de l’instruction, ne peut excéder deux ans, sans qu’il soit nécessaire d’en ordonner la prolongation tous les six mois, et sous réserve de la possibilité pour l’intéressé d’en demander la mainlevée. »
V. – L’article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins d’une bonne administration de la justice, il peut être recouru au cours de la procédure pénale, dans les cas et selon les modalités prévus au présent article, à un moyen de communication audiovisuelle. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « prolongation de la détention provisoire », sont insérés les mots : «, y compris l’audience prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 179, » ;
3°
Supprimé
4° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « trois » est supprimé et les mots : «, celui-ci peut » sont remplacés par les mots : « ou par un interprète, ceux-ci peuvent » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par les mots : « l’avocat » ;
c) À la fin de la dernière phrase, les mots : « a déjà été remise à l’avocat » sont remplacés par les mots : « lui a déjà été remise » ;
d) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Si ces dispositions s’appliquent au cours d’une audience, celle-ci doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne à présenter elle-même ses observations. »
VI. – Après l’article 51 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un article 51-1 ainsi rédigé :
« Art. 51 -1. – Par dérogation aux articles 80-1 et 116 du code de procédure pénale, le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour le délit de diffamation procède conformément aux dispositions du présent article.
« Il informe la personne de son intention de la mettre en examen par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et en l’avisant de son droit de faire connaître des observations écrites dans un délai d’un mois. Il peut aussi, par le même avis, interroger la personne par écrit afin de solliciter, dans le même délai sa réponse à différentes questions écrites. En ce cas, la personne est informée qu’elle peut choisir de répondre auxdites questions directement en demandant à être entendue par le juge d’instruction.
« Lors de l’envoi de l’avis prévu au deuxième alinéa du présent article, la personne est informée de son droit de désigner un avocat. En ce cas, la procédure est mise à la disposition de l’avocat désigné durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Les avocats peuvent également se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier dans les conditions mentionnées à l’article 114 du code de procédure pénale.
« À l’issue d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis mentionné au deuxième alinéa du présent article, le juge d’instruction peut procéder à la mise en examen en adressant à la personne et à son avocat une lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 113-8 du code de procédure pénale. Il informe à cette occasion la personne que, si elle demande à être entendue par le juge d’instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
« Les III à VIII de l’article 175 du même code ne sont pas applicables. S’il n’a pas reçu les réquisitions du procureur de la République dans un délai de deux mois après la communication du dossier prévu au I du même article 175, le juge d’instruction rend l’ordonnance de règlement. »

Cet article 35 simplifie le déroulement de l’instruction, notamment en permettant l’ouverture des scellés même en l’absence du mis en examen. Cependant, la principale disposition de cet article dans la version initiale déposée par le Gouvernement consistait à permettre le recours à la visioconférence en matière de détention provisoire, même sans l’accord de la personne intéressée.
La commission est revenue sur cette disposition ; c’est heureux. Nous nous inquiétons toutefois du sort que réservera la majorité En Marche de l’Assemblée nationale à cette mesure.
Il s’agit, dans la droite ligne de la loi Asile et immigration, dont nous avons débattu en juin dernier, d’étendre l’usage de la visioconférence sans l’accord de l’intéressé qui était jusque-là nécessaire pour procéder à une audience à distance et derrière un écran. Nous l’avons déjà exprimé maintes fois : nous sommes contre cette justice dématérialisée, qui finira, pour des motifs économiques évidents, par s’étendre à toutes sortes d’audiences.
En l’espèce, son usage est d’autant plus contestable qu’il s’applique aux détenus provisoires. En effet, la détention provisoire est déjà largement dérogatoire au droit commun et plus que discutable, dans la mesure où, pour faire simple, des personnes non jugées sont mises derrière les barreaux.
Ces personnes voient donc leur droit à la défense encore réduit en étant jugées par écran interposé. Nous connaissons déjà tous les désagréments liés à cette mesure : l’impossibilité pour l’avocat d’être à la fois présent auprès du juge et auprès de son client, notamment, ou encore la mise à mal de la solennité du lieu du tribunal. En quelque sorte, l’idée d’une justice au rabais est consubstantielle au procédé de la visioconférence.

L’amendement n° 152, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 9 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Cet amendement a pour objet la durée de l’assignation à résidence sous surveillance électronique.
Aujourd’hui, le code de procédure pénale prévoit que cette assignation à résidence ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée, mais sous réserve, notamment, d’un débat contradictoire et d’une ordonnance motivée ; elle ne peut en tout cas excéder deux ans.
Madame la garde des sceaux, vous souhaitez, par le biais de ce projet de loi, sans changer cette durée, supprimer la nécessité d’ordonner la prolongation : dès lors, pas de réexamen de la situation, pas d’ordonnance motivée, pas de débat contradictoire !
Certes, on a évoqué le fait qu’il suffirait, dans ce cas, à la personne concernée de demander la mainlevée de la mesure, mais c’est autre chose. Nous savons très bien que ce mode de contrôle est complexe et n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. En effet, la durée de la mesure est un élément qui pose problème aux personnes concernées, au-delà d’un certain nombre de mois.
Dès lors, même si vous plaidez, depuis le début de l’examen de ce texte, la simplification du droit et l’inutilité d’un certain nombre de procédures, là encore, une vigilance sur les conditions de restriction de la liberté d’aller et venir des personnes doit s’imposer.
C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement de suppression.

Dans la mesure où la personne qui est assignée à résidence sous surveillance électronique conserve la possibilité de demander, à tout moment, la mainlevée de la mesure, on peut considérer que la simplification contenue dans cet article est respectueuse des droits de la personne poursuivie, s’agissant d’une mesure de contrainte qui est moins attentatoire à ces droits que le placement en détention provisoire.
La possibilité d’agir et de contester la mesure à n’importe quel moment constitue de ce point de vue une forme de protection.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Cette clarification a été très sollicitée par les praticiens lors de la concertation que nous avons menée dans le cadre des chantiers de la justice. Le manque de lisibilité des règles applicables à l’assignation à résidence sous surveillance électronique lors de la clôture de l’instruction avait notamment été avancé pour expliquer le faible recours à cette mesure en pratique : 292 personnes en bénéficiaient au 1er juillet 2017.
En réalité, comme vient de l’expliquer M. le rapporteur, cette disposition ne revient absolument pas sur la nécessité de prolonger l’assignation à résidence tous les six mois au cours de l’instruction ; elle prévoit uniquement que cette prolongation n’est pas nécessaire après la clôture de l’instruction et le renvoi du prévenu ou de l’accusé devant la juridiction de jugement.
En outre, cette disposition ainsi circonscrite, qui est de nature à favoriser le recours à l’assignation à résidence plutôt qu’à la détention provisoire, n’empêche en aucun cas l’intéressé – M. le rapporteur l’a rappelé – de demander à tout moment la mainlevée de la mesure et de provoquer ainsi un débat.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Madame la garde des sceaux, vous avez employé un argument qui n’est pas absolument complet, pour le dire poliment. Il est vrai qu’il est très peu fait recours à cette procédure ; néanmoins, si je peux me permettre, cela ne découle pas des raisons que vous avez évoquées. Le faible recours à cette procédure résulte plutôt de l’obligation, inscrite dans le code de procédure pénale, de vérifier la faisabilité technique de la mise en place du dispositif ; or le ministère de la justice ne dispose pas d’un nombre suffisant de services pénitentiaires d’insertion et de probation pour ce faire, ce qui rend très compliqué le recours à cette procédure.
Nous maintenons donc notre amendement.
Madame la sénatrice, votre observation tombe à merveille, puisqu’elle me permet de préciser que le budget que nous proposons pour le ministère de la justice nous permettra de recruter 1 500 conseillers d’insertion et de probation supplémentaires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit d’un débat au cours duquel il doit être statué sur le placement en détention provisoire, il ne peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle si la personne le refuse, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement a pour objet de rétablir l’extension du recours à la visioconférence en matière de prolongation de la détention provisoire.
Le présent projet de loi, tel que je l’ai déposé, prévoyait de supprimer la nécessité de l’accord de la personne détenue pour l’utilisation de la visioconférence lors des débats en matière de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention. Votre commission des lois a supprimé ces dispositions.
Le Gouvernement estime cependant qu’il est indispensable de favoriser, dans certains cas, le recours à la visioconférence. Nous avions évoqué ce sujet lors de la discussion générale ; vous vous en souvenez sans doute, mesdames, messieurs les sénateurs. Il apparaît en effet nécessaire de remédier aux importantes difficultés que rencontrent les juridictions et qui sont liées à l’impossibilité d’assurer l’extraction de la personne détenue et donc sa présentation devant le juge dans les délais impératifs de comparution prévus par la loi, ce qui entraîne parfois des remises en liberté qui semblent injustifiées. En 2017, plus de 12 000 extractions judiciaires n’ont ainsi pas pu être prises en charge par l’administration pénitentiaire, soit près de 15 % des réquisitions d’extraction judiciaire.
Le Gouvernement a toutefois pris en compte – je tiens à le souligner – les observations faites par les représentants nationaux de la profession d’avocat, notamment le Conseil national des barreaux, ainsi que par le Syndicat de la magistrature et l’Union syndicale des magistrats, organisations qu’il a entendues dans le cadre de la concertation conduite après le dépôt du projet de loi.
Je reconnais ainsi que la visioconférence ne doit pas pouvoir être utilisée sans l’accord de la personne détenue pour les débats contradictoires relatifs au placement initial en détention provisoire. C’est uniquement pour les débats qui concernent la prolongation de cette détention que l’exigence d’un accord de la personne devrait être écartée.
Nous avons donc fait évoluer notre texte. Tel est l’objet du présent amendement, qui tend à maintenir l’accord de la personne pour les débats sur le placement en détention, mais l’exclut en revanche pour sa prolongation. Il me semble qu’il s’agit d’une solution raisonnable et équilibrée.

La commission n’a pas changé d’avis : elle reste défavorable à ce dispositif, même si nous prenons acte de l’évolution du Gouvernement en cette matière.
La personne qui risque d’être placée en détention provisoire doit pouvoir bénéficier d’un débat contradictoire avec une présence physique. Nous sommes là dans l’un des éléments les plus importants du droit pénal : il s’agit de priver quelqu’un de liberté.
Imposer la visioconférence, ne serait-ce que pour la prolongation de cette détention, ce serait ne pas respecter ce principe, que le Sénat a toujours défendu, y compris en matière de droit des étrangers.

Je reviens sur ce point : le Sénat a toujours voulu que l’étranger, dans le cas où il ne voudrait pas utiliser ce moyen pour se défendre, puisse être conduit devant son juge pour une comparution physique. Il n’y a, en matière de droit des étrangers, aucune obligation de subir, pour ainsi dire, la visioconférence.
Or les enjeux de privation de liberté sont bien plus importants en matière de détention provisoire que pour le placement d’un étranger en centre de rétention ; nous savons tous dans cette enceinte en effet que la durée moyenne de rétention dans ces centres est de douze à treize jours environ. Sans entrer de nouveau dans un débat sur ce sujet, je tiens à rappeler qu’en matière de droit des étrangers nous avons maintenu la visioconférence comme une possibilité, et non pas comme une obligation. C’est pourquoi, dans la matière qui nous occupe aujourd’hui, nous ne pouvons pas accepter que ce soit une obligation, y compris pour la prolongation de la détention.
Dans ces conditions, il faut que la personne puisse comparaître physiquement, si elle le souhaite, en présence du magistrat et de ses conseils, dès lors qu’il s’agit de l’envoyer en détention provisoire.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Il est impératif que ce ne soit qu’avec l’accord de la personne, sur les conseils de son avocat ou après un échange avec celui-ci, que la visioconférence soit possible. J’imagine, madame la garde des sceaux, que les avocats vous ont confié qu’une vraie difficulté se pose pour eux quant à la visioconférence : devraient-ils être avec leur client dans la maison d’arrêt, auquel cas ils ne sont pas en face du juge, ou être en présence du juge, mais sans leur client ?
La vie est ainsi faite ; aujourd’hui, on peut communiquer en visioconférence les uns avec les autres. Ce n’est pourtant pas la même chose dans le cas visé : être en face ou à côté de la personne en cause est fondamental. On ne peut pas envisager que la visioconférence s’impose, même si elle facilite la vie.
Que sera l’étape suivante ? Un ministre de la justice – non pas vous, peut-être, madame la garde des sceaux, mais l’un de vos successeurs, comme on ne sait jamais ce qui peut arriver – viendra nous dire que, finalement, tout cela pourrait se faire par écrit, sans aucun contact ! C’est la déshumanisation de la justice que vous nous proposez !
Certes, vous le faites pour des raisons d’économie que l’on peut comprendre, parce que le problème est compliqué. Il l’est d’autant plus qu’un de vos prédécesseurs, il y a déjà un certain temps, a accepté ce que le ministre de l’intérieur lui a imposé : les extractions et les transferts vers les tribunaux sont désormais du ressort de l’administration pénitentiaire. Or celle-ci, au moment où cette décision a été prise, n’en avait pas les moyens.
Depuis lors, on lutte sur cette question, mais nous ne pouvons pas pour autant accepter que la visioconférence s’impose. Je remercie d’ailleurs M. le rapporteur de l’avoir exprimé. Tel est le sens des observations que je voulais faire pour expliquer les raisons pour lesquelles, madame la garde des sceaux, nous ne soutiendrons pas votre amendement, même s’il représente un progrès par rapport à votre projet initial.

Nous savons que la commission des lois – j’en remercie mes collègues – se montre très attentive, dans l’examen du texte, à l’exercice des libertés publiques. Néanmoins, au regard de la règle pratique et de la règle juridique, je veux formuler deux observations rapides.
Quant à l’aspect pratique de la question, Mme la garde des sceaux a raison de dire que le nombre d’extractions liées à ces procédures est considérable et demande un temps considérable à l’administration pénitentiaire ou aux services de sécurité. Il ne me paraît donc pas scandaleux que le ministère de la justice se demande comment optimiser ses moyens. De la même manière que l’esprit du texte, visible à travers de multiples mesures pratiques, consiste à préserver du temps pour le juge, il me semble assez raisonnable d’essayer de préserver du temps pour les forces de sécurité.
Quant à la question purement juridique, ou de préservation des libertés, et dans le prolongement de l’intervention de M. le rapporteur, j’ai vérifié les éléments pertinents de la décision rendue par le Conseil constitutionnel, le 6 septembre dernier, sur la loi Asile et immigration. Ses considérants 23 et suivants concernent les articles 8, 20 et 24 de cette loi, qui suppriment l’exigence de consentement du requérant pour le recours à des moyens de communication audiovisuels pour l’organisation de certaines audiences en matière de droit d’asile ou de droit au séjour. Pour faire bref, le Conseil constitutionnel, dans son considérant 29, juge que « les griefs tirés de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense et du droit à un procès équitable doivent être écartés ».
Il me semble donc que la réponse apportée par le Conseil constitutionnel à la préoccupation de notre commission peut venir soutenir l’amendement gouvernemental.

Je suis presque étonné de la proposition du Gouvernement ! Il y a plusieurs mois, le texte relatif à l’asile et à l’immigration – mauvaise formulation, d’ailleurs – arrivait devant le Sénat. J’étais alors, je l’avoue, favorable à la recherche de solutions permettant d’éviter l’extraction, parmi lesquelles, éventuellement, la visioconférence. J’ai d’ailleurs cru comprendre qu’à la fin de notre débat, le ministre s’était plus ou moins rallié à la position selon laquelle la visioconférence est en fin de compte compliquée et assez dangereuse ; on en reste donc au vis-à-vis avec le magistrat.
Par ailleurs, de moi-même ou du fait de mes fonctions antérieures de rapporteur spécial chargé de l’immigration au sein de la commission des finances, j’ai effectué un certain nombre de visites dans des centres de rétention. Sincèrement, tous les policiers et les gendarmes que j’y ai rencontrés m’ont confié que l’extraction leur prenait beaucoup de temps : ce n’était pas possible de continuer ainsi !
Je me suis pourtant laissé convaincre par l’argumentation développée en séance qui a conduit à ne pas faire figurer ce dispositif dans le texte consacré à l’immigration.
C’est pourquoi je ne comprends pas très bien comment, pour faire écho aux propos de M. le rapporteur, si l’on ne peut pas prendre le risque, dans le cas de l’immigration, de mettre quelqu’un en rétention pour dix jours, quinze jours, trois semaines au plus sans comparution directe, on pourrait prendre ce risque pour l’ensemble des citoyens, dans tous les cas de délinquance, et pour des durées de détention provisoire beaucoup plus longue !
Il y a là selon moi quelque chose d’incohérent. Soit l’on dit que la visioconférence est dangereuse, représente un vrai risque constitutionnel et est donc impossible – auquel cas, n’en parlons plus, et tenons-nous en au vis-à-vis avec le juge ! –, soit l’on dit qu’il n’y a aucun risque. Dans ce cas, pourtant, je ne comprends pas pourquoi on n’appliquerait pas ce dispositif de manière globale ; or on ne l’a pas fait, et tout le monde s’est laissé convaincre des dangers de ce dispositif lors de l’examen des textes précédents.
Pour ma part, je pense qu’il n’y a pas de solution miracle. Certes, je sais le poids que représente l’extraction pour la police, la gendarmerie et les magistrats, mais peut-être faut-il en rester à la solution actuelle.
Je veux répéter ce que nous proposons par le biais de cet amendement : il s’agit de mettre en place le système de visioconférence uniquement pour le renouvellement de la détention provisoire, et non pour le premier placement. Pour celui-ci, je comprends tout à fait qu’il faille un vis-à-vis, un contact physique avec le juge ; cela, nous en convenons.
Simplement, pour le renouvellement de la détention provisoire, nous désirons pouvoir passer outre le manque d’accord de la personne prévenue. Évidemment, si le magistrat souhaite que celle-ci vienne devant lui, cela pourra se faire, on ne le lui interdira pas. En revanche, dans certains cas, le magistrat pourra passer outre.
Par ailleurs, monsieur Karoutchi, peut-être ne nous sommes-nous pas bien compris : vous avez voté en faveur d’une telle disposition au sein de la loi Asile et immigration, et cela a été acté dans la loi ! Là aussi, dans certains cas, nous pouvons passer outre le refus.
En somme, premièrement, il s’agit uniquement de la prolongation de la détention, et deuxièmement, ce mécanisme est déjà prévu pour le placement d’étrangers en rétention ; je ne vois pas très bien quelle est la différence avec la situation qui nous préoccupe en cet instant.
Troisièmement, ce qui est important dans la mise en œuvre de ce dispositif de visioconférence, c’est évidemment la qualité du parc : si vous ne voyez pas la personne avec laquelle vous communiquez par visioconférence, cela pose problème ! Or nous sommes en train d’améliorer considérablement le parc de la visioconférence, de sorte qu’il n’y ait plus de difficultés. C’est un point important.
Quatrièmement, ce système fonctionne déjà. J’étais récemment en Guyane : vous n’ignorez pas les impossibilités physiques qu’il y a à communiquer dans ce territoire… §C’est la réalité !
Ces impossibilités physiques font que la visioconférence est utilisée en permanence ; or on n’a pas le sentiment qu’il y a là violation de droits majeurs.
Voilà pourquoi, mesdames, messieurs les sénateurs, je soumets cet amendement à votre vote.

Madame la garde des sceaux, j’avoue que mes références sont peut-être trop simplistes, mais je veux tout de même rappeler que nos lois pénales prévoient sept motifs pour une détention préventive – chacun les connaît bien – et, notamment, le risque que la personne s’éloigne, le risque pour l’ordre public, ou encore le risque que l’intéressé fasse pression sur d’autres personnes mêlées à l’affaire, auquel cas la bonne tenue de l’enquête justifie cette détention provisoire.
Je crois profondément que la distinction que vous faites entre la première mise en détention et le renouvellement de la détention provisoire est très contestable. Au fond, pour ce qui est de la première décision, on peut avoir une appréciation qui justifierait que la procédure soit relativement plus souple que pour la prolongation. Celle-ci, en quelque sorte, est plus grave que la mise en détention. En effet, quand vous avez été deux mois en détention provisoire et qu’on renouvelle celle-ci pour plusieurs mois supplémentaires, cette détention prend une autre tournure : c’est presque une peine qui s’applique sans le nom.
Je ne vois donc pas pourquoi la procédure devrait être plus souple pour le renouvellement que pour la première mise en détention provisoire. Je dirais même que, si l’on devait distinguer entre les deux décisions, il faudrait que la procédure soit plus souple pour la première mise en détention que pour la décision de prolongation. C’est d’ailleurs ce que la commission des lois a souhaité. Voilà pourquoi mes collègues rapporteurs ont émis un avis défavorable sur cet amendement.
Je ne partage pas le raisonnement de M. le président de la commission, tout en ayant beaucoup de respect pour la manière dont il l’a énoncé.
En effet, selon moi, dans le cadre d’une détention provisoire, c’est tout de même le premier contact entre le juge et la personne soumise à cette mesure qui est le plus important : c’est à cette occasion que se mesurent l’ampleur de l’infraction commise et la réalité des motifs pour lesquels on place l’intéressé en détention provisoire.
Monsieur le président de la commission, nous ne parlons pas d’un renouvellement unique, qui serait plus grave que la première mise en contact du juge et du prévenu, mais de renouvellements réitérés à intervalle régulier. Les décisions de renouvellement du juge interviendront à plusieurs reprises. On peut dès lors estimer que, ce qui compte, c’est le premier contact, la première décision de mise en détention provisoire, parce que c’est là qu’est appréciée la réalité des critères imposant la détention provisoire. Je maintiens donc cet amendement.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Nous ne suivrons pas la position du Gouvernement, pour les raisons que je vais exposer.
Chacun est sensible à la situation, et nous comprenons bien ce que Mme la garde des sceaux vient de nous expliquer. Il est vrai que c’est au moment du premier placement en détention que l’examen le plus approfondi est réalisé, parce qu’il se pose alors un vrai choix pour le magistrat : faut-il, ou non, permettre à la personne qu’on a devant soi de rester en liberté ? C’est pourquoi de nombreuses vérifications sont alors faites.
La difficulté qui demeure, madame la ministre, c’est le risque de facilité. Lorsque la personne ne sera pas devant le juge et que l’enquête sera toujours en cours, dès lors qu’il n’y aura plus cette capacité de dialogue réel, de présence du prévenu et de son avocat, de solliciter des vérifications, il y a fort à parier – nous pourrons en faire le bilan dans quelque temps – que la reconduction de la détention provisoire sera faite mécaniquement.
Pour avoir vécu de telles situations en tant qu’avocat, je sais combien cet enjeu est réel : c’est bien la présentation devant le juge qui fait la réalité de l’échange et donc celle des droits de la défense !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 345, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 22
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 884 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « sixième et huitième ».
La parole est à M. le corapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 346, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
1° Alinéa 25, première phrase
Remplacer le mot :
accusé
par le mot :
avis
2° Alinéa 27, première phrase
Remplacer le mot :
accusé
par les mots :
demande d’avis
La parole est à M. le corapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 35 est adopté.

L’amendement n° 270 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Guérini, Guillaume et Gabouty, Mme Jouve, MM. Menonville, Requier, Roux et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui est réputée avoir été atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli ou gravement altéré son discernement ou empêché l’exercice de sa volonté sur le contrôle de ses actes. Des soins psychiatriques adaptés lui sont apportés. »
La parole est à Mme Françoise Laborde.

Les personnes malades ou handicapées psychiques sont aujourd’hui surreprésentées en prison au regard de leur proportion dans la population totale. Certes, des maladies psychiques liées à l’enfermement sont développées en incarcération, mais l’incarcération est également la conséquence de ces maladies psychiques puisqu’il est rare que les responsabilités soient reconnues.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 122-1 du code pénal établit en effet une distinction théorique entre l’abolition du discernement et du contrôle des actes d’une personne et l’atténuation du discernement ou entrave au contrôle de ses actes.
Dans le premier cas, cela se traduit par la reconnaissance d’une irresponsabilité pénale, mais dans le second cas la responsabilité pénale peut être engagée, avec une adaptation des peines prononcées le cas échéant.
Si cette distinction est satisfaisante sur le plan théorique, dans la pratique il apparaît qu’elle reste difficile à établir par les neuroscientifiques et les psychiatres, en particulier concernant les états de crise des personnes malades psychiques. Il existe un consensus pour préciser que, dans ces cas – crise d’hallucinations, violentes angoisses, sentiment de persécution, etc. –, la capacité d’exercer sa pleine volonté dans le contrôle de ses actes est particulièrement affectée, en plus du discernement.
Le présent amendement tend donc à préciser les circonstances dans lesquelles l’irresponsabilité pour trouble psychique ou neuropsychique peut-être constatée.
De façon plus globale, une réflexion approfondie sur les failles du système actuel de prise en charge de ces personnes doit être conduite, en particulier dans un contexte de surpopulation carcérale. Cet amendement vise explicitement à ouvrir ce débat, qui pourra s’appuyer sur l’excellent rapport d’information récemment réalisé par plusieurs de nos collègues sur la situation de la psychiatrie des mineurs en France.

Il s’agit bien sûr d’un sujet extrêmement important. L’irresponsabilité pénale, dont les principes viennent d’être rappelés, existe dès lors que l’altération psychologique de la personne qui a commis l’infraction est totale.
Le présent amendement tend à interroger le caractère souhaitable ou non du placement en détention des personnes dont l’altération psychologique n’est que partielle. Si ce placement est possible, il est certain qu’il pose une difficulté réelle.
Je rappelle que la législation a évolué, puisque, depuis 2011, les personnes qui sont victimes d’altération psychologique partielle peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. S’il appartient au juge de déterminer à quel niveau et d’adapter la peine à chaque cas particulier, on ne peut exclure la possibilité d’un placement en détention.
La commission des lois estime que si la problématique soulevée est réelle, elle mérite d’être analysée de manière beaucoup plus approfondie, afin d’adapter la législation, sans exclure d’emblée un possible placement en détention.
La solution réside vraisemblablement dans les conditions de la détention. Nous avons pu constater à l’occasion d’autres travaux que les personnes incarcérées souffrant de difficultés psychologiques, voire de troubles psychotiques, sont de plus en plus nombreuses. Il nous faut trouver les moyens de traiter l’exécution de la peine, ou de prendre en compte ces situations particulières avant le prononcé de la peine.
C’est pourquoi, à ce stade, la commission des lois est plutôt défavorable à cet amendement.
Madame Laborde, je suis également défavorable à l’amendement que vous défendez, non pas évidemment pour la réflexion que vous souhaitez lancer sur ce sujet, qui me tracasse beaucoup – nous avons déjà eu l’occasion d’en parler –, mais pour les deux raisons que je vais développer.
Sur la forme, le présent projet de loi porte sur la procédure pénale. Il s’agit certes d’un argument purement formel, mais nous ne traitons pas du fond.
Sur le fond, dans la situation actuelle, le trouble grave du discernement justifie une diminution de la peine, comme le Sénat l’a d’ailleurs réaffirmé en adoptant la loi Taubira de 2014, mais non une totale irresponsabilité pénale, qui n’est justifiée qu’en cas d’abolition du discernement, autrement dit d’altération totale du discernement.
Sans doute faut-il approfondir la réflexion, comme l’a suggéré M. le corapporteur, mais, dans la situation actuelle, je souhaite que nous en restions aux dispositions en vigueur. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Non, je vais le retirer, d’autant qu’un travail a été entrepris sur ce sujet au travers du rapport Amiel et par d’autres collègues encore. Mais nous reviendrons en deuxième semaine, si j’ose dire, madame la garde des sceaux ; vous pouvez compter sur nous !
Je retire donc cet amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 270 rectifié est retiré.
L’amendement n° 271 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Collin, Mme Costes, MM. Gabouty, Guérini, Guillaume, Menonville, Requier, Roux et Vall et Mme Laborde, est ainsi libellé :
Après l’article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article L. 132-41-… ainsi rédigé :
« Art. 132 -41 -… – Lorsque la santé mentale de la personne condamnée est reconnue comme sujette à des altérations identifiées, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consiste en un suivi renforcé pluridisciplinaire et évolutif comprenant une obligation de soins psychiatriques faisant l’objet d’un suivi régulier par le service pénitentiaire d’insertion et de probation visant à fournir à la personne les meilleures chances d’améliorer sa santé et de pouvoir ainsi se réinsérer au sein de la société. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Dans le même esprit que le précédent, cet amendement vise à souligner que les personnes atteintes de maladies psychiques n’ont pas leur place en prison.
Selon l’Observatoire international des prisons, près de 17 000 détenus en France présentent des troubles et des maladies psychiatriques. C’est plus que le nombre de places que le Gouvernement s’était engagé à construire. En outre, en détention pénitentiaire, à l’exception des unités hospitalières spécialement aménagées, les UHSA, seuls des soins ambulatoires limités aux jours ouvrables et aux horaires de bureau sont dispensés aux malades volontaires.
C’est pourquoi le présent amendement vise à développer, parmi les mesures alternatives à l’emprisonnement, le sursis probatoire incluant l’observance de soins psychiatriques adaptés. Cette mesure permettrait de favoriser l’insertion ou la réinsertion des personnes et de prévenir le risque de récidive.

Ce sujet est également très important. Permettez-moi d’indiquer que, dans le droit positif, le suivi socio-judiciaire et l’accompagnement des personnes souffrant de ce type de troubles dans le cadre de la probation sont déjà assurés. Dans le texte de la commission, nous proposons d’ailleurs une redéfinition de l’échelle des peines visant notamment l’autonomisation de la peine de probation, dont nous espérons qu’elle deviendra une peine principale.
Cet amendement étant satisfait par le droit positif, j’en sollicite le retrait ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.
Je souscris aux propos de M. le corapporteur.
Monsieur Requier, nous nous heurtons actuellement à de grandes difficultés en matière de soins psychiatriques en détention. Mme la ministre des solidarités et de la santé et moi-même avons entamé un travail sur ce sujet. Celui-ci sera alimenté par le rapport sur la prise en charge des soins psychiatriques qui nous sera remis dans les semaines à venir.
Comme vous le savez, actuellement les soins psychiatriques sont pris en charge soit dans les prisons par les services médico-psychologiques régionaux, les SMPR, soit par les UHSA, qui sont au fond des prisons dans l’hôpital.
Les difficultés – ce n’est pas nouveau, vous le savez – tiennent premièrement au manque de personnel médical dans le domaine psychiatrique, deuxièmement au manque de places – ce point relève de mon ministère, et il sera intégré dans les programmations pour les établissements pénitentiaires – et troisièmement à la nature des soins et à ce que peuvent faire les personnels médicaux dans les prisons.
En effet, si un détenu placé en hôpital psychiatrique a l’obligation de suivre les thérapies qui lui sont proposées, il peut les refuser à son retour en détention trois ou quatre jours plus tard. Cela entraîne des ruptures de soins problématiques. Je souhaiterais que nous puissions faire évoluer les choses, car il s’agit d’un sujet très sensible.
Ces différents chantiers ne répondent pas directement à l’objet de votre amendement, monsieur le sénateur, mais ils me semblent correspondre à la réalité des difficultés que nous rencontrons.

Permettez-moi d’apporter un complément d’information à Mme la garde des sceaux, ou du moins d’insister sur ce qu’elle sait déjà.
En juin dernier, j’ai organisé au Sénat un colloque réunissant des psychiatres, des personnels de santé et des personnels pénitentiaires. Ils ont été nombreux à insister sur le fait que, à défaut de places dans les hôpitaux psychiatriques, on place actuellement de nombreux détenus souffrant de troubles psychiatriques en prison, et que cette situation est ingérable.
Telle fut la conclusion de cet après-midi de débats. Il me semble qu’il faut faire quelque chose pour régler ce problème.

En écoutant le débat, je constate que l’on manque de places partout !
Nous sommes heureux d’avoir versé notre contribution à cette réflexion. À présent, en coordination avec mes collègues, je retire cet amendement, monsieur le président.

L’amendement n° 271 rectifié est retiré.
Sous-section 3
Dispositions relatives à la clôture et au contrôle de l’instruction
I. – L’article 84-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « les articles 161-1 et 175 » sont remplacées par la référence : « l’article 161-1 » et, à la fin, les mots : « ces articles » sont remplacés par les mots : « cet article » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
II. – L’article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 175. – I. – Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les avocats des parties ou, si elles ne sont pas assistées par un avocat, les parties. L’avis est notifié, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, il peut également être notifié par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé.
« II. – Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps par lettre recommandée aux avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocats, aux parties.
« III. – Dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d’instruction, selon les modalités prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article 81, qu’elles souhaitent exercer l’un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article.
« IV. – Si elles ont indiqué souhaiter exercer ces droits conformément au III, les parties disposent d’un même délai d’un mois ou de trois mois, selon les distinctions prévues au II, pour :
« 1° Adresser des observations écrites au juge d’instruction, selon les mêmes modalités ; copie de ces observations est alors adressée en même temps au procureur de la République ;
« 2° Formuler des demandes ou présenter des requêtes, selon les mêmes modalités, sur le fondement du neuvième alinéa de l’article 81, des articles 82-1, 82-3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve qu’elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1.
« À l’expiration du délai mentionné au II du présent article, les parties ne sont plus recevables à adresser de telles observations ou formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
« V. – Si les parties ont adressé des observations en application du 1° du IV, le procureur de la République dispose d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des réquisitions complémentaires à compter de la date à laquelle ces observations lui ont été communiquées.
« VI. – Si les parties ont indiqué qu’elles souhaitaient exercer ce droit conformément au III, elles disposent d’un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue ou d’un mois dans les autres cas pour adresser au juge d’instruction des observations complémentaires à compter de la date à laquelle les réquisitions leur ont été communiquées.
« VII. – À l’issue, selon les cas, du délai d’un mois ou de trois mois prévu aux II et IV, ou du délai de dix jours ou d’un mois prévu aux V et VI, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s’il n’a pas reçu de réquisitions ou d’observations dans ces délais.
« VIII. – Le III, le 1° du IV, le VI et, s’agissant des requêtes en nullité, le 2° du IV sont également applicables au témoin assisté. »
III. –
Supprimé
IV. – Au deuxième alinéa de l’article 185 du code de procédure pénale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».
V à VII. –
Supprimés

L’amendement n° 35, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

L’article 36 simplifie le renvoi par le juge d’instruction à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CRPC, qui a été instaurée en 2004 afin de désengorger les tribunaux correctionnels.
Cette procédure ne peut être mise en place que sous certaines conditions, notamment la reconnaissance des faits de la part de la personne poursuivie, ce qui en fait une procédure de « plaider-coupable » à la française.
Cependant, depuis la loi du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridictionnelles, le juge d’instruction a la possibilité de renvoyer, avec l’accord des parties et du ministère public, des faits correctionnels reconnus pour être jugés selon cette procédure.
Cette procédure en vigueur est depuis près de sept ans, mais elle n’est que très peu utilisée – les juges n’y ont recours que pour 1 % des informations judiciaires correctionnelles selon l’étude d’impact du projet de loi, soit environ une centaine de dossiers par an au niveau national –, essentiellement car elle ne correspond pas à un besoin véritable, les informations judiciaires auxquelles elle est susceptible d’être appliquée étant de fait très rares.
La CRPC, mode de jugement dégradé et superficiel, apparaît en effet peu compatible avec le niveau de gravité et de complexité que suppose par principe le recours à une information judiciaire.
Le projet de loi prévoit néanmoins de renforcer ce mode de jugement en permettant au parquet de se dispenser du travail de règlement de la procédure et au juge d’instruction d’éviter la rédaction d’une ordonnance de renvoi motivée – une exigence pouvant pourtant considérée comme une garantie fondamentale dans la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, adoptée à la suite de l’affaire dite « d’Outreau ».
Ainsi est étendu le recours à une procédure dont plus de six ans d’expérience n’ont pas démontré l’utilité et qui est de nature à créer de lourdes difficultés dans les quelques dossiers pour lesquels elle serait utilisée, dans l’espoir de gains de temps tout de même très hypothétiques.
Cette extension ne semble être justifiée que par une foi aveugle, et j’oserai dire quelque peu naïve, dans la procédure de CRPC.

La commission estime que la réduction du délai de clôture de l’instruction est une disposition importante de l’article 36. Le présent amendement tendant à supprimer cet article, elle a émis un avis défavorable.
La CRPC est une procédure à laquelle les magistrats peuvent avoir recours dans un certain nombre de situations, notamment lorsque l’auteur d’une infraction admet sa culpabilité.
On peut comprendre qu’il soit plus compliqué de l’appliquer pour des dossiers soumis à l’instruction, qui sont plus complexes et comportent de plus lourds enjeux. C’est ce qui explique – je l’imagine – le pourcentage plus faible que vous avez évoqué, ma chère collègue. Il convient toutefois de conserver cet outil dans notre arsenal juridique.
La commission émet donc un avis défavorable.
Madame Assassi, le Gouvernement est naturellement opposé à la suppression de cet article, qui, selon nous, améliore les règles applicables au contrôle et à la clôture de l’instruction.
En particulier, l’amélioration du mécanisme du règlement contradictoire, qui s’appliquera si une partie l’a demandé et non de manière systématique, a vocation à être maintenu, afin de raccourcir les délais de l’instruction dans un souci d’efficacité et de bonne administration de la justice – nous évitons d’ailleurs la systématisation du délai de trois mois en prévoyant un délai de quinze jours.
De même, l’uniformisation du délai d’appel du procureur de la République des ordonnances du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention devant la chambre de l’instruction sur ceux du procureur général et des autres parties nous semble pleinement justifiée.
Enfin, nous proposons de mettre en place une passerelle entre l’instruction et la CRPC. Cette solution permettra de revitaliser cette procédure, qui nous semble tout à fait pertinente.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 153, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
quinze jours
par les mots :
quarante-cinq jours
La parole est à M. Éric Kerrouche.

Si de nombreux praticiens se sont plaints de la longueur et de la rigidité des délais prévus lors de la clôture de l’instruction, il n’en demeure pas moins que le respect du contradictoire constitue une pièce maîtresse dans le déroulement du procès pénal, car il est la condition de l’exercice effectif des droits de la défense.
Dans le droit en vigueur, le juge d’instruction doit communiquer le dossier au procureur de la République et en aviser en même temps les parties et leurs avocats aussitôt que l’information lui paraît terminée. Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction.
Copie de ce règlement définitif est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. Les parties disposent du même délai pour adresser des observations écrites au juge d’instruction, pour formuler des demandes ou pour présenter des requêtes. À l’expiration de ce délai, les parties ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
L’article 36 du texte initial du présent projet de loi donne un délai de dix jours aux parties pour annoncer si elles souhaitent recourir aux mécanismes de règlement contradictoire de l’instruction ou y renoncer.
On escompte que les parties ne recourent à ce mécanisme que si elles estiment qu’il présente un intérêt. Mais, en pratique, le mécanisme du règlement contradictoire ne s’appliquera que si une partie l’a demandé et non de manière systématique.
Outre que le dispositif retenu par l’article 36 complexifie la procédure, ce qui nous semble contraire à l’objectif du projet de loi, le mécanisme envisagé oblige les parties à réagir dans des délais extrêmement contraints, ce qui retire au droit de la défense une réelle effectivité, portant atteinte au caractère du contradictoire, donc à la protection du justiciable.
La commission des lois a porté ce délai de dix à quinze jours. Nous estimons qu’il serait plus raisonnable de laisser aux parties un délai de quarante-cinq jours, afin que celles-ci disposent de plus de temps pour prendre position.

Sans revenir sur le fond, à l’issue de l’instruction, le magistrat instructeur rend une ordonnance de règlement qui clôture son instruction. Il en informe le procureur de la République et chacune des parties, qui, dans le droit positif, dispose d’un délai pour demander des éléments d’information complémentaires.
Le projet de loi réduit ce délai de quarante-cinq jours à dix jours. La commission a jugé que c’était un peu court ; elle a considéré qu’un délai de quinze jours était plus raisonnable pour permettre aux parties de formuler une demande complémentaire ; libre ensuite au magistrat de donner ou non son accord.
De plus, il faut reconnaître que les demandes formulées le quarante-troisième jour à la veille de la remise de l’ordonnance relèvent parfois d’une manœuvre dilatoire visant à faire durer le procès. Dans ces conditions, un délai de quinze jours nous paraît tout à fait raisonnable.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’allongement du délai, qui a été porté de dix à quinze jours sur proposition de la commission, comme vient de le rappeler M. le corapporteur, paraît suffisant pour garantir les droits des parties.
Il me semble que porter ce délai à quarante-cinq jours serait complètement excessif. En effet, il excéderait ainsi le délai d’un mois qui est accordé aux parties pour présenter leurs réquisitions, observations et demandes dans le cadre du dossier qui concerne une personne détenue.
Le Gouvernement souhaite réellement accélérer les délais de règlement, car, dans la plupart des dossiers, il n’y a pas de demande d’actes. Le délai de trois mois allongeant inutilement la procédure, nous souhaitons vraiment en rester au délai de quinze jours qui est proposé.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 347, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer trois paragraphes ainsi rédigés :
… – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 173 du code de procédure pénale, les mots : « 175, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « 175, quatrième à septième alinéas ».
… – Au huitième alinéa de l’article 116 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
… – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 186-3 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».
La parole est à M. le corapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 240, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Rétablir les V à VII dans la rédaction suivante :
V. – Au deuxième alinéa des articles 41-4 et 778 du code de procédure pénale, les mots : « à la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « au président de la chambre de l’instruction ou à la chambre de l’instruction».
VI. – À l’article 41-6 et à la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 706-153 du même code, les mots : « la chambre de l’instruction » sont remplacés par les mots : « le président de la chambre de l’instruction ou la chambre de l’instruction».
VII. - Après l’article 170 du même code, il est inséré un article 170-1 ainsi rédigé :
« Art. 170 -1. - Lorsque la solution d’une requête en annulation paraît s’imposer de façon manifeste, le président de la chambre de l’instruction statue sur cette demande, conformément aux dispositions de l’article 199, sans la présence des deux conseillers de la chambre.
« Si la décision qui s’impose consiste dans l’annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d’accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu’il soit procédé à l’audience prévue par l’article 199.
« L’auteur de la requête en annulation peut cependant demander que celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Le présent amendement tend à rétablir les dispositions supprimées par la commission des lois, afin d’étendre la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant à juge unique pour les contentieux en matière de saisie, de restitution et de rectification d’identité, tout en lui permettant de statuer à juge unique, le cas échéant sans audience, pour les requêtes en annulation dont la solution paraît s’imposer.
Ces dispositions constituent selon nous des simplifications cohérentes. En effet, la rigidité des règles d’examen en formation collégiale des requêtes en annulation ne se justifie pas lorsque la nullité est évidente. Ces simplifications sont d’ailleurs très attendues par les acteurs du droit, compte tenu de la longueur des délais de traitement par la chambre d’instruction, du fait de son encombrement.
Cependant, pour tenir compte des inquiétudes de la commission des lois, il est proposé que, si l’auteur de la requête le demande, celle-ci soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.

La commission ayant adopté un amendement de nos collègues du groupe socialiste et républicain qui visait à maintenir le principe de la collégialité, elle a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Permettez-moi d’exprimer nos préventions quant à l’évolution du texte.
Concernant tout d’abord la procédure dite « du plaider-coupable », le projet de loi prévoyait que, lorsque la proposition émanait du procureur de la République, les parties disposaient d’un délai de dix jours pour se prononcer. En cas d’accord, les dispositions de l’article 175 du code de procédure pénale n’étaient pas applicables.
Cette solution permet au parquet de se dispenser du travail de règlement de la procédure et au juge d’instruction d’éviter la rédaction d’une ordonnance de renvoi motivé. Or le règlement nous semble constituer un indispensable travail de synthèse et d’analyse de la procédure. Nous avions déposé en commission un amendement de suppression de cette mesure, qui a été adopté par la commission des lois.
Concernant ensuite la collégialité, qu’il vient d’être question de réduire, de la chambre d’instruction, il nous semble que cette collégialité constitue un gage de qualité de la délibération et une protection du justiciable contre les aléas liés à des décisions individuelles.
L’article 36 du projet de loi allège la charge de la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale. Il étend dans trois matières la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant à juge unique, lui permettant éventuellement de statuer sur cette demande à juge unique – le cas échéant sans audience lorsque le parquet admet lui aussi la nécessité d’annuler les pièces.
Nous avions présenté en commission un amendement de suppression de ces mesures, et celui-ci a été adopté par la commission des lois, les corapporteurs ayant exprimé un avis de sagesse. Nous constatons avec regret que le Gouvernement souhaite rétablir une partie de ces mesures au travers de l’amendement n° 240. Vous ne serez donc pas surpris par notre intention de voter contre celui-ci.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 36 est adopté.

Chapitre III
Dispositions relatives à l’action publique et au jugement
Section I
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites et aux poursuites
Sous-section 1
Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;
2° L’article L. 3421-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
II. – L’article L. 3315-5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 800 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 640 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 1 600 €. »
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 495-17 est ainsi rédigé :
« Lorsque la loi le prévoit, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle. Le paiement de l’amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, éteint l’action publique dans les conditions prévues à la présente section. » ;
1° bis
« Art. 495 -17 -1. – Pour les délits, prévus par le code pénal, punis d’une peine d’amende, le procureur de la République peut recourir à la procédure de l’amende forfaitaire, conformément à la présente section, lorsque la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que les victimes éventuelles ont été intégralement désintéressées.
« Sauf disposition contraire, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. » ;
2° L’article 495-23 est abrogé ;
3° L’article 768 est complété par un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
4° Après le 4° de l’article 768-1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les informations relatives au paiement des amendes forfaitaires ou à l’émission du titre exécutoire des amendes forfaitaires majorées non susceptibles de réclamation pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
5° L’article 769 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « expiration de la peine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, la date du paiement de l’amende et la date d’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée non susceptible de réclamation. » ;
b) Le 6° est complété par les mots : «, soit fait l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle mentionnée au 11° de l’article 768 du présent code » ;
c) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les fiches relatives aux amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur paiement, si la personne n’a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou correctionnelle, soit exécuté une composition pénale, soit fait de nouveau l’objet d’une amende forfaitaire délictuelle. » ;
6° Après le 15° de l’article 775, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les amendes forfaitaires mentionnées au 11° de l’article 768 du présent code. »
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121 -5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale.
« Le recours à cette procédure, y compris en cas d’extinction de l’action publique résultant du paiement de l’amende forfaitaire, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre et l’exécution des mesures administratives de rétention et de suspension du permis de conduire, ou d’immobilisation et de mise en fourrière du véhicule, prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-7 et L. 325-1 et L. 325-1-2 du présent code. » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 325-1-2 est complétée par les mots : «, sauf s’il a été recouru à la procédure de l’amende forfaitaire ».

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, l’article 37 du présent projet de loi prévoit notamment une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants.
Présenté il y a quelques mois par le Gouvernement comme un premier pas vers la décriminalisation de l’usage des stupéfiants, qui viendrait remplacer les peines de prison auxquelles sont parfois condamnés certains consommateurs, l’alinéa 2 de l’article 37 renforce simplement l’arsenal pénal prévu pour sanctionner la prise de drogue.
Sur un tel sujet, le bon sens devrait primer. Plutôt que la répression, une véritable politique de santé publique et de prévention devrait être mise en place. Plutôt que d’enfermer les consommateurs victimes d’addiction, accompagnons-les !
Depuis plusieurs années maintenant, je milite pour la légalisation contrôlée du cannabis – j’ai d’ailleurs déposé une proposition de loi en ce sens –, ainsi que la décriminalisation des autres drogues comme l’héroïne, la cocaïne ou le crack.
Nous ne saurions mettre tous les stupéfiants sur le même plan, comme le fait notre droit. Le cannabis a déjà fait l’objet d’une légalisation contrôlée dans certains pays européens et États fédérés américains, ainsi qu’au Canada, pour la consommation récréative aussi bien que médicale.
Malgré la répression accrue de la consommation du cannabis dans notre pays, le nombre d’utilisateurs augmente vertigineusement d’année en année. On aurait pu au moins espérer la dépénalisation du cannabis, qui est déjà effective dans la grande majorité des pays européens. Or l’amende délictuelle ne constitue nullement une dépénalisation, bien au contraire.
Quant aux autres stupéfiants, ils créent dans tous les cas une dépendance et nuisent fortement à la santé de leurs consommateurs. Il est urgent d’accompagner ceux-ci, et de la meilleure manière.
Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait donné quelques gages en faveur de la légalisation du cannabis. Aujourd’hui, il rétropédale et traite la question aux antipodes de ses promesses antérieures. Pourtant, on ne peut envisager de meilleur moyen de contrôler une consommation que de la rendre légale afin de la réguler et d’en prévenir les risques tout en s’adonnant à la prévention en général et à l’accompagnement des addicts.
C’est pourquoi nous enjoignons l’exécutif à mener une réflexion en la matière. Il est temps de poser avec courage et pragmatisme la question de la légalisation contrôlée du cannabis.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, sous le titre « Dispositions clarifiant et étendant la procédure de l’amende forfaitaire », l’article 37 crée trois groupes d’amendes forfaitaires délictuelles, qui s’ajouteraient aux deux cas déjà prévus par la loi de 2016-1547 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
L’amende forfaitaire délictuelle constitue à mon sens une négation absolue du principe d’individualisation de la peine, en ce qu’elle réduit l’acte de juger à l’application de tarifs à la seule appréciation des forces de l’ordre, sans intervention préalable de magistrats.
Selon le Syndicat de la magistrature, c’est d’autant plus grave que l’on nous propose ni plus ni moins d’étendre ce dispositif d’amende forfaitaire à trois nouvelles infractions, dont la principale est l’usage de stupéfiants, alors même qu’il reste purement et simplement inapplicable en pratique, faute de mesures réglementaires d’application, en raison d’obstacles juridiques et techniques non résolus.
De plus, loin de l’ambition de clarification affichée, ce projet de loi sème la confusion sur un certain nombre de points.
Ainsi, il y a une réelle incohérence entre le montant des amendes forfaitaires prévu par le projet de loi et les peines délictuelles encourues. Par exemple, l’amende forfaitaire pour la conduite sans assurance – 500 euros – est plus lourde que celle qui est prévue pour la vente d’alcool à un mineur – 300 euros –, alors que c’est l’inverse concernant leurs peines délictuelles, respectivement 3 750 euros et 7 500 euros.
De la même façon, l’article L. 3353-5 du code de la santé publique prévoit qu’aucune peine ne sera appliquée au prévenu qui peut prouver « qu’il a été induit en erreur sur l’âge du mineur, sur la qualité ou l’âge de la personne l’accompagnant ou encore sur l’état du malade ». Quid de l’application de cette disposition en cas de procédure de forfaitisation ?
En outre, je tiens à le souligner, la mise en place d’une amende forfaitaire pour usage de stupéfiants n’empêcherait aucunement les poursuites directes devant le tribunal correctionnel et ne constituerait donc pas un allégement de la répression ni une simplification : elle serait plus vraisemblablement de nature à « élever significativement le niveau de répression de l’usage de stupéfiants ». Cela va clairement à l’encontre du rapport de la mission d’information parlementaire du mois de janvier 2018, qui recommande la contraventionnalisation de l’usage de stupéfiants au regard des moyens insuffisants accordés à la justice pour traiter ce délit.
C’est pourquoi j’ai déposé un amendement tendant au maintien de la possibilité de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie applaudit.

Plusieurs associations – Fédération Addiction, Syndicat de la magistrature, Autosupport des usagers de drogues ou ASUD, la Ligue des droits de l’homme, Médecins du Monde, AIDES – considèrent que cet article marquerait un net recul quant à la santé, aux avancées des politiques de réduction des risques et aux droits des usagers et usagères de drogues, qui demeurent les oubliés des politiques publiques qui les concernent.
En réalité, cette mesure d’extension de l’amende forfaitaire délictuelle au délit d’usage de stupéfiants n’a d’autre finalité que de poursuivre et d’affirmer la politique du chiffre et de faciliter la répression, en rendant la procédure plus expéditive, en faisant fi des pratiques diverses – pour la plupart non problématiques –, de la consommation de stupéfiants, et cela bien évidemment en passant sous silence les enjeux sanitaires.
Pourtant, un consensus se dégage, y compris en France, pour réduire la pression pénale. L’avis sur les addictions du Conseil économique, social et environnemental, publié au mois de juin 2015 pointe les limites de la politique répressive, souligne la nécessité de lever les stigmatisations qui pèsent sur les usagers et usagères de drogues et plaide en faveur de l’ouverture d’un débat public sur les sanctions. Dans son avis « Usages de drogues et droits de l’homme » du mois de novembre 2016, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, préconise notamment de renforcer et de sécuriser les politiques de réduction des risques et de leur donner des moyens.
Or ce projet de loi place policiers et gendarmes dans la position d’évaluer la situation sociale et sanitaire d’une personne, dans un contexte qui ne permet pas de prendre en compte la complexité des parcours, des trajectoires et des risques associés à la consommation.
Cette confusion des genres est dangereuse, dans la mesure où il existe une pluralité de consommations, comme le rappelle l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies, l’OFDT : les usages problématiques de produit sont liés à l’environnement social, au contexte de la pratique, aux facteurs de vulnérabilité de la personne, à la fréquence et à la quantité, bien plus qu’au caractère licite ou illicite des substances.
Mes chers collègues, sachez que, avec ce choix, la France ferait toujours partie des six pays européens continuant de sanctionner l’usage de cannabis par une peine de prison ferme, …

… au lieu de considérer ce problème avant tout comme une question de santé publique.

Je sais qu’il est compliqué d’avoir une échelle de peines performante pour un usage qui est aujourd’hui devenu un effet de société, un fait de société, parfois une mode, voire un snobisme entre copains, une façon de se prouver, lorsque l’on est adolescent, que l’on est un homme, fort, costaud, et que l’on peut ainsi entrer dans le monde des adultes.
Personnellement, sur le sujet de la consommation de drogue, je ne céderai ni à la candeur ni à l’angélisme. Une drogue reste une drogue. Aujourd’hui, il n’est plus question de catégoriser les effets de ces consommations. J’invite tous ceux qui continueraient de croire qu’il s’agit de substances que l’on pourrait légaliser et que l’on pourrait tendre vers une certaine permissivité à rencontrer des parents d’enfants consommateurs et à visiter les hôpitaux psychiatriques.

Ces établissements regorgent d’enfants, de jeunes, d’adolescents qui ont sombré dans la schizophrénie après une consommation de cannabis dont le caractère toxique a été prouvé.
Certes, l’échelle des peines est difficile à mettre en place. On pourrait parler de contraventions, de stages, comme vient de le proposer mon collègue, ou de pédagogie. Aujourd’hui, notre devoir est aussi, pourquoi pas, de taper au porte-monnaie, pour faire comprendre que le cannabis n’est pas une substance neutre, qui ne ferait pas de dégât : le cannabis est une drogue qui fait des dégâts dans le cerveau de tous, notamment des jeunes, et provoque, chez nombre d’entre eux, une kyrielle d’effets dont il est aujourd’hui difficile de guérir.
Aussi, faites de votre mieux, tous ici. L’État doit mettre en place toutes les panoplies possibles et imaginables pour permettre une prise de conscience de la toxicité et des effets indésirables causés par un fait qui s’est banalisé, mais qui est hautement dommageable, en particulier chez les jeunes.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, je vous ai tous écoutés avec attention ; vous abordez, à juste titre, le débat sous l’angle du code de la santé publique, puisque c’est là que sont prévues les amendes forfaitaires.
Ce n’est pas ce que fait Mme le garde des sceaux, dont la démarche vise à soulager l’organisation judiciaire. Elle propose donc, pour des raisons de surcharge de travail et face à l’impossibilité des parquets d’appliquer la législation, la mise en place de l’amende forfaitaire. Ce n’est pas forcément la bonne solution, mais ce n’est pas forcément non plus la plus mauvaise. Ce qui est gênant, c’est d’aborder cette question sans une réflexion stratégique, qui s’inscrive dans le code de la santé publique.
Comment faire pour prévenir la consommation des jeunes ? Certains pensent que la libéralisation serait une solution.

Personnellement, je n’en suis pas sûr.
Notre collègue Maurice Antiste considère, à juste titre, qu’il vaudrait mieux imposer aux jeunes un stage qu’une amende forfaitaire, puisque ce sont leurs parents qui paieront cette dernière et que la famille en souffrira encore davantage.
Cet article aborde le problème sous un seul angle, en considérant que les amendes forfaitaires permettront au procureur de mieux poursuivre et que cela crée une stratégie. Pour autant, je ne suis pas sûr que ce texte soit le bon véhicule pour aborder ces questions, dans la mesure où il n’a pour objectif que d’arriver à équilibrer le programme financier de l’organisation judiciaire. C’est le cas de tous les sujets convoqués dans ce texte.
Selon moi, il n’y a pas suffisamment de poursuites et elles seraient de toute façon trop lourdes. Ce n’est donc sans doute pas la solution. Reste que décider que l’on ne fait plus rien du tout serait dramatique.
C’est la raison pour laquelle l’amende forfaitaire est peut-être la solution. Cela supposerait, madame la garde des sceaux, que vous nous expliquiez la stratégie du Gouvernement et celle de la ministre de la santé sur ce sujet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 36 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cet article traite de l’application d’une procédure d’amende forfaitaire au délit d’usage illicite de stupéfiants.
Cette mesure a été présentée par le ministre de l’intérieur comme une réponse permettant de simplifier le travail des forces de l’ordre et de la justice et visant à automatiser les peines en la matière.
Or le principe d’individualisation de la peine est ici bafoué, et la mesure octroie un pouvoir arbitraire aux forces de l’ordre chargées d’appliquer la contravention. Celles-ci pourront de ce fait sanctionner sans limites, au plus grand mépris des droits des personnes suspectées. En plus d’augmenter les inégalités des citoyens devant la loi, une telle mesure est dénuée de toute réflexion sur les questions relatives à la santé publique, pour ce qui a trait à la prévention et au traitement de l’addiction.
Le seul effet de l’amende sera d’aggraver par une sanction pécuniaire une situation souvent déjà précaire : nous savons que les comportements de consommation sont diversifiés et divergent entre les milieux paupérisés et les milieux mondains.
Ce dispositif, en plus d’accroître le millefeuille législatif en matière de répression de l’usage des stupéfiants, semble inefficace, compte tenu de l’impossibilité juridique d’appliquer une amende forfaitaire délictuelle pour les mineurs, qui, pour certains d’entre eux, sont devenus des consommateurs réguliers – leur nombre augmente d’ailleurs sans cesse. Elle sera donc dénuée de tout effet dissuasif chez les populations les plus jeunes.
Cette mesure, mes chers collègues, est quelque peu rétrograde. C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 2 de cet article. Englobant tous les stupéfiants, il paraîtra répressif pour les uns et laxiste pour les autres. Ce sera en effet la même amende pour le cannabis, l’héroïne, la cocaïne, etc.
Il est temps d’ouvrir ce débat, d’abord pour changer la liste des stupéfiants et distinguer le cannabis des autres stupéfiants. En France, ce débat reste tabou. Or qui dit « tabou » dit « pas de prévention et pas d’accompagnement ».

Mes chers collègues, je vous invite à ne pas dépasser le temps qui vous est imparti.
L’amendement n° 81 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet et Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 5 et 7, premières phrases
Supprimer les mots :
y compris en cas de récidive,
La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Cet article prévoit l’extension de la procédure de l’amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d’alcool à des mineurs, usage de stupéfiants. Il s’agit du même principe que les amendes forfaitaires délictuelles pour la conduite sans permis ou sans assurance voté dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Or il est prévu ici d’éteindre l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire, y compris en cas de récidive.
Cet amendement vise donc à supprimer la procédure de l’amende forfaitaire en cas de récidive, afin de ne pas affaiblir la fermeté de la réponse pénale et de ne pas donner un sentiment d’impunité.

La mise en place de ce dispositif d’amende forfaitaire n’est qu’une réponse parmi d’autres en fonction de la situation – ici, l’usage de stupéfiants –, qui peut faire l’objet de poursuites.
Il faut garder cet outil, qui est utile et qui a une autre vertu, celle de – passez-moi l’expression – taper là où ça fait mal. En prenant de l’argent, on agit : c’est un moyen d’action tout à fait intéressant et efficace.
Depuis qu’elle a commencé à examiner ce texte, notamment le volet d’exécution des peines, la commission considère qu’il faut trouver la peine adaptée et efficace, c’est-à-dire dissuasive pour celui qui va la subir.
Dans certaines hypothèses, sans doute majoritaires en matière d’usage de stupéfiants, l’action sur la capacité à acheter peut être regardée avec beaucoup d’intérêt.
Lorsque le Président de la République, en tant que candidat, a évoqué au cours de la campagne électorale les questions liées à la consommation d’un certain nombre de stupéfiants, il ne s’est jamais prononcé pour une dépénalisation. Le débat qui a lieu sur cette question dans la société est tout à fait respectable, mais cela ne correspond pas à l’engagement du Président de la République, que le Gouvernement suit.
Sur la politique pénale que je mènerai en matière de consommation de stupéfiants, j’ai eu l’occasion de m’exprimer au mois d’avril dernier à l’Assemblée nationale, qui avait organisé un débat spécialement sur ces questions. La forfaitisation que nous proposons est un outil supplémentaire : ce n’est pas l’outil qui remplacera l’ensemble des autres mesures de politique pénale.
Je souhaite insister sur trois points : c’est un outil efficace ; c’est un outil qui n’empêche en aucun cas de conduire une politique de santé publique ; c’est un outil qui préserve une réponse individualisée dans un certain nombre de cas.
Premièrement, c’est un outil efficace. Notre idée est de faire reculer le sentiment d’impunité par une poursuite plus systématique des consommateurs qui, aujourd’hui, fument dans les lieux publics. La forfaitisation est précisément destinée à cela : dans les rues, aux sorties des écoles, cette procédure d’amende forfaitaire délictuelle nous permettra de résoudre ce problème.
Évidemment, cette amende forfaitaire donnera lieu à une instruction générale des procureurs locaux pour sanctionner efficacement les consommateurs qui, aujourd’hui, font l’objet de simples rappels à la loi. Par conséquent, nous aurons une gamme supplémentaire, qui sera sans doute beaucoup plus dissuasive. Je crois que c’est ce que nous avons souhaité faire.
Deuxièmement, c’est un outil qui n’empêche évidemment pas la conduite d’une politique publique en matière de santé. La forfaitisation n’empêche en aucune manière les réponses pédagogiques et sanitaires pour les toxicomanes habituels ou pour des drogues un peu plus dures.
La direction des affaires criminelles et des grâces, dont le directeur se trouve à mes côtés, rappellera en effet au parquet qu’il leur appartiendra de diffuser des instructions spécifiques, qui viendront encadrer la mise en œuvre de cette procédure et qui leur permettront de contrôler ce type de profil, afin que, au lieu d’une amende forfaitaire, soit mise en place une réponse sanitaire, sociale, pédagogique correspondant à un certain type de consommateurs.
Bien sûr, madame la sénatrice.
Troisièmement, nous voulons que l’amende forfaitaire soit un outil supplémentaire dans une gamme de réponses. Cette diversité nous permettra d’individualiser les réponses face aux différents types d’infractions auxquelles nous aurons affaire.
Au fond, et je terminerai par là, nous suivons une logique à la fois d’efficacité et de fermeté. Ce n’est pas du tout une logique d’économies. Je ne suis d’ailleurs pas sûre que cela en entraîne, quand bien même cela soulagera peut-être dans un premier temps un certain nombre de magistrats par des procédures différentes.
En effet, la justice restera évidemment saisie de nombreuses procédures, lorsqu’il y aura soit d’autres réponses que la forfaitisation soit des procédures sur opposition qui apparaîtront. C’est donc véritablement une logique à la fois de dissuasion et de santé publique que nous suivons.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 77, présenté par M. Antiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants prévu à l’article 131-35-1 du code pénal peut être proposé en lieu et place du paiement de l’amende forfaitaire minorée. »
La parole est à M. Maurice Antiste.

Cet article maintient la pénalisation de l’usage de stupéfiants, mais ouvre la possibilité d’éteindre l’action publique, y compris en cas de récidive, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Ces modifications ne marquent pas un changement fondamental d’approche, pourtant nécessaire, mais ouvrent des risques de discrimination sociale entre ceux qui auront les moyens de payer les amendes et les plus démunis, qui ne le pourront pas.
De plus, le maintien au sein du code de procédure pénale d’un stage de sensibilisation donnerait la possibilité de responsabiliser et sensibiliser les consommateurs de produits stupéfiants aux risques sanitaires et sociaux, en leur proposant une réponse éducative, en lieu et place, ou en plus, du paiement d’une amende minorée.
La seule création de l’amende forfaitaire aboutit à un véritable permis de consommer sans amener à une réflexion en termes de santé publique, alors que le stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants permet d’engager une réflexion sur les dangers de la consommation et crée des passerelles vers la démarche de soins.

Cet amendement est en réalité satisfait par l’article 43 du projet de loi, qui prévoit que toute possibilité de stage peut être ouverte.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

L’amendement n° 77 est retiré.
L’amendement n° 83 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet et Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Cet article prévoit l’extension de la procédure de l’amende forfaitaire à de nouveaux délits : vente d’alcool à des mineurs et usage de stupéfiants. Il s’agit là de l’une des propositions du rapport Beaume et Natali, qui évoque aussi les délits d’occupation des halls d’immeuble.
Il est donc proposé de fixer le montant de l’amende forfaitaire délictuelle pour l’occupation des halls d’immeuble selon le barème suivant : 300 euros, minorés à 250 euros et majorés à 600 euros.

On comprend parfaitement le sens de cet amendement. En revanche, le véhicule juridique qui est proposé est moins bien adapté que l’ordonnance pénale. La commission des lois préfère, dans les conditions que vous avez décrites, ma chère collègue, que l’ordonnance pénale soit utilisée. Celle-ci constitue en effet une véritable sanction et ouvre un champ de possibilités un peu plus grand, en permettant notamment des saisies.
C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.
La procédure de forfaitisation ne paraît pas du tout adaptée à ce type de situation. La forfaitisation n’est adaptée que pour les délits dont la constatation relève d’une forme d’évidence.
C’est par exemple le cas pour le délit de vente d’alcool aux mineurs, où, au fond, il suffit d’établir que l’acheteur est mineur et que le produit vendu est de l’alcool. Ce n’est pas le cas pour le délit d’occupation illicite d’un hall d’immeuble, qui nécessite que soit établi le trouble causé à autrui, et ce n’est possible qu’à la suite d’investigations complémentaires, telles que des auditions.
Par ailleurs, cette infraction fait déjà l’objet de modifications dans le cadre du projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dit « ÉLAN », puisque l’article 40 bis du texte de la CMP a augmenté la peine d’emprisonnement encourue de six mois à un an. Par conséquent, le législateur ne peut pas vouloir à la fois augmenter la peine d’emprisonnement encourue pour ce délit et prévoir la possibilité d’éteindre l’action publique par le paiement d’une amende forfaitaire. Il y aurait là une contradiction.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

La commission des lois préfère l’ordonnance pénale, car, à l’article 40 du projet de loi, le champ de l’ordonnance pénale est élargi. C’est bien l’outil pertinent en la circonstance. Je confirme donc que cet amendement est satisfait.

L’amendement n° 83 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 84 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet et Imbert et MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy, Lefèvre et Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 446-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 et suivants du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 600 €. »
La parole est à Mme Brigitte Micouleau.

Je retire également cet amendement, monsieur le président, relatif à la vente à la sauvette.

Je modifie l’amendement n° 244 aux mêmes fins, monsieur le président, et retire son II, qui vise l’article 446-1 du code pénal.

Les deux amendements suivants sont donc désormais identiques.
L’amendement n° 244 rectifié est présenté par MM. Yung, Mohamed Soilihi, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 173 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 9 à 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au premier alinéa de l’article 495-17, après le mot : « délictuelle » sont insérés les mots : « fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, » ;
La parole est à M. Alain Richard, pour présenter l’amendement n° 244 rectifié.

Par cet amendement, nous souhaitons marquer une limite à la position prise par la majorité de la commission, qui va beaucoup plus loin dans la généralisation de l’usage de l’amende forfaitaire pénale, et qui le fait sans transition.
Le dispositif proposé par le Gouvernement porte, cela a été rappelé, sur un point très important, à savoir la consommation de stupéfiants comme la vente d’alcool aux mineurs. Il complète la réforme sur la répression de la conduite sans permis menée l’année dernière, après de longues discussions. Cela constitue une bonne avancée dans la pratique de l’amende pénale dans des domaines où, comme l’a rappelé Mme le garde des sceaux, la constatation peut se résumer à une évidence ; il n’y a pas véritablement de sujet d’investigation.
Il nous semble que la commission va trop vite en proposant une généralisation sans évaluation approfondie des cas dans lesquels pourrait se pratiquer l’amende forfaitaire.
J’ai retiré le II de cet amendement, qui s’en est trouvé donc modifié, car, comme cela vient d’être évoqué, la répression de la vente à la sauvette, qui constitue un cas supplémentaire un peu particulier, ne paraît pas prioritaire.
Il faut concentrer le développement de l’amende forfaitaire sur ces délits prioritaires qui, au fond, font l’objet de ce que j’appellerais le pénal de tous les jours. Pour ceux-ci, le procès pénal est lourd, complexe et ne produit pas de valeur ajoutée, comme le répète souvent la garde des sceaux. Ce mécanisme est une répression nécessaire et plus efficace, même si nous préconisons de ne pas le généraliser trop vite.

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 173.
Cet amendement vise à supprimer l’ajout de la commission des lois permettant de recourir à la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle pour tous les délits punis d’une peine d’amende, afin de rétablir le texte dans sa version initiale.
La proposition adoptée par la commission des lois paraît un peu excessive, en ce que, comme vient de le rappeler Alain Richard, la catégorie des délits punis d’une peine d’amende recouvre des infractions très diverses pour lesquelles la procédure de forfaitisation n’est pas toujours souhaitable, dans la mesure où elle n’est pas toujours très simple à appliquer.
À titre d’exemple, si la proposition adoptée par la commission était maintenue, il serait permis de forfaitiser des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public ou encore le délit de dégradations légères par inscriptions sur les façades, véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain, ce qui ne semble pas opportun. Je crois qu’une telle extension va trop loin.
Comme l’a rappelé Alain Richard, la forfaitisation s’est adaptée aux délits dont la constatation est en pratique simple à opérer ; pour les autres infractions, c’est plus compliqué, parce qu’il faut recueillir des preuves et procéder à des constatations, ce qui n’est pas toujours adapté.
Par ailleurs, il me semblerait judicieux d’attendre un retour d’expérience sur la forfaitisation de certains délits avant d’envisager une généralisation aussi importante que celle à laquelle la commission souhaite procéder.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de rétablir le texte dans sa version initiale.

Les deux amendements suivants sont également identiques.
L’amendement n° 78 est présenté par M. Antiste.
L’amendement n° 295 rectifié est présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 11 à 13
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 78.

La création d’un recours systématique à l’amende forfaitaire minorée pour tout type d’infraction ne permet pas d’engager une responsabilisation de l’auteur d’une infraction.
Cette logique d’amende forfaitaire est en contradiction avec le principe d’individualisation de la peine, puisque chaque personne paye l’amende sans qu’il soit tenu compte de la situation.
Enfin, le paiement d’une amende ne permet en aucun cas de mettre en place un mécanisme de prévention de la récidive à travers la compréhension de la portée de l’acte commis.

La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l’amendement n° 295 rectifié.

Nous sommes opposés à la généralisation de l’amende forfaitaire. Nous souhaitons réserver celle-ci aux délits du quotidien punis d’une amende.

Ces quatre amendements sont en réalité presque identiques. Ils tendent tous à revenir sur la volonté de la commission des lois d’élargir l’application de l’amende forfaitaire.
Je précise d’ailleurs que seuls les délits reconnus par leur auteur, la victime étant informée, et pour lesquels une peine d’amende peut être prononcée sont concernés. Les délits poursuivables par des peines de prison sont évidemment exclus. Il s’agit souvent de cas peu réprimés, les poursuites n’étant pas engagées du fait de la longueur des procédures devant les tribunaux.
C’est donc un outil supplémentaire en la matière, que nous pensons utile. Il figure d’ailleurs dans la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale adoptée par le Sénat en janvier 2017.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois a émis un avis défavorable sur les quatre amendements restant en discussion commune.
En bonne logique, je suis favorable à l’amendement n° 244 rectifié, qui est identique à celui qu’a déposé le Gouvernement, et défavorable aux amendements identiques n° 78 et 295 rectifié.

Je voterai votre amendement, madame la garde des sceaux, contrairement aux amendements précédents.
Il ne faut pas oublier que l’amende forfaitaire est une atteinte au principe de l’individualisation de la peine. Je voterai néanmoins l’article 37, à titre personnel, l’expérimentation de stratégies, notamment dans le domaine des atteintes à la santé publique, me paraissant intéressante. Ce sera, sur le terrain, une question de stratégie de la part des procureurs. Je ne minimise pas le fait que cette mesure ait été suggérée par le rapport sur les chantiers de la justice de MM. Beaume et Natali.
Cependant, monsieur le corapporteur, je ne suis pas favorable à une extension immédiate. Énormément d’infractions peuvent être sanctionnées de peines d’emprisonnement et d’amende. Attendons de voir si les procureurs parviennent à mettre en œuvre localement les amendes forfaitaires, avant d’en étendre éventuellement le champ d’application.
Je rejoins complètement le Gouvernement sur ce point et voterai les amendements visant à rétablir le texte initial.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 37 est adopté.

Sous-section 2
Dispositions relatives aux alternatives aux poursuites, à la composition pénale et à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 6° de l’article 41-1, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Demander à l’auteur des faits de ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime. » ;
2° L’article 41-1-1 est abrogé ;
3° L’article 41-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « punis à titre de peine principale d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans » sont supprimés ;
b) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux désignés par le procureur de la République et dans lesquels l’infraction a été commise ou dans lesquels réside la victime ; »
c) Le vingt-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au présent article, la proposition de composition n’est pas soumise à la validation du président du tribunal lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition n’excédant pas le montant prévu au premier alinéa de l’article L. 131-13 du code pénal ou sur la mesure prévue au 2° du présent article, à la condition que la valeur de la chose remise n’excède pas ce montant. » ;
d) Le trentième alinéa est ainsi modifié :
– la deuxième phrase est ainsi rédigée : « La victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de constituer partie civile. » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le procureur de la République informe la victime de ces droits ainsi que, lorsqu’il cite l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel, de la date de l’audience. » ;
4° Après l’article 41-3, il est inséré un article 41-3-1 A ainsi rédigé :
« Art. 41 -3 -1 A. – Les dispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu’elles prévoient une amende de composition et l’indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant légal ou toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d’une délégation de pouvoir à cet effet, reconnait sa responsabilité pénale pour les faits qui lui sont reprochés.
« Le montant maximal de l’amende de composition pouvant être proposé est alors égal au quintuple de l’amende encourue par les personnes physiques. » ;
5° L’article 495-8 est ainsi modifié :
a)
Supprimé
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut proposer que la peine d’emprisonnement proposée révoquera tels ou tels sursis précédemment accordés. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République peut, avant de proposer une peine conformément aux dispositions du quatrième alinéa du présent article, informer par tout moyen la personne ou son avocat des propositions qu’il envisage de formuler. » ;
5° bis
6° Après l’article 495-11, il est inséré un article 495-11-1 ainsi rédigé :
« Art. 495 -11 -1. – Sans préjudice des cas dans lesquels les conditions prévues au premier alinéa de l’article 495-11 ne sont pas remplies, le président peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ou lorsque les déclarations de la victime entendue en application de l’article 495-13 apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur. »
II
III

L’amendement n° 154, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

Le Gouvernement souhaite favoriser le développement de la procédure de composition pénale. Aussi, le projet de loi prévoit de ne plus réserver le recours à cette procédure aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans. Une composition pénale pourrait ainsi être proposée pour tous les délits, quel que soit le quantum de la peine encourue.
En premier lieu, nous souhaitons rappeler que la composition pénale créée par la loi du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale était initialement conçue comme un mode alternatif simplifié destiné à répondre aux délits les moins graves.
La liste des infractions susceptibles d’être traitées par la voie de la composition pénale a été considérablement enrichie et simplifiée depuis 1999 par les lois de septembre 2002 et de mars 2004. La loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a encore étendu son champ d’application, désormais très vaste.
Cette procédure peut en effet s’appliquer aux délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans, à l’exclusion des délits commis par les mineurs, des délits de presse, des délits d’homicide involontaire ou des délits politiques.
En pratique, elle est surtout mise en œuvre pour traiter des infractions simples en matière de délinquance urbaine de faible gravité, telles que les atteintes aux biens. Aussi, la préoccupation émise par notre commission, qui estime qu’« un grand nombre de petites infractions appelle une réponse pénale sans nécessairement mériter une audience devant le tribunal correctionnel », est déjà satisfaite dans les faits.
En proposant la suppression de toute limite dans le seul objectif de faire du chiffre avec la réponse pénale, le projet de loi risque de dégrader ce dispositif. Le succès de la composition pénale ne dépend pas d’un effet de seuil, mais repose essentiellement sur la concertation entre le siège et le parquet. C’est la recherche d’un consensus minimum entre les magistrats du siège et du parquet sur les grandes lignes de conduite de la politique pénale locale qui favorise la réussite de la composition pénale.
Pour toutes les raisons invoquées ci-dessus, nous nous opposons à la suppression du quantum maximal de cinq ans d’emprisonnement encouru par l’auteur des faits.

Je voudrais rappeler que la procédure de composition pénale permet au procureur de la République, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, de proposer une sanction pénale, directement ou par l’intermédiaire d’une personne habilitée, à celui qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis d’une peine d’amende ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, d’une ou plusieurs contraventions connexes.
La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions, avec des sanctions adaptées, en application des dispositions de l’article 41-3 du code de procédure pénale.
Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l’auteur des faits justifie de la réparation du préjudice causé, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer le dommage causé par l’infraction.
Les dispositions de l’article 41-2 du code de procédure pénale énumèrent dix-huit mesures de composition pénale, parmi lesquelles figurent notamment le versement d’une amende, la réalisation de différents stages, l’interdiction de paraître dans le ou les lieux dans lesquels l’infraction a été commise, à l’exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement, la réalisation d’un travail non rémunéré ou encore l’injonction thérapeutique.
Pour favoriser le recours à la composition pénale, le texte qui nous est soumis propose de supprimer la limitation aux délits punis de cinq ans d’emprisonnement au plus. La commission n’a pas jugé cette mesure inopportune au regard de l’utilité de la composition pénale pour sanctionner rapidement certaines infractions et contribuer à soulager quelque peu les audiences des tribunaux correctionnels.
Je tiens à préciser que, contrairement à ce que l’on peut entendre ici ou là, il n’est pas possible de mettre quelqu’un en détention dans le cadre d’une composition pénale. Le choix de la prison dépend naturellement du tribunal.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 154.
Nous souhaitons le maintien de cette disposition, qui permettra au Parquet de recourir à la composition pénale pour tous les délits et non plus seulement pour ceux qui sont punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans.
Je rappelle que la composition pénale est un accord passé entre le procureur et le prévenu. Elle ne peut exister que lorsque des faits de faible importance ont été commis. Cela ne signifie pas que les faits les plus graves seront désormais punis d’une simple mesure de composition pénale, je tiens à le préciser. Il s’agit, par cette proposition, de donner davantage de souplesse et de marge d’appréciation au procureur de la République. Je rappelle que celui-ci dispose de l’opportunité des poursuites, ce qui est évidemment important, donc de l’opportunité d’une composition pénale en matière délictuelle.
Par ailleurs, ce texte améliore le contenu de la composition pénale, en ajoutant l’interdiction de paraître, mesure qui peut être extrêmement utile dans certaines situations, notamment dans les quartiers difficiles.
Je ne vois donc aucune raison de supprimer cette disposition et émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 155, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.

L’article 38 du projet de loi modifie les dispositions régissant la procédure de composition pénale. Il envisage notamment la suppression de l’exigence de validation par le juge du siège pour deux mesures : lorsque, pour un délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, elle porte sur une amende de composition pénale ou sur l’obligation de se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit et dont le montant ne pourra pas excéder le plafond des amendes contraventionnelles, soit 3 000 euros.
Une telle disposition est contradictoire avec la démarche de simplification et d’harmonisation qui inspire le projet de loi, en créant un nouveau seuil et une nouvelle procédure dérogatoire. Surtout, il est permis de considérer que la présente disposition s’écarte des exigences constitutionnelles.
La phase de l’homologation ne doit pas être minimisée. Elle permet de vérifier les faits et leur qualification juridique. À défaut, l’exigence d’un procès équitable garantissant l’équilibre des droits des parties, dont ceux des victimes, ne serait pas respectée.
En matière de délits et de crimes, la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement concourt à la sauvegarde de la liberté individuelle.
L’exécution de la composition pénale permet une inscription au casier judiciaire et une extinction de l’action publique à la seule discrétion du parquet et sans aucune intervention d’un magistrat du siège, y compris sur des faits très graves. Il convient également de ne pas écarter l’hypothèse de la personne qui, après avoir donné son accord, n’exécute pas intégralement les mesures décidées dans le cadre de la composition pénale. Dans ce cas, la proposition initiale devient caduque.
De telles mesures constituent des sanctions pénales. Leur exécution, même avec l’accord de la personne, requiert la décision d’une autorité de jugement.

La commission s’est interrogée, disons les choses telles qu’elles sont, sur le fait de ne pas avoir recours au juge du siège lorsqu’un accord a été trouvé entre la personne poursuivie et le procureur de la République… Nous sommes effectivement dans un système dérogatoire.
Néanmoins, il s’agit d’un système bien cadré, l’amende étant plafonnée à 3 000 euros. J’ajoute que la personne comparaît accompagnée de son conseil, qui est là aussi pour rappeler un ensemble de principes.
Tous ces éléments ayant été pesés, la commission a estimé que le texte proposé par le Gouvernement était acceptable sur ce point ; elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le sénateur, je puis évidemment comprendre les motifs de cet amendement, qui tend à présenter la disposition issue du projet de loi comme étant contraire aux exigences constitutionnelles. Cependant, comme j’ai pu le dire au moment de la discussion générale, le projet de loi que je porte a été construit dans le respect des équilibres constitutionnels et procéduraux.
Sur la composition pénale, nous avons évidemment tenu compte de la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 2 février 1995, qui impose l’exigence de validation par le juge lorsque les mesures peuvent porter atteinte à la liberté individuelle.
C’est la raison pour laquelle le projet de loi limite la dispense de validation par le juge aux mesures qui peuvent être considérées comme ne portant pas atteinte à la liberté individuelle, à savoir l’amende de composition pénale, qui ne me semble pas porter atteinte à la liberté individuelle, et la remise de la chose ayant servi à commettre l’infraction ou en étant le produit.
De plus, l’absence de validation par le juge ne concernera que les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, et à la condition que l’amende de composition ou la valeur de la chose dont le mis en cause devra se dessaisir n’excède pas le plafond des amendes contraventionnelles, c’est-à-dire 1 500 euros ou 3 000 euros en cas de récidive. Nous visons, entre autres, les infractions en lien avec les faits de vol ou bien le contentieux routier.
Cette mesure constitue une vraie mesure de simplification procédurale, utile pour les juridictions qui l’ont très fréquemment demandée lors des consultations que j’ai pu mener. C’est la raison pour laquelle j’en souhaite le maintien.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 348, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer le mot :
ces
par le mot :
ses
La parole est à M. le corapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 86 rectifié, présenté par M. D. Dubois, Mme Billon et MM. Delahaye, Delcros, Henno et Moga, n’est pas soutenu.
L’amendement n° 174, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 17
Rétablir le a dans la rédaction suivante :
a) Au deuxième alinéa, les mots : «un an » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Le projet de loi supprimait, en matière de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ou CRPC, l’interdiction de proposer une peine de plus d’un an d’emprisonnement. Je rappelle que la CRPC est une forme de plaider-coupable à la française. La commission des lois du Sénat a estimé excessive cette suppression, qui permettait de proposer une peine de cinq ans d’emprisonnement lorsque le maximum encouru est de dix ans.
Le présent amendement vise donc à maintenir un assouplissement nécessaire et proportionné de la CRPC, très pratiquée et très appréciée des professionnels, en prévoyant un seuil intermédiaire de trois ans. Celui-ci paraît satisfaisant dès lors que la procédure de CRPC exige l’accord de la personne, l’assistance et la présence indispensable et obligatoire d’un avocat, ainsi qu’une homologation de la peine par un magistrat du siège.
Bien évidemment, outre le seuil de trois ans demeure l’interdiction de prononcer une peine supérieure à la moitié de la peine encourue. Ainsi, pour vous donner un exemple, en cas de vol simple, qui est puni de trois ans d’emprisonnement, le maximum de la peine sera de dix-huit mois. Ce n’est que pour les délits punis de peines d’au moins sept ans d’emprisonnement que la peine de trois ans pourra être proposée. C’est une solution de compromis, qui me semble équilibrée.
Telle est la logique de l’amendement que je vous présente.

Cet amendement tend à revenir sur le texte initial, en prévoyant, dans le cadre de la CRPC, la limitation à un délai de trois ans.
La commission émet donc un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 38 est adopté.

L’amendement n° 296 rectifié, présenté par MM. Requier, Collin, Arnell et A. Bertrand, Mmes M. Carrère et Costes, MM. Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et M. Roux, est ainsi libellé :
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 459 du code de procédure pénale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il rend un jugement immédiat sur les exceptions d’incompétence juridictionnelle et sur les exceptions d’irrecevabilité de constitution de partie civile dont il est saisi, sauf s’il ne peut y être répondu qu’à la suite de l’examen au fond.
« Ces exceptions doivent être examinées avant toute autre exception, y compris les questions prioritaires de constitutionnalité.
« Le jugement immédiat n’est susceptible de recours qu’avec le jugement sur le fond. »
La parole est à M. Jean-Claude Requier.

Contrairement à la cour d’assises, qui peut régler les questions d’exceptions avant de statuer au fond et en toutes circonstances, le tribunal correctionnel, dans la rédaction actuelle de l’article 459 du code de procédure pénale, ne se prononce sur ces questions qu’en fin d’audience, sauf « impossibilité absolue » ou question touchant à l’ordre public.
Or, dans la pratique, cette différence peut contribuer à un allongement considérable des débats, en particulier s’agissant de la constitution de la partie civile. Concrètement, il arrive que de vieux professeurs s’invitent à la barre pour commenter une affaire sans que le tribunal correctionnel puisse soulever l’exception préalablement.
C’est pourquoi, afin de rationaliser les débats devant les tribunaux correctionnels, nous proposons cette nouvelle rédaction s’inspirant de celle qui est relative aux assises, et prévoyant une articulation entre ces décisions immédiates et le traitement des questions prioritaires de constitutionnalité.

Cet amendement tend à soulever une question technique relative au jugement des exceptions d’incompétence juridictionnelle et des exceptions d’irrecevabilité de constitution de partie civile. Ses dispositions se présentent comme une mesure de codification d’une jurisprudence de la Cour de cassation.
Très sincèrement, la commission n’a pas pu évaluer rapidement toutes les conséquences de cet amendement ; elle a donc souhaité connaître l’avis du Gouvernement.
Comme vous l’avez expliqué, monsieur le sénateur, cet amendement vise à renverser le principe posé par l’article 459 du code de procédure pénale, selon lequel le tribunal correctionnel, lorsqu’il est saisi d’incidents ou d’exceptions de procédures, doit joindre ces incidents à l’examen de fond de l’affaire, et doit statuer sur le tout dans une seule et même décision, sauf en cas d’impossibilité absolue ou lorsque la disposition contestée touche à l’ordre public.
Concrètement, il me semble que ce texte satisfait l’exigence de bonne administration de la justice, en évitant que les différentes exceptions de nullité ne viennent paralyser la procédure pénale et ne soient en réalité utilisées à des fins dilatoires. Ainsi, le tribunal n’est pas obligé de renvoyer l’examen de l’affaire au fond dès lors qu’une nullité est soulevée, et il doit à l’inverse statuer sur le tout dans un même jugement.
L’amendement que vous proposez vise à inverser ce principe pour les questions touchant à la recevabilité de partie civile et à la compétence du tribunal, en obligeant le tribunal à rendre un jugement sur ces exceptions avant d’examiner l’affaire au fond. Il me semble que cette complexification n’est pas justifiée. En outre, contrairement à ce qu’indique l’exposé des motifs de votre amendement, elle ne consacre pas la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en la matière.
L’adoption de cet amendement obligerait le tribunal à statuer en deux étapes, ce qui me semble vraiment constituer une complexité procédurale supplémentaire, à laquelle je suis tout à fait opposée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Je suis évidemment sensible à l’argumentation de Mme la garde des sceaux. Néanmoins, puisqu’il s’agit typiquement d’une question de bonne administration, une solution probablement plus efficace serait de laisser le choix à la juridiction, lorsqu’elle pense que cela permet d’évacuer une vulnérabilité de la procédure et d’éviter des rebonds d’argumentation en cours d’audience ou des renvois, de se prononcer pour statuer sur une incompétence en particulier, sans attendre la fin du litige.
Cela ne peut pas être improvisé maintenant, mais je suggère tout de même, madame la garde des sceaux, que vous y réfléchissiez.
Monsieur Richard, vous avez tout à fait raison, mais il me semble que les exceptions d’incompétence du tribunal sont d’ordre public et que le tribunal peut donc décider de s’organiser comme il le souhaite. Il est déjà possible, au regard du droit existant, de les examiner avant le fond, ce qui est logique.
C’est la raison pour laquelle je pense que votre observation, qui est tout à fait légitime, est déjà satisfaite en ce qui concerne l’incompétence.

N’étant ni avocat ni magistrat, je n’entrerai pas dans ce dossier très technique. Cet amendement, préparé avec Yvon Collin, faisant l’objet de deux avis défavorables, je le retire, monsieur le président.

L’amendement n° 296 rectifié est retiré.
Section II
Dispositions relatives au jugement
Sous-section 1
Dispositions relatives au jugement des délits
I. – Le troisième alinéa de l’article 388-5 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avocat est alors convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant l’audition, et il a accès au dossier au plus tard quatre jours ouvrables avant cette date. »
II et III. –
Supprimés
IV. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 394 à 396, il peut décider, de fixer à la même audience, afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites dont la personne a fait l’objet pour d’autres délits, à la suite d’une convocation par procès-verbal, par officier de police judiciaire ou en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, d’une citation directe, d’une ordonnance pénale ou d’une ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Hors le cas de la comparution immédiate, cette décision doit intervenir au moins dix jours avant la date de l’audience. Le prévenu et son avocat en sont informés sans délai. »
V. –
Supprimé
VI. – Le dernier alinéa de l’article 394 du code de procédure pénale est supprimé.
VI bis
VI ter
VI quater
VII. –
Supprimé
VIII. – Le début du premier alinéa de l’article 397-2 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Dans tous les cas prévus au présent paragraphe, le tribunal peut, à la demande des parties ou d’office, commettre… (le reste sans changement). »

L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par Mme Deromedi, MM. Allizard, Babary et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier, Micouleau et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
dix
La parole est à Mme Jacky Deromedi.

L’article 39 du projet de loi modifie le code de procédure pénale, notamment son article 388-5, qui prévoit la situation dans laquelle le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par le procureur de la République. Dans ce cas, le droit en vigueur prévoit que le prévenu ou la victime ont le droit d’être assistés lors de leur audition par leur avocat.
L’article 39 tend notamment à préciser le délai dans lequel l’avocat doit être convoqué et le délai avant l’accès au dossier.
Le présent amendement vise à doubler les délais proposés par le projet de loi : de cinq à dix jours ouvrables pour ce qui concerne la convocation ; de quatre à huit jours ouvrables pour ce qui concerne l’accès au dossier. Il s’agit d’apporter de nouvelles garanties au principe du contradictoire, en laissant aux avocats des délais raisonnables pour l’exercice des droits de la défense.

La commission des lois est soucieuse d’assurer les droits de la défense, de préserver les intérêts de tous et de permettre aux avocats d’être présents dans les procédures. Toutefois, s’agissant des délais, pour ce qui concerne la convocation et l’accès au dossier, nous pensons que ceux qui sont proposés par le texte sont parfaitement raisonnables et ne posent pas de difficulté particulière.
C’est dans ce souci d’équilibre général que je sollicite, madame Deromedi, le retrait de votre amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable, mais, à vrai dire, je ne souhaite vraiment pas être contraint de le faire !
Sourires.
Madame Deromedi, je partage totalement les observations de M. le corapporteur. J’ajouterai simplement que les délais proposés dans le texte constituent l’exacte reprise des règles aujourd’hui applicables en matière d’information judiciaire, qui prévoient les mêmes délais de quatre et cinq jours avant l’interrogatoire des parties par le juge d’instruction. Il me semble que rien ne justifie de doubler ces délais, comme le prévoit votre amendement.
Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi il émettrait un avis défavorable.

Madame Jacky Deromedi, l’amendement n° 55 rectifié bis est-il maintenu ?

L’amendement n° 55 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 175, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. Alinéa 2
Rétablir les II et III dans la rédaction suivante :
II. – Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section I du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la comparution immédiate » sont remplacés par les mots : «, de la comparution immédiate et de la comparution différée ».
III. – Au premier alinéa de l’article 393 du même code, les mots : « et 395 » sont remplacés par les mots : «, 395 et 397-1-1 ».
B. Alinéa 5
Rétablir le V dans la rédaction suivante :
V. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 393 et à l’article 393-1 du même code, après les mots : « à 396 » sont ajoutés les mots : « et à l’article 397-1-1 ».
C. Alinéa 10
Rétablir le VII dans la rédaction suivante :
VII. – Après l’article 397-1 du même code, il est inséré un article 397-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 397 -1 -1. – Dans les cas prévus par l’article 395, s’il existe contre la personne des charges suffisantes pour la faire comparaître devant le tribunal correctionnel, mais que l’affaire n’est pas en état d’être jugée selon la procédure de comparution immédiate parce que n’ont pas encore été obtenus les résultats de réquisitions, d’examens techniques ou médicaux déjà sollicités, le procureur de la République peut poursuivre le prévenu devant le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution à délai différé conformément aux dispositions du présent article.
« Le prévenu est présenté devant le juge des libertés et de la détention conformément aux dispositions de l’article 396, qui statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat. Les réquisitions du procureur précisent les raisons justifiant le recours à la présente procédure, en indiquant s’il y a lieu les actes en cours dont les résultats sont attendus. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si la peine d’emprisonnement encourue est égale ou supérieure à trois ans. L’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans un délai de dix jours devant la chambre de l’instruction.
« L’ordonnance prescrivant le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou la détention provisoire, rendue dans les conditions et selon les modalités prévues par l’article 396, énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard dans un délai de deux mois, à défaut de quoi, il est mis fin d’office au contrôle judiciaire, à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire.
« Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 141-2 et de l’article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d’instruction par ces articles sont alors exercées par le procureur de la République.
« Les procès-verbaux ou autres pièces résultant des réquisitions, examens techniques ou médicaux mentionnés à l’alinéa premier, sont versés au dossier de la procédure dès leur accomplissement et mis à la disposition des parties ou de leur avocat.
« Jusqu’à l’audience de jugement, le prévenu ou son avocat peuvent demander au président du tribunal la réalisation de tout acte qu’ils estiment nécessaire à la manifestation de la vérité, conformément aux dispositions de l’article 388-5, dont les alinéas deux à quatre sont applicables. Si le prévenu est détenu, la demande peut être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement.
« Pour la mise en œuvre de la procédure de comparution à délai différée, la présentation de la personne devant le procureur de la République prévue par l’article 393, ainsi que sa présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le deuxième alinéa du présent article peuvent intervenir dans un lieu autre que le tribunal si l’état de santé de celle-ci ne permet pas de l’y transporter ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à revenir – il n’y a évidemment rien d’original à cela – au texte initial du Gouvernement. Il tend à restaurer la procédure de comparution différée, qui constitue une mesure de simplification absolument essentielle du projet de loi, souhaitée et attendue par les professionnels.
Une telle mesure figurait d’ailleurs dans le rapport remis par MM. Beaume et Natali à l’issue des chantiers de la justice. Comme eux-mêmes l’indiquaient, l’expérience des juridictions a montré que, très souvent, certaines enquêtes, dans lesquelles les gardes à vue se terminent par un déferrement, sont ouvertes à l’instruction pour la simple et unique raison qu’une mesure de sûreté paraît opportune, alors que, en réalité il ne manque qu’un seul acte de pur complément à une enquête globalement achevée.
Il peut s’agir, par exemple, de la réponse à une réquisition, du résultat écrit d’une expertise ou d’un acte médical qu’il faudrait terminer. Dans ce cas, l’ouverture d’une information judiciaire va occuper du temps d’instruction sans bénéficier d’une quelconque plus-value de fond autre que celle d’attendre le versement de la pièce manquant au dossier.
La procédure de comparution différée permettra ainsi, en l’attente du seul résultat de ces investigations, le prononcé d’une mesure de sûreté avant le jugement devant le tribunal saisi de l’action publique. Elle évitera, d’une part, de devoir ouvrir des informations judiciaires inutiles, et, d’autre part, point très important, de prononcer des détentions provisoires de plusieurs mois, qui résultent nécessairement, dans ces hypothèses, de l’ouverture d’une information.
C’est la raison pour laquelle le rétablissement d’un tel dispositif est essentiel à l’architecture du projet de loi que je porte.

L’adoption de cette procédure nouvelle proposée à notre vote reviendrait, lorsqu’une enquête préliminaire n’est pas terminée et qu’il manque des éléments dans la procédure, non pas à ouvrir une information judiciaire ou tout autre moyen pour compléter le dossier, mais à renvoyer immédiatement la personne devant le tribunal correctionnel, en lui fixant une date, plus ou moins lointaine – c’est un autre problème.
Serait ainsi renvoyé devant le tribunal un dossier incomplet – disons les choses telles qu’elles sont – obligeant les parties désireuses d’obtenir des éléments complémentaires à saisir le président de la juridiction correctionnelle pour ce faire ; et cela avec le risque potentiel d’arriver à la date d’audience fixée au départ avec un dossier toujours incomplet.
Dans l’intervalle, il faudrait décider si la personne engagée dans cette procédure est placée ou non en détention provisoire, pour qu’elle puisse comparaître à l’audience fixée. Il y aurait, de ce fait, une audience de comparution immédiate, et la personne serait potentiellement placée en détention provisoire, faute d’un dossier complet, dans l’attente de la fixation de la date de l’audience du tribunal.
De deux choses l’une : soit il y a les éléments suffisants pour juger et éventuellement ordonner un placement en détention provisoire, et la procédure suit son cours normal ; soit il n’y a pas les éléments suffisants pour juger, et il ne faut pas procéder de la sorte.
Par conséquent, la commission des lois, attachée à l’équilibre et au bon fonctionnement de la procédure, a souhaité ne pas donner suite à cette proposition et a émis un avis défavorable à cet amendement visant à réinstaurer l’audience de comparution différée.
Je vous prie, mesdames, messieurs les sénateurs, de bien vouloir m’excuser : je n’ai pas été complète dans ma présentation, ce qui a pu justifier l’intervention de M. le corapporteur.
J’ai oublié de préciser devant vous que cette procédure de comparution différée est limitée dans le temps, ne pouvant excéder deux mois. Elle évitera l’ouverture d’une information judiciaire, ce qui est tout de même extrêmement précieux, et diminuera le nombre de détentions provisoires. Durant la procédure, les avocats pourront évidemment demander des actes nouveaux s’ils le souhaitent.
Les droits des parties seront donc totalement préservés dans le cadre de cette procédure véritablement très efficace en pratique et extrêmement précieuse.

Cette proposition du Gouvernement le prouve, la réflexion n’est pas aboutie sur l’évolution et le rôle particulier des procureurs, sur le rôle qu’aura, demain, le juge des libertés et de la détention, ainsi que sur l’hypothèse que soit, peu à peu, d’une certaine manière, actée la disparition du juge d’instruction.
Au travers de cet amendement est défendue l’idée selon laquelle l’instruction est une phase trop longue, trop lourde, et que la procédure d’enquête à la demande du parquet pourrait suffire à compléter, dans les deux mois, un dossier qui ne l’est pas. Sans doute est-ce à quoi il faudra arriver un jour.
À vos yeux, madame la garde des sceaux, l’intérêt de cette démarche est de permettre au procureur de demander une détention préventive, une incarcération immédiate, une mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence.
Or, nous le savons, 40 % des établissements pénitentiaires sont surchargés par le fait de la détention préventive. Cette dernière est souvent prononcée au titre de la protection de l’ordre public, notamment sous la pression de la population, pour laquelle telle ou telle personne doit être tout de suite mise en prison, c’est-à-dire, en fait, « précondamnée ». Il nous faut envisager les moyens de réduire la détention préventive. En l’espèce, vous allez encore l’amplifier.

Aujourd’hui, le procureur de la République, parce qu’il dispose d’un dossier prêt dans les deux mois, peut ne pas saisir un juge d’instruction. Il peut ne pas forcément demander une détention, surtout si celle-ci n’est motivée que sous la pression de l’opinion.
Alors que nous devons promouvoir une autre politique pénale, celle que vous nous proposez manque de vision stratégique ; nous y reviendrons à propos de l’exécution des peines. Elle montre que vous n’avez pas encore abouti dans votre réflexion sur la nouvelle organisation censée conférer au procureur de la République un rôle plus important. Dans ce cas, il faudrait permettre les conditions du débat contradictoire, accorder une autre place au juge des libertés et de la détention.
En l’état, je partage l’avis du rapporteur : cette procédure de comparution différée ne peut répondre à nos attentes. Si le procureur considère effectivement qu’il y a une instruction complémentaire à mener, il lui revient dès lors de respecter les principes actuels et de prendre une ordonnance de renvoi devant le juge d’instruction.
Monsieur Bigot, sans doute me suis-je mal expliquée, mais notre amendement a précisément l’objet inverse de ce que vous dites. Cette proposition de comparution différée vise à limiter la durée de la détention provisoire.
Actuellement, la procédure applicable à l’encontre d’une personne dangereuse peut se dérouler de deux façons. Soit tous les actes sont prêts : cette personne va passer en jugement. Soit il manque un acte quelconque et une information est immédiatement ouverte : cette personne va partir en détention provisoire et y rester six mois ou plus, avant de venir en jugement.
Notre proposition consiste à laisser un sas de deux mois pour obtenir les résultats des actes et expertises demandés. Pendant cette période, la personne concernée pourra, certes, éventuellement aller en détention provisoire, mais pas plus que deux mois. Dès lors que les pièces nécessaires pour le jugement seront réunies, elle passera en jugement.
Par cette mesure, nous entendons, bien entendu, diminuer la détention provisoire. C’est, pour nous, un objectif extrêmement important, que nous partageons avec vous.

Madame la garde des sceaux, nous sommes d’accord sur le constat, factuel, que vous faites de la situation ; il n’y a pas de difficulté de ce point de vue.
En revanche, c’est sur la manière de résoudre les problèmes que nous avons ce point de divergence. Cela ne change pas l’avis de la commission, mais permettra peut-être d’ouvrir le débat au cours du parcours législatif du texte.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 156, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
il peut décider,
insérer les mots :
sous réserve de l’accord du prévenu,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Le regroupement de plusieurs poursuites en cours à l’occasion d’un seul jugement, tel qu’il est envisagé par l’article 39, présente une utilité, car le prévenu peut avoir intérêt à ce que sa situation soit examinée à l’occasion d’une audience unique. Une telle proposition, déjà approuvée au sein de l’institution judiciaire, est souvent pratiquée sous la forme d’une comparution volontaire du prévenu.
Toutefois, en l’état du texte, les droits de la défense pourraient se trouver lésés, car le regroupement pourrait être imposé dans le cadre d’une procédure de comparution inadaptée aux circonstances en raison de critères d’urgence et de complexité différenciés.
Par ailleurs, dans le cadre de la comparution sur procès-verbal, les dispositions relatives au délai d’information de dix jours de l’avocat et du prévenu sont inadéquates pour préparer une défense sur des dossiers multiples.
Finalement, le regroupement des poursuites, présenté comme une avancée en termes d’efficacité et d’allègement des charges de la procédure et d’organisation des juridictions, pourrait constituer, dans certains cas, une atteinte aux droits de la défense.
C’est la raison pour laquelle nous prévoyons, au travers de cet amendement, ce qui s’apparente à une simple garantie, et je ne vois pas quel argument pourrait être opposé à cette proposition positive. Il serait à notre sens souhaitable de conditionner le mécanisme du regroupement à l’accord du prévenu, afin d’assurer une conciliation plus satisfaisante entre l’efficacité recherchée des audiencements et les droits de la personne poursuivie.
Il s’agit d’étendre quelque peu les droits du prévenu et je sais, madame la garde des sceaux, que vous allez considérer notre proposition avec une bienveillante attention.

L’objet de cet amendement est de permettre au procureur de la République de regrouper l’ensemble des affaires concernant un même prévenu et de les faire traiter par le tribunal correctionnel au cours de la même instance, mais sous réserve de l’accord du prévenu.
Monsieur Sueur, je ne conteste absolument pas le sérieux de votre proposition, …

… mais le procureur a toute légitimité pour estimer nécessaire de juger toutes les affaires en même temps si cela a du sens, si c’est utile à la procédure elle-même et si les dossiers sont liés. L’important est que le conseil du prévenu soit parfaitement informé et qu’il ait le temps de préparer la défense de celui qu’il assiste devant le tribunal correctionnel. En la circonstance, nous estimons que la procédure est suffisamment établie, notamment en matière de délai de convocation.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur Sueur, c’est évidemment avec bienveillance, mais aussi avec certitude que je vais émettre moi aussi un avis défavorable sur cet amendement. J’y vois une rigidification qui ne me semble pas apporter d’éléments très positifs.
Vous avez évoqué les droits de la défense. Or ces derniers sont préservés par le texte. Ainsi, la décision de regroupement de l’ensemble des convocations doit être prise au moins dix jours avant l’audience, ce qui correspond, de manière générale, au délai de convocation avant une audience pénale. De plus, le prévenu et son avocat doivent être informés sans délai.
J’ajouterai que la proposition que nous avons formulée est, une fois encore, extrêmement demandée par les praticiens. Elle est de nature à favoriser l’individualisation des jugements, puisqu’au fond c’est l’ensemble des éléments concernant une personne qui pourront ainsi être pris en compte. Cela évite tout découpage et clarifie le regard que le tribunal pourra porter sur la personne, me semble-t-il.

Madame la garde des sceaux, vous affirmez que votre proposition est très attendue par les praticiens. Or je croyais que, parmi les praticiens, on incluait les auxiliaires de justice, ceux qui assurent les droits de la défense.

Puisque la commission vous suit sur ce point, il faut que M. le corapporteur ait bien conscience des enjeux.
En l’état, le procureur peut parfaitement regrouper plusieurs affaires concernant un même prévenu et le citer à la même audience pour l’ensemble des faits pour lesquels il est poursuivi. En l’occurrence, il s’agit tout simplement de permettre au procureur, dix jours avant l’audience, de décider de regrouper des affaires pour lesquelles des citations n’auront peut-être pas encore été décernées ou renvoyées à des audiences ultérieures.
Je ne suis pas sûr que, dans ce délai de dix jours, s’il y a plusieurs affaires différentes et parfois peut-être complexes, la défense ait le temps de préparer son argumentaire. La moindre des choses, c’est qu’il y ait effectivement un accord. L’intérêt du justiciable, de la défense est que tout soit regroupé dans le cadre d’une même audience. Les garanties, de ce point de vue, ne sont pas apportées.
C’est une question procédurale qui sera à revoir ; j’attire votre attention sur ce point. Certains avocats risquent, au moment de l’audience portant sur ce genre de regroupements, d’en demander le renvoi parce qu’ils n’ont pas eu temps de préparer la défense. Le tribunal sera peut-être amené à considérer cette demande comme bien fondée et à prononcer le renvoi.
Il est donc dans l’intérêt de tout le monde de faire en sorte que la procédure fonctionne mieux. Le délai de dix jours est bien trop bref pour assurer les droits de la défense. Il correspond au délai de la citation, alors qu’il s’agit là de communiquer sur la décision de regroupement de toutes les affaires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° 54 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa de l’article 396 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
… – À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 397-2 du code de procédure pénale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».
… – À l’avant-dernière phrase de l’article 397-7 du code de procédure pénale, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
La parole est à Mme Muriel Jourda.

Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat, en janvier 2017, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale, présentée par les sénateurs du groupe Les Républicains.
Il s’agit d’allonger de trois à cinq jours la durée maximale de la détention provisoire à l’égard d’une personne déférée préalablement à une comparution immédiate dans l’hypothèse où la réunion du tribunal s’est révélée impossible le jour même, ce qui est prévu par l’article 396 du code de procédure pénale.

Sur cet amendement, déjà voté par le Sénat en 2017 dans le cadre de l’examen d’un texte qui n’avait pas prospéré, la commission a émis un avis favorable.
Madame la sénatrice, il ne faut pas écarter le risque inflationniste en matière de détention provisoire que ne manquerait pas de provoquer la mise en œuvre d’une telle mesure. Cette dernière ne me semble pas pertinente, et je ne souhaite pas que votre amendement soit adopté.
J’émets donc un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 39 est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.