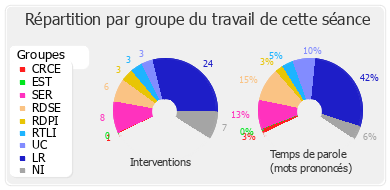Séance en hémicycle du 6 décembre 2018 à 21h15
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt et une heures quinze, sous la présidence de M. Philippe Dallier.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » (et article 77 quater).
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 3 octobre dernier, le ministre de l’intérieur, l’homme le mieux informé de France, décrivait la situation très dégradée des quartiers sensibles aux mains d’islamistes radicaux et de narcotrafiquants, concluant en ces termes : « Je crains que, demain, on ne vive face à face. »
Comment en est-on arrivé là ? Reportez-vous trente ou quarante ans en arrière : que la France paraissait paisible !
Mme Esther Benbassa s ’ exclame.

Disons-le tout net : le budget de la mission « Immigration, asile et intégration » pour 2019, pourtant en augmentation de 22, 7 %, à hauteur de 1, 7 milliard d’euros, ne repose sur aucune ambition politique de relever ces immenses défis. Pourtant, n’est-il pas urgent d’ouvrir le débat sur les priorités de la générosité nationale ?
Tout d’abord, ces trois termes obéissent à une compréhension différente et devraient être traités séparément : l’asile pour Asia Bibi n’a rien à voir avec l’immigration d’un étudiant ou d’un cadre japonais qui vient travailler en France. Quant à l’intégration, ultime étape d’un parcours personnel, elle renvoie à un désir de vivre dans un pays d’adoption et d’en partager les valeurs et les usages.
Si le rôle du politique est de fixer des repères, lier ces trois notions signifie ne pas comprendre, ni maîtriser, ni anticiper les dangers pour la patrie que représente cette absence de politique migratoire. Il faut nommer, compter et distinguer.
D’ailleurs, ces 1, 7 milliard d’euros ne représentent qu’une infime partie des coûts liés à l’immigration : dans le document de politique transversale annexé au projet de loi de finances pour 2019, auquel contribuent neuf ministères, le coût estimé est de 6, 2 milliards d’euros.
Y a-t-il une crise migratoire ? Certains le réfutent. Ainsi, le directeur général de France Terre d’asile m’a assuré qu’il n’y avait plus de crise migratoire. Malheureusement, dans la même conversation, il m’a expliqué que les effectifs de son organisation étaient passés de 30 personnes en 1998 à 900 cette année et que, pourtant, il manquait de moyens…
Sans parler des zones de conflit et de la dégradation du contexte géostratégique, les bouleversements démographiques à l’œuvre à nos portes, avec une Afrique passée de 100 millions d’habitants en 1900 à 1, 2 milliard aujourd’hui, et qui en comptera 2, 5 milliards en 2050, appellent à sortir du silence.
Pouvons-nous, en conscience, détourner les yeux ? Stephen Smith, dans La Ruée vers l ’ Europe, affirmait en 2017 que l’on n’avait jamais connu une telle pression démographique : « À l’échelle du continent africain, 42 % des jeunes déclarent vouloir émigrer. »
Cette absence de lucidité par rapport aux enjeux, ce projet de budget en est imprégné. Pour les 70 000 à 80 000 obligations de quitter le territoire français, ou OQTF, le Gouvernement fait malheureusement semblant d’appliquer les décisions. Ainsi, on observe une stagnation des crédits pour les reconduites à la frontière, à environ 30 millions d’euros depuis quatre ans, et une baisse continue du taux d’exécution des mesures d’éloignement, qui atteignait à peine 12, 5 % au premier semestre de 2018. Que deviennent les personnes concernées ?
Les chiffres des demandes d’asile sont systématiquement sous-évalués. Ainsi, en 2017, alors que 97 300 demandes d’asile avaient été prévues, plus de 100 000 ont été enregistrées. L’enveloppe de l’allocation pour demandeur d’asile, l’ADA, pourtant revalorisée de 5, 7 %, pour atteindre un peu plus de 335 millions d’euros, sera insuffisante. En effet, le nombre des demandes d’asile continue de croître, à rebours de ce que l’on observe chez nos voisins : au premier semestre de cette année, il a augmenté de 16, 7 %, et nous devrions dépasser les 110 000 demandeurs d’asile l’année prochaine, contre 35 000 en 2007.
Surtout, ces chiffres cachent la hausse du nombre des demandeurs d’asile sous procédure Dublin. Alors que, partout en Europe, le flux des demandes diminue, il continue d’augmenter chez nous. N’est-ce pas la conséquence de notre politique laxiste ?
Mais je dois dire, mes chers collègues, que ce qui me choque le plus, c’est la gestion comptable de cette question décisive pour notre avenir. Nous alignons des chiffres, sans réaliser que, en 2017, nous avons reçu plus de 100 000 demandeurs d’asile, des mineurs isolés et accordé 240 000 titres de séjour. Si l’on ajoute à cela les « dublinés » et l’immigration clandestine, nous dépassons largement les 450 000 entrées. Avons-nous conscience que, à ce rythme, sur cinq ans, c’est au minimum la population de ville de Paris que nous aurons accueillie ? Pouvons-nous nourrir, loger, soigner et intégrer dignement autant de personnes ? Vous devinez la réponse…
Avons-nous été élus pour agir contre les intérêts de la France et des Français ? Il n’y a ni fermeté ni humanité à laisser faire les trafiquants d’êtres humains qui se jouent de nos faiblesses !
Pour éviter d’aller plus avant dans la désintégration de l’identité nationale et la partition du territoire, ayons le courage de reprendre en main nos frontières, qui décrivent les appartenances culturelles et historiques dont nous avons besoin pour vivre.
Dans la situation chaotique que nous traversons, le président Macron serait bien inspiré de refuser le pacte pour les migrations.
M. Alain Houpert opine.

Quant à ce projet de budget qui mérite d’être qualifié d’insincère, mes chers collègues, je vous invite naturellement à le rejeter !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, trois minutes, c’est peu pour résumer l’avis de la commission des lois sur le projet de budget de cette mission. Je me bornerai donc à rappeler quelques principes.
Il faut reconnaître que, à périmètre constant, ce budget augmente de l’ordre de 12 %, et qu’un effort assez substantiel est consenti, puisque les crédits sont en hausse de 0, 6 %, soit 200 millions d’euros, par rapport à ce qui avait été programmé. Toutefois, la commission des lois regrette de retrouver dans ce budget des incohérences qu’elle a déjà signalées lors des débats sur la loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, promulguée en septembre dernier.
Monsieur le secrétaire d’État, nous avons bien observé les efforts consentis.
S’agissant d’abord de l’intégration, éternel parent pauvre des politiques migratoires ces dernières années, dont votre rapporteur pour avis avait dénoncé l’insuffisance des moyens l’année dernière déjà, la hausse des crédits devrait profiter à l’accueil des étrangers primoarrivants, via notamment des mesures d’insertion professionnelle et un doublement des cours de langue, ainsi que le préconisait le Sénat. Si cet effort doit être reconnu, il nous faudra rester attentifs à la mise en œuvre des mesures.
Des efforts sont prévus également pour l’accompagnement matériel des réfugiés, avec la création de places d’hébergement pour les demandeurs d’asile. C’est un élément important, mais sans doute faudra-t-il à terme simplifier le dispositif technique, qui paraît complexe.
Reste que ces hausses ponctuelles et importantes des moyens par rapport à 2018 sont généralement fondées sur des hypothèses peu plausibles. À l’évidence, les moyens prévus sont insuffisants au regard de la réalité des phénomènes migratoires auxquels nous devons faire face.
Ainsi, le projet de loi de finances prévoit une stabilisation de la demande d’asile en 2019 puis en 2020, alors que la France reste exposée à une demande d’asile sans précédent, situation atypique en Europe : les demandes ont crû de près de 19 % cette année, avec des flux secondaires en provenance d’Espagne, en sorte que le seuil des 100 000, voire des 120 000 demandeurs, devrait être franchi.
Or les budgets alloués à nos organismes sont stables : ni l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, ni la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA, non plus probablement que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII, ne pourront tenir le délai cible de six mois en moyenne pour le traitement des demandes, pas plus que l’objectif de 86 % de demandeurs d’asile hébergés.
En ce qui concerne l’immigration régulière, toujours très dynamique, le nombre des admissions exceptionnelles au séjour a cessé de croître, mais, contrairement à nos espérances, la circulaire Valls, qui représente 30 % de ces régularisations, n’a pas été supprimée.
Enfin, l’immigration irrégulière reste le parent pauvre de la politique migratoire : ses crédits ne représentent que 8 % du total de la mission. Certes, un effort important est consenti pour 2019 en matière de rétention, avec la création de 450 places nouvelles, mais l’effort est quasi nul depuis quatre ans pour ce qui concerne les crédits consacrés à la mise en œuvre des mesures d’éloignement.
La France n’étant pas en mesure de réaliser un quelconque suivi des déboutés du droit d’asile, il n’est guère étonnant que nos politiques d’éloignement des étrangers en situation irrégulière soient un échec. Le taux d’exécution des obligations de quitter le territoire français, déjà dérisoire en 2017, a encore baissé cette année… Sur les six premiers mois de 2018, seulement 12, 6 % des décisions d’éloignement ont été exécutées !
Je ne parlerai pas de la procédure Dublin, si ce n’est pour faire observer que l’évolution espérée ne se produira pas, le commissaire européen Avramópoulos ayant annoncé hier dans la presse qu’il n’était pas possible de trouver un accord. Nous sommes donc en très grande difficulté.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission des lois a émis un avis défavorable sur les crédits de cette mission.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de dix minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. le rapporteur pour avis regrette que la circulaire Valls sur l’admission exceptionnelle au séjour n’ait pas été abrogée. Une circulaire est une sorte de compilation de textes législatifs et réglementaires. Il ne nous dit pas exactement ce qu’il voudrait y changer. S’agissant des paramètres sur lesquels le Gouvernement a une certaine marge de manœuvre, je signale que les critères d’admission prévus par les circulaires Sarkozy de 2006 et Hortefeux de 2008 étaient plus souples…
Vous regrettez aussi, monsieur Buffet, l’absence d’augmentation des crédits pour le financement de l’exécution des mesures d’éloignement. Je rappelle qu’un éloignement coûte en moyenne plus de quatre SMIC. C’est la méthode qui pose problème aujourd’hui, pas le manque d’argent. En réalité, le « tout-rétention » n’est pas efficace, surtout quand les pays d’origine ne coopèrent pas. La méthode allemande, plus souple, est plus efficace.
Monsieur Buffet, vous déplorez que le nombre de personnes en situation irrégulière augmente. Cela vaut pour toute l’Europe : de la Grèce à l’Allemagne et de la Turquie au Maroc, partout on constate une telle augmentation. Ces dernières années, le flux est plutôt mieux maîtrisé en France que dans nombre de pays voisins.
Le rapport de la commission des finances, quant à lui, semble confondre les crédits de cette mission de pilotage de la politique d’asile et d’immigration avec un supposé coût de l’immigration. Pourtant, les estimations de recettes, en termes de cotisations sociales ou d’impôts, rapportées au coût des prestations sociales et de la scolarité des enfants, notamment, montrent que la population immigrée apporte une contribution positive, tant à l’État qu’aux organismes sociaux, alors que l’immigration est toujours vue comme un coût !
Je rappelle à ceux qui affirment que signer le pacte de Marrakech sur les migrations serait une mauvaise chose que, si l’on souhaite lutter contre les passeurs et les trafics, il est bon d’améliorer le dialogue entre pays d’arrivée et pays de départ. Instaurer un cadre de dialogue est utile pour lutter contre l’immigration irrégulière : c’est l’objet de ce pacte, qui sera un outil non contraignant à la disposition des différents États, dont il respecte pleinement la souveraineté.
La France n’est pas seule face à ces défis. Depuis 2015, l’Europe a fait beaucoup. Ainsi, les franchissements irréguliers des frontières européennes sont passés de plus de 1, 8 million en 2015 à moins de 150 000 par an aujourd’hui. Au cours de la même période, le nombre des demandes d’asile a été divisé par deux. C’est le résultat des politiques européennes. À cet égard, le budget de FRONTEX a plus que doublé entre 2015 et 2018. Si la situation reste préoccupante, il faut rappeler le chemin déjà parcouru !
Il est important, monsieur le secrétaire d’État, d’être attentif au budget de l’OFPRA, qui représente moins de trois semaines de financement de l’ADA. Pour des raisons à la fois humanitaires, d’efficacité et budgétaires, il importe que cet organisme puisse étudier rapidement les demandes d’asile. Ne le ramenons pas à sa situation de 2012 ! Aujourd’hui, il faut à l’OFPRA moins de cent jours pour étudier une demande d’asile : c’est un beau résultat, fruit du travail de ses agents. Pour aller plus loin et faire davantage d’économies, il faudrait donner la possibilité aux demandeurs d’asile de travailler et veiller à ce que l’application de la nouvelle loi sur l’asile permette d’améliorer l’accueil dans les services des étrangers des préfectures, la formation et le statut des personnels, ainsi que la cohérence entre les informations disponibles sur service-public.fr et les sites des préfectures et la réalité des choses. Je souligne aussi l’importance de la question des langues pour accélérer le traitement des demandes d’asile.
Les conditions de travail difficiles des agents de la police aux frontières – leur temps de travail dépasse souvent largement ce qu’il devrait être – pèsent aussi sur le quotidien des personnes en rétention.
Monsieur le secrétaire d’État, si nous sommes très critiques à l’égard des positions de la majorité sénatoriale, nous ne pourrons cependant pas voter les crédits dévolus à une politique qui manque de solidarité envers des pays comme l’Italie ou l’Espagne, avec les conséquences politiques que nous constatons aujourd’hui en Italie. Nous ne sommes bien sûr pas seuls responsables de cette catastrophe européenne, mais nous y avons participé.
Après l’Aquarius, ce sont aujourd’hui des bateaux marchands qui, alors qu’ils ne font que respecter le droit de la mer en sauvant des vies, ne savent pas où accoster pour mettre en sécurité les personnes qu’ils ont repêchées !
Je constate aussi que la coopération entre les garde-côtes libyens et l’Union européenne est très aléatoire, d’autant que l’on ne sait pas très bien à qui ils répondent.
Enfin, nous refusons une application de la procédure Dublin qui conduit 30 % des demandeurs d’asile en France à végéter pendant dix-huit mois avant de pouvoir engager la démarche. En attendant, ils vivent de manière indigne dans nos rues. Soit un autre pays a déjà étudié leur demande d’asile, auquel cas il faut changer les règles pour plus d’efficacité, soit ils n’ont pas encore déposé de demande d’asile, auquel cas nous devons appliquer le système Dublin de manière plus souple, pour qu’ils puissent la formuler immédiatement en France.
Par ailleurs, monsieur le secrétaire d’État, pourquoi les personnes ayant travaillé avec l’armée française en Afghanistan n’obtiennent-elles pas toutes rapidement un visa dans des conditions dignes ?

Je n’ai pas parlé d’intégration, parce qu’avec des discours comme celui de notre collègue rapporteur spécial rien ne sera jamais possible, quelle que soit l’importance des moyens engagés !
La France inclusive que nous appelons de nos vœux n’a pas besoin d’une pluie de milliards : elle a simplement besoin de s’aimer et de faire vivre ses principes. C’est plus difficile que de mobiliser des milliards, mais là est l’enjeu pour l’intégration : respecter les droits, refuser absolument toute discrimination et permettre que, d’une génération à l’autre, les jeunes qui naissent en France puissent se sentir français et ne pas être discriminés du fait de leur origine !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, les crédits affectés à la mission « Immigration, asile et intégration » dans le projet de loi de finances pour 2019 sont en hausse de 22, 7 % en crédits de paiement. Toutefois, comme d’autres missions, celle-ci voit son périmètre élargi : à périmètre constant, l’augmentation n’est que de 12 % à 14 % en crédits de paiement.
Nécessaire, cette augmentation nécessaire vise à faire face à des demandes d’asile toujours plus nombreuses année après année : leur nombre a augmenté de 17 % en 2018 par rapport à 2017. C’est donc sans surprise que la grande majorité des crédits sont concentrés sur l’action n° 02, Garantie du droit d’asile.
Bien entendu, ces chiffres à eux seuls ne sauraient refléter les dépenses de l’État pour les politiques d’immigration, d’asile et d’intégration, qui ont de multiples coûts annexes, portant la facture pour l’État à près de 5, 8 milliards d’euros pour 2018.
Si le Gouvernement a augmenté les crédits de la mission, ceux-ci restent encore insuffisants pour traiter en profondeur l’enjeu majeur que constituent l’immigration et l’asile dans notre pays.
Conscient qu’il faut repenser totalement notre système d’accueil et d’intégration, de l’hébergement d’urgence à l’exécution des décisions administratives, j’accueille très favorablement l’initiative prise par le Gouvernement de consacrer une loi à cette problématique. Cela me semble d’autant plus nécessaire que, partout en Europe, et même ailleurs, le populisme gagne du terrain en se nourrissant de la question migratoire. Adopter une approche globale est donc absolument nécessaire si l’on veut que les Français ne perçoivent pas notre politique d’accueil et d’intégration comme une charge déraisonnable et contraire à leurs intérêts.
« Il faut avoir à l’esprit que cette vision négative est liée au sentiment de déclassement et au renforcement des inégalités que certains de nos concitoyens éprouvent. » Tels étaient mes propos en juillet dernier, monsieur le secrétaire d’État, des propos qui font malheureusement écho à la crise des « gilets jaunes » que nous sommes en train de vivre.
Pour revenir à la question migratoire, le texte de juillet dernier, s’il a la vertu de corriger ou d’améliorer certains dispositifs, laisse des pans entiers de la problématique sans réponse. Comme les États à l’échelle européenne, les territoires français ne sont pas exposés de la même manière aux phénomènes migratoires : les zones frontalières, particulièrement les îles françaises les plus éloignées, sont les premières concernées.
À cet égard, la situation en outre-mer est largement sous-estimée. Je pense à Mayotte et à la Guyane, mais aussi à mon territoire, Saint-Martin, qui doivent faire face à un afflux important de migrants au regard de leur taille et de leur population, ce qui fragilise fortement les équilibres locaux. À Saint-Martin, l’inexistence d’une frontière étatique physique sur l’île tend à favoriser l’installation de populations immigrées, dont la précarité s’est accrue après les désastres causés par l’ouragan Irma, dont nous peinons toujours à nous relever.
Rien non plus, dans la loi de juillet dernier, ne permet de surmonter les difficultés chroniques dans les services publics régaliens ni de garantir des solutions d’hébergement d’urgence effectives. La loi ne comporte pas davantage de dispositions contraignantes relatives à la question des futurs réfugiés climatiques ou destinées à lutter contre la traite des êtres humains à laquelle se livrent les passeurs.
Le projet de loi de finances pour 2019 ne contient aucune mesure complétant utilement nos travaux de juillet dernier ou apportant des moyens supplémentaires pour combler les lacunes que je viens de mentionner. L’augmentation des crédits de paiement est avant tout un ajustement, au demeurant indispensable, du budget pour répondre à l’accroissement du nombre des demandes d’asile à traiter.
C’est peut-être la seule raison qui conduira la grande majorité du groupe du RDSE à voter les crédits de la mission. Nous mettons cependant en garde le Gouvernement : s’il veut réellement traiter le sujet dans toutes ses dimensions, il lui faudra mobiliser à l’avenir des moyens beaucoup plus importants !

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, « la qualité de notre politique d’intégration est au cœur de l’équilibre général de notre politique d’immigration et d’asile. Nos priorités sont connues. Nous voulons un système d’asile plus rapide, une politique d’éloignement plus efficace pour les étrangers en situation irrégulière, une politique d’intégration digne de notre République pour tous ceux à qui nous donnons le droit de séjourner en France. »
Ces mots ne sont pas de moi, mais du Premier ministre, qui les a prononcés devant le Comité interministériel à l’intégration, le 5 juin dernier. En d’autres termes, le Gouvernement entend mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Nous saluons cette volonté.
Au regard de ces dernières années, force est de constater que la demande d’asile connaît, en France, une hausse sans précédent, alors que, dans d’autres États européens, elle est en baisse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : au cours de la décennie 2007-2017, la demande de protection internationale en France a pratiquement triplé, augmentant de 183 %.
L’immigration régulière est toujours très dynamique, certains efforts ayant été réalisés. En effet, l’année 2019 sera marquée par une augmentation des crédits destinés à l’accueil des étrangers primoarrivants.
De plus, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie produit ses premiers effets. Elle a permis, entre autres résultats, une meilleure insertion professionnelle des étrangers, auxquels elle assure une formation dispensée en langue française.
Néanmoins, notre collègue François-Noël Buffet signale, au nom de la commission des lois, que, « malgré des hausses ponctuelles, les moyens programmés par le présent budget sont fondés sur des hypothèses irréalistes et restent notoirement insuffisants au regard de la réalité des phénomènes migratoires auxquels la France est aujourd’hui confrontée ». En particulier, en raison de la forte hausse de la demande d’asile dans notre pays, les objectifs avancés par le Gouvernement – respect d’un délai cible de six mois pour le traitement des demandes d’asile et 86 % de demandeurs d’asile hébergés – ne semblent pas tenables.
Je voudrais attirer votre attention sur les crédits alloués à l’action n° 03 du programme « Immigration et asile », intitulée Lutte contre l’immigration irrégulière. Ils sont certes bienvenus, mais ne prennent pas en compte les conséquences de l’augmentation du nombre des demandes d’asile, non plus que les flux secondaires en provenance, notamment, d’Italie et d’Espagne. Ma collègue Denise Saint-Pé avait alerté le Gouvernement à cet égard lors des questions d’actualité au Gouvernement du 8 novembre dernier, expliquant que les Pyrénées étaient devenues une nouvelle route pour les populations migrantes. De fait, plus de 50 000 personnes sont arrivées sur les côtes espagnoles depuis le début de l’année, ce qui représente la moitié des entrées sur le continent. En réponse à ma collègue, monsieur le secrétaire d’État, vous avez exprimé votre volonté de nommer un coordinateur pour l’ensemble du massif pyrénéen, afin qu’un interlocuteur unique dialogue avec les autorités espagnoles : pouvez-vous nous indiquer si cette initiative s’est concrétisée et ce qui ressort de vos échanges avec les autorités espagnoles ?
La suite de mon propos sera consacrée au nombre de mesures d’éloignement effectivement exécutées.
Nous le savons, mes chers collègues, l’effort à cet égard est quasi nul. En effet, depuis quatre ans, les dépenses d’éloignement des migrants en situation irrégulière stagnent à un niveau proche de 30 millions d’euros. Je fais notamment référence à l’organisation des procédures d’éloignement par voies aérienne et maritime des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, dont la mise en œuvre revient à la police aux frontières.
Le problème est connu : près de neuf obligations de quitter le territoire sur dix ne sont pas exécutées. C’est une question complexe, dont la résolution, j’en suis bien conscient, ne nécessite pas simplement une écriture budgétaire.
Plus globalement, le problème majeur sur lequel bute ce gouvernement, comme d’ailleurs ceux qui l’ont précédé, est celui du traitement des déboutés du droit d’asile.
Oui, la France doit continuer à protéger les populations en danger au titre de l’asile. Oui, elle a encore des progrès à faire dans le traitement de ces demandes et sur les garanties offertes à ceux qui obtiennent l’asile. Mais, surtout, pour que ce système fonctionne, pour qu’il ait un sens, il est indispensable que nous trouvions de nouvelles solutions efficaces afin que les déboutés ne viennent pas presque systématiquement grossir les rangs des personnes en situation irrégulière sur notre territoire.
Monsieur le secrétaire d’État, cette diminution des crédits est en contradiction avec l’intention affichée à plusieurs reprises par le Gouvernement de faciliter l’accès aux places de rétention partout sur le territoire, en vue, notamment, de lutter contre l’insécurité et de renforcer la lutte contre l’immigration irrégulière.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, les sénateurs centristes ne peuvent pas apporter leur soutien aux crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » du projet de loi de finances pour 2019 !
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, dans le projet de loi de finances pour 2019, la mission « Immigration, asile et intégration » voit ses ressources fortement augmenter, il faut le souligner. En effet, le montant du budget alloué à cette mission s’établit à 1, 7 milliard d’euros en crédits de paiement et à 1, 9 milliard d’euros en autorisations d’engagement, soit une progression respective de 23 % en crédits de paiement et de 37, 5 % en autorisations d’engagement en un an.
Certes, le budget augmente, mais avec la crise migratoire que connaît l’Union européenne et avec les programmes de relocalisation, il est loin d’être suffisant. Ne nous y trompons pas : il s’agit encore une fois d’un budget d’affichage où rien n’est fait efficacement pour lutter contre l’immigration irrégulière. Voilà pourquoi ce budget suscite de nombreuses remarques.
Tout d’abord, et il s’agit d’un point positif, je salue les efforts consentis en vue d’accueillir les étrangers en situation régulière. Je mentionnerai le renforcement du dispositif d’hébergement d’urgence et de la formation linguistique, ainsi que l’évolution du contrat d’intégration républicaine.
En revanche, il est toujours difficile de comprendre que le Gouvernement persiste à refuser l’abrogation de la circulaire Valls du 28 novembre 2012, qui a conduit en cinq ans à une augmentation de plus de 30 % des régularisations d’étrangers en situation irrégulière.
En 2017, on a comptabilisé 10 654 exécutions de mesures d’éloignement de moins qu’en 2012, alors que la pression migratoire était largement supérieure. Pis encore, le taux d’exécution des mesures prononcées recule, signe de l’insuffisance des politiques mises en œuvre.
Sur ce point, les chiffres sont édifiants : seuls 17, 5 % des obligations de quitter le territoire français ont été exécutées l’an dernier. Il s’agit du plus bas niveau historique. Non seulement ces obligations de quitter le territoire sont peu appliquées, mais le Gouvernement ne prend même pas la peine de prendre une telle mesure quand un demandeur d’asile est débouté de sa demande ; en effet, seuls 36 % des déboutés en reçoivent une.
Une politique d’éloignement efficace constitue, à bien des égards, le pendant d’une bonne intégration des étrangers en situation régulière, et notamment des réfugiés.
La crédibilité de nos politiques d’éloignement est en outre entachée par les difficultés d’application du règlement de Dublin, qui prévoit le transfert des demandeurs d’asile vers l’État de l’Union européenne responsable de leur traitement, sans qu’une volonté de réforme se manifeste à ce jour : moins de 12 % des étrangers sous procédure Dublin ont été effectivement transférés vers un autre État au début de 2018.
Ce laxisme en matière d’éloignement du territoire vous conduit même, monsieur le secrétaire d’État, à refuser d’éloigner ceux qui représentent une menace pour la sécurité des Français. Je veux parler des 3 391 étrangers fichés pour radicalisation à caractère terroriste.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, dans ce contexte, le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne votera pas les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » pour 2019.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mes chers collègues, cette année encore, malgré un environnement budgétaire contraint et un contexte migratoire difficile, le budget consacré à la mission « Immigration, asile et intégration » connaît une augmentation significative, puisqu’il atteindra 1, 69 milliard d’euros en 2019, soit 314 millions d’euros de plus qu’en 2018.
Monsieur le secrétaire d’État, cette hausse de 22 %, cohérente avec l’objectif du plan gouvernemental de refonte de notre politique d’asile et d’immigration et les dispositions de la loi du 10 septembre dernier, vous permettra d’améliorer les conditions d’exercice du droit d’asile et de faire face aux défis des migrations et de l’intégration des étrangers entrés régulièrement en France.
Suivant ces trois objectifs, le budget que vous nous présentez prévoit une mise à niveau et une réorganisation du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile, qui permettra de disposer de plus de 97 000 places en 2019.
S’il est vrai que ce budget repose sur une hypothèse optimiste de stabilisation de la demande d’asile et de baisse des demandeurs d’asile placés sous la procédure Dublin, il me semble que sa sincérité n’en est pas pour autant affectée. En effet, cette année, aucun décret d’avance n’a été prévu sur cette mission dans le projet de loi de finances rectificative, ce qui démontre que cette action n’avait pas été sous-budgétisée. Je tiens à préciser que cela n’était pas arrivé depuis neuf ans.
S’agissant de l’immigration régulière, je voudrais saluer les efforts consentis par le Gouvernement en matière d’intégration des étrangers primoarrivants. Les crédits alloués permettront notamment le renforcement de l’accompagnement en matière d’insertion professionnelle, et le doublement des cours de français et d’éducation civique. L’emploi, la maîtrise de la langue et la compréhension des valeurs de la République sont en effet des facteurs essentiels d’intégration.
Enfin, concernant la lutte contre l’immigration irrégulière, s’il est vrai que l’essentiel des crédits est consacré au maintien en zone d’attente ou en rétention, il est en revanche inexact de dire que l’effort dédié à l’éloignement est quasi nul. Même si ce n’est pas suffisant, quelque 30, 9 millions d’euros sont consacrés aux frais d’éloignement des migrants en situation irrégulière, ce n’est pas rien.
Je ne puis évidemment pas m’exprimer sur cette question sans évoquer la situation au sein de mon département, où plus de la moitié de la population est étrangère et d’où sont effectuées chaque année la moitié des reconduites à la frontière depuis la France.
La pression migratoire inouïe que subissent les Mahorais m’a conduit à proposer l’adaptation des règles d’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France.

Cette proposition a reçu l’avis favorable du Conseil d’État et a été validée par la suite par le Conseil constitutionnel. Il faut savoir que cela concerne tout de même 41 % à 50 % des naissances enregistrées à Mayotte.

Si, c’est très bien, chère collègue !
Au cours des dix derniers mois, des tensions importantes sont apparues dans les rapports entre les autorités comoriennes et les autorités françaises. Ces tensions ont eu pour conséquence de suspendre le retour chez eux de migrants reconduits à la frontière depuis Mayotte, ou de les rendre aléatoires, suscitant la colère légitime de la population mahoraise.
La crise était tellement profonde que, le 21 mars dernier, l’Union des Comores a renvoyé vers Mayotte un bateau qui devait accoster à Anjouan, avec, à son bord, une centaine de migrants reconduits à la frontière.
Fort heureusement, nous avons retrouvé le chemin du dialogue et, aujourd’hui, des retours sont de nouveau effectués grâce aux relations que le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, entretient avec le gouvernement comorien. Il est vrai que le dialogue est primordial, comme le soulignait notre collège Jean-Yves Leconte.
Ce dialogue entre nos deux pays, mené en concertation avec les élus mahorais, devrait donner lieu très prochainement à la formalisation d’un document-cadre qui comportera des décisions et des engagements réciproques en matière de lutte contre les mouvements de population non maîtrisés et de sauvegarde des vies humaines en mer, ainsi qu’en matière de développement.
Comme mes collègues parlementaires de Mayotte, je serai évidemment vigilant quant à sa bonne mise en œuvre et compte sur le Gouvernement pour apporter une solution pérenne à ce problème.
Pour conclure, je pense que ce budget pour 2019 donnera au Gouvernement les moyens de mener des politiques ambitieuses en matière d’asile et d’immigration régulière et irrégulière. C’est la raison pour laquelle le groupe La République En Marche votera en faveur des crédits de cette mission.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, monsieur le rapporteur spécial, mes chers collègues, il y a quelques mois, la Haute Assemblée adoptait un texte validant l’enfermement des mineurs en centre de rétention administrative, ou CRA, facilitant les expulsions et réduisant l’accès aux droits des exilés, alors même que nous connaissions, toutes et tous, la terrible réalité de ces destins arrachés à leur terre natale par la guerre, la famine, la persécution, l’instabilité politique et le dérèglement climatique.
Après le vote de la loi Asile et immigration, restait à découvrir le budget sur lequel s’appuierait sa mise en œuvre. Chacun peut aujourd’hui constater la nette augmentation des crédits alloués à cette mission. Pourtant, sous ces apparences flatteuses, se cache une réalité tout autre.
Alors que croît le nombre de requérants à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et en dépit des alertes lancées par les professionnels de terrain, le Gouvernement mise sur une stabilisation très hypothétique des demandes d’asile. Le dispositif d’hébergement et de formation professionnelle, absolument nécessaire à l’intégration des personnes émigrées, souffre d’une évidente sous-budgétisation. Ce choix politique ne fera qu’aggraver la précarité déjà grande des exilés et aboutira, je le crains, à l’apparition de nouveaux campements de fortune.
Par là même, le Gouvernement nous éclaire sur sa priorité : la lutte contre l’immigration irrégulière, au détriment de l’intégration républicaine, ce qu’attestent notamment les 450 places supplémentaires qui seront créées en CRA, et l’aide au retour largement déployée par l’exécutif.
Du fait d’un désengagement de l’État, qui se refuse à développer des programmes pertinents comme celui de l’AFPA – l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes –, ce sont les forces vives de la société civile qui prennent le relais, telles que la CIMADE, COALLIA et d’autres associations et organisations non gouvernementales, qui sont à la pointe des combats en faveur des migrants que les pouvoirs publics renoncent à mener eux-mêmes en matière d’accès aux droits, d’accès aux soins et de socialisation par l’emploi et l’apprentissage du français.
Au lieu de promouvoir les bienfaits de certaines politiques publiques exemplaires en matière d’intégration, ou d’apprécier pour ce qu’elles sont les innovations de la société civile pour accompagner l’arrivée des exilés, le Gouvernement préfère agiter les peurs.
Pourtant, que vous le vouliez ou non, monsieur le secrétaire d’État, les mouvements de populations à l’échelle mondiale ne sont pas près de s’estomper. Reprenant, hélas, à son compte les mots du Rassemblement national, votre prédécesseur estimait que l’Europe était actuellement « submergée » par les migrations d’une Afrique appauvrie et d’un Moyen-Orient en guerre. Je parle évidemment de M. Collomb.
Sourires.

Avec les 250 millions de réfugiés climatiques supplémentaires prévus par l’ONU d’ici à 2050, nous ne sommes qu’à l’aube de flux migratoires susceptibles de bousculer le principe même de frontière.
Nous devons donc adopter dès à présent une politique budgétaire ambitieuse en faveur d’une prise en charge sociale et sanitaire des exilés, par un traitement plus attentif et plus fluide des dossiers par l’OFPRA et la CNDA, la Cour nationale du droit d’asile, et par un soutien accru aux associations, qui effectuent un travail remarquable.
Sourires.

Soyons à la hauteur des enjeux et de l’histoire. Lors de l’arrivée des boat people en France, …

… Raymond Aron, Jean-Paul Sartre et d’autres avaient réussi à dépasser leurs clivages idéologiques pour agir en leur faveur.
Environ 120 000 d’entre eux furent effectivement admis, puis s’intégrèrent parfaitement. Pourquoi serions-nous incapables du même geste ?
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le secrétaire d’État, ce soir, j’imagine que vous avez davantage en tête les problèmes de samedi prochain que les questions migratoires. J’en suis désolé et j’espère que vous aurez la ténacité et le courage nécessaires pour assurer la sécurité de tous les Français ce jour-là.
Toutefois, revenons au sujet du jour. J’ai parfois l’impression de parler tout le temps d’immigration et d’avoir fait vingt ou trente rapports sur le sujet…
Pour faire bref, puisque je n’ai que très peu de temps, je commencerai par rappeler que tout État a le droit de décider de qui rentre sur son territoire. Dans ces conditions, nous devons respecter les obligations européennes. Celles-ci existent depuis des années : elles sont parfois compliquées, mais elles seront certainement renégociées après les élections européennes parce que, compte tenu du climat politique général dans l’ensemble de l’Europe, je doute que l’on en reste aux règles actuelles.
Ensuite, je n’insisterai pas sur ce point, mais je trouve un peu difficile, incohérent et franchement sans grand intérêt, l’adoption d’un pacte mondial sur les migrations sous les auspices de l’ONU. En théorie, il s’agit d’un accord non normatif, mais, en pratique, il y aura toujours quelqu’un pour nous dire que, d’après notre droit, la France devrait s’inscrire dans ce cadre. Je ne suis pas convaincu que ce pacte ait beaucoup d’effets, mais je suis convaincu que cela n’apportera rien à la politique migratoire de la France.
Enfin, j’évoquerai le droit d’asile : pour moi, il est imprescriptible et sacré. Mais le problème, c’est qu’il est détourné.
Nous ne sommes plus au XIXe siècle ou au début du XXe siècle, lorsque se pressaient aux frontières de la France des personnes qui étaient toutes torturées. Aujourd’hui, certaines personnes fuient la guerre, les massacres, les persécutions et doivent être, de ce fait, correctement accueillies. Mais, en parallèle, et c’est pourquoi on en arrive à 120 000 ou 130 000 demandes, beaucoup de personnes ressortissant à l’immigration économique cherchent en réalité à détourner les règles de l’asile pour venir en France.
La preuve, c’est que les décisions rendues par nos juridictions, quelles qu’elles soient, y compris après appel, aboutissent en gros à écarter 80 % des demandes d’asile. Seuls 20 % des demandeurs d’asile sont admis sur le territoire national avec le statut de réfugié, ce qui veut quand même dire que plus de 80 % de ces étrangers ne respectent pas les règles, ou, en tout cas, ne remplissent pas les critères.
Monsieur le secrétaire d’État, il faut bien entendu réduire l’immigration régulière. Il serait normal que le Parlement puisse voter chaque année des quotas sur le fondement des critères économiques et sociaux de la République, de même qu’il serait normal que nous puissions décider qui rentre ou ne rentre pas sur le territoire national de manière régulière.
Toutefois, je considère que le vrai problème aujourd’hui – je l’ai toujours dit –, c’est que les réfugiés qui obtiennent l’asile n’obtiennent en réalité pas grand-chose, voire très peu de chose ! Les crédits alloués à l’intégration sont en effet notoirement insuffisants.
Le réfugié va faire un peu de français, un peu de formation civique ici ou là. Le ministère a imaginé un petit film pour lui résumer l’histoire de France en une demi-heure, de la préhistoire au général de Gaulle. Les cours de français sont certes obligatoires, mais ils ne sont pas sanctionnés d’un examen final pour vérifier si le réfugié a la moindre connaissance dans ce domaine, ce qui veut dire en fait qu’il suffit pour lui de se présenter. À part cela, rien ! Ce n’est ni sérieux ni digne.
Pour les réfugiés, pour les immigrés en situation régulière, les centres d’accueil, quels que soient les efforts que l’on fait en la matière, les campements dans les rues, le manque de place, c’est indigne ! En fait, nous sommes sursaturés, et comme nous sommes sursaturés, nous traitons mal tout le monde : les immigrés en situation régulière, ceux qui sont en situation irrégulière et qui ne quittent pas le territoire national, et les réfugiés qui ne sont pas bien intégrés.

J’en termine, monsieur le président, en disant que, tant que l’on ne remettra pas à plat la politique migratoire, on n’y arrivera pas.
En attendant, comme l’ensemble du groupe Les Républicains, je voterai naturellement contre les crédits de cette mission.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, notre pays, comme de nombreux pays européens, doit faire face à un phénomène migratoire majeur, qui devrait conduire à la mise en œuvre de politiques et de mécanismes appropriés.
C’est la raison pour laquelle la mission « Immigration, asile et intégration » est éminemment prioritaire.
Je veux évoquer ici une question qui occupe tout particulièrement le sud-ouest de notre pays, celle de l’augmentation sensible des flux transitant par la route dite « de la Méditerranée occidentale ». L’Espagne est en effet aujourd’hui le premier point d’entrée des migrants dans l’Union européenne, avec plus de 41 000 migrants arrivés en Espagne au cours des neuf premiers mois de 2018, soit une hausse de plus de 143 % par rapport à 2017.
Nos voisins espagnols sont par là même exposés à une très forte augmentation de la demande d’asile, avec une proportion importante de mineurs non accompagnés. Ces migrations donnent bien souvent lieu à des flux dits « de rebond » vers la France, puisque nombre de ces migrants ne font que transiter par l’Espagne et cherchent à franchir les Pyrénées. En témoigne la forte hausse du nombre de refus d’entrée à la frontière franco-espagnole.
Comme je le disais dans mon propos liminaire, la France est confrontée, non pas à un, mais à des phénomènes migratoires sans précédent, protéiformes et aux résonnances multiples.
Pour ce projet de loi de finances pour 2019, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » représentent 1, 86 milliard d’euros en autorisations d’engagement et 1, 69 milliard d’euros en crédits de paiement, soit une hausse de 38 % en autorisations d’engagement et de 22 % en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2018. À périmètre constant, ces crédits augmenteront donc de 12 %.
Néanmoins, si le budget de la mission et de ses deux programmes affiche des crédits en hausse, ces derniers sont loin d’être suffisants.
Je voudrais parler plus particulièrement de la problématique du règlement de Dublin. En 2017, près de 36 % des demandes d’asile déposées au guichet unique des préfectures s’inscrivaient dans le cadre de ce règlement, soit 36 000 demandes. Il s’agit là d’un niveau sans précédent : pour rappel, les demandes sous procédure Dublin étaient au nombre de 22 300 en 2016.
L’année 2018 confirme par ailleurs cette tendance, puisque, au cours du seul premier semestre 2018, on comptabilisait 19 400 demandes. Notre pays reste ainsi confronté, cette année encore, à une forte augmentation du nombre des demandeurs d’asile placés sous cette procédure.
Je regrette donc le refus du Gouvernement d’une éventuelle abrogation de la circulaire Valls ou, a minima, d’un durcissement des règles fixées par cette circulaire, alors même que cette dernière a contribué à l’augmentation significative des régularisations : plus de 30 % en cinq ans !
Afin d’élaborer le présent projet de loi de finances, le Gouvernement a retenu une hypothèse particulièrement basse, pour ne pas dire chimérique, de progression de la demande d’asile, puisqu’il table sur une hausse de 10 % seulement en 2018, et de 0 % en 2019 puis en 2020 !
Le Gouvernement considère que le flux des personnes placées sous la procédure Dublin n’augmentera que de 10 % en 2018 et diminuera de 10 % en 2019 puis en 2020.
Monsieur le secrétaire d’État, permettez-moi de m’interroger sur les éléments factuels, sources et autres mesures ayant amené le Gouvernement à de telles hypothèses. Je rejoins les propos émis par le rapporteur pour avis de la commission des lois, François-Noël Buffet, et m’interroge, à juste titre, sur la « crédibilité des hypothèses sur lesquelles le Gouvernement a calibré les crédits relatifs à l’asile au sein de ce budget, minorant exagérément une demande d’asile toujours très dynamique, au risque de fausser la sincérité de la programmation budgétaire ».
C’est donc sans états d’âme que notre groupe ne s’associera pas à ces orientations et ne votera pas les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur spécial, monsieur le rapporteur pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » représentent 1, 694 milliard d’euros, soit une hausse de 13 % à périmètre constant, après une progression de 26 % en 2018.
Cette hausse significative traduit le fait que la pression migratoire reste forte dans notre pays, avec notamment une demande d’asile très soutenue. Notre attachement à la sincérité budgétaire nous a donc conduits à accompagner cette hausse de la demande d’asile sur le plan budgétaire.
Cette hausse correspond également à la traduction budgétaire de priorités politiques très claires en application, d’une part, des décisions prises lors du comité interministériel à l’intégration du 5 juin 2018, et, d’autre part, du plan d’action du Gouvernement pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser les flux migratoires.
Ce budget pour 2019 est donc robuste et complet. En effet, il garantit les moyens qui permettront à l’État de renforcer les capacités d’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés – j’y reviendrai.
Ensuite, il assure des ressources nouvelles pour renforcer les instruments de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, qui est bien une priorité.
Enfin, il permet le changement d’échelle des politiques d’intégration, qui sont déployées en faveur des étrangers qui ont vocation à rester durablement en France. Il s’agit d’une politique très équilibrée, madame Benbassa, qui priorise certes la politique de reconduite, mais également l’intégration. Je vous donnerai quelques éléments chiffrés dans un instant.
Vous le savez, notre pays reste soumis à une pression migratoire intense, évolutive, qui appelle de notre part une action toujours plus déterminée.
Cette pression migratoire n’est pas sans paradoxes. Entre 2016 et 2017, le nombre de demandeurs d’asile dans l’Union européenne a diminué de moitié, mais il a augmenté de 17 % en France, dépassant le cap des 100 000 demandes d’asile enregistrées à l’OFPRA. Pour une part importante, cette hausse de la demande d’asile émane de personnes qui n’ont pas de véritable besoin de protection. J’en citerai deux exemples.
En 2017, le pays qui se classait au premier rang des demandeurs d’asile dans notre pays était l’Albanie, pays sûr, candidat à l’entrée dans l’Union européenne, dont les ressortissants n’ont guère plus de 6 % de chances d’obtenir le statut de réfugié.
La même année, on constatait en Guyane une hausse constante et préoccupante de la demande d’asile provenant d’Haïti, avec des personnes qui ne font généralement pas état de motifs de protection au sens du droit international.
D’où ce paradoxe : la demande d’asile est en hausse, alors que les arrivées sur notre continent de personnes fuyant véritablement la guerre baissent. Cette réalité, le Gouvernement s’en est saisi à bras-le-corps, et je reprendrai, pour en apporter la démonstration, les deux mêmes exemples.
La demande d’asile en provenance de l’Albanie enregistre, sur les neuf premiers mois de 2018, une baisse de 41 % par rapport à la même période en 2017. Pour obtenir ce résultat, l’élaboration avec le Gouvernement albanais d’un plan d’action très concret, destiné à dissuader les flux migratoires irréguliers, a été décisive.
En Guyane, le constat avait été dressé que la durée excessive de nos procédures d’asile constituait un facteur important d’attractivité. Nous avons donc pris un décret réduisant à titre expérimental le délai de traitement de l’asile dans ce territoire à deux mois, ce qui a permis une baisse de 49 % de la demande d’asile.
L’année écoulée nous le prouve, mesdames, messieurs les sénateurs, pour dissuader les flux migratoires irréguliers, l’action déterminée de l’État porte ses fruits.
Il n’en reste pas moins, et je le reconnais volontiers devant vous, que la France reste confrontée à une situation migratoire délicate, qui justifie de poursuivre et d’amplifier notre action et, par conséquent, d’y allouer les moyens nécessaires. Là aussi, je ne prendrai que deux exemples particulièrement illustratifs.
Après l’Albanie, la France est aujourd’hui la destination d’un nombre important et toujours croissant de demandeurs d’asile originaires de Géorgie. Ce pays a obtenu récemment une exemption de visas pour ses ressortissants qui se rendent dans l’Union européenne.
Or, sur les neuf premiers mois de l’année, la demande en provenance de ce pays a enregistré une hausse de 289 %. Notre détermination sera totale pour endiguer ce phénomène, qui relève effectivement d’une migration économique et concerne très largement des personnes qui n’ont pas de besoins de protection au sens du droit. Nous mobiliserons tous les outils bilatéraux, mais aussi européens, pour y parvenir.
Du fait des dysfonctionnements actuels du règlement de Dublin, notre pays est fortement exposé aux flux secondaires internes à l’Union européenne, flux dans lesquels les déboutés du droit d’asile sont, hélas, de plus en plus nombreux, comme M. Bonhomme l’a rappelé. Un tiers des demandes d’asile enregistrées en France provient de personnes ayant déjà enregistré une demande dans un autre pays de l’Union européenne. Ce n’est pas acceptable. Voilà pourquoi Christophe Castaner et moi-même nous sommes fortement engagés dans les négociations européennes, pour réformer enfin le système qui permet ce phénomène.
Même si vous pouvez compter sur mon courage et ma ténacité pour affronter ce qui nous attend samedi prochain, monsieur Karoutchi, et même si je suis devant vous ce soir, j’étais ce matin encore à Bruxelles…
… pour évoquer la question de la réforme et de l’évolution du règlement de Dublin avec mes homologues, en marge du conseil JAI. Dans cette attente, nous continuerons d’utiliser avec détermination les outils à notre disposition, en transférant les personnes concernées vers le pays européen chargé de l’examen de leur demande d’asile.
Comme vous pouvez le constater, en matière migratoire, l’enjeu pour l’année 2019, c’est de poursuivre et d’amplifier nos efforts pour maîtriser l’immigration, garantir le droit d’asile et tirer les conséquences de l’octroi ou du refus du statut de réfugié.
Nous le ferons en conduisant un dialogue ferme avec les pays d’origine des migrants pour qu’ils travaillent à dissuader les départs et qu’ils reprennent leurs ressortissants, en œuvrant à l’échelle européenne pour une réponse coordonnée aux défis migratoires que nous partageons, qu’il s’agisse des arrivées en Méditerranée ou des flux de rebond dans l’Union européenne, et en garantissant la dignité de l’accueil dans notre pays, par la création en 2019, conformément aux engagements du Président de la République à Orléans en juillet 2017, de 3 500 nouvelles places d’hébergement pour les demandeurs d’asile.
Il faudra aussi assumer d’éloigner ceux qui sont déboutés de leur demande d’asile, y compris, je le dis sans détour, en les plaçant en rétention lorsqu’il existe un risque de fuite. Enfin, pour les quelque 30 % de demandeurs qui obtiennent le statut de réfugié, il faudra leur donner réellement les moyens de s’intégrer dans notre pays.
Ces orientations, mesdames, messieurs les sénateurs, sont celles qui guident la construction de notre budget en 2019. J’aborderai maintenant la question des moyens de la politique d’asile.
Tout d’abord, pour faire face à une demande d’asile toujours soutenue, les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration » incluent des moyens supplémentaires pour traiter les demandes d’asile et accueillir les demandeurs dans des conditions dignes. Ce renforcement du dispositif d’accueil et d’hébergement est indispensable : c’est le meilleur moyen de lutter contre les campements.
Aussi, pendant tout le temps du traitement de la demande d’asile, tous les moyens seront déployés pour accueillir dignement les demandeurs d’asile.
Conformément aux engagements déjà pris par le Gouvernement, 1 000 nouvelles places en centres d’accueil de demandeurs d’asile, les CADA, et 2 500 nouvelles places en hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile, les HUDA, seront créées en 2019. S’y ajouteront 2 000 places dans les centres provisoires d’hébergement, les CPH, qui visent à faciliter l’accès au logement des réfugiés les plus vulnérables.
Ce projet de loi de finances met également fin à une anomalie qui voulait que les places d’hébergement pour demandeurs d’asile en Île-de-France, dans les centres d’hébergement d’urgence pour migrants – CHUM –, soient financées sur le programme 177, sous la responsabilité du ministre chargé du logement. Le projet de loi de finances organise donc le transfert de ces 7 800 places de ces centres vers les programmes 104 et 303, pour un montant de 113 millions d’euros.
Pour atteindre, à la fin de 2019, notre objectif d’un délai de traitement de six mois, en moyenne, de la demande d’asile, des renforts seront alloués à l’ensemble des services qui contribuent au traitement de ces demandes.
Tout d’abord, 170 renforts de personnels titulaires ont été alloués aux préfectures. Pour tous les personnels en fonction dans les services chargés des étrangers et de l’asile, un plan d’attractivité sera mis en œuvre, destiné à fidéliser l’expertise de ces agents, mais aussi à reconnaître leur implication et leur engagement dans ces missions parfois difficiles.
De plus, 25 effectifs nouveaux seront dédiés à l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour investir des missions nouvelles, notamment armer les équipes mobiles prévues par la circulaire du 12 novembre 2017, et 10 équivalents temps plein travaillé supplémentaires seront affectés à l’OFPRA, qui aura ainsi vu ses effectifs renforcés de 280 postes depuis 2015.
Enfin, en dehors de cette mission, mais je le mentionne tout de même compte tenu de l’importance de cette juridiction, 122 équivalents temps plein seront créés à la Cour nationale du droit d’asile, chargée de statuer sur les recours contre les refus d’asile décidés par l’OFPRA.
Enfin, toujours s’agissant de l’accueil des demandeurs d’asile, ce projet de loi de finances prévoit la poursuite du rebasage de l’allocation pour demandeur d’asile, l’ADA, qui leur est versée pendant toute la durée de la procédure et dont les crédits sont en hausse de 5, 7 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2018.
Par ailleurs, le PLF pour 2019 traduit l’attachement très fort du Gouvernement à la mise en œuvre d’une politique toujours plus crédible de lutte contre l’immigration irrégulière et d’éloignement.
En la matière, l’entrée en fonction de ce gouvernement a marqué un tournant, avec une reprise des éloignements, qui ont progressé de 14 % en 2017, après des années de fléchissement. Depuis le début de l’année 2018, la tendance se maintient, puisque le nombre de personnes ayant quitté le territoire est à nouveau en hausse de 20 % par rapport à la même période en 2017.
Toutefois, cette tendance à la hausse, pour être amplifiée, appelle des moyens supplémentaires. En particulier, si la dynamique de l’aide au retour volontaire est très positive, celle des éloignements contraints, en hausse de 9 %, est en deçà de la mobilisation, que je sais pourtant très forte, des services de l’État.
Les préfets nous l’indiquent dans leurs rapports : ce qui est en cause, c’est une insuffisance criante de places dans les centres de rétention, pour permettre l’éloignement effectif de ceux qui tentent de se soustraire à l’application du droit.
L’engagement avait été pris, vous vous en souvenez, d’ouvrir 400 places supplémentaires en centres de rétention. Depuis octobre 2017, plus de 200 places ont déjà été ouvertes. Mais, pour poursuivre cette dynamique, il nous faut également investir dans ces équipements, et c’est la raison pour laquelle les crédits qui vous sont proposés prévoient un plan d’investissement en matière de rétention d’un montant de 48 millions d’euros.
Concernant les éloignements, bien évidemment, une politique est menée de manière bilatérale avec chacun des États pour obtenir des laissez-passer. Nous sommes souvent dans une politique de cousu main et, avec le ministre Christophe Castaner, je me mobilise dans les relations que nous entretenons avec les États concernés pour améliorer ces taux de laissez-passer, qui sont un élément important de la politique menée.
S’agissant du budget de l’intégration, vous le savez, mesdames, messieurs les sénateurs, les efforts qui sont accomplis pour éloigner ceux qui n’ont pas vocation à rester durablement sur notre territoire doivent nous permettre d’amplifier, en parallèle, notre engagement pour donner plus de perspectives à ceux qui arrivent légalement en France. Il nous faut combattre leur assignation à des identités, des quartiers, des difficultés que nous ne connaissons que trop bien, et leur donner tous les moyens de contribuer à la dynamique et à la diversité de notre nation.
Toutefois, vous le savez aussi, cela ne se décrète pas : il faut y travailler avec constance et ambition. C’est pourquoi le Gouvernement a décidé un véritable changement d’échelle de nos politiques d’intégration, d’abord par la maîtrise de la langue et la maîtrise des valeurs de la République, avec des cours d’éducation civique passant de douze heures à vingt-quatre heures, puis par une intégration, une insertion plus réussie par le travail.
En matière d’intégration, j’en terminerai par ce point, ce sont 89 millions d’euros de crédits supplémentaires qui seront dédiés à la mise en œuvre des décisions du comité interministériel.
Tels sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les éléments d’information que je tenais à vous donner.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Marc Laménie applaudit également.

Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Immigration, asile et intégration
Immigration et asile
Intégration et accès à la nationalité française

L’amendement n° II-696, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Immigration et asile
Intégration et accès à la nationalité française
TOTAL
SOLDE
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Dans son projet de loi de finances pour 2019, le Gouvernement prévoit une augmentation de 46, 3 % du programme « Intégration et accès à la nationalité française ». Au sein de celui-ci, l’action relative à l’accueil des étrangers primoarrivants est revalorisée de 33, 9 %. C’est heureux, et nous ne pouvons que nous en féliciter.
Grâce à ces nouvelles dotations, l’OFII aura les moyens de mener une politique ambitieuse d’intégration. Est notamment prévu le doublement des cours de français, de la formation civique et d’une prestation d’orientation professionnelle.
Tous ces éléments sont évidemment importants, car la citoyenneté ne s’invente pas ; elle s’acquiert, et ce par la socialisation, par l’emploi et par l’apprentissage de la langue, mais aussi des us et mœurs des pays d’accueil. Mais ces bons sentiments ne doivent pas empêcher une vision plus globale de la prise en charge des exilés.
Pour ces primoarrivants, qui ont fui la guerre et le marasme économique, la priorité doit être, avant toute chose, la sécurité d’un foyer. Nous ne pouvons laisser se développer de nouveaux bidonvilles, comme cela a pu être le cas à Calais.
Voilà quelques semaines, j’ai eu l’occasion de visiter le centre Exelmans dans le XIXe arrondissement de Paris. L’association Aurore, qui en a la charge, réalise un travail formidable pour les migrants, mêlant accueil décent et apprentissage du français. De tels dispositifs devraient se multiplier.
C’est ce que propose, d’ailleurs, le Gouvernement, en incorporant dans ce projet de loi de finances pour 2019 la création de 3 500 places dans les centres d’hébergement d’urgence. Dans un esprit constructif, les auteurs du présent amendement proposent de soutenir et d’amplifier cette disposition, en portant ce chiffre à 5 500 places.
Le droit au logement est un objectif à valeur constitutionnelle. Il doit pouvoir s’appliquer à toute personne résidant sur notre territoire, ne serait-ce que temporairement.

Alors que nos mesures d’éloignement sont déjà les plus faibles qui soient, c’est une mauvaise idée que de baisser encore ces crédits !
L’avis de la commission est donc défavorable.
La France est dotée d’un dispositif spécifique d’hébergement pour l’accueil des réfugiés les plus vulnérables. Tous les réfugiés n’ont pas vocation à être hébergés dans ce cadre. Au contraire, la plus grande partie d’entre eux accède au logement par le biais de dispositifs de droit commun.
J’ai rappelé l’effort de 3 500 places, déployées dans le cadre du projet de loi de finances. Entre le début de l’année 2017 et la fin de l’année 2019, sur trois ans, le parc aura été multiplié par quatre, sa capacité atteignant 8 707 places au plan national. C’est donc un effort très considérable que le Gouvernement a consenti et qu’il maintiendra cette année encore, comme je le rappelais, conformément aux engagements pris.
Compte tenu de cet effort, priver le programme 303, « Immigration et asile », de 20 millions d’euros, alors que ses besoins sont également élevés, n’apparaît pas justifié.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° II-697, présenté par Mmes Benbassa, Apourceau-Poly et Assassi, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile
II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Immigration et asile
Intégration et accès à la nationalité française
Fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile
TOTAL
SOLDE
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Dans un contexte marqué par une demande d’asile soutenue et une immigration en progression, les moyens budgétaires prévus par l’exécutif sont insuffisants.
Partant de prévisions erronées des demandes de l’OFPRA, l’exécutif a déterminé le montant des crédits en retenant l’hypothèse d’une stabilisation de la demande d’asile en 2019. Ce calcul, quelque peu erroné, entraîne un risque de sous-budgétisation de la mission et, oserai-je dire, une forme d’insincérité budgétaire. Cette hypothèse est effectivement jugée irréaliste par l’ensemble des associations et organismes compétents, lesquels estiment que l’OFPRA risque l’engorgement du fait d’un nombre croissant de requérants dans les années à venir.
Le présent amendement vise à créer un fonds de soutien à la garantie de l’exercice du droit d’asile, afin de renforcer le financement de l’action n° 02 du programme 303, « Immigration et asile ». Nous espérons ainsi réunir les conditions d’un fonctionnement plus efficient de l’OFPRA, par davantage d’emplois de personnels qualifiés.
Alors que l’action relative à la lutte contre l’immigration irrégulière a augmenté drastiquement de 86 % entre 2018 et 2019, nous jugeons qu’un transfert de 20 millions d’euros vers un soutien à l’exercice effectif du droit d’asile est nécessaire, afin d’offrir aux primoarrivants des conditions d’accueil dignes.

La commission partage votre avis sur l’insincérité du budget, madame la sénatrice, malgré les efforts et les augmentations budgétaires. En revanche, comme pour le premier amendement, il me semble que diminuer le budget finançant les mesures d’éloignement au profit d’une autre action n’est pas une bonne idée.
La commission émet donc un avis défavorable.
Le fonds, dont la création est envisagée par prélèvement des moyens du programme 303, aurait exactement le même objet que certaines des actions financées par ce même programme 303… Dès lors, cette création ne nous paraît pas utile.
Nous considérons que l’effort fourni est tout de même significatif. Je ne donnerai qu’un seul exemple, celui de l’OFPRA, dont, madame la sénatrice, vous jugez les moyens insuffisants. Depuis 2015, les crédits alloués à l’OFPRA ont augmenté de 65 %, pour atteindre 70 millions d’euros dans ce projet de loi de finances, et, dans le même temps, quelque 280 emplois ont été créés dans cet établissement public.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° II-698, présenté par Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Créer le programme :
Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques
II. – En conséquence, modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Immigration et asile
Intégration et accès à la nationalité française
Fonds de soutien à l’accompagnement des troubles psychotraumatiques
TOTAL
SOLDE
La parole est à Mme Esther Benbassa.

Le 23 novembre dernier, au tribunal de grande instance de Paris, un jeune Burkinabé de quinze ans s’est défenestré après avoir été entendu par le juge. Ce fait n’est, hélas, pas un cas isolé et nous a été signalé par plusieurs associations.
La cécité du Gouvernement sur ce grave enjeu de santé publique nous interroge. La souffrance psychique des migrants est directement provoquée par les violences que subissent ces personnes, tant dans leur pays d’origine que lors de leur traversée.
Ces multiples troubles, parmi lesquels figure le syndrome de stress post-traumatique, compliquent également le travail des agents de l’OFPRA, censés examiner la véracité des récits et témoignages. Les demandeurs d’asile qui en sont atteints souffrent d’amnésies traumatiques et ne peuvent relater aisément et avec précision les persécutions subies.
Ces pathologies mentales peuvent être plus graves encore. Sans suivi médical, les individus peuvent pâtir à long terme de maladies psychiatriques de plus grande ampleur, telle la schizophrénie.
Parce que le suivi psychotraumatique est inexistant et occulté par les politiques publiques, nous proposons la création d’un fonds nécessaire à la prise en charge des pathologies dont souffrent ces personnes brisées par l’exil.
Mes chers collègues, il est de notre devoir de mettre en place, au sein de notre politique d’accueil et d’intégration, une offre de soins en santé mentale, afin de redonner confiance et dignité à ceux qui sont atteints de syndromes psychotraumatiques.

M. Sébastien Meurant, rapporteur spécial. Nous accueillons mal, parce que nous accueillons trop !
Mme Esther Benbassa s ’ exclame.
Les éventuels troubles psychotraumatiques dont peuvent souffrir les primoarrivants font l’objet d’une prise en charge, à la fois au titre de l’intégration et en tant qu’impératif de santé publique.
Depuis plusieurs années, les crédits de l’action n° 02 « Garantie de l’exercice du droit d’asile » du programme 303 sont mobilisés au bénéfice d’associations qui interviennent spécifiquement dans le champ de la prise en charge de ce type de syndromes pour les demandeurs d’asile. En 2018, plus de 500 000 euros ont été versés à des acteurs associatifs spécialisés dans la prise en charge médico-psychologique de demandeurs d’asile. Il s’agit bien de crédits spécifiques, mobilisés à cette seule fin.
Cette politique a été confirmée dans le cadre du comité interministériel à l’intégration de juin 2018. Dès lors, la création d’un fonds national n’apparaît pas opportune, d’autant plus que les modalités de prise en charge de ces traumatismes ont été mieux définies au plan local et que les préfets bénéficient de moyens supplémentaires qui, de surcroît, sont déconcentrés sur les territoires, pour mieux prendre en compte ce type de traumatismes.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

Je voudrais brièvement indiquer, notamment à l’attention de Mme Benbassa, que l’OFII a massivement créé, depuis deux ans, des postes de médecins, et qu’il a développé l’ensemble des programmes d’accueil et de contrôle médical, ne serait-ce que pour éviter que l’on retrouve, dans les rues de nos villes, des gens ayant des problèmes de santé.
Le contrôle médical est donc beaucoup plus performant aujourd’hui qu’il y a quelques années. Je ne dis pas que tout est merveilleux ou magnifique, mais des efforts importants ont été réalisés par les pouvoirs publics au cours des trois dernières années.
Dans ces conditions, il me semble nécessaire de laisser l’OFII poursuivre son travail, plutôt que de créer un fonds nouveau.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L’amendement n° II-574 rectifié bis, présenté par Mme Taillé-Polian, M. Durain et Mmes G. Jourda et de la Gontrie, n’est pas soutenu.
Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Immigration, asile et intégration », figurant à l’état B.
Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits.
Les crédits ne sont pas adoptés.

J’appelle en discussion l’article 77 quater, qui est rattaché pour son examen aux crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».
Immigration, asile et intégration
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de fixer le montant de cette contribution. À cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« L’État est ordonnateur de la contribution forfaitaire. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception. »
II. – L’article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « de liquider cette contribution » sont remplacés par les mots : « fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’État selon des modalités définies par convention » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’État est ordonnateur de la contribution spéciale. À ce titre, il liquide et émet le titre de perception.
« Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2018.
L ’ article 77 quater n ’ est pas adopté.

Le Sénat va examiner les crédits de la mission « Sécurités » et du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, les récents événements, marqués par d’importants dérapages en matière de maintien de l’ordre, démontrent encore une fois l’importance de la mission « Sécurités ».
Malgré tout, cette année encore, le budget n’est pas à la hauteur des enjeux. Le projet de loi de finances prévoit une augmentation des crédits de cette mission de 1, 62 %. La principale caractéristique de ce budget est la création de 2 378 ETP, qui devrait constituer la plus forte hausse sur une annuité de toutes celles qui sont prévues sur l’ensemble du quinquennat.
Cette augmentation des effectifs n’est malheureusement pas suivie d’une augmentation équivalente des dépenses de fonctionnement et d’investissement, ce qui entraîne, une fois de plus, une dégradation préoccupante du ratio des dépenses de personnel sur l’ensemble des crédits.
Ce ratio sera de 89, 39 % pour la police nationale et de 84, 39 % pour la gendarmerie nationale, soit une moyenne de 87, 36 % pour les deux forces. Voilà une dizaine d’années, les dépenses de personnel représentaient 80 % des crédits, pour 20 % de crédits de fonctionnement et d’investissement. Depuis, les sommes affectées aux dépenses de personnel ont crû de 34, 53 %, tandis que les autres ont diminué de 6, 53 %.
Les revalorisations générales, notamment l’application des protocoles d’accord signés en mai 2016, ont entraîné 200 millions d’euros de dépenses supplémentaires en 2018 et la hausse devrait être de 92 millions d’euros en 2019, selon l’estimation de la Cour des comptes.
Les comparaisons internationales démontrent qu’avec un gendarme ou un policier pour 280 habitants, notre pays n’est pas en situation de sous-effectif. Nos forces de l’ordre disposent de 151 000 policiers et de 96 000 gendarmes, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il y a un policier ou gendarme pour 273 habitants en Allemagne, un pour 427 en Angleterre, un pour 220 en Italie et un pour 292 en Espagne. Parmi nos voisins, seule l’Italie possède plus de policiers et de gendarmes par million d’habitants que nous. Encore ce chiffre ne tient-il pas compte des polices municipales, ni des 7 000 militaires déployés dans le cadre de l’opération « Sentinelle ».
Avec des dépenses de personnel qui représentent plus de 87 % des crédits de la mission, les crédits de fonctionnement sont donc insuffisants et n’augmentent que de 0, 88 %. Les crédits d’investissement, quant à eux, baissent de 13, 37 % !
Comme l’a montré l’enquête de la Cour des comptes sur l’équipement des forces de l’ordre, réalisée à la demande de la commission des finances du Sénat, des efforts ont pourtant été réalisés pour faire face au terrorisme et à la crise migratoire. Ainsi, dans des délais relativement courts, votre rapporteur a pu constater que pour les primo-intervenants sur une scène d’attentat, chaque brigade anticriminalité dispose désormais d’une arme lourde et d’une protection assortie.
Toutefois, toujours selon ce rapport, de nombreux points noirs demeurent. La Cour des comptes dénonce ainsi le manque de formation : en 2017, seuls 51 % des policiers et gendarmes ont effectué leurs trois séances de tir par an.
Par ailleurs, la Cour a mis fin à une polémique entre le Sénat et le Gouvernement sur l’état du parc automobile. Il est regrettable que la multiplication des plans n’ait pas enrayé le vieillissement de ce parc. Sur ce point, le contraste entre les chiffres avancés et la réalité est flagrant : en 2017, sur 3 000 véhicules annoncés, seuls 1 500 sont arrivés sur le terrain. Depuis 2010, le nombre de véhicules achetés ne permet pas de garantir le maintien à niveau de la flotte.
Dans la police nationale, un véhicule doit être remplacé après 170 000 kilomètres ou huit ans. En 2019, 14 000 véhicules sur 30 000 auront bientôt atteint ce seuil. Dans la gendarmerie, où le critère de réforme se situe actuellement à 7, 4 années, tout le monde ne peut qu’être inquiet, car cet outil de travail est essentiel pour la couverture d’immenses zones géographiques.
L’état du parc immobilier est aussi très préoccupant. Dans la gendarmerie, l’état des logements influe sur le moral. La commission d’enquête dont mon collègue François Grosdidier était le rapporteur a évalué l’effort d’investissement nécessaire à un niveau de 300 à 400 millions d’euros. Dans la police, où 536 bâtiments nécessitent une réhabilitation lourde, le délabrement est tel qu’il faudrait des crédits d’investissement à hauteur de 650 millions d’euros. Or, le niveau de ces crédits est respectivement de 100 millions d’euros et de 165 millions d’euros.
Certaines réorganisations ont mis à mal les dispositifs opérationnels. En particulier, la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, applicable à la gendarmerie nationale depuis le 1er septembre 2016, implique la création de 4 000 ETP. Or il n’est prévu de créer que 2 500 ETP sur le quinquennat.
Pour la police nationale, les protocoles de mai 2016, jugés sévèrement par la Cour des comptes, conduisent à l’application aux forces opérationnelles de la vacation forte. Cette disposition améliore le moral des agents, qui peuvent disposer d’un week-end sur deux, au lieu d’un sur six. Mais son application sur 11 % des effectifs, malgré l’injection de 433 ETP supplémentaires dans les services concernés, a été difficile.
Le directeur général de la Police nationale a dû décréter un moratoire, dans l’attente d’un rapport de l’Inspection générale de l’administration et de l’Inspection générale des finances qui est prévu pour mars 2019. La généralisation progressive semble remise en cause dans ce cadre budgétaire. Il faudrait, à terme, envisager 4 160 ETP de plus pour un coût financier d’environ 205 millions d’euros annuels.
Je comprends, monsieur le secrétaire d’État, vos préoccupations financières pour tenir ces engagements et j’espère que vous apporterez prochainement au Sénat des réponses à ces interrogations.
Le fait que la préfecture de police de Paris ne puisse pas appliquer la vacation forte constitue un paradoxe révélateur des difficultés induites par ce régime. Il est effectivement surprenant que, dans la région capitale, où les conditions de travail sont particulièrement difficiles, ce régime ne puisse pas être mis en œuvre. Sur le territoire de la préfecture de police, une expérimentation a été menée à Boissy-Saint-Léger et a conduit à son abandon.
Monsieur le secrétaire d’État, les sénateurs sont préoccupés par le stock d’heures supplémentaires, qui a crû de 18 % en trois ans pour atteindre 21, 7 millions d’heures. Ce problème ne concerne pas les gendarmes, qui sont sous statut militaire et disposent d’un logement de fonction. C’est, en revanche, une véritable épée de Damoclès sur la capacité opérationnelle de la police nationale, car ces congés sont pris avant le départ à la retraite, ce qui peut priver le service d’un fonctionnaire pendant une année entière, sans que celui-ci soit remplacé.

Les tâches indues demeurent constantes. Il en va, ainsi, de la garde de vingt-quatre préfectures ou de celle du palais de Justice de Paris qui exige 450 postes. Ces tâches mobilisent 5 % des effectifs.
Au vu de ces éléments, la commission des finances propose, contrairement à d’autres missions régaliennes de l’État, un rejet des crédits de la mission « Sécurités ».

Mes chers collègues, j’invite chacun d’entre vous à respecter son temps de parole. Ainsi parviendrons-nous peut-être à achever l’examen des crédits de cette mission avant minuit et demi.
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, l’objectif fixé pour la politique de sécurité routière est clair : réduire au maximum le nombre de morts et de blessés, donc d’accidents sur les routes françaises.
Ce faisant, cette politique diminue le coût de l’insécurité routière. Si la valeur d’une vie brisée est inestimable, le coût matériel des accidents de la route – évalué par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l’ONISR, à 39, 7 milliards d’euros – est très élevé. Comment évaluer la politique de sécurité routière à l’aune de ses résultats ?
Si l’on est loin de l’objectif, fixé par l’Union européenne, de passer sous la barre des 2 000 morts en 2020, les années 2017 et 2018 laissent enfin entrevoir une éclaircie.
En 2017, après trois années consécutives de hausse - une première depuis quarante-cinq ans –, le nombre de tués sur les routes repart enfin à la baisse. Ce sont 3 600 tués qui ont été dénombrés sur les routes de France métropolitaine et des départements d’outre-mer, soit 55 décès de moins par rapport à 2016.
Toutefois cette embellie demeure fragile et doit être relativisée. En effet, le nombre d’accidents et de blessés hospitalisés continue d’augmenter. En outre, la France se trouve toujours en quatorzième position, c’est-à-dire dans le « ventre mou » du classement des pays de l’Union européenne.
Quand on considère la distance parcourue sur les réseaux routiers, plusieurs de nos voisins – l’Allemagne, le Royaume-Uni ou la Suisse – affichent de meilleurs résultats. La France peut donc mieux faire.
Les crédits du programme 207, « Sécurité et éducation routières » de la mission « Sécurités », qui ne représentent que 0, 2 % du montant de la mission, augmentent de nouveau légèrement – de 3, 9 % par rapport à 2018 –, pour s’établir à 41, 4 millions d’euros.
Le point saillant de ce programme est le permis de conduire, dont les coûts d’organisation représentent plus de la moitié des crédits. La réforme de cet examen, engagée en 2014, s’essouffle : les indicateurs de performance stagnent, tandis que l’opération « permis à un euro par jour », qui m’apparaît, comme l’an dernier, trop budgétée, connaît un succès très relatif.
Cet été, le Gouvernement a confié une mission à deux de nos collègues députés, visant à relancer la réforme du permis de conduire, tandis que l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, dit « LOM », qui vient d’être déposé au Sénat, doit aussi permettre de lui donner un nouvel élan.
Monsieur le secrétaire d’État, quelles pistes envisagez-vous pour aider les jeunes à obtenir leur permis, souvent indispensable pour « décrocher » un premier emploi ?
S’agissant du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », le « CAS Radars », l’estimation, en projet de loi de finances, du produit total des amendes de la police de la circulation et du stationnement n’a jamais été aussi élevée : elle atteint 1 867 millions d’euros.
J’avoue que cette estimation, il y a encore quelques semaines, me semblait quelque peu frileuse. Le montant du produit réalisé, l’an dernier, c’est-à-dire en 2017, s’est révélé en effet nettement supérieur aux prévisions de la loi de finances initiale de 2017.
Cependant, au cours de ces trois dernières semaines de mobilisation des « gilets jaunes », de nombreux radars ont été vandalisés et sont désormais hors service – selon les éléments qui nous ont été donnés, plus de 800 radars automatiques, soit 20 % du parc. L’impact sur les recettes de l’État pourrait être important.
S’agissant des dépenses, j’observe que les décisions prises à l’issue du comité interministériel réuni le 9 janvier 2018 s’inscrivent dans la droite ligne de la politique des deux précédents gouvernements.
Si je reste très mesuré – c’est un euphémisme – quant aux effets de l’abaissement de la vitesse autorisée à 80 kilomètres par heure, j’aurais préféré, comme beaucoup de mes collègues, notamment ceux du groupe de travail sur la sécurité routière, que ces décisions soient prises en concertation avec les collectivités et les élus locaux et davantage ciblées sur les routes les plus accidentogènes. Je salue cependant certaines des mesures du comité interministériel, qui rejoignent les recommandations émises par notre collègue Vincent Delahaye dans son rapport de contrôle budgétaire de 2017.
Par ailleurs, je constate que le plan de déploiement de ces nouveaux équipements prend un sérieux retard. L’objectif des 4 700 radars et des 200 itinéraires sécurisés, qui devait être atteint au 31 décembre 2018, est pratiquement reporté d’une année.
Ce décalage, qui serait en partie lié à une phase d’homologation des nouveaux dispositifs plus longue que prévu, notamment ce que l’on appelle les radars tourelles, me fait m’interroger sur la nécessité d’augmenter encore les crédits du programme 751, même si, à ce jour, je comprends bien que cette augmentation puisse être justifiée par une évolution de la composition du parc privilégiant des radars plus intelligents, donc plus onéreux.
En outre, cette hausse de crédits pourrait d’ailleurs être absorbée par les frais de remise en état des radars détériorés. Monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous nous dire à combien pourraient s’élever les frais de remise en état de ces appareils, compte tenu du bilan connu à ce jour et que je viens de citer ?
S’agissant des collectivités locales, je note que les crédits du programme 754 diminuent de nouveau d’environ 7 % en 2019. Cette baisse est certes justifiée par l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant. En effet, depuis le 1er janvier, les communes et les intercommunalités ont la faculté de fixer le montant du forfait post-stationnement et à en recueillir le produit. Ce n’est, en revanche, pas le cas des départements, auxquels incombe l’entretien de quelque 370 000 kilomètres de voirie.
Au cours de l’examen de la première partie, le Sénat a adopté un amendement, présenté par le rapporteur général, visant à créer un prélèvement sur le produit des amendes forfaitaires hors radars et amendes forfaitaires majorées au bénéfice des départements. Je présenterai donc un amendement de crédits pour permettre de financer ce prélèvement, au détriment du programme 755 « Désendettement de l’État ».
Je suis en effet convaincu que la politique de sécurité routière, pour être efficace, doit être comprise par nos concitoyens. Même si la part des recettes issues du contrôle automatisé et fléchées vers le désendettement de l’État est inférieur à 9 %, le manque de lisibilité du compte d’affectation spéciale et son architecture tarabiscotée, enchevêtrant les flux des différentes catégories d’amendes, ne contribuent pas à rendre la politique de sécurité routière plus transparente et plus acceptable dans la répartition des produits collectés.
Je préconise donc, monsieur le secrétaire d’État, d’étudier une refonte complète de l’architecture de ce compte d’affectation spéciale, avec un souci de simplification.
En conclusion, la commission des finances propose donc d’adopter les crédits de la mission dans sa partie « Sécurité et éducation routières » – 0, 2 % du total –, sans modification, ainsi que ceux du compte d’affectation spéciale, ainsi modifiés.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en 2019, les crédits du programme « Sécurité civile » connaissent une baisse de 393, 97 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 6, 86 millions d’euros en crédits de paiement par rapport à la loi de finances initiale pour 2018, soit une hausse de 1, 29 % en crédits de paiement et une baisse de 46, 15 % en autorisations d’engagement.
Cette baisse de crédits s’explique par la passation, en 2018, d’un marché de remplacement de la flotte de Tracker par des avions-multirôles. Si l’on neutralise l’impact de l’acquisition des avions dans le projet de loi de finances pour 2018, le budget du programme « Sécurité civile » est stable en autorisations d’engagement – une hausse de 1, 64 % – et baisse de 4, 51 % en crédits de paiement.
Les crédits du programme « Sécurité civile » pour 2019 sont inférieurs à la programmation triennale de près de 10 millions d’euros en crédits de paiement. Cette différence s’explique principalement par des économies réalisées à l’occasion de la passation du marché de renouvellement des Tracker.
Je tiens à évoquer la situation des services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, qui me semble préoccupante. Leur importance et pourtant capital : ils ont réalisé en 2017 près de 4, 65 millions d’interventions, soit une croissance de 2 % par rapport à l’année précédente.
Leurs budgets sont en légère hausse – de 2, 4 % en valeur brute. Toutefois, leurs dépenses d’investissement ont connu une diminution importante de près de 20 % entre 2008 et 2017. Cette baisse apparaît d’autant plus préoccupante que le soutien de l’État aux investissements structurants des SDIS s’est récemment affaibli.
Cette dotation de soutien aux SDIS, dont le financement s’élevait à 25 millions d’euros en 2017, n’est que de 10 millions d’euros en 2019, comme ce fut le cas d’ailleurs en 2018.

Cette faible dotation est d’autant plus incompréhensible que les crédits prévus par le projet de loi de finances sont inférieurs à la programmation pluriannuelle.
Cette dotation sera très majoritairement consacrée au financement du projet de système d’information unifié des SDIS et de la sécurité civile, le SGA-SGO, projet considéré comme stratégique par le ministère de l’intérieur. De l’avis général, son montant est toutefois très insuffisant. Il me paraît indispensable que cette dotation soit réévaluée dans les années à venir.
Outre un problème de financement, les SDIS risquent de devoir faire face à une transformation récente du droit européen de nature à remettre en cause le modèle français de secours. En effet, à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 21 février 2018 sur un contentieux opposant un sapeur-pompier volontaire belge à la commune de Nivelles à propos de la rémunération de son service de garde, la directive européenne de 2003 relative au temps de travail pourrait s’appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires français.
Cette directive contient notamment deux dispositions contraignantes : la durée maximale de travail hebdomadaire de 48 heures ; le repos journalier de 11 heures consécutives.
La Cour de justice de l’Union européenne a ainsi considéré que les sapeurs-pompiers volontaires doivent être considérés comme « travailleurs » au sens de la directive ; que les périodes de garde sont toujours considérées comme du temps de travail ; que les périodes d’astreinte ne peuvent être exclues du temps de travail que dès lors que les contraintes ne sont pas excessives et ne peuvent être assimilées à celles qui découlent d’un travail.
En tout état de cause, le développement et la pérennité du modèle français de distribution des secours, qui reposent de façon significative sur les sapeurs-pompiers volontaires, constituent un enjeu majeur pour la sécurité civile. De fait, quelque 79 % des sapeurs-pompiers français sont des volontaires, et leur proportion peut aller jusqu’à 90 % dans les départements les moins peuplés.
L’application de la directive aux sapeurs-pompiers volontaires français entraînerait un accroissement de moitié du coût des services d’incendie et de secours, soit 2, 5 milliards d’euros, ce qui serait de nature à remettre en cause le modèle français de secours.
La préservation du statut de sapeur-pompier volontaire appelle une initiative forte de la part du Gouvernement français vis-à-vis de la Commission européenne. C’est là l’un des principaux points d’interrogation, monsieur le secrétaire d’État, sur lequel nous souhaiterions vous entendre.

Le budget 2018 est marqué par la poursuite du déploiement du système d’alerte et d’information des populations, dont les choix stratégiques, fortement contestables, ne sont toujours pas remis en cause.
Je vous avais alerté, par le biais de mon rapport d’information, sur le fait que ce projet concentrait près de 80 % des crédits prévus au volet « sirènes », alors même que son impact apparaît bien plus faible que celui de la téléphonie mobile, qui ne bénéficiait pourtant que de 3 % des crédits consommés ou prévus pour ce projet.
Après un an de fonctionnement, et à la suite des recommandations formulées dans mon rapport, l’application smartphone, dont j’avais relevé les insuffisances, a fait l’objet d’une évaluation par l’Inspection générale de l’administration et a finalement été abandonnée le 29 mai 2018, sans qu’aucun projet de remplacement soit prévu. Le volet « téléphonie mobile » aura ainsi coûté 1, 6 million d’euros sans faire preuve de la moindre utilité.
Il me semble nécessaire de procéder à une réorientation stratégique plus large de ce projet avant que l’affectation des crédits de la phase 2, qui commence en 2020, ne soit effectuée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en ouverture de mon propos, je souhaite en tout premier lieu rendre hommage à l’action des gendarmes, qui, dans un contexte souvent difficile, ont accompli en 2018 leurs missions avec une grande conscience professionnelle.
En attestent les succès obtenus dans la lutte contre la délinquance du quotidien, avec la baisse des cambriolages, mais aussi dans la prévention du terrorisme, avec une montée en puissance du renseignement opérationnel, désormais étroitement associé au renseignement territorial.
La gendarmerie a également su affronter des crises de grande ampleur, montrant qu’elle était en mesure de fournir au ministère de l’intérieur, en étroite coordination avec les autres forces de sécurité, mais aussi avec les élus locaux, une réponse adéquate aux défis, souvent difficiles, auxquels elle est confrontée.
L’évacuation maîtrisée de Notre-Dame-des-Landes au mois d’avril dernier témoigne de sa compétence et de sa capacité d’adaptation, tout comme son intervention aux Antilles après le passage de l’ouragan Irma à l’automne 2017.
Je souhaite aussi mettre en évidence le rôle important des membres de la réserve opérationnelle, en particulier lorsqu’ils apportent une aide précieuse aux collectivités locales pour le bon déroulement de certains événements. C’est pourquoi le fait que la régulation budgétaire de 2018 ait conduit à une réduction de 900 emplois de réservistes jusqu’en septembre dernier a constitué un handicap très sérieux pour le bon accomplissement des missions de la gendarmerie.
Il est d’autant plus nécessaire de souligner le travail accompli que, comme l’ont montré les travaux de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, les conditions d’exercice du métier sont difficiles, du fait de relations souvent tendues avec certains publics, de tâches administratives de plus en plus lourdes et d’une procédure judiciaire devenue trop complexe.
Il serait imprudent de croire que la gendarmerie est protégée contre les crises par son statut militaire. Il était donc important et nécessaire que le budget pour 2019 soit à la hauteur.
À nos yeux, ce n’est malheureusement pas le cas. En effet, nous ne relevons pas d’amélioration réelle des moyens de fonctionnement : seulement 2 800 véhicules légers à acquérir – si, toutefois, les crédits ne sont pas gelés –, alors que les besoins sont criants dans les brigades. Nous ne constatons pas non plus de nouvel investissement dans les véhicules lourds et aériens.
Enfin, le plan de rénovation de l’immobilier présenté est très insuffisant par rapport aux besoins réels : ce n’est pas assez pour éloigner le risque d’une crise de grande ampleur au sein de l’institution.
Aussi, en cohérence avec l’ensemble de ces observations, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a émis un avis défavorable sur les crédits du programme 152 pour 2019.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je veux tout d’abord constater que nos forces de sécurité sont une fois de plus soumises à rude épreuve depuis quelques semaines. Elles doivent quotidiennement affronter des agressions de la part de personnes ou de groupes extrémistes organisés.
Les travaux de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure l’ont démontré : la situation est grave, et il est indispensable que la Nation consente un effort important pour éviter une crise profonde, aussi bien au sein de la police nationale qu’au sein de notre gendarmerie. Dans ce contexte, je réaffirme mon soutien et ma reconnaissance aux services que nos gendarmes rendent chaque jour à la Nation, avec courage, sang-froid et abnégation.
Or, à l’issue de l’analyse des crédits de la gendarmerie pour 2019, il me faut malheureusement constater que « le compte n’y est pas ».
S’agissant des moyens de fonctionnement courant et des véhicules, les crédits prévus stagnent et ne sont pas à la hauteur des enjeux.
S’agissant de l’immobilier, c’est un plan non pas de 100 millions d’euros, mais de 300 millions d’euros par an qui serait nécessaire pour rattraper le retard accumulé et permettre aux gendarmes et à leurs familles de retrouver des conditions de vie décentes.
En outre, la stratégie d’ensemble fait défaut. Si l’on souhaite préserver les capacités opérationnelles de la gendarmerie, il faut aujourd’hui élaborer un plan global de remise à niveau en mettant clairement en regard les missions et les moyens correspondants, sur une base pluriannuelle.
Dès lors, monsieur le secrétaire d’État, n’est-il pas temps d’envisager une nouvelle loi de programmation pluriannuelle des forces de sécurité, en parallèle en quelque sorte à la loi de programmation militaire ?
Au-delà des crédits, il faut aussi retrouver le sens de la mission, qui consiste avant tout pour les gendarmes en une présence sur le terrain auprès de nos concitoyens, conformément d’ailleurs à l’ambition de la police de sécurité du quotidien.
Alors que la directive européenne sur le temps de travail a fait perdre l’équivalent de 4 000 emplois à la gendarmerie, il est impératif de mettre réellement fin aux tâches indues pour redonner des marges de manœuvre et atteindre cet objectif de retour de proximité.
Enfin, nous avons noté que le ministère de l’intérieur s’est engagé dans la création de directions générales des achats et du numérique. Celles-ci absorberont certains services préexistants de la police et de la gendarmerie. Il est important d’opérer des mutualisations. Faisons cependant attention à préserver ce qui fonctionne bien : je pense notamment aux innovations remarquables accomplies au sein de la gendarmerie nationale dans le domaine du numérique.
Globalement, les crédits proposés ne sont pas à la hauteur des exigences désormais imposées aux forces de sécurité et ils ne sont pas à la hauteur nécessaire pour répondre aux malaises constatés. C’est pourquoi nous voterons contre les crédits du programme « Gendarmerie nationale ».
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la commission des lois partage le constat dressé par notre collègue rapporteur spécial de la commission des finances : en dépit d’une augmentation des crédits alloués à la sécurité, la trajectoire financière du projet de loi de finances pour 2019 demeure déséquilibrée et insuffisante au regard de la situation particulièrement dégradée des forces de sécurité.
Cette année encore, le Gouvernement a fait le choix de mettre l’accent sur le renforcement des effectifs. En 2019, ce seront 1 735 emplois qui seront créés dans la police et 643 dans la gendarmerie.
Ces créations suffiront-elles à améliorer la présence des forces sur le terrain, à permettre le déploiement de la police de sécurité du quotidien, et, plus largement, à faire face aux défis sécuritaires auxquels la France est confrontée ? Je ne le crois pas ! Je suis même persuadé du contraire. L’augmentation des effectifs que vous envisagez de 10 000 policiers et gendarmes en cinq ans est à la fois optique et inefficiente.
Optique, car elle parviendra à peine à compenser la baisse de capacité opérationnelle suscitée par l’application de la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, qui nécessite de mobiliser, selon les informations qui m’ont été communiquées, plus de 8 000 équivalents temps plein dans les deux forces.
Inefficiente, car il est probable que cette hausse des effectifs n’exercera aucun effet de levier si elle n’est pas accompagnée de réformes structurelles d’ampleur. Comment, en effet, espérer améliorer la lutte contre la délinquance dans les territoires les plus difficiles alors même que la police peine à y maintenir ses agents les plus expérimentés ?
Comment renforcer la présence de nos forces de l’ordre sur le terrain alors qu’elles sont absorbées par des tâches administratives et procédurales nombreuses, complexes et fastidieuses ?
Aucune augmentation d’effectifs ne portera ses fruits si elle n’est accompagnée d’une amélioration des conditions de travail des policiers et des gendarmes, qui se sont profondément dégradées au cours des dernières années et qui pèsent sur leur efficacité comme sur leur moral.
Or, à cet égard, le budget présenté par le Gouvernement n’est à la hauteur ni des annonces ni des besoins. En effet, la forte augmentation des dépenses de personnel se fait, cette année encore, au détriment des crédits de fonctionnement et d’investissement, dont la part ne cesse de se réduire dans le budget global.
Je déplore tout particulièrement la baisse des crédits d’investissement, qui constituent, ne nous en cachons pas, la variable d’ajustement de ce budget. Les efforts que vous annoncez, monsieur le secrétaire d’État, ne se traduisent pas dans les chiffres.
Vous réduisez les dépenses de formation, alors même que le nombre de recrues n’a jamais été aussi important.
Vous prévoyez l’acquisition de 3 000 véhicules pour la police, mais 8 000 sont maintenus en service, alors qu’ils remplissent les critères de réforme.
Vous programmez 105 millions d’euros pour la remise à niveau des casernes de gendarmerie, alors même que sa direction évalue ses besoins à 300 millions d’euros par an.
Ce que revendiquent à l’unanimité les forces de sécurité, ce n’est pas le renforcement des effectifs, mais plutôt l’amélioration de leurs conditions matérielles de travail. À quoi bon, en effet, augmenter les effectifs si nos policiers et nos gendarmes manquent de moyens, d’équipements et de munitions ? Force est de constater que vous avez choisi la stratégie inverse.
Aussi la commission des lois a-t-elle émis un avis défavorable à l’adoption des crédits de la mission « Sécurités » prévus par le projet de loi de finances pour 2019.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je m’associe en tout point au constat et aux questionnements de notre excellent collègue Jean Pierre Vogel.
Le budget de la sécurité civile pour 2019 ouvre dangereusement la voie à une sécurité civile à deux vitesses avec, d’un côté, des crédits importants alloués, à juste titre, aux moyens de la sécurité civile d’État, et, de l’autre, une sécurité civile territoriale laissée en marge.
S’agissant de la sécurité civile d’État, les crédits sont mis au service de priorités identifiées les années précédentes et que nous partageons : le renouvellement, la rénovation et le maintien en condition opérationnelle de la flotte aérienne ; le renforcement des capacités de déminage ; le développement de différents systèmes de communication.
S’agissant de la sécurité civile territoriale, il est vrai que les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, sont principalement financés par les collectivités territoriales, départements en tête. Pour autant, la loi de finances devrait prévoir les adaptations fiscales et les concours ciblés nécessaires à leurs investissements, qui sont en baisse depuis plusieurs années.
L’explication de cette baisse est simple, et nous la connaissons tous : la contraction des moyens budgétaires des départements se conjugue à une augmentation des dépenses de fonctionnement des SDIS, en lien direct avec l’augmentation de leur activité, notamment en matière de secours à personne.
Sur le plan budgétaire, il est inadmissible que les économies réalisées par l’État avec la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance versée aux sapeurs-pompiers volontaires soient détournées cette année encore, alors qu’il avait été décidé de les sanctuariser pour financer des investissements des SDIS.
Fixé à 25 millions d’euros dans la loi de finances pour 2017, le montant de la dotation de soutien aux investissements structurants des SDIS a été réduit à 10 millions d’euros dans la loi de finances pour 2018. Il en sera malheureusement de même en 2019. Mes chers collègues, il s’agit d’une véritable perte sèche pour la sécurité civile des territoires.
Sur le plan fiscal, je souhaite vivement que l’Assemblée nationale conserve la mesure prévoyant le remboursement aux SDIS d’une partie de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE, versée sur le gazole, que le Sénat a adoptée à l’unanimité sur ma proposition.
Enfin, il importe que le Gouvernement publie rapidement le décret nécessaire à la mise en œuvre effective de la gratuité des péages autoroutiers pour les véhicules de secours en intervention, prévue il y a bientôt un an par la loi de finances pour 2018.

Pour ces raisons, la commission des lois a été conduite à donner un avis défavorable à l’adoption des crédits du programme.
Elles me conduisent aussi à vous poser une question, monsieur le secrétaire d’État : quelles mesures allez-vous enfin mettre en œuvre pour soutenir nos services départementaux d’incendie et de secours ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste.

Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d’intervention générale et celui de l’explication de vote.
Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.
Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Loïc Hervé.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, l’examen de la mission « Sécurités » intervient cette année dans le cadre d’une actualité brûlante.
Une fois encore, nos forces de sécurité intérieure, en particulier CRS et gendarmes mobiles, sont en première ligne pour protéger nos concitoyens. En première ligne aussi pour protéger nos institutions – le Premier ministre l’a dit tout à l’heure dans cet hémicycle –, notamment contre des individus qui ont fait preuve d’une violence inouïe lors des dernières semaines.
Notre groupe rend hommage à leur sang-froid, à leur courage et à leur engagement. Nous adressons aussi nos vœux de prompt rétablissement aux fonctionnaires de police et aux militaires de la gendarmerie qui ont été blessés, parfois gravement, lors des dernières manifestations.
L’examen des crédits de la mission « Sécurités » est l’occasion d’évoquer la situation dramatique dans laquelle nos forces doivent maintenir l’ordre.
Le contexte actuel est particulièrement révélateur. Depuis 2015, la pression sur leurs épaules n’a cessé de croître, notamment avec le contexte terroriste et l’état d’urgence qui l’accompagnait. Aujourd’hui, plus que jamais, on en a l’illustration. Nos forces de l’ordre, dans cette ambiance insurrectionnelle, se trouvent démunies et à bout de force. Et les chiffres le prouvent : uniquement à Paris, vingt-trois de ses membres ont été blessés au cours de la journée du 1er décembre.
Ainsi, des efforts doivent être faits pour le budget de la mission « Sécurités ». Si les crédits des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » augmentent, les problèmes connus par les forces de sécurité intérieure ne sont pas pour autant résolus. En effet, la hausse des dépenses correspond très largement à celle du personnel, accentuant ainsi le ratio dépenses de personnel sur l’ensemble des crédits, en le portant à 89, 39 % pour la police nationale et à 84, 39 % pour la gendarmerie nationale.
Or ces augmentations de personnel depuis 2013 ne sont pas la seule priorité. Lorsque l’on se compare à nos voisins européens, on se rend compte que la France ne souffre pas d’une sous-dotation en effectifs. Ces effectifs sont d’ailleurs encore trop mobilisés sur des tâches indues, telles que la garde des bâtiments préfectoraux, l’assistance aux opérations funéraires, etc. Ces dernières mobilisent 6 000 équivalents temps plein travaillé, soit 4, 1 % du total des missions de la gendarmerie et 9 % de la police ! Il convient de poursuivre la lutte contre celles-ci.
Si des avancées significatives ont pu être réalisées, de grands chantiers restent à conduire. La priorité est de redonner aux forces de l’ordre des moyens matériels décents pour les accompagner dans leurs actions. Cela passe tout d’abord par le devoir de réinvestir dans le patrimoine immobilier des deux corps. En effet, pour la gendarmerie nationale, les crédits prévus sur les années 2018-2020 seraient inférieurs d’environ 450 millions d’euros aux besoins identifiés, contre 650 millions d’euros pour la police nationale.
Cette priorité passe aussi par la nécessité d’accroître les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Si des avancées ont pu être constatées, elles restent très largement insuffisantes. Plusieurs points noirs ont d’ailleurs été dégagés par le rapporteur spécial : la formation continue et les crédits d’équipements, notamment ceux de l’accès aux munitions.
Le parc automobile, vieillissant et inadapté aux missions des forces de l’ordre, est un très bon reflet de la situation dans laquelle la gendarmerie nationale et la police nationale se trouvent. La Cour des comptes a d’ailleurs déterminé que cela constituait l’une des principales préoccupations relatives à l’équipement des forces de sécurité intérieure.
Par surcroît, une bombe à retardement voit sa puissance grossir dans la police nationale : c’est celle des heures récupérables. À la fin de 2017, le stock des heures supplémentaires à apurer s’élevait à 21, 764 millions, pour un montant évalué à 271 millions d’euros en 2018.
Le rachat ne pouvant être effectué que pour les CRS, il s’agit, pour reprendre les mots du directeur général de la police nationale, d’une véritable « épée de Damoclès opérationnelle ». En effet, elles ont vocation à être récupérées avant le départ à la retraite sous forme de congés et ne mènent donc pas au remplacement de ces fonctionnaires durant cette période. Ainsi, un trou opérationnel est à prévoir. Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d’État, si un rachat de ces heures ne pourrait pas être envisagé pendant que la situation est encore soutenable.
C’est pour ces raisons que le groupe Union Centriste ne votera pas le budget de la mission « Sécurités ».
M. Michel Canevet applaudit.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, au regard des besoins des forces de sécurité qui sont indispensables – renforcement de la lutte contre le terrorisme, mise en place de la police de sécurité du quotidien –, le budget de la mission « Sécurités » pour 2019 est un budget en trompe-l’œil, augmentant seulement de 1, 67 %, soit un peu plus de 300 millions d’euros par rapport à 2018.
Comme en 2018, l’accent est mis sur l’augmentation des effectifs, avec la création de plus de 2 300 emplois dans la police et la gendarmerie.
Toutefois, ce nécessaire renforcement des effectifs, s’il n’est pas accompagné d’un important redressement des crédits d’équipements et des moyens de fonctionnement des forces de l’ordre, ainsi que de réformes structurelles adéquates, ne sera pas en mesure de provoquer un véritable effet de levier pour renforcer sur le terrain la présence des forces de sécurité.
Cette hausse apparaît également très insuffisante au vu des violences urbaines récurrentes auxquelles les forces de l’ordre sont confrontées et eu égard aux agressions dont elles font l’objet. Je veux parler de l’émergence d’un phénomène nouveau que l’on désigne par l’expression « Black Blocs », ou encore des faits qui se sont déroulés en marge des manifestations des « gilets jaunes ».
Ces hausses d’effectifs semblent, en effet, servir de prétexte pour dissimuler un manque de vision politique et une pénurie organisée, car, sur la totalité de la mission, les dépenses d’investissement diminuent de près de 47 %. Dès lors, pourquoi augmenter les effectifs des forces de l’ordre si les moyens et les équipements ne suivent pas ?
En outre, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite attirer votre attention sur les grands oubliés de votre ministère, à savoir les sapeurs-pompiers, qui, en intervention, sont victimes d’agressions dont le nombre augmente de manière intolérable.

Ces agressions ont augmenté de 18 % entre 2015 et 2016. Et les sapeurs-pompiers voient leurs marges budgétaires se réduire dangereusement.
Je voudrais évoquer la gratuité des autoroutes pour les véhicules d’intérêt général prioritaires en intervention, notamment ceux des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie. L’année dernière, cette gratuité avait été décidée. Mais rien n’a changé aujourd’hui, faute de décret d’application. C’est tout simplement inadmissible ! Cela l’est d’autant plus que ce budget laisse en marge la sécurité civile territoriale au moment où les départements et les intercommunalités se heurtent à de graves difficultés financières.
Bien que les services départementaux d’incendie et de secours soient financés principalement par les collectivités territoriales, le projet de loi de finances pour 2019 ne prévoit pas les adaptations fiscales et les concours ciblés nécessaires à l’amélioration de leurs investissements, comme l’a souligné notre collègue Catherine Troendlé, rapporteur pour avis pour le programme « Sécurité civile ».
Je veux rendre hommage à cette tribune aux hommes et aux femmes qui, tous les jours, souvent au péril de leur vie, assurent notre sécurité. Je les remercie ici de leur engagement au service des citoyens. Je souhaite également saluer les sapeurs-pompiers dont les interventions de secours à la personne ont considérablement augmenté, de 40 % au cours de ces dix dernières années !
En raison de l’affaiblissement du maillage territorial du système de santé, les sapeurs-pompiers sont devenus aujourd’hui un dernier recours, dans certains quartiers urbains, mais également et surtout dans nos zones rurales de plus en plus touchées par la désertification médicale.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le projet de budget n’apporte ni à la police ni à la gendarmerie nationale les moyens, matériels et humains à la hauteur de leurs missions et de leur niveau de sollicitation. Il ne prend pas non plus la pleine mesure de la dégradation du contexte sécuritaire dans notre pays.
Pour toutes ces raisons, le groupe Les Indépendants – République et Territoires ne votera pas les crédits de la mission « Sécurités » du projet de loi de finances pour 2019.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais à mon tour saluer avec sobriété le professionnalisme, le dévouement et l’humilité de nos forces de sécurité, mais aussi de secours, avec une pensée particulière envers ceux qui ont été blessés par certains de nos concitoyens – concitoyens certes, mais bien peu républicains – venus en découdre avec une violence inouïe et singulière.
À l’évidence, le débat budgétaire n’est pas qu’une joute technique réservée à ses seuls pratiquants. C’est l’affaire de tous. Il doit sans doute redevenir un outil d’instruction populaire et de controverse politique. Or nous vivons encore dans un monde où l’information budgétaire est une lutte politique permanente. Et l’on est parfois bien en peine d’identifier sur ces lignes budgétaires filandreuses, car difficilement praticables, le contenu politique qui s’y est déposé, et cela malgré l’amélioration remarquée de la maquette de performance sur le budget et les objectifs du ministère de l’intérieur.
Il importe de remonter la trace de quelques marqueurs politiques un tant soit peu consistants. J’en viens donc à quelques observations fondamentales sur la mission « Sécurités ».
La progression des crédits de la mission et des effectifs, avec – cela a été souligné – 2 500 recrutements prévus pour l’exercice 2019, s’effectue au bénéfice de la force de frappe opérationnelle des policiers et gendarmes, conformément au plan quinquennal de recrutement.
En parallèle, le Gouvernement s’affaire à recentrer les forces de l’ordre dans leur office. Notre doctrine d’action, c’est prioritairement le terrain, le lien quotidien avec la population. Les tâches indues doivent être éliminées ; elles le seront. La procédure pénale sera révisée. La numérisation et la rationalisation des activités de police et de gendarmerie seront accrues. Le chemin est donc tout tracé pour assouplir le formalisme procédural qui frappe partiellement d’inertie nos services de sécurité. À ces gains de disponibilité attendus s’additionneront les moyens alloués à la police de sécurité du quotidien et à l’expérimentation des brigades territoriales de contact.
Un effort particulier doit être également salué. Il concerne l’amélioration des conditions matérielles de travail de nos agents. On peut considérer l’ampleur de la tâche ; on peut aussi considérer l’effort. Ainsi, 137 millions d’euros seront affectés à l’acquisition de 5 800 véhicules neufs sur 60 000. C’est l’investissement le plus important depuis huit ans.
Les commissariats de police et les casernes de gendarmerie bénéficieront de la poursuite du plan triennal 2018-2022 s’agissant du parc immobilier domanial des forces de sécurité. Sur le terrain des rémunérations également, l’institution respectera les engagements pris envers les agents qui la servent. Ainsi, la mise en œuvre du protocole de valorisation des corps, des carrières et des métiers sera poursuivie en 2019, à hauteur de près de 61 millions d’euros.
Je souhaite évoquer le matériel à disposition de nos forces de l’ordre, auquel sont assurément liés le moral des troupes et l’attractivité de leur métier, comme le soulignent avec justesse les conclusions de la commission d’enquête sénatoriale relative au malaise dans les forces de sécurité intérieure.
Voilà pourquoi, outre les véhicules, il y aura 14 000 caméras supplémentaires pour équiper nos policiers. Et, au cours du premier trimestre de 2019, ce sont 50 000 tablettes et smartphones Néopol et 67 000 équipements Néogend, ainsi que le dispositif Nex-Sys pour nos services d’incendie et de secours et de sécurité civile auront été déployés.
Voilà donc un arsenal budgétaire sous l’effet duquel la hausse des effectifs s’adjoindra à celle des équipements. C’est un budget qui prend acte du processus endogène de restructuration du risque terroriste, en s’abstenant toutefois de lui opposer les actes de délinquance quotidienne, un budget qui inscrit donc dans la durée les efforts passés et les efforts récents, accentués.
Telle est l’articulation des faits qui nous conduit à renouveler notre confiance au ministre de l’intérieur et à voter les crédits de la mission « Sécurités ».

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, cela fait maintenant de nombreuses années que les membres du groupe CRCE dénoncent les conditions de travail déplorables de nos forces de sécurité intérieure.
Je le rappelais voilà peu en tant que membre de la commission d’enquête sénatoriale sur le sujet : le décalage est grand entre les priorités nettes des gouvernements successifs en matière de sécurité publique, qui ont donné lieu à de nombreuses lois, globalement répressives, et les moyens concrètement alloués à nos services de police et de gendarmerie.
Conformément aux annonces du Gouvernement, le présent projet de loi de finances s’inscrit dans la tendance d’augmentation des effectifs constatée depuis 2013, avec le financement de 2 378 équivalents temps plein en 2019 pour les programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale ». Cette hausse est bien évidemment positive. Mais elle vient – hélas ! – nourrir un déséquilibre important entre dépenses de personnels et ensemble des crédits.
Comme le relève le rapporteur spécial de la commission des finances sur cette mission, cette évolution positive du schéma d’emplois intervient alors même que les comparaisons internationales ne témoignent d’aucun sous-dimensionnement des forces de sécurité intérieure de notre pays, et surtout alors même que, en parallèle, le parc automobile est marqué par une augmentation continue de l’âge moyen des véhicules et une dégradation de leur état.
En outre, le parc immobilier des forces de sécurité intérieure devrait constituer une préoccupation majeure pour le Gouvernement. C’est également ce que relevait voilà peu l’enquête sénatoriale que je citais.
Toutefois, au-delà des données quantitatives et des questions de fonctionnement et d’investissement, il apparaît urgent de réfléchir enfin à la doctrine d’emploi que nous souhaitons pour nos forces de sécurité intérieure, notamment en vue de renouer le lien entre forces de l’ordre et population. Nous ne cessons de le répéter, mais nous sommes convaincus qu’il s’agit là de la seule issue possible pour améliorer cette relation et pour que l’État assure son autorité en toute légitimité.
La gestion de la crise actuelle lors des manifestations des « gilets jaunes » est pour nous révélatrice de l’état de désœuvrement dans lequel sont plongés nos agents de police, obéissant à des ordres qui semblent parfois contestables…
Tout en condamnant sévèrement – je l’ai également fait cet après-midi, ainsi qu’à de nombreuses autres reprises – les violences et les dégradations, nombre de ces agents estiment que la meilleure manière de mettre fin aux violences dans les manifestations est d’accéder aux revendications légitimes des manifestants, que d’ailleurs beaucoup d’entre eux partagent, habités qu’ils sont par la même colère sociale, se sentant eux aussi laissés-pour-compte.
Aussi, un syndicat de policiers déclarait hier : « Nous, salariés du ministère de l’intérieur, sommes impactés par la baisse du pouvoir d’achat, à travers le gel du point d’indice, pour les fonctionnaires, et l’absence de coup de pouce pour le SMIC, pour les contractuels, par l’injustice fiscale, et plus largement par la politique de modération salariale que nous subissons toutes et tous depuis plus de vingt ans. […] Pour nous, le Gouvernement doit entendre et répondre positivement aux revendications des salariés, retraités, privés d’emploi, étudiants. C’est la seule solution pour retrouver la paix sociale. »
Nous partageons pleinement cette analyse. Rappelons d’ailleurs que le rôle des forces de l’ordre n’est sûrement pas d’être le dernier rempart d’un pouvoir politique bloqué, sourd aux revendications populaires ; c’est bien d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Je finirai mon propos sur les crédits alloués à la sécurité civile de notre pays. La situation est plus que préoccupante en la matière. Les augmentations de crédit sont ciblées sur les lacunes révélées les années précédentes, soit la flotte aérienne et le renforcement de la capacité de déminage. Mais alors que les départements et les intercommunalités connaissent de graves difficultés financières, la sécurité civile territoriale continue à être sous-dotée par rapport à la sécurité civile de l’État. Cela n’est pas acceptable, à plus forte raison compte tenu de la situation de crise politique pour la gestion de laquelle eux aussi sont fortement, voire trop fortement, sollicités.
Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce budget, qui ne prend en compte aucune nouvelle doctrine de sécurité pour notre pays à l’heure où l’urgence est à l’écoute des policiers qui sont sur le terrain et des habitants qui souffrent de l’insécurité.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – M. Jean-Pierre Sueur applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, après les deux exercices exceptionnels de 2016 et 2017 pour le ministère de l’intérieur, où la priorité opérationnelle a été donnée à la lutte contre le terrorisme, les crédits consacrés à la mission « Sécurités » en 2019, comme en 2018, traduisent la volonté du Gouvernement de réorienter les efforts vers la sécurité et la paix publique des Français au quotidien.
Toutefois, la menace terroriste n’a pas disparu : elle a évolué d’une forme exogène vers une forme endogène, comme l’a constaté François Molins. Nos services de renseignements et forces de l’ordre, au-delà des renforts budgétaires et humains, vont bénéficier dans les années à venir d’un cadre légal plus favorable pour lutter contre le terrorisme.
Monsieur le secrétaire d’État, nous soutenons votre volonté d’accompagner le changement de perception d’insécurité de nos concitoyens, que les attentats ont profondément altérée. Il faut absolument empêcher la pérennisation d’un sentiment de méfiance généralisée et rétablir la concorde.
C’est la philosophie de la « police de sécurité du quotidien », qui est actuellement expérimentée. C’est aussi le sens de l’amendement de notre collègue Nathalie Delattre, qui vise à rassurer les Français dans leurs activités de loisir.
Si l’on s’attarde sur les conditions matérielles d’exercice des femmes et des hommes qui concourent bravement à la sécurité de notre pays, nos rapporteurs ont relayé leurs craintes, en matière d’équipement et surtout d’organisation du temps de travail, après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne, qui invalide le système d’astreintes.
Sur le premier point, l’équipement, nous nous interrogeons sur les difficultés liées à la passation des commandes. Celle-ci permet-elle une réactivité suffisante selon la priorité opérationnelle du moment ? Les rapporteurs ont posé la question de la flotte vieillissante des véhicules, mais on pourrait y ajouter celle de la généralisation des tenues ignifugées.
Enfin, une évaluation de l’utilité des nouveaux outils technologiques est nécessaire, alors que les actions récursoires en cas de casse ou de perte exposent financièrement les agents, qu’il s’agisse de la mise à disposition de téléphones portables équipés de logiciels de consultation de fichiers ou aux caméras mobiles.
Je m’interroge sur l’angle d’approche de nos rapporteurs quant aux conséquences de la jurisprudence européenne. Ne s’agit-il pas d’un défi managérial de réorganisation du temps de travail, plutôt que d’une lacune budgétaire ?
D’autres réformes attendent le ministère de l’intérieur : des transformations internes, avec, dans le mouvement Action publique 2022, la conduite d’une réflexion sur l’équilibre des moyens entre l’administration centrale, qui peut paraître hypertrophiée, et les services déconcentrés sur tout le territoire, en métropole comme outre-mer. La réduction des tâches indues doit être recherchée par le dialogue interministériel, afin de permettre des redéploiements utiles d’effectifs et de rapprocher les agents des missions qui ont fait naître leur vocation.
J’avais constaté l’importance du dispositif d’escorte nécessaire au centre de rétention administrative de Vincennes. Dans un ministère particulièrement exposé à la brutalité des rapports humains et à la mort, le renforcement de l’accompagnement psychologique paraît nécessaire ; il ne doit pas reposer seulement sur des entreprises associatives, comme celle du domaine de Courbat, qui accueille les forces de l’ordre victimes de burn-out.
L’évolution des attentes de la société concernant la lutte contre les violences sexuelles et familiales devrait faire l’objet d’une réflexion et d’adaptation des pratiques, en concertation avec le ministère de la justice.
Un autre chantier majeur est celui de l’évolution du continuum de sécurité associant les forces de sécurité nationales, locales et privées. Parallèlement à l’augmentation des effectifs de police municipale, soit 21 500 personnes en 2016, les dernières évolutions législatives prises dans le contexte terroriste ont organisé la montée en puissance des activités privées de sécurité.
En particulier, les lois de 2017 ont marqué un changement de paradigme, avec, comme le formule le Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS, la « consécration de la place de la sécurité privée comme un acteur à part entière de la sécurité globale de la Nation ». Entre 2012 et 2017, le Conseil a ainsi délivré plus de 363 000 cartes professionnelles d’une durée de validité de cinq ans.
Certes, cette évolution crée de la richesse et des emplois : les entreprises de la prévention et de la sécurité représentent aujourd’hui 7, 1 milliards d’euros de chiffre d’affaires et près de 165 000 salariés, soit approximativement la somme des crédits « dépenses de personnel » de la gendarmerie et le nombre d’agents de la police nationale…
Prenons garde à ne pas sous-estimer la portée de ces changements, en particulier l’extension du port d’arme à certains agents privés. Le risque existe de voir augmenter le nombre d’armes en circulation sur notre territoire, sans un contrôle rigoureux des modalités de leur conservation au domicile des agents.
De la même manière, le recours aveugle à des agents contractuels à des fonctions support pourrait mettre en danger les effectifs des commissariats et gendarmerie, en offrant un accès privilégié à leurs coordonnées et à leur vie familiale.
Monsieur le secrétaire d’État, la plupart des membres du groupe du RDSE voteront donc les crédits de la mission « Sécurités », avec la confiance dans votre capacité de relever ces défis et avec pour soutien ces mots de Georges Clemenceau : « Un homme de gouvernement qui doit agir a d’autres soucis que l’homme d’opposition, dont la parole n’engage que lui et dont les théories ne s’inquiètent pas du possible. »

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, le 19 novembre dernier, j’étais à être Haybes, dans les Ardennes, aux obsèques de Maggy Biskupski, présidente de l’Association des policiers en colère.
Elle était le trente-troisième membre de la police à mettre fin à ses jours en 2018, de même qu’il y a eu trente et un gendarmes. En m’embrassant, sa maman m’a dit : « Ma fille demandait si peu ». Je lui ai répondu : « Oui, si peu et si juste : des conditions matérielles minimales, un peu de considération et de respect, du soutien moral et juridique que doit tout employeur à ses employés. »
Il faut écouter les policiers qui souffrent au lieu d’envoyer l’Inspection générale de la police nationale aux policiers qui expriment cette souffrance. Place Beauvau, on met depuis trop longtemps la poussière sous le tapis ; vous devez le savoir, monsieur le secrétaire d’État. C’est bien de cultiver le secret – c’est même indispensable à la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI. C’est moins bien dissimuler la réalité, au risque de se mentir à soi-même et parfois aux autres.
Au sein de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, nous n’avons rien dissimulé de la réalité, ni même de nos responsabilités antérieures : RGPP et pression par les chiffres pour la droite ; faiblesse pénale et sous-investissement pour la gauche. Et puis, il y a eu la vague terroriste, la vague migratoire, l’Euro, les manifestations contre la loi Travail… Le problème réside non pas dans les responsabilités antérieures, mais dans la situation actuelle.
Certaines solutions appellent non pas des moyens financiers, mais de la volonté politique, d’autres attitudes morales, des déblocages idéologiques, des révolutions culturelles. La première est certainement celle du management dans la police nationale ; le rapport dit beaucoup sur ce point. Je parle de révolutions culturelles, de déblocages idéologiques et de volonté politique pour apporter enfin une réponse pénale adaptée.
Policiers et gendarmes courent de plus en plus de risques pour pas grand-chose ou pour rien, et cela les mine. Ils sont dévorés aussi par la lourdeur et la complexité de la procédure pénale, qui mangent les deux tiers de leur temps.
En cinq ans, vous créerez péniblement 7 500 postes de policiers et 2 500 postes de gendarmes, en grande partie gommés, on l’a dit, par la vacation forte ou la directive européenne sur le temps de travail. Vous en gagnerez des dizaines de milliers en allégeant drastiquement la procédure pénale. Mais là, ce n’est pas Bercy qui commande ; c’est la place Vendôme. Le projet de loi sur la justice, c’est seulement un cinquième de ce qui était attendu, soit une timide numérisation. L’oralisation était exclue ; on l’a réintroduite au Sénat par amendement ; l’Assemblée nationale l’a pour l’instant maintenue. J’espère que cela tiendra.
Nicolas Hulot disait que le Gouvernement se mentait à lui-même et donc aussi aux autres. Ce budget est en trompe-l’œil ; nos rapporteurs l’ont parfaitement démontré. Ce budget ne résorbera pas le stock des 22 millions d’heures supplémentaires impayées, qui vont continuer à augmenter. Ce budget ne répond pas au déficit de formation. Ce budget ne résorbe pas les dizaines de millions d’euros d’arriérés de loyers dus aux collectivités, qui logent les gendarmes tellement mieux que l’État, lequel les montre pourtant du doigt.
Nous avons vu comment l’État loge ces gendarmes, par exemple à Satory, dans des appartements indignes, insalubres, sans double vitrage, avec des baignoires sabots des années cinquante et des installations électriques non conformes, aussi dangereuses que ces voitures qui ne passeraient pas le contrôle technique si elles n’étaient pas sérigraphiées.
Vous vous apprêtez à déployer samedi prochain les blindés de la gendarmerie. Ils ont quarante-cinq ans ! Quand j’étais gamin, je jouais avec un VBRG Solido ; c’est dire s’ils ne sont pas jeunes !
Sourires.
Nouveaux sourires.

Les hélicoptères vieillissent aussi. Et un aéronef qui tombe en panne, c’est très dangereux ! Les équipements les plus modernes manquent sérieusement ; nous en avons parlé mardi au sujet des forces mobiles. La violence dont elles sont victimes et le courage dont elles font preuve nous obligent. Je pourrais encore évoquer les manteaux qui manquent aux jeunes gendarmes pour affronter l’hiver ou les munitions qui font défaut simplement pour faire les tirs réglementaires.
Votre budget n’y répond pas. Les crédits de paiement augmentent ? Oui, mais moins que l’inflation ! Le parc automobile va continuer à vieillir. Le parc immobilier va continuer à se dégrader. L’équipement indispensable va continuer à manquer. Le stock d’heures supplémentaires va continuer à augmenter.
Certes, en un an ou deux, vous ne pouvez pas rattraper une décennie, voire deux de retards et de manquements. Mais vous les aggraverez en 2019 ; au mieux, vous les stabiliserez.
Il vous faut prendre dès 2019 un rythme qui permette d’atteindre le niveau minimum nécessaire aux missions que la Nation confère à ses forces de sécurité. Pour leur ouvrir cette perspective, pour leur redonner le moral, pour sécuriser ses moyens, il faut une loi de programmation pour la sécurité intérieure, à l’instar de la loi de programmation militaire. Même si le montant des investissements est sans commune mesure, ils sont aussi indispensables à la sécurité des Français et – je le dis cette semaine avec une gravité particulière – à la protection non pas du pouvoir, mais de la République, dont elles sont le seul rempart !
Or vous ne fournissez pas à nos forces les moyens nécessaires et vous ne le ferez pas en 2019. Nous ne ferons pas semblant d’y croire, et nous voterons donc contre ce budget en trompe-l’œil.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la difficulté de l’exercice tient au fait que, plus on avance dans la soirée, plus on est en quelque sorte condamné à redire les mêmes choses. Le point qui m’apparaît tout à fait significatif ce soir est la grande convergence des interventions.
Bien sûr, la hausse des effectifs se poursuit par rapport à l’année dernière, puisqu’il y aura 2 360 emplois de plus, dont 1 735 policiers et 632 gendarmes. Le Président de la République a annoncé pendant la campagne électorale 10 000 effectifs de policiers et de gendarmes de plus pendant le quinquennat.
Je le rappelle, pendant le quinquennat précédent, 9 000 emplois avaient été créés. Mais, pour être tout à fait juste, cher monsieur Grosdidier, vous qui évoquiez la dernière décennie, il ne faut jamais oublier ce qui s’est passé de 2007 à 2012.

Je pense aux deux dernières décennies. Personne ne m’empêchera de rappeler que, de 2007 à 2012, il y a eu 13 720 postes de moins, dont 6 930 postes de policiers et 6 730 postes de gendarmes.

Notre groupe s’est associé à la commission des lois, qui s’est prononcée contre ces crédits. Certes, le fait que le nombre d’emplois augmente est positif. Mais je souhaite formuler trois remarques.
Premièrement, je crains que l’annonce des 10 000 postes dans le quinquennat ne soit compromise. En effet, dans le projet annuel de performances, le PAP – vous le savez, on crée toujours de nouveaux acronymes –, il n’y a que 832 postes, dont 824 pour la police et 8 pour la gendarmerie, si l’on tient compte des reports de l’année précédente. Par conséquent, il faudra en effet, comme cela a déjà été souligné, un important effort l’année prochaine et les autres années si l’on veut atteindre les 10 000 postes promis.
Deuxièmement, je souhaite évoquer les charges indues. Certes, c’est toujours un refrain ; cela doit faire quelques dizaines d’années que l’on en parle. Il s’agit en effet de profiter des créations de postes pour avoir davantage d’effectifs opérationnels.
Malheureusement, il y a un point sur lequel j’ai le sentiment – peut-être me démentirez-vous, et j’en serai heureux, monsieur le secrétaire d’État – que les choses n’avancent pas comme cela avait été prévu pour la question des transfèrements judiciaires.
Vous le savez, il y a plusieurs centaines de transfèrements judiciaires tous les mois, qui mobilisent d’importants effectifs de police. Un accord a été conclu avec le ministère de la justice – mais nous n’ignorons pas que ce dernier a aussi des problèmes de personnels et de moyens –, pour que la tâche soit effectuée par des personnels de ce ministère. Or il a été conclu un accord en vertu duquel ce processus serait achevé en 2019. Je ne vois pas les effets concrets de cette reprise de charge. Mais peut-être allez-vous me répondre, monsieur le secrétaire d’État.
Troisièmement, ainsi que M. Leroy l’a rappelé, le problème ce sont les investissements, les locaux, les véhicules le matériel et les crédits d’investissement de la police. La masse salariale augmente et prend une place toujours plus importante dans le budget.
Toutefois, la réalité est que les crédits d’investissement de la police diminuent de 11, 7 % en autorisations d’engagement et de 18, 6 % en crédits de programme. Mes collègues ont déjà souligné l’ancienneté des véhicules, avec une moyenne de six ans et quatre mois d’ancienneté pour la police et de sept ans et quatre mois pour la gendarmerie. On ne peut à l’évidence pas continuer comme cela.
À l’instar de mes collègues, j’affirme notre total soutien et notre totale solidarité à l’égard des policiers et des gendarmes, qui sont soumis à dure épreuve. Ce n’est pas la violence qui règle les questions, et celle-ci est condamnable. Nous sommes dans une démocratie où on peut parler, discuter et s’affronter sans que cela passe par cette violence.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, avec une augmentation des crédits de la mission « Sécurités » de 3, 63 % en autorisations d’engagement et de 1, 84 % en crédits de paiement, le projet de loi de finances pour 2019 présente, tout du moins en apparence, les signes du redressement du budget des forces de sécurité intérieure.
Néanmoins, en dépit de cette progression des crédits, le budget de la mission « Sécurités » apporte-t-il une réponse suffisante aux difficultés rencontrées par nos forces de sécurité intérieure, si fortement sollicitées et auxquelles chacun se doit, ces jours-ci particulièrement, de rendre un hommage appuyé ?
J’aborderai plus spécifiquement le programme 152 « Gendarmerie nationale » et le programme 176 « Police nationale ».
Si le budget des forces de l’ordre semble bénéficier d’une certaine consolidation, il n’en demeure pas moins qu’il présente des déséquilibres. Oui, ces dernières années le budget de la mission a connu une augmentation qu’on ne saurait méconnaître. Rappelons que les crédits des programmes « Police nationale » et « Gendarmerie nationale » ont augmenté de 18, 6 % en autorisations d’engagement et de 17, 1 % en CP entre 2010 et 2018.
Pour autant, ce budget manque d’ambition au regard de la situation dégradée et de la grave insuffisance de l’équipement de nos forces de sécurité intérieure. Il manque également d’ambition au regard des difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure. Enfin, il manque d’ambition au regard du contexte sécuritaire actuel, qui, comme chacun le sait, se révèle particulièrement tendu – je n’y reviendrai pas ce soir.
Concernant la situation dégradée de l’équipement de nos forces de sécurité intérieure, l’état du parc automobile est pour le moins préoccupant. C’est une situation marquée par la dégradation de l’état des véhicules ainsi que par l’augmentation continue de leur âge moyen.
C’est notamment le cas dans la police, où l’âge moyen des véhicules légers est passé, de 2012 à 2018, de trois ans et huit mois à six ans et quatre mois. Je rappelle à ce titre qu’un rapport de la Cour des comptes relatif aux équipements de police et de gendarmerie en appelait récemment à la « nécessaire remise à plat de la gestion du parc automobile ».
J’en viens à l’état des parcs immobiliers de la police et de la gendarmerie nationale. Monsieur le secrétaire d’État, en moyenne, les logements des familles de gendarmes n’ont pas été rénovés depuis quarante-cinq ans : quarante-cinq ans ! Vous le savez, mais c’est une illustration pénible du déficit d’investissement de l’État en matière immobilière.
Si la programmation immobilière 2018-2020 annoncée en janvier dernier prévoit le lancement de soixante-seize opérations immobilières nouvelles pour les trois années à venir, je regrette vivement que ces annonces ne se traduisent par aucun effort significatif sur le plan budgétaire.
En 2019, les dépenses de fonctionnement et d’investissement sont identiques à celles de 2007 dans la police. Pour la gendarmerie ces dernières ont même été réduites de plus de 8 % ! Cette évolution est préoccupante, car la capacité opérationnelle des forces de sécurité intérieure repose, outre sur le nombre de personnels actifs, sur l’aptitude de l’État à équiper et entretenir ses forces.
Enfin, je soulignerai les difficultés rencontrées par les forces de sécurité intérieure en m’attachant plus spécifiquement à la question de la formation.
En 2019, les crédits alloués au financement de la formation des forces de sécurité intérieure s’élèveront à 19 millions d’euros dans la police nationale et à 13 millions d’euros dans la gendarmerie nationale. Par rapport à 2018, ils sont en baisse de 15 % pour la police et stagnent pour la gendarmerie. Ils ont diminué, depuis 2017, de 23 % pour la police nationale et de 1, 7 % pour la gendarmerie.
Eu égard au contexte sécuritaire dégradé et aux défis auxquels les forces de sécurité intérieure sont confrontées, la formation continue, jugée aujourd’hui largement insuffisante par l’ensemble des professionnels de la police et de la gendarmerie, devrait constituer une priorité budgétaire.
Je rappelle, à ce titre, que dans son rapport publié en juin 2018 la commission d’enquête sénatoriale sur l’état des forces de sécurité intérieure, citée à plusieurs reprises ce soir, relevait que, en 2017, moins des deux tiers des agents actifs de la police nationale avaient, par exemple, effectué leurs séances réglementaires de tir.
Voilà pourquoi les crédits de cette mission « Sécurités » nous paraissent insuffisants au regard des enjeux qui nous occupent.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, au sein de la mission « Sécurités », mon intervention portera sur les crédits accordés à la sécurité civile qui regroupe l’ensemble des politiques du ministère de l’intérieur consacrées à la protection des populations et à la gestion de crises.
On peut tout d’abord se satisfaire de la légère augmentation de 1, 2 % des crédits de paiement alloués à ce programme budgétaire, puisqu’ils passent à 538, 7 millions d’euros, contre 532, 27 millions d’euros pour 2018. Je regrette néanmoins qu’ils aient été diminués de 1, 7 million d’euros par l’Assemblée nationale en première lecture.
La forte baisse des autorisations d’engagement est liée à l’acquisition l’an dernier par l’État de six appareils « multirôles » – bombardiers d’eau, transport de personnes et de fret, évacuation sanitaire –, qui avait nécessité l’ouverture de crédits considérables, à savoir environ 400 millions d’euros.
Les dépenses de personnel s’élèvent, quant à elles, à 183 millions d’euros en crédits de paiement, soit une baisse de 1, 6 % par rapport à l’année précédente.
On le sait, le budget de la sécurité civile affecte traditionnellement peu les services départementaux d’incendie et de secours, les SDIS, qui sont financés en quasi-totalité par les collectivités territoriales, pour un montant de près de 5 milliards d’euros.
Toutefois, dans un contexte marqué à la fois par la hausse budgétaire et par l’augmentation constante du nombre d’interventions, on ne peut que déplorer la baisse de 20 millions d’euros en deux ans du soutien à l’investissement des SDIS apporté par l’État, alors que ce dernier avait promis de pérenniser son engagement financier à leurs côtés.
À la suite de la réforme de la prestation de fidélisation et de reconnaissance intervenue en 2016, les fonds dégagés devaient être en partie réaffectés aux investissements des SDIS. Or, après avoir chuté de 60 % en 2018, pour atteindre 10 millions d’euros, la dotation de soutien aux investissements structurants des services d’incendie et de secours subit une nouvelle baisse drastique de 10 millions d’euros.
De surcroît, 70 % de ces crédits étant destinés au seul projet NexSIS, ou système d’information et de commandement unifié des services d’incendie et de secours et de la sécurité civile, seuls 3 millions d’euros seront au final destinés au financement des projets locaux retenus en 2017. Ce n’est pas acceptable !
Au-delà de ces chiffres, nos débats sur ce programme budgétaire sont marqués par la menace que fait planer la directive européenne de 2003 sur le temps de travail, à la suite de l’arrêt Matzak, rendu le 21 février dernier par la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère le volontariat comme du temps de travail.
Selon la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, une application de cette directive européenne aux sapeurs-pompiers volontaires conduirait la France à se priver des pompiers volontaires exerçant une activité professionnelle à titre principal, soit environ 60 % de leurs effectifs.
Les 120 000 pompiers volontaires devraient être remplacés par 60 000 pompiers professionnels, pour un montant de 2, 5 milliards d’euros, soit 50 % du budget actuel des services d’incendie et de secours. C’est d’autant plus préoccupant que les sapeurs-pompiers volontaires composent l’essentiel des effectifs des SDIS, en particulier dans les zones rurales.
Dans mon département du Finistère, il y a 600 pompiers professionnels pour 2 200 pompiers volontaires qui s’engagent en dehors de leurs heures de travail et qui, pour ce faire, acceptent de suivre une formation contraignante. Nous devons à tout prix préserver notre modèle français de sécurité civile, qui est internationalement reconnu et qui repose sur l’action commune et complémentaire des pompiers professionnels et volontaires.
C’est en ce sens que notre groupe avait soutenu l’amendement qui avait été déposé par Mme Catherine Troendlé en première lecture du PLFSS pour 2019 et adopté par le Sénat.
Cet amendement visait à instaurer une exonération de charges patronales d’un montant de 3 000 euros pour toute embauche d’un employé sapeur-pompier volontaire, dans la limite de 15 000 euros par an et par structure. Cette disposition a malheureusement été supprimée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, à la suite d’un amendement du Gouvernement.

Enfin, j’insisterai en dernier lieu sur la nécessité d’améliorer les conditions de travail et la protection de l’ensemble des sapeurs-pompiers, surtout lorsque l’on sait que les agressions à leur encontre ont été multipliées par deux et demi en dix ans.
C’est en ce sens que le groupe socialiste et républicain du Sénat, autour de son président Patrick Kanner, a déposé le 30 octobre dernier une proposition de loi relative au renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers. Elle vise à permettre l’anonymat pour les sapeurs-pompiers qui portent plainte afin d’éviter qu’ils ne se trouvent exposés à des risques de représailles de la part des personnes mises en cause.
Cette proposition s’inspire du droit en vigueur qui s’applique au bénéfice des agents de la police ou de la gendarmerie nationale, des douanes ou encore des services fiscaux.
Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, et dans un contexte où les sapeurs-pompiers font face à une demande croissante de secours et de protection de la population, les crédits dévolus à la sécurité civile dans nos territoires nous paraissent largement insuffisants.

M. Jean-Luc Fichet. Notre groupe votera donc contre ce projet de budget.
M. Jean-Pierre Sueur applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à saluer le travail de nos collègues au sein de notre institution, ainsi que celui du personnel du Sénat. J’associe à mes propos ma collègue Nicole Duranton, qui m’a confié son temps de parole sur cette mission « Sécurités » qui me tient particulièrement à cœur et sur laquelle j’interviens modestement depuis 2007.
Chaque année, j’insiste toujours sur les moyens humains. Face à une situation économique et sociale particulièrement compliquée, liée à la crise de nos valeurs, nous nous devons d’exprimer notre respect et notre reconnaissance à l’ensemble de nos forces de sécurité : police nationale, gendarmerie nationale, sapeurs-pompiers. Nos gendarmes et nos policiers doivent faire face à des engagements de plus en plus difficiles et dangereux.
Je pense également à nos militaires, même s’ils ne dépendent pas de cette mission, ainsi que, plus largement, au personnel des collectivités territoriales, aux personnels de la santé, au personnel de l’administration des douanes, au sein du ministère de l’économie et des finances, sans oublier les personnels de l’institution judiciaire.
Dans le cadre du projet de loi de finances pour 2019, les crédits de paiement s’élèvent à 19, 5 milliards d’euros, en hausse de 1, 62 %. Ils se répartissent comme suit : police nationale, 10, 7 milliards d’euros ; gendarmerie nationale, 8, 8 milliards d’euros. Nous notons avec satisfaction la création pour 2019 de 2 378 ETP pour les deux programmes.
Les effectifs prévus pour 2019, soit 151 680 policiers et 96 374 gendarmes, sont de plus en plus sollicités. C’est encore plus le cas ces dernières semaines à Paris, en province et outre-mer, comme l’ont rappelé cet après-midi nos collègues lors du débat organisé avec M. le Premier ministre. Je citerai le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a appelé à préserver l’unité de la Nation.
Nos forces de sécurité se trouvent de plus en plus confrontées à des problématiques à caractère social, alors que leurs missions prioritaires consistent en la sécurité des personnes et des biens, ce qui a été souligné par bon nombre de nos collègues, sans oublier la lutte contre le terrorisme et l’insécurité routière.
Dans le département que je représente, les Ardennes, je puis mesurer le dévouement de nos forces de sécurité, sans oublier nos sapeurs-pompiers.
Je pense en particulier aux jeunes sapeurs-pompiers qui participent activement aux cérémonies patriotiques dans le cadre du devoir de mémoire. Nous avons tous pu apprécier leur implication dans nos départements respectifs dans le cade de la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale. Je citerai également les journées nationales de mémoire de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des sapeurs-pompiers, car il arrive malheureusement que ces personnels perdent la vie dans l’exercice de leurs missions.
Cependant, la situation reste très difficile : personnel épuisé, postes non pourvus dans certaines brigades, véhicules en mauvais état, parc immobilier dégradé. Il est nécessaire de redonner confiance à l’ensemble des personnels.
Concernant les recrutements, il est indispensable de susciter des vocations, notamment chez les jeunes. Je fais ici référence à la Journée défense et citoyenneté, la JDC. Qu’en sera-t-il exactement, monsieur le secrétaire d’État ? Je souhaite également vous interroger sur le devenir de la réserve ; j’en témoigne ici modestement en tant que membre de la réserve citoyenne de la gendarmerie.
En tout état de cause, compte tenu des différentes incertitudes que nous avons pu mesurer, mon groupe ne votera pas la mission « Sécurités ».
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, madame et messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, les crédits de la mission « Sécurités » représentent 13, 6 milliards d’euros, soit près de 80 % des crédits du ministère de l’intérieur.
Pour 2019, la sécurité intérieure bénéficie, comme en 2018, d’un budget sincère, solide et réaliste. En effet, la sécurité est pour le Gouvernement, comme elle l’est pour nos concitoyens, une priorité absolue.
Les événements d’une extrême gravité que notre pays a récemment traversés le montrent encore une fois. Fortement sollicitées par la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la délinquance, la lutte contre l’immigration irrégulière tout au long de ces derniers mois, nos forces ont aussi été très fortement mobilisées ces dernières semaines, comme vous l’avez rappelé, sur le terrain de l’ordre public. Je veux donc de nouveau et à mon tour leur rendre solennellement hommage.
Les événements récents soulignent, si cela était nécessaire, toute l’importance des crédits qui sont discutés aujourd’hui. L’importance des enjeux, le Gouvernement en a pleinement conscience. C’est bien pourquoi les moyens de la police et de la gendarmerie seront en 2019 de nouveau en hausse très significative, de 33 milliards d’euros, soit une progression de 2, 6 %.
Si l’on prend un peu de recul, par rapport à 2015, dans les deux forces, on constate que les crédits sont globalement en hausse de près de 12 %. Cela représente plus de 1, 4 milliard d’euros de crédits supplémentaires. Le message est donc clair : non seulement nous consolidons les efforts passés, mais nous les accentuons. Non seulement les mesures qui étaient hier exceptionnelles et limitées dans le temps – je veux parler des différents plans de remise à niveau du budget des forces de sécurité – sont pérennisées et inscrites dans la durée, mais le Gouvernement a encore accentué cet effort.
L’effort budgétaire en faveur de la sécurité est donc confirmé, ce qui traduit bien – il faut en avoir conscience – une orientation très forte de ce quinquennat.
Avec ces moyens, les engagements pris – ceux du Président de la République, lors de la campagne, ceux du Gouvernement, devant le Parlement, mais aussi vis-à-vis des femmes et des hommes qui œuvrent chaque jour à la sécurité de tous – seront tenus.
Le budget pour 2019 de la sécurité intérieure est donc dépourvu de toute surprise. Il est en tout point conforme aux annonces faites et aux engagements pris en matière d’effectifs, d’immobilier, de moyens de fonctionnement des forces ou encore de politique indemnitaire, sociale et salariale.
Concernant les effectifs, nous bénéficierons de l’affectation dans les unités opérationnelles de tous les personnels recrutés en 2018 au titre du plan de 10 000 recrutements ; ils étaient, je vous le rappelle, au nombre de 2 000. Mais nous bénéficierons aussi du recrutement des 2 500 emplois supplémentaires prévus en 2019 et du concours des réservistes de la garde nationale. En 2019, le budget pourra nous permettre de consacrer jusqu’à 130 millions d’euros dans les deux forces à la réserve de la garde nationale, qui concerne désormais un vivier de 37 000 volontaires.
Après la suppression entre 2007 et 2012 de 12 519 emplois de policiers et de gendarmes, nous avons inversé la tendance avec ce plan de recrutement, pour permettre le renforcement de l’effectif des forces de sécurité sur le terrain. Ce n’est qu’à la fin de l’année 2019 que nous aurons reconstitué le vivier du corps d’encadrement et d’application, le CEA, dans la police nationale, tel qu’il était en 2007.
J’entends parfois dire que le budget d’équipement et de fonctionnement n’a pas été conçu pour aller de pair avec ce renforcement humain. Je veux, mesdames, messieurs les sénateurs, vous rassurer : il n’en est rien. Ce n’est pas la méthode de ce gouvernement et ce n’est pas la manière dont ce plan de recrutement a été conçu.
J’en veux pour preuve le fait qu’il y a, dans ces crédits, deux mesures bien identifiées représentant le « sac à dos des recrutements », c’est-à-dire 26 millions d’euros de crédits dans les deux forces. Les policiers et les gendarmes que nous recrutons sont donc bel et bien, mesdames, messieurs les sénateurs, armés, équipés et installés : les forces disposent des budgets nécessaires pour cela.
Concernant les questions d’immobilier et d’équipement, les travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur l’état des forces de sécurité intérieure l’ont montré : l’effort doit aussi porter sur le budget d’équipement, d’investissement et de fonctionnement des forces de sécurité. C’est précisément ce que nous avons entrepris en 2018, comme en 2019.
Concernant l’immobilier, des orientations claires ont été données pour la programmation immobilière jusqu’en 2020. En effet, il faut agir résolument, comme vous l’avez souligné, sur la situation des commissariats de police et des casernes de gendarmerie, qui sont parfois très dégradées, faute d’entretien régulier et suffisant par le passé. C’est un axe très important de notre politique : il faut améliorer les conditions de travail des policiers, en intervenant sur la qualité de leurs lieux de travail.
Comme cela a été annoncé, le budget de l’immobilier de la police nationale est donc maintenu à un niveau historiquement élevé, tout comme dans la gendarmerie : 196 millions d’euros seront accordés à la police, soit 5, 4 % de plus qu’en 2017, et 105 millions d’euros à la gendarmerie, soit une hausse de 9 % par rapport à 2017.
Cette priorité donnée à l’entretien, à la rénovation et à des constructions neuves quand elles sont nécessaires n’exclut pas de mettre en place des projets ambitieux. Je veux ici rappeler les opérations immobilières qui concernent la DGSI, dont a parlé François Grosdidier : 20 millions d’euros seront consacrés à des travaux programmés d’aménagement dans une commune dont je tairai le nom, puisque tout cela est mis sous le tapis.
L’objectif est de lancer en 2019 les premières études concernant le futur site unique pour la DGSI, plus que jamais d’actualité. Il s’agit clairement du projet immobilier le plus important du ministère pour les années qui viennent et en faveur duquel 450 millions d’euros de crédits sont budgétés dans la trajectoire financière du ministère d’ici à 2022.
En matière d’équipement, le niveau atteint par le budget pour 2019 permettra de donner corps à une police et à une gendarmerie aux ambitions renouvelées, respectées et tirant parti des progrès de la technologie. Il est donc prévu de commander 5 800 véhicules neufs dans les deux forces en 2019, pour un budget total de 137 millions d’euros.
Ce faisant, nous réaliserons l’investissement le plus important depuis huit ans, avec plus de 1 600 véhicules de plus que la moyenne de ces dernières années. C’est ainsi que nous pourrons véritablement améliorer l’état du parc, faire baisser l’âge moyen des véhicules, qui dépasse aujourd’hui, comme certains d’entre vous l’ont rappelé, sept ans, et organiser la montée en gamme du parc automobile.
Pour ce qui concerne l’équipement, le budget pour 2019 atteindra 143 millions d’euros. Sont bien évidemment concernés, aussi bien dans la police que dans la gendarmerie, des équipements technologiques : tablettes et smartphones. À la fin du premier trimestre de 2019, 50 000 tablettes et smartphones « NEOPOL » dans la police et 67 000 équipements « NEOGEND » dans la gendarmerie auront été déployés. Ce sont autant d’équipements qui moderniseront l’activité de nos policiers et de nos gendarmes.
Par ailleurs, 10 000 équipements supplémentaires seront acquis dans la police en 2019, comme en 2020, pour un investissement de 5, 4 millions d’euros. De la même manière, je souhaite que la diffusion des caméras-piétons se poursuive activement en 2019.
Enfin, nous lancerons en 2019 deux programmes importants qui méritent d’être soulignés. Tout d’abord, un plan d’investissement en matière d’équipement technologique pour le renseignement, dont bénéficiera la DGSI en accompagnement de la montée en puissance d’un autre grand service, à savoir la DGSE.
Par ailleurs, 22, 5 millions d’euros seront débloqués pour entrer dans la phase opérationnelle du réseau radio du futur. Des efforts importants en termes d’équipement sont donc consentis dans les deux forces.
En complément de ces projets de modernisation, l’année 2019 marquera la conduite des premières expérimentations de la procédure pénale numérique dans le ressort des TGI d’Amiens et de Blois.
Ce programme porté conjointement avec le ministère de la justice est complémentaire de la simplification de la procédure pénale en cours, qui nous conduira à rétablir un certain nombre de mesures prévues dans le dispositif initial, mais supprimées par le Sénat. Il s’agit de mesures visant à alléger la tâche des policiers et des gendarmes, ce que nous souhaitons tous ardemment.
Vous avez été nombreux à aborder les tâches indues, c’est bien notre priorité. La procédure pénale en fait partie – je le souligne et j’y insiste –, mais il y en a d’autres. En réponse à la question de Jean-Pierre Sueur, je confirme que le plan concernant les extractions, et non les transfèrements, …
… sera mis en œuvre. L’objectif est bien d’y parvenir en 2019.
De la même façon, de nombreux allégements de tâches indues sont prévus, je pense notamment aux gardes statiques. Comptez sur nous pour agir de manière déterminée.
J’en viens maintenant aux moyens de la sécurité civile, qui augmentent de 1, 5 %, pour s’établir à 486 millions d’euros. L’objectif, dans ce domaine, c’est que le budget de la sécurité civile permette de maintenir et de renforcer les termes du contrat opérationnel avec la Nation.
L’an passé, vous vous en souvenez, nous avions engagé l’acquisition de six avions multirôles DASH, pour un budget de 380 millions d’euros. L’ensemble du marché a aujourd’hui été lancé et les premières dépenses réalisées. Le premier DASH sera livré dans le courant du premier semestre 2019 et pourra être engagé dès la saison de feux de l’an prochain. Les cinq autres avions seront livrés chaque année jusqu’en 2022.
L’année 2019 sera consacrée à la poursuite de la modernisation des moyens nationaux, avec 4, 8 millions d’euros de crédits supplémentaires, au profit, d’une part, du service du déminage, et, d’autre part, des formations militaires de la sécurité civile.
Enfin, nous engagerons en 2019 la phase opérationnelle du chantier du système unifié de gestion des appels d’urgences NexSIS, en mobilisant pour cela 10 millions d’euros en provenance de la dotation de soutien à l’investissement des SDIS, dont l’existence est confortée.
Ce projet est emblématique de la transformation que nous souhaitons impulser au ministère. C’est un projet de mutualisation, gage d’économies pour les SDIS et leurs financeurs. C’est aussi un projet de modernisation, qui assurera l’interopérabilité des systèmes d’information des services de secours avec ceux des SAMU et de la sécurité publique.
L’État prendra donc toute sa part dans cet investissement stratégique, en créant en 2019 une « agence du numérique de la sécurité civile », qui lancera les premiers développements applicatifs et procédera à l’acquisition des infrastructures nécessaires à la conduite du projet.
Pour répondre à une question qui m’a été posée, je confirme, en ce qui concerne la directive relative au temps de travail et la jurisprudence de la Cour européenne, que le Gouvernement a engagé plusieurs chantiers sur des terrains divers et variés, dont celui d’exploiter les dérogations offertes par cette directive. Le cas échéant, nous envisageons de demander la modification du texte européen.
Quoi qu’il en soit, notre volonté reste intacte, comme nous l’avons exprimé plusieurs fois devant vous. Je souligne également que nos partenaires européens ne nous reprochent rien pour l’instant. Par ailleurs, le Gouvernement est en train d’examiner le pourcentage de sapeurs-pompiers volontaires concernés par ce texte ; nous sommes en train d’affiner les chiffres.
Comptez sur nous, mesdames, messieurs les sénateurs, pour exploiter tous les champs des possibles pour contourner cette jurisprudence, afin qu’elle ne remette pas en cause le modèle des sapeurs-pompiers volontaires tel qu’il existe dans notre pays.
Je conclurai mon propos en évoquant les moyens des politiques de sécurité routière. L’importance humaine de cette politique est grande, à la hauteur de la fragilité des résultats obtenus, année après année. Voilà pourquoi il est important, en ce domaine également, de disposer d’un budget à la hauteur des enjeux.
À cet égard, le PLF pour 2019 permettra d’assurer le financement des mesures décidées lors du comité interministériel de sécurité routière du 9 janvier dernier, mesures qui visent à nous permettre de faire passer la mortalité routière sous les 2 000 morts par an.
Nous augmenterons de 32 millions d’euros le plafond des crédits du compte d’affectation spéciale utilisé pour financer les structures et dispositifs de sécurité routière, et nous assurerons à hauteur de 36 millions d’euros le financement des mesures d’accompagnement, décidées par le Premier ministre, à la diminution de la vitesse autorisée sur le réseau national secondaire.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce que je retiens du budget de la mission « Sécurités ». C’est en tout point un bon budget, et même un très bon budget, matérialisant combien la sécurité compte, pour la seconde année consécutive, parmi les priorités du Gouvernement.
Nombre d’entre vous connaissent les politiques de sécurité, à force de travail parlementaire, de rapports et d’analyses. Vous saurez donc mesurer combien l’effort est grand et combien il est également important que le niveau de crédits atteint en 2019 soit une base pérenne et consolidée, sur laquelle nous appuyer pour mettre en œuvre les politiques de sécurité.
Je dirai quelques mots rapides en réponse à certaines de vos préoccupations. Je pense notamment à ce qui a été dit sur les agressions de pompiers. Je rappelle qu’il existe dans tous les départements des protocoles. Nous veillons à leur application avec les services de police et les services de gendarmerie afin que ces derniers puissent accompagner les sapeurs-pompiers lorsque ceux-ci interviennent sur des terrains difficiles. Nous veillerons également à mettre en œuvre l’expérimentation des caméras-piétons, qui est un dispositif très attendu par la profession.
Mme Éliane Assassi a semblé dire que nous n’avons pas de doctrine. Mais un budget, c’est aussi une doctrine ! Ce gouvernement a élaboré un certain nombre de doctrines, j’en ai été le premier témoin dans mes fonctions précédentes en matière de lutte antiterroriste avant d’entrer au Gouvernement. C’est aussi vrai en matière de police de sécurité du quotidien.
Oui, notre objectif est bien de rapprocher la police et la population. C’est ce que nous faisons au quotidien. Par rapport à ce qui s’est fait dans le passé, nous laissons beaucoup plus d’initiative aux échelons territoriaux, pour construire ce partenariat entre nos forces de sécurité et l’ensemble des acteurs de la sécurité sur le territoire. M. Guillaume Arnell a d’ailleurs parfaitement rappelé les différentes doctrines et je ne reviendrai pas sur le continuum de sécurité.
Je ne peux donc laisser dire qu’il n’y a pas de doctrine derrière la volonté du Gouvernement de faire augmenter nos budgets.
Monsieur François Grosdidier, je vous confirme que le suicide est bien l’une de nos préoccupations. Un plan d’action et de suivi des suicides a été mis en place dans la police nationale et dans la gendarmerie. Croyez bien que nous sommes très attentifs à cette question. Toutefois, je ne souhaite pas qu’il soit dit à cette tribune que l’Inspection générale de la police nationale, l’IGPN, est mêlée à cela.
L’IGPN a une mission très claire, celle de veiller au respect de la déontologie au sein de la police nationale, et les policiers le savent. Il est vrai que ceux-ci sont soumis dans l’exercice de leur mission à une contrainte forte et que, dans ce contexte, il se peut que l’IGPN intervienne.
Toutefois, encore une fois, je ne souhaite pas qu’un lien ou un raccourci soit fait entre les suicides dans la police nationale et le fait que l’IGPN diligente un certain nombre de missions. Je puis vous assurer, quoi qu’il en soit, que la prévention du suicide dans la police nationale et dans la gendarmerie est bien l’une de nos priorités.
Pour ce qui concerne la formation, un point évoqué par plusieurs d’entre vous, l’investissement dans ce domaine est stable ; je ne sais pas d’où sortent les chiffres que certains ont cités à cette tribune ! Ainsi, pour la police nationale, le plan de formation sera stable en 2019 par rapport à 2018.
S’agissant des tâches indues, je me permets de revenir sur le sujet de la procédure pénale. Nous avions un projet ambitieux et audacieux, qui a été quelque peu détricoté. Il faudra le retricoter, si j’ose dire, à l’Assemblée nationale.
La procédure pénale est importante pour les policiers. Vous accordez beaucoup d’attention, et je vous en remercie, au travail et aux tâches indues des policiers nationaux. Mais lorsque Christophe Castaner et moi-même leur rendons visite dans les commissariats, ce que nous faisons très souvent, ils insistent à chaque fois sur le sujet de la procédure pénale.

Nous allons procéder à l’examen des crédits de la mission « Sécurités », figurant à l’état B.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Sécurités
Police nationale
Dont titre 2
9 589 631 109
9 589 631 109
Gendarmerie nationale
Dont titre 2
7 474 870 819
7 474 870 819
Sécurité et éducation routières
Sécurité civile
Dont titre 2
183 317 063
183 317 063

L’amendement n° II-761 rectifié bis, présenté par Mme N. Delattre, M. Artano, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gold et Guérini, Mme Jouve et MM. Menonville et Requier, n’est pas soutenu.
Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Sécurités », figurant à l’état B.
Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits.
Les crédits ne sont pas adoptés.

Nous allons procéder à l’examen des crédits du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », figurant à l’état D.
En euros
Mission
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
Structures et dispositifs de sécurité routière
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Ces amendements visent tous à prélever des crédits sur l’action n° 01 du programme 755, « Désendettement de l’État ».
L’amendement n° II-612 rectifié ter, en particulier, tend à vider cette action de l’ensemble de ses crédits. Il deviendra donc automatiquement sans objet en cas d’adoption de l’amendement n° II-971 de la commission des finances.
En revanche, l’amendement n° II-610 rectifié ter, qui tend à prélever 50 millions d’euros sur l’action n° 01, ne deviendra pas sans objet en cas d’adoption de l’amendement n° II-971.
L’amendement n° II-971, présenté par M. Gabouty, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Structures et dispositifs de sécurité routière
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. le rapporteur spécial.

Cet amendement tend à tirer les conséquences de l’adoption par le Sénat, lors de l’examen de la première partie du projet de loi de finances, d’un amendement, présenté par M. le rapporteur général de la commission des finances, visant à insérer un article additionnel après l’article 31 du projet de loi de finances.
Le programme 754, « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières » du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » voit ses crédits diminuer d’environ 7 % dans le projet de loi de finances pour 2019.
Cette baisse est justifiée par la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, entrées en vigueur le 1er janvier 2018, qui permettent désormais aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, de fixer le montant du forfait de post-stationnement, le FPS, et d’en recueillir le produit.
Or les départements, auxquels incombe l’entretien d’un réseau routier de plus de 370 000 kilomètres, ne bénéficient pas directement de cette réforme.
Afin de renforcer les moyens affectés aux collectivités territoriales pour entretenir leur réseau routier, et ainsi contribuer à la lutte contre l’insécurité routière, le Sénat a adopté, en première partie du projet de loi de finances, un amendement visant à créer un prélèvement sur recettes au profit des départements.
Ce prélèvement, d’un montant de 45 millions d’euros, serait opéré sur la fraction du produit des amendes forfaitaires, qui ne sont pas issues du contrôle automatisé, et de l’ensemble des amendes forfaitaires majorées de la police et de la circulation, versée chaque année au budget général. L’amendement susvisé permet de porter le montant de ce produit, qui est actuellement de 45 millions d’euros, à 90 millions d’euros.
Le présent amendement a pour objet de financer le doublement de ce produit par la baisse des crédits affectés au programme 755, « Désendettement de l’État ».

L’amendement n° II-612 rectifié ter, présenté par M. Raison, Mme Vullien, MM. Bas, Milon et Perrin, Mme Estrosi Sassone, MM. Dallier, Longuet, Husson, Vaspart, Cornu, Rapin, Pointereau et Darnaud, Mme Micouleau, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Louault et Maurey, Mme Deromedi, MM. Sido et Longeot, Mme Morhet-Richaud, M. Pellevat, Mme Garriaud-Maylam, MM. Chaize et Reichardt, Mmes Procaccia, Di Folco, Puissat et Gruny, M. Kern, Mme M. Mercier, M. Joyandet, Mmes Deseyne et Lassarade, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Goy-Chavent et Canayer, MM. Courtial, Revet et Piednoir, Mmes A.M. Bertrand, Imbert, Chain-Larché et Chauvin, MM. Morisset et Regnard, Mme Sollogoub, MM. Lefèvre, Vogel, Bonhomme, Dufaut, Chatillon, Détraigne, Savary, Moga, Luche et Chevrollier, Mme Férat, MM. Gremillet, Pierre, Mizzon et Huré, Mmes Bories et de Cidrac, MM. Genest et Priou, Mme C. Fournier, MM. B. Fournier et de Nicolaÿ, Mme Duranton, M. Mayet et Mmes Malet et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Structures et dispositifs de sécurité routière
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. François Bonhomme.

Le présent amendement tend à s’inscrire dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial du 18 avril 2018 intitulé Sécurité routière : mieux cibler pour plus d ’ efficacité.
Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 kilomètres à l’heure la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail à l’origine de ce rapport recommandait d’appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l’adapter aux réalités des territoires, c’est-à-dire sur les tronçons de route accidentogènes. Il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et, surtout, empreinte d’une acceptabilité sociale. Malheureusement, cette recommandation du Sénat n’a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.
Si les effets de la réduction de la vitesse ne sont aujourd’hui pas encore scientifiquement exploitables, le niveau d’acceptabilité de la mesure reste, lui, très insatisfaisant : une majorité de Français y voit toujours un prétexte de l’exécutif, et parfois une occasion sournoise, pour financer le désendettement de l’État.
Afin de lever ces soupçons et surtout de diminuer le nombre de morts sur les routes, les auteurs de l’amendement proposent donc de consacrer les recettes des « amendes radars » à l’amélioration du réseau routier et de ses zones les plus accidentogènes. Cela permettra de favoriser les politiques de prévention, conformément aux souhaits exprimés tant par le Gouvernement que par les usagers de la route et les associations de prévention de la sécurité routière.
L’amendement vise donc à transférer les crédits de l’action n° 01 du programme « Désendettement de l’État » vers l’action n° 01 du programme « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».

L’amendement n° II-610 rectifié ter, présenté par M. Raison, Mme Vullien, MM. Bas et Milon, Mme Estrosi Sassone, MM. Perrin, Vaspart, Husson, Dallier, Longuet, Pointereau, Darnaud et Maurey, Mme Duranton, MM. Mayet, Cornu et Rapin, Mme Micouleau, M. Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, M. Louault, Mmes Garriaud-Maylam et Morhet-Richaud, MM. Longeot et Sido, Mme Deromedi, MM. Pellevat, Chaize et Reichardt, Mmes Procaccia, Di Folco, Puissat et Gruny, M. Kern, Mme M. Mercier, M. Joyandet, Mmes Deseyne et Lassarade, M. Charon, Mmes Goy-Chavent et Canayer, MM. Courtial et Revet, Mme A.M. Bertrand, M. Piednoir, Mmes Imbert, Chain-Larché et Chauvin, MM. Morisset et Regnard, Mme Sollogoub, MM. Lefèvre, Vogel, Bonhomme, Dufaut, Chatillon, Détraigne, Savary, Moga, Luche et Chevrollier, Mme Férat, MM. Gremillet et Priou, Mme C. Fournier, MM. B. Fournier, de Nicolaÿ, Mizzon, Pierre et Huré, Mmes Bories et de Cidrac, M. Genest et Mmes Malet et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
Modifier ainsi les crédits des programmes :
En euros

Programmes
Autorisations d’engagement
Crédits de paiement
Structures et dispositifs de sécurité routière
Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers
Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières
Désendettement de l’État
TOTAL
SOLDE
La parole est à M. François Bonhomme.

L’amendement n° 612 rectifié ter vise à supprimer complètement ce qui est fléché en direction du budget de l’État, c’est-à-dire à transférer la totalité des 452 millions d’euros consacrés au programme « Désendettement de l’État » vers le programme « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ».
Je puis comprendre l’intention des auteurs de l’amendement, mais ils ont mis la barre relativement haute ! Sans vouloir critiquer celui d’entre eux qui a fait un excellent travail dans le cadre du groupe de travail sur la sécurité routière, je pense que cette proposition n’est pas raisonnable.
De toute façon, cet amendement n’est pas compatible avec celui de la commission, lequel procède d’une application obligatoire de ce que nous avons voté en première partie. Il sera donc sans objet en cas d’adoption de l’amendement n° II-971.
L’avis de la commission sur l’amendement n° 612 rectifié ter est donc défavorable.
L’amendement de repli n° II-610 rectifié ter vise à transférer 50 millions d’euros vers le programme « Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières ». Il est pratiquement satisfait, puisque 45 millions d’euros sont prélevés au profit d’une collectivité locale particulière, le département, lequel ne bénéficie pas de la dépénalisation et de la décentralisation du stationnement payant.
J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Le Gouvernement, par la voix du secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics, a émis un avis défavorable sur l’amendement n° II-971, visant à créer un prélèvement sur recettes destiné à l’entretien de la voirie départementale.
La création d’un tel prélèvement n’est pas justifiée, dès lors que d’autres dispositifs existent. Je rappelle ainsi qu’une compensation des charges d’entretien a déjà été assurée lors du transfert de la voirie au département.
Il existe par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, le principe de l’éligibilité au Fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA, pour les charges d’entretien de la voirie.
De plus, le financement des dépenses liées à la circulation routière peut s’effectuer, pour partie, grâce au produit des amendes de police relatives à la circulation routière reversées aux collectivités, soit 478 millions d’euros en 2019.
Parmi les autres dispositifs de soutien aux départements, il y a enfin la dotation de soutien à l’investissement des départements, instituée par ce projet de loi de finances et dotée de 296 millions d’euros, à laquelle les projets de voirie sont éligibles.
L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur l’amendement n° II-971.
S’agissant de l’amendement n° II-612 rectifié ter, les règles de répartition des amendes issues de la police de la circulation sont fixées par l’article 49 de la loi de finances initiale pour 2006. Ces dispositions étant relatives à des recettes de l’État, leur modification ne peut donc intervenir que par la voie d’amendements déposés en première partie de la loi de finances.
En outre, les règles de répartition du produit des amendes de police obéissent à un équilibre soigneusement pesé entre divers objectifs. Depuis 2006, aucun gouvernement n’a cru bon de devoir modifier cet équilibre, ce qui signifie qu’il est bien adapté. L’actuel gouvernement ne souhaitant pas plus que les précédents modifier cet équilibre, l’avis est défavorable.
Sur la limitation de la vitesse à 80 kilomètres à l’heure, je veux rappeler que ce dispositif est en cours d’expérimentation. Comme cela avait été annoncé au moment de la présentation de cette mesure, le passage de 90 à 80 kilomètres à l’heure a un impact en termes d’accidentabilité.
Notre objectif, je le répète, est d’étudier avec beaucoup d’objectivité et de précision l’impact sur l’accidentabilité de la mesure de réduction de la vitesse maximale autorisée sur le réseau national secondaire, en vue de la clause de rendez- vous fixée au 1er juillet 2020.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur les amendements n° II-612 rectifié ter et II- 610 rectifié ter.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, l’amendement n° II-612 rectifié ter n’a plus d’objet.
Monsieur Bonhomme, l’amendement n° II-610 rectifié ter est-il maintenu ?

L’amendement n° II-610 rectifié ter est retiré.
Nous allons procéder au vote des crédits du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers », figurant à l’état D.
Je n’ai été saisi d’aucune demande d’explication de vote avant l’expiration du délai limite.
Je mets aux voix ces crédits, modifiés.
Les crédits sont adoptés.

J’appelle en discussion les amendements tendant à insérer un article additionnel qui sont rattachés pour leur examen au compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-613 rectifié ter, présenté par M. Raison, Mme Vullien, MM. Bas, Perrin, Milon, Husson, Pointereau, Longuet et Rapin, Mme Estrosi Sassone, MM. Darnaud et Dallier, Mme Micouleau, MM. Vaspart et Cornu, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Louault et Maurey, Mme Deromedi, MM. Sido et Longeot, Mmes Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Pellevat, Chaize et Reichardt, Mmes Procaccia, Di Folco, Puissat et Gruny, M. Kern, Mme M. Mercier, M. Joyandet, Mmes Deseyne et Lassarade, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Goy-Chavent et Canayer, MM. Courtial, Revet et Piednoir, Mmes A.M. Bertrand, Imbert, Chain-Larché et Chauvin, MM. Morisset et Regnard, Mme Sollogoub, MM. Lefèvre, Vogel, Bonhomme, Dufaut, Chatillon, Détraigne, Savary, Moga, Luche et Chevrollier, Mme Férat, MM. Gremillet, Pierre, Huré et Mizzon, Mmes de Cidrac, Bories et Malet, MM. Genest et Priou, Mme C. Fournier, MM. B. Fournier et de Nicolaÿ, Mme Duranton, M. Mayet et Mme Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
A. Après l’article 84 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du quinzième alinéa est supprimée ;
2° Les seizième et dix-neuvième alinéas sont supprimés ;
3° La première phrase du dix-septième alinéa est supprimée.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
La parole est à M. François Bonhomme.

L’amendement n° II-611 rectifié ter, présenté par M. Raison, Mme Vullien, MM. Bas, Milon et Perrin, Mmes Estrosi Sassone et Micouleau, MM. Dallier, Pointereau, Rapin, Husson, Longuet, Vaspart, Cornu et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Louault et Maurey, Mme Deromedi, M. Sido, Mme Garriaud-Maylam, M. Longeot, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Chaize et Reichardt, Mmes Procaccia, Puissat, Di Folco et Gruny, M. Kern, Mme M. Mercier, M. Joyandet, Mmes Deseyne et Lassarade, MM. Charon et D. Laurent, Mmes Goy-Chavent et Canayer, MM. Courtial, Revet et Piednoir, Mmes A.M. Bertrand, Imbert et Chain-Larché, M. Morisset, Mme Chauvin, M. Regnard, Mme Sollogoub, MM. Lefèvre, Vogel, Bonhomme, Dufaut, Chatillon, Détraigne, Savary, Moga, Luche et Chevrollier, Mme Férat, MM. Mizzon, Gremillet, Pierre et Huré, Mme Bories, MM. Genest, Priou et Darnaud, Mme C. Fournier, MM. B. Fournier et de Nicolaÿ, Mmes Duranton et Malet, M. Mayet et Mmes de Cidrac et Lanfranchi Dorgal, est ainsi libellé :
A. Après l’article 84 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la troisième phrase du dix-neuvième alinéa de l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2019, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi de finances initiale pour 2017. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
La parole est à M. François Bonhomme.

Ces deux amendements sont en réalité satisfaits par l’amendement précédemment adopté.
L’avis de la commission est donc défavorable.

Monsieur Bonhomme, les amendements n° II-613 rectifié ter et II-611 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Les amendements n° II-613 rectifié ter et II-611 rectifié ter sont retirés.
Mes chers collègues, nous avons achevé l’examen des crédits de la mission « Sécurités » et du compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 7 décembre 2018, à neuf heures trente, quatorze heures trente et le soir :
Suite du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (n° 146, 2018-2019) ;
- Relations avec les collectivités territoriales (+ articles 79 à 81 ter)
- Compte spécial : Avances aux collectivités territoriales ;
- Discussion des missions et des articles rattachés reportés ;
- Discussion des articles de la seconde partie non rattachés aux crédits.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 7 décembre 2018, à zéro heure trente.