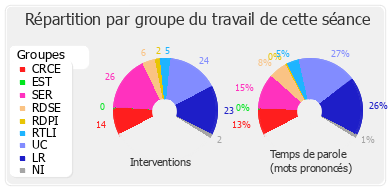Séance en hémicycle du 8 octobre 2019 à 14h30
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Éloge funèbre de philippe madrelle sénateur de la gironde (voir le dossier)
- Hommage aux victimes d'une attaque à la préfecture de police de paris
- Modification de l'ordre du jour (voir le dossier)
- Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique (voir le dossier)
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.

Le compte rendu intégral de la séance du jeudi 3 octobre 2019 a été publié sur le site internet du Sénat.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté.

M. le président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, madame, c’est – souvenons-nous – avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris, le 27 août dernier, la disparition du doyen de notre assemblée.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que M. le ministre auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, et M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, se lèvent.

Philippe Madrelle nous a quittés au terme d’un combat contre la maladie qu’il menait courageusement, en poursuivant ses activités. Nous avons encore tous en mémoire – c’était au cours de la première session extraordinaire de cet été – l’intervention qu’il avait tenu à faire lors d’une séance de questions d’actualité au Gouvernement.
Présent à ses obsèques, le 2 septembre, en l’église Notre-Dame de Bordeaux, je lui ai rendu un premier hommage, au nom du Sénat tout entier, lors de cette cérémonie d’adieu à laquelle assistaient un millier d’habitants de la Gironde et de nombreuses personnalités politiques, dont le président de son groupe, le groupe socialiste et républicain, Patrick Kanner.
Figure emblématique du département de la Gironde, Philippe Madrelle voua sa vie entière à un engagement inlassable au service de ses compatriotes et de l’intérêt général. Ses grandes facultés d’écoute et d’empathie, son humanisme, son indéfectible esprit de justice, de solidarité et de fraternité étaient unanimement salués et suscitaient le respect de tous.
Profondément ancré dans son territoire – oui, « son » territoire ! –, il exerça avec une longévité exceptionnelle, et sans doute inégalée, ses mandats locaux et nationaux. Il fut maire de Carbon-Blanc pendant un quart de siècle, de 1976 à 2001. La confiance des électeurs du canton de Carbon-Blanc, jamais démentie, renouvelée à sept reprises, lui permit de siéger sans discontinuité quarante-sept années durant au sein de l’assemblée départementale. Il présida aux destinées du département de la Gironde pendant trente-six ans, jusqu’en 2015, avec une brève interruption de 1985 à 1988. Élu pour la première fois au Sénat en 1980, après douze ans de mandat de député, et ensuite réélu sénateur à quatre reprises, il siégea pendant près de trente-neuf ans dans notre hémicycle.
Comme il en convenait lui-même en prenant la parole devant le Sénat, à cette place même, comme doyen d’âge en 2017, « sans doute ne sera-t-il plus possible, à l’avenir, de s’exprimer avec le recul de cinquante années de vie parlementaire ». Et pourtant, ce recul n’est pas inutile, me semble-t-il, à notre vie démocratique…
Philippe Madrelle était né le 21 avril 1937 à Saint-Seurin-de-Cursac, petite commune du Blayais dans le nord de la Gironde, là même où il repose aujourd’hui.
Il fut immergé dans la vie politique dès son plus jeune âge. Son père, contrôleur des contributions, était aussi un militant SFIO et un élu local, conseiller municipal, puis maire de la commune.
Le sport occupa une place importante dans sa jeunesse. Coureur de fond, il fut plusieurs fois champion universitaire de 400 mètres. Ainsi qu’il le déclara plus tard, cette dure école du sport lui donna des leçons de courage, d’endurance, d’humilité et de loyauté.
Titulaire d’un baccalauréat de philosophie et d’un certificat d’études littéraires générales de la faculté de Bordeaux, il débuta dans la vie professionnelle comme instituteur dans un village, puis comme professeur d’anglais.
Mais Philippe Madrelle fut très tôt attiré par la vie politique, où l’entraînèrent tant ses inclinations personnelles que cette solide tradition de militantisme familial. Son père déclarait pourtant qu’il l’avait plutôt poussé vers l’enseignement, car « la politique, c’est instable. Mieux vaut avoir un métier ».
Sourires.

Dès 1965, à l’âge de 28 ans, Philippe Madrelle fut élu conseiller municipal d’Ambarès. Deux ans plus tard, il devint le suppléant du député René Cassagne. Cet ami de son père, autre grande figure du socialisme girondin, fut, selon ses propres dires, « l’inspirateur de toute [sa] carrière ».
Philippe Madrelle lui succéda à l’Assemblée nationale en 1968. À l’âge de 31 ans, il fut alors le plus jeune député de France et le benjamin du groupe socialiste. Il ne savait pas encore que le destin le conduirait, cinquante années plus tard, à devenir le doyen du Sénat.
Il fut successivement conseiller général en 1969, adjoint au maire de Carbon-Blanc en 1971, puis, comme je l’ai évoqué, maire de cette commune.
Quelques mois après son élection comme maire, il devint, à 39 ans, le plus jeune président de conseil général de France.
Il s’investit avec passion dans cette fonction. Il s’attacha sans relâche à favoriser le développement de son département – un développement, je souhaite le préciser car c’est un point auquel il tenait par-dessus tout et dont il m’avait entretenu, équilibré entre espace urbain et monde rural, entre la métropole bordelaise et les autres composantes du plus vaste département de France métropolitaine.
Pour ce faire, il dota l’assemblée départementale d’instruments d’action novateurs, comme le fonds départemental d’aide à l’équipement des communes. Il mit également en place des contrats de développement social, urbain et rural, pour soutenir tant les quartiers sensibles que les zones rurales fragilisées.
En 1980, il fit donc son entrée au Sénat. Expliquant son choix de quitter l’Assemblée nationale pour rejoindre notre assemblée, il déclarait alors que sa fonction de président de conseil général l’orientait tout naturellement vers la chambre représentant les collectivités territoriales.
En 1981, il succéda à André Labarrère comme président du conseil régional d’Aquitaine. Pendant quelques années, il fut à la fois sénateur, président de conseil général et président de conseil régional !
Murmures amusés dans l ’ assemblée.

C’est une frange de l’histoire qui passe, avec cet hommage que nous rendons, aujourd’hui, dans cet hémicycle, à notre collègue Philippe Madrelle !
À un journaliste du Monde, qui l’avait interpellé sur le cumul de ces lourdes responsabilités, il avait rétorqué qu’il serait prêt à donner l’exemple en cas de vote d’une loi limitant le cumul des mandats, tout en faisant observer que « la carte de visite est imprimée par le [seul] suffrage universel ».
Sourires.

Au Sénat, Philippe Madrelle choisit de siéger à la commission des affaires étrangères et de la défense, dont il fut membre pendant plus de vingt ans avant de rejoindre la commission de la culture en 2011, puis la commission de l’aménagement du territoire en 2014. C’est donc tout naturellement qu’il prenait régulièrement part aux débats sur les questions de politique étrangère ou de défense.
Il avait gardé de sa jeunesse un intérêt particulier pour le milieu sportif et avait à cœur d’intervenir, presque chaque année, sur le budget de la jeunesse et des sports.
Il profitait également, le plus souvent possible, des séances de questions orales pour défendre les intérêts de son cher département de la Gironde sur des questions qui lui tenaient à cœur.
Philippe Madrelle fut un acteur majeur de la décentralisation en Gironde. Décentralisateur acharné, il était, dans tous les sens du terme, un « Girondin ». Dès 1980, il déclarait croire profondément en l’avenir de la décentralisation, « cette réforme essentielle pour l’avenir démocratique de notre pays ». Aussi s’engagea-t-il avec conviction en faveur des lois de décentralisation initiées par le président Mitterrand et Gaston Defferre.
Il fut en même temps, tout au long de sa carrière politique, un défenseur du monde rural et des collectivités territoriales, tout particulièrement du binôme département-communes. Son épouse me disait combien la rencontre avec les maires, jusqu’au dernier instant, était pour lui un moment où il nourrissait son action.
En 1998, il écrivait dans une tribune libre publiée dans Le Figaro : « Comment imaginer de renoncer à l’inestimable atout de proximité que constitue le couple département-communes ? » Il considérait ces collectivités comme des « socles de notre démocratie ».
En 2002, il défendait, cette fois dans le journal Sud-Ouest, l’avenir du département comme « territoire de référence et d’appartenance » et « collectivité de solidarité ».
En 2014, au cours de la campagne pour les élections sénatoriales, il dénonçait, transgressant même le périmètre établi par sa propre formation politique, la réforme territoriale en cours comme portant atteinte à ce binôme département-communes, qui avait permis – je reprends ses mots – de « mettre fin à des siècles de féodalité ».
Philippe Madrelle avait pressenti, avant tout autre, le péril mortel que ferait courir à notre démocratie une fracture territoriale qui ne cesse, depuis des années, de s’élargir. Souvenons-nous de son allocution de président d’âge en 2017 : « nous avons tous conscience qu’il y a urgence à prendre en compte la lassitude et les attentes des élus locaux, qui animent dans la proximité les cellules de base de la République et de notre démocratie représentative ».
Sa carrière de parlementaire et d’élu local l’avait également convaincu, depuis longtemps, de la nécessité d’une seconde chambre, assurant la représentation de la Nation selon une approche fondée sur les territoires, et ce même s’il pensait que le Sénat devait sans cesse s’adapter et se moderniser.
Je reviens une fois de plus à l’allocution qu’il fit, en qualité de doyen d’âge, en 2017. Il avait tenu à se référer, en tant que Girondin, à Montesquieu, pour qui le bicamérisme était une condition essentielle de l’équilibre des pouvoirs. Il avait également rappelé que le bicamérisme était « la marque des régimes démocratiques ». Selon ses propres mots, le Sénat, loin d’être l’assemblée conservatrice parfois décrite par ses détracteurs, était l’assemblée de l’approfondissement du travail législatif, « un lieu de travail serein et sincère, dont la valeur essentielle est le respect : respect des principes de la République, respect du Gouvernement, respect du pluralisme et de la diversité idéologique, et surtout respect des collègues et de leurs expressions ou opinions, en toutes circonstances ». Ces mots, je crois, sont la meilleure présentation du Sénat.
Soucieux de la préservation et de la transmission de la mémoire de l’action des sénateurs, Philippe Madrelle a tenu à déposer au Sénat, au début de cette année, son fonds d’archives privées liées à l’exercice de son mandat sénatorial.
L’hommage que nous lui rendons aujourd’hui n’est pas uniquement solennel ; il est aussi affectif. C’est un hommage à un parlementaire estimé, un humaniste. C’est un hommage à un défenseur inlassable de la ruralité et des collectivités territoriales, un acteur majeur de la décentralisation et de l’aménagement du territoire, un partisan du bicamérisme, et notre doyen – ce qui a un sens pour chacun d’entre nous, quel que soit le groupe dans lequel nous siégeons.
À ses anciens collègues des commissions des affaires étrangères, de la culture et de l’aménagement du territoire, à ses amis du groupe socialiste et républicain, j’exprime toute notre sympathie.
À son épouse, à ses enfants, à toute sa famille et à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite redire la part que le Sénat prend à leur chagrin.
Philippe Madrelle, nous ne l’oublierons pas comme ça, comme le temps qui passe !
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, madame, nous sommes aujourd’hui réunis pour honorer la mémoire du sénateur Philippe Madrelle. En tant que ministre chargé des relations avec le Parlement, j’ai témoigné, lors de ses funérailles à Bordeaux, au nom du Gouvernement, de la reconnaissance de la République à l’un de ses plus fidèles serviteurs.
Philippe Madrelle aura connu un parcours politique exceptionnel. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, lui-même indiquait, lors du discours qu’il prononça comme doyen d’âge du Sénat, à l’ouverture de la séance ayant suivi le dernier renouvellement de la Haute Assemblée, en 2017, que des parcours comme le sien ne seraient bientôt plus possibles.
Il aura en effet exercé les mandats de sénateur, député, maire de Carbon-Blanc, président du conseil général de la Gironde et président du conseil régional d’Aquitaine. C’est une vie entière consacrée à la politique et au bien commun !
Cet engagement tient sans doute à un atavisme paternel. C’est son père Jacques, adhérent de la SFIO et lui-même maire, qui l’éveillera à la politique et au militantisme.
Mais il y a une dimension personnelle dans ce parcours hors du commun : Philippe Madrelle aimait la politique dans le sens le plus noble du terme, parce qu’il aimait les gens et ne répugnait pas non plus au combat politique – on peut même dire qu’il en avait le goût. « Seule la victoire a un intérêt », avait-il confié à son biographe dans la perspective de la publication d’un ouvrage retraçant son parcours.
Cette ardeur au combat politique n’était peut-être pas étrangère à son goût pour la compétition sportive, qu’il pratiqua dès son plus jeune âge, remportant, année après année, le cross de l’école primaire avant de devenir le champion de 400 mètres que vous avez évoqué, monsieur le président.
Mais cet homme politique d’une redoutable pugnacité était aussi un homme chaleureux et sensible. L’un n’allait pas sans l’autre, et la longévité de son parcours illustre la confiance qu’il aura su inspirer à ses électeurs, pour lesquels il éprouvait un attachement sincère et réel. Il savait se montrer à l’écoute de chacun, avec une curiosité inépuisable et une profonde empathie.
Après ses premiers pas dans l’enseignement à Ambarès, il fut élu conseiller municipal SFIO en 1965, à l’âge de 28 ans, puis succéda à René Cassagne en qualité de suppléant, devenant à 32 ans le plus jeune député de France, du département le plus grand de France métropolitaine.
En 1967, il devient président du conseil général, fonction qu’il exercera, à l’exception d’une période de trois ans, entre 1985 et 1988, jusqu’en 2015.
Précurseur de la décentralisation, il crée en 1977 un fonds départemental d’aide à l’équipement des communes, qui constituera un instrument d’aménagement précieux au service d’une exigence de justice et d’équité territoriales. Seul le Lot de Maurice Faure et la Nièvre de François Mitterrand s’étaient alors dotés d’un instrument comparable.
Il manifesta ainsi précocement les qualités qui feront de lui le grand aménageur auquel les lois Defferre permettront de donner sa pleine mesure. « Pas de Gironde à deux vitesses », se plaisait-il à dire, et il mettra en place, au fil des années, les instruments permettant aux 535 communes de son territoire, qu’elles soient petites ou grandes, de se couvrir d’équipements structurants : places, salles polyvalentes, gymnases – tous ces lieux où se tissent les liens invisibles et indispensables qui font la cohésion sociale.
En 2017, dans son discours d’ouverture de la séance publique, il portait un regard rétrospectif sur son action et disait avoir découvert, dans ses fonctions d’élu local, « l’importance déterminante du rôle des politiques d’aménagement et de solidarité mises en place par des institutions de proximité comme le conseil départemental ».
À cette attention portée à l’équilibre territorial s’ajoutait un combat contre les inégalités. Philippe Madrelle s’investit tout particulièrement dans la politique de l’aide sociale à l’enfance, qui constitua l’un des axes de ses mandats de président de département et fut sa fierté, lui qui avait débuté sa carrière en tant qu’enseignant.
Son territoire, il en avait une intime connaissance, connaissance des lieux, du patrimoine – du plus grandiose au plus modeste –, des élus aussi. Hervé Gillé, qui lui succède, a confié à la presse ses souvenirs de la campagne électorale de 2014, et son admiration de voir Philippe Madrelle appeler par leurs nom et prénom tous les maires et les adjoints rencontrés à cette occasion. Évoquant son souvenir, votre collègue Françoise Cartron a pu déclarer facétieusement : « Pas besoin de GPS avec Philippe Madrelle : il connaît toutes les routes de Gironde ! »
C’est fort de cet enracinement local que Philippe Madrelle deviendra député, puis sénateur. Après avoir siégé à l’Assemblée nationale de 1968 à 1980, il entra au Sénat et fut réélu à cinq reprises. Il y siégera près de trente-neuf ans.
Ardent défenseur du bicamérisme, il voyait la Haute Assemblée, non seulement comme une « tribune » des territoires, pour reprendre le terme qu’il employait, mais aussi comme une institution essentielle à l’équilibre des pouvoirs, cher à Montesquieu, comme lui Girondin.
Philippe Madrelle avait une longue expérience, mais ne se laissait pas entraîner à la facilité d’une nostalgie stérile. Il constatait les modifications profondes d’exercice du mandat parlementaire, en particulier, et des mandats politiques, en général. Il appelait de ses vœux l’approfondissement du travail des assemblées, tout en souhaitant que le Sénat puisse continuer à relayer les préoccupations de toutes les collectivités territoriales.
Ce fut un homme qui suscita des vocations et forma des générations de jeunes élus talentueux et dévoués. Pour son territoire, pour la République, il eut la générosité de se projeter au-delà de lui-même. Il était conscient de la défiance manifestée par nos concitoyens envers nos institutions et ceux qui les incarnent, et appelait à la vigilance face à une lassitude des élus.
Le projet de loi que le Sénat s’apprête à examiner lui aurait sans doute donné l’occasion de débattre avec le Gouvernement des moyens de conforter ces hommes et ces femmes politiques sans lesquels la démocratie ne peut fonctionner.
Philippe Madrelle aura incarné une certaine génération d’hommes politiques, pour lesquels l’engagement était celui d’une vie. Fidèle à ses électeurs, fidèle à son parti, fidèle à son territoire, inlassable bâtisseur, il laisse un vide béant pour ses proches, pour son épouse, ses enfants, sa famille, ses collaborateurs, ses concitoyens, ses collègues du groupe socialiste et républicain, l’ensemble de ses collègues au Sénat. Je leur adresse à tous, au nom du Gouvernement et en mon nom personnel, mes condoléances attristées.

M. le président. Madame la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous invite maintenant à partager un moment de recueillement à la mémoire de notre doyen Philippe Madrelle.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme et MM. les ministres, observent une minute de silence.

M. le président. Madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, avant de suspendre la séance, conformément à notre tradition, en signe d’hommage à Philippe Madrelle, je vous propose maintenant d’avoir une pensée pour les quatre fonctionnaires de la préfecture de police de Paris, morts en service jeudi dernier et auxquels la Nation a rendu hommage ce matin.
Mmes et MM. les sénateurs, ainsi que Mme et MM. les ministres, observent une minute de silence.

Nous allons suspendre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à quinze heures, est reprise à quinze heures quinze.

Mes chers collègues, je vous indique que le Sénat sera appelé à se prononcer le jeudi 10 octobre, à dix heures trente, sur les conclusions de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relatives à la proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête afin d’évaluer l’intervention des services de l’État dans la gestion des conséquences environnementales, sanitaires et économiques de l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen.
Le délai limite pour le dépôt des amendements sur cette proposition de résolution est fixé à demain, mercredi 9 octobre, à dix-sept heures.
Avant le vote du texte, la parole sera accordée pour explication de vote à un représentant de chaque groupe pour une durée de deux minutes trente.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.

L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, modifié par lettre rectificative, relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (projet n° 677 rectifié [2018-2019], texte de la commission n° 13, rapport n° 12).
La procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées du groupe UC.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, État et collectivités ont la République en partage. Les élus locaux, au premier rang desquels les maires, sont au plus près des citoyens, de leurs demandes, encouragements ou récriminations.
Dans tous mes déplacements, je constate la volonté inébranlable de femmes et d’hommes portés par la fierté d’agir au quotidien pour leurs habitants. Ils conduisent leur mandat avec un engagement sans limite.
Lors des consultations menées dans le cadre du grand débat national, les maires ont pu témoigner de cet engagement. Ils ont également confié leurs attentes et leurs aspirations. Ces attentes, je les comprends au regard de la complexité de la tâche à accomplir et de leur farouche volonté d’apporter à nos concitoyens les meilleures réponses à leurs problèmes du quotidien.
Le projet de loi dont votre assemblée entame l’examen est une première réponse concrète. Il est porté par Sébastien Lecornu, qui a mené une large concertation, tant avec les élus locaux qu’avec les parlementaires.
Ce texte propose deux leviers majeurs. D’une part, il redonne des libertés locales, afin que les élus retrouvent des capacités d’action et que les décisions se rapprochent du terrain, en proposant une meilleure articulation entre communes et intercommunalités. D’autre part, il lève certains freins à l’engagement et au réengagement des élus locaux dans la perspective des prochaines élections municipales.
Les propositions de ce texte sont résolument pragmatiques : elles visent à donner plus de souplesse et à remettre de la proximité dans l’exercice des politiques publiques.
Ces actions sont très attendues au sein des territoires. Elles s’inscrivent dans la droite ligne de la mission que je mène à la tête de mon ministère : relever le défi de la cohésion des territoires.
À cette fin, nous avons renouvelé notre cadre d’action publique. Nous partons des besoins, des modes de vie locaux, pour proposer un accompagnement sur mesure des projets de territoire à travers les programmes d’appui. Nous travaillons en partenariat avec les collectivités territoriales pour revitaliser les centres-villes, promouvoir le retour de l’industrie dans nos campagnes, conforter le lien social et l’emploi dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, ou encore assurer le déploiement du service public. De manière générale, nous voulons que chacun de nos concitoyens dispose des mêmes chances et des mêmes possibilités, quel que soit l’endroit où il habite.
L’État devient facilitateur, accompagnateur des élus locaux, au lieu de se conduire en prescripteur. C’est ainsi que nous avons conçu l’agenda rural, que le Premier ministre et moi-même avons présenté au congrès des maires ruraux, le 20 septembre dernier à Eppe-Sauvage, dans le département du Nord. D’ailleurs, nombre de mesures inscrites dans le projet de loi que nous vous présentons aujourd’hui sont la traduction de mesures proposées dans cet agenda rural.
C’est cette même philosophie qui guide les travaux préalables au prochain acte de décentralisation et de différenciation ; ce nouveau texte, appelé désormais « 3D » – décentraliser, différencier, déconcentrer –, vise plus largement à incarner les nouvelles relations entre l’État et les collectivités. Il permettra de développer une boîte à outils pour adapter notre action commune aux réalités locales. Il sera le réceptacle pour envisager de potentiels transferts de compétences entre l’État et les collectivités ou entre les collectivités elles-mêmes. Il sera également le réceptacle des mesures qui permettront, demain, d’assouplir la procédure d’expérimentation.
Mesdames, messieurs les sénateurs, avant de céder la parole à Sébastien Lecornu, je tiens à vous le dire une nouvelle fois : l’État et les collectivités – j’en ai la conviction – ont destin lié pour dessiner l’avenir de nos territoires. La cohésion des territoires, objectif qui nous réunit, c’est le pari d’une France conquérante, parce qu’elle est attractive. Nous ne relèverons ce pari qu’en faisant alliance avec les collectivités territoriales, qui ont fait la démonstration de leur pleine maturité.
Je n’en doute pas : le Sénat, dans sa grande sagesse, mettra tout en œuvre pour renforcer ces libertés et responsabilités locales, comme il l’a encore signifié récemment.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Ces enjeux sont tellement importants pour l’avenir de nos territoires qu’il nous faut y travailler collectivement, et de façon constructive !
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées des groupes UC, Les Républicains, RDSE et Les Indépendants.
Monsieur le président du Sénat, monsieur le président de la commission des lois, madame, monsieur les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, Jacqueline Gourault vient de le rappeler : la question territoriale a déjà fait l’objet de nombreux actes législatifs. Je pense évidemment à la proposition de loi de Mme Gatel relative aux communes nouvelles, …
… texte que nous avons su examiner collectivement il y a de cela quelques mois.
En la matière, d’autres textes sont à venir : le présent projet de loi, que je vais vous présenter succinctement dans un instant, le projet de loi de finances pour 2020 et, bien entendu, le projet de loi de décentralisation auquel Mme la ministre a fait référence.
Monsieur le président du Sénat, il y a maintenant quelques mois, je m’étais engagé auprès de vous à changer de méthodologie dans la construction du présent texte. Ainsi, nous avons mené des consultations directes avec les associations d’élus – nous en avons désormais l’habitude et, à ce titre, je n’oublie pas les 96 heures de débats entre le Président de la République et les maires de France, pendant le grand débat national…
M. Philippe Dallier s ’ exclame.
Monsieur Dallier, 96 heures de débats, cela s’entend, cela s’écoute…
Sourires sur des travées du groupe Les Républicains.
D’ailleurs, à cette occasion, un certain nombre de maires de Seine-Saint-Denis sont venus à la rencontre du Président de la République.
Monsieur le président du Sénat, je me suis également engagé auprès de vous à mener la meilleure coproduction possible avec la Haute Assemblée. Avec votre accord, avec votre concours, nous nous sommes donc inspirés de nombreux travaux du Sénat, qu’il s’agisse de propositions de loi passées – je pense aux textes élaborés par Alain Marc et par Mathieu Darnaud – ou des recommandations formulées par la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, présidée par Jean-Marie Bockel. De plus, nous avons rencontré l’ensemble des présidents de groupe afin de faire converger toutes les sensibilités ici représentées vers un texte pragmatique.
Or, en la matière, la seule manière d’être pragmatique, c’est de répondre aux attentes des 600 000 élus locaux que dénombre notre pays.
En résumé, nous devons répondre à trois sentiments, qu’expriment nos collègues maires, adjoints au maire et conseillers municipaux : le présent texte traite essentiellement du bloc communal, et le projet de loi de Jacqueline Gourault sera, quant à lui, consacré davantage aux questions départementales et régionales.
Le premier sentiment est, sans nul doute, celui de la complexité : il est plus difficile d’être maire ou adjoint au maire aujourd’hui qu’il y a quinze, vingt ou trente ans.
Mme Brigitte Micouleau opine.
Bien souvent, nos collègues élus locaux expriment ce sentiment avec beaucoup de force, et ils s’adressent à nous, membres du Gouvernement, députés et sénateurs : les normes dont il s’agit traduisent parfois une pression sociétale, exercée par nos concitoyens.
Bien souvent, la simplification, c’est compliqué. Les quelque mille amendements déposés sur ce texte en témoignent : il existe une forte volonté normative de garantir une égalité territoriale pour l’ensemble du pays. Bien souvent, nous faisons de grands discours pour parler de liberté ; mais, très vite, cette autre valeur républicaine essentielle qu’est l’égalité vient concurrencer la liberté. N’est pas tocquevillien qui veut, monsieur le président de la commission des lois !
Aussi, nous vous adressons un certain nombre de propositions qui, grâce à la discussion parlementaire, pourront sans doute aller beaucoup plus loin.
Nous proposons un certain nombre de dérogations, notamment un dispositif opérationnel en faveur du patrimoine en danger ; nous traitons de l’organisation des délégations entre élus au sein des collectivités territoriales ; du rapprochement entre différentes collectivités ; de certaines obligations qui, n’étant pas tout à fait nécessaires, pourraient céder la place à des dispositions facultatives – je m’attends déjà à un débat nourri quant à la faculté, pour les conseillers communautaires, d’instituer ou non un conseil de développement.
Nous défendons également plusieurs innovations territoriales : je pense par exemple au médiateur territorial, dont le groupe du RDSE a suggéré la création via une proposition de loi. Nous devons encore avancer dans l’écriture de ces dispositions ; mais ces dernières présentent un intérêt certain. Plus largement, le débat et la navette parlementaires vont permettre, j’en suis persuadé, d’enrichir ces différents dispositifs.
Le deuxième sentiment que nous avons entendu et que nous entendons, de la part des élus locaux, lorsque nous nous rendons dans nos territoires, c’est celui de la dépossession.
Monsieur le président du Sénat, vous le dites souvent : « Les maires sont à portée d’engueulade. » Encore faut-il qu’ils se fassent « engueuler » pour ce qu’ils ont vraiment décidé, et non pour des mesures prises à d’autres endroits, à d’autres niveaux ! Naturellement, c’est toute la question de la relation entre la commune et son intercommunalité.
L’intercommunalité a été un outil populaire chez les élus locaux. Malheureusement, certaines dispositions de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, sont venues créer des « irritants » – je revendique la paternité de ce mot ! §Petit à petit, elles ont conduit à organiser une concurrence au sein du bloc communal. Sans cesse plus intégrés, toujours plus grands, les établissements publics de coopération intercommunale finissent par oublier que c’est le maire qui doit être au cœur de l’intercommunalité, et pour cause : l’EPCI est non pas une collectivité territoriale, mais un établissement public au service des communes.
Il s’agit donc, en suivant ce chemin de crête, de continuer à défendre l’intercommunalité. En cette année 2019, nous fêtons les vingt ans des lois Chevènement, mais nous ne devons pas occulter les différentes irritations et incompréhensions que nous entendons sur le terrain, autour du triptyque bien connu : gouvernance – à ce sujet, nous nous inspirerons des travaux du Sénat, en particulier de la proposition de loi d’Alain Marc, que je salue –, compétences – je n’ignore pas que la question de l’eau et de l’assainissement devient également politique : nous devons la traiter avec beaucoup de calme et de pragmatisme – et périmètres.
Au sujet des périmètres, les élus municipaux de la mandature 2014-2020 ont connu d’immenses bouleversements ! Pour notre part, nous voulons proposer des outils pour corriger, sans pour autant sacrifier les élus en exercice entre 2020 et 2026, car nos collègues demandent des corrections et, en aucun cas, un grand soir.
Le troisième sentiment entendu sur le terrain est plus terrible, plus redoutable : c’est le besoin de protection, qui soulève plusieurs enjeux, à commencer par l’engagement. Les élus s’interrogent : « Pourquoi m’engager ? Pourquoi donner du temps à la cité ? » Bien souvent, ils accomplissent leur mission bénévolement : l’essentiel des élus municipaux de notre pays ne perçoivent aucune indemnité.
Tout à fait monsieur Husson, et j’ajoute que la question de l’engagement ne se pose pas seulement pour les élus municipaux. Est-il plus compliqué, aujourd’hui qu’il y a vingt ans, de trouver des sapeurs-pompiers volontaires ? La réponse est oui. Est-il plus difficile, aujourd’hui qu’il y a vingt ans, de recruter des réservistes dans les armées ou dans la gendarmerie ? La réponse est oui. Est-il plus difficile, aujourd’hui qu’il y a vingt ans, de trouver des bénévoles pour faire vivre nos associations ? La réponse est oui.
L’engagement local, l’engagement municipal n’échappent pas à cette évolution. Nous devons aborder la question aussi sereinement que possible, et avec beaucoup d’humilité. Face à ce mouvement de décomposition très lent que connaît notre société, il n’y aura peut-être pas de solution miracle. Mais collectivement, avec beaucoup de pragmatisme, nous pouvons redonner envie, en mettant de nouveau en lumière la beauté de l’engagement, du don de soi pour la République, et notamment pour la démocratie locale – nous y reviendrons.
Il s’agit de traduire ces ambitions par des mesures concrètes. D’aucuns parlent de statut de l’élu. Toutefois, sur le terrain, certains n’apprécient pas ce terme. Ils nous disent : « Je ne veux pas un statut, mais un cadre pour m’engager. Je ne veux pas être le salarié, l’agent de ma commune, je veux en être l’élu. »
Je vous propose donc tout simplement une série de mesures pragmatiques et calmes, concernant, notamment, la question des indemnités. Je tiens à saluer sincèrement, madame Gatel et monsieur Darnaud, votre prise de position sur ce point. Je dois vous avouer que j’ai écrit à beaucoup d’associations d’élus à ce propos, et que certaines d’entre elles, pourtant éminentes, n’ont toujours pas pris la peine de répondre au Gouvernement pour se positionner sur la proposition gouvernementale ou sur celle de la commission des lois.
Je salue le Sénat, singulièrement sa commission des lois, qui a pris cette question à bras-le-corps. On sait que la vérité n’est pas évidente à identifier en la matière dans notre pays, mais je crois que nous avançons et je tiens à m’en réjouir.
La question de la formation est évidemment importante. Aujourd’hui, un élu départemental, régional, d’une grande métropole ou d’une grande ville, a facilement accès au budget qui y est consacré, mais nous devons aller plus loin s’agissant de formation des élus ruraux, même si Jacqueline Gourault, lorsqu’elle siégeait parmi vous, a fait avancer les choses avec le DIF, le droit individuel à la formation.
En ce qui concerne les frais d’accompagnement pour celles et ceux qui sont chargés de famille ou de personnes en situation de handicap, nous devons comprendre que nous ne sommes pas égaux : on ne peut pas s’absenter si facilement pour un conseil municipal ou pour une commission municipale lorsque l’on est dans cette situation. Sur ce point également, la solidarité nationale est appelée en soutien, notamment pour toutes les communes jusqu’à 3 500 habitants. Arnaud de Belenet a déposé un amendement, que je salue, visant à leur permettre de voir ces différents frais pris en charge par l’État.
Le pragmatisme, encore, monsieur le sénateur Éric Kerrouche, me conduit à vous indiquer que je vais lever le gage sur un amendement que vous avez déposé concernant l’adaptation des frais spécifiques de déplacement pour les élus en situation de handicap, et qui n’est pas directement recevable au titre de l’article 40. C’est une proposition qui devrait nous rassembler et j’émettrai un avis favorable à son endroit.
Monsieur le président du Sénat, vous étiez vous-même à Signes ; nous ne pouvons pas débuter la discussion de ce texte sans avoir une pensée particulière pour le maire de Signes, qui a fait don de sa vie dans l’exercice de ses fonctions.
Cela a mis un coup de projecteur, dans les médias, sur l’autre casquette des maires dans leur commune : ils sont non seulement patrons de leurs collectivités territoriales, mais ils sont aussi officiers de police judiciaire, agents de l’État dotés de pouvoirs de police depuis maintenant plus de deux siècles. C’est un héritage de la Révolution française.
On a parfois laissé les maires trop seuls dans l’exercice de cette mission, dans une société sans cesse plus violente au sein de laquelle certains de nos concitoyens multiplient, malheureusement, les incivilités et manquent de respect envers nos élus locaux.
Sur ce point également, ce projet de loi prévoit un certain nombre d’outils de protection et, lorsqu’il est malheureusement trop tard, d’accompagnement juridique et psychologique.
Il y a quelques semaines, avec Mme la sénatrice Gatel et quelques autres, nous avions reçu des élus qui avaient été agressés dans le cadre de leurs fonctions. Par pudeur, ceux-ci avaient refusé de présenter à leur conseil municipal une facture de cabinet d’avocats, mais, arrivés au tribunal correctionnel en tant que victime, ils avaient constaté que leurs agresseurs, eux, avaient un avocat.
De cela nous ne voulons plus et nous entendons donc garantir un niveau d’équité entre tous les élus de la République en matière d’accompagnement juridique ; ceux-ci sont en droit d’en bénéficier non seulement lorsqu’ils sont mis en cause, mais également lorsqu’ils sont victimes. C’est une mesure qui va dans le bon sens et qui doit faire honneur à la République.
Il sera également nécessaire d’être plus en confiance : on parle beaucoup de liberté, mais, bien souvent, lorsqu’il s’agit d’attribuer des compétences nouvelles aux élus locaux, tout le monde résiste.
Ces compétences nouvelles relèvent non pas seulement de la décentralisation, mais aussi de la déconcentration, s’agissant de certains pouvoirs de police, notamment administrative, qui sont traditionnellement aux mains des préfets, mais qui, demain, doivent pouvoir revenir aux maires afin de leur garantir l’exécution des décisions qu’ils ont prises.
Sur ce sujet aussi, le projet de loi contient un certain nombre d’éléments. Je tiens à saluer les travaux de la commission des lois, une fois de plus, qui souhaite enrichir les dispositions que nous avons proposées.
En conclusion, monsieur le président du Sénat, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie de cette coproduction, nous la devons aux 600 000 élus locaux de ce pays, je vous remercie également des 1 000 amendements que vous avez déposés et qui traduisent une vitalité démocratique qui me semble de bon ton. §Même si, comme le président du Sénat l’a rappelé, l’urgence a été déclarée sur ce projet de loi.
Vous le savez, monsieur Roger Karoutchi, vous qui avez été ministre en charge des relations avec le Parlement, certaines dispositions doivent produire leurs effets au 1er janvier prochain ; l’urgence n’a pas été décidée pour le plaisir, mais bel et bien parce que beaucoup de nos collègues élus sur le terrain attendent les effets juridiques de ce texte de loi au 1er janvier.
Je ne doute pas que vous serez attentif à ces attentes de terrain !
J’appliquerai trois principes à l’égard des amendements déposés, d’où qu’ils viennent, car il nous faut collectivement tirer les conclusions de l’épisode de la loi NOTRe. Comme vous le savez, quand j’étais maire de Vernon et président du conseil départemental de l’Eure, je m’étais opposé farouchement à ce texte.
Je resterai constant dans cette opposition. Ces trois critères me semblent importants.
Le premier, ainsi que je l’ai dit précédemment, est le suivant : des corrections, oui, le grand soir, non. Nos collègues élus locaux ne comprendraient pas que nous nous lancions dans un énième big-bang territorial, je n’en entends pas le souhait sur le terrain, mais je serai heureux d’en débattre avec vous.
Je vous présente le deuxième critère sans filtre : tout le monde parle de liberté, mais beaucoup d’amendements visent encore et toujours à rigidifier et à normer ce qui se passe dans les collectivités territoriales. C’est le droit le plus souverain du Parlement que de le définir, puisque les collectivités territoriales, dont l’autonomie est certes reconnue par la Constitution, sont tout de même soumises aux lois, lesquelles doivent elles-mêmes être constitutionnelles.
Il faut néanmoins être cohérents : l’on affirme la liberté, en accusant souvent l’État, les préfets ou le Gouvernement d’être une source de rigidité, mais j’aurai l’occasion de rappeler que, sur le millier d’amendements déposés, beaucoup d’entre eux ne vont pas forcément dans le sens de la liberté.
Le troisième critère est l’impact financier. Si, pendant les discussions de la loi NOTRe, on s’était davantage interrogé, au moment de toucher aux questions institutionnelles, sur les conséquences réelles que ces mesures pouvaient emporter sur le périmètre des intercommunalités, sur le degré d’intégration fiscale, sur le calcul du potentiel financier ou, évidemment, sur la question des compétences, certains de nos collègues élus, confrontés à certains choix, n’auraient peut-être pas pris les décisions qu’ils ont prises sur le terrain.

Le Conseil constitutionnel a abdiqué sur l’exigence d’une étude d’impact !
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je souhaite seulement que les commissaires aux lois n’ignorent pas, par ailleurs, le très bon travail des commissaires aux finances de cette institution ! Nous ne pouvons pas, monsieur le président Retailleau, passer plusieurs heures à travailler avec cette assemblée, qui a d’ailleurs voté la mission « Relations avec les collectivités territoriales » l’année passée sur le rapport du sénateur Charles Guené ici présent, sans nous interroger sur un certain nombre d’effets.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le sénateur Dallier, il n’y a pas besoin de simulation pour savoir que lorsque l’on modifie une compétence, le coefficient d’intégration fiscale, le CIF, bouge !
Pour le coup, n’importe quel étudiant en première année de finances publiques le sait !
Je me réjouis de me retrouver devant vous et de réaliser cette œuvre collective tous ensemble, au service de nos collectivités territoriales, de notre territoire, mais également de la République.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées des groupes Les Indépendants, UC, RDSE et SOCR. – M. Bruno Sido et Mme Michelle Gréaume applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est forts d’un esprit pragmatique que nous abordons l’examen de ce texte, parce que les temps l’exigent, parce que les élus attendent de nous des actes et que nous les entendons.
Ce pragmatisme ne nous a jamais fait défaut depuis que nous nous sommes penchés sur ce texte ; nous l’avons encore démontré mercredi dernier en présentant un plan d’action pour la sécurité des maires. Je veux rendre hommage, à ce sujet, au président de la commission des lois, M. Philippe Bas, ainsi qu’à ma collègue Françoise Gatel.
Oui, il nous faut être pragmatiques ; oui, il est grand temps de passer des paroles aux actes et de montrer que, sur ces questions, nous savons parfois faire front commun. Ce qui est en jeu, c’est avant tout la démocratie locale et la vitalité de cette France communale. N’entendez pas dans mes propos une opposition entre l’intercommunalité d’un côté et la commune de l’autre ; pour nous, les choses sont claires : la commune, c’est la porte d’entrée de l’intercommunalité, l’échelon de base de la démocratie, le lieu où l’on crée du lien social, le creuset des solidarités.
Ici au Sénat, nous avons à cœur de réaffirmer aujourd’hui sa place dans des ensembles intercommunaux où règne un esprit de coopération, de mutualisation et de projets. Ce bloc intercommunal est avant tout un couple, qui, avec le temps, devient indissociable, mais qui n’oublie jamais que la commune est la porte d’entrée.
Nous allons le réaffirmer de manière très symbolique dans ce texte, madame et monsieur les ministres, car pour nous il n’est pas question, aujourd’hui ou demain, que les membres des intercommunalités soient élus au suffrage universel direct.
Nous avons fait la preuve de ce pragmatisme lors de l’examen de nombreuses dispositions du texte. Ainsi – Françoise Gatel reviendra sur la question des compétences –, nous avons la volonté d’intégrer de la souplesse, le maximum de libertés conventionnelles, de faire du cousu main afin que ce texte réponde aux différentes spécificités territoriales.
Madame la ministre, vous avez évoqué le texte à venir sur la différenciation territoriale, mais il me semble que nous devons adopter cet état d’esprit dès la discussion de ce texte sur l’engagement et la proximité. Nous devons prendre en compte la nécessité de permettre à ce projet de loi, comme à ceux qui vont venir, de s’adapter aux réalités territoriales.
C’est peut-être là l’écueil majeur : la loi NOTRe a cherché à légiférer de façon uniforme, alors que les élus sur les territoires attendent aujourd’hui un peu plus de souplesse et la reconnaissance de leur capacité à s’organiser.
Au-delà du pragmatisme, nous souhaitons redonner du relief et du souffle à cette France communale et remettre enfin l’élu au cœur de la décision. Là est peut-être le point le plus important. Nous l’avons fait au travers de plusieurs dispositions relatives à la composition des commissions de coopération intercommunale ou aux pactes de gouvernance, nous avons voulu donner aux femmes et aux hommes qui souhaitent s’engager le sentiment que la représentation parlementaire est là pour les soutenir et pour répondre à leurs exigences en matière de conditions d’exercice des mandats locaux.
Cela concerne la formation, la question des indemnités, la protection fonctionnelle, tout ce qui, aujourd’hui, contribue à donner à celles et ceux qui veulent s’engager au service de la démocratie locale la capacité de le faire.
Permettez-moi, enfin, de mettre l’accent sur la richesse des travaux du Sénat. Je le disais, nous avons eu à cœur d’être à l’écoute de tous les territoires, de nous y rendre pour en prendre le pouls et pour connaître les exigences de leurs élus, mais aussi de ceux qui aspirent à s’engager dans la vie locale.
Au-delà du travail que nous nous apprêtons à faire, au-delà de l’architecture institutionnelle, ce qui est en jeu, c’est l’essentiel : notre capacité à donner du souffle à la démocratie locale et, conformément à l’intitulé de ce texte, de la vitalité à ce lien de proximité.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Indépendants.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes Les Indépendants et RDSE.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, en 1789, Mirabeau déclarait à l’Assemblée nationale qu’il fallait rapprocher l’administration des hommes et des choses ; en 2019, soit 230 ans plus tard, le mouvement des « gilets jaunes » et le grand débat national expriment, à leur manière, la même vérité.
Mirabeau se serait-il donc fracassé sur l’atavisme jacobin de la quête du Graal d’un idéal égalitaire uniformisant ? Pour parodier Georges Brassens, « le temps ne fait rien à l’affaire » ! Qu’avons-nous donc fait de la valeur unique et si précieuse de l’engagement des 600 000 élus locaux, ce long cortège de sentinelles de la République, et de ses valeurs ?
Désenchantés, fatigués de réorganisations à marche forcée et de baisses des dotations, trop de maires réclament un cessez-le-feu en matière de big-bang territorial ; en même temps, tenus d’inventer des possibles pour leurs concitoyens et leur territoire, ils nous demandent d’effacer les irritants et de desserrer l’étau.
Telle est votre volonté, monsieur le ministre, et je la salue d’autant plus sincèrement que le Sénat a quelque peu inspiré votre projet de loi. C’est avec cette même volonté de redonner aux élus une véritable capacité à agir, de retisser, au sein du bloc communal, des relations apaisées et positives, que la commission des lois s’est engagée dans la voie de la souplesse et du sur-mesure.
Tout d’abord, comme vous le proposez, il s’agit de replacer le maire et les élus municipaux au cœur des décisions, car, aux yeux de nos concitoyens, le maire est celui qui porte la responsabilité et qui en rend compte, celui qui est « à portée d’engueulade », comme aime à dire notre président. Le pacte de gouvernance, la conférence des maires, l’association des élus municipaux à la vie de l’intercommunalité sont de bonnes mesures, que nous saluons.
Un second axe vise à donner à chaque territoire la possibilité de choisir le niveau le plus pertinent de l’action publique en sortant de cette rigidité normative parfois bloquante. N’est-ce pas là, monsieur le ministre, l’origine et la raison de votre projet de loi ?
Mon collègue Mathieu Darnaud a indiqué que l’intercommunalité était un fait, une nécessité incontournable qui renforce la capacité du bloc local. Pourquoi, toutefois, l’étouffer en lui attribuant des compétences qu’elle ne peut parfois exercer que difficilement parce que son territoire est trop vaste ou trop hétérogène ou que sa ville-centre est trop faible pour entraîner ses territoires ?
L’intercommunalité a une vocation : la subsidiarité, qui consiste à faire ensemble ce que l’on ne peut faire tout seul. Tel est le sens de nos propositions. La réussite des territoires repose sur la coopération intelligente entre les communes et les intercommunalités. Aussi le Sénat propose-t-il davantage de souplesse et d’agilité en supprimant la catégorie des compétences optionnelles, en ouvrant la voie à des transferts à la carte de compétences facultatives aux EPCI, en permettant d’inscrire dans la loi la procédure de restitution de compétences d’un EPCI à fiscalité propre.
Il s’agit d’assouplir, de faciliter et de différencier pour permettre d’agir.
Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, lors du grand débat, le Président de la République a déclaré : « Il ne doit pas y avoir de tabou. » Il ne saurait donc y avoir de pré carré dogmatique intouchable ! Il y a juste, pour nous tous, une urgente et ardente obligation d’efficience de l’action publique dès lors que la République veut reconquérir le cœur de ses concitoyens.
Votre texte est ambitieux, monsieur le ministre, vous entendez redonner confiance et envie aux élus locaux. Ici, dans cette chambre des territoires, en pensée avec le maire de Signes et avec tous les élus locaux, cette armée des faiseurs de la République du quotidien, nous vous disons, comme Mirabeau et sous le regard de Portalis, que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois.
Alors, madame la ministre, monsieur le ministre, faites encore un effort pour nous rejoindre un pont plus loin : celui de la libre administration et de la responsabilité, celui de la confiance dans la République des territoires qui font la France !
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains, ainsi que sur des travées des groupes Les Indépendants et RDSE.

M. le président. La parole est à M. président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, mes chers collègues, je suis heureux de m’exprimer à cette tribune en qualité de président de la délégation aux collectivités territoriales. Je mesure le caractère exceptionnel de cette prise de parole, que je prends comme une reconnaissance du travail de notre délégation, dont l’un des traits est l’investissement dans une coconstruction souvent fructueuse avec l’exécutif.
Je veux saluer ici l’esprit de dialogue des ministres Jacqueline Gourault puis Sébastien Lecornu, avec lesquels nous avons travaillé très en amont du projet de loi. En effet, dès la finalisation du rapport de la délégation que nous avons présenté, en présence du président Larcher, en juillet 2018, des contacts ont eu lieu aux niveaux politique et administratif afin d’identifier très concrètement les pistes de mise en œuvre.
Nous avons pu mener ce travail préparatoire parce que nous nous sommes rapidement saisis du sujet, conformément au souhait exprimé par le président du Sénat dès la fin de 2017, alors que la crise des vocations s’amplifiait, que notre délégation conduise une réflexion sur les conditions d’exercice des mandats locaux.
Cette démarche s’est faite en dialogue avec le Gouvernement, certes, mais aussi, et d’abord, avec les élus locaux. Nous avons fondé nos recommandations sur une longue série d’auditions, sur l’échange étroit et constant avec les associations d’élus, mais aussi, à la base, sur une consultation nationale des élus locaux de France, qui a reçu plus de 17 000 réponses. Du jamais vu !
Ce travail a eu des effets concrets rapides pour les élus locaux, puisqu’un certain nombre de mesures réglementaires, avant même les projets de loi, ont mis en œuvre, chemin faisant, sans tarder, certaines de nos propositions, en matière de régime social, par exemple, afin de mieux diffuser l’information sur les conditions dans lesquelles les élus locaux ont la possibilité d’assurer sans sanction financière leur mandat pendant un congé de maladie. Quelques cas d’irritants s’étaient manifestés et, maintenant, un formulaire spécifique d’affiliation des élus locaux au régime général de sécurité sociale a été mis en place. De même, la prise en charge des frais d’hébergement des élus locaux, dans le cadre de leurs fonctions, a été améliorée.
Ces avancées sont certes insuffisantes, mais elles remédient à un certain nombre de difficultés ponctuelles, mais irritantes et injustes, signalées par les élus et leurs associations. Je forme le vœu que d’autres avancées suivent.
En parallèle, nous avons engagé une mission pour mieux associer les élus municipaux à la gouvernance des intercommunalités. Sous une forme ou une autre, nous en trouvons l’écho dans ce texte dans le pacte de gouvernance, la conférence territoriale, le conseil des maires ou la meilleure association des conseils municipaux aux travaux des intercommunalités. Ces idées ont fait l’objet de propositions dans notre rapport, mais beaucoup les avaient déjà évoquées, notamment au sein des associations. Nous les avons mises en forme et en perspective.
J’ajoute que, dans notre esprit, il s’agit d’abord de bonnes pratiques à diffuser. Il faut sans doute éviter d’aller trop loin vers de nouvelles obligations normatives au risque de rigidifier le travail des élus. Il en faut, mais pas trop ! Autant dire que, sur ces points, l’esprit du texte ne nous semble pas opposé à nos propres recommandations. C’est la raison pour laquelle nos amendements s’inscrivent dans sa dynamique.
Je relève toutefois une exception, concernant la réécriture de l’article sur les modalités de fixation du taux maximal d’indemnisation des maires. Compte tenu des effets que ne manquerait pas d’avoir la mise en œuvre de ces modalités, qui pèserait avant tout sur les plus modestes des élus locaux, ceux des petites communes, je ne peux que m’associer à la volonté de la commission d’infléchir la rédaction du projet de loi sur ce point.
Je termine en saluant de nouveau le travail accompli par les collègues de notre délégation, toutes sensibilités confondues, en bonne intelligence avec les ministres et avec la commission des lois et je forme le vœu que cette convergence au service des élus locaux demeure à toutes les étapes du processus.
Puisse ce texte, après la crise de vocation que j’évoquais au début de mon propos, constituer un signal, certes modeste, mais net, de manière à permettre à un certain nombre de nos concitoyens, dans la perspective des prochaines élections municipales, de s’engager, dans la tradition des maires de France, ces fantassins de la proximité. Souhaitons qu’ils en aient l’envie et qu’ils se sentent soutenus, car, on le sait bien, le déclic est souvent psychologique. Il y a l’amour, mais il y a aussi les preuves d’amour ! C’est dans cet esprit que nous allons, je l’espère, construire ce texte qui n’est que le point de départ de réformes attendues. Il donnera le ton, à nous de jouer !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Je suis saisi par la commission des lois d’une demande d’examen séparé des amendements n° 384 rectifié, 431 rectifié, 270 rectifié et 751 rectifié à l’article 1er, en application de l’article 46 bis, alinéa 2, du règlement du Sénat.
Cette demande légitime vise à permettre un débat clair, qui se déroule de la meilleure façon possible.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Éric Kerrouche.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Monsieur le président, madame et monsieur les ministres, mes chers collègues, permettez-moi, monsieur le ministre, de vous citer, ce que je fais assez rarement.
Dans le dossier de presse de ce projet de loi Engagement et proximité, vous écrivez : « Ce texte comporte des mesures concrètes, qui repartent de la vie quotidienne des élus, pour leur donner des marges de décision sur le terrain […] et pour lever les freins à l’engagement ou au réengagement […] Objectif : clarifier le cadre d’exercice de leurs mandats alors que se multiplient les témoignages de maires qui ne veulent pas se représenter et qu’attirer de nouvelles personnes à l’engagement devient nécessaire. »
Comme tous les textes du Gouvernement, ce projet de loi est présenté comme très ambitieux, voire disruptif, conformément à votre manière habituelle de procéder.
Les objectifs que vous affichez sont louables et ne peuvent être que partagés. Néanmoins, le contexte est tout à fait particulier : une défiance s’est installée entre votre majorité et les territoires, qui s’est encore manifestée lors du congrès des régions à Bordeaux.
Sachez que ce désamour est toujours d’actualité ! Dans une enquête commandée par notre groupe et réalisée en coopération avec le Cevipof, 27 % des maires interrogés font confiance au Gouvernement pour la mise en œuvre des réformes locales, soit moins d’un tiers d’entre eux.
En tout état de cause, la première chose à faire est de vous féliciter de votre capacité d’adaptation puisque, en moins d’un an, nous sommes passés du hashtag #BalanceTonMaire au hashtag #CajoleTonÉlu !
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Si l’on était moqueur, ce dont vous ne pouvez me soupçonner, on ne pourrait que souligner l’heureux calendrier de ce projet de loi, qui, par le plus grand des hasards et parce qu’il est évidemment très utile, doit absolument être voté avant les élections municipales.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – Exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.

Chacun sait ici que cette coïncidence est purement fortuite et que les propositions qui nous sont faites témoignent avant tout d’un intérêt sincère…

… pour les maires et les élus locaux, intérêt que le Gouvernement tentera sans doute de prolonger jusqu’en septembre 2020.
Nouvelles exclamations ironiques sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Monsieur le ministre, j’ai lu votre texte, je l’ai travaillé et je me suis demandé dans quelle mesure il répondait aux objectifs que vous affichez et que vous présentez comme étant de bon sens, ce qui est, comme chacun sait, la chose la moins bien partagée.
Je constate un écart entre la volonté que vous affichez et les dispositions que vous proposez. Pour le dire autrement, il me semble qu’il y a loin de la coupe aux lèvres. Un texte parle aussi par ses manques ; nous y reviendrons.
Abordons d’abord le couple communes-communauté. Vous présentez parfois l’intercommunalité comme une entrave et vous l’instrumentalisez dans une volonté de séduction des élus locaux, suivis, en cela, par la majorité de droite.
La loi NOTRe a-t-elle été problématique à certains endroits ? La réponse est oui !
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

A-t-elle suscité parfois un sentiment de dépossession ? La réponse est oui !
Mêmes mouvements.

Je suis un militant de l’intercommunalité, mais je constate qu’à certains endroits les élus peuvent se sentir perdus dans des grands ensembles. Faut-il alors corriger les périmètres « XXL » qui sont dysfonctionnels ? La réponse est encore oui, monsieur le ministre !
Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.

Il est toujours important de corriger et d’évaluer les effets d’un texte, en particulier ses effets pervers. Mais à l’inverse, faut-il se contenter d’une réponse qui peut s’assimiler à une remise en cause, alors qu’il faut avant tout permettre aux spécificités territoriales de s’exprimer ? La réponse est non !
Votre texte veut faire du « cousu main », mais il ne prend pas les mesures nécessaires. À ce sujet, vous avez vous-même reconnu, lors de votre audition au Sénat, qu’il était difficile de savoir combien d’intercommunalités allaient être concernées possiblement par les scissions. Après les irritants, vous prenez le risque de provoquer de nouvelles allergies. Il est plus important de travailler à la démocratisation des intercommunalités qu’à leur remise en cause.
Faut-il prendre le risque de scission à un moment où les édifices se stabilisent ? Je ne le crois pas. À toutes fins utiles, je rappelle à tout le monde que l’avant-loi NOTRe n’était pas plus le paradis de l’intercommunalité que l’après-loi NOTRe n’est son enfer.
Je remarque juste qu’avant ce texte certains EPCI n’étaient pas en situation de mettre en place des politiques structurantes. C’est d’ailleurs probablement pour ce motif qu’une grande partie de cette assemblée – y compris à droite, bien que les intéressés aient tendance à l’oublier de manière fort opportune –, a voté le texte de la loi NOTRe.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Vous l’aurez compris, si nous pouvons réfléchir à certains assouplissements correctifs, nous serons opposés à la remise en cause du couple communes-communauté. Comme le disait Pierre Mauroy, l’intercommunalité permet d’assurer un avenir à la commune. C’est bien aussi la solitude qui tue les petites communes.
Dans le même temps, nous avons un gouvernement « Janus », qui, avec ce texte, passe la main dans le dos des élus, mais qui se prépare dans le projet de loi de finances à remettre en cause les moyens dont ils disposent.
Vous me direz qu’il faut attendre de nouveaux textes, notamment le « 3D ». Je ne suis pas sûr que les effets spéciaux suffiront à combler les élus locaux. Bien entendu, s’agissant des dotations financières, vous me renverrez à la diminution des dotations du précédent quinquennat.

M. Éric Kerrouche. Je vous rappellerai qu’elles ont été nécessaires essentiellement en raison des comptes publics, enfin, de ceux que nous avons trouvés en arrivant au pouvoir en 2012.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

J’en viens à la démocratisation et à la parité. L’un des manques les plus criants concerne justement la démocratisation et la parité. Dans le texte initial, la logique indemnitaire que vous proposiez plaçait les élus devant un choix qu’ils ne pouvaient pas faire par manque de moyens.
Il s’avère que le statut des élus, qui devait être le pilier de ce texte, n’en est plus qu’un élément, et c’est regrettable. Des sujets utiles comme la formation et la reconversion professionnelle seront de nouveau traités, mais par le biais d’une ordonnance.
Monsieur le ministre, tout se passe comme si vous considériez que les élus forment un groupe homogène et qu’il ne fallait pas traiter différemment des situations qui sont différentes. Il le faut pourtant.
S’agissant enfin de la parité, vous évitez courageusement et avec détermination le sujet
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

, bien aidé en cela par une droite qui a toujours eu du mal à supporter la fin du patriarcat en politique, et qui, à l’Assemblée nationale, préfère payer 1, 8 million d’euros plutôt que d’avoir plus de femmes élues.
Nouveaux applaudissements sur les travées du groupe SOCR. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Mais la démocratie est aussi attaquée quand le texte rend facultatifs les conseils de développement. À un moment où on demande plus de participation, vous enlevez l’un des rares outils qui permet justement que s’exprime la diversité sociale.
Pour conclure, monsieur le ministre, ce texte est-il mauvais ? Non, mais il n’est pas en phase avec les objectifs que vous avez vous-même affichés. À vrai dire je suis très sévère, parce que nous aurions aimé que vos annonces soient suivies d’effets aussi importants. Du grand débat sort malheureusement un trop petit texte, notamment au regard du statut de l’élu.
Il reste que, malgré ce jugement en demi-teinte, ce texte a le mérite de nous permettre de discuter tous ensemble de ces sujets. Certaines mesures seront utiles : je pense au pacte de gouvernance, à l’amélioration des prises en charge des frais de déplacement, éventuellement au vote des élus et aux améliorations apportées en commission des lois, notamment sur la représentativité des communes.
Comme le Petit Poucet, monsieur le ministre, nous ramasserons les cailloux qui nous semblent intéressants tout en faisant en sorte de proposer d’autres améliorations parce que, encore une fois, nous aurions souhaité que l’ambition initiale soit respectée. Nous tenterons donc, avec les amendements du groupe socialiste et républicain, de faire progresser encore ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en France, le maire est la pierre angulaire de notre culture républicaine, la clé de voûte de notre pacte social, le visage familier de notre quotidien. Il est l’élu préféré des Français.
Mais malheureusement, depuis 2015 et le vote de la loi NOTRe, nos élus locaux se sentent dépossédés de leurs compétences. Que ce soit au profit des plus grands ensembles ou du fait de complexités administratives, le premier édile a vu son champ d’action se réduire alors que les attentes des citoyens à l’égard de son action municipale se font de plus en plus exigeantes.
Les tensions exercées autour des budgets municipaux sont également sources d’inquiétudes. Malgré la prévision d’allocations compensatrices par le Gouvernement, l’avenir reste préoccupant pour nos maires : baisse de dotation globale de fonctionnement, suppression des contrats aidés, incertitudes quant à la suppression de la taxe d’habitation et quant à l’équilibre du dispositif compensatoire, non-application de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives prévue dans le projet de loi de finances pour 2020…
Comment en vouloir à nos maires d’être aussi interrogatifs ? Comment ne pas comprendre leur anxiété face à l’impossible équation de « faire mieux avec moins » ?
Face à ces multiples défis, je ne peux donc que saluer l’initiative du Gouvernement de présenter un projet de loi visant à revaloriser la fonction de maire et son rôle au sein du modèle communautaire, à faciliter l’exercice de son mandat, notamment en étendant son pouvoir de police, et à susciter de nouvelles vocations pour un engagement local.
Vous dire que ce texte était attendu, tant ici au Sénat, grand défenseur des collectivités territoriales, qu’au cœur de nos territoires, serait un euphémisme. Je regrette néanmoins qu’il manque de souffle pour l’avenir de notre modèle communal. J’espère donc que le Gouvernement sera sensible aux propositions formulées par le RDSE tout au long des débats pour remettre les maires au cœur de l’action, et la mairie, non pas au cœur du village – elle y est déjà –, mais au cœur de la République.
Concernant la place du maire au sein du modèle intercommunal, ce texte de loi généralise des pratiques qui sont en fait déjà instaurées dans une grande majorité d’intercommunalités. Pour aller plus loin dans le pacte de gouvernance, le RDSE a souhaité introduire des amendements permettant d’y aborder certains sujets cruciaux, comme le schéma de mutualisation des services et le renforcement des solidarités financières. Nous avons proposé, dès le travail en commission, d’inclure le partage de documents essentiels aux fins de favoriser une bonne circulation de l’information au sein de tout EPCI pour l’ensemble des conseillers municipaux, ces exemplaires devant pouvoir être consultables en mairie, faute parfois d’accès informatique ou de réseau.
Dans la version initiale du texte, le Gouvernement n’a pas souhaité aborder la question de la répartition des compétences. Malgré les frustrations générées par la loi NOTRe au sein de nos mairies, malgré l’objectif partagé de « conforter chaque maire dans son intercommunalité », seules les possibilités d’adaptation ou d’assouplissement sous contrôle de l’EPCI sont proposées. Il me paraît donc important de souligner le travail ambitieux mené par la commission des lois, sur l’initiative courageuse de ses rapporteurs, pour permettre un transfert de compétences à la carte.
Le texte du Sénat supprime également le transfert obligatoire des compétences eau et assainissement dans les communautés de communes et les agglomérations, ce que prônait le RDSE. C’est dans ce même esprit que j’ai souhaité déposer un amendement visant à conditionner l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal à un transfert volontaire et explicite de cette compétence « PLU » par la commune vers l’EPCI.
Concernant le pouvoir de police du maire, le RDSE a tenu à vous soumettre des propositions concrètes. Ainsi, pour les débits de boissons, l’amendement déposé complète votre dispositif de fermeture en prévoyant que le maire puisse émettre formellement un avis simple et consultatif sur le dossier de demande d’ouverture des débits de boissons sur sa commune.
Pour le défrichement, nous proposons aussi d’introduire un mécanisme d’information du maire.
S’agissant de la gestion des épaves de voitures, la proposition du rapporteur d’une astreinte pesant sur le propriétaire est évidemment la bienvenue, mais, lorsque le propriétaire est inconnu, les frais restent à la charge de la commune. C’est pourquoi il est crucial de donner à la DGFiP un accès direct au système d’immatriculation des véhicules, le SIV, lui permettant d’identifier rapidement le dernier propriétaire de la carte grise, allégeant ainsi la procédure de recouvrement au nom des communes.
Concernant la simplification du droit applicable aux élus, je tenais à vous remercier à cette tribune, monsieur le ministre, pour votre encouragement répété en faveur de ma proposition de loi visant au développement des médiateurs territoriaux dans nos collectivités. Intégré en commission à votre projet de loi, ce socle de médiation permettra, j’en suis persuadée, de faire prospérer un mode de règlement à l’amiable de conflits susceptible de faciliter ou de réinstaurer le dialogue entre les collectivités et leurs habitants. Il s’agit d’un outil de proximité, à l’image des élus locaux, au service du bien-vivre ensemble.
Étant convaincue des bienfaits de la médiation, vous ne serez pas étonné de me voir porter également des amendements de défense et de promotion de nos conseils de développement.
En conclusion, après cette scène 1, acte II des relations entre les collectivités territoriales, nous attendons avec impatience l’examen futur des textes annoncés par le Gouvernement sur la décentralisation et la différenciation, ainsi que sur la sécurité locale. Dans cette perspective, si notre groupe souhaite que le présent projet de loi Engagement et proximité soit une première pierre pour des textes plus refondateurs, il conditionnera son vote à l’adoption des amendements précités et au maintien des avancées introduites par la commission des lois.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE, ainsi que sur des travées du groupe UC. – MM. Bernard Buis et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées du groupe UC.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, je craignais que cette discussion générale ne soit une succession de propos consensuels, parfois lénifiants et assez unanimistes.

Notre collègue socialiste m’a rassuré sur ce point : il y a malgré tout sur ce texte qui nous fédère quelques polémiques, quelques querelles partisanes. C’est sans doute la nécessité du débat démocratique !
À ce propos, permettez-moi de dire un mot de la démocratie. Nos démocraties connaissent depuis plus de vingt ans des transformations d’ampleur. Elles touchent aux clivages politiques, aux systèmes partisans, aux affiliations des électeurs et même à l’attachement aux libertés publiques.
Tout semble bouger, dans une accélération du temps qui donne le sentiment d’une grande incertitude quant à la marche du monde, et favorise une forme de populisme par nature liberticide.
L’horizon de l’idéal démocratique s’éloigne. Plus de 36 % des Français estiment qu’un autre système pourrait être aussi bon que celui de la démocratie. Les plus jeunes sont particulièrement favorables à une alternative à la démocratie.
Nos concitoyens consentent à se départir des libertés publiques parce qu’ils sont inquiets, sans doute, face aux mutations climatiques, économiques, mais plus profondément, parce qu’ils se pensent moins comme citoyens que comme individus, prêts à ce que la liberté de tous s’efface pour peu que la leur soit garantie sous une forme de droit à jouir d’objets variés, de temps de loisirs, d’informations digestes. Pierre Rosanvallon appelle cela « l’individualisme de singularité ».
Si la démocratie représentative est interrogée, je crois profondément en la démocratie territoriale, au plus près des besoins et des aspirations populaires, comme un moyen pertinent de convaincre nos compatriotes de se penser et d’agir en citoyens, comme un gage et un facteur de cohésion. Je voudrais remercier le Gouvernement de mettre la démocratie territoriale à l’honneur dans ce texte Engagement et proximité.
Dans le droit-fil de cette réflexion, les élus locaux sont et seront plus encore le rempart face à ce mouvement indicible que j’évoquais. Ils renouent et renoueront avec le collectif face à l’individu. Nous avons plus que jamais besoin d’eux.
Après avoir mis un terme à la baisse des dotations, stabilisé les moyens d’agir et stoppé les évolutions institutionnelles, le Gouvernement a souhaité les conforter dans leur rôle, consolider leur statut, clarifier leur environnement institutionnel.
Ce texte comporte des mesures concrètes pour redonner aux élus, en particulier aux maires, la capacité d’agir plus librement, plus efficacement, plus simplement au quotidien : meilleure gouvernance et information dans les intercommunalités, clarification des compétences dans le couple communes-intercommunalité, renforcement des pouvoirs de police du maire. Il comporte également des mesures pour lever les freins à l’engagement ou au réengagement : il s’agit des sujets d’indemnités, de formation, de prise en charge des frais de garde ou de protection fonctionnelle.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui procède en grande partie des travaux issus de notre assemblée, que ce soient des propositions de loi de nos collègues, de rapports issus de la commission des lois ou de rapports faits au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. Je pense notamment au rapport, trop rarement cité en commission ou à cette tribune, de nos collègues Patricia Schillinger et Antoine Lefèvre, intitulé Mieux associer les élus municipaux à la gouvernance des intercommunalités : valoriser les bonnes pratiques. Ce rapport a été une source d’inspiration.
Je salue le Gouvernement qui nourrit sa réflexion des travaux du Parlement. Notre assemblée a été invitée à renforcer et à enrichir ce projet de loi, et la commission des lois a pu apporter des modifications substantielles.
Les points de consensus sont nombreux. C’est le cas par exemple pour le renforcement des pouvoirs de police du maire.
Je me réjouis que notre amendement de suppression de l’article 42 de la loi NOTRe ait été adopté par la commission – il fallait qu’il le soit avant le 1er janvier puisque cet article supprimait les indemnités d’un certain nombre d’élus dans les syndicats.
Je me réjouis également que l’amendement visant à rehausser de 1 000 à 3 500 habitants le seuil de prise en charge par l’État des frais de garde ait été adopté par notre commission, dont je salue le président ainsi que les rapporteurs.
Quelques points restent toutefois à discuter dans les deux semaines qui viennent, et certainement dans la navette. Ainsi, le curseur de la relation communes-intercommunalité trouvera certainement un positionnement plus abouti au cours de nos travaux.
Je n’évoque pas les questions de l’eau et de l’assainissement, ni la problématique du transfert obligatoire, sur lesquelles nous reviendrons certainement.
Je m’étonne du recours très important à l’article 40 dans le cadre de l’examen de ce texte, notamment sur le sujet des indemnités, pour un amendement qui prévoyait un seuil plancher sur lequel le conseil municipal pouvait revenir.
À titre illustratif, je suis un peu plus circonspect quant à l’adoption d’un amendement, qui me semble de circonstance, visant à autoriser les élus locaux à poursuivre l’exercice de leurs fonctions pendant leur arrêt maladie sauf avis contraire de leur médecin. Pour paraître anecdotique, cela illustre une problématique à laquelle nous sommes confrontés. Ce faisant, la logique est inversée : faciliter l’exercice d’un mandat, oui, mais trouver des dispositifs dont la décence n’est pas immédiatement caractérisée me semble un risque à éviter.
En ce qui concerne la formation et l’aide à la reconversion des élus, la commission a accepté d’habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance tout en apportant des dispositions qui vont dans le bon sens, telles que la validation des acquis de l’expérience ou la possibilité pour le CNFPT de dispenser des formations aux élus.
J’espère que nous évoquerons également le principe d’une formation socle qui pourrait être similaire à celle des agents publics, et pas seulement en matière de police judiciaire, mais aussi la possibilité d’être accompagné dans la perspective d’une fin de mandat pour une nouvelle carrière, voire une reconversion en valorisant les expériences acquises, ou encore les congés de formation.
Enfin, s’agissant de la protection des élus, la commission a enrichi le texte initial tout en approuvant les mesures gouvernementales proposées. Je ne reviens pas dans le détail sur les dispositifs.
Pour conclure, je dirai que nous avons assisté jusqu’à maintenant à un travail collectif et constructif au sein de la commission des lois ; je ne doute pas que cet état d’esprit présidera à nos débats, dans l’intérêt des élus locaux dont nous sommes les représentants et, à travers eux, dans l’intérêt de notre démocratie, des libertés publiques et de l’efficacité de l’action publique.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM, ainsi que sur des travées du groupe UC. – M. Philippe Adnot applaudit également.
Mme Valérie Létard remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.

M. Philippe Adnot. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, avec Arnaud de Belenet, il ne faut pas arriver en retard ! Il est rare qu’un orateur disposant d’un temps de parole de treize minutes ne s’exprime que pendant six ou sept minutes ; félicitations, mon cher collègue !
Sourires.

Cette assemblée compte suffisamment de spécialistes des communes et des intercommunalités pour défendre tous les sujets qui le méritent ; je ne vais donc rien ajouter à ce qu’ils vont dire.
Je me concentrerai sur l’article 17. Permettez-moi de dire, à ce sujet, que je me réjouis de la position d’ouverture du Gouvernement et de la position qu’a prise la commission sous l’autorité des deux rapporteurs, avec un appui particulier de notre collègue Jacques Genest.
Le dispositif qui va être proposé constitue une avancée qui permettra de coller aux réalités du terrain. Toutes les intercommunalités ne se ressemblent pas – par leur taille, par leurs besoins et leurs capacités d’investissement. Cette avancée permettra de faire vivre le droit à l’initiative.
L’article 17 porte sur la « sécabilité », c’est-à-dire sur la possibilité, pour une collectivité, de transmettre à une autre entité la capacité de porter une partie de ses responsabilités. Cela me paraît extrêmement important, y compris pour les départements.
Vous le savez, mon passé m’autorise à parler des relations entre les intercommunalités et les départements. Les départements sont comme les intercommunalités : il y en a de toutes les catégories, de toutes les capacités, de toutes les nécessités.
Permettez-moi de dire quelques mots sur le département de l’Aube. Nous nous sommes intéressés à l’enseignement supérieur : tous les départements ne se sont pas intéressés à l’enseignement supérieur et, pour autant, si on ne l’avait pas fait, personne d’autre ne l’aurait fait à notre place. Nous nous sommes intéressés à des parcs d’activités départementaux : si on ne l’avait pas fait, personne d’autre n’aurait porté ces projets à notre place.
Nous l’avons fait parce que nous étions la collectivité de proximité capable de porter financièrement ces projets dans le temps, d’aménager par anticipation, et parce que nous disposions de l’ingénierie nécessaire.
Or sans ce texte, tout aurait pu s’arrêter, les départements ne pouvant plus reconstituer de réserves foncières ni réaliser d’aménagements. Ce texte le permettra et je pense qu’en ce sens il est extrêmement important, à condition bien sûr que son application se fasse en partenariat avec les collectivités de base.
Je souhaite que l’article 17, qui a été remarquablement corrigé par la commission, soit maintenu en l’état, et qu’il nous permette ainsi de faire vivre le concept essentiel de droit à la différence, de droit à l’initiative, et d’encourager la souplesse, la réactivité et l’esprit d’entreprise. C’est l’avenir de nos territoires. Par avance, je remercie tous ceux qui vont le faire aboutir dans cet esprit.
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi de rapporter une anecdote en préambule. Hier, un réseau social bien connu me rappelait qu’il y a six ans je déclarais au sujet de la loi Maptam que j’arrivais au Sénat pour « la poursuite des débats sur le texte des métropoles. Nous allons continuer à défendre l’idée que l’aménagement des territoires n’est pas la compétitivité entre eux, la suprématie de la métropole sur le reste. Au contraire, pour nous, l’urbain et le rural se complètent, l’État doit affirmer la solidarité entre les territoires tout en valorisant leurs atouts respectifs ».
Où en sommes-nous aujourd’hui ? Après la loi Maptam, la loi NOTRe a également été votée. Elles ont entraîné une réorganisation de nos territoires, aggravant la situation que nous vivions dans notre pays précédemment.
Nous avons donc le choix : nous pouvons mettre des pansements sur des plaies ouvertes et non refermées depuis plusieurs années, ou au contraire nous attaquer réellement à la problématique de l’engagement dans la vie locale et la proximité de l’action publique, comme le titre de votre projet de loi nous y invite, monsieur le ministre.
Ce texte n’arrive pas au hasard. Il arrive en effet en milieu de quinquennat, après deux ans et demi de rapports que l’on peut qualifier de compliqués, parfois même conflictuels, entre le Président de la République, son gouvernement et les élus locaux.
Il arrive également à un moment de crispation au sein de la société, après la crise des « gilets jaunes » et le grand débat qui a suivi, et qui, au vu des décisions prises et annoncées, a fait pschitt !
Une fois de plus, et comme pour le grand débat, ce texte arrive à grands coups de communication. Pourtant, faut-il le rappeler, c’est un texte attendu par les élus et dont nous attendons tous des outils qui viennent en renfort de ces derniers.
Le contexte doit être pris en compte, car nous avons connu ces derniers mois, voire ces dernières semaines, des épisodes d’agressions successives – je pense particulièrement à deux d’entre eux qui ont eu lieu dans mon département – et même un décès, avec la tragédie qui a touché la commune de Signes et son maire Jean-Mathieu Michel.
Tous ces événements viennent donc inévitablement poser la question de la place de l’élu dans notre société, mais aussi des moyens que cette société lui donne dans l’exercice de son mandat. Ce point est très important, car il est un enjeu de la démocratie locale : il nous faut redonner du sens à l’action publique des élus envers les citoyens et les administrés.
Le désengagement citoyen face à la perte d’engouement pour la participation politique n’est pas nouveau. L’abstentionnisme existait, mais il se renforce élection après élection. Les maires qui ne souhaitent pas renouveler leur mandat sont de plus en plus nombreux, d’où la nécessité de redonner du sens à cet engagement.
Malgré les effets d’annonce, le texte initial qui devait être un grand projet de loi devient un simple ajustement technique où persiste à nos yeux un manque criant d’ambition. Le texte manque d’envergure : il répond certes à des problèmes particuliers, mais il ne répond pas globalement à la problématique de l’engagement des élus et de la population dans notre pays.
Monsieur le ministre, vous l’avez vous-même rappelé dans vos propos : pas de big-bang ni de grand soir. Mais d’ailleurs, en faudrait-il ? Sur ce sujet comme sur d’autres, l’histoire nous a démontré certainement qu’il ne le fallait pas.
À la lecture précise de votre texte, il n’y a que parcimonie, des avancées timides qui soulignent des problèmes criants sans les résoudre réellement et surtout dans la durée.
Vous nous direz que tout ne relève pas de ce projet de loi et vous aurez raison. Vous nous direz d’ailleurs que de nombreux points évoqués seront traités plus tard, dans d’autres textes, que tel ou tel point relève du débat budgétaire. En bref, de vous-même, vous nous ferez comprendre que vous êtes loin de répondre aux attentes et d’apporter les solutions.
Le texte aura alors suscité plus d’espoir que de résultats. Pourtant, vous n’êtes pas sans savoir qu’en politique susciter de l’espoir et ne pas y répondre est souvent dangereux.
Alors d’ores et déjà, sachez que nous serons vigilants sur le projet de loi de finances, sur le futur projet de loi dit « 3D » que vous annoncez, madame la ministre, en espérant que nous ayons les bonnes lunettes pour pouvoir bien le lire, qui concernera la décentralisation, la différenciation et la déconcentration.
Monsieur le ministre, puisque vous considérez vous-même ce projet de loi comme le premier d’une série, permettez-moi de vous dire qu’il manque un véritable point de départ : quel bilan faites-vous de la décentralisation ? Où se trouve cet état des lieux ? Nous en débattrons très rapidement, puisque l’un de nos premiers amendements porte sur ce sujet.
Vous entendez traiter des conséquences sans même vous attaquer aux causes des problèmes ni revenir à la source des effets néfastes que vous semblez pourtant remarquer. Si l’ambition affichée est réelle, il faut savoir dresser un bilan et en tirer les conséquences. Sans cela, il n’y aura ni rupture ni réorientation.
Pour autant, il faut l’admettre, ce projet de loi marque un vrai coup d’arrêt à la politique des gouvernements successifs qui, avec les lois RCT, Maptam et NOTRe, ont, en leur temps, suscité colère et désespoir. Ces trois sigles ont plongé notre organisation territoriale dans de l’obligatoire et de l’injonction. On est bien loin du principe de libre administration des collectivités territoriales.
Je veux dire ici que la mobilisation des élus et les remarques que certains groupes, dont le nôtre, ont formulées, ici et ailleurs, sont enfin en partie entendues. Pour la première fois en dix ans, on ne cherche plus à faire grossir les EPCI et à retirer des compétences aux communes.
Toutefois, un peu comme si nous étions toujours dans l’« ancien monde », il nous faut hélas nous dépatouiller avec des monstres qu’une partie de cet hémicycle a contribué à engendrer. Rassurez-vous, mes chers collègues, l’heure n’est pas et ne sera pas aux règlements de compte !
Cela étant, faire de la politique, c’est un peu comme un récit de la mythologie grecque : il convient parfois de rappeler que ce sont toujours les choix des hommes qui décident du présent et de l’avenir. Ce que nous ferons ou ce que nous ne ferons pas sera décisif pour l’organisation territoriale de notre pays et la satisfaction des besoins des populations. Ce texte peut être l’occasion de montrer ce que nous sommes capables de faire réellement pour les communes, les citoyens et les citoyennes.
Voyez-vous, monsieur le ministre, il n’y aura pas de posture de notre part. Cela étant, dans votre intervention, vous avez cité des sénateurs issus de six groupes politiques différents. Or je vous rappelle qu’il y a sept groupes constitués dans cet hémicycle et qu’il faut éviter d’en rejeter certains. Comme je ne crois pas au hasard en politique, je me permets de vous l’indiquer.
Marques d ’ approbation sur les travées du groupe CRCE.

Je voudrais par ailleurs saluer le travail des deux rapporteurs de la commission des lois, laquelle a enrichi le texte, même si, sur certains aspects, nous pouvons – nous en sommes convaincus – aller plus loin encore. Je me garderai bien, évidemment, de prendre un ton professoral à cette tribune et dirai simplement : « De bons efforts à poursuivre et à concrétiser ! »
Pour finir, je veux revenir sur le fait que la presse s’est parfois polarisée ces derniers jours, à l’évocation de ce texte, sur les agressions de maires – loin de moi l’idée d’en minimiser l’importance – et les indemnités des élus. Je tiens à réaffirmer ici que le fait de s’attaquer aux élus revient à s’attaquer à la démocratie, et que la démocratie a un coût, si l’étymologie de ce mot a réellement un sens. Si l’on souhaite que le pouvoir du peuple s’exerce, il faut trouver les moyens juridiques et financiers permettant à tout un chacun d’exercer ce beau mandat d’élu local.
Ce texte doit répondre aux enjeux de notre pays : parvenir à une organisation territoriale équilibrée, renforcer le pouvoir du maire en vue d’une meilleure reconnaissance, accroître les droits des élus pour que tout citoyen puisse le devenir. Dire cela, c’est évidemment parler de République, de démocratie, et des besoins des populations et des territoires.
De fait, ce projet de loi ne peut pas être un texte à la petite semaine. Oui, la crise de l’engagement est manifeste dans la vie de nos communes. Elle l’est aussi, comme vous l’avez rappelé, à la mairie, dans les associations ou la vie syndicale.
Mais comment voulez-vous que les gens s’engagent, madame, monsieur les ministres, alors que les budgets diminuent année après année ? D’ailleurs, vous prévoyez un nouveau gel des dotations, puisque la solidarité entre les communes s’exercera au sein de l’enveloppe globale dédiée aux collectivités territoriales, et que l’État ne participe plus aux efforts de solidarité financière entre collectivités.

Année après année, vous avez retiré des compétences aux communes. Année après année, la présence des services publics et de l’État a été réduite comme une peau de chagrin dans les territoires. Et ce ne sont pas les maisons France services que vous annoncez qui viendront redonner du service public pour nos concitoyens, une présence de l’État pour accompagner les élus dans la réalisation de leurs projets.
Finalement, cette situation incite de plus en plus souvent les élus à faire appel à des consultants privés. Chaque semaine, en inaugurant telle ou telle réalisation, nous mesurons bien ce que le recours à de tels cabinets coûte à la collectivité.
Comment s’engager quand il n’y a plus les moyens de porter des projets, le sentiment que tout se complexifie, que la proximité fait place aux grands EPCI et aux grandes régions ? Comment, dès lors, répondre aux besoins des populations ?
La crise est là et appelle des réponses publiques et politiques. Nous n’aurons peut-être pas les mêmes idées ou les mêmes réponses, mais telle est la démocratie. Débattons de ce texte en sortant de l’incantation et des postures. Sachons revitaliser l’échelon communal et retisser le lien entre nos concitoyens et les élus. Telle doit être notre seule ligne directrice. Notre vote dépendra bien évidemment de nos débats.
À nos yeux, ces quinze jours de discussions, loin de favoriser l’entre-soi, doivent être au service des femmes et des hommes de nos communes, départements et régions dans leurs diversités.
Ces diversités sont une chance : sachons incarner l’assemblée qui les fédère et qui ne les oppose pas. Évitons les clivages et les postures caricaturales entre campagne et ville. Évitons de creuser davantage l’écart entre communautés de communes et communautés d’agglomération, d’un côté, communautés urbaines et métropoles, de l’autre. En effet, le seul clivage réel, le seul fossé qui existe dans notre société est celui qui se creuse jour après le jour entre élus et citoyens.
Ce texte doit être envisagé comme un texte non pas pour les élus, mais pour les citoyens, qui doivent retrouver le goût de l’engagement, la confiance en leurs élus et la proximité de leur commune et des services publics. Sachons redonner du sens à la politique !
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE, ainsi que sur des travées des groupes SOCR, RDSE et UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le constat est clair : depuis plusieurs années, les maires se sentent dépossédés et impuissants face à la baisse des dotations de l’État et à la marche forcée vers les grandes intercommunalités, notamment durant la précédente mandature présidentielle.
Aussi, à cinq mois des élections municipales, le Gouvernement en nous soumettant ce projet de loi a l’ambition de replacer les maires au cœur de l’action publique locale et d’enrayer la crise des vocations.
Je ne peux que m’en réjouir !
En effet, les 600 000 élus locaux sont épuisés par les nombreuses réformes successives. Le transfert de la gestion des déchets, de l’eau, de l’assainissement, de la voirie, du tourisme et du plan local d’urbanisme aux intercommunalités a donné aux maires et aux conseillers municipaux le sentiment d’être dépouillés et éloignés des décisions.
Il est urgent de donner dès à présent aux élus la capacité d’agir, de décider librement et en responsabilité de la meilleure organisation pour leur territoire. En effet, le maire est l’interlocuteur naturel des administrés. Lorsqu’un habitant rencontre un problème, une difficulté, c’est au maire qu’il s’adresse spontanément, et non à l’intercommunalité.
Vis-à-vis de leurs concitoyens, les maires doivent être en situation de rester des décideurs. Or il existe chez les élus locaux un fort sentiment de dépossession, qui est souvent lié à l’organisation intercommunale, et qui est relayé par les travaux du Sénat.
Si le projet de loi que nous allons examiner vise à apporter des corrections à la loi NOTRe, afin d’en expurger un certain nombre d’« irritants », comme le disait M. le ministre, la commission des lois a amélioré très significativement ce texte, ce dont je me félicite.
Lors de l’examen des amendements, j’aurai l’occasion de revenir sur divers sujets qui auront pour vertu, je l’espère, d’assouplir les relations entre communes et intercommunalités, mais aussi entre communes, intercommunalités et départements. À mon avis, le nombre de communes en France n’est pas un problème. Je crois même qu’il s’agit plutôt d’une chance.
Je souhaite aborder plus particulièrement la question des compétences eau et assainissement.
La loi NOTRe a prévu le transfert obligatoire de la distribution de l’eau potable et de l’assainissement des eaux usées aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération à compter du 1er janvier 2020, malgré les réserves exprimées par le Sénat.
Dans certaines communes, le transfert obligatoire de ces compétences avait fait craindre une augmentation du coût de l’eau, une gestion moins directe de la ressource, ainsi qu’une perte de la connaissance du réseau.
La loi du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes a toutefois apporté quelques assouplissements bienvenus, sans être suffisants.
Cette loi a permis aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas les compétences eau ou assainissement de s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de cette communauté de communes, représentant au moins 20 % de la population, ont délibéré en ce sens . Je vous l’accorde, il s’agit d’une disposition extrêmement technique.
Ce dispositif, qui institue une minorité de blocage, ne répond toutefois aux problèmes que de manière transitoire puisque, si ces conditions sont réunies, le transfert n’est repoussé que de six ans et prend effet au 1er janvier 2026.
L’article 5 du présent projet de loi apporte des assouplissements bienvenus, mais qui ne vont pas aussi loin que je l’aurais souhaité.
Ainsi, le mécanisme de délégation proposé par le Gouvernement démontre la prise en compte de ces difficultés, mais demeure limité en raison de sa complexité : en excluant les syndicats de communes du dispositif, il ne permet en effet pas l’exercice des compétences eau et assainissement au niveau pertinent.
Au vu de ces difficultés, je me félicite que la commission ait préféré faire confiance aux élus locaux, suivant ainsi la position désormais traditionnelle du Sénat sur le sujet. Elle considère que, lorsque les transferts sont pertinents, ceux-ci sont réalisés. S’ils ne le sont pas, c’est qu’ils ne correspondent pas aux spécificités locales.
Plutôt que d’imposer des directives extrêmement verticales, je préférerais que l’on fasse confiance aux élus locaux : les résultats d’analyse de l’eau transmis par les ARS obligent les maires, soit à opter pour l’interconnexion, soit à améliorer la qualité de cette eau au niveau des stations d’épuration. Arrêtons d’embêter les élus locaux : ils savent ce qu’il y a à faire. Selon moi, il est inutile de légiférer. Je demeure favorable à un transfert facultatif de ces compétences.
Avant de conclure, je voudrais saluer ici, à cette tribune, le travail accompli par nos collègues Françoise Gatel et Mathieu Darnaud, et souligner la qualité de leur rapport.
Particulièrement attentif aux préoccupations exprimées par les collectivités territoriales, notre groupe Les Indépendants demeure très attaché à une meilleure reconnaissance de la place centrale des maires et des élus, ainsi que de leur engagement. Il votera donc ce projet de loi amélioré par les travaux de la commission.
Applaudissements sur les travées des groupes Les Indépendants, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, historiquement, la France s’est construite autour de son État.
Sous Louis XIV, c’était « l’État, c’est moi ». Sous Napoléon, c’était « l’État d’abord ». Sous Clemenceau, c’était « l’État fait la guerre, je fais la guerre ». En réalité, rien ou presque rien n’existait en dehors de celui-ci. Le jacobinisme était à la mode, et dominait même totalement.
Après la Seconde Guerre mondiale, la haute administration jacobine, sous la contrainte d’un pays détruit, a bien voulu accepter que la France s’engage sur la voie de la déconcentration et de la décentralisation, mais à la condition que les décisions continuent de se prendre à Paris ! La Datar et le Commissariat au Plan, c’était parfait, car cela permettait à la haute administration de conserver la main.
Et puis voilà que, depuis vingt ans, la situation est devenue difficile, parce que l’État n’a plus autant de pouvoir, n’a plus les moyens financiers dont il disposait, ni l’autorité ou le crédit qu’il avait. À cela se sont ajoutés le discrédit de la parole publique dans l’opinion ainsi que la montée des antagonismes, des égoïsmes et des agressions.
Selon les gouvernements, la réaction a été très différente. Certains d’entre eux, comme ce fut le cas récemment, ont considéré que, comme nous n’avions plus rien et que l’État était désargenté, il fallait réduire d’autant les dotations des collectivités pour essayer de redresser les comptes publics. Or cela ne marche pas ! Cela favorise même les crises, comme celle des « gilets jaunes », la contestation générale. Cela crée un pays fracturé, un pays déséquilibré, qui ne se reconnaît plus.
Depuis quelques années, on se dit que, finalement, la démocratie, c’est peut-être bien ces 600 000 élus locaux, ces maires, ces maires adjoints, ces conseillers municipaux, que certains dans l’administration considéraient comme des enfants gâtés, comme des personnes qui, par définition, n’ont pas de compétences et doivent naturellement écouter la parole préfectorale ou la parole administrative qui, elle, est tellement rationnelle.
On se dit aussi que la décentralisation et la déconcentration pourraient peut-être aussi venir de la base. Un gouvernement – pourquoi pas le vôtre, monsieur, madame les ministres ? – devrait peut-être se demander si, en rendant le pouvoir aux maires, en rétablissant leur capacité d’agir aux communes, on ne contribuerait pas à restaurer la démocratie, à restaurer ce lien social tant distendu et presque disparu.
Cela permettrait peut-être à ce pays, au-delà des communes et des élus locaux, de se parler. On ne peut plus accepter cette parole qui vient d’en haut, quand elle peut être – c’est la démocratie ! – contestée et critiquée.
En revanche, tous les citoyens admettent que le maire incarne le pouvoir de proximité, qu’il est à l’écoute et qu’il est responsable : par définition, ils peuvent en changer ou le garder tous les six ans – d’ailleurs, ils le gardent le plus souvent, parce que le maire est extrêmement attentif à leurs besoins.
Alors oui, on a peu à peu décidé au nom de la rationalité de créer des territoires de plus en plus grands : on a créé de grandes régions et des intercommunalités de plus en plus vastes, parce que cela devait soi-disant permettre de rationaliser la dépense. En réalité, on n’a rien rationalisé du tout sinon le discrédit. Et les citoyens se sont sentis complètement écartés de la décision !

Aujourd’hui, il faut faire le travail inverse, non pas tout déconstruire et défaire ce qui a été réalisé au niveau des intercommunalités, des départements ou des régions, mais faire en sorte que la cellule de base qu’est la commune redevienne ce qu’était l’agora athénienne. Si la commune ne parvient pas à recouvrer cette forme originelle de la démocratie, cette dernière sera en péril dans notre pays.
Sur d’autres sujets, j’entendais le Président de la République se demander ce qu’est la Nation et ce qu’est la France aujourd’hui. Eh bien, en ce qui me concerne, monsieur le ministre, madame la ministre, je répondrai que ce pays tiendra d’autant plus que vous restituerez aux communes et aux 600 000 élus locaux leur capacité d’agir matérielle, financière, morale et intellectuelle. Retrouvons la démocratie !
Applaudissements nourris sur les travées des groupes Les Républicains et UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Indépendants et RDSE. – MM. Bernard Buis et Martial Bourquin applaudissent également. – L ’ orateur rejoint sa place sous les bravos de son groupe.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le mandat municipal qui s’achève aura été, à plus d’un titre, à nul autre pareil.
Jamais, depuis tant d’années, les communes n’avaient connu des changements aussi profonds dans une période aussi courte. Rappelons-en les principaux : la réforme territoriale et ses conséquences sur la réorganisation des territoires ; des nouveaux transferts de compétences que cette même réforme a entraînés ; la baisse des dotations de l’État et ses répercussions sur les budgets locaux ; enfin, la suppression progressive, partielle et bientôt presque totale de la taxe d’habitation, dont on ne sait toujours pas, de manière précise, par quoi et comment elle sera remplacée.
Sans doute ces épisodes qui ont laissé un goût amer à nombre d’élus locaux ont-ils contribué à nourrir leur découragement, au point que l’on estime aujourd’hui que près d’un maire sur deux ne se représentera pas dans moins de six mois maintenant.
Le projet de loi que nous nous apprêtons à examiner est-il de nature à réparer ce passé récent ?
Pas vraiment. En effet, il ne revient pas sur les principaux griefs formulés à l’encontre des dernières réformes, qu’il s’agisse de la baisse des dotations ou des transferts de compétences imposés par la loi.
Ce texte est-il annonciateur d’une ère nouvelle dans laquelle les relations entre l’État et les communes seraient empreintes de plus de respect et de confiance mutuels ?
Peut-être. En tout cas, il s’agit d’un premier pas en ce sens, d’un pas que nous apprécions, même si le chemin est encore long.
Ce projet de loi est-il de nature à mettre un peu de baume au cœur des élus ?
À l’évidence, oui, car toutes les propositions qu’il comporte vont dans la bonne direction. Celles-ci manquent quelque peu de souffle et d’envergure, mais elles apportent un petit plus pour les libertés locales, après les années de régression qu’ont imposées des lois venues de l’enfer.
On sent comme un parfum de liberté dans ce texte, mais ce n’est qu’un parfum !
D’autres textes permettront au Gouvernement de montrer plus clairement ses véritables intentions. Je pense bien sûr au prochain projet de loi de finances qui, pour les collectivités, sera centré sur la question primordiale de la compensation de la suppression intégrale de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, mais aussi au nouvel acte de la décentralisation qui devrait intervenir au premier semestre de l’année 2020.
En attendant, ce projet de loi conforte le rôle du maire et de la commune. Il s’agit de l’une des réponses pour lutter contre la fracture territoriale dénoncée par les mouvements sociaux de ces derniers mois.
Nous le savons, les Français aiment leur maire et leur commune plus que tous les autres responsables ou institutions politiques. Toutes les études le montrent, y compris celle qui a été réalisée par l’IFOP le mois dernier pour le compte de notre groupe, dans la perspective du colloque sur le droit à la différenciation que nous avons organisé ici même le 23 septembre dernier.
À la question de savoir auquel des trois niveaux de collectivité, auxquels a été joint l’EPCI, elles souhaiteraient attribuer davantage de pouvoir, les personnes interrogées ont sans surprise placé la commune en tête. C’est d’ailleurs la seule collectivité qui recueille plus de 50 % des votes.
Il est donc bienvenu de renforcer le rôle et la place des maires dans la gouvernance des EPCI à fiscalité propre. Le conseil ou la conférence des maires n’est pas une nouveauté et donne satisfaction partout où il a été mis en place. Je crois à l’expertise, mais je crois plus encore à l’expérience. Voilà pourquoi je me réjouis que la commission des lois l’ait conforté.
Mais je souhaite que nous puissions aller plus loin. C’est pourquoi nous vous proposerons un amendement visant à le rendre obligatoire dans tous les EPCI. Cela peut paraître contradictoire avec l’esprit du texte, qui en laisse l’initiative aux maires eux-mêmes, le cas échéant, mais je considère qu’il ne faut pas hésiter à généraliser une instance qui a fait ses preuves et à l’installer partout.
De même, faire en sorte que le maire soit systématiquement le représentant de sa commune dans l’EPCI, dès lors qu’il en est d’accord, contribuera à un meilleur fonctionnement de la coopération intercommunale et, donc, à une plus grande efficacité de son action.
Pareillement, faciliter la représentation des communes au sein des commissions de l’EPCI ou encore élargir la transmission des informations tenant aux réunions des conseils communautaires à l’ensemble des élus municipaux du territoire permettront de mieux les associer aux affaires communautaires et concourront à l’appropriation progressive du fait intercommunal.
L’attribution des compétences eau et assainissement a suivi un parcours assez chaotique ces nombreux mois. Il est difficile d’expliquer aux maires que leur transfert a été imposé par la loi pour une plus grande efficacité, puis d’expliquer que cette efficacité passe par un retour à l’échelon communal. L’efficacité maximale eût donc été de ne rien faire !
Votre gouvernement n’est pas à l’origine de ce parcours, mais il avait la possibilité, l’année dernière, de sortir de cet imbroglio par le haut. Tel n’a pas été son choix et je le regrette. C’était avant, avant les mouvements sociaux qui l’ont amené à porter un regard nouveau sur les communes. Il n’est jamais trop tard, mais s’agissant de ces compétences, je pense que la commission des lois a adopté une position pertinente et cohérente, dans la droite ligne de ce qu’a toujours défendu le Sénat sur ce sujet.

Je salue également la suppression de la révision automatique tous les six ans des schémas départementaux de coopération intercommunale. Le Président de la République l’a rappelé, les intercommunalités ne sont jamais que des constructions au service de la population. Elles doivent permettre aux communes de mieux répondre aux défis auxquels elles sont confrontées.
La révision sexennale favorisait une logique de massification, notamment là où les préfets de département faisaient du zèle. Et il y en a eu !
Désormais, la carte intercommunale bénéficiera d’une certaine stabilité, ce qui donnera davantage de lisibilité aux EPCI et leur permettra de porter des projets à long terme.
Enfin, ce projet de loi traite également du pouvoir de police des maires. Il propose d’ajouter à l’arsenal juridique existant quelques moyens nouveaux, dont la mise en œuvre est aisée. L’efficacité devrait être au rendez-vous. Ce volet paraît mineur. Il l’est assurément pour les maires des grandes villes, mais il en va différemment des autres, qui ne bénéficient pas des mêmes services.
Qu’il s’agisse des établissements recevant du public, de la tranquillité publique, de l’urbanisme opérationnel ou encore de comportements troublant la sécurité publique, tous ces domaines peuvent être sources de tensions qui empoisonnent le quotidien des élus. Mais ces choses-là, on ne les mesure pleinement que si l’on va les voir « avec les pieds », que si l’on prend le temps d’aller sur le terrain pour être à l’écoute.
Précisément, l’écoute semble être la marque de fabrique de ce projet de loi, et c’est tant mieux ! Je ne saurais que trop vous inviter, madame, monsieur les ministres, à prolonger cette écoute et, peut-être, entendrez-vous alors la voix du Sénat !
Applaudissements sur les travées du groupe UC, ainsi que sur des travées des groupes Les Républicains et Les Indépendants.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, attendu de longue date, le projet de loi Engagement et proximité dont nous débattons aujourd’hui arrive à un moment choisi pour répondre aux attentes largement exprimées par les élus locaux et relayées depuis longtemps par le Sénat.
Alors que les échéances de mars 2020 approchent, un maire sur deux hésite toujours à se représenter. Les raisons avancées sont toujours les mêmes : perte d’efficacité et d’utilité, absence de moyens et poids grandissant des responsabilités.
Cette situation est d’autant plus paradoxale que 67 % des Français font confiance à leur maire, bien plus qu’à leur député ou sénateur.
Les causes de la baisse du moral des élus locaux sont connues : loi NOTRe, baisse des dotations durant le précédent quinquennat, multiplication et complexité des normes, désengagement des services de l’État. Et les inquiétudes pour l’avenir existent, notamment en raison du flou qui persiste autour de la réforme de la fiscalité locale.
Formulées lors du grand débat, ces attentes ont été enfin entendues par le Gouvernement. Les nombreux travaux du Sénat, tant ceux de la délégation aux collectivités territoriales sur le statut de l’élu que ceux de la commission des lois, sous l’égide de son président Philippe Bas, sur la réforme de la décentralisation et les irritants de la loi NOTRe ont largement inspiré les rédacteurs du présent texte.
Je me félicite, comme l’a affirmé le Premier ministre au cours de sa déclaration de politique générale au Sénat le 13 juin dernier, que 80 % des dispositions de ce texte résultent des travaux du Sénat. C’est bien, mais peut mieux faire !
L’excellent travail de nos rapporteurs Mathieu Darnaud et Françoise Gatel contribue à enrichir le texte initial, afin de prendre en compte toute la réalité du vécu quotidien des maires et éviter que ce texte attendu ne rate sa cible.
Conforter les maires dans leur rôle impose de redonner de la proximité à leur action et de favoriser leur engagement.
La perte de proximité constitue un leitmotiv. Beaucoup de maires rencontrés affirment être trop souvent dépourvus face à des décisions intercommunales prises sans leur consentement, ou des mesures législatives ou réglementaires déconnectées de la réalité et appliquées uniformément par les préfets. L’application du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie en Seine-Maritime en est une parfaite illustration.
Plus récemment, la faible information des maires lors de l’incendie de l’usine Lubrizol de Rouen – je pense à ma collègue Catherine Morin-Desailly – a privé la chaîne de communication auprès des citoyens d’un maillon essentiel, relais de proximité nécessaire.
Mme Catherine Morin-Desailly opine.

Le texte dont nous débattons répond à ce besoin de proximité.
S’inspirant des trente propositions de la mission de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des lois de réforme territoriale pour revitaliser l’échelon communal, dont M. Darnaud était le rapporteur, et de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale, il tend à rééquilibrer les relations entre communes et EPCI pour que l’intercommunalité soit au service de la commune, et non l’inverse.
Souhaitant aller plus loin, la commission des lois a renforcé la place de la commune, en autorisant le transfert de l’intercommunalité vers la commune de compétences ou de la gestion d’équipements de proximité. Cette nouvelle souplesse permettra d’adapter l’organisation des EPCI aux spécificités locales, de faire du sur-mesure et d’éviter le modèle unique.
Si la proximité est essentielle pour redonner du sens à l’action municipale, elle ne peut suffire pour favoriser l’engagement des maires. L’amélioration des conditions d’exercice des mandats locaux est vitale pour encourager les vocations et favoriser l’engagement en politique, notamment des femmes. Seuls 16 % des maires sont aujourd’hui des femmes ; on ne peut que le déplorer.
La conciliation de la vie professionnelle, de la vie politique et de la vie familiale reste difficile. La prise en charge des frais de garde et de déplacements est une première avancée. Pour répondre à la demande d’élus, j’ai déposé un amendement tendant à faciliter le télétravail pour les élus. Son adoption permettra de rapprocher le maire de sa commune en lui libérant du temps de trajet.
L’augmentation du plafond des indemnités réclamée par les élus doit rester supportable par les budgets communaux et acceptable par les administrés. C’est tout le sens des améliorations introduites par les rapporteurs.
Enfin, la perte de ressources et de cotisations retraite liée à l’engagement politique et la gestion de la fin de mandat restent de véritables sujets de préoccupations pour les élus locaux, sur lesquels nous devons encore progresser ensemble.
Le texte Engagement et proximité répond en grande partie aux attentes des élus locaux, grâce aux avancées obtenues collectivement. Le groupe Les Républicains le votera, tel qu’il a été profondément amélioré par le Sénat.
Applaudissements sur les travées d u groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant d’aborder le texte, je veux évoquer le contexte.
Monsieur le ministre, nous sommes à cinq mois des élections municipales et nous avons compris qu’il était temps, pour l’exécutif, de tenter de combler le fossé qu’il a creusé avec les élus locaux, l’éloignant des territoires.
En effet, les décisions négatives se sont multipliées depuis le début du quinquennat, suscitant interrogations, inquiétude, défiance et, parfois, colère.
Dès 2017, alors que le Président de la République affichait sa volonté de dialogue avec les élus locaux en instituant la conférence des territoires, le Gouvernement annonçait, sans concertation, l’annulation de plus de 300 millions d’euros de crédits d’investissement dédiés aux collectivités. C’était mal parti !
Suivaient la diminution drastique du nombre d’emplois aidés, amputant les politiques d’insertion, affaiblissant les associations et obligeant les communes à voler à leur secours, la baisse des APL, impactant le modèle économique des HLM et, par conséquent, les politiques d’urbanisme et de logement des maires et, enfin, la disparition de services publics locaux, celle des trésoreries en étant le dernier avatar.
Puis – je vous passe des étapes – est venue l’annonce de la suppression de la taxe d’habitation, qui fera l’objet non pas d’un dégrèvement, mais d’une compensation par transfert de fiscalité, rappelant la suppression, de triste mémoire, de la taxe professionnelle et ses conséquences sur les finances locales.
Enfin, cerise sur le gâteau, le hashtag #BalanceTonMaire a démontré toute la considération du Gouvernement et de la majorité pour les 600 000 élus locaux qui, chaque jour, s’engagent au bénéfice de leurs concitoyens et de leur territoire.
Mme la ministre et M. le ministre protestent.

Il aura fallu la crise des « gilets jaunes » et l’appel à la rescousse des maires pour que le Président de la République découvre qu’ils étaient indispensables au lien social, à la cohésion territoriale et, tout simplement, à la République, dont ils sont bien souvent le rempart. C’est à cette occasion que M. Macron a découvert que nos collègues étaient en souffrance et qu’ils avaient le blues, à tel point que nombre d’entre eux n’envisageaient pas de se représenter et que l’on pouvait craindre une crise des vocations.
Ce texte arrive, par un pur hasard de calendrier, juste avant les échéances municipales et sénatoriales de 2020, avec l’ambition affichée de répondre aux attentes des maires, de retisser du lien, de redonner confiance. Nous ne sommes pas dupes de la manœuvre, mais, en responsabilité, nous sommes prêts à prendre tout ce qui améliorera la vie de ces élus, même si le projet de loi est loin de répondre à l’ambition affichée.

Monsieur le ministre, madame la ministre, que demandent les maires ? Ils attendent d’abord de la considération. À cet égard, ils ne se contenteront pas d’un hashtag #CâlineTonMaire. Comme l’a dit en substance le président Jean-Marie Bockel, vous leur faites des déclarations d’amour, ils veulent des preuves d’amour !
Ensuite, ils demandent des moyens. De ce point de vue, la perspective du gel de l’évolution des bases locatives et d’une augmentation de seulement 0, 2 %, hors FCTVA, des concours de l’État aux collectivités dans la prochaine loi de finances ne les rassure pas.

Enfin, ils veulent retrouver de la liberté d’action, sans contractualisation étouffante, sans tutelle suffocante des services préfectoraux, sans avalanche de normes nouvelles.
Madame la ministre, monsieur le ministre, vous avez fait le choix de reprendre de nombreuses dispositions déjà votées par le Sénat, souvent à l’unanimité, qui, malheureusement, faute de relais au Gouvernement et au sein de la majorité de l’Assemblée nationale, n’avaient pas pu prospérer. Nous considérerons donc un bon nombre de vos propositions avec bienveillance.
Cependant, notre approche sera également exigeante.
Votre texte a été amendé par la commission des lois, qui en a renforcé certains aspects, ce dont il faut se réjouir, mais qui a aussi introduit, sous couvert de gommer certains irritants, des dispositions qui pourraient en créer de nouveaux.
Plusieurs de nos propositions ont été reprises, essentiellement sur les droits des élus. Nous nous en félicitons.
Nous présenterons, en séance, d’autres amendements, qui, nous l’espérons, pourront rassembler.
Ainsi, pour ce qui concerne la consolidation de la place de la commune et du maire dans l’intercommunalité, nous invitons nos collègues à aller plus loin que nos rapporteurs, en rendant obligatoires le pacte de gouvernance et la conférence des maires, considérant que c’est dans les territoires où ils n’existent pas encore qu’ils seront les plus utiles et que, sans obligation, il y a peu de chances qu’ils y voient le jour.
Nous veillerons, par ailleurs, à ce que les possibilités de scission d’EPCI soient bien réservées aux quelques cas d’intercommunalités « XXL » posant difficulté, en fixant des bornes quant à leur taille, et à ce que l’assouplissement de la répartition des compétences n’ouvre pas de remise en cause insidieuse de l’intercommunalité. Il ne faudrait pas que la suppression des compétences optionnelles et l’introduction des compétences à la carte fragilisent tout l’édifice d’une intercommunalité en cours de stabilisation.
Comme le souligne Mme le rapporteur, l’intercommunalité est une chance et une force pour nos territoires. À cet égard, nous sommes convaincus que la si décriée loi NOTRe a redonné aux EPCI des capacités d’action – il en va de même pour les communes.
S’agissant des conditions d’exercice des mandats locaux, nous nous félicitons que la commission ait retenu notre proposition selon laquelle seul le maire peut demander une indemnité inférieure au plafond. Nous aurions souhaité que les indemnités des maires et des adjoints puissent être augmentées de façon dégressive, au-delà de 3 500 habitants jusqu’à 100 000 habitants, strate au-dessous de laquelle l’indemnité du maire est inférieure au salaire médian français.

De nombreuses autres dispositions vont dans le bon sens, bien qu’elles ne révolutionnent pas le quotidien des élus et que ce soit au final le budget communal qui devra, s’il en a les moyens, assumer celles qui ont un coût. Je veux citer la prise en compte des frais de déplacement et des frais de garde, qui, effectivement, améliorera le quotidien des élus.
Cependant, ce texte opère également des reculs. Je pense, concernant la participation des citoyens à la vie locale, à la remise en cause des conseils de développement.
Il présente également des manques, notamment sur la parité, alors que ce texte devrait permettre de la faire progresser au sein des EPCI, qui ne comptent qu’un tiers de femmes et seulement 8, 9 % de femmes présidentes.
Enfin, il ne lève pas certaines incertitudes, la question essentielle de la formation étant renvoyée à une ordonnance.
En outre, nous déplorons que l’après-mandat soit le grand absent du texte. On n’en parle pas, alors que c’est une condition de l’engagement. Qu’en est-il de la validation des acquis de l’expérience ? Qu’en est-il de la reconversion professionnelle ? Sur ce plan, nous aurions souhaité que le texte prévoie le bénéfice de l’ancienneté des élus dans le cas d’une reprise d’activité, amplifie l’allocation différentielle de fin de mandat, soutienne la création d’entreprise, en faisant bénéficier l’élu de prêts en quasi-fonds propres. Nous aurions aussi voulu réformer le régime de retraite des élus, alors que celle-ci est, aujourd’hui, indigente.
Ces sujets ne figurent pas dans le texte, et l’article 40 de la Constitution ne nous permet pas de les y intégrer. Nous regrettons que le Gouvernement n’en ait pas pris l’initiative.
Madame la ministre, monsieur le ministre, madame, monsieur les rapporteurs, la question de l’engagement citoyen est primordiale. Ce texte va-t-il décider des élus sortants hésitants à se représenter ? Va-t-il susciter de nouvelles vocations ? Nous ne le croyons pas. Il ne règle en rien la question des moyens financiers. Il ne règle pas plus celle d’une liberté retrouvée ni celle de la sécurité des élus.
Ce texte est, certes, utile, mais c’est un petit texte, qui ne répond pas à une grande ambition et qui risque malheureusement de susciter quelques frustrations.
Applaudissements sur les travées du groupe SOCR.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, quelle démocratie voulons-nous pour demain ? C’est le véritable enjeu de ce texte de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui, dans son intitulé, énonce deux fondamentaux de la vie politique : l’engagement et la proximité.
L’engagement à servir l’intérêt général, les populations et les territoires doit être le moteur de tout mandat.
La proximité est quant à elle un fondement de notre République.
La France est souvent montrée du doigt pour ses 35 000 communes et ses 503 000 élus municipaux. Ce serait trop.
Trop pour leur budget ? Nous le savons tous ici, ce sont très majoritairement des bénévoles qui consacrent leur quotidien à leur ville ou à leur village, 72 % des communes comptant moins de 1 000 habitants.

Tout cela ne représente jamais que 1, 2 % du budget des communes.
Trop de moyens humains ? Quand on constate leur sacerdoce, comment nier le rôle évident des élus locaux ? « Nous sommes de véritables amortisseurs sociaux », m’a dit une maire que j’ai rencontrée lorsque j’ai fait le tour de mon département de l’Hérault. J’aime à répéter cette phrase, qui reflète la réalité des élus communaux.

De fait, les élus locaux sont présents sept jours sur sept, quasiment jour et nuit.

La plupart indiquent remplacer certains services qui ont déserté les communes rurales ou les agents municipaux que leur petit budget ne peut assumer.
Bref, notre République s’appuie sur ces élus, qui offrent à notre pays un véritable équilibre, une paix dans un contexte pour le moins agité. Si l’on peut débattre de leur nombre au sein du conseil municipal quand on connaît la difficulté qu’ont certains candidats à constituer une équipe, la nécessité des élus et l’importance de leurs missions sont, elles, incontestables. Dès lors se pose une question fondamentale : comment les soutenir dans leur mandat ?
Merci pour ce texte, qui, dans ses quatre parties, a pour objectif d’apporter des réponses aux problèmes des maires, s’agissant notamment de leur positionnement au sein des EPCI ou encore de leurs pouvoirs de police.
Toutefois, je regrette deux éléments majeurs. En premier lieu, monsieur le ministre, l’intitulé du projet de loi ne mentionne pas le « statut de l’élu local » dont vous avez parlé tout à l’heure. En second lieu, le texte ne prévoit que des droits, et pas de devoirs.
Le « statut de l’élu » est-il devenu un gros mot ? Avons-nous peur des citoyens ? Depuis des années, les élus locaux revendiquent un statut. Pour rappel, ce terme n’a rien de subversif ! Il s’agit uniquement d’un ensemble de textes qui règlent la situation d’une personne ou d’un groupe. Depuis des décennies, les textes s’empilent sur le sujet, sans qu’il y ait eu de réforme radicale.
Le présent projet de loi est l’occasion de s’emparer de la question, à la condition, bien évidemment, que nous soyons écoutés. Pour l’heure, il consiste en un mélange de mesures, certes utiles – je pense notamment à la formation ou à la prise en charge des frais de garde –, mais il ne va pas au fond du sujet.
Les enjeux du statut de l’élu sont triples. Alors que plus de deux maires sur cinq sont des retraités, alors que seulement 16 % des maires sont des femmes, ces enjeux sont ceux de notre société : il s’agit de lutter contre les freins à l’engagement liés à l’activité professionnelle, à la parité et à la représentation de la société dans la vie publique.
Les chiffres publiés sur le site de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité montrent une progression de la part des retraités. Cela indique de façon très claire la difficulté qu’ont les salariés, et plus particulièrement ceux du privé, à réintégrer leur entreprise à l’issue de leur mandat. Une quantification du temps qu’exige l’exercice d’un mandat municipal s’impose pour expliquer aux citoyens la nécessité de réformer les retraites et les indemnités des élus locaux.
À cet égard, ce texte aurait dû associer les droits et les devoirs. Comment, dans un contexte social en crise, dans une défiance exacerbée des citoyens envers leurs gouvernants, imaginer des droits sans devoirs ? Alors que le « tous pourris » inonde les réseaux sociaux, les élus locaux font les frais de ce manque de confiance, mais également de l’absence de respect, qui s’amplifie.
Quel est le contexte sous-jacent du drame de Signes intervenu cet été ? Celui de citoyens qui ne respectent plus les élus et de fortes menaces pesant sur l’autorité du maire.
La commission des lois du Sénat a lancé récemment une consultation auprès des maires. Les chiffres qui ont été communiqués démontrent ce malaise : 92 % des participants à la consultation ont déjà subi des incivilités, des injures, des menaces ou des agressions physiques.
Rédiger des textes de loi pour renforcer les moyens de contrainte, c’est bien. Expliquer, c’est essentiel, car la citoyenneté ne se décrète pas, pas plus que la confiance.
C’est pourquoi nous devons collectivement œuvrer pour reconquérir les Français. Nous devons collectivement débattre, expliquer, quels que soient nos mandats et quels que soient les publics.
Pourquoi, par exemple, ne pas imposer à chaque élu de consacrer une demi-journée par mois à une rencontre avec les jeunes ? La citoyenneté se crée dès le plus jeune âge, et je peux vous dire, pour rencontrer les conseils municipaux de jeunes, mais également des élèves et des étudiants du CE2 jusqu’au master 2, qu’il y a une vraie appétence pour nos institutions. Ainsi, dans une décennie, la situation pourrait être inversée, à la condition toutefois que nous expliquions bien nos droits et nos devoirs.
La nécessité de détenir un casier vierge, pour les candidats aux élections, est l’un de ces devoirs. Une telle condition paraît d’ailleurs évidente pour les élus locaux qui la réclament. J’ai réalisé une enquête dans mon département : 82 % des maires qui ont répondu y sont favorables.
D’après ce même questionnaire, pour 74 % des maires, l’exigence accrue des citoyens représente le principal frein à l’engagement. C’est pourquoi il est fondamental de témoigner, d’informer sur le rôle majeur de nos élus et de soutenir encore et toujours cet extraordinaire maillage de notre pays.
En ce sens, le groupe RDSE a déposé de nombreux amendements qui vont plus loin que le texte examiné, car, si le débat a le mérite d’être posé sur plusieurs sujets, certaines propositions sont perçues par les élus locaux comme des effets d’annonce ou de communication. Par exemple, quelle valeur aura la possibilité, pour un EPCI, de déléguer la compétence eau et assainissement aux communes qui le souhaitent, si cette délégation est soumise au vote de l’établissement ? Dans la réalité, certains EPCI ont une gouvernance de baronnie et des postures politiciennes qui bloqueront toute délégation. Par conséquent, il faut soit figer la situation voulue par la loi NOTRe, soit revenir purement et simplement sur celle-ci, en annulant le transfert. Tel n’est pas votre choix, mais la disposition du texte n’est pas tenable dans la réalité. Il faut aller plus loin.
L’augmentation du pouvoir de police du maire est également une bonne intention. Toutefois, dans la réalité, certains pensent que cela les mettra encore plus en danger.

M. Henri Cabanel. Enfin, proposer une hausse des indemnités prélevée sur le budget communal est irréaliste. C’est presque une injure pour les plus petites communes. Dans un contexte financier contraint, une telle mesure est illusoire ! L’État devrait en assumer la charge. C’est le prix à payer pour soutenir l’engagement citoyen. C’est le prix à payer pour notre démocratie.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE. – MM. Didier Marie et Jean-Pierre Sueur applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants. – M. Arnaud de Belenet applaudit également.

Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, le projet de loi qu’il nous est donné d’examiner aujourd’hui marque une prise de conscience par le Gouvernement du rôle des élus locaux dans notre démocratie et de la nécessité de mieux les considérer.
En effet, chez les élus, un sentiment latent de dépossession s’est installé. Successivement, ils ont dû affronter les baisses de dotations de l’État, qui ont affecté toutes les collectivités de manière indistincte et non concertée, puis la marche forcée vers les grandes intercommunalités et les grandes régions et, demain, la réforme de la fiscalité locale.
Ce projet de loi entend ainsi valoriser et accompagner ceux qui s’engagent pour la démocratie et la collectivité, en améliorant les conditions d’exercice des mandats locaux.
Dans le même esprit, il vise à étendre les libertés locales, à conforter le rôle du maire pour assurer un meilleur équilibre avec l’intercommunalité, à simplifier le quotidien des élus locaux et à mieux adapter certaines règles ou certains seuils aux réalités territoriales.
Je me réjouis tout particulièrement que ce texte vise à opérer de réelles avancées pour redonner des libertés locales aux élus, afin que ces derniers retrouvent des capacités d’action qui leur ont été enlevées par les lois NOTRe et Maptam.

Sans remettre ces lois en cause, il paraît nécessaire de conforter le rôle des maires au sein des intercommunalités, d’améliorer la gouvernance des EPCI pour permettre des ajustements à la carte lorsque cela ne marche pas et de redonner du pouvoir aux maires.
Il est primordial de faire de l’intercommunalité un véritable instrument au profit des maires. N’oublions pas que ce sont les communes qui font l’intercommunalité, et non l’intercommunalité qui fait les communes !

Je suis heureux également que ce projet de loi prévoie de lever des freins à l’engagement et au réengagement, pour attirer de nouvelles personnes à se présenter et pour ne pas décourager les élus locaux, alors que la menace de voir des listes incomplètes aux élections de 2020 se fait jour.
Je pense toutefois qu’il faudrait aller plus loin.
En effet, sur le terrain, les maires, notamment ceux des communes de moins de 1 000 habitants, réclament une diminution du nombre de conseillers municipaux, car ils rencontrent des difficultés à constituer des listes en vue des prochaines élections.
Ainsi, dans les communes comptant jusqu’à 100 habitants, il faut 7 conseillers municipaux. À partir de 101, il en faut déjà 11, soit plus de 10 % de la population ! Pourquoi ne pas porter le nombre de conseillers à 7 dans les communes de 1 à 199 habitants, à 9 dans les communes de 200 à 499 habitants et à 13 dans celles de 500 à 1 499 ?
De plus, l’abaissement du seuil du scrutin proportionnel en contrepartie, en le fixant, par exemple, à 200 habitants, favoriserait la parité et la démocratie et réduirait l’iniquité qui existe actuellement pour le même scrutin. En effet, pour les communes de 1 000 habitants prévaut actuellement le panachage, ce qui se réduit parfois à un jeu de chamboule-tout, quand les autres connaissent le scrutin proportionnel. Nous avons déposé des amendements en ce sens.
Avant de conclure, je veux saluer, à cette tribune, l’immense travail accompli par les élus locaux, au premier rang desquels les maires, qui sont toujours au plus près des citoyens, de leurs demandes, de leurs encouragements, mais aussi de leurs récriminations.
Oui, le travail que mènent les élus au quotidien au service des habitants, au niveau communal comme au niveau intercommunal, doit être simplifié et soutenu. Oui, le bloc communal doit être valorisé et remis au cœur de notre démocratie. C’est une valeur essentielle de notre République !
Monsieur le ministre, mes chers collègues, réenchanter l’exercice de ce bel engagement qu’est le mandat local est à portée de main. Si ce texte en ouvre la perspective, je me félicite que la commission des lois ait apporté de nombreuses et importantes modifications afin de mieux sécuriser, motiver et outiller les élus locaux, en les dotant d’une plus grande capacité à agir.
Rendre l’engagement citoyen attractif pour de nouveaux élus et répondre aux demandes des maires d’aujourd’hui : voilà l’urgence à laquelle ce texte doit répondre.
Pour cette raison, le groupe Les Indépendants votera ce projet de loi, enrichi largement et significativement par les travaux de la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants, ainsi que sur des travées du groupe UC. – MM. Arnaud de Belenet et Yves Bouloux applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe UC.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, aujourd’hui, notre Haute Assemblée entame l’examen d’un projet de loi dont l’objet est essentiel.
Essentiel, parce qu’il traite de la difficile et nécessaire représentation locale de l’ensemble de nos concitoyens.
Essentiel, parce qu’il touche le socle même de notre modèle démocratique.
Essentiel, enfin, parce qu’il rappelle le rôle premier de notre chambre, tel qu’énoncé à l’article 24 de la Constitution française : celui d’assurer la représentation des territoires de la République.
Assurer leur représentation, c’est accompagner les élus locaux dans l’exercice de leurs missions ainsi que dans la gestion de leur commune, dont ils connaissent mieux que quiconque les réalités, les exigences et les turpitudes du quotidien.
Accompagner les élus locaux, c’est aussi les défendre lorsqu’ils sont menacés ou lorsque certains cris d’alerte ne sont plus audibles.
En juin dernier, nos collègues Antoine Lefèvre et Patricia Schillinger ont rédigé, au nom de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, présidée par notre collègue, Jean-Marie Bockel, un remarquable rapport alertant notamment sur les difficultés rencontrées par les élus locaux dans la gouvernance des intercommunalités.
Malgré la volonté affichée de décentralisation, l’atavisme jacobin rattrape malheureusement trop souvent les 35 000 communes qui composent notre territoire. Le trouble est important pour les élus locaux, qui assurent avec beaucoup de dignité des fonctions parfois difficiles. Surtout, la nature et le rôle de l’élu s’en trouvent considérablement transformés.
Ces dernières années, nous avons bien senti dans nos territoires une forme de découragement, qui a saisi de nombreux élus. Ce découragement est engendré par le décalage entre l’envie d’agir des élus et les trop nombreux obstacles auxquels ces derniers doivent faire face, se sentant souvent trop seuls face à la complexité de nos organisations institutionnelles et la diminution des moyens de nos collectivités territoriales.
Les fonctions que nous occupons aujourd’hui au Sénat, celles que nous exercions hier dans nos communes, comme maires, adjoints au maire, conseillers municipaux, départementaux ou régionaux, nous ont placés quotidiennement au contact de la France des élus locaux, de l’engagement, du courage et de la prise de risque, celle des communes, grandes et petites, celle des petits bourgs, des communautés d’agglomération et des métropoles.
C’est pourquoi nous mesurons, mieux que d’autres peut-être, le gâchis des énergies contenues dans nos territoires. Disons-le clairement : depuis cette position privilégiée, à cette tribune comme dans les allées des marchés, nous mesurons à quel point la volonté, l’abnégation et le sens du mouvement se heurtent à chaque instant aux forces du statu quo.
Non, gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages n’est pas chose facile. §Sur ce plan, les échanges constructifs entre le Gouvernement, quel qu’il soit, et le Sénat sont une école de réalisme : on n’administre pas un pays contre ses élus locaux.
Oui, la condition de nos élus locaux se dégrade. De nombreux exemples nous l’ont malheureusement montré.
D’abord, les efforts à fournir pour assurer une fonction dont l’indemnisation est faible au regard du temps consacré et des efforts consentis sont considérables. Surtout, la délégation de compétences aux EPCI et la diminution des moyens mis à la disposition des communes nourrissent les tensions, les incompréhensions et, à terme, les divisions entre les élus et leurs administrés, dont les problématiques, aux facteurs éminemment locaux, trouvent rarement une réponse simple, concrète et efficace.
La dégradation de la fonction d’élu doit être une préoccupation majeure pour notre assemblée, parce que nous sommes les représentants des élus, mais aussi et surtout parce qu’une remise en cause du rôle de l’élu local est une mise à mal de notre socle démocratique.
L’élu local et la commune étaient au cœur des grandes avancées vers la décentralisation de notre pays. Les lois Defferre constituèrent des avancées considérables pour la démocratie. Les récentes tentatives de décentralisation sont, elles – il faut le reconnaître –, bien plus floues. En effet, la décentralisation a conduit à un enchevêtrement des compétences, qui obscurcit les réalités et dilue les responsabilités.
Aujourd’hui, posons-nous les bonnes questions. Quel élu voulons-nous pour demain ? Celui-ci doit-il être un professionnel, un expert, ou doit-il rester un représentant des habitants ? L’élu de demain devra-t-il renoncer définitivement à toute carrière professionnelle ? Devra-t-il appliquer des directives venues d’« en haut », sans aucune prise avec le quotidien d’« en bas » ? Le texte que nous étudions aujourd’hui vise à apporter des réponses à ces questions.
Mes chers collègues, le Gouvernement reprend les travaux préliminaires du Sénat et défend le texte en première lecture devant nous. Cela témoigne, madame, monsieur les ministres, d’une confiance en la capacité de notre assemblée à se saisir de sujets aussi importants pour la démocratie locale. C’est dans cet esprit de confiance et de proximité que nous assumerons pleinement notre rôle.
Je tiens évidemment à saluer le remarquable travail réalisé par nos deux rapporteurs, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel, qui ont permis à la commission des lois d’améliorer significativement le texte qui nous est soumis aujourd’hui.
Tout d’abord, le projet de loi renforce le maire au sein de l’intercommunalité. Il apporte, au titre Ier, la nécessaire clarification du rôle des maires dans les EPCI, à travers la possibilité d’élaborer un pacte de gouvernance ainsi qu’une conférence des maires.
Ensuite, les pouvoirs de police du maire et les libertés locales sont renforcés. Le sentiment d’impuissance face à certaines incivilités est réel. Dès lors, il est urgent d’accorder à cet élu un pouvoir de sanction réglementé et, bien entendu, délimité.
L’article 20 est également louable, en ce qu’il permettra aux relations entre la commune et l’État d’aller de l’avant et de connaître davantage de fluidité.
Enfin, le dernier titre du texte entend mieux accompagner l’élu dans l’exercice de ses fonctions comme de sa carrière professionnelle. C’est un point fondamental. L’exercice d’un mandat permet d’acquérir de nombreuses compétences. Celles-ci doivent être reconnues.
Une élection ne peut plus être un frein ou une parenthèse dans une carrière professionnelle. À ce titre, les actions de réinsertion doivent faire partie des formations financées sur les budgets locaux, dans l’enveloppe de formation déjà prévue par le code général des collectivités territoriales.
Il s’agit ainsi d’encourager la réinsertion des élus, et donc la fluidité de leur carrière professionnelle. Nous aurons l’occasion d’y revenir durant le débat. En pratique, ces formations restent très peu mobilisées. Les élus locaux doivent être mieux accompagnés dans leur reconversion professionnelle, notamment par la validation des acquis de l’expérience, la VAE. Il s’agit d’assurer la cohérence entre cet outil de formation et le DIF.
Enfin, saluons la volonté d’avancer sur la question des indemnités. Même si le sujet est sensible, parler de l’engagement des élus sans l’aborder aurait été une erreur.
Ce texte se veut une réponse au mal-être des élus. Il ne réglera pas la question dans son intégralité : les problèmes sont si divers que la réponse ne peut être unique.
Madame, monsieur les ministres, vous affirmez l’ambition de clarifier le rôle de l’élu dans un cadre qui a évolué et de concevoir l’élu local que nous voulons pour demain. Notre société ayant changé, les élus locaux, eux aussi, sont amenés à évoluer. Ils aspirent désormais à plus d’autonomie et de responsabilité, dans tous les domaines. Cela est encore plus vrai des nouvelles générations qui arrivent.
Par plaisanterie, on a pu dire de la politique qu’elle était l’art d’empêcher les gens de s’occuper de leurs propres affaires. Il nous faut aujourd’hui faire tout le contraire. L’exigence pour les prochaines années, c’est la redistribution des pouvoirs. Or il n’y aura pas de partage des pouvoirs sans véritable décentralisation. Le mot reste cependant ambigu : il accrédite l’idée que les pouvoirs viennent d’en haut et que c’est le sommet de l’État qui décentralise « ses » pouvoirs au profit des collectivités territoriales. La décentralisation cache souvent une simple déconcentration des pouvoirs. Il nous faudra remettre la décentralisation à l’endroit.
Ce texte peut être une première pierre à l’édifice. Les échanges qui suivront doivent viser à présenter une analyse de la situation, à donner du sens à notre action et à montrer sur quoi peuvent déboucher les efforts de nos élus. Ils aboutiront, je l’espère, à affirmer une vision optimiste, et non à élaborer un énième texte sur le statut des élus.
Il ne tient qu’à nous de faire de ce projet de loi, à la veille des élections municipales, une réponse aux personnes, déjà élues, qui se demandent si elles seront candidates à un nouveau mandat, et à celles, pas encore élues, qui se posent la question de leur présence sur une liste municipale.
Simplifier la gestion de nos communes, élargir de nouveau le champ des possibles pour les élus, redonner du sens et de l’envie à l’engagement : tels sont les trois enjeux des débats que nous entamons aujourd’hui. Sachons saisir l’occasion d’y apporter des réponses appropriées.
Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Arnaud de Belenet applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, chers collègues, les premiers mots de l’intitulé de ce projet de loi mettent en valeur « l’engagement dans la vie locale ».
Au regard de ce réel engagement quotidien, le premier constat est que nos élus locaux ne sont pas entendus, voire qu’ils sont méprisés : je pense, par exemple, au hashtag #BalanceTonMaire… Mes propositions visent à rendre hommage à nos maires, à nos élus locaux, afin de les valoriser et de susciter des vocations. Ils sont avant tout enracinés dans leurs territoires, dévoués à leurs concitoyens et passionnés par la vie publique. Donnons-leur la reconnaissance qu’ils méritent !
Le deuxième constat est que les élus dans leur ensemble sont fustigés sur les réseaux sociaux et par certains médias. Ces dernières années, une médiatisation à outrance de quelques affaires a terni l’engagement quotidien et désintéressé des quelque 35 000 maires de France. Il est impératif de communiquer sur cet engagement au service du bien commun.
Troisième constat, face aux grandes intercommunalités, nos élus se sentent exclus, privés de parole, et donc démotivés. Il faut redonner la parole aux maires des petites communes, leur accorder la place qui doit être la leur pour qu’ils puissent répondre au mieux aux besoins de leur territoire.
Le quatrième constat est relatif aux transferts de compétences. Nos maires se sentent déshabillés. Il est essentiel de redonner du pouvoir de décision à nos élus. Je salue à cet égard le travail de nos rapporteurs. Fidèle à l’esprit du Sénat et à sa connaissance du terrain, la commission a supprimé le transfert obligatoire de la compétence en matière d’eau et d’assainissement – une aberration que nous n’avons de cesse de dénoncer. Le Gouvernement entendra-t-il raison à ce sujet ?
Le cinquième constat concerne les indemnités et leur caractère dérisoire au regard des responsabilités des maires de nos petites communes, taillables et corvéables à merci vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La reconnaissance passe aussi par la revalorisation de leurs indemnités, que je demandais déjà au travers de la proposition de loi de septembre 2018 pour une juste indemnisation des élus municipaux des petites communes.
De nombreux élus locaux vivent, selon leurs propres mots, un « véritable malaise » et une « crise des vocations ». En effet, le poids des responsabilités et la complexité de leurs missions n’ont cessé de croître, alors que leur statut, notamment leur indemnisation, n’a pas évolué en parallèle. Ce projet de loi peut nous permettre d’y remédier, et je remercie les rapporteurs pour leur travail sur ce sujet. Garder les trois premières strates actuelles, telles qu’adoptées en commission, me paraît aussi nécessaire pour la cohérence et l’acceptation de la valorisation indemnitaire.
Cette reconnaissance passe aussi par certains symboles, notamment quand d’autres élus locaux et nationaux en bénéficient déjà. Je pense ici à la cocarde tricolore, que nos maires ne peuvent rendre visible dans leur véhicule sous peine d’être verbalisés, comme le fut le plus ancien maire de mon département, après cinquante ans de mandat… Madame la ministre, il s’agit ici du champ réglementaire : pourriez-vous faire évoluer cette pratique afin de bien marquer le respect dû à la fonction de maire ?
Mon sixième constat est celui de l’impunité ou en tout cas du sentiment d’impunité des agresseurs de nos maires. La récente consultation sénatoriale auprès de nos édiles montre que ces faits divers sont une réalité trop répandue. Nos maires, pourtant officiers de police judiciaire, vivent mal le classement sans suite de plaintes et les procédures judiciaires sans fin, alors que la responsabilité pénale du maire est trop souvent engagée. Madame la ministre, pouvez-vous vous saisir du sujet avec votre collègue Mme la garde des sceaux, afin que les plaintes soient prises en considération, que les sanctions soient exemplaires, que justice soit faite ?
Mon septième constat est celui du manque de sécurité, qui entraîne une crise des vocations. Certes, être élu n’est pas un métier ; toutefois, pour susciter des vocations, il faut rendre la fonction plus respectée et attractive. Le sujet de la formation des élus est primordial : il importe de permettre à l’élu de poursuivre une carrière professionnelle qu’il a sacrifiée ou ébréchée pendant son mandat. Il faut aussi faciliter la mise en disponibilité, pour l’exercice de leur mandat, aux élus salariés du privé, sur les mêmes bases que pour les agents de la fonction publique. La problématique est abordée dans le projet de loi, mais celui-ci renvoie à des ordonnances.
Enfin, à propos de proximité, on ne peut que déplorer, en tant qu’élu de la Nation, la fin du cumul entre un exécutif local, particulièrement dans une petite commune, et un mandat de parlementaire. Ce cumul permettait, comme le dit si justement mon collègue Rémy Pointereau dans sa proposition de loi visant à garantir une République de proximité en rendant possible le cumul de mandats, de renforcer le lien unissant les territoires à leurs représentants nationaux.
Madame, monsieur les ministres, mes chers collègues faisons en sorte que le texte qui sortira des travaux du Sénat soit à la hauteur des attentes de nos maires ! C’est l’intérêt général qui guide l’action de nos élus locaux : leur engagement mérite une reconnaissance pleine ; cela est légitime et juste !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, j’ai été maire d’une commune rurale de 450 habitants durant dix années : cette expérience ne me quitte pas et nourrit chaque jour mes réflexions et mon travail de législateur.
C’est vous dire combien j’étais sinon impatiente, du moins curieuse, madame, monsieur les ministres, de découvrir le grand projet de loi annoncé par le Gouvernement et destiné – je cite l’exposé des motifs – « à lutter contre la fracture territoriale » et « à réconcilier la métropole, la ville moyenne et le rural » : rien de moins !
Personne n’est dupe de cette « opération séduction » lancée à quelques mois des élections municipales, et il faudra bien plus qu’un projet de loi pour renouer la confiance avec les maires et les élus locaux.
Ainsi, il aura fallu la crise des « gilets jaunes » pour que l’exécutif se rende enfin compte des difficultés rencontrées au quotidien par les maires, expliquant pourquoi un maire sur deux déclare ne pas vouloir se représenter lors des élections municipales de mars 2020.
Oui, les communes sont le socle de la République, les maires sont les premiers agents de l’État sur le territoire : un État qui, sans les élus locaux, serait bien en peine de préserver la cohésion sociale.
Aujourd’hui, pardon de le dire, ils sont bien mal payés en retour avec ce projet de loi. En effet, malgré les intentions affichées par le Gouvernement, le compte n’y est pas : rien sur les baisses de dotations de l’État, ni sur la suppression de la taxe d’habitation, qui bat en brèche l’autonomie financière des collectivités territoriales, pourtant inscrite dans la Constitution ; peu de choses sur les intercommunalités « XXL » et rien sur les super-régions qui éloignent le pouvoir du terrain et laissent les élus communaux seuls en première ligne ; service minimum sur l’assouplissement maintes fois annoncé de la loi NOTRe ; rien sur l’acte III de la décentralisation que réclament en vain les associations représentatives des communes, des départements et des régions ; surtout, rien sur ce qui constitue le vrai problème, à savoir qu’avec la réforme territoriale et la priorité donnée au couple intercommunalité-région, avec la marche forcée vers les grandes intercommunalités, la légitimité technique par la compétence est, peu à peu, en train de remplacer la légitimité politique par le suffrage. Place aux « technotables » !
Telle est la vérité du malaise des élus locaux, et pas seulement des maires. Vous dites vouloir donner plus de pouvoirs aux maires, mais ce n’est pas en les autorisant à fermer les débits de boissons à la place des préfets que vous rétablirez la confiance. Cela conduira surtout à soulager une fois de plus les services de l’État d’une tâche subalterne et à placer les maires dans des situations délicates.
Donner des pouvoirs aux maires ? Mais pour faire quoi, et avec quels moyens ? Ce que nos collègues élus locaux réclament, c’est déjà de pouvoir disposer de moyens suffisants pour exercer leurs responsabilités actuelles. Commençons par là : ce serait déjà bien. C’est en tout cas que m’ont répondu les maires de la Haute-Savoie que j’ai pris soin de consulter sur la base de votre projet de loi et dont je me fais l’interprète aujourd’hui.
Enfin, à quoi bon vouloir légiférer tout le temps et sur tout ? Je fais ici référence au projet de pacte de gouvernance et à la conférence territoriale des maires, qui se pratiquent déjà sous des formes diverses sur le terrain sans qu’il soit besoin de loi pour cela, tout simplement parce que la solidarité entre les territoires et la confiance entre les élus locaux ne décrètent pas, mais se vivent au quotidien.
Le vécu quotidien des maires et de leurs adjoints – ne les oublions pas –, c’est souvent le choix de ne pas percevoir ses indemnités pour ne pas grever un budget communal déjà faible. À cet égard, le relèvement du plafond des indemnités que vous proposez et dont vous laissez la modulation à la discrétion des maires est une réponse insuffisante.
Le vécu quotidien des maires et des adjoints, c’est la difficulté à concilier vie professionnelle, vie familiale et mandat électif, en particulier pour les femmes, nombreuses à être engagées dans la vie publique locale.
Le vécu quotidien des maires et de leurs adjoints, c’est le maintien coûte que coûte d’un service de proximité et de qualité répondant aux besoins de leur population. Quand j’entends le Gouvernement annoncer la création de plusieurs milliers de maisons des services au public, tout en laissant leur fonctionnement futur à la charge des communes, je réponds qu’il existe déjà près de 35 000 maisons des services au public en France : cela s’appelle les mairies !
Le vécu des maires et des adjoints, c’est le temps qui manque pour se former et la difficulté à conserver une activité professionnelle régulière et, le cas échéant, à retrouver une activité ou à se reconvertir en fin de mandat.
Sur tous ces points, je ferai des propositions, notamment pour étendre le bénéfice du temps partiel, pour instaurer un fonds visant à financer des prêts pour les anciens élus désireux de créer leur entreprise ou pour que soit pris en compte, au titre du calcul des droits à la retraite, le temps consacré bénévolement à la collectivité et au public.
Madame, monsieur les ministres, nous autres montagnards sommes des taiseux ; nous ne donnons pas notre confiance comme cela, nous jugeons aux actes. Comme se plaisait à le dire Churchill, « que la stratégie soit belle est un fait, mais n’oubliez pas de regarder le résultat » ! Comme beaucoup de mes collègues, j’attendrai donc de voir quelle suite vous réserverez aux propositions du Sénat pour me prononcer. Il ne tient qu’au Gouvernement de faire en sorte que ce débat ne soit pas une occasion manquée.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, comme le soulignait fort justement le président de la Haute Assemblée, Gérard Larcher, « le temps est venu de recréer des ponts entre les collectivités territoriales et l’exécutif ». En effet, le lien de confiance entre les élus locaux et l’État a été fortement et durablement endommagé. Disons-le sans ambages, il ne tient plus qu’à un fil.
Les dégâts occasionnés par le chamboule-tout des réformes territoriales bâclées, le diktat des contraintes financières étranglant l’autonomie fiscale locale, les ravages causés par les mensonges de la Conférence nationale des territoires, l’ignominie du hashtag #BalanceTonMaire doivent être réparés maintenant !
M. Jackie Pierre applaudit.

En point d’orgue de cette vertigineuse dégradation, la grave crise dite des « gilets jaunes » est venue stopper net l’arrogance du « nouveau monde » et a plongé le pouvoir dans la crainte et la fébrilité. Après avoir fait un chèque sans provision de plus de 10 milliards d’euros pour acheter la paix sociale, le Président de la République s’est lancé avec frénésie dans un tour de France des élus locaux, ne comptant plus son temps, prenant force notes et découvrant enfin les vertus de la proximité. « En même temps », il n’avait pas le choix, parce que c’est aux fantassins de la République, aux élus eux-mêmes qu’il faut redonner confiance, et ce maintenant. Il est indispensable de leur apporter l’appui de la Nation qu’ils incarnent au quotidien auprès de nos concitoyens, de leur signifier que la confiance des Français, dont plus de 80 % ont une image positive de leur maire, se traduit en actes, en clair qu’on ne les laisse pas tomber.
Est-ce réellement pour atteindre cet objectif que le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique nous est présenté aujourd’hui ? D’un naturel optimiste, je me plais à le croire. Car oui, la situation est devenue intenable pour les élus locaux, les maires en tête. Entre sentiment d’abandon et absence de reconnaissance, ces derniers ont exprimé récemment un sentiment d’usure et d’impuissance encore jamais éprouvé jusqu’alors.
Au Sénat, conformément à la responsabilité que nous confère l’article 24 de la Constitution, nous avions entendu de longue date les appels au secours montant des territoires. Le texte qui nous est présenté aujourd’hui reprend d’ailleurs un grand nombre des positions tenues par le Sénat depuis plusieurs années, notamment sur l’articulation communes-EPCI ou encore sur les conditions d’exercice des mandats. Il était plus qu’urgent d’agir !
Apportant la preuve tangible que la vision du Sénat n’est pas « datée », sous l’impulsion de son président Philippe Bas, que je veux ici saluer, la commission des lois a lancé, de manière inédite, une vaste consultation des maires, des adjoints et des conseillers municipaux bénéficiant d’une délégation de fonctions. Les résultats n’ont pas tardé à remonter du terrain, en France métropolitaine et dans les territoires d’outre-mer.
La commission des lois a donc logiquement pris en compte leurs justes demandes et amendé profondément le projet de loi Engagement et proximité. Sur tous les points sur lesquels le texte initial avait été jugé timoré ou frileux par les associations d’élus, nous avons ajouté des dispositions nettement plus ambitieuses. Comme le soulignait Mathieu Darnaud voilà quelques instants, il ne s’agit évidemment pas d’opposer communes et intercommunalités, mais il est grandement nécessaire de rappeler que la commune est la porte d’entrée de l’intercommunalité, et non l’inverse.
C’est ainsi que nous avons entendu le souhait mille fois répété des associations d’élus de voir supprimer purement et simplement le transfert obligatoire de la compétence en matière d’eau et d’assainissement dans les communautés de communes et d’agglomération. Il ne s’agit plus là du mécanisme limité et compliqué proposé au travers du texte initial, mais d’une solution simple et efficace.
En ce qui concerne le renforcement des pouvoirs de police du maire, nous proposons notamment d’augmenter fortement le montant des amendes pouvant accompagner une astreinte et de codifier la possibilité d’interdire la vente de boissons alcoolisées la nuit dans les communes.
C’est à nous qu’il revient de faire en sorte que des orientations fermes de politique pénale en cas d’agression d’élus locaux soient diffusées à l’ensemble des parquets. C’est à nous de faire en sorte que les conditions de mutualisation des polices municipales soient assouplies.
Mes chers collègues, chacun d’entre nous le sait personnellement, la vie politique est ardue, chronophage et souvent ingrate. Mais chacun d’entre nous sait aussi qu’elle offre toutes les richesses d’un engagement humain au service de l’intérêt général, d’un projet de territoire, d’une Nation. Il est du devoir de notre démocratie de protéger ceux qui représentent la République ; la République doit aussi savoir se faire respecter !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

M. Max Brisson . Madame la présidente, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, Jean-Raymond Hugonet ayant déblayé le terrain et Roger Karoutchi évoqué Louis XIV, Bonaparte et Clemenceau, il ne me reste plus qu’à vous parler de ce que je connais, c’est-à-dire des Pyrénées-Atlantiques !
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicai ns.

Mon département abrite la plus grande communauté d’agglomération de France par le nombre de communes membres : 158, pour 238 conseillers communautaires.
Même mouvement.

« En même temps », comme dirait le Président de la République, en Béarn, la communauté de communes de la vallée d’Ossau ne compte, elle, que 18 communes.
Certes, dans un cas comme dans l’autre, c’est la volonté des élus qui s’est exprimée, à de larges majorités : en Pays basque, elle était le puissant écho d’une volonté d’existence institutionnelle ; en Béarn, c’est l’esprit montagnard et « valléen » qui s’est manifesté.
Au-delà de ces contingences locales, ces exemples démontrent que le découpage intercommunal recouvre aujourd’hui des réalités bien différentes. Or la législation n’a jamais été adaptée à cette diversité des situations.
En effet, sous le quinquennat précédent, deux courbes ont été prolongées sans jamais qu’elles se rencontrent, avec, d’une part, le meccano institutionnel de la loi NOTRe, qui fut tout sauf l’acte III de la décentralisation, cher Éric Kerrouche, et, d’autre part, l’énergie déployée par les préfets pour établir de vastes intercommunalités, parfois en recourant au « passer outre », c’est-à-dire en passant outre la volonté des élus.
Pourtant, en 1981, Gaston Defferre soulignait que « c’est bien servir la France que de permettre aux élus de décider sur place des solutions à apporter aux problèmes qu’ils connaissent mieux que quiconque ». A-t-on continué dans cette voie au cours des dernières années ? Hélas, non ! Bien au contraire, la tentation recentralisatrice a pris le dessus.
L’actuel gouvernement n’y fut pas insensible – c’est le moins qu’on puisse dire –, comme l’a souligné Jean-Raymond Hugonet. En atteste la contractualisation, dont l’esprit est jacobin dans son essence, et la méthode infantilisante.
Mes chers collègues, comme vous, c’est donc avec un certain plaisir que j’ai accueilli les orientations de ce projet de loi, qui reprennent largement les travaux du Sénat. Ce texte ne règle pas tout, mais il recherche, pour la première fois depuis longtemps, un nouvel équilibre entre la commune et l’intercommunalité. Il vise à une meilleure participation des maires à la gouvernance des intercommunalités, renouant ainsi avec une vision essentielle : la commune est le premier lieu où se vit la démocratie. L’intercommunalité relève d’une dynamique territoriale, elle ne saurait être une instance surplombant les communes et leur imposant ses décisions.
Madame la ministre, le projet de loi que vous présenterez prochainement pourrait être l’occasion d’aller plus loin en mariant, dans les intercommunalités « XXL », cohérence des politiques publiques à grande échelle et proximité dans la gestion grâce aux pôles territoriaux.
Enfin, en bon girondin et élu du Pays basque que je suis, j’avoue aussi attendre de votre texte un nouvel et réel acte de décentralisation et la traduction d’une volonté sincère d’installer solidement dans notre pays le droit à la différenciation.
Je dois le dire, cette attente forte a été largement refroidie par le discours du Premier ministre à Bordeaux. Madame, monsieur les ministres, merci de la réchauffer ! Vous pourrez compter sur l’expertise du Sénat pour débattre de ce projet de loi avec responsabilité.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.
Mme Patricia Schillinger applaudit.
Je répondrai rapidement à chacun des dix-sept orateurs de la discussion générale, sans anticiper sur le débat à venir, pour évacuer les sujets les plus politiques ; nous pourrons peut-être ensuite nous accorder sur le droit que nous devons élaborer au service des 600 000 élus locaux de notre pays.
Messieurs Kerrouche et Marie, vous avez distribué beaucoup de bons et de mauvais points sur le fondement du dossier de presse accompagnant ce projet de loi. En tant qu’ancien maire et ancien président de conseil départemental, j’ai quant à moi lu attentivement non pas le dossier de presse, mais les textes de la loi Maptam, de la loi NOTRe et des lois de finances que vous avez soutenues ici même pendant cinq ans : ils ont entériné une baisse de 11 milliards d’euros des dotations aux collectivités territoriales, agrandi les intercommunalités de manière autoritaire, transféré les compétences de façon également autoritaire, créé de grandes régions en méconnaissant la géographie de notre pays… (Marques d ’ approbation sur les travées du groupe Les Républicains.) Comment pouvez-vous faire ici la leçon à la nouvelle majorité présidentielle aussi tranquillement, avec un aplomb aussi invraisemblable ?
M. René Danesi applaudit.
Que l’on soutienne ou pas ce gouvernement, force est de constater que le mal causé par la loi NOTRe est très profond. Ne cherchez pas à le minimiser ! Très franchement, monsieur le sénateur Kerrouche, à votre place, au lieu d’employer un ton offensif, pour ne pas dire quelque peu agressif, j’aurais plutôt présenté des excuses pour avoir soutenu la loi NOTRe et les lois de finances du quinquennat précédent ! (M. Jean-Marie Bockel applaudit. – Marques d ’ approbation sur des travées du groupe Les Républicains.) Vous vous étonnez de notre volonté de faire adopter ce projet de loi avant les élections municipales, mais si la loi NOTRe n’existait pas, nous ne serions pas réunis ici pour en gommer les irritants.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Madame la sénatrice, soit vous avez la preuve que le Gouvernement est à l’origine de ce hashtag, soit vous cessez de tenir de tels propos. Je vous le dis comme je le pense !
Protestations sur des travées des groupes Les Républicains et SOCR.
J’ai été maire, j’ai été président de conseil départemental, je suis élu municipal : je n’ai pas de leçons à recevoir sur ce sujet. Arrêtons les caricatures, madame la sénatrice ! Le hashtag #BalanceTonMaire me révolte, me dégoûte. Je l’ai condamné. Vous ne pouvez pas l’imputer au Gouvernement, en particulier aux deux ministres présents ce soir.
Messieurs les sénateurs Kerrouche et Marie, vous parlez d’une loi opportuniste intervenant avant les élections municipales. Nous assumons notre volonté que ce texte produise ses effets juridiques au 1er janvier prochain, tout simplement parce que certaines dispositions de votre loi NOTRe, que j’avais pour ma part combattue, entreront en application le 1er janvier 2020. Si nous voulons désamorcer ces dispositions – je pense par exemple au rétablissement des indemnités dans les syndicats infracommunautaires –, nous devons donc adopter le présent projet de loi avant le 31 décembre.
Vous avez dit que la question de la formation des élus était anecdotique. Je ne partage pas cette opinion. Vous avez également dit que nous portions un dur coup aux conseils de développement en les rendant facultatifs. Là encore, il va falloir que nous nous accordions sur la doctrine à appliquer pour l’examen de ce projet de loi : soit on prône les libertés locales et la confiance aux élus locaux, auquel cas il faut « dénormer » quelque peu et laisser aux élus le soin d’adapter ou pas ces conseils à l’échelle de leur intercommunalité, soit on norme à tout-va. On ne peut soutenir les deux positions.
Pour ma part je fais confiance aux élus locaux, monsieur le sénateur Kerrouche ! Pourquoi vouloir forcer un président d’intercommunalité et ses conseillers communautaires à mettre en place un conseil de développement s’ils ont imaginé un autre outil de concertation territoriale avec les associations, le monde de l’entreprise ou les agriculteurs, par exemple ? Si telle est votre intention, dites clairement devant la Haute Assemblée que vous aimez les normes et la rigidité des cadres appliqués sur l’ensemble du territoire.
Madame la sénatrice Delattre, il n’y a pas eu de baisse de la DGF depuis 2017.
L’enveloppe globale est normée et stable, monsieur Duplomb. Il existe des variations à l’échelle des communes, qui tiennent premièrement à la péréquation en faveur des communes les plus fragiles – DSU pour les communes urbaines et DSR pour les communes rurales –, et deuxièmement à l’évolution du chiffre de la population. Il est bien normal que la DGF d’une commune qui gagne des habitants augmente et que celle d’une commune qui en perd diminue. Nous avons déjà eu ce débat lors de l’élaboration du budget. Vous ne pouvez pas dire que la DGF diminue globalement alors que vous-même avez voté les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », qui prévoient sa stabilité.
Selon Mme Delattre, ce projet de loi manque de souffle. Je peux l’entendre, mais, après m’avoir dit et répété pendant trois semaines que j’avais intégralement copié les propositions du Sénat, on me dit maintenant que le texte manque de souffle et qu’il est heureux que le travail de la commission des lois ait permis de l’enrichir…
« C ’ est vrai ! » sur des travées du groupe Les Républicains.
J’en suis très heureux, parce que seul le résultat compte. Là encore, faisons moins de politique en nous disputant la maternité ou la paternité de telle ou telle proposition. Sinon, on n’en finira pas d’invoquer la loi NOTRe, entre ceux qui la soutiennent et qui continuent visiblement de la soutenir, ceux qui ne l’ont pas soutenue mais l’ont tout de même votée, ceux enfin qui ne l’ont ni soutenue ni votée. Pour ma part, je n’étais ni ministre ni parlementaire à l’époque, mais j’ai combattu cette loi. Nous n’allons pas y revenir sans cesse pendant quinze jours ! Quelle que soit l’appartenance politique de chacun, il s’agit, au-delà des procès d’intention, de trouver des solutions opérationnelles et concrètes pour l’ensemble de nos élus locaux.
Mme Delattre a commencé à défendre, au nom du groupe RDSE, un certain nombre d’amendements, portant notamment sur les pouvoirs de police du maire. Nous aurons l’occasion d’y revenir.
Monsieur de Belenet, je vous remercie de vos propos sur la formation des élus. Concernant les indemnités des élus dans les syndicats intercommunaux, le Gouvernement a levé le gage en commission des lois, ce qui a permis aux différents groupes de la Haute Assemblée de déposer un certain nombre d’amendements sur ce sujet. Vous avez souhaité fixer à 3 500 habitants le seuil de population pour le bénéfice de l’ensemble des dispositions d’accompagnement. Cela permet de couvrir l’essentiel de la ruralité. Il me semble donc que là aussi les choses vont dans le bon sens.
J’indique à M. Adnot que Jacqueline Gourault aura l’occasion de revenir sur l’ensemble des délégations au travers du projet de loi relatif à la décentralisation et à la déconcentration, cette question recoupant évidemment celle de la répartition des compétences entre les différentes strates. En tant qu’ancien président d’un conseil départemental, je suis particulièrement attentif à ce sujet. Il nous faudra être extrêmement vigilants en écrivant la loi, puisqu’il ne peut y avoir de tutelle d’une délégation sur une autre. Nous devrons veiller à ce que de bonnes intentions n’accouchent pas d’un enfer légal !
Madame Cukierman, je vous dois des excuses, à vous et à l’ensemble des membres de votre groupe. En effet, tout à l’heure, m’exprimant sans notes à la tribune, je vous ai oubliés de manière totalement involontaire. Nous avons eu une longue réunion de travail, voilà maintenant plusieurs semaines, comme j’en ai eu avec l’ensemble des présidents de groupe et des sénateurs chefs de file sur ces questions. Nous avons pu avancer sur un certain nombre de points. Je pense d’ailleurs que quelques-uns de vos amendements devraient recevoir un avis favorable tant de la commission que du Gouvernement, car ils vont dans le bon sens.
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
Vous semblez regretter que nous renvoyions certains sujets à d’autres textes. Pour autant, l’examen de ce projet de loi, dont tout le monde dit qu’il manque d’ambition ou qu’il est très technique, durera déjà quinze jours, près de 1 000 amendements ayant été déposés. Nous assumons notre méthode, qui donne aussi le temps, madame la sénatrice, de faire de la pédagogie auprès de nos collègues élus locaux. En effet, on a bien vu qu’il était très difficile de leur faire comprendre et appliquer les grandes lois qui bouleversent tout, telle la loi NOTRe.
Vous avez pris acte de la philosophie du texte de loi, à savoir tourner la page du gigantisme en matière d’intercommunalités. À cet égard, ce projet de loi représente une rupture culturelle avec la démarche qui a prévalu pendant une décennie.
Selon vous, l’État ne participerait plus financièrement à la solidarité entre les communes. Tel n’est pas le cas : cette année, la DGF s’élève à 28 milliards d’euros, et les crédits d’investissement à 2 milliards d’euros. Au demeurant, votre groupe est cohérent, puisque vous souhaiteriez davantage.
Mme Cécile Cukierman s ’ exclame.
Monsieur Alain Marc, vous avez rappelé l’essentiel des enjeux en matière d’assouplissement concernant les délégations. Nous en discuterons plus avant au moment de l’examen de l’article en question.
M. Karoutchi est parti…
M. Sébastien Lecornu, ministre. Je l’ai moi-même fréquentée, dans le passé, avant d’être exclu des Républicains !
Exclamations amusées.
M. Karoutchi a vraiment placé le débat au bon niveau. Il a donné de la profondeur historique à ce que nous cherchons à faire ; là est le vrai fil d’Ariane. Il aurait d’ailleurs pu remonter encore un peu plus loin qu’il ne l’a fait, en partant de 1789, puisque l’acte fondateur de la commune a été posé lors de la Révolution française. En effet, dès le 12 novembre 1789, les Constituants, par un décret et non par une loi, ont transformé ce que l’on appelait les groupements de campagne et les paroisses en communes. Ils ont ensuite décidé, dans un second texte, de construire une maison commune, que l’on appellera la mairie, dans laquelle devront se tenir le maire et l’administration municipale. Tout ce que M. Karoutchi a rappelé est parfaitement exact et nous devrons, au cours de nos travaux, toujours nous référer à ce cadre historique.
Monsieur Mizzon, vous m’avez invité en conclusion à « trouver la voie du Sénat ». Je ne sais pas comment je dois le comprendre. Vous souhaitez, par le biais d’amendements, normer un certain nombre de choses. En même temps, vous avez évoqué un « parfum de liberté » du texte de loi. Je ne vous en fais pas reproche, bien au contraire, puisque vous vous inscrivez ainsi dans la problématique qui imprégnera nos discussions des deux semaines à venir : comment faire bien sans rendre plus rigide ? Peut-être nos avis initiaux sur un certain nombre d’amendements pourront-ils évoluer en séance. En effet, si l’expérience de nos départements ou terres d’élection peut nous guider pour élaborer la loi, la traduction en droit d’une refonte globale d’un système s’avère délicate. Vous pourrez ainsi constater, je pense, que le principe de la liberté obligatoire n’est pas simple à transcrire en droit…
Madame Canayer, vous êtes revenue sur un certain nombre de dispositions. Nous devons continuer d’expertiser l’une de vos propositions, relative au télétravail, car elle n’est pas sans soulever, potentiellement, quelques difficultés pour les employeurs. Il me semble que, au sein du groupe Les Républicains, on aime aussi la liberté d’entreprendre !
Je vous le rappellerai à propos d’un certain nombre d’amendements ! À nos yeux, il s’agit d’un fil conducteur intéressant. Ne rendons pas nos collègues élus locaux inemployables ! Il ne faudrait pas que, croyant leur rendre service, on les discrimine à leur corps défendant aux yeux des employeurs, surtout en milieu rural.
Monsieur Marie, quelques amendements du groupe socialiste et républicain vont dans le bon sens et nous les examinerons avec bienveillance, comme je m’y suis engagé auprès du président Kanner. Je pense notamment à cet amendement relatif aux frais de déplacement des élus en situation de handicap, qui a retenu l’attention de Sophie Cluzel et sur lequel, je le redis, je lèverai le gage.
Monsieur Cabanel, vous avez évoqué assez courageusement les devoirs, à côté des droits. Vous êtes d’ailleurs le seul à l’avoir fait. Ce sujet mérite que l’on s’y arrête. Soyons là aussi attentifs à la rédaction que nous adopterons. En effet, il s’agit davantage, au travers de ce texte, de redonner de la confiance et de la liberté, que d’introduire de nouvelles contraintes. Faut-il inscrire dans la loi que l’engagement est, comme vous le dites, le combat de demain et que les élus d’aujourd’hui ont un devoir de transmission dans les écoles ? Je n’en suis pas certain. Cela étant, vous avez eu raison d’indiquer que nous devons être, collectivement, les promoteurs de cet engagement.
Sur les pouvoirs de police du maire, je ne suis pas vraiment d’accord avec vous. J’ai mené de nombreuses consultations, de même que Françoise Gatel et Mathieu Darnaud. Certains maires ne souhaitent pas avoir davantage de pouvoirs de police : nous n’entendons pas en rendre obligatoire l’extension. Aucun maire ne sera forcé de recourir à des pouvoirs de police qu’il n’a pas envie d’utiliser. La majeure partie des maires demandent néanmoins à disposer des moyens de faire exécuter les décisions de police. Je me suis amusé à regarder le flux de courriers que nous recevons, Jacqueline Gourault et moi-même, depuis maintenant plus d’un an. Aucun maire ne nous a écrit pour nous dire qu’il ne voulait plus être agent de l’État, être OPJ, disposer de pouvoirs de police. Les maires nous demandent des moyens, juridiques ou matériels, pour réaffirmer leurs pouvoirs de police, auxquels nul d’entre eux n’entend renoncer.
Pas seulement, monsieur le sénateur. Bien souvent, les maires ne peuvent rien faire de la qualité d’OPJ qu’on leur a conférée. Constater et traduire devant le parquet ou devant un juge ne relève pas que de moyens matériels ; l’écriture du droit compte aussi. Cela participe, comme je le disais tout à l’heure, d’une forme de déconcentration de pouvoirs détenus auparavant par l’autorité judiciaire et, surtout, par l’autorité administrative.
Un autre texte de loi relatif aux questions de sécurité, je l’ai déjà dit plusieurs fois publiquement, sera présenté l’année prochaine. Il s’agira notamment non pas de réinventer les gardes champêtres, mais de mettre en place une véritable police municipale adaptée au milieu rural et complètement mutualisable. Tous les chantiers ne peuvent pas être menés au travers d’un unique projet de loi.
Monsieur Wattebled, je partage complètement votre constat. C’est en effet la commune qui fait l’intercommunalité. Je le redis pour MM. Kerrouche et Marie, l’EPCI est un établissement public au service de ses adhérents que sont les communes. L’ensemble forme le bloc communal, Lyon, où la métropole est devenue collectivité territoriale, constituant un cas à part. Si l’on veut changer de modèle – tel n’est pas mon cas –, il faut le dire clairement, monsieur Kerrouche !
Je l’ai déjà dit en commission des lois, Mme Gourault, le ministre de l’intérieur et moi-même serions éventuellement prêts à examiner une proposition concernant la diminution du nombre d’élus municipaux, à la condition expresse qu’il y ait véritablement consensus sur vos travées. En effet, je note que le Gouvernement est l’objet de nombreux procès d’intention. Il ne faudrait pas que ceux-là mêmes qui nous incitent à réduire le nombre d’élus dans les communes rurales viennent expliquer ensuite que ce gouvernement n’aime pas les communes rurales !
Monsieur Lafon, votre long constat était éloquent. Je m’y rallie sans réserve. Vous avez su poser, sur le sujet de l’engagement, des questions assez préoccupantes pour l’avenir. L’élu salarié du secteur privé relèvera toujours, malheureusement, d’un modèle d’engagement spécifique. Quoi qu’il en soit, je note qu’aucune solution miracle ne figure dans les différents rapports sénatoriaux, propositions de loi ou résolutions, tout simplement parce que la question renvoie à d’autres contraintes.
Monsieur Boyer, j’ai déjà répondu sur #BalanceTonMaire. Je n’y reviens, croyant avoir été clair.
Puisque nous nous rejoignons tous sur le constat, il est temps maintenant de trouver des solutions. Je ne pense pas que, dans cet hémicycle, il y ait, d’un côté, ceux qui n’aiment pas les communes, et, de l’autre, ceux qui les aiment, sauf à vouloir faire un procès d’intention ! §En tout cas, il sera compliqué de démontrer que Jacqueline Gourault et moi-même n’aimons pas les communes.
Je le disais à l’oreille du président Bas, on peut avoir une vision exclusivement financière des choses. J’ai souvenir d’un candidat à l’élection présidentielle qui envisageait initialement de réaliser 20 milliards d’euros d’économies sur les collectivités territoriales. Finalement, ce chiffre a été ramené à 8 milliards d’euros, puis le projet a été abandonné par le président de l’Association des maires de France quand il a conduit la bataille des législatives en 2017. Le sujet est donc délicat. Aujourd’hui, on nous fait reproche de la stabilité de la DGF, mais du moins elle ne diminue pas.
Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.
Je ne demande pas à ce que l’on nous en félicite, mais telle est la vérité des faits ! J’ajoute que vous avez voté à l’unanimité les crédits concernés lors de l’examen du projet de loi de finances !
Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Sébastien Lecornu, ministre. La DGF baisse ou augmente selon les situations, madame la sénatrice ! De nombreuses communes des Yvelines bénéficient de la solidarité au titre de la DSU. Les dotations de l’État aux grandes communes de votre département comptant des quartiers prioritaires de la politique de la ville témoignent de cet effort consenti au titre de la péréquation, laquelle a été décidée par les majorités précédentes…
Mme Sophie Primas proteste.
Si vous voulez être parfaitement cohérents, déposez des amendements visant à stopper l’effort de péréquation au titre de la DSR cible ! Je le rappelle, nous proposerons cette année de l’augmenter encore de 80 millions d’euros, de même que la DSU. Certes, en affaiblissant la péréquation en faveur des communes les plus fragiles ou en y mettant fin, la DGF sera encore plus stable, mais il y a un choix à faire par les sénateurs et les députés ! La péréquation est un vrai choix politique. On ne peut pas défendre la DSR et la DSU, tout en s’étonnant que la dotation forfaitaire puisse diminuer pour certaines communes. Cela fait quarante ans que le Comité des finances locales a construit ses critères ! M. Laignel les définissait déjà quand je n’avais aucune responsabilité politique. À mon avis, ce choix de la solidarité va dans le bon sens.
Madame Noël, personne n’est dupe de cette « opération séduction » lancée à quelques mois des élections municipales, dites-vous. En quoi cette loi aurait-elle une incidence sur les élections municipales ?
Rires sur les travées des groupes Les Républicains et SOCR.
J’appartiens à une génération d’élus municipaux qui ont passé leur mandat à participer à la commission départementale de la coopération intercommunale, à refaire leur budget en raison d’une diminution autoritaire de la DGF, à s’adapter au redécoupage de leur canton et de leur région.
Pour la génération d’élus à venir, celle de 2020-2026, le seul vœu que je formule, en tant que ministre, c’est que le paysage soit le plus clarifié possible : voilà ce que nous lui devons !
Le premier des rendez-vous, c’est bien sûr la clarification de la relation à l’intercommunalité, qui constitue un gros morceau de ce projet de loi. Au lendemain des élections municipales, les nouveaux élus municipaux, devenus élus communautaires, seront concernés par cette problématique. C’est la raison pour laquelle nous nous hâtons de proposer différentes corrections en la matière.
Je ne reviens pas, madame la sénatrice, sur vos propos un peu gratuits sur le fait que l’exécutif découvrirait le malheur des maires. Ce malheur, je l’ai connu en tant qu’élu local dans mon propre département.
Vous dites qu’il n’y a rien, dans ce projet de loi, sur les départements et les régions. J’ai déjà répondu sur ce point : comment réfléchir aux relations entre département et région sans s’interroger sur le rôle de l’État ? Le sujet difficile de l’articulation entre les régions et les départements, tout comme celui des métropoles, trouvera sa place dans le projet de loi que défendra Jacqueline Gourault.
Un amendement déposé par Mme Assassi nous permettra néanmoins d’évoquer les départements. Je peux d’ores et déjà vous affirmer que le Gouvernement croit fermement à la strate départementale et à l’avenir des conseils départementaux quant à leur capacité à organiser les solidarités territoriales de proximité. Cela fait quinze ans que les départements traînent des difficultés financières, de quinquennat en quinquennat et la loi NOTRe est venue gommer un certain nombre de leurs compétences. Le projet de loi de Jacqueline Gourault permettra d’apporter des réponses.
Pour ce qui concerne la fermeture des débits de boissons, l’État ne cherche nullement à se débarrasser du problème, madame la sénatrice. D’un côté, on nous reproche de ne pas écouter les élus ; de l’autre, on accuse l’État de vouloir se décharger sur eux quand nous les écoutons. S’il s’agit là d’une stratégie d’opposition, vous allez devoir finir par prendre un parti ! Sinon, vous ne serez pas audibles !
Mme Cécile Cukierman s ’ exclame.
Pour ma part, je reste persuadé qu’un grand nombre de maires souhaitent voir leurs pouvoirs de police reconnus et respectés. Pour autant, ils ne seront pas obligés de se servir des outils que nous allons, je l’espère, décider ensemble de mettre à leur disposition. Il s’agira d’une simple faculté. Si, chaque fois qu’une liberté nouvelle est donnée aux élus locaux, vous soupçonnez l’État de vouloir se décharger sur eux, vous rejoignez MM. Marie et Kerrouche ! Pour ma part, je soutiens l’extension des pouvoirs de police des maires. Il ne s’agit pas, pour l’État, de se décharger de quoi que ce soit ; il s’agit de liberté et de confiance.
Monsieur Hugonet, j’ai connu de votre part des mélodies plus bienveillantes.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Je comprends la stratégie politique consistant à dire que des malheurs terribles s’enchaînent depuis deux ans, mais ce n’est pas ainsi que nous avancerons dans le bon sens et que nous serons crédibles collectivement aux yeux des élus locaux. Les opposants au président Pompidou lui reprochaient déjà de ne pas avoir été élu local et de ne rien comprendre aux territoires et aux collectivités.
M. Sébastien Lecornu, ministre. Tout cela renvoie à une période, remontant à une quinzaine d’années, durant laquelle les gouvernements successifs ont profondément hésité à donner de véritables pouvoirs aux élus locaux, un avenir à la strate départementale, de la clarté à la fiscalité. Sur ce dernier point, on pourrait évoquer la suppression de la taxe professionnelle sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, la baisse de la DGF et la loi NOTRe sous celui de François Hollande… Après avoir dit ce que nous avions à dire sur le plan politique, nous allons devoir rendre collectivement des comptes. Au moment d’aborder la discussion des articles, je forme le vœu que, plutôt que de faire la généalogie de mesures, bonnes ou mauvaises, remontant pour certaines à ma tendre enfance, nous fassions ensemble, Sénat et Gouvernement, une belle œuvre afin d’améliorer la vie au quotidien des 600 000 élus locaux de notre République.
Applaudissements sur les travées du groupe LaREM et sur quelques travées du groupe RDSE.

La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission des lois.

Je vous remercie, monsieur le ministre, d’avoir pris soin de répondre dans le détail aux interventions de nos collègues ; je suis sûr qu’ils y ont été sensibles.
Je n’imaginais pas que le jour viendrait où j’aurais avec vous une querelle de paternité. Nous avons adopté, en 2017, une loi sur la compétence eau et assainissement, et, le 13 juin 2018, une proposition de loi de portée plus large sur l’équilibre des territoires. Ce dernier texte n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Pourtant, vous aviez tout loisir de le faire, puisque vous considériez que notre travail était une bonne base de départ. Il vous aurait d’ailleurs été loisible, si vous l’aviez inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, de faire amender cette proposition de loi par votre majorité. Si vous aviez opté pour une telle démarche, il n’y aurait eu aucune querelle de paternité. Surtout, votre ambition de voir adopter le présent projet de loi avant le 31 décembre 2019 aurait pu être aisément réalisée, puisque nous vivrions sans aucun doute depuis un an sous le régime d’une loi qui aurait supprimé les irritants de la loi NOTRe, qui semblent aujourd’hui vous donner tant d’urticaire !
Par conséquent, vous avez eu tout loisir de vous inspirer de notre proposition de loi, mais vous n’avez pas voulu l’inscrire à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale et vous avez choisi de déposer votre propre texte. Tout cela nous a fait prendre un grand retard dans l’aménagement des dispositions applicables aux collectivités territoriales, concernant notamment la relation entre l’intercommunalité et ses communes membres.
Par ailleurs, j’aimerais évoquer la véritable signification de notre débat. Selon vous, il s’agit de savoir si nous sommes favorables aux libertés locales et si nous faisons confiance aux élus. Je trouve que cette manière de poser le problème augure bien de notre débat. Malheureusement, le Gouvernement a déposé un certain nombre d’amendements qui ne me paraissent pas cohérents avec le propos que vous nous avez tenu. En effet, qui a voulu plus de libertés locales ? C’est la commission des lois.
Je citerai quelques exemples à cet égard : les pôles territoriaux avec délégation de compétences, vous n’en voulez pas ; la répartition des compétences entre les communes et l’intercommunalité, avec la fin des compétences optionnelles, vous n’en voulez pas ; la disposition qui vise à neutraliser les effets d’un retour de compétences aux communes sur le montant total des dotations d’intercommunalité, vous n’en voulez pas ! Vous avez fait une proposition sur les indemnités des élus ; nous aurons à discuter de la nôtre. J’espère que vous l’accepterez, car son adoption évitera au maire d’une commune de moins de 500 habitants de quémander à son conseil municipal un triplement de son indemnité à la charge de la commune.

Quant aux pouvoirs du maire, je vous sais gré d’avoir ajouté dans votre propre texte, via une lettre rectificative, quelques dispositions à celles qui y figuraient initialement. Je serais heureux que vous acceptiez les propositions que nous avons formulées et d’ores et déjà intégrées au texte de la commission des lois pour renforcer l’autorité des maires, leurs pouvoirs de police et leur capacité à lever des amendes administratives sans passer par la procédure pénale, pour développer les polices intercommunales – c’est une liberté locale qu’il nous faut fortifier – et pour mieux protéger les élus lorsqu’ils sont menacés ou font l’objet d’agressions. Il est absolument nécessaire que les maires soient confortés par rapport à toutes ces incivilités et à toutes ces violences qui aujourd’hui accablent certains d’entre eux.
Le Gouvernement a eu deux ans, monsieur le ministre, pour réfléchir. Vous nous demandez une année supplémentaire pour franchir une étape dans le développement des libertés locales, en invoquant toute la difficulté technique qu’il y aura à poser de nouvelles règles pour les départements et les régions. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts. J’ai déposé avec Mathieu Darnaud et Bruno Retailleau des textes, prévoyant même un socle constitutionnel. Nous souhaitons pouvoir en débattre très rapidement. Pourquoi vous faut-il tant de temps pour réfléchir alors que la question des libertés locales est aujourd’hui cruciale, comme vous l’avez vous-même expliqué il y a un instant ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Loïc Hervé applaudit également.

Je voudrais réagir aux propos de M. le ministre.
S’agissant de l’utilisation de l’expression « copier-coller », monsieur le ministre, j’ai simplement dit, sans aucun esprit polémique, que nous devions faire front commun et que les travaux du Sénat allaient un peu plus loin que le texte proposé par le Gouvernement.
La commission a estimé qu’il fallait donner davantage de souffle à ce projet de loi. On ne peut nous reprocher un manque de pragmatisme, voire de plasticité. Pour ne prendre que le seul exemple de la délégation que le Gouvernement a souhaité introduire pour la compétence eau et assainissement, nous avons dit « chiche ! » à son extension à d’autres compétences, considérant qu’il s’agissait peut-être là de la souplesse et de la capacité d’adaptation qu’appellent de leurs vœux nombre d’élus de nos territoires. Je m’empresse d’indiquer à l’adresse de certains de nos collègues socialistes que, sans opposer les tenants de l’intercommunalité à ceux de la commune, il apparaît nécessaire de mettre de l’huile dans les rouages. Je l’ai souligné dans la discussion générale, nos rapports se fondent sur un constat partagé par nombre d’élus sur les territoires. Notre collègue Max Brisson a cité l’exemple de sa communauté d’agglomération, qui compte 158 communes : on voit bien qu’il y a, dans le fonctionnement quotidien, dans la gouvernance, dans la gestion de certaines compétences, une visée stratégique et une visée de proximité.
Pour notre part, nous essayons d’être pragmatiques. Françoise Gatel et moi-même appelons à un souffle nouveau, le souffle de l’audace. Ce texte ne doit pas se résumer à une simple boîte à outils ; il doit nous permettre d’aller plus loin pour résoudre certaines difficultés qui marquent très clairement, en termes de gouvernance et d’exercice des compétences, les limites de l’intercommunalité telle qu’elle fonctionne aujourd’hui. Le temps est venu du second souffle, qui passe par plus de souplesse et une plus grande capacité d’adaptation aux problématiques locales. C’est un pont que nous jetons vers le futur projet de loi relatif à la décentralisation, à la différenciation territoriale et à la déconcentration.
Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.
Je lève le gage sur un certain nombre d’amendements relatifs à la participation à l’Agence France locale.
Le ministre n’étant pas présent en commission des lois, j’ai souhaité que le Gouvernement dépose un certain nombre d’amendements pour que nous puissions avoir un débat libre et éclairé sur certains sujets, notamment celui de la délégation.
Par ailleurs, monsieur le président de la commission des lois, s’il est facile de voter certaines dispositions pour créer de la liberté, cela impose aussi de recalculer l’intégration fiscale et les dotations.
La neutralisation du coefficient d’intégration fiscale, le CIF, appelle la fin de l’intercommunalité telle qu’on la connaît aujourd’hui. C’est donc une réforme profonde que vous proposez ! Nous aurons en tout cas ce débat. Je serais d’ailleurs curieux de savoir ce qu’en pensent certaines associations d’élus…
Ma volonté, monsieur le président de la commission des lois, n’est pas de fermer la porte à un certain nombre de libertés. Je souhaite simplement que le débat puisse avoir lieu. Lors de l’élaboration de la loi NOTRe, si les impacts financiers et budgétaires avaient été examinés avec davantage de prospective, un certain nombre d’élus n’auraient peut-être pas constaté des variations aussi brutales de la DGF que celles que déplore à juste titre M. Duplomb. En effet, quand une commune a changé d’intercommunalité pour en rejoindre une plus riche, sa DGF diminue. Mais ce sont les mêmes critères qui sont en vigueur depuis quarante ans.
En ce qui concerne les pouvoirs de police du maire, vous avez rappelé, monsieur le président Bas, que la commission des lois a enrichi le texte. Quant à la décentralisation, ne soyez pas impatient : la dernière loi de décentralisation remonte à 2003. Vous exerciez d’ailleurs déjà des fonctions éminentes à cette époque, puisque vous étiez secrétaire général de la présidence de la République ! Il n’y a pas eu d’autre loi de décentralisation depuis. La commission des lois a commis quelques propositions de loi organiques ou constitutionnelles. J’imagine que c’est pour les verser au débat que nous allons avoir. Un an pour réfléchir à la place de l’État, à la coordination du bloc départemental, du bloc régional et du bloc communal, ce n’est pas trop. Je crois d’ailleurs savoir que, même au sein de cet hémicycle, le débat n’a pas encore eu lieu, puisque les propositions de loi que j’évoquais n’ont pas encore été examinées par le Sénat. Nous serons heureux, avec Jacqueline Gourault, de pouvoir y participer le moment venu !

L’amendement n° 745 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mme Gréaume, M. Collombat, Mme Benbassa, M. Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Cohen, MM. Gay et P. Laurent, Mmes Lienemann et Prunaud et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :
I. – Avant le titre Ier
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le livre Ier de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3111-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3111 - … . – La République reconnaît les départements comme division territoriale essentielle, inhérente à l’organisation administrative et politique française et nécessaire à son bon fonctionnement, notamment par leurs compétences en matière de solidarités et leur soutien aux communes. »
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
Titre préliminaire
Le rôle des départements
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Cet amendement vise à consacrer le rôle du département comme division administrative française, afin de le protéger.
La loi NOTRe a déjà retiré la clause de compétence générale aux départements et transféré un grand nombre de leurs compétences aux régions, notamment en matière de transport et de développement économique. Les élus s’inquiètent à juste titre de la future réforme de la fiscalité locale, qui portera un nouveau coup dur aux départements et à leur autonomie.
Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit d’ôter aux départements leur dernier levier en matière de fiscalité locale, la taxe sur le foncier non bâti, supprimant ainsi tout lien entre les citoyens et les finances des départements. En tant qu’élue régionale, je puis vous assurer que quand une collectivité n’a quasiment plus aucune marge de manœuvre en termes de fiscalité, le lien entre elle et les citoyens s’affaiblit fortement !
Le rôle du département ne doit pas se réduire aux questions sociales, comme on l’entend souvent dire, puisqu’il est né d’une volonté de rapprocher les administrés de l’administration : il a été conçu afin que nul citoyen ne soit éloigné de plus d’une journée à cheval de la préfecture. Il doit rester un échelon adapté à la mise en œuvre des solidarités territoriales et à l’accompagnement en termes d’ingénierie.
Monsieur le ministre, j’ai parfois tendance, entre autres défauts, à faire à la fois les questions et les réponses. Vous avez indiqué tout à l’heure que la question des départements et des régions serait traitée dans un autre texte. Or parler de la commune, c’est aussi parler du lien entre l’État et les différentes collectivités. Pourquoi, par conséquent, repousser ce débat aux calendes grecques ou à même à 2020 ? Il me paraît pertinent de réaffirmer d’ores et déjà, au travers du présent texte, la place du département.

Cet amendement empreint d’empathie à l’égard des départements relève d’une simple déclaration de principes et n’a pas de valeur normative. Mue par la volonté de privilégier la sobriété et l’efficacité de la loi, la commission a émis un avis défavorable.
Madame la sénatrice, j’ai cru comprendre qu’il s’agissait là d’un amendement d’appel. Oui, le Gouvernement croit en la strate départementale. Les conseils départementaux ont un avenir. Dans cette optique, il faut trouver des solutions sur le plan financier. Je ne partage pas complètement votre opinion sur la réforme de la fiscalité. L’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, ou le revenu de solidarité active, le RSA, sont des dépenses dynamiques, pour des raisons structurelles dans le premier cas, conjoncturelles dans le second. Vous qui êtes élue régionale, vous n’ignorez pas que les régions ne voulaient pas de la TVA il y a quelques années. Aujourd’hui, aucune ne songerait à y renoncer ! Affecter un impôt national aussi dynamique que la TVA aux conseils départementaux est plutôt une bonne idée à mon sens, mais nous aurons l’occasion d’en parler lors de l’examen du projet de loi de finances.
En tout état de cause, ne souhaitant pas émettre un avis défavorable sur un amendement qui parle à mon cœur, puisque j’aime la strate départementale, j’en demande le retrait. Ces questions pourront être mieux examinées lors de la discussion du projet de loi que présentera Jacqueline Gourault.

Mme Cécile Cukierman. Monsieur le ministre, mon objectif est de parler non pas à votre cœur, mais à votre raison, car nous sommes ici pour faire la loi, hors de toute passion !
Sourires.

Nous ne partageons pas votre vision du devenir de la fiscalité ; nous y reviendrons lors de l’examen du projet de loi de finances. Libre à vous d’estimer que la TVA est un impôt juste ; ce n’est pas notre cas.

Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui souhaitent que l’on remplace un impôt dynamique par un autre, certes lui aussi dynamique, mais totalement injuste !
Madame la rapporteure, votre réponse m’étonne quelque peu. J’ai souvenir que, lors de la discussion de la loi Maptam ou de la loi NOTRe, nous avions entériné, afin de permettre l’adoption finale de ces textes modifiés par le Sénat, un certain nombre de principes pour réaffirmer la place de la commune ou la libre administration des collectivités territoriales dont la portée législative n’était guère évidente. Comme l’a rappelé la semaine dernière M. le président de la commission des lois, certaines choses vont mieux en les disant !
Quoi qu’il en soit, monsieur le ministre, je vais retirer cet amendement, en vous donnant rendez-vous pour l’examen du projet de loi de Mme Gourault. Nous verrons alors quel sort vous entendez réserver aux départements. Bien que laïque, je suis comme saint Thomas : je ne crois que ce que je vois !

L’amendement n° 745 rectifié bis est retiré.
TITRE Ier
LIBERTÉS LOCALES : CONFORTER CHAQUE MAIRE DANS SON INTERCOMMUNALITÉ
Chapitre Ier
Le pacte de gouvernance : permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur EPCI

Les amendements n° 179 et 180 rectifié, faisant l’objet d’une discussion commune, ne sont pas soutenus, non plus que les amendements n° 174, 175 et 177.
L’amendement n° 744 rectifié, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mme Gréaume, M. Collombat, Mme Benbassa, M. Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Cohen, MM. Gay et P. Laurent, Mmes Lienemann et Prunaud et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogée.
La parole est à Mme Éliane Assassi.

Cet après-midi, plusieurs intervenants ont fait référence à la loi NOTRe, certains vantant ses mérites, d’autres dénonçant ses effets néfastes pour nos collectivités. Pour notre part, en parfaite cohérence avec nos positions passées, nous avons déposé cet amendement visant à l’abroger.
Cette loi marque le paroxysme des politiques menées depuis la fin du XXe siècle, et plus particulièrement ces dernières années, en matière de décentralisation, après la loi de 2010 de réforme des collectivités territoriales et la loi de 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ses dispositions ont dénaturé radicalement l’esprit ayant présidé à la création des EPCI : mettre en œuvre une intercommunalisation volontaire au service des communes, en complément du triptyque républicain communes-départements-régions.
L’application de la loi NOTRe a eu des conséquences néfastes pour le bon fonctionnement des collectivités territoriales, avec une intercommunalisation à marche forcée écrasant les communes pour créer des EPCI géants dont le périmètre n’a parfois aucune pertinence et dépouillant les communes de compétences qui leur tenaient pourtant à cœur et dont elles pouvaient assurer le bon exercice.
Dans le même temps, cette loi a révélé un désir de réduire, progressivement mais sûrement, la place des départements, qui ont perdu leur clause de compétence générale et vu nombre de leurs compétences passer aux mains des régions. Les gouvernements successifs menant ces politiques ne rêvent que de grandes régions européennes et de métropoles.
Aux contours naturels des territoires se sont substitués de grands ensembles irrationnels. Au libre transfert de compétences par les communes ont succédé des transferts forcés, au détriment du lien de proximité avec les citoyens qu’assuraient des élus désormais dépités, fatigués, démunis !
Nous refusons la politique de rafistolage du Gouvernement. Bien qu’il semble avoir compris que la voie ouverte par la loi NOTRe est profondément mauvaise, il ne propose que des modifications à la marge. Nous lui demandons aujourd’hui, ainsi qu’au Sénat, de prendre ses responsabilités.

Cet amendement procède effectivement d’une grande cohérence, mais il est quelque peu disruptif… On reconnaît bien là l’audace des sénateurs, parfois sous-estimée !
Cet amendement vise à demander l’abrogation de la loi NOTRe ; on ne peut pourtant pas dire que le roi est nu ! Les élus locaux ne veulent plus de big-bangs territoriaux. Certains d’entre eux sont insatisfaits, certes, mais il est nécessaire d’avancer. Les trois années d’efforts considérables de réorganisation qu’ils ont consentis ne doivent pas être vaines. Il faut desserrer l’étau, assouplir et aller un peu plus loin, monsieur le ministre.
Même si je partage un certain nombre de vos constats, madame la sénatrice, je ne peux qu’émettre un avis défavorable.
Là encore, il s’agit à mon sens d’un amendement d’appel visant à orienter la réflexion. J’en appelle cette fois à votre raison, et non à votre cœur, madame la sénatrice : abattre d’un coup de hache la loi NOTRe créerait une insécurité juridique. Je ne peux donc qu’émettre un avis défavorable, dans l’hypothèse où cet amendement ne serait pas retiré.

L’amendement n° 744 rectifié est retiré.
L’amendement n° 746 rectifié bis, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mmes Gréaume et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Cohen, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mmes Lienemann et Prunaud et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Conformément à l’article 37-1 de la Constitution et pour une durée maximale de trois ans, le représentant de l’État dans le département, ou le préfet de police à Paris, peuvent expérimenter, dans les départements et régions volontaires, pour un maximum de deux régions et de six départements, la mise en place d’un comité d’évaluation des politiques de décentralisation depuis la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique.
II. – Cette expérimentation permet de faire un bilan des politiques de coopération intercommunale en analysant les conséquences en termes de services publics, de contrôle des citoyens sur l’action publique et d’efficacité financière, sociale et organisationnelle.
III. – Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d’apprécier l’opportunité de telles politiques imposant aux communes la coopération intercommunale et des transferts obligatoires de compétences.
La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Comme je l’ai souligné lors de la discussion générale, ce projet de loi marque tout de même un point d’arrêt par rapport à un certain nombre de lois précédentes visant en réalité à dévitaliser l’échelon communal, sous couvert de décentralisation.
Nous souhaitons qu’un point soit fait sur les politiques de décentralisation conduites depuis les années quatre-vingt dans notre pays. Dans cette optique, le présent amendement vise à permettre leur évaluation par la voie de l’expérimentation dans les départements et les régions.
Cela nous paraît nécessaire avant de légiférer de nouveau. Il convient en effet de ne pas naviguer à l’aveugle, sachant que rien aujourd’hui ne nous permet d’affirmer que les politiques successives d’intercommunalisation à marche forcée répondent effectivement aux enjeux.
Vous parlez de lever les irritants de la loi NOTRe, monsieur le ministre, mais nous demandons davantage pour notre part. Il nous paraît nécessaire d’étudier la mise en œuvre des différentes lois que j’évoquais pour comprendre comment ont pu apparaître ces fameux irritants, qui ne sont pas simplement issus de la loi NOTRe. Il conviendrait également de savoir ce que ces politiques ont apporté aux citoyens, aux élus, aux collectivités et in fine à la République.
À l’heure où le Gouvernement souhaite rationaliser les services publics en coupant dans les moyens et dans les effectifs, pouvez-vous nous dire si les conséquences financières de ces politiques ont été positives ? Peut-on parler de mesures efficaces au vu de la complexité de la répartition des compétences ? La mandature qui s’achèvera au mois de mars prochain a été marquée à cet égard par un grand chamboule-tout institutionnel.
Nous nous intéressons aussi aux conséquences sociales et culturelles de ces réformes, ainsi qu’au vécu des élus et des administrés. Nous ne pouvons rester inactifs devant le découragement des élus et les fractures territoriales qui s’amplifient.

Ma chère collègue, l’appel à l’évaluation est entendu par tous, me semble-t-il. Nous devrions d’ailleurs pratiquer cet exercice plus régulièrement. Toutefois, votre proposition de créer des comités d’évaluation expérimentaux de la mise en œuvre des lois de décentralisation intégrant des préfets me semble satisfaite : n’est-ce pas le rôle du Parlement d’évaluer et de contrôler ? Le président de la commission des lois a d’ailleurs mis en place une mission d’évaluation des lois d’organisation territoriale. Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Je ne le retire pas.
J’entends ce que vous dites sur le rôle du Parlement, madame la rapporteure. Loin de nous l’intention de le fragiliser dans son action de contrôle et d’évaluation, d’autant que l’on pourrait faire beaucoup mieux. Nous pourrions, par exemple, revoir comment l’on entend collectivement, du côté tant du Parlement que du Gouvernement, cette mission de contrôle.
Je me permets d’insister sur l’objet premier de cet amendement, qui est d’organiser une expérimentation au sein des collectivités territoriales, en associant l’ensemble des acteurs qui ont apprécié ou subi, selon les cas, les différentes lois de décentralisation. Le dispositif de cet amendement ne s’oppose pas au rôle du Parlement. Il pourrait au contraire en être tout à fait complémentaire.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous -section 3
« Relations entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres
« Art. L. 5211 -11 -1. – I. – Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement.
« Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il l’adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l’opération prévue au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes membres.
« II. – Le pacte détermine :
« 1° Dans les communautés de communes, les communautés d’agglomération et les communautés urbaines, s’il est créé une conférence des maires telle que mentionnée à l’article L. 5211-11-2 ;
« 2° Le cas échéant, la composition et les modalités de fonctionnement de la conférence des maires ;
« 3° Les modalités de mutualisation de services entre les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres afin d’assurer une meilleure organisation des services ;
« 4° Les conditions dans lesquelles est mis en œuvre l’article L. 5211-57 ;
« 5° Éventuellement, les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions créées dans les conditions prévues aux articles L. 2121-22 et L. 5211-40-1.
« III. – Le pacte peut prévoir :
« 1° Les conditions dans lesquelles l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut, par convention, confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. La convention répond aux mêmes exigences que celles prévues à l’article L. 1111-8 ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut déléguer au maire l’engagement de certaines dépenses d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d’une autorité fonctionnelle sur les services de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services.
« IV. – La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
« Art. L. 5211 -11 -2. – I. – La conférence des maires est une instance de coordination entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d’intérêt communautaire ou relatifs à l’harmonisation de l’action de ces personnes publiques.
« La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les métropoles.
« Dans les autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sa création est facultative. Toutefois, dès lors que 30 % des maires des communes membres de la communauté urbaine, de la communauté d’agglomération ou de la communauté de communes considérée en ont fait la demande par courrier adressé au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la création de la conférence des maires est obligatoire.
« II. – La conférence des maires est présidée de droit par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et comprend, en outre, les maires des communes membres.
« Elle se réunit, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la demande d’un tiers des maires.
« Le présent II s’applique sous réserve des mesures prévues par le pacte de gouvernance mentionné à l’article L. 5211-11-1. »
II. – Les articles L. 5211-40 et L. 5217-8 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.
III. – L’article L. 5832-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les articles L. 5211-11-1 et L. 5211-11-2 ; »
2° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° L’article L. 5211-40-1 ; ».

Le pacte de gouvernance pourra prévoir la mise en place d’une instance de dialogue des maires de communes appartenant à un même EPCI, autrement dit d’un conseil ou d’une conférence des maires. Il en existe déjà dans de nombreux EPCI. Ces instances ont un objet d’intérêt général, à savoir conforter la place des maires au sein des EPCI, notamment lorsqu’ils ne sont pas membres du bureau. Trop souvent en effet, les maires des petites communes ont des difficultés à se faire entendre au sein des intercommunalités.
Par ailleurs, créer une telle instance de dialogue et de concertation entre les exécutifs locaux sur des projets communautaires, ainsi que sur des questions de coordination entre les actions engagées par les communes et celles des EPCI, constituerait une réelle avancée.
Depuis des mois, nous débattons de ce sujet. Même si une très large majorité des EPCI ont déjà instauré une telle instance de dialogue, il n’en demeure pas moins que ce n’est pas le cas d’un nombre important d’entre eux.
Faut-il rendre obligatoire la mise en place d’une telle conférence des maires, sorte de bureau élargi, avec le risque d’alourdir la réglementation et d’imposer de nouvelles contraintes ? Doit-on, au contraire, la rendre facultative ? Dans certains cas, elle ne verra alors pas le jour, l’exécutif intercommunal pouvant n’avoir aucun désir de voir se réunir régulièrement l’ensemble des maires. Faut-il opter pour un dispositif facultatif, mais en donnant la possibilité, par exemple à 30 % des maires de l’EPCI, d’imposer la création d’une telle instance de dialogue, avec le risque d’aboutir à des situations de désaccord entre les maires et de « gâcher l’ambiance » ? En outre, à quel niveau fixer le seuil : 20 %, 25 %, 30 %, 33 % ?
Bref, aucune de ces solutions n’est exempte de critiques. Chacune peut être source de problèmes. La plus satisfaisante consisterait sans doute à créer cette instance de dialogue dès lors que le bureau de l’EPCI ne comprendrait pas l’ensemble des maires des communes membres. Ce serait d’ailleurs un bon moyen d’inciter les maires à faire partie du bureau de l’EPCI. Nous présenterons un amendement en ce sens.

La délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, à laquelle j’ai l’honneur et le grand plaisir d’appartenir depuis sa création, se préoccupe de la question de la place des élus municipaux dans les intercommunalités depuis très longtemps. Elle avait ainsi relevé, en septembre 2018, dans son ample rapport sur les conditions d’exercice des mandats locaux, le sentiment d’inquiétude et de dépossession des élus municipaux résultant de l’orientation prise par la construction intercommunale depuis les lois Maptam et NOTRe. Des voix de plus en plus nombreuses s’élevaient pour dire que « l’esprit n’y était plus ». Le président du Sénat notait que « les élus municipaux ont le sentiment d’être pris dans de vastes ensembles, et parfois décrochent ».
Certains de nos collègues ont eu la gentillesse de le rappeler, Patricia Schillinger, que je salue, et moi-même avons produit un rapport, adopté le 6 mai 2019 à l’unanimité par notre délégation. Au travers d’exemples concrets, nous y avons répertorié et mis en valeur les bonnes pratiques en matière d’organisation des relations entre l’intercommunalité et les communes. Outre la mise en place d’une consultation numérique, qui a permis de recueillir près de 4 000 réponses, nous nous sommes déplacés sur le terrain et avons fait partout le même constat : les maires et les élus municipaux non communautaires ne se sentent pas suffisamment associés à la gouvernance des EPCI.
Nous avons donc formulé douze recommandations visant à renforcer la place des élus municipaux dans cette gouvernance. La première d’entre elles est ainsi intitulée : « se doter d’une charte de gouvernance pour définir les rôles respectifs entre les communes et la communauté, et formaliser la coopération entre communes membres dans le respect de chaque territoire ». Je citerai encore la proposition n° 4 : « prévoir, dans le fonctionnement de l’EPCI, une instance spécifique de dialogue des maires et faire en sorte que ceux-ci deviennent des relais de l’action communautaire dans chaque territoire ».
Ces recommandations sont reprises au travers de l’article 1er du présent projet de loi, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela témoigne d’une belle concordance de nos préoccupations s’agissant des « irritants » de la loi NOTRe. Croyez bien, monsieur le ministre, que nous sommes sensibles à cette convergence de propositions relatives à la gouvernance et au conseil des maires, que nous entendons comme la résultante des bonnes pratiques observées sur le terrain. Nous devons nous en inspirer avec pragmatisme, tout en évitant de créer de nouvelles obligations normatives.

Mon intervention portera en fait sur l’ensemble des articles du titre Ier. Elle est inspirée par notre volonté de conforter la place du maire au sein de l’intercommunalité.
Dans le cadre de rencontres organisées sur le territoire avec les élus locaux, nous avons constaté que persistait un sentiment de frustration, dû notamment à un manque de débat tenant soit au nombre important d’élus dans les grandes intercommunalités, qui nuit à la qualité des échanges et réduit les possibilités d’intervenir, soit tout simplement à la multiplicité des questions inscrites à l’ordre du jour. Lorsqu’il reste, à vingt-trois heures trente, encore dix points à aborder, certains élus n’osent plus s’exprimer ; cela peut d’ailleurs les mettre en difficulté lorsqu’ils reviennent devant leur conseil municipal…
Du fait des regroupements de communes à marche forcée, beaucoup d’intercommunalités n’ont plus aujourd’hui aucune cohérence. On voit les limites de cette démarche, y compris dans le fonctionnement des EPCI.
Nous avons toujours milité pour des intercommunalités à taille humaine, fondées sur un projet territorial commun, et nous continuerons à le faire au cours de la discussion de ce projet de loi. Nous présenterons des amendements visant à redonner du pouvoir aux maires au sein des intercommunalités. Nous pensons en effet qu’au-delà de l’affirmation des grands principes, il est nécessaire de mettre des outils à disposition et d’aller plus loin sur un certain nombre de points pour redonner aux maires la maîtrise des enjeux politiques au sein des intercommunalités.

Je parcours moi aussi chaque week-end mon département, qui comprend quelque 800 communes et 20 intercommunalités, pour 530 000 habitants. Je rencontre des maires, des femmes, des hommes déterminés, parlant avec enthousiasme de leur village, décrivant une qualité de vie recherchée. Ils constituent la première marche de la démocratie dans notre pays, ils mettent en œuvre des projets d’aménagement, ils sont les animateurs infatigables de leur commune, ils donnent une portée concrète à un premier niveau de solidarité.
Je veux me faire ici l’écho de leurs difficultés, mais aussi de leur volonté de construire, encore et toujours, un avenir possible sur des territoires économiquement et socialement éprouvés.
Dans la crise exacerbée de la représentation politique que nous connaissons, le maire conserve largement la confiance des citoyens. Il est celui que l’on identifie, qu’il est possible d’interpeller dans la rue, celui que l’on imagine encore chargé de régler tous les problèmes de la vie quotidienne, alors que désormais ceux-ci relèvent souvent de l’échelon communautaire.
Assumé la plupart du temps à titre quasiment bénévole, l’engagement du maire est synonyme de sacrifices personnels. Son coût humain est important en termes de responsabilité, d’exposition à la violence, de normes à appréhender, de vie familiale perturbée, de compatibilité avec un exercice professionnel.
Évolution ou suppression des services publics, extension souvent à marche forcée des périmètres des intercommunalités amenant à s’interroger sur la nature des processus démocratiques qui se déroulent en leur sein, dévitalisation des centres-bourgs ou centres-villes, concentration de familles en grande souffrance : les élus locaux sont confrontés à des problématiques qui dépassent leur pouvoir d’action, mais dont les effets les touchent directement.
L’échelon communal a bien sûr perdu sa pertinence en termes d’offre de nouveaux services à la population, d’investissements, d’aménagements lourds, et la dimension communautaire est aujourd’hui incontournable. Mais la présence, l’autorité, l’initiative du maire demeurent indispensables à une vie équilibrée dans la ruralité de notre pays.
Vous l’aurez compris, je soutiendrai la création de conseils des maires, prévue à l’article 1er, même si son caractère facultatif et les modalités proposées ne permettront pas qu’elle suffise à remédier aux dysfonctionnements dans les relations entre l’intercommunalité et ses communes.

Le département des Alpes de Haute-Provence compte deux communautés d’agglomération, six communautés de communes dont le siège est situé dans le département et quatre autres dont le siège est hors du département. Nous sommes donc en présence d’EPCI pouvant compter quarante, voire soixante communes membres, et à cheval sur deux départements, parfois même sur deux régions.
Le périmètre d’action des intercommunalités rurales et de montagne renforce, à n’en pas douter, le sentiment d’éloignement et de disparition des communes membres dans des ensembles dont l’identité est en construction. Dans ce contexte, le transfert de compétences complet et le transfert de compétences morcelé, quand il s’agit par exemple de la compétence scolaire ou de l’urbanisme, sont largement vécus comme une dépossession par les maires des petites communes.
La création de la conférence des maires est une bonne chose. Pour autant, à notre sens, elle n’est pas suffisante.
Pierre Mendès France écrivait, dans La République moderne, que « la démocratie ne consiste pas à mettre épisodiquement un bulletin dans une urne, à déléguer les pouvoirs à un ou plusieurs élus puis à se désintéresser, s’abstenir, se taire pendant cinq ans. Elle est action continuelle du citoyen non seulement sur les affaires de l’État, mais sur celles de la région, de la commune, de la coopérative, de l’association, de la profession. »
Il en va de même pour les maires de petites communes membres de grandes communautés de communes. Nous pensons qu’il faut inventer un autre mode de gouvernance, associant de manière plus continue les maires. Ce texte, de manière générale, tend à renforcer le rôle institutionnel des maires, en améliorant la communication et en renforçant les possibilités de blocage d’un projet. C’est une étape à prendre en compte. Il faudrait, en parallèle, veiller à améliorer le rôle décisionnel des communes et mettre en place une véritable codécision, un travail en commun. Notre groupe présentera plusieurs amendements en ce sens.

Le Gouvernement entend affirmer sa volonté de conforter le rôle du maire au sein d’une intercommunalité qui a été profondément bouleversée par la mise en œuvre de la loi NOTRe. Avec celle-ci, on a en effet réussi le tour de force de fragiliser les communes comme échelons de proximité et d’affaiblir l’idée intercommunale au profit d’une supracommunalité ivre d’elle-même et portée par une logique d’intégration à marche forcée.
Ce double mouvement, à l’œuvre depuis quelques années, a profondément bouleversé l’équilibre au sein du bloc communal et nourri des tensions très dommageables dans le couple communes-communauté de communes. Cette situation conduit aujourd’hui le Gouvernement – sur la requête, il est vrai, du Sénat – à tenter de réformer et de répondre à un besoin de proximité de plus en plus fort issu des territoires, dans l’attente d’un projet de loi relatif à la décentralisation annoncé pour le second semestre de 2020.
Le présent article a au moins le mérite de chercher à redonner une place véritable, si possible centrale, au maire. Oui, il est impératif d’inverser la logique à l’œuvre ces dernières années, qui a nourri chez les maires un réel sentiment de dépossession. Il faut que l’intercommunalité se construise avec le consentement des élus communaux, et non contre ou malgré eux.
Vous pouvez compter sur le Sénat et sa commission des lois pour renforcer les mesures proposées par le Gouvernement, pour peu, évidemment, qu’elles visent à consolider la place des communes et des maires dans le fonctionnement de l’intercommunalité. C’est l’objet de cet article, qui prévoit l’instauration d’un pacte de gouvernance. Seule une véritable association des maires à la gouvernance de l’intercommunalité permettra de trouver un équilibre entre les communes, dont l’intercommunalité est en principe l’émanation.
L’intercommunalité doit se construire à partir d’une vision et d’un projet intercommunaux, construits collectivement. De même, l’instauration d’un conseil des maires est un moyen de favoriser le dialogue et la connaissance des problématiques communes et, finalement, de faire en sorte que la commune redevienne, comme l’a dit notre collègue Mathieu Darnaud, la porte d’entrée de l’intercommunalité.

Je vais vous étonner, mes chers collègues, mais, pour une fois, je suis en accord avec la méthode qui a conduit à l’élaboration de ce projet de loi, d’une part, et avec l’objectif de celui-ci, d’autre part.
Le présent texte a ainsi été élaboré à la suite de rencontres avec les associations d’élus, les parlementaires engagés sur le sujet des collectivités territoriales et les présidents de groupe du Sénat. Plus de 500 contributions ont ainsi été reçues, analysées et intégrées. L’exécutif ne nous avait pas habitués à tant d’égards ! Il faut dire que les maires et, plus généralement, les 600 000 élus locaux, se sentant dépossédés, déclassés et impuissants, ont fait entendre leurs doléances pendant le grand débat national.
L’objectif annoncé de « revaloriser le bloc communal et la figure du maire, qui est centrale dans notre histoire et notre identité commune » – je reprends ici vos propos, monsieur le ministre – ne peut trouver qu’un écho favorable en ce lieu.
Ce texte entend valoriser et accompagner ceux qui s’engagent pour la collectivité, en améliorant les conditions d’exercice des mandats locaux. Il vise également à étendre les libertés locales, à conforter le rôle du maire pour que celui-ci puisse trouver un meilleur équilibre avec son intercommunalité, à simplifier le quotidien des élus locaux et à mieux adapter certaines règles ou certains seuils aux réalités territoriales.
Si ce projet de loi va effectivement dans le bon sens, ses mesures, par ailleurs hétéroclites, seront-elles suffisantes pour atténuer le mal-être des maires, dont près de la moitié sont prêts à jeter l’éponge à l’occasion du prochain scrutin municipal de mars 2020 ? Elles constituent plutôt, à mon sens, une avancée, un premier pas qui doit en amener d’autres ! Il y a urgence à revaloriser, à revitaliser la démocratie en agissant au plus près des territoires.
Cela devrait également passer, et c’est ce qui manque aussi à ce texte, par une prise en compte, au titre du calcul des droits à la retraite, du travail de maire. J’espère que cette lacune sera corrigée à très court terme.

Cela m’oblige à reprendre la parole…
L’article 1er a pour objet la place des maires dans l’intercommunalité. Les pôles territoriaux seront-ils dotés, au travers du présent texte ou de celui que défendra Mme Gourault, d’un cadre clair au sein des intercommunalités « XXL », voire « XXXL » pour ce qui concerne le Pays basque ?
En effet, la relation des maires avec une intercommunalité qui compte 158 communes et 238 conseillers communautaires passe obligatoirement aussi par des pôles territoriaux. Les maires ont besoin, dans ces grands ensembles qu’ils ont certes voulus – au Pays basque, par exemple, il n’y a pas eu besoin de « passer outre » –, de pouvoir se retrouver au sein d’un ensemble territorial de plus petit périmètre pour évoquer les dossiers concrets, en retrouvant les principes mêmes qui ont guidé la création des grandes intercommunalités : synergie et cohérence pour la définition de schémas à grande échelle, qui est parfois la bonne, et proximité pour la gestion du quotidien.
Aujourd’hui, lorsqu’un administré de Mauléon est confronté à un problème de conteneur, il doit s’adresser à une lointaine administration, situé à Bayonne, pour le régler. Certes, le schéma de collecte et de traitement des déchets doit être élaboré à grande échelle, celle du Pays basque. J’étais favorable, en tant qu’élu, à la création de la grande intercommunalité du Pays basque, mais certainement pas pour que cela conduise à ce que nos concitoyens se perdent dans le dédale d’une administration tentaculaire pour régler des problèmes de conteneur !
Certes, nos concitoyens ne connaissent que le maire, qui est « à portée d’engueulade », comme le dit le président Larcher, mais trop d’engueulades peuvent mener au découragement !
Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe UC.

Dans mon département du Calvados comme ailleurs, les maires, en particulier ceux des petites communes rurales, demandent que la création de cet outil de dialogue et de concertation qu’est la conférence des maires soit obligatoire. Je les comprends, car une intercommunalité ne peut convenablement fonctionner si elle n’est pas, d’une certaine manière, « partagée ». J’aurais d’ailleurs pu dire la même chose au sujet du pacte de gouvernance.
En l’état actuel du texte, le caractère facultatif de la création de la conférence des maires et les modalités proposées risquent de rendre le dispositif insuffisant pour résoudre les dysfonctionnements. Rappelons que cette instance aura pour objet de débattre des orientations politiques et des décisions importantes de l’EPCI.
En rendant obligatoire, et non plus facultative, la mise en place d’un tel outil, on assurerait à toutes les petites communes rurales une certaine visibilité dans le traitement des projets intercommunaux. C’est très important ; elles ne sont pas des communes de seconde zone ! Le Gouvernement, par la voix du Premier ministre, n’a-t-il pas récemment présenté un « agenda rural » ?
Il faut passer de la parole aux actes : au sein des intercommunalités, tout doit être fait pour garantir l’équilibre territorial, le respect de la souveraineté des communes, la recherche du plus large consensus et le partage des décisions. En rendant la création de la conférence des maires obligatoire, on reconnaîtra le rôle central des maires. Il me semble que telle est l’ambition de ce texte.
M. Roland Courteau applaudit.

Je suis saisie de dix amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 383 rectifié, présenté par MM. Kerrouche, Durain, Marie, Kanner et Jacques Bigot, Mme de la Gontrie, M. Fichet, Mme Harribey, MM. Leconte, Sueur et Sutour, Mme Blondin, MM. Montaugé, Courteau, Daunis, Bérit-Débat, Antiste et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 4 et 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 5211-11-1. – I. – Dans chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est établi un pacte de gouvernance.
« Le pacte de gouvernance détermine les modalités de la coopération entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres. Il est élaboré après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3. Il est adopté, après avis des conseils municipaux des communes membres, au plus tard le 31 décembre de l’année du renouvellement général ou dans les neuf mois qui suivent une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3.
La parole est à M. Éric Kerrouche.

Monsieur le ministre, vous avez choisi de caricaturer une partie de nos propos. Pourquoi pas, mais il faut désormais entrer dans le cœur de notre discussion, et essayer d’améliorer autant que faire se peut le texte, voire nous accorder sur certaines dispositions.
En l’espèce, j’ai du mal à comprendre ce qui empêche de faire du pacte de gouvernance la règle de droit commun dans les EPCI, comme nous le proposons. Vous me répondrez qu’il faut faire confiance aux élus dans les territoires. Nous sommes tout à fait d’accord sur ce point, mais, « en même temps », il est nécessaire d’associer au mieux les conseillers municipaux, les conseillers communautaires et les maires au sein de l’instance intercommunale. Quoi de mieux à cet égard que d’instaurer l’obligation de conclure, à chaque renouvellement de celle-ci, un pacte fixant les règles du jeu pour les six années à venir ? Pourquoi ne serait-il pas possible de mettre en place une instance dont l’existence même permettrait le rapprochement, que vous dites souhaiter, entre les communes et l’intercommunalité ?

L’amendement n° 590 rectifié, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Conway-Mouret, MM. Duran et Daudigny et Mme Monier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 5211-11-1. – I. – Dans les dix mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue par l’article L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale adopte un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres.
« Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale adopte un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Le pacte de gouvernance vise à améliorer la coopération entre communes et intercommunalité. Son instauration est souhaitée de longue date par beaucoup d’acteurs locaux et elle est saluée par de nombreux élus.
Cependant, le lien entre communes et intercommunalité étant souvent insuffisant, nous devons rendre obligatoire la création de ce nouvel outil de renforcement de la relation entre les différents maillons de la politique locale. Cet amendement a pour objet de faire en sorte que les éléments bénéfiques de ce pacte puissent profiter à toutes les communes de France.
Par ailleurs, le délai de six mois prévu dans le projet de loi pour l’adoption du pacte semble trop court. L’amendement vise donc à le porter à dix mois.

L’amendement n° 748, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Savoldelli, Mmes Gréaume et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Apourceau-Poly, Brulin et Cohen, MM. Gay, Gontard et P. Laurent, Mmes Lienemann et Prunaud et M. Ouzoulias, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Remplacer la référence :
L. 5211-5-1 A
par la référence :
L. 5211-5-1
2° Supprimer les mots :
à fiscalité propre
3° Remplacer les mots :
un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement
par les mots :
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement de coopération intercommunale dont elles sont membres
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
Si l’organe délibérant de l’élaboration d’un pacte, il adopte dans un délai de neuf mois à compter du
par les mots :
Ce pacte est adopté dans les neuf mois qui suivent le
La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Cet amendement vise également à rendre l’établissement du pacte de gouvernance obligatoire. Un tel outil est en effet essentiel au bon fonctionnement d’un EPCI. Il permet d’établir des relations satisfaisantes avec les communes et leurs élus. L’établissement d’un pacte de gouvernance est, d’ores et déjà, une pratique courante, et le présent dispositif reprend largement ce qui existe dans nombre d’EPCI.
Tout en respectant le principe de libre administration des collectivités territoriales, nous estimons que donner à ce pacte un caractère facultatif n’encouragera pas les EPCI au sein desquels les relations avec les mairies sont tendues et problématiques à le mettre en place. Un tel pacte risque de n’être conclu que dans les intercommunalités où règne une bonne entente.
Rendre obligatoire ce pacte permettra de poser un cadre consensuel de réflexion sur la gouvernance de l’intercommunalité et les relations avec les communes membres. À chaque renouvellement ou création d’un EPCI, il semble cohérent de partir sur de bonnes bases en ouvrant ce débat entre les communes et en leur laissant ensuite la possibilité ensuite de définir ce pacte comme elles le souhaitent, en coordination avec l’EPCI.

L’amendement n° 674 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Longeot, L. Hervé, Cigolotti et Médevielle, Mmes Morin-Desailly et Billon, M. Prince, Mmes Sollogoub et Vérien, M. Mandelli, Mme Duranton, MM. Mizzon, de Nicolaÿ et P. Martin, Mme Létard, M. Decool, Mme Ramond, M. Delcros, Mme Vermeillet, M. Guerriau, Mme Sittler et MM. Gremillet et H. Leroy, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après la référence :
L. 5211-41-3,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres est adopté dans les neuf mois, par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, après avis des conseils municipaux des communes membres.
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Loïc Hervé.

Cet amendement, dont Hervé Maurey est le premier signataire, vise à rendre obligatoire l’adoption d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’EPCI dans les neuf mois suivant la mise en place du conseil communautaire.
Il est très important de rendre la conclusion d’un tel pacte obligatoire. On sait dans quelles conditions se déroule souvent l’élection du président, des vice-présidents et du bureau de l’intercommunalité… On ne consacre pas assez de temps, au sein des intercommunalités, à définir des principes et des règles de gouvernance. La mesure proposée nous semble aller dans le bon sens.

L’amendement n° 20, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’élaboration d’un pacte est obligatoire pour les métropoles.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.

L’étude d’impact du projet de loi indique que les métropoles sont des EPCI très intégrés. Le présent article prévoit ainsi l’obligation de créer une conférence des maires pour les métropoles, en remplacement de l’actuelle conférence métropolitaine. Je propose de rendre également obligatoire l’élaboration d’un pacte de gouvernance pour les métropoles.
Je siège depuis mars 1983 au sein de l’intercommunalité de Montpellier, jusqu’à il y a deux ans en tant que maire et désormais comme simple conseiller métropolitain. J’ai assisté à la dérive épouvantable qui s’est produite depuis la constitution de la métropole. Le président de la métropole de Montpellier considère que celle-ci n’est pas un EPCI, mais une collectivité de plein exercice. Cela signifie, en définitive, que la loi n’y est pas respectée. Nous voulons qu’elle le soit !

L’amendement n° 124 rectifié bis, présenté par MM. P. Joly, Lozach et Antiste, Mme Jasmin, MM. Tourenne, Courteau, Vaugrenard et Tissot, Mmes Féret et Perol-Dumont, MM. Montaugé, Duran et Temal et Mme Monier, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dès lors que l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte de gouvernance, est systématiquement évoquée la question de la création d’un conseil de développement.
La parole est à M. Maurice Antiste.

Il s’agit d’un amendement de repli, dans l’hypothèse où les conseils de développement deviendraient facultatifs.
Les conseils de développement sont en cours de généralisation dans les intercommunalités de plus de 20 000 habitants. Cette dynamique est récente et fragile. Pour perdurer, elle a encore besoin d’être encouragée et accompagnée, jusqu’à assurer un maillage suffisant dans l’ensemble des territoires, ruraux et urbains.
Ne pas favoriser l’existence des conseils de développement briserait l’élan et constituerait un retour en arrière en matière de mobilisation citoyenne, fragilisant les plus récents d’entre eux dans un contexte de renouvellement des mandats.
Il y a lieu de prendre en compte les apports des conseils de développement. Outre leur contribution à l’enrichissement des politiques publiques, ils constituent, à l’échelle intercommunale, l’un des seuls lieux organisés dans lesquels les désaccords peuvent s’exprimer de manière argumentée et se réduire de façon apaisée. Dans un contexte marqué par la défiance et l’urgence écologique, ils font vivre et contribuent à diffuser les valeurs d’écoute et de respect de l’autre, d’attention à l’intérêt général et d’une citoyenneté active et responsable.
Il est donc nécessaire, à défaut de conserver l’article L. 5211-10-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction actuelle, de prévoir au moins la tenue d’un débat, dès le renouvellement des mandats intercommunaux, sur la mise en place d’un conseil de développement.

L’amendement n° 633 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Laménie, Meurant et Frassa, Mme Deromedi, M. Guerriau et Mmes Bruguière et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un pacte, il
par les mots :
L’organe délibérant
La parole est à M. Henri Leroy.

Le pacte de gouvernance est un outil important, qui permet aux élus locaux, et surtout à l’exécutif de chaque commune membre, de s’accorder sur le fonctionnement de leur EPCI, ainsi que sur l’ordre du jour de la prochaine séance.
En l’état, le projet de loi prévoit que sa création soit une simple possibilité. Compte tenu de sa pertinence et de son indubitable utilité, je propose de rendre sa conclusion obligatoire.

L’amendement n° 462, présenté par MM. Patriat, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer le nombre :
neuf
par le nombre :
six
La parole est à M. Arnaud de Belenet.

Ce modeste amendement de bon sens vise à réduire de neuf à six mois le délai pour la conclusion du pacte de gouvernance. Si l’élection a lieu en mars, un délai de six mois conduit à la fin septembre : cela laisse le temps de travailler avant l’été et de finaliser le pacte pour la rentrée. Avec le délai de neuf mois prévu par le texte actuel, c’est une année pleine qui passe avant que le pacte soit conclu. On perd alors cette période stratégique qu’est la première année du mandat. On sait en effet que, dans les intercommunalités, l’essentiel se met en place au cours de cette période.

L’amendement n° 904 rectifié, présenté par M. Jacquin, Mmes Jasmin et Conway-Mouret et MM. Vaugrenard, Temal, Tissot et Daudigny, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
neuf
par le mot :
douze
II. – Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ….° Les conditions dans lesquelles l’intercommunalité entend coopérer avec les collectivités voisines.
La parole est à M. Olivier Jacquin.

Le présent amendement a un double objet.
En premier lieu, il vise à instaurer davantage de cohésion à l’intérieur du bloc communal en disposant que le pacte de gouvernance prévoie, le cas échéant, l’établissement de liens avec les collectivités voisines. En effet, les périmètres administratifs ne correspondent pas systématiquement aux bassins de vie ni aux périmètres de pertinence de certaines politiques publiques, qui nécessitent d’être définies à une échelle plus vaste. C’est le cas, par exemple, pour les mobilités, l’économie, le tourisme, la santé, les réseaux numériques, etc.
Ainsi, pour pleinement satisfaire l’ensemble des communes et des administrés d’un EPCI, il peut être nécessaire d’envisager des partenariats avec les collectivités voisines, a fortiori en l’absence de pôles d’équilibre territorial et rural.
Adopter une telle disposition serait gage d’une plus grande cohésion et permettrait de rassurer les communes excentrées au regard de la mise en œuvre de certaines politiques publiques : elles auraient la garantie que leur EPCI se donne au moins une obligation de moyens en vue de bien les raccorder à celle-ci.
Vu sous un autre angle, celui du regard de nos concitoyens, les habitudes de vie de ceux-ci dépassent souvent le cadre administratif de leur EPCI de résidence. Aussi, même avec des EPCI agrandis, il s’agit d’anticiper le fait que ces continuités s’épanouiront et que des connexions seront tentées, voire établies. En présence d’un PETR, qui a pour objet partiel de répondre à cette logique, l’EPCI en périphérie de ce PETR visera à s’assurer des continuités hors PETR pour certaines politiques publiques.
En second lieu, l’amendement vise à porter le délai d’élaboration du pacte de gouvernance de neuf à douze mois, compte tenu de l’importance de ce document.

L’amendement n° 636 rectifié, présenté par MM. H. Leroy, Laménie, Meurant et Frassa, Mme Deromedi, M. Guerriau et Mmes Bruguière et Sittler, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet article par les mots :
et l’annexe à son règlement intérieur
La parole est à M. Henri Leroy.

Cet amendement tend à s’inscrire dans la continuité de ma proposition précédente.
Afin de permettre une meilleure lisibilité des documents qui ont trait au fonctionnement interne de l’EPCI, je vous propose, mes chers collègues, d’inscrire dans la loi que le pacte de gouvernance doit être annexé au règlement intérieur des EPCI.

L’ensemble de ces amendements a pour objet cette nouveauté qu’est le pacte de gouvernance. Celui-ci répond, je le crois, à l’aspiration des communes d’être plus associées, au souhait que soit bien respecté le principe de coopération intercommunale et à la volonté de remettre le maire et les élus locaux au cœur des décisions.
Les amendements n° 383 rectifié, 590 rectifié, 748, 674 rectifié bis et 633 rectifié visent l’obligation pour tous les EPCI de conclure un pacte de gouvernance, l’amendement n° 20, que je rattache aux précédents, ayant quant à lui pour objet d’instaurer cette obligation seulement pour les métropoles.
Avec ce texte, nous voulons accorder de la liberté et remettre le maire au cœur du village républicain, si je puis dire. Un élément extrêmement important doit être pris en considération : la discussion portant sur l’élaboration ou non d’un pacte de gouvernance est obligatoire, puisqu’elle est inscrite dans la loi. Nul ne peut donc esquiver ce sujet.
Le pacte de gouvernance permettra aussi d’associer les communes, puisque leur consultation pour avis a été introduite dans le texte par la commission des lois. Afin que les élus disposent de suffisamment de temps, et que les communes puissent être sollicitées, nous avons prévu un délai de neuf mois.
Enfin, mes chers collègues, si nous instituions l’obligation de conclure un pacte de gouvernance, celui-ci pourrait n’être qu’une enveloppe vide. C’est la raison pour laquelle nous avons défini un certain nombre d’items qui doivent figurer dans ce pacte : je pense notamment à la suggestion de certains collègues, dont Bernard Delcros, d’y intégrer les éléments de solidarité financière, et à l’évocation des délégations qui pourraient être accordées.
Nous avons intégré dans la loi un dispositif assez complet, mais les discussions nous ont montré qu’il y avait presque autant d’EPCI que de réalités territoriales et de réalités de gouvernance. Tout EPCI peut compléter le pacte de gouvernance à sa guise, en y ajoutant des éléments qui relèvent même du règlement intérieur. Ce pacte peut donc être enrichi selon les choix et la volonté des élus locaux. Je rappelle par ailleurs que l’avis des communes membres sera bien sollicité.
Nous avons apporté là, me semble-t-il, une excellente réponse à l’expression des élus, qui demandent à être davantage associés. Néanmoins, il faut que nous soyons raisonnables quant à ce que nous allons mettre dans la loi. C’est la raison pour laquelle je suis défavorable aux amendements que j’ai cités. Et j’indique que la commission des lois a prévu que la conférence des maires était obligatoire.
M. Joly souhaite, au travers de l’amendement n° 124 rectifié bis, que soit systématiquement évoquée dans le pacte de gouvernance la question de la création d’un conseil de développement.
Je ne développerai pas plus avant ce sujet, parce qu’il faut garder un peu de plaisir pour plus tard et que nous ne manquerons pas d’avoir des échanges stimulants… Je rappelle simplement que la commission des lois a conservé le caractère facultatif des conseils de développement.
MM. Antoine Lefèvre et André Reichardt manifestent leur approbation.

Toutefois, nous avons proposé à M. Joly d’émettre un avis favorable à son amendement sous réserve qu’il rectifie ce dernier, en prévoyant que le pacte de gouvernance peut définir les modalités d’association des acteurs socio-économiques, c’est-à-dire pour laisser aux EPCI le choix de le faire ou non et de décider des modalités concrètes de cette association. M. Joly nous a indiqué qu’il ne souhaitait pas changer d’avis. L’avis de la commission est donc défavorable.
Enfin, s’agissant des amendements n° 462 et 904 rectifié, j’ai bien entendu, mon cher collègue Arnaud de Belenet, votre impatience à conclure un pacte de gouvernance. Je m’en réjouis, mais le délai de neuf mois permet parfois d’accoucher de choses absolument superbes !
Sourires.

Ce temps est nécessaire, me semble-t-il. Il ne s’agit pas de retarder et diluer, mais, si nous voulons qu’un véritable projet politique et de territoire soit élaboré et que l’avis des communes soit recueilli, ce qui est important, je crois souhaitable de prévoir un délai de réalisation de neuf mois. À défaut de retrait de ces deux amendements, mon avis serait donc défavorable.
En revanche, et je terminerai de manière plus positive, nous émettons un avis favorable sur l’amendement de M. Leroy qui propose que le pacte de gouvernance soit annexé au règlement intérieur de l’EPCI.
L’avis du Gouvernement est globalement le même que celui de la commission. On parle de liberté, mais on est déjà en train de rendre toute une série d’éléments obligatoires.
Je ne reprendrai pas ce que j’ai déjà dit depuis le début de la discussion ; je maintiens mon avis défavorable à tout ce qui tend à rendre obligatoires les outils d’adaptation locale.
De plus, en l’état actuel du texte, le président de l’intercommunalité ne peut forcer les choses, puisqu’une partie des maires membres de l’EPCI est susceptible d’imposer l’inscription de points à l’ordre du jour et même de rendre obligatoires les conseils des maires.
Nous avons un dispositif équilibré. C’est la raison pour laquelle l’avis du Gouvernement sera défavorable sur les amendements n° 383 rectifié, 590 rectifié, 748, 674 rectifié bis et 20.
Je m’arrête quelques instants sur l’amendement n° 124 rectifié bis de M. Joly, qui a déjà pour objet de traiter de l’affaire du conseil de développement. Je n’y suis pas opposé : je souhaite que le recours au conseil de développement soit facultatif ; il faut bien, dès lors, que la question se pose à un moment ou à un autre du mandat. Même si la commission a émis un avis défavorable, j’émets un avis de sagesse, pour que l’on se rappelle dans la suite de la discussion que je n’y suis pas défavorable.
En revanche, je suis défavorable pour les raisons que j’ai déjà indiquées, à l’amendement n° 633 rectifié, qui tend à instituer une obligation ferme.
J’en viens à l’amendement n° 462 de M. Patriat, défendu par M. de Belenet. Six ou neuf mois ? Je vous répondrai : peu importe, et raisonnons autrement.
L’EPCI dispose d’un délai de six mois pour élaborer son règlement intérieur. On ne peut pas parler de simplification pendant les deux heures de la discussion générale et ensuite imaginer des délais différents pour l’élaboration du pacte de gouvernance et du règlement intérieur !
Il faut faire attention : soit on porte tous les délais à neuf mois, soit – c’est ce que j’espère – on les porte à six mois. Quand on est président d’une communauté de communes de 16 000 habitants, on a autre chose à faire que de passer sa vie à regarder dans le CGCT à examiner ce qui relève des six mois et des neuf mois ! Cela correspond vraiment à ce que je souhaite : l’avis du Gouvernement est donc favorable sur l’amendement de M. de Belenet, qui vise à fixer tous les délais à six mois, ce qui représente un peu moins de 10 % des six ans du mandat : c’est déjà une durée importante.
J’entends le bon argument de Mme Gatel : c’est vrai, quand l’EPCI comprend de nombreuses communes membres, il faut consulter et faire délibérer chacune d’entre elles. Mais puisque cet amendement tend à prévoir un délai de six mois et qu’il n’y a pas d’amendement pour fixer à neuf mois le délai pour le règlement intérieur, j’émets donc un avis favorable.
Enfin, pour les raisons que je viens d’indiquer, monsieur Jacquin, l’avis du Gouvernement est défavorable sur votre amendement n° 904 rectifié. Un an sur six ans de mandat, c’est considérable.
Je comprends votre souci de laisser du temps au temps, mais, en l’occurrence, les deltas de temps commencent à être assez considérables !
Enfin, monsieur Leroy, en ce qui concerne votre amendement n° 636 rectifié, relatif au lien entre le règlement intérieur et le pacte de gouvernance, comme je viens de le dire, j’émets un avis plutôt favorable, dès lors que le délai est de six mois dans les deux cas.
Or je ne vois pas très bien comment on peut ajouter une annexe au règlement intérieur… Vous m’avez compris, il faut que l’on fasse œuvre de simplification, sinon nous n’allons pas nous en sortir. Et là, pour être honnête, ce sont deux supports pour deux objets différents : le règlement intérieur ne concerne que les assemblées délibératives, en clair le conseil communautaire et les commissions ; le pacte de gouvernance, lui, peut aller au-delà, notamment avec les questions de représentation et de délégation – on y reviendra à propos d’autres articles du projet de loi.
Je le répète, ce sont deux objets juridiques différents, mais je ne vois pas d’obstacle particulier à ce qu’ils soient ensuite annexés au même support. Il faut rester vigilant sur un point, celui des délais.
L’avis du Gouvernement est donc favorable sur l’amendement n° 636 rectifié.

Je voudrais revenir sur l’amendement n° 462 et la question des délais. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous dire que votre argument technique…

… me semble quelque peu léger par rapport à l’enjeu du pacte de gouvernance.
Le pacte de gouvernance, c’est un projet politique et un projet de territoire. Il me semble que s’engager à réaliser un tel document dans un délai de six mois est une gageure, qui va mettre les élus en difficulté. On l’a bien dit, l’intercommunalité est un espace de consensus et d’élaboration de projets collectifs. Soit l’on apaise les relations au sein des intercommunalités, soit l’on continue à mener les choses à la hussarde en faisant semblant.
Je crois en votre sincérité quand vous dites que vous voulez apaiser les relations et faire de l’intercommunalité heureuse. Si c’est ce que vous voulez, maintenez le délai de trois mois pour donner aux communes le temps de s’exprimer ! Sinon, vous allez seulement les contrarier.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. J’entends votre argument de tout fixer à neuf mois. Mais cette position trop dogmatique ne vous ressemble pas, monsieur le ministre !
Sourires.

J’éprouve des difficultés à comprendre les blocages des rapporteurs, d’autant que je viens d’écouter attentivement Mme Gatel, qui nous explique que le pacte de gouvernance devait être un projet politique et un projet de territoire ; nous sommes, bien évidemment, d’accord !
Nous ne comprenons pas pourquoi la définition d’un projet politique et d’un projet de territoire ne peut pas être obligatoire dans un EPCI.
À l’inverse, si le président d’une intercommunalité, surtout si celle-ci comprend de nombreuses communes, ne proposait qu’un débat et passait outre l’avis des maires, la mise en œuvre de ce pacte serait privée de cette fameuse liberté que l’on veut leur donner, de ce droit à avoir tout simplement voix au chapitre.
Nous demandons que ce pacte soit effectivement garanti et qu’il concoure à la cohésion de l’EPCI. En ce qui concerne les délais pour le mettre en œuvre, que ce soit six, neuf ou douze mois… Pour nous, cela doit être fait à la fin de l’année qui suit le renouvellement général dans les communes, donc l’installation de l’EPCI.
Il faut mettre de l’huile dans les rouages, nous en sommes tous d’accord. Là où cela grince et là où il n’y a pas aujourd’hui de pacte de gouvernance, c’est la plupart du temps parce qu’il y a des difficultés : il est donc nécessaire de les résoudre.

Tout d’abord, je veux insister sur l’importance du pacte de gouvernance.
Dans les nouvelles instances intercommunales issues des élections municipales siégeront, à la fois, des élus anciens, qui connaîtront déjà bien le fonctionnement, et des élus nouveaux, qui auront tout à découvrir. Il est extrêmement important que l’on puisse débattre d’un certain nombre de sujets : le fonctionnement de la communauté – la commission l’a prévu –, la mutualisation de certains services, et évidemment des données financières. On sait en effet qu’il y a une interaction très forte entre les choix financiers réalisés par l’intercommunalité et les dotations ou les finances des communes.
Ensuite, s’il doit y avoir un pacte de gouvernance, je suis favorable à ce que l’on maintienne un délai de neuf mois, monsieur le ministre. Comme le disait Françoise Gatel, cela reste malgré tout un projet politique, qu’il faut construire avec de nouvelles instances et de nouveaux élus, en demandant l’avis des conseils municipaux… Il est préférable de laisser un délai de neuf mois pour se donner toutes les chances d’avoir un pacte bien construit, ce qui permettra de faciliter la gestion de la communauté et les projets pour les années à venir.

Je m’interroge, parce que je n’ai pas obtenu aucune réponse du rapporteur et du ministre sur la partie rectifiée, qui en est pourtant l’élément essentiel, de mon amendement.
Monsieur le ministre, madame le rapporteur, vous m’avez répondu sur les questions de délai, mais pas sur un point extrêmement important, qui ne figure nulle part dans le texte : celui des relations entre EPCI.
Je proposais que le pacte de gouvernance prévoie clairement les conditions dans lesquelles l’intercommunalité entend coopérer avec les collectivités voisines.
Monsieur le ministre, il me semble qu’il s’agit d’une question importante de cohésion. Aucun périmètre administratif n’est parfait. Vous le savez, il arrive que la politique des transports qui est pensée pour le cœur d’une intercommunalité ne convienne pas pour une commune excentrée : il faut trouver une solution avec un voisin. Intégrer cette question dans le pacte de gouvernance ne me semble absolument pas pesant, et ce serait très rassurant pour les communes périphériques.
J’aimerais obtenir une réponse sur cette question d’avenir qui me semble très importante. Nos périmètres administratifs sont dépassés par les modes de vie de nos habitants : il est souvent nécessaire de trouver des solutions de partenariat avec les voisins. Cela permettrait de donner davantage de cohésion et de solidité au bloc communal.
Je vous remercie de votre éclairage sur ce point, qui, je le rappelle, est très important ; nous l’aborderons d’ailleurs certainement de nouveau dans le projet de loi dit « 3D » – décentralisation, différenciation, déconcentration.
En l’espèce, nous débattons du pacte de gouvernance, et cette question a pleinement sa place ici. J’espère vivement, monsieur le ministre, madame le rapporteur, avoir votre avis sur l’amendement n° 904 rectifié.

Je soutiens totalement les propositions de Mme le rapporteur concernant le pacte de gouvernance, parce que je suis commissaire aux lois et que ce travail a été fait par notre commission, mais surtout parce que je suis convaincu que nous sommes parvenus à un équilibre dans le texte sur la question du pacte de gouvernance.
Mes chers collègues, s’agissant du caractère facultatif ou obligatoire du pacte de gouvernance, je me vois mal commencer un travail qui va durer quinze jours sur un projet de loi intitulé « Engagement et proximité » par une obligation !
M. le ministre approuve.

Je vois M. le ministre opiner du chef, mais nous avons dit qu’il fallait essayer de remédier aux difficultés essentielles liées à la désaffection des maires – je ne reprendrai pas les propos qui ont été tenus lors de la discussion générale –, en donnant davantage de liberté.
C’est le moment de montrer et de confirmer cette volonté de donner plus de liberté aux acteurs des collectivités locales.

À titre personnel, j’estime qu’il aurait pu être utile, comme l’ont proposé de nombreux collègues dans leurs amendements, que toutes les collectivités élaborent un pacte de gouvernance. Naturellement, pour y parvenir, instituer une obligation permettrait de répondre à cette demande.
En réalité, là encore, je suis persuadé qu’en laissant les acteurs libres – un pacte de gouvernance est de l’intérêt de tous les acteurs au sein de l’intercommunalité, du président de celle-ci bien sûr, mais aussi de tous ses membres –, on parviendra tôt ou tard à généraliser ce pacte à toutes les intercommunalités.
Même s’il est souhaitable que chaque intercommunalité ait son pacte de gouvernance, l’obligation est une mauvaise recette : laissons faire les choses, donnons de la liberté, et nous parviendrons à ce résultat, car c’est dans l’intérêt de tous.

Une fois n’est pas coutume, je partage totalement les propos d’André Reichardt.
Je souhaite à mon tour insister sur l’équilibre auquel la commission est parvenue. Les obligations doivent rester l’exception, même s’il est vrai que rendre obligatoire la conférence des maires ou la discussion sur le pacte est une bonne chose.
Je veux simplement me référer aux travaux de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation, particulièrement au rapport d’Antoine Lefèvre et Patricia Schillinger sur les relations entre les communes et les communautés, auquel plusieurs de nos collègues ont fait référence.
Ils sont vraiment partis de l’idée des bonnes pratiques. Au fond, ce sont les bonnes pratiques d’hier, que nous avons tous connues – je les ai moi-même expérimentées dans ce domaine – et qui ont été rendues possibles par le champ de liberté découlant du fait que tout n’était pas codifié. C’est comme cela que l’on invente des bonnes pratiques.
J’avais à l’époque appelé « charte » l’équivalent du pacte, et cela nous a beaucoup aidés. Ce texte va devoir vivre et s’inscrire dans la durée : il faut maintenir des espaces de bonnes pratiques et d’expérimentations, celles-ci pouvant d’ailleurs, dans certains cas, être reprises et généralisées.
Il s’agit là en quelque sorte d’une question philosophique : si l’on commence par tout codifier d’emblée, nous obtiendrons des résultats qui seront peut-être à l’inverse de ce que nous voulons, alors que, avec cet espace de liberté, les choses se feront, et peut-être même mieux, en termes de contenu et d’acceptation de ces pactes.
Je plaide donc, à mon tour, pour la position sage et équilibrée de la commission.

M. Didier Rambaud. Pour assister très assidument, aux débats depuis le début de l’après-midi, j’ai l’impression que l’intercommunalité est quelque peu dans le collimateur, si j’ose dire, et cela me dérange.
M. le président de la commission des lois s ’ exclame.

J’ai présidé une intercommunalité pendant dix ans, alors peut-être vois-je les choses sous ce prisme… Ce qui fait la force d’une intercommunalité, c’est son projet de territoire. Pourquoi cela a-t-il raté jusqu’à présent dans beaucoup d’endroits en France ? On a commencé par dire qu’il fallait fusionner en fixant tel périmètre sans définir le projet de territoire. En revanche, si l’on fait ce travail, cela va tout seul !
Je partage tout à fait les propos de Didier Marie : il faut rendre cette étape obligatoire. Pour que l’intercommunalité fonctionne, elle ne peut être une auberge espagnole.
J’ai entendu dire pendant les débats que ce sont les communes qui font l’intercommunalité. Si l’on commence par dire cela, il est certain qu’on va à l’échec ! Ce sera une auberge espagnole, dans laquelle chaque commune voudra se servir… Ce n’est pas comme cela qu’il faut s’y prendre. Rendons obligatoire ce projet de territoire ! Sur un territoire donné, demandons-nous quelles politiques publiques on veut mener ; ensuite, la gouvernance, le périmètre, les compétences, cela ira tout seul !

Je voudrais insister sur le délai de neuf mois. S’il y a un point qui nous est commun à toutes et tous, c’est qu’un jour nous avons débuté ! À ce moment-là, peut-être l’avons-nous oublié, c’était difficile, parce qu’il fallait appréhender quantité de choses.
Le Gouvernement le reconnaît d’ailleurs, puisqu’il a introduit dans le projet de loi un important volet formation, parce qu’il faut maîtriser l’ensemble des éléments de la politique locale, et Dieu sait qu’ils sont nombreux…
Pour y parvenir, il faut un délai suffisant – d’autant que dans les neuf mois, il y a deux mois de vacances, puisque certains partent en juillet et d’autres en août. (Sourires.) Ce sont pratiquement deux mois qui sont neutralisés, et au fond nous ne sommes plus très loin des six mois. Finalement, le délai de neuf mois satisferait tout le monde !
Applaudissements sur des travées du groupe UC.

Je ne comprends pas ce débat.
Tout d’abord, monsieur le ministre, vous avez évoqué le règlement intérieur et le délai de six mois. Mais on ne parle pas de la même chose ! Il s’agit d’une différence non pas seulement de degré, mais de nature entre un règlement intérieur, qui prévoit les modalités de fonctionnement, et un projet de territoire, qui indique ce qu’on va faire ensemble pendant un temps donné. Je ne vois pas où est le problème.
Ensuite, je voudrais citer un extrait du discours de Stockholm d’Albert Camus : « L’art vit de contraintes et meurt de liberté. » C’est exactement la même chose. La question que nous nous posons tous ici est la suivante : comment faire en sorte, surtout au début d’une mandature, qu’il y ait une osmose entre les représentants des conseils municipaux et les conseillers communautaires ? Comment faire fonctionner cet ensemble ? On y parviendra avant tout avec un projet de territoire.
C’est pour cette raison que ce projet ne doit pas être facultatif : j’y insiste, réfléchir ensemble à ce que sera notre projet politique doit être non pas une faculté, mais une obligation. Sinon l’intercommunalité n’a pas de sens ; elle se contente d’être uniquement un regroupement de communes, alors que, je vous le rappelle, elle est définie certes comme un groupement de communes, mais qui se réunissent autour d’un projet pour former un espace de solidarité. Le pacte de gouvernance est le moyen de cette solidarité.

Je voudrais revenir sur le caractère obligatoire ou non du pacte de gouvernance. J’ai rencontré un certain nombre de maires, et je peux vous dire que beaucoup d’entre eux se sentent exclus des EPCI. C’est une réalité ! Cette sensation d’exclusion est remontée dans les questionnaires que nous leur avons adressés.
Aujourd’hui, il faut faire confiance aux maires et plus largement aux élus. Rendre le pacte de gouvernance obligatoire, c’est redonner la parole aux élus et surtout les associer à l’EPCI.

Ce débat un peu long nous invite à reprendre les discussions que nous avons eues au moment de la rédaction des amendements au sein, je l’imagine, de tous les groupes sur la nécessité ou non de rendre le pacte de gouvernance obligatoire par principe.
Tout d’abord, dans la plupart des intercommunalités, quelle que soit leur taille, l’équivalent du pacte de gouvernance, appelé ainsi ou autrement, existe déjà, et se construit parce qu’il est indispensable à la bonne vie de l’intercommunalité.
Depuis le début, j’avoue ma réticence à l’idée de faire du pacte une obligation, y compris donc par rapport à l’amendement de mon groupe en ce sens, parce que nous devons nous prémunir contre un écueil : défendre, ici au Sénat, la libre administration des collectivités territoriales tout en leur disant, ainsi qu’à leurs groupements, ce qu’elles doivent faire, dès lors que ce qui se dit dans les débats politiques locaux ne nous plairait pas.
Ensuite, après avoir entendu un certain nombre d’orateurs défendre le caractère obligatoire du pacte, j’estime qu’il faut prendre garde à ne pas inverser la logique. Si l’on aboutit aujourd’hui à des intercommunalités « XXL », si un certain nombre de communes ne trouvent pas leur place dans les intercommunalités, je ne suis pas sûre que c’est en rendant obligatoire et en imposant un pacte de gouvernance qu’on réglera ces problèmes.
En effet, au vu des problèmes qui se posent et eu égard au nombre d’intercommunalités, il faut cesser de se raconter des histoires et revenir à la réalité : tous les élus ne pourront pas contribuer à l’élaboration du pacte de gouvernance, même si le délai est de neuf mois. Réduire ce dernier aboutirait d’ailleurs à un résultat encore plus catastrophique, sauf à admettre que les élus ne rédigeront pas leur propre pacte de gouvernance.
Monsieur Rambaud, vous avez dit que les communes ne faisaient pas l’intercommunalité. Eh bien si, justement ! Pour ma part, je suis attachée au fait que les communes contribuent ensemble à faire l’intercommunalité, et non l’inverse.
Personnellement, je ne voterai pas les amendements qui tendent à rendre obligatoire le pacte de gouvernance.
Messieurs Reichardt et Bockel, je vous remercie d’avoir rappelé la philosophie sous-tendant notre projet. Dans un tel cadre, commencer par imposer une obligation ne m’apparaît pas très opportun pour la suite de nos discussions et pour l’image que nous renverrions à l’extérieur. C’est néanmoins un débat important, qui, on le voit bien, n’est pas complètement tranché.
Je vous remercie aussi, madame la sénatrice Cécile Cukierman : vous avez tenu à peu près les mêmes propos, avec vos propres mots, et vous êtes, vous aussi, inscrite dans la philosophie globale de la démarche.
Par ailleurs, il ne faut pas, à mon sens, mélanger projet de territoire et gouvernance de ce projet. Si je veux entrer sur le terrain de la provocation, je dirai qu’il ne serait pas envisageable d’inscrire dans la loi l’obligation, pour un député ou un sénateur, d’avoir un programme électoral.
C’est la démocratie, monsieur Hervé ! Par définition, ce sont nos concitoyens qui jugent ; c’est le principe.
Que l’on cherche à encadrer strictement les modalités de gouvernance est une chose – une fois de plus, je suis prudent sur ce sujet, étant partisan d’une grande liberté –, mais le projet de territoire découle directement des campagnes électorales, puisque ce sont les conseillers municipaux, élus lors des élections municipales, qui sont appelés à devenir conseillers communautaires. J’ai peu de doute sur ce point, mais nous pourrons en débattre.
En tout cas, je ne crois pas à une injonction à avoir un projet, tel François Guizot clamant « Enrichissez-vous ! » Si le concept est de faire confiance aux élus, il n’est tout de même pas simple de défendre une telle position.
Enfin, que l’on ne s’y méprenne pas, je ne suis pas opposé au délai de neuf mois. Mais, une fois de plus, monsieur Kerrouche, l’approche doit être non pas universitaire ou conceptuelle, mais bel et bien pragmatique.
Je proposerai donc, si nous en restons à neuf mois – je ne sais pas si le sénateur Arnaud de Belenet en sera d’accord, mais ce me semble être une bonne chose –, de prévoir, au cours de la navette, l’inscription dans le texte d’un délai obligatoire pour l’adoption du règlement intérieur d’un EPCI également fixé à neuf mois. On ne m’ôtera pas cette idée qu’une homogénéisation des délais constitue, en soi, une mesure de simplification.
N’aurions-nous pas l’air malins s’il nous fallait expliquer à certains élus qu’ils ont dépassé les délais, pour s’être mélangé les pinceaux entre les échéances à six mois et à neuf mois ?
Je le répète, un délai de neuf mois me paraît correct. Si c’est celui qui est retenu, nous profiterons de la navette pour procéder à cette homogénéisation.

La proposition que nous formulons est équilibrée. Je ne crois pas que l’on puisse décréter qu’un espace intercommunal devra avoir « envie d’avoir envie », pour paraphraser quelqu’un de célèbre…
Le pacte de gouvernance repose avant tout sur l’envie. En le rendant obligatoire, on prendrait le risque d’en faire un document complètement vide de sens. C’est pourquoi nous maintenons l’avis exprimé.
Cher Olivier Jacquin, pardon de ne pas avoir apporté de réponse concernant votre amendement.
Il est bien évident que toutes les intercommunalités peuvent être amenées à travailler sur des espaces élargis, dans le cadre de schémas de cohérence territoriale, ou SCOT, d’espaces touristiques, etc. Une intercommunalité peut tout à fait décider de l’inscrire dans son pacte de gouvernance, mais il ne nous semble pas forcément pertinent de rendre cette démarche obligatoire par la loi, sachant que les adhésions à des espaces plus vastes relèvent de délibérations prises par le conseil communautaire, et parfois même soumises à l’avis des conseils municipaux.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.