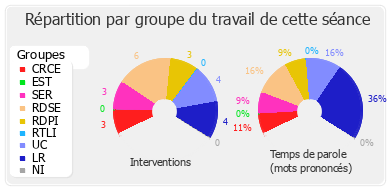Séance en hémicycle du 4 avril 2013 à 9h00
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

M. le président du Sénat a reçu de M. Jacques Mézard un rapport fait au nom de la commission d’enquête sur l’influence des mouvements à caractère sectaire dans le domaine de la santé, créée le 3 octobre 2012, sur l’initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen, en application de l’article 6 bis du règlement.
Ce dépôt a été publié au Journal officiel, édition « Lois et Décrets », d’aujourd’hui jeudi 4 avril 2013. Cette publication a constitué, conformément au paragraphe III du chapitre V de l’Instruction générale du bureau, le point de départ du délai de six jours nets pendant lequel la demande de constitution du Sénat en comité secret peut être formulée.
Ce rapport sera publié sous le n° 480, le 10 avril 2013, sauf si le Sénat, constitué en comité secret, décide, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie de ce rapport.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la suite de la discussion de la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, présentée par M. Philippe Marini (proposition n° 682 rectifié [2011-2012], résultat des travaux de la commission n° 288, rapport n° 287, avis n° 291, 298 et 299).
Je rappelle que nous avions commencé l’examen de cette proposition de loi le jeudi 31 janvier dernier.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. David Assouline.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, défendue par M. Marini, soulève des questions majeures, comme nous l’avons tous souligné. Cette discussion ne relève pas du débat technique entre spécialistes, car elle s’inscrit au cœur des problématiques de régulation en temps de crise, à l’heure ou les avancées technologiques modifient non seulement les modèles économiques et industriels, mais aussi les habitudes de consommation culturelle.
L’économie numérique est partout, elle capte au quotidien des milliards d’individus connectés et irrigue l’ensemble des secteurs économiques. Dans le monde, Google a dépassé les 50 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2012 et son bénéfice net a augmenté de 10 %. En France, Google, Amazon, Facebook et Apple, à eux seuls, dégagent de 2, 5 milliards d’euros à 3 milliards d’euros de revenus.
Les entreprises que je viens de citer sont emblématiques de l’industrie numérique, qui reste fondamentalement une industrie de contenus. Dès lors, vous pouvez imaginer que l’instauration d’une fiscalité neutre et équitable s’avère cruciale pour la culture et pour la presse, notamment avec la question des droits d’auteurs et de la rémunération des contenus par les moteurs de recherche. L’accord récent entre Google et l’Association de la presse d’information politique et générale, qui n’a pas de lien avec les réflexions en cours sur l’intervention de l’État en faveur de la presse, constitue une avancée qu’il faut saluer. Par ailleurs, l’État a pu aider à la mise en place d’un fonds dédié, d’un montant de 60 millions d’euros, qui facilitera la transition de la presse vers le monde numérique : ce n’est qu’un début, car cette mesure ne représente pas la solution définitive. Tous ces éléments montrent qu’il est légitime de se pencher sur l’argent qui irrigue le numérique, et Google l’a bien compris !
Il s’agit en l’espèce de redistribuer de la richesse, de favoriser l’innovation et la création culturelle. Les acteurs de la culture sont concernés au premier chef, parce que leurs ressources sont tirées de taxes affectées. Or le secteur de l’économie numérique échappe à l’impôt depuis trop longtemps, et nous ne pouvons plus regarder ailleurs. Prolonger notre temps de réaction ne fera que rendre la situation plus difficile. Les marchés classiques du livre et de la musique, pour ne parler que de supports physiques, sont en difficulté et voient leur assiette de taxation se réduire. Dans le même temps, l’édition et la distribution d’œuvres, surtout audiovisuelles, ont des besoins de financement importants, et le contexte budgétaire est contraint.
S’il faut être connecté pour réaliser des transactions dématérialisées, l’impôt sur les sociétés et la TVA, eux, sont déconnectés du pays de consommation. Prenons l’exemple des médias : certains groupes de presse se sont alliés, compte tenu de la crise qu’ils traversent, pour demander la création d’une taxe sur ceux qui captent leurs productions. On a invoqué les compétences de l’Union européenne, avant que les Allemands n’adoptent une telle taxe. On a alors organisé des réunions intergouvernementales, notamment avec les Portugais. Depuis, Google s’inquiète de l’adoption éventuelle d’une législation et en tient compte. Il est donc nécessaire à la fois de sortir du cadre restreint du commerce en ligne et de dépasser le cadre national. Pour défendre la culture et la communication, il faudra agir au niveau global.
Malheureusement, cette proposition de loi ne voit pas assez loin et son champ n’est pas assez large. Son auteur envisage la création de taxes sectorielles sur la publicité en ligne et le commerce électronique sur le territoire national. Or, en réalité, nous avons besoin de mesures fiscales adaptées à chaque domaine. Il faut cibler pour être efficace : c’est la seule solution pour avancer dans ce dossier complexe. Tous les secteurs de la culture sont physiquement touchés : les archives, les bibliothèques, le cinéma. Avec cette proposition de loi, nous abordons le problème sous un angle trop général, mélangeant les aspects technique, économique, de compatibilité européenne, de sorte que nous n’y voyons plus clair. Nous gagnerions à adopter une stratégie de taxation ciblée sur chacun des champs de notre compétence.
À ce titre, le rapport de MM. Collin et Colin, remis le 18 janvier 2013, trace des perspectives très intéressantes, en dehors des sentiers battus, qu’il s’agisse du recensement des données des utilisateurs ou du financement par le marché de ce secteur. Il est donc trop tôt, à mon avis, pour se doter d’un arsenal législatif qui fermerait des portes au lieu d’en ouvrir. En outre, dans l’état actuel des choses, ce dernier serait difficile à rendre opérationnel non seulement du point de vue fiscal, mais aussi au regard du droit européen – vous le savez d’ailleurs bien, monsieur Marini.

Il nous revient de réfléchir à un meilleur fléchage des rentrées fiscales – et cette question m’intéresse en tant que membre de la commission de la culture –, qui, si l’on suit les préconisations de l’auteur de la proposition de loi, tomberaient simplement dans le « pot commun » du budget général de l’État ou reviendraient aux collectivités territoriales, sans que de nouvelles ressources soient affectées aux industries culturelles.
Avec l’enjeu que représente aujourd’hui la négociation commerciale internationale, où l’exception culturelle française est nettement menacée, en particulier pour l’audiovisuel, il me semble que cette voie ne doit pas être suivie. Au contraire, comme l’ont fait jusqu’à présent tous les gouvernements, de droite comme de gauche, il faut continuer à mener la bataille de la France pour l’exception culturelle.
On le voit, la problématique du financement de la culture est centrale, compte tenu de l’importance de l’échange des supports culturels dans les communications dématérialisées. Il y a là une manne financière qui pourrait soutenir l’industrie culturelle. À ce sujet, il serait important d’attendre les conclusions des travaux de la commission présidée par M. Pierre Lescure, qui seront rendues en avril 2013, donc dans quelques jours, pour envisager de nouvelles perspectives.

J’ignore en quoi elles consisteront exactement, mais nous aurons ici, le moment venu, un vrai débat. Un « acte II » de l’exception culturelle, à préserver et à financer, prenant en compte la révolution numérique, devra voir le jour. Il sera incontournable pour protéger les créateurs contre les grands groupes, ces derniers s’apparentant aujourd’hui à des « monstres » qui captent tout sans rien créer ! Ce n’est rien moins que la survie de la création pluraliste dans le monde qui est en jeu, et nous ne l’oublions pas dans notre volonté de faire participer les grands acteurs du numérique à l’effort fiscal.
Néanmoins, monsieur Marini, votre proposition de loi a eu le mérite de provoquer un débat et de rappeler que le Sénat est attentif à cette question. §

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, présentée par Philippe Marini, a le mérite de rappeler la nécessité de l’équité fiscale, alors que les grands groupes de l’Internet, tels que Google, Apple, Facebook, Amazon ou eBay, ne paient pas, ou quasiment pas, l’impôt sur les sociétés en France, parce qu’ils ont fait le choix de s’établir en Irlande ou au Luxembourg.
Ces entreprises dissocient presque systématiquement leur lieu d’établissement des lieux de consommation. Comme l’indique le rapport commandé par le Gouvernement à MM. Pierre Collin et Nicolas Colin, ces entreprises « sont d’emblée organisées en vue de tirer le meilleur parti des différences de systèmes fiscaux ». En conséquence, il est difficile de fiscaliser leurs bénéfices.
Ainsi, le texte de Philippe Marini vise à instaurer une taxe sur la publicité en ligne et une autre taxe sur les services de commerce électronique, dans le cadre d’une obligation de déclaration d’activité pour les acteurs de services en ligne basés à l’étranger.
Ces propositions s’inscrivent dans une logique d’équité fiscale, dans la mesure où les acteurs de l’économie numérique établis en France, et soumis à l’impôt, sont concurrencés par des sites internet basés à l’étranger, qui ne supportent ni les mêmes charges fiscales en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés ni les taxations spécifiques à la France, et destinées à financer les réseaux ou encore l’audiovisuel public.
Assujettir les sites internet basés à l’étranger à la fiscalité présenterait, en outre, le grand intérêt d’augmenter les recettes fiscales, dans une période où les contraintes budgétaires sont très fortes et où l’État doit pourtant faire face à des dépenses d’investissement essentielles. Je pense en particulier à la couverture de l’ensemble du territoire par le très haut débit, action majeure pour laquelle le Gouvernement vient de présenter une feuille de route pour les dix ans à venir. Il y est prévu que l’État apporte trois milliards d’euros, sur l’ensemble de la période, pour aider les collectivités locales à déployer des réseaux de communication électronique dans les secteurs les moins denses démographiquement.
La fiscalisation des recettes de la « bande GAFA » – Google, Amazon, Facebook et Apple – est donc non seulement une question d’équité fiscale, mais aussi une nécessité pour redonner des marges financières à l’action publique.
Tous les avis convergent donc sur la nécessité de mettre en place une fiscalité numérique, neutre et équitable. Cependant, d’autres solutions que celles de Philippe Marini ont été proposées. Ainsi, le rapport d’expertise précité tend à mettre en place une fiscalité incitative en matière de collecte, de gestion et d’exploitation des données personnelles.
Dès lors, la motion de renvoi à la commission, adoptée par la commission des finances du Sénat, paraît parfaitement adaptée. Elle permet de disposer du temps nécessaire pour étudier les diverses solutions envisagées, et ce dans la perspective d’une réforme plus globale.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je crois utile de prendre la parole à ce stade, avant que Mme la ministre ne réponde aux différents orateurs de cette discussion générale qui se déroule en deux temps, séparés par une interruption de deux mois. En effet, l’examen de ma proposition de loi, lors de l’inscription initiale de cette dernière à l’ordre du jour du Sénat, n’avait pu être mené à bien, faute de temps, et nous devons le terminer ce matin.
Je voudrais simplement vous inviter, mes chers collègues, à réfléchir sur ce qui s’est passé au cours de ces deux mois. Quelles ont été les initiatives du Gouvernement pour faire progresser la recherche concrète d’une solution ? Quelles sont les évolutions du contexte national et international ?
La commission des finances s’est efforcée, pour sa part, de continuer à faire vivre le débat, tout particulièrement grâce à l’audition, le 20 février dernier, de Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Il nous a exposé – il a d’ailleurs très largement communiqué sur ce sujet – les conditions dans lesquelles le G20 a donné mandat à l’OCDE pour fournir, d’ici au mois de juin de cette année, un plan d’action définissant la direction dans laquelle de nouveaux instruments seront présentés pour lutter contre l’érosion des bases fiscales.
Les grands groupes de l’économie numérique offrent un exemple – seulement un exemple, mais un bel exemple – des situations décrites par l’OCDE et des difficultés à localiser les bénéfices taxables selon les territoires où exercent les filiales d’une multinationale.
Nous avons donc compris que la négociation d’un modèle de convention fiscale multilatérale qui viendrait remplacer certaines dispositions des conventions bilatérales serait sans doute plus rapide que l’élaboration d’un nouveau modèle de convention bilatérale et la renégociation de l’ensemble des conventions bilatérales existantes.
C’est un processus que la France soutient dans le cadre d’un mouvement qu’elle a lancé de concert avec la Grande-Bretagne et l’Allemagne.
J’en viens à un autre aspect des choses : l’argument de l’euro-compatibilité ou incompatibilité de ma proposition de loi m’ayant été opposé lors du débat précédent, notamment par le Gouvernement, je me suis efforcé de fouiller ce point ; j’ai donc interrogé par courrier, le 6 mars dernier, les deux commissaires européens compétents, Michel Barnier, en charge du marché intérieur et des services, et, surtout, Algirdas Šemeta, en charge de la fiscalité, de l’union douanière, de l’audit et de la lutte antifraude, leur posant noir sur blanc deux questions.
Première question, « ne pourrait-on soutenir que le respect des principes de la concurrence sur le marché intérieur, qui constitue l’un des fondements de l’Union, doit être regardé comme un motif d’intérêt général, eu égard au déséquilibre flagrant de la publicité en ligne, justifiant l’application d’un régime dérogatoire prévoyant la désignation d’un représentant fiscal ? » – la désignation de ce représentant fiscal est en effet, vous le savez, l’un des éléments clés de la proposition que j’ai formulée.
Seconde question, « l’extension de la procédure simplifiée de déclaration des services fournis par voie électronique aux fins d’application de taxes nationales spécifiques soulève-t-elle des objections au regard du droit communautaire ? »
MM. les commissaires ont bien voulu me faire parvenir en tout début de semaine une réponse documentée que je tiens à votre disposition, madame la ministre. J’ai noté avec intérêt que le contenu de ce courrier était loin d’être aussi négatif que les arguments que le Gouvernement m’oppose depuis des mois. Certes, il m’a été répondu que seule la Cour de justice de l’Union européenne peut donner une interprétation contraignante sur la compatibilité d’une législation nationale avec le droit européen. Mais cela, tout bon étudiant en droit le sait dès le début de ses études supérieures !
Toutefois, si les commissaires semblent écarter, à ce stade, l’argument tiré du respect des principes de la concurrence pour justifier l’entrave aux libertés que constituerait la désignation obligatoire d’un représentant fiscal, je pense qu’il faut lire leur réponse comme on lirait un arrêt ou un avis du Conseil d’État, c'est-à-dire à la fois « en plein et en creux ». Que nous disent-ils précisément ? « […] la Cour de justice, selon une jurisprudence constante, examine l’existence d’un lien direct entre la restriction apportée par une mesure nationale à l’exercice des libertés garanties par le Traité, d’une part, et le motif d’intérêt général invoqué pour justifier de cette restriction, d’autre part. Ce lien est également nécessaire pour apprécier le respect du principe de proportionnalité, dans l’hypothèse où la condition relative à l’existence d’une raison d’intérêt général est remplie ».
Dès lors, la Commission ne se prononce pas ici sur l’existence de ce lien. Mais elle nous indique a contrario que c’est à nous de démontrer le lien.
Or quel est le lien ? Il s’agit du déséquilibre fondamental de ce marché caractérisé par la position dominante de certaines sociétés au détriment des autres sociétés, déséquilibre qui se manifeste particulièrement en ce qui concerne la publicité.
De quoi s’agit-il ? De créer un système déclaratif et de représentation fiscale pour mieux connaître ledit marché de la publicité en ligne. Il me semble que l’on peut au moins plaider avec une bonne structure d’argumentation et avec conviction – sans être certain, naturellement, comme dans toute plaidoirie, d’aboutir – que le lien direct est établi !
J’en tire pour conséquence, madame la ministre – j’espère que vous ne m’en voudrez pas –, qu’il est de la responsabilité du Gouvernement de demander et de faire constater ce lien de causalité pour rendre possible l’obligation de désignation d’un représentant fiscal.
Par ailleurs, les commissaires soulignent aussi la possibilité de mettre en place des taxes nationales utilisant un autre système déclaratif : « Si la France souhaite mettre en place des taxes nationales non harmonisées, sous réserve de respecter le droit de l’Union, elle peut établir son propre système de déclaration, le cas échéant dématérialisé ». Or c’est bien ce que je demande dans ma proposition de loi. Madame la ministre, je tiens à votre disposition ce courrier pour que vos services puissent l’étudier et agir en conséquence.
J’observe – et là, il s’agit du contexte – que Google fait actuellement l’objet d’une procédure pour abus de position dominante, lancée par le commissaire européen chargé de la concurrence. Ce n’est pas une imagination des sénateurs, c’est bien la réalité : il y a des procédures en cours pour entorse au droit de la concurrence et pour abus de position dominante. Et il appartient aujourd’hui au commissaire Almunia de décider s’il recherche un processus transactionnel ou s’il va au contentieux devant la Cour de justice de l’Union européenne à l’encontre de Google, en particulier.
Sur ce point, je souhaiterais connaître la position du Gouvernement français. Est-il plutôt favorable à un contentieux qui permettrait de mettre sur la table, en toute transparence, les arguments et les chiffres, un contentieux qui permettrait d’évoluer vers une jurisprudence publique, accessible à tous ? Le Gouvernement est-il plutôt – telle est l’inclination actuelle des services de la Commission, me semble-t-il – en faveur de la recherche d’une sorte de transaction ? Ce serait une façon de demander à Google de se mettre en conformité. Au terme d’un certain délai, il serait procédé à une analyse de la situation pour décider que faire. C’est concevable, car il existe beaucoup de précédents pour une telle voie de conciliation et de corrections de pratiques qui ne seraient pas conformes au droit de la concurrence.
Mais l’inconvénient d’une procédure transactionnelle, c’est qu’elle est forcément moins transparente, moins publique, et qu’elle peut aussi revêtir certains aspects dilatoires au bénéfice du groupe économique susceptible de tirer avantage d’une position dominante sur le marché.
J’espère, madame la ministre, que l’on va avancer. Je n’ai pas eu le sentiment que le Gouvernement avait, de son côté, beaucoup progressé. MM. Collin et Colin nous ont livré une superbe réflexion technologique et presque philosophique…

Malheureusement, la fiscalité est loin de se situer sur ces hauteurs ! Mme la ministre le sait, la fiscalité, ce sont une assiette, un taux, un système de recouvrement et des sanctions. Cela ne nécessite pas de faire appel à de hautes compétences intellectuelles ! C’est une discipline pratique, c’est quelque chose qui doit tourner, qui doit fonctionner !
Peut-être nous direz-vous, madame la ministre, si MM. Collin et Colin ont progressé, si leurs travaux ont été complétés et si l’on peut voir un vrai impôt mis en place sur les données personnelles et leur absorption par des moteurs de recherche.
Ce que je sais, c’est que, dans un domaine très précis, celui de la rémunération des éditeurs de presse, domaine qui ne peut évidemment être que très attentivement suivi par nos excellents collègues de la commission de la culture, l’Allemagne, quant à elle, a continué à avancer. Elle a adopté une loi, votée par le Bundestag le 1er mars, ratifiée par le Bundesrat le 22 mars, établissant des droits voisins du droit d’auteur pour les éditeurs de presse. Certes, le lobby de Google s’est absolument déchaîné en mettant en œuvre des moyens considérables. Quant à la France, elle n’a pas voulu suivre cette voie législative en ce qui concerne les éditeurs de presse, préférant un accord a minima négocié entre les éditeurs et Google, certes signé sous les ors de l’Élysée et en présence de M. le Président de la République lui-même.
Mais, vous le savez, il reste beaucoup de choses à clarifier. Et je ne parle pas seulement de la nomination du président du conseil d’administration du Fonds d’aide à la transition numérique de la presse : si je ne me trompe, il y a polémique sur ce sujet, et on n’a pas vraiment réussi à se mettre d’accord.
Je ne sais pas non plus quel est le statut de ce Fonds. Je ne sais pas s’il fonctionnera avec de l’argent privé ou de l’argent public. Si argent privé il y a, je ne sais pas s’il sera utilisé selon des prescriptions publiques. Je ne sais pas si ces 60 millions d’euros sont un fusil à un coup. À la vérité, je ne sais pas non plus de manière certaine quelle est la provenance de ces crédits.
Je n’irai pas plus loin dans les questions. Peut-être, madame la ministre, nous apporterez-vous des éléments de réponse ? En tout cas, cher président David Assouline, par rapport à une loi votée par une représentation nationale, par deux assemblées, comme l’ont fait nos collègues et partenaires allemands, le dispositif dans lequel nous nous sommes engagés comporte à mon avis des faiblesses. Il est en tout cas beaucoup moins transparent et clair que celui qui a été mis en place outre-Rhin.
Vous allez sans doute évoquer de nouveau, madame la ministre – et je le souhaite vivement –, la feuille de route numérique adoptée par le Gouvernement. Celle-ci comporte un volet que j’applaudis, relatif au « rétablissement de notre souveraineté fiscale ».
Comme chacun le sait, plusieurs étages sont à considérer. Nous sommes bien engagés, avec d’autres, dans le processus mondial lancé par l’OCDE et le G20, dans lequel s’intègre le concept d’établissement stable virtuel.
Par ailleurs, l’assiette commune consolidée de l’impôt sur les sociétés pour les entreprises du numérique, à savoir l’opération communautaire ACCIS, suivra le sort de l’ensemble de l’opération ACCIS de modification des règles internationales de l’OCDE et communautaires : il faudra parvenir à un consensus des États membres de l’Union européenne. Or je ne crois pas que vous ayez la capacité divinatoire de nous indiquer quand il sera à notre portée. Cet objectif, qu’il nous faut manifestement chercher à atteindre, paraît encore bien lointain.
En outre, vous avez sollicité l’avis du nouveau Conseil national du numérique, le CNN, ce qui est une excellente chose, mais le précédent s’était livré au même exercice.
Il ne faut pas être grand clerc pour comprendre que les professionnels qui siègent au sein d’un tel conseil sectoriel, et donc quelque peu corporatif, ne sont que rarement enthousiastes à l’idée de concevoir eux-mêmes une taxation s’appliquant à leur propre secteur.
Enfin, en matière de TVA, j’ai lu que la France exigerait de ses partenaires européens le strict respect du calendrier relatif à la mise en place du « mini-guichet » européen de TVA, qui permettra, dès 2015, de taxer la consommation de services en ligne dans l’État du consommateur. C’est une excellente chose. Je pense qu’il faut en effet veiller au strict respect des engagements pris par nos partenaires en ce sens.
Vous me pardonnerez mon insistance et mon impatience, mais il y aura tant de sujets à traiter dans le projet de loi de finances pour 2014 ! Le renvoi à la commission de cette proposition de loi était tout à fait envisageable voilà deux mois, et je l’avais alors approuvé. Depuis lors, le rapport de MM. Colin et Collin a-t-il donné lieu à la définition d’une taxe opérationnelle ? Je ne le crois pas.
Avec cette motion tendant au renvoi à la commission qui, je le répète, pouvait sembler naturelle au départ, n’essaie-t-on pas d’enterrer la démarche dans des méandres procéduraux, afin de ne rien faire ? Vous ne m’en voudrez pas de le suspecter quelque peu.

Cher président Assouline, la situation du numérique était assez différente il y a dix ans ! Vous-même auriez été bien en peine, en dépit de votre capacité d’anticipation, de nous expliquer comment allait évoluer ce marché.

C’est ici et maintenant que le sujet se présente !
Je serai attentif à votre réponse, madame la ministre. Il me semble que, en la matière, il nous faut avancer concrètement.
Je remercie enfin les différents orateurs, qui ont bien voulu dire que ce débat était utile, même si nous divergeons sur les solutions. §
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, messieurs les rapporteurs pour avis, mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable, ainsi que le rappel utile que vous avez fait des enjeux en termes de culture, d’économie et d’aménagement du territoire qui s’attachent à la fiscalité du numérique, vient en amont d’une série d’initiatives gouvernementales.
Le 31 janvier dernier, j’ai eu l’occasion de vous indiquer combien ce sujet importait au Gouvernement, qui entend bien faire de la France un élément moteur des discussions ayant lieu dans le cadre des instances internationales.
Depuis notre dernier débat sur ce texte, ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur Marini, l’OCDE a présenté lors du G20 de Moscou des 14 et 15 février dernier son plan d’action destiné à lutter contre les phénomènes d’évasion fiscale et d’érosion des bases imposables. Le ministre de l’économie et des finances a rappelé à cette occasion que la France soutenait activement ce plan d’action.
J’y insiste, j’ai usé de toute mon influence auprès du Gouvernement pour que nous portions de manière très proactive à la fois les groupes de travail et la réflexion au sein de l’OCDE, un terrain qui avait été totalement laissé à l’abandon depuis dix ans par les gouvernements précédents.
Vous le savez, ce combat n’est pas gagné d’avance. Au sein du G20 et de l’OCDE, cependant, la France est désormais motrice. Elle copréside aujourd’hui, avec les États-Unis, le groupe de travail sur la modernisation des règles traditionnelles de territorialité, au sein duquel sera revisité le concept d’établissement stable virtuel. La France poussera en ce sens. Je crois que les travaux internationaux en cours fournissent, comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, une occasion historique de progresser.
Au sein de l’Union européenne, la France, là encore, s’est voulue très proactive et motrice. Dans un courrier adressé à la Commission européenne, le Gouvernement avait demandé au commissaire Šemeta d’inclure des dispositifs volontaristes ciblant le secteur numérique dans son plan de lutte contre la fraude.
Lors du Conseil Ecofin de janvier dernier, la France a appelé la Commission européenne à faire plus et mieux dans ce domaine, et s’est engagée à lui proposer au cours de l’été prochain des mesures législatives concrètes pour réformer, en Europe, la taxation des entreprises du secteur numérique. L’échéance que nous nous sommes fixée peut sembler quelque peu lointaine, mais elle se justifie par la nouveauté de ce sujet, qui n’est pas aussi simple que M. Marini l’a laissé entendre. Il s’agit là de problématiques extrêmement complexes. Si des solutions simples existaient, je pense que les gouvernements précédents n’auraient pas manqué de les trouver depuis longtemps. Il est en effet très difficile, s’agissant de telles activités, de territorialiser les revenus et les bénéfices.
Plus globalement, le rapport de MM. Colin et Collin irrigue désormais la réflexion en France et dans nombre des États européens. Une mission de concertation a été confiée au Conseil national du numérique, dont la composition, je tiens à le préciser, a été entièrement renouvelée afin, précisément, d’éviter qu’il ne devienne une instance de lobbying ou de représentation d’intérêts catégoriels ou sectoriels. Il est désormais composé non seulement de représentants de l’écosystème numérique, mais également de chercheurs, d’universitaires et d’investisseurs, c’est-à-dire de parties prenantes n’ayant pas forcément intérêt à ce que le débat ne progresse pas, bien au contraire. Tel est bien le sens dans lequel j’ai souhaité renouveler la composition du Conseil national du numérique.
Ma position, dans le dossier de la fiscalité numérique, est qu’il faut rétablir une égalité devant l’impôt, une égalité concurrentielle entre les acteurs aujourd’hui vertueux en termes fiscaux et ceux qui ne le sont pas ou qui sont exemptés de fait d’impôt en vertu des stratégies d’optimisation fiscale qu’ils mettent en place. Notre objectif n’est pas de pénaliser l’économie numérique ou son développement. Nous devons donc, dans le cadre de notre réflexion sur la fiscalité, être très attentifs aux équilibres afin que celle-ci ne constitue pas un frein pour les entreprises innovantes, notamment françaises, et ne les pénalise pas au profit d’acteurs over the top ou multinationaux dont les obligations en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés sont très allégées.
Nous devons veiller à établir une équité entre les différents acteurs présents sur les mêmes marchés, quelle que soit leur nationalité, sans qu’il soit ici question de cibler plus particulièrement les Américains ou telle société déterminée.
La mission de concertation confiée au CNN a été mise en place pour tester les différentes hypothèses envisageables, parallèlement au chantier concernant l’imposition des résultats. D’autres hypothèses, qui ne figurent pas toutes dans le rapport de MM. Colin et Collin, ont en effet été envisagées, comme la taxe sur la bande passante ou la taxe sur les clics, qui impliquent un certain nombre de réflexions techniques.
S’agissant de la taxe sur les clics, par exemple, il convient de déterminer les moyens techniques qui peuvent être mis en œuvre sans être trop intrusifs et dans le respect de la protection des données personnelles. Ce travail est extrêmement lourd techniquement, et cela explique le temps que nous prenons pour le mener à bien et pour trouver des solutions. Ces concertations sont actuellement en cours.
M. Claude Domeizel a rappelé, à juste titre, que la prospérité des entreprises du numérique repose en grande partie sur l’exploitation de contenus produits par d’autres. C’est notamment le cas des contenus culturels, mais on pourrait également citer les données personnelles et la publicité ciblée : si quelque chose est gratuit, c’est en général parce que vous êtes le produit !
Vous l’avez dit, monsieur Marini, les contenus culturels ont retenu bien légitimement l’attention de la commission de la culture du Sénat. J’ai d’ailleurs été auditionnée par ses membres le mois dernier – M. Assouline l’a rappelé – pour répondre à leurs interrogations. Nombre de questions se posent en effet en termes de culture et de répartition de la valeur du fait du développement de l’économie numérique dans le secteur culturel.
Je tiens néanmoins à insister sur le caractère général et transversal des problèmes posés par l’économie numérique. L’ensemble des contenus, culturels ou non, participent à la création de valeur des entreprises du numérique, notamment les données personnelles, très minutieusement analysées dans le rapport de MM. Colin et Collin.
Il ne faut pas non plus stigmatiser l’économie numérique.
L’affaire Starbucks montre en effet que ces pratiques d’optimisation fiscale et de déplacement des profits sont le fait non pas seulement d’entreprises du secteur numérique, mais également de sociétés multinationales ayant recours aux prix de transfert. Il convient donc de ne pas pointer du doigt, vilipender ou accuser le seul secteur de l’économie numérique, ce secteur porteur de croissance, ce levier pour la création d’emplois et pour l’économie de la connaissance qui sera notre modèle économique de demain.
L’exploitation des contenus culturels n’est que l’un des aspects du problème. Il faut trouver une solution d’ensemble, plutôt que de recourir à un traitement découpé secteur par secteur. À cet égard, je reviendrai ultérieurement sur la question de la presse que vous avez soulevée.
M. Yves Rome a rappelé combien il était important de remédier à la fracture numérique sur le territoire, en mettant en œuvre les engagements présidentiels en matière de déploiement du très haut débit.
Le Président de la République, lors de son déplacement en Auvergne le 20 février dernier, a annoncé le lancement d’un chantier qui représentera plus de 20 milliards d’euros dans les dix prochaines années, et qui associera le secteur privé et le secteur public.
En cette période de responsabilité budgétaire où des efforts sont demandés à la fois à nos concitoyens, aux entreprises et à l’État, l’annonce d’un chantier et d’un engagement financier public d’une telle importance constitue la preuve que ce gouvernement n’hypothèque en rien l’avenir, malgré les difficultés financières, et qu’il s’engage dans des dépenses structurantes pour la compétitivité des entreprises et l’attractivité du territoire.
Le séminaire gouvernemental sur le numérique a été l’occasion de dévoiler la feuille de route précise du Gouvernement : cette dernière comporte une trentaine de mesures, mais les ministères en avaient proposé une centaine qui ont été rendues publiques et feront l’objet d’un suivi. Vous pouvez y voir le signe que le Gouvernement répond à votre préoccupation d’une véritable politique menée dans le domaine du numérique, accompagnée d’une vision à moyen terme, qui avait quelque peu fait défaut jusqu’à présent.
M. Jean Arthuis a souligné avec sévérité les responsabilités de l’Union européenne dans la situation de sous-fiscalisation des entreprises du numérique que nous constatons. Je souscris pleinement à l’idée que l’Union européenne doit reprendre des initiatives pour y remédier. Lors du Conseil Ecofin de janvier dernier, la France a annoncé des propositions en vue de procéder à une révision des règles communautaires.
Tout d’abord, nous devons mener à bien, à l’échelle européenne, la réforme de la TVA due sur les services électroniques. Il nous faut impérativement tenir l’échéance du 1er janvier 2015, date à partir de laquelle la TVA sera due dans l’État du consommateur et non plus dans l’État du siège de l’entreprise. La concurrence fiscale par la TVA prendra fin ce jour-là, supprimant ainsi une situation tout à fait inadmissible entre États européens.
Ensuite, il nous reviendra de transposer ce qui a été fait en matière de TVA pour l’appliquer à l’impôt sur les sociétés. Cette voie de l’ACCIS dans laquelle vous nous encouragez à travailler, monsieur Marini, nous allons la suivre avec nos partenaires communautaires. Tel est le sens de l’annonce faite lors du séminaire gouvernemental sur le numérique. L’État d’installation devra reverser aux États où sont établis les utilisateurs une partie de l’impôt sur les sociétés collecté.
Je dirai quelques mots sur la question du représentant fiscal. Monsieur Marini, des éléments de la lettre que vous avez reçue – et j’espère que vous nous communiquerez ce document –, je déduis que cette piste sera difficile à faire prospérer. Sachez que le Gouvernement réfléchit aussi aux moyens de rendre obligatoire pour un certain nombre d'entreprises la présence d’un représentant fiscal légal sur le territoire français. Nous avons également travaillé sur la piste des données personnelles : la manipulation de ces dernières étant une question de souveraineté nationale, un mécanisme de proportionnalité entre la défense de la souveraineté nationale et la présence d’un représentant fiscal pourrait être envisagé. Le principe de l'égalité devant l'impôt pourrait aussi tout à fait justifier ce type de dispositif.
Monsieur le sénateur, nous travaillons avec la Commission européenne pour essayer de trouver un moyen permettant la création d’un représentant fiscal tout en respectant la jurisprudence qui, il est vrai, n’est pas très favorable jusqu'à présent : il n’est qu’à voir ce qui s'est passé avec les sociétés d'assurance en Belgique. Nous devons donc trouver un moyen un peu habile pour arriver à nos fins tout en respectant la jurisprudence.
C'est même une très bonne idée à laquelle je souscris pleinement.
Enfin, je partage totalement votre sentiment : il n’est pas normal qu’un État européen tolère le versement de redevances depuis son territoire vers les Bermudes ou d'autres paradis fiscaux. La directive Intérêts et redevance doit être remise sur la table, pour mettre bon ordre à ces pratiques en Europe. Il serait assez vexatoire que, en la matière, l’OCDE aille plus vite ou plus loin que l’Union européenne. Il nous faut donc agir sans tarder.
Ainsi que vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, les centaines de millions d’euros, voire les milliards d'euros à l’échelle européenne, de bases éludées – selon des articles publiés encore ce matin, cela représenterait 10 % du PIB de l’Union Européenne – nous incitent à traiter d’urgence ce sujet de l'évasion ou de l'optimisation fiscale. Vous pouvez compter sur mon engagement : je m'y emploie depuis ma prise de fonctions, et même auparavant, avec la plus grande vigueur – j’ai d’ailleurs contribué à ce que ce sujet soit remis à l'ordre du jour des négociations internationales et européennes –, et je continuerai. Il n’est pas question pour moi de mettre quoi que ce soit sous le tapis.
Je suis donc un peu vexée par les propos que vous avez tenus tout à l'heure, monsieur Marini : il s’agit là d’un sujet qui me tient à cœur, que je considère comme extrêmement important, notamment dans une période où nous recherchons des recettes fiscales. Contrairement à mon prédécesseur, je suis totalement impliquée dans ce chantier.
J'en viens au contentieux pour abus de position dominante. Vous avez raison de le souligner, la solution retenue aux États-Unis par la Federal Trade Commission dans le cadre de ses négociations avec Google, pas plus que la voie, plus transactionnelle que contentieuse, qui semble se dégager au sein de l'Union européenne ne me semblent satisfaisantes.
Pour ma part, je militerai au sein du Gouvernement pour que nous puissions soutenir la voie contentieuse, même si c’est la plus longue et la plus laborieuse. Il me semble important que nous nous situions désormais sur le terrain des principes.
Je souhaite donner un certain nombre de précisions sur l'accord intervenu entre Google et la presse, même si cela dépasse le cadre de cette proposition de loi. Il s'agit bien d'un accord privé.
J’ai évidemment examiné attentivement la loi sur les droits voisins du droit d’auteur pour les éditeurs de presse qui vient d’être votée en Allemagne : elle est extrêmement difficile à mettre en œuvre. En réalité, si ce droit voisin est instauré pour les éditeurs de presse, ni la quotité ni les modalités ne sont définies, et il appartient aux éditeurs de presse de négocier de gré à gré avec les moteurs de recherche la manière dont ces derniers vont les indemniser pour tenir compte de ce droit. Cette loi est déjà extrêmement contestée en Allemagne : elle est peu protectrice et sera vraisemblablement à l'avantage des grandes entreprises comme Bertelsmann, en mesure de négocier avec des acteurs comme Google. Google sera peut-être incité à déréférencer les sites de presse, ainsi qu'il l’a fait au Brésil ou en Belgique.
Pour toutes ces raisons, je ne suis pas du tout sûre que cette loi soit aussi favorable au secteur de la presse, en particulier aux éditeurs de presse, qu’on l’affirme. Il me semble plus prudent de se donner quelques mois pour vérifier la façon dont elle est appliquée en Allemagne. Si les résultats sont positifs, nous pourrons toujours nous en inspirer. Pour l’instant, nous avons obtenu des espèces sonnantes et trébuchantes, alors que les éditeurs allemands, malgré cette loi, attendent encore. Patientons donc quelques mois pour décider quelle solution aura été la plus efficace.
L'accord qui a été trouvé en France entre les éditeurs de presse et Google comporte deux volets. Le premier volet est commercial et destiné à aider les éditeurs à monétiser davantage un site internet grâce à des revenus publicitaires. Le second volet prend la forme d’un fonds de dotation privé qui relève de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise ; cela s’inscrit en quelque sorte dans une démarche de RSE. Ce fonds privé, assez considérable par son montant, ne se substitue en rien aux aides de l'État à la presse. Je rappelle qu'un contentieux du même type, avec les éditeurs de presse, avait éclaté en Belgique ; si les éditeurs de presse belges sont parvenus à un accord commercial, ils n'ont cependant jamais obtenu un fonds destiné à aider les entreprises de presse à moderniser leur modèle économique à l'heure du numérique, donc à mieux valoriser leur contenu, leurs revenus publicitaires, etc.
En résumé, ce fonds constitue une solution privée entre acteurs privés, une action que l’on peut identifier à du mécénat. Il faudra voir comment s’opère la gestion. L’entreprise négocie actuellement avec les représentants de la presse les modalités précises d’allocation des fonds, les types de projets concernés, les cahiers des charges, etc. L’association de la presse d’information politique et générale semble plutôt satisfaite. En tout cas, ce dispositif présente l’avantage d'être concret, ce qui n’est pas le cas des mécanismes plus théoriques qui ont été retenus en Allemagne
Je remercie une fois de plus Philippe Marini de cette proposition de loi, qui a permis de faire avancer le débat sur ce sujet très important auquel je suis, à l'instar de nombre d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs, extrêmement sensible. Le Gouvernement soutient néanmoins la motion de renvoi à la commission afin d’avancer plus avant sur ce chantier de la fiscalité du numérique, à l’échelon tant national qu’international.
Vous l'avez compris, cette matière est extrêmement complexe et technique. Il faut donc attendre au moins jusqu'à l'examen du projet de finances pour 2014, puisque c'est bien de fiscalité qu'il s'agit, pour approfondir davantage ces sujets et les traiter le plus efficacement possible dans une optique d'équité et sans compromettre les capacités d'innovation des entreprises du numérique nationales. §

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de la motion tendant au renvoi à la commission.

Je suis saisi, par M. Collin, au nom de la commission des finances, d'une motion n° 1.
Cette motion est ainsi rédigée :
En application de l’article 44, alinéa 5, du règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission des finances, la proposition de loi pour une fiscalité numérique neutre et équitable (n° 682 rectifié, 2011-2012).
Je rappelle que, en application de l’article 44, alinéa 8, du règlement du Sénat, ont seuls droit à la parole sur cette motion l’auteur de l’initiative ou son représentant, pour quinze minutes, un orateur d’opinion contraire, pour quinze minutes également, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et le Gouvernement.
Aucune explication de vote n’est admise.
La parole est à M. le rapporteur, pour la motion.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie tout d’abord de bien vouloir excuser mon collègue Yvon Collin, qui ne peut, pour des raisons de santé, vous présenter cette motion de renvoi à la commission. La tâche qu’il m’a demandé d’assumer en le remplaçant aujourd’hui sera d’autant plus aisée que la motion en question a été, je le rappelle, adoptée à l’unanimité par les membres non seulement de la commission des finances, mais aussi des trois commissions saisies pour avis : la commission de la culture, la commission des affaires économiques et la commission du développement durable.
La discussion de ce texte ayant été suspendue le 31 janvier dernier, permettez-moi de revenir très brièvement sur le contexte de cette motion de procédure.
La discussion générale a très clairement montré que la proposition de loi présentée par notre collègue Philippe Marini posait les bonnes questions, qu’il s’agisse de l’« évaporation » des assiettes fiscales liées à l’économie numérique ou des distorsions de concurrence engendrées par les acteurs de l’internet installés dans des États à fiscalité basse ou nulle.
Ces constats ont été confortés par les conclusions de la mission d’expertise Colin et Collin sur la fiscalité de l’économie numérique. Certes, celle-ci ne s’est pas prononcée en faveur de la taxation de la publicité en ligne ou du commerce électronique. En revanche, elle a posé très sérieusement les fondements théoriques de la nécessité d’appréhender fiscalement ce qu’elle appelle le « travail gratuit » des internautes et l’utilisation commerciale qui en est faite par les acteurs de l’économie numérique.
Les débats ont montré que nous sommes tous convaincus de la nécessité d’agir rapidement : le Parlement, et tout particulièrement le Sénat, le Gouvernement, mais aussi les États du G20 et l’OCDE. À cet égard, la commission des finances a auditionné le 20 février dernier M. Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE, afin qu’il nous présente le projet BEPS, à savoir la lutte contre l’érosion des bases d’imposition et les transferts de bénéfices. Nous avons compris qu’un plan d’action serait présenté au G20 au mois de juin prochain pour lancer la négociation d’une convention fiscale multilatérale dont l’élaboration devrait être plus rapide que la renégociation de l’ensemble des conventions bilatérales existantes.
De son côté, le Gouvernement n’a pas été inactif depuis la suspension de nos travaux. Mme la ministre vient de le rappeler : la feuille de route adoptée le 28 février dernier lors du séminaire gouvernemental sur le numérique prévoit de rétablir notre souveraineté fiscale. Pour cela, le Gouvernement souhaite « pousser à la reconnaissance de l’établissement stable virtuel dans les conventions OCDE ; promouvoir, à l’échelle européenne, la mise en place d’une assiette consolidée d’impôts sur les sociétés [...]. Un guichet unique d’IS pourrait être proposé à nos partenaires […] ; étudier, sur la base de la concertation qui a été demandée au Conseil national du numérique et qui s’achèvera avant l’été, l’opportunité d’introduire des dispositions relatives à la fiscalité du numérique dans le projet de loi de finances pour 2014 ».
Madame la ministre, permettez-moi à ce stade de mon intervention de présenter un point de vue plus personnel sur ce sujet, en particulier sur le problème du financement des infrastructures à très haut débit dans les territoires. Nous le savons bien, les opérateurs n’investissent que là où c’est rentable. Ainsi, dans la région toulousaine, les collectivités locales ne sont pas sollicitées, puisque ce sont les opérateurs qui interviennent ; en revanche, pour obtenir des équipements corrects dans le Larzac, les collectivités locales doivent agir. C'est tout le contraire de la péréquation que nous sommes un certain nombre à défendre ! Aussi, pour remplir l’objectif de la feuille de route gouvernementale, 20 milliards d’euros d’investissements sur dix ans ne suffiront pas : le compte n’y est pas !
Je rappelle que, dans l’après-guerre, pour construire le réseau de distribution électrique, une taxe avait été mise en place, le Fonds d'amortissement des charges d’électrification, ou FACE, qui a permis d'électrifier l'ensemble de notre pays. Pourquoi serions-nous moins ambitieux et moins imaginatifs que nos prédécesseurs et pourquoi ne créerions-nous pas, pour financer le déploiement du réseau sur tout le territoire, un prélèvement sur les abonnements internet, visant en particulier les opérateurs ?

Il s'agit non pas de mettre en place un impôt supplémentaire, mais de savoir si l'on veut un véritable aménagement du territoire ou pas. L'argent public étant rare, il faut trouver des ressources ailleurs.

Je sais que cette mesure est soutenue par nombre de mes collègues et qu’elle est évidemment combattue par les opérateurs. Ce n'est pourtant pas une raison pour ne pas continuer à aller dans ce sens.
Il nous appartient de définir la politique du développement numérique et de nous en donner les moyens. L’ambition de couvrir l’ensemble du territoire, en en faisant assumer le coût par tous, est aussi dans l’intérêt des acteurs de l’économie numérique, puisque cette couverture intégrale permettra d’augmenter le nombre d’abonnés et d’offrir des services plus développés.
J’en reviens à l’aspect fiscal de ce problème. On le voit, le calendrier de cette feuille de route s’inscrit dans un temps plus long que celui de l’examen de la présente proposition de loi. Pour autant, nous n’en sommes pas réduits à l’inaction : j’en veux pour preuve les travaux que je viens de vous énumérer.
C’est pourquoi le renvoi à la commission de la proposition de loi présentée par Philippe Marini nous a semblé la meilleure procédure pour ne pas être appelés à voter contre un texte qui, même s’il soulève de fortes réserves, a très utilement porté la question d’abord sur la scène parlementaire, ensuite dans le débat public. Ainsi, tout en respectant le dispositif présenté, le renvoi à la commission permet de préserver le temps nécessaire au Parlement, mais aussi au pouvoir exécutif, pour étudier des solutions complémentaires ou alternatives, notamment la taxation de la collecte ou de l’exploitation des données.
Cette motion de renvoi à la commission est présentée dans un esprit d’ouverture : elle permet à la proposition de loi de continuer à vivre et d’être, le moment venu et à l’issue du calendrier de travail annoncé par le Gouvernement, réinscrite à l’ordre du jour du Sénat ou associée à l’examen d’un éventuel projet de loi. Incidemment, je rappelle, au nom de mon collègue Yvon Collin, que de telles mesures fiscales ont idéalement vocation à être examinées dans le cadre d’un projet de loi de finances plutôt que dans celui d’une proposition de loi. §

M. Philippe Marini. Je veux tout d’abord remercier notre excellent collègue, François Fortassin, ainsi que Mme la ministre, Fleur Pellerin, du grand soin avec lequel ils ont motivé cette motion de renvoi en commission, qui vise, si j’ose dire, à ensevelir sous un tapis de fleurs une modeste proposition de loi.
Sourires.

Voilà deux mois, j’étais également d’avis de voter le renvoi en commission.
À présent, pour les raisons que j’ai exposées lors de la discussion générale, il me semble que cette motion est en décalage par rapport à l’évolution du problème et qu’il convient de la rejeter.
Certes, l’examen et l’adoption de cette proposition de loi ne constitueraient qu’un signal, une petite piqûre d’épingle, somme toute mineure, qui ne serait vraisemblablement pas de nature à entamer la carapace particulièrement épaisse des quelques groupes qui exercent, à mon sens, une position dominante sur le marché des services numériques. Mais le simple fait d’engager une navette sur ce texte serait perçu comme une avancée. En termes de communication, ce ne serait pas neutre !
Au demeurant, pour faciliter une éventuelle adoption de la proposition de loi, je serais prêt à la modifier et à la simplifier, en particulier en supprimant l’article qui vise à instaurer une taxation sur les services commerciaux en ligne. Il s’agit en réalité d’un autre débat, que j’avais initialement souhaité joindre à celui-ci, mais qui soulève une multitude d’autres questions.
Il me semblerait donc opportun d’en revenir à une modeste taxation des régies de publicité en ligne, la publicité constituant bien le cœur du modèle économique des groupes de l’internet.
Au demeurant, les spécialistes de l’économie de l’audiovisuel savent que l’un des grands problèmes aujourd’hui est la baisse tendancielle du marché publicitaire, qui pose à la fois des problèmes de financement et de concurrence pour l’ensemble des chaînes de télévision, les anciennes comme les nouvelles.
Les causes de cette hémorragie du marché publicitaire sont, dans une très large mesure, à chercher dans le développement des vecteurs numériques, qui peut par ailleurs s’avérer excellent sur le plan économique.
Il me semble que cette taxation des régies de publicité est susceptible de faire son chemin. Au demeurant, l’adoption d’un modeste texte au Sénat ne serait absolument pas de nature à compromettre toute étude que le Gouvernement souhaiterait engager par ailleurs. Il ne ferait qu’initier le processus de navette, la date d’inscription du texte à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale restant pour l’instant indéterminée.
Je crois que ce serait surtout une façon de poursuivre le dialogue engagé avec la Commission européenne sur le respect des principes de proportionnalité et de lien direct évoqués dans la récente lettre des commissaires que j’ai citée.
Madame la ministre, je regrette que, au début de votre intervention, vous ayez pu dire que le terrain que nous traitions avait été abandonné par les gouvernements précédents. Ceux-ci n’ont certes pas été parfaits, mais celui-ci ne l’est pas non plus !
Mes chers collègues, pour me connaître un peu, vous savez que, lorsque mes amis politiques étaient au gouvernement, mon soutien ne me dispensait pas d’exercer, au jour le jour, une sorte de devoir d’inventaire, ce qui m’évite de devoir le faire à présent qu’ils ont cédé la place… Il me semble d’ailleurs qu’il est préférable de procéder ainsi, de ne pas jouer aux béni-oui-oui à l’égard de ses amis lorsqu’ils sont au pouvoir, mais d’être transparents et directs à leur endroit, ne fût-ce que pour tâcher de leur rendre service.
En l’occurrence, il me semble que, sur ce sujet, des idées et des principes avaient été évoqués du temps de Nicolas Sarkozy : en particulier, la mission conduite par M. Zelnik avait été, à l’époque, la première à évoquer ce problème du déséquilibre des marchés de l’internet et à plaider pour des éléments de fiscalité spécifique.
Ensuite, je ne referai pas la chronique : il est vrai qu’un fort lobbying s’est exercé en la matière. Dans ce pays comme dans les autres États amis d’Europe, les intérêts économiques sont en effet extrêmement puissants et n’hésitent pas à se faire entendre. Nous ne pouvons l’ignorer, mes chers collègues.
D’ailleurs, Mme la ministre a eu raison, en évoquant la situation de la presse en Allemagne, de dire qu’il existait des groupes d’intérêt de force variable, et que certains avaient pesé plus que d’autres. C’est la réalité des choses. Ne soyons pas naïfs : il est clair qu’il existe sur ce marché des services de l’information des positions puissantes. Il appartient aux États de frayer leur chemin au milieu d’un paysage pour le moins complexe.
Mes chers collègues, le groupe auquel j’appartiens a bien voulu, hier, s’associer à ma demande de rejet de cette motion tendant au renvoi du texte en commission. J’espère que le Sénat votera majoritairement contre celle-ci.
S’il ne le faisait pas, la commission des finances continuerait son travail et profiterait en quelque sorte de ce renvoi pour approfondir ses propres études. Il s’agit pour nous d’un sujet structurant, sur lequel, quoi qu’il en soit, nous reviendrons, madame la ministre, et sur lequel nous nous efforcerons d’être exigeants, en dépassant les clivages politiques qui, s’ils sont naturels dans notre assemblée, devraient à mon sens davantage s’effacer sur un thème de cette nature.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Le Gouvernement est favorable à la motion tendant au renvoi du texte à la commission.

Je mets aux voix la motion n° 1, tendant au renvoi à la commission de la proposition de loi.
J’ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Je rappelle que l’avis du Gouvernement est favorable à la motion.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 125 :
Le Sénat a adopté.
En conséquence, le renvoi à la commission de la proposition de loi est ordonné.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe UMP, la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l’usage des armes à feu, présentée par MM. Louis Nègre, Pierre Charon et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 767, résultat des travaux de la commission n° 454, rapport n° 453).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Louis Nègre, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, pourquoi cette proposition de loi ? Tout simplement parce que le rôle, le devoir et l’honneur du politique est de traiter les problèmes qui préoccupent la société.
S’il est un problème sensible aujourd’hui, c’est bien celui de la protection pénale des forces de sécurité et de l’usage des armes à feu. Tel est l’objet de notre proposition de loi, qui procède d’un double constat : il existe, d’une part, un malaise au sein des forces de l’ordre et, d’autre part, un ressenti de même nature parmi la population.
Dans son rapport, monsieur le ministre, la mission Guyomar revient par deux fois sur le « contexte actuel caractérisé par un certain malaise ». Elle ajoute que « des améliorations sont souhaitables et d’autres plus que nécessaires ». Dans le compte rendu des auditions sont également évoquées les questions récurrentes touchant à l’usage des armes et à la légitime défense, qui traduisent, selon la mission, l’existence d’un besoin de protection élargie et plus efficace.
De même, dans son rapport, notre collègue Virginie Klès souligne qu’il existe légitimement une forte attente des forces de l’ordre. Je me plais à relever, monsieur le ministre, qu’elle-même appelle à améliorer significativement et dans les délais les plus brefs la sécurité juridique des membres des forces de l’ordre.
L’actualité est telle que l’Assemblée nationale a elle aussi examiné, dès le mois de décembre 2012, une proposition de loi ayant le même objet, déposée par nos collègues députés du groupe UMP Guillaume Larrivé, Éric Ciotti et Philippe Goujon.
Le malaise, je l’ai dit, est également ressenti par la population, qui, devant la recrudescence des attaques contre les forces de l’ordre, réagit à son tour et réclame une protection renforcée pour ces dernières ainsi que des sanctions aggravées contre les auteurs des actes violents.
À ce double constat se greffe un autre élément préoccupant. Il s’agit de ce que j’ai appelé un « effet de ciseaux », c’est-à-dire d’un certain divorce entre, d’une part, l’interprétation jurisprudentielle des textes faite par la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de Cassation et, d’autre part, le sentiment populaire, c'est-à-dire le sentiment du peuple, que nous représentons, sur le principe de la légitime défense.
Cette fracture ne peut qu’interpeller le politique. Ce dernier aspect de la question constitue un problème quasi philosophique, qui resitue le débat dans un contexte plus large.
Ce sont ces trois raisons qui nous ont conduits, mon collègue Pierre Charon et moi-même, à nous mobiliser sur ce sujet qui apparaît comme un vrai problème de société.
Si nous pouvons comprendre, madame le rapporteur, les observations que vous faites en matière de techniques juridiques et en discuter, notre vision – notre philosophie, dirais-je même – est totalement différente de la vôtre.
J’en veux pour preuve votre argumentaire selon lequel on ne répond pas à la violence par la violence. À travers cette expression, que je trouve particulièrement malheureuse, vous stigmatisez ce que vous appelez « la violence » des forces de l’ordre. Ce faisant, vous parlez comme les juges de la Cour européenne des droits de l’homme, qui évoquent « la force meurtrière » des forces de l’ordre.
Nous, tout simplement, nous parlons de légitime défense ; nous, tout simplement, nous voulons d’abord protéger les policiers et les gendarmes, qui ne sont, je le rappelle, ni des machines ni des ordinateurs, mais des hommes et des femmes qui risquent leur vie pour nous et pour la défense de la société.
Qui est prêt, aujourd’hui, comme eux, à mettre en péril sa vie pour les autres ?
Sauf à confondre le bien et le mal, sauf à faire fi, monsieur le ministre, de toutes les valeurs qui fondent la cité, on ne peut mettre sur un même plan la violence illégale, aveugle et barbare, d’individus qui n’hésiteront pas un instant, eux, à ouvrir le feu sur des innocents et l’usage des armes fait par les forces de l’ordre dans un cadre légal, contraignant et ne permettant, comme nous le proposons, d’ouvrir le feu que dans un nombre de cas très limité.
Nous ne sommes pas au Far-West ni même aux États-Unis, et nous n’avons pas besoin de cow-boys en France. Toutefois, cette philosophie rousseauiste, démentie par la brutalité de la violence de malfaiteurs sans foi ni loi, ne nous paraît pas admissible !
Jour après jour, les Français sont les témoins impuissants de cette profonde dérive « du vivre ensemble » et des valeurs. L’uniforme ne protège plus ; au contraire, il devient une cible. À mes yeux, mes chers collègues, notre pays marche sur la tête.
Nous devons donc prendre toutes les mesures pour nous adapter à cette nouvelle situation. Le contrat social vole en éclats à cause d’une infime minorité. Nous sommes indignés par la situation actuelle. Avec mon collègue Pierre Charon et les sénateurs du groupe UMP, nous avons donc décidé de réagir et de déposer cette proposition de loi.
Nous souhaitons, monsieur le ministre, que notre indignation soit partagée sur toutes les travées et que l’appel que nous lançons puisse faire bouger les lignes en faveur des forces de l’ordre, qui n’ont pas à payer un si lourd tribut aux voyous.
Ce malaise parmi les policiers et les gendarmes et que ressent aussi la population est confirmé au quotidien par l’aggravation de la violence meurtrière contre les forces de l’ordre. Tout le monde le reconnaît, y compris notre collègue rapporteur, qui évoque elle-même le « constat, incontestable, de l’augmentation dans notre société de la violence et de l’usage des armes ».
Mieux qu’un long discours, quelques exemples récents illustrent la gravité de la situation que nous entendons combattre.
En juin 2012, deux femmes gendarmes ont été abattues à Collobrières. Le meurtrier a assommé l’une des deux militaires pour lui prendre son arme, avant de l’abattre dans l’appartement qu’il cambriolait. Il a ensuite poursuivi la seconde et l’a tuée en pleine rue, sur la placette du village. Elles étaient armées, et ce sont elles qui sont mortes !
Le 16 août 2012, à Cagnes-sur-Mer, ma ville, un malfaiteur multirécidiviste a lui aussi tenté de s’emparer de l’arme d’une policière nationale qui le tenait en joue alors qu’il venait d’être pris en flagrant délit de cambriolage. Le pire fut évité, de justesse, mais pourra-t-il toujours l’être ?
En octobre 2012, le capitaine Brière a été tué par le chauffeur d’un véhicule qui a foncé sur lui alors qu’il portait son brassard et qu’il était sur le côté de la chaussée. Il avait sorti son arme mais il n’a pas tiré… Nous avons tous deux assisté, monsieur le ministre, aux obsèques de cet homme courageux et vous avez vous-même qualifié sa mort « d’intolérable, d’insupportable, d’inqualifiable ». Vous aviez cent fois raison ; mais il est mort !
La semaine dernière, dans une commune littorale des Alpes-Maritimes, à la suite d’un vol à main armée, les gendarmes se sont retrouvés braqués par les malfaiteurs. Ils n’ont pas tiré, mais que ce serait-il passé si les malfaiteurs avaient ouvert le feu ? Les gendarmes me l’ont dit eux-mêmes au téléphone : si ceux-ci avaient tiré, eux-mêmes ne seraient plus là aujourd’hui !
Voilà la situation. Si nous continuons ainsi, nous aurons sans doute à déplorer de nouvelles victimes.
D’autres affaires, à Chambéry, en Corse, dans le Cher, confirment la violence des malfaiteurs face à des forces de l’ordre qui se retrouvent dans une situation impossible.
Pourquoi impossible ? Parce que le cadre légal actuel est interprété par la jurisprudence de telle façon que les forces de l’ordre, les hommes de terrain qui, même s’ils ne la maîtrisent pas totalement, connaissent l’interprétation jurisprudentielle, n’osent pas utiliser leurs armes, y compris dans une situation de légitime défense où leur vie est pourtant en jeu. C’est un comble, et tout cela en raison des conséquences judiciaires, administratives, voire financières, de l’emploi de leur arme par les policiers et les gendarmes !
Du fait du cadre juridique actuel, les forces de l’ordre de terrain préfèrent, comme plusieurs me l’ont déclaré, ne pas utiliser leur arme. Elles ont le sentiment, comme la population, de ne pas avoir plus, si ce n’est pas moins, de droits que les malfaiteurs qui les agressent. Il s’agit là d’un vrai problème, non pas juridique, non pas judiciaire, non pas administratif, mais moral. Nous nous trouvons dans une situation amorale, où le bon peuple constate que les policiers se font tirer dessus et meurent alors que les malfaiteurs arrivent à s’échapper et restent, eux, en vie.
Cette situation, complètement anormale et, je l’ai dit, amorale, heurte le bon sens. Aussi, avec Pierre Charon, proposons-nous une modification de la législation sur la légitime défense et l’usage des armes afin de mieux protéger les forces de l’ordre.
Il est en effet nécessaire de donner aux policiers et aux gendarmes un cadre légal plus protecteur, ainsi que les moyens d’agir appropriés pour tenir compte de la violence des délinquants d’aujourd’hui, laquelle ne ressemble pas à la violence des délinquants d’hier. Comme nous venons de le voir, l’actualité confirme la dangerosité des malfaiteurs, dont certains n’hésitent plus à ouvrir le feu et donc à tuer. En tant que législateurs nous nous devons, me semble-t-il, de réagir pour protéger ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie tous les jours.
Cette crainte conduit à des situations paradoxales : d’un côté, le risque de voir se multiplier le nombre des blessés et des morts dans les rangs des forces de l’ordre ; de l’autre, la diffusion de directives à l’image de celle qui a été adressée par un haut responsable départemental à ses hommes à propos de l’engagement des personnels face aux raids nocturnes contre les magasins de téléphonie et dans laquelle il demande à ceux-ci, premièrement, de s’abstenir de toute poursuite du ou des véhicules utilisés, deuxièmement, d’aborder la scène du crime seulement après s’être assuré du départ effectif des malfaiteurs, troisièmement, de s’abstenir de toute intervention en se tenant sur un point d’observation sans engager d’action !
Une telle attitude peut surprendre, mais elle est en fait conforme à l’état actuel du droit et à la jurisprudence. Ce chef voulait tout simplement protéger ses hommes et sauver leurs vies. Voilà où nous en sommes réduits et voilà pourquoi il est nécessaire, selon nous, de faire évoluer le cadre légal vers un dispositif plus protecteur. Tel est l’objet de notre proposition de loi.
Je le répète, la présente proposition de loi a pour objet, d’une part, de renforcer le régime juridique des policiers pour le rapprocher de celui des gendarmes en instituant au bénéfice des policiers une disposition semblable à la mesure figurant à l’article L. 2338-3 du code de la défense et, d’autre part, de créer deux nouvelles présomptions de légitime défense en faveur des policiers et des gendarmes intervenant dans le cadre du dispositif que nous proposons.
Je ne terminerai pas mon intervention sans évoquer une difficulté particulière de ce dossier que j’ai soulevée précédemment. En effet, l’interprétation du droit, que ce soit par la Cour européenne des droits de l’homme ou, désormais, par la chambre criminelle de la Cour de cassation, pose, me semble-t-il, un vrai problème. Ainsi, l’arrêt Ülüfer c. Turquie rendu au mois de juin 2012 par la première de ces instances puis suivi par la chambre criminelle de la Cour de cassation définit désormais un cadre particulièrement restrictif de l’usage des armes pour nos forces de l’ordre, quelles qu’elles soient, police ou gendarmerie.
La mission Guyomar confirme : « Au-delà des textes, la particularité du domaine de l’usage de la force armée est d’avoir été considérablement modelé, dans un sens restrictif par la jurisprudence. » Ce n’est pas le législateur, ce n’est pas nous, parlementaires, qui avons demandé une telle restriction. Nous, nous avons des comptes à rendre au peuple. Nous, nous sommes élus par le peuple.
Le rapport de la mission précitée poursuit : « Le résultat original en est désormais que les critères jurisprudentiels […] priment finalement sur la question du respect des cas légaux d’ouverture du feu. »
C’est la Cour européenne des droits de l’homme qui pose la condition d’« absolue nécessité », qu’elle apprécie de plus en plus sévèrement.
En bref, quelles que soient les différences du cadre légal national, les agents de la police nationale comme de la gendarmerie se retrouvent jugés de la même manière à l’aune du critère fondamental « de la prééminence du respect de la vie humaine », principe devant lequel nous ne pouvons que nous incliner. La France est un pays de grande culture, mais devons-nous pour autant accepter de voir nos policiers et nos gendarmes sacrifiés ?
Dans le sillage de la Cour européenne, la chambre criminelle de la Cour de cassation exige, à son tour, que le recours à la force meurtrière soit « absolument nécessaire ». Même dans les cas d’usage légal de l’arme, la Cour vérifie que les critères d’existence d’un danger actuel, d’absolue nécessité et de proportionnalité de la riposte sont véritablement remplis. De même, elle fait une appréciation tout autant restrictive des dispositions de l’article L. 2338-3 du code de la défense.
Bref, la jurisprudence a démantelé le cadre légal national existant qui, selon la mission Guyomar, « est désormais largement dépourvu d’efficacité juridique ». La messe est dite !
Ce faisant, cette jurisprudence n’équivaut-elle pas, en pratique, à une présomption de culpabilité à l’encontre du policier ou du gendarme et ne heurte-t-elle pas la présomption d’innocence qui, à ma connaissance, a valeur constitutionnelle ?
Face à ces incertitudes, mes collègues, dont Pierre Charon, et moi-même pensons que le statu quo n’est plus admissible. Le malaise est réel. Voilà bientôt près d’un an, la mission Guyomar a fait vingt-sept propositions, toujours non mises en œuvre à notre connaissance.
Monsieur le ministre, les Français ne comprennent pas cette situation, qui paraît inéquitable et déséquilibrée. Aussi, en attendant que le gouvernement auquel vous appartenez se manifeste, nous, nous avons décidé d’agir ! §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d’abord de rectifier quelques confusions qui ont pu ressortir de mes propos, lesquels ont été interprétés à l’instant par notre collègue Louis Nègre. Je souhaite, notamment, éclaircir les appels que je lance, dans mon rapport, à une meilleure protection des policiers comme des gendarmes.
À l’instar des préconisations de la mission Guyomar, que vous avez abondamment citée, mon cher collègue, la protection demandée est non pas pénale mais fonctionnelle. À cet égard, à la suite des propositions de cette mission, je le sais, les services du ministère travaillent actuellement en liaison étroite avec les organisations syndicales et tous les intervenants de la chaîne policière et de la chaîne judiciaire afin d’améliorer effectivement cette protection fonctionnelle des policiers. Je n’ai jamais appelé à une amélioration de la protection pénale, qui, aux yeux de la commission et de moi-même, semble suffisante aujourd’hui.
Pour ce qui concerne d’autres propos que vous me prêtez relatifs à la réponse à la violence, vous n’êtes pas non plus allé jusqu’au bout de ma démarche. Il me semble important de le relever dans cette enceinte. J’ai dit que, en réponse à la violence et pour le retour de l’autorité, que nous prêchons tous dans cet hémicycle, il faut des réponses qui peuvent être fermes, dures, intransigeantes, mais qui sont non violentes car réfléchies. Il ne s’agit pas de délivrer une escalade de réponses non réfléchies, instinctives à l’imitation des délinquants.
Par ailleurs, certains propos qui figurent notamment dans l’exposé des motifs de la présente proposition de loi soulèvent un problème. Ils ont fait bondir plusieurs membres de la commission, y compris certains collègues appartenant à votre groupe politique, monsieur Nègre, autrement dit de l’opposition actuelle. Aujourd’hui, on ne peut pas affirmer publiquement, me semble-t-il, que les délinquants et les forces de l’ordre sont traités sur un même pied d’égalité par la justice sans mettre les forces de sécurité en danger.

Il est urgent et important d’affirmer que c’est bel et bien le contraire. Si vous lisiez jusqu’au bout les textes au lieu de faire, comme vous avez affirmé le faire, de la politique uniquement pour gagner des élections et non pas pour faire passer des convictions et pour vous mettre au service de votre pays, …

… vous auriez pu constater que dans les textes en vigueur, en particulier dans le code pénal, une rébellion contre l’autorité des forces de l’ordre ne peut jamais constituer un cas de légitime défense. En aucun cas, et même si l’arrestation se passe dans des conditions un peu à la limite de la légalité, des délinquants, ou des non-délinquants d’ailleurs, bref des citoyens qui se rebellent contre les forces de l’ordre ne peuvent être considérés comme étant en état de légitime défense. Par conséquent, ne mettons ni les policiers ni les gendarmes en difficulté de ce point de vue.
Mon cher collègue, on ne peut pas affirmer que, en France, les juges, la justice sont du côté de la délinquance. C’est dangereux de le faire vis-à-vis tant des délinquants que de nos policiers.

Parlons-en ! Moi aussi, dans ma commune, j’ai été confrontée à la mort de trois gendarmes il y a quelques années. Je suis d’ailleurs parfois encore en contact avec certains de leurs collègues. Je peux vous dire que ce ne sont pas les dispositions du droit pénal, une quelconque hésitation, ou encore un enjeu de protection pénale qui ont entraîné ce drame malheureux.
Je déteste que l’on invoque l’honneur des policiers et des gendarmes, que l’on se réfère à des drames, qui sont aussi familiaux, pour faire passer de fausses idées, circuler de fausses rumeurs et faire de la politique pour gagner des élections.

Les gendarmes que je viens de citer sont morts car ils n’ont pas pris les précautions nécessaires. Intervenant auprès d’une famille qu’ils connaissaient, ils ont sous-estimé la dangerosité de la situation et ne se sont pas suffisamment protégés eux-mêmes.

Monsieur Nègre, il me semble que l’autorité et la confiance se reconstruisent dans un pays d’abord avec le respect des uns envers les autres, y compris des paroles des sénateurs même quand celles-ci sont prononcées par des femmes qui se mêlent de sécurité…

Je n’ai pas interrompu votre intervention. Je ne me suis pas permis d’interpréter vos propos avant que vous les ayez terminés. Je vous demanderai de respecter la parole des autres, du rapporteur qui est porte-parole de la commission et non de ses seules opinions. Je vous remercie !

En ce qui concerne l’exposé des motifs de la présente proposition de loi, il me semble évident, sauf à mentir, que nous partageons tous sur ces travées les objectifs de lutte contre la délinquance et de protection maximale de nos policiers et de nos gendarmes, comme de toutes les forces armées de la nation, de toutes celles qui sont en danger à un moment ou à un autre. Il serait faux et déshonorant de tenter de faire croire le contraire.
Comme je viens de le dire, les circonstances dans lesquelles des policiers comme des gendarmes trouvent aujourd’hui malheureusement la mort ou sont blessés ne tiennent pas aux dispositions du code pénal qui régissent l’usage des armes.
Malgré vos affirmations relatives aux hésitations des policiers et des gendarmes à sortir leurs armes, je constate pour ma part ces dernières années une légère augmentation du nombre d’opérations au cours desquelles il y a des tirs. Par ailleurs, alors que, selon vous, les gendarmes se sentiraient mieux protégés et hésiteraient moins à sortir leurs armes, je constate pourtant que les interventions opérationnelles avec tirs sont moins nombreuses chez les gendarmes que chez les policiers nationaux. Même si je ne tire aucune conclusion de ce fait, il ne me semble cependant pas qu’il traduise un sentiment de liberté plus grand chez les gendarmes que chez les policiers quant à l’usage de leur arme.
Selon moi, avant de sortir une arme de son étui pour tirer sur la personne qui est en face de lui, tout homme, toute femme hésite légitimement et ne le fait qu’en cas d’absolue nécessité ou de légitime défense. C’est d’ailleurs ce qui se passe dans 99, 99 % des cas puisque fort peu de policiers ou de gendarmes sont condamnés, malgré les mises en cause systématiques et les examens systématiques. En effet, avant de retirer la vie à quelqu’un, on doit se demander pourquoi et comment.
Mon cher collègue, le sentiment d’insécurité, c’est sans doute vous qui le créez avec vos affirmations, y compris celles que vous proférez à cette tribune.
Je le rappelle, aujourd’hui, nous sommes dans un État de droit dans lequel la vie des citoyens est protégée, tout comme celle des policiers et des gendarmes, qui, pour ce faire, ont le droit d’utiliser leurs armes de par la loi ou le règlement, en cas de commandement de l’autorité légitime, d’absolue nécessité ou de légitime défense. Dans tous ces cas, l’usage de l’arme reste une infraction mais l’irresponsabilité pénale des forces de l’ordre est régulièrement affirmée par la jurisprudence. Il n’y a pas de divorce entre les forces de l’ordre et la justice, contrairement à ce que vous voudriez faire croire.
Pour être reconnues, à l’heure actuelle, la légitime défense et l’absolue nécessité doivent répondre aux mêmes critères selon la jurisprudence tant internationale que nationale, à savoir l’existence ou la probabilité forte d’une menace. Même si l’arme brandie par l’agresseur est factice, à partir du moment où les circonstances permettent d’affirmer que la personne ne pouvait pas savoir qu’il s’agissait d’une arme factice mais pouvait légitimement penser qu’elle était en danger, la légitime défense est reconnue. La menace, la mise en danger, le risque sont les premières circonstances nécessaires pour que l’absolue nécessité ou la légitime défense soient reconnues. La simultanéité comme la proportionnalité de la réponse à la menace ou au sentiment de menace sont bien évidemment également examinées.
Alors, me direz-vous, pourquoi l’article L. 2338–3 du code de la défense établit-il une différence entre les policiers et les gendarmes ? Il énumère en effet certaines circonstances précises dans lesquelles les gendarmes peuvent utiliser leurs armes en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, alors que les policiers n’ont pas cette possibilité. Les gendarmes demeurent des militaires, même s’ils sont désormais rattachés au ministère de l’intérieur. Ils se voient encore confier des missions militaires et ont encore accès à une formation de militaires ; ils bénéficient en particulier du tutorat d’un gendarme expérimenté lors de leur première affectation, ce qui n’est pas le cas des policiers nationaux. En outre, même si un gendarme fait usage de son arme dans l’une des circonstances prévues par l’article L. 2338–3 du code de la défense, les juges examinent si les conditions étaient réunies et ils retiennent le critère de l’absolue nécessité.
Est-il vraiment nécessaire de faire croire que certains sont mieux protégés que d’autres, qu’ils peuvent sortir leur arme plus facilement, de manière plus libérale ? Je ne le crois pas. Il est au contraire nécessaire de leur répéter à tous – policiers et gendarmes – ce qu’ils savent déjà : sortir son arme de son étui et en faire usage contre un être humain est un acte grave, qu’il ne faut pas manquer d’accomplir si on en a besoin, mais dont on portera la trace toute sa vie. Il importe que la société, l’État, le Gouvernement et l’autorité hiérarchique de ces hommes et de ces femmes soient à leurs côtés, avec la justice, et leur disent de façon très claire que, après avoir tout regardé, tout examiné, après avoir décortiqué les circonstances, on les couvrira parce qu’on a constaté qu’ils avaient eu raison de se défendre.
C’est ce qu’il faut rappeler, au lieu de faire croire que les magistrats ou je ne sais qui d’autre seraient hostiles aux policiers et s’amuseraient à protéger les délinquants en disant aux policiers qu’ils ont eu tort de sortir leur arme. Ceux qui affirment de telles choses se déshonorent ; j’y insiste, mes chers collègues. Respecter l’honneur des policiers et des gendarmes consiste à leur dire que, dans 99, 99 % des cas, si ce n’est dans 100 % des cas, ils ont eu raison d’utiliser leur arme. La chaîne de la justice avec laquelle ils travaillent tous les jours et qui lutte à leurs côtés contre la délinquance est là aussi pour leur dire, en toute transparence et devant les citoyens, qu’ils ont eu raison.

Voilà pourquoi je ne pense pas qu’il soit nécessaire de rompre l’équilibre qui existe aujourd'hui entre le droit de tuer en temps de paix, que nous accordons de fait à nos forces de sécurité, et le droit de vivre inscrit dans la Constitution, qui concerne tout le monde. Cet équilibre est conforme à la jurisprudence nationale et internationale. Dans son arrêt Ülüfer c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a simplement délivré une mise en garde : les législations nationales ne doivent pas accorder des droits de tuer disproportionnés au regard du droit de vivre inscrit dans les différentes constitutions. La Cour n’a pas invité les délinquants à tuer des policiers, en leur promettant qu’il ne leur arriverait rien ! Je ne peux accepter que l’on fasse cette caricature ; je suppose d'ailleurs que ma voix trahit ma colère.
Je ne crois pas qu’il faille déséquilibrer les choses. Je ne crois pas qu’il faille ouvrir, ou faire semblant d’ouvrir aux policiers un nouveau droit à faire usage de leurs armes. Les policiers ont le droit de faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité, de légitime défense ou de commandement par l’autorité légitime. Ils le font d'ailleurs très bien, avec mesure. Peut-être – je ne sais pas – y a-t-il lieu de revoir le droit à tirer prévu par l’article L. 2338–3 du code de la défense pour les gendarmes dans le cadre de leurs missions civiles. En tout état de cause, il faudrait d'abord un examen très sérieux et très circonspect des conséquences que cette réforme engendrerait. L’idée de « diminuer », si je puis dire, le droit des gendarmes à faire usage de leurs armes a été émise lors des auditions que nous avons réalisées. Cela nécessiterait la révision de l’ensemble du code de la défense, et je ne suis pas du tout certaine que cela soit indispensable en l’état actuel de la jurisprudence, y compris internationale. Je mentionne néanmoins cette idée, car elle a été évoquée en commission.
C’est donc pour de multiples raisons qu’il ne me paraît pas nécessaire d’ « aligner », comme vous dites, le régime des policiers nationaux sur celui des gendarmes. Je ne crois pas non plus qu’il soit nécessaire de renforcer la présomption d’innocence en créant une présomption de légitime défense. Là encore, ma conviction s’appuie sur plusieurs raisons, dont certaines ont déjà été citées. Il y a d'abord une raison très juridique : cela reviendrait à instaurer, en regard de la présomption de légitime défense, une présomption de culpabilité dans un domaine non contraventionnel, alors que, en droit français, il n’existe de présomption de culpabilité que pour les infractions routières et uniquement en matière contraventionnelle. Cela bousculerait l’équilibre de l’ensemble du droit français.
Surtout, la création d’une présomption de légitime défense reposant sur la qualité – on en bénéficierait ès qualités, en l’occurrence ès gendarmes, ès policiers – risquerait d’aboutir à un résultat contraire à celui que recherchent les auteurs de la proposition de loi : les juges pourraient devenir plus circonspects au sujet de la légitime défense des forces de sécurité. Les policiers et les gendarmes sont censés mieux maîtriser les situations de stress, car ils sont censés être mieux formés à l’usage des armes et à l’évaluation des risques ; on pourrait donc penser qu’ils sont formés à moins faire usage de leurs armes. Or aujourd'hui les juges ne raisonnent pas ainsi : lorsqu’ils examinent un cas de légitime défense, ils estiment que les policiers et les gendarmes ont le droit d’avoir exactement les mêmes réflexes qu’un citoyen normal.
Il me semble que nous avons des efforts à faire en matière de formation des forces de sécurité. Tous mes interlocuteurs, aussi bien dans la police municipale que dans la police nationale ou dans d’autres instances des forces armées – seule la gendarmerie fait peut-être exception –, m’ont dit qu’ils étaient formés, puisqu’ils tirent x cartouches par an. Ils sont formés au maniement des armes, mais pas à déterminer s’il faut ou non les utiliser. Nous avons sans doute des efforts à faire dans ce domaine. En attendant, il me semble plus protecteur pour les policiers comme pour les gendarmes que la légitime défense soit jugée d’après les critères applicables à n’importe quel citoyen. Les policiers et les gendarmes sont mis dans des situations dangereuses ; il ne faut pas partir du principe que leur formation devrait les conduire à moins utiliser leur arme. Ce serait d'ailleurs aller à l’encontre de ce que prêchent les auteurs de la proposition de loi.
En conclusion, nous ne pouvons que nous accorder sur la nécessité de protéger les forces de l’ordre et de lutter contre la délinquance ; c’est notre devoir. Mais nous n’y parviendrons pas en opposant les uns aux autres, en créant des relations de méfiance entre les uns et les autres, surtout entre les institutions et les hommes et les femmes qui se dévouent au service de ces institutions. Notre justice et nos forces de sécurité doivent travailler ensemble, la main dans la main. Oui, à gauche, nous partageons – même les femmes… – la volonté d’un retour de l’autorité. Mais, comme je vous l’ai dit tout à l'heure, ce retour ne se fera pas par la force. L’autorité doit être ferme, et parfois même intransigeante, dure, mais elle ne se déclare pas ni ne se déclame à la tribune : elle se construit.
Il y a des efforts à faire, je l’ai souligné dans mon rapport. Cependant, la mission Guyomar, qui a listé tous ces efforts, a clairement exclu, après un long travail, l’ensemble des mesures que comporte votre proposition de loi, mes chers collègues. Des efforts doivent être faits en matière de formation, je l’ai indiqué. Une réflexion pourrait également être menée sur les premières affectations des policiers. J’ai récemment assisté aux assises de la formation de la police nationale. Certains intervenants ont déclaré – cela m’a marqué – que le premier acte administratif des jeunes policiers nationaux était très souvent une demande de mutation, non pas parce qu’ils ne s’investissent pas dans leur mission, mais parce que leurs premiers postes sont des postes difficiles qui ne correspondent pas du tout à ce qu’ils auraient souhaité : ils se sentent sans doute un peu perdus. Nous pourrions peut-être prendre exemple sur la gendarmerie nationale et l’armée, qui prévoient une formation opérationnelle et un tutorat plus poussés.
Il y a également des efforts à faire en matière de communication et de respect des institutions. Peut-être faudrait-il arrêter de stigmatiser les uns ou les autres en fonction des circonstances. J’ai entendu certains membres de l’UMP – pas vous, mes chers collègues – accuser les policiers tantôt de laxisme, tantôt d’agressivité, voire même d’usage inconsidéré de certaines armes, selon la nature des manifestations. Ces variations sont-elles liées à l’identité des manifestants, ou à autre chose ?

Pourrions-nous avoir un peu de constance dans la communication et mieux respecter les institutions ?

Pourrions-nous éviter de bafouer ou de défendre la présomption d’innocence et de refuser ou d’accepter l’intrusion dans les affaires de la justice en fonction de ce qui nous arrange ? Faisons preuve de plus de constance dans notre communication, notamment sur certaines travées.

En matière de justice et de respect des institutions, il me semble que oui, mon cher collègue ! Je pense être parfaitement bien placée pour en parler. Je n’ai jamais commenté aucune décision de justice ni stigmatisé aucune institution. Mon discours n’a jamais varié sur ce sujet. Vous ne me prendrez donc pas en défaut, du moins sur ce sujet, cher collègue.

Ce n’était pas une attaque personnelle, c’était une réflexion collective !

Vous y répondez personnellement, mais pas collectivement parce que vous ne pouvez pas le faire !

… car, pour l’instant, c’est moi qui suis à la tribune. Mais je ne pense pas que mon groupe ait à rougir en la matière.
Nous devons faire des efforts en matière de communication. Dans ce domaine aussi, la police nationale devrait peut-être regarder ce que fait la gendarmerie. Je sais d'ailleurs qu’une telle démarche est en cours pour améliorer la communication au sujet des faits divers qui défraient la chronique. C’est sans doute à l’autorité hiérarchique de reprendre la main afin de rétablir un lien de confiance avec les policiers qui sont sur le terrain ; je pense que ce serait une bonne chose. La gendarmerie le fait déjà aujourd'hui.
Oui, nous avons également beaucoup d’efforts à faire, et rapidement, en matière de protection fonctionnelle, mon cher collègue. Là aussi, des travaux sont en cours. Oui, il faut continuer d’affirmer la présomption d’innocence de tout policier mis en cause. Oui, tant que dure l’enquête, il faut prendre des mesures de reclassement et assurer une meilleure communication entre les autorités disciplinaires et judiciaires afin de minimiser les délais d’enquête. Les personnes concernées doivent être reclassées à des postes qui ne leur font pas subir de perte sur le plan financier. Elles ne doivent pas être stigmatisées aux yeux de leurs collègues. Oui, il y a là des choses à faire. Il y a aussi des choses à faire s'agissant de l’extension de la protection fonctionnelle aux ayants droit, ou encore des réseaux susceptibles de conseiller les personnes mises en cause. La mission Guyomar a pointé tous ces éléments, et le ministère de l’intérieur travaille sur ces sujets, en lien avec l’ensemble des organisations professionnelles concernées, et pas seulement avec les organisations professionnelles de la justice.
Pour conclure, la commission, soutenue par certains membres de votre groupe, monsieur Nègre, a émis un avis défavorable sur cette proposition de loi. Celle-ci ne répond pas aux objectifs que vous affichez. En outre, nous nous refusons à stigmatiser la justice ou à l’opposer à la police nationale et à la gendarmerie. Nous nous refusons également à rompre l’équilibre actuel en matière d’usage des armes par les forces de sécurité, qui est conforme au droit national et international, rappelé encore récemment par des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation – je pense notamment à celui qu’elle a rendu le 12 mars dernier – et de la Cour européenne des droits de l’homme. Nous avons atteint un équilibre. Cet équilibre existe, mais il est fragile. Ne le rompons pas : tenons plutôt un vrai discours de confiance vis-à-vis des policiers et des gendarmes, qui se dévouent tous les jours au service de la France et de notre sécurité et méritent autre chose que les invectives que nous avons entendues tout à l'heure. §
Monsieur le président, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, imposer l’ordre républicain en s’opposant aux individus qui le contestent : telle est la mission qui incombe aux policiers et aux gendarmes. Ils l’accomplissent avec le courage, l’engagement et le professionnalisme qui caractérisent les forces de l’ordre de notre pays.
Vous le savez tous, s’opposer n’est pas sans risques. En témoignent les noms des femmes et des hommes qui sont tombés dans l’accomplissement de leur mission, de leur devoir, en luttant contre la criminalité et en défendant les valeurs qui fondent notre société. Je le dis ici, de nouveau, devant la représentation nationale : ces noms sont évidemment notre fierté et il appartient à la République de toujours les honorer.
En 2012, six policiers et gendarmes sont morts en mission. Le 26 février dernier, avec le Premier ministre, j’ai rendu un dernier hommage au capitaine Cyril Genest et au lieutenant Boris Voelckel, policiers de la BAC, tués dans des circonstances d’une extrême gravité sur le périphérique parisien. Ce jour-là, c’est toute la police nationale qui portait le deuil ; c’est toute la République qui était le deuil !
Au-delà des chiffres, il y a des souffrances : celles des familles, des proches, des collègues de ces policiers et gendarmes. Ces souffrances, nous devons les respecter, sans jamais exploiter la mort de ces femmes et de ces hommes.
Je veux insister sur la gravité du sujet que votre assemblée est appelée à examiner aujourd’hui, au travers de cette proposition de loi.
Faire usage de son arme – Mme la rapporteur l’a très bien dit – n’est pas une chose anodine. C’est potentiellement ôter la vie. Aucun policier, aucun gendarme ne peut aborder cette éventualité autrement que comme une épreuve. Une épreuve nécessaire qu’ils assument dans le cadre prévu par la loi.
Encadrer scrupuleusement le recours à la force légitime : tel est le fondement même d’un État de droit !
Monsieur Nègre, il y a effectivement une différence – et heureusement ! – entre les policiers et les gendarmes, qui agissent dans le cadre de la loi, et les voyous, qui contestent cette autorité. §
La question de l’usage de l’arme est grave ; elle ne peut être abordée dans l’émotion, notamment celle qui naît devant l’indicible et l’insupportable. Cette question, nous devons l’aborder sereinement, de façon dépassionnée. Or de telles circonstances ne sont par réunies, je le crains, pour la discussion de cette proposition de loi, dans l’exposé des motifs de laquelle il est affirmé que la loi met « quasiment sur le même plan les malfaiteurs et les forces de l’ordre ».
Que des législateurs censés voter la loi puissent affirmer que celle-ci place les malfaiteurs et les forces de l’ordre au même niveau est proprement stupéfiant ! §
M. Manuel Valls, ministre. Ce n’est pas parce que nous sommes réunis un matin au Sénat, tandis que l’actualité porte sur d’autres sujets, que nous devons laisser passer de telles phrases dans une enceinte de la République !
Bravo ! et applaudissementssur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. –
Mesdames, messieurs les sénateurs, la loi que vous votez ne peut pas dire cela ! Je ne pourrai jamais partager ce constat !
Aborder la question de l’usage de l’arme implique d’avoir une juste représentation de ce qu’est le métier de policier. Pour l’essentiel, c’est justement de ne pas utiliser son arme, qui ne doit rester qu’un ultime recours. Pour toutes celles et tous ceux qui agissent sur le terrain, qui font face à la délinquance, au crime organisé, une intervention réussie, c’est maîtriser la situation, interpeller, neutraliser sans devoir faire feu.
Cette proposition de loi, en tendant à mettre l’arme au centre de la réflexion, en en faisant le seul sujet, fait fausse route.
Policiers et gendarmes sont tous dépositaires de l’autorité publique ; tous portent une arme, sauf circonstances exceptionnelles.
Les auteurs de ce texte, en partant d’une analyse simpliste, caricaturale du droit en vigueur, veulent voir une différence majeure entre les deux forces en matière d’usage de cette arme. Or, dans les faits, comme l’a dit Mme Virginie Klès, la situation est beaucoup plus nuancée.
Le Gouvernement, par la voix de mon collègue Alain Vidalies, a déjà pu s’expliquer sur ce point, voilà quelques mois, à l’Assemblée nationale, lors des débats relatifs à la proposition de loi présentée par le député Guillaume Larrivé et plusieurs de ses collègues, à laquelle M. Nègre a fait allusion. Je le fais, à nouveau, aujourd’hui, devant vous.
Le principe de la légitime défense est régi par l’article 122–5 du code pénal. L’usage des armes par les forces de sécurité intérieure relève de ce principe général : l’auteur de violences ou d’un homicide volontaire est pénalement irresponsable lorsqu’il répond à une agression injuste, par une riposte immédiate, nécessaire et proportionnée. Ainsi, il ne peut être imputé aux policiers et aux gendarmes un usage illégal de la force dès lors qu’ils ont agi en état de légitime défense ou sous l’empire de l’état de nécessité.
Il faut, en outre, ajouter un cas spécifique d’usage légitime des armes à feu par les forces de l’ordre lorsqu’il s’agit de dissiper un attroupement. C’est ce que prévoit l’article 431–3 du code pénal.
Toutefois, à ce tronc commun s’ajoutent, pour la gendarmerie nationale, des dispositions spécifiques issues du code de la défense. Ce texte permet aux gendarmes d’utiliser leurs armes non seulement pour se défendre, mais aussi pour empêcher la fuite d’une personne ou d’un véhicule, après sommations faites à voix haute et s’il n’existe pas d’autres moyens.
Cependant, la jurisprudence a largement tempéré cette différence apparente sur laquelle les auteurs de cette proposition de loi fondent l’ensemble de leur raisonnement. Qu’il s’agisse des juges de la Cour européenne des droits de l’homme ou de ceux de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tous exigent, au-delà même des textes, pour légitimer l’usage des armes, l’existence d’une absolue nécessité, c’est-à-dire le respect du principe fondamental de proportionnalité.
Ainsi, l’unification à laquelle tend cette proposition de loi a déjà eu lieu dans les faits. Il s’agit de tenir compte de trois évolutions : la réunion au sein du ministère de l’intérieur des deux corps de la police nationale et de la gendarmerie nationale, l’harmonisation des terrains d’intervention en raison de l’urbanisation croissante des territoires, et, enfin, la proximité des missions de sécurité intérieure entre la police et la gendarmerie.
J’observe également que l’article 1er de la proposition de loi, qui a pour objet d’unifier les deux régimes juridiques, manque précisément son objectif. En effet, il ajoute aux violences et voies de fait, les tentatives d’agressions et la nécessité d’une sommation, qui ne figurent pas dans le texte applicable à la gendarmerie. Les policiers auraient donc, sur ce point, un usage des armes plus large que celui qui est accordé aux gendarmes.
En outre, il circonscrit l’usage des armes pour empêcher la fuite d’un suspect à la commission de crimes ou de délits graves. Les policiers auraient alors, sur cet autre point, un usage des armes plus restreint que les gendarmes.
Je veux donc le redire : cette demande d’harmonisation des régimes relatifs à l’usage de la force armée n’est pas utile.
Elle n’est pas non plus opportune, car la différence de régime demeure justifiée, autant par le statut militaire des gendarmes que par la porosité, dans certaines zones, entre missions de maintien de l’ordre et missions militaires. Je pense notamment à la Guyane.
Cette proposition de loi tend également, en créant une présomption de légitime défense qui leur serait spécifique, à aller plus loin dans les conditions d’usage des armes à feu par les policiers et les gendarmes. Je le dis de la manière la plus claire : c’est une très mauvaise idée ! Ce droit obtenu par un renversement de la charge de la preuve est un piège vers lequel je refuse de conduire les policiers et les gendarmes dont j’ai la responsabilité. D’ailleurs, je vous rappelle que mon prédécesseur, Claude Guéant, avait lui-même rejeté une telle option le 27 avril 2012, …
En effet, une telle présomption va à l’encontre d’une réalité : les forces de l’ordre étant formées et entraînées au maniement des armes, elles sont donc censées en faire un usage maîtrisé. Maintenir l’ordre et protéger nos concitoyens sans faire feu est, comme je l’ai déjà dit, une fierté. C’est donc faire injure au professionnalisme des policiers et gendarmes que de banaliser l’usage des armes en consacrant le principe d’une légitime défense a priori.
Qui peut croire, enfin, que cette disposition désarmerait les délinquants, qu’elle rendrait plus sûr le métier de policier ? Personne !
En revanche, comment ne pas voir en filigrane de ce texte un message de défiance à l’égard de la justice ? Ce message, toujours le même, depuis dix ans, vise à opposer systématiquement les policiers aux magistrats. Cette présomption de légitime défense, c’est un préjugé à l’égard de la justice.
Votre proposition de loi véhicule une idée fausse qui voudrait qu’une protection accrue des policiers passe par l’usage de l’arme. C’est une vision trompeuse. C’est une vision simpliste. Mesdames, messieurs les sénateurs, les solutions sont ailleurs. Certes, on peut toujours faire évoluer les textes, mais, ces solutions, contrairement à ce qui a été dit, le Gouvernement les met en œuvre dans le cadre, j’y reviendrai, d’une politique de sécurité renouvelée, visant à assurer la sécurité des Français et à renforcer l’efficacité de nos services de police et de gendarmerie.
Monsieur Nègre, vous avez raison
M. Louis Nègre sourit.
Ce n’est pas sérieux. C’est d’autant moins sérieux, monsieur Nègre, que, dans toutes les affaires que vous avez évoquées, les gendarmes et policiers étaient en état de légitime défense. Prétendre, en prenant appui sur une note ou une circulaire, que les forces de l’ordre n’ouvriraient pas le feu par crainte des tracasseries administratives et des poursuites judiciaires n’est pas non plus sérieux.
L’honneur, la fierté, je le répète, des forces de sécurité, c’est de maîtriser des individus, c’est de gérer des situations sans faire feu. Le sang-froid des policiers et des gendarmes, leur discernement ne peuvent pas, comme vous le faites, être ravalés au rang d’impuissance et de faiblesse de nos forces de l’ordre.
En tant que ministre de l’intérieur, j’ai donc le souci permanent de protéger les policiers et les gendarmes – et je ne veux pas oublier les policiers municipaux –, qui, au quotidien, je le sais très bien, font face à une contestation, parfois virulente, de leur autorité, et ce non pas depuis dix mois, mais depuis des années.
Dès ma prise de fonctions, j’ai voulu, à la suite des engagements du Président de la République, renforcer la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes. J’ai donc confié une mission en ce sens à M. Mattias Guyomar, conseiller d’État.
La protection fonctionnelle, c’est la juste garantie qu’accorde l’administration à ses agents lorsqu’ils sont victimes ou mis en cause dans l’exercice de leurs fonctions. C’est, pour l’État, un devoir impérieux de protéger ces hommes et ces femmes qui, chaque jour, risquent leur vie pour nos concitoyens.
Les auteurs de la proposition de loi affirment, dans son exposé des motifs, que « par peur de poursuites administratives ou judiciaires, des policiers ont pu hésiter à se défendre, devant des agresseurs dénués de tout scrupule ». C’est faux : le ministère de l’intérieur n’abandonne pas ses agents ! La protection juridique des policiers et des gendarmes est déjà une réalité : le nombre de mesures de protection prises pour les agents victimes, comme pour les agents mis en cause, en témoigne. Ce nombre n’a cessé d’augmenter depuis cinq ans pour atteindre plus 20 000 mesures de protection en 2012.
Cette protection que l’État doit à ses agents, j’ai souhaité qu’elle soit renforcée en signe de reconnaissance de la nation. J’ai voulu que l’administration exprime clairement sa solidarité envers celles et ceux qui la servent. Les fonctionnaires de police doivent savoir que l’État sera toujours présent pour les soutenir lorsqu’ils remplissent, avec professionnalisme, leur mission de service public.
Le rapport Guyomar, qui m’a été remis le 13 juillet dernier, comporte vingt-sept recommandations dont la plupart ont d’ores et déjà été mises en œuvre. Trois axes ont été privilégiés.
D’abord, la protection juridique accordée aux victimes devait être étendue aux concubins et aux pacsés, qui n’en bénéficiaient pas. Cette injustice a été réparée dans la police nationale ; elle est en train de l’être dans la gendarmerie.
Ensuite, les droits des agents mis en cause doivent être mieux protégés. Les services qui mènent les enquêtes judiciaires et administratives ne peuvent être les mêmes ; ils sont donc séparés. Par ailleurs, le droit à l’assistance juridique est désormais assuré dès la phase d’enquête administrative, ce qui constitue également une avancée importante.
Enfin, protéger les agents, c’est éviter de précariser leur carrière lorsqu’ils sont mis en cause. À cet égard, les policiers avaient une attente forte, notamment à la suite de l’affaire de Noisy-le-Sec qui avait quelque peu enflammé – une nouvelle fois sur ce sujet – la fin de la campagne pour l’élection présidentielle. La suspension « préventive » était devenue la règle. Désormais, en accord avec la garde des sceaux, le maintien en service sera privilégié ; des instructions en ce sens ont déjà été données.
Sécuriser les carrières, protéger les fonctionnaires et leur famille : parce que cet objectif vaut pour l’ensemble de la fonction publique, un certain nombre de mesures générales sont actuellement étudiées dans un cadre interministériel, sous l’égide du ministère de la réforme de l’État.
Mieux protéger nos policiers et nos gendarmes est nécessaire, mais ce n’est pas tout. Il faut aussi se demander comment ils peuvent agir efficacement contre les phénomènes délinquants auxquels ils sont confrontés – comment et avec quels moyens !
La question est donc bien plus complexe que le cadre dans lequel les auteurs de la proposition de loi cherchent à l’enfermer. Ceux qui connaissent la réalité savent qu’il est difficile d’avancer sur ce terrain sans heurter des principes fondamentaux. D’ailleurs, monsieur Nègre, vous n’avez jamais pris une telle initiative sous les gouvernements que vous souteniez. §
Les forces de l’ordre doivent faire face à une montée de la violence, qui n’est pas nouvelle, et à des individus déterminés, de plus en plus jeunes, lesquels utilisent parfois des armes de guerre. Elles sont aussi confrontées à des trafics et à des groupes organisés qui, dans les quartiers, veulent substituer un autre ordre à l’ordre républicain. Enfin, les policiers et les gendarmes doivent lutter contre une délinquance qui change de formes et qui se déplace vers de nouveaux territoires.
Personne ne conteste cette réalité. Je l’assume, quoiqu’elle ne soit pas le bilan du Gouvernement ni le mien. Je pourrais même vous dire qu’elle est le bilan de dix ans de la politique de sécurité menée par la majorité précédente ; c’est en partie vrai, mais c’est réducteur.
Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, je ne veux pas, moi, tomber dans vos caricatures. C’est un fait que cette situation est aussi le fruit d’une contestation de l’autorité, de la famille et de l’école ; le fruit aussi de la place de l’argent dans notre société, ainsi que des évolutions de la délinquance que je viens de rappeler. Une réponse très déterminée est nécessaire ; elle incombe à l’État, qui doit incarner l’autorité, mais aussi à toute la société.
Je veux agir avec détermination, ce qui implique de repenser non pas l’usage des armes, mais les dispositifs, les modes d’intervention, de sécuriser l’action des policiers. Sécuriser leur action, c’est faire en sorte qu’ils soient plus nombreux, mieux formés, mieux équipés et, surtout, pleinement respectés.
(M. Jacques Chiron opine.) Ces suppressions ont nécessairement rendu les missions sur le terrain beaucoup plus complexes
Eh oui ! sur plusieurs travées du groupe socialiste.
Mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, je ne doute pas de votre bonne foi, mais il est pour le moins étonnant que vous présentiez une proposition de loi visant à protéger les policiers alors même qu’au cours des cinq dernières années les gouvernements que vous avez soutenus ont supprimé 10 700 postes de policiers et de gendarmes ! §, et aussi beaucoup plus dangereuses : combien de policiers et de gendarmes soulignent que leurs équipages sont réduits !
Protéger les policiers, c’est avant tout garantir qu’ils soient en nombre suffisant sur le terrain et que les effectifs dont ils disposent leur permettent de se sécuriser eux-mêmes.
En effet, la meilleure façon d’utiliser la force, qui est nécessaire, est de commencer par la rendre visible et opérationnelle sur le terrain.
C’est pourquoi, conformément aux engagements du Président de la République, il a été mis un terme à la politique de non-remplacement des départs en retraite. Non seulement les 3 000 départs prévus cette année seront remplacés, …
… mais 288 policiers et 192 gendarmes supplémentaires seront recrutés en 2013. Ces embauches se poursuivront à un même rythme annuel au cours du quinquennat, de sorte que 500 policiers et gendarmes supplémentaires au total seront recrutés chaque année. Bien évidemment, cela ne remplacera pas toutes les suppressions de poste, mais c’est le signe que le Gouvernement est décidé à s’attaquer avec force et détermination aux défis que nous posent la violence et la délinquance.
En matière de formation, – Mme la rapporteur y a fait allusion – j’ai voulu que des assises soient organisées au sein de la police nationale afin de réfléchir aux dispositifs permettant de rendre plus efficace la police d’aujourd’hui et de préparer celle de demain. Ces assises, qui se sont tenues au début du mois de février dernier, ont permis de préciser l’effort à accomplir en matière de formation initiale dans les écoles de police. Elles ont aussi permis de fixer des orientations pour renforcer la formation continue. En effet, il est primordial d’assurer, tout au long de la carrière des policiers, l’adéquation entre leurs compétences et les missions qui leur sont confiées, compte tenu des évolutions de la délinquance.
Les policiers ont également besoin de moyens matériels pour agir. Certes, le cadre budgétaire est contraint ; mais le Gouvernement entend donner à la police et aux gendarmes, qui les réclament, les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
En particulier, les forces de l’ordre doivent pouvoir bénéficier d’avancées technologiques comme la géolocalisation des véhicules ou les caméras embarquées, qui permettent de dépêcher les effectifs nécessaires en renfort. Quant à la vidéoprotection, elle permet de sécuriser nos concitoyens, mais aussi les policiers dans leurs interventions.
En ce qui concerne les avancées technologiques, il faut encore citer les caméras-piétons, qui contribueront au rétablissement du rapport de confiance avec la population. Le retour du matricule et le nouveau code de déontologie concourront à ce même objectif. En levant les incompréhensions et en désamorçant les tensions, il s’agit aussi de sécuriser les policiers dans leurs interventions sur le terrain.
À Clermont-Ferrand où j’étais il y a quelques jours, dans un quartier classé en zone de sécurité prioritaire à la suite du drame qui s’est produit voilà un an, les policiers m’ont rapporté qu’ils rencontraient encore des difficultés pour patrouiller à pied, ce qui est pourtant nécessaire au rétablissement de la sécurité.
Je veux que les policiers soient respectés, que leur autorité soit pleinement établie. Cette autorité implique une police respectueuse et au contact de la population, notamment dans les quartiers ; c’est ainsi que la police sera respectée par la population.
Tout acte d’agression verbale ou physique à l’égard de nos forces de l’ordre doit être sévèrement puni. Je me rendrai demain à Amiens pour faire le point sur la zone de sécurité prioritaire créée il y a plusieurs mois, avant que n’éclatent des émeutes urbaines. Grâce au travail accompli par les enquêteurs sous l’autorité du parquet, ceux qui ont semé le désordre et qui ont agressé les forces de l’ordre sont, les uns après les autres, arrêtés et déférés à la justice.
Ce résultat montre qu’il faut avoir confiance dans la justice et dans sa collaboration avec les policiers. La mise en cause permanente de la justice affaiblit l’État de droit et la relation indispensable entre les forces de l’ordre et les magistrats. Hier soir, lors d’une visite de terrain à Aubervilliers et à Pantin, en Seine-Saint-Denis, j’ai constaté les fruits d’une coopération exemplaire entre la police, les douanes et la justice pour lutter contre les trafics et tout ce qui pourrit la vie quotidienne de nos concitoyens dans les quartiers populaires.
Une police sécurisée, c’est aussi une police confortée dans ses missions et dans ses modes d’intervention. Tel est l’objectif des soixante-quatre premières zones de sécurité prioritaires.
Comme je viens de le montrer, l’action coordonnée entre les services et les liens renforcés avec la justice portent déjà leurs premiers fruits. C’est le cas à Amiens, mais aussi contre des phénomènes de bandes à Grigny, où les agresseurs du RER ont été interpellés, à Corbeil-Essonnes, où une quarantaine de vols avec violence ont été élucidés, ou encore à Marseille, où des trafics sont démantelés. Seulement, pour lutter contre ces phénomènes, il faut un temps qui est parfois contraire à l’émotion que provoque tel ou tel fait ou à l’exploitation politique à laquelle il donne lieu.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cette proposition de loi apporte une mauvaise réponse à une bonne question. Cette réponse, la même depuis dix ans, n’a pas empêché les violences aux personnes d’augmenter : elles augmentent depuis trente ans, touchant toutes les catégories, particulièrement les femmes et les plus fragiles. Pourtant, je ne doute pas que la même réponse sera avancée lors de la convention que tient aujourd’hui l’UMP sur le thème de la sécurité, avec un traitement spécial réservé à la garde des sceaux et au ministre de l’intérieur – j’ai bien compris que c’est la nouvelle stratégie.
Cette réponse, le Gouvernement ne peut pas l’entendre. C’est pourquoi il demande au Sénat de rejeter cette proposition de loi, qui n’est utile ni pour la sécurité des forces de l’ordre ni pour celle des Français !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi qu’au banc des commissions . – MM. André Gattolin et François Fortassin applaudissent également.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, j’aurais pu commencer mon intervention par le récit de quelques-uns de ces faits divers quotidiens qui illustrent malheureusement la terrible situation de notre pays. Louis Nègre m’ayant devancé avec beaucoup de talent et d’émotion, je consacrerai mon propos à la proposition de loi que nous présentons.
Il importe malgré tout de replacer notre initiative dans le contexte de l’hyper-violence à laquelle nos forces de l’ordre doivent répondre et qu’elles s’efforcent de contenir. Il s’agit d’une nouvelle violence dont les acteurs sont chaque jour plus lourdement armés. Quand j’étais adolescent, les blousons noirs avaient des canifs et des chaînes de vélo ; aujourd’hui, les délinquants ont troqué les canifs contre des kalachnikovs.
Or nous sommes très régulièrement témoins de situations terribles dans lesquelles un policier ou un gendarme perd la vie dans l’exercice de ses fonctions. Certains parleront sans doute des risques du métier. C’est un fait que l’engagement dans la police ou dans l’armée présente cette particularité qu’on y risque sa vie pour protéger celle des autres ; cette particularité doit nous inspirer le plus grand respect et la plus profonde gratitude, en aucun cas de la moquerie ou du dédain.
Ce sont, chaque année, plus de 10 000 policiers qui sont blessés, soit une quarantaine par jour ! Le cadre juridique semblant ne plus être adapté à cette situation, Louis Nègre, moi-même et une quarantaine de nos collègues avons décidé de déposer cette proposition de loi.
Ce texte a une portée symbolique et une nécessité concrète. Une portée symbolique, tout d’abord, en ce qu’il confirme le monopole de la violence légitime, pour reprendre la formule du sociologue Max Weber, monopole qui fonde l’État de droit. Permettez-moi, mes chers collègues, de prendre le temps d’ouvrir ici une parenthèse sur la nature de cet État de droit, si cher à nos démocraties contemporaines.
L’État de droit se fonde sur deux socles : le monopole de la violence légitime, qui justifie la prérogative de l’État en matière de maintien de l’ordre, et le respect des libertés civiles, lequel implique un usage exclusivement défensif de la violence.
Si l’on oublie l’un de ces deux socles, la société bascule, soit dans l’anarchie des règlements de compte, soit dans l’État totalitaire, qui étouffe la liberté sous la répression policière. Dans les deux cas, la fin de cet équilibre crée une situation dangereuse. Si l’État n’a plus le monopole de la violence légitime, c’est l’escalade anarchique de la violence des milices et des gangs, c’est la société du désordre du tous contre tous, où la loi du plus fort remplace la loi du juste. Au contraire, si l’État ne limite pas son autorité, c’est l’escalade de la répression, l’assèchement de la liberté et, bien souvent, la révolte d’un peuple contre un autre.
C’est donc dans un souci permanent d’équilibre que nous avons bâti cette proposition de loi, afin de donner toute leur légitimité et leur place à nos forces de l’ordre, en respectant les règles les plus fondamentales relatives aux limites de l’autorité dans une démocratie moderne.
Nous avons dû élaborer ce texte en veillant à suivre deux fils conducteurs : la protection des policiers, qui voient leurs conditions de travail se dégrader chaque jour et attendent de la part du législateur une réponse concrète à ce problème, et la vigilance, afin que ce texte ne constitue en aucun cas une incitation, pour les policiers, à tirer à la première occasion. Ce travail exige une certaine finesse, et les frontières sont bien entendu ténues.

Mais quand il s’agit d’une question aussi essentielle que le maintien de la paix civile, nous ne pouvons pas systématiquement nous réfugier derrière la complexité du droit. Si nous voulons vivre ensemble, et vivre en paix, il faut qu’il y ait un ordre, et des forces qui le fassent respecter.
Or, comme l’expliquait voilà quelques instants mon collège Louis Nègre, contrairement aux gendarmes et aux douaniers, qui peuvent faire usage de leur arme à feu après des sommations et sous réserve de conditions limitatives, les policiers ne sont autorisés à ouvrir le feu qu’en réponse à une agression de même nature. Cette situation met donc quasiment sur le même plan les délinquants et les forces de police.
C’est tout simplement moralement inadmissible. Il est par conséquent urgent de faire évoluer le droit afin de l’adapter à une réalité qui a changé.
Notre proposition de loi vise ainsi à donner aux policiers la possibilité de faire usage de leurs armes dans un cadre légal et protecteur des forces de l’ordre, et sous réserve de certaines conditions limitatives.
Dans un État de droit, si les délinquants bénéficient de la présomption d’innocence, il est légitime que les forces de police bénéficient de la présomption de légitime défense. Or, dans l’état actuel du droit, il faut quasiment que le policier se soit déjà fait tirer dessus pour pouvoir utiliser son arme. La réalité des situations est souvent beaucoup plus complexe que les classements arbitraires validant ou non la légitime défense.
Permettez-moi de vous donner un exemple, mes chers collègues, afin de bien comprendre ce qui se passe sur le terrain. Un policier poursuit un individu armé d’un pistolet. Celui-ci, à vingt mètres du policier, se retourne et menace de son arme ce dernier, lequel fait usage de la sienne à trois reprises. L’individu est tué et l’autopsie démontre que la balle l’a frappé de dos, alors que le policier affirme avoir tiré sur l’individu qui le menaçait. Légalement, la balle ayant frappé l’individu de dos, celui-ci ne pouvait diriger « simultanément » son arme en direction du policier : la légitime défense est donc exclue. Cet individu, qui s’enfuyait en tenant un pistolet à la main, présentait pourtant un danger important pour les policiers et les passants. On peut imaginer qu’entre le premier et le troisième coup de feu tiré par le policier l’individu s’est retourné un micro-instant pour se cacher, la balle l’ayant frappé alors qu’il faisait volte-face. Dans le système pénal actuel, le policier, menacé directement lorsqu’il a commencé à tirer, était en état de légitime défense, la condition de simultanéité étant retenue. Dès que l’individu a amorcé son retournement pour s’enfuir, le policier n’était plus en situation de légitime défense. Dans la réalité, toute la scène n’a duré qu’un instant. S’il est facile ensuite pour les magistrats de la décortiquer quart de seconde par quart de seconde, il était impossible pour le policier, dans le feu de l’action, d’arrêter son geste au moment où l’individu se retournait.
C’est pourquoi nous avons proposé une telle adaptation de la loi n° 2011–267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui modifie les conditions d’usage des armes à feu pour les fonctionnaires de police. Nous proposons que les membres des forces de l’ordre puissent tirer sur un individu armé refusant de déposer son arme après les appels répétés de « halte police ». Cela leur évitera de devoir attendre, au risque de leur vie, d’être directement menacés par l’arme et incitera les délinquants à déposer leurs armes sur injonction de la police. Telle est la dimension préventive de ce texte.
En élargissant le droit des policiers à utiliser leurs armes, le législateur envoie un signal à la société, et en particulier aux délinquants. Ce signal dissuasif devrait les inviter à un plus grand respect ou, du moins, à une plus grande crainte des forces de l’ordre. Mais ce signal concerne également les policiers, qui travaillent dans un climat d’insécurité judiciaire, lequel, associé à des conditions de travail extrêmement violentes, favorise malheureusement les situations d’exaspération et la possibilité de dérapages.
Mes chers collègues, j’ai entendu les craintes exprimées par certains d’entre vous, qui redoutent que ce texte n’ouvre la porte aux violences policières. Pourtant, les gendarmes servent déjà dans le cadre de la légitime défense que nous proposons d’ouvrir aujourd’hui aux policiers, et aucun chiffre n’indique un différentiel positif, en matière de faute professionnelle, dans la gendarmerie ! Par conséquent, sauf à différencier la confiance que nous accordons aux policiers et aux gendarmes, il n’y a aucune raison de différencier les conditions d’exercice de la légitime défense. Une telle confiance dépasse les particularités des deux branches de notre sécurité intérieure, et c’est bien dans cet état d’esprit que Louis Nègre et moi-même avons décidé d’harmoniser les conditions d’utilisation des armes à feu par les policiers et les gendarmes.
Je souhaite éclairer cet état d’esprit en revenant sur un sondage, qui indiquait récemment que l’armée – celle-ci inclut la gendarmerie – est l’institution dans laquelle 85 % des jeunes de notre pays ont le plus confiance. La police ne bénéficie malheureusement pas de la même réputation
M. Jean-Louis Carrère s’exclame.

Vous en conviendrez, mes chers collègues, nos policiers ne tirent sur les gens ni par plaisir ni par excès de zèle. Dans une société centrée sur le confort, le moindre effort et le moindre engagement, nous devons nous incliner avec respect devant ceux qui font le choix de cet engagement : risquer sa vie pour assurer la paix de tous. Pourtant, mes chers collègues, ces femmes et ces hommes qui se réveillent chaque matin sans savoir s’ils rentreront chez eux le soir sont quotidiennement méprisés, insultés et agressés.
Lequel d’entre nous peut sérieusement affirmer que la police fait aujourd’hui régner la terreur en France ? §Lequel d’entre nous peut sérieusement prétendre que l’insécurité est un fantasme, et qu’il n’y a pas de problème de délinquance en France ? Lequel d’entre nous peut nier l’évolution de la violence et la nature des armes qui circulent aujourd’hui dans certains milieux ?
Mes chers collègues, nous avons pris acte, lors de la discussion de ce texte en commission, des inquiétudes exprimées par un certain nombre d’entre vous. Je dois vous le dire, je suis attristé par de telles réticences, qui me semblent en décalage avec la réalité. Refuser, par méfiance, de renforcer le droit de nos policiers à se défendre, c’est renverser les choses, et voir la menace du côté des forces de l’ordre. Peut-on aujourd’hui estimer que la police utilise abusivement les armes qui sont à sa disposition ?
Mes chers collègues, nous avons tous en mémoire les images de nos policiers se réfugiant derrière des boucliers sous les tirs de fusils de chasse des émeutiers, à Clichy-sous-Bois, en 2005. Devant le sang-froid et la mesure de ces agents, je ne crois pas que l’on puisse parler de police de « cow-boys », pour reprendre le terme utilisé par Louis Nègre.
Un certain nombre de cosignataires de ce texte m’ont dit vouloir soutenir une proposition de « bon sens ». Je crois effectivement qu’en donnant aux forces de l’ordre les moyens de leur mission, il s’agit plus de bon sens que d’idéologie. Il aurait d’ailleurs été à l’honneur de notre Haute Assemblée de trouver, en la matière, une large majorité réunissant nos différents groupes politiques. Je souhaite pour ma part que cette question, au lieu d’être enterrée, trouve bientôt une réponse et un cadre adapté. Car si nous négligeons ceux qui garantissent la paix, nous risquons tout simplement, un jour, de la perdre. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, quand le législateur se contente de réagir aux faits divers, même les plus horribles, il ne faut guère s’étonner qu’il méconnaisse certains des principes qui fondent nos sociétés démocratiques et tendent à éviter que l’on ne puisse tuer arbitrairement.
Quand les politiques cèdent aux raccourcis faciles, il ne faut pas non plus s’émouvoir que, trop occupés à agiter le chiffon rouge de la délinquance, ils reprennent des thèmes d’extrême droite
Exclamations sur plusieurs travées de l'UMP.

Dans ces conditions, on ne s’étonnera pas que les auteurs de cette proposition de loi connaissent si mal la jurisprudence pénale. Ils fondent en effet leur texte sur une inexactitude, sinon un mensonge. Selon eux, « un policier doit avoir été blessé pour être juridiquement en mesure de riposter ». C’est faux. §
Mes chers collègues, vous comprenez que, je puis d’ailleurs l’affirmer dès à présent, les sénateurs du groupe CRC s’opposent sans aucune réserve à la proposition de loi qui nous est soumise, d’autant que les politiques menées par la droite au cours de ces dix dernières années, en accentuant les injustices, en renforçant la précarité et la misère sociale, …

… en prônant des politiques répressives et liberticides, ont largement contribué aux dérives de cette société violente que certains de nos collègues de l’UMP déplorent aujourd’hui.
Alors qu’il faudrait changer nos méthodes d’organisation sociale – guérir et non punir, éduquer et non combattre, accompagner et non isoler –, la droite nous propose un texte qui nous semble aussi inutile que dangereux.
Comme l’a très clairement démontré notre rapporteur, cette proposition de loi méconnaît tant les principes constitutionnels que les engagements internationaux de la France, notamment le droit à la vie. L’argumentaire juridique développé dans le rapport de la commission des lois est très complet, et je ne reviendrai donc que sur certains points.
Tout d’abord, en prétendant aligner l’usage de la force armée par la police sur la gendarmerie, les auteurs de la proposition de loi oublient qu’il ressort des jurisprudences tant européennes que nationales que l’article L. 2338–3 du code de la défense est limité à une « absolue nécessité », sans quoi, précise la jurisprudence, « un tel cadre juridique est fondamentalement insuffisant et se situe bien en deçà du niveau de protection “par la loi” du droit à la vie requis par la Convention [européenne des droits de l’homme] dans les sociétés démocratiques aujourd’hui en Europe ».
Il faut donc mettre fin au mythe selon lequel les gendarmes bénéficieraient d’un régime plus permissif que celui qui s’applique à la police nationale. En présentant cet alignement comme un renforcement sans condition de l’usage de la force armée, les auteurs de la proposition de loi exposent les fonctionnaires à une mauvaise interprétation du droit. Ils les induisent en erreur et, du coup, les fragilisent plus qu’ils ne les protègent.
Il est important de bien préciser que les gendarmes comme les policiers sont soumis au code pénal et bénéficient du monopole de la violence légitime sous certaines conditions, notamment sur ordre de la loi ou du règlement, en raison d’un état de nécessité ou de la légitime défense, ou pour « dissiper un attroupement ».
À ce sujet, parce que nous sommes persuadés que la violence engendre la violence et que nous sommes attachés aux libertés publiques, nous, les sénateurs du groupe CRC, avons été à l’initiative d’une proposition de loi s’opposant totalement à celle qui nous est présentée aujourd’hui par nos collègues de droite, et visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations et leur commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou des particuliers.
Ensuite, il est important de noter que, dans le cadre légal posé par le code pénal, applicable à tous, les forces de l’ordre bénéficient d’un traitement plus protecteur que n’importe quel citoyen. Ainsi, un policier ayant fait usage de son arme est réputé avoir agi légalement. En revanche, on ne tient pas compte de sa formation pour attendre de lui une meilleure appréciation que celle qu’aurait n’importe quel citoyen de la situation qui a donné lieu à tir.
Or, pour vérifier la réalité de la légitime défense, la gravité de l’agression s’apprécie subjectivement. On s’attache non pas aux résultats effectifs de l’attaque ni même au danger réel couru par la personne attaquée, mais bien au péril que cette personne a cru raisonnablement courir.
Il serait donc certainement plus utile, si l’on veut protéger les forces de l’ordre – je pense que nous le voulons tous ici – et respecter le droit à la vie, de renforcer la formation initiale et continue des forces de l’ordre, mais également d’être plus attentif à la gestion de leur stress.
On doit insister sur le fait que la prétendue présomption de légitime défense, comme un super bouclier, est un leurre qui expose les forces de l’ordre. En effet, il serait très dangereux de faire croire à une sorte d’impunité ou d’irresponsabilité pénale qui pourrait aggraver l’escalade de la violence.
Comme vous le savez, cette présomption n’est pas irréfragable ; autrement dit, elle peut être réfutée. Par conséquent, mes chers collègues de l’UMP, votre article 2 est, en droit, absolument inutile.
En raison de l’état de légitime défense, il appartient en effet au parquet de démontrer que celle-ci n’est pas caractérisée. Quid alors du risque de la preuve ? Que se passe-t-il en effet si un doute existe sur la caractérisation de ce fait justificatif ? Dans cette situation, le doute doit bien évidemment profiter au mis en examen puisqu’il existe une incertitude sur la commission de l’infraction. La présomption de légitime défense ne changerait donc rien au droit positif.
Enfin, comme je l’ai fait dans le rapport pour avis sur la mission « Sécurité », je voudrais insister sur la nécessité de rompre avec l’application de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Il y a là toute l’hypocrisie de nos collègues UMP, qui ont approuvé des politiques de réduction du nombre des fonctionnaires et qui, aujourd’hui, prétendent défendre ces derniers.
L’austérité budgétaire doit bien sûr être abandonnée s’agissant de la police et de la gendarmerie, mais également d’autres services publics telles l’éducation, la santé, la culture.
Par ailleurs, je me réjouis que le Gouvernement ait donné des directives claires pour, sinon abolir, du moins encadrer la politique du chiffre imposée par la droite. En effet, cette politique avait des effets néfastes pour les personnes et la protection de leurs droits, mais également pour les forces de l’ordre. Elle accentuait à la fois la perte de sens de l’exercice de leur métier et leur stress.
Mes chers collègues, on constate un réel malaise chez les forces de l’ordre et un nombre important de suicides, une cinquantaine chaque année, selon les estimations, dont trois au cours des trois derniers jours.
Les policiers et les gendarmes doivent faire respecter l’ordre public, mais, aujourd’hui, ils sont confrontés à la paupérisation de la société sans y avoir été préparés, ce qui peut les faire plonger eux aussi dans de grandes souffrances.
Dans une enquête réalisée en janvier 2012, Cadre de vie et sécurité, on apprend que plus des trois quarts des personnes interrogées sur les trois problèmes les plus préoccupants de la société française ont cité le chômage, la précarité et l’emploi. Si le sentiment d’insécurité semble augmenter, contrairement à la délinquance, cela montre que la violence que nous devons combattre est avant tout une violence économique et une violence sociale.
Renforcer l’usage des armes à feu, dans ce contexte, nous semble une proposition inadaptée et dangereuse. C’est pourquoi, je le dis encore une fois, les sénateurs du groupe CRC voteront contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur plusieurs travées du groupe socialiste . – M. le président de la commission des lois et M. André Gattolin applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues du groupe UMP est liée à plusieurs événements tragiques qui ont suscité des réactions vives et légitimes des forces de police et qui ont ému l’opinion publique.
Nous avons tous en mémoire les événements d’avril 2012 à Noisy-le-Sec, quand le parquet de Bobigny mettait en examen, pour homicide volontaire, un policier après le décès d’un homme, délinquant multirécidiviste, recherché pour vols à main armé et alors qu’il pointait son arme sur un autre policier.
Cette décision judiciaire avait provoqué une profonde et légitime émotion parmi les policiers et des réactions dans la classe politique, à l’origine de cette proposition de loi.
Il n’est pas nécessaire de multiplier les exemples tragiques et les cas où les forces de l’ordre ont été victimes d’actes violents ou mortels. Nos collègues Louis Nègre et Pierre Charon les ont rappelés il y a quelques instants.
L’objectif de cette proposition de loi est de mieux assurer la protection des policiers et des gendarmes dans l’exercice de leurs missions. Cet objectif, nous le partageons.
Nous sommes naturellement aux côtés des forces de l’ordre, qui payent un lourd tribut chaque année. En 2012, ce sont ainsi plus de 11 000 policiers et gendarmes qui ont été blessés dans l’exercice de leur fonction de maintien de l’ordre public.
Assurer la sécurité de tous est une mission noble et nous n’oublions pas que policiers et gendarmes la remplissent au péril de leur vie.
Nous mesurons aussi l’extrême difficulté de leurs missions : sous le regard des médias et de l’opinion, il leur faut en quelques fractions de secondes prendre la bonne décision, assurer la sécurité de tous et la leur également, sans prendre le risque de commettre une faute pénale.
On sait aussi que lorsque le délinquant n’a pu être mis hors d’état de nuire chacun se tourne vers la police et s’interroge sur les raisons de cette situation.
Nos forces de l’ordre travaillent au quotidien dans un contexte très tendu. Elles le font avec un grand professionnalisme, que je veux saluer.
La question de ce matin est la suivante : faut-il modifier la loi applicable en matière d’usage des armes à feu pour les policiers ? Nous répondons oui.
Une seconde question lui fait alors suite : l’approche proposée à travers cette proposition de loi est-elle suffisante ? Là, je n’en suis pas sûr. Et poser cette question, c’est aller dans le sens de l’intérêt des policiers.
Comme l’a expliqué Mme la rapporteur, la proposition de loi de nos collègues soulève un certain nombre de difficultés juridiques et pratiques. L’instauration d’une présomption de légitime défense apparaît en effet, à l’examen, comme problématique. D’ailleurs, le rapporteur UMP du texte similaire qu’avait examiné l’Assemblée nationale, Guillaume Larrivé, l’a lui-même montré. Cette disposition ne répondrait pas aux difficultés actuelles et pourrait se retourner contre les policiers. C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement de suppression de l’article 2 de la présente proposition de loi afin d’abroger la présomption de légitime défense pour les agents de la police nationale, qui est une mauvaise réponse à une vraie question.
Je ne développe pas plus ce point puisque cela a déjà été évoqué par Mme la rapporteur, mais je précise que le texte examiné à l’Assemblée nationale ne comportait pas un article similaire à cet article 2.
M. le ministre opine.

Quant à l’article 1er de la proposition de loi, il vise à donner aux policiers l’autorisation de faire usage de leur arme lorsqu’ils sont menacés, à l’exemple de ce qui existe pour les gendarmes. Il s’agit d’améliorer l’efficacité de leur action et de faciliter la conduite des opérations communes entre la police nationale et la gendarmerie sur le terrain.
Contrairement aux gendarmes, qui peuvent le faire après des sommations verbales et dans des conditions limitatives précisément énoncées à l’article L. 2338–3 du code de la défense, les policiers ne sont autorisés à faire usage de leur arme à feu qu’en réponse à une agression de même nature, dans le strict cadre de la légitime défense.
J’ai déposé un amendement visant à réécrire cet article 1er afin de répondre aux difficultés juridiques et pratiques posées par le dispositif présenté par MM. Nègre et Charon.
Cet amendement, qui reprend la rédaction proposée par le rapporteur de l’Assemblée nationale, vise à préciser juridiquement la transposition du dispositif existant pour les gendarmes en le rendant applicable aux forces de police. Surtout, il intègre la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme en précisant que l’usage des armes par les forces de l’ordre est conditionné par une « absolue nécessité ».
Dans mon esprit, apporter cette précision, ce n’est pas affaiblir le dispositif ; bien au contraire, c’est lui donner plus de force. L’encadrer, le préciser, c’est donner plus de force au cadre juridique dans lequel les policiers pourraient agir.
Le rapprochement des deux forces de sécurité intérieure – police nationale et gendarmerie – est engagé depuis la loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale. Certes, les gendarmes sont des militaires et leur statut est régi par le code de la défense, mais les deux corps des forces de sécurité relèvent du ministère de l’intérieur, coopèrent et assurent des missions de plus en plus semblables.
Il est donc bien légitime que les policiers s’interrogent et posent la question : « Comment comprendre qu’aujourd’hui, lorsqu’il s’agit de faire usage de leurs armes à feu, les policiers et les gendarmes ne soient pas soumis aux mêmes règles ? »
Transposer le texte applicable aux gendarmes serait donc une tentation logique. Mais cette doctrine d’emploi des armes par les gendarmes est encadrée par les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, qui conditionnent le déploiement de la force armée par « l’absolue nécessité » de l’usage de l’arme pour atteindre l’objectif. C’est cette jurisprudence que nous réaffirmons en proposant de l’intégrer, par voie d’amendement, dans le texte de cette proposition de loi. Mieux vaut un droit clair et bien encadré.
Cette rédaction améliore sensiblement, je le crois, ce texte. Nous verrons au cours de son examen si elle suffit à apporter une solution juridique adaptée à un vrai problème. On peut imaginer d’autres voies complémentaires.
Au-delà, il faut en effet s’interroger avec prudence sur le texte applicable aux gendarmes, ce à quoi nous conduit, de façon quelque peu paradoxale, cette proposition de loi. Les règles auxquelles sont soumis les gendarmes ne devraient-elles pas intégrer elles aussi la jurisprudence qui s’applique déjà à eux en pratique ? De fait, les gendarmes l’ont assimilée et savent bien que la justice apprécie leur attitude selon les principes de la proportionnalité et de l’absolue nécessité.
Il faut ici convenir que la première rédaction, issue d’un décret, du texte applicable aux gendarmes date de 1903 ! Nous ne l’écririons sans doute pas ainsi aujourd’hui.
Une voie serait donc de poser le problème de fond et d’aboutir à une doctrine d’emploi de la force armée commune aux policiers et aux gendarmes, selon les principes de 2013 et non pas ceux de 1903.
On m’objectera que la doctrine appliquée aux gendarmes est liée à leur statut militaire. Je mesure bien que la voie suggérée peut paraître périlleuse ; mieux vaut sans doute la considérer avec beaucoup de prudence et dans un contexte dépassionné, ce qui n’est pas forcément le cas depuis bien longtemps pour tout ce qui touche à ces sujets. Nous ne devons bien évidemment pas affaiblir la situation des gendarmes. C’est, me direz-vous, la quadrature du cercle.
Je pose néanmoins une question : en cas de contrôle de sécurité sur route, par exemple, les gendarmes tirent-ils si un individu franchit le contrôle sans les menacer ? À l’évidence, ils ont à l’esprit la jurisprudence et doivent proportionner l’usage des armes à la situation rencontrée. C’est l’honneur des policiers et des gendarmes d’agir ainsi et c’est tout leur professionnalisme, c’est toute la difficulté de leur mission, dont ils s’acquittent avec force et talent.
La mission Guyomar proposait de réfléchir et de codifier les conditions jurisprudentielles d’un usage légal des armes à feu pour l’ensemble des forces de l’ordre. C’est sans doute moins simple et moins lisible que la posture adoptée par les auteurs de la proposition de loi, mais c’est, me semble-t-il, plus opérationnel pour les forces de l’ordre. Au demeurant, s’il était fait usage d’une arme à feu dans un contexte inapproprié et dans le cadre du texte qui nous est soumis ce matin, je crains que le résultat ne soit de dresser l’opinion contre les policiers eux-mêmes.
En toute hypothèse, cette modification de l’usage des armes à feu par les policiers nécessite, quoi qu’il en soit, de renforcer leur formation à l’usage de celles-ci, notamment en augmentant les entraînements au tir, comme le réclament les organisations professionnelles de policiers.
Mieux former et mieux équiper les policiers et les gendarmes est en effet un élément essentiel de leur protection et de leur sécurisation dans l’exercice des missions de sécurité.
Au total, ces questions méritent une analyse juridique et opérationnelle plus poussée. En l’état, le groupe UDI-UC s’abstiendra donc.
Enfin, avant de conclure, je tiens à relayer une demande très forte des policiers et des gendarmes qui est de réformer la protection juridique dont ils font l’objet. Sur ce point, M. le ministre a fait part d’éléments rassurants et je ne peux que l’inviter à poursuivre dans cette voie et à donner aux policiers des garanties sur leur protection. Amplifier les efforts dans ce domaine serait un signe fort de confiance à l’égard de nos forces de l’ordre.
MM. Joël Bourdin et René Garrec applaudissent.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l’usage des armes à feu fait écho à des faits divers dramatiques dans lesquels des agents des forces de l’ordre ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces tragédies suscitent chaque fois une profonde émotion au sein des corps de la police et de la gendarmerie, mais aussi parmi nos concitoyens. Le sentiment prévaut, fondé ou non, que les policiers hésitent à riposter par crainte d’une bavure qui les exposerait à une condamnation pénale.
Le législateur est souvent tenté de répondre à de telles situations en créant un nouvel arsenal destiné à mieux protéger ceux qui assurent la sécurité des biens et des personnes. Le précédent chef de l’État était d’ailleurs particulièrement actif, au gré de l’actualité, dans la mise en œuvre et la mise en scène de lois dites « de circonstance », au risque d’alimenter une forme de populisme pénal.

Dans ce domaine, l’essentiel est de ne pas sombrer dans l’émotionnel. C’est pourquoi nous devons nous garder d’adopter des mesures hâtives qui n’écarteraient pas, malheureusement, le risque zéro, et dont les effets pourraient être contraires à l’objectif recherché.
Des condamnations, heureusement très rares, mais très médiatisées, d’agents des forces de sécurité ont accrédité l’idée que la justice penchait plutôt du côté de la victime. Or, en réalité, la jurisprudence est plutôt protectrice à l’égard des policiers et des gendarmes. J’ajouterai que le juge ne fait pas de différence entre ces deux catégories.
Au-delà des arguments juridiques, un rapprochement des conditions d’emploi des armes à feu par les policiers et les gendarmes ne semble pas pertinent au regard de leurs spécificités respectives.
Bien que les gendarmes et les policiers aient en commun certaines missions d’ordre civil, leurs modes et leur aire de déploiement diffèrent. Les premiers interviennent majoritairement en milieu rural tandis que les seconds exercent plutôt dans les zones urbaines, ce qui suppose des approches différentes, notamment eu égard à la densité de population.
En outre, qu’apporterait aux policiers le régime de la sommation propre aux gendarmes ? Certains syndicats de policiers y voient un risque supplémentaire sur le plan pratique, alors que la légitime défense est possible sans sommation en cas de menace.
Pour toutes ces raisons, et bien d’autres qui ont été développées plus longuement par certains de mes collègues, il apparaît que le dispositif proposé conduirait à laisser penser que les policiers seraient pénalement plus à l’abri en cas de riposte, alors qu’ils seraient in fine en situation de plus grande fragilité juridique.
Pour autant, la proposition de loi a le mérite d’ouvrir un débat sur les conditions générales d’exercice des fonctions de policiers et de gendarmes.
En tant qu’élu de terrain, nous connaissons tous bien nos commissariats et nos casernes. Nous devons malheureusement constater qu’ils pâtissent, au-delà du manque de moyens humains, d’équipements souvent anciens et inadaptés. Face à une criminalité « riche » de ses trafics, donc souvent très bien armée et puissamment motorisée, les agents de sécurité se retrouvent très affaiblis dans certaines situations. Ce fut le cas de deux policiers de la BAC tragiquement assassinés en février dernier par un malfaiteur qui s’est servi d’un véhicule 4x4 pour tuer intentionnellement.
Le problème de la proportionnalité des équipements entre malfaiteurs et forces de sécurité est également illustré par l’utilisation banalisée d’armes de guerre. Sur ce point, la loi du 6 mars 2012 relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif a jeté les bases d’un meilleur contrôle des armes à feu sur le territoire. Il n’en demeure pas moins que ce contrôle reste d’un exercice délicat. J’espère que ce texte, qui avait été unanimement approuvé, portera rapidement ses fruits.
Je sais que les temps sont à l’économie s’agissant du budget de l’État, mais un renforcement des moyens de la police et de la gendarmerie serait de nature à renforcer la protection dont nos agents ont besoin pour exercer sereinement leurs missions. Au-delà, il est fondamental de garantir une des premières fonctions régaliennes de notre République : la sécurité de nos concitoyens.
Enfin, je souhaite évoquer la question de la protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes, qui a fait l’objet d’un rapport qui vous a été remis au mois de juillet 2012, monsieur le ministre. Vous l’avez dit, vingt-sept propositions ont été formulées.
Nous ne pouvons qu’être satisfaits de constater que vous avez appréhendé le rapport Guyomar avec pertinence.

Les policiers et les gendarmes sont demandeurs de ces mesures visant à les protéger, eux-mêmes et leurs ayants droit, lorsqu’ils sont mis en cause.
Je souhaite que nous ayons l’occasion de revenir sur les conditions statutaires des policiers et des gendarmes qui exercent, avec responsabilité et courage, un métier difficile, au péril de leur vie. Dans cette attente, afin de ne pas rompre le subtil équilibre découlant de la jurisprudence sur l’usage des armes à feu, le groupe RDSE n’approuvera pas la proposition de loi de nos collègues Louis Nègre et Pierre Charon.
Avant de quitter cette tribune, je tiens à souligner que l’élu de terrain que je suis et qui, comme chacun de vous, rencontre assez fréquemment des représentants des forces de l’ordre a pu mesurer que l’immense majorité des policiers et des gendarmes apprécie tout particulièrement l’action de M. le ministre de l’intérieur
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste . – M. André Gattolin applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a des textes qui semblent pavés de bonnes intentions. Mais pour poser ces pavés, le remblai initial est lui truffé de chausse-trapes mal comblées. C’est pourquoi, et pour continuer à filer la métaphore, je dirais que cette proposition de loi ne tient pas la route, faute d’avoir été suffisamment réfléchie. Si nous la votions, les roues du char de l’État que sont la police et la gendarmerie ne pourraient que s’embourber.
Bien sûr, comment ne pas s’indigner que des policiers soient blessés ou tués ? Ils sont les serviteurs de notre état de droit, garant du respect de nos lois et de la sécurité de nos concitoyens. Ils sont en première ligne des angoisses de notre société, de ses déviances et de ses dérives. Ils ont de lourdes tâches à effectuer et qui ne consistent pas seulement en l’arrestation de délinquants. Ils doivent aussi alerter et assister les proches des victimes, enquêter sur des drames et, évidemment en premier lieu, les prévenir.
Alors oui, protéger ceux qui nous protègent est un devoir fondamental. Aussi et à première vue, cette proposition de loi peut sembler apporter une plus grande sécurité aux policiers par l’alignement de leur régime sur celui des gendarmes en ce qui concerne les possibilités d’utiliser leur arme et de bénéficier d’une présomption de légitime défense.
Dans les faits, ces deux propositions n’apportent qu’une apparence de sécurité.
D’abord parce que ce texte démontre une méconnaissance du comportement des délinquants armés. Aujourd’hui, les délinquants n’ont plus peur des forces de l’ordre et, s’ils en ont encore peur, ils s’arment en conséquence.
Mais surtout, et le plus souvent, un délinquant est persuadé de ne jamais se faire prendre, sinon, il ne serait pas délinquant.
Savoir que les policiers peuvent user dans des conditions moins draconiennes de leur arme ne va certainement pas dissuader les délinquants de tirer.
Si les délinquants ont, par hasard, connaissance de cette nouvelle disposition, ne vont-ils pas, au contraire, être tentés de dégainer encore plus vite pour s’échapper, selon le vieil adage : qui tire le premier a gagné.
Permettre aux policiers de tirer dans les mêmes cas que les gendarmes n’est donc pas protecteur. Cela participe surtout d’une surenchère.
Aujourd’hui, les policiers font déjà un usage de leur arme tout comme les gendarmes : quelque 250 cas par an sur des milliers d’arrestations, pour les deux corps réunis.
S’il y a globalement aussi peu d’utilisation des armes, c’est que les policiers, tout comme les gendarmes, savent que cet usage est le dernier recours quand la vie de leurs concitoyens, de leur collègue ou leur propre vie est en jeu. Les laisser croire qu’ils pourront tirer plus tôt, plus vite, les exposera donc à un risque juridique plus grand, doublé, je viens de le rappeler, d’un risque de riposte plus élevé.
En alignant le régime de l’usage des armes par les policiers sur celui qui s’applique aux gendarmes, nous créerions une égalité de droit factice et surtout précaire. Qu’est-ce qui garantira aux policiers qu’ils sont dans le cadre du droit, qu’ils peuvent faire usage de leur arme, alors même que la jurisprudence de la Cour de cassation reste très stricte pour les gendarmes en la matière ?
Mais surtout, les dispositions de cette proposition de loi ne sont-elles pas, avant même leur éventuelle adoption, déjà « condamnées » par la jurisprudence restrictive de la Cour de cassation, qui s’appuie sur celle de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’emploi de la force létale ?
Il est assez paradoxal de vouloir étendre aux policiers le cadre juridique d’une loi dont la conventionnalité n’est pas établie. Cette égalité est d’autant plus factice que le texte ne reprend pas l’intégralité de l’article L. 2338-3 du code de la défense. À ce titre, le rapport très précis de notre collègue Virginie Klès pointe clairement les faiblesses et les incohérences de cette proposition de loi et les effets pervers, au détriment des policiers eux-mêmes, que son application pourrait engendrer.
Quant à la présomption de légitime défense, elle ne vaut que ce que valent les présomptions juridiques. Elles sont l’exception à la règle commune. Elles doivent dépendre non pas de la personne qu’elles entendent protéger, mais de la situation et des circonstances dans lesquelles cette personne agit.
Cette règle juridique est d’autant plus nécessaire que le port d’arme ne concerne pas exclusivement les forces de l’ordre. Il concerne aussi notamment les convoyeurs de fond, si souvent pris pour cible, et les gardiens de prison.
Prévoir que seules les forces de l’ordre pourraient agir sous le statut protecteur de la légitime défense est un non-sens juridique.
Si on a le droit de porter une arme, c’est parce qu’on protège des intérêts dignes de protection et qu’on a suivi une formation au droit et au tir. Pourquoi seules deux catégories de porteurs d’arme seraient présumées être toujours en état de légitime défense ?

Enfin, pourquoi les policiers et les gendarmes auraient-ils besoin d’attendre l’ultime moment, quand seul l’usage des armes peut arrêter la catastrophe ? Pourquoi devraient-ils attendre alors qu’ils seraient protégés par une présomption de légalité du tir ? N’est-ce pas prendre le risque d’un usage accru de leur arme, avec pour conséquence le risque d’erreurs, de bavures…

… et donc le risque d’incompréhension de la population ?
Rappelons-nous qu’au bout du viseur de l’arme d’un policier ou d’un gendarme qui serait présumé, si ce texte était adopté, en situation de légitime défense, il y a toujours un corps, celui d’un citoyen présumé innocent de par notre Constitution.
Voilà donc un texte a priori protecteur qui, au fond, est insécurisant de fait, mais aussi de droit, tant pour les forces de l’ordre que pour les citoyens.
Alors pourquoi avoir présenté ce texte ? Parce qu’il a été dicté non par la réflexion, mais par la logique infernale de la réponse instantanée à un événement dramatique...
Depuis des années, notre droit pénal s’est gonflé au rythme des faits divers développés par les journaux télévisés. Tout comme la vie de nos « gardiens de la paix », l’équilibre des situations juridiques est trop important pour être laissé à la seule indignation et aux réflexes séculaires du « œil pour œil, dent pour dent ».
En réalité, pour protéger les forces de l’ordre, il faut un ingrédient essentiel : une présence sur le terrain plus importante pour faire de la prévention et de la dissuasion a priori, et non pour tirer une fois que le mal est fait.
Le groupe écologiste votera évidemment contre cette proposition de loi, considérant que ce texte imparfaitement élaboré s’apparente davantage à un effet d’affichage à des fins de communication politique qu’à une réelle volonté d’améliorer la législation.
Nos « gardiens de la paix » et le respect du travail parlementaire soigné méritent, à nos yeux, bien davantage. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous examinons la proposition de loi de MM. Nègre et Charon visant à renforcer la protection pénale des forces de sécurité et l’usage des armes à feu.
Pour les auteurs de cette proposition de loi, le cadre légal en vigueur conditionnant l’emploi des armes à feu par les policiers et les gendarmes serait inadapté.
Aussi, nos collègues Louis Nègre et Pierre Charon préconisent un rapprochement des règles d’usage des armes pour les deux forces de sécurité intérieure.
Au-delà de ce rapprochement, ils proposent également de créer un nouveau cas, celui de « présomption de légitime défense pour les policiers ».
Tout d’abord, avant d’aborder le fond de cette proposition de loi, je souhaite attirer votre attention sur ses motivations telles qu’elles sont formulées par les auteurs du texte.
Le contenu de son exposé des motifs est pour le moins inhabituel, pour ne pas dire déroutant.
Ces dix dernières années, la ligne de conduite du Gouvernement en matière de sécurité intérieure semble avoir été dictée par ce que l’on pourrait appeler « la politique du fait divers ».
À chaque événement suscitant l’émotion de l’opinion publique, l’ancien Président de la République s’empressait d’apporter une réponse législative quasi immédiate.
Comme l’a rappelé Jean-Marc Ayrault, nous ne voulons plus de ces « lois de circonstances », dépourvues de tout recul et bien souvent inappliquées.

Cette marque de fabrique qui a été celle de Nicolas Sarkozy durant toutes ces années se retrouve aujourd’hui dans la proposition de loi dont nous débattons.
Pas moins de quatre faits divers sont cités dans ce curieux exposé des motifs ! D’autres l’ont été également à la tribune par notre collègue Louis Nègre. Comme s’il était nécessaire d’en faire état ici devant le Sénat pour que nous prenions pleinement conscience de la dangerosité du métier de policier ou de gendarme, d’autant que rien ne démontre, dans cet exposé des motifs, que, si le dispositif proposé existait, les dramatiques faits divers dont il est fait mention auraient pu être évités.
D’ailleurs, cet exposé des motifs ne démontre rien, si ce n’est, peut-être, la mauvaise foi de ses auteurs lorsque ceux-ci écrivent : « Il n’est pas acceptable qu’aujourd’hui, en France, un policier doive être blessé pour être juridiquement en mesure de riposter. » Cela témoigne d’une profonde méconnaissance du dossier, ainsi que l’ont souligné Mme le rapporteur et M. le ministre.
En revanche, il est utile, me semble-t-il, de rappeler à nos collègues de l’opposition tous les méfaits que la RGPP, la révision générale des politiques publiques, a engendrés sur la sécurité des policiers et des gendarmes.
À cet égard, il paraît surprenant de soutenir un emploi facilité des armes à feu tout en assumant le bilan d’une RGPP qui a conduit à une importante réduction des exercices de tir ces dernières années dans les rangs des forces de l’ordre.
Et que dire des 11 000 suppressions de postes intervenues entre 2008 et 2012 ? Assurément, comme l’a rappelé M. le ministre, elles n’ont pas contribué à renforcer la protection des policiers et des gendarmes dans l’exercice de leurs missions quotidiennes.
C’est notamment pour cela que nous nous employons, depuis l’élection de François Hollande, à ce que les policiers et les gendarmes soient plus nombreux, mieux formés et mieux équipés. Je tiens à saluer à ce titre les efforts déployés par M. le ministre de l’intérieur, Manuel Valls.
J’en viens au fond de cette proposition de loi.
Celle-ci fait écho à un autre texte récent, rejeté par nos collègues députés le 6 décembre dernier. Tout comme celui que nous examinons aujourd’hui, il émanait de parlementaires UMP, et avait aussi vocation à aligner le régime juridique des policiers sur celui qui s’applique aux gendarmes.
Je note d’ailleurs qu’un amendement visant à introduire des exceptions de légitime défense au bénéfice des policiers et des gendarmes avait été déposé à l’Assemblée nationale, mais qu’il avait été rejeté, les auteurs de la proposition de loi y étant eux-mêmes défavorables.
Je précise à cet égard que les auteurs de cette proposition d’amendement étaient Mme Maréchal-Le Pen et M. Collard, tous deux membres du Front national.
Ici, il y a des rapprochements révélateurs…

En effet, vous reprenez cet amendement dans le texte de votre proposition de loi. Il est regrettable que vous n’ayez pas eu la sagesse de vos collègues députés !
Cette disposition est purement « d’affichage » ; elle résulte de la volonté politique d’envoyer un signal à un électorat qui se reconnaît aujourd’hui dans les discours musclés de l’extrême-droite, mais elle n’apporte rien en termes d’efficacité. §
Le souci principal des sénateurs socialistes est de rendre hommage à toutes nos forces de sécurité : la police nationale, la gendarmerie, les polices municipales, qui agissent au quotidien, parfois au péril de leur vie, cela a été dit. Nous souhaitons les aider et les protéger.
Tout cela mérite bien mieux qu’une proposition de loi démagogique. Nous voulons avant tout être efficaces.
Votre proposition de loi, messieurs les sénateurs, souhaite donc de nouveau introduire une exception de légitime défense.
L’instauration de présomptions de légitime défense fondée sur la seule qualité de membres des forces de l’ordre ne saurait être présentée comme une sécurisation de l’action desdites forces.
En effet, comme Virginie Klès l’a rappelé dans son excellent rapport, celle-ci aboutirait au contraire à l’effet inverse en venant bouleverser l’ordonnancement actuel du principe de la légitime défense.
Ce texte s’inscrit en porte-à-faux avec les jurisprudences successives en matière d’encadrement de l’usage des armes à feu entre policiers et gendarmes.
Ces jurisprudences concluent à des exigences de nécessité absolue et de proportionnalité équivalente, voire identique, pour l’ensemble des forces de sécurité.
L’alignement que vous envisagez fait donc fi de cette importante jurisprudence, tant nationale qu’européenne, puisque, vous le savez, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu des décisions qui s’imposent à nous.
Aussi, il ne semble pas concevable d’envisager une réflexion sur la base légale encadrant l’usage des armes à feu pour les gendarmes en dehors de son cadre jurisprudentiel.
Ma conviction est que nous serons sûrement amenés un jour à débattre d’un tel alignement, mais je ne suis pas certain qu’il se fasse dans le sens que vous souhaitez. Il serait peut-être plus intéressant de réfléchir à un alignement dans l’autre sens, même si j’ai entendu M. le ministre rappeler que, pour le moment, il n’y était pas favorable.
Enfin, le présent texte se trouve en complet décalage avec les conclusions de la mission de réflexion sur la « protection fonctionnelle des policiers et des gendarmes » présidée par le conseiller d’État M. Guyomar. Vous l’avez abondamment citée, mais à vous entendre, j’avais l’impression de ne pas avoir lu le même rapport.
En effet, cette mission préconise dans son rapport rendu au mois de juillet dernier le statu quo en matière d’usage des armes. Elle écarte clairement l’option consistant à créer un nouveau cas de présomption de légitime défense.
En revanche, la mission propose d’engager une réflexion sur l’usage des moyens de forces intermédiaires – les armes « non létales » –, le cadre légal de l’usage des armes actuelles n’étant pas nécessairement adapté à l’hétérogénéité des armes appartenant à cette catégorie et à la diversité des finalités auxquelles elles répondent.
Elle écarte aussi l’idée d’une modification du cadre légal d’usage des armes à feu.
Mais elle propose de codifier, par une disposition réglementaire, les conditions jurisprudentielles d’un usage légal des armes à feu, à savoir les exigences d’actualité de la menace, d’absolue nécessité et de proportionnalité.
La mission Guyomar a clairement conclu que l’alignement d’un régime civil sur un régime militaire n’était pas la bonne méthode.
Les préconisations de la mission Guyomar ont notamment porté sur le renforcement de la protection fonctionnelle et, M. le ministre l’a rappelé, le Gouvernement s’y emploie activement.
Ce sujet essentiel de la protection fonctionnelle accordée aux représentants de la force publique, et porté avec exigence par les organisations professionnelles, a été pris en compte, qu’il s’agisse de la notion d’ayant droit pour les concubins et les partenaires du PACS ou de l’extension du bénéfice de la protection fonctionnelle aux agents victimes d’infractions volontaires donnant lieu à des poursuites pénales.
On le voit sur ce sujet, le Gouvernement a pris le dossier en main, et cela répond à une demande forte des policiers et des gendarmes.
En conclusion, je souhaite relever que notre collègue Pierre Charon, coauteur de cette proposition de loi n’a pas toujours tenu un discours aussi bienveillant qu’aujourd’hui en direction des forces de police.

J’ai presque eu l’impression que votre position avait complètement changé…

… en une semaine à peine. En effet, ici même, dans le cadre des questions d’actualité au Gouvernement, vous avez mis violemment en cause leur professionnalisme et la légitimité de leurs interventions.

Permettez-moi de citer certains des propos que vous avez alors tenus, qui figurent au procès-verbal : « Images et vidéos accablantes pour vos services. » – vous parliez du ministre ; « Demande d’ouverture de commission d’enquête » ; « Quand le pouvoir s’en prend aux enfants, c’est la République qui saigne. »

Les mêmes policiers, si difficilement exposés à la violence des délinquants et des criminels, seraient-ils tout d’un coup devenus des mangeurs d’enfants à la solde d’un État exagérément répressif ?

Peut-être notre collègue a-t-il une conception du maintien de l’ordre public à géométrie variable... Mais cette dernière semble être l’apanage de l’UMP sur d’autres sujets : je pense notamment à l’indépendance de la justice. Nous aurons certainement l’occasion de le vérifier, puisque cet après-midi nous commencerons l’examen d’un texte important concernant le mariage pour tous.

Mes chers collègues, après la présentation et une large discussion de tous les éléments techniques de ce texte, nous constatons que celui-ci va à l’encontre de toute la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, des préconisations du rapport Guyomar et, cela a été dit et nombreux sont les orateurs qui y ont insisté, serait de nature à créer une plus grande insécurité juridique.
C’est pourquoi le groupe socialiste s’opposera à cette proposition de loi. Parce qu’elle ne répond pas aux attentes des policiers, comme l’ont exprimé plusieurs de leurs syndicats lors des auditions auxquelles ont procédé les rapporteurs. Parce que, en définitive, il ne s’agit que d’une loi d’affichage dont les visées électoralistes ne trompent personne. §Parce qu’il s’agit aussi d’une proposition de loi « proclamatoire ». Certes, de tels textes permettent à l’opposition de s’opposer, …

… mais ils n’ont pas vocation à être adoptés puisqu’ils ne règlent pas les problèmes de fond.
Montesquieu écrivait en 1748 : « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires ». En l’occurrence, cette proposition de loi n’est pas seulement inutile, elle est même néfaste. Aussi, le groupe socialiste votera des deux mains contre ce texte. §

En ma qualité de rapporteur de la commission des lois, permettez-moi d’apporter quelques précisions.
J’ai écouté attentivement l’ensemble des intervenants, et je voudrais dire à M. Charon que le fait d’être coauteur d’une proposition de loi qui a reçu un avis négatif de la commission ne l’autorise pas à dénaturer les propos que celle-ci a tenus.
Monsieur le sénateur, d’où tenez-vous cette information dont vous avez voulu faire part à notre assemblée et qui figurera au Journal officiel, selon laquelle certains membres de la commission auraient exprimé un sentiment de méfiance à l’égard de la police nationale ?
Personnellement, je le redis, j’ai écouté avec beaucoup d’attention tous les intervenants qui se sont exprimés tant en commission, notamment lors des auditions, qu’en séance plénière à l’instant, car en tant que rapporteur, je me sens responsable de l’examen de ce texte. Or, à aucun moment, je n’ai entendu, de la part d’un membre de la commission, un sentiment de méfiance à l’encontre de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.
En revanche, le sentiment de méfiance qui a été exprimé concerne, et vous m’en voyez désolé pour vous, votre texte et l’absence de protection, voire la mise en difficulté qu’il pourrait engendrer pour nos policiers nationaux. Je tenais à le préciser très clairement. §
Au cours de ce débat, les uns et les autres ont pu exprimer avec conviction les raisons pour lesquelles ils soutenaient ou s’opposaient à cette proposition de loi, après les interventions de ses coauteurs. J’ai déjà eu l’occasion de répondre tout à l’heure à M. Charon.
Pendant que M. Kaltenbach s’exprimait, l’un d’entre vous a dit : « Vous verrez au prochain enterrement ! » Il se trouve que, comme tous mes prédécesseurs, et c’est l’une des tâches les plus difficiles pour un ministre ou un maire, j’ai assisté à des obsèques.
J’ai en mémoire ce qui s’est passé à Chambéry, ce policier de la BAC tué dans des circonstances tragiques. J’imagine ce qu’a éprouvé le ministre Claude Guéant, lorsqu’il a été interpellé par la veuve du brigadier-chef.
Mais je pose la question, mesdames, messieurs les sénateurs : dans de telles circonstances, et devant de tels événements, nous, membres de la représentation nationale et du Gouvernement, ne pourrions-nous pas convenir que ces faits, à l’occasion desquels s’exprime la douleur la plus vive, méritent une autre attitude et une certaine hauteur de vues ?
En la matière, les statistiques sont terribles, et de tels drames ne manqueront pas, hélas, de se reproduire. De nombreux exemples ont été cités au cours du débat. J’ai moi-même assisté à d’autres hommages rendus depuis un an. Or les situations étaient toutes très différentes.
Ce que demandent les familles, les collègues et les camarades des policiers et des gendarmes décédés, c’est la réponse judiciaire la plus efficace et la plus rapide possible.
Mme Catherine Troendle acquiesce.
Et songez-y : les deux femmes gendarmes tuées à Collobrières, au reste dans des circonstances abominables, étaient armées. Plusieurs d’entre vous l’ont souligné.
Certains ont suggéré que l’issue de cet événement aurait pu être différente si un troisième gendarme les avait accompagnées. Cela revient à soulever le problème des effectifs. Toutefois, nous le savons, pour gagner en mobilité, les forces de l’ordre doivent être organisées en équipages de deux personnes, et armées.
D’autres se sont même demandé ce qu’il serait arrivé si ces gendarmes avaient été des hommes. Les deux gendarmes, ce jour-là, étaient des femmes, et c’est l’honneur de la gendarmerie et de la police nationales de compter dans leurs rangs des femmes si aguerries, qui assument de plus en plus de responsabilités.
Je le répète, ces femmes gendarmes étaient armées et elles pouvaient faire usage de leur arme. La véritable question est donc la suivante : que faire face à la violence de tels individus ?
Ce que demandent les familles de ces deux femmes, à qui nous rendrons un nouvel hommage en juin prochain, c’est que la justice fasse son travail et se montre impitoyable à l’égard des coupables, ces meurtriers qui portent atteinte à l’autorité de l’État.
Je le dis à l’intention de la majorité comme de l’opposition : je serai toujours disposé à rechercher les meilleures solutions techniques, juridiques et financières pour protéger gendarmes et policiers dans l’exercice de leurs missions.
Vous le savez, ce débat a de nouveau surgi lors de la campagne présidentielle, entre mars et avril 2012, au lendemain de l’affaire de Noisy-le-Sec. Or jamais un ministre de l’intérieur n’a abondé dans le sens que vous indiquez. Jamais ! Et ce, pour toutes les raisons qui ont été rappelées.
Ceux qui se sont exprimés à l’instant contre le présent texte reconnaissent tout à fait qu’il existe des difficultés, des attentes et des craintes, et tous s’interrogent : que faire face à des individus qui emploient des armes de guerre ? Faut-il donc que nos policiers utilisent également des armes de guerre ?
Prenons garde : répondre par l’affirmative reviendrait précisément à se placer sur le plan que M. Charon dénonçait il y a quelques instants.
M. Capo-Canellas a posé une véritable question, celle de l’unification du régime de l’usage des armes par les deux forces réunies au sein du ministère de l’intérieur. Toutefois, je l’ai déjà indiqué, à mes yeux, la spécificité de certains terrains d’intervention de la gendarmerie nationale justifie encore cette différence. J’ai cité l’exemple de la Guyane, où je me suis rendu il y a trois semaines : nos gendarmes y mènent de véritables opérations de guerre. Deux d’entre eux ont d’ailleurs été gravement blessés il y a quelques mois, intervenant aux côtés de deux de leurs camarades des forces armées qui, eux, ont été tués.
Monsieur Fortassin, vous avez invoqué d’autres arguments pour justifier cette différence de régime entre la police et la gendarmerie, et je souscris à vos propos. Je tiens à vous remercier du soutien que vous m’avez apporté, d’autant que vous connaissez bien ces sujets.
Vous posez deux vraies questions : celle des moyens humains indispensables pour lutter efficacement contre la délinquance et celle de la dangerosité des armes issues des nombreux trafics contre lesquels ont à lutter policiers et gendarmes.
S’agissant tout d’abord des moyens, je me suis employé à préserver les effectifs, malgré les contraintes budgétaires.
S’agissant maintenant des armes et des trafics, plutôt que de mettre en cause nos forces de l’ordre ou d’attaquer le Gouvernement sur la base de données statistiques, saluons le travail tout à fait remarquable qu’accomplissent la police et la gendarmerie ! En effet, le démantèlement d’un trafic de drogue va presque toujours de pair avec le démantèlement d’un trafic d’armes.
Tout à fait, madame la sénatrice.
Cette question très grave constitue l’une de mes priorités. Nous nous sommes engagés dans une stratégie déterminée de démantèlement de ces trafics, et nous devons renforcer les moyens de lutter contre un phénomène dont l’ampleur s’est considérablement accrue avec la chute du mur de Berlin et la guerre en ex-Yougoslavie : depuis lors, l’Europe de l’Ouest a été inondée par les armes de ce type. Je vous remercie d’avoir évoqué ce sujet tout à fait capital, monsieur Fortassin.
Monsieur Gattolin, nous partageons votre exigence. Nous éprouvons un trop grand respect pour nos policiers et nos gendarmes pour nous satisfaire d’une telle proposition de loi. En effet, l’adoption de ce texte entretiendrait l’illusion d’une sécurité accrue par un usage facilité des armes. Je le répète, c’est un piège dans lequel je ne veux pas entraîner nos forces de sécurité.
Pour ma part, j’ai fait un autre choix, celui de la sécurisation des interventions par la formation et par l’encadrement, pour les policiers comme pour les gendarmes - à cet égard, le rôle de la hiérarchie est tout à fait essentiel.
Mme le rapporteur acquiesce.
Je ne me contente pas de demander des chiffres à nos forces de l’ordre, même si j’exige bien sûr des résultats. Je leur demande avant tout d’agir dans la durée, pour obtenir des avancées pérennes fondées sur des pratiques professionnelles sécurisées, consolidées, valorisées, dans des zones de sécurité prioritaire et en lien très étroit avec les parquets. C’est là le plus sûr moyen de garantir les meilleures procédures et, partant, d’atteindre les buts visés !
Monsieur Kaltenbach, je vous remercie de rappeler les conclusions de la commission Guyomar. Au terme d’une phase de consultation très large et unanimement saluée, celle-ci a proposé une forme de statu quo sans pour autant fermer la voie à une réflexion et à une évolution auxquelles nombreux d’entre vous nous ont invités.
Enfin, regardons de près les évolutions en cours à l’échelle européenne, concernant les rapports entre les forces de l’ordre et les citoyens. Sur ce point également, je suis tout à fait ouvert au débat. Mme Assassi a évoqué cette question. J’en conviens tout à fait, il faut déterminer comment nos forces de l’ordre peuvent devenir plus performantes : face à une délinquance de plus en plus dangereuse et dont les formes sont en constante évolution, les moyens mis à la disposition des policiers et des gendarmes doivent, eux aussi, évoluer.
Je le répète, je ferai toujours preuve de la plus grande ouverture d’esprit sur ce terrain. A contrario, je m’opposerai toujours aux propositions qui, relevant à mon sens de la démagogie, ne rendraient pas service aux forces de l’ordre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste – Mme Cécile Cukierman et M. François Fortassin applaudissent également.

Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
Mes chers collègues, je vous rappelle que ce débat s’inscrit dans le cadre d’un espace réservé et que des questions cribles thématiques, retransmises en direct par France 3, sont prévues cette après-midi, à quinze heures. En conséquence, je devrai impérativement suspendre la séance à treize heures, même si nous n’avons pas terminé l’examen des articles du présent texte.
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure est complétée par un article 143 ainsi rédigé :
« Art. 143 . – Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale peuvent, en l’absence de l’autorité judiciaire ou administrative, déployer l’usage des armes dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences, des voies de fait ou tentatives d’agressions sont exercées délibérément contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés dès lors qu’il y a eu sommation ;
« 2° Lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu’elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° En cas de crimes ou de délits graves, lorsque les personnes invitées à s’arrêter par des appels répétés de « halte police » faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s’arrêter que par l’usage des armes ;
« 4° Lorsqu’ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt.
« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s’arrêtent pas à leurs sommations. »

L'amendement n° 1, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Port, transport et usage » ;
2° Il est complété par un article L. 315-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3 - Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée, en cas d'absolue nécessité, que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;
« 2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiées ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;
« 3° Lorsque les personnes armées refusent de déposer leur arme après deux injonctions à haute et intelligible voix :
« - Première injonction : Police, déposez votre arme ;
« - Deuxième injonction : Police, déposez votre arme ou je fais feu ;
« 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.
« Ils sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations. »
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Le présent amendement tend à réécrire l’article 1er sur deux plans.
Premièrement, il tend à assurer une rédaction juridiquement plus précise concernant l’application du régime du déploiement de la force armée propre aux gendarmes. Il tend à transposer ce dispositif dans un nouvel article du code de la sécurité intérieure.
À cet égard, il vise à apporter des précisions propres à la situation des forces de police nationale, notamment en indiquant que cet usage de la force armée ne s’applique que dans des cas où les forces de l’ordre sont confrontées à des personnes armées. Précisions que cette disposition ne figure pas dans le code de la défense.
Par ailleurs, cet amendement tend à préciser que les agents de la police nationale ne peuvent déployer les forces armées que lorsque les personnes concernées refusent de déposer leur arme après deux injonctions.
Deuxièmement, il s’agit d’intégrer dans le présent texte l’apport de la jurisprudence de la Cour de cassation, en reprenant explicitement les mots d’« absolue nécessité ». Cette question a déjà été évoquée lors de la discussion générale.

La commission est sensible à l’effort accompli par M. Capo-Canellas pour préciser quelque peu l’article 1er du présent texte.
Il n’en reste pas moins que, même ainsi précisé, le texte prévoit toujours d’aligner l’usage des armes au sein de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Or, pour l’ensemble des raisons invoquées au cours de la discussion générale, cette réforme ne nous semble pas opportune aujourd’hui. De surcroît, en consacrant dans la loi l’apport jurisprudentiel de l’« absolue nécessité », une telle disposition pourrait à mon sens rigidifier un peu plus encore l’examen par les magistrats des cas qui pourraient leur être soumis, avec l’éventualité de suites judiciaires encore plus risquées.
En conséquence, compte tenu de l’évidente difficulté à modifier l’équilibre actuel, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 1 er n'est pas adopté.
Il est ajouté deux alinéas à l’article 122-6 du code pénal ainsi rédigés :
« 3° Dans le cadre des autorisations accordées aux officiers et sous-officiers de gendarmerie à l’article L. 2338-3 du code de la défense.
« 4° Dans le cadre des autorisations accordées aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale à l’article 143 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. »

L'amendement n° 2, présenté par M. Capo-Canellas, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Le présent amendement tend à supprimer l’article 2 de cette proposition de loi, qui ajoute deux nouvelles présomptions de légitime défense spécifiques pour les forces de l’ordre.
En effet, cette disposition est problématique, comme l’a souligné M. Guillaume Larrivé, auteur d’une proposition de loi de même inspiration et rapporteur à l’Assemblée nationale puis, il y a quelques instants, par Mme le rapporteur elle-même.
Loin de garantir la sécurisation des forces de l’ordre, la création d’une présomption de légitime défense risque fort de produire l’effet contraire en engendrant une forme « d’illusion d’irresponsabilité pénale », pour reprendre les termes de M. Larrivé.

La commission s’étant prononcée pour le rejet de l’ensemble de ce texte, donc avant même sa transmission à l’Assemblée nationale, nous ne pouvons que suivre M. Capo-Canellas : la moitié du chemin vient d’être accomplie avec la suppression de l’article 1er. En toute logique, la suppression de l’article 2 doit suivre. Elle peut être opérée via cet amendement. Par conséquent, la commission émet un avis favorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l’amendement n° 2, je me permets d’appeler votre attention sur un point : si cet amendement est adopté, il n’y aura plus lieu de voter sur l’ensemble de la présente proposition de loi, dans la mesure où les deux articles qui la composent auront été supprimés. Il n’y aura donc pas d’explication de vote sur l’ensemble du texte.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l’amendement n° 2.
L'amendement est adopté.

En conséquence, l'article 2 est supprimé et la proposition de loi est rejetée.

Par courrier en date du 3 avril 2013, M. Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP, a fait connaître que ce dernier exerçait son droit de tirage, en application de l’article 6 bis du règlement, pour la création d’une mission commune d’information sur l’avenir de l’organisation décentralisée de la République.
La conférence des présidents prendra acte de cette création lors de sa prochaine réunion.
Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.