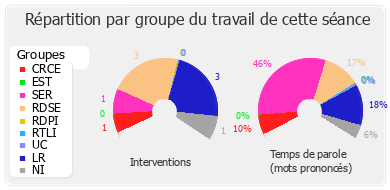Séance en hémicycle du 21 novembre 2013 à 9h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à neuf heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle l’examen, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (projet n° 97, texte de la commission n° 142, rapport n° 141).
Pour ce projet de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d’examen simplifié.
Je vais donc le mettre aux voix.
Est autorisée la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (ensemble deux annexes), signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi autorisant la ratification de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.
Le projet de loi est adopté.

L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions des commissions mixtes paritaires chargées d’élaborer les textes sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique (texte de la commission n° 111, rapport n° 110) et du projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution (texte de la commission n° 112, rapport n° 110).
La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.
Dans la discussion générale commune, la parole est à M. le rapporteur.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner les conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi organique et le projet de loi portant application de l’article 11 de la Constitution.
Vous me permettrez de faire une nouvelle fois quelques remarques sur cet article 11. J’ai déjà dit à plusieurs reprises que l’instauration du référendum d’initiative partagée par l’article 11 de la Constitution était en quelque sorte un faux-semblant. Pourquoi ? Beaucoup de personnes, éminentes pour certaines, ont pu penser que cette procédure s’apparentait au référendum d’initiative populaire, c’est-à-dire que le souhait d’un certain nombre de citoyens entraînerait derechef l’organisation d’une consultation. Mais tel n’est pas le cas.
Je ne dis pas que le référendum d’initiative populaire soit forcément la panacée ; il est permis d’avoir des réserves à ce sujet. Pour ma part, j’en ai ! À cet égard, il me semble que les référendums locaux, par exemple, mériteraient une analyse précise. Très souvent, en effet, on sollicite l’organisation d’une telle consultation pour défendre tel ou tel intérêt, souvent collectif, mais parfois partiel, voire partial.
En ce qui me concerne, je pense, s’agissant des sujets tant locaux que nationaux, mis à part les cas où le référendum existe depuis déjà de nombreuses années dans notre Constitution, que le travail des assemblées, qu’elles soient locales ou parlementaires, est le plus à même d’apporter des réponses suffisamment débattues et adaptées à des questions complexes. Il y a finalement peu de questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non.
En l’occurrence, le sujet qui nous intéresse n’est pas le référendum d’initiative populaire ; il s’agit d’un référendum d’initiative partagée. Or, mes chers collègues, pour que ce dernier puisse exister, en vertu des termes de l’article 11 de la Constitution, il faut remplir tellement de conditions que la mise en œuvre de cette procédure ressemble à un véritable parcours du combattant. C’est pourquoi je me suis permis de parler, selon les jours, de « faux-semblant » ou de « trompe-l’œil ».
Il faut tout d’abord qu’une proposition de loi soit signée par un cinquième des membres du Parlement. Je note à ce sujet que la position que j’ai défendue au Sénat a été reprise par l’Assemblée nationale avant même la réunion de la commission mixte paritaire. En effet, nous avions considéré que, dès lors que la Constitution évoquait « une » proposition de loi, il ne pouvait y en avoir deux différentes, c’est-à-dire une dans chaque assemblée. C’est une évidence qui ressort de la lecture de la Constitution. Le Sénat a donc proposé de créer une proposition de loi d’un type particulier qui pourrait être signée à la fois par des députés et par des sénateurs. L’Assemblée nationale nous a suivis sur ce point, ce dont je me réjouis. En l’espèce, l’initiative revient donc au Parlement et non à un certain nombre de citoyens qui signeraient une déclaration, une pétition ou un texte.
Ensuite, le Conseil constitutionnel doit examiner la proposition de loi pour vérifier qu’elle est conforme à la Constitution et surtout qu’en l’occurrence l’article 11 s’applique. En effet, il n’aura échappé à personne que si tel groupe politique de l’une ou l’autre assemblée avait tout d’un coup trouvé opportun d’inscrire dans son temps réservé cette proposition de loi, c’était peut-être parce qu’il apparaissait utile de faire ressurgir dans l’actualité l’idée du référendum à la suite de l’adoption d’un texte voté – chacun s’en souvient, monsieur le ministre – dans des conditions assez bonnes, puisqu’il s’applique dans les différentes communes de France comme loi de la République.
Puis, il faut que 4, 5 millions de citoyens apportent leur soutien à ladite proposition de loi, ce qui est considérable. En effet, à l’occasion d’initiatives récentes, on a pu constater combien il était difficile de recueillir un tel nombre de signatures, qui seront bien entendu vérifiées, représentant 10 % du corps électoral français.
Enfin, en vertu d’une condition qui est souvent passée inaperçue, le Président de la République ne peut provoquer l’organisation du référendum que si le texte n’a été examiné ni à l’Assemblée nationale ni au Sénat pendant un délai de six mois. Nous avons beaucoup discuté, notamment lors de la réunion de la commission mixte paritaire, sur ce qu’il fallait entendre par le terme « examiné ». Je tiens à préciser – cela pourra éclairer l’interprétation du texte – que nous avons considéré qu’un texte est examiné dès lors qu’il est inscrit à l’ordre du jour et que la discussion a commencé avec la prise de parole du premier orateur en séance publique.
Je rappelle qu’il existe six groupes parlementaires au sein de chacune des deux assemblées. Or chacun d’entre eux dispose d’un temps réservé et peut donc inscrire ladite proposition de loi à l’ordre du jour en vertu de la Constitution, sans que le Gouvernement ait son mot à dire, monsieur le ministre. Un groupe peut choisir de la faire inscrire parce qu’il l’approuve, mais il peut aussi choisir de le faire pour qu’il n’y ait pas de référendum. Rendez-vous compte, mes chers collègues : un seul groupe parlementaire par assemblée peut donc stopper le processus et annihiler 4, 5 millions de signatures !
Je reprends le fil de la procédure : une fois que les signatures ont été obtenues, que les six mois sont passés et que le constat est fait que les deux assemblées n’ont pas examiné le texte, alors, le Président de la République doit organiser le référendum.
Mes chers collègues, pour ma part, je n’ai pas voté cette modification de la Constitution, mais je ne suis pas sûr que ceux qui l’ont votée ont bien perçu le caractère très particulier de ce dispositif. Après tout, on peut inscrire dans la Constitution un référendum d’initiative populaire – c’est un choix politique – ou un référendum d’initiative partagée, mais reconnaissez qu’il faut beaucoup d’imagination pour produire une procédure aussi compliquée qui, de ce fait, aura assez peu de chances d’être mise en œuvre.
Les remarques qui précèdent ne portent que sur le texte de la Constitution : elle est la Constitution de la République et nous la respectons. Je veux maintenant rappeler quelle a été la position de la commission des lois.
La commission des lois a été saisie à deux reprises par le groupe UMP de la loi organique et de la loi ordinaire. L’attitude de tous les membres de la commission des lois a été foncièrement républicaine, cela va de soi : il existe une Constitution, certains ont voté sa modification, d’autres non, mais cette Constitution est la nôtre. La Constitution enjoint au Parlement d’adopter une loi organique pour que son article 11 puisse être appliqué. Nous avons donc fait notre travail, sérieusement, avec une seule pensée : rester le plus fidèles possible à l’esprit et à la lettre de la Constitution. Monsieur le ministre, je tiens à souligner le soin particulier avec lequel vous avez suivi les travaux : vous êtes intervenu, aussi bien devant l’Assemblée nationale que devant le Sénat, avec le même état d’esprit – être fidèle à la Constitution –, parce que c’est l’état d’esprit républicain qui nous anime tous.
Des points de divergence existaient entre les deux assemblées. Je tiens à saluer le travail très constructif que les deux rapporteurs ont pu mener. Je souhaite également rendre un hommage particulier à notre collègue député Guy Geoffroy, rapporteur pour l’Assemblée nationale, et à mon homologue Jean-Jacques Urvoas, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale : l’un et l’autre ont fait preuve – je tiens à le souligner – d’une volonté d’aboutir qui a été extrêmement précieuse. De même, nos collègues qui se sont investis dans l’examen de ce texte, et tout particulièrement notre collègue Hugues Portelli, ont largement permis d’aboutir à l’élaboration d’une position commune que j’ai maintenant l’honneur d’exposer devant vous, mes chers collègues.
L’Assemblée nationale était particulièrement attachée à deux points, sur lesquels nous nous sommes ralliés à sa position lors de la réunion de la commission mixte paritaire – c’est le rôle des commissions mixtes paritaires de trouver un accord.
Le premier point concernait les règles relatives aux modalités de transmission de la proposition de loi initiale entre les deux assemblées. À cet égard, nous avons choisi de retenir la procédure définie par l’Assemblée nationale.
Le second point auquel tenait l’Assemblée nationale était le suivant : compte tenu de son caractère très particulier, la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peut pas être soumise au Conseil d’État, contrairement à toutes les autres propositions de loi, puisqu’elle sera soumise de droit au Conseil constitutionnel avant que le processus ne se poursuive. Là aussi, nous nous sommes rangés au point de vue de l’Assemblée nationale et, si vous en décidez ainsi, mes chers collègues, cette disposition sera inscrite dans le texte de la loi ordinaire.
Sur quatre autres points, des divergences existaient entre nos deux assemblées et, sur trois d’entre eux, les représentants du Sénat à la commission mixte paritaire ont particulièrement tenu à être strictement fidèles à la lettre de la Constitution.
J’aborde immédiatement le quatrième point de divergence, relatif au recueil des soutiens. Lors des deux lectures qui ont eu lieu, notre assemblée a souhaité que les 4, 5 millions de soutiens puissent être exprimés par les électeurs soit par voie électronique, soit sur un formulaire sur support papier. Le Sénat est très sensible à la situation de nos concitoyens sur l’ensemble du territoire : on ne peut pas leur imposer d’avoir un ordinateur et d’utiliser uniquement la voie électronique pour manifester leur avis.
Nous avons retenu la situation suivante : la mairie de la commune la plus peuplée de chaque canton, qui jouera le rôle de mairie centralisatrice, enregistrera et transmettra les signatures par voie électronique. Toutefois, tout citoyen pourra apporter un formulaire papier à la mairie centralisatrice. Les agents de cette mairie seront habilités à prendre connaissance des formulaires et à transmettre par voie électronique le soutien du citoyen ou de la citoyenne concernés.
Notre proposition a été adoptée par la commission mixte paritaire et, avant-hier, par l’Assemblée nationale. Ce point, qui ne relève pas de la lettre de la Constitution, a pu faire l’objet d’un accord « simple et pratique », comme eût dit notre collègue Jean-Pierre Chevènement.
Restent donc trois points de divergence.
La question des délais nous a tout d’abord occupés : nous étions parvenus à un accord sur l’ensemble des délais. Toutefois, le texte adopté par l’Assemblée nationale comportait une disposition qui ne nous paraissait pas acceptable. En effet, dès lors que le recueil des signatures aurait eu lieu et dès lors qu’il était constaté que, dans un délai de six mois – les suspensions et interruptions de la session ne sont bien sûr pas décomptées –, la question n’aurait pas été examinée par les deux assemblées, l’Assemblée nationale avait décidé que le Président de la République disposait d’un délai de quatre mois pour organiser le référendum. Or un tel délai n’est aucunement prévu par le texte de la Constitution qui dispose que le Président de la République soumet la proposition de loi au référendum, sans poser aucune condition de délai.
Il nous est donc apparu que, si nous avions accepté la position de l’Assemblée nationale, le législateur organique eût outrepassé ses droits, car il doit naturellement être totalement fidèle aux choix du constituant. Par conséquent, nous avons plaidé devant la commission mixte paritaire pour la suppression de ce délai et un accord a été obtenu sur ce point.
J’ai déjà évoqué l’un des deux derniers points de désaccord subsistant, à savoir celui de l’examen du texte par les deux assemblées. L’Assemblée nationale avait décidé que le texte de la proposition de loi devait être « voté » par les deux assemblées pour que le Président de la République ne soit pas contraint d’organiser un référendum. Nous avons considéré que l’obligation d’un vote outrepassait, encore une fois, les compétences du législateur organique. Dès lors que l’article 11 de la Constitution – et je ne doute pas que ceux qui ont voté sa modification n’aient réfléchi à la portée des mots – contient le terme « examinée » et non le terme « votée », il faut que la loi organique reprenne le terme « examinée ». Sur ce point encore, la commission mixte paritaire a bien voulu se ranger à notre interprétation.
J’ai précisé tout à l’heure qu’une proposition de loi est considérée comme ayant été « examinée » dès lors qu’elle a été inscrite à l’ordre du jour et que le débat a commencé en séance publique dans l’une des assemblées. Ce débat peut se conclure de toutes les manières possibles : par un vote, par l’adoption d’une motion de procédure, etc., car l’examen d’un texte peut toujours aboutir à diverses conclusions.
Restait un ultime point de désaccord qui nous a longuement retenus. Il s’agit du rôle du Conseil constitutionnel dans le contrôle des 4, 5 millions de signatures. L’Assemblée nationale avait imaginé que cette mission pût être dévolue à une commission.
Nous concevons bien la difficulté que représente un tel contrôle pour les neuf membres éminents du Conseil constitutionnel, voire plus, si leur effectif est complété par d’anciens présidents de la République – encore que je sois toujours partisan de la suppression de la disposition créant ces membres de droit.
D’une part, nous avons pu faire observer que, l’Assemblée nationale ayant proposé que cette commission fût composée de six membres – deux membres du Conseil d’État, deux membres de la Cour de cassation et deux membres de la Cour des comptes –, ces six personnes eussent été dans une situation également difficile, voire plus difficile puisqu’elles eussent été encore moins nombreuses.
D’autre part, le Sénat a considéré qu’il fallait, là encore, respecter la lettre et l’esprit de la Constitution. Or celle-ci, telle qu’elle a été écrite et votée, dispose que « le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l’alinéa précédent ». C’est donc bien au Conseil constitutionnel lui-même qu’appartient ce contrôle.
Nous avons pensé qu’il fallait respecter l’esprit et la lettre de la Constitution, mais qu’il fallait bien entendu prendre en compte la situation pratique. C’est pourquoi nous avons écrit dans la loi organique que le Conseil constitutionnel pouvait d’abord disposer de tous les services de l’État et, en particulier, de ceux du ministère de l’intérieur. Nous avons précisé qu’il pouvait nommer des rapporteurs adjoints et désigner des délégués dans tous les départements – c’est le bon sens même. Nous avons également prévu toute une série de clauses qui permettront au Conseil constitutionnel d’accomplir son office.
Restait enfin une question à régler : nous avons pensé qu’il était possible de créer une « formation » chargée d’examiner les recours. Nous avons proposé que cette formation fût présidée par un membre du Conseil constitutionnel et comprenne deux autres de ses membres, et la commission mixte paritaire a adopté cette disposition. Je me fais donc le porte-parole des défenseurs de ce point de vue.
Depuis, la réflexion a progressé – l’esprit souffle toujours, monsieur le ministre ! –, et il est apparu qu’un risque de conflit pouvait exister entre cette formation et la formation plénière du Conseil constitutionnel qui, de toute façon, devra statuer en dernier ressort sur les recours qui surgiraient. Il me semble qu’une solution peut être trouvée à ce problème. Tel est en tout cas notre état d’esprit.
Je pense avoir ainsi évoqué l’ensemble des points de divergence qui existaient entre les deux assemblées.
J’ai voulu vous expliquer ce que nous avons fait pour défendre notre conception, qui prône le respect absolu de la lettre et de l’esprit de la Constitution, et comment, grâce au travail commun au sein des commissions mixtes paritaires, nous avons réussi à trouver l’accord que j’ai le grand plaisir de vous soumettre et que je vous incite bien entendu, mes chers collègues, à approuver.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, de l'UDI-UC et de l'UMP.
M. Alain Vidalies, ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la Haute Assemblée examine aujourd’hui les textes issus des travaux des commissions mixtes paritaires, lesquelles sont parvenues à trouver un accord mettant fin au parcours parlementaire du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire destinés à mettre en œuvre les dispositions de l’article 11 de la Constitution. Tel est bien en effet l’objet de ces deux textes, même si j’ai parfois eu l’impression que le président Sueur prononçait plutôt l’éloge funèbre de cet article…
Sourires.
Notre objectif est que soient votées des dispositions conformes à la volonté ou à l’aspiration du constituant.
Comme vous le savez, l’Assemblée nationale, dans un vote qui illustre la parfaite concorde républicaine, a approuvé mardi dernier le projet de loi organique dans la rédaction résultant de la commission mixte paritaire, modifiée par un amendement du Gouvernement.
Deux dispositions de notre loi fondamentale permettent de recourir au référendum : l’article 89, d’une part, et l’article 11, d’autre part, lequel permet au Président de la République, sur proposition du Gouvernement ou sur proposition conjointe des deux assemblées, de soumettre au peuple des projets de loi entrant dans le champ fixé par son premier alinéa.
C’est de cette disposition, dans sa rédaction issue de la révision de 2008, qu’il est aujourd’hui question.
Comme a pu le relever M. Portelli, il n’est pas tout à fait satisfaisant que des textes ayant fait l’objet d’une révision constitutionnelle depuis plus de cinq ans – et même plus de six ans pour ce qui est de l’article 68 – ne soient toujours pas entrés en vigueur à ce jour. Il y a là matière à réflexion pour le législateur organique, Gouvernement comme Parlement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, il est temps d’achever le parcours de ces textes qui ont connu un long cheminement. Ils ont en effet été déposés en décembre 2010, et une première lecture est intervenue un an plus tard, le 21 décembre 2011.
Comme cela est rappelé dans l’excellent rapport de votre commission, si les nouvelles dispositions de l’article 11 sont en elles-mêmes précises, elles prévoient toutefois qu’une loi organique détermine les conditions de présentation de la proposition de loi et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel assure le contrôle du respect des règles fixées par la Constitution.
C’est sur ce dernier point que d’ultimes ajustements sont intervenus entre les chambres afin de s’assurer de la meilleure des rédactions possibles. Vous en conviendrez en effet, il serait étonnant que le législateur voie ces dispositions relatives au rôle du Conseil constitutionnel censurées pour inconstitutionnalité par ce même Conseil...
L’histoire retiendra peut-être que c’est encore le Sénat qui voulut garantir le respect de la lettre constitutionnelle, et peut-être protéger le Conseil constitutionnel du Conseil constitutionnel lui-même...
Mon propos sera bref, car il ne me paraît plus opportun de revenir sur les discussions et les échanges intéressants que les chambres ont pu connaître sur les notions de « référendum » ou d’ « initiative populaire ».
À l’ordre du jour du Sénat figurent donc ces textes relatifs aux modalités de mise en œuvre de l’article 11, lequel institue ce que l’on a laissé nommer, à tort, le « référendum d’initiative populaire », alors qu’il s’agit en fait, comme l’a rappelé M. Sueur, d’un référendum d’initiative partagée. Celui-ci résulte d’un compromis obtenu sur la base d’amendements déposés par plusieurs groupes politiques qui visaient alors à créer un véritable référendum d’initiative populaire.
Il n’y a nulle contradiction à vouloir, d’une part, revaloriser le rôle du Parlement et, d’autre part, achever l’entrée en vigueur de cette disposition afin de mieux associer les citoyens à la vie publique.
C’était déjà, je le rappelle – les parlementaires d’expérience, dont j’ai eu l’honneur de faire partie, s’en souviennent –, le sens des travaux du Comité consultatif pour la révision de la Constitution, institué en décembre 1992 par François Mitterrand, qui fut le premier à proposer l’instauration d’un « référendum d’initiative minoritaire ». Il s’agissait de combiner « le vœu d’une minorité parlementaire et [celui] d’une minorité de pétitionnaires dont le cumul pouvait conduire à l’arbitrage de la nation elle-même ». Nous y sommes, vingt ans plus tard.
Le constituant ayant décidé d’instaurer ce type de référendum, il appartient désormais au législateur, dans la marge étroite d’appréciation – la ligne de crête – qui lui reste en ce domaine, d’adopter un dispositif qui présente les garanties nécessaires de clarté et de sécurité, comme de simplicité.
Les membres de la commission mixte paritaire sont parvenus à des propositions convergentes qui conservent les apports de l’Assemblée nationale et du Sénat, tout en respectant la lettre et l’esprit de la Constitution.
Je ne reviendrai pas sur les avancées obtenues sur les questions de recueil des soutiens, sur les modalités de transmission de la proposition de loi entre les deux assemblées, sur la question de la consultation du Conseil d’État ou sur les délais impartis au Président de la République pour organiser le référendum.
Il m’apparaît donc que l’approche rigoureuse des textes fondamentaux par la Haute Assemblée a pu prévaloir.
Je le dis d’emblée, sous la réserve d’un amendement technique de précaution déposé par le Gouvernement et approuvé avant-hier par l’Assemblée nationale, amendement qui viendra encore sécuriser votre dispositif s’agissant de la composition des formations de première instance du Conseil constitutionnel, vos travaux recueillent l’approbation et le soutien complet du Gouvernement.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en adoptant ces deux projets de loi, les deux chambres satisferont à la demande de deux présidents de la République, Nicolas Sarkozy, l’initiateur de cette réforme constitutionnelle, et François Hollande, qui rappelait le mois dernier, à l’occasion de l’anniversaire de notre Constitution, son souhait de voir cette disposition acquérir force de loi. §

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, que dire de plus que lors des deux lectures précédentes ? Peu de chose. Mais il n’est pas interdit de répéter, encore et toujours, les arguments déjà développés auparavant.
Certes, l’article 11 de la Constitution instaure un référendum qui est dorénavant, selon M. le rapporteur, d’initiative partagée, après avoir été d’initiative parlementaire. L’appellation « référendum d’initiative minoritaire », évoquée par M. le ministre, aurait été aussi fort à propos.
Ce référendum d’initiative partagée est quelque peu décevant, alors même que nombre de nos concitoyens attendaient un référendum d’initiative populaire afin de pouvoir enfin être plus actifs dans notre démocratie ; plus actifs en tout cas qu’en mettant un bulletin de vote de temps à autre dans l’urne, ou qu’en envahissant – cela semble être la nouvelle forme de démocratie ! – les boîtes aux lettres informatiques des parlementaires de courriels pour les engager à faire basculer de-ci ou de-là une loi par la voie d’un amendement qu’ils ont inventé.
Certes, grâce à cette navette parlementaire et aux travaux de la commission mixte paritaire, nous avons gagné sur les points de l’organisation et de la composition de la commission pour le décomptage des voix.
Mais quelles voix ? Celles de plus de 4, 5 millions d’électeurs français ! Sachant que le nombre des inscrits, lors de la dernière élection présidentielle, s’élevait à 44, 3 millions, ce sont donc plus de 10 % des électeurs qui sont concernés.
Pour paraphraser Henri Rochefort, la France a donc 43 millions d’électeurs, sans compter les sujets de mécontentement… §Quand on voit combien il est difficile d’obtenir un référendum européen, qui nécessite seulement 1 million de signatures – quatre fois moins, donc – réunies dans sept pays parmi les vingt-huit que compte l’Union, nous ne sommes pas près de voir le début du bout du nez de ce référendum !
Nous voterons toutefois ces textes adoptés en commission mixte paritaire grâce au travail et à l’immense talent du président de la commission des lois du Sénat, également rapporteur pour le Sénat des commissions mixtes paritaires, tout en ayant conscience que nous avons élaboré des lois, certes belles, mais bien vaines…

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le groupe UMP votera bien entendu ce projet de loi organique et ce projet de loi ordinaire, tels qu’ils résultent des travaux des commissions mixtes paritaires.
Je rejoins tout à fait les propos tenus par M. le président de la commission des lois et M. le ministre s’agissant notamment de la nécessité de mettre en œuvre intégralement la Constitution. À cet égard, je n’adresserai pas de reproche à l’actuelle majorité, puisque des dispositions relatives à l’article 11 ont été présentées pour la première fois en 2008. Il y avait donc tout loisir de les faire entrer en vigueur depuis lors, et je suis de ceux qui regrettent que l’on ait tant tardé à le faire.
Je suis d’ailleurs très heureux que le Président de la République ait souligné qu’il serait bon, aussi, de faire entrer en application l’article 68 dans sa mouture résultant de la révision constitutionnelle de 2007.
Je crois me rappeler que le Sénat, sur l’initiative de M. Robert Badinter, avait adopté une proposition de loi organique sur ce sujet, et que celle-ci circule, au travers d’une navette quelque peu « virtuelle », en même temps qu’un projet de loi organique voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ces deux textes, que j’ai relus voilà quelques jours, présentent peu de différences.
Je citerai la principale : dans le projet de loi organique voté par les députés, le bureau des assemblées se voit confier le soin de piloter le travail, tandis que, aux termes de la proposition de loi organique adoptée par le Sénat, c’est la conférence des présidents qui doit assumer cette tâche.
Les autres différences, mineures, portent sur des points de détail. Il serait donc facile de trouver une version de compromis entre ces deux rédactions.
Pour ce qui concerne l’article 11 de la Constitution, tel qu’il ressort de la révision constitutionnelle de 2008, je suis de ceux qui le considèrent comme très peu praticable. Que ce soit dans sa mouture datant de 1992 ou dans celle de 2008, il porte plus la marque d’une réticence que d’un intérêt pour l’initiative populaire.
En réalité, une seule chose comptera si les mesures proposées dans ces deux textes viennent, un jour, à être adoptées et, surtout, mises en œuvre : la campagne menée pour récolter les 4, 5 millions de signatures. Autrement dit, l’adoption de ces dispositions permettra que l’on puisse mener des batailles d’opinion. En effet, comme l’a très bien expliqué M. le président de la commission des lois, il suffira de mettre la proposition de loi à l’ordre du jour d’une des assemblées du Parlement pour bloquer le processus, pour empêcher que le référendum ne voie le jour. Mais si véritablement des millions de signatures ont été récoltées, il sera tout de même difficile de faire comme si rien ne s’était passé.
Les textes issus des travaux des commissions mixtes paritaires valent ce qu’ils valent et sont, dans leurs différentes modalités, à peu près praticables.
Je voudrais tout de même intervenir, à titre personnel, sur l’amendement que le Gouvernement a déposé afin de tenir compte d’un certain nombre de souhaits. Je suis très attaché à la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs concerne aussi bien les pouvoirs exécutif et législatif – séparation relative dans la Constitution de 1958 – que le pouvoir juridictionnel. Lorsque le Parlement travaille, ou lorsque le Gouvernement travaille avec le Parlement, pour mettre au point des textes de loi, il n’est pas très bon que des pressions extérieures se manifestent de façon extrêmement outrancière et aboutissent au dépôt d’amendements, lesquels, d’ailleurs, suivent un cheminement institutionnel assez baroque.
Ainsi, je crois savoir que l’amendement déposé par le Gouvernement n’a pas été rédigé par ce dernier, mais qu’il est passé par des circuits beaucoup plus élevés. Tout cela ne me paraît pas du tout respectueux de la Constitution, qu’il convient, me semble-t-il, de respecter tant dans sa lettre que dans son esprit. Je souhaite donc que, à l’avenir, les textes élaborés par le Parlement et par le Gouvernement ne le soient que par eux seuls !
Cela étant dit – à bon entendeur, salut ! –, j’accomplis la mission qui m’a été confiée en indiquant que le groupe UMP votera ce texte.
Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi qu’au banc de la commission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l’avons expliqué à l’occasion des deux premiers débats sur ce sujet, nous sommes opposés à la réforme de l’article 11 de la Constitution telle qu’elle est envisagée au travers des textes qui nous sont soumis, et ce y compris après les travaux des commissions mixtes paritaires.
Outre la complexité de mise en œuvre de la procédure instituée, que M. le président de la commission des lois vient de rappeler, on ne peut manquer de constater que, dans les faits, le citoyen reste cantonné dans un rôle purement secondaire.
La réalité est donc bien différente de l’ambition affichée à l’époque où l’article 11 a été modifié !
Tout d’abord, il ne s’agit nullement d’une nouvelle forme de consultation populaire d’initiative populaire. C’est en fait une nouvelle forme d’initiative parlementaire soutenue par le droit de pétition – on a parlé d’« initiative partagée » –, dans la mesure où le recueil des soutiens ne pourra intervenir qu’après le dépôt de la proposition de loi par un cinquième des parlementaires.
Ainsi, notre représentation nationale donne l’impulsion et les citoyens n’interviennent que de manière secondaire, en soutien à cette initiative parlementaire. Ce n’est donc pas un nouveau pas vers la démocratie participative.
Je note, au passage, que ce constat met significativement en lumière le leurre employé par Nicolas Sarkozy lors de la révision du 23 juillet 2008 : cette réforme était présentée comme une démocratisation profonde de nos institutions, de nouvelles dispositions, dont celle qui nous occupe aujourd’hui, étant censées introduire une nouvelle forme d’initiative populaire. Nous en sommes loin !
Par ailleurs, la procédure définie s’apparente à une véritable course d’obstacles entravant, de fait, l’organisation de ce type de référendums.
Premier obstacle, le dispositif exige que la proposition de loi soit déposée devant le Conseil constitutionnel par un grand nombre de parlementaires, à savoir un cinquième de la représentation nationale. Un tel ratio n’est pas si facile à atteindre. Si tel était le cas, nous aurions déjà adopté le droit de vote pour les résidents extracommunautaires. Mais je ne m’attarderai pas sur la question des rapports de force parlementaires…
Deuxième obstacle, la proposition de loi référendaire doit être soutenue par un nombre élevé d’électeurs inscrits : près de 4, 5 millions de personnes.
Tous les observateurs ont noté le caractère rédhibitoire de ces deux conditions réunies, surtout au regard du délai prévu pour recueillir les soutiens. Indépendamment même de ce délai, la difficulté est réelle.
Qui plus est, à ces conditions drastiques s’ajoute un contrôle du Conseil constitutionnel qui, d’emblée, limitera l’initiative parlementaire, si du moins une telle initiative voit le jour.
Notre discours, mes chers collègues, ne présente pas la moindre ambiguïté : nous avons dénoncé le caractère manipulateur, pour ne pas dire « truqueur », de ces dispositions, et j’ai du mal à comprendre comment, aujourd’hui, l’ensemble des groupes de gauche peut faire sienne une réforme dont les limites démocratiques sont relativement évidentes.
Les sénateurs et sénatrices du groupe CRC sont partisans d’une profonde réforme des institutions, faisant la part belle à l’initiative citoyenne. Nous continuerons de réclamer l’ouverture d’un véritable débat sur l’avenir de nos institutions, sur la nécessité d’une profonde rénovation de ces dernières et sur la place en leur sein d’une initiative populaire et citoyenne, reconnue comme telle.
Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas les deux textes de loi qui nous sont proposés.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, il aura fallu plus de cinq ans pour que la loi organique portant application de l’article 11 de la Constitution puisse entrer en vigueur, un dispositif censé rapprocher les citoyens de l’élaboration des lois au travers d’un référendum d’initiative partagée aux allures d’œuvre d’art byzantine. D’ailleurs, le mot « art » n’est peut-être pas nécessaire…

Nous n’oublions pas que l’adoption de ces deux textes répond à l’engagement du Président de la République, qui a souhaité, lors du cinquante-cinquième anniversaire de la Constitution de la Ve République, que le nouvel article 11 de la Constitution entre rapidement en vigueur.
Nous prenons acte de l’accord auquel est parvenue la commission mixte paritaire sur – il faut bien le dire – des questions relativement accessoires au regard de l’enjeu que constituent ces textes.
Pour autant, l’appréciation dont nous avions déjà fait part lors des deux lectures précédentes n’a pas changé. Bien qu’ayant toujours été circonspects devant un dispositif totalement impossible à mettre en œuvre, nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire. En tant que républicains, nous sommes effectivement soucieux du respect de la loi de la République, en l’occurrence de la Constitution, quoique nous puissions en penser… Et nous en pensons d’ailleurs de plus en plus de mal !
Notre position n’ayant pas varié, nous pouvons aisément rappeler que les conditions requises pour déclencher ce référendum ne pourront quasiment jamais être réunies dans la réalité. Une proposition de loi cosignée par un cinquième des parlementaires, soit 185 élus, appuyée par 4, 5 millions d’électeurs : on ne peut pas croire un seul instant que cette double condition sera un jour remplie !
Cette impossibilité matérielle nous satisfait d’autant plus que la loi organique ne laisse guère d’espace aux formations minoritaires, confortant le système bipartisan de la Ve République que, pour notre part, nous avons toujours réprouvé. Seuls les deux partis dominants – des partis qui, se succédant au pouvoir, dominent beaucoup trop, avec les résultats que l’on sait aujourd’hui – seront éventuellement en capacité de réunir un cinquième des membres du Parlement pour cosigner une proposition de loi référendaire.
Une fois de plus, ce dispositif confirme que, en dehors du bipartisme, il n’est point de salut, hélas ! même si nos concitoyens commencent enfin à prendre la mesure des travers consubstantiels de la Ve République et d’une pratique à bout de souffle, aggravés par le quinquennat et l’inversion du calendrier.
Soyons réalistes, le dispositif de la proposition de loi référendaire rend improbable l’organisation in fine par le chef de l’État d’un référendum, dans la mesure où la simple adoption d’une motion de rejet vaut « examen » par une assemblée, au sens de la loi organique. Non seulement la majorité en place pourra facilement neutraliser la procédure dès son stade parlementaire, …

… mais on encourage de la sorte l’instrumentalisation de la question référendaire, transformée pour l’occasion en tribune médiatique.
Le risque, vous le connaissez, mes chers collègues, c’est que la discussion de ces propositions de loi apparaisse comme une troisième ou une quatrième lecture d’un même texte, comme l’ultime outil de l’opposition pour occuper le débat public. Il me semble d’ailleurs que nous avons presque assisté à une telle tentative au cours des derniers mois !
L’autre risque que nous craignons, quitte à nous répéter, est celui d’une instrumentalisation de l’outil législatif par certains lobbie s bien financés, heureux de voir s’introduire dans le débat démocratique, autour de la campagne de recueil des soutiens populaires, une question qui pourrait servir leurs intérêts, bien souvent voire presque toujours pécuniaires. Or le débat public n’a jamais fait bon ménage avec l’argent, et nous tenons à ce qu’il continue d’en être ainsi.
La famille politique à laquelle je suis fier d’appartenir, celle des radicaux, s’est toujours méfiée de la pratique référendaire, bien souvent transmuée en plébiscite dans l’histoire de notre pays. Non que nous craignions aujourd’hui qu’un Badinguet se transforme demain en dictateur ; mais à notre sens, le référendum ne devrait être confiné qu’à des hypothèses ultimes, comme l’approbation par le peuple de grandes décisions affectant l’avenir de la Nation. Notre confiance réside d’abord dans l’expression du suffrage universel et la démocratie représentative, dont nous émanons et dont nous retirons notre légitimité de par l’article 3 de la Constitution.
Pour autant, nous ne saurions retirer son mérite à la procédure d’examen de ces deux textes. Nos deux assemblées ont pu, pour une fois, dialoguer et se mettre d’accord, ce qui devient très rare par les temps qui courent et confirme, en passant, que personne ne croit à l’application future de ce dispositif.
Les principaux points de divergence portaient sur les modalités de recueil et de contrôle des soutiens, avec, en particulier, la question de l’opportunité de créer ou non une commission ad hoc chargée de contrôler ceux-ci. Nous prenons acte avec satisfaction du fait que la position du Sénat, plus respectueuse de la lettre de la Constitution, a été suivie. C’est suffisamment peu fréquent pour que nous nous en réjouissions.
Quant à la question de la forme du recueil des soutiens populaires, nous saluons également le fait que la position du « tout électronique » voulue par les députés n’a pas été retenue. C’est une bonne chose, me semble-t-il, que la commission mixte paritaire soit parvenue à cette conclusion.
Vous aurez donc compris, monsieur le ministre, mes chers collègues, que notre groupe votera unanimement les conclusions de ces commissions mixtes paritaires, non pas avec enthousiasme, mais avec le souci responsable de ne pas laisser des pans de la Constitution en jachère.
À ce propos, monsieur le ministre, oserais-je vous demander s’il entre dans les intentions du Gouvernement de faire prochainement adopter, avec la même célérité, la loi organique portant application des articles 67 et 68 de la Constitution relatifs à la Haute Cour ?
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi qu’au banc de la commission.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d’un long processus, puisque nous sommes appelés à adopter définitivement le dernier projet de loi organique de mise en œuvre de la réforme constitutionnelle de 2008.
Ce long processus, assurément, aboutit à un dispositif dont je ne sais s’il faut le qualifier d’original ou de saugrenu. Original, en tout cas, il l’est ! D’ailleurs, en 2008, l’un de nos plus illustres prédécesseurs à cette tribune, M. Robert Badinter, rappelait au sujet de l’article 11 de la Constitution la boutade de Clemenceau : « Savez-vous ce qu’est un chameau ? C’est un cheval dessiné par une commission parlementaire. »
Sourires.

Il appartenait au législateur organique de donner vie à la nouvelle rédaction de l’article 11 de la Constitution instituant le référendum d’initiative partagée. Désormais, cette initiative appartiendra non pas aux citoyens, raison pour laquelle on ne parle pas de référendum d’initiative populaire, mais à un cinquième des membres du Parlement, soit le nombre – astronomique ! – de 185 parlementaires. Elle doit ensuite être soutenue par un dixième des électeurs, soit environ 4, 5 millions de soutiens.
Cela ne suffit toutefois pas à rendre obligatoire un référendum, une autre condition étant fixée. Celui-ci ne pourra être organisé que si les deux assemblées n’ont pas examiné le texte qui doit être soumis à référendum.
Enfin, l’article 11 prévoit que la procédure doit être organisée sous le contrôle du Conseil constitutionnel.
Cette initiative prendra la forme d’une proposition de loi qui pourra être déposée indifféremment sur le bureau de l’une ou l’autre des deux assemblées. Le recueil des soutiens, qui seront apportés par voie électronique, s’étalera sur une période de neuf mois. Toutes ces dispositions ont déjà été détaillées par les orateurs qui m’ont précédée à cette tribune.
Il appartiendra au Conseil constitutionnel de vérifier qu’une initiative a reçu le nombre de soutiens nécessaire. En commission mixte paritaire, il a été précisé que ce contrôle serait effectué par une formation restreinte du Conseil constitutionnel, composée de son président et de deux de ses membres. Sur l’initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a modifié ce point. C’est l’objet de l’amendement n° 1.
Là encore, on peut s’interroger sur la conformité de ce procédé avec l’adage delegatus delegare non potest, c'est-à-dire « le délégué ne peut pas déléguer ». Pour autant, nous partageons l’idée qu’il faut éviter que le Conseil constitutionnel ne se retrouve submergé par l’ampleur de sa nouvelle tâche, même si, en l’occurrence, les occasions ne seront pas très fréquentes.
Enfin, le projet de loi organique prévoit que la période pendant laquelle les deux assemblées doivent examiner la proposition de loi ayant reçu un nombre suffisant de soutiens s’étale sur six mois.
Nous avons pris la précaution de prévoir que le rejet de la proposition de loi par l’une des deux assemblées n’interromprait pas la navette parlementaire, comme c’est le cas pour les propositions de loi de droit commun. En effet, cela aurait permis à une seule des deux assemblées de forcer l’organisation d’un référendum.
Je tiens ici à faire remarquer qu’un point devra être traité dans les règlements des deux assemblées. En effet, si l’adoption d’une motion tendant à poser la question préalable ou d’une motion tendant à opposer l’exception d’irrecevabilité entraîne le rejet de la proposition de loi examinée, avec ce projet de loi organique, elle entraînera la transmission du texte discuté à l’autre assemblée.
Reste l’adoption d’une motion de renvoi en commission, qui, elle, ne vaut pas rejet du texte examiné. Elle permettrait à l’une des assemblées de garder « au chaud » une proposition de loi référendaire en son sein et d’empêcher sa transmission à l’autre assemblée. Il sera donc utile de préciser dans les règlements respectifs des deux assemblées que le renvoi en commission ne peut être appliqué aux propositions de loi à vocation référendaire.
En conclusion, cela a été souligné, chacun a ici conscience que les chances – ou les risques ! – qu’un référendum puisse être organisé sur le fondement de l’article 11 sont limitées, voire extrêmement restreintes, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, dans la pratique, seul l’un des deux grands partis pourra en être à l’initiative. Ensuite, le nombre de 4, 5 millions de soutiens paraît difficile à atteindre, même avec les progrès de la communication électronique. Enfin et surtout, le référendum n’aura finalement lieu que si les assemblées et le Gouvernement le veulent bien et n’inscrivent pas la proposition de loi à l’ordre du jour des travaux du Parlement.
Pour autant, en tant que législateurs, nous sommes tenus de mettre en œuvre toutes les dispositions de la Constitution, ce que le gouvernement précédent s’était refusé à faire. C’est pourquoi, malgré les réserves qui viennent d’être énoncées dans cet hémicycle par mes collègues et par moi-même, le groupe socialiste apportera son soutien à ce dispositif.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique portant application de l'article 11 de la Constitution.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
Chapitre IER A
Dispositions relatives aux propositions de loi présentées en application de l’article 11 de la Constitution
Chapitre IER
Dispositions relatives au Conseil constitutionnel
L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel est ainsi modifiée :
1° Après le chapitre VI du titre II, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« De l’examen d’une proposition de loi déposée en application du troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution
« Art. 45-1 . – Lorsqu’une proposition de loi lui est transmise par le président d’une assemblée en vue du contrôle prévu au quatrième alinéa de l’article 11 de la Constitution, le Conseil constitutionnel en avise immédiatement le Président de la République, le Premier ministre et le président de l’autre assemblée.
« Art. 45-2 . – Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d’un mois à compter de la transmission de la proposition de loi :
« 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ;
« 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d’enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ;
« 3° Et qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.
« Art. 45-3 . – Le Conseil constitutionnel statue par une décision motivée, qui est publiée au Journal officiel.
« S’il déclare que la proposition de loi satisfait aux dispositions de l’article 45-2, la publication de sa décision est accompagnée de la publication du nombre de soutiens d’électeurs à recueillir.
« Art. 45-4 . – Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi.
« Il examine et tranche définitivement toutes les réclamations. Il peut être saisi par tout électeur durant la période de recueil des soutiens ou dans un délai de dix jours suivant sa clôture.
« Les réclamations sont examinées par une formation présidée par un des membres du Conseil constitutionnel et composée de deux autres membres désignés par le Conseil.
« Dans un délai de dix jours suivant la notification de la décision de la formation, l’auteur de la réclamation peut contester la décision devant le Conseil assemblé.
« Dans le cas où, saisi d’une contestation mentionnée à l’alinéa précédent ou saisi sur renvoi d’une formation, le Conseil constate l’existence d’irrégularités dans le déroulement des opérations, il lui appartient d’apprécier si, eu égard à la nature et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle.
« Art. 45-5 . – Le Conseil constitutionnel peut ordonner toute enquête et se faire communiquer tout document ayant trait aux opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi. Le ministre de l’intérieur communique au Conseil constitutionnel, à sa demande, la liste des soutiens d’électeurs recueillis.
« Le Conseil constitutionnel fait appel, pour l’exercice de ses fonctions, aux services compétents de l'État.
« Il peut désigner des rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'État et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. Les rapporteurs adjoints n'ont pas voix délibérative.
« Il peut désigner des délégués parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires, ainsi que des experts, afin de l'assister dans ses fonctions.
« Il peut commettre un de ses membres ou un délégué pour recevoir sous serment les déclarations des témoins ou pour diligenter sur place d’autres mesures d’instruction.
« Art. 45-6. – Le Conseil constitutionnel déclare si la proposition de loi a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Sa décision est publiée au Journal officiel. » ;
2° À la seconde phrase de l’article 56, la référence : « et 43 » est remplacée par les références : «, 43 et 45-5 ».
Chapitre II
Dispositions relatives au recueil des soutiens
Le ministre de l’intérieur met en œuvre, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, le recueil des soutiens apportés à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.
Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution.
Ce soutien est recueilli sous forme électronique.
Un soutien ne peut être retiré.
Les électeurs sont réputés consentir à l’enregistrement de leur soutien aux seules fins définies par la présente loi organique.
Des points d’accès à un service de communication au public en ligne permettant aux électeurs d’apporter leur soutien à la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution par voie électronique sont mis à leur disposition au moins dans la commune la plus peuplée de chaque canton ou au niveau d’une circonscription administrative équivalente et dans les consulats.
Pour l’application du premier alinéa, tout électeur peut, à sa demande, faire enregistrer électroniquement par un agent de la commune ou du consulat son soutien présenté sur papier.
Chapitre III
Dispositions relatives à la procédure référendaire
Si la proposition de loi n’a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées parlementaires dans un délai de six mois à compter de la publication au Journal officiel de la décision du Conseil constitutionnel déclarant qu’elle a obtenu le soutien d’au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, le Président de la République la soumet au référendum. Ce délai est suspendu entre deux sessions ordinaires.
Pour l’application du premier alinéa, en cas de rejet de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie, son président en avise le président de l’autre assemblée et lui transmet le texte initial de la proposition de loi.
Chapitre IV
(Suppression de la division et de l’intitulé maintenue)
(Suppressions maintenues)

Nous allons maintenant examiner l'amendement déposé par le Gouvernement.

L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 14
Après le mot :
formation
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel sur proposition de son président parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.
La parole est à M. le ministre délégué.
Cette disposition, qui a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale, tend à sécuriser juridiquement les travaux issus de la commission mixte paritaire.
La commission mixte paritaire a en effet souhaité la création de formations chargées du contrôle du recollement des signatures, présidées par un membre du Conseil constitutionnel et composées de deux autres membres désignés par cette même instance.
Tel qu’il est prévu, ce dispositif pourrait être de nature à entraîner une atteinte au principe constitutionnel d’impartialité, puisque les travaux de cette formation seront soumis à l’appréciation du Conseil constitutionnel. Or le membre du Conseil constitutionnel ayant participé aux travaux de la formation se retrouverait, comme on le dit dans le langage courant, à la fois juge et partie, puisqu’il aurait à se prononcer sur des travaux qu’il a lui-même menés.
Le Gouvernement souhaite lever cette difficulté, afin que le travail effectué depuis plusieurs années ne soit pas, in fine, remis en cause par une décision négative du Conseil constitutionnel lui-même.
C’est pourquoi, dans l’esprit de la commission mixte paritaire, il est prévu que ces formations – il pourrait en effet y en avoir plusieurs – seraient composées de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel sur proposition de son président, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires.
Comme je l’ai fait à l’Assemblée nationale, je précise, pour l’interprétation de nos débats, que ces membres honoraires sont ceux des juridictions administratives comme ceux des juridictions de l’ordre judiciaire.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu adresser cet amendement à la commission des lois dans des délais qui lui ont permis de se prononcer, ce dont je vous remercie.
Le Gouvernement a pointé une difficulté technique ou juridique, qui pourrait surgir dès lors qu’un membre du Conseil constitutionnel aurait successivement à statuer sur un objet et à être juge de sa propre décision. C'est la raison pour laquelle il est proposé ici un dispositif selon lequel les membres de la formation examinant les recours ou les observations formulées en première instance seraient trois magistrats.
Les trois magistrats sont désignés par le Conseil constitutionnel lui-même et, par conséquent, émanent de lui. Dès lors, le respect de la Constitution – principe qui a guidé les membres de la commission des lois du début à la fin de cette procédure –, est garanti. En effet, la Constitution prévoit que le Conseil constitutionnel, et lui seul, contrôle le processus.
Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.

Sur les articles 2 à 19, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par l'amendement du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant application de l'article 11 de la Constitution.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
Après le livre VI bis du code électoral, il est inséré un livre VI ter ainsi rédigé :
« LIVRE VI TER
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPÉRATIONS RÉFÉRENDAIRES
« TITRE I ER
« RECUEIL DES SOUTIENS À UNE PROPOSITION DE LOI PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 DE LA CONSTITUTION
« Chapitre I ER
« Financement des actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens
« Art. L. 558-37. – Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ne peuvent excéder 4 600 €.
« Tout don de plus de 150 € consenti à un parti ou groupement politique en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le parti ou groupement politique délivre un reçu pour chaque don.
« Le montant global des dons en espèces faits au parti ou groupement politique en vue du financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens ne peut excéder 20 % du total des fonds récoltés.
« L’ensemble des opérations financières conduites par un parti ou groupement en vue de la campagne de collecte de soutiens fait l’objet d’une comptabilité annexe et détaillée dans les comptes de ce parti ou groupement politique.
« À l’exception des partis ou groupements politiques, les personnes morales ne peuvent participer au financement d’actions tendant à favoriser ou défavoriser le recueil des soutiens à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution ni en consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en fournissant des biens, services ou autres avantages, directs ou indirects, à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.
« Aucun État étranger ou personne morale de droit étranger ne peut participer, directement ou indirectement, au financement de telles actions.
« La violation des six premiers alinéas du présent article est passible des peines prévues au II de l’article L. 113-1. »
L’article 4 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les trois premiers alinéas du présent article ne sont pas applicables à une proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution et transmise au Conseil constitutionnel dans les conditions prévues à l’article 45-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. »
Le livre VI ter du code électoral, tel qu’il résulte de l’article 1er A de la présente loi, est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« ORGANISATION DU RÉFÉRENDUM
« Chapitre I ER
« Dispositions générales
« Art. L. 558-44. – Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet ou la proposition de loi soumis au référendum, décide à la majorité des suffrages exprimés.
« Art. L. 558-45. – Il est mis à la disposition des électeurs deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l’un porte la réponse oui et l’autre la réponse non.
« Lorsque plusieurs référendums sont organisés le même jour, il est mis à disposition des électeurs un bulletin de vote imprimé sur papier blanc permettant de répondre à chaque question posée par la réponse oui ou non.
« Art. L. 558-46. – Sont applicables aux opérations référendaires régies par le présent titre :
« 1° Les chapitres Ier, II, V, VI et VII du titre Ier du livre Ier, à l’exception des articles L. 52-3, L. 55, L. 56, L. 57, L. 58, des deux derniers alinéas de l’article L. 65, de l’article L. 66, des deux derniers alinéas de l’article L. 68, des articles L. 85-1, L. 88-1, L. 95, des 1° à 5° du I de l’article L. 113-1 et du II du même article ;
« 2° Les articles L. 385, L. 386, L. 387, L. 389, L. 390-1 et L. 393 ;
« 3° Les articles L. 451, L. 477, L. 504 et L. 531.
« Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de lire : “parti” ou “groupement habilité à participer à la campagne” au lieu de : “candidat” ou “liste de candidats”.
« Chapitre II
« Recensement des votes
« Art. L. 558-47. – Dans chaque département, chaque collectivité d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, il est institué une commission de recensement siégeant au chef-lieu et comprenant trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d’appel ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le président du tribunal supérieur d’appel.
« Aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le président de la juridiction d’appel peut, si le nombre des magistrats du siège est insuffisant, désigner, sur proposition du représentant de l’État, des fonctionnaires en qualité de membres de la commission prévue au premier alinéa.
« Il est institué une commission de recensement siégeant à Paris et comprenant trois magistrats, dont son président, désigné par le premier président de la cour d’appel de Paris, compétente pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art. L. 558-48. – La commission de recensement est chargée :
« – de recenser les résultats constatés au niveau de chaque commune et, aux îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au niveau de la collectivité d’outre-mer ;
« – de trancher les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins et de procéder aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d’appréciation du Conseil constitutionnel.
« La commission prévue au dernier alinéa de l’article L. 558-47 exerce les missions mentionnées aux deux alinéas précédents pour les votes émis par les Français établis hors de France.
« Art. L. 558-49. – Au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit, la commission de recensement adresse au Conseil constitutionnel les résultats du recensement et le procès-verbal auquel sont joints, le cas échéant, les procès-verbaux portant mention des réclamations des électeurs.
« Le recensement général des votes est effectué par le Conseil constitutionnel. »

Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Personne ne demande la parole ?...
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire.
Le projet de loi est adopté définitivement.

Mes chers collègues, avant d’aborder le point suivant de l’ordre du jour, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix heures quarante-cinq, est reprise à onze heures cinq, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, poursuivre nos réformes en soutien à la croissance, rétablir les équilibres financiers de la nation, préparer l’avenir sans abaisser le niveau de nos ambitions sociales : tel est le cap fixé par le Président de la République, tel est l’objectif servi par le projet de loi de finances pour 2014 qui est soumis à votre examen.
Un projet de loi de finances est toujours un acte fondateur de l’action d’un gouvernement, quel qu’il soit. Il y a un an, mesdames, messieurs les sénateurs, nous vous présentions, avec les autres membres du Gouvernement, le premier budget de la gauche au pouvoir depuis dix ans, un budget tout entier tourné vers la défense de notre souveraineté financière.
La France luttait alors contre la récession dans une zone euro qui jouait sa survie. Nous commencions tout juste à mettre en place nos instruments de politique économique ; le pacte de compétitivité n’avait pas encore vu le jour ; la France entamait à peine son dialogue avec la Commission européenne sur ses cibles budgétaires et elle venait tout juste de prendre de premières mesures pour enrayer un déficit public qui avait atteint des niveaux inacceptables – il s’élevait à 5, 3 % du PIB en 2011 et aurait été de même ampleur en 2012 si nous n’avions pas agi.
Le budget que nous avions défendu alors était un budget conçu pour éviter à la France le scénario du pire, un budget de redressement pour permettre à notre pays de garder la maîtrise de son destin, face à des marchés financiers dont le risque de prédation ne pouvait être négligé.
Un an après, le chemin parcouru est considérable. La zone euro n’est plus en proie à des attaques spéculatives. Surtout, l’activité économique en France a changé de tendance. Avant l’embellie observée au printemps, c’est-à-dire avant le rebond plus fort qu’il n’était anticipé du deuxième trimestre, la France était sur une tendance de stagnation, de croissance nulle, il faut bien l’avouer.
Or, depuis le printemps, toutes les enquêtes, qu’elles émanent de l’INSEE, l’Institut national de la statistique et des études économiques, de la Banque de France ou des organisations internationales comme le FMI, le Fonds monétaire international, la Commission européenne ou l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques, suggèrent que nous sommes désormais sur une tendance d’environ 1 % de croissance en rythme annuel. Toutes ces institutions ont revu leurs prévisions de croissance à la hausse depuis l’été.
Le résultat du troisième trimestre, s’il a pu frapper les esprits, ne remet pas en cause ce diagnostic. Tout d’abord, il ne constitue pas une surprise, puisqu’il avait été anticipé par l’INSEE ; ensuite, le rebond de l’activité au quatrième trimestre est en marche – j’en veux notamment pour preuve l’évolution positive des ventes d’automobiles – ; enfin, l’amélioration de la tendance n’exclut pas des à-coups, un profil un peu heurté : il arrive qu’un moteur qui redémarre pétarade un peu.
Sourires.
Il faut du temps pour qu’une amélioration de la conjoncture se traduise concrètement dans le quotidien des Français, j’en suis bien conscient, mais cette embellie n’est pas une vue de l’esprit.
Notre scénario de reprise de croissance a été conforté par tous les instituts de conjoncture indépendants et les institutions internationales.
Le Haut Conseil des finances publiques, une institution que nous avons créée voilà un an avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs, a qualifié nos prévisions de croissance pour 2013 de « plausibles », puis de « réalistes ».
La Commission européenne, et j’en suis fier, vient elle aussi de valider notre scénario la semaine dernière : ses dernières prévisions s’établissent à 0, 2 % en 2013, 0, 9 % en 2014 et 1, 7 % en 2015 ; elles sont donc pleinement en ligne avec les nôtres et même légèrement plus optimistes pour 2013. La France est sur la voie du redressement, grâce à la politique que nous menons et grâce, surtout, au dynamisme et à la résilience des acteurs économiques.
Oui, nous voyons les premiers résultats de notre action. Et je ne veux pas apparaître ici comme un adepte de la méthode Coué, absurdement porté à l’autosatisfaction.
Dans son édition datée du 20 novembre dernier, un quotidien du soir titrait : « Moscovici et Benzema, match nul ». Mais c’était avant que la France ne l’emporte ! Après la victoire des Bleus au Stade de France, je trouve finalement cette comparaison pas si déshonorante…
Je connais aussi bien – je n’ose pas dire mieux – que quiconque les problèmes économiques du pays et les difficultés dont nous avons hérité. Je ne veux pas tomber dans la facilité, je sais tout ce que la France fait et tout ce qu’elle a encore à faire. Toutefois, à quoi sert-il de diffuser un pessimisme qui n’est pas de mise ? L’économie française va mieux ; elle doit aller encore mieux à l’avenir, et nous devons faire encore plus pour la compétitivité et la croissance.
Ce message de confiance dans le pays, nos compatriotes ont besoin de l’entendre de la part des formations politiques républicaines, qui ont l’ambition d’élever notre pays, sauf à nourrir des inquiétudes qui, nous le savons, profitent à d’autres.
La reprise est là, elle est réelle. Il est vrai aussi qu’elle est fragile, je ne le cache pas. Nous devons conforter et amplifier ce redressement, en restant résolument engagés dans la voie des réformes de croissance. Notre tâche n’est pas finie. Il faut poursuivre le travail de réforme.
C’est ce que je retiens de la dégradation récente de la note de la France par l’agence Standard & Poor’s. J’ai pointé les limitations, réelles, dont souffre à mes yeux cet exercice. Comme je l’ai souligné le jour même de la dégradation de la note de notre pays, l’analyse de cette agence me semble incomplète, et même approximative. D’autres aussi ont pris leurs distances avec ses conclusions, notamment le gouverneur de la Banque de France. Je tire toutefois de cet épisode deux convictions renouvelées.
Premièrement, l’économie française est forte, ce qui explique que les investisseurs aient continué à faire confiance imperturbablement à la France, que nos spreads n’aient pas même bougé d’un point de base et que l’écart avec l’Allemagne ne se soit pas non plus réduit.
Deuxièmement, il faut maintenir le cap de la crédibilité et de la force d’une politique de redressement.
Je pense au cap des réformes économiques, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes, mais aussi au cap du sérieux budgétaire et de l’équilibre structurel, que le projet de loi de finances pour 2014 vient confirmer. Ce sont des acquis que nous devons à tout prix préserver.
Le déficit public devrait ainsi s’établir cette année à 4, 1 % du PIB, au-delà, il est vrai, de la prévision initiale de 3, 7 %. Ce dépassement tient pour une très large part à l’impact de l’environnement économique et de la faible inflation sur les recettes fiscales, la TVA et l’impôt sur les sociétés – j’imagine que Bernard Cazeneuve reviendra sur ces points.
Toutefois, la dépense, elle, est maîtrisée, et l’effort structurel est extrêmement important – de 1, 7 point de PIB en 2013, après 1, 3 point en 2012. C’est aussi la reconnaissance de l’importance de cet effort structurel qui explique que la commission européenne, la semaine dernière, ait dans son avis validé sans réserve notre stratégie budgétaire.
Pour 2014, notre objectif de déficit nominal est de 3, 6 %, en cohérence avec nos engagements européens, et l’effort structurel représentera 0, 9 point de PIB.
Je reviens sur l’avis de la Commission européenne, qui a estimé que nous étions parfaitement en ligne avec nos engagements européens et avec la recommandation du Conseil du 21 juin dernier, à la différence de nombreux pays de l’Union européenne. La Commission reconnaît ainsi la réalité des efforts structurels que nous conduisons. Pour ma part, je m’en félicite.
Je tiens aussi à formuler une remarque importante sur l’évolution des déficits : mesdames, messieurs les sénateurs, il ne vous aura pas échappé que celle-ci va dans le bon sens. En 2011, le déficit s’établissait à 5, 3 % du produit intérieur brut ; en 2012, nous l’avons ramené à 4, 8 % ; en 2013, il sera à 4, 1 % et à 3, 6 % à la fin de 2014. Nous avons certes gagné deux ans, mais pas pour ne rien faire ; nous devons mettre à profit ces deux années pour redresser nos finances publiques et notre économie. Notre déficit passera en deçà des 3 % du PIB en 2015, avec un effort structurel qui devra être maintenu.
Nous réalisons cet effort de redressement des comptes tout en tendant vers la stabilité des prélèvements obligatoires pour 2014. Sur un effort de redressement budgétaire total de 18 milliards d’euros, 2 milliards d’euros proviendront en effet de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale et, surtout, 15 milliards d’euros proviendront d’économies de dépenses publiques par rapport à leur évolution spontanée – je précise au passage que tous les pays de l’Union européenne effectuent ce calcul de la même manière.
Nous avons fait le choix de réaliser, à court terme, des ajustements au moyen d’une hausse des prélèvements obligatoires. Contrairement à d’autres, nous n’avons aucune hostilité de principe à l’égard de l’impôt, qui incarne notamment le service public et le consentement citoyen. Néanmoins, nous pensons également que, dans un deuxième temps – nous y sommes ! –, c’est par des économies que doivent se réaliser les efforts.
Le sérieux budgétaire est donc un cap que nous tenons. Cependant, nous avons aussi choisi d’élaborer un projet de budget pour 2014 résolument favorable à l’offre productive, un budget de soutien déterminé à la compétitivité des entreprises et à l’investissement.
Comme le disait en 1953 Pierre Mendès-France, que l’on gagne toujours à relire, la priorité, c’est « d’accroître la masse des biens à répartir ». En effet, on ne peut redistribuer et répartir que ce que l’on a produit.
Il faut donc véritablement encourager la production, c’est-à-dire faire le choix de la création, de l’invention, de l’innovation. C’est faire le choix de produire, préalable indispensable à la répartition.
C’est un choix assumé par le Gouvernement : c’est la voie qui mène et mènera à un redressement durable de l’économie et de l’emploi. Ce n’est pas un choix qui sert les intérêts de quelques-uns, c’est un choix au service de tous les Français, car nous partageons tous le même objectif : l’emploi.
La création d’emplois de demain, c’est dans l’entreprise, avec les salariés, qu’elle aura lieu. C’est grâce à la croissance que les entreprises créeront et développeront ces emplois. C’est ce mouvement de croissance et d’emplois que nous voulons accélérer, avec le projet de loi de finances. Voilà ce qui fait la signature de ce budget, sa marque propre.
Monsieur Gorce, en tant que sénateur socialiste, vous aurez à cœur, j’en suis sûr, de soutenir à l’action du Gouvernement et de la majorité.
Évidemment, certaines réalités rendent notre tâche plus difficile. Notre pays ne dispose pas, contrairement à ce que certains pensent, de marge de manœuvre pour une relance keynésienne. C’est aussi le legs des précédents gouvernements. C’est donc plutôt vers eux que vous devriez vous tourner, monsieur Gorce.
De même, nous ne pouvons nier les difficultés de notre appareil productif et la perte de compétitivité mise en évidence par le rapport Gallois, qui constituent aujourd’hui une réelle menace. Toutefois, ayons confiance, dans la capacité de rebond de notre économie et dans notre propre capacité à l’aider à se redresser.
Pour stimuler cette reprise, nous avons d’abord décidé de poursuivre le rétablissement de la compétitivité de nos entreprises, en soutenant tous les leviers de l’investissement productif.
En effet, l’investissement productif, privé et public, c’est le moteur de la croissance.
Or cet investissement productif, convenons-en, reste aujourd’hui à la peine, même s’il a un peu mieux résisté depuis un an que dans le reste de la zone euro. C’est pourquoi nous avons choisi de concentrer sur lui nos efforts, avec une palette large de mesures en faveur de la compétitivité des entreprises.
Tout d’abord, l’année 2014 sera celle de la montée en charge du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE. Ce dispositif a permis de renverser la vapeur en termes de coût du travail, notamment par rapport à l’Allemagne. Nous voulons faire un effort de convergence avec ce pays.
Je suis élu d’un territoire où l’industrie automobile est puissante et je m’entretenais encore avec les constructeurs français de ce secteur il y a deux jours, lors d’un voyage en Israël où j’accompagnais le Président de la République. Nous constatons des difficultés de compétitivité ; nous devons les dépasser. Tel est l’objectif du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
Les premiers travaux d’évaluation montrent en effet que ce dispositif bénéficie à hauteur de 20 % à l’industrie, soit environ deux fois plus que la contribution de ce secteur au produit intérieur brut. Je parle là uniquement de l’impact direct du CICE sur le secteur manufacturier, mais il faut aussi compter sur l’impact indirect, ce que l’on appelle « l’effet de second tour », sous la forme d’une baisse du prix des consommations intermédiaires. Surtout, le CICE aura un effet incitatif dès 2013 ; d’après les premières évaluations, il aura sauvé ou contribué à créer 30 000 emplois.
C’est un choix fort : nous devons veiller à ce qu’il soit aussi un choix cohérent et lisible. C’est la raison pour laquelle l’effet favorable sur le coût du travail du CICE sera intégralement préservé en 2013 et en 2014. En effet, une politique économique exige de la constance, de la persistance, des efforts sur le temps long.
Rappelons-nous que l’Allemagne, présentée il y a dix ans comme « l’homme malade de l’Europe », possède aujourd’hui l’économie la plus puissante du continent. Elle a mis une décennie à se redresser. Je ne préconise pas les mêmes remèdes qu’en Allemagne.
Je ne suis ni pour les « mini-jobs » ni pour la précarité et je sais qu’il nous faut respecter notre modèle social. Cependant, des réformes ambitieuses, à la française, pour la compétitivité, doivent être poursuivies, et c’est ce que nous faisons.
Le deuxième volet sur lequel nous travaillons pour soutenir l’offre productive, c’est le soutien à la création d’entreprises et à l’entreprenariat. En effet, les créations d’entreprises aujourd’hui, ce sont les emplois de demain.
Ce soutien passe, dans le projet de loi de finances pour 2014, par une réforme de l’imposition des plus-values mobilières. Nous rééquilibrons ce dispositif, pour le rendre simple, lisible et pérenne, plus incitatif aussi.
Le projet de loi de finances comporte enfin plusieurs mesures de soutien à l’investissement et à l’innovation – c’est notre troisième volet. Il porte ainsi la réforme du plan d’épargne en actions, le PEA, et la création d’un PEA spécialement tourné vers les petites et moyennes entreprises. Celui-ci favorisera le financement en fonds propres de l’entreprise et garantira aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux entreprises de taille intermédiaire, les ETI, un accès plus aisé à l’épargne des particuliers.
Concrètement, le plafond du PEA sera relevé de 132 000 euros à 150 000 euros. Celui du PEA-PME, qui concernera les actions ou autres titres donnant accès au capital des PME et des entreprises de taille intermédiaire, et également les parts de fonds communs de placement sous certaines conditions, sera fixé à 75 000 euros.
Les PME innovantes seront dynamisées par la réforme du statut de jeune entreprise innovante. Tout cela s’inscrit dans un vaste mouvement de réforme du financement de l’économie, destiné à mieux orienter l’épargne abondante des ménages, vers l’investissement des entreprises, c’est-à-dire vers l’économie réelle. C’est également ce que nous ferons dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, à travers la réforme de l’assurance vie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le budget qui est soumis à votre examen prend le parti de faire du levier de l’investissement et de la compétitivité des entreprises, le moteur de la croissance de demain. Ce n’est pas exclusif d’une démarche déterminée pour ramener à l’emploi ceux qui en sont les plus éloignés, au contraire. Il est logique que notre politique structurelle s’accompagne d’un soutien conjoncturel lorsque l’économie se redresse mais continue de manquer de demande privée.
Je l’ai dit en de nombreuses occasions, comme Michel Sapin, mon collègue ministre du travail et de l’emploi : nous n’avons pas l’emploi aidé honteux. C’est conforme à nos principes dans une période économique qui reste difficile.
Le projet de loi de finances pour 2014 déploie donc avec vigueur nos politiques volontaristes en faveur de l’emploi. Il finance la création d’ici à la fin de l’année 2014 de 150 000 emplois d’avenir, qui concernent les jeunes de 16 à 25 ans, la montée en charge des contrats de génération, la consolidation de 340 000 contrats aidés non marchands et la création d’un nouveau contingent de 2 000 postes chez Pôle emploi, après les 2 000 de 2013, car nous avons besoin d’un service public de l’emploi disponible, efficace et qui accompagne le combat pour l’emploi.
En effet, le redémarrage de l’emploi est la condition essentielle pour redresser le pouvoir d’achat. Sur ce point, un facteur non négligeable joue positivement, et je vous invite à le prendre en considération, c’est celui de la baisse de l’inflation. Il faut d’ailleurs veiller à ce que cette évolution ne tourne pas à la déflation. C’est le sens des mesures prises par la Banque centrale européenne, qui a abaissé son taux de refinancement de 0, 25 point la semaine dernière.
Dans ce projet de budget, de nombreuses mesures vont permettre de soutenir le pouvoir d’achat des ménages – en particulier des classes moyennes et des plus modestes. Je veux prendre le temps ici de revenir sur certaines de ses mesures, avant que Bernard Cazeneuve ne complète mes propos, avec sa maestria habituelle et sa connaissance du budget pour 2014.
Si je devais résumer notre action en faveur du pouvoir d’achat des Français dans ce budget, je dirais que celle-ci se joue sur quatre fronts à la fois.
J’ai déjà évoqué le front de l’emploi, qui est absolument capital.
Ensuite, nous agissons sur les dépenses contraintes, qui pèsent de plus en plus sur le pouvoir d’achat des Français, à commencer par le logement et l’énergie. Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous renvoie ici à nos mesures sur l’encadrement des loyers dans les zones tendues ou sur le plafonnement des frais bancaires, voté par le Sénat dans le cadre de la loi de réforme bancaire. Je peux également citer les mesures sur l’encadrement des tarifs sociaux de l’électricité et du gaz, qui devraient bénéficier à 4 millions de foyers – c’est notre objectif – contre environ 1, 3 million auparavant.
Le troisième front concerne la maîtrise des prélèvements obligatoires. C’est le refus d’une hausse généralisée d’impôts, au-delà de la réforme des taux de TVA déjà votée à la fin de l’année 2012.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Vous devriez écouter, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, chaque mot compte !
Si nous n’étions pas revenus sur la hausse du taux de TVA de 19, 6 % à 21, 2 % que vous, membres de l’ancienne majorité, aviez votée, les ménages acquitteraient 12 milliards d’euros supplémentaires. §
Revendiquez-la puisque c’est cela votre politique. Dites-le haut et fort plutôt que de vous opposer à une mesure correctrice de vos propres turpitudes !

Monsieur le ministre, n’exagérez pas : parler de turpitudes, c’est franchement excessif !
En parallèle, le barème de l’impôt sur le revenu sera réindexé sur le coût de la vie, après deux années de gel décidées par le précédent gouvernement, qui ont été profondément douloureuses pour beaucoup de Français.
Enfin, le quatrième front pour maintenir le pouvoir d’achat passe par une plus grande progressivité de l’impôt. Les inégalités ont progressé aux deux extrémités des niveaux de vie en 2010. En 2011, la fracture s’est aggravée : les niveaux de vie ont augmenté pour la moitié la plus aisée de la population et reculé pour la moitié la plus modeste. Il faut répondre à ce problème.
Comme disait le philosophe italien Norberto Bobbio, « l’étoile polaire de l’égalité » est le trait distinctif entre la droite et la gauche, j’en suis convaincu. C’est le critère qui résiste à l’usure du temps. C’est le sens des suppressions de plusieurs niches fiscales que nous avons proposées et sur lesquelles un premier débat a eu lieu lors de la discussion à l’Assemblée nationale.
C’est donc un projet de grande ampleur, que celui de l’évolution de notre fiscalité, auquel Bernard Cazeneuve et moi-même prendrons part et que nous piloterons dans nos domaines respectifs.
Enfin, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi de finances est aussi et avant tout un outil pour préparer l’avenir. Cela se manifeste de plusieurs façons dans les textes financiers de l’automne.
Tout d’abord, le cap de l’équilibre budgétaire structurel en fin de mandat est maintenu, car le désendettement est une nécessité pour notre souveraineté.
Ensuite, la compétitivité suppose de construire un État plus agile, meilleur stratège, en soutien de la compétitivité de notre économie. C’est pour cela qu’il faut moderniser l’action publique. Sur ce point, notre démarche est résolument différente de celle qui prévalait jusqu’à présent. Il s’agira non pas de procéder par coups de rabot, mais de mener une politique d’évaluation, qui doit accompagner de vraies modernisations et dégager de vraies économies – Bernard Cazeneuve et moi-même y tenons beaucoup. Nous avons besoin de cette agilité !
Préparer l’avenir, c’est aussi consolider notre modèle social, dont les déséquilibres financiers menacent la pérennité. C’est le sens des réformes de la politique familiale et des retraites de cet automne.
Enfin, le projet de budget consacre le lancement du nouveau programme d’investissements d’avenir, de 12 milliards d’euros, annoncé en juillet dernier par le Premier ministre. Plus de la moitié de ce programme sera consacrée à des investissements directs ou indirects pour la transition écologique. Ces derniers seront soigneusement choisis, avec pour objectif de renforcer la croissance potentielle de la France, ce qui passe bien sûr d’abord par l’innovation.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, les quelques remarques dont je souhaitais vous faire part. Avec Bernard Cazeneuve, nous avons conçu ce projet de loi de finances comme un levier pour le retour de la croissance en France.
Cette croissance s’affirmera par l’affermissement de la dynamique de l’investissement, donc par une action déterminée en faveur de la compétitivité des entreprises. Elle passe aussi par l’amélioration de la situation économique des Français. Ces deux objectifs, en réalité, se renforcent mutuellement. N’opposons pas ménages et entreprises, soutien à l’investissement et défense du pouvoir d’achat. Au contraire, ils se confortent !
Une bonne politique économique, soucieuse du redressement productif et financier de la France, doit encourager l’offre, et je l’assume.
M. Pierre Moscovici, ministre. Elle doit aussi stimuler la demande et restaurer la confiance de tous les acteurs économiques dans la justice fiscale.
Exclamations sur les travées de l'UMP.
Notre budget de l’an II, en quelque sorte, est tout entier irrigué par cette ambition : conforter la croissance par la confiance et la confiance par la croissance, afin de lutter contre le chômage. Nous tiendrons ce cap.
Pour ma part, j’ai la conviction que la France tient ce cap, et qu’il est bon. Je sais les atouts de notre économie. Je n’accepte pas les vociférations ou la représentation négative, systématiquement pessimiste, noire et sombre que certains en donnent.
Il se trouve que, dans mes fonctions, je suis souvent appelé à participer à des réunions internationales. Demain encore, ne vous en déplaise, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, je représenterai la France à une réunion de l’Eurogroupe, au cours de laquelle la Commission européenne et nos partenaires valideront notre stratégie budgétaire.
Votre vision systématiquement pessimiste et négative est de nature à nourrir les inquiétudes réelles – nous ne les sous-estimons pas – des Français.
Notre tâche, la mienne, celle du ministre du budget, celle du Gouvernement, c’est non pas de dénigrer, comme vous le faites, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition
Protestations sur les travées de l'UMP.
M. Pierre Moscovici, ministre. Ne vous en déplaise, c’est le sens et l’ambition du projet de loi de finances que nous vous présentons. Nous comptons fortement sur le soutien de la majorité pour tenir ce cap et approuver cette politique.
Applaudissementssur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE. –

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Au moins, un ministre du budget, on sait à quoi ça sert !
Sourires sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, par souci de complémentarité avec l’intervention de Pierre Moscovici, j’insisterai sur quelques aspects du projet de loi de finances pour 2014, afin que nous puissions, dans les heures et les jours qui viennent, étudier au fond l’ensemble des questions que vous pouvez légitimement vous poser au sujet de nos orientations budgétaires. Je forme le vœu que nous ayons un débat à la fois apaisé, approfondi et de qualité.
Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement le président de la commission des finances, Philippe Marini, et le rapporteur général de la commission des finances, François Marc, de la qualité du travail qu’ils ont accompli dans la préparation de nos débats.
Il est important, pour Pierre Moscovici et moi-même, de venir devant les commissions parlementaires aussi souvent qu’elles le souhaitent, afin de rendre compte de la manière dont nous concevons et exécutons les lois de finances, dans un contexte de redressement des comptes publics. Ce travail préparatoire est important. Il contribue amplement à l’amendement de nos textes et à la qualité de nos débats. Je voudrais rendre hommage à tous les sénateurs et à toutes les sénatrices qui ont travaillé à la préparation de nos débats.
Je voudrais également profiter de cet échange pour rendre un hommage appuyé aux fonctionnaires de Bercy. Ils ont le sens de l’État et du service public.
Ils sont engagés à nos côtés dans le redressement des comptes publics. Il est injuste de les critiquer en les présentant comme les membres d’une technocratie très éloignée des préoccupations de nos compatriotes.
Les fonctionnaires de Bercy contribuent à l’élaboration de la décision politique. Si la décision n’est pas bonne – cela peut arriver, car nul n’est à l’abri de commettre des erreurs –, il faut en imputer la responsabilité non aux fonctionnaires, mais au ministre.
Les ministres sont là pour protéger leur administration. Celle-ci n’est pas comptable de toutes les difficultés, de tous les maux auxquels un pays peut être confronté.
Ce principe est consubstantiel à la République. Les fonctionnaires appliquent les orientations que le pouvoir politique souhaite faire prévaloir. Ils le font en tout temps avec beaucoup de loyauté, de compétence et de sens des responsabilités. Au moment où nous abordons les questions budgétaires, qui sont des questions sérieuses, il est important de rendre à ces fonctionnaires l’hommage qui leur est dû. Je veux dire très clairement que nous travaillons en confiance avec nos collaborateurs de Bercy et je veux saluer la qualité de leur travail, leur ardeur à la tâche et leur profond sens de l’État.
Je voudrais également profiter de ce débat pour insister sur quelques points, en donnant des chiffres, parce que, finalement, la seule chose qui vaut en matière budgétaire, c’est la réalité des chiffres.
Je voudrais tout d'abord insister sur l’évolution des déficits et le redressement de nos comptes.
Je voudrais ensuite souligner l’effort d’économies en dépenses que représente ce budget.
Je voudrais également insister sur les mesures que ce budget contient pour le redressement de notre économie et l’amélioration du pouvoir d'achat de nos compatriotes ; il s’agit d’une question importante, dans laquelle j’inclus celle de l’emploi.
Je voudrais enfin insister sur quelques questions qui nous tiennent à cœur, à Pierre Moscovici et à moi-même, et sur lesquelles nous sommes mobilisés ; en témoignent ce projet de loi de finances, mais également le projet de loi de finances rectificative et le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Je veux parler de l’action résolue que nous avons engagée ensemble pour lutter contre la fraude fiscale et récupérer ainsi les recettes qu’auraient dû verser ceux qui ont décidé de ne pas payer leurs impôts. En effet, chaque euro récupéré sur ceux qui fraudent est un euro de moins prélevé sur ceux qui, depuis longtemps, s’acquittent de leurs devoirs de citoyens.
Commençons par les déficits. Examinons la séquence des chiffres, puisque ce sont ces derniers qui indiquent la trajectoire. Le reste, c’est le tohu-bohu, le vacarme qui peut parfois occuper tout l’espace public sans que la bonne foi soit nécessairement convoquée. Pour ma part, je m’en tiens à la réalité des chiffres.
Lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, le déficit nominal était de 5, 3 % du produit intérieur brut. En 2012, il s’est établi à 4, 8 %. Il est vrai que nous nous étions fixé un objectif de 4, 5 %, mais tous ceux qui, au sein de la commission des finances, ont examiné de près les raisons de ce décalage savent qu’il s’explique essentiellement par la nécessité de prendre en compte la situation de la banque Dexia et d’intégrer des crédits de paiement qui n’avaient pas été alloués à l’Union européenne depuis novembre 2010, afin d’éviter que cette dernière ne se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses engagements au titre des perspectives financières 2007-2013.
Si l’on ôte ces deux éléments extérieurs, nous sommes très près de l’objectif que nous nous étions fixé. Pour 2013, notre objectif est de ramener le déficit à 4, 1 % ; je reviendrai tout à l'heure sur l’évolution des recettes et la manière dont nous tenons la dépense. Enfin, le projet de loi de finances pour 2014 prévoit un déficit de 3, 6 %.
En dépit de ce qu’il m’arrive souvent d’entendre dire, ces chiffres sont incontestables. On les trouve dans les rapports que vous avez pu étudier. Les déficits ne dérapent pas !
Depuis que nous sommes en situation de responsabilité, nous menons une stratégie continue de réduction des déficits. Non seulement cette dernière, qui donne un sens à la trajectoire des finances publiques, est en cours, mais, en outre, nous avons réussi à atteindre cet objectif en faisant des efforts structurels que la Commission européenne comme le Haut Conseil des finances publiques saluent.
Je veux donner les chiffres précis : 1, 3 % en 2012, 1, 7 % en 2013 et 1 % en 2014. Si la Commission européenne, dans le cadre du semestre européen et du programme de stabilité au sein duquel s’inscrivent nos engagements, reconnaît que la trajectoire est tenue, c’est parce qu’elle sait que les chiffres d’efforts structurels que je viens de vous donner correspondent à ce que nous faisons et nous permettront d’atteindre les engagements que nous avons pris. Il est important que notre crédibilité soit préservée et réaffirmée à tout moment.
Si nous voulons retrouver le chemin de la croissance, il faut que nous accomplissions cet effort d’assainissement de nos comptes publics. De la même manière, nous n’avons aucune chance d’atteindre l’objectif d’assainissement de nos comptes publics si nous ne mettons pas tout en œuvre pour retrouver le chemin de la croissance.
Notre effort de réduction des déficits publics se traduit également par la maîtrise des comptes sociaux. Je rappelle que, en 2010, alors même que le taux de croissance était légèrement supérieur à 1, 5 %, le déficit des comptes sociaux – celui du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse, le FSV – s’est dégradé d’environ 4, 5 milliards d'euros, pour atteindre 28 milliards d'euros. En 2011, le déficit était encore de 20, 8 milliards d'euros.
Si nous n’avions rien fait lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, si nous n’avions pas présenté de projet de loi de finances rectificative pour 2012, le déficit aurait sans doute dépassé 25 milliards d'euros. Grâce aux dispositions que nous avons prises, il s’est établi à 17, 5 milliards d'euros en 2012. En 2013, il sera de 16, 2 milliards d'euros, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 prévoit qu’il sera de 12, 8 milliards d'euros l’an prochain.
Nous sommes donc dans une séquence très affirmée de diminution des déficits des comptes sociaux. En l’espace de dix-huit mois, nous aurons réduit ces déficits de 8 milliards d'euros. Si nous maintenons cette tendance, le déficit du régime général et du FSV s’établira à 4 milliards d'euros en 2017. En cinq ans, nous aurons ainsi divisé par plus de cinq le déficit des comptes sociaux.
Voilà les chiffres. On peut ensuite débattre à l’infini, mais ils parlent d’eux-mêmes. Je veux dire au Sénat et, à travers lui, aux Français, que les efforts accomplis, dont il faut reconnaître qu’ils ont parfois été lourds, aboutissent à la réduction des déficits nominaux et des déficits des comptes sociaux, qui s’étaient envolés de manière significative au cours des dernières années. Certes, il y a eu la crise, mais le déficit structurel avait lui aussi augmenté entre 2008 et 2011. La crise n’était donc pas le seul élément d’augmentation des déficits et de dégradation de nos comptes. Les rapports du Haut Conseil des finances publiques en témoignent.
Le deuxième sujet sur lequel je voudrais insister, c’est la dépense. Ma conviction profonde est qu’il n’est pas possible – j’insiste sur ce point – de préserver nos services publics et notre modèle social, qui sont le patrimoine de ceux qui n’en ont pas, sans maîtriser la dépense publique.
Le ministère du budget n’est pas le ministère du prélèvement par l’impôt du patrimoine de ceux qui en ont un ; il est, et il doit être avant tout, a fortiori dans un contexte de crise, le ministère de la préservation du patrimoine de ceux qui n’en ont pas, c'est-à-dire des services publics et de la protection sociale.
Si nous sommes attachés aux services publics et à la protection sociale – au modèle social français, qui est souvent évoqué par le Premier ministre –, notre devoir est de faire en sorte que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne, et même qu’il ne reste que la bonne, c'est-à-dire que chaque euro dépensé soit un euro utile. C’est le moyen de préserver le modèle social français et les services publics à la française, qui, je le répète, sont le patrimoine des Français les plus modestes et les plus exposés au tumulte de la crise.
La volonté qu’a le Gouvernement de réduire les déficits ne traduit pas une orientation « austéritaire », comme certains se plaisent à la qualifier, qui serait suivie au détriment des services publics ou de la protection sociale. Non ! Si nous voulons que la mauvaise dépense publique ne chasse pas la bonne, c’est en raison de notre attachement viscéral au modèle social français. Nous avons en effet la conviction qu’il n’est pas possible d’assurer la soutenabilité de ce modèle si nous ne maîtrisons pas la dépense publique.
Nous devons réaliser des économies. Ces économies, nous les faisons avec discernement. Nous économisons 9 milliards d'euros sur l’État et 6 milliards d'euros sur la sphère sociale.
Les 9 milliards d'euros d’économies sur l’État absorbent le rythme tendanciel d’augmentation de la dépense publique, soit environ 7, 5 milliards d'euros. Cela signifie que les dépenses de l’État diminuent de 1, 5 milliard d'euros.
Nous économisons également 6 milliards d'euros sur la protection sociale.
Ces économies sont mesurées avec les mêmes instruments qui servaient à mesurer les efforts des précédents gouvernements. Nous n’avons pas changé les instruments de mesure.
Les instruments de mesure sont les mêmes qu’auparavant. En effet, il n’y a aucune raison pour que les efforts de ce gouvernement ne soient pas jugés d’après les mêmes critères que ceux des gouvernements précédents. La Cour des comptes et la Commission européenne ont, à cet égard, défini des critères qui s’appliquent au gouvernement actuel comme ils s’appliquaient au précédent.
Du reste, dans un récent rapport, la Commission a confirmé que les efforts que nous accomplissons au titre des réductions de dépenses représentent bien 0, 7 % du PIB : elle souligne ainsi que ce sont de véritables économies. Je le répète, elle nous évalue comme elle a évalué les précédents gouvernements.
Ce constat étant établi, comment se répartissent ces économies ? Où sont-elles réalisées ? J’en dirai un mot.
Parmi les 9 milliards d’euros d’économies réalisées par l’État, 2, 6 milliards d’euros sont assumés par les dépenses de fonctionnement des ministères, grâce, notamment, à la maîtrise de l’évolution des rémunérations des fonctionnaires. Il faut rendre hommage à l’effort que ces derniers consentent pour contribuer au redressement de nos comptes publics. Le gel du point d’indice est un effort qui leur est demandé, il ne faut pas le contester.
Les fonctionnaires sont parfois stigmatisés, voire mis en cause parce qu’ils coûteraient trop cher, parce qu’ils seraient, en tant que tels, à l’origine de dépenses que nous ne serions pas en mesure de maîtriser. C’est faux ! Ils contribuent à l’effort général.
Au-delà du gel du point d’indice, je songe à la division par deux des mesures catégorielles, ou encore à l’évolution des effectifs de la fonction publique. Contrairement à ce que l’on peut entendre ici ou là, le nombre de postes n’augmente pas de manière non maîtrisée, il diminue ! La baisse représente 1 373 fonctionnaires cette année par rapport à l’an passé. Elle résulte non pas de coups de rabot désorganisant des services tout entiers, mais d’une véritable modernisation de l’administration. Ce travail permet de dégager des effectifs là où nous menons des efforts de numérisation et de dématérialisation.
À ce titre, je citerai l’exemple de deux ministères.
Le ministère de la justice s’attelle à la modification de ses circuits comptables et à la mise en place d’une plateforme judiciaire d’entraide. Ces éléments concourent à l’effort général de modernisation. Sans que la justice soit en aucun cas affectée dans sa capacité à remplir ses missions de service public, 45 millions d’euros seront ainsi économisés.
De même, à Bercy, ce sont la télédéclaration ou encore la numérisation de l’activité du ministère qui permettent de dégager plus de 120 millions d’euros d’économies.
Après les ministères, j’en viens aux collectivités territoriales et aux opérateurs de l’État, qui permettent de réaliser 3, 3 milliards d’euros d’économies. Les opérateurs ont vu leur budget augmenter de 15 % au cours du précédent quinquennat. Leurs dépenses de personnel, en particulier, ont bondi de 6 %. Pour notre part, grâce à un effort de rationalisation, de regroupement et de mutualisation, nous réduisons leurs effectifs. En outre, dans le budget qui vous est présenté aujourd’hui, mesdames, messieurs les sénateurs, leurs dépenses générales diminuent de 4 %. D’aucuns se demandent où sont les économies. J’en donne là le détail.
Dans le cadre de la MAP, la modernisation de l’action publique, nous allons poursuivre ce travail de rationalisation de l’action des opérateurs de l’État. Par ailleurs, nous réalisons un effort considérable de maîtrise des taxes affectées dont ces acteurs bénéficient. Je songe notamment aux décisions que nous avons prises au sujet des organismes consulaires ou des agences de l’eau. Nonobstant les débats qu’elle a pu susciter, la maîtrise des taxes affectées représente 300 millions d’euros d’économies.
Enfin, nous rationalisons également notre politique d’intervention : ce sont encore 3 milliards d’euros sur des sujets très divers, qu’il s’agisse de la remise en cause d’un certain nombre de grands projets mal maîtrisés au titre des investissements ou dont le fonctionnement indu se serait révélé coûteux pour l’État, de la redéfinition de notre relation avec le stade de France, qui suscitera une économie de près de 16 millions d’euros, ou encore de la remise à plat du financement de l’Agence de financement des infrastructures de transport, l’AFIT. Dans ce domaine, aucune dépense annoncée ne doit rester sans financement. A contrario, nous devons garantir une véritable déclinaison pluriannuelle du financement des infrastructures de transports.
Monsieur le président de la commission, au sujet de la taxe poids lourds, si nous avons placé un milliard d’euros supplémentaires en réserve cette année, c’est précisément pour faire face à toutes les hypothèses et pour assurer la soutenabilité du schéma national des infrastructures de transport, le SNIT.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Nous étendons donc bien notre stratégie aux interventions de l’État, sans pour autant remettre en cause les grands investissements dont notre pays a besoin pour se moderniser et renouer avec la croissance. Les comptes sont sérieusement tenus.
La protection sociale contribue quant à elle à cet effort à hauteur de 6 milliards d’euros. L’an passé, nous avons exécuté 900 millions d’euros sous la norme des dépenses de l’assurance maladie. Cette année, nous sommes à 500 millions d’euros sous la norme.
En d’autres termes, après avoir progressé en moyenne de 4 % par an au cours des sept dernières années, les dépenses d’assurance maladie n’augmentent plus que de 2, 4 % cette année. Nous sommes donc bel et bien dans la maîtrise. En 2014, cette méthode permettra de dégager 3 milliards d’euros d’économies, sans déremboursements ou franchises nouvelles qui priveraient les Français de l’accès aux soins. En effet, l’hôpital doit garantir l’égalité d’accès aux soins pour tous les Français.
Au titre des régimes de retraite, l’économie s’élève à 2 milliards d’euros, soit 1 milliard d’euros résultant de la négociation entre les partenaires sociaux au titre du régime des retraites complémentaires AGIRC – Association générale des institutions de retraite des cadres – ou ARRCO – Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés –, c'est-à-dire près de 1 milliard d’euros garantis par la dernière réforme, différant l’indexation de ces retraites au mois d’octobre.
Dans ce domaine aussi, par la numérisation et la dématérialisation, nous modernisons la gestion des conventions d’objectifs et de gestion des caisses de sécurité sociale. Ce chantier représente 500 millions d’euros d’économies. Et là non plus, le modèle social français n’est pas remis en cause !
À tous ceux qui se demandent si les économies existent et, dans l’affirmative, où elles sont réalisées, j’en donne le montant et la nature ! Par ailleurs, je rappelle que ces 15 milliards d’euros d’économies, qui permettent d’absorber la hausse tendancielle de la dépense publique, et même davantage, doivent être rapportés aux 10 milliards d’euros dégagés par la révision générale des politiques publiques.
Ces 10 milliards d’euros ont été économisés en l’espace de trois ans, entre 2010 et 2013. Pour notre part, nous proposons, via ce seul budget, 15 milliards d’euros de réductions de dépenses en un an. Qui plus est, je le répète, nous ne travaillons pas au rabot, avec brutalité. À l’inverse, nous sommes mus par la volonté de moderniser l’administration publique. C’est ainsi que nous dégageons les économies dont nous avons besoin pour équilibrer nos budgets.
À ce titre, je précise que ces 80 % d’économies composant le budget pour 2014 doivent être suivies par un ajustement exclusif des prochains budgets via la réduction des dépenses. Le niveau des prélèvements obligatoires ne permet pas de solliciter de nouveau les impôts, comme le firent, par le passé, tous les gouvernements confondus.
M. Bernard Cazeneuve, ministre délégué. Non, monsieur Reichardt. Je n’avais pas l’intention de citer ces chiffres, craignant d’être indélicat, mais puisque vous m’y invitez, je vais le faire !
Souriressur les travées du groupe socialiste et du RDSE.
En 2011, 20 milliards d’euros de prélèvements ; en 2012, 21 milliards d’euros, dont 13 milliards d’euros imputables à l’ancien gouvernement et 8 milliards d’euros imputables au nouveau ; en 2013, le même montant. Cette année, l’augmentation des prélèvements obligatoires s’élève à 3 milliards d’euros.
De surcroît, si l’on neutralise les 2 milliards d’euros dégagés par la lutte contre la fraude fiscale, ce montant s’établit à 1 milliard d’euros.
Les prélèvements obligatoires augmentaient, naguère, de 0, 5 % par an en moyenne. Dans le cadre du programme de stabilité, nous avons réduit ce taux à 0, 3 %. Cette année, nous avons décidé de le porter à 0, 15 %. Et si, là encore, on neutralise l’effet de la lutte contre la fraude fiscale, on obtient une progression de 0, 05 %. Voilà la réalité en matière de prélèvements obligatoires cette année !
Mesdames, messieurs les sénateurs, ces chiffres sont incontestables. Ils doivent être rendus publics. Au surplus, je m’engage devant vous à ce que le budget présenté l’an prochain par le Gouvernement au Sénat et à l’Assemblée nationale comporte 0 % d’augmentation des prélèvements obligatoires et 100 % de réduction des dépenses.
J’en profite pour souligner que la réforme fiscale a été engagée dès la première année du quinquennat de François Hollande, au travers de la « barèmisation » des revenus du capital. Ces derniers sont désormais taxés au même niveau que les revenus du travail. S’y sont ajoutées les réformes de l’impôt sur la fortune et de l’impôt sur les successions. Cette année, s’y adjoignent la réindexation du barème de l’impôt sur le revenu, la mise en place d’une décote et l’augmentation du revenu fiscal de référence, sans compter notre volonté d’engager la réforme de la fiscalité des entreprises.
La réforme fiscale n’est pas le grand soir fiscal ! C’est une méthode que le Premier ministre a appelée de ses vœux, qui est fondée sur la concertation et qui correspond un engagement de campagne du Président de la République. Loi de finances après loi de finances, nous devons garantir, avec méthode, dans la concertation et dans la maîtrise, la modernisation de notre fiscalité. Nous devons recourir non seulement à l’impôt, mais aussi aux réductions de dépenses pour ajuster les budgets de demain.
Cette modernisation, cette exigence de la réforme fiscale que le Premier ministre vient de rappeler répondent à des objectifs clairs.
Premièrement, la simplification fiscale doit être assurée, notamment pour ce qui concerne l’investissement des entreprises. En effet, elle est source de sécurité pour les entrepreneurs, à l’heure où nous devons renouer avec la croissance.
Deuxièmement, il faut garantir la stabilité. En effet, nous voyons à quel point l’instabilité fiscale peut se révéler dissuasive pour les investissements.
Or c’est d’eux que découle la croissance, que nous devons stimuler. Aujourd’hui, nous devons faire de la fiscalité un instrument du retour de la croissance et de l’emploi.
Troisièmement, et enfin, pour ce qui concerne directement les Français, il faut faire en sorte que la réforme fiscale soit un vecteur de justice. De fait, le consentement à l’impôt, qui, dans la République, doit être plus fort que toutes les tentations de poujadisme fiscal, …
… doit reposer sur deux idées simples. D’une part, la justice fiscale passe par un impôt plus redistributif.
De l’autre – il faut le rappeler sans cesse –, s’il y a des impôts, c’est parce qu’il y a des écoles avec des enseignants, des hôpitaux avec des infirmières, des tribunaux avec des juges, sans oublier les policiers, qui, dans nos rues, veillent à notre sécurité.
Le consentement à l’impôt, c’est une manière de témoigner, dans la République, l’attachement aux services publics, l’importance de l’accès de tous à la connaissance, à la sécurité et à la justice. Le consentement à l’impôt est consubstantiel à la République, car la fiscalité est garante de la qualité des services publics et de leur montée en gamme !
Tel est le lien entre la réforme fiscale et la volonté de réduire les dépenses, de maîtriser la dépense publique et de renforcer constamment le consentement à l’impôt, dont certains voudraient détourner le pays, quitte à le faire basculer vers des valeurs qui ne sont pas celles de la République.
Certes, monsieur le sénateur, il y a du travail, mais vous allez nous aider dans ce chantier.
En effet, quand il y a du travail à accomplir, mieux vaut le faire ensemble plutôt que de chercher partout la division, la confrontation, les conflits et les polémiques qui n’ont pas lieu d’être.
Voilà ce que je souhaitais dire au sujet des économies, des services publics et de la réforme fiscale. J’évoquerai à présent les mesures du présent projet de loi de finances en faveur du pouvoir d’achat et en soutien aux entreprises.
La question du pouvoir d’achat est au cœur de ce budget. Je l’ai dit aux parlementaires de toutes sensibilités politiques, …
… qui s’interrogent sur ce sujet légitimement – non parce qu’il y aurait là matière à s’inquiéter, mais parce que cette question est toujours pertinente.
Les mesures que nous avons prises dans ce domaine sont fortes, …
… à commencer par la réindexation du barème de l’impôt sur le revenu. Son gel, engagé en 2011, était très injuste. Il a conduit des Français à payer cette contribution alors qu’ils n’y avaient pas vocation, ne figurant pas parmi les plus riches.
S’y ajoute l’augmentation du revenu fiscal de référence et de la décote, destinée à corriger l’effet du gel de la demi-part des veufs et des veuves. Cette mesure avait conduit nombre de nos concitoyens, après avoir travaillé toute leur vie, à payer davantage au titre de la taxe d’habitation, de la CSG ou de la redevance audiovisuelle, alors qu’ils n’y avaient pas vocation.
Ces trois dispositions sont en faveur du pouvoir d’achat. Elles sont destinées à corriger des effets qui, hier, ont pu créer des injustices, en assujettissant des Français à tel ou tel impôt alors que telle n’était pas leur vocation.
Au demeurant, je pourrais citer d’autres exemples : l’augmentation du RSA à hauteur de 2 % au-dessus de l’inflation ; la mise en place des tarifs sociaux de l’électricité, afin que la facture énergétique ne pèse pas aussi lourdement sur les revenus des Français, cet enjeu figurant au cœur du pouvoir d’achat ; la création de 55 000 bourses supplémentaires, pour que les enfants de tous les Français, s’ils souhaitent accomplir des études, aient accès à l’université même si leurs parents n’ont pas les moyens de financer leur scolarité.
Je pourrais évoquer la TVA à taux réduit pour la rénovation thermique qui, elle aussi, permettra de réduire la facture énergétique des ménages les plus modestes.
Je pourrais également parler de la TVA à taux réduit sur le logement social et les petites réparations.
M. Jean-Louis Carrère acquiesce.
Ainsi, les loyers ne viendront pas obérer la pouvoir d’achat des plus modestes des Français.
Toutes ces mesures font partie du projet de loi de finances pour 2014 et visent à favoriser le pouvoir d’achat. Notre volonté d’engager un effort massif pour l’emploi vise le même objectif avec les contrats de génération, les contrats d’avenir et les contrats aidés.
Lorsque la crise est là, elle prive des millions de Français d’emploi, donc d’un avenir et d’un accès à la consommation. Offrir des perspectives d’emploi à ces Français revient à leur permettre de se construire un avenir, d’avoir accès à la consommation et, par conséquent, à un peu d’espérance, là où la crise a fait tant de dégâts. Toutes ces mesures sont donc incluses dans le projet de loi de finances pour 2014.
De surcroît, pour ce qui concerne le retour à la croissance et l’augmentation du pouvoir d’achat, nous agissons également en direction des entreprises : nouveau régime des plus-values de valeurs mobilières, afin que ceux qui prennent des risques en investissant dans les PME-PMI innovantes n’en soient pas découragés ; mise en place du nouveau régime des jeunes entreprises innovantes ; mise en place d’un nouveau dispositif d’amortissement pour celles des grandes entreprises qui interviennent dans le financement des PME-PMI dans le cadre du dispositif dit « corporate venture » ; mise en place d’un mécanisme d’amortissement intéressant pour ceux qui décident d’investir dans la robotisation, afin que nous gagnions en compétitivité et en productivité ; grande réforme de l’assurance vie, de sorte que ses 1 400 milliards d’euros de placements soient davantage investis vers le logement et les PME-PMI innovantes.
Ce budget exprime donc la confiance dans notre appareil productif, dans la croissance, dans nos PME, dans nos PMI, dans l’innovation. Il vise non seulement à corriger des injustices et à préserver le pouvoir d’achat, mais également à octroyer une chance de redressement à notre appareil productif, afin que nous retrouvions le chemin de la croissance.
De la lutte contre la fraude fiscale, nous attendons 2 milliards d’euros cette année. Il s’agit d’un élément déterminant de la réforme fiscale appelée de ses vœux par le Premier ministre, qui vise à renforcer le consentement à l’impôt.
Je veux dire mes remerciements aux sénatrices et aux sénateurs qui se sont impliqués sur ce sujet, notamment M. Éric Bocquet.
Sourires.
Tout comme vous, bien sûr, madame Goulet.
Tout ce que nous faisons a pour objectif de renforcer le consentement à l’impôt. Nous attendons 2 milliards d’euros de la lutte contre la fraude, dont 1 milliard d’euros des particuliers. La circulaire prise au mois de juin dernier nous conduit aujourd’hui à traiter près de 7 000 dossiers déposés depuis trois mois, c'est-à-dire bien plus qu’au cours des quatre dernières années. Le nombre significatif de ces dossiers déposés devant notre administration nous rend optimistes quant à la possibilité d’atteindre cet objectif de 1 milliard d’euros récupérés au titre de la lutte contre la fraude fiscale des particuliers.

Et les recettes qui ne rentrent pas ? Vous n’en parlez pas. C’est tout de même important !
Je vais en parler, madame la sénatrice.
S’y ajoute tout ce que nous faisons, également, pour lutter contre la fraude fiscale des entreprises. Grâce aux réformes engagées concernant la comptabilité analytique, la déduction des intérêts d’emprunt, l’inversion de la charge de la preuve, la réflexion engagée sur l’abus de droit, nous avons pu avancer considérablement sur les deux sujets distincts que sont l’optimisation fiscale et la lutte contre la fraude.
Pour conclure, y a-t-il un effondrement des recettes fiscales, la courbe de Laffer nous privant aujourd’hui de recettes dont nous avons besoin ?

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mais non ! Tout va au mieux. Il n’y a aucun problème !
Souriressur les travées de l'UMP.
Je répondrai précisément.
Je rappelle tout d’abord que les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat ont toujours été informées en temps réel de la situation. En outre, nous avons bâti un projet de loi de finances initial pour 2013 avec une prévision de croissance de 0, 8 %. Celle-ci s’élève finalement à 0, 1 %. L’élasticité des recettes à la croissance est un phénomène bien connu.

S’il manque 11, 2 milliards d’euros, l’élasticité est vraiment importante !
Vous connaissez ce principe, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition, pour la bonne et simple raison que, en 2009, lorsque la crise s’est enclenchée, vous avez été témoins de son impact très important, infiniment plus que ce que nous constatons aujourd’hui, sur l’impôt sur les sociétés.
Il existe bien un décalage de 10 milliards d’euros entre les recettes inscrites dans la loi de finances initiale de 2013 et ce que nous constatons aujourd’hui, en raison du décalage de croissance de 0, 8 % à 0, 1 % et de la moindre élasticité des impôts à la croissance, d’autant que nous subissons depuis de nombreuses années une croissance étale ou atone.
Ce phénomène s’est déjà produit par le passé, car ce que nous connaissons aujourd’hui n’est pas fondamentalement différent de ce qui s’est déroulé lorsque la crise était là et que l’absence de croissance avait un impact sur les recettes fiscales. Il est incorrect d’en déduire que cette situation résulterait d’un exil fiscal massif ou d’un effet, en France, de la courbe de Laffer.
C’est vrai, madame la sénatrice, mais comme ce fut le cas par le passé, dans des situations comparables, lorsqu’il existait des décalages entre les hypothèses de croissance initiale et la croissance réelle.
Autant je pense qu’il est importance d’être transparent, et je le suis, car cela vous est dû, mesdames, messieurs les sénateurs, autant il n’est pas correct de profiter de ces éléments pour manipuler, pour susciter de la peur, pour inférer des choses qui n’ont rien à voir avec le sujet.
Un débat budgétaire doit être honnête et transparent, car on doit la vérité à la représentation nationale !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, chacun a conscience, au moment où nous entamons la discussion de ce projet de budget pour 2014, du contexte particulier dans lequel celui-ci s’inscrit.
Le débat autour de la question fiscale est à la fois légitime et nécessaire. Le consentement à l’impôt est un fondement de notre démocratie. Il ouvre d’ailleurs chaque projet de loi de finances de l’année, après, désormais, le fameux article liminaire rappelant que nos choix s’inscrivent dans le cadre de nos engagements européens.

Il convient cependant de prendre garde à ce que ce débat ne conduise pas à une remise en cause du principe même de solidarité et de la légitimité de l’intervention de l’État pour la garantir.
Devant le risque d’un délitement du consentement à l’impôt, il faut rappeler que les prélèvements obligatoires assurent le financement de nos services publics et de notre système de protection sociale. D’aucuns les jugent trop coûteux, mais certaines dépenses ne seraient pas supprimées comme par magie si elles cessaient d’être des dépenses publiques : d’aucuns, par exemple, jugent notre système de santé coûteux, mais rappelons que les États-Unis dépensent nettement plus que nous pour leur santé, dans le cadre d’un système fondé sur une logique libérale.

Il faut s’attacher à comprendre les réactions de nos concitoyens, tout en se gardant, selon moi, de les inscrire au seul passif de l’actuel gouvernement.

Le précédent gouvernement, faut-il le rappeler, a augmenté les prélèvements obligatoires de 33 milliards d’euros en un an et demi !

Cette critique est insensée ! C’est vous qui en profitez, car vous les avez dans les caisses. Et vous n’êtes même pas capables de faire en sorte que cela suffise !

C’est davantage que les augmentations auxquelles il a été procédé depuis lors.
Certes, je conçois que les Français acceptent plus difficilement la dernière hausse d’impôt que toutes les précédentes, …

… d’autant que le précédent gouvernement nous a laissé quelques bombes à retardement fiscales, comme certains contentieux européens en attestent d’ailleurs.

Mes chers collègues, depuis quelques semaines, voire quelques mois, nous recevons dans nos permanences de très nombreux citoyens qui se plaignent de situations qu’ils ne comprennent absolument pas.

Ils doivent aujourd’hui payer des impôts qu’ils ne payaient pas hier, des veuves subissent des situations qu’elles n’avaient pas anticipées, sans parler des élus qui viennent nous faire part de leur surprise quant à la baisse de 10 %, 15 %, voire 20 % des recettes de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, par rapport aux prévisions annuelles.
Il ne faut pas avoir la mémoire courte : c’est le précédent gouvernement…
Sourires sur les travées de l'UMP.

Et c’est ce gel qu’il est proposé de corriger aujourd’hui, puis de supprimer cette année. C’est le précédent gouvernement qui a supprimé le bénéfice de la demi-part fiscale supplémentaire attribuée aux veuves, dont l’entrée en vigueur a été progressive.

C’est le précédent gouvernement aussi qui a adopté des dispositions en matière de taxation des plus-values qui ont littéralement bloqué le marché immobilier.

C’est lui qui a mis en œuvre dans la précipitation la réforme de la taxe professionnelle dont tout le monde se plaint aujourd’hui !

M. François Marc, rapporteur général de la commission des finances. C’est enfin lui, et vous êtes bien placée pour le savoir, madame Des Esgaulx, qui décidé de cette fameuse écotaxe.
Exclamations sur les travées de l'UMP.

C’est lui qui a signé un contrat de partenariat avec la société Ecomouv’ sur lequel nous souhaitons rapidement faire toute la lumière.
Nombre de griefs portent donc aujourd’hui sur la compétitivité de notre économie. N’oublions pas à ce sujet que le coût du travail a augmenté beaucoup plus rapidement qu’en Allemagne durant les dix dernières années, ce que nous commençons à corriger avec la mise en œuvre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi.
D’aucuns nous disent aujourd’hui que le Gouvernement ne va pas assez loin et nous dispensent volontiers des leçons de courage politique.

La précédente majorité, cependant, avait voté une TVA sociale, en toute fin de législature, …

… dont les conséquences sur le coût du travail étaient moindres, et avec un effet différé dans le temps, comme s’il ne s’agissait en définitive de rien de plus que d’un marqueur symbolique dans le cadre d’une campagne électorale.
Chers collègues de l’opposition, lorsque vous critiquez aujourd’hui les augmentations de TVA, où est la cohérence ?

Quelle est en définitive votre position ? Nous aimerions le savoir.
Les réactions auxquelles nous sommes confrontés trouvent donc leur source au moins autant, sinon plus, dans la gestion des gouvernements précédents que dans celle que nous menons depuis un an et demi. §

Je ne conteste pas la légitimité d’un débat, même intense, sur les choix du Gouvernement pour parvenir à notre redressement. Il est sain qu’il ait lieu, qu’il permette d’exposer les solutions de substitution et contribue à éclairer nos concitoyens quant à notre situation.
En revanche, il est irresponsable d’encourager, avec un objectif politique de court terme, le rejet de l’impôt qui se manifeste ici ou là, compte tenu de l’enjeu et du défi que représente la réussite du redressement de nos finances publiques pour notre pays.
J’assume totalement, pour ma part, les décisions de rééquilibrage des finances publiques prises au travers, notamment, de l’augmentation de l’imposition des patrimoines, des hauts revenus et du capital : ces mesures ont moins affecté la croissance que des coupes dans les dépenses publiques, auxquelles il ne pouvait du reste être procédé sans avoir mené au préalable les concertations et les évaluations nécessaires. Ces augmentations ont concerné en outre, dans un souci de justice sociale, surtout les ménages les plus aisés.
La précédente majorité nous reproche de ne pas suffisamment réduire les dépenses publiques, …

… alors qu’elle a augmenté massivement les prélèvements obligatoires, après avoir, quelques années plus tôt, multiplié les cadeaux fiscaux inutiles – souvenons-nous du bouclier fiscal –, …

… dont certains pèsent encore sur nos comptes publics. Je pense, par exemple, à la défiscalisation des intérêts d’emprunt pour l’achat d’une résidence principale.

Et la défiscalisation des heures supplémentaires, vous n’en parlez pas ?

Aussi, les réformes structurelles que l’opposition d’aujourd’hui reproche au Gouvernement de ne pas avoir réalisées, elle n’a pas su les conduire au cours des dix années précédentes, lorsqu’elle était elle-même au pouvoir. La RGPP est d’ailleurs rapidement devenue, au mieux, une construction visant à crédibiliser la suppression d’un emploi de fonctionnaire sur deux partant à la retraite, au pire, un exercice de communication.
Au total, les dépenses publiques ont tout de même augmenté de 1, 6 % par an, en moyenne, pendant l’ensemble du quinquennat de M. Sarkozy.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Heureusement qu’il existe ! Que feriez-vous sans lui ?
Souriressur les travées de l'UMP.

J’en dirai plus sur d’autres sujets, monsieur le président de la commission !
À y regarder de plus près, quelles réformes de structure ont été menées à bien pendant le dernier quinquennat ?
La réforme des retraites ? Nous sommes obligés, trois ans à peine après, de la corriger, pour y introduire de la justice, …

L’effort consenti en faveur de l’enseignement supérieur et de la recherche, au travers, notamment, du crédit d’impôt recherche ? L’autonomie des universités ? Le grand emprunt ? C’est en effet un sujet important, …

… mais cela ne permet pas de réaliser des économies, bien au contraire.
Aujourd’hui, pas davantage qu’hier, la droite ne sait nous dire où il faudrait faire des économies, …

… sauf à procéder à une réduction dogmatique du nombre des fonctionnaires, qu’elle se plaît à stigmatiser.
Chers collègues de l’opposition, la droite s’honorerait à aller au bout de sa logique, en nourrissant le débat politique avec de véritables propositions, au-delà des pétitions de principe.
J’espère donc que notre débat sera marqué par la cohérence, car cela nous serait collectivement utile.

… et l’encourage à être déterminé dans les choix difficiles qui permettront de respecter nos engagements européens.
L’acte I du redressement a porté, à titre principal, sur les recettes, tandis que l’acte II, que ce projet de loi de finances inaugure, concentre désormais tous nos efforts sur les dépenses publiques.
Notre trajectoire pluriannuelle des finances publiques a dû être ajustée à plusieurs reprises ces derniers mois, compte tenu d’une croissance et de recettes fiscales moins dynamiques que prévu. À cet égard, je remercie M. le ministre de nous avoir fourni les explications utiles en la matière.
Nous avons ainsi décalé cette trajectoire visant à faire passer notre déficit public en deçà de 3 % du PIB en 2015, pour atteindre quasiment l’équilibre structurel en 2016, puis, enfin, le plein équilibre en 2017.
La Commission européenne a confirmé la justesse de ces prévisions de croissance et a donné un satisfecit au projet de budget pour 2014, qui prévoit un effort ajouté à celui de 2013 conforme à l’évolution du solde structurel qui nous était demandée. Elle nous a aussi fait part de ses interrogations et de ses recommandations, qui sont, je tiens à le dire, pleinement légitimes.
Nous avons collectivement souscrit à un « règlement de copropriété de l’euro », pour reprendre une expression de notre collègue Jean Arthuis. Il serait paradoxal de se plaindre aujourd’hui qu’il soit appliqué avec discernement, mais sans exception ni tabou.
La Commission européenne constate également que nous n’avons pas encore adopté l’ensemble des mesures permettant de ramener notre déficit sous le seuil de 3 % du produit intérieur brut en 2015 et nous engage à mettre en œuvre des réformes structurelles. Il nous reviendra, en effet, de prendre les dispositions nécessaires pour respecter notre trajectoire, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2015.
Mes chers collègues, permettez-moi maintenant d’insister sur quelques points qui me semblent déterminants pour assurer le respect de notre trajectoire.
Tout d’abord, il s’agit de faire porter notre effort sur l’ensemble des dépenses publiques : l’État et ses opérateurs, mais aussi les organismes de sécurité sociale et les collectivités territoriales.
Ensuite, la réduction des dépenses publiques ne sera ni simple ni indolore. C’est un défi exigeant, que nous devons collectivement relever.
Enfin, elle ne sera pas temporaire. Si nous croyions ou faisions croire qu’il suffirait de faire un effort quelques mois ou quelques années, « le temps que l’orage passe », nous mentirions à nos concitoyens et nous n’arriverions pas à consolider dans la durée notre redressement. Il s’agit bien de définir de manière pérenne un modèle plus économe des derniers publics.

Au cours des dernières années, les gouvernements ont cherché, au travers de diverses méthodes, à optimiser le fonctionnement de l’État afin de ralentir la croissance de ses dépenses. Nous devons, bien sûr, ne jamais perdre de vue cette exigence de l’efficience et de l’efficacité.
Toutefois, les économies auxquelles nous devrons procéder en 2015 – plus de 15 milliards d’euros – ne pourront être obtenues ni en concentrant notre effort sur l’État ni en nous contentant d’optimiser, de rationaliser ou de raboter la dépense. Ce ne serait pas à la hauteur des enjeux.
De plus, nous sommes arrivés à un point où cette méthode, que nos prédécesseurs ont mise en œuvre, trouve ses limites. Elle peut nous conduire à prendre des décisions qui ne seraient, sur le long terme, ni les plus économes ni les plus justes ; je pense, par exemple, à la dérive de certains contentieux ou au recours à des partenariats public-privé.
Le projet de budget que nous allons examiner est marqué par l’importance des efforts d’économies, d’un montant inégalé. Il est aussi porté par deux ambitions que le Gouvernement entend concilier : la compétitivité des entreprises et la justice sociale.
S’agissant de la compétitivité, donc de l’emploi, nous devons aider nos entreprises, en particulier nos PME, à se développer, à investir et à exporter. Nous avons déjà eu recours à plusieurs outils et engagé une baisse inédite du coût du travail, avec le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE.
Ainsi que vous l’avez souligné, monsieur le ministre, ce projet de loi de finances comporte à cet égard plusieurs dispositions bienvenues : la réforme du régime des plus-values de cession, l’amortissement exceptionnel pour l’acquisition de robots dans les PME, que nous souhaitons étendre aux entreprises de taille intermédiaire, les ETI, la simplification de l’assiette du crédit d’impôt recherche, l’extension du régime d’exonérations sociales accordé aux jeunes entreprises innovantes, notamment. Le financement des PME sera par ailleurs facilité par la création d’un nouveau plan d’épargne en actions, qui leur sera dédié, et de nouveaux supports d’assurance vie dans le projet de loi de finances rectificative.
Cette action en faveur de la compétitivité de nos entreprises doit dépasser le cadre du budget et s’inscrire dans une dimension européenne. Il n’est pas possible de laisser l’Europe tolérer, voire encourager, une concurrence fiscale et sociale qui met à mal notre modèle et sapera, demain, la construction européenne.
À cet égard, je me félicite de l’annonce de la mise en place d’un salaire minimum généralisé en Allemagne faite ce matin même par Angela Merkel.

De même, la question du taux de change de l’euro ne peut plus être éludée, car toutes les grandes puissances économiques procèdent de fait à des formes de dévaluation compétitive, et le niveau de l’euro contribue dès lors, en France comme dans d’autres pays, à la disparition des industries les plus fragiles.
Enfin, l’Europe doit poursuivre de manière énergique les efforts engagés en faveur de la levée du secret bancaire, de la lutte contre les paradis fiscaux et de l’échange automatique d’informations. Des progrès considérables ont déjà été accomplis si l’on se réfère, par exemple, à l’évolution de la Suisse. D’autres pays encore doivent rentrer dans le rang, en Europe comme hors de ses frontières.
C’est une question importante, parce que la lutte contre la fraude fiscale apporte à l’État des recettes qui sont tout sauf anecdotiques. Par ailleurs, nos concitoyens ne doivent pas avoir le sentiment que certains, parmi les plus favorisés, pourraient échapper impunément à l’effort commun.
J’en viens maintenant à la seconde priorité de ce projet de budget, que vous avez rappelée, monsieur le ministre, à savoir la justice sociale.
Il est, à mes yeux, essentiel de protéger les ménages les plus fragiles, qui ont été les plus durement touchés par la crise. C’est dans cet esprit qu’ont été prises un certain nombre de mesures en faveur de nos concitoyens les plus fragiles : augmentation de l’allocation de rentrée scolaire, amélioration des bourses pour les étudiants, revalorisation du RSA socle, création d’un RSA jeunes et hausse du montant de l’allocation pour adulte handicapé. Concernant les ménages imposables les moins favorisés, nos collègues députés ont introduit dans ce projet de loi de finances un certain nombre d’avances, au-delà de la fin du gel du barème de l’impôt sur le revenu.
Ce choix aussi, nous l’assumons pleinement : au moment où nous devons procéder à des ajustements difficiles, le souci de la justice sociale doit être permanent.
Cette préoccupation de justice doit s’étendre au financement des collectivités territoriales. Celles-ci ne peuvent être exclues de l’effort de redressement des comptes, mais ce dernier doit s’accompagner, d’une part, d’une limitation du coût des normes et des dépenses obligatoires sur lesquelles elles n’ont aucune maîtrise
M. Philippe Dallier s’exclame.

Je soutiens pleinement les choix du Gouvernement, appuyés par le Comité des finances locales, et je souhaite que nous puissions, dès l’année prochaine, travailler à une refonte de la dotation globale de fonctionnement, dans cette même perspective.
Je souhaite également que nous puissions renforcer la progressivité de l’imposition des revenus. La commission des finances a décidé hier de saisir le Conseil des prélèvements obligatoires, afin que celui-ci étudie la fusion de l’assiette de l’impôt sur le revenu et de la CSG et, à défaut, la possibilité d’appliquer des taux progressifs aux revenus soumis à la CSG.
Notre initiative est confortée par la volonté du Premier ministre d’engager une « remise à plat » de notre fiscalité. En effet, nous ne devons pas abandonner l’ambition de réformer nos impôts au prétexte que les temps sont trop durs.
J’ai évoqué la question de l’imposition des revenus. S’agissant des collectivités territoriales, cela passe par la révision des valeurs locatives, dont je souhaite que la prochaine étape, à savoir l’expérimentation concernant les locaux d’habitation, soit engagée rapidement.
Pour ce qui concerne, enfin, la fiscalité des entreprises, il y aura lieu, lors des prochaines assises annoncées au début de l’année prochaine, d’étudier de nouvelles assiettes d’imposition, qui devront permettre d’éviter l’affichage d’un taux nominal élevé de l’impôt sur les sociétés, de moins peser sur le coût des facteurs de production et de limiter les possibilités d’optimisation fiscale.
Mes chers collègues, le projet de budget qui nous est soumis marque une confirmation, celle de notre engagement à redresser nos comptes publics, et témoigne d’une inflexion significative, celle des moyens mis en œuvre pour y parvenir. Il manifeste également une double conviction : celle de la nécessité d’améliorer la compétitivité de nos entreprises et celle de la justice sociale.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous invite à voter ce projet de loi de finances, sur la première partie duquel la commission des finances a émis un avis favorable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi, tout d’abord, de remercier tous les membres de la commission des finances et l’ensemble des rapporteurs spéciaux, qui ont animé des débats particulièrement utiles et fructueux, montrant ainsi notre souci de suivre avec la plus grande attention possible la problématique de la dépense publique.
Je veux aussi, même si nos options sont franchement opposées, remercier le rapporteur général, qui, avec sa courtoisie et sa force de travail, exerce une fonction difficile, dont je connais les charmes et les contraintes. §
Ce préambule étant fait, je commencerai par relever que le projet de loi de finances pour 2014 nous parvient dans un contexte de confusion institutionnelle et politique, une confusion que, pour ma part, je n’ai jamais connue auparavant.
Certes, il existe des facteurs permanents de confusion : le découpage de la discussion budgétaire en deux lois financières montre davantage encore cette année ses limites. Comment traiter de la fiscalité de l’épargne de manière cohérente dans deux textes ? Comment fractionner les choix fiscaux quand les préoccupations des commissions sont légitimement différentes ?
Observons toutefois que, chose nouvelle, l'Assemblée nationale a adopté les deux lois financières en sachant que celles-ci comportaient des dispositions fantômes, destinées à être modifiées lors d’une étape ultérieure. Je veux parler de la taxation des revenus de l’épargne, issue du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, et de la taxe poids lourds, dont les recettes figurent toujours dans le projet de loi de finances pour 2014, alors même que cette taxe est suspendue pour un temps, à mon avis, indéterminé.
La confusion institutionnelle est aggravée par la procédure d’examen des plans budgétaires nationaux par la Commission européenne. À cet égard, les craintes que nombre d’entre nous éprouvaient apparaissent aujourd’hui fondées.
Quel étrange schéma institutionnel que celui qui voit la Commission européenne donner son avis après que l’Assemblée nationale s’est prononcée sur la première partie du projet de loi de finances ! Mes chers collègues, si l’on devait un jour corriger la copie, comment pourrait-on bien s’y prendre ?
Le plus grave, pourtant, c’est que la confusion politique règne et soit à ce point alimentée par le Gouvernement.
Cette confusion a encore été tout récemment alimentée lorsque le Premier ministre a annoncé la remise à plat du système fiscal. J’en conclus, mes chers collègues, que le projet de loi de finances dont nous abordons l’examen en séance publique repose sur un système qui, nous dit-on, doit être complètement réformé !
Remettre à plat le système fiscal, pourquoi pas ?

Seulement, le gouvernement qui lance ce chantier est le même qui, pendant dix-huit mois, a éprouvé tous les charmes des augmentations fiscales, en agissant sur l’ensemble des outils existants.
Par ailleurs, la confusion de notre procédure de discussion budgétaire, éclatée entre plusieurs textes examinés en parallèle, l’un modifiant parfois l’autre, ne peut pas rester sans conséquence sur notre démocratie : on sait de moins en moins où et quand se prennent les décisions en matière économique et sociale. Or le Gouvernement en joue, par exemple lorsqu’il instaure le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, sans régler le problème de son financement.

Monsieur le ministre, cette tactique à courte vue se retourne aujourd’hui contre vous dans l’opinion publique, au moment où vont entrer en application les augmentations de TVA indissociables de la décision de créer le CICE. L’an dernier, vous avez annoncé les aspects agréables, remettant à plus tard la présentation des aspects plus rugueux !
Mes chers collègues, une telle confusion provoque des dégâts considérables : quand le gouvernement précédent avait amorcé, fût-ce trop tard et trop peu selon moi, un mouvement de transfert des prélèvements pesant sur le travail vers les impôts de consommation, le gouvernement actuel a pris à peu près le même chemin l’an dernier, mais en catimini et en suivant une méthode incertaine qui met en péril la réussite d’une évolution que, presque tous, nous savons indispensable à la préservation de notre compétitivité.
À cela s’ajoutent bien entendu les multiples reculs du Gouvernement, sur lesquels je n’aurai pas la cruauté d’insister, mais qui font s’effriter l’autorité de l’État, dans une période où nous aurions bien besoin, monsieur le ministre, d’un État fort, d’un État stratège, porteur d’une vision claire de l’avenir, pour résoudre les nombreux problèmes de nos concitoyens.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Mes chers collègues, il est une vérité que l’on oublie, et au regard de laquelle les propos du ministre de l’économie et des finances, des propos à mon sens lénifiants
M. Antoine Lefèvre acquiesce.

Certes, nous ne sommes plus dans une phase aiguë de cette crise, et les écarts de taux se sont réduits ; mais les déséquilibres qui ont conduit à des appréciations défavorables portées sur la France existent toujours, et même se sont peut-être accrus. Au fond, le fonctionnement de la zone euro continue de reposer sur des ambiguïtés, ce qu’illustre, par exemple, le projet d’union bancaire.
De fait, l’Allemagne s’oppose de plus en plus nettement à un fonds de résolution qui conduirait nos contribuables à payer pour la défaillance de banques d’autres États ; à mon avis, du reste, elle n’a pas tort. Elle s’oppose aussi à la recapitalisation directe des banques par le mécanisme européen de stabilité.
Au vu de telles positions, monsieur le ministre, que reste-t-il de l’union bancaire ? J’aurais aimé poser la question à M. Moscovici, s’il avait pu rester un peu plus longtemps ! En réalité, il n’en reste que le mécanisme de supervision unique, tel que les banques françaises, au lieu d’être supervisées à Paris, le seront à Francfort, par un régulateur certainement très compétent, mais probablement moins compréhensif à l’égard des spécificités de nos supports d’épargne. Cela peut avoir des incidences lourdes sur le financement de l’économie et des entreprises, et par conséquent sur le niveau de l’emploi.
Ces développements me conduisent à aborder le problème principal, qui met en jeu notre souveraineté : celui de la dette publique. Mes chers collègues, nous devons réduire notre dépendance à l’égard de nos créanciers, une dépendance qui a aussi le sens d’une véritable addiction !
À ce sujet, en souhaitant que nul ne prenne mon propos en mauvaise part, je veux relever un paradoxe : l’ennemi d’hier, la finance, est devenu aujourd’hui le meilleur ami ! §
En effet, compte tenu de l’évolution de l’encours de notre dette publique, qui s’élève maintenant à près de 2 000 milliards d’euros, c’est grâce aux taux d’intérêt historiquement bas que nous consentent les marchés financiers, naguère tant critiqués, que nous parvenons, pour le moment, à éviter l’éviction de nos dépenses publiques les plus utiles par les charges de remboursement des emprunts.
Malgré les discours rassurants du Gouvernement, quelles que soient les nombreuses marques d’autosatisfaction et les efforts accomplis pour minimiser les conséquences du dérapage de nos finances publiques par rapport à notre trajectoire, nous avons un vrai problème de dette publique, un problème qui ne cesse d’enfler.
Permettez-moi de faire état d’une donnée qui, pour ma part, m’inquiète beaucoup, même si elle concerne l’avenir. Alors que, voilà un an, on prévoyait que le ratio d’endettement de la France s’établirait à 83 % du PIB en 2017, cette prévision est aujourd’hui passée à 91 %. De la même façon, on prévoyait, il y a un an, que le pic du taux d’endettement serait atteint en 2013, au niveau de 91, 3 % du PIB ; douze mois plus tard, le pic est annoncé pour 2014 et il devrait atteindre 95, 1 % du PIB !
Or, même si les taux d’intérêt sont très bas, la dette publique pèse sur notre activité économique. Elle est un facteur de prudence et d’attentisme, qui conduit les agents économiques à épargner davantage, parce qu’ils craignent, quelques assurances qu’on leur donne, de futures hausses d’impôt. Peut-être, monsieur le ministre, ce phénomène contribue-t-il à la sinistrose qui a été critiquée tout à l’heure.
L’augmentation de la dette rapportée au PIB alourdit la contrainte qu’il faudra respecter le jour où nous aurons ramené le déficit à 3 % du PIB : en effet, il ne faut pas oublier que, à ce moment-là, les règles européennes nous conduiront à nous rapprocher, en quelque sorte à marche forcée, du plafond de dette fixé à 60 % du PIB.
Mes chers collègues, nous devons avoir conscience que des efforts seront nécessaires pendant longtemps. Ceux qui ne sont pas accomplis maintenant, ou qui ne le seront pas en 2014, non seulement devront l’être plus tard, mais seront d’autant plus durs, coûteront d’autant plus cher et seront perçus d’autant plus mal encore qu’on ne sera pas allé assez loin aujourd’hui.
Serons-nous capables de tenir une trajectoire de réduction du solde effectif des finances publiques en deçà du seuil de 3 % du PIB ? Telle est, à mes yeux, la question essentielle qui se pose à nous.
Il est clair que nous ne pouvons nous engager sur un chemin crédible qu’en réalisant des efforts très importants pour réduire les dépenses publiques de manière pérenne. Or, en dépit de tous les commentaires que l’on égrène et de toutes les assurances que l’on nous prodigue, je ne vois pas que cette politique soit mise en œuvre aujourd’hui.
Certes, par affichage, le Gouvernement tient un langage tout à fait rassérénant. Les trajectoires qu’il soumet à nos partenaires européens vont toujours dans le bon sens, même si elles se dégradent un peu chaque année. Le Gouvernement se livre à un exercice, que je qualifierai de normal, pour maîtriser la dépense publique, mais en qualifiant d’économie ce qui n’est que ralentissement d’une tendance haussière.
Or, si l’on y regarde de plus près, on constate que, depuis un an, le Gouvernement a assoupli sa trajectoire de solde structurel et de solde conjoncturel, qu’il a renoncé à l’objectif d’équilibre des comptes publics en 2017, quelles que soient les assurances verbales qu’on veut bien nous donner !
À la vérité, le Gouvernement manie le double langage bien connu : un langage pour rassurer sur la scène intérieure, un autre pour rassurer ses partenaires à Bruxelles.
Des progrès ont bien été accomplis en matière de gouvernance ; je pense, en particulier, à la création du Haut Conseil des finances publiques, dont le travail permet d’objectiver le débat sur les hypothèses macroéconomiques qui fondent le projet de loi de finances, ce dont je ne me plaindrai pas.
Des sujets d’interrogation tout à fait essentiels n’en subsistent pas moins. En particulier, le Haut Conseil vient de confirmer qu’il constatera, au printemps prochain, un écart significatif, de plus d’un point, par rapport à la trajectoire de solde structurel prévue. Monsieur le ministre, comment jouera le mécanisme de correction automatique ? Je vous ai déjà plusieurs fois posé la question : votre habileté est très grande, mais vous ne m’avez jamais répondu. Quelles conséquences le Gouvernement tirera-t-il donc de cet écart ?
Par ailleurs, je regrette que le chantier de la rationalisation et de la réduction des niches fiscales soit mené avec une grande mollesse. Alors que 20 % du stock de niches devait être évalué en 2013, je ne sache pas que cet exercice ait été conduit – en tout cas, je n’ai reçu aucune information à ce sujet.
Ce qui est aussi préoccupant, c’est la liberté que prend le Gouvernement avec la norme de dépense qu’il a lui-même définie. Il en est toujours allé ainsi, mais, cette année, les accommodements vont un peu plus loin. En particulier, plus de 1, 5 milliard d’euros de transferts de fiscalité aux régions et aux départements auraient dû, en application de la charte de budgétisation, se traduire par des économies en dépense, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, monsieur le ministre, lorsque vous soutenez que la dépense publique est réduite en valeur absolue de 1, 5 milliard d’euros, c’est à mon sens un pur sophisme. En effet, avec 1, 5 milliard d’un côté et 1, 5 milliard de l’autre, il n’y a aucune réduction de la dépense publique en valeur absolue !
J’observe, enfin, …

… qu’une certaine confusion entoure les investissements d’avenir, dont le deuxième programme, d’un montant de 12 milliards d’euros, a été annoncé au mois de juillet dernier, en dehors de toute procédure budgétaire.
Il est vrai, monsieur le ministre, que ces investissements sont un hommage, justifié, à vos prédécesseurs, qui ont inventé la formule ; mais ils viennent souvent se confondre, dans les crédits des missions, avec la dépense budgétaire classique. C’est le cas, par exemple, au ministère de la défense, où un effet de substitution se produit.
Or, ne l’oublions pas, les 12 milliards d’euros en question, ce sont 12 milliards d’euros de dettes supplémentaires, 12 milliards de plus à trouver sur les marchés financiers – vos meilleurs amis, décidément – dans une conjoncture difficile.
Mes chers collègues, les objectifs de dépenses que se fixe le Gouvernement nécessiteraient – et vous n’avez d’ailleurs pas dit le contraire, monsieur le ministre – de véritables réformes de structure.

Le Gouvernement espère limiter la progression en volume des dépenses publiques à 0, 4 % en 2014, puis à 0, 2 % les années suivantes : c’est la trajectoire sur laquelle vous engagez votre responsabilité.
Qu’il me soit simplement permis de rappeler qu’en 2012 la progression réelle en volume a été de 1 %, alors que l’on attendait 0, 4 %, mais il est vrai que 2012 était une année à gestion partagée. Pour 2013, on attendait 0, 9 % et on a eu 1, 7 %. Par conséquent, pardonnez-moi de jauger votre nouvelle prévision à l’aune de ce qui a pu être fait dans le passé le plus récent.

M. le rapporteur général n’a pas utilisé tout son temps de parole. Quant aux ministres, ils ont majoré les quarante-cinq minutes dont ils disposaient. Au demeurant, je serai raisonnable puisque j’en arrive à ma conclusion.
Le Gouvernement ne prépare pas vraiment l’opinion à recevoir un vrai message annonciateur d’économies. Il peut être amené à faire des économies, mais il préfère communiquer plutôt sur ses annonces coûteuses : sur les recrutements dans la fonction publique – certes plus facile à entendre que la réduction du nombre de fonctionnaires –, sur la garantie universelle des loyers
M. Philippe Dallier s’exclame.

Certes, vous devez avancer, monsieur le ministre, tel un funambule sur un fil, avec de part et d’autre beaucoup de récifs et d’écueils. Mais, trop souvent, il vous arrive d’annoncer une chose en sachant que vous allez faire le contraire ! Certes, l’horrible RGPP est morte, remplacée par la vertueuse MAP. Mais chacun de ceux qui analysent les budgets et les méthodes sait que, dans le fond, c’est toujours la même démarche d’audit et de recherche de réformes.
De grâce, n’allez pas, par un procédé trop facile, « sataniser » vos prédécesseurs
M. le ministre délégué manifeste par un geste qu’il ne se sent pas concerné par la remarque.

J’observe que le ressentiment monte aussi chez les élus locaux, chargés de financer les politiques décidées par le Gouvernement, par exemple en matière de rythmes scolaires, tout en assumant, à la place du Gouvernement, les hausses d’impôt – c’est ce qu’on nous propose de faire avec les droits de mutation à titre onéreux – et tout en subissant une baisse des dotations, qui atteignent des niveaux tout à fait inédits. Bien entendu, vous avez le talent de qualifier cela de « pacte de confiance et de responsabilité », comme si cette politique du verbe n’était pas ce qui mine le plus la confiance et comme si cette manière de présenter les choses, contraire à la réalité, pouvait être considérée comme véritablement responsable.
Enfin, en matière fiscale, nous pouvons observer à chaque instant, sur presque chaque sujet, une absence de cohérence. L’impréparation des décisions, les allers et retours, l’absence d’une ligne politique arrêtée et assumée, les concessions qu’il vous faut faire, tout cela porte, je le crains, un coup dur au consentement à l’impôt dans notre pays.

Comme vous, monsieur le ministre, je pense que l’impôt est une réalité citoyenne indispensable dans notre République.
Je me bornerai à regretter que le Gouvernement persiste à afficher des objectifs idéologiques et à mettre en place par la suite les moyens de les contourner, sans vraiment dire la vérité, que ce soit à ses amis et ses alliés, voire à ses compétiteurs et ses adversaires.
Un bon exemple est celui de la fiscalité de l’énergie, mais nous en parlerons au cours de la discussion des articles. Permettez-moi toutefois d’évoquer brièvement la fiscalité écologique. Il devait s’agir de 4 milliards d’euros, destinés à participer au financement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. J’examine, je scrute, mais, même dans le cadre de la « remise à plat », je ne trouve pas l’esquisse du début de cette démarche.

M. Philippe Marini, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est dans ce contexte difficile que nous allons examiner ce projet de loi de finances pour 2014. Pour ma part, j’estime, avec de nombreux sénateurs et sénatrices, qu’il faudra rejeter franchement, globalement et frontalement ce texte dès l’examen de l’article d’équilibre.
Applaudissements

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous fais une promesse, et je la tiendrai : je serai beaucoup plus bref que le président de la commission des finances !

C’est une appréciation !
Le budget que le Gouvernement soumet à la représentation nationale s’inscrit, vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, dans la continuité, dans votre continuité. Pourtant, la France est au bord de la rupture. Des Abeilles aux Poussins, les professions se mobilisent les unes après les autres en un improbable bestiaire, des jacqueries violentes sonnent la rébellion contre l’État, le chômage atteint des niveaux inédits et le racisme s’affiche sans vergogne.

Les préfets décrivent une « société en proie à la crispation, à l’exaspération et à la colère ». Il devient urgent d’en prendre conscience : ce qui fonde notre pacte social et républicain est aujourd’hui en danger.
Certes, la majorité précédente nous a laissé un pays exsangue, à la fois économiquement, avec une dette augmentée de 600 milliards d’euros, et idéologiquement, avec une extrême droite qu’elle a choisi de légitimer.

Il reste que c’est désormais à ce gouvernement qu’il appartient de mener le changement.
Lorsque la France a entériné sans renégociation le traité voulu par Mme Merkel et M Sarkozy, j’avais, parmi d’autres, dénoncé à cette tribune les méfaits de l’implacable logique de l’austérité. Le mécanisme en est simple : les efforts commandés par la rigueur se trouvent neutralisés par la contraction de l’économie qu’ils engendrent eux-mêmes, alimentant ainsi le cercle vicieux de la crise.
La première année du quinquennat aura suffi à apporter la démonstration, si besoin était, que l’austérité de gauche, fût-elle travestie en « sérieux budgétaire », reste l’austérité. La loi de programmation des finances publiques prévoyait pour 2013 un déficit structurel de 1, 6 %. Néanmoins, et sans qu’aucun événement extérieur nouveau vienne le justifier, les recettes fiscales se sont atrophiées depuis lors de 11 milliards d’euros, si bien que, malgré les efforts, le déficit structurel pour 2013 devrait finalement être de 2, 6 %, soit un point de plus que prévu.

Or le TSCG – traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance – stipule qu’un écart d’un demi-point suffit à déclencher le mécanisme de correction automatique. C’est donc logiquement que le Haut Conseil des finances publiques a indiqué, dans son avis, qu’il serait contraint de demander ce déclenchement au printemps prochain, à l’occasion de l’examen de la loi de règlement.
Que se passera-t-il alors ? La France devra-t-elle payer une amende ? Le Gouvernement sera-t-il contraint à un ajustement structurel ? Ou bien cela se réglera-t-il par un discours de bonnes intentions ? Comme nous l’avions prédit – cela étant, l’exercice n’avait rien de bien difficile –, cette « règle d’or » n’offre qu’une alternative entre la catastrophe et la mascarade. La responsabilité incite évidemment à préférer la seconde, mais on ne peut pas dire que la politique en sorte grandie.
Bien qu’il ne soit pas parvenu à atteindre son objectif pour 2013, en dépit de l’effort consenti, le Gouvernement, fidèle à sa logique, le reporte pour partie sur l’année prochaine. Il s’engage donc pour 2014 à un effort de 0, 9 point de PIB, au lieu du 0, 5 point prévu par la loi de programmation. Nous nous enferrons ainsi un peu plus dans une spirale infernale.
C’est dans ce contexte, où la rigueur assumée ne laissait déjà que peu de marges, qu’ont été annoncés l’avènement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi et son financement partiel par une hausse de la TVA. Vous nous présentez régulièrement cette mesure, monsieur le ministre, comme la colonne vertébrale de la politique économique du quinquennat. Il est, du coup, difficile de comprendre pourquoi elle ne figurait pas en bonne place parmi les engagements de campagne du Président de la République et pourquoi elle fut introduite par un simple amendement, livré aux députés la veille de son examen.
Là encore, au-delà de la rupture du contrat politique, le Gouvernement s’est engagé dans la voie d’une économie sociale-libérale, aussi obsolète que dangereuse. Ce crédit d’impôt est non seulement un chèque en blanc aux entreprises, mais c’est surtout un chèque à toutes les entreprises. Qu’il s’agisse de TPE ou de multinationales, d’entreprises en difficulté ou distribuant des dividendes, d’entreprises soumises à la concurrence internationale ou à l’abri de celle-ci, d’entreprises écologiques ou polluantes, toutes bénéficient de la même disposition, sans conditions. Dans des secteurs comme la grande distribution, les effets d’aubaine sont considérables. Les entreprises considérées sont-elles confrontées à un problème de compétitivité ? Les ménages français vont-ils faire leurs courses en Italie ?
Cette mesure, pourtant extrêmement onéreuse, ne fournit donc aucun levier pour orienter l’économie vers sa nécessaire transition écologique. C’est ainsi qu’il a été décidé d’utiliser cette maigre marge de manœuvre que tolérait la stratégie de la rigueur.
Sous la contrainte de ce double péché originel que constituent donc le TSCG et le CICE, le budget pour 2014 prévoit 6 milliards d’euros d’économies sur les amortisseurs sociaux et 1, 5 milliard d’euros sur les collectivités territoriales. Pour l’État et ses opérateurs, ce seront 7 milliards d’euros de coupes claires, dont je mesure les dégâts, par exemple, dans la police et la gendarmerie – je suis le rapporteur spécial de la commission des finances pour les programmes Police nationale et Gendarmerie nationale de la mission « Sécurités ». Heureusement, des crédits viennent d’être « dégelés » afin de pouvoir acheter 2 000 véhicules.
La mission « Écologie, développement et mobilité durables », dont vous comprendrez qu’elle nous est chère, fait partie de celles qui ont été le plus atteintes, alors même que la défense, qui ne figure pourtant pas au rang des trois priorités revendiquées par le Président de la République, est sanctuarisée.
Du côté des recettes, c’est en 2014 que devrait entrer en vigueur la hausse de la TVA. Le paradoxe du choix de la rigueur, monsieur le ministre, c’est qu’il suscite l’envie de s’alimenter sur des assiettes larges. Dès lors, le vrai malheur des gens modestes est d’être beaucoup plus nombreux que les riches ! En effet, lorsque la nécessité du rendement fiscal se fait pressante, il est moins rentable pour le Gouvernement de cibler et de proportionner son prélèvement que de ponctionner la grande masse des Français.
C’est donc par cet impôt régressif pesant sur les ménages – au moment où il est plutôt question de rendre les impôts plus progressifs – que sera largement financé le chèque en blanc aux entreprises.
En outre, le choix d’augmenter le taux intermédiaire à 10 % pénalisera beaucoup de secteurs participant à la transition écologique : transports en commun, traitement des déchets, gestion de l’eau.
Dans ce marasme budgétaire, deux mesures ont toutefois retenu positivement notre attention. La première a consisté à sortir la rénovation thermique des logements du champ de la hausse de TVA, pour en revenir à la situation antérieure au 1er janvier 2012 ; nous ne pouvons que nous en féliciter. La seconde mesure a consisté à poser les bases d’une contribution climat-énergie, ainsi que le Président de la République s’y était engagé. C’est une avancée majeure vers le verdissement de notre fiscalité. Nous regrettons néanmoins que le produit de cette contribution aille au financement du CICE, dont j’ai rappelé le caractère peu écologique, au lieu d’être investi ou d’être retourné aux redevables sous forme de compensations incitatives, conformément à l’objectif prioritaire d’une contribution climat-énergie.
De même, pour que le dispositif soit efficace, il conviendrait de revoir rapidement le prix de la tonne de carbone – 7 euros en 2014 et 22 euros en 2016 –, de manière à se rapprocher des montants qui figurent dans l’accord de mandature que nous avons passé avec nos amis socialistes, à savoir 36 euros dès 2012 et 56 euros en 2020.

Dans ce contexte, c’est avec grand intérêt que nous avons pris connaissance de l’annonce faite par le Premier ministre, dont je salue la volonté réformatrice, réaffirmant l’engagement du Président de procéder à une réforme fiscale. Sans doute n’est-il pas encore trop tard pour s’y atteler.
Cette réforme devra permettre d’en finir avec la dégressivité de l’impôt, qui voit aujourd’hui les plus riches contribuer proportionnellement moins que les gens modestes. Elle devra aussi permettre de rattraper le retard de la France, qui occupe l’avant-dernière place au sein de l’Union européenne en matière de fiscalité écologique. Ce sera l’occasion d’expliquer que l’écotaxe, soutenue par les syndicats et décriée par le MEDEF, est l’alliée du progrès social, qu’elle permet de faire payer les externalités, c’est-à-dire la destruction de l’environnement, aux quelques-uns qui en profitent aujourd’hui gratuitement plutôt qu’à l’ensemble de la collectivité, et d’expliquer aussi qu’en faisant payer le juste prix de la pollution on verra apparaître clairement les secteurs économiques condamnés qu’il convient d’aider à se transformer.
Monsieur le ministre, lors de l’examen du programme de stabilité, en avril, je vous avais dit que, si vous l’aviez soumis à un vote du Sénat, le groupe écologiste ne l’aurait pas voté. Lors du débat d’orientation, en juillet, je vous avais indiqué que nous ne pourrions pas, dans les conditions actuelles, accepter un budget de l’écologie en baisse.
Vous ne serez donc pas surpris d’apprendre que, en attendant la mise en œuvre de la grande réforme annoncée par le Premier ministre, à laquelle nous espérons être pleinement associés, comme l’ensemble des groupes parlementaires – y compris, sans doute, celui qui est le plus proche du pouvoir –, à moins d’avancées significatives dans la discussion des amendements, le groupe écologiste ne sera pas en mesure d’approuver le volet recettes de ce projet de loi.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à treize heures, est reprise à quinze heures.