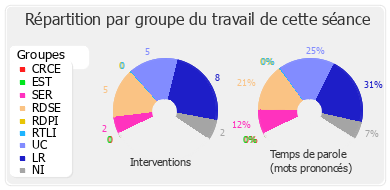Séance en hémicycle du 25 février 2014 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance est ouverte à quatorze heures trente.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

L’ordre du jour appelle le débat sur la justice de première instance, organisé à la demande de la commission des lois.
La parole est à M. Yves Détraigne, corapporteur.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, en octobre 2012, nous avions eu un débat dans cet hémicycle sur le rapport d’information intitulé La Réforme de la carte judiciaire : une occasion manquée, que notre ancienne collègue Nicole Borvo Cohen-Seat et moi-même avions rédigé au nom de la commission des lois.
Je rappelle que la réforme de la carte judiciaire avait abouti à la suppression de près du tiers des juridictions de notre pays. Elle avait notamment entraîné une réduction de 37 % du nombre des tribunaux d’instance – incarnation par définition de la justice du quotidien –, de 23 % des conseils de prud’hommes, de 30 % des tribunaux de commerce, mais de 12 % seulement – si je puis dire – des tribunaux de grande instance, lesquels ont été relativement épargnés.
Cette réforme, menée sans beaucoup de concertation, avait été purement quantitative. Nous avions regretté qu’elle n’ait pas été précédée d’une réflexion sur l’organisation même de notre justice, notamment sur la justice de première instance.
Dans ce rapport, après avoir souligné l’aspect purement quantitatif de la réforme et le manque de réflexion sur l’organisation judiciaire, nous proposions quelques pistes à suivre, notamment pour remédier aux problèmes d’éloignement qui en résultaient. Nous préconisions, au nom de la proximité, de la simplification et de la clarification de l’organisation des juridictions de première instance, d’explorer la piste du tribunal de première instance, laquelle semblait recueillir l’assentiment de la plupart des organisations représentatives du monde judiciaire. Cela a été fait dans le rapport intitulé Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, que Virginie Klès et moi-même avons présenté à la commission des lois le 9 octobre dernier.
J’observe que nous n’avons pas été les seuls à explorer cette piste d’évolution possible de notre organisation judiciaire. Dans son rapport, le groupe de travail présidé par M. Didier Marshall, premier président de la cour d’appel de Montpellier, est même allé plus loin que nous dans la déclinaison des mesures proposées. Par ailleurs, les échanges qui ont eu lieu sur votre initiative, madame la garde des sceaux, les 10 et 11 janvier 2014 à l’UNESCO dans le cadre du débat sur la justice du XXIe siècle, ont montré l’intérêt de cette piste.
De quoi s’agit-il ? Ma collègue Virginie Klès entrera dans le détail. Pour ma part, je vous présenterai les éléments de base qui sont à l’origine de notre réflexion.
Le premier élément est que, quelques années après une réforme des implantations judiciaires ayant fortement marqué le monde de la justice et laissé de mauvais souvenirs sur la manière dont elle avait été conduite – mais peut-être, et c’est une réflexion personnelle, était-ce la seule manière de pouvoir réformer de manière aussi forte notre organisation judiciaire ? –, il nous est apparu impossible de réengager une nouvelle réforme géographique pour remédier à l’éloignement constaté en de nombreux endroits. Il nous a donc semblé qu’il fallait chercher la solution dans une autre direction.
Le second élément est que, pour tous les Français qui ne sont ni magistrats ni auxiliaires de justice, le monde judiciaire est complexe. Qu’est-ce qui relève du tribunal d’instance, du tribunal de grande instance ou d’une juridiction spécialisée, et laquelle ? Comment y accéder ? Je rappelle que le code de l’organisation judiciaire mentionne presque une vingtaine de juridictions, qui diffèrent les unes des autres par leur composition, leurs compétences et leurs procédures.
Nous avons donc eu l’idée de proposer une porte d’entrée unique sur la justice de première instance, qui pourrait être le lieu de justice le plus proche du citoyen. Quel que soit le tribunal ou le juge du ressort compétent pour juger au fond l’affaire, le justiciable pourrait s’adresser à un greffe proche de chez lui, qui se chargerait ensuite de transmettre la demande à la juridiction compétente au fond.
À terme, le tribunal de première instance devrait réaliser la fusion des juridictions de première instance, sans nouvelle suppression d’implantations judiciaires. Les tribunaux actuels deviendraient des chambres détachées du nouveau tribunal de première instance. Ce TPI serait géré de la même manière qu’un tribunal de grande instance aujourd’hui, avec un président, un procureur de la République et un directeur de greffe, à l’autorité desquels seraient soumises l’ensemble des juridictions d’origine du ressort de ce TPI, ce qui permettrait d’aboutir à une mutualisation de leurs moyens.
Ce schéma de principe étant défini, il n’en reste pas moins vrai qu’un certain nombre de préalables doivent être réglés et que des étapes intermédiaires doivent être franchies avant de parvenir à cette fusion. Je laisse donc maintenant Virginie Klès vous indiquer de quelle manière nous envisageons cette évolution à terme.
Applaudissements.

Vous aurez noté la belle organisation de la commission des lois, monsieur le président !
Sourires.

Organisation, complémentarité et même parité, monsieur le président de la commission ! Cela méritait d’être relevé.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme l’indique le titre du rapport, c’est dans un esprit pragmatique que nous avons abordé cette mission d’information. Nous avons tenté de nous mettre à la place du justiciable et de raisonner en termes d’accessibilité à la justice.
Le terme « accessibilité » recouvre différentes réalités.
L’accessibilité suppose de comprendre l’organisation et le fonctionnement de la justice, ainsi que le langage juridique lui-même. Ce dernier recourt à des termes techniques, assez compliqués, voire un peu anciens pour certains d’entre eux.
L’accessibilité doit également être géographique. On ne peut pas parler d’accès à la justice quand il faut parcourir 200 à 300 kilomètres pour rejoindre un tribunal ou s’il n’existe pas de transports publics pour s’y rendre. Le maillage territorial de la justice, telle qu’elle sera organisée demain, nous paraît primordial.
L’accessibilité doit en outre être temporelle. Il faut pouvoir saisir rapidement un juge quand on en a besoin. De même, il est nécessaire qu’un jugement soit rendu le plus rapidement possible, ce qui ne signifie pas pour autant dans les jours ou les semaines qui suivent la saisine. En tout état de cause, le justiciable doit comprendre pour quelles raisons la justice n’est pas rendue aussitôt.
Enfin, l’accessibilité doit être financière. Cette question, qui n’entrait pas dans le champ de notre mission, fait l’objet d’autres travaux, notamment d’un rapport consacré à l’aide juridictionnelle. Bien évidemment, elle ne concerne pas que les juridictions de première instance.
Quelle est l’image de la justice ? Si l’on se réfère au numéro de janvier 2014 d’Infostat justice, le regard des Français n’a pas beaucoup changé depuis 2001. Qu’ils aient ou non été confrontés à la justice – seul un tiers d’entre eux environ a eu affaire à la justice au moins une fois dans leur vie –, leur opinion est à peu près semblable : 95 % d’entre eux reprochent à la justice sa lenteur et 80 % à 88 % sa complexité. S’ils ont du mal à y accéder, c’est parce qu’ils ont du mal à la comprendre. En outre, 65 % des Français trouvent qu’elle est peu moderne.
Le taux de satisfaction des Français ayant eu affaire à la justice est en général assez élevé. Nos concitoyens ont confiance dans la justice qui leur est rendue, mais ils trouvent que son organisation pourrait être améliorée, ce qui démontre à la fois, me semble-t-il, leur attachement à la justice et leur reconnaissance du travail des magistrats, des greffiers et des autres fonctionnaires de la justice.
L’indépendance des juges est aussi reconnue par plus de 60 % des Français.
Nos propositions collent à cette réalité de fait, qui est venue conforter l’impression que nous avions a priori. Je me demande d’ailleurs si beaucoup d’entre vous dans cet hémicycle savent, par exemple, à quel tribunal d’instance ou de grande instance il leur faudrait s’adresser s’ils devaient gérer la tutelle d’un majeur ou d’un mineur.

Vous, vous le savez, monsieur Mézard, mais je ne suis pas certaine que cela soit le cas de tout le monde dans l’hémicycle. De même, je ne suis pas sûre que tout le monde sache quelles procédures sont écrites ou orales, ni même dans quels cas on a besoin d’être représenté ou non par un avocat. Ces informations ont besoin d’être rendues plus lisibles pour nos concitoyens et plus accessibles.
Pour accompagner les justiciables vers la justice et à l’intérieur de la justice, nous avons envisagé la création de ce que nous avons appelé le « guichet universel de greffe », et non pas le guichet unique de greffe. En règle générale, le greffe est la première porte d’accès à la justice. Il nous semble donc qu’il faut véritablement renforcer son rôle et ses moyens, y compris ses moyens matériels, en particulier en informatique, afin qu’il puisse être en mesure de mieux orienter et de mieux accompagner les justiciables.
Une telle réforme nécessite – c’est un préalable, madame la garde des sceaux, et je suis certaine que vous serez extrêmement attentive sur ce point – de rassurer les personnels des greffes et d’affirmer, ainsi que l’a dit mon collègue Yves Détraigne, qu’il ne s’agit pas de mettre en place une nouvelle carte judiciaire. Il faut leur dire que cette réforme n’entraînera pas de suppressions de postes, bien au contraire. Il faut enfin leur donner des garanties statutaires en termes de mobilité géographique. Ils doivent savoir qu’ils ne seront pas déplacés au gré des humeurs des chefs de juridiction du futur tribunal de première instance, s’il doit voir le jour. Cela signifie que le maillage territorial sera respecté et que les personnels des greffes verront leur situation s’améliorer, tant en termes de formation que de rémunération.
Les personnels des guichets universels de greffe devront pouvoir accompagner les justiciables et les informer, tant en matière pénale que civile par exemple. Un tel accompagnement nécessitera une formation et des compétences complémentaires et donc une rémunération supplémentaire.
Il faudra bien évidemment aussi penser à harmoniser les procédures.
Si nous voulons réellement être efficaces, ces lieux de premier accès à la justice devront pouvoir faire le lien avec les associations d’aide aux victimes, avec les médiateurs et les conciliateurs afin de « déjudiciariser » tout ce qui peut l’être. Les Français sont d’accord sur le fait que, dans nombre de cas, l’intervention du juge n’est pas absolument nécessaire et qu’une médiation ou une conciliation sont des outils tout aussi efficaces pour régler certains différends.
L’accessibilité doit être géographique, disais-je, car tous les services que je viens d’évoquer doivent être rendus à proximité immédiate des citoyens, au sein d’un guichet universel de greffe. Notre idée – nous sommes loin de la réforme de la carte judiciaire ! – est de maintenir tous les lieux d’accès à la justice qui existent aujourd'hui, à savoir le maillage territorial des tribunaux d’instance, ainsi que celui des maisons de justice et du droit, lesquelles gagneraient sans doute à voir leurs moyens renforcés afin d’être mieux connues des Français. Aujourd'hui, seuls 18 % de nos concitoyens savent ce que sont les maisons de justice et du droit.
Si les tribunaux de première instance doivent voir le jour demain, il doit y en avoir au moins un par département et ils doivent sans doute s’établir dans les lieux qui sont aujourd'hui le siège des tribunaux de grande instance. Dans certains départements, il est impossible d’imaginer que la justice puisse fonctionner sans deux tribunaux de première instance, des chambres détachées reprenant le maillage des tribunaux d’instance, ainsi que des maisons de justice et du droit. En tout cas, il est nécessaire d’établir un maillage territorial important.
Les juridictions de proximité seront sans doute supprimées, mais les juges de proximité, eux, ne doivent pas être oubliés. Ils doivent être reversés aux actuels tribunaux de grande instance, puis aux futurs tribunaux de première instance. Il est sans doute nécessaire que leur formation soit consolidée, afin que les contrats puissent être renouvelés. Ne nous passons pas des juges de proximité !
Les moyens matériels nécessaires sont essentiellement de nature informatique. En matière pénale, il faut conserver le logiciel CASSIOPÉE. En matière civile, en revanche, l’application Portalis doit impérativement faire l’objet de mesures prioritaires et urgentes de la part de la Chancellerie. Si l’on veut vraiment que les chambres détachées des futurs tribunaux de première instance ou les maisons de justice et du droit fonctionnent bien et mieux, il est nécessaire que tous les magistrats et greffiers qui travailleront dans ces lieux de justice puissent entrer les données et y accéder afin d’informer correctement les justiciables et de rendre un vrai service de justice de proximité. L’informatisation est une urgence dont il faut faire une priorité absolue dans le cadre de la réorganisation de la justice. Cela correspond d’ailleurs à une demande des Français, qui trouvent que leur justice fonctionne parfois de manière un peu désuète. Ils pourraient ainsi effectuer un certain nombre de démarches depuis leur domicile grâce à internet et en communiquant par mails.
Par ailleurs, il serait bon que la loi fixe un bloc de compétences minimales aux chambres détachées des tribunaux de première instance. Celles-ci pourraient reprendre peu ou prou les compétences exercées par les tribunaux d’instance et de grande instance. Les chefs de juridiction pourraient également confier à ces chambres détachées des compétences supplémentaires en fonction des besoins recensés localement. J’ajoute que, si le bloc de compétences minimales doit être fixé par la loi, c’est pour éviter que les juges, comme il est naturel et humain, concentrent ce qui les intéresse au siège du tribunal de première instance et délèguent ce qui ne les intéresse pas aux chambres détachées.
Petit à petit, évitant ainsi les révolutions, qui font beaucoup de dégât quand elles ont lieu brutalement, les juridictions pourraient être rapprochées. Je pense par exemple aux tribunaux des affaires de sécurité sociale et aux tribunaux du contentieux de l’incapacité. Il est nécessaire que les membres de ces tribunaux apprennent à se connaître, à travailler ensemble, à répartir les compétences. Le Défenseur des droits – cet exemple est très parlant, même s’il ne concerne pas directement la Chancellerie – a su rassembler sous un même toit des compétences, des façons de fonctionner et des cultures différentes, pour le plus grand bénéfice de tous et pour un meilleur fonctionnement de cette institution. On doit pouvoir réaliser le même travail avec les juridictions. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais progressivement, par la persuasion, par la pédagogie et non par la contrainte. Madame la garde des sceaux, je sais que vous partagez cette façon de voir les choses. Il s’agit de convaincre encore et encore !
Notre rapport examine de nombreuses autres possibilités de rapprochement entre les différents acteurs, mais je ne vais pas toutes les exposer aujourd'hui. Je vais simplement revenir en quelques mots sur ce que j’ai appelé l’« accessibilité temporelle ».
Le grand principe du rapprochement des juridictions qui figure dans notre rapport rejoint les recommandations d’autres rapports, notamment celui de Didier Marshall. Si la justice est réorganisée progressivement, comme nous le proposons, nous pensons que, grâce à la mutualisation des compétences, son fonctionnement en sera amélioré. Nous pensons également que le ressenti des justiciables sera meilleur. En effet, s’ils peuvent régulièrement consulter leur dossier pas trop loin de chez eux, comprendre pourquoi la procédure n’a pas avancé davantage, savoir quelle est la prochaine étape, le temps leur semblera moins long que s’ils restent des mois durant sans aucune nouvelle de l’institution judiciaire au sujet de l’affaire qui les occupe.
J’en viens à l’avenir.
Je précise qu’il nous manquait de nombreuses données pour aller plus avant dans notre rapport, notamment celles que présentera la mission d’information sur la justice familiale, dont nous examinerons demain en commission des lois le rapport rédigé par nos collègues Catherine Tasca et Michel Mercier.
Il faudra également veiller à la cohérence de l’éventuel tribunal de première instance avec la deuxième instance, en tenant compte de la réflexion actuelle sur les cours d’appel. Sur ce point également, le Sénat a constitué une mission d’information qui publiera bientôt un rapport présenté par nos collègues Alain Richard et Bernard Saugey.
Enfin, il faudra réfléchir à nouveau à la dualité de notre justice juridictionnelle et de notre justice administrative. Certains points méritent peut-être d’être retravaillés ; toutefois, je me sens bien trop peu juriste aujourd'hui pour m’engager sur ce chemin extrêmement compliqué.
Pour conclure, je dirai que la première étape nous semble être celle des guichets universels de greffe. Si nous arrivons à la franchir en confiance avec les personnels de la justice de première instance d’aujourd'hui, nous aurons déjà fait beaucoup pour l’accessibilité de la justice et l’amélioration de son fonctionnement.
Applaudissements.

Notre débat d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre du chantier de la justice du XXIe siècle que vous avez lancé il y a plusieurs mois, madame la garde des sceaux. La question n’est pourtant pas nouvelle, comme en témoignent le rapport Guinchard, le rapport Casorla et d’autres. Je pourrais d’ailleurs résumer la situation en disant que nous avons besoin de magistrats et de greffiers. Si nous les avions, je ne dis pas que tous les problèmes seraient réglés, mais ce serait un progrès considérable compte tenu de l’état de la justice dans notre pays.
Des nombreux rapports rédigés, il ressort que la justice de première instance est complexe et peu lisible pour le justiciable. Outre le tribunal de grande instance, on peut dénombrer plus d’une vingtaine de juridictions : des tribunaux d’instance aux tribunaux de commerce, en passant par les conseils de prud’hommes ou les juridictions échevinales comme le tribunal paritaire des baux ruraux, le tribunal des affaires de sécurité sociale et bien d’autres.
Comme l’ont fait remarquer nos excellents rapporteurs, à la question du ressort de ces juridictions, qui diffère selon la juridiction concernée, s’ajoute l’absence de correspondance entre un type de juridiction et le contentieux pour lequel elle est compétente ainsi que la nature de la procédure suivie en cette matière. Les impératifs constitutionnels de sécurité juridique et d’accès effectif au juge sont au cœur de cette question.
La création des tribunaux de première instance – cela rappelle l’excellent temps de la IIIe République ; je ne peux que vous inciter à revenir aux sources et aux fondements de la République – résulterait de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance au siège actuel de chaque tribunal de grande instance, comme le préconisent le rapport Marshall et le rapport Détraigne-Klès. Ce tribunal de première instance permettrait de constituer une porte d’entrée unique pour la justice et de simplifier les démarches du justiciable, qui n’aurait à s’adresser qu’à un seul greffe. Ce greffe se chargerait ensuite de transmettre administrativement la demande à la juridiction compétente. Cela représenterait une avancée pour les justiciables. À ce titre, il devrait également être possible d’examiner l’idée de la création d’une juridiction de sécurité sociale unique.
Cette réforme, qui est attendue et qui correspond à un souci assez partagé sur les différentes travées de notre assemblée, dans la droite ligne du choc de compétences, formule que je préfère à « choc de simplification », ne doit pas conduire à une diminution des moyens de la justice, après la réforme de la carte judiciaire dont les dégâts se font encore sentir. Vous avez certes fait un pas considérable en rétablissant le tribunal de grande instance de Tulle, mais ce n’est pas suffisant.
Il n’est pas le seul à avoir été rétabli !

... le trait d’humour.
Il faut également mettre en œuvre la mutualisation des moyens, qui doit être le fleuron d’une réforme efficace de la justice de première instance.
Le meilleur moyen de faciliter l’accès à la justice, comme je l’ai dit, c’est d’avoir un nombre de magistrats et de greffiers suffisant. Il faut également accroître la dématérialisation dans le domaine judiciaire.
L’accessibilité à la justice, vous le savez car nous nous en sommes déjà entretenus, pose aussi la question difficile de la réforme indispensable du système de l’aide juridictionnelle. Cette aide bénéficie aujourd’hui à plus de 900 000 personnes et est absorbée aux deux tiers par le contentieux civil.
La suppression du droit de timbre de 35 euros, qui est une bonne mesure que vous avez initiée, entraîne des pertes de recettes qu’il faut compenser. Je travaille avec d’autres sénateurs et sénatrices à un rapport qui sera prêt dans quelques semaines. En effet, il faut absolument trouver des sources de financement diversifiées, d’autant que nous connaissons la situation du budget de l’État.
La question de l’accès à la justice est un vrai problème aujourd'hui. Ne revenons pas sur le rapport de la commission Darrois, qui est assez original et qui ne mérite pas qu’on en dise davantage… Reste que le système actuel ne garantit pas un égal accès de tous les justiciables. En particulier, on sait que nombre de nos concitoyens qui ont des revenus faibles, de 1 000 à 1 500 euros par mois, ne peuvent pas avoir un véritable accès à la justice. Il faut donc progresser rapidement dans ce domaine.
Je m’interroge sur les bons moyens de conforter les juridictions de première instance et de développer la conciliation judiciaire. Il est en effet nécessaire de conserver la proximité. Or la suppression d’un certain nombre de tribunaux d’instance a posé beaucoup de problèmes. Dans une vie de justiciable, il est rare d’avoir affaire à la cour d’appel. Et ne parlons pas de la Cour de cassation ! En revanche, quand on est confronté aux problèmes du quotidien, on a besoin d’une justice de proximité, aussi bien spatiale que temporelle.
Nombre de gouvernements, toutes sensibilités confondues, ont tendance à aller vers la déjudiciarisation. C’est à la mode, parce que ce moyen permet, paraît-il, de faire des économies. Or ce n’est pas de cela que nous avons besoin. Si le seul objectif de la déjudiciarisation est de désengorger les tribunaux, il ne faut pas oublier quelle est la raison d’être du magistrat. Je suis de ceux qui considèrent, par exemple, qu’il ne peut pas y avoir de divorce sans juge, car il faut vérifier la réalité du consentement des parties et préserver un certain équilibre. Plus on dit qu’il faut sortir du cadre judiciaire, plus, à mon avis, on s’éloigne de la justice.
Je ne suis pas favorable non plus au rapport Delmas-Goyon, qui privilégie les économies pécuniaires à l’économie de la justice elle-même.
Les juridictions sont très encombrées, nous le savons. Les charges n’ont cessé d’augmenter, alors que les effectifs de magistrats sont restés à un niveau très faible ; c’est ça, le véritable problème ! Il y a plusieurs centaines de postes vacants. Vous avez hérité d’une situation difficile. Je ne dis pas – loin de là – qu’elle s’est aggravée, mais elle demeure atypique par rapport aux autres pays européens.
Je suis de ceux qui croient à la nécessité de conforter le rôle et la présence du magistrat et du greffier. Nous avons ici une statue de Portalis. Voici ce qu’il écrivait : « Les questions de divorce étaient attribuées à des conseils de famille ; nous les avons rendues aux tribunaux. L’intervention de la justice est indispensable, lorsqu’il s’agit d’objets de cette importance. » Si nous ne sommes pas opposés par principe aux modes alternatifs de règlement des litiges, qui sont une forme de déjudiciarisation, nous nous interrogeons sur leur efficacité. La gestion de la pénurie judiciaire ne saurait tout justifier. Nous avons vu les résultats de l’expérimentation des citoyens assesseurs ; Yves Détraigne connaît bien ce sujet, sur lequel il a rédigé un excellent rapport.
En conclusion, madame la garde des sceaux, l’amélioration de notre système judiciaire de proximité passe – je vous l’ai déjà dit – par le renforcement de l’office conciliateur du juge, de l’ancien juge de paix. Aux termes de l’article 829 du code de procédure civile – j’aime la procédure –, « la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d’assigner ». C’est le rôle de conciliateur du juge d’instance qu’il faut renforcer. Le problème est qu’il n’a plus le temps de mener cette action de proximité. Quand il a le temps, il résout les litiges dans le calme, par la transaction. C’est cette voie que nous devons privilégier. Elle est toujours prévue par le code de procédure civile ; il faudrait qu’elle redevienne une réalité. Cette mission légale du juge présente pour nous un caractère impératif.
« La justice est la première dette de la souveraineté », écrivait encore Portalis. Nous vous demandons simplement de mettre cet excellent principe en application.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la justice de première instance, porte d’entrée des citoyens vers leur justice, devrait toujours être accessible et simple. Or, comme le rappellent nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne dans le rapport qui sert de base à notre débat, « le constat de la complexité et du manque de lisibilité de l’organisation judiciaire française n’est plus à faire ».
En effet, la compétence de droit commun du tribunal de grande instance est aujourd’hui doublement limitée. Elle l’est d'abord par le grand nombre de contentieux confiés à des juridictions spécialisées, comme le tribunal de commerce, le conseil de prud’hommes ou le tribunal des affaires de sécurité sociale. La quasi-totalité des contentieux social et commercial échappent ainsi au TGI, qui connaît principalement des affaires civiles ou pénales.
La compétence de droit commun du TGI est également limitée dans la mesure où il ne connaît que des demandes indéterminées ou d’un montant supérieur à 10 000 euros ; c’est le tribunal d’instance qui est compétent pour les demandes d’un montant inférieur. Ajoutons à cela les réformes de ces dernières années, dont l’emblématique réforme de la carte judiciaire, engagée en 2007 par Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, qui a abouti à la suppression de 178 tribunaux d’instance et à une diminution importante de la confiance des citoyens en leur justice et leurs juges.
J’avais eu l’occasion de le dire dans cet hémicycle à la fin de l’année 2012, alors que nous débattions des juges de proximité : c’est tout l’appareil judiciaire de première instance qu’il faut revoir. Une réforme ambitieuse et l’apport de moyens financiers et humains plus importants sont plus que jamais nécessaires. Madame la garde des sceaux, je connais votre engagement sur ces questions. La réflexion a débuté il y a près de dix-huit mois : une concertation a été menée avec de nombreux acteurs de la vie judiciaire et parlementaire.
C’est dans cet esprit que nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne soulignent – le groupe écologiste souscrit totalement à leur opinion – que, s’il est urgent de s’engager sur la voie de la réforme, il convient, à court terme, de donner la priorité à l’accessibilité de la justice. Pour ce faire, trois chantiers peuvent d’ores et déjà être engagés.
Le premier est la création d’un guichet universel de greffe, souvent préconisée mais jamais encore mise en œuvre. Ce guichet, qui permettrait au justiciable de recevoir des informations sur les modalités de saisine des juridictions, d’introduire les procédures qui peuvent s’effectuer sans avocat et de suivre le déroulement des procédures en cours, serait sans aucun doute garant d’une plus grande proximité judiciaire. Toutefois, comme le soulignent tant les auteurs du rapport que les syndicats de magistrats, cette réforme doit s’accompagner d’une politique de ressources humaines ambitieuse.
Le deuxième chantier est le renforcement des moyens de projection judiciaire, afin de maintenir une présence judiciaire là où elle risquerait de manquer. En effet, si le guichet universel de greffe apporte une première réponse au problème de la proximité judiciaire, il se limite toutefois à l’information et à l’entrée dans la procédure. Dans leur rapport sur la réforme de la carte judiciaire, nos collègues Nicole Borvo Cohen-Seat et Yves Détraigne appelaient au développement des audiences foraines pour remédier à l’éloignement trop important de la juridiction de regroupement par rapport à la juridiction supprimée. Je pense moi aussi qu’il faut renforcer les audiences foraines lorsqu’elles apparaissent nécessaires ; l’expérience menée avec succès en Picardie le montre. De surcroît, s’il existe de multiples difficultés dans ce domaine, la création d’un guichet universel de greffe et la mutualisation des effectifs des greffes devraient permettre de surmonter nombre d’entre elles.
Enfin, le troisième chantier est la poursuite de la déjudiciarisation et de la réforme des procédures afin de permettre au juge de se concentrer sur sa mission première, qui est de trancher les litiges qui lui sont soumis par les justiciables. En effet, comme le soulignent à juste titre nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne dans leur rapport, « la réforme de la justice de première instance ne peut se limiter à une réforme des structures. Dans un contexte de forte contrainte budgétaire et compte tenu de l’importance de la charge de travail qui pèse aujourd’hui sur les magistrats, elle doit inclure une réflexion sur l’office du juge, afin de lui permettre de se concentrer sur sa fonction principale et retrouver ainsi des marges de manœuvre pour le mobiliser sur les actions qui le méritent. »
L’une des voies qui pourraient être suivies est l’attribution aux greffiers en chef de certaines prérogatives juridictionnelles limitées aujourd’hui détenues par le juge. Les greffiers ont en effet reçu la formation adéquate, et de nombreuses personnes auditionnées représentant les magistrats se sont prononcées en faveur d’une telle évolution. Il faudrait cependant, ici encore, être vigilant sur les moyens humains mis en œuvre, et il est certain que de nombreux greffiers devraient être recrutés.
Mes chers collègues, telles sont les mesures concrètes qui peuvent dès maintenant être mises en place et que le groupe écologiste appelle de ses vœux. Pour conclure, je reprendrai les mots du Premier ministre : « La justice mérite la confiance des Français. Chaque fois qu’elle s’affaiblit, c’est le pacte républicain qui s’affaiblit. Nous avons tous un combat à mener pour le redressement de la République. » Le groupe écologiste mènera ce combat nécessaire, mais sera toujours vigilant à ce que des moyens à la hauteur des enjeux lui soient attribués.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, depuis quelques années, la principale richesse de notre justice est le nombre de rapports qui lui sont consacrés. Il n’est qu’à voir le nombre de rapports qui ont été cités par les différents intervenants ce soir. C’est extraordinaire !
Tout le monde cherche à améliorer le fonctionnement de la justice, et il y a plusieurs manières de procéder.
On peut trancher à la hache : c’est la réforme de la carte judiciaire. On en parlait depuis vingt ou vingt-cinq ans – le Sénat y avait même consacré deux rapports –, mais rien n’était fait, car il est toujours difficile de supprimer ou de regrouper des juridictions.
On peut débattre, par exemple du tribunal départemental ou du parquet départemental. Sous toutes les majorités, on a débattu, chacun essayant de faire en sorte que les juridictions fonctionnent mieux. Il est donc normal que la commission des lois rédige, elle aussi, beaucoup de rapports sur le sujet, comme celui sur la réforme de la carte judiciaire publié il y a deux ans. La Chancellerie et d’autres acteurs mènent également leurs propres réflexions.
Nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne plaident, quant à eux, pour une « réforme pragmatique de la justice de première instance ». Naguère, le principal débat portait sur les décisions rendues par un juge unique, comme celles du tribunal d’instance, et les décisions rendues par une formation collégiale, comme celles du tribunal de grande instance, même si le président du TGI a des fonctions particulières. Aujourd'hui, ce débat n’est plus forcément d’actualité. On s’est rendu compte que le principe de collégialité, qui était défendu mordicus par beaucoup de nos collègues, pouvait ne pas être immuable. Du reste, le Conseil constitutionnel ne s’oppose pas à l’intervention d’un juge unique dès lors qu’il existe des procédures d’appel.
L’apport fondamental du rapport de nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne est le guichet universel de greffe. Cette idée me semble d’autant plus intéressante qu’elle permettrait à tout justiciable d’être orienté dans le maquis judiciaire. Pour autant, n’exagérons pas : un chef d’entreprise sait très bien qu’il doit s’adresser au tribunal de commerce ! Je rappelle d'ailleurs que la création des tribunaux de commerce est à peu près contemporaine de celle des autres juridictions. En revanche, il n’est pas toujours facile de savoir si l’on doit s’adresser au tribunal d’instance ou au tribunal de grande instance, puisque cela dépend du montant prévisible du litige. Le rapport estime qu’il faut conserver le critère du montant du litige. Pour ma part, je ne suis pas totalement convaincu. Peut-être pourrait-on trouver d’autres critères.
Le rapport évoque également les juridictions de proximité. Madame le garde des sceaux, la commission des lois du Sénat avait affirmé que la création des juridictions de proximité n’était pas une bonne idée. Nous l’avions même écrit. Malgré tout, ces juridictions ont été créées. Il faut bien faire des compromis… Quand le Président de la République se prononce en faveur d’une réforme, tout le monde dit qu’il faut la faire. Pourtant, dans certains cas, mieux vaudrait essayer de convaincre le Président de la République qu’il ne s’agit pas forcément d’une bonne idée, …

… surtout quand tout part d’une simple phrase dans un discours.
Je le répète, nous pensions que la création des juridictions de proximité n’était pas une bonne chose. En revanche, il nous semblait utile de conserver des juges de proximité auprès des tribunaux d’instance ou de grande instance, car ceux-ci peuvent apporter une aide non négligeable à la justice.
Nous avons créé beaucoup de fonctions : délégué du procureur, médiateur, conciliateur, etc. Néanmoins, à mon sens, les juges de proximité, pour un certain nombre de petits litiges, pourraient être mieux utilisés. Aussi, je regretterais qu’ils soient supprimés à terme. Il me semble même qu’ils seraient susceptibles de constituer un renfort extrêmement utile pour les juridictions, surtout dans le cadre d’un vrai tribunal de première instance. Cependant, madame le garde des sceaux, avant de créer ce tribunal de première instance, il importe d’harmoniser les procédures et de procéder à une nouvelle répartition des contentieux. C’est une condition sine qua non ; à défaut, nous allons continuer à observer ce flou et ces empiétements.
Par ailleurs, je suis d’accord avec Jacques Mézard lorsqu’il met en garde contre trop de déjudiciarisation. Reste qu’il faut arrêter de créer systématiquement de nouveaux contentieux. Mes chers collègues, regardez tout ce que nous avons fait en matière de consommation : nous avons multiplié les sources de litiges judiciaires ! Il en va de même avec la loi ALUR, dont je ne sais si elle a belle allure… Et je ne parle pas des lois que nous avons votées sur le surendettement, qui nous ont vus successivement judiciariser, déjudiciariser, rejudiciariser plusieurs fois la matière ! Ce phénomène est d’autant plus infernal qu’il intervient sans aucune véritable étude d’impact sur le fonctionnement des juridictions, notamment des tribunaux d’instance, qui sont les plus sollicités.
Madame Klès, monsieur Détraigne, vous appelez de vos vœux un tribunal de première instance. Votre proposition a fait l’objet de nombreuses objections, notamment constitutionnelles, liées à l’indépendance des magistrats. À mes yeux, de tels obstacles ne sont pas avérés. Néanmoins, je crois qu’il faudrait se cantonner, dans un premier temps, à la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance. Ensuite, il faudra s’interroger sur l’étendue de la compétence des chambres détachées des TGI.
Je veux bien entendre votre proposition de créer un tribunal départemental, mais pas partout, car, dans certains cas, cela n’a pas de sens. Je le répète, il y a actuellement des TGI dans notre pays qui sont des monstres, notamment autour de Paris. Ce sont de véritables usines à justice qui n’ont plus taille humaine, sans préjuger la qualité des hommes qui les composent. Là encore, il faudrait peut-être envisager des chambres détachées pour mieux répartir l’organisation de la justice sur ces territoires.
Il y a aussi des objections fortes en ce qui concerne le risque d’éclatement du pôle de la famille, avec la dispersion des juges spécialisés dans le domaine de l’enfance, qui sont l’une des spécificités de notre système judiciaire. Il en va de même pour les conseils de prud’hommes, les tribunaux de commerce, dont la dernière réforme a été précédée de beaucoup de rapports également. Les propositions que vous faites appellent donc de notre part de la vigilance et de la prudence avant de nous lancer dans une nouvelle réorganisation de notre architecture judiciaire.
Madame le garde des sceaux, il est vrai que notre justice manque de moyens. À cet égard, les comparaisons internationales ne sont pas toutes pertinentes, le champ du contentieux n’étant pas toujours le même. Par exemple, en France, la justice consulaire est pratiquement gratuite, ou du moins coûte-t-elle beaucoup moins cher que dans d’autres pays où officient des juges professionnels ou des échevins, ce qui est forcément plus onéreux.
Or, quelles que soient vos convictions et les priorités que le Président de la République et le Gouvernement reconnaissent à la justice, je ne pense pas que ses moyens augmenteront significativement à l’avenir. Si certains crédits ministériels feront l’objet d’une réduction drastique, la justice, comme la sécurité et, je l’espère, la défense verront leurs moyens garantis, mais ils ne seront plus augmentés comme ils l’ont été durant les vingt dernières années en proportion du budget de l’État.
Il convient donc de mieux utiliser les moyens en simplifiant. À cet égard, je dis toujours que la justice concerne non seulement les juges et les justiciables, mais aussi les auxiliaires de justice, lesquels contribuent souvent autant que les magistrats à la réussite de la justice. Ce constat nous renvoie à la question de la réforme de l’aide juridictionnelle, à laquelle nous n’échapperons pas. Objectivement, le dispositif n’est plus financé : les avocats ne sont pas payés, ou avec beaucoup de retard, et les bureaux d’aide juridictionnelle font ce qu’ils peuvent. Je le répète, il faudra réformer ce système.
Il nous avait été reproché d’avoir mis en place une taxe. Aujourd’hui, tout le monde se réjouit qu’elle ait été supprimée, même si rien n’est prévu pour compenser le manque à gagner…

D’accord, mais comme l’aide juridictionnelle était déjà largement déficitaire, …

… elle va l’être encore plus après l’adoption du projet de loi dont nous avons débattu hier : entre 13 millions et 29 millions d’euros de plus.

Pour conclure, je dirais que si nous voulons que chacun puisse accéder à la justice, que chacun puisse être défendu dans de bonnes conditions et que les victimes soient respectées, le rapport très intéressant de nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne doit nous conduire à améliorer très rapidement le fonctionnement des greffes. Pour ce faire, il n’est nul besoin de voter une loi, car il s’agit d’organisation judiciaire.
Enfin, nous devons continuer à réfléchir à une réforme de nos juridictions, tout en respectant l’aménagement du territoire, pour que les juges ne soient pas trop éloignés des justiciables. Cependant, gardons à l’esprit que beaucoup de nos concitoyens sont très heureux de ne jamais avoir affaire à la justice !
Applaudissements sur les travées de l'UMP, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la réforme de la carte judiciaire réalisée sous la législature précédente avait entraîné la disparition et le regroupement de nombreuses juridictions, principalement des tribunaux d’instance, remettant ainsi en cause l’accès à une justice simple et proche des justiciables. Elle avait également affecté l’ensemble des partenaires de justice et posé la question des conditions d’exercice du service public de la justice et de sa présence sur le territoire, auprès de tous les citoyens, en particulier des plus isolés.
La question d’une réforme profonde de l’institution judiciaire et de son organisation est donc plus que jamais nécessaire. Elle est largement réclamée par les organisations syndicales, mais il reste à savoir comment elle se fera.
Madame la garde des sceaux, vous avez réaffirmé, au mois de janvier dernier, lors du colloque sur la justice du XXIe siècle, votre volonté d’améliorer et de moderniser la justice. L’une des pistes envisagée est la création d’un tribunal de première instance qui aurait vocation à unifier la plupart des juridictions, et ce dans un souci de simplifier la justice et d’en garantir l’accès à tous les citoyens. Cette perspective de nouvelle répartition des contentieux paraît évidemment séduisante, puisqu’elle permet d’adapter l’organisation judiciaire à cette exigence de proximité. C’est l’objectif louable que vise la création d’un guichet unique de greffe, comme vous l’avez proposé, qui permettrait de construire une nouvelle proximité judiciaire en rendant possible la saisine d’un juge dans le tribunal le plus proche du justiciable, et ce quel que soit le tribunal effectivement compétent.
Nicole Borvo Cohen-Seat et Yves Détraigne, auteurs du rapport d’information fait au nom de la commission des lois du Sénat en 2012, tout en émettant des réserves, voyaient trois avantages majeurs à la mise en place d’un tribunal de première instance : il permettrait « d’adapter les réponses judiciaires aux besoins de la population et d’assurer une présence judiciaire effective » ; il « garantirait la lisibilité […] de l’organisation judiciaire et simplifierait la saisine des juridictions » ; enfin, par la mutualisation des effectifs, « il assurerait aux chefs de juridiction une plus grande facilité de gestion ». Ces idées ont été reprises et approfondies dans le rapport d’Yves Détraigne et de Virginie Klès rendu cette année.
Si ses objectifs sont louables, la création d’un tribunal de première instance soulève malgré tout quelques interrogations, car le souci de cohérence et de lisibilité de l’institution judiciaire ne doit pas se traduire par la création d’une « hyper-structure gestionnaire », selon les termes de magistrats inquiets, qui aurait pour but de remplir des objectifs gestionnaires de souplesse et de flexibilité. Je profiterai d’ailleurs de ce débat pour relayer les interrogations et inquiétudes des professionnels de justice.
Tout d’abord, ce dispositif prévoit la fusion des juridictions de première instance et le rattachement des tribunaux d’instance transformés en chambres détachées. Se pose donc la question du périmètre fonctionnel d’une telle fusion. Comment intégrer des juridictions dont les procédures et la composition diffèrent sans remettre en cause leurs spécificités ? En effet, la création des TPI pourrait présenter un réel danger pour le fonctionnement de la justice en entraînant une perte d’identité pour les juridictions absorbées, voire une dégradation du service rendu aux justiciables.
Ensuite, une réforme du TPI ne doit pas conduire à une baisse des effectifs et des crédits budgétaires, tous les sites judiciaires correspondant aux tribunaux d’instance devant pouvoir être maintenus comme chambres détachées. L’idée d’un TPI départemental unique présente un certain risque : celui d’éloigner la justice des citoyens et, surtout, de ceux, isolés ou fragiles, qui y ont ordinairement difficilement accès, a fortiori pour ce qui est des juges spécialisés, qui ne pourraient se maintenir que dans les sites pouvant comporter des collèges de taille suffisante.
En outre, il est permis d’émettre quelques réserves sur le souhait d’harmonisation des procédures et de répartition des contentieux. En effet, certaines fonctions juridictionnelles spécialisées, comme celle de juge d’instance, seraient menacées de disparition, et le nouveau contentieux de proximité risquerait d’être déséquilibré s’il incluait une partie du contentieux familial, qui, nous le savons, représente tout de même plus de la moitié de l’activité civile des tribunaux de grande instance.
Enfin, dans le cadre de ce tribunal de première instance, il pourrait être procédé à une mutualisation des moyens et des effectifs au sein du TPI, ce qui permettrait aux chefs de juridiction de gérer selon leur souhait le personnel. Dans ce cas, il ne faudrait pas que les logiques de gestion ou de rationalisation prennent le pas sur la qualité de la réponse à apporter aux justiciables. Il importe d’y être d’autant plus attentif que l’insuffisance des moyens de la justice est particulièrement criante, comme j’ai eu l’occasion de le vérifier moi-même récemment à l’audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Créteil où les magistrats se plaignent d’un nombre de postes vacants très important, s’agissant pourtant d’un ressort particulièrement populaire dans lequel, vous le savez, madame la garde des sceaux, les besoins sont immenses.
Il est à craindre également que la mutualisation des effectifs ne tende à diluer la spécialisation des magistrats, qu’il est pourtant nécessaire de préserver pour offrir un service de justice de qualité pour tous.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons être assurés que la réforme du TPI ne se fera au détriment ni des justiciables ni du personnel judiciaire et des magistrats et que, en simplifiant les procédures et en facilitant l’accès de tous à la justice, elle ne nuira pas à l’autonomie et à la qualité de l’exercice judiciaire. Madame la garde des sceaux, je ne doute pas que vous serez attentive à nos remarques.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la justice constitue l’un des piliers de la démocratie, une attention toute particulière doit donc être portée à son fonctionnement. En tant que parlementaires, nous devons veiller à ce que lui soient attribués les moyens nécessaires pour assurer sa qualité et son indépendance.
Par ailleurs, l’accès à la justice doit être facilité et doit constituer, dans un pays démocratique, le moyen ordinaire de résolution des conflits. Pour le citoyen de base, la justice est un monde souvent étranger qui ne fait pas partie de ses préoccupations quotidiennes, sauf si un événement exceptionnel survient, qui l’amène soit à subir une sanction pénale, soit à régler un conflit privé.
Lorsque l’on aborde la question de la justice, il me semble nécessaire de distinguer ce qui relève de la justice pénale et ce qui relève des conflits privés. Ce débat nous invite à nous interroger sur le volet privé.
Je souhaite saluer le travail accompli par mes collègues Yves Détraigne et Virginie Klès depuis notre débat en séance publique sur la réforme de la carte judiciaire, en octobre 2012. En effet, leur rapport d’information, intitulé Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance et publié il y a quelques mois, permet aux idées de réformes de progresser dans le bon sens, celui d’une justice de première instance plus simple et plus accessible.
Ce débat nous invite à nous interroger sur les grands principes régissant la justice de première instance et, ainsi, sur la justice dont ont besoin nos territoires. Je développerai donc trois points : l’organisation de la justice de première instance, les conditions qui permettraient de faciliter l’accès à cette justice et, enfin, la nécessité de faire entrer cette justice dans l’ère du numérique.
En premier lieu, je souscris entièrement aux conclusions du rapport relatives à la nécessité de créer un tribunal de première instance dans l’objectif d’une meilleure gestion des juridictions. Le code de l’organisation judiciaire recense presque une vingtaine de juridictions d’attribution. L’idée de la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance en un tribunal de première instance est, à mon sens, une nécessité. En effet, ce tribunal de première instance apporterait davantage de lisibilité et de simplicité pour le justiciable, en lui évitant de se pencher sur la problématique des exceptions d’incompétence liées à la répartition des contentieux. Il permettrait également une meilleure répartition des moyens et une meilleure organisation des audiences. Surtout, il permettrait de retrouver, par le biais des chambres délocalisées, un contentieux de proximité et des moyens d’adaptabilité pour répondre aux besoins des populations.
Dans mon département de Lot-et-Garonne, madame la garde des sceaux, vous avez mis en place une chambre délocalisée du tribunal de grande instance d’Agen pour pallier la suppression du tribunal de grande instance de Marmande. Cette chambre sera opérationnelle en septembre prochain. Cette innovation peut constituer un exemple à suivre dans la perspective d’une réforme.
Je suis également d’accord pour conserver la spécificité du conseil de prud’hommes et des tribunaux de commerce, qui, de longue date, ont fait leurs preuves et concernent des contentieux facilement identifiables associant des partenaires sociaux et des professionnels. Je précise que les tribunaux de commerce fonctionnent dans des conditions financières exceptionnellement peu coûteuses, puisque les fonctions de juge sont bénévoles.
On peut aussi espérer de ce tribunal de première instance une proximité adaptée au volume des contentieux, à leur spécificité et à leur répartition sur le territoire. L’organisation de chambres spécialisées permettra la qualification des magistrats et des greffiers et l’adaptation à l’évolution des contentieux. En effet, je pense qu’il faut éviter de créer des tribunaux spécialisés qui complexifient la procédure et désorientent le justiciable. À ce titre, je me félicite d’une mesure que j’ai défendue avec conviction, adoptée lors de l’examen du projet de loi relatif à la consommation, qui permettra à l’ensemble des tribunaux de grande instance de traiter de l’action de groupe, au lieu de réserver ce type de contentieux à huit TGI spécialisés seulement, comme le prévoyait le texte initial du projet de loi.
Il convient enfin de souligner qu’une juridiction de première instance fonctionne avec des partenaires de justice. Le président du tribunal pourra veiller à l’organisation de ces partenariats, qui se feront à l’échelle de son territoire et qui assureront ainsi un accès et une liaison plus humains pour les justiciables.
La création d’un tribunal de première instance pose, dès lors, d’autres questions, notamment celle de la représentation du justiciable devant cette juridiction. Comme vous avez pu le dire, madame la garde des sceaux, « il faut que le citoyen puisse s’approprier son litige et participer à sa résolution. Il faut le rendre capable, lui donner des éléments pour l’éclairer sur les chances d’aboutissement de son affaire, sur les coûts ou encore sur les délais ». Veillons cependant à ne pas laisser croire au justiciable qu’il peut se défendre seul ! Ce serait un leurre, car l’organisation judiciaire est complexe et nécessite un accompagnement par des professionnels de l’accès au droit.

Le rapport n’aborde pas ces questions, pourtant essentielles : dans quelles formes le tribunal va-t-il être saisi ? Et par qui ? La réponse à ces deux questions va déterminer le travail du greffe et la qualité de la décision du juge, qui dépendra de la bonne instruction du dossier.
À l’heure actuelle, le tribunal d’instance et le tribunal de grande instance permettent soit un accès direct, soit la représentation obligatoire par avocat, c’est-à-dire la postulation. Quelle solution faudra-t-il adopter pour le TPI ?
Selon moi, créer un TPI, c’est aussi dire que les justiciables seront représentés par un avocat qui offrira une compétence et des garanties de déontologie et d’assurance mises au service du justiciable. L’avocat aura pour mission, avec le justiciable, de définir l’objet du litige, de déterminer la demande, d’en préciser le fondement juridique et d’apporter contradictoirement les preuves la justifiant. Grâce à ce conseil en amont, à cette compétence, le justiciable aura accès à divers modes de résolution des litiges et, s’ils échouent, le tribunal pourra être saisi dans des conditions de nature à engager une procédure construite, dans laquelle le magistrat pourra se concentrer sur la solution juridique à apporter au litige.
Envisager un accès direct du justiciable au juge est une mauvaise idée, car le justiciable n’a ni les compétences ni les moyens de soutenir utilement sa demande. Cette méconnaissance entraîne de lourdes charges pour les greffes et les magistrats, qui sont contraints de suppléer cette carence.
L’idée serait donc d’organiser les TPI autour de chacun des barreaux qui accompagnent habituellement les TGI. Cette organisation territoriale permettrait d’apporter au magistrat la certitude d’un dossier bien constitué et au justiciable la compétence et la garantie d’un professionnel.
Enfin, j’émets le souhait de voir ouvrir l’assemblée générale du TPI aux avocats pour favoriser l’organisation et la localisation des chambres spécialisées. Jusqu’à présent, les assemblées générales des TGI et des cours d’appel sont réservées aux seuls magistrats et greffiers et n’ont jamais été ouvertes aux justiciables, qui pourraient facilement être représentés par les avocats. Or cette ouverture s’impose, selon moi, pour permettre une meilleure organisation des juridictions.
Un dernier aspect de cette accessibilité relève, bien entendu, de l’organisation des greffes. L’idée d’un guichet universel de greffe paraît une évidence à l’heure du numérique. Le constat actuel est que la France a pris un retard considérable sur ce terrain. Le ministère de la justice et les autres acteurs sont partis en ordre dispersé.
Les expériences vécues sont pour le moment assez malheureuses, à l’image du RPVA, le réseau privé virtuel des avocats, mis en place laborieusement par les barreaux. Dans ce système, une collaboration étroite doit être envisagée entre les avocats et le ministère de la justice, et il est impensable qu’il en reste au stade de simple information accessible au justiciable. Il faudra en outre établir rapidement un système sécurisé, adapté à la procédure, qui est la base d’une bonne justice, avec la mise en forme de l’argumentation juridique, un échange contradictoire des moyens et des preuves et une instruction sous le contrôle des juges.
Pour conclure, je pense que la justice civile, à la différence de la justice pénale, doit continuer à relever de l’initiative des justiciables. Le juge doit seulement intervenir pour apporter une solution juridique au conflit, il n’a pas vocation à suppléer la carence des parties.
Le TPI me semble un bon outil pour apporter cet équilibre nécessaire entre les partenaires de justice, les magistrats et les greffes, dans un objectif de qualité. Il ne faudra jamais attendre des sondages un satisfecit des justiciables qui s’exposent aux foudres de la justice. Gardons cependant comme objectifs communs l’indépendance du juge et la qualité de ses décisions, seuls moyens de garder ou de rétablir la confiance des citoyens.
Applaudissements sur les travées de l’UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, notre organisation judiciaire doit répondre à plusieurs impératifs, souvent contradictoires, il est vrai.
Premièrement, elle doit répondre aux attentes des justiciables, qu’ils viennent volontairement devant les tribunaux où qu’ils soient attraits par le parquet. L’organisation judiciaire doit donc être accessible, y compris physiquement, et lisible : le justiciable doit pouvoir savoir très exactement à qui il doit s’adresser, sans avoir à recourir à des conseils payants.
Deuxièmement, cette organisation doit prendre en compte les personnels judiciaires : les magistrats, qui sont paraît-il trop peu nombreux – je ne partage pas totalement ce point de vue –, les greffiers et les avocats.
À cet égard, on sait que les dépenses d’aide juridictionnelle vont augmenter, Jean-Jacques Hyest l’a rappelé. Il faut donc en venir à une réforme totale de ce dispositif. Il y a plusieurs dizaines d’années, un député, Michel de Grailly, décédé depuis, avait proposé un système de « sécurité sociale judiciaire », avec des avocats conventionnés, des prix à l’acte, etc. Je crois qu’il faut envisager très sérieusement d’en revenir à cette solution, car nous ne pouvons pas – nous ne pouvons plus ! – faire fonctionner l’aide juridictionnelle en laissant aux avocats le choix de pratiquer des tarifs à l’heure variant selon qu’ils sont célèbres ou non, qu’ils exercent en province ou non. Je le dis comme je le pense, c’en est fini de ce système ! Ou plutôt, il devrait en être ainsi, mais vous n’avez fait aucune annonce en ce sens, madame la garde des sceaux, malheureusement.
Troisièmement, l’organisation judiciaire doit prendre en compte les nécessités de l’aménagement du territoire, en particulier les possibilités de transport des justiciables, notamment dans les départements dits ruraux, qu’un certain nombre d’entre nous connaît bien dans cet hémicycle. À cet égard, la suppression d’un certain nombre de tribunaux d’instance a été une véritable catastrophe : je pourrais vous citer des exemples d’audiences qui se tiennent sans justiciables, y compris des audiences de tutelle de majeurs. En effet, les justiciables sont maintenant éloignés de plus de 50 kilomètres du nouveau tribunal d’instance, sans aucun moyen de transport public pour s’y rendre.
On voit bien que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ces grands principes soient respectés. C’est la raison pour laquelle notre collègue Yves Détraigne, avec Nicole Borvo Cohen-Seat en 2012, avec Virginie Klès aujourd’hui, produit ces rapports. C’est également la raison pour laquelle vous avez vous-même, dans le cadre de la réflexion sur la justice du XXIe siècle, demandé un certain nombre de rapports sur l’organisation judiciaire, notamment au premier président Didier Marshall.
Avec la réforme de la carte judiciaire menée à la hache par Mme Dati, les choses n’ont fait qu’empirer. Cette réforme s’est faite sans véritable vision de l’aménagement du territoire ni sans véritable concertation. Je n’aime pas beaucoup parler de moi-même, mais je n’ai été consulté par personne.

Or je pense que les chefs de cour auraient pu consulter les parlementaires de leur ressort… On a donc supprimé toute une série de tribunaux dans le département dont je suis l’élu, sans jamais me demander ce que j’en pensais ni si l’on pouvait faire autrement. Peu importe, car ce que j’aurais pu dire n’intéressait pas, à l’époque, le ministère de la justice. C’est d’ailleurs un honneur pour moi, s’agissant de Mme Dati.

Quoi qu’il en soit, les préconisations des chefs de cour n’ont pas été respectées. Elles étaient d’ailleurs souvent assez proches des recommandations du rapport de nos collègues : par exemple, la suppression d’un tribunal de grande instance à un endroit pouvait être compensée par la création d’une chambre économique et sociale ailleurs.
Le rapport dont nous discutons aujourd’hui aborde un certain nombre de solutions, et je voudrais en évoquer quelques-unes.
Ainsi, je rejoins Jean-Jacques Hyest sur la nécessité de supprimer carrément le tribunal d’instance et d’unifier les contentieux. Il ne doit plus être question de déterminer la compétence en fonction du montant du litige, qui de toute façon fluctue au gré du temps, comme l’inflation ou jadis le franc.
Il faut donc décréter la création d’un seul tribunal et éviter ce que connaît le tribunal de grande instance, à savoir que la compétence de droit commun dont il est en principe doté devienne dans les faits, compte tenu de la kyrielle de juridictions spécialisées, une compétence d’exception. Évidemment, personne ne veut toucher à cette situation, pour ne pas se mettre à dos des corporations très influentes. La réforme Badinter, par exemple, n’a jamais été appliquée aux tribunaux de commerce. Elle visait à faire intervenir des magistrats professionnels en première instance et des commerçants en appel. On y a renoncé, on a reculé, on a eu peur !
Pourquoi attendre pour réorganiser les conseils de prud’hommes, qui doivent faire appel au juge départiteur pour se prononcer dans les affaires importantes et difficiles ? Parce que les syndicats sont derrière ! Et l’on sait à quel point, dans certains cas, ils peuvent être conservateurs !
Je pourrais poursuivre l’énumération avec les tribunaux paritaires des baux ruraux, les tribunaux départementaux des pensions, les tribunaux des affaires de sécurité sociale, j’en passe et des meilleures. Il faut vraiment faire un tri, unifier toutes ces strates et créer un tribunal de première instance.
Cette réforme placera le juge au centre du dispositif et lui permettra d’exercer sa fonction, qui, je le rappelle, est de juger. Il en va en matière de justice comme en matière de santé : il est inutile de solliciter constamment le juge, comme il est inutile que tout le monde aille aux urgences, qui sont saturées. Certains problèmes peuvent être réglés sans son intervention. Le juge est là pour trancher des problèmes importants, difficiles. C’est pourquoi il faut satisfaire la demande des syndicats de greffiers et donner aux greffiers en chef des compétences juridictionnelles. Ils ont les connaissances et la formation requises pour les exercer. Il faut donc que les juges acceptent de se défaire de leur imperium.
Il convient également de développer la collégialité. La pratique démontre souvent, hélas ! la justesse du dicton qui assimile juge unique et juge inique. Ceux qui l’ont pratiquée le savent, la collégialité permet de confronter des points de vue souvent diamétralement opposés pour aboutir, après une discussion – qu’on appelle « délibéré », mais peu importe –, à un consensus médian. D’ailleurs, le justiciable a plus confiance dans ce genre de décision, et il a raison, que dans la décision rendue par un juge unique dont on suspecte toujours les motivations.

Le juge doit donc retrouver son rôle. Pour ma part, je suis absolument hostile au fait que ce ne soit pas le juge qui rende les décisions, y compris en matière pénale. Ce pouvoir n’est pas du ressort du parquet. Or, aujourd’hui, on le voit bien, dans plus de 50 % des cas, les décisions sont rendues par le parquet : ordonnances pénales, reconnaissance de culpabilité, etc. Certes, on me dira que, ensuite, le juge entérine. Au vu des empilements d’ordonnances dans le cabinet des juges – c’est pareil en Italie –, on comprend que le juge signe sans prendre connaissance du contenu, sauf à y passer la semaine. Je n’appelle pas cela de la justice ! La justice doit être rendue par le juge et non par le procureur, qui est une autorité de poursuite.
Il faut donc revenir à ce rôle du juge, qui est essentiel et qui est aujourd’hui dévoyé par la création de toute une série d’institutions plus ou moins intéressantes – médiateur, conciliateur, délégué du procureur, … – qui rendent une justice molle. C’est ce que le Conseil d’État appelle le droit mou.

Le droit souple ! Le Conseil d’État a dit que le droit souple ne doit pas être confondu avec le droit mou !

On rend donc des décisions souples, des décisions molles, qui ne sont pas vraiment des décisions. D'ailleurs, peut-on appeler « décision de justice pénale » un rappel à la loi ? Non, un rappel à la loi ne veut rien dire et n’emporte aucune conséquence. Je conseille d’ailleurs à tous ceux qui me demandent ce dont il s’agit de refuser de signer le papier et de demander soit le classement sans suite, soit la saisine du tribunal. Tout cela doit être nettoyé, c’est le cas de le dire !

Enfin, on l’a dit souvent, il faut mieux répartir les contentieux en recherchant la création de pôles par domaines. On pourrait, à l’occasion de la suppression des tribunaux d’instance, trouver un pôle pour les affaires familiales, un pôle pour les affaires de personnes, d’état civil. Pourquoi les tutelles devraient-elles être jugées par le tribunal d’instance et les divorces ou les abandons de famille par le tribunal de grande instance ? Cela n’a pas grand sens ! D'ailleurs, le justiciable n’y comprend pas grand-chose.
Si l’on acceptait de s’occuper de l’organisation des territoires sans trop mécontenter les élus locaux – ce qui est quelquefois utile –, on pourrait faire en sorte d’éviter de tout concentrer dans un seul endroit pour répartir ces pôles au sein du département. Une juridiction de première instance permettrait de faire ces répartitions.
D’autres questions se posent, dont certaines constituent d’ailleurs des petits poils à gratter.
La première question, sur laquelle mon collègue Simon Sutour va certainement revenir, concerne les cours d’appel.

Voilà des décennies que l’on parle de cours d’appel qui ont un volume d’affaires peu important.

Inutile de les citer, tout le monde les connaît.
Je ne sais plus qui a proposé une cour d’appel par région. Encore faudrait-il commencer par s’accorder sur le périmètre de la région. Va-t-on regrouper certaines régions ?

M. Jean-Pierre Michel. Je ne pensais pas à la vôtre, mon cher collègue, qui est tellement énorme qu’il sera impossible d’envisager un regroupement. On va plutôt la diviser.
Sourires.

Après, peut-être pourra-t-on unifier les régions – pas demain, ni après-demain, je rassure certains de mes collègues – et faire en sorte qu’il y ait une cour d’appel par région.
La deuxième question, qui va provoquer chez mon collègue Alain Richard une deuxième grimace, porte sur les deux ordres ou plutôt sur les trois ordres de contentieux.
Le premier, c’est l’ordre judiciaire.
Le deuxième, c'est l’ordre administratif, créé par Napoléon…

… pour protéger l’administration. Depuis lors, les choses ont évolué et ont atteint un tel degré de complexité qu’il a fallu prévoir des sortes de blocs de compétences. Les accidents de la circulation, par exemple, ont donné lieu à une abondante jurisprudence, notamment pour déterminer si la voiture concernée était un véhicule du service public. Si la voiture appartenait à la RATP, il fallait déterminer si la Régie était un service public ou un service privé.

Tout cela est tellement compliqué que vous avez proposé dernièrement une réforme du Tribunal des conflits.
Le troisième ordre de contentieux, ce sont les juridictions financières, créées après la décentralisation. Était-ce tellement utile ? Ne pouvait-on pas demander aux tribunaux administratifs, qui contrôlent les actes des collectivités locales, de contrôler également leurs comptes ?

En outre, on peut relever une sorte de contradiction, de dissonance. Certaines de ces juridictions ne se privent pas – pour une, en tout cas ! – de donner des conseils, ce qui est souvent totalement incongru, surtout lorsqu’on critique ce qu’on a préconisé un ou deux ans auparavant.

Madame la garde des sceaux, vous avez fait des annonces au cours du colloque de l’UNESCO consacré à la justice du XXIe siècle. Vous avez demandé des rapports. Ils ont été déposés. Je crois que, maintenant, il faut agir, dans votre domaine, comme dans d’autres d'ailleurs. Je pense au domaine économique, par exemple. Les annonces doivent maintenant se traduire dans les faits. C’est ainsi que vous permettrez à nos concitoyens de mieux réagir qu’aujourd'hui à la pratique du pouvoir. Ils attendent des actes, des faits, des solutions, particulièrement dans votre domaine, madame la garde des sceaux. Je le sais, ces solutions sont compliquées à mettre en œuvre et difficiles à trouver. En période de vaches grasses, cela serait moins compliqué qu’en cette période de vaches très maigres, mais, tout de même, on peut commencer par faire un certain nombre de choses.
L’intérêt du rapport qui nous est présenté aujourd'hui et qui nous donne l’occasion de cet aimable échange est double.
Il s’agit d’abord de montrer une façon pragmatique de mener les choses à leur terme. Il est impossible de tout faire en même temps, mais on peut commencer par ce qui est peut-être le plus simple à mettre en œuvre, à savoir le guichet unique. Donnons ensuite aux greffiers en chef des compétences juridictionnelles. Après quoi, avançons petit à petit vers ce qui devrait être la justice de demain : un tribunal unique, un bloc des compétences et tout ce qui s’ensuit.
Il s’agit ensuite de montrer à ceux qui en douteraient encore que le Sénat, notamment sa commission des lois, produit régulièrement, aujourd'hui comme hier – et, je l’espère, encore demain ! –, des rapports présentés par des sénateurs de sensibilités politiques différentes. Nous parvenons à trouver un accord, à dégager un consensus, lequel permet de faire progresser les choses.
Cela prouve que notre rôle n’est pas seulement d’examiner un peu bêtement des lois, si je puis dire, qui finissent, comme l’a dit Jean-Jacques Hyest, par être votées parce que, à défaut d’être d’accord, on subit la tutelle de sa majorité. Nous sommes également là pour réfléchir, pour proposer des solutions nouvelles et innovantes. C’est ce que font aujourd'hui Virginie Klès et Yves Détraigne. Il faut les en remercier et, bien entendu, le groupe socialiste se félicite de cette méthode de travail.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, permettez-moi – une fois n’est pas coutume – de commencer cette intervention par une citation de Franklin Delano Roosevelt : « Gouverner, c’est maintenir les balances de la justice égales pour tous ». C’est en ce sens que, depuis toujours, les gouvernements successifs veillent, avec les moyens qui sont les leurs, à rendre la justice accessible à tous. Cela passe notamment par un arbitrage entre proximité et rationalisation, entre efficacité et économie, entre spécialité et lisibilité.
On le sait depuis près de quarante ans maintenant, la technicité des litiges a conduit les pouvoirs publics sur la voie de la spécialisation. C’est aussi la judiciarisation croissante des rapports sociaux qui nous a incités à développer les strates juridictionnelles pour pallier l’encombrement de certains tribunaux. Mais voilà, parce qu’il est bien difficile, dans toute action déterminée, de mêler la mesure à la vigueur, il nous faut aujourd’hui, pour les mêmes raisons de lisibilité et d’accessibilité, rationaliser notre organisation judiciaire pour lui rendre un peu de la clarté qu’elle a perdue. C’est essentiel pour la vie quotidienne de nos concitoyens.
Nous convenons tous qu’il ne faut plus forcément chercher d’antagonisme entre accessibilité et rationalisation. Nous savons que, en réalité, l’accessibilité n’est pas seulement physique et qu’un dossier peut être traité à distance, à condition que les citoyens aient accès au suivi de la procédure qu’ils ont entamée. C’est en ce sens que nous entendions développer les greffes uniques et les greffes universels.
Il est temps que nous engagions en profondeur cette réforme de la justice de première instance, en ayant toutefois conscience des difficultés que nous devrons surpasser.
Il convient de rassurer avant tout les personnels de justice, sans lesquels rien ne sera possible. Les erreurs d’hier ne doivent pas se reproduire, osons le reconnaître. Dans cette assemblée qui n’a jamais hésité à appeler l’attention des différents gouvernements sur les risques potentiels de réformes trop brutales, nous savons que l’initiative que nous défendons ici ne peut pas comporter que des mesures comptables.
Nous savons également que notre action doit s’inscrire sur le long terme, qu’il faut procéder à une répartition des contentieux et rapprocher progressivement les juridictions de première instance avant d’envisager toute unification.
Nous sommes convaincus, enfin, que l’expérience que nous avons dans ce domaine doit nous guider avec modestie. Certains tribunaux, caractérisés justement par la proximité et l’accessibilité de leurs décisions, ont fait leurs preuves. La rationalisation des conseils de prud’hommes et des tribunaux de commerce doit ainsi être appréhendée avec prudence, comme le préconisent nos rapporteurs.
Tous ces constats ont été développés très largement par Yves Détraigne et Virginie Klès dans leur rapport. J’en profite pour saluer à nouveau le travail très important qu’ils ont mené en ce sens.
Madame la garde des sceaux, nous sommes nombreux à savoir ici à quel point il peut être stimulant de réformer lorsqu’on est engagé dans la vie publique. Sur le plan national, l’un ou l’autre ministère – pas spécialement celui de la justice, je le concède – est connu pour engager une réforme à chaque changement de ministre, ou presque. Mais l’histoire sait également reconnaître les actions plus modestes, rendues vénérables par l’action du temps qui vient éprouver, à n’en pas douter, la solidité de leurs fondements.
Actuellement, vous l’aurez compris, il ne saurait à mon sens y avoir de « grand soir » de la justice de première instance. Mais trois actions importantes pourraient nous y préparer : tout d’abord, le développement des outils permettant un accès de proximité à la justice et, parmi ceux-ci, le développement des greffes universels ainsi que l’installation du logiciel Portalis offrant à ces greffes une base de données unique ; ensuite, cela a été dit, la rationalisation des contentieux et le rapprochement des juridictions de proximité ; enfin, un engagement budgétaire à la hauteur de l’ambition que nous affichons. La justice en a besoin ! Je n’y insisterai pas, car M. Mézard s’est largement exprimé sur le sujet. C’est seulement après que nous pourrons, à mon sens, entamer sérieusement la création d’une grande juridiction de première instance.
Je souhaiterais maintenant aborder un sujet spécifique à l’Alsace, ma région, et vous sensibiliser à nouveau, brièvement, aux importants problèmes liés aux transferts de compétences entre le tribunal de grande instance de Strasbourg et celui de Nancy.
À plusieurs reprises, les bâtonniers successifs du barreau de Strasbourg ont appelé l’attention de vos prédécesseurs, ainsi que la vôtre, sur les transferts progressifs de compétences qui ont eu lieu depuis le tribunal de grande instance de Strasbourg vers celui de Nancy, au détriment de la proximité, mais souvent aussi de la rationalité et, oserais-je dire, de la raison.
Lors d’une réunion à la Chancellerie, tenue il y a quelques mois en présence de plusieurs parlementaires de mon département, les différents services transférés successivement à Nancy vous ont été présentés. Permettez-moi de les citer ; cette énumération, certes fastidieuse, est nécessaire pour comprendre le problème qui se pose.
Ont donc été transférés à Nancy : le centre de protection judiciaire de la jeunesse du Grand Est ; la juridiction interrégionale spécialisée en matière de délinquance et criminalité organisée ; la juridiction interrégionale spécialisée en matière d’infractions économiques et financières ; le pôle de compétence en matière de pratiques restrictives de concurrence et de propriété intellectuelle, et Dieu sait pourtant si l’université de Strasbourg est compétente en la matière ; le pôle de compétence pour les contestations concernant les obligations de publicité et de mise en concurrence des contrats de droit privé relevant de la commande publique ; la juridiction spécialisée dans les procédures concernant les accidents collectifs ; enfin, le pôle interrégional des commissions de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux.
Dernièrement, dans le cadre de la loi de programmation militaire, une nouvelle juridiction, la juridiction spécialisée des forces armées du tribunal de grande instance de Strasbourg, a également été transférée à Nancy. Même si je reconnais que celle-ci n’avait qu’une activité limitée au sein du TGI de Strasbourg, son transfert a néanmoins une implication importante sur l’activité de ce dernier.
Outre le fait que le TGI de Strasbourg perd à nouveau une compétence, deux postes de greffiers vont être supprimés. Ils rendaient pourtant d’importants services au parquet ou aux juridictions correctionnelles. Leur disparition aura nécessairement des répercussions sur les autres postes, à un moment où ces fonctionnaires de greffe sont déjà surchargés de travail.
Madame la garde des sceaux, seule une volonté politique forte pourra stopper cette hémorragie. Dès lors, je compte sur vous pour prendre les mesures qui permettront de mettre définitivement fin, à l’avenir, à ces pratiques contraires aux intérêts de Strasbourg et de l’Alsace. Il y va aussi d’une forme d’équilibre à trouver entre la proximité et la rationalisation, lesquelles sont largement mises en exergue dans le rapport de Virginie Klès et d’Yves Détraigne.
Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UDI-UC, ainsi que sur plusieurs travées du groupe socialiste et du RDSE.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je suis très heureux, en tant membre de la commission des lois, de pouvoir m’exprimer sur un sujet qui nous tient tous particulièrement à cœur : la réforme de la justice de première instance et, plus généralement, la réforme judiciaire.
Européen convaincu, j’agis, en tant que président de la commission des affaires européennes du Sénat, pour un rapprochement de l’Europe et des citoyens. Nous souhaitons par exemple que le parquet européen, dont le dossier avance, soit collégial. Cela n’est pas toujours facile, mais, dans de nombreux domaines, il y a des avancées notables. Je souhaite que le même rapprochement puisse s’opérer dans le domaine judiciaire.
Depuis que j’exerce mon mandat parlementaire, j’ai eu à me prononcer sur une multitude de textes tendant à réformer la justice. En effet, madame la garde des sceaux, un certain nombre de vos prédécesseurs souhaitaient, en quelque sorte, « imprimer leur marque ». Il faut bien l’avouer, ces réformes n’ont pas été toujours de grandes réussites. On ne peut, dans ce domaine en particulier, initier de grandes et profondes réformes quand le seul et unique objectif poursuivi est celui de faire des économies budgétaires.
Dès le départ, on connaît malheureusement les résultats : faute d’une grande réforme touchant aussi bien l’organisation juridictionnelle que la pratique du droit, on se retrouve avec une réforme tronquée et limitée. Trop souvent, en fait de réforme, il nous est présenté une carte de France avec des points noirs symbolisant les juridictions à supprimer. C’est pourquoi je me félicite que vous ayez lancé en ce début d’année le débat sur la justice du XXIe siècle, avec notamment pour objectif « de repenser le système judiciaire dans sa globalité et améliorer son fonctionnement, son efficacité et, finalement, le service rendu au citoyen ». Je pense que nous adhérons tous, mes chers collègues, à ces principes.
Pour ce faire, un certain nombre de rapports, d’origine parlementaire ou autre, seront très utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre de cette grande réforme. Je suis certain qu’elle sera, de par votre volonté, madame la garde des sceaux, ambitieuse, et ce d’autant plus que ce gouvernement a fait de la justice l’une de ses priorités. À ce sujet, si je suis conscient des contraintes budgétaires actuelles, je sais que les efforts d’aujourd’hui sont non seulement source d’efficacité, mais aussi, à plus long terme, gage d’une bonne gestion et d’économies.
Parmi ces rapports, il faut souligner l’excellence du travail effectué par nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne. Dans leur rapport d’information fait au nom de la commission des lois du Sénat, intitulé Pour une réforme pragmatique de la justice de première instance, ils émettent un constat juste et sans concession sur la situation actuelle et livrent un ensemble de propositions concrètes qui, j’en suis persuadé, seront à même, non seulement d’améliorer sensiblement le fonctionnement de l’ensemble des juridictions de première instance, mais aussi et surtout de rapprocher la justice et les citoyens.
Ce rapport est d’ores et déjà une référence. Sans entrer dans le détail des propositions – d’autres orateurs l’ont fait précédemment –, je voudrais revenir sur deux points qui m’ont tout particulièrement interpellé, et positivement : le souci constant de placer l’intérêt du justiciable au cœur de toute future réforme de la justice de première instance et le souhait de maintenir une présence judiciaire au plus près de nos concitoyens.
Alors même que les effets de la réforme de la carte judiciaire se font encore sentir dans les départements qui ont alors été touchés, ce qui est le cas du Gard, département dont je suis l’élu et qui a subi la disparition du tribunal d’instance du Vigan, rappeler que la justice doit s’exercer au plus près des justiciables n’est pas anodin.

Cette proximité est bien évidemment indispensable en première instance. Mais nous ne pouvons pas écarter cette notion de proximité pour ce qui concerne les cours d’appel. Je suis persuadé que nos collègues Alain Richard et Bernard Saugey, chargés par la commission des lois d’un rapport d’information sur les cours d’appel, seront du même avis.
Certains rapports sont donc très bien accueillis, comme celui de nos collègues Virginie Klès et Yves Détraigne, qui tend à proposer des réformes pragmatiques, mais néanmoins substantielles et novatrices, basées sur la concertation. D’autres au contraire – je le déplore –, tel celui de M. Didier Marshall, premier président de la cour d’appel de Montpellier, qui vous a été remis le 16 décembre dernier, suscitent dès leur parution des controverses et des polémiques malheureusement bien légitimes.

En effet, comment ne pas s’émouvoir lorsqu’est proposée la disparition de sept cours d’appel et de quelque soixante juridictions de première instance ?
Comment est-il possible de parvenir à un tel résultat ? C’est finalement assez simple. Il suffit de proposer la « régionalisation » des cours d’appel, selon la méthodologie suivante : les vingt-huit départements qui dépendent d’une cour d’appel située hors de leur région administrative doivent être rattachés à la cour d’appel située dans le ressort de cette région. Simple, et même simpliste ! C’est la mort annoncée de nombreuses cours d’appel, notamment de celle de Nîmes. M. Didier Marshall a d’ailleurs confirmé à l’occasion d’interviews données à la presse locale gardoise que, en tant que premier président de la cour d’appel de Montpellier, il souhaitait la suppression de cette juridiction nîmoise.
On peut aussi s’interroger sur la pertinence de ces propositions, alors que le Président de la République vient de lancer le débat de la réorganisation administrative des régions et de leur redécoupage en vue d’un regroupement plus pertinent sur le plan européen.

Si je suis un farouche partisan de l’amélioration et de la réforme du service public de la justice, je suis également attaché à conserver ce qui fonctionne et, surtout, madame la garde des sceaux, ce qui fonctionne très bien.

Vous m’avez confirmé votre soutien, monsieur le président de région, et je m’en félicite. Mais cela ne suffira peut-être pas...
Je ne peux pas accepter qu’un rapport remette en cause des juridictions qui, à l’instar de la cour d’appel de Nîmes, font preuve d’excellence. Pourquoi supprimer une cour d’appel qui figure pourtant dans le premier tiers des cours d’appel du territoire en termes d’activité et d’efficacité ? En effet, selon les statistiques de 2012, en un an, celle-ci n’a pas traité moins de 6 185 affaires en matière civile et 2 128 en matière pénale, et ce dans des délais parmi les plus brefs de notre pays. On devrait plutôt la prendre en exemple !

Les conclusions de ce rapport sont donc pour le moins surprenantes et ses motifs mal explicités.
La disparition de la cour d’appel de Nîmes, comme son démembrement, aurait des conséquences dramatiques non seulement pour les professions judiciaires, l’université et les professions juridiques proches – notaires, experts, huissiers, commissaires aux comptes, ... –, dont les instances administratives et de formation sont toutes calquées sur le ressort de la cour d’appel, mais aussi et surtout pour les justiciables. À ce titre, nous sommes tous concernés.
En effet, l’éloignement des justiciables du lieu de jugement renchérit le coût du procès et complique l’accès à la justice, notamment pour les plus démunis d’entre eux qui, s’ils bénéficient de l’aide juridictionnelle, se verraient désigner un avocat loin de leur domicile et seraient contraints de multiplier les déplacements. Et que l’on ne nous rétorque pas que l’on pourrait simplement supprimer les deux chefs de cour et que la cour d’appel continuerait. Oui, cela nous a été dit, à nous, élus gardois !
Avec cette réforme globale de notre système judiciaire sont en jeu des centaines d’emplois publics, privés, libéraux, sans compter les retombées financières sur les bassins de vie. C’est à cela qu’est très attentif le président de la région Languedoc-Roussillon, Christian Bourquin, ici présent.

À cet égard, je souhaite remercier tout particulièrement mon collègue Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, qui vient de vous saisir par courrier, madame la garde des sceaux, pour vous indiquer son soutien en faveur de la cour d’appel de Nîmes.

La concentration n’est pas un gage d’efficacité. Ce pays a besoin d’air. Un aménagement équilibré de notre territoire est, j’en suis depuis toujours convaincu, source de bien-être pour nos concitoyens, mais est également bénéfique pour le développement économique.
Madame la garde des sceaux, nous ne voulons pas revivre le cauchemar que nous avons vécu voilà quelques années avec Mme Dati.

M. Simon Sutour. Il est en votre pouvoir d’affirmer dès aujourd’hui que la cour d’appel de Nîmes vivra. Faites-le ! Ce serait, pour reprendre le titre de la chanson de Stromae, « formidable ».
Applaudissements.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le débat qui nous réunit n’est pas le premier du genre. En effet, vous m’avez invitée à plusieurs reprises pour évoquer un certain nombre de sujets concernant la justice. Je pense au débat sur la carte judiciaire, à celui sur l’application de la loi pénitentiaire de 2009, organisé à la suite d’un rapport d’information auquel a participé M. le rapporteur Détraigne, ou à la séance de questions cribles thématiques qui a eu lieu récemment. Nous avons en quelque sorte pris l’habitude de nous retrouver à l’occasion de la publication de rapports de très grande qualité et d’explorer en détail des sujets qui préoccupent le législateur, les professionnels de la justice et du droit.
Je me réjouis d’être parmi vous cet après-midi et salue votre très forte implication. Je remercie le président de la commission des lois, les deux rapporteurs ainsi que Catherine Tasca d’avoir assisté, pendant plus de deux heures et demie, à la restitution des conclusions et à la présentation des recommandations des groupes de travail que j’ai organisées à la Chancellerie, sous forme de séance plénière. J’associe à ces remerciements Christian Favier et tous ceux qui ont accepté de participer au grand colloque qui s’est tenu à la Maison de l’UNESCO au début du mois de janvier dernier. C’est dire si les questions qui ont été soulevées aujourd’hui sont essentielles et occupent fortement la Chancellerie.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’exercice auquel je me livre devant vous est complexe. J’ai le souci de vous présenter l’esprit et la doctrine de la réforme judiciaire que j’ai engagée et, dans le même temps, pour avoir été extrêmement attentive à vos interventions, je tiens à répondre aux questions que vous m’avez posées. À certains d’entre vous d’ailleurs, je veillerai à les apporter par écrit. Je répondrai bien évidemment à l’interpellation très directe de Simon Sutour concernant la cour d’appel de Nîmes, mais permettez-moi de faire durer encore un peu le suspense...
Sourires.
Je commencerai par vous rappeler les raisons pour lesquelles cette réforme judiciaire est engagée et les motivations profondes qui en sont à l’origine. Globalement, dans notre pays, l’organisation judiciaire remonte à 1958. C’est en effet sur l’initiative de Michel Debré qu’ont été supprimés les juges de paix et créés les tribunaux de grande instance, les tribunaux d’instance, les juges de l’application des peines, le Centre national d’études judiciaires, lequel est devenu en 1970 l’École nationale de la magistrature.
Depuis lors, des évolutions ont eu lieu. Des gardes des sceaux d’envergure ont apporté des modifications d’importance dans notre organisation judiciaire. Ce fut le cas de Robert Badinter, qui a introduit la possibilité pour les justiciables de saisir la Cour européenne des droits de l’homme, supprimé les juridictions d’exception, notamment la Cour de sûreté de l’État, instauré le travail d’intérêt général, qui a eu, vous le savez, un effet important sur les décisions de justice. Ce fut également le cas d’Henri Nallet, qui a mis en place la politique publique de l’aide juridictionnelle. Ce fut encore le cas d’Élisabeth Guigou, qui a élaboré la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, créant notamment le juge des libertés et de la détention.
Ces modifications ont considérablement consolidé notre organisation judiciaire. D’autres sont également intervenues. Ainsi, certains tribunaux de grande instance ont été créés, d’autres supprimés. Il en est de même des tribunaux d’instance et des conseils de prud’hommes. Enfin, les greffes, qui étaient auparavant des charges privées, ont été fonctionnarisés en 1965.
Pour autant, notre organisation judiciaire manque d’une vision globale. Elle est aujourd'hui nécessaire. En effet, la société a changé : le droit est devenu plus complexe, la demande des justiciables s’est fortement diversifiée, les justiciables eux-mêmes ont changé leur rapport à la justice – ils sont plus informés, plus exigeants –, de nouveaux contentieux existent. J’ai entendu tout à l’heure que la loi ALUR créerait de nouveaux contentieux. Monsieur Hyest, il s’agit plutôt d’apporter des réponses et d’élaborer des procédures pour des contentieux qui existent et qui ne sont pas traités. Ainsi, si la loi relative à la consommation introduit la possibilité de répondre à des préjudices sériels, c’est bien parce que le préjudice et le contentieux existaient, mais qu’aucune réponse satisfaisante n’avait encore été trouvée. Aux réponses éclatées à des initiatives individuelles se substituera désormais une réponse collective, structurée et plus rapide, ce qui constitue une amélioration du service de la justice.
Je vous répondrai sur ce point, et je me délecterai même à décrire un certain nombre de moyens mis en place depuis une vingtaine de mois.
Il est nécessaire de penser l’organisation judiciaire de façon cohérente, sous la pression des contraintes que je viens d’énoncer et que renforcent un certain nombre d’initiatives récentes. Je pense notamment à la décision heureuse que vous avez prise ici même au mois de décembre 2012, mesdames, messieurs les sénateurs, de reporter de deux ans la suppression des juridictions de proximité, qui était prévue au 1er janvier 2013, sur la base du rapport Guinchard du mois de décembre 2011. Comme je l’ai souvent rappelé à cette tribune, un certain nombre de mesures d’accompagnement de cette suppression de juridictions de proximité, indispensables et prévisibles, n’avaient pas été prises. Je pense au décret en Conseil d’État qui n’a même pas été rédigé, au recrutement de magistrats qui était nécessaire, à la formation des juges de proximité, puisqu’ils devaient être rattachés aux tribunaux de grande instance.
Votre initiative a donc été incontestablement heureuse. Il n’en demeure pas moins, puisque vous l’avez souligné, monsieur Hyest, qu’il n’est pas question de supprimer les juges de proximité : leur utilité est reconnue par les justiciables et par les professionnels de justice. Reste qu’il nous faut réfléchir aux missions que nous allons leur confier, à la façon dont ils interviendront dans les tribunaux de grande instance. Tout cela participe de cette réflexion globale sur le tribunal de première instance que vous avez menée dans votre rapport avec un pragmatisme indéniable, madame, monsieur les rapporteurs. Ainsi, vous avez très clairement énoncé la conception idéale du tribunal de première instance, tout en tenant compte des réticences et des difficultés pratiques ; en conséquence, vous avez proposé une mise en œuvre progressive, ce qui me paraît tout à fait raisonnable.
Il nous faut tenir compte de l’impact de ces dispositions. C’est pourquoi nous devons continuer à réfléchir à la fermeture des juridictions de première instance qui a été programmée, puis différée au 1er janvier 2015. La maintenons-nous ? Pour ma part, cela me paraît souhaitable. J’entends les arguments en faveur d’une prolongation du report, mais je n’ai pas souhaité que, comme cela m’a été suggéré, cela figure dans le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures en cours de navette parlementaire. Nous avons un peu de temps pour poursuivre la réflexion afin de prendre la meilleure décision possible.
Pour penser l’organisation judiciaire, d’autres éléments de « pression » existent. Je pense à la collégialité de l’instruction, élaborée par la loi du 5 mars 2007, votée à l’unanimité, qui prévoit la suppression de 74 infrapôles. Cette mesure a un effet immédiat et direct sur l’organisation judiciaire. L’application de cette loi a été reportée à plusieurs reprises déjà, parce qu’elle demandait elle aussi le recrutement de 314 magistrats, selon nos estimations.
L’été dernier, j’ai présenté en conseil des ministres un projet de loi relatif à la collégialité de l’instruction, qui n’a malheureusement pas trouvé place dans le calendrier parlementaire. Voyant la fin de l’année arriver et ne souhaitant pas un report de l’application de ce texte prévue au mois de janvier 2014 – ce que je considère du plus mauvais effet –, j’ai pris sur moi de demander l’introduction dans le projet de loi de finances pour 2014 d’un amendement tendant à reporter d’un an encore l’application de la loi du 5 mars 2007. Je rappelle d’ailleurs que, avant cette loi du 5 mars 2007, deux textes sur la collégialité de l’instruction avaient été adoptés, qui avaient dû être abrogés avant leur application, parce que les mesures d’accompagnement et les moyens nécessaires à leur entrée en vigueur manquaient.
Je veux croire que, d’ici à la fin de l’année, ce débat se tiendra à l’Assemblée nationale et au Sénat, et que le texte de loi relatif à la collégialité de l’instruction pourra ainsi être mis en œuvre.
S’y ajoutent d’autres effets liés à la demande de spécialisation, qu’a évoquée M. André Reichardt. Nous le savons, cette requête est exprimée au titre des accidents collectifs et des procédures militaires.
À cet égard, je vous renvoie à la dernière loi de programmation militaire, pour ce qui est des compétences confiées à diverses cours d’appel.
D’autres demandes concernent la cybercriminalité. Globalement, la réalité de notre vie quotidienne et collective impose, aujourd’hui, un effort de spécialisation.
M. Christian Bourquin acquiesce.
La justice doit se rapprocher le plus possible des Français, en particulier sur le plan géographique. C’est là tout l’enjeu du tribunal de première instance et du guichet unique de greffe. Comment placer la justice à la portée physique de nos concitoyens, quelles que soient la nature et la technicité des contentieux ? En spécialisant certaines juridictions.
Par ailleurs, M. Reichardt l’a également rappelé avec raison, les nouvelles technologies sont le moyen par excellence pour atteindre cet objectif de proximité, dans le domaine des contentieux spécialisés.
De surcroît, nous devons faire face aux effets des deux lois de mai 2013 conduisant à diviser par deux le nombre de cantons.
Je le sais bien, monsieur le sénateur, c’est précisément la raison pour laquelle je me tourne, à cet égard, vers la Haute Assemblée.
Monsieur le sénateur, il n’y a pas de voile ! Ces textes ont été débattus publiquement. Ils ont été promulgués. Les décrets d’application ont été rédigés. Ils ont été publiés le 20 février prochain.
Enfin, je sais qu’un carrousel de recours a été déposé devant le Conseil d’État. Vous le voyez, il n’y a absolument rien de secret ou de confidentiel ! Ces lois énoncent très clairement qu’il s’agit de réduire de moitié le nombre de cantons. C’est un travail, non de redécoupage, mais de fusion.
Je le répète, cette réforme a été menée par les deux chambres du Parlement. Elle est bien sûr susceptible d’avoir un effet sur la carte judiciaire.
À ce titre, la direction des services judiciaires s’est saisie de la question suivante, que nous continuons à traiter avec les services du ministère de l’intérieur : quelle doit être notre référence ? En effet, on nous le répète à longueur de temps, la carte judiciaire ne correspond pas à la carte administrative.
Aujourd’hui, l’échelon retenu pour le tribunal d’instance, c’est le canton. Nous sommes donc placés face à une alternative : conserver ou non, dans ce domaine, la référence aux cantons existants.
Soyons clairs : nous n’allons pas réviser la carte judiciaire au détour d’un redécoupage cantonal mené par le ministère de l’intérieur. Il n’y aurait pas de logique judiciaire à le faire, notamment en termes de proximité.
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Monsieur Hyest, je n’ai rien entendu !
Sourires.
J’insiste sur ce point : il n’y aurait aucune logique à ce que cette modification de la carte administrative emporte celle de la carte judiciaire, qui se fonde sur les cantons actuels.
Par ailleurs, je le dis haut et fort : il n’y aura pas de fermeture de sites judiciaires, …
… j’y reviendrai en conclusion.
Dès lors, la question qui se pose à nous est la suivante : quelle sera la référence ? Aujourd’hui, dans le code de l’organisation judiciaire, le canton est bien le niveau de base pour le tribunal d’instance.
En conséquence, nous envisageons de prendre pour référence un groupe de communes. En découle une difficulté pratique, car, de ce fait, l’article annexe tableau IV dudit code comptera non plus 4 055 entrées, mais plus de 36 000. Toutefois, cette solution semble préférable quant à la pratique et à la doctrine. Si une commune disparaît – cela arrive – nous en tirerons les conséquences, mais la référence de nos instances judiciaires de base n’en sera pas modifiée pour autant.
De surcroît, nous avons envisagé de geler la carte actuelle, sur la base des cantons existants au 1er janvier 2014, c’est-à-dire avant la publication des décrets et la mise en œuvre de la réforme. Je n’ai pas encore tranché définitivement cette question. C’est la solution qui a été privilégiée pour les circonscriptions législatives. Il s’agit bien d’une option possible. Nous sommes en train d’étudier la faisabilité de la référence aux communes, eu égard aux 36 000 entrées qui seraient nécessaires. Si cette difficulté se révélait insurmontable, mais je ne crois pas que ce sera le cas, nous pourrions retenir cette méthode.
Personnellement, sur le plan philosophique, j’éprouve certaines réticences à geler une carte sur la base d’une référence administrative, en sachant que cette dernière est déjà modifiée et que sa révision s’apprête à entrer en vigueur. Je sais que cette possibilité a été retenue pour les circonscriptions législatives, mais, je le répète, si nous pouvons procéder par commune, nous privilégierons cette solution.
Je précise qu’un autre texte emporte des conséquences en la matière : il s’agit de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. Ces modifications portent avant tout sur les cours d’appel. J’y reviendrai dans quelques instants. Toutefois, je précise d’ores et déjà que ces effets doivent être pris en compte dans la réflexion que nous menons au sujet de l’organisation judiciaire.
Nous devons étudier plus précisément chacun des territoires. Je songe, par exemple, à la métropole de Lyon, qui sera dotée d’un statut particulier et absorbera, sauf erreur de ma part, le conseil général du Rhône.
Protestations amusées sur les travées de l'UMP.

Une partie seulement de ses compétences et de son ressort, madame la ministre !
Quoi qu’il en soit, tous ces éléments méritent d’être pris en considération dans le cadre de la réflexion consacrée à l’organisation judiciaire.
J’ai souhaité que ce chantier soit mené en concertation. Voilà pourquoi j’ai réuni des groupes de travail, en leur demandant de me remettre leurs rapports passé un délai de quatre mois. Leurs membres ont souhaité bénéficier d’un plus grand laps de temps.
Aussi, ces documents m’ont été communiqués en décembre dernier, et non en juin dernier comme je l’espérais à l’origine. Sur la base de ces travaux, 268 préconisations ont été émises. S’y ajoutent les 20 recommandations énoncées dans votre rapport, monsieur Détraigne, qui a largement alimenté notre réflexion, notamment au sein du groupe de travail sur les juridictions du XXIe siècle. Ces diverses pistes ont fait l’objet d’un travail collectif mené, en janvier dernier, à la maison de l’UNESCO.
Au total, nous avons retenu trois axes, qui ont été soumis aux juridictions, comme je m’y étais engagé. Actuellement, ces dernières travaillent sur ces pistes, à l’aide de questionnaires et de formulaires qui leur ont été adressés et qui concernent, notamment, le tribunal de première instance.
Tout d’abord, il faut associer plus étroitement les citoyens à la construction d’un certain nombre de réponses et de solutions apportées à leurs litiges. En effet, nous ne pouvons pas nous réjouir que le citoyen soit plus informé et plus érudit, qu’il connaisse mieux les textes de loi et devienne partant plus exigeant, tout en persistant à le traiter comme un administré passif.
À cet égard, MM. Mézard et Hyest ont évoqué les juges de paix, ainsi que les fonctions de conciliation et de médiation. Il importe que nous développions ces dernières pour des contentieux assez divers, notamment civils ou sociaux. Il convient de faire du citoyen un acteur à part entière de la résolution de son litige tout en redéfinissant et en améliorant, via lesdites fonctions, les missions des professionnels de justice.
Dans la perspective du vaste chantier qui nous attend, j’ai souhaité m’en remettre à l’intelligence collective, en mobilisant les personnels des juridictions tout entières – magistrats, greffiers et fonctionnaires – et les professionnels du droit, ainsi que les parlementaires.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne manque jamais une occasion de le dire : il importe que la représentation nationale soit informée, …
… du fonctionnement de nos juridictions, des besoins qu’expriment les magistrats, les greffiers et les fonctionnaires de la justice, ainsi que des évolutions que connaît l’organisation de nos juridictions.
Évidemment, l’organisation judiciaire soulève des enjeux territoriaux, auxquels se joint la question de la répartition des contentieux.
En matière territoriale, je rappelle que le Président de la République lui-même s’est prononcé pour la création d’une juridiction unique de première instance. Il a souligné combien il importait d’assurer un accueil mutualisé des contentieux tout en développant les procédures de conciliation et de médiation. À cet égard, nous disposons, depuis quelques semaines, des nombreux rapports remis par les récents groupes de travail, sans oublier les documents antérieurs.
Parallèlement, nous devons nous pencher sur la définition des périmètres des contentieux. Il s’agit, là aussi, d’un sujet que vous avez abordé, monsieur Détraigne, et pour lequel vous avez formulé certaines propositions. Il faut poursuivre le travail engagé sur ce front.
J’entends qu’il est nécessaire de mettre en œuvre progressivement cette juridiction unique, une fois que nous serons parvenus à en définir le périmètre territorial.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je peux d’ores et déjà vous l’affirmer : je tiendrai les engagements que j’ai pris. Il n’y aura pas de fermetures de sites judiciaires. Aucun site ne sera fermé, ni la cour d’appel de Nîmes ni aucun autre !
Monsieur Sutour, vous souhaitiez me l’entendre dire à la tribune. Je l’affirme sans détour : Nîmes vivra, …
… et bien au-delà de sa cour d’appel !
Parallèlement, nous renforçons les sites judiciaires, notamment les maisons de justice et du droit. Je remercie les sénateurs dont les collectivités territoriales ont détaché des personnels au sein de ces structures. Toutefois, d’un point de vue organisationnel, les maisons de justice et du droit sont des sites judiciaires. Elles doivent, par conséquent, être dotées de greffiers.
Aussi, nous avons décidé de créer des postes de greffier et de les affecter à ces instances.
Au surplus, sans insister lourdement et inélégamment sur la réforme de la carte judiciaire de 2008, je rappelle que nous ne supprimons pas de sites. Bien au contraire, depuis vingt mois, la tendance est plutôt à les rouvrir.
Monsieur Mézard, nous avons rouvert non pas un, mais trois tribunaux de grande instance, auxquels s’adjoignent quatre chambres détachées. Pour cette catégorie de juridiction, un cinquième dossier de réouverture est en cours d’examen.
Je le répète, nous affectons des greffiers aux maisons de justice et du droit. Nous ouvrons de nouveaux points d’accès au droit, les PAD, y compris au sein de nos établissements pénitentiaires, et nous dédions certains PAD spécifiquement aux jeunes. La dynamique à l’œuvre est donc bien celle des réouvertures !
Quant aux moyens et aux effectifs, s’ils nourrissent un débat récurrent, ils ne peuvent constituer un sujet en tant que tel. En effet, l’augmentation des effectifs ne garantit pas nécessairement, à elle seule, l’efficacité et la proximité de la justice, si essentielles pour nos concitoyens. Je songe à l’observation, formulée par M. Hyest, au sujet des nouveaux contentieux et des contentieux de masse.
Concernant les effectifs, je rappelle tout de même que, depuis l’arrivée aux affaires du Gouvernement, quelque 500 emplois sont créés chaque année dans le domaine de la justice.
Cette année 2014, nous bénéficierons même de 590 créations de postes.
J’en conviens, la situation est préoccupante sur le front des effectifs. Quelle est-elle ? Dès notre arrivée au pouvoir en 2012, nous avons estimé à 1 400 le nombre de départs à la retraite à venir, dans le domaine de la justice, au cours du quinquennat. Pour compenser ce flux, il aurait fallu, sous la précédente mandature, ouvrir 300 postes chaque année. Dans les faits, seuls 85 postes ont été créés par an – les promotions ayant été fixées à 105 élèves et divers postes ayant été supprimés au titre de la réforme de la carte judiciaire. Dès lors, il est facile d’évaluer les déficits cumulés en cinq ans !
Sourires sur les travées du RDSE.
Depuis que je suis garde des sceaux, soit au seul titre des deux dernières années budgétaires, nous ouvrons en moyenne plus de 300 postes au concours. Cette année, ce nombre a été fixé à 384. L’année dernière, les 420 postes proposés n’ont pas tous été attribués. Il m’a alors été suggéré de baisser le niveau du concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature, l’ENM…
Je m’y suis catégoriquement opposée !
En effet, le concours de l’ENM est l’un des plus beaux de la fonction publique, et de la République tout entière. Il nous faut, à tout le moins, en maintenir le niveau actuel. Plutôt que de réduire nos exigences, nous avons donc mené, sur deux années, une campagne de sensibilisation, pour attirer les meilleurs candidats et recruter partant les meilleurs étudiants. L’an passé, ces efforts ont été récompensés : les 384 postes ouverts ont trouvé preneur.
Par ailleurs, comme je vois que cette assemblée est massivement masculine…
Comme je vois que cette assemblée est massivement masculine, disais-je, je souhaitais rappeler que le taux de féminisation des lauréats du concours de l’ENM atteint 82 %. Vous l’avez d'ailleurs vous-mêmes observé, mesdames, messieurs les sénateurs. Ce n’est pas un mal, dans la mesure où les études ont montré que les magistrates jugent de la même façon que les magistrats – ni plus ni moins sévèrement.

J’ai dit : « Un signe de cette dégradation », ma chère collègue. Que l’on s’entende bien !
Les femmes magistrates appliquent le droit, comme les hommes. Cette année, la promotion de l’École nationale de la magistrature compte 72 % de femmes, les hommes représentant 10 % de plus qu’auparavant. Leur nombre augmente donc un peu. Il n’y a pas eu, durant les dix dernières années, autant de lauréats hommes aux trois concours d’entrée à l’École nationale de la magistrature.
De plus, soixante-quatre auditeurs de justice ont intégré ce cursus au titre de l’article 18-1 du statut de la magistrature, c'est-à-dire après avoir exercé d’autres professions, ce qui entraîne une diversification des expériences et des cultures qui se rencontrent à l’école.
Enfin, treize auditeurs de justice sont issus de nos classes préparatoires, qui visent à contribuer à la mixité sociale. Il s’agit de jeunes ayant suivi des parcours différents, originaires de milieux sociaux moins favorisés que ceux qui ont emprunté les autres voies. Après un cursus en classe préparatoire, ils intègrent l’École nationale de la magistrature avec exactement le même niveau que les autres lauréats : ils passent le même concours, avec les mêmes épreuves, corrigées de la même manière.
En ce qui concerne les greffiers, nous avons fait le même effort, et plus encore. Je suis en effet soucieuse de l’échéance de 2023, à laquelle 40 % de la profession partira en retraite. Nous avons donc déjà commencé à anticiper cette évolution. Dans l’immédiat, 1 084 greffiers vont arriver dans nos juridictions.
En résumé, 250 magistrats arrivent dans nos juridictions, où 350 postes sont vacants, alors qu’à peu près 250 autres magistrats sont en poste à l’extérieur des juridictions. Ils prendront leurs fonctions d’ici à septembre prochain et renforceront les effectifs en place. De surcroît, 1 084 greffiers prendront leurs fonctions dans les juridictions durant la même période, apportant un renfort humain. Depuis vingt mois, le Gouvernement n’a pas désarmé pour améliorer les effectifs et les moyens. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant ce sujet qui, s’il est sérieux, n’est pas le seul important.
Mesdames, messieurs les sénateurs, j’ai parlé un peu trop longtemps et vais accélérer mon propos…
Mme Christiane Taubira, garde des sceaux. Au moins, monsieur le sénateur, n’êtes-vous pas un ingrat !
Nouveaux sourires.
Concernant l’aide juridictionnelle, nous avons, vous l’avez dit, supprimé la taxe de trente-cinq euros. Il s’agissait d’une mesure impérative de justice sociale : il fallait lever cette entrave à l’accès au juge pour les personnes disposant de revenus modestes. Le plafond de ressources est en effet fixé non pas à 1 500 euros, mais à 929 euros, soit un peu en dessous du seuil de pauvreté. Comme il nous fallait prendre cette décision, nous avons abondé le budget de la justice de 60 millions d’euros pour compenser ses conséquences.
Le sujet de l’aide juridictionnelle est toutefois plus vaste et plus complexe, vous avez eu raison de le souligner. Nous disposons de dix ans de rapports sur ce thème. En 2006, un rapport du Sénat évoquait d’ailleurs la nécessité de « réformer un système à bout de souffle ». Nous le savons tous, l’aide juridictionnelle est structurellement affaiblie et défaillante. Nous devons répondre à cette situation non pas en attendant la reconduction annuelle du budget de la justice, mais bien en identifiant des ressources nouvelles, de façon à construire une grande politique nationale de solidarité.
Comme vous le rappeliez, monsieur Hyest, la possibilité de l’assistance d’un avocat pour les personnes entendues en audition libre, ouverte par la transposition de la directive B dont nous avons discuté ici hier, emportera des conséquences financières, qui sont estimées à 30 millions d’euros.
Nous devons donc mettre en place une véritable politique de l’aide juridictionnelle. J’y travaille depuis plus d’un an maintenant, en faisant en sorte d’y associer les différentes professions concernées. À mes yeux, en effet, les réformes sont toujours meilleures lorsqu’elles sont préparées à plusieurs mains. Nous avons rencontré des difficultés, et j’ai pris l’initiative de charger d’une mission sur le sujet un avocat général honoraire de la Cour de cassation, qui a remis ses propositions. Nous continuons donc à y travailler ensemble.
Concernant l’outil informatique dans le cadre de la proximité de la justice, Portalis est indispensable pour la justice civile. En arrivant, nous avons constaté que rien n’avait été fait pour mettre en place cet outil. Nous avons donc très rapidement lancé le chantier. Il s’agit, à mon sens, d’une nécessité urgente. Vous connaissez cependant le temps nécessaire au développement d’une application informatique de cette importance. En effet, il s’agira d’un outil national, déployé sur l’ensemble du territoire.
Les premières études sont lancées. Le coût de Portalis sera inclus dans le prochain budget triennal, qui couvrira les années 2015, 2016 et 2017, et s’élèvera à environ 41 millions d’euros. Les experts nous demandent de commencer par des expérimentations, qui aboutiront ensuite à une généralisation du dispositif. Elles commenceront sans doute dans trois ans, en gardant un rythme soutenu. Rien n’ayant été lancé avant notre arrivée aux affaires, c’est en tout cas ce que nous pouvons envisager à présent.
Monsieur Tandonnet, concernant la participation, c'est-à-dire la gouvernance des juridictions, il me semble, en effet, que nous devons définir un espace où les magistrats pourront informer les citoyens. Je ne suis pas persuadée que ces derniers devront, dans ces instances, être représentés par des avocats. Toutefois, cette nécessité d’information est incontestable. Il s’agit non pas d’intégrer les citoyens à la gestion des juridictions, mais bien de les informer sur le fonctionnement de ces dernières. Il en va de même des élus locaux, très impliqués dans leurs territoires, et qui doivent bénéficier du meilleur niveau d’information.
Sur la gouvernance, nous avons déjà lancé des initiatives, notamment au travers d’un projet de décret que j’ai soumis aux organisations syndicales, conformément au code de l’organisation judiciaire. Dans un premier temps, ces dernières n’ont pas souhaité qu’il soit publié, sans pour autant proposer de modifications substantielles. Le contenu du décret leur convenait, mais elles ont estimé qu’il était préférable d’attendre un peu, pour favoriser l’articulation des calendriers. Les juridictions travaillent actuellement, dans le cadre des assemblées générales, sur nos propositions concernant la réforme judiciaire. Les discussions se poursuivent et devraient assez rapidement aboutir à la publication de ce décret.
Au sujet de Strasbourg, monsieur Reichardt, vous savez que j’ai personnellement reçu une délégation des élus en janvier dernier, pour mener une véritable séance de travail. J’ai confirmé les propos que j’y avais tenus par un courrier adressé à tous les élus y participant.
La spécialisation est un vrai sujet. Le tribunal de Strasbourg est spécialisé, notamment en matière de propriété intellectuelle et de contentieux médical, pour lequel il constitue un pôle régional et interrégional. En revanche, vos craintes relatives aux conséquences de la loi de programmation militaire ne sont pas fondées : le décret n’est absolument pas publié, aucun transfert n’a donc été décidé entre Strasbourg et Nancy du fait de cette loi. Monsieur Reichardt, j’assume entièrement ce que je dis, je vous confirmerai donc tout cela par écrit, de manière précise et détaillée.

Madame la ministre, je vous rappelle que je dois impérativement interrompre nos échanges à dix-sept heures, pour permettre le débat sur la demande du Gouvernement d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées en République centrafricaine.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pardonnez-moi d’avoir abusé de mon temps de parole !
Jean-Pierre Michel a évoqué les nombreux rapports publiés, en ajoutant : « Maintenant, il faut agir ! » Non, monsieur le sénateur : nous agissons déjà ! J’ai d’ailleurs apprécié les propos de l’un de vos collègues, affirmant qu’il n’y aurait pas de grand soir de la justice. Je ne prétends pas en effet à cela. Nous agissons déjà, nous avons pris de multiples dispositions, certaines grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs.
Par exemple, c’est grâce à vous que nous introduisons la communication électronique : vous avez accepté de l’intégrer dans un projet de loi que nous avons présenté. Selon le code de procédure pénale, il faut envoyer des lettres recommandées, dont 80 % ne sont pas réclamées. Cela coûte chaque année 58 millions d’euros en frais de justice. Par la mise en place de la communication électronique, assortie bien entendu de la sécurisation des procédures, nous agissons donc directement.
Nous agissons également au quotidien sur les tutelles. Sans rien vous demander, j’ai augmenté le nombre des magistrats, des greffiers et des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi de révision des mesures de tutelle. Nous sommes ainsi parvenus à respecter le délai fixé à décembre 2013.
Nous agissons enfin en modifiant, au travers d’un texte que vous avez voté récemment, les règles d’administration légale, en mettant en place un parquet financier spécialisé dans la lutte contre la fraude fiscale, en répartissant les contentieux spécialisés, ou encore en nous penchant sur les juridictions de proximité.
Il me semble important de valoriser le travail du Parlement, qui permet, par le vote de propositions ou de projets de loi, d’améliorer au quotidien le fonctionnement de nos juridictions et les missions de nos magistrats, que ceux-ci appartiennent au ministère public ou au parquet. Songeons, par exemple, à la suppression des instructions individuelles.
Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, nous agissons déjà dans les juridictions, et c’est en avançant que nous écrivons cette réforme judiciaire !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste, du groupe CRC et du groupe écologiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE . – M. Henri Tandonnet applaudit également.

Nous en avons terminé avec le débat sur la justice de première instance.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinquante-cinq, est reprise à dix-sept heures, sous la présidence de M. Jean-Pierre Bel.

L’ordre du jour appelle un débat sur la demande du Gouvernement d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées en République centrafricaine, en application du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, suivi d’un vote sur cette demande d’autorisation.
La parole est à M. le ministre.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le 5 décembre dernier, le Président de la République décidait d’envoyer nos soldats en République centrafricaine, afin d’éviter à ce pays de sombrer dans le chaos.
La Centrafrique était en effet en proie à une violence généralisée et à ce que l’on peut appeler – le terme est faible ! – une dérive confessionnelle. Les « Séléka », ces milices à dominante musulmane, qui avaient déposé quelques mois auparavant le président Bozizé, multipliaient les exactions et les pillages.
Ceux que l’on appelle les « anti-balaka », recrutés essentiellement parmi les populations chrétiennes, commençaient à s’en prendre aux civils musulmans, par esprit de vengeance et pour des motifs crapuleux.
Sur la base d’un mandat des Nations unies et en appui à la force de l’Union africaine, l’opération Sangaris – c’est le nom de l’opération française – avait deux objectifs : rétablir la sécurité en Centrafrique et permettre le retour des organisations humanitaires ; favoriser la montée en puissance de la force africaine, la MISCA, et son déploiement opérationnel.
Cette intervention répondait à l’urgence. Il n’y avait plus, en Centrafrique, ni armée, ni police, ni justice. Les écoles et les hôpitaux avaient cessé de fonctionner. À la tête d’un État failli, l’équipe de transition avait perdu tout contrôle, et la spirale de la violence prenait brutalement une ampleur nouvelle. À la veille même de notre intervention, les massacres avaient fait pas moins de 1 000 morts dans la capitale.
Voilà, mesdames, messieurs les sénateurs, ce qu’était, à ce moment, la réalité centrafricaine.
La France, par la voix du Président de la République à la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, avait pourtant, dès septembre 2013, alerté la communauté internationale. Toutefois, à l’exception des États voisins, de l’Union africaine et des acteurs humanitaires, notre mise en garde n’avait pas permis, il faut bien le dire, de surmonter une coupable indifférence, et la République centrafricaine se trouvait au bord du gouffre.
Fallait-il, dans ces conditions, que la France, qui était, grâce à ses forces pré-positionnées, le seul pays à pouvoir intervenir sans délai en appui à la MISCA, laisse ces atrocités se perpétuer et le pays s’enfoncer dans une situation que certains, à l’ONU, ont qualifiée de « pré-génocidaire » ?
Fallait-il abandonner ce pays au cœur de l’Afrique, dans une région déjà très fragilisée par les conflits, notamment dans autour des Grands Lacs ou au Soudan ?
Fallait-il prendre le risque de laisser se créer une zone de non-droit à la merci de tous les trafics et de tous les terrorismes ?
Fallait-il rester sourd à l’appel au secours désespéré de la population centrafricaine et à la demande de soutien unanime des Africains ?
À l’évidence, la réponse est non ! Je sais que, comme moi, ce n’est pas l’idée que vous vous faites de la France et de ses valeurs. Ce n’est pas la conception que nous avons du rôle de notre pays dans le monde. C’est d’ailleurs ce que vous aviez tous exprimé lors du débat précédent.
Au contraire, la France devait prendre ses responsabilités. Et c’est parce que nous avons agi que des massacres de masse ont été évités, que, chaque jour, des vies sont sauvées et que la République centrafricaine a une chance de pouvoir reprendre en main son destin.
C’est aussi parce que nous avons été capables d’ouvrir la voie que, peu à peu, avec nos amis africains, nous entraînons d'autres partenaires internationaux. En peu de temps, la MISCA est passée d’environ 2 500 hommes au début de notre intervention à 6 000 hommes aujourd’hui. Elle accomplit en général un travail de grande qualité, en bonne coordination avec l’opération Sangaris.
D’autres pays contribuent aux opérations en cours par un soutien logistique indispensable. C’est le cas des États-Unis d’Amérique et de certains de nos partenaires européens. L’Union européenne apporte aussi un soutien financier, à hauteur de 50 millions d’euros.
Au-delà de ce soutien, l’Union européenne a décidé d’engager directement des troupes sur le terrain, en établissant, à l’unanimité, le 10 février dernier, l’opération Eufor-RCA. Elle a pris cette décision, constatons-le, plus vite qu’elle ne l’avait fait auparavant et, dans les prochains jours, un premier échelon devrait, selon les dires des responsables des institutions européennes, arriver sur le terrain.
Cette force européenne, qui, selon l’objectif évoqué par Mme Ashton, la Haute Représentante de l’Union européenne, devrait compter jusqu’à 1 000 hommes – encore faut-il qu’ils soient là ! –, aura pour mission principale d’assurer la sécurité de l’aéroport de Bangui et de certains quartiers. Elle devrait permettre à la MISCA et à Sangaris de continuer à se déployer en province, où leur intervention est évidemment très attendue. À ce jour, une dizaine de partenaires européens ont fait part de leur intention d’y contribuer. Néanmoins, le processus dit « de génération de forces » n’est pas encore terminé.
Comme l’a annoncé la chancelière Merkel à l’occasion du conseil des ministres franco-allemand, l’Allemagne, pour sa part, devrait participer à cet effort, par des moyens logistiques.
Mesdames, messieurs les parlementaires, il appartient aux Nations unies de faire davantage et plus vite. C’est le souhait exprimé à mon endroit par le secrétaire général lui-même. L’ONU doit notamment être en mesure de coordonner l’aide humanitaire, de préparer le désarmement et la réinsertion des combattants, ainsi que d’aider le gouvernement centrafricain à avancer vers les élections.
Les Nations unies – à l’issue de ce débat, je m’entretiendrai ce soir au téléphone avec M. Ban Ki-moon ; j’apporte cette précision au texte lu simultanément par le Premier ministre à l'Assemblée nationale – ont un rôle évident à jouer dans la lutte contre l’impunité, grâce au déploiement d’une commission d’enquête internationale, dont le travail complétera celui de la Cour pénale internationale.
Enfin – j’y reviendrai –, la préparation d’une opération de maintien de la paix, en partenariat avec l’Union africaine, doit s’accélérer.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nos efforts ont commencé à porter leurs fruits. L’embrasement généralisé qui menaçait a été évité. La mobilisation internationale s’organise. Sangaris poursuit avec opiniâtreté les objectifs qui lui sont assignés.
À Bangui même, l’insécurité ne se concentre plus que sur certains quartiers. La plupart des combattants appelés « ex-Séléka » ont été désarmés et cantonnés sous le contrôle de la MISCA, et nombre d’entre eux sont repartis vers le nord, ce qui pose d’ailleurs d’autres problèmes. Dans la capitale, la menace vient principalement des « anti-balaka », contre lesquels nous agissons de manière très vigoureuse.
Dans la moitié occidentale du pays, des affrontements entre communautés ont toujours lieu. En lien étroit avec la MISCA, nos forces font le maximum pour protéger les populations, qu’elles soient chrétiennes ou musulmanes, avec une impartialité totale.
À l’est, il convient de veiller à ce que les regroupements d’« ex-Séléka » n’aboutissent pas à une coupure de fait entre cette région et le reste du pays.
Le départ massif de populations musulmanes constitue un sujet de vive inquiétude, dans un pays où les religions ont longtemps vécu en bonne harmonie. Les pays voisins, notamment le Tchad et le Cameroun, font preuve de solidarité en accueillant un nombre important de réfugiés. Ils doivent pouvoir, eux aussi, compter sur l’appui de la communauté internationale ; celui de la France leur est évidemment acquis.
En matière humanitaire, la situation reste en effet extrêmement critique, avec – nous citons ces chiffres comme ordre de grandeur – quelque 250 000 réfugiés et 825 000 déplacés, dont 400 000 dans la capitale elle-même. Cela signifie qu’un habitant sur deux a besoin de soins médicaux d’urgence et un sur cinq au moins d’aide alimentaire. Le départ de nombreux musulmans, qui animaient le commerce, fragilise l’ensemble de l’économie.
Sur place, les agences des Nations unies s’efforcent de faire face. Le Programme alimentaire mondial a mis en place un pont aérien, qui permet de ravitailler les déplacés en attendant que la MISCA, soutenue par Sangaris, sécurise totalement l’axe vital entre Bangui et le Cameroun. De nombreuses ONG sont actives, dont Médecins du monde et Médecins sans frontières, qui gèrent le seul hôpital actuellement resté ouvert à Bangui.
Sur le plan politique maintenant, la nouvelle présidente de transition, Mme Samba-Panza, une femme remarquable - la première femme à diriger un pays d’Afrique francophone - a su créer une dynamique. Je veux lui renouveler, avec vous, le soutien de la France.
Il faut maintenant que cette dynamique puisse se concrétiser dans la vie quotidienne de la population et que le paiement des salaires des fonctionnaires reprenne, afin que les institutions de base puissent recommencer à fonctionner. Les pays de la région ont promis leur aide. Il est important que les institutions financières internationales, elles aussi, soient au rendez-vous. La France agit en ce sens.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la situation en République centrafricaine, je viens de la décrire, je crois, sans fard. Oui, les difficultés sont considérables. Non, la France ne les sous-estime pas, pas plus qu’aucun d’entre vous, et ne cherche pas à les minimiser.
Pour autant, les premiers progrès sont réels, et une perspective se dessine dans chaque domaine. Ainsi, des étapes importantes ont déjà été franchies dans la préparation des élections qui doivent être organisées d’ici à février 2015 : le code électoral a été adopté et l’autorité électorale mise en place. Il est urgent que la communauté internationale réunisse les moyens nécessaires au respect du calendrier prévu.
Pour son développement, la République centrafricaine, qui a longtemps fait partie des pays orphelins de l’aide, a évidemment besoin de l’assistance internationale. Le 20 janvier dernier, à Bruxelles, près d’un demi-milliard de dollars ont été promis pour faire face aux défis humanitaires les plus pressants et pour engager, dès maintenant, la reconstruction économique et sociale du pays.
Pour sa part, la France s’est engagée à hauteur de 35 millions d’euros pour 2014. Notre assistance technique à la République centrafricaine redémarre, et nous travaillons à accélérer la remise en marche de l’État, qui est la condition indispensable du retour des principaux bailleurs : le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l’Union européenne.
Quant à la sécurité, qui est évidemment un aspect essentiel, une opération de maintien de la paix sous Casques bleus nous paraît seule à même de répondre aux besoins de la Centrafrique.
La MISCA a accompli un travail indispensable, qui doit être conforté dans la durée. La mise en place d’une opération de maintien de la paix permettra, sur le plan militaire, de garantir les renforts nécessaires et, sur le plan civil, d’assurer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants, ainsi que, le moment venu, l’organisation des élections.
Le secrétaire général des Nations unies présentera, dans les tout prochains jours, un rapport en ce sens. Nous souhaitons que le Conseil de sécurité des Nations Unies l’examine au début du mois de mars prochain, afin que la force de maintien de la paix puisse être déployée au plus vite.
D’ici là, Sangaris assurera son rôle de relais, au côté de la MISCA et de l’opération Eufor-RCA. Afin de répondre à la situation et spécifiquement à l’appel du secrétaire général des Nations unies, le Président de la République a décidé, le 14 février dernier, de porter l’effectif de nos troupes à 2 000 hommes. L’effort supplémentaire de la France comprend le déploiement anticipé de forces de combat et de gendarmes, qui participeront ensuite à l’opération européenne.
Ensuite, la France pourra réduire son effort tout en maintenant une présence en appui à l’opération des Nations unies. Nous n’avons pas vocation à nous substituer aux forces internationales, auxquelles il incombe d’assurer, dans la durée, la sécurisation de la Centrafrique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, à Bangui et partout en République centrafricaine, nos soldats ont trouvé un pays dévasté. Comme toujours, ils ont fait preuve d’un courage et d’un professionnalisme qui font honneur à la France.
Tout comme vous, j’en suis sûr, je tiens à saluer leur engagement et à rendre hommage à nos trois soldats qui ont perdu la vie au cours de missions opérationnelles : les caporaux Nicolas Vokaer et Antoine Le Quinio, tombés le 10 décembre 2013, et le caporal Damien Dolet, tué dimanche dernier. Je veux aussi saluer la mémoire de leurs compagnons d’armes, soldats de la MISCA, qui ont été tués en opération.
Dans cette épreuve, la nation a su se rassembler dès le déclenchement de notre opération. Je veux vous en remercier toutes et tous, que vous siégiez dans la majorité ou dans l’opposition.
Une délégation de députés, conduite par la présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, s’est rendue à Bangui, la semaine dernière, pour prendre par elle-même la mesure de la situation. De son côté, le Gouvernement continuera d’informer le Sénat et l’ensemble de la représentation nationale.
Chacun, dans cet hémicycle, est conscient que notre action en Centrafrique n’est pas terminée. C’est la raison pour laquelle, conformément à l’article 35, alinéa 3, de la Constitution, le Premier ministre et moi-même demandons au Sénat d’autoriser la prolongation de notre intervention, qui a déjà permis d’éviter la destruction totale du pays.
L’action et le courage de nos soldats ont forcé et forcent l’admiration. Les conditions décisives sont réunies pour qu’un accompagnement international robuste, à la fois militaire, humanitaire et politique, permette à la République centrafricaine de retrouver le chemin de la paix.
D’ici là, il nous revient à tous d’assumer nos responsabilités. C’est un défi, mais c’est aussi l’honneur de la France !
Applaudissements.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi, sur la demande du Gouvernement, pour le débat et le vote sur l’autorisation de prolongation de l’intervention de nos forces armées en République centrafricaine.
Cette procédure est prévue à l’article 35, alinéa 3, de notre Constitution, qui dispose : « Lorsque la durée de l’intervention excède quatre mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement ».
Je me permettrai, tout d’abord, de souligner que notre précédent débat date du 10 décembre dernier. Il semble regrettable que celui de cet après-midi ne puisse pas bénéficier du recul nécessaire.
Bien évidemment, le groupe écologiste estime indispensable que ce vote intervienne. Au demeurant, comme j’ai déjà eu l’occasion de le souligner dans cet hémicycle, les écologistes défendent même l’idée qu’un vote soit organisé non seulement lors de la prolongation de l’intervention des forces armées françaises, mais dès l’engagement de celles-ci.
Murmures sur les travées de l'UMP.

S’agissant du vote sur le maintien de notre dispositif militaire en Centrafrique, peut-être aurait-il dû avoir lieu dans un mois et demi, comme notre Constitution le prévoit ; ainsi, il aurait été fondé sur un réel bilan, portant sur une durée de quatre mois depuis le début de l’opération Sangaris, dont je vous rappelle qu’elle a été lancée le 5 décembre dernier.
Il faut se souvenir que, au début du mois de décembre dernier, le Conseil de sécurité de l’ONU a autorisé, à l’unanimité de ses membres, le déploiement de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, la MISCA, pour une période de douze mois. Appuyée par des forces françaises, la MISCA est notamment chargée de contribuer à protéger les civils, à rétablir la sécurité et l’ordre public, à stabiliser le pays et à créer les conditions propices à la fourniture d’une aide humanitaire aux populations qui en ont besoin.
Lors du débat du 10 décembre dernier, j’ai déclaré que, pour les écologistes, « la capacité des pays africains à assurer eux-mêmes leur sécurité est un objectif qui requiert le soutien international et particulièrement le soutien européen ». Dans cette perspective, en effet, nous voyons s’éloigner le spectre de la « Françafrique ».
De ce point de vue, nous prenons acte de l’annonce du renforcement des effectifs européens, prévu sous peu, en réponse à la demande de l’Union africaine et en complément du soutien financier et logistique déjà mis en œuvre.
Mettre un terme au drame sécuritaire et humanitaire en cours nécessite l’action collective de nos partenaires, dans l’intérêt des populations civiles centrafricaines et de la stabilité du pays. Il y va plus largement de l’équilibre régional, dans la mesure où les troubles qui secouent cette zone alimentent des trafics en tous genres, que le groupe écologiste dénonce avec force, notamment une contrebande d’armes de petit calibre.
Preuve que la logique de multilatéralisation renforcée est nécessaire pour faire face aux enjeux immédiats de sécurité et de reconstruction de la paix, la chef de l’État de transition et le secrétaire général des Nations unies ont appelé, la semaine passée, au maintien et à l’accroissement des forces en République centrafricaine. Il me semble que nous ne pouvons rester insensibles à ces appels à mener une action présentée comme « une étape intermédiaire avant l’arrivée d’une opération de maintien de la paix en République centrafricaine ».
Le 17 février dernier, lors d’une visite au Tchad, Catherine Samba-Panza a fait part à une délégation de députés français de son souhait de voir l’intervention militaire française prolongée jusqu’aux élections prévues au début de l’année 2015. Le 20 février, Ban Ki-Moon, a demandé, devant le Conseil de sécurité, le déploiement rapide d’au moins 3 000 soldats et policiers supplémentaires pour rétablir l’ordre et protéger les civils. Par ailleurs, le président tchadien Idriss Déby Itno se déclare désormais favorable aux renforts, de même qu’à la prise de relais par les forces onusiennes.
Or, comme l’a souligné le secrétaire général de l’ONU, la mise en place de l’intervention des Casques bleus « risque de prendre des mois », alors que « la population centrafricaine ne peut attendre des mois ». Aussi, « il faut agir maintenant pour éviter une nouvelle aggravation de la situation ».
En outre, un rapport d’Amnesty International, rendu public le 12 février dernier, dénonce les violences interreligieuses qui persistent en Centrafrique en dépit de la mise en place de la MISCA, ainsi que les exactions dont sont victimes les civils musulmans ; selon l’organisation, ces exactions sont à l’origine d’« un exode sans précédent ».
Au cours des dernières semaines, cette ONG a recueilli plus d’une centaine de témoignages directs sur les attaques de grande ampleur menées dans les villes de Bouali, Boyali, Bossembélé, Bossemptélé, où plus de cent musulmans sont morts le 18 janvier, et Baoro, dans le nord-ouest du pays. Amnesty International reproche aux troupes internationales de ne pas s’être déployées dans ces villes, laissant ainsi « la population civile sans protection et livrée aux attaques des milices anti-balaka ».
Dans ces conditions, la France doit évidemment rester attentive à la situation des musulmans de Centrafrique et œuvrer à leur protection. Il me semble donc que le maintien de nos forces armées en République centrafricaine, sous mandat de l’ONU et en appui à la MISCA, doit être perçu comme une solution nécessaire à titre transitoire, jusqu’à la mise en place d’une opération onusienne de maintien de la paix.
Mes chers collègues, la prolongation soumise à notre approbation répond à une urgence sécuritaire et humanitaire ; elle a été demandée par le gouvernement transitoire de la RCA, les autorités africaines et le secrétaire général des Nations unies.
Si la France ne peut rester indifférente à ces demandes et se doit de poursuivre ses efforts sous la conduite des forces africaines, le groupe écologiste estime toutefois que notre pays ne pourra pas faire l’impasse sur la nécessaire réévaluation doctrinale de sa politique d’intervention. Aussi souhaitons-nous, monsieur le ministre, que vous nous apportiez des précisions sur la question centrale de l’engagement de nos forces sur les théâtres d’opérations extérieures.
Les écologistes tiennent également à rappeler qu’il faut faire preuve de modestie et de prudence et que la stabilité en Centrafrique suppose nécessairement un travail de concertation avec les acteurs régionaux, qui devront être associés au processus de paix pendant toute sa durée.
L’enjeu immédiat est de sécuriser la zone afin de faire cesser au plus vite les violences qui sévissent encore en Centrafrique. Cette action passe par la poursuite du processus de désarmement, qui doit être conduit de façon impartiale ; celui-ci, en effet, est la condition de la mise en place d’une aide humanitaire rapide et efficace.
Il s’agit donc de prévenir l’enlisement et de relever un défi humanitaire considérable, dans la mesure où plus d’un million de Centrafricains ont dû fuir leur domicile pour se réfugier dans des camps de regroupement, en brousse ou dans les pays frontaliers.
Le défi politique et institutionnel qui attend la Centrafrique, où des élections démocratiques doivent avoir lieu en février 2015 alors que l’administration est aujourd’hui presque inexistante, ne doit pas non plus être sous-estimé. De fait, l’État devra entièrement se reconstruire et tout recensement électoral prendra du temps. Au demeurant, ces élections post-conflit nécessiteront une forte coopération entre l’Union africaine, les ONG et les observateurs internationaux, principalement ceux de l’ONU, dans la mise en œuvre et le suivi du processus électoral.
Le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou-Nguesso, a rappelé il y a quelques jours l’importance des défis qui attendent la République centrafricaine. S’il soutient le maintien des forces armées françaises, il se prononce, plus largement, en faveur de l’augmentation du contingent international, afin qu’une présence effective puisse être assurée sur tout le territoire centrafricain.
L’ultime étape, comme j’ai déjà eu l’occasion de le rappeler à plusieurs reprises dans cet hémicycle, sera évidemment celle de l’aide au développement de la Centrafrique. Cette étape, chère aux écologistes, nous semble la seule susceptible de permettre au pays de se maintenir dans une paix durable.
Enfin, le groupe écologiste demande la tenue d’un débat dans une période de six mois, à compter de ce jour, afin d’évaluer l’état d’avancement du processus de désarmement et l’instauration de conditions décentes de sécurité pour les Centrafricains, indicateur réel de la pertinence du maintien de notre dispositif militaire dans ce pays.
Pour toutes ces raisons, et sous les réserves que je viens d’évoquer, je voterai, avec la majorité du groupe écologiste, pour la prolongation de l’intervention des forces armées en République centrafricaine, trois de nos collègues ayant néanmoins choisi de s’abstenir.
Applaudissements sur les travées du groupe écologiste, du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en décembre dernier, nous étions réunis dans cet hémicycle pour un débat d’information, au tout début de l’engagement des forces françaises en République centrafricaine et après l’adoption, à l’unanimité, de la résolution 2127 du Conseil de sécurité des Nations unies.
Quatre mois plus tard, avant l’interruption de la session parlementaire et conformément à l’article 35, alinéa 3 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle de 2008, que notre groupe a votée, nous sommes ici pour autoriser ou non la prolongation de l’opération Sangaris, qui mobilise désormais 2 000 de nos soldats.
Au nom du groupe UMP, je tiens d’abord à rendre hommage une fois de plus à ceux qui sont morts en opération. C’était le cas, dimanche encore, du caporal Dollet. Nos soldats mènent une action malaisée, car la crise centrafricaine est complexe et ses acteurs difficiles à identifier.
Aussi, la mission dévolue à la force Sangaris n’apparaît pas toujours très clairement. S’agit-il d’appuyer un gouvernement légitime ? Le régime de François Bozizé est tombé sous le coup d’une rébellion, qui s’est elle-même baptisée « Séléka », c'est-à-dire « l’alliance », mais dont la force militaire est constituée de combattants venus du nord-est du pays et essentiellement musulmans. Quant au président auto-proclamé M. Djotodja, incapable de rétablir l’ordre à Bangui, il a fini par démissionner, laissant la place à une présidente par intérim, choisie par un conseil national de transition, Mme Samba-Panza, qui était jusqu’alors maire de Bangui et qui est issue de la société civile. J’avais d’ailleurs eu l’honneur de la recevoir ici, au Sénat, avant son élection.
Son accession au pouvoir n’a pas encore permis de rétablir le calme. Face à la Séléka s’est constituée une milice dite « anti-balaka ». Il est réducteur d’en faire une milice chrétienne, face à une Séléka à dominante musulmane. Ces « anti-balakas » sont d’abord l’expression d’une réaction à une agression venue d’ailleurs ou ressentie comme telle. Ils pensent qu’ils peuvent se protéger des balles de kalachnikov des miliciens sélékas, d’où le terme « anti-balles d’AK », le fusil AK-47. Ils expriment d’abord une réaction nationaliste ou ethnique, doublée d’une incontestable propension au pillage.
Il faut rendre hommage ici aux autorités religieuses de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, archevêque de Bangui, l’iman Oumar Kobine Layama et le pasteur Nicolas Guerekoyame-Gbangou, qui ont agi ensemble et avec un grand courage pour essayer de rétablir le calme. Ce faisant, ils montrent que la situation actuelle ne résulte pas d’un affrontement religieux.
Bien évidemment, nos forces et celles de l’Union africaine ou de l’ONU sont là non pas pour soutenir un camp contre un autre, mais pour tenter de désarmer tous les violents. Ces derniers ont sans doute des inspirateurs… Ceux qui utilisent abusivement la religion, comme ils ont utilisé des enfants soldats, pour viser leurs buts politiques, doivent savoir qu’ils relèvent d’un tribunal pénal international. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si certains inspirateurs des violences commises ont été identifiés ?
Qui pourrait aujourd’hui comprendre que nous retirions nos forces d’un pays secoué par de telles violences ? Quel signal serait ainsi donné ? Quelle responsabilité serait alors celle de la France ? Bien évidemment, le groupe UMP se prononcera en faveur de la prolongation de l’opération Sangaris.

Toutefois, notre vote ne nous dispense pas d’exprimer des regrets, de poser des questions et de formuler des recommandations.

Première interrogation : était-il vraiment impossible d’éviter d’en arriver à cette violence généralisée ? Les mises en garde, pourtant, n’avaient pas manqué. L’arrivée de la Séléka à Bangui reproduit d’assez près les événements ayant précédé et suivi la chute, en 2003, du président Patassé et l’arrivée au pouvoir du général Bozizé : mêmes enrôlements de coupeurs de route, de pillards divers, par des rebelles souvent venus du nord musulman ou des limites du Tchad et du Darfour, qui se payent de leurs efforts en pillant Bangui, en 2003 comme en 2013, mais aussi Bossangoa et les missions catholiques et les églises, qui, souvent, en brousse, représentent les seuls services de soin ou sociaux à la disposition de la population.
N’avons-nous pas perçu la montée de l’humiliation et de la colère dans un pays qui s’est alors senti mis sous tutelle ? Il me semble nécessaire de nous interroger sur nos capacités de prévision et d’analyse. Nous passions pour être bien informés sur l’Afrique, au moins l’Afrique francophone. Est-ce vraiment encore le cas ? À cet égard, mes chers collègues, je vous invite à relire le rapport de notre collègue Robert del Picchia, paru en 2011, intitulé La Fonction « anticipation stratégique » : quel renforcement depuis le Livre blanc ?
J’avais évoqué ce point dans mon intervention du mois de décembre dernier : avons-nous réagi suffisamment vite, face à la situation créée à Bangui à la suite du renversement par la force du régime Bozizé ? Pourtant, les avertissements n’ont pas manqué ! Dans un message du 14 février 2013 signé par les onze évêques du pays, soit avant la prise et le pillage de Bangui, la conférence épiscopale centrafricaine appelait la communauté internationale à l’aide. J’avais quant à moi posé une question écrite dès le 28 mars 2013, en évoquant un « désastre humanitaire qui menace ». Je ne faisais que reprendre des informations largement répandues.
Voilà pourquoi nous pensons, monsieur le ministre, que si la France, et donc son gouvernement, a été plus courageuse que bien d’autres pays en portant finalement l’affaire devant l’ONU et en intervenant, cette initiative n’en a pas moins été tardive et effectuée a minima.
Intervenir dans ces conditions rend périlleuse la situation de nos troupes, et ne permet pas d’arrêter les violences, à Bangui d’abord, mais surtout en brousse, où nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Est-ce trop demander que de suggérer que les conditions de notre intervention, avec ses insuffisances, fassent l’objet d’une réflexion utile, au service d’une action efficace de la France en Afrique : quels objectifs, avec quels moyens ?
Il convient de rappeler que nos soldats sont surtout présents en théâtre urbain et que nous n’avons pas les moyens d’un déploiement sur un territoire immense. Rien ne serait pire que l’affirmation d’une volonté politique sans la capacité à mettre en œuvre les moyens qui la rendent efficace.
Parlons maintenant de l’avenir. La République centrafricaine est un état effondré. Celui-ci doit être reconstruit dans son intégrité territoriale. Toutefois, tout est à refaire. Bien évidemment, ce n’est pas la seule mission de la France. C’est d’abord l’affaire des Centrafricains eux-mêmes. C’est pourquoi il est indispensable de donner au gouvernement transitoire les moyens d’agir et au peuple centrafricain la possibilité de choisir ses dirigeants. À cet égard, je ne suis pas sûr que Mme Samba-Panza, la courageuse présidente intérimaire, dispose des moyens de mener une action.
Il faut aussi tenir un langage de vérité. La France et la communauté internationale n’accepteront pas longtemps de risquer la vie de leurs soldats pour un pays dont la classe politique resterait enfermée dans des querelles dérisoires. Cependant, plus que d’élections, nécessaires bien sûr pour constituer, dans des délais raisonnables, un gouvernement légitime, les Centrafricains ont d’abord besoin de sécurité, de soins, de nourriture et d’éducation.
L’ensemble du pays doit retrouver le calme. Bangui et une partie de l’Ouest centrafricain sont parcourus par nos forces et les forces africaines. L’Est, entre le Sud-Soudan et la république démocratique du Congo, est plus ou moins sécurisé par des troupes ougandaises, qui luttent contre les criminels de l’Armée de résistance du Seigneur, la terrible LRA. Toutefois, le repli des musulmans, terrifiés, vers la Vakaga, au nord-est du pays, autour de Birao, ne risque-t-il pas d’instaurer de facto une partition, dont ce malheureux pays n’a sûrement pas besoin ? Des forces internationales vont-elles se rendre aussi à Birao, monsieur le ministre ?
Les moyens rassemblés auprès des pays donateurs ne risquent-ils pas d’apparaître bien insuffisants pour réhabiliter les routes et les équipements publics ? L’AFD, l’Agence française de développement, va-t-elle reprendre son travail à Bangui ? L’armée française elle-même, avec les moyens du génie, ne peut-elle pas, au moins dans la capitale du pays, faire la démonstration très visible de sa présence au service de la population ? La meilleure façon de faire reculer la violence, c’est évidemment de montrer à la population centrafricaine, quelle que soit sa religion ou son ethnie, que la France et les autres intervenants internationaux sont là pour la population, sa protection et sa sécurisation.
Rétablissement de la sécurité et des communications vont de pair. Avec l’arrêt de l’entretien des routes et la fuite des commerçants, souvent musulmans, c’est le ravitaillement qui est en péril. La disette menace. Qu’est-il envisagé pour y faire face, monsieur le ministre ?
Il est aujourd'hui à la mode de dire que l’Afrique est l’avenir de la francophonie. Encore faut-il que le français soit enseigné, donc qu’il y ait un service éducatif qui fonctionne… J’ai connu jadis une RCA dont le territoire tout entier était maillé d’écoles, de collèges et de lycées. Avec le concours de l’Europe, des pays africains de la zone et de l’Organisation internationale de la francophonie, est-il prévu de réhabiliter le système éducatif centrafricain ?
Votre collègue, Mme Benguigui, ministre chargée de la francophonie, annonçait récemment à la commission des affaires culturelles qu’elle allait lancer une grande opération de formation de professeurs pour l’Afrique. Est-il prévu d’en faire bénéficier prioritairement la RCA ?
Les collectivités territoriales françaises se sont massivement mobilisées en faveur du Mali. La Centrafrique n’avait pas la même tradition de coopération décentralisée avec les collectivités territoriales françaises. Toutefois, est-il envisagé d’inciter à une semblable mobilisation en faveur de la RCA ?
Ne nous y trompons pas, après un tel effondrement, c’est au moins dix années qui seront nécessaires pour reconstruire ce pays. Cependant, c’est bien un tel objectif, à savoir une reconstruction exemplaire, qu’il faut proposer à tous ceux qui, avec nous, avec l’Afrique, à l’ONU, voudront s’engager dans l’action.
Ces vingt dernières années, la France est intervenue six fois en Centrafrique. Plutôt qu’une succession d’interventions ponctuelles, nous devons, avec nos partenaires, être capables d’une action de longue durée, qui s’attaque à la racine des problèmes. Ce pays a des ressources. Il peut se développer, offrir à sa population des conditions de vie convenables. Voilà le véritable objectif à atteindre.
Au Sénat, nous réfléchissons en profondeur aux rapports entre la France et l’Afrique. La semaine dernière, le colloque organisé conjointement par le groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest et l’Agence française de développement sur le thème « Éducation et formation professionnelle » a connu un beau succès. Nos collègues Jean-Marie Bockel et Jeanny Lorgeoux, avec leur rapport intitulé L’Afrique est notre avenir, ont soumis à notre réflexion, et à la vôtre, monsieur le ministre, de nombreuses propositions, dont nous pouvons discuter.
Toutefois, réfléchissons bien à ce que signifie l’affirmation selon laquelle l’Afrique est une part de notre avenir. C’est reconnaître que ce qui se passe sur ce continent a nécessairement chez nous des conséquences importantes et à court terme.
Fort heureusement, de nombreux pays d’Afrique connaissent actuellement une belle croissance. Il ne faut pas les oublier. Pourtant, chaque année, 12 millions de jeunes en Afrique subsaharienne arrivent sur le marché du travail. Quel avenir pour eux ? Quelles conséquences pour nous ? Nous devons vouloir que la Centrafrique se relève, que l’Afrique gagne. C’est notre intérêt, mais aussi, bien sûr, notre honneur.
Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, face à la spirale de l’affrontement et de la violence entre les rebelles de l’ancienne Séléka et les groupes d’auto-défense « anti-balaka », la communauté internationale se devait de réagir en Centrafrique.
C’est dans cet esprit de responsabilité que la France a lancé l’opération Sangaris, dans le cadre de la résolution 2127 du Conseil de sécurité de l’ONU. Depuis lors, les soldats français, dont je tiens à mon tour à saluer l’engagement, œuvrent avec courage et détermination aux côtés des forces africaines pour rétablir un niveau minimal de sécurité.
Cependant, près de trois mois après le début de l’opération, force est de constater que la situation sécuritaire reste particulièrement fragile à Bangui et plus encore en province, entraînant l’exode de nombreuses familles centrafricaines.
L’environnement de crise complexe rend par ailleurs la conduite de l’opération malaisée. En effet, comment identifier des ennemis infiltrés au sein même de la population ? Comment désarmer des rebelles dont les atrocités sont souvent commises à la machette ? Alors que le président Hollande avait initialement évoqué une opération « rapide » en RCA, Jean-Yves Le Drian a annoncé que celle-ci serait plus longue que prévu, en raison du « niveau de haine et de violence ».
S’agissant de l’anticipation de cette situation, je m’associe aux questions soulevées à l’instant par Jacques Legendre.
Certes, le groupe UDI-UC souscrit à cette nécessaire adaptation à la réalité du terrain et apportera très majoritairement, dans une démarche d’union nationale, son soutien à la prolongation de l’intervention. Il n’en demeure pas moins que l’engagement de nos forces armées, ainsi que la situation en RCA dans son ensemble, se heurte à certains défis, auxquels il est urgent d’apporter des réponses pour sortir durablement de la crise.
Vous l’aurez compris, à l’heure de se prononcer sur la poursuite de l’opération Sangaris, ce sont donc les interrogations qui prévalent.
Tout d’abord, la question des moyens se pose. Pour faire face à une situation sécuritaire volatile, le processus de désarmement, démobilisation, réintégration – DDR –, la réforme du secteur de sécurité et le respect de l’embargo sont prioritaires. Or il semble évident que les forces françaises et la MISCA sont sous-dimensionnées pour atteindre ces objectifs. On considère par exemple qu’un rapport d’un soldat pour soixante civils est nécessaire pour les missions de DDR. Dans le cas de Bangui, il faudrait dans l’absolu près de 20 000 hommes pour mener efficacement une campagne de désarmement. Le secrétaire général de l’ONU réclame quant à lui le déploiement rapide d’au moins 3 000 soldats supplémentaires…
Monsieur le ministre, alors que le Président de la République a décidé d’envoyer 400 soldats en renfort, portant notre contingent à 2 000 hommes, quel est votre sentiment sur ce rapport de force ? Les soldats français seront-ils en mesure de se déployer progressivement en province, notamment vers les villes de Berbérati, Bouar et Bossangoa, où la présence militaire reste encore limitée ? Sommes-nous finalement encore capables de mener ce type d’opération, qui nécessite d’importants moyens humains et logistiques, compte tenu des tensions capacitaires qui apparaissent au sein de nos armées ?
Dans ce contexte, nous ne pouvons que nous réjouir de l’envoi d’une force européenne d’environ 1 000 soldats. Alors qu’Eurfor-RCA devrait contribuer à sécuriser Bangui, nous appelons désormais les États membres à faire preuve de responsabilité lors de la conférence de génération des forces, pour permettre le déploiement de l’opération au plus vite. Quid également d’un soutien européen au système judiciaire et pénitentiaire centrafricain, à travers l’envoi de gendarmes, d’experts et de professionnels ?
Au-delà de l’engagement des forces françaises et européennes, la stabilité de la RCA est avant tout un enjeu régional. Avec une superficie de plus de 600 000 kilomètres carrés et 4, 6 millions d’habitants, ce pays est un carrefour de l’Afrique dont la porosité profite aux groupes armés en tous genres.
De la stabilité de la RCA dépend la stabilité du cœur de l’Afrique. Il suffit de regarder la carte pour le comprendre ; celle-ci figurait il y a quelques jours dans un grand quotidien et elle est extrêmement parlante. L’« africanisation » du conflit en RCA passe ainsi par un renforcement de la MISCA, qui devrait atteindre le seuil de 6 000 hommes sous la bannière de l’Union africaine. C’est surtout de matériel – et plus particulièrement de capacités de transport – que la MISCA a besoin pour projeter ses troupes sur l’ensemble du territoire.
Plus globalement, la crise en Centrafrique rappelle avec force que la mise en place d’une véritable architecture de paix et de sécurité africaine demeure essentielle pour que l’Afrique puisse contribuer activement à la sécurité du continent. À la suite du conflit malien, l’Union africaine a d’ailleurs annoncé la création d’une capacité africaine de réponse immédiate aux crises, à laquelle la France a apporté son soutien lors du dernier sommet de l’Élysée.
Ce dispositif, qui repose sur le volontariat, vise à améliorer la réactivité des forces africaines en situation de crise, grâce à la mobilisation d’une capacité de projection pouvant être déployée sous dix jours. Si certaines réticences subsistent, une dizaine de pays africains se sont déjà portés volontaires pour y participer.
Cette initiative, certes en devenir, mérite d’être saluée, car elle va dans le bon sens, à savoir la gestion par les Africains de leurs problèmes sécuritaires, démarche indispensable à terme et à laquelle nous devons déjà réfléchir pour les années à venir.
Néanmoins, seule l’ONU possède aujourd’hui l’intégralité des instruments de gestion de crise pour proposer une réponse globale, coordonnée et cohérente à ces conflits complexes. Aussi, à l’instar de ce qui prévaut au Mali, il convient de transformer la MISCA en une opération de maintien de la paix – nous en sommes tous d’accord, me semble-t-il – dotée d’un mandat robuste et élargi. La gravité de la situation en RCA requiert des moyens importants et de l’expertise pour accompagner la transition politique et maintenir une présence humanitaire.
Monsieur le ministre, le déploiement de Casques bleus, s’il est autorisé, pourrait-il conduire, le cas échéant et le moment venu, à une diminution des effectifs militaires français présents en RCA, au profit d’un volet civil étoffé, comme l’a évoqué de manière précise et convaincante Jacques Legendre ?

Par ailleurs, parallèlement aux efforts d’interposition, il faut au plus vite enclencher un processus de réconciliation nationale. C’est un chantier considérable pour la présidente de transition Catherine Samba-Panza. Il lui appartient de créer les conditions de l’union nationale, car le facteur religieux, convoqué par les chefs de guerre, a profondément divisé les communautés, qui vivaient pourtant en harmonie dans le pays depuis des décennies. Comme l’affirme l’archevêque de Bangui, « pour avancer vers la réconciliation, chacun doit désormais prendre conscience des exactions commises par les deux camps, anti-balaka et ex-Séléka. C’est pourquoi le pardon passe nécessairement par la réparation ».
Les efforts de médiation de la communauté de Sant’Egidio – celle-ci est intervenue à plusieurs reprises dans des conflits en Afrique avec une certaine efficacité, en particulier au Mozambique –, sous l’égide de laquelle a été signé à Rome en novembre dernier un « pacte républicain », pourraient faciliter la mise en place des mécanismes concrets de réconciliation, tout en établissant un dialogue politique inclusif avec les forces vives du pays.
Dans le même temps, il faut s’attaquer aux enjeux plus profonds de la gouvernance et du développement, car il ne pourra y avoir de sécurité durable sans reconstruction de l’État et sans développement. L’économie centrafricaine est au point mort ; elle a beaucoup reculé d’une année sur l’autre. Ce qu’il reste des structures économiques, mais aussi les municipalités, les ONG et les associations locales ont un rôle essentiel à jouer pour relancer la vie économique et reconstruire un vouloir-vivre ensemble. Si la situation sécuritaire le permet, pourquoi ne pas renforcer progressivement la présence de l’Agence française de développement, dont l’expertise serait déterminante pour accompagner ces projets en Centrafrique ?
Enfin, je souhaite revenir, avant de conclure, sur la dramatique crise humanitaire que traverse la RCA. Selon l’ONU, près d’un million de personnes ont été déplacées depuis le début de la crise, dont 60 % d’enfants. Des milliers de personnes ont également fui vers les pays voisins – Cameroun, Tchad, etc. Selon la secrétaire générale adjointe des Nations unies aux affaires humanitaires, plus de la moitié de la population centrafricaine requiert une assistance immédiate.
À ce jour, les bailleurs de fonds ont promis 207 millions de dollars pour financer l’aide humanitaire en Centrafrique, mais seulement 28 % de ces fonds ont été engagés. Le plan de réponse stratégique de l’ONU, d’un montant total de 551 millions de dollars, n’est financé qu’à hauteur de 15 %.
Monsieur le ministre, alors que l’aide internationale est clairement insuffisante face à l’urgence de la situation, quelles mesures la France et ses partenaires pourraient-ils mettre en œuvre pour en accélérer la distribution, notamment vers le camp de M’poko, où près de 100 000 personnes vivent dans des conditions terribles ?
Les défis, qu’ils soient sécuritaires, politiques ou humanitaires, sont nombreux en RCA, et le chemin vers la paix et la stabilité sera long et exigeant. C’est en premier lieu sur les dirigeants et le peuple centrafricain que repose la lourde responsabilité d’entamer le processus de réconciliation indispensable pour sortir le pays des massacres et du chaos.
Toutefois, c’est un poids que, seuls, sans le soutien des États africains et de la communauté internationale, ils pourront difficilement porter. La France, en raison de sa proximité historique et de sa place sur la scène internationale, se doit d’apporter sa contribution à cet effort de stabilisation. C’est notre responsabilité partagée.
Sous ces réserves, en formant le souhait que se tienne dès que possible un nouveau débat d’évaluation de la situation, le groupe UDI-UC votera, dans sa très grande majorité, pour la prolongation de l’intervention de nos forces armées en RCA.
Applaudissements.

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le Gouvernement, comme lui en fait obligation le troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, sollicite du Parlement, quatre mois après le début de cette intervention militaire, l’autorisation de prolonger notre opération en République centrafricaine.
Je ne puis m’empêcher de regretter, légitimement, que notre réforme constitutionnelle se soit, en la matière, arrêtée au milieu du gué et qu’il n’ait pas été prévu de demander une autorisation du Parlement en premier lieu, comme c’est le cas chez certains de nos voisins européens. On mesure dans les débats en général qu’il est beaucoup plus complexe d’accorder notre autorisation de prolongation a posteriori, celle-ci étant en quelque sorte amputée, en l’absence de tout véritable approfondissement. Je tenais à le dire.
Avant d’aborder la question qui nous est posée, je voudrais rendre hommage à Damien Dolet, jeune caporal du 8° régiment d’infanterie chars de marine, qui est mort dans l’accomplissement de sa mission. À l’heure où le Parlement doit prendre sa décision, je voudrais saluer le courage, le sang-froid et le professionnalisme dont font preuve nos soldats dans la mission qu’ils remplissent au nom de la France.
Au vu de la complexité du sujet et de l’évolution de la situation en Centrafrique, la décision est difficile à prendre. Pour y réfléchir, notre groupe a procédé à de nombreux échanges et a beaucoup consulté.
Au mois de décembre dernier, lorsque nos forces sont intervenues militairement, le basculement de la Centrafrique dans l’anarchie et la violence était en cours depuis de nombreuses années. La situation s’est particulièrement aggravée au cours de l’année 2012. Les raisons de l’effondrement de ce pays sont connues : l’extrême pauvreté et l’instabilité politique chronique résultent d’une situation économique catastrophique.
Rappelons-le, la France y avait une part de responsabilité pour avoir trop longtemps joué un rôle d’influence négatif, notamment en soutenant successivement des gouvernements peu recommandables.
C’est grâce, il faut le dire, aux alertes lancées par des organisations non gouvernementales et à la suite des réactions diplomatiques de notre pays face à l’aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire que, enfin, une résolution de l’ONU a autorisé au mois de décembre dernier le déploiement de nos troupes en appui des forces africaines déjà sur place depuis quelques mois.
Lors d’un premier débat au mois de décembre 2013, notre groupe avait soulevé quelques interrogations et émis des réserves sur les objectifs et les conditions de cette nouvelle opération extérieure, quelques mois après l’intervention au Mali.
« Pourquoi et comment, avec qui et avec quels moyens la France veut-elle gérer cette nouvelle crise au centre de l’Afrique ? », demandions-nous alors. Nous soulignions aussi l’absence de solidarité européenne, qui nous isolait dangereusement.
Or, où en est-on aujourd’hui sur place ? Les choses sont encore plus complexes, car, depuis quelque temps, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de cette crise. Après avoir partiellement réussi à neutraliser et à repousser hors de Bangui les milices de la « Séléka », les forces françaises et africaines éprouvent de grandes difficultés à empêcher les actes de revanche des milices adverses « anti-balaka », qui se livrent aussi à des représailles contre les civils musulmans accusés de complicité avec l’ex-rébellion. Cela se traduit par de nouveaux massacres, sous prétexte de rivalités ethniques et religieuses instrumentalisées.
La gravité de ces faits est telle que le Secrétaire général de l’ONU et Amnesty international ont pu les qualifier de « nettoyage ethnique ». S’y ajoute la menace, annoncée par plusieurs ONG, d’une nouvelle catastrophe humanitaire due à la famine, à tel point que le programme alimentaire mondial a dû établir un pont aérien.
Ainsi, le résultat actuel est que Sangaris a certainement permis d’éviter un massacre peut-être pire encore, mais n’a malheureusement pas pu faire obstacle à un nettoyage ethnique d’une rapidité fulgurante.
Il faut donc à tout prix mettre un terme à l’un des principaux facteurs de déstabilisation qu’est cette guerre civile aux relents d’épuration ethnico-religieuse. En effet, si elle se poursuivait, elle laisserait des traces profondes et pourrait mener tout droit à la partition du pays.
La première urgence est donc humanitaire et sécuritaire. Le rétablissement de la situation sécuritaire est un préalable nécessaire à la mise en œuvre d’une transition politique et institutionnelle. La phase de soutien militaire est donc nécessaire, et cette séquence n’est malheureusement pas encore terminée.
Toutefois, à côté de ces motivations d’ordre purement humanitaire, en intervenant dans ce pays militairement, il faut aussi se demander sans naïveté si la France n’entend défendre que des valeurs et de grands principes.
Comme l’écrit sur son blog avec franchise et clarté – je m’exprimerai de la même façon – un analyste militaire reconnu, le colonel Michel Goya, dans cette affaire, la France cherche à « préserver une influence dans la région – une quarantaine de votes africains quasi automatiques aux Nations unies, la zone monétaire CFA et ses intérêts économiques. Il s’agit d’éviter que la Centrafrique ne se transforme définitivement en zone de non-droit, entraînant les pays voisins dans une grave instabilité, avec le risque de développement d’organisations islamistes radicales à la manière de Boko Haram dans le nord du Nigéria. »
Je disais précédemment que, avec les évolutions récentes, nous étions entrés dans une nouvelle phase de gestion de cette crise, sans connaître vraiment les objectifs, les solutions politiques et sécuritaires que vous voulez mettre en œuvre, monsieur le ministre.
En effet, l’opération Sangaris change de nature : alors qu’elle était initialement destinée à faire cesser les massacres, vous demandez maintenant à nos troupes, sur la requête de la présidente Samba-Panza, d’assurer une mission d’accompagnement jusqu’aux prochaines élections.
Ce changement suscite inévitablement des interrogations. Quel est précisément et fondamentalement l’objectif de cette mission ? Quel délai lui fixez-vous et comment pourrions-nous nous en désengager ?
Face à toutes ces difficultés et à ces incertitudes, l’urgence est d’obtenir, dans l’attente du modeste déploiement de l’Eufor-RCA, l’accélération du processus de transformation de Sangaris et de la MISCA en opération onusienne de maintien de la paix, beaucoup plus efficace et légitime pour résoudre cette crise.
Dans ce contexte, qui constitue tout à la fois un drame humanitaire et un défi concret de sécurité régionale, le processus démocratique en Centrafrique piloté par l’ONU avec des autorités politiques et étatiques légitimées par des élections offrira sans doute plus de garanties de réussite. Après le rétablissement de la sécurité, c’est la réponse indispensable pour sortir des crises chroniques et ouvrir enfin à ce pays des perspectives de réconciliation nationale et de développement. C’est le seul objectif qui doit guider notre intervention.
Il faut qu’une telle opération de maintien de la paix soit rapidement mise sur pied afin de prendre le relais de nos troupes. Toutefois, il faut également veiller à ce qu’elle ait une forte composante civile et s’accompagne des financements propres et pérennes que lui garantira le statut d’OMP, c'est-à-dire d’opération de maintien de la paix.
Dans ce pays, comme sur d’autres théâtres d’opérations, tout le monde s’accorde à reconnaître, et les militaires sans doute les premiers, que le « tout militaire » n’apporte pas la solution.
Il faut une approche globale pour agir sur plusieurs leviers, et il est heureux que vous nous ayez apporté un peu plus de précisions sur ce point, monsieur le ministre. En effet, au-delà des solutions d’urgence, il est grand temps de s’attaquer aux causes profondes qui déstabilisent ce pays depuis si longtemps.
Il faut rompre définitivement avec les politiques et les mauvaises pratiques qui ont cours depuis la décolonisation et qui ont entraîné ce continent dans le sous-développement et la misère, alors même qu’il regorge de richesses.
Nous l’avions déjà dit, avec d’autres, ici même, il faut sans tarder procéder à une véritable refonte de l’ensemble de notre politique d’aide publique au développement, afin de redéfinir ses objectifs, ses enjeux et ses moyens. Cette politique doit être enfin fondée sur de véritables partenariats, qui permettent d’entretenir des rapports débarrassés des arrière-pensées de simple préservation des intérêts stratégiques et économiques de la France.
Par exemple, en Centrafrique, de façon très concrète et significative, une fois rétablie une autorité étatique souveraine, l’une des premières mesures de transparence d’ordre économique devrait être de rendre publics tous les contrats dans le secteur minier et dans celui de l’extraction du pétrole et de l’uranium.
De ce point de vue, nous estimons que les efforts et les engagements de votre gouvernement et de sa majorité en matière d’aide publique au développement ne sont pas véritablement à la hauteur des enjeux. À cet égard, le projet de loi sur le développement et la notion d’action extérieure des collectivités territoriales qui vient d’être adopté par l’Assemblée nationale ne concrétise pas suffisamment les espoirs qu’il a pu susciter. En particulier, nous constatons un désengagement de l’État qui ne dit pas son nom dans le domaine des collectivités territoriales et des ONG.
Ah ! sur les travées de l'UMP.

Mme Michelle Demessine. … en particulier de la Centrafrique, qui nous préoccupe ce soir. Car « s’il faut que tout change pour que rien ne change », nous vivrons des crises à répétition, avec des conséquences de plus en plus graves et de moins en moins de moyens pour y faire face.
Marques d’impatience sur les travées de l'UMP.

Compte tenu des dangers non écartés d’accélération des massacres de populations civiles, la sécurité est encore loin d’être établie. Nous sommes d’accord pour dire que l’annonce d’un retrait serait un mauvais signal envoyé à tous les belligérants et milices de toute sorte. Nous appelons de nos vœux la mise en place rapide de l’opération de maintien de la paix.
Après en avoir beaucoup discuté au sein de notre groupe, qui partage de manière unanime l’appréciation de fond que je viens de développer dans mon propos, …

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, le 5 décembre dernier, le Président de la République décidait de lancer l’opération Sangaris. Cette intervention était urgente et nécessaire pour venir au secours d’un pays au bord du gouffre et d’une population qui subissait exactions et massacres.
En effet, depuis la prise du pouvoir par des rebelles de la Séléka, en mars 2013, les pillages, les viols, les mutilations et les exécutions sommaires se multipliaient au cours d’affrontements intercommunautaires et interconfessionnels. Dès le 24 septembre dernier, le Président de la République avait lancé un cri d’alarme…
Sourires sur les travées de l'UMP.

… devant l’Assemblée générale des Nations unies, invitant la communauté internationale à se mobiliser pour « éviter le pire en Centrafrique ».
Face à ce drame, la France ne devait pas, ne pouvait pas rester sourde aux appels à l’aide des autorités centrafricaines et de l’Union africaine. La France était en effet le seul pays extérieur à l’Afrique à disposer de forces aux frontières de la Centrafrique, notamment au Gabon et au Tchad.
Nos troupes auraient été stationnées à proximité des massacres, et nous aurions laissé faire ? Ce serait alors en milliers, voire en dizaines de milliers de morts que l’on compterait aujourd’hui les victimes de cette tragédie, et chacun a en mémoire celle du Rwanda.
C’est donc sur la base d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies, sa résolution 2127, et en appui à la mission internationale de soutien à la Centrafrique, la MISCA, que la France a décidé d’engager Sangaris. En deux jours, nous avons réussi à porter notre présence sur place à 1 600 hommes, entre nos troupes stationnées dans la région et celles qui sont venues de France.
À l’appel du secrétaire général des Nations unies, M. Ban Ki-moon, le Président de la République a décidé le 14 février dernier l’envoi de 400 hommes supplémentaires, portant ainsi l’effectif français à 2 000 soldats en RCA.
Notre action, aux côtés des 6 000 militaires africains de la MISCA, vise trois objectifs : tout d’abord, éviter un bain de sang, ensuite, faciliter l’action humanitaire, enfin, rétablir la sécurité pour favoriser le rétablissement d’un processus démocratique.
Concernant le premier objectif, depuis décembre dernier, les militaires français et africains sécurisent les sites les plus sensibles et participent aux actions de cantonnement et de désarmement des groupes armés. Certes, il y a encore des exactions, des meurtres, des lynchages, mais sans commune mesure avec la situation qui prévalait avant notre intervention, comme l’a indiqué avant-hier le général Soriano, qui commande l’opération Sangaris.
Trois mois après son lancement, l’intervention française a donc permis d’atteindre l’objectif immédiat qui était de diminuer le nombre de massacres et d’arrêter le basculement de tout le pays dans la guerre civile.
Le deuxième objectif de Sangaris est de faciliter la réponse humanitaire. Certes, six habitants sur dix ont encore besoin d’assistance. Certes, près d’un tiers de la population est encore sous-alimenté, dont un grand nombre de femmes et d’enfants. Certes, le nombre de personnes déplacées reste très élevé : environ 700 000, soit près d’un habitant sur six, dont 275 000 pour la seule capitale, Bangui.
Cependant, les organisations non gouvernementales peuvent désormais couvrir les besoins les plus urgents de la population, et la conférence des donateurs qui s’est tenue à Addis-Abeba, le 1er février dernier, a permis de confirmer la mobilisation de la communauté internationale en faveur de la RCA.
Pour sa part, la France soutient des programmes d’aide alimentaire et d’aide médicale d’urgence, dont elle a confié la mise en œuvre au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, au HCR, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, à l’UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l’enfance, ainsi qu’aux grandes ONG internationales.
Enfin, concernant le troisième objectif, le rétablissement de l’État de droit, la Centrafrique est entrée dans une nouvelle séquence, puisque l’opération Sangaris a précipité la chute du pouvoir Séléka et du tandem politique Djotodia-Tiangaye.
Mme Catherine Samba-Panza a été élue chef d’État de transition le 20 janvier dernier et elle a nommé un premier ministre. L’un comme l’autre sont aujourd’hui pleinement investis dans leurs fonctions en faveur de la stabilisation de la République centrafricaine, de la réconciliation nationale et de la tenue d’élections libres.
Sangaris était donc nécessaire, Sangaris était évidemment urgente et Sangaris a commencé à réussir. Pour autant, rien n’est acquis, et la France doit continuer sa mission, d’autant que la communauté internationale s’apprête à venir en renfort.
Tout d’abord, des renforts en provenance d’Europe. L’Union européenne n’a pas attendu la récente explosion de violence pour aider la Centrafrique, puisque ce sont plus de 360 millions d’euros d’aide humanitaire, mais aussi de soutien à la MISCA, qu’elle a déjà mobilisés avant même qu’elle n’enclenche une action militaire.
En outre, le 20 janvier dernier, le Conseil des affaires étrangères de l’UE a franchi une nouvelle étape en décidant de contribuer « par un appui temporaire, pour une période pouvant aller jusqu’à six mois, à fournir un environnement sécurisé, dans la région de Bangui, en vue de passer le relais à l’Union africaine ».
Ce dispositif Eufor-RCA, dont les coûts communs sont estimés à 26 millions d’euros, sera opérationnel au début du mois de mars prochain, aux côtés de la force Sangaris et de la MISCA, et il devrait monter progressivement en puissance, jusqu’à atteindre plus de 1 000 hommes.
Ces soldats européens arriveront de France, évidemment, mais aussi de Pologne, de Roumanie, du Portugal et de pays plus petits, qui n’ont aucun intérêt stratégique, ni même économique en Afrique, et dont il faut saluer l’engagement : je pense à l’Estonie, à la Lettonie et à la Géorgie. La Finlande, l’Espagne, le Luxembourg et la Suède pourraient, eux aussi, annoncer prochainement leur participation, et la gendarmerie européenne sera également présente.
Quant à Londres et Berlin, elles ont déclaré qu’ils apporteraient un soutien seulement logistique et financier. Ces réticences à s’engager sur le terrain, au sol, comme disent les militaires, sont regrettables, provenant de deux grands pays qui ont, comme la France, des liens historiques, mais aussi économiques avec l’Afrique.
Si nos amis britanniques et germaniques savent bien que l’avenir de l’Europe passe par celui de l’Afrique, un continent riche de sa jeunesse et de ses ressources et qui pourrait bien être le continent du XXIe siècle, ils doivent savoir aussi que, si le développement de l’Afrique est potentiellement porteur d’avenir pour l’Europe, c’est à la condition que l’Europe, les grands pays européens en particulier, ne se désintéresse pas de ce qui s’y passe sur le plan politique.
Or l’anarchie en République centrafricaine était une menace de déstabilisation pour toute la région : je pense aux Grands Lacs, aux deux Soudans, au Congo, mais aussi au Tchad et au Cameroun, sans oublier le Nigeria voisin. La porosité des frontières, l’exploitation illégale et le commerce de ressources naturelles, le trafic d’armes au profit de groupes terroristes, nombreux dans cette zone, favorisent une multiplication de conflits, latents ou potentiels. L’Europe ne peut y être indifférente, et en Europe les plus grands pays moins que les autres.
Après l’Europe, c’est bien sûr à l’ONU de s’engager, et la création d’une OMP, cela a déjà été dit, semble désormais indispensable, car il est évident que le simple renforcement du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, le BINUCA, ne permettra pas de relever les nombreux défis qui sont devant nous.
Seule une OMP sera en mesure d’apporter à la Centrafrique les moyens d’accroître, dans la durée et de façon efficace, le volume de troupes et de policiers nécessaire pour reconstruire l’État, préparer les élections, protéger les droits de l’homme et permettre l’acheminement de l’aide humanitaire. Des discussions s’engageront à la fin de cette semaine au Conseil de sécurité de l’ONU, à New York, et elles seront évidemment cruciales.
Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, si la France a pris ses responsabilités en Centrafrique, c’est parce qu’elle a le sens de ses responsabilités, notamment internationales, comme membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.
Si la France a pris ses responsabilités en Centrafrique, c’est aussi parce qu’elle a une histoire en Afrique, et cette histoire nous oblige, hier au Mali, aujourd’hui en République centrafricaine.
Il y a un an, le Mali allait tomber aux mains de groupes djihadistes : la charia était la loi, on coupait des mains et les terroristes se préparaient à prendre tout le pays en otage. Un an après le lancement de l’opération Serval, le Mali est devenu un pays sécurisé, avec un président élu au suffrage universel, une assemblée nationale, un gouvernement et un début de reprise économique.
La compétence de nos forces armées et la vaillance de nos soldats ont permis la réussite de Serval. Même si l’intervention française en RCA est évidemment différente, dans ses raisons comme dans sa nature, l’objectif est le même : permettre à un pays ami d’éviter de sombrer dans le chaos et à une population d’éviter d’être massacrée.
Pour autant, si la France aujourd’hui, l’Europe demain, l’ONU bientôt répondent présent au Mali comme en Centrafrique, c’est bien sûr d’abord à l’Afrique elle-même de prendre son destin en main. Si j’ai dit que ce continent était porteur des plus grandes promesses de développement dans le siècle qui commence, il doit aussi savoir relever, par lui-même, le défi de sa sécurité.
C’est pourquoi il faut se féliciter que le sommet franco-africain de l’Élysée, réuni autour du Président de la République en décembre dernier, a rappelé la nécessité de renforcer les capacités africaines de réponse aux crises sur le continent avec la mise en place d’une véritable force panafricaine de réaction rapide.
Mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, la question qui nous est posée aujourd’hui est simple : Sangaris doit-elle continuer ? Imagine-t-on un seul instant de répondre non ? Certes, nous sommes confrontés à des difficultés, plus importantes que prévu. Certes, l’opération va durer plus longtemps qu’on pouvait le penser en décembre dernier. Est-ce pour autant qu’on devrait renoncer et quitter la Centrafrique pour l’abandonner à la guerre civile ?
J’entends les critiques qui commencent à poindre, je vois les doutes qui commencent à se manifester. Toutefois quelle solution de rechange proposent ceux qui émettent ces doutes et ces critiques ? Quitter purement et simplement la Centrafrique ? Personne n’y pense sérieusement. Exiger le renfort de l’Europe ? Il va arriver. Demander la création d’une OMP à l’ONU ? Elle est en cours.
En attendant, nous devons évidemment rester aux côtés des forces africaines pour remplir notre mission. Les soldats français doivent pouvoir compter sur le soutien le plus large de la nation, donc de la représentation nationale. Je veux bien sûr, à mon tour, rendre hommage à la mémoire des militaires qui sont tombés en accomplissant leur devoir au service de la France, dans le cadre de l’opération Sangaris : les soldats de première classe Nicolas Vokaer et Antoine le Quinio, tombés dans la nuit du 9 au 10 décembre 2013, le caporal Damien Dolet, mortellement blessé dimanche dernier.
Parce que c’est l’honneur de la France d’assumer son rôle en Afrique, au service de la paix, et sur mandat des Nations unies, c’est en toute lucidité, monsieur le ministre, que le groupe socialiste votera résolument en faveur de la prolongation de l’opération Sangaris en Centrafrique.
Applaudissements.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la décision d’intervenir en République centrafricaine a sans doute été tardive, comme certains orateurs l’ont remarqué, eu égard aux violences initialement perpétrées par la Seleka. Néanmoins, le groupe du RDSE, au nom duquel je m’exprime, comprend qu’une telle intervention ne pouvait avoir lieu en dehors d’un mandat du Conseil de sécurité des Nations unies.
On aurait pu espérer un retour au calme plus rapide par l’exercice de ce que certains ont appelé un « effet de sidération ». C’était sans compter le potentiel de haines mis en mouvement et les violences aveugles déchaînées par les milices « anti-balaka », abusivement décrites comme des milices chrétiennes.
L’Afrique, il faut le constater, n’est plus ce qu’elle était : les autorités traditionnelles se sont effondrées. Aucun État digne de ce nom ne les a remplacées. L’usage des armes à feu s’est banalisé. La République Centrafricaine était déjà réputée être La Cendrillon de l’Afrique, selon une expression employée par Louis Brustier dans son ouvrage de 1962. Georges Conchon s’en inspirait en 1964 pour écrire L’État sauvage, qui reçut alors le prix Goncourt.
Depuis lors, les choses ne se sont pas arrangées : la Centrafrique a toujours été sous-administrée et mal gouvernée. Au point de déliquescence où les choses en étaient arrivées, notre intervention a du moins évité des massacres de masse, comme M. le ministre de la défense l’a souligné devant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées le 17 février dernier, et ainsi que vous l’avez vous-même rappelé, monsieur le ministre des affaires étrangères.
Aux 1 600 hommes qui ont été envoyés, 400 ont été ajoutés pour répondre à l’appel du secrétaire général de l’ONU, M. Ban Ki-moon. À cela, il faut bien sûr ajouter les contingents de la MICSA, soit 6 000 hommes provenant des États frontaliers ou voisins.
Le 20 janvier 2014, il a été décidé d’envoyer une force européenne de 500 hommes, me semble-t-il, composée de soldats estoniens, lettons, géorgiens – or la Géorgie ne fait pas partie de l’Union européenne, jusqu’à nouvel ordre –, polonais, portugais, roumains, ce qui permettait au moins de relayer à Bangui la force Sangaris.
L’effectif total des forces engagées ne suffira pas à ramener la sécurité sur toute l’étendue d’un territoire dont la superficie est plus vaste que celle de la France. La première priorité consiste évidemment à sécuriser la route qui joint Bangui à Douala, pour permettre l’acheminement de vivres et, ainsi, enrayer la famine. La décision de mettre en œuvre le programme alimentaire mondial permettra-t-elle de l’éviter ?
Il paraît clair à ce stade que l’armée française n’est pas destinée à des missions d’interposition. Les effectifs disponibles ne le permettent pas et, surtout, nos forces armées ont été conçues pour remplir des missions d’intervention dont il est important qu’elles restent limitées dans le temps, et non des missions d’interposition, qui immobilisent des effectifs pendant des années.
Je me souviens avoir vu, sur les côtes du Liban, à Naqoura, un contingent français présent depuis 1978 et qui, à ma connaissance, s’y trouve toujours !

Nous risquons d’être pris dans un engrenage si une opération de maintien de la paix n’est pas promptement décidée et mise en œuvre par l’ONU, comme vous l’avez laissé entrevoir, monsieur le ministre des affaires étrangères, à un horizon très court, c’est-à-dire au mois de mars prochain. Je vous pose la question : les États-Unis, principaux contributeurs des Nations unies, y sont-ils disposés ?
Force nous est de constater, en RCA comme sur d’autres théâtres, la faiblesse de la solidarité internationale, financière d’abord, comme vous l’avez souligné, monsieur le ministre, mais aussi politico-militaire. Il est frappant de constater que les pays européens qui ont annoncé un concours sont, pour la plupart, des pays périphériques. Aucun, hormis le Portugal, n’appartient à l’Europe d’avant la chute du Mur. Cela fait réfléchir à ce qu’il faut attendre de la « défense européenne », thème si fréquemment mis en avant…
Comment ne pas relever la sous-estimation frappante, par nos partenaires européens, des risques entraînés par le naufrage de certains États africains ? Ni l’Allemagne, ni la Grande-Bretagne, ni l’Italie, ni l’Espagne ne se sentent véritablement concernées, si l’on en juge par la modestie, voire l’inexistence de leur contribution. Or l’Afrique aura doublé sa population en 2050, et l’Afrique sahélienne triplé la sienne. Aucun développement harmonieux ne pourra se produire si les conditions de sécurité qui permettent l’essor des activités économiques ne sont pas réunies.
Il paraît clair que les grands pays européens n’ont pas pris la mesure des risques de l’islamisme radical et du djihadisme armé pour l’Afrique, mais aussi pour l’Europe, et pas davantage des risques humanitaires et migratoires qui y sont associés. L’absence de développement ne peut que conduire à des formes de régression barbares, dont nous avons eu un premier avant-goût avec l’application de la charia en matière pénale dans le nord du Mali, en 2012-2013.
C’est l’honneur de la France d’avoir pris conscience de ces dangers et d’avoir secouru le Mali, comme d’avoir pris les devants en République centrafricaine, en anticipant une opération de maintien de la paix de l’ONU qu’il serait encore plus difficile de mettre en route si notre pays n’avait pas manifesté sa réactivité. C’est pourquoi je vous apporte, monsieur le ministre, le soutien des sénateurs du groupe du RDSE.
Comme M. Vallini l’a fait avant moi, je voudrais maintenant invoquer une autre raison justifiant notre intervention, l’histoire. Celle-ci a existé ; elle nous a liés, voilà plus d’un siècle, aux populations de l’Oubangui-Chari. Nous n’oublions pas que les territoires de l’Afrique-Équatoriale française ont rallié la France libre, dès le mois d’août 1940, sous l’impulsion du gouverneur Éboué et des colonels Leclerc et Larminat. La France était alors au fond du gouffre.
L’histoire a existé, et par-delà l’époque révolue de l’Union française et de la Communauté, elle nous crée encore des devoirs. Si la France n’avait pas envoyé ses soldats en avant-garde d’une mission d’interposition qui, encore une fois, incombe à l’ONU, quelle autre nation l’aurait fait ? Certes, nous voyons bien les risques de l’engrenage, monsieur le ministre, mais nous devons aussi soupeser les inconvénients, ceux de l’action et ceux de l’inaction, comme le Président de la République, votre collègue ministre de la défense et vous-même l’avez fait.
Dès lors qu’il existait un mandat de l’ONU, nous vous donnons raison d’avoir fait prévaloir les considérations d’humanité, non que celles-ci ne soient pas quelquefois le paravent de desseins moins avouables – Mme Demessine l’a rappelé à cette tribune. Toutefois, en l’occurrence, nous n’en voyons pas, et aucune de celles que vous avez énumérées, chère collègue, ne nous paraît vraiment convaincante.
Certes, la RCA occupe en Afrique une position stratégique, à la frontière de pays instables comme le Nigeria et le nord du Cameroun menacés par Boko Haram, ou bien à la frontière du Sud-Soudan dont la sécession d’avec le Soudan n’a pas eu que des résultats heureux. Nous le constatons dans ce pays plongé, lui aussi, dans le chaos.
C’est pourquoi nous approuvons le souci que la France a manifesté, en accord avec l’Union africaine et les États riverains, de refuser une partition entre l’est de la RCA, principalement musulman, et le sud, animiste et chrétien. Certes, il faudra du temps pour construire un État centrafricain, et sans doute faudra-t-il envisager une très forte décentralisation, pour tenir compte de la diversité des territoires et de leur peuplement. Les mécanismes de l’aide internationale et leur territorialisation doivent être conçus de manière à tenir compte de l’hétérogénéité du pays.
Cependant, dans l’immédiat, l’accent doit être mis sur les prérogatives régaliennes de l’État, afin de lui donner une police, une armée, une justice, un système pénitentiaire.
Lors du sommet franco-africain du 7 décembre dernier, le Président de la République a évoqué la formation de 20 000 soldats africains par an, dans le cadre de l’Union africaine, je l’imagine. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire où en est ce projet dont nous mesurons l’ambition et les moyens qu’il requiert ? En effet, comme le ministre de la défense nous l’a dit : « Que faire des coupeurs de chemin et des brigands dès lors qu’ils auront été arrêtés et jugés, s’il n’y a pas de prison pour les mettre hors d’état de nuire ? »
À plus long terme, pouvons-nous imaginer une stabilisation de la région dans le seul cadre centrafricain ? La République centrafricaine se situe à la charnière entre les régions islamisées du Nord et les régions du Sud, animistes ou chrétiennes. Il est très important d’assurer la coexistence de ces populations. Seul un gouvernement d’union nationale peut le permettre.
Faut-il beaucoup attendre des élections dans un pays dont une partie de la population n’est même pas inscrite sur les listes électorales ? N’y a-t-il pas lieu de mettre en place des commissions de réconciliation, à l’image de celles qui ont été instituées en Afrique du Sud et au Rwanda ?
Certains en viennent à imaginer des regroupements régionaux inédits, allant par exemple du Cameroun au Kenya, avec une façade sur l’Atlantique et une autre sur l’océan Indien. Il me semble qu’il ne faut rien exclure a priori. L’Afrique a son histoire devant elle. Si le respect des frontières héritées de la période coloniale est sans doute sage dans l’immédiat, on ne doit pas écarter, à l’avenir, la perspective de regroupements régionaux plus vastes, s’ils sont voulus par les populations, établis de manière concertée dans le cadre de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations unies, puis ratifiés par les peuples.
La France ne doit pas se substituer à l’ONU. Son intervention au service de l’Afrique et des Africains ne peut être que provisoire. Il doit donc y avoir une date butoir à l’opération Sangaris : celle de la mise en place par l’ONU d’une opération de maintien de la paix. Le désengagement militaire est le terme normal de notre intervention, ce qui ne signifie nullement un désengagement sur les plans politique, administratif et financier. Il ne serait pas sain que nos soldats, quelles que soient leurs qualités, se substituent durablement aux administrateurs et aux coopérants civils.
L’opération Sangaris entraînera un surcoût annuel de 200 millions d’euros, selon les déclarations de M. le ministre de la défense. Mais nous connaissons la fragilité des équilibres définis par la loi de programmation militaire. Il est important que celle-ci soit non seulement épargnée par les coupes budgétaires, mais aussi réalisée dans tous ses aspects ; je pense en particulier aux recettes exceptionnelles.
Au total, et malgré les réserves que j’ai exprimées au nom du nécessaire devoir de vigilance incombant au Parlement, les sénateurs du groupe RDSE approuveront à l’unanimité la prolongation de l’opération Sangaris. Ils expriment par la même occasion l’affectueuse sollicitude de la Nation aux hommes qui en ont la charge et l’hommage dû à nos soldats tombés. §

La parole est à M. Philippe Adnot, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe.

Monsieur le président, monsieur le ministre des affaires étrangères, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, je tiens d’abord à rendre hommage à nos troupes qui, dans un contexte extrêmement difficile, essaient de mener à bien leur mission.
La France, par son action rapide, s’est honorée pour éviter un bain de sang dramatique.
Aujourd’hui, le contexte est différent. Nous avons eu plusieurs mois pour associer les différents pays d’Afrique et d’Europe à notre effort. Aussi, à la question qui nous est posée de savoir si nous devons rester plus longtemps et être plus nombreux en République centrafricaine, je répondrai : peut-être, voire sûrement, mais certainement pas seuls.
Il est grand temps que l’Europe agisse de concert et soit partie prenante de l’action qui doit être conduite.
Je me réjouis, monsieur le ministre, des décisions que vous avez annoncées tout à l’heure et qui ont été prises à l’échelon européen. Je vous l’avoue, si cela n’avait pas été le cas, il est vraisemblable que les deux parties en présence en Centrafrique auraient fini par se retourner contre nous, malgré notre bonne volonté et le courage de nos troupes.
Et si l’Europe ne s’était pas engagée, fût-ce de manière modeste, comme c’est le cas pour l’instant – mais j’espère que nous réussirons à convaincre nos partenaires de faire plus –, je ne vous le cache pas, je me serais abstenu afin de ne pas cautionner un engagement solitaire de la France. Le temps est à l’action concertée.
Compte tenu de ce qui a été dit, de la direction qui est prise, de la même façon que mes collègues non-inscrits, je voterai en faveur de la prolongation de l’opération Sangaris. §

Monsieur le président, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ayant le privilège d’intervenir le dernier, je commencerai par rendre un hommage appuyé et, je le pense, mérité, à la qualité de notre diplomatie et de son chef, Laurent Fabius.
Votre engagement personnel, monsieur le ministre, ainsi que celui de vos homologues allemand et polonais, a selon moi été décisif pour accompagner le peuple ukrainien dans sa lutte pour la liberté. Quel bel exemple, à quelques mois des élections européennes, de ce que peut faire l’Europe quand elle prend son destin en mains ! Évidemment, les problèmes demeurent, mais au moins un espoir a jailli, et il m’est très agréable de le souligner.
C’est aussi l’espoir que la France est venue rallumer en République centrafricaine, grâce à la décision, à la fois courageuse, lucide et responsable, qu’a prise le Président de la République d’intervenir militairement le 5 décembre dernier, alors que ce pays était au bord du chaos. On doit d’ailleurs regretter que l’alerte lancée par la France dès le mois de septembre 2013 à la tribune des Nations unies n’ait pas été entendue plus tôt. La France, elle, avait joué son rôle.
Qui peut dire ce que serait aujourd’hui la Centrafrique s’il n’y avait pas eu la France ? Pays laminé, pays déchiré, la République centrafricaine était aussi un pays oublié par la communauté internationale. C’est pourtant un pays situé à la charnière de régions sensibles : le Sahel, la Corne de l’Afrique, les Grands Lacs. Quelles auraient été les conséquences d’un effondrement dans la violence de ce cœur de l’Afrique ?
Je salue, monsieur le ministre, l’engagement de nos soldats. Trois d’entre eux y ont laissé la vie. Hommage leur soit ici rendu. Leur mission est particulièrement délicate, mêlant action de combat, assistance humanitaire et maintien de l’ordre. Il faut faire preuve de sang-froid, maîtriser sa force, agir avec doigté et souci d’équilibre entre les différentes communautés. Professionnalisme, détermination, courage : ce sont là des qualités dont les armées françaises ne manquent pas. Notre commission, mes chers collègues, se rendra prochainement auprès de ces soldats pour leur manifester le soutien, j’en suis convaincu, du Sénat tout entier.
Je ne peux nier que la situation n’a pas évolué comme nous l’avions espéré. L’exode massif des populations musulmanes – Tchadiens et Peuls – du sud et de l’ouest, le repli des membres de la Seleka vers l’est, les risques de partition du pays, les représailles sauvages exercées contre les « enclaves » musulmanes de Bangui par les milices anti-balakas, soutenues par une partie de la population chrétienne complètement traumatisée par des mois passés sous le joug de la Seleka, aggravent encore une situation humanitaire déjà désespérée.
Le conseil de défense en a tiré la conclusion qui s’imposait : 400 soldats supplémentaires viennent porter notre effectif à 2 000, pour consolider une situation qui reste malgré tout fragile.
Cela étant, nous avons remporté des succès : Bangui est globalement sécurisée, beaucoup de miliciens y ont été désarmés, regroupés et seront prochainement, pour une bonne part d’entre eux, réintégrés dans les forces armées centrafricaines.
Oui, je voterai pour la prolongation de l’opération Sangaris, car, à l’évidence, notre mission n’est pas achevée et, n’en déplaise à ceux – ils ne sont pas ici – qui agitent comme une rengaine le spectre d’un prétendu « enlisement », je pense que notre approche est juste.
Il est indéniable que notre action militaire a permis d’enrayer la spirale des atrocités, même si elle ne l’a pas fait aussi complètement et aussi rapidement que nous l’aurions souhaité. Partout où sont installées les forces de l’opération Sangaris, le niveau de violence diminue. Le problème, c’est que ces forces ne peuvent pas, pour l’instant, être partout. N’oublions pas que le 5 décembre – ce n’est pas loin –, la folie meurtrière avait fait 1 000 morts en quarante-huit heures ! La violence, mes chers collègues, a heureusement changé d’échelle à partir de cette date. Elle demeure néanmoins, j’en conviens, préoccupante.
Nous sommes face, pour l’heure, à quatre impératifs : sécuriser la province et éviter une partition de fait ; consolider le processus de démilitarisation, de démobilisation et de réintégration des différentes milices au sein des forces armées centrafricaines ; mettre fin à l’impunité, rétablir un minimum de police, de gendarmerie et de justice pour pouvoir condamner et les pillards et les criminels ; enfin, appuyer le faible État centrafricain et son administration dans sa marche vers la transition politique. Il faut, mes chers collègues, payer les fonctionnaires. Il faut faire fonctionner l’État ! L’importante mobilisation internationale doit nous y aider.
Je suis confiant, car nous avons su nous appuyer sur trois piliers solides de notre politique africaine telle que l’a reformulée le président Hollande : l’Union africaine, l’Union européenne, l’ONU.
Il faut s’appuyer, d’abord, sur les Africains. Cette conclusion du sommet de l’Élysée, dans la perspective de la construction d’une architecture africaine de sécurité, nous la mettons aujourd’hui en œuvre. Notre objectif politique est que la sécurité de l’Afrique soit assurée, à terme, par les Africains. L’opération Sangaris n’est précisément là qu’en appui de la MISCA.
Même avec des moyens encore trop limités, l’Union africaine a d’ailleurs réagi avec détermination : ses contingents – 6 000 hommes, je vous le rappelle, soit deux fois plus que ce qui avait été initialement envisagé – montent progressivement en puissance. Au total, 1 800 soldats africains œuvrent aujourd’hui en dehors de Bangui. Des centaines de millions de dollars de dons ont été promis par les États africains. Les États de la sous-région, le Tchad et le Congo en particulier, ont su gérer de façon pour l’instant exemplaire le volet politique de la crise centrafricaine.
Oui, je le dis : l’Afrique est au rendez-vous de la République centrafricaine. Nous entrons, me semble-t-il, dans une ère nouvelle, plus mature, plus partenariale, dans nos rapports avec ce grand continent qui peut, qui doit devenir notre avenir, comme cela était souligné dans un récent rapport de notre commission. Je m’en félicite.
Il faut, ensuite, impliquer l’Europe. Que n’a-t-on entendu sur l’Europe impuissante et divisée, sur la France isolée – cela vient encore d’être dit –, sur l’inconsistance de la politique de sécurité européenne, sur l’égoïsme ou l’aveuglement de nos partenaires ! C’est parfois justifié, force est de le reconnaître. Toutefois, si je regrette les lenteurs de l’Europe, qui n’a pas l’agilité décisionnelle ni la volonté politique que nous aurions souhaitées, il faut essayer tous ensemble de convaincre les pays européens d’accélérer le pas. La France, mes chers collègues, plutôt que de se plaindre, doit se faire entendre de ses partenaires européens.
La génération de forces qui est en cours n’est pas à la hauteur de l’enjeu. Il faut aller au-delà des seuls contingents polonais, estoniens, roumains, portugais, lettons, en plus de ceux de la Géorgie, État associé, voire de la participation finlandaise, espagnole et suédoise. Il s’agit bien, je le souligne, de troupes combattantes, car l’Union ne doit pas se cantonner au rôle facile de « super ONG ». Nous en sommes, mes chers collègues, à quelque 400 combattants. Il faut aller à 1 000, au moins ! Il faut demander à l’Europe de consentir un effort nettement plus substantiel.
Sans doute l’Union européenne n’a-t-elle pas dit son dernier mot. On peut imaginer qu’elle acceptera de créer, le moment venu, une mission de formation de la future armée de la République centrafricaine, sur le modèle de ce qui s’est fait au Mali, voire, compte tenu du délitement de l’État centrafricain, une mission de formation des forces de police et de gendarmerie. Cela devra se faire parallèlement à l’effort de reconstruction des institutions, œuvre indispensable et de longue haleine.
Évidemment, on peut toujours dire que ce n’est pas assez ! Moi, j’affirme qu’il s’agit déjà d’un premier pas non négligeable, qui donne progressivement corps à la politique européenne de sécurité et qui ouvre – pourquoi pas ? – la voie à une défense commune.
J’observe d’ailleurs que, à la suite du conseil des ministres franco-allemand, la brigade franco-allemande va être projetée au Mali. C’est un symbole fort, n’est-ce pas, cher collègue Jean-Marie Bockel ?
Il y a donc support de l’Europe, mais aussi des États-Unis, qui viennent épauler notre effort, comme cela a été confirmé lors de la visite d’État du Président de la République à Washington.
Il faut, enfin, donner à l’ONU tout le rôle qui doit être le sien. L’armée française n’a pas vocation à s’interposer indéfiniment. En RCA, nous avons besoin de l’ONU, en complémentarité de l’Union africaine, pour accompagner la transition politique et assurer la stabilisation durable du pays.
Pour reconstruire l’État et la sécurité dans ce pays en lambeaux, il est également indispensable de faire cesser l’impunité, de châtier les crimes de guerre, de rétablir une chaîne de réponse pénale face aux exactions. C’est une opération de l’ONU qui doit conduire toutes ces missions. Là réside tout l’enjeu des semaines à venir. Un rapport au Conseil de sécurité est attendu dans les tout prochains jours ; des discussions débuteront le 5 mars ; une résolution sera peut-être adoptée en avril ; le déploiement d’une opération de maintien de la paix sera possible à partir de la fin de l’été.
Une opération sous « casques bleus » présenterait l’avantage d’assurer un financement pérenne, d’adjoindre d’autres forces à celles de la MISCA et, surtout, de déployer un important volet civil, combinant aide à la transition politique, action humanitaire et formation.
Je pense que, si ces conditions sont remplies, la date de février 2015 évoquée pour les élections est à portée de main, ces élections pouvant être organisées avec l’aide et l’expertise des différentes agences onusiennes. Je sais, monsieur le ministre, que notre diplomatie s’emploie activement à la réalisation de cet objectif.
Quels sont les enseignements à tirer, pour nous-mêmes, de cette crise ?
Le premier est celui de la pertinence des décisions prises au plus haut niveau de l’État et de l’efficacité de notre système institutionnel.
Le chef de l’État, le Gouvernement, notre diplomatie et notre défense ont été à la hauteur de l’urgence, et ils ont été fidèles à l’image que nous nous faisons de la France. Je salue l’action du Président de la République, qui a su prendre lucidement une décision courageuse. C’est la France qui a inscrit à l’agenda international ce drame oublié. C’est la France qui a été la cheville ouvrière des résolutions des Nations unies. Nous avons su agir en temps utile, alors qu’il était si facile, si confortable, de faire l’autruche ! Mais quelles auraient été conséquences d’une telle attitude ? Sans doute le délitement de l’État centrafricain !
Le deuxième enseignement, c’est la nécessité, en matière de défense, de ne pas baisser la garde face à la permanence des menaces. Je partage pleinement vos recommandations à cet égard, monsieur Legendre.
Nous venons de voter une loi de programmation militaire qui nous garantit de disposer d’un outil de défense fiable, sans l’exonérer d’une participation au redressement des finances publiques. Toutefois, l’effort de redressement des comptes et les 50 milliards d’euros d’économies – effort que je soutiens, car c’est aussi une question de souveraineté – ne manqueront pas de susciter, chez quelques-uns, des tentations. Il est d’ailleurs dommage que certains ministres nous aient quittés, car je les aurais regardés dans les yeux en expliquant cela. Mais ils auront tout de même connaissance de mes propos !
L’arbitrage très clair et très ferme du Président de la République pour stabiliser le budget de la défense a encore été rappelé au moment de ses vœux aux armées. Nous nous appuierons sur lui pour veiller à la bonne mise en œuvre de la loi de programmation dans les années à venir. Que le Gouvernement sache qu’il faudra compter avec notre vigilance.

Certes, mais si nous le sommes tous, le résultat sera d’autant mieux assuré. Du reste, sur des sujets comme celui-ci, nous devons pouvoir nous rassembler.
Monsieur le ministre, notre vote d’aujourd’hui ne sera pas un quitus ad vitam aeternam, vous l’avez compris. Dans la loi de programmation militaire, nous avons prévu une revue annuelle de l’ensemble de nos engagements extérieurs, avec un débat en séance. Cela doit nous permettre de rester lucides et de lutter, si nécessaire, contre la tentation de la sédimentation.
C’est dans cette perspective dynamique que je vous invite aujourd’hui, mes chers collègues, à voter cette autorisation, sachant que nous serons périodiquement en mesure d’en évaluer tous les effets. §
Mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, en premier lieu, vous remercier toutes et tous, d’abord d’un vote qui sera, si j’ai bien compris, très massivement favorable à la prolongation de l’opération Sangaris, mais aussi de l’élévation de pensée qui s’est manifestée à cette tribune.
Nous savons que, dans les circonstances que traverse notre pays, faites de difficultés économiques, de tensions sociales, il peut être facile de faire écho à un discours que l’on entend ici ou là : « Que va faire la France en Afrique ? Ça coûte de l’argent ! Ça expose nos troupes ! Il vaudrait mieux… » Oui, mais… Vous avez su montrer, chacun avec sa sensibilité et ses mots, que la France doit, bien sûr, examiner les décisions avec attention, mais aussi avec hauteur, en sachant qu’existent une histoire, une géographie qui font que l’Afrique est proche de nous, qu’une responsabilité nous lie à un continent et à un pays qui sont un continent et un pays d’avenir.
Je n’ai évidemment pas connaissance de la tonalité et de la teneur des débats qui se déroulent en ce moment même à l’Assemblée nationale, mais je peux dire que le débat qui a eu lieu ici fait honneur autant à la Haute Assemblée qu’à la politique.
Je reprendrai simplement quelques points de chacune des interventions.
Mme Ango Ela, au nom du groupe écologiste, a insisté, à juste titre, sur le fait que cette prolongation était « une solution nécessaire et transitoire ». Cette prolongation n’en est pas moins nécessaire. Du reste, la chef d’État de la transition, une femme tout à fait remarquable, Mme Catherine Samba-Panza, vous a appelés à prendre la décision que vous vous apprêtez à prendre. Et le secrétaire général des Nations Unies, qui représente la plus haute instance de la communauté internationale, a fait de même.
Madame Ango Ela, j’ai également apprécié que vous ayez bien marqué la différence – d’autres orateurs l’ont également fait – entre l’opération qu’il faut mener à bien aujourd'hui et la perspective qui doit se dessiner pour l’avenir : il est indispensable que les Africains se dotent eux-mêmes de la capacité d’assurer leur propre sécurité.
La décision qui est prise aujourd'hui n’est donc pas du tout un blanc-seing. Il s’agit d’une décision nécessaire, transitoire et placée dans une certaine perspective, celle qui doit voir les Africains prendre leurs responsabilités.
M. Legendre, au nom de l’UMP, a parfaitement résumé la complexité de la situation, tant il est vrai qu’on ne peut décrire les choses à coup de serpe. Il a rendu avec raison un hommage particulier non seulement à nos soldats – chacun l’a fait, et c’est bien légitime –, mais aussi aux autorités religieuses. Je suis allé plusieurs fois en Centrafrique et je me suis entretenu avec ces autorités religieuses, qui incarnent parfaitement, par leur comportement, la conduite qu’il convient de tenir.
En effet, non seulement ces chefs religieux refusent l’entraînement des passions et agissent ensemble, mais, comme vous le savez sans doute, ils vivent sous le même toit : le chef des musulmans vit dans la maison du chef des chrétiens. Je pense qu’il s’agit d’un symbole extrêmement fort face à des affrontements religieux qui, il faut le savoir, gagnent petit à petit, malheureusement, bien des pays de la région. Lorsqu’il m’est donné de discuter avec des personnalités aussi différentes que le chef de l’État du Cameroun ou celui de l’Angola, j’entends que ces divisions, qui n’existaient pas il y a quelques années, deviennent menaçantes.
M. Legendre a donc eu tout à fait raison, selon moi, de souligner l’importance du rôle joué par les autorités religieuses centrafricaines.
Il a en outre posé la question : « Avons-nous agi assez vite ? ». Mesdames, messieurs les sénateurs, la réponse est claire comme de l’eau de roche.
Dans son discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, qui s’est tenue comme chaque année au cours de la dernière semaine de septembre, le Président de la République a été le premier à la saisir de la question de la Centrafrique. Il a alors surpris et frappé les esprits, comme il avait, l’année précédente, surpris et frappé les esprits en saisissant l’Assemblée générale des Nations unies de la question du Mali.
À partir de ce moment, nous avons déployé beaucoup d’efforts – c’est la tâche de la diplomatie – pour que l’ONU nous autorise à intervenir, car il n’était pas question d’intervenir sans autorisation.
Alors, avons-nous agi assez vite ? Je vous rappelle que nous sommes intervenus le lendemain du jour où les Nations unies nous ont donné l’autorisation de le faire. On peut bien sûr regretter qu’entre le mois de septembre, où le Président de la République a saisi les Nations unies, et le jour de décembre où les Nations unies se sont prononcées, trois mois et demi se soient écoulés. Mais vous savez ce que sont les procédures ! Et je puis vous assurer que nous n’avons pas ménagé nos efforts, ayant de multiples entretiens, passant d’innombrables coups de téléphones ; je le répète, c’est la tâche du chef de la diplomatie et de ses représentants.
En tout cas, à partir du moment où l’autorisation a été accordée, il ne s’est pas écoulé vingt-quatre heures avant que nos soldats soient sur le terrain.
Dès lors que l’on connaît ces données, il est impossible, me semble-t-il, de prétendre que les choses auraient pu, du point de vue de la France, être faites plus rapidement. Ou alors, il eût fallu ne pas attendre l’autorisation des Nations unies ! Or, de cela, il ne pouvait être question.
M. Legendre a également eu raison d’insister, comme d’autres l’ont fait, sur la nécessité d’éviter la partition.
Il a aussi posé une question sur l’Agence française de développement. Les instructions ont été données pour que celle-ci retourne sur le terrain. En liaison avec M. Canfin, qui suit particulièrement ces sujets, des programmes sont prévus à cet effet. J’ai moi-même, quelques minutes avant de vous rejoindre, rencontré Mme Paugam, la directrice de l’Agence française de développement, pour lui confirmer ces instructions.
La question du commerce a également été posée. Il est vrai que les musulmans tiennent une grande place dans cette activité, qui est profondément désorganisée. À cet égard, il est évidemment essentiel de rétablir la liaison entre Bangui et le Cameroun. Actuellement, il y a trois séries de convois chaque semaine. Les renforts, notamment les renforts européens, qui vont arriver permettront bientôt à Sangaris de dégager cette route.
J’en viens à la question de la mobilisation des collectivités locales.
Sans doute les collectivités locales françaises n’ont-elles pas les mêmes liens avec la Centrafrique qu’avec le Mali. Cependant, je vous rappelle que le ministère des affaires étrangères a créé un fonds spécial, le Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales, ou FACECO, pour apporter une aide d’urgence en cas de catastrophe ou d’opération à l’étranger. Dites aux maires qui vous entourent qu’ils peuvent alimenter ce fonds. Il est bien entendu rendu compte de l’utilisation des sommes versées. Si telle ou telle collectivité souhaite soutenir l’opération en République centrafricaine, elle peut le faire par le biais de ce fonds, qui est évidemment soumis à des contrôles.
M. Bockel, qui intervenait au nom de l’UDI-UC, a également bien retracé la situation. Il a dit qu’il voterait l’autorisation de la prolongation de l’intervention, mais qu’il se posait des questions, à l’instar, du reste, de beaucoup d’entre vous.
Il a en particulier demandé si le lancement d’une opération de maintien de la paix entraînerait un retrait total ou un retrait partiel des soldats français déployés en Centrafrique. Retrait total, certainement pas, car, je vous le rappelle, nous avions déjà, avant le lancement de l’opération Sangaris, selon les moments, 250 à 450 soldats stationnés en Centrafrique.
Dans notre esprit, il doit se produire la même évolution qu’au Mali, où nos effectifs ont augmenté – ils ont même atteint un niveau bien plus élevé qu’en Centrafrique –, avant de diminuer. L’intention du Gouvernement – je me suis récemment entretenu avec le Président de la République à ce sujet – est de maintenir nos effectifs au niveau que nous avons fixé aujourd'hui, avant de les réduire progressivement, lorsque l’opération de maintien de la paix sera mise sur pied.
Il n’est pas question de renoncer à toute présence en Centrafrique : non seulement, je le répète, nous avions déjà des troupes stationnées en Centrafrique, mais ce serait contre-productif du point de vue de notre demande de création d’une opération de maintien de la paix.
Je remercie Michelle Demessine de son « verdict » final, plutôt positif, même si j’en ai bien perçu toutes les nuances, puisque le groupe CRC laisse la liberté de vote à ses membres. Elle a posé la question tout à fait judicieuse de la nécessité d’une transformation rapide de Sangaris en opération de maintien de la paix. C’est ce à quoi nous travaillons. Ce n’est pas si facile, mais c’est indispensable : d'une part, nous avons besoin, sur un plan matériel, que l’ONU prenne en charge une partie des opérations ; d'autre part, comme vous l’avez souligné, madame Demessine, la situation exige une opération à la fois militaire, civile, humanitaire et financière que seule l’ONU peut mettre en œuvre.
Au nom du groupe socialiste, André Vallini a apporté son soutien au Gouvernement, en se fondant sur une analyse précise et de qualité ; je l’en remercie. Il a redéfini les objectifs de l’opération. Il a tenu, au sujet de l’Europe, qu’a également évoquée le président Carrère, des propos que je partage totalement. Oui, l’Europe va être présente ; elle en a pris la décision de principe.
L’implication de l’Europe constitue évidemment une préoccupation pour beaucoup d’entre vous. M. Adnot nous a même confié que, si l’Europe n’avait pas pris cette décision, son vote aurait peut-être été différent.
Nous savons qu’il n’existe malheureusement pas de vraie politique européenne de défense, mais nous devons avancer dans ce sens. Nous avons obtenu un vote de principe de nos partenaires européens. Maintenant, il faut « remplir les cases », et c’est difficile. Une deuxième conférence de génération de forces s’est tenue aujourd'hui même ; il y en aura une troisième dans quelques jours. Cette conférence a montré que nous n’en étions pas encore au chiffre indiqué par Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, qui a parlé de 1 000 soldats européens en Centrafrique. Il nous faut donc aiguillonner nos partenaires.
André Vallini a eu raison de souligner, en termes choisis – des termes de diplomate ! –, que, pour telle ou telle raison, les pays comme la Grande-Bretagne, l’Allemagne ou l’Italie, qui ont des moyens militaires importants, ne sont malheureusement pas, malgré leurs affirmations, au rendez-vous dans les proportions que l’on pouvait escompter. C’est à coup sûr le cas de la Grande-Bretagne. L’Allemagne n’a pas envoyé de troupes au sol. Quant à l’Italie, nous verrons ; je rencontrerai bientôt ma nouvelle homologue.
Il faut absolument que, par le jeu de nos influences respectives, nous les convainquions que, de même qu’il n’y a pas d’amour, il n’y a que des preuves d’amour, il n’y a pas de défense européenne, il n’y a que des preuves de défense européenne ! §
Si nous nous engageons sur la voie d’une défense et d’une sécurité européennes, il faut en tirer les conséquences.
Jean-Pierre Chevènement a, lui aussi, apporté au Gouvernement le soutien de son groupe, le RDSE. Il a souligné à quel point la création d’une opération de maintien de la paix était nécessaire. Il a posé, à la manière facétieuse dont il a le secret, une question sur l’attitude des États-Unis. Nous sommes évidemment en discussion avec nos partenaires américains, qui, pour différentes raisons, notamment financières, ne sont jamais très enclins à approuver de tels dispositifs. J’ai cependant bon espoir de parvenir à les convaincre, comme cela avait été le cas au sujet du Mali. Les Américains savent en effet que, en matière africaine, il existe un leadership et qu’il faut faire en sorte qu’il puisse s’exercer.
À la fin de son intervention, Jean-Pierre Chevènement a posé une question centrale, celle que nous posent nos électeurs lorsque nous bavardons avec eux, quand ils dressent la liste des enjeux et même des inconvénients de la décision que nous nous apprêtons à prendre. La sphère de la politique n’est pas l’empyrée ! Aucune solution ne présente 100 % d’avantages !
Comme souvent, il faut ici comparer le coût de la décision et celui de la non-décision ; c’est ainsi que se présente une problématique de premier rang comme celle qui nous occupe aujourd'hui. Or le coût de la non-décision, c'est-à-dire d’une interruption de l’opération Sangaris, c’est quelque chose que l’on ne peut même pas envisager ; votre vote va d'ailleurs montrer l’absurdité d’une telle hypothèse.
De la même manière – chacun d’entre vous l’a dit avec ses mots –, il eût été inconcevable que la France, seul pays ayant des troupes à proximité, n’intervînt pas alors que la RCA avait déjà un pied dans le gouffre.
Jean-Pierre Chevènement a posé la question comme elle devait l’être.
J’y ai déjà fait allusion, Philippe Adnot a déclaré que, si nos partenaires européens n’avaient pas pris la décision de principe que j’ai évoquée, son vote aurait sans doute été différent. Son vote sera finalement positif, et je l’en remercie.
Le président Carrère a commencé par évoquer l’Ukraine, et je le remercie des propos qu’il a bien voulu tenir. Bien sûr, l’Ukraine, c’est un autre sujet, mais il recoupe malgré tout celui qui est au centre de ce débat. Jean-Louis Carrère a salué la contribution de l’Europe à la résolution de la tragédie ukrainienne.
On fait beaucoup de reproches à l’Europe et, souvent, ils ne sont pas infondés. Cependant, force est de reconnaître que, en l’espèce, mes homologues allemand et polonais et moi-même sommes arrivés un matin dans une ville en état de siège, où des snipers avaient déjà tué plusieurs dizaines de personnes, mais que, quand nous sommes repartis, un accord avait été conclu, même si ses termes ont ensuite été modifiés par la dynamique de la situation révolutionnaire. Le président Ianoukovitch, qu’à Kiev on appelle « Ianoucescu »
Rires.
S’agissant de la Centrafrique, le président Carrère a raison lorsqu’il dit que tout repose sur un trépied composé de l’Union africaine, de l’Union européenne et de l’ONU. C’est la ligne de conduite de la France.
J’en reviens à la remarque que j’ai faite tout à l'heure en répondant à Kalliopi Ango Ela : nous n’avons pas vocation à intervenir dans chaque crise. Lors du sommet de l’Élysée de décembre, qui a été très intéressant, la cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement représentant les pays membres de l’Union africaine et le Président de la République se sont mis d'accord pour que, en 2015 – j’espère que cette date sera respectée –, il y ait une force interafricaine qui permette à l’Afrique elle-même d’intervenir. Encore faut-il que cette force soit bien équipée et qu’elle puisse être mobilisée rapidement, ce qui suppose notamment qu’elle dispose des moyens de transport nécessaires. L’Europe et les États-Unis, mais aussi les pays du Golfe et les pays asiatiques, devront aider, y compris sur le plan financier, à la constitution de cette force. Nous sommes dans une situation transitoire ; c’est ainsi qu’il faut comprendre notre intervention.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je ne vous cache pas qu’il n’est pas si facile de convaincre les pays membres de l’Union africaine de soutenir la création d’une opération de maintien de la paix. Une idée a cours, selon laquelle la MISCA, composée d’Africains, serait désavouée si l’ONU prenait le contrôle des opérations. Pas du tout ! Il y aurait un continuum entre Sangaris, la MISCA, les forces européennes et l’opération de maintien de la paix, qui, sous d’autres formes, avec une composante civile et humanitaire, prendrait le contrôle de l’ensemble.
De même qu’il faut continuer à faire pression auprès des Nations unies et de l’Union européenne, il faut essayer de convaincre les pays membres de l’Union africaine qui ne sont pas encore totalement convaincus. J’ai bon espoir que les choses finiront par évoluer comme nous le souhaitons.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie vivement du vote que vous vous apprêtez à émettre. J’achèverai mon propos en citant deux mots, que plusieurs d’entre vous ont utilisés et qui résument fort bien à la fois le fond de vos positions et la tonalité de notre débat. Ce sont deux mots qu’il ne faut pas galvauder : responsabilité et honneur.

Je vais mettre aux voix la demande du Gouvernement d’autorisation de prolongation de l’intervention des forces armées en République centrafricaine.
Aucune explication de vote n’est admise.
En application de l’article 73-1, alinéa 2, du règlement, il va être procédé à un scrutin public ordinaire, dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici le résultat du scrutin n° 158 :
Le Sénat a autorisé la prolongation de l’intervention des forces armées en République centrafricaine. §
L’Assemblée nationale ayant elle-même émis un vote favorable, je constate, en application du troisième alinéa de l’article 35 de la Constitution, que le Parlement a autorisé la prolongation de l’intervention des forces armées en République centrafricaine.
Nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures quinze, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.