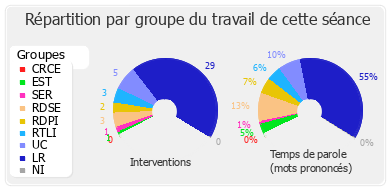Séance en hémicycle du 6 mars 2018 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures vingt, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Les Républicains, de la proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit, présentée par M. Patrick Chaize (proposition n° 83, texte de la commission n° 323, rapport n° 322).
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous rappelle que, conformément aux conclusions de la conférence des présidents réunie le 21 février dernier, nous suspendrons nos travaux à dix-sept heures. Ils seront repris, le cas échéant, à vingt et une heures, pour la suite de l’examen de ce texte.
Dans la discussion générale, la parole est à M. Patrick Chaize, auteur de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, en tant qu’auteur de la présente proposition de loi, je souhaiterais tout d’abord rappeler le contexte dans lequel le texte que nous allons examiner a été élaboré : à l’été 2017, un opérateur de télécommunications a annoncé son intention de couvrir l’ensemble du territoire en fibre optique par son propre réseau, menaçant ainsi l’équilibre fragile issu du partage des territoires entre la zone d’initiative privée et les réseaux d’initiative publique, pourtant indispensable afin d’assurer rapidement la couverture intégrale de notre pays, en conformité avec le plan gouvernemental.
Si l’opérateur en question est revenu sur son intention déclarée de « fibrer la France », cette accalmie, donc passagère, dissimule la réalité des rapports de force locaux entre opérateurs et collectivités. Nul besoin de chercher bien loin pour s’en convaincre : le cas des Yvelines, département dont sont issus notre rapporteur, Marta de Cidrac, et notre président, Gérard Larcher, nous rappelle qu’un opérateur privé peut chercher à dupliquer un réseau d’initiative publique et que les pouvoirs publics sont bien en peine, en l’état actuel du droit, de l’en empêcher. Je pourrais également citer l’île de La Réunion et, malheureusement, bien d’autres cas encore.
Il y a donc encore aujourd’hui un besoin de sécurisation. Alors, monsieur le secrétaire d’État, j’ai fait un rêve : le rêve que cette proposition de loi apporte aux collectivités territoriales et à leurs groupements, qui contribuent directement à l’aménagement numérique de leurs territoires, cette sécurisation. Les élus sont très impliqués dans les déploiements de réseaux à très haut débit en fibre optique et ont fait des efforts considérables qui ne sauraient ni être oubliés ni laissés sans protection de notre part.
Les dispositions contenues dans la proposition de loi visent ainsi à fournir un cadre sécurisant pour les investissements favorables à l’aménagement numérique du territoire, mais aussi contraignant s’agissant des engagements de déploiement des opérateurs. Pour atteindre ces objectifs et m’assurer que le texte qui vous est soumis aujourd’hui réponde effectivement à des problématiques concrètes, j’ai été en relation constante avec l’ensemble des acteurs concernés, publics et privés, y compris avec le Gouvernement. J’ai également échangé avec des représentants de la Commission européenne, qui m’ont indiqué être en phase avec le texte, dans le contexte de l’élaboration du code européen des communications électroniques.
L’objectif actuel de l’Union européenne est de donner les moyens législatifs et réglementaires aux autorités compétentes - l’État, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, les collectivités et leurs groupements - pour écarter tout risque de superposition d’un réseau en fibre optique déployé ou en voie de déploiement avec un autre réseau du même type. J’insiste sur ce point, car il a pu nous être opposé que le calendrier de la proposition de loi n’était pas optimal. Dès lors que le texte présenté aujourd’hui s’inscrit en cohérence avec ce que nous devrons transposer dans les prochaines années, cet argument semble peu opportun. Au contraire, je considère qu’en matière de transposition il vaut mieux anticiper que subir. C’est aussi une condition pour que la France pèse à sa juste mesure dans le concert européen.
Le texte qui vous est présenté aujourd’hui est donc bien nécessaire et pertinent, ce qui ne signifie pas qu’il ne pourra pas évoluer au cours de la navette parlementaire en fonction de la stabilisation du cadre européen et du contexte national concernant les réseaux fixes à très haut débit. Sa philosophie générale peut se résumer ainsi : il s’agit d’accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit en fibre optique sur l’ensemble du territoire français. Le déploiement de cette technologie me paraît essentiel à au moins deux égards.
D’abord, pour une raison d’équité territoriale et sociale : nous avons la responsabilité de permettre à chaque citoyen français l’accès aux réseaux de communications, où qu’il se trouve sur le territoire. C’est une condition de la cohésion nationale et de la mobilité sociale. On ne peut imaginer la fibre pour les villes et des technologies dégradées pour les champs.
Ensuite, pour une raison d’attractivité : la France est régulièrement mise en avant dans les classements internationaux pour la qualité et la densité de ses infrastructures, et celles concernant le numérique sont particulièrement stratégiques au XXIe siècle. Nous ne pouvons donc pas faire l’économie du déploiement d’une technologie qui a fait ses preuves et qui permettra de renforcer la performance de nos entreprises et l’attractivité de notre pays.
Les treize articles constituant la proposition de loi initiale répondent donc à deux enjeux principaux.
Le premier est la sécurisation des investissements dans les réseaux en fibre optique. Les engagements de déploiement des opérateurs doivent être juridiquement contraignants et les acteurs publics, que ce soient les collectivités ou l’ARCEP, doivent disposer de davantage de possibilités pour assurer la cohérence des déploiements. C’est l’objet du titre Ier de la proposition de loi, regroupant les articles 1er à 7, qui prévoient notamment de formaliser la répartition et les calendriers de déploiement, de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’ARCEP pour en assurer le suivi, le cas échéant, de sanctionner, et de s’appuyer sur les permissions de voirie pour prévenir la duplication des réseaux et les éventuelles stratégies de préemption des opérateurs.
Le deuxième enjeu auquel répond le texte est le besoin d’incitation aux investissements dans les réseaux en fibre optique. En prévoyant l’extinction progressive du cuivre et des mesures d’exonération fiscale visant à la transition vers la fibre optique, le titre II du texte et les articles 8 à 10 visent à accélérer le rythme des déploiements.
Quant à l’article 11, il tire les conséquences de l’approche qualitative désormais retenue par l’ARCEP pour l’évaluation de la couverture mobile sur l’ensemble du territoire. Il s’agit de renforcer les obligations pesant sur les opérateurs, pour que, dans chaque commune, les habitants puissent utiliser les services « de base » du mobile, à savoir la messagerie, le téléphone et l’accès à l’internet mobile. Cela me semble être une exigence minimale.
Je souhaite saluer la qualité de l’écoute et du travail de la rapporteur, Marta de Cidrac, qui s’est rapidement approprié ce sujet particulièrement technique et a conduit un grand nombre d’auditions dans un délai très restreint. Le texte sort renforcé de son examen par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et je m’en félicite. Les ajouts et précisions apportés par la rapporteur consolident les dispositifs prévus, et j’ai moi-même proposé d’apporter des compléments au texte sur le statut de « zone fibrée » et sur l’IFER fixe.
Il me semblait important, s’agissant de la zone fibrée, que l’attribution de ce statut se fasse dans une logique plus transparente et liée à la réalité des déploiements des réseaux, sans sollicitation des opérateurs. L’ARCEP voit ainsi sa compétence consolidée et devra suivre avec précision et attention l’état d’avancement des déploiements.
S’agissant de l’IFER fixe, conditionner son application à la délivrance du statut de « zone fibrée » permettra par ailleurs une application plus progressive de cette imposition aux nouveaux réseaux.
Avant de conclure, je voudrais vous faire part de la suite de mon rêve : le rêve que le Gouvernement, porté par son ADN ni de droite ni de gauche, soutienne clairement cette initiative ou, du moins, adopte une position non équivoque sur son contenu. Il y a, je l’ai rappelé, de vrais problèmes à résoudre et, jusqu’à présent, en dépit de nos nombreux échanges avec le Gouvernement, nous n’avons obtenu de réponses suffisamment claires, ni sur le texte en lui-même, ni sur les inquiétudes des élus, ni même sur de vraies alternatives pour y répondre. Notre impatience est donc en passe de se transformer en déception, alors même que le Sénat est prêt à des concessions ou à des évolutions. Je forme donc le vœu, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, que les débats d’aujourd’hui permettent enfin d’avancer ensemble sur ces sujets.
Le constat fait récemment sur le mobile – vous avez largement évoqué un accord historique, monsieur le secrétaire d’État – doit nous inciter à anticiper pour le fixe. Il y a aujourd’hui urgence. J’espère que vous allez pouvoir me dire que ce rêve est en fait une réalité et que nous allons collectivement construire un texte répondant aux objectifs d’aménagement des territoires en étant plus qu’attentifs à leur cohésion.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à l’heure où internet est considéré comme un bien commun, l’ensemble de nos concitoyens doit pouvoir y accéder dans de bonnes conditions et dans des délais raisonnables. Dans ce but, il est indispensable que des réseaux de communications électroniques de dernière génération puissent irriguer rapidement l’ensemble de notre pays. Ce déploiement doit bénéficier à tous, sans privilégier certaines zones au détriment de territoires moins denses, mais susceptibles de tirer profit autant sinon davantage du numérique.
Au regard de cet objectif prioritaire d’aménagement du territoire, la France s’est dotée depuis 2010 d’une programmation nationale en vue de déployer le très haut débit, permettant d’offrir des perspectives d’accès aux habitants de tous les territoires. Ce plan est fondé sur la complémentarité entre l’offre privée et l’initiative publique, cette dernière ayant été sollicitée pour compenser le manque d’intérêt économique des opérateurs sur une grande partie du territoire national. Or, au cours de l’année 2017, plusieurs annonces et tentatives d’opérateurs privés ont laissé paraître un risque de duplication des réseaux sur certaines zones prises en charge par les pouvoirs publics. Par ailleurs, la concrétisation pleine et entière des intentions des opérateurs dans la zone réservée à l’initiative privée reste depuis plusieurs années une source de vives inquiétudes pour les collectivités et les habitants concernés.
Remettant en cause les principes structurants du déploiement du très haut débit, ces différents éléments ont révélé la fragilité d’un programme fondé sur un simple consensus entre acteurs publics et privés. Afin de répondre à ces difficultés, la présente proposition de loi a été déposée au Sénat le 10 novembre 2017 par notre collègue Patrick Chaize, que je remercie, et de nombreux membres du groupe Les Républicains.
Je ne reviendrai pas en détail sur le contenu de la proposition de loi que mon collègue vient de vous présenter synthétiquement, et dont l’analyse détaillée figure dans le rapport de la commission. Le principal objectif de ce texte est de mettre en place des outils législatifs et réglementaires permettant d’éviter les superpositions entre réseaux en fibre optique afin de conforter la complémentarité public-privé retenue par le plan France très haut débit. Le texte comprend également des dispositions relatives à la couverture du territoire par les réseaux mobiles, visant à actualiser les critères de couverture des zones blanches et à accélérer les déploiements de stations de radio.
Lors de l’examen du texte, la commission a très largement confirmé plusieurs inquiétudes relatives à la poursuite du déploiement. Celles-ci concernent en particulier les risques de concurrence des réseaux d’initiative publique par des projets privés, ainsi que le manque de garanties sur la réalisation des intentions exprimées par les opérateurs privés dans la zone de déploiement qui leur est réservée depuis 2011.
Jugeant qu’un projet d’une telle ampleur financière ne saurait se poursuivre dans de bonnes conditions sans être sécurisé juridiquement, notre commission a approuvé les objectifs de la proposition de loi, en apportant certains ajustements aux solutions proposées.
Notre commission a ainsi procédé à une réécriture de l’article 2, prévoyant l’établissement d’une liste fixant les responsabilités et les calendriers du déploiement des réseaux en fibre optique. Notre objectif était de ne pas modifier le fondement juridique sur lequel des négociations sont en cours entre l’État et les opérateurs privés. Tout en tenant compte de ce contexte spécifique, nous avons jugé nécessaire de maintenir un dispositif visant à formaliser la répartition des responsabilités. Par cette réécriture, la commission a apporté plusieurs compléments, en excluant les zones très denses du dispositif, en prévoyant un avis public de l’ARCEP sur le projet de liste et en précisant le traitement des cas de duplication.
Notre commission a par ailleurs souhaité apporter des précisions à l’article 6, permettant aux autorités chargées de délivrer les permissions de voirie de mieux tenir compte des objectifs de mutualisation afin de prévenir les stratégies de duplication des réseaux ou de préemption du domaine public.
À l’article 8, une nouvelle rédaction a été adoptée pour organiser le rachat des infrastructures d’accueil des réseaux en cuivre afin de laisser davantage de marges de manœuvre aux collectivités. Cet article a également fait l’objet d’un complément, sur l’initiative de notre collègue Patrick Chaize, en vue de conforter le rôle de l’ARCEP pour l’attribution du statut de « zone fibrée ».
Notre commission a par ailleurs adopté un article additionnel conditionnant l’extension aux réseaux en fibre optique de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux à la délivrance du statut de « zone fibrée », afin d’assurer une application plus progressive de cette imposition.
Enfin, une modification a été apportée à l’article 11, en vue de relever les exigences de couverture des zones blanches de la téléphonie mobile, pour assurer la disparition rapide de ces situations, devenues insupportables pour les habitants concernés.
Permettez-moi à présent de mentionner trois éléments de contexte, qu’il nous faut avoir à l’esprit dans nos travaux.
Le premier concerne les risques de duplication, qui sont à l’origine du présent texte. Bien que l’opérateur à la source des perturbations du plan en 2017 ait affirmé avoir renoncé à ses intentions initiales, rien n’empêche un autre opérateur de mener demain des déploiements concurrents à un réseau public. Dans mon département des Yvelines, je pourrais vous citer, monsieur le secrétaire d’État, le cas de la commune de Beynes, dans laquelle un grand opérateur privé déploie en ce moment même son réseau en doublon du RIP.
Le principal risque identifié par les collectivités est une duplication partielle des réseaux par des opérateurs privés décidant de se déployer sur les parties les plus rentables. Une telle stratégie fragiliserait significativement l’équilibre économique des RIP, déployés sur l’intégralité de la zone, dans une logique d’aménagement du territoire.
Le deuxième élément concerne le nouveau paquet Télécom en cours de négociation au niveau européen. L’article 22 du projet de code européen vise précisément à mieux identifier les intentions des opérateurs et à lutter contre les projets de réseaux non déclarés.
Si les discussions entre institutions européennes ne sont pas achevées, il est légitime de la part du législateur national de proposer une voie, le cas échéant par anticipation. Nous réaffirmons ainsi les préoccupations des pouvoirs publics français, en tenant compte des choix spécifiques qu’a faits notre pays en faveur du très haut débit.
Le troisième élément, monsieur le secrétaire d’État, concerne les négociations actuellement menées par le Gouvernement avec les opérateurs privés en vue d’obtenir de leur part des engagements précis et opposables sur les déploiements de réseaux en fibre optique.
Comme je l’ai déjà indiqué, nous avons souhaité en tenir compte en ne modifiant pas le fondement juridique sur lequel sont menées ces discussions pour ne pas les perturber. Toutefois, nous n’avons de certitude ni sur le résultat de ces négociations ni sur leur adéquation à nos préoccupations. C’est la raison pour laquelle le dispositif prévu à l’article 2 a été maintenu et nous semble toujours pertinent.
En conclusion, je tiens à dire que la présente proposition de loi apporte de vraies solutions aux problèmes rencontrés par les collectivités territoriales, qui n’ont pas encore obtenu à ce jour de réponses à la hauteur de leurs préoccupations.
Comme nous vous l’avons indiqué depuis le début, monsieur le secrétaire d’État, nous sommes prêts à construire des solutions communes avec vous. Toutefois, nous avons dû faire face à une faible implication du Gouvernement sur ce texte, qui ne nous a pas permis à ce stade d’élaborer ensemble un compromis. Devant notre commission, vous vous étiez déclaré favorable aux intentions du texte, sans souscrire véritablement aux dispositions proposées. Si vous nous le confirmez, quelles sont alors les solutions concrètes que vous proposez aux collectivités territoriales pour répondre à leurs difficultés ?
Notre travail sur ce sujet est guidé par un seul objectif : apporter à tous nos concitoyens, quel que soit leur lieu de vie, un accès de même qualité aux réseaux de communications électroniques de dernière génération. J’espère que les discussions d’aujourd’hui nous permettront d’y contribuer collectivement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe socialiste et républicain. – M. Alain Fouché applaudit également.
Monsieur le président, madame la rapporteur, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vous le savez, le Président de la République a fait du numérique une priorité du quinquennat. Cet engagement de la campagne présidentielle a été confirmé par le Président de la République et par le Premier ministre lors de leur prise de fonction.
Comme vous l’avez dit, madame la rapporteur, le numérique est un formidable outil de lutte contre les fractures territoriales, et donc un formidable outil pour favoriser la cohésion des territoires, dont j’ai la charge avec Jacques Mézard. Comme vous le savez, aujourd’hui, seul un Français sur deux a accès au très haut débit, c’est-à-dire à un réseau numérique de qualité, alors même que se développe un ensemble de dispositifs allant du télétravail à la télémédecine et que plus de la moitié des démarches administratives s’effectuent désormais sur internet.
Le sujet est complexe et plusieurs d’entre vous, qui se reconnaîtront, se sont mobilisés très tôt sur cette question, y compris dans l’installation de nouveaux dispositifs en étant à l’initiative des premiers réseaux d’initiative publique voilà de nombreuses années. À cet égard, je tiens à saluer, en introduction de mon propos, l’implication des parlementaires, en particulier des sénateurs, avec une pensée particulière pour le sénateur Patrick Chaize – et aussi pour Mme la rapporteur –, avec qui nous avons eu des échanges importants et constructifs, depuis plus de sept mois, dans un contexte particulièrement difficile.
La réflexion sur ce texte n’a pas débuté voilà quelques semaines. Elle fait suite à plusieurs travaux du Sénat. Je pense notamment aux sénateurs Maurey et de Nicolaÿ, qui ont offert dans leur rapport d’information un nouveau regard, parfois de nouvelles méthodes, avec des changements de paradigmes visant à faire en sorte que les gouvernements, désormais, puissent considérer certaines démarches, dont l’octroi de fréquences, comme des outils d’aménagement du territoire et non plus comme de simples ressources budgétaires. C’est l’un des éléments, monsieur le président de la commission, que nous avons pris en compte.
L’attente de nos concitoyens est immense. Alors que les chiffres indiquent un nombre limité de zones blanches et une accessibilité massive à la téléphonie mobile, un accès à internet très largement satisfait sur l’ensemble du territoire, ce n’est pas du tout la perception de nos concitoyens. Les exemples que nous avons tous en tête, les expériences que nous vivons quotidiennement doivent donc nous amener à redoubler d’efforts pour trouver des solutions concrètes.
Nous partageons les objectifs de cette proposition de loi, vous le savez. C’est pourquoi nous travaillons depuis plusieurs mois, collectivement, pour déterminer les solutions qui peuvent être mises en avant et les actions à entreprendre.
Le Président de la République, le Premier ministre ont fixé des objectifs ambitieux en matière de numérique. Il s’agit d’offrir à tous les Français un accès à internet de bonne qualité, donc un débit supérieur à 8 mégabits par seconde, d’ici à 2020 et un accès au très haut débit, autrement dit un débit supérieur à 30 mégabits par seconde, à partir de 2022. L’amélioration de la qualité de la téléphonie mobile est également concernée, qu’il s’agisse de l’accès à la 4G ou de la couverture des zones blanches.
Quatre axes principaux ont ainsi été annoncés par le Gouvernement, que ce soit par le Premier ministre, le 14 décembre dernier, à l’occasion de la Conférence nationale des territoires, ou par Jacques Mézard et moi-même, à la mi-janvier, à la suite d’un accord important, mentionné par le sénateur Patrick Chaize, passé avec les opérateurs de téléphonie mobile.
Le premier, c’est l’accélération de la couverture numérique des territoires, qui passe d’abord par une accélération et une sécurisation du déploiement des réseaux, mais aussi par une consolidation des réseaux d’initiative publique. Le débat ouvert à leur sujet a été rapidement stoppé : nous soutenons les réseaux d’initiative publique, qu’il convient de sécuriser juridiquement et financièrement, grâce au plan France très haut débit. Elle passe également par la mobilisation de toutes les technologies et de tous les opérateurs, y compris des investisseurs, les investisseurs privés étant de plus en plus nombreux à vouloir investir dans nos réseaux numériques.
Le deuxième axe, c’est la généralisation d’une couverture mobile de qualité. Chaque opérateur, dans l’accord que nous avons passé en janvier dernier, s’est engagé à couvrir en 4G 5 000 nouveaux sites, dont certains seront mutualisés, ainsi que plus de 10 000 communes qui étaient couvertes en 2G ou en 3G d’ici à la fin de 2020. C’est essentiel, car le passage à la 4G permet, au-delà de la voix, l’accès à internet via un téléphone intelligent.
Le troisième axe, c’est la simplification des procédures de déploiement. Des échanges ont eu lieu avec plusieurs d’entre vous afin de déterminer les mesures de simplification à même d’améliorer véritablement les délais de construction, actuellement trop longs, dans la mise en œuvre des infrastructures sur le terrain.
Le quatrième et dernier axe, c’est un choc de transparence. Il faut être totalement transparent sur le déploiement du numérique et de la téléphonie mobile. C’est le sens de l’observatoire des déploiements fixes que l’ARCEP prépare pour l’été 2018. C’est également le sens des observatoires que l’Agence du numérique déploiera s’agissant du numérique.
Aujourd’hui, nos débats portent spécifiquement sur les travaux que vous avez menés, madame la rapporteur, monsieur le sénateur. Je tiens d’abord à saluer l’ensemble de ces travaux. Ils ont pesé, vous le savez, dans un contexte qui était tout autre que celui que nous connaissons aujourd’hui. Les déclarations de certains opérateurs laissaient entendre qu’il était possible de déployer la fibre sur un territoire, quels que soient les projets existants. À l’époque, voilà déjà trois mois, vos travaux ont permis, dans les discussions que nous avons eues avec ces acteurs économiques, de porter une voix nécessaire au rétablissement d’un équilibre qui, je le crois, s’est largement amélioré aujourd’hui.
Le contexte dans lequel s’inscrit cette proposition de loi a également évolué du fait des travaux que nous avons pu mener dans le cadre de la préparation du projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique, que Jacques Mézard et moi-même présenterons prochainement. Le texte du Gouvernement contient notamment une série de mesures de simplification pour accélérer le déploiement des réseaux sur le territoire.
C’est au regard de ce contexte, marqué, j’y reviendrai, par des évolutions sur trois principaux points, que le Gouvernement émet effectivement des réserves sur l’opportunité d’adopter, dès à présent, la proposition de loi. Cela étant, monsieur le sénateur Chaize, vous le savez bien, le Gouvernement reprend à son compte vos objectifs – votre « rêve », comme vous dites –, et il a toujours exprimé à l’égard de l’ensemble de vos travaux un soutien non équivoque. Vous le savez d’autant plus que nous ne comptons plus, ni vous ni moi, les heures de discussion et de travail que nous avons pu avoir en commun ou avec l’association que vous représentez.
Je le disais, le contexte a évolué, sur trois principaux points.
Le premier concerne les négociations avec les opérateurs, s’agissant notamment de leur positionnement, que j’ai précédemment évoqué.
Le deuxième point est le fait que la proposition de loi n’est bien entendu pas conforme au projet de code européen des communications électroniques, lequel a une portée bien plus large et est d’ailleurs toujours en cours de discussion. Ma collègue Delphine Gény-Stephann se rendra à Bruxelles dans quelques jours pour poursuivre les négociations en la matière, qui, d’après les dernières informations dont nous disposons, pourraient être finalisées au premier semestre de l’année en cours, pour une transposition envisagée à la fin du second. Ce calendrier est à prendre avec précaution, tant les discussions européennes, vous le savez comme moi, peuvent parfois être plus longues que prévu.
Le troisième point, que vous avez vous-même mentionné, madame la rapporteur, porte sur la nature des engagements que nous avons demandé à chacun des opérateurs de prendre dans le cadre du déploiement de leurs réseaux. Ces engagements seront plus contraignants, car soumis au dispositif de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, dispositif porté déjà à l’époque de la loi Montagne. Tel est le résultat des discussions que nous avons eues au cours des dernières semaines avec l’ensemble des opérateurs, en particulier avec deux d’entre eux.
Depuis mon audition devant la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, nous avons donc obtenu de nouveaux engagements de la part des opérateurs. Ils seront présentés à l’ARCEP dans les tout prochains jours. Dès que l’ARCEP se sera prononcée, nous vous les transmettrons en totale transparence, en y incluant le contenu des débats qui auront été menés.
Par conséquent, l’application de l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques sera possible, du moins dès que l’ARCEP aura rendu son avis. Le contexte a donc bien changé en quelques semaines.
Je terminerai mon propos en insistant sur le rôle des collectivités.
L’accord que nous avons signé avec les opérateurs voilà maintenant deux mois met les collectivités au centre du dispositif, et ce pour au moins deux raisons. D’une part, l’identification des nouveaux sites de déploiement, sur lesquels portera l’investissement des opérateurs, se fera en liaison avec les collectivités. Ce seront non pas les opérateurs, mais bien l’État et les collectivités locales qui décideront de l’endroit où les nouvelles infrastructures de téléphonie mobile seront installées. D’autre part, les collectivités locales ne supporteront plus le coût de ces infrastructures, notamment l’édification nécessaire de nouveaux pylônes. Celui-ci incombera aux opérateurs eux-mêmes.
À mes yeux, l’élément le plus important lorsqu’il est question de la duplication des réseaux potentiels, le choix qui a guidé toutes les décisions que nous avons prises, c’est que les collectivités sont les donneurs d’ordre. Aujourd’hui, il n’est pas possible de construire un réseau si le donneur d’ordre ne fournit pas un certain nombre d’autorisations. Le rôle des collectivités en la matière doit être conforté, d’où, notamment, le renforcement du volet juridique des réseaux d’initiative publique.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous partageons et soutenons pleinement les objectifs de cette proposition de loi et l’ambition affichée. Cependant, en termes de calendrier, parce qu’elle porte en particulier largement sur la transposition du code européen des communications électroniques, elle devrait être adoptée a posteriori et non avant que les discussions et négociations en cours, menées pour la France par ma collègue Delphine Gény-Stephann, ne soient finalisées.
M. Frédéric Marchand applaudit.

M. Hervé Maurey, président de la commission de l ’ aménagement du territoire et du développement durable. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd’hui pour examiner la proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit, déposée par Patrick Chaize et rapportée par Marta de Cidrac. Je tiens à cette occasion à féliciter nos deux collègues pour leur implication et la qualité de leur travail sur ce sujet aussi complexe qu’important, avec une mention toute particulière pour vous, madame la rapporteur. Je crois pouvoir dire, en notre nom à tous, que vous avez réussi votre baptême du feu !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – MM. Alain Fouché et Frédéric Marchand applaudissent également.

Le déploiement de réseaux à très haut débit sur l’intégralité du territoire est un sujet capital par l’ampleur du chantier, qui représentera plus de 35 milliards d’euros d’investissements, par le nombre – 33 millions – de foyers et d’entreprises concernés, par le fait qu’il s’agit d’un projet structurant et déterminant pour la compétitivité de notre pays, ainsi que d’un enjeu majeur en termes d’aménagement du territoire et d’équité entre nos concitoyens.
Nous devons donc tout faire pour doter la France dans les meilleurs délais d’une couverture complète en très haut débit, en privilégiant, bien sûr, le déploiement de la fibre optique jusqu’à l’utilisateur, puisque c’est la technologie la plus pérenne et la plus adaptée aux usages de demain.
Cet objectif d’une couverture rapide et exhaustive de tout le territoire repose sur un partage de responsabilités entre, d’une part, une zone confiée à l’initiative privée à partir d’intentions manifestées par les opérateurs en 2011 et, d’autre part, le reste du territoire, pris en charge par l’initiative publique.
J’ai eu l’occasion à maintes reprises d’exprimer mes regrets face à ce choix fait en 2011. Celui-ci permet en effet aux opérateurs privés de pratiquer une politique d’écrémage, c’est-à-dire de préempter les zones rentables en laissant les autres à la charge des collectivités territoriales.
S’il n’est malheureusement plus possible de revenir sur une telle décision, il convient de protéger les efforts menés par les collectivités territoriales, qui sont en première ligne pour assurer l’aménagement numérique du territoire.

Nous avons pu mesurer cette nécessité voilà quelques mois avec les annonces pourtant peu crédibles d’un opérateur, qui ont néanmoins eu un effet relativement déstabilisant sur un certain nombre de réseaux d’initiative publique.
Par ailleurs, il est indispensable de nous assurer, enfin, que les déploiements dans la zone d’initiative privée se concrétisent réellement et pleinement. Il s’agit simplement d’exiger des opérateurs qu’ils respectent leurs engagements, là où l’initiative publique a été écartée précisément en raison de ces intentions. Aujourd’hui, tel n’est toujours pas le cas, malgré les propositions réitérées du Sénat visant à ce que les opérateurs soient liés par leurs engagements et sanctionnés au cas où ils ne les respecteraient pas.
Sur le sujet, le combat du Sénat est ancien. Déjà, en 2011, et je me tourne spontanément vers Jean-Paul Émorine, qui présidait la commission dont j’étais membre à l’époque, nous avions présenté un rapport d’information intitulé Aménagement numérique des territoires : passer des paroles aux actes. Par la suite, avec mon ancien collègue Philippe Leroy, j’avais déposé une proposition de loi, adoptée par le Sénat en février 2012. Ce texte imposait aux opérateurs de s’engager sur un nombre précis de lignes construites, par année et pour chaque territoire, avec la possibilité de mises en demeure et de sanctions prononcées par l’ARCEP en cas de manquement. Malheureusement, le Gouvernement avait, à l’automne 2012, obtenu le rejet du texte par l’Assemblée nationale.
Dans un rapport d’information plus récent, publié en 2015, Patrick Chaize et moi-même avions recommandé une contractualisation dotée d’engagements précis, avec la possibilité pour l’autorité de régulation de prononcer des sanctions en cas d’inexécution.
Sur ce sujet, le gouvernement précédent nous avait régulièrement affirmé que le système de conventionnement lancé en 2013 était une réponse suffisante. Le ministre de l’économie de l’époque, devenu depuis Président de la République, avait annoncé un achèvement de ce processus de contractualisation pour la fin de l’année 2015, objectif ensuite reporté pour la fin de l’année 2016. À la fin de l’année 2017, le processus n’était toujours pas achevé ; là où il était réalisé, chacun pouvait déplorer le manque de précision des conventions signées avec les opérateurs.
En octobre dernier, nous avons eu la satisfaction de constater que l’ARCEP se ralliait au point de vue du Sénat en confirmant, une fois encore, qu’un encadrement des engagements des opérateurs était indispensable, compte tenu notamment du retard observé dans une grande partie de la zone d’initiative privée.
Monsieur le secrétaire d’État, nous sommes en mars 2018. Le problème identifié par le Sénat dès 2011 n’a toujours pas été résolu. Les écarts considérables entre les engagements initiaux des opérateurs et la réalité compromettent une couverture intégrale du territoire national en très haut débit à l’horizon de 2020 et risquent de donner naissance à de véritables « zones blanches » en matière de très haut débit.
Les opérateurs affirment toujours qu’ils rendront l’intégralité des logements éligibles à une offre commerciale d’ici à 2020. Je n’y crois pas un seul instant. L’expérience nous a malheureusement montré combien ce type d’affirmations de la part des opérateurs était peu crédible et peu suivi d’effets. Si les opérateurs sont aussi sûrs d’eux-mêmes, qu’ils s’engagent enfin, concrètement, en termes de déploiement, territoire par territoire, avec des échéanciers permettant de contrôler régulièrement le respect des engagements, sous l’égide de l’ARCEP !
J’ai bien noté, monsieur le secrétaire d’État, que des discussions étaient en cours entre le Gouvernement et les opérateurs. Mais nous n’avons aucune garantie sur leur résultat final. Le Sénat entend donc aller plus loin avec cette proposition de loi. Sur ce sujet, comme sur d’autres problématiques d’accès au numérique, telles que l’accès à un haut débit de qualité ou la définition des zones blanches de la téléphonie mobile, il est regrettable que le Sénat n’ait pas été entendu plus tôt. Nous avons en effet, je l’ai rappelé, proposé des solutions, qui, de toute évidence, sont indispensables à mettre en œuvre. Permettez-moi, d’ailleurs, de déplorer que le Parlement ne soit pas davantage associé à la politique d’aménagement numérique du territoire.
Pour le déploiement des réseaux fixes, comme sur les questions de couverture mobile, le gouvernement actuel prolonge la tendance antérieure consistant à privilégier des négociations informelles et des conventions avec les opérateurs, dont le Parlement ne prend connaissance que tardivement et très partiellement. Les gouvernements successifs n’ont jamais réellement saisi le Parlement sur ce sujet pourtant essentiel. Cette pratique, qui conduit parfois à véritablement « court-circuiter » la représentation nationale, n’est pas acceptable. Nous aimerions que le Gouvernement agisse différemment et – pourquoi pas ? – qu’il applique l’engagement pris devant notre commission par un certain Emmanuel Macron, alors ministre de l’économie, de revenir tous les six mois faire le point sur le déploiement des réseaux.
Pour conclure, je voudrais me féliciter de ce que la présente proposition de loi apporte de vraies solutions sur ce sujet essentiel. Une fois encore, le Sénat a fait preuve de vigilance et de réactivité et démontre sa mobilisation sur la question de l’aménagement numérique du territoire. Toutefois, si nous l’abordons aujourd’hui, c’est parce que nous n’avons pas été entendus par les gouvernements précédents. J’espérais, monsieur le secrétaire d’État, que, cette fois-ci, il en irait différemment.
Je l’avoue, mais peut-être les débats vont-ils nous éclairer, je n’ai pas tout compris du positionnement du Gouvernement, qui nous explique partager les objectifs du texte, mais trouver que, quelque part, celui-ci arrive un peu trop tôt dans le calendrier. Non, monsieur le secrétaire d’État, il n’est pas trop tôt, il est presque trop tard ! Nous vous demandons donc de soutenir cette proposition de loi, essentielle pour le déploiement du numérique et pour nos territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. – M. Alain Fouché applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à peine arrivé au gouvernement en juin 2017, le secrétaire d’État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi, promettait publiquement d’« amener internet là où il ne l’est pas », à l’appui d’un renforcement du plan France très haut débit, destiné à assurer une couverture complète du territoire d’ici à 2020. Or l’État dématérialise à tout-va ses services, alors même que la couverture numérique n’est pas totalement assurée. Vous l’avez vous-même rappelé, monsieur le secrétaire d’État, un Français sur deux n’a pas accès à ce type de connexion. Est-ce normal de mettre la charrue devant les bœufs ? Aujourd’hui, notre pays crée de l’exclusion numérique. C’est bien regrettable.
Annoncé sous le précédent quinquennat, ce plan numérique était supposé répondre à un enjeu d’avenir pour notre pays, puisqu’il devait assurer l’inclusion économique et sociale de tous les territoires, en désenclavant certains espaces géographiques aujourd’hui isolés du reste de la République. Pourtant, le fossé numérique demeure et crée des injustices notables.
Dans certains départements, la « zone blanche » est encore une réalité malheureuse. J’en veux pour preuve les nombreux exemples pointés du doigt par des collègues de mon groupe. Ainsi, au cœur de la Corrèze, à Saint-Martin-la-Méanne, le téléphone ne passe pas et la commune est exclue du plus petit débit internet. En Occitanie, l’ARCEP ne dénombre pas moins de 89 zones blanches souffrant d’isolement téléphonique et numérique. Et même en zone urbaine, il existe parfois des zones blanches ; je pourrais vous donner quelques exemples.
Face à cette situation, déplorable à la fois pour les habitants et les commerçants, le Gouvernement se doit d’agir.
Notre collègue Patrick Chaize nous soumet une proposition de loi pour protéger les réseaux d’initiative publique déployant la fibre dans les zones rurales. Nous souscrivons totalement à son analyse et saluons le travail ainsi réalisé.
Toutes les administrations et les institutions mettent en avant la dématérialisation comme étant l’alpha et l’oméga du bien-être, un moyen de faciliter la vie. Mais qu’en est-il en réalité ? Notre société abandonne une partie de la population, ceux qui ont des difficultés de connexion, qui ne sont pas des cybercitoyens, ou ceux encore, comme nombre de personnes âgées, qui ne possèdent pas d’équipements informatiques.
Ce qu’il faut, c’est envisager le court terme, l’urgence, pour ces territoires isolés, pour ces espaces relégués. La proposition de loi contient une série de mesures pour encourager la démultiplication des pylônes en zone rurale et assurer un bon débit : stagnation des redevances, plafonnement de l’IFER mobile, allégement des formalités administratives, etc. Nous devons saisir l’opportunité de la renégociation des licences d’utilisation des fréquences par les opérateurs pour accélérer ces débats.
Par ailleurs, nous saluons l’introduction, en commission, d’un article additionnel limitant l’extension de l’IFER sur les réseaux de câble et de fibre optique aux dites « zones fibrées ».
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la couverture numérique devrait être non pas un enjeu d’avenir, mais une réalité. Nous sommes en retard, il faut le reconnaître, et je salue à cet égard les propos du président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable. La transformation digitale du pays devra bénéficier à toute la France, celle des villes comme celle des campagnes, sujet sur lequel mon collègue Alain Fouché vous dira quelques mots dans quelques instants.
Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Alain Fouché applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à répondre aux préoccupations de nos concitoyens confrontés quotidiennement à la fracture numérique dans bon nombre de nos territoires ruraux ou peu denses.
La question de l’aménagement numérique de notre territoire et de l’égal accès aux services pour tous est primordiale au regard des évolutions de la société : démarches administratives en ligne, accès à l’information, aux savoirs et à la culture, ouverture sur le monde, ou encore télétravail, auquel notre groupe est particulièrement attaché.
Grâce à des initiatives locales, les besoins en termes de médiation et d’inclusion numériques sont pris en compte pour former les personnes les plus éloignées du numérique. Pourtant, une partie de notre territoire demeure pénalisée par un déploiement des réseaux trop lent ou trop inégal. En effet, selon l’Agence du numérique, 6, 4 millions de Français disposent encore d’une connexion d’un débit inférieur à 8 mégabits par seconde, et même à 3 mégabits par seconde pour 3, 5 millions d’entre eux, situés en zone rurale ou de montagne.
Nous connaissons tous des exemples de communes où les activités économiques et l’accès aux services publics sont fortement mis à mal par un réseau défaillant. Ainsi, j’ai été interpellé, comme beaucoup d’entre vous, par des élus de communes ayant des connexions tellement limitées que l’agent de La Poste ne peut plus effectuer ni versements ni prélèvements bancaires pour ses clients, qu’aucun mail ne peut partir de la mairie ou de l’EHPAD, des communes où les réservations en ligne pour les professionnels du tourisme sont impossibles et où les habitants n’ont pas accès aux services en ligne. De telles inégalités doivent cesser.
Le plan France très haut débit, lancé en 2013, a répondu à un certain nombre de nos interrogations, voire de nos inquiétudes : il organise les déploiements du réseau et la répartition entre l’initiative publique et privée jusqu’en 2022, pour couvrir l’ensemble du territoire français en très haut débit, tandis que 50 % des résidents en zones peu denses bénéficieront de la fibre.
S’il est certes pertinent d’équiper en priorité les zones denses, l’ambition doit être la même pour les territoires ruraux ou peu peuplés, l’accès aux services de toutes sortes étant déjà source de difficultés pour nombre de nos concitoyens. L’objectif intermédiaire d’un « bon débit pour tous », fixé en juillet dernier par le Président de la République, ne doit pas nous détourner des objectifs du plan France très haut débit.
Dans les zones peu denses, où les acteurs privés se montraient jusqu’ici réticents à s’engager, les collectivités territoriales ont investi massivement pour permettre l’installation rapide du très haut débit. Or, cela a été rappelé, l’annonce faite par un opérateur l’été dernier, en vue de couvrir l’intégralité du territoire national par son propre réseau, a menacé les principes structurants du déploiement et en a souligné les fragilités. Bien que l’opérateur semble aujourd’hui avoir revu ses ambitions à la baisse, on ne peut exclure des tentatives ultérieures des réseaux d’initiative privée qui viendraient ébranler l’équilibre financier.
Loin de nous l’idée de vouloir freiner l’accès au très haut débit par le recours à une initiative privée accrue. Mais nous partageons les arguments des auteurs de la présente proposition de loi : d’une part, les investissements déjà réalisés ou projetés par les collectivités doivent être sécurisés ; d’autre part, la cohérence de la couverture numérique du territoire doit être assurée. Nous le savons, les intentions du secteur privé ne coïncident pas toujours avec l’intérêt général, et c’est finalement l’utilisateur qui en subit les conséquences en termes de qualité de service et de coût.
Dans son avis en date du 25 octobre 2017, l’ARCEP souligne que les initiatives privées doivent tenir compte des réseaux publics et ne pas freiner l’expansion du très haut débit par une rupture de l’équilibre voulu par le plan France très haut débit. Ainsi, préserver l’existence d’une seule boucle locale optique mutualisée sur chaque territoire en zone peu dense apparaît comme une solution nécessaire.
L’adoption de l’article 2 de la proposition de loi, en rendant les engagements des opérateurs juridiquement contraignants par l’établissement d’une liste des lignes existantes ou en projet et d’un calendrier prévisionnel des déploiements, assortis de sanctions éventuelles, permettra d’accélérer les projets et de garantir leur visibilité. Cela fait partie des recommandations de l’ARCEP, qui constate que le Gouvernement aurait pu avoir recours à l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques. Créé par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, cet article L. 33-13 permet en effet au ministre compétent d’accepter des engagements souscrits par les opérateurs pour contribuer à l’aménagement et à la couverture des zones peu denses et à l’ARCEP de contrôler leur respect et de sanctionner les manquements.
En ce qui concerne les autres mesures proposées, le renforcement de la mutualisation des infrastructures, ainsi que la possibilité de confier le déploiement à un autre opérateur lorsque l’opérateur sur place ne s’est pas conformé à ses obligations constituent un progrès.
Nous restons toutefois vigilants quant aux incitations financières prévues dans l’accord qualifié d’« historique », passé en janvier dernier entre l’État et les opérateurs, lequel instaure un certain nombre de contreparties au déploiement accéléré de la 4G et à la résorption des zones blanches. Ces contreparties mériteraient de faire l’objet d’une étude d’impact, et il reste prématuré d’accorder de nouveaux avantages lorsque l’on constate que les engagements ne sont pas respectés par la suite.
Enfin, il nous semble que l’article 10, relatif à l’allégement des formalités pour encourager l’amélioration des constructions existantes, est en l’état imprécis quant aux simplifications qui seront apportées aux règles d’urbanisme. Plutôt que le renvoi à un décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 426-1 du code de l’urbanisme, il eût été plus judicieux d’affiner la rédaction de l’article en question.
Nous savons que cette ambition et ces inquiétudes sont partagées par le Gouvernement, qui entend légiférer sur ces questions dans le cadre du projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique. C’est à notre sens le bon véhicule, ne serait-ce que pour permettre d’évaluer l’impact des contreparties de l’accord « historique » sur nos finances publiques. Elles sont partagées également au sein de l’Union européenne, où est encore en discussion le projet de code européen des communications électroniques.
Ainsi, le groupe du RDSE, s’il est favorable à toute réforme visant à désenclaver nos territoires et à l’amélioration de la sécurité juridique des investissements publics, reste néanmoins réservé sur cette proposition de loi, pour les raisons que je viens d’évoquer.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, lors de la Conférence nationale des territoires, organisée en ces murs le 17 juillet dernier, le Président de la République indiquait : « Pour l’État, le premier enjeu est la lutte contre la fracture territoriale. L’État et les collectivités territoriales doivent travailler de concert afin de construire cette cohésion des territoires. »
Cette priorité gouvernementale de résorber la fracture territoriale passe aujourd’hui également par la résorption de la fracture numérique. C’est pourquoi le Président de la République a pris, à cette même occasion, des engagements très ambitieux en faveur de l’accélération de la couverture numérique de notre territoire : garantir le bon débit pour tous en 2020, le très haut débit en 2022 et la fibre pour tous en 2025.
En effet, cela a été rappelé, la France se trouve en bas du classement européen en termes de couverture en très haut débit fixe. Aujourd’hui, 6 millions de nos concitoyens n’ont pas accès à un débit internet fixe de qualité et plus de la moitié des Français déclare ne pas profiter assez des opportunités offertes par les nouvelles technologies.
Cette carence est d’autant moins acceptable que l’État, lui, accélère sa transformation numérique, afin de dématérialiser et de simplifier les démarches des particuliers, des associations, des entreprises et des administrations. Je salue en ce sens la mise en ligne, la semaine dernière, de la plateforme demarches-simplifiees.fr par le secrétaire d’État chargé du numérique, qui constitue un bénéfice pour tous, en particulier pour nos territoires ruraux.
Cette dématérialisation et cette transformation permettent de rendre plus efficaces et plus réactifs les services publics. Dans le même temps, elles peuvent accroître le sentiment d’abandon et d’exclusion des citoyens à mesure que les usages se développent : la fracture numérique devient alors une fracture d’accès aux services.
Oui, la fracture numérique entre les territoires est manifeste, elle nourrit les écarts de développement économique. Or les besoins en très haut débit sont les mêmes quels que soient les territoires : qu’il habite dans le centre de Lille ou en zone rurale, comme dans l’Avesnois, un lycéen aura toujours les mêmes nécessités d’accès à internet pour faire son exposé. Les petites et moyennes entreprises installées sur nos territoires ont elles aussi exactement les mêmes besoins que les PME de la région parisienne. Enfin, les zones rurales ont parfois justement davantage besoin du numérique que les zones urbaines ; je pense notamment à la promesse de la télémédecine, de l’e-santé en général, qui permet de lutter contre la désertification médicale. Comment faire alors sans une connexion internet de très grande qualité ?
Il nous faut lutter contre la situation d’inégalité dans laquelle nous nous trouvons, contre le sentiment d’abandon de trop de nos concitoyens, et veiller à l’inclusion des populations éloignées du numérique, en dotant les territoires d’infrastructures adéquates.
Les attentes des citoyens en matière de couverture numérique sont fortes et nécessitent une grande ambition, que l’on retrouve dans les objectifs que se sont fixés l’État et les opérateurs télécoms. En effet, certains retards accumulés par les opérateurs dans la mise en œuvre du plan France très haut débit ont mis en péril la réalisation des ambitions du Gouvernement.
Dans les zones d’initiative publique, les zones peu denses, rurales ou de montagne, la plupart des RIP sont lancés. Ces lourds investissements consentis par les collectivités territoriales doivent absolument être protégés de la concurrence des réseaux privés, sinon leur modèle économique est en péril. Il faut préserver les investissements publics et assurer de façon certaine la desserte de l’ensemble des habitants en fibre optique.
Tel est l’objectif de la proposition de loi de notre collègue Patrick Chaize, mobilisé depuis plusieurs années, nous le savons, sur ce sujet du numérique et dont la compétence n’est plus à démontrer.
Nous sommes tous d’accord, les Français doivent être égaux dans l’accès au numérique grâce à l’effort conjoint des collectivités territoriales et des opérateurs privés, que ce soit en termes d’investissements ou de respect des engagements et contraintes de ces derniers.
À ce titre, le groupe que je représente est en adéquation avec la philosophie générale de la proposition de loi de Patrick Chaize. Toutefois, si nous nous rejoignons sur le fond du texte, notamment après son passage en commission, nous avons quelques réserves concernant non seulement la temporalité choisie, mais aussi le calendrier dans lequel s’inscrit son examen.
À l’échelon européen, si un accord politique provisoire a été trouvé sur le futur code européen des communications électroniques, les négociations n’ont pas encore abouti. En l’état, l’adoption de cette proposition de loi anticiperait donc les conclusions à venir, ce qui n’est, de notre point de vue, guère opportun.
Par ailleurs, nous le savons tous ici, au Sénat, qui a accueilli la Conférence de consensus sur le logement, comme vous l’avez rappelé, monsieur le secrétaire d’État, un chapitre dédié à la simplification du déploiement des réseaux de communications électroniques à très haute capacité est inclus dans le futur projet de loi Évolution du logement et aménagement numérique, dit projet de loi ÉLAN. Dans ce dernier figurent quatre articles concernant cette simplification et répondant, en grande partie, aux mesures préconisées par notre collègue dans la présente proposition de loi. Ce sujet pourra alors prendre toute sa place dans le cadre, plus global, de l’examen du projet de loi ÉLAN, au mois de juin prochain.
C’est pourquoi le groupe La République En Marche s’abstiendra sur la présente proposition de loi. Néanmoins, nous estimons que le débat de ce jour est nécessaire pour envoyer un signal fort aux opérateurs : malgré les désaccords sur la forme, la majorité des groupes parlementaires et le Gouvernement parlent d’une seule et même voix.

Nous sommes alignés en matière de politique numérique. Les opérateurs doivent respecter leurs engagements en matière de développement des infrastructures numériques pour atteindre les objectifs fixés par le plan France très haut débit et le Gouvernement. En cas de manquement, ils devront être sanctionnés.
Le rôle du Parlement est non seulement de légiférer, certes, mais aussi de contrôler, notamment le respect des délais et du calendrier, et d’évaluer. La réforme constitutionnelle à venir, dont nous allons parler dans ces murs entre dix-sept heures et vingt et une heures, souhaite graver dans le marbre un aspect du travail parlementaire souvent méconnu et rendu parfois difficile au regard de notre procédure législative.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons là un sujet qui intéresse tous nos concitoyens, qu’ils soient jeunes ou âgés, urbains ou ruraux, actifs ou inactifs. Voilà pourquoi il est essentiel que nous nous en emparions, et c’est ce que nous ferons, maintenant ainsi une pression certaine sur les opérateurs tout en rassurant les collectivités, pour qu’elles continuent d’investir.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je souhaite avant tout remercier l’auteur de cette proposition de loi, notre collègue Patrick Chaize. Par son initiative, la question de l’accès au numérique, question vitale pour le désenclavement et le développement des territoires ruraux et de montagne, revient au cœur de l’hémicycle.
Nous partageons l’objectif de cette proposition de loi : clarifier et encourager les investissements dans le numérique afin d’atteindre les objectifs du plan France très haut débit, soit la couverture en 2025 de 100 % de la population par la fibre optique. Nous considérons en effet ce réseau par fibre comme essentiel pour les populations, d’une importance équivalente au réseau électrique ou ferroviaire que la puissance publique a su déployer en d’autres temps.
Aujourd’hui, l’accès à ces technologies est déterminant non seulement en termes d’attractivité des territoires, mais également pour le droit à l’information et à la communication, pour l’accès aux œuvres et aux savoirs. Autant de considérants qui ont conduit l’ONU à définir l’accès au numérique comme un nouveau droit de l’homme.
Par ailleurs, pour nos territoires, l’économie numérique pourrait devenir l’outil privilégié de lutte contre les fractures territoriales : un véritable moteur de développement.
Pour toutes ces raisons, nous sommes très soucieux du retard pris par la France, qui se place au vingt-septième rang parmi les pays européens en matière d’accès au numérique fixe. Ce retard est la conséquence directe des politiques de libéralisation totale de ce secteur et du désengagement de l’État, qui ne définit pas un cadre juridique contraignant, lequel serait pourtant favorable au développement du très haut débit.
La politique numérique de la France se résume très simplement : liberté totale pour les opérateurs selon un schéma habituellement délétère où l’on socialise les pertes et où l’on privatise les profits. Un plan qui permet aux opérateurs d’intervenir là où la rentabilité est assurée et qui partout ailleurs, soit 90 % du territoire, appelle les collectivités à prendre en charge le financement des infrastructures déficitaires.
Cette structuration du marché permet aux majors des télécommunications de dégager d’importants profits. En 2016, le bénéfice d’Orange a progressé de 10, 7 %, s’élevant à 2, 93 milliards d’euros. Pour SFR, ce sont 3, 6 milliards d’euros de bénéfice.
À l’inverse, pour les collectivités qui doivent investir en zone non rentable, cet effort est de plus en plus difficile à produire du fait de la baisse continue et importante des dotations.
Par rapport à cette situation, la proposition de loi permet d’introduire quelques correctifs sur cette structuration de marché, mais uniquement pour les zones dites « intermédiaires ». Il s’agit des zones ni très denses ni trop peu denses, où l’État a émis des appels à manifestation d’intérêt pour faire pression sur les opérateurs et obtenir des engagements de leur part. Or, aujourd’hui, dans ces zones dites « AMI », les engagements des opérateurs, dans le cadre des conventionnements, ne sont assortis d’aucune obligation de résultat ni même de moyens. En cas de défaillance, la seule option est celle de l’intervention du secteur public pour pallier les manquements.
Cette proposition de loi préconise dans ce cadre plusieurs évolutions positives : d’abord, une meilleure connaissance des engagements pris ; ensuite, l’obligation de respecter ces engagements sous peine de sanctions ; enfin, l’interdiction pour les opérateurs d’intervenir à un endroit où un autre opérateur a déjà manifesté son engagement d’intervenir. Il s’agit clairement de répondre à l’offensive de SFR, qui avait annoncé être en mesure de « fibrer » l’ensemble du territoire.
Nous sommes donc favorables à ces évolutions tout en regrettant leur périmètre circonscrit et leur caractère limité. En effet, cette proposition de loi préserve malgré tout un modèle hybride, injuste, qui entérine les fractures territoriales : rien sur la zone dense et rien non plus pour aider les collectivités à assumer leur mission de service public local reconnu par la présente proposition de loi.
Nous estimons, pour notre part, que c’est l’ensemble du modèle qu’il faut repenser. Il est indispensable de remettre de la cohérence, de la transparence et de la responsabilité politique pour garantir des droits nouveaux pour nos concitoyens.
La rentabilité à court terme ne peut plus être la seule boussole de notre développement. Il faut sortir de ce prisme et redonner une dimension d’intérêt général à ce secteur.
Nous voyons ici les limites du tout-privé et de la dérégulation. Les solutions existent pourtant. Un seul exemple : la « rente du cuivre », qui a permis d’offrir de généreux dividendes aux actionnaires d’Orange, aurait d’ores et déjà permis de « fibrer » l’ensemble du territoire national.
Nous avons déjà perdu trop de temps.
Deux options uniquement s’offrent à nous pour répondre au défi de la couverture numérique du territoire : soit le public, au sens large, prend la responsabilité d’intervenir partout pour engager une péréquation permettant, dans des conditions acceptables, la création de ce réseau ; soit cette responsabilité est confiée au privé, avec un cahier des charges, des obligations de service public dans le cadre du service public universel qui serait alors étendu au très haut débit.
Si l’objet de cette proposition de loi reste donc loin de cette « révolution du numérique » que nous appelons de nos vœux, elle permet tout de même de corriger certains dysfonctionnements.
Cette proposition de loi a le mérite d’apporter un meilleur encadrement et un début de régulation dans le secteur du numérique. C’est bien sûr une avancée, mais, nous l’avons rappelé, dans un système général qui ne fonctionne pas. C’est pourquoi le groupe CRCE portera une abstention constructive sur ce texte.
Mme Michelle Gréaume applaudit.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous examinons aujourd’hui la proposition de loi de notre ami et collègue Patrick Chaize, et je voudrais m’associer aux orateurs précédents pour rendre hommage au travail réalisé à travers ce texte.
À l’instar du dernier rapport d’information publié en 2015 compilant les recommandations du groupe de travail sur l’aménagement numérique du territoire, notre commission réalise depuis plusieurs années déjà un important travail de vigilance sur ce sujet tout en se montrant force de proposition.
Si les retards de déploiement et le manque d’investissement public ont longtemps été la norme dans notre pays – ce qui se matérialise par la dix-huitième place qu’il occupe parmi les vingt-huit pays européens au classement de la performance numérique –, je me réjouis que ce temps soit désormais en passe d’être révolu grâce à une ambition politique renouvelée.
Une bonne partie du chemin a été tracée au cours du précédent quinquennat, sous l’impulsion de François Hollande, avec le lancement du plan France très haut débit. Mobilisant des sommes jamais investies jusqu’alors, ce plan a fait le choix de développer la fibre optique jusqu’à l’abonné et plusieurs objectifs ambitieux à l’échéance de 2022.
Aujourd’hui, malgré des retards et des difficultés parfois observées sur le terrain, la dynamique de cette tendance ne saurait se démentir. Mieux, elle doit selon moi être soutenue et même renforcée afin de bénéficier au plus grand nombre de nos concitoyens.
Comme toute dynamique, elle comporte également des dérives, en l’espèce une concurrence déloyale de certains opérateurs comme nous l’avons vu au cours de l’été 2017.
Cette proposition de loi arrive donc à point nommé ; elle est une réponse à ces difficultés et propose un cadre législatif raffermi indispensable à la dynamique des déploiements, à la prévisibilité et à la confiance nécessaire pour ce type d’investissement.
L’ARCEP, dont je salue la qualité du travail, ne s’y était d’ailleurs pas trompée : dans plusieurs de ses avis, elle a appelé à préserver l’articulation public-privé instituée par l’appel à manifestation d’intentions d’investissement réalisé en 2011.
Aussi, je souscris pleinement aux objectifs du texte : conforter les investissements publics dans la fibre et permettre aux collectivités de mieux contrôler les dynamiques de déploiement sur leur territoire. Il vise à préserver l’indispensable équilibre entre les acteurs grâce à plusieurs propositions importantes rappelées avant moi. Pour ma part, je souhaite m’attarder sur deux de ces dispositions, prévues aux articles 4 et 5, qui rendent opposables les engagements des opérateurs en instaurant des sanctions.
Ce mécanisme est au cœur du texte et en constitue à mes yeux un des apports principaux : il complète l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques tel qu’institué par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique grâce à un amendement du groupe socialiste et républicain. Il confie à l’ARCEP le soin de contrôler le respect du calendrier de déploiement et de veiller au respect de la répartition entre opérateurs et collectivités tel qu’établie par la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques. La sanction comportant toujours un effet de dissuasion, le texte prévoit que l’ARCEP pourra désormais être susceptible de prononcer une sanction pécuniaire à l’égard d’un opérateur fautif.
Autre sujet d’importance à mes yeux, et qui doit contribuer à encourager le passage du cuivre à la fibre : il était impératif de définir les modalités d’octroi du statut de zone fibrée et d’en définir plus précisément les contours. En consolidant la compétence de l’ARCEP en la matière, le texte répond à une revendication des collectivités et précise les conditions de rachat des infrastructures cuivrées.
À ce stade de la discussion, vous l’aurez compris, notre groupe votera ce texte.

Toutefois, je souhaite faire quelques observations pour conclure, en forme de points de vigilance. Certaines de ces observations, que je vous adresse tout particulièrement, monsieur le secrétaire d’État, font écho à des interrogations que vous avez pu entendre lors de votre récente audition par notre commission.
D’abord, concernant la zone d’initiative publique, face à la volonté exprimée par certains opérateurs de contribuer dans une plus grande proportion aux déploiements inscrits dans le cadre de l’AMII de 2011, j’estime, comme le fait d’ailleurs l’ARCEP, qu’il y aurait tout à gagner à réattribuer une partie des zones AMII selon un ciblage et des critères précis. Cette démarche pragmatique permettrait, outre le fait de parer à certaines insuffisances chroniques et persistantes, d’accélérer le déploiement dans certaines zones sous-équipées.
Ensuite, il est clair que l’objectif de « bon débit pour tous » pour la fin de 2020 ne pourra être atteint qu’en exploitant au maximum les synergies entre les déploiements fixes ou mobiles dans les zones moins denses, c’est-à-dire rurales. Aussi, dans cette optique de complémentarité où le réseau mobile doit jouer toute sa part, je souhaite que vous puissiez affirmer des objectifs précis de couverture à échéance datée.
De même, la définition de critères de priorité les plus ambitieux possible pour inciter les acteurs privés à investir massivement dans les anciennes zones blanches est d’après moi un impératif majeur.
Les maires de nos petites et très petites communes rurales attendent impatiemment vos annonces sur ce sujet. Je vous remercie de leur répondre.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – MM. Jean-Paul Émorine, Alain Fouché et Bruno Sido applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je salue tout d’abord le travail remarquable de l’auteur de cette proposition de loi, notre collègue Patrick Chaize, engagé pour l’aménagement numérique du territoire depuis déjà plusieurs années, ainsi que Marta de Cidrac, rapporteur.
Ce projet d’infrastructure – le très haut débit pour tous – est une révolution technologique et industrielle indispensable pour lutter contre la fracture numérique et permettre le désenclavement de nos territoires ruraux, pour doper leur attractivité et accompagner leur compétitivité.
Aujourd’hui, monsieur le secrétaire d’État, c’est un sénateur plein d’optimisme qui s’adresse à vous. Cet optimisme, vous le devinez, je le dois à la signature le 9 novembre dernier, en votre présence, de la délégation de service public relative à la conception, l’établissement, le financement et l’exploitation du déploiement du réseau très haut débit dans mon département de la Mayenne, par Olivier Richefou, président du département, le président du syndicat mixte Mayenne très haut débit, Stéphane Richard, président d’Orange, et Xavier Niel, président de Free. Cet accord historique permettra à mon département de la Mayenne d’être le premier 100 % fibré en 2021.
Cet accord est historique pour deux raisons : il repose sur une alliance inédite entre deux opérateurs ; il prouve aussi que collectivités territoriales et opérateurs peuvent parfaitement s’entendre pour servir ensemble l’intérêt général.
Cet accord est historique, et je m’en félicite, mais il est une exception dans le paysage national. Et c’est parce que l’intérêt public et les intérêts privés ne convergent pas toujours qu’il est de notre responsabilité aujourd’hui de voter cette proposition de loi ! En effet, chaque mois, chaque semaine, nous apprenons que des réseaux d’initiative publique, ou RIP, voient leur modèle économique fragilisé par le déploiement d’une seconde boucle locale optique mutualisée dans une zone déjà couverte. Ces situations ne peuvent pas être tolérées. Des territoires, des collectivités et des élus attendent que nous agissions.
Personne dans cet hémicycle ne pense que la situation peut rester en l’état. Votre récente audition par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable l’a prouvé, monsieur le secrétaire d’État. Vous avez reconnu, sans difficulté aucune, que certains investissements publics avaient été fragilisés et que cette situation n’avait aucune raison de ne pas se reproduire. Vous avez admis que cette proposition de loi, en dehors de son axe central sur la lutte contre le doublement des réseaux en zone rurale, apporte des précisions utiles.
Alors oui, bien sûr, il faut le reconnaître, des interrogations subsistent, notamment en ce qui concerne le calendrier. Quand faut-il légiférer ? Faut-il attendre la nouvelle réglementation européenne sur le secteur des communications électroniques ? Doit-on transposer la nouvelle réglementation dans ce texte ou ailleurs ?
Toutes ces questions sont légitimes et certaines réponses nous font aujourd’hui défaut. Pour autant, elles restent anecdotiques, dérisoires, par rapport à l’esprit de la loi, si proche des ambitions affichées par le Gouvernement. En effet, depuis son arrivée aux responsabilités, le Gouvernement a fixé un cap. Le déploiement de la fibre est un enjeu prioritaire, et les objectifs sont chiffrés : un accès au numérique avec un bon débit en 2020 et très haut débit en 2022 ; une consolidation du plan France très haut débit avec un financement de 3, 3 milliards d’euros ; ou encore une redéfinition plus juste des « zones blanches ».
Le Gouvernement a donc affiché les ambitions fermes d’une politique publique, et nous sommes aujourd’hui dans l’attente de sa concrétisation.
La proposition de loi de Patrick Chaize, monsieur le secrétaire d’État, vous propose sur un plateau d’argent la mise en œuvre d’une politique publique à laquelle le Gouvernement souscrit. Il me semble donc qu’il serait malvenu de lui réserver le même sort que la proposition de loi Eau et assainissement portée par le Sénat et cassée ensuite par la majorité à l’Assemblée nationale.
Monsieur le secrétaire d’État, nous comptons sur votre soutien pour le vote de ce texte afin de lutter réellement contre la fracture numérique dans nos territoires.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste. – M. Jean-Pierre Decool applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’interviens en complément de notre collègue Joël Guerriau sur cette proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit.
Lancé au début des années 2010, le plan France très haut débit devait ouvrir la voie au droit à la connexion pour tous. Si ce plan a permis de grandes avancées, la France est toujours dans le peloton de queue de l’Europe concernant l’éligibilité des foyers au très haut débit, qu’il soit fixe ou mobile. On dénombre en effet encore des centaines de « zones blanches » où la connexion au réseau de téléphone est limitée, hésitante, voire inexistante et l’accès à internet très difficile.
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes l’affirme : il y a un risque réel d’exclusion à moyen terme de l’accès au très haut débit de certaines zones.
Il y a donc l’internet des villes et l’internet des campagnes. Une telle situation est décevante et doit être évitée par la mise en œuvre de politiques publiques adaptées.
Aujourd’hui, s’il n’y a pas d’internet, il n’y a pas d’économie. À l’heure de la dématérialisation de l’action publique, s’il n’y a pas d’internet, il n’y aura plus d’accès aux services publics. Cela signifie la mort d’un territoire et d’une population.
Ainsi, dans un objectif tant de cohésion que de compétitivité, il devient urgent d’accélérer la couverture numérique en haut débit et très haut débit sur l’ensemble du territoire national. Le réseau ne doit pas se contenter de se développer le long des grands axes de communication, mais il doit s’inviter dans les zones rurales au plus près des habitations. Plus que la couverture du réseau, c’est la proximité des habitations qui est essentielle.
Soit dit par parenthèses, monsieur le secrétaire d’État, ce n’est pas avec la décision sans fondement des 80 kilomètres par heure que vous allez attirer les entreprises sur les routes secondaires ! Au contraire, vous les attirerez sur les axes principaux.
Vifs applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.

Vous le voyez, je ne suis pas le seul à le penser ! Il faut que le Gouvernement nous écoute.
Aucun territoire ne doit être oublié. Le Sénat se doit d’être là pour y veiller. La proposition de la loi de notre collègue Patrick Chaize va dans le bon sens, mais je ne veux pas oublier que, dans la ruralité, les infrastructures de réseaux sont le fait des collectivités et que ces dernières ont avant tout besoin de lisibilité et donc d’une stabilité législative et réglementaire.
Monsieur le secrétaire d’État, vous voudrez bien m’en excuser, je ne pourrai pas être présent pour écouter votre réponse, car je dois participer à une commission, mais, bien entendu, je la lirai volontiers.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voudrais à mon tour, comme l’ont fait mes collègues, saluer notre éminent collègue Patrick Chaize, qui nous parle sans arrêt du numérique. Cette proposition de loi se situe dans la droite ligne de la volonté politique affichée de couvrir la population en haut débit d’ici à 2020 et en très haut débit d’ici à 2022. Elle a aussi pour objectif d’accompagner et de sécuriser les investissements publics et privés en levant un maximum de difficultés opérationnelles. Concrètement, pour les collectivités, il s’agit de leur donner les moyens de lutter contre les tentatives potentielles de déstabilisation de l’économie de leurs réseaux et d’envisager un cadre d’engagement ferme de la part des opérateurs en rationalisant les permissions de voirie et en mettant en place les mécanismes de sanction indispensables.
J’insisterai, mes chers collègues, sur trois points qui me paraissent essentiels.
Le premier est la sécurisation des investissements. Nous avons tous en effet à l’esprit les velléités de certains opérateurs privés de déployer de la fibre optique dans des zones les moins denses, alors que la plupart des réseaux d’initiative publique sont déjà lancés ; le tout enrobé de garanties floues sur l’aménagement du territoire. Or il est primordial pour les territoires de sécuriser tout cela, en préservant bien évidemment le principe constitutionnel de liberté d’entreprendre, mais cela ne doit pas se faire au détriment de ces mêmes territoires.
Pour mémoire, ces réseaux de collectivités doivent couvrir en très haut débit 43 % de la population dans des zones où la carence des opérateurs privés a expressément été actée. Il s’agit de zones qu’ils n’ont pas voulu fibrer eux-mêmes en 2011 !
Ne soyons pas naïfs : l’action du privé, nécessairement guidé par la rentabilité, conduirait indubitablement à prioriser les investissements et à générer une nouvelle fracture numérique, en termes d’égalité de services et de délais, dans les territoires ruraux. Or nous ne pouvons pas prendre le risque de voir s’opérer un mitage du territoire.
L’avis rendu le 23 octobre dernier par le régulateur des télécoms, l’ARCEP, à la suite de la saisine du Sénat, est notamment très clair sur ce point en ce qu’il défend le principe de mutualisation en vue d’éviter la duplication des réseaux.
Le deuxième point porte sur la nécessité d’un cadre contraignant des engagements existants ou en projet en termes de péréquation, de complétude et de calendrier, assorti d’un mécanisme de sanction clairement établi.
L’objectif est simple : il s’agit d’un partage de responsabilités entre opérateurs privés et collectivités territoriales afin que toutes les parties prenantes contribuent à l’objectif du très haut débit pour tous en 2022.
Le cadre se devait d’être précisé, et ce sans fragiliser les initiatives existantes. Il est dès lors nécessaire que les engagements pris puissent être juridiquement opposables comme le prévoit cette proposition de loi.
Le troisième point concerne la facilitation de l’aménagement numérique du territoire que propose ce texte.
Toutes les mesures envisagées en termes d’encouragement et de soutien au déploiement, à la fois pour les réseaux fixes et mobiles, se doivent d’être soutenues activement pour que l’accès au numérique devienne une réalité pour tous et que cesse l’insatisfaction prégnante des utilisateurs.
Nous attendons beaucoup des mesures de simplification administratives en matière d’urbanisme et du plafonnement de l’IFER, qui, en l’état, se révèle un véritable frein aux initiatives de couverture.
J’insisterai enfin particulièrement sur la nécessité du basculement du cuivre vers la fibre, dont la facilitation est envisagée à l’article 8. À l’heure où l’objectif est bien l’entrée dans une société du gigabit dès 2025, cette bascule est nécessaire si nous voulons profiter pleinement des promesses technologiques induites. Je pense évidemment aux services de télémédecine, qui ne seront efficaces qu’avec la technologie fibre.
Pour conclure, et puisque cette proposition de loi a été votée à l’unanimité de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, je m’adresserai plus particulièrement à vous, monsieur le secrétaire d’État.
Vous avez effectivement acté un changement de paradigme – c’est le mot à la mode – en ce domaine lors de votre récente audition du 14 février dernier devant notre commission. Nous voici donc sur le point de rendre cela effectif : soyons audacieux sur l’importante question que constitue l’urgence à réduire la fracture numérique de façon pragmatique. Ne pas accepter cette proposition de loi pénaliserait une fois de plus nos territoires et montrerait vos trop nombreuses tergiversations.
À ce titre, au groupe Les Républicains du Sénat, nous soutenons et voterons cette proposition de loi dès aujourd’hui, car il est d’une impérieuse nécessité à la fois de redonner une stabilité au secteur en préservant un équilibre entre tous les acteurs, de même que d’offrir l’environnement réglementaire et concurrentiel adéquat en ce domaine.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, depuis le plan France très haut débit, nous notons année après année une succession d’appels à projets destinés à l’aménagement numérique et téléphonique de nos territoires.
Je salue bien évidemment les annonces du 14 décembre renforçant le niveau des investissements, ainsi que l’accord du 14 janvier rendant opposables des engagements des opérateurs à des exigences d’aménagement du territoire. Plus que jamais, il est nécessaire de réguler et d’encadrer ces investissements, d’autant qu’ils se déroulent dans un temps particulièrement contraint. Je salue de ce fait l’initiative de notre collègue Patrick Chaize de réaffirmer le rôle central des RIP, de protéger leurs positions dans un secteur mouvant.
Cette proposition de loi témoigne d’une prise de conscience, partagée sur toutes nos travées, que les collectivités locales ont un intérêt stratégique à maîtriser leurs infrastructures. Je suis à ce titre attentif à ce que les opérateurs de RIP ne puissent être soumis à l’IFER, ce qui serait un signal étrange à leur endroit.
Je salue également la réaffirmation du rôle de l’ARCEP. Nous devrons sans doute veiller, chers collègues, lors des discussions budgétaires, à ce qu’elle dispose de moyens suffisants pour accomplir sa tâche.
Mon intervention s’attachera plus précisément à la transition entre les différents projets et la définition des priorités d’action.
Je crois utile de rappeler que la redéfinition des cartes de couverture, issue de la loi Montagne, a été à ce titre déterminante, mais elle n’est pas prescriptive pour déterminer les priorités d’intervention. Je pense que le Sénat pourrait utilement donner quelques indications majeures sur celles-ci, mais, surtout, sur la communication essentielle et continue avec tous les élus.
Premier point, mes chers collègues : nous ne sommes pas sur un terrain totalement vierge. Des projets sont en cours, y compris dans les RIP, et il appartient de donner des perspectives aux projets publics existants, qui craignent – et on les comprend – d’être fortement concurrencés. Je pense aux contrats existants comme celui du syndicat mixte ouvert PACA très haut débit. Il est donc absolument nécessaire de sécuriser, y compris financièrement, les projets en cours. La fermeture du guichet du Fonds national pour la société numérique est source d’inquiétude pour les porteurs de projets anciens, dont le premier plan quinquennal a été acté. Ceux-ci ne disposent pas en effet d’une visibilité financière suffisante, alors qu’ils ont des contrats d’affermage de quinze ans.
Par ailleurs, si ce texte formule des propositions intéressantes pour éviter des doublons inutiles, il apparaît bien nécessaire de prévenir ceux qui pourraient exister non pas entre les RIP et les opérateurs privés, mais bien entre les opérateurs privés eux-mêmes. Ces batailles font perdre du temps et de l’argent.
Deuxième point : veillons à être pleinement acteurs de la priorisation des investissements, y compris en zones très peu denses. Élu de montagne, j’y suis évidemment très sensible.
À cela s’ajoute une autre caractéristique : la possibilité donnée par la loi Montagne de proposer d’autres infrastructures. C’est pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, je souhaite que nous identifiions dès maintenant avec les élus de montagne les endroits où les technologies alternatives pourraient être en priorité déployées ou non et leur articulation avec d’autres choix technologiques, y compris avec un lissage dans le temps.
Autre remarque, et non la moindre : ces investissements attendus dans nos territoires vont s’accompagner vraisemblablement d’une autre concurrence, celle de la main-d’œuvre. Je rappelle que l’observatoire des RIP avait noté une augmentation des effectifs entre 2012 et 2016 de l’ordre de 200 %. L’observatoire indique également qu’il faudrait former 40 000 personnes sur l’ensemble du territoire à l’horizon de 2020, dont près de 20 000 uniquement sur les RIP. Des accords de formations ciblés doivent à mon sens être pris dès à présent, en veillant à la répartition géographique.
Dernier élément et non le moindre : ce service public local, qui est en train de se mettre en place, ne pourra exister sans un plan des usages du numérique. J’ai eu l’occasion de vous remettre, monsieur le secrétaire d’État, des propositions relatives aux maisons de services au public. Je plaide en effet pour que l’accès aux infrastructures numériques s’accompagne notamment de la présence dans les mairies et maisons de services au public de personnels et d’équipements qui permettent d’aller vers ce changement sociétal majeur. Ces infrastructures, mes chers collègues, sont des moyens, jamais des fins.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, c’est avec satisfaction que je m’exprime aujourd’hui devant vous.
Cette satisfaction, c’est d’abord celle d’un élu local : maire de Montmorillon et président de communauté de communes pendant dix ans, j’ai pu constater à quel point la pénétration des nouvelles technologies de l’information et de la communication est un travail de longue haleine. Dans mon département de la Vienne, les deux pôles urbains, Poitiers et Châtellerault, développent la fibre, mais pour le reste du territoire, le très haut débit est encore un espoir trop lointain. C’est pourquoi cette satisfaction, c’est aussi celle du jeune parlementaire – tout est relatif
Sourires.

Pour ceux qui en douteraient encore, toute la logique du texte, ou au moins son postulat de départ, c’est la nécessité de favoriser « le déploiement d’une seule boucle locale optique mutualisée, ou BLOM, dans les zones moins denses ». Dit plus simplement, il s’agit de protéger les réseaux publics installés en zone rurale d’une concurrence privée à laquelle ils ne survivraient pas. Je ne m’attarderai pas sur la nécessité de cette protection, mais je crois utile de rappeler quelques principes, la répétition étant la meilleure pédagogie.
Les réseaux d’initiative publique ne se sont pas faits en un jour. Nous devons leur existence à la loi du 21 mai 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, qui donna enfin aux collectivités territoriales une compétence en matière d’aménagement numérique.
Toutefois, pour créer un réseau, il ne faut pas simplement en avoir le droit. Il faut constater une insuffisance d’initiatives privées par l’intermédiaire d’un appel d’offres déclaré infructueux, il faut garantir l’utilisation partagée des infrastructures, il faut respecter le principe d’égalité et de libre concurrence, tout cela dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées. Il faut bien sûr respecter l’ensemble des droits et obligations régissant l’activité d’opérateur de télécommunications, notamment la séparation avec l’entité chargée de l’octroi des droits de passage. Enfin, il faut remplir toutes les obligations relatives au régime de subvention.
Parmi toutes ces règles, il faut rappeler que la création d’un réseau public est subordonnée à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales : « L’insuffisance d’initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d’intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins […] des utilisateurs… » Autrement dit, les réseaux d’initiative publique doivent leur existence à l’inexistence de l’offre privée. Pour cette raison, et je pourrais dire pour cette unique raison, il est essentiel que nous protégions les collectivités et toutes les formes juridiques sui generis qui ont souhaité investir. Ce sont ces investissements qui assurent l’égalité entre nos concitoyens.
Pour être complet, j’ajoute que cette proposition de loi ne protège pas uniquement les investissements des collectivités territoriales, elle protège également les investissements de l’État, puisque celui-ci a aussi mis la main à la poche. Il faut rappeler que, sur les 6, 5 milliards d’euros de subventions publiques destinées aux réseaux d’initiative publique, 3, 3 milliards d’euros proviennent de subventions de l’État, selon les chiffres de 2017. Il serait donc étonnant que l’État donne d’une main des financements et que, de l’autre, il ne crée pas les conditions législatives pour les sécuriser.
Il est donc impératif que le législateur se saisisse de la question et donne enfin à l’ARCEP les moyens de réguler l’offre en infrastructures dans les zones les plus fragiles. Nous ne pouvons pas abandonner des territoires, des collectivités et des élus qui se battent depuis des années pour résorber la fracture numérique au moment critique où nous apprenons que certains opérateurs veulent concurrencer les RIP là où il y a le plus de prises raccordables.
Je profite de cette intervention pour faire amende honorable auprès de l’auteur de la proposition de loi, Patrick Chaize, et de la rapporteur, Marta de Cidrac : le temps dont je dispose ne me permet pas d’évoquer l’ensemble des dispositions de cette riche proposition de loi ni même les nombreux ajouts de notre rapporteur en commission – beaucoup, d’ailleurs, a déjà été dit –, mais je sais que notre assemblée aujourd’hui réunie ne doute ni de leur compétence ni de leur volontarisme. Devant le retard désolant de notre pays, au seizième rang en Europe pour l’accès au numérique, cette initiative contribuera assurément à redorer le blason de la France, pour le développement de tous les territoires au service de l’ensemble de nos concitoyens.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à insister sur un premier point : l’urgence est là, et l’impatience, nous la partageons. Depuis ma nomination à ce poste voilà huit mois, je peux vous dire que, sur le haut de la pile des nombreux dossiers que nous avons à traiter avec Jacques Mézard, le numérique est certainement celui qui a la plus grande priorité. Toutes celles et tous ceux avec lesquels nous travaillons au quotidien peuvent en témoigner.
Au-delà de cette détermination, comme l’a dit M. le sénateur Fouché, une approche vraiment différente a été opérée dans la gestion du dossier du numérique. Je ne citerai qu’un exemple : l’accord du mois de janvier que nous avons scellé avec les opérateurs part pour la première fois du principe selon lequel les enchères en matière de téléphonie auront un enjeu non pas budgétaire, mais lié à l’aménagement du territoire. C’est une modification majeure dans la gestion de ce dossier.
Cela fait des années que les accords s’enchaînent sans qu’on réfléchisse au moyen de rendre les engagements des différents opérateurs contraignants. Ces nouvelles obligations seront transcrites dans les autorisations d’utilisation de fréquences des opérateurs. J’y insiste, car c’est l’une des preuves, parmi bien d’autres, qui montrent que nous essayons d’agir différemment pour aller plus vite.
Comment fait-on pour aller plus vite ? Nous n’avons pas de baguette magique, mais nous disposons de trois moyens d’action.
Le premier, c’est l’augmentation des investissements, qu’il s’agisse de l’argent public de l’État et des collectivités ou de l’argent des investisseurs privés. On évoquait tout à l’heure un certain nombre de déclarations tonitruantes émanant d’opérateurs. Il faut les canaliser, les encadrer, mais il faut aussi se féliciter de la volonté de ces opérateurs d’injecter de l’argent dans le déploiement du numérique.
Le deuxième moyen, c’est la transparence. Monsieur le président de la commission, je viendrais avec plaisir, je m’y engage, tous les six mois ou au rythme que vous déciderez, vous tenir informés de l’ensemble de ces engagements. Ces engagements seront également rendus publics via les observatoires que j’évoquais précédemment.
La transparence est essentielle. Il n’est pas possible de dire que 98, 8 % de la population est bien couverte en téléphonie mobile, alors que, lorsque vous les rencontrez, nos concitoyens se plaignent d’une mauvaise réception.
Enfin, le troisième moyen, essentiel à mes yeux – c’est tout l’enjeu de la proposition de loi –, c’est de faire en sorte que les engagements soient contraignants et non pas de simples promesses qu’on ferait la main sur le cœur. Il existe trois cas de figure différents.
Le premier, ce sont les réseaux d’initiative publique. Les RIP présentent l’avantage d’être des engagements contractuels. Si un opérateur ne donne pas satisfaction, il encourt des pénalités.
Le deuxième cas de figure est celui des zones urbaines très denses, c’est-à-dire des grandes villes. Là, il n’est pas nécessaire de prévoir des engagements contraignants, car c’est tellement rentable que tout le monde se jette dessus.
Enfin, la zone AMII, que nombre d’entre vous ont mentionnée, pose un vrai problème. Jusqu’à présent, il y avait des desiderata, des engagements, mais sans force contraignante. Depuis plusieurs mois, nous discutons avec les opérateurs pour que les engagements, y compris passés, puissent être contraignants, en utilisant l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques. Comme je l’ai déjà indiqué, nous sommes dans la phase finale des discussions. Les propositions des opérateurs sont envoyées en ce moment à l’ARCEP, qui prendra une position dans une quinzaine de jours, et seront ensuite rendues totalement publiques. Il est essentiel d’envisager les cas les uns après les autres pour voir comment tous ces engagements peuvent être contraignants.
Encore une fois, pour aller plus vite, il n’y a que trois possibilités : l’investissement, le choc de transparence, et, enfin, des engagements contraignants, car c’en est fini de la bonne foi ; il faut vraiment que chacun assume ses responsabilités jusqu’au bout.

La discussion générale est close.
Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je vous rappelle que je dois suspendre la séance dans cinquante minutes. Si nous n’avons pas achevé l’examen de ce texte d’ici à dix-sept heures, nous devrons reprendre nos travaux à vingt et une heures.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
TITRE Ier
SÉCURISATION DES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS OU PROJETÉS DANS LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Le I de l’article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le d est complété par les mots : « et les modalités de prise en compte de l’existence ou de l’établissement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont considérés comme projetés au sens du d du présent I les établissements de lignes figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L. 33-13. »

Je profite de la discussion de ce texte pour rappeler que le cadre du déploiement des réseaux en fibre optique, qui a été posé dans notre pays voilà sept ans, a laissé aux opérateurs, cela a été dit, le choix d’investir dans les zones correspondant à leurs critères de rentabilité, les fameuses zones AMII. De fait, on n’a pas considéré la couverture numérique comme une véritable mission de service public à remplir par les opérateurs. La couverture du reste des territoires, c’est-à-dire des zones peu rentables, car moins denses – vous aurez reconnu les zones rurales –, a été laissée à l’initiative publique via les réseaux d’initiative publique, les RIP.
Ce choix politique continue de porter préjudice à une part très importante de nos territoires et des citoyens qui y habitent. Malgré tout, les collectivités hors zones AMII l’assument, à travers des investissements très importants pour apporter la couverture du réseau de fibre optique à domicile à tous leurs administrés.
Dans mon département, l’Ariège, que vous avez visité il y a quelques jours, monsieur le secrétaire d’État, le coût du chantier de déploiement du réseau de très haut débit pour ce projet de RIP est estimé à 120 millions d’euros. Le département, à lui seul, s’apprête à rembourser 1 million d’euros par an pendant vingt-trois ans.
Pourtant, aucune mesure contraignante ne permet aujourd’hui d’éviter le déploiement d’un réseau concurrent à un RIP. Si la sécurité des investissements publics venait à être remise en cause par l’ouverture d’investissements privés dans des zones préalablement laissées au RIP, cela constituerait une double peine.
Je tiens dès lors à profiter de cette prise de parole pour saluer l’esprit de cette proposition de loi portée par notre collègue Patrick Chaize : permettre le maintien d’un équilibre entre tous les acteurs du secteur, mieux contrôler le déploiement sur nos territoires et permettre la réalisation des réseaux dont nos administrés ont tant besoin.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains.

L’amendement n° 15, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer la référence :
L. 33-13
par la référence :
L. 33-14
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 6, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et ceux figurant dans les plans de déploiement décrits dans les conventions conclues entre un opérateur et une ou plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, pour autant que ces conventions prévoient le prononcé de sanctions en cas de non-respect de ses engagements par ledit opérateur
La parole est à M. Alain Schmitz.

Cet amendement tend à compléter le dispositif proposé au 1° de l’article 1er, dont l’objet est de limiter la superposition inorganisée de réseaux de fibre optique.
Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 4 de l’article 1er de la proposition de loi ne vise, par renvoi à l’article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques, que les engagements de déploiement souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques après avis de l’ARCEP. Se trouvent de facto exclus les déploiements auxquels, dans des cadres juridiques divers, des opérateurs se sont engagés directement auprès de collectivités territoriales, alors même que ces engagements sont assortis de sanctions en cas de non-respect.
Il apparaît nécessaire d’inclure ces engagements, et ce pour trois raisons.
La première est de ne pas défavoriser les opérateurs qui ont fait l’effort de s’engager localement, là où leurs concurrents avaient jusqu’alors délaissé des zones par nature peu denses et donc peu rentables ; mécaniquement, ne pas tenir compte de ces engagements placerait les opérateurs ayant pris des engagements au titre de l’article L. 33-13 du code des postes et communications électroniques dans une situation injustement et, selon nous, illégalement protectrice au regard du droit de la concurrence, puisque la loi organiserait ainsi un marché asymétriquement régulé.
La deuxième raison est d’assurer une prise en compte des actions menées par les collectivités territoriales au titre de leurs compétences en matière d’aménagement numérique des territoires, ce que traduisent ces conventions locales d’engagement de déploiement.
Enfin, la troisième raison est de rendre ces conventions locales opposables au titre du 1° de l’article 1er de la proposition de loi, ce qui évitera la redondance de réseaux sur les zones considérées et incitera par là même les opérateurs à adresser des zones dépourvues de tout engagement de déploiement, favorisant ainsi une couverture plus rapide de l’ensemble de notre territoire national.

Cet amendement vise à mentionner à l’article 1er les conventions conclues entre collectivités territoriales et opérateurs pour les déploiements du réseau en fibre optique.
En réalité, l’article 1er se borne à renvoyer à la liste créée par l’article 2 et qui a vocation à être un document intégrateur. L’amendement de coordination que nous venons d’adopter permet d’éviter tout malentendu à ce titre, en faisant référence au nouvel article L. 33-14 du code des postes et des communications électroniques, et non à l’article L. 33-13. Le présent amendement n’est donc pas nécessaire.
La question du périmètre de la liste sera, quant à elle, examinée lorsque nous en viendrons à l’article 2, qui fait l’objet de plusieurs propositions d’amendements, notamment de la part de notre collègue Alain Schmitz. Nous suggérons donc le retrait de cet amendement.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, pour une raison différente de celle de la commission : cet amendement va dépendre des articles 20 à 22 du code européen, qui est en cours d’élaboration.
En outre, j’y insiste, à la fin des fins, l’acteur décisionnaire reste le donneur d’ordre, à savoir la collectivité. Si notre action vise à faire en sorte que tout se passe bien, n’oublions pas de toujours remettre la collectivité au centre du dispositif.

Compte tenu de ce que vient de dire M. le secrétaire d’État et de ce qu’a proposé Mme la rapporteur, je le retire, monsieur le président.
L ’ article 1 er est adopté.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par Mmes Dindar et Malet et MM. Dennemont et Lagourgue, est ainsi libellé :
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La continuité numérique territoriale est un principe de service public destiné à assurer une qualité et un coût des communications électroniques dans les départements d’outre-mer au moins équivalent à ceux proposés dans la moyenne des départements métropolitains. Ce principe est assuré par la compensation des handicaps dus aux surcoûts liés à l’éloignement ou à l’étroitesse des marchés, ainsi que par toute mesure législative ou réglementaire visant à assurer des conditions loyales de concurrence. Il est motivé par le respect du principe d’égalité entre tous les citoyens français, mais également par l’objectif de développement économique par les services liés aux technologies de l’information et de la communication.
La parole est à Mme Viviane Malet.

Cet amendement, initialement déposé par la sénatrice de La Réunion, Nassimah Dindar, retenue cet après-midi par un rendez-vous à l’extérieur, est de bon sens, puisqu’il prévoit d’imposer par tous les moyens le principe de la continuité numérique entre la France métropolitaine et les départements d’outre-mer, non seulement pour des questions d’égalité de traitement, mais également pour des impératifs de développement économique.
La continuité numérique territoriale est un principe de service public destiné à assurer une qualité et un coût des communications électroniques dans les départements d’outre-mer au moins équivalents à ceux qui sont proposés dans la moyenne des départements métropolitains. Or, dans les départements d’outre-mer, le rapport qualité-prix de l’internet est inférieur à celui de la France métropolitaine. Pourtant, il n’existe techniquement aucune raison à cet état de fait.
À titre d’exemple, une rapide recherche sur des offres en fibre du plus grand opérateur français, Orange, nous montre une différence de 30 % en moyenne : les trois principales offres mensuelles en métropole s’élèvent à 42 euros, 48 euros et 56 euros, alors que les trois principales offres à La Réunion sont, par mois, de 55 euros, 65 euros et 75 euros. Pourquoi, monsieur le secrétaire d’État, une telle disparité entre la métropole et La Réunion ? Je compte sur votre sens de l’équité pour remédier à cet état de fait.

Cet amendement définit un principe général de continuité numérique territoriale en faveur des outre-mer, pour assurer une qualité et un coût des communications électroniques dans les départements d’outre-mer au moins équivalents à ceux qui sont proposés dans la moyenne des départements métropolitains.
Bien sûr, nous partageons les préoccupations et les objectifs de notre collègue. Toutefois, la formulation très générale de l’amendement nous paraît peu opérationnelle et crée de réelles incertitudes sur sa portée exacte. Compte tenu de sa formulation, nous l’avons lu davantage comme un amendement d’appel. À ce titre, nous en suggérons le retrait.
Le Gouvernement a le même avis que la commission.
J’en profite pour vous dire que la mobilisation du Gouvernement, à travers le plan France très haut débit, en faveur des outre-mer est très forte. Plus de 150 millions d’euros ont été engagés ou sont sur le point de l’être – 40 millions d’euros sont en cours de finalisation avec la Guyane. En outre, beaucoup d’autres actions sont entreprises, qui ne sont pas d’ordre financier.
Je reviens de Saint-Martin – j’ai atterri il y a quelques heures –, où j’ai travaillé à la remise en état des réseaux numériques et de téléphonie mobile. Sur l’île, il y a par exemple la problématique des nouvelles fréquences pour les boucles locales radio que l’ARCEP vient d’octroyer. Comme vous le voyez, la mobilisation du Gouvernement est totale.

Pour soutenir cet amendement, j’aimerais apporter un témoignage très bref.
Lorsque M. le secrétaire d’État affirme la mobilisation du Gouvernement, je veux bien le croire. Reste que la Guadeloupe – c’est vrai aussi pour Saint-Martin, La Réunion et Saint-Barthélemy – a dû investir à l’époque 30 millions d’euros, avec très peu d’aides de l’État et de l’Europe, pour être reliée à Porto Rico, à Miami et à l’Europe. Elle a ensuite dû faire la même chose pour être reliée au plateau des Guyanes, en Amérique latine. Une branching unit a permis de réaliser la liaison entre Saint-Martin et Porto Rico, qui a coûté 1 million d’euros à la collectivité.
Aujourd’hui, il n’y a pas d’égalité numérique dans les outre-mer. Je prendrai un seul exemple : après la liaison maritime, la couverture terrestre en fibre optique coûte maintenant 183 millions d’euros en deux tranches. Or l’État n’a donné que 19 millions, tout comme l’Europe. Il faut trouver le reste !
Il faut véritablement répondre, peut-être par une autre rédaction, à cette demande de continuité numérique, qui correspond à un besoin de services publics.
M. Marc Daunis et Mme Nelly Tocqueville applaudissent.

Nous proposerons une prochaine fois cet amendement, modifié, mais pour l’heure nous le retirons.
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 33-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 33 -14. – Le ministre chargé des communications électroniques arrête, au vu d’un recensement des engagements pris par les opérateurs sur la base de consultations formelles établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, la liste des opérateurs ainsi que des collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales autorités organisatrices du service public local des communications électroniques mentionné à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales qui, sur le territoire de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont en charge l’établissement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, au point de mutualisation et en aval du point de mutualisation, permettant de desservir les utilisateurs finals.
« Les zones très denses identifiées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 38-4-3 du présent code ne sont pas prises en compte dans la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
« La liste mentionnée au même premier alinéa précise le calendrier prévisionnel du déploiement des lignes dont l’établissement n’est pas achevé sur la base des engagements souscrits par les opérateurs auprès du ministre chargé des communications électroniques en application de l’article L. 33-13 du présent code et des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ou, à défaut et le cas échéant, des projets déposés dans le cadre du plan “France très haut débit”.
« Le projet de liste mentionnée au premier alinéa du présent article est soumis pour avis à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L’avis de l’autorité est rendu public et la liste ne peut être arrêtée par le ministre chargé des communications électroniques avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de cette publication.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes contrôle le respect du calendrier de déploiement fixé par la liste mentionnée au même premier alinéa ainsi que de la répartition entre opérateurs et collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales qui en découle. Elle peut être saisie et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36-11. Le fait, pour un opérateur, de procéder à un déploiement sur le territoire d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont a la charge une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales en application de la liste mentionnée au premier alinéa du présent article, sans l’accord de cette collectivité ou de ce groupement, est assimilé à un manquement au sens du présent article. »

Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par M. Lafon, Mme Dindar, MM. Kern, Luche, Détraigne et Laugier, Mmes Billon et Vullien, MM. Bonnecarrère, Cigolotti et Médevielle, Mmes Gatel et Létard et M. Canevet.
L’amendement n° 13 est présenté par M. Lalande.
L’amendement n° 14 est présenté par Mme Procaccia.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Après le mot :
denses
insérer les mots :
hors les poches de basse densité,
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

L’article 2 exclut les zones denses, ce qui est logique – c’est le cœur de la proposition de loi. Néanmoins, dans ces zones, certaines situations sont parfois hétérogènes, comme l’a reconnu l’ARCEP, qui a introduit la notion de « poches de basse densité » : ce sont des territoires défavorisés même s’ils se situent à proximité de zones denses.
Cet amendement de précision vise bien à exclure les zones denses sans pénaliser les poches de basse densité.

Cet amendement a été excellemment défendu par notre collègue Lafon.
L’exclusion des zones denses à l’article 2 met en difficulté certains territoires. C’est pourquoi il nous semble opportun, à l’alinéa 3, d’insérer les mots : « hors les poches de basse densité ». Cette précision permettrait une couverture du territoire égalitaire, notamment pour ceux qui vivent dans des zones défavorisées en dépit d’un tissu dense à proximité.

L’amendement n° 14, présenté par Mme Procaccia, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission ?

Ces amendements identiques visent à intégrer « les poches de basse densité » au recensement proposé par l’article 2. Pour rappel, ce terme désigne certaines parties des zones très denses qui appellent une mutualisation accrue du réseau local en fibre optique.
En commission, nous avions exclu les zones très denses du dispositif dès lors qu’y prévaut un principe de concurrence par les infrastructures. Toutefois, nous avions relevé dans notre rapport que la question de ces poches de basse densité devrait faire l’objet d’un traitement spécifique. En ce sens, nous partageons complètement les préoccupations exprimées par nos différents collègues : dès lors que la réglementation des déploiements dans ces territoires tend à s’aligner sur celle des zones moins denses, prévoir leur intégration dans la liste nous semble pertinent.
C’est pourquoi nous émettons un avis favorable sur ces amendements.
Ces amendements vont dépendre, là aussi, des articles 20 à 22 du futur code européen des communications électroniques. Je ne peux donc me prononcer favorablement sur ces mesures.
Reste que le traitement de ces poches au sein des zones denses mérite une réflexion. Je m’engage, au nom de Delphine Gény-Stephann, qui mène les négociations, à ce que ce point soit abordé dans le cadre de la révision du code européen.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat sur ces amendements.
Marques de satisfaction et applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Les amendements sont adoptés.

Je constate que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 8 est présenté par M. Schmitz.
L’amendement n° 17 est présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 3
Remplacer la référence :
L. 38-4-3
par la référence :
L. 34-8-3
La parole est à M. Alain Schmitz, pour présenter l’amendement n° 8.
Les amendements sont adoptés.

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
territoriales
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, des projets déposés dans le cadre du plan « France très haut débit », et, le cas échéant, des conventions conclues par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour l’établissement de lignes en fibre optique assorties de sanctions.
La parole est à M. Alain Schmitz.

Cet amendement vient compléter le dispositif proposé par l’amendement à l’article 1er, en prévoyant la prise en compte des engagements de déploiement souscrits par les conventions conclues entre les collectivités territoriales et leurs prestataires pour l’établissement des recensements et de la liste dressée sous l’autorité du ministre des communications électroniques et destinée à rationaliser l’établissement de réseaux en fibre optique sur l’ensemble des zones du territoire national.
Ignorer les initiatives locales engageantes des opérateurs porterait atteinte à l’exhaustivité et à la pertinence de cette liste.

Cet amendement vise à ajouter la contractualisation locale menée par les collectivités territoriales aux sources d’informations pour constituer la liste permettant d’identifier les calendriers de déploiement de la fibre optique.
Cela peut effectivement être pertinent pour être pleinement exhaustif dans l’élaboration de la liste prévue à l’article 2. En effet, les conventions de type « délégation de service public » constituent souvent les documents les plus précis quant au calendrier du déploiement, en comprenant les différentes phases de déploiement du réseau d’initiative publique.
En conséquence, la commission a émis un avis favorable.
M. Julien Denormandie, secrétaire d ’ État. J’ai un avis défavorable.
Oh ! sur des travées du groupe Les Républicains.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 2 est adopté.
Au dernier alinéa de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, après le mot : « déploiements », sont insérés les mots : «, l’optimisation de l’utilisation des infrastructures existantes ou projetées ». –
Adopté.
Après l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 34-8-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34 -8 -3 -1. – L’opérateur qui fournit l’accès à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final, ou l’utilisateur final, ne peut percevoir aucune aide, subvention ou concours financier de quelque nature que ce soit, direct ou indirect, d’une personne publique, sauf au titre de la compensation d’obligations de service public, au titre d’une politique d’action sociale ou lorsque le réseau est établi ou exploité en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales. » –
Adopté.

L’amendement n° 11 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 34-8-4 du code des postes et des communications électroniques, la référence : « L. 45-1 » est remplacée par la référence : « L. 45-9 ».
La parole est à M. Alain Schmitz.

Cet amendement vise à rectifier une erreur rédactionnelle et à prendre en considération la renumérotation des articles L. 45 et suivants issue de l’article 19 de la loi du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 4.
Après le huitième alinéa du III de l’article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, appréciée notamment au regard du nombre de locaux non raccordables ou de zones arrière de points de mutualisation sans complétude de déploiement, sans pouvoir excéder un plafond fixé à 1 500 € par local non raccordable ou 450 000 € par zone arrière de point de mutualisation sans complétude de déploiement, lorsque l’opérateur en cause ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’obligations de déploiement résultant d’un engagement mentionné à l’article L. 33-13 ; ». –
Adopté.
I
II. – L’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a)
b)
c)
2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la délivrance de cette permission est subordonnée à une demande d’accès à des installations existantes ou projetées en application du cinquième alinéa du présent article, ce délai court à compter de la transmission à l’autorité compétente de la réponse du gestionnaire d’infrastructure d’accueil communiquée au demandeur dans les conditions prévues par l’article L. 34-8-2-1. » ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il apparaît que l’occupation du domaine public routier dans les conditions sur la base desquelles a été délivrée une permission de voirie fait techniquement obstacle à l’accueil d’un nouvel opérateur, l’autorité compétente en informe l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui publie cette information et la tient à la disposition du public. Une permission de voirie ne peut alors être délivrée sur la zone concernée qu’après que l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a constaté qu’un bénéficiaire d’une permission de voirie ne s’est pas conformé à une mise en demeure portant sur le respect d’une obligation de déploiement sur cette zone résultant d’un engagement mentionné à l’article L. 33-13 ; la délivrance de cette nouvelle permission de voirie rend alors caduque, en ce qui concerne la même zone, celle initialement accordée. »

À l’occasion de l’examen de cet article, dédié aux conditions matérielles des déploiements des réseaux à très haut débit en fibre optique, je souhaiterais évoquer un sujet connexe que je sais important, à savoir l’adressage. Le recensement des adresses et leur consolidation sont un enjeu majeur pour au moins deux raisons.
D’abord, une étude du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique évalue à près de 0, 5 point de PIB, soit 10 milliards d’euros, la perte sèche annuelle pour l’économie française provenant d’un mauvais référencement des adresses. L’intérêt sécuritaire est également important.
Ensuite, améliorer la connaissance des adresses des Français est essentiel pour optimiser les déploiements des réseaux en fibre optique. Ce sujet soulève trois questions distinctes.
La première est celle du travail d’adressage en lui-même. Il convient de le poursuivre pour résorber les 2, 6 millions d’habitations qui n’ont pas encore d’adresse.
La deuxième question est celle de la consolidation des bases de données entre les acteurs concernés, à savoir La Poste et l’IGN, qui permet de générer les clefs d’interopérabilité.
Nous savons qu’un travail est en cours pour compléter la Base adresse nationale, la BAN, qui compte aujourd’hui 25 millions d’adresses, tandis que La Poste en dénombre 22 millions. Le 15 avril prochain, une nouvelle version de la base adresse sera active et les collectivités territoriales auront la possibilité d’y contribuer.
Enfin, la troisième question est celle de la tarification pour l’accès à ces données, dans le cadre d’une mission d’aménagement numérique des territoires, qui reste à préciser. La Poste peut d’ores et déjà donner une géolocalisation des adresses spécifiquement pour le déploiement de la fibre optique. Dans ce contexte, La Poste doit encore structurer son offre, notamment pour ce qui concerne les modalités techniques et tarifaires d’accès à ces informations pour les opérateurs et les collectivités.
Monsieur le secrétaire d’État, je crois important d’appeler votre attention sur la nécessité de considérer l’adresse comme un bien public tout en prévoyant une juste compensation pour La Poste, avec une prise en compte spécifique de sa mission de service public et des charges qui en résultent au titre de l’adressage. L’accès des porteurs de RIP à ces informations devrait être facilité, au service de l’aménagement numérique des territoires.

L’amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délivrance d’une permission de voirie en vue du déploiement de lignes de communication électroniques à très haut débit en fibre optique mentionnées aux articles L. 33-6 et L. 34-8-3 du présent code peut être suspendue par l’autorité compétente, tant que l’opérateur demandeur n’assure pas la bonne information des collectivités desservies par ces réseaux et des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents au sens des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales, au moyen des consultations préalables aux déploiements ou à leur mise à jour, dans les conditions prévues par les décisions de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en application de l’article L. 34-8-3 du présent code. » ;
La parole est à M. Alain Schmitz.

Cet amendement tend à clarifier et à améliorer la cohérence entre, d’une part, les déploiements projetés d’un opérateur de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et, d’autre part, l’octroi des droits de passage sur le domaine public – ce sujet a été largement évoqué par les différents orateurs.
En application de l’article L. 34-8-3 du code des postes et des communications électroniques, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a mis en place, au travers de ses décisions, un ensemble de consultations préalables obligatoires auxdits déploiements, à destination des acteurs concernés par un projet de déploiement, notamment les collectivités territoriales et leurs groupements.
Ce travail a permis de recueillir les remarques des intéressés, et les opérateurs déployeurs doivent en tenir le plus grand compte.
Il convient néanmoins de constater que, dans la pratique, les collectivités territoriales et leurs groupements concernés sont susceptibles de ne pas recevoir, ou de recevoir trop tardivement, les consultations initiales en question, notamment du fait des filtres mis en œuvre pour la réception des courriers électroniques.
J’ajoute que ces collectivités et leurs groupements ne reçoivent généralement pas le projet définitif issu desdites consultations, pourtant d’importance au titre des politiques publiques de gestion du domaine public et d’urbanisme.
Par ailleurs, par le jeu des transferts de compétences, l’autorité compétente pour accorder le droit de passage peut ne pas être celle compétente au titre des articles L. 1425-1 et L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales. En résulte une contradiction inefficace entre deux politiques publiques complémentaires.
Les autorités chargées de l’octroi ne sont donc pas toujours en mesure, notamment du fait du court délai desdites procédures de consultation préalable, de vérifier la cohérence de ces demandes avec le déploiement projeté.
Les dispositions du présent amendement permettent de s’assurer que les opérateurs déployeurs ont respecté, préalablement aux dépôts des demandes de permission de voirie nécessaires au déploiement projeté de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, leurs obligations relatives aux consultations préalables.
La suspension de la demande encourue par un opérateur apparaît tout à la fois raisonnable et proportionnée, soit parce que l’opérateur sera en mesure d’apporter, à bref délai, la preuve de la parfaite exécution de ses obligations, soit parce que l’opérateur défaillant pourra lancer ou relancer une consultation dont la durée n’apparaît pas comme rendant impossible le déploiement, nonobstant la suspension encourue.

Cet amendement a pour objet de renforcer l’information des collectivités directement concernées par les déploiements de réseaux en fibre optique, préalablement à la délivrance d’une permission de voirie par l’autorité locale compétente en matière d’aménagement numérique.
Le dispositif de cet amendement s’appuie sur les consultations préalables existantes, dont le contenu est précisé par l’ARCEP, et vise à garantir la transparence quant à l’état d’avancement des déploiements dans les territoires.
Ces dispositions vont dans le sens d’une plus grande cohérence des déploiements dans les territoires et d’une meilleure gestion du domaine public. Aussi, la commission a émis un avis favorable.
Je comprends complètement l’intention de cet amendement. Il convient effectivement de procéder dans le bon ordre, en tenant compte de l’ensemble des consultations. Toutefois, divers délais de réalisation se révèlent aujourd’hui de plus en plus longs. Or ces dispositions risquent d’accroître encore un certain nombre d’entre eux.
Pour cette raison, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 6 est adopté.

L’amendement n° 1 rectifié bis, présenté par Mme Vermeillet, MM. Longeot, Lafon, Détraigne, D. Dubois, Luche, Cigolotti et Médevielle, Mme Doineau, MM. Delcros et Vanlerenberghe et Mmes Gatel et Létard, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le IV de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du présent article, les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent financer toute opération d’investissement pour l’établissement et l’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques en application de l’article L. 1425-1 du présent code. Ce financement est encadré par les modalités prévues au V de l’article L. 5214-16, à l’article L. 5215-26 et au VI de l’article L. 5216-5. »
La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux communes membres d’EPCI non maîtres d’ouvrage de cofinancer les opérations de déploiement de réseau numérique dans lesquelles s’engagent financièrement ces derniers selon les modalités prévues par les fonds de concours.
Dans le cadre du déploiement de certains réseaux départementaux de très haut débit, des conventions de partenariat sont passées entre les départements, maîtres d’ouvrage, et les EPCI du territoire.
En l’état actuel de la loi, il est impossible pour le bloc communal, lorsqu’il le souhaite, de mettre en œuvre, entre les communes et les EPCI, un financement permettant de répartir la charge d’investissement que représente le déploiement du nouveau réseau numérique, quand bien même ce partenariat permettrait de sécuriser financièrement et, surtout, d’accélérer le déploiement.
Il va sans dire que les conséquences financières de cet amendement sont neutres pour le bloc communal. En l’occurrence, on se borne à autoriser les communes membres à prendre en charge une partie de la contribution de l’EPCI si elles le souhaitent.
Mes chers collègues, ces dispositions sont soutenues par l’Association des maires de France, et pour cause, elles répondent à une demande exprimée par de nombreuses communes, dans plusieurs départements. Je vous remercie par avance d’y souscrire.

Cet amendement vise à permettre aux communes de contribuer à tout investissement en vue d’établir ou d’exploiter des réseaux de communications électroniques, en application de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, via le mécanisme des fonds de concours intercommunaux.
Il s’agit ainsi de résoudre une difficulté technique, qui fait actuellement obstacle à certains schémas de financement entre différentes collectivités territoriales pour établir des réseaux de télécommunications.
Les représentants des communes nous ont par ailleurs indiqué qu’il s’agissait d’une demande forte des élus pour faciliter le financement de ces réseaux.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis favorable.
Cet amendement a pour objet ou en tout cas aurait pour conséquence de créer des financements indirects par le truchement de ce qu’on appelle les fonds de concours.
Une commune créerait ainsi un fonds de concours en faveur de l’EPCI à fiscalité propre auquel elle appartient. Lui-même aurait la capacité de transférer ces crédits, par exemple, au conseil départemental, si le RIP relevait de sa compétence.
En définitive, on aboutirait à une sorte de financement croisé, de financement en cascade. Or tel n’est pas le sens de la fiscalité adoptée aujourd’hui. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.
L’intitulé du chapitre V du titre II du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : « Services publics locaux de transport de communications électroniques ». –
Adopté.
TITRE II
INCITATION AUX INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
L’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b)
c)
1° bis
a) La première phrase est supprimée ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « La décision d’attribution du statut de “zone fibrée” rendue par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes précise les obligations pesant sur l’opérateur chargé du réseau concerné. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : «, pris dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, » sont supprimés ;
b) Après les mots : « ce statut », sont insérés les mots : «, les critères au regard desquels s’apprécie le caractère raisonnable du prix mentionné au II du présent article » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Dans les dix ans à compter de la décision d’attribution du statut de “zone fibrée”, le gestionnaire d’un réseau de lignes téléphoniques en cuivre, propriétaire d’infrastructures d’accueil dédiées à ce réseau, et la collectivité dans le ressort duquel ces infrastructures sont implantées peuvent s’entendre sur le rachat, par la collectivité, des infrastructures d’accueil susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Le refus, par la collectivité, d’acquérir ces infrastructures est motivé et ne peut être fondé sur le prix proposé par l’opérateur lorsqu’il apparaît que celui-ci est raisonnable au regard de l’état des infrastructures en cause. »

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Magras et Mme Malet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne propriétaire d’infrastructures accueillant un réseau de communications électroniques, situées sur un territoire faisant l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peut, dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent II, demander à la collectivité territoriale sur laquelle sont implantées ces infrastructures d’accueil de racheter celles susceptibles de donner lieu à des activités de génie civil. Cette faculté est ouverte pendant un délai de dix-huit mois à compter de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou de trois mois à compter de la publication par la collectivité de son intention de lancer un programme d’enfouissement des réseaux. »
La parole est à Mme Viviane Malet.

Nous le savons tous, les ouragans qui ont balayé Saint-Martin, Saint-Barthélemy et la Guadeloupe en septembre dernier ont eu des conséquences catastrophiques pour ces territoires. Ils ont, en particulier, détruit tous les réseaux de communications électroniques qui n’étaient pas enterrés.
Les dégâts causés chaque année par les catastrophes naturelles, tout particulièrement dans les territoires d’outre-mer exposés aux ouragans, sont très importants. Or les réseaux de communications électroniques sont indispensables au bon fonctionnement de chaque territoire. Dès lors, les autorités publiques responsables de ces territoires peuvent être conduites à lancer des programmes d’enfouissement des réseaux pour les mettre à l’abri de futures catastrophes naturelles, ce qui permet au demeurant d’accélérer leur passage au très haut débit.
Cet amendement, que je défends avec mon collègue Michel Magras, a pour objet de permettre aux opérateurs qui disposeraient d’infrastructures d’accueil d’en proposer le rachat à la collectivité. Ainsi, cette dernière pourrait définir un plan global de rénovation sur l’ensemble du secteur frappé par une catastrophe naturelle. Ce plan devra permettra ensuite à tous les opérateurs de réseaux de communications électroniques présents sur ce secteur d’enterrer leurs réseaux et de saisir cette occasion pour déployer, par exemple, de la fibre optique.

Cet amendement vise à étendre, pour les collectivités territoriales, la possibilité, introduite à l’article 8 du présent texte, de racheter les infrastructures d’accueil des réseaux de communications électroniques, qui constituent un actif stratégique.
Cette faculté de rachat s’inscrit dans la procédure prévue dans le cadre de l’attribution du statut de zone fibrée, mais s’appuie sur la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Je suis sensible à la problématique que connaissent nos territoires, notamment outre-mer, face aux dégâts causés par les catastrophes naturelles. Au nom de la commission et en mon nom personnel, je leur apporte mon soutien par un avis favorable sur cet amendement.
Madame Malet, je reviens tout juste de Saint-Martin, où je me suis rendu pour travailler les dossiers du logement et du réseau numérique et téléphonique. Évidemment, il faut trouver les meilleures solutions, et mon déplacement est la preuve de mon implication.
Toutefois, je ne souscris pas à la philosophie de cet amendement. Je ne suis pas sûr que, lorsqu’il y a une catastrophe naturelle, la solution soit que l’opérateur puisse donner la possibilité à la collectivité d’effectuer un rachat. Certes, il y a « donner la possibilité » et « donner la possibilité en incitant fortement », si vous voyez ce que je veux dire…
Tout le monde doit contribuer à la gestion des catastrophes naturelles, y compris les opérateurs, pour assurer un déploiement plus rapide des réseaux – c’est leur métier – et donc une reconstruction plus rapide.
Je relève une seconde difficulté : une fois que la catastrophe naturelle est passée et que le réseau a été rétabli, les infrastructures de télécommunication deviennent propriété de la collectivité, conseil départemental ou conseil régional. Or les collectivités ne sont pas compétentes pour assurer la maintenance de ce réseau de BTP et y faire les réparations nécessaires : il s’agit là aussi d’une mission de l’opérateur, dont c’est véritablement le métier.
Compte tenu de cette différence d’approche, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 8 est adopté.
Après le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant total de l’imposition forfaitaire prévue au premier alinéa du présent III à la charge d’une même personne ne peut excéder, pour l’ensemble du territoire national, 20 000 fois le montant figurant à la première phrase du même premier alinéa. Lorsque le nombre de stations radioélectriques dont dispose une personne sur l’ensemble du territoire, pour les besoins de son activité professionnelle au 1er janvier de l’année d’imposition, conduit à faire application de ce plafond, le montant dont elle est redevable est réparti entre les collectivités au prorata du nombre de stations dont cette personne dispose, à la même date, sur le territoire de chacune d’entre elles. »

L’amendement n° 4 rectifié, présenté par MM. Gold, Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin et Corbisez, Mme Costes, M. Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty et Guérini, Mmes Guillotin et Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Léonhardt, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Gold.

Cet amendement vise à supprimer l’article 9, qui plafonne le montant de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux due par les opérateurs, assise sur le nombre d’antennes relais déployées.
Cet article a pour but d’inciter à l’accélération du déploiement de ces réseaux : nous ne le contestons pas. Cependant, plusieurs raisons nous poussent à considérer que cet article est, soit prématuré, soit insuffisamment ciblé en termes d’aménagement du territoire.
Premièrement, cet article est prématuré, car nous ne connaissons pas les modalités de l’accord historique signé en janvier dernier entre le Gouvernement et les opérateurs : quel impact sur nos finances publiques auront les contreparties financières octroyées aux opérateurs, notamment le renoncement à la mise aux enchères des bandes de fréquences 900, 1 800 et 2 100 mégahertz, dont les autorisations arrivent à terme en 2021 et 2024 ? Quid de la concrétisation juridique des nouveaux engagements en matière de couverture mobile des zones prioritaires ? Il est essentiel de prévoir des obligations de résultat pour ne pas aboutir à la situation que nous avons connue par le passé.
Deuxièmement, ces dispositions imposeraient une perte de recettes pour les collectivités territoriales. Il aurait été plus efficace de renforcer les exonérations existantes pour cibler le déploiement des zones les moins denses de notre territoire plutôt que de plafonner l’IFER. Encore une fois, une étude d’impact en la matière serait la bienvenue !

Cet amendement tend à supprimer l’article 9, qui vise à faciliter le déploiement de stations radio pour la téléphonie mobile.
L’amendement de réécriture de cet article, que la commission a déposé et que nous examinerons dans un instant, permettra de répondre aux inquiétudes exprimées par notre collègue. Notre nouvelle rédaction n’aura pas d’impact sur le rendement actuel de l’IFER mobile et ciblera par ailleurs les zones peu denses, plutôt que d’instaurer un plafonnement global.
En ce sens, parce que les dispositions du présent amendement seront pleinement satisfaites sur le fond par notre amendement de réécriture, je demande le retrait de l’amendement n° 4 rectifié.
… même si j’admets que le raisonnement suivi peut paraître quelque peu alambiqué.
Je suis favorable à cet amendement, parce que, à mon sens, la proposition de loi n’est pas le bon véhicule pour traiter de l’IFER. En revanche, sur le fond, il me semble judicieux de plafonner l’IFER, mais d’une manière très équilibrée.
D’un côté, l’IFER est une source de revenus très importante pour les collectivités ; mais, de l’autre, elle peut constituer un frein pour le déploiement des infrastructures.
Dans le cadre du prochain projet de loi de finances, nous vous soumettrons donc ce dispositif, sur lequel vous aurez à vous prononcer : pour l’IFER mobile, nous proposerons de donner une sorte d’exonération pour les infrastructures prévues dans l’accord que nous avons signé en janvier dernier, c’est-à-dire pour les infrastructures supplémentaires par rapport à la tendance d’investissement annuel des opérateurs - je parle bien des infrastructures supplémentaires. Ce dispositif permettrait de favoriser l’investissement par les opérateurs sans grever les ressources des collectivités.

L’amendement n° 4 rectifié est retiré.
L’amendement n° 16, présenté par Mme de Cidrac, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les stations radioélectriques construites entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022 pour assurer ou améliorer la couverture par les réseaux radioélectriques mobiles ouverts au public de zones identifiées conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs de communications électroniques titulaires d’une autorisation d’utilisation de fréquences radioélectriques pour l’exploitation d’un réseau mobile ouvert au public ne sont pas soumises à cette imposition. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme la rapporteur.

Comme je viens de le préciser, cet amendement vise à réécrire l’article 9 afin de proposer un dispositif plus ciblé que celui figurant dans la rédaction actuelle.
Compte tenu d’éléments techniques qui nous ont été communiqués après l’examen du présent texte en commission, il apparaît que le dispositif de plafonnement, tel qu’il est proposé, risque d’entraîner une perte importante de recettes pour les collectivités territoriales. Telle n’était pas l’intention des auteurs de cette proposition de loi.
À travers le présent amendement, nous proposons donc un mécanisme d’exonération ciblée sur les futurs déploiements destinés à assurer ou à améliorer la couverture par les réseaux mobiles dans les zones identifiées conjointement par l’État, les collectivités territoriales et les opérateurs.
Ainsi, ce dispositif n’affectera pas le rendement actuel de l’IFER, ni même son évolution future pour les déploiements de sites hors de ces zones. Dans le même temps, il permettra une mise en œuvre rapide du contenu de l’accord mobile conclu en janvier dernier avec les opérateurs.
Pour les raisons que j’ai précédemment évoquées, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Il préfère renvoyer au débat prévu au titre du prochain projet de loi de finances.

Naturellement, je voterai en faveur de l’amendement présenté par Mme la rapporteur : ces dispositions permettent d’apporter une solution techniquement robuste en vue d’accélérer les déploiements dans les zones non couvertes ou mal couvertes par les réseaux mobiles.
Bien entendu, l’objectif de l’article 9 dans sa rédaction initiale n’était pas d’affecter les recettes de l’IFER, qui bénéficient aux collectivités territoriales, mais de proposer un dispositif de plafonnement plus pérenne, permettant de donner davantage de visibilité à toutes les parties prenantes et de simplifier le fonctionnement de cette imposition, au-delà de nombreuses dérogations à l’application du montant forfaitaire de base.
Après réexamen, il est apparu que ce dispositif n’était pas suffisamment abouti pour permettre une refondation générale de l’IFER sans effet sur son rendement.
Toutefois, à terme, une modification d’ensemble me paraît toujours nécessaire pour soutenir davantage les déploiements. Je pense en particulier qu’une approche par site plutôt que par station permettrait de lever certaines barrières qui limitent aujourd’hui le déploiement de plusieurs réseaux différents sur les mêmes points hauts.
On estime à 20 000 le nombre de sites nécessaires pour assurer une couverture totale de la population. Dès lors, ce nombre devrait être retenu comme borne supérieure de l’IFER.
Par ailleurs, cette évolution permettrait de tenir compte de la densité accrue que les futurs réseaux 5G exigeront en termes de stations.
En tout cas, il est impératif, premièrement, de donner de la visibilité aux opérateurs et, deuxièmement, de favoriser les déploiements tout en préservant les recettes des collectivités locales. Certes, l’équation est sûrement compliquée, mais il est indispensable de la résoudre.
M. Jérôme Bascher applaudit.
L ’ amendement est adopté.
I. – Le troisième alinéa du a du 2° du I de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par les mots : «, lorsque le statut de “zone fibrée” a été attribué à ces réseaux en application de l’article L. 33-11 du même code ».
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 265 du code des douanes.
III. – La perte de recettes résultant pour les autres collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Par le présent amendement, le Gouvernement entend lever le gage prévu à l’article 9 bis.
Je défends par la même occasion l’amendement n° 19, également présenté par le Gouvernement, qui tend à lever le gage à l’article 12.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 9 bis est adopté.
Après l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421 -4 -1. – Les installations, les travaux et les aménagements effectués sur des constructions existantes peuvent, quand ils ont pour objet d’améliorer la couverture du territoire en réseaux de communications électroniques, y compris par un changement de technologie, être dispensés de certaines formalités prévues au présent code et par les dispositions auxquelles il renvoie, ou y être soumis dans des conditions moins contraignantes, dans le respect des objectifs mentionnés à l’article L. 101-2. » –
Adopté.
La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° L’article 52-1 est ainsi modifié :
a) Au 2° du I, la référence : « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° … du … tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;
b) À la première phrase du II, la référence : « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 » est remplacée par la référence : « loi n° … du …» ;
c) Au III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
2° L’article 52-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;
b) À la fin du 1°, la référence : « loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques » est remplacée par la référence : « loi n° … du … tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit » ;
3° L’article 52-3 est ainsi rédigé :
« Art. 52 -3. – L’une des zones mentionnées aux articles 52-1 et 52-2 est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52-1 et 52-2 dès lors qu’un ou plusieurs opérateurs de radiocommunications y assurent une très bonne couverture en téléphonie mobile de deuxième génération, conformément à une méthodologie définie par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
« Lorsque l’une des zones mentionnées auxdits articles 52-1 et 52-2 est couverte, selon les modalités définies au premier alinéa du présent article, en services de téléphonie mobile de troisième génération, elle est réputée couverte au sens de ces mêmes articles 52-1 et 52-2. »

L’amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. de Nicolaÿ, Chaize, Pointereau, Retailleau et Savin, Mme Renaud-Garabedian, MM. Bansard, Joyandet, J.M. Boyer, Raison et Perrin, Mme Deromedi, MM. Lefèvre et Mayet, Mme Micouleau, MM. Poniatowski, Paccaud, Bascher, Bouchet et Rapin, Mmes Garriaud-Maylam, Duranton et Lamure, M. Danesi, Mmes Troendlé et Eustache-Brinio, MM. Panunzi, Bazin, Vogel, Duplomb, Brisson, Pellevat, Piednoir et Genest, Mme Puissat, M. Darnaud, Mmes Gruny et Billon, MM. H. Leroy et Chevrollier, Mmes Vullien et Dindar, M. Husson, Mmes Thomas, Chauvin et Chain-Larché, MM. Bonhomme, Bonnecarrère, Louault, Bizet, Kern, Milon, Henno, Chatillon et Pierre, Mme Deroche, MM. Longeot, D. Laurent, A. Bertrand et B. Fournier, Mme F. Gerbaud et MM. Leleux et Charon, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Remplacer le mot :
troisième
par le mot :
quatrième
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.

Cet amendement de précision vise à renforcer les exigences de couverture pour les zones blanches, en cohérence avec l’accord du 14 janvier 2018.
Conclu entre les opérateurs et l’État, cet accord prévoit une couverture des zones blanches de centres-bourgs en 4G à 75 % d’ici à 2020 et à 100 % d’ici à 2022 – nous l’espérons !
Dès lors, au lieu de faire référence à la 3G, comme c’est le cas à l’alinéa 11 de l’article 11, mieux vaut viser tout de suite la 4G, pour garantir une meilleure réception.

Cet amendement vise à rehausser les exigences de couverture pesant sur les opérateurs dans les zones blanches.
L’accord annoncé en janvier dernier entre le Gouvernement et les opérateurs sur la couverture mobile s’inscrit dans un calendrier comparable et repose sur les technologies de quatrième génération, ou 4G. Il doit être traduit dans les autorisations d’utilisation des fréquences mobiles des opérateurs, qui arrivent à terme entre 2021 et 2024.
Je suis favorable à cet amendement, car les zones blanches continuent à exister en nombre, alors que nous devons veiller à l’égalité des territoires dans la politique d’aménagement numérique : c’est une condition de l’attractivité et du dynamisme des territoires, et nous serons collectivement attentifs à ce que la liste des communes concernées se réduise effectivement.
L’objectif est bien de déployer la 4G de manière massive, en lieu et place de la 2G et de la 3G. À ce titre, l’accord que nous avons signé en janvier dernier prévoit deux choses.
Premièrement, il convient d’assurer la transformation pour plus de 10 000 communes d’ici à 2020. Ce sont principalement les communes qui, aujourd’hui, sont encore en 2G ou en 3G. Les autres communes sont principalement en 4G.
Deuxièmement, il faut prévoir, pour les zones blanches, un passage directement en 4G. À cet égard, nous avons également fixé un objectif contraignant pour les opérateurs : que 75 % des zones blanches actuelles soient en 4G d’ici à la fin de l’année 2020.
Voilà pour le volet contractuel que nous avons passé avec les opérateurs.
Mesdames, messieurs les sénateurs, l’objectif contraignant a déjà été inscrit dans l’accord conclu, en janvier dernier, avec les opérateurs : il ne me semble pas nécessaire d’en faire mention dans la loi. Pour ce qui concerne cet amendement, je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
Ces dispositions me permettent toutefois de vous dire, très précisément, les engagements que nous avons pris pour déployer massivement la 4G. Il s’agit là d’un objectif majeur. J’insiste : la 4G, c’est internet sur le téléphone et non pas la voix.

Je soutiens cet amendement, et je me réjouis de l’avis donné par Mme la rapporteur : beaucoup de zones souffrent de la situation de rupture que leur inflige leur position très défavorable en matière numérique.
À mes yeux, cette proposition de passer tout de suite à la 4G relève du bon sens.
Je me félicite que le Sénat s’exprime en faveur de ces territoires, qui ont été trop souvent oubliés dans notre pays.
M. Jérôme Bascher applaudit.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 11 est adopté.
I. – L’augmentation de charges résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
Cet amendement a été précédemment présenté par le Gouvernement.
Quel est l’avis de la commission ?
L ’ amendement est adopté.

L’amendement n° 10, présenté par M. Schmitz, est ainsi libellé :
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° du II de l’article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques est complété par les mots : «, sur la base notamment des schémas directeurs territoriaux d’aménagement numérique prévus à l’article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales ».
La parole est à M. Alain Schmitz.

Cet amendement tend à compléter les objectifs visés au titre de la politique générale des communications électroniques, lesquels fondent les mesures que peuvent prendre le ministre chargé des communications électroniques et l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans le cadre de leurs attributions respectives. Il s’agit de reconnaître la portée et l’intérêt des documents d’orientation élaborés par les collectivités territoriales et leurs groupements quant à la politique d’aménagement numérique dans les territoires.
Ce constat a été rappelé lors de la discussion générale : depuis, notamment, l’adoption de l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements ont mené, au sein des territoires, une importante politique de recensement des besoins et ont consenti des investissements considérables à la suite de ces diagnostics. L’ensemble de ce travail est régulièrement et fortement souligné, tant par l’État que par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Dans cet esprit, la loi Pintat a mis en place un outil, dont les collectivités peuvent se saisir et à l’occasion de l’élaboration duquel peut s’engager un dialogue constructif entre tous les acteurs : il s’agit du schéma directeur territorial d’aménagement numérique.
Alors que l’État associe toujours plus étroitement les collectivités à la politique d’aménagement numérique et affiche sa volonté de faire d’elles un partenaire essentiel en leur reconnaissant certains pouvoirs décisionnels, il apparaît nécessaire d’intégrer les documents d’orientation issus des collectivités comme un élément fondant l’appréciation des objectifs visés au service de l’aménagement numérique des territoires.
La présente proposition de modification s’inscrit donc comme un complément naturel et indispensable du présent texte.

Pour ne pas dépasser le temps qui nous est imparti, je me contente de vous donner l’avis de la commission : favorable.
Le code général des collectivités territoriales prévoit déjà ce schéma d’aménagement. À mon sens, il n’est donc pas nécessaire d’en faire mention dans le code des postes et des communications électroniques. C’est pourquoi je m’en remets à la sagesse du Sénat.
Mesdames, messieurs les sénateurs, étant donné qu’il s’agit là de ma dernière prise de parole dans cette discussion, je tiens à vous remercier toutes et tous de nos débats de cet après-midi.
L ’ amendement est adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 12.
(Supprimé)

Personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi tendant à sécuriser et à encourager les investissements dans les réseaux de communications électroniques à très haut débit.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 66 :
Nombre de votants333Nombre de suffrages exprimés282Pour l’adoption282Le Sénat a adopté.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 7 mars 2018 :
De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :
Proposition de loi organique visant à améliorer la qualité des études d’impact des projets de loi (n° 610 rectifié, 2016-2017) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 317, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 318, 2017-2018).
Proposition de loi visant à instituer le Conseil parlementaire d’évaluation des politiques publiques et du bien-être (n° 611 rectifié, 2016-2017) ;
Rapport de M. Jean-Pierre Sueur, fait au nom de la commission des lois (n° 319, 2017-2018).
De dix-huit heures trente à vingt heures trente et de vingt-deux heures à minuit :
Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer (n° 368, 2016-2017) ;
Rapport de M. Dominique Watrin, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 315, 2017-2018) ;
Texte de la commission (n° 316, 2017-2018).
Proposition de résolution en application de l’article 34-1 de la Constitution, pour une Conférence des parties (COP) de la finance mondiale, l’harmonisation et la justice fiscales (n° 271, 2017-2018).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures.