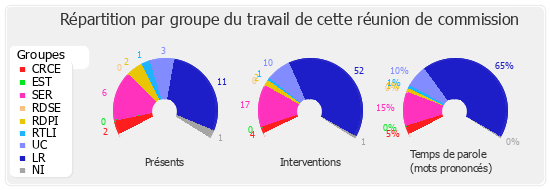Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale
Réunion du 13 janvier 2021 à 8h30
Sommaire
- Désignation d'un rapporteur (voir le dossier)
- Proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat
- Proposition de loi visant à consolider les outils des collectivités permettant d'assurer un meilleur accueil des gens du voyage
- Proposition de loi visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels
- Audition de représentants de la profession d'avocat à la suite du rapport de m. dominique perben (voir le dossier)
- Audition de m. éric dupond-moretti garde des sceaux ministre de la justice (voir le dossier)
- Audition de m. jean-louis debré à la suite de son rapport sur les élections départementales et régionales (voir le dossier)
La réunion
La commission désigne M. Philippe Bas rapporteur sur le projet de loi n° 254 (2020-2021) portant report du renouvellement général des conseils départementaux, des conseils régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique (procédure accélérée), ainsi que sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et reportant la date de caducité des régimes institués pour faire face à la crise sanitaire (sous réserve de son dépôt et de sa transmission).

Nous examinons aujourd'hui la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat, déposée le 27 octobre dernier par notre collègue Dominique Estrosi-Sassone et cosignée par une centaine de sénateurs.
À la suite des affaires récemment relayées par les médias, telles celles de Théoule-sur-Mer ou du Petit Cambodge, ce texte tend à mieux protéger ce « droit inviolable et sacré » qu'est la propriété, selon les termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, contre les squatteurs.
Il existe bien des dispositifs spécifiques pour lutter contre le squat, qui ont été améliorés au fil des ans. Mais les affaires que j'ai évoquées démontrent qu'ils ne sont ni suffisamment dissuasifs à l'égard des squatteurs, ni suffisamment connus des préfectures et des forces de police, voire des propriétaires eux-mêmes.
Il existe tout d'abord un délit spécifique. L'article 226-4 du code pénal sanctionne l'introduction et le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. Le terme de domicile désigne ici, selon la jurisprudence, tout lieu où une personne a le droit de se dire chez elle. En revanche, il ne vise pas des lieux qui ne servent pas effectivement d'habitation, par exemple un appartement vide de meubles ou un terrain nu.
L'article 226-4 prévoit actuellement une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. L'article 1er de la proposition de loi alourdit la sanction, en la portant à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende, afin de la rendre plus dissuasive à l'égard des squatteurs. Pour rappel, le propriétaire qui tente de se faire justice soi-même sans avoir obtenu le concours de l'État encourt lui une peine de trois ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Je signale que cette mesure a déjà été adoptée par le Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi d'accélération et simplification de l'action publique (ASAP), mais qu'elle a été censurée par le Conseil constitutionnel comme cavalier législatif. Il n'y aura pas de difficulté à l'adopter dans cette proposition de loi.
Il existe ensuite une procédure administrative dérogatoire, créée par la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (Dalo) à l'initiative du Sénat, et plus précisément de notre collègue Catherine Procaccia, qui permet à un propriétaire ou à un locataire de solliciter le concours du préfet pour procéder à l'évacuation forcée de son logement lorsqu'il y a violation de domicile au sens de l'article 226-4. Cette procédure requiert la réunion de trois conditions cumulatives : le dépôt préalable d'une plainte pénale ; la preuve que le local occupé constitue le domicile du demandeur ; enfin, le constat par un officier de police judiciaire de l'occupation illicite. Elle permet d'obtenir une évacuation rapide des lieux sans attendre d'avoir obtenu une décision de justice.
Ces dispositions « anti-squat » demeurent cependant peu connues et mal appliquées, comme l'ont mis en lumière les auditions auxquelles j'ai procédé.
L'affaire de Théoule-sur-Mer en fournit un exemple frappant : le procureur de la République se serait opposé à une intervention des gendarmes, en invoquant le dépassement d'un délai de flagrance de 48 heures non prévu par les textes, puisqu'il s'agit d'un délit continu, tandis que la sous-préfecture paraissait peu au fait de la procédure prévue à l'article 38 de la loi Dalo, et refusait de l'appliquer à une résidence secondaire. C'est finalement parce qu'elle a constaté des faits de violences conjugales au sein du couple de squatteurs que la gendarmerie nationale est intervenue, ce qui a permis aux propriétaires de récupérer leur bien.
Les représentants du ministère de l'intérieur ont admis que la procédure de l'article 38 précité était mal connue du grand public comme des préfectures. Le ministère ne dispose pas de statistiques nationales sur la mise en oeuvre de cette procédure. Il m'a toutefois été indiqué que la préfecture de Paris en avait fait usage à cinq reprises au cours de l'année 2019, ce qui donne une idée de sa faible application.
Mieux faire connaître cette procédure administrative très spécifique auprès des préfets et des forces de sécurité intérieure me semble constituer un impératif. Une circulaire est en cours de préparation par les ministères concernés et nous pourrons interroger en séance la ministre à ce sujet.
Les articles 2 à 4 de la proposition de loi élargissent le champ d'application des dispositifs anti-squat et renforcent la protection de tous les biens immobiliers, et non du seul domicile.
À cette fin, l'article 2 introduit dans le code pénal quatre nouveaux articles afin de créer un délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble, défini comme le fait de se maintenir, sans droit ni titre, dans un bien immobilier appartenant à un tiers contre la volonté de son propriétaire ou de la personne disposant d'un titre à l'occuper. La peine encourue serait identique à celle prévue en cas de violation du domicile : trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Seraient également incriminées la propagande ou la publicité en faveur de l'occupation frauduleuse d'un immeuble, punies d'une amende de 3 750 euros.
L'article 3 de la proposition de loi modifie l'article 38 de la loi Dalo pour permettre l'utilisation de la procédure dérogatoire d'évacuation forcée en cas de maintien sans droit ni titre dans tout bien immobilier, sans subordonner le recours à cette procédure à une entrée illicite dans les lieux. Il réduit également les délais d'intervention accordés au préfet, à la fois pour prononcer une mise en demeure, puis pour procéder à l'évacuation forcée du logement.
Enfin, l'article 4 permettrait d'écarter, dans le cadre de la procédure judiciaire d'expulsion, l'application du délai de deux mois reconnu à l'occupant après la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, ainsi que le respect de la trêve hivernale, sans avoir à établir l'existence de voies de fait.
Je suis favorable aux mesures envisagées par le texte, sous réserve de six amendements que je vous présenterai à l'issue de notre discussion et qui ont été élaborés en concertation avec Dominique Estrosi Sassone, avec laquelle j'ai eu un échange tout à fait constructif lors de mes travaux préparatoires.
À la suite des auditions que j'ai menées, auprès des ministères concernés, mais aussi de l'Union nationale des propriétaires immobiliers et de la fondation Abbé Pierre, il me semble nécessaire de distinguer la situation des locataires défaillants, ou des occupants à titre gratuit qui se maintiennent dans les lieux contre la volonté du propriétaire, de celle des véritables squatteurs.
Il s'agit d'une raison d'opportunité, tout d'abord : ces personnes sont entrées dans les lieux de manière licite et elles peuvent être simplement confrontées à un accident de la vie. Pénaliser le locataire défaillant reviendrait finalement à réintroduire l'emprisonnement pour dettes....
Il s'agit également de préserver l'équilibre entre le droit constitutionnel qu'est la propriété, garantie par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et le droit au logement, qui a été reconnu comme un objectif de valeur constitutionnelle. Sauf à encourir une censure pour inconstitutionnalité, il n'est pas possible de traiter comme des squatteurs des locataires défaillants, même s'il peut exister des cas de mauvaise foi éhontée chez ces derniers. La régulation des rapports locatifs soulève toutefois des questions qui dépassent le cadre de cette proposition de loi et relèvent de la commission des affaires économiques.
Je vous proposerai donc de préciser que le délit d'occupation frauduleuse d'un immeuble est constitué si l'auteur des faits s'est introduit dans les lieux à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, ce qui permet de viser les squatteurs sans concerner les locataires défaillants. Enfin, il me paraît nécessaire d'introduire une gradation des peines et de punir plus sévèrement le squat d'un domicile que celui de locaux qui ne sont pas utilisés comme habitation principale.
Je vous proposerai également de préciser la définition de la nouvelle infraction consistant à faire la propagande ou la publicité de l'occupation frauduleuse d'immeuble, pour ne pas être accusé de porter atteinte à la liberté d'expression des associations luttant contre le mal-logement.
Enfin, par cohérence, à l'article 3, je souhaite exclure de la procédure administrative d'évacuation forcée les locataires ou occupants entrés dans les lieux avec l'accord du propriétaire, et qui se maintiendraient contre sa volonté après résiliation du contrat de bail ou retrait de l'autorisation.
Il me semble en revanche opportun d'élargir l'application de cette procédure dérogatoire aux locaux à usage d'habitation. Nous l'avions déjà voté dans le cadre de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan), à l'initiative de notre collègue Marc-Philippe Daubresse, qui était rapporteur pour avis. C'est une disposition qui permet d'apporter une solution lorsque le logement illicitement occupé n'est pas encore le domicile effectif de quelqu'un - par exemple, un logement vacant entre deux locations ou un logement nouvellement acheté.
Enfin, à l'article 4, je vous proposerai de maintenir l'exigence d'une entrée dans les lieux par voies de fait pour priver un occupant du bénéfice du délai de deux mois et de la trêve hivernale dans le cadre d'une procédure d'expulsion, tout en précisant la notion de voies de fait, pour éviter certaines jurisprudences divergentes peu favorables aux propriétaires.
Vous l'aurez compris, sous réserve du recentrage de la proposition de loi sur les squatteurs, je suis tout à fait favorable à ce texte et vous demande de l'adopter modifié par les amendements que je vous présenterai après notre discussion générale.

Cette proposition de loi est intéressante parce qu'elle répond à des situations que nous connaissons tous et toutes dans nos circonscriptions respectives. Je lui vois une vertu, mais elle pose trois problèmes. Sa vertu est de protéger, de préserver tous les types de biens immobiliers. À cet égard, l'extension de la protection est bienvenue : des terrains, des biens secondaires peuvent aussi être occupés, et ils n'étaient pas suffisamment protégés.
Mais ce texte soulève trois questions. Il double systématiquement les sanctions. Quiconque a assisté à un procès dans lequel des squatteurs sont poursuivis se rend compte que ceux-ci se répartissent en trois catégories. Il y a d'abord une petite minorité de jeunes qui ont fait le choix de vivre en communauté. Une deuxième minorité est constituée d'étrangers qui arrivent en France illégalement et sont souvent orientés par des filières. Mais l'écrasante majorité des squatteurs sont des miséreux : ce sont de petites gens, qui ont galéré pour trouver un logement auprès d'un bailleur privé ou d'un bailleur social. Lorsqu'ils arrivent devant le tribunal, on apprécie le niveau de leurs biens, de leurs moyens, avant de leur infliger une sanction. Autrement dit, nous pouvons doubler, tripler, quadrupler, quintupler même les sanctions : lorsqu'ils arriveront devant les tribunaux, on se rendra compte qu'ils vivent des minima sociaux, qu'ils ne demandent parfois même pas tant ils sont marginalisés. L'accroissement des sanctions peut bien satisfaire le législateur, il sera complètement inefficient, et quasiment jamais appliqué sur le terrain.
La création d'une peine complémentaire, consistant à interdire pendant trois ans à toute personne reconnue coupable d'avoir squatté d'exciper du Dalo, fabriquera des squatteurs en puissance. À qui ces personnes vont-elles s'adresser ? Aux bailleurs privés ? Mais elles ne rempliront pas les garanties pécuniaires nécessaires. Ne donnons pas le sentiment de nous acharner sur ces personnes, en ne leur laissant d'autre issue que d'aller squatter ailleurs.
Enfin, la lutte contre la publicité et la propagande risque d'entraver l'action de certaines associations, qui dénoncent la situation du mal-logement dans certaines villes, et interpellent les pouvoirs publics et l'État, sans pour autant cibler les biens des particuliers. Lorsque des biens appartenant à des particuliers sont listés, c'est souvent à travers la presse, pour pointer du doigt des milliers ou des centaines de mètres carrés qui sont inoccupés dans nos villes. Imaginerait-on engager des poursuites contre l'abbé Pierre parce qu'il dirait qu'il faut réquisitionner les logements vacants ?
Je comprends qu'on veuille protéger la propriété individuelle, mais attention à ne pas aller trop loin : il faut trouver un juste équilibre pour protéger deux droits à valeur constitutionnelle, qui sont consacrés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Sur la question de la peine, il s'agit en fait de mettre à égalité le squatteur et le propriétaire. Ce dernier, s'il évacue lui-même le squatteur de son domicile, encourt trois ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
S'agissant de la peine complémentaire, celui qui aurait commis un délit n'aurait pas le droit de recourir au droit au logement - mais c'est à la discrétion du juge, qui peut appliquer ce dispositif, ou non.
Enfin, sur la propagande, les associations qui luttent contre le mal-logement ne sont pas concernées. Mais une amende de 3 750 euros est prévue pour ceux qui incitent au squat en donnant la conduite à tenir et en encourageant à commettre un délit. Il me paraît logique qu'un texte réprime l'incitation à commettre un délit.
EXAMEN DES ARTICLES

Conformément à la procédure fixée par la Conférence des présidents, il nous appartient de définir le périmètre de la proposition de loi pour l'application de l'article 45 de la Constitution, relatif aux cavaliers législatifs. Compte tenu du fait que la proposition de loi tend à améliorer la lutte contre l'occupation sans droit ni titre de biens immobiliers, je vous propose de considérer comme recevable tout amendement portant sur les dispositifs permettant de dissuader et sanctionner les occupants sans droit ni titre de biens immobiliers, ainsi que de les évacuer ou les expulser.
Article 1er
L'article 1er est adopté sans modification.
Article 2

Mon amendement COM-1 précise le champ d'application de cet article afin de viser les seuls squatteurs, et non les locataires défaillants. La rédaction proposée pour le nouvel article 315-1 pourrait en effet donner l'impression que les locataires défaillants pourraient être poursuivis pénalement s'ils se maintiennent quelque temps dans les lieux après la résiliation de leur bail. Or tel n'est pas l'objectif de la proposition de loi.
L'amendement COM-1 est adopté.
Mon amendement COM-2 modifie le quantum de la peine encourue en cas d'occupation frauduleuse d'un bien immobilier qui n'est pas un domicile. L'article 1er prévoit de punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'occupation frauduleuse d'un domicile. Afin de respecter le principe de proportionnalité des peines, il paraît préférable de retenir une peine plus réduite - un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende - lorsque les locaux occupés ne constituent pas un domicile.
L'amendement COM-2 est adopté.
Cet article vise à punir des actes de complicité que le code pénal permet déjà de réprimer, puisque son article 121-7 précise que le complice est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction principale. Mon amendement COM-3 supprime donc l'alinéa 7, superfétatoire.
L'amendement COM-3 est adopté.
Mon amendement COM-4 précise la rédaction de l'alinéa 8 afin de sanctionner ceux qui diffusent un véritable mode d'emploi du squat. Ces modes d'emploi consultables en ligne encouragent les squatteurs potentiels à passer à l'acte et leur donnent toutes les astuces pour retarder l'expulsion et tenter d'échapper aux poursuites.
L'amendement COM-4 est adopté.
Article 3

Mon amendement COM-5 recentre la procédure dérogatoire d'évacuation forcée sur les seuls squatteurs : les locataires défaillants doivent continuer à relever de la procédure d'expulsion locative classique. Il y ajoute, à l'instar de ce que la commission des lois avait déjà voté au cours de la discussion du projet de loi Elan en 2018, les locaux à usage d'habitation. Il réduit de 48 à 24 heures le délai accordé au préfet pour examiner la demande et prendre la décision de mise en demeure afin d'apporter une réponse plus rapide. À Théoule-sur-Mer, il a fallu attendre trois semaines ! Enfin, mon amendement apporte une amélioration rédactionnelle en remplaçant le terme « préfet » par les mots « représentant de l'État dans le département ».
L'amendement COM-5 est adopté.
Article 4

Mon amendement COM-6 clarifie les critères qualifiant le squat dans le code des procédures civiles d'exécution en reprenant les termes du code pénal. Il clarifie la rédaction de l'article L. 412-3, qui prévoit que les occupants dont l'expulsion a été ordonnée n'ont pas à justifier de titre à l'origine de l'occupation. Cette précision semble induire que le juge n'a pas à tenir compte de l'origine de l'occupation des locaux dans son appréciation de la bonne ou mauvaise foi de l'occupant. Il est donc souhaitable de la supprimer.
L'amendement COM-6 est adopté.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans un contexte particulier. Le législateur s'est déjà penché récemment sur le sujet de l'accueil des gens du voyage. La loi du 7 novembre 2018, issue de propositions de loi d'initiative sénatoriale de notre ancien collègue Jean-Claude Carle et de notre collègue Loïc Hervé, a procédé à un triple renforcement du cadre juridique de la politique d'accueil des gens du voyage : elle a clarifié la répartition des rôles entre État, communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), précisé les cas dans lesquels les procédures d'évacuation trouvent à s'appliquer et doublé les sanctions pénales pour l'occupation, par des gens du voyage, de terrains sans titre.
Dès lors, vous vous interrogez sûrement sur la nécessité de remettre sur le métier un sujet dont le législateur s'est saisi il y a deux ans à peine, alors que nous manquons encore de recul sur la portée et l'efficacité des dernières modifications législatives en la matière.
Cette question appelle deux réponses, qui fondent la nécessité de légiférer.
D'une part, force est de constater que des pistes d'amélioration demeurent, tant la politique territoriale d'accueil semble perfectible sur le terrain. En effet, la charge de l'accueil semble inégalement répartie entre les communes et EPCI concernés. Au surplus, les élus locaux ne sont pas toujours en mesure d'anticiper les déplacements de gens du voyage, ce qui rend leur accueil d'autant plus difficile qu'il est imprévu. Par ailleurs, nous savons tous que les stationnements illicites continuent de soulever des difficultés pour les élus locaux, qui constatent le recours trop sporadique à la procédure d'évacuation d'office, pourtant prévue par le législateur.
D'autre part, le Sénat a porté avec constance des positions fortes sur le sujet de l'accueil des gens du voyage : l'examen du projet de loi relatif à l'égalité et la citoyenneté et celui, en 2017 et 2018, des propositions de loi de Jean-Claude Carle et Loïc Hervé ont ainsi été l'occasion pour notre chambre de porter divers dispositifs qui, faute d'avoir été retenus au cours de la navette parlementaire, ne figurent pas dans la loi aujourd'hui. Les difficultés auxquelles ces dispositifs entendaient répondre n'en persistent pas moins et appellent à réitérer une réponse législative dont la nécessité ne s'est pas démentie.
La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui poursuit ainsi trois objectifs principaux : créer les conditions d'une meilleure anticipation des déplacements de résidences mobiles ; améliorer la gestion des aires d'accueil de gens du voyage ; et renforcer la procédure administrative d'évacuation d'office en cas de stationnement illicite.
Afin d'atteindre le premier de ces objectifs et d'éviter les risques de saturation des aires d'accueil, l'article 1er de la proposition de loi prévoit le recensement par le préfet de région de l'ensemble des groupes de résidences mobiles de gens du voyage dont l'accueil est prévu à l'horizon de soixante jours. En cas de saturation d'une aire d'accueil, il serait en mesure de réorienter l'un ou plusieurs des groupes envisageant de s'installer sur l'aire concernée. Ce dispositif soulève à la fois des difficultés pratiques - les préfectures de région n'étant, selon toute vraisemblance, pas en mesure de déployer un tel recensement - et des risques juridiques, tenant notamment à la protection des données personnelles.
Je comprends néanmoins pleinement les objectifs poursuivis par cet article. Afin d'en pallier les difficultés techniques tout en préservant l'esprit ayant présidé à sa rédaction, je vous proposerai donc d'adopter un amendement substituant au recensement une stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles. Je tiens à souligner que le dispositif permettrait d'atteindre les objectifs d'une meilleure anticipation des déplacements de groupes de résidences mobiles et d'une pleine association des collectivités territoriales concernées.
Le deuxième but de la présente proposition de loi est d'améliorer la gestion des aires d'accueil des gens du voyage. À cette fin, elle prévoit principalement la possibilité pour les communes et EPCI concernés de subordonner à une réservation préalable l'accès aux aires d'accueil. Le dispositif ainsi prévu par l'article 2 m'a néanmoins paru perfectible sur le plan technique. Je vous proposerai en conséquence d'adopter un amendement prévoyant une réécriture globale, plus robuste, de l'article.
Il m'a en particulier semblé judicieux, conformément à l'équilibre juridique préservé par le législateur entre devoirs d'accueil et droit de lutter contre les stationnements illicites, d'adapter le champ d'application du nouveau dispositif aux seuls communes et EPCI à jour de leurs obligations d'accueil. J'ai également veillé à réintroduire explicitement au sein de cet article le dispositif de réorientation initialement prévu à l'article 1er. L'amendement que je vous proposerai d'adopter tend enfin à préciser les conditions dans lesquelles le préfet peut procéder à l'évacuation d'office des personnes stationnant sans réservation ou en méconnaissance d'une réservation préalablement acceptée.
D'autres dispositions de la proposition de loi visent également à faciliter, pour les collectivités territoriales concernées, la gestion des aires d'accueil. L'article 4 tend ainsi à comptabiliser les emplacements des aires permanentes d'accueil des gens du voyage dans les quotas de logements sociaux auxquels sont soumises certaines communes. L'article 5 prévoit pour sa part de supprimer la procédure de consignation de fonds pour les communes et EPCI ne respectant pas leurs obligations en matière d'accueil. Déjà examinées et adoptées en des termes identiques par le Sénat, ces dispositions relèvent du bon sens et me semblent pouvoir être adoptées sans modification particulière.
Enfin, le troisième et dernier objectif poursuivi par la présente proposition de loi est le renforcement de la procédure administrative d'évacuation d'office en cas de stationnement illicite, prévue à l'article 9 de la loi dite Besson II. Nous connaissons tous la situation inacceptable dans laquelle peut se trouver une commune ou un EPCI qui, respectueux de ses obligations et confronté à une occupation illicite, voit le préfet opposer une fin de non-recevoir à ses demandes légitimes d'évacuation.
À cet égard, le renforcement de la procédure, d'une part via le doublement de la période pendant laquelle court la mise en demeure du préfet et, d'autre part, par l'obligation du préfet à procéder à l'évacuation d'office dès lors qu'à son échéance la mise en demeure n'a pas été suivie d'effet, me semblent tout à fait bienvenus.
J'ai néanmoins estimé, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, que le dispositif d'astreinte initialement proposé n'était pas suffisamment opérationnel. Rendue redondante par la compétence liée du préfet pour procéder à l'évacuation d'office, une telle disposition semblait finalement - bien que j'en comprenne l'intention - dépourvue d'effet concret. Je vous proposerai en conséquence un amendement tendant à supprimer ce dispositif.
À titre plus subsidiaire, l'article 7 de la proposition de loi, auquel je souhaite apporter des modifications rédactionnelles, prend acte d'une censure partielle du Conseil constitutionnel relative à l'article 9 de la loi Besson II.
Permettez-moi à présent d'évoquer deux articles qui ne semblent pas apporter une réponse satisfaisante aux trois objectifs que je viens d'évoquer. Leur présence dans la proposition de loi me paraît, au regard de leur faible valeur ajoutée ou des risques constitutionnels qu'ils soulèvent, de nature à mettre en péril sa cohérence.
En premier lieu, l'article 3 renforce le poids des communes et EPCI dans l'élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI). L'introduction de cette disposition paraît inopportune : l'article présente plusieurs problèmes techniques et reprend un amendement rejeté par le Sénat en séance publique lors de l'examen de la loi relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, dite loi Engagement et proximité. Une telle disposition semble au surplus inutile puisque les SDCI ne comportent pas de dispositions en matière d'accueil des gens du voyage, et leur révision est devenue facultative depuis le vote de cette loi. Je vous proposerai en conséquence de supprimer cet article.
En second lieu, l'article 6 limite la proportion de gens du voyage inscrits sur les listes électorales d'une commune à un plafond de 3 % de la population municipale. Cet article revient à restaurer le volet électoral du dispositif de la commune de rattachement qui a été abrogé par la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. D'une part, il court le risque d'être concrètement dépourvu de toute applicabilité : le répertoire électoral unique, dont sont désormais extraites les listes électorales des communes, ne permet pas la prise en compte d'informations relatives à l'appartenance des électeurs à la catégorie de gens du voyage. D'autre part, l'article pose plusieurs risques constitutionnels au regard du principe de liberté de choix du domicile, mais aussi, et surtout, du principe d'égalité devant l'exercice des droits civiques. Au vu des difficultés posées par cet article, je vous proposerai de le supprimer.
C'est donc un texte équilibré et respectueux des intentions de ses auteurs que je vous propose d'adopter.
Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement les auteurs de la proposition de loi, qui se sont systématiquement rendus disponibles pour échanger, chemin faisant, sur les pistes de solution que je vous propose aujourd'hui.
Ces solutions ayant emporté leur pleine adhésion, je vous les présente aujourd'hui dans un esprit de consensus, convaincue de leur bien-fondé et de leur opérationnalité. J'espère qu'elles recueilleront votre plein et entier soutien.

Je tiens à féliciter notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio pour son travail très complet, et je remercie les auteurs de ce texte, qui nous donnent l'occasion de faire un point sur cette problématique.
Je ne fais pas partie des élus qui ont une vision romantique de l'accueil des gens du voyage. Dans mon département, la Haute-Savoie, la situation est compliquée. Elle le demeure malgré la crise sanitaire, et les élus sont toujours confrontés aux mêmes difficultés.
Le problème de fond dans la loi Besson II est qu'elle a inversé la charge de l'accueil, la faisant reposer sur les élus locaux et non sur les gens du voyage. L'accueil des gens du voyage est ainsi une politique publique qu'il est compliqué de mener sur le terrain. Les élus sont souvent des gens de bonne volonté, qui essaient d'apporter un maximum de solutions concrètes. Cela coûte extrêmement cher - le groupe Union centriste a d'ailleurs déposé un amendement à ce sujet. Et, à la fin, c'est le maire qui est responsable, voire coupable, de ne pas avoir mis en place suffisamment de choses pour l'accueil des gens du voyage ! C'est assez difficile à vivre pour les élus. J'ai eu la chance de pouvoir faire une campagne sénatoriale pendant l'été, et je peux vous assurer que, dans mon département, le sujet est presque systématiquement mis sur la table par les élus, y compris dans les petites communes rurales, où le problème se pose plusieurs fois par an.
L'examen de cette proposition de loi est aussi l'occasion de faire le point sur l'application de la loi issue de la fusion entre la proposition de loi de Jean-Claude Carle et la mienne, que l'Assemblée nationale avait partiellement vidée de leur contenu. Avec Catherine Di Folco, qui était rapporteur, nous avions fait un travail minutieux de mise à plat des différents problèmes qui se posaient sur la politique d'accueil des gens du voyage et proposé, pour chacun, des pistes de solutions concrètes. L'Assemblée n'en a conservé qu'une petite partie, et le Sénat a fait le choix, pour en assurer l'entrée en vigueur rapide, d'adopter le texte tel que voté par l'Assemblée
Ce texte comportait entre autres avancées une innovation intéressante : l'amende forfaitaire délictuelle en cas d'installation illicite. À ce jour, les dispositions afférentes figurent dans le code pénal, mais elles ne sont pas appliquées, ce qui pose une vraie difficulté. J'ai alerté le ministre de l'intérieur hier sur ce sujet, et nous devrions voir la mise en oeuvre de cette amende forfaitaire délictuelle en octobre - ce qui est un délai extrêmement long, beaucoup trop long si on le confronte à la réalité de terrain vécue par les élus ! Nous devrons, dans l'hémicycle, mettre la pression pour que cette amende forfaitaire délictuelle, qui produit des résultats tout à fait intéressants en matière de trafic de stupéfiants ou de toxicomanie, soit mise en oeuvre rapidement.

On comprend le dépôt de cette proposition de loi, vu les difficultés qui viennent d'être évoquées. Si la loi Besson II a mis en place un certain nombre d'obligations, et que celles-ci, au cours des dernières années, sont passées des communes aux EPCI, cela tient aussi à une difficulté : compte tenu du nombre de personnes qui font partie de cette communauté et qui bougent, il n'y a pas suffisamment d'aires d'accueil pour permettre la mobilité. Notre rôle n'est pas simplement de donner des réponses aux élus : nous devons en donner aussi, et surtout, aux gens du voyage qui, pour être mobiles, ont besoin d'un certain nombre de places.

Les schémas départementaux prévoient environ 36 500 places en aires permanentes d'accueil, et nous en avons environ 27 300 sur l'ensemble du territoire. Seules 75 % environ des places prévues par les schémas départementaux en aires permanentes d'accueil existent donc dans les faits, et ce chiffre ne progresse plus beaucoup. En revanche, moins d'un quart des schémas départementaux d'accueil des gens du voyage sont réalisés à 100 %. Il n'y a donc pas suffisamment de places d'accueil. Lorsqu'il y a occupation illicite, le préfet sait bien qu'il peut difficilement procéder à l'évacuation d'office s'il n'a pas de solution de repli pour les personnes concernées. Ces dernières années, des solutions ont été mises en place, en particulier pour les communes et EPCI qui remplissent leurs obligations, afin de permettre des expulsions plus rapides en cas d'occupation illicite.
N'oublions pas, toutefois, que nous parlons d'une communauté qui a été particulièrement touchée par la pandémie, étant donné son mode de vie et ses activités, souvent commerçantes et foraines.
Je salue le travail de la rapporteure. Il y a effectivement des articles qui posent problème : l'article 3, notamment, et l'article 6 portant sur des questions électorales, de ce fait quelque peu hors sujet, et posant des problèmes constitutionnels. Je suis d'accord avec leur suppression.
Pour le reste, Loïc Hervé a raison : il y a une certaine nonchalance du Gouvernement à mettre en oeuvre les dispositions qui ont été votées.

L'article 8, à cet égard, est redondant avec le droit existant. Pourquoi le voter alors que nous n'avons même pas évalué l'existant ?
La loi relative à l'égalité et à la citoyenneté, votée début 2017, avait mis en place un système de consignation pour les communes qui ne remplissaient pas leurs obligations, puisque le pouvoir de substitution du préfet, qui existe, n'avait jamais été mis en oeuvre. Elle avait également précisé le contenu des schémas départementaux et les modalités d'accueil. Le Gouvernement a mis plus de deux ans à prendre les décrets d'application de ces dispositions ! Cette nonchalance pose question.
Puisque les dispositions qui avaient fait évoluer la législation n'ont pas été mises en oeuvre par le Gouvernement, et qu'on peut donc difficilement les évaluer, il est difficile d'envisager leur suppression - ou leur aggravation, en ce qui concerne la procédure d'évacuation d'office. Nous ne serons pas favorables à cette proposition de loi.

Je souhaite à mon tour remercier les auteurs, la rapporteure et saluer le travail qu'on ne cesse de faire au Sénat, et qui montre que cette question n'est pas réglée. Comme souvent, il y a de la perte en ligne dans l'application des dispositions législatives, et le plus difficile est de parcourir le dernier kilomètre !
La loi Besson II revenait à fixer, au sein des schémas départementaux, un nombre de places selon la taille des communes. Il était nécessaire, à l'époque, de faire un effort pour accueillir les gens du voyage. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Certaines communes ou intercommunalités, qui se sont acquittées de leurs obligations et offrent pléthore de places, voient celles-ci occupées à hauteur de 35 % ! Dans mon département, tout autour de la commune dont j'ai eu la chance d'être maire, il y avait cinq ou six aires, qui n'étaient guère plus occupées qu'à hauteur de 35 % - et cela coûtait une joyeuse fortune aux collectivités. Les gens du voyage, comme nous tous, se regroupent par affinité. En outre, ils se sédentarisent. On ne peut pas dire qu'on manque de place. Simplement, se posent de vraies questions de rassemblement de résidences mobiles qui vont bien au-delà de la capacité de l'aire d'accueil. Ce texte est intéressant, car il répond à une forte attente des élus locaux, et à une incompréhension de la population, qui est verbalisée pour toutes sortes d'infractions, et voit de manière régulière des gens du voyage arriver dans des zones d'activités ou sur des terrains sans aucune contrainte.

Dans le Nord, nous avons subi depuis un an une vraie pression des gens du voyage. Même les communes et intercommunalités qui sont en règle ont eu des difficultés. Ainsi, Lesquin, qui avait fait une aire de grand passage, a vu celle-ci occupée avant qu'elle ne soit achevée. Bien souvent, les préfets ne réagissent pas, alors que la loi les y oblige. Nous avons donc, et pendant encore un an, 200 caravanes... Nous avions aussi des gens du voyage qui étaient installés sur une commune et que nous avons voulu déplacer sur un aéroport non loin. Ils ont refusé, parce qu'il y avait déjà une autre communauté sur place...
Il serait intéressant de faire un point très précis de tous les départements. Combien d'aires d'accueil sont réellement disponibles ? Il faut faire une analyse approfondie des besoins, et ne pas recréer partout des aires d'accueil dans chaque département. Cette proposition de loi est bienvenue, parce qu'il est temps de mettre des règles, et surtout de les faire appliquer. Il y a bien sûr la question de la bonne gestion du temps de nos policiers ou de nos gendarmes : si on les déplace régulièrement, il y a des heures supplémentaires à payer.
Ce texte n'évoque pas les dégradations. Pourtant, certaines communautés, avant de partir dégradent les aires d'accueil sans qu'aucune poursuite ne soit engagée. Nous avions prévu des dispositions dans le texte précédent, mais elles ont été retirées par l'Assemblée nationale. C'est le seul volet qui manque à ce texte. Pourtant, on sait qui est là, on fait faire un relevé par des huissiers, pour pouvoir, en cas de dégradation, exiger un paiement. C'est trop facile de partir ! J'ai vu des locaux d'activité dégradés de fond en comble - jusqu'aux câbles !

Merci pour ce travail. J'espère que ces propositions retiendront un peu plus l'attention de nos collègues députés que celles que nous avions faites en 2018, qui avaient été largement élaguées. Je partage complètement les propos de Loïc Hervé. Mme Gatel a raison : les aires d'accueil ne sont pas occupées à 100 %. Dans cette proposition de loi, nous avions prévu de ne pas imposer de construction d'aires supplémentaires si celles qui existaient n'étaient pas occupées au-delà d'un certain pourcentage qui aurait été fixé par un décret. C'est cette disposition qui avait été supprimée par l'Assemblée nationale, ce qui est regrettable. Il faut déjà que les aires soient occupées à 100 %. Certes, les communes ne se sont peut-être pas toutes acquittées de leurs obligations, mais il faut savoir ce que cela coûte, en investissement et en fonctionnement ! Il est temps de rationaliser l'usage des deniers publics.

Dans le Nord, quand j'étais adjoint à la sécurité de Tourcoing, j'ai eu très souvent à procéder à des évacuations. Pour un élu, c'est une expérience douloureuse. On déplace les gens d'un endroit à l'autre, et l'on n'a pas de solution pérenne : la plupart du temps, c'est pour recommencer le même processus un peu plus tard. Tourcoing étant limitrophe de la Belgique, les gens du voyage restaient en France plutôt que d'aller en Belgique, où les règles étaient beaucoup plus sévères.
Il faut faire une différence entre les différentes catégories de gens du voyage. Les forains, qui se déplacent pour les fêtes foraines, ne posent que rarement des problèmes. Ils ont souvent des terrains et sont organisés. Les gens qui vivent en caravane, et qui n'ont pas vraiment de grands déplacements à faire, posent davantage de problèmes. J'ai siégé dans la commission consultative des gens du voyage du département pendant très longtemps. On voyait qu'il s'agissait de gens très précaires, qui voulaient absolument vivre en caravane, alors qu'ils auraient pu bénéficier d'habitats sociaux. Dans les schémas départementaux, on organise des points d'accueil. Dans le Nord, la plupart sont pleins, et les grandes aires de passage sont souvent remplies de gens qui sont sédentaires. Ces personnes se regroupent en famille et ne bougent pas. Du coup, les nouveaux arrivants occupent des aires illicites, parce que les aires aménagées sont déjà occupées par ces personnes sédentaires. C'est vrai qu'il existe encore des places libres, mais on m'a dit, à la métropole européenne de Lille, que les frais demandés pour aller sur ces aires étaient peut-être trop importants.
De toute évidence, les occupations sauvages constituent une très lourde charge pour les villes concernées. Quand on concevait les schémas départementaux, toutes les communes n'étaient pas représentées. Certaines essaient de trouver des solutions en amont. Beaucoup voient cela comme une lourde contrainte. Bref, cette proposition de loi est bienvenue.

Les difficultés sont différentes, non seulement en fonction de la typologie des aires, mais également en fonction du lieu dans lequel on se trouve. Les aires d'accueil évoluent. Dans les Landes, elles sont très remplies, mais largement de personnes sédentarisées, qui attendent parfois un autre type de logement.
Dans les départements touristiques comme le mien, les problèmes proviennent avant tout des aires de grand passage. Aussi, certains EPCI ne respectent pas leurs obligations. Et, quand bien même vous respectez les vôtres, cela ne veut pas dire que les dispositions dont vous êtes censés bénéficier par ailleurs sont effectivement appliquées.
Sur les aires de grand passage, nous avons un vrai problème, qui est un problème de quantité. Pour parler clairement, c'est la quantité de résidences mobiles présentes qui fait que les forces de l'État peuvent intervenir ou non. En fonction du nombre de caravanes, il y a une possibilité de déloger, ou pas. Il faut donc faire un bilan, au niveau national, de la répartition des aires de grand passage, car c'est là que les problèmes estivaux se posent particulièrement. Le sentiment d'envahissement est souvent périodique et singulièrement ponctuel. Comme Jean-Yves Leconte, je ne suis pas certain qu'il faille encore ajouter d'autres mesures à celles qui existent déjà, et que nous n'avons pas évaluées.

Notre groupe s'abstiendra sur cette proposition de loi. En effet, nous sommes extrêmement sceptiques quant à l'utilité d'un nouvel acte législatif en la matière, alors que l'application de la loi existante pose déjà de sérieuses difficultés.
Il est difficile de trouver des solutions permettant le maintien en circulation de la partie de la communauté qui continue à se déplacer, la quasi-totalité des aires étant devenue des aires de sédentarisation. Au reste, la formule des terrains familiaux locatifs correspond mal aux attentes des familles de voyageurs qui souhaitent se sédentariser et devenir propriétaires. Les conflits d'usage sont assez fréquents.
Il nous semble qu'il faut plutôt poursuivre la concertation avec les élus locaux et les associations représentatives, de manière à assurer le respect des textes en vigueur.

Le sujet est extrêmement sensible. Derrière les discours et la bonne volonté affichée, les difficultés subsistent au niveau local. Pour les élus locaux, il est parfois plus délicat d'ouvrir une aire d'accueil qu'une déchèterie ou une prison, car cela fait débat dans la population.
Il faudrait peut-être réfléchir à une typologie qui permette de refléter l'existence de plusieurs catégories de gens du voyage.
Je m'interroge sur l'effectivité réelle dans le temps de l'article 2. La réservation préalable ne réglera qu'une partie des difficultés. Le problème des grands rassemblements restera posé. Ces dernières années, de véritables efforts ont été faits pour trouver des espaces, mais, dans les faits, une partie des gens du voyage se sédentarisent, ce qui pose la question des places disponibles à terme sur les aires d'accueil. Nos concitoyens demandent que l'on accompagne ces populations et que l'on facilite leur insertion, notamment via l'école, mais les aires ne sont pas forcément faites pour un usage permanent et sédentaire.
Mon groupe ne votera pas cette proposition de loi. À titre personnel, je pense qu'il faut s'interroger. On sait que l'ensemble des articles issus de la proposition de loi de Jean-Claude Carle et Loïc Hervé n'ont pas été appliqués. Si les lois ne sont pas appliquées, c'est notre démocratie qui est en danger.
Nous aurons à travailler, dans l'avenir, sur une typologie des gens du voyage et à réfléchir aux réponses à apporter à des questions très particulières. Ainsi, deux difficultés se posent dans mon département : celle de personnes très marginales qui se réfugient dans le statut des gens du voyage et celle des grands déplacements collectifs. Il y a parfois des soucis avec les forains, mais je constate que les communes savent s'organiser au sein d'une vallée pour supporter l'accueil temporaire que nécessite, par exemple, l'organisation de la Vogue des noix à Firminy.

Personne ne peut disconvenir du fait que la loi n'est pas appliquée. Plutôt que de faire une nouvelle loi, pourquoi ne demande-t-on pas, par voie de résolution, l'application par les ministres et les préfets de la loi existante ?
Un rassemblement de 15 000 gens du voyage a lieu chaque année dans un village de 1 200 habitants de mon département. Ce n'est pas facile et cela pose des problèmes concrets, mais nous parvenons à gérer la situation.
Sur la question de la consignation de fonds, nous avons voté une loi en 2017. Cette loi ne semble pas avoir fait l'objet d'une réelle application. Pourquoi la supprimer alors que, n'ayant pas été suffisamment appliquée, elle ne peut, par définition, être correctement évaluée ?

Je partage la frustration qui résulte du défaut d'application des textes que nous avons votés. Nous gagnerions à demander au Gouvernement qu'il fasse le nécessaire pour que la loi entre en vigueur.
Il n'en demeure pas moins que nous sommes quotidiennement interpelés par les élus locaux. Il n'est pas anormal de vouloir enrichir la loi, qui mérite des compléments et des aménagements.
Singulièrement, il va falloir traiter le problème, essentiel, du dol pour les collectivités : alors qu'on les a obligées à investir pour réaliser des aires d'accueil des gens du voyage, elles voient des espaces publics occupés, ce qui entraîne, parfois, des coûts particulièrement importants, notamment lorsqu'il s'agit de petites collectivités.
Oui, le législateur doit mettre la pression sur le Gouvernement pour que le texte s'applique - nous sommes tous d'accord -, mais nous devons aussi l'enrichir sur certains points.

Je veux mettre en garde contre la multiplication des textes, qui peut aussi se retourner contre le Parlement : cela peut donner l'impression que le travail du législateur ne sert pas à grand-chose, faute de décret d'application.
N'oublions pas que nous sommes les représentants des territoires. En multipliant les textes qui ne seront pas mis en oeuvre, on ne sert pas la fonction législative.

On voit bien que le débat intéresse et interroge chacun d'entre nous. C'est un vrai sujet sur tous les territoires.
Nous pouvons regretter que la loi de 2018 ne soit pas appliquée, et il appartient à chacun d'entre nous d'interpeler le Gouvernement sur la lenteur de sa mise en application.
Je pense néanmoins que nous devons à nouveau légiférer : il est dans notre rôle de rechercher les perspectives d'amélioration des textes existants, même si le Gouvernement n'a pas été capable de les appliquer rapidement.
À titre d'exemple, la loi Besson II prévoit que les grands rassemblements doivent être anticipés avec le préfet et les élus. Le dispositif que je propose à l'article 2 est au contraire concentré sur les rassemblements de moins de cent-cinquante résidences mobiles et vient ainsi compléter l'existant.
La proposition de loi vise à renforcer le rôle et les obligations de l'État, en particulier du préfet, dans la mise en oeuvre d'un certain nombre de dispositifs. L'article 1er conforte l'implication du préfet de région, ce qui permettra d'avoir une vision régionale du problème dans les départements. Force est de constater que seules 50 % des aires de grand passage prévues ont été réalisées et que 24 schémas départementaux d'accueil des gens du voyage seulement sont respectés dans l'intégralité de leurs prescriptions au titre de la loi Besson II.
Comme l'ont montré les auditions, les gens du voyage doivent également être responsabilisés. Ils ont des droits, mais aussi des devoirs. Il nous appartient de rappeler les lois et les règles qui régissent les espaces que nous leur proposons, de manière à ce que les élus locaux n'aient pas à assumer des coûts exorbitants de remise en état. Nous devons avancer les uns avec les autres.
La sédentarisation a plusieurs visages. Elle est lente à se mettre en place. Elle est souvent compliquée et coûte très cher aux collectivités. Elle est dans l'air du temps et est souhaitée par les gens du voyage, mais ce n'est pas un choix politique et financier anodin pour les élus.
EXAMEN DES ARTICLES

En application du vade-mecum sur l'application des irrecevabilités au titre de l'article 45 de la Constitution, adopté par la Conférence des présidents, il nous revient d'arrêter le périmètre indicatif de la proposition de loi.
Je vous propose d'indiquer que ce périmètre comprend notamment les dispositions relatives, d'une part, à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et, d'autre part, aux sanctions et procédures applicables dans le cas de stationnements illicites de résidences mobiles de gens du voyage.
Article 1er

L'amendement COM-7 tend à instituer une stratégie régionale de gestion des déplacements de résidences mobiles de gens du voyage.

Je suis favorable à ce que l'on donne de nouvelles responsabilités au représentant de l'État, notamment au plan régional. Je tiens cependant à souligner que la personnalité des préfets joue énormément. D'un préfet à l'autre, les stratégies territoriales peuvent être très différentes. Les préfets sont plus ou moins allants dans l'application des mesures.
En Haute-Savoie par exemple, la donnée démographique est intégrée dans l'élaboration du schéma départemental. Un préfet a considéré que le nombre de places devait suivre l'augmentation démographique du département, créant des contraintes supplémentaires. Alors que les schémas ont une durée de vie très courte, la pression monte d'année en année...
L'amendement COM-7 est adopté.
Article 2

L'amendement COM-8 vise à garantir la solidité juridique du dispositif de réservation de places de stationnement.
L'amendement COM-8 est adopté.
Article 3
L'amendement de suppression COM-9 est adopté.
Article 6
L'amendement de suppression COM-10 est adopté.
Article 7
L'amendement rédactionnel COM-11 est adopté.
Article 8

L'amendement COM-12 vise à supprimer le dispositif d'astreinte en cas de stationnement illicite, qui serait pratiquement inappliqué.
L'amendement COM-12 est adopté.
Articles additionnels après l'article 8

L'amendement COM-1 a pour objet de prévoir la possibilité de mise en oeuvre de la procédure administrative d'évacuation d'office dans les communes et EPCI qui ne respectent pas leurs obligations, mais qui prennent les mesures nécessaires dans le respect du calendrier déterminé par l'État.
Les collectivités qui, sans être à jour de leurs engagements, font des efforts en ce sens, pourraient bénéficier des mêmes règles d'évacuation d'office que celles qui respectent au schéma départemental.
Je ne suis pas opposée à cette disposition. Dans le même esprit que, en vertu de la loi SRU, les communes qui prouvent qu'elles construisent des logements sociaux ne paient pas la même amende que celles qui ne font rien.
En revanche, je suis défavorable à la mise en demeure prévue par l'amendement. Je propose donc à M. Pellevat de retravailler l'amendement d'ici à la séance publique.
L'amendement COM-1 n'est pas adopté.
L'amendement COM-5 est en partie déjà satisfait sur le fond. Son dispositif de mise en demeure pose un problème constitutionnel.
L'amendement COM-5 n'est pas adopté.
L'amendement COM-4 rectifié tend à renforcer le dispositif de saisie des véhicules constituant une habitation en permettant leur déplacement de force. Je note que cette disposition pourrait être très difficile à appliquer.

Nous l'avons déjà votée : c'est la stricte reprise du texte de Catherine Di Folco.

Le Sénat doit maintenir sa position, tout en ayant conscience que l'effectivité de la mesure ne va pas de soi.

J'ai conscience de la difficulté matérielle que représente le transport de caravanes : il faut à tout le moins mobiliser des dépanneuses... Le but est cependant de pouvoir menacer d'un transfert lorsqu'une aire d'accueil située à quelques kilomètres n'est pas occupée.
L'amendement COM-4 rectifié est adopté.

L'amendement COM-6 rectifié vise à modifier les dispositions pénales relatives au stationnement illicite.
Il pose un problème technique : alors que le dispositif proposé prévoit de créer une circonstance aggravante lorsqu'une dégradation de biens est commise à l'occasion d'une installation illicite de gens du voyage, l'objet de l'amendement indique qu'il crée une peine complémentaire d'interdiction de paraître pour ces mêmes installations illicites.

Je le retire. Je le retravaillerai d'ici à la séance publique.
L'amendement COM-6 rectifié est retiré.

Les amendements COM-2 rectifié et COM-3 rectifié ont pour objet la remise au Parlement de rapports annuels du Gouvernement. Mes chers collègues, vous connaissez la position constante de la commission des lois et du Sénat en général sur la production de rapports !
Par ailleurs, la Commission nationale consultative des gens du voyage fournit de nombreux éléments sur ces sujets.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements.

Je suis solidaire de la position du Sénat sur les demandes du rapport au Gouvernement. Toutefois, ces demandes de rapport constituent souvent le seul moyen d'aborder un sujet dans une discussion.
Outre cette demande de rapport, il serait possible de créer avec la commission des finances une mission d'information sur le coût de l'accueil des gens du voyage en France.
On a parlé du coût que représente la construction d'aires d'accueil pour les collectivités. Or, plus les aires restent vides, plus elles coûtent cher, puisque les compensations de la Caisse d'allocations familiales sont fonction de l'occupation. Pour autant, les coûts de fonctionnement sont réels. La remise à niveau d'une aire à la suite de dégradations se chiffre en centaines de milliers d'euros.
Depuis la disparition du carnet de circulation, on ne sait plus dénombrer la population des gens du voyage, d'autant que les chiffres évoluent sur l'année. Certains gens du voyage sont semi-sédentaires.
Nous devons avoir une idée du coût global de l'accueil des gens du voyage dans notre pays. Sur une politique publique de ce niveau, nous devons disposer de chiffres totalement rationnels et agrégés.
Dans quelques semaines, le Sénat va examiner le texte confortant le respect des principes de la République. En France, des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés. À l'adolescence, les enfants du voyage, notamment les filles, sont retirés de l'école. En théorie, ces élèves sont inscrits dans un établissement scolaire ou au Centre national d'enseignement à distance (CNED), mais, dans les faits, ils ne vont pas à l'école. Je pense que nous sommes tous complices de cette situation. Nous fermons les yeux sur la réalité. Il y a un travail considérable à mener.
Il existait autrefois des classes mobiles et des instituteurs détachés qui allaient au plus près des familles. Cela n'existe plus. Les enfants du voyage doivent pouvoir être libres de choisir leur vie lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. C'est un enjeu considérable pour l'école de la République.
Je redéposerai ces deux amendements en séance.
Les amendements COM-2 rectifié et COM-3 rectifié sont retirés.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Notre commission est appelée à examiner ce matin la proposition de loi déposée par Annick Billon et plusieurs de nos collègues visant à protéger les jeunes mineurs des crimes sexuels. Elle sera débattue dans l'hémicycle le 21 janvier prochain, dans le cadre d'un espace réservé.
Cette proposition de loi a pour objet de créer un nouveau crime sexuel sur mineur de treize ans, de façon à poser dans le code pénal un interdit sociétal clair et de manière à mieux protéger les jeunes adolescents contre les violences sexuelles qui peuvent être commises par des adultes.
Ces dernières années, le Sénat a mené plusieurs travaux de contrôle, qui ont montré que les violences sexuelles sur mineurs demeuraient trop rarement réprimées par les juridictions pénales. Trop souvent, les victimes n'osent pas dénoncer ce qu'elles ont subi et beaucoup de plaintes sont classées sans suite, faute de preuves.
La proposition de loi est examinée deux ans et demi après l'entrée en vigueur de la loi Schiappa du 3 août 2018. Cette loi a amélioré les dispositions pénales tendant à protéger les mineurs, mais elle n'a pas donné satisfaction à tous les acteurs de la protection de l'enfance. Certains, en effet, appellent de leurs voeux la création d'une nouvelle infraction ou une modification de la définition du viol, afin qu'il ne soit plus nécessaire de s'interroger, au cours du procès pénal, sur l'éventuel consentement du jeune mineur qui aurait eu un rapport sexuel avec un majeur.
La proposition de loi de nos collègues vise à répondre à cette attente en créant une nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur, laquelle serait constituée en cas de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'elle soit, commise par un majeur sur un mineur de treize ans, dès lors que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.
La peine encourue serait la même que celle aujourd'hui prévue pour viol sur mineur de quinze ans, soit vingt ans de réclusion criminelle. La peine serait portée à trente ans de réclusion en cas de décès du mineur et à la réclusion criminelle à perpétuité en cas d'actes de torture ou de barbarie.
À la différence du viol ou de l'agression sexuelle, l'infraction serait constituée sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'il y a eu un élément de contrainte, de menace de violence ou de surprise, dont la preuve est souvent difficile à rapporter.
Je voudrais souligner que la proposition de nos collègues tient compte des débats qui nous ont occupés en 2018, lors de l'examen de la loi Schiappa.
À l'époque, le Gouvernement avait envisagé de modifier la définition du viol pour introduire une présomption de non-consentement en cas d'acte de pénétration sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans. Cette solution n'avait pas été retenue au regard de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui n'a admis que de manière très limitée - dans le seul domaine contraventionnel - la possibilité de prévoir une présomption en droit pénal, à condition qu'il s'agisse d'une présomption simple.
La proposition de loi cherche à contourner cet obstacle juridique en créant une infraction autonome. La nouvelle infraction de crime sexuel sur mineur serait construite sur le modèle du délit d'atteinte sexuel, qui figure déjà dans le code pénal et qui punit de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le majeur qui a un contact de nature sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans. Le crime sexuel sur mineur viendrait renforcer la protection des jeunes de moins de treize ans, le délit d'atteinte sexuelle étant maintenu pour les jeunes de treize à quinze ans.
Dans son avis du 15 mars 2018 sur le projet de loi Schiappa, le Conseil d'État avait par ailleurs estimé que la seule référence à l'âge de la victime pourrait ne pas suffire pour répondre à l'exigence constitutionnelle relative à l'élément intentionnel en matière criminelle. Selon les représentants de la Chancellerie, le fait de retenir un seuil d'âge à treize ans plutôt qu'à quinze ans réduit cependant ce risque constitutionnel.
Dans son avis, le Conseil d'État notait que le seuil de quinze ans soulevait une difficulté dans l'hypothèse, par exemple, d'une relation sexuelle qui serait librement consentie entre un mineur de dix-sept ans et demi et une adolescente de quatorze ans - c'est le problème des « jeunes couples ». Cette relation serait licite au regard du code pénal jusqu'à ce que le jeune homme atteigne l'âge de dix-huit ans, puis elle deviendrait criminelle, donc susceptible de renvoyer le jeune homme aux assises, alors que rien n'aurait changé dans son comportement et qu'il n'aurait bien sûr pas conscience de commettre une infraction.
Avec un seuil à treize ans, l'écart d'âge avec un jeune majeur devient plus significatif - au minimum cinq ans -, ce qui rend beaucoup plus improbable qu'un jeune majeur puisse entretenir une relation consentie avec un mineur à peine sorti de l'enfance.
J'en viens aux auditions auxquelles j'ai procédé. Elles ont montré une absence de consensus.
Les représentants du barreau contestent l'utilité de légiférer à nouveau sur le sujet des infractions sexuelles sur mineurs. Ils estiment que l'arsenal législatif est déjà suffisamment étoffé et ils font valoir que le délit d'atteinte sexuelle pose déjà un interdit clair concernant les rapports entre majeurs et mineurs. Ils nous mettent en garde contre la tentation de légiférer sous le coup de l'émotion et soulignent que les affaires qui ont été médiatisées, comme celles de Pontoise et de Melun, demeurent assez exceptionnelles.
Parmi les interlocuteurs qui sont favorables à une évolution de la législation, une double ligne de clivage est apparue : sur l'âge et sur le choix d'une présomption plutôt que d'une infraction autonome.
Pour ce qui concerne l'âge, comme je vous l'ai indiqué, les auteurs de la proposition de loi ont retenu le seuil d'âge de treize ans à la fois pour mieux garantir la constitutionnalité du dispositif et pour tenir compte de certaines situations de fait. Pourtant, le seuil de quinze ans conserve des partisans, notamment du côté des associations de protection de l'enfance, qui ont insisté sur la nécessité de protéger tous les collégiens. Elles ont admis qu'il pouvait exister des jeunes couples, mais elles ont estimé que « l'effet-couperet » inhérent à la fixation d'un seuil était un inconvénient difficilement évitable.
La députée Alexandra Louis, auteure d'un récent rapport d'évaluation de la loi Schiappa, défend elle aussi le seuil des quinze ans, de même que notre collègue Laurence Rossignol, qui a déposé une proposition de loi en ce sens avec plusieurs de ses collègues du groupe socialiste, écologiste et républicain.
En ce qui concerne le choix d'une présomption de non-consentement, elle est défendue avec grande conviction par le juge des enfants Édouard Durand, qui travaille sur ce sujet au sein du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce dernier reproche à l'infraction autonome proposée par Annick Billon de gommer la dimension violente de l'acte sexuel imposé au mineur, en évacuant du débat judiciaire la question du consentement. C'est la raison pour laquelle il lui paraît important, par respect pour la victime, d'affirmer une présomption de contrainte en dessous d'un certain âge. Cette idée est également défendue par notre collègue Valérie Boyer, qui a déposé des amendements en ce sens.
Constatant ces nombreuses divergences, je me suis attachée à trouver un moyen d'enrichir le texte pour atténuer les réticences qu'il suscite, tout en conservant le coeur du dispositif proposé par Annick Billon.
Je crois très important de rappeler que, sur le plan politique, la fixation d'un nouveau seuil à treize ans n'est pas synonyme d'affaiblissement de la protection que nous devons aux jeunes de treize à quinze ans. Nous devons vraiment éviter de donner l'impression que le seul public véritablement digne de protection serait les mineurs de moins de treize ans. C'est la raison pour laquelle je vous proposerai un amendement, que le Sénat avait déjà adopté en 2018, mais qui n'avait pas été retenu lors de la commission mixte paritaire sur la loi Schiappa, afin d'indiquer dans le code pénal que la contrainte, qui est un élément constitutif du viol, peut résulter du jeune âge du mineur de moins de quinze ans, lequel ne dispose pas de la maturité sexuelle suffisante. Il s'agit, par cet amendement, de réaffirmer l'attention que nous devons porter aux mineurs de treize à quinze ans. Nous devons continuer à les protéger.
J'ai auditionné de nombreux principaux de collège, des pédiatres, des parents. J'ai rencontré les animateurs de maisons d'adolescents. Tous les principaux de collège alertent sur les dangers des réseaux sociaux.
Ils soulignent aussi la grande évolution qui s'opère entre les élèves de sixième et ceux de troisième. Être en couple quand on est en sixième, c'est se faire des bisous... La sexualité de ces enfants ne peut pas être comparée à celle des adultes. L'âge du premier rapport sexuel est toujours de dix-sept ans pour les garçons et de seize ans pour les filles, malgré les réseaux sociaux et la pornographie. Le point de vigilance porte sur les jeunes âgés de treize à quinze ans. Entre ces deux âges, la différence est sensible.
Je vous proposerai deux améliorations juridiques au dispositif de la proposition d'Annick Billon.
Il est important de modifier, par coordination, le code de procédure pénale, afin d'appliquer au nouveau crime sexuel sur mineur les règles de procédure dérogatoire prévues pour les affaires qui concernent les mineurs. Je pense à la possibilité de prononcer une injonction de soins, à l'obligation d'enregistrer l'audition du mineur, au droit de bénéficier d'une expertise médico-psychologique et à la possibilité d'inscription dans le Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijaisv).
Par le jeu des renvois, la mesure que je vous propose aura également pour effet d'appliquer au nouveau crime sexuel sur mineur les règles de prescription adoptées en 2018 pour les autres crimes sur mineurs : pour ces crimes, l'action publique est prescrite au terme d'un délai de trente ans à compter de la majorité de la victime. C'est très protecteur pour la victime puisque le délai de prescription de droit commun est de vingt ans à compter de la commission des faits. Il tient compte du temps souvent très long qui s'écoule avant que la victime ne parvienne à briser la loi du silence et trouve la force de porter plainte.
En conclusion, je vous proposerai, mes chers collègues, d'adopter la proposition de loi complétée par mes amendements. Conformément à l'accord politique passé entre les groupes, je rappelle que la commission ne peut adopter d'amendements qu'avec l'accord de l'auteur de la proposition de loi. Je me suis entretenue avec Annick Billon, qui a donné son accord pour que nous intégrions au texte les quatre amendements que j'ai déposés. Je lui ai également demandé quelle était sa position concernant les amendements déposés par nos collègues Valérie Boyer et Michel Savin, que nous examinerons à l'issue de notre débat.
Les amendements que j'ai déposés visent à aboutir à un texte un peu plus complet, pour protéger les enfants de moins de treize ans sans négliger les mineurs âgés de treize à quinze ans. Le Sénat se bat depuis plusieurs années pour protéger tous les mineurs.

Bien évidemment, l'accord de l'auteur pour modifier les propositions de loi ne s'applique qu'en commission : la séance publique reste souveraine.

Nous partageons tous le même objectif : trouver les solutions les plus efficaces, les plus pertinentes, sans nous laisser envahir par les polémiques du moment.
Il ne faut pas non plus légiférer pour légiférer - nous avons déjà beaucoup légiféré. J'ignore si le texte aura, au final, une influence concrète sur la politique pénale, dès lors que le régime de l'opportunité des poursuites de la part du parquet est, en France, un principe intangible.
Au-delà, nous nous interrogeons sur la question du consentement. Nous trouvons globalement insupportable que cette question soit posée à un âge où nous considérons qu'elle ne devrait pas se poser. Sur ce sujet, il n'y a pas forcement d'unanimité au sein des groupes. Pour ma part, je suis favorable au seuil de treize ans : il faudrait affirmer que, en dessous de cet âge, l'acte sexuel n'est pas autorisé. Laurence Rossignol a, pour sa part, déposé une proposition de loi, largement signée par les collègues de mon groupe, retenant l'âge de quinze ans.
Sur la question de contrainte, nous avions travaillé, avec Marie Mercier, sur la différence d'âge. C'est une piste intéressante, même s'il est un peu compliqué d'édicter une différence d'âge normative. Néanmoins, c'est un paramètre que les parquets me semblent prendre en considération.
Sur l'imprescriptibilité, mon groupe n'a pas évolué : nous y restons opposés, pour trois raisons. Premièrement, il nous semble qu'elle doit être réservée aux crimes contre l'humanité. Quelle que soit l'horreur des infractions que nous évoquons ce matin, je ne pense pas qu'elles soient plus graves qu'un assassinat précédé d'actes de barbarie. Or celui-ci n'est pas imprescriptible... Deuxièmement, comme on l'a vu dans l'affaire qui a récemment occupé les médias, la prescription est, paradoxalement, un facteur de parole : c'est lorsque les faits sont prescrits que certains parlent. Troisièmement, certains, sachant que les faits seront bientôt prescrits, se mettent à parler.
À ce stade de nos réflexions, mis à part la question de l'âge, sur laquelle certains de mes collègues déposeront peut-être un amendement, l'architecture générale de la proposition de loi, intégrant les propositions de modifications de Marie Mercier, nous semble intéressante. Cependant, nous estimons qu'il convient d'ajouter, dans la définition du viol, les rapports buccaux-génitaux, la pénétration pouvant être effectuée sur la personne de l'auteur. En outre, nous proposerons probablement un allongement de la prescription concernant la non-dénonciation de mauvais traitements ou d'agressions sexuelles, qui est un outil très intéressant.
En résumé, nous sommes plutôt favorables au texte, enrichi des amendements de Mme la rapporteure et des deux amendements que je viens d'évoquer, mais il y aura sans doute, au sein de notre groupe, des positions divergentes sur la question de l'âge.

Je remercie Mme la rapporteure de la finesse de son travail.
Ce texte est issu des débats que nous avons eus lors de l'examen de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment au sein de la délégation au droit des femmes, que préside Annick Billon.
Il entend marquer clairement l'interdiction d'une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de treize ans. Les associations demandent quinze ans. Cette interdiction existe déjà avec l'atteinte sexuelle, lorsqu'un majeur a une relation sexuelle avec un mineur de quinze ans, sans avoir à prouver quelque consentement que ce soit. Pour autant, le juge se pose toujours la question du consentement. Avec l'institution du crime de violence sexuelle, le consentement ne devra plus être interrogé pour les mineurs de treize ans.
La proximité entre les deux âges peut amener à considérer qu'il n'y a pas forcément de crime en cas de relation entre un jeune de quinze ans et un autre de dix-huit ans. Les enfants évoluent considérablement entre la sixième et la troisième : il n'est pas impossible qu'un élève de seconde ait des relations avec un jeune de terminale... En revanche, on n'imagine pas une relation entre un jeune de terminale et un sixième. Par conséquent, retenir l'écart d'âge entre treize et dix-huit ans plutôt qu'entre quinze et dix-huit ans me semble garantir plus de sécurité. D'ailleurs, dans la loi de 2018, l'écart d'âge constitue déjà un élément qui peut être pris en compte pour caractériser l'infraction.
Les associations évoquent une politique de petits pas. Sur les violences conjugales, on se rend compte que les avancées ont toujours résulté de petits pas... Toutes les avancées qui conduisent à une meilleure protection des femmes ou des enfants doivent être saluées.
En conclusion, notre travail n'est pas totalement achevé. Pour ce faire, il faudrait que la loi soit appliquée, que les procureurs et les juges entendent correctement les victimes, que les policiers et les gendarmes soient mieux formés à la prise en charge initiale. Cependant, un pas est franchi.

Merci pour ce rapport, et merci d'avoir récapitulé le débat tenu il y a trois ans. Comme tous les groupes, le nôtre est partagé. Nous laisserons donc à chacun sa liberté de vote. Il n'y a aucun doute sur la nécessité de protéger, et de mieux en mieux, nos enfants, et les mineurs en général. Mais est-il opportun, moins de trois ans après 2018, de légiférer encore sur un sujet aussi sensible et aussi lourd ? Pour ma part, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire confiance aux juges et aux jurés. Trois ans, ce n'est pas suffisant pour remettre à nouveau un tel sujet sur la table sans avoir pris le temps de consulter, d'examiner, d'écouter les jurisprudences qui ne vont pas manquer de survenir. Nous avons un système de double degré de juridiction, avec première instance et appel - et possibilité d'aller en cassation, et même jusque devant la Cour européenne des droits de l'homme. Attendons de connaître la jurisprudence, notamment de la Cour de cassation, pour décider s'il faut légiférer de nouveau.

Nous avons tous le même objectif : mieux protéger les mineurs contre les agressions sexuelles. Ce qui nous différencie, ce sont les moyens d'y parvenir. La question de l'imprescriptibilité se pose. Il n'y a pas de bonne solution, et la législation n'a cessé d'évoluer. En tous cas, il faut l'étendre à l'ensemble des crimes sur mineurs : on ne peut pas s'en tenir aux crimes sexuels. Pour la notion de viol, faire figurer les rapports bucco-génitaux me semble une bonne chose, mais je souhaiterais aussi qu'on ajoute la notion de sidération. Il faut également que l'on protège mieux les mineures qui subissent une IVG, en prévoyant la conservation de prélèvements qui pourront ensuite servir de preuves. Je travaille sur ces sujets depuis plusieurs années, et j'ai été vice-présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. J'ai donc déposé plusieurs propositions de loi et rencontré des personnes qui s'occupent de mineurs, notamment dans des hôpitaux de Saint-Germain et de Saint-Denis, et dont la presse parle régulièrement. Je sais qu'il est extrêmement difficile de produire des preuves plusieurs années après le crime.
Bien sûr, je souscris à la protection des 13-15 ans, mais on ne peut pas ignorer les débats qui ont lieu en ce moment chez nos collègues de l'Assemblée nationale sur l'âge de 13 ans pour les mineurs délinquants. La loi rappelle que c'est l'âge du discernement, et c'est un âge qui existe déjà dans notre code. Cela ne signifie pas qu'à 13 ans et un jour on n'est plus protégé... Pour que nos travaux ne restent pas limités à notre hémicycle, nous devons faire en sorte qu'ils puissent être repris. Le but n'est pas simplement de se faire plaisir ici, en disant qu'on a raison, qu'on a bien légiféré, mais de faire avancer la loi. Pour cela, nous devons nous mettre en cohérence avec un certain nombre de choses, même si nous sommes tous d'avis qu'entre 13 et 15 ans il faut améliorer la protection des mineurs. Ce n'est pas parce qu'on améliore la protection jusqu'à 13 ans qu'on la diminue entre 13 et 15 ans.

Marie Mercier a de nouveau accepté de faire un travail très difficile, de réinterroger ses propres convictions, après avoir déjà mené cette tâche il y a maintenant un peu plus de deux ans. Le résultat auquel elle aboutit est un compromis, qui nous permet de ne pas rejeter une proposition de loi inspirée par des motivations que nous partageons tous, mais dont on peut se demander, néanmoins, si elle a des chances sérieuses d'améliorer réellement la protection des enfants. Il ne faudrait pas accréditer l'idée que notre code pénal, aujourd'hui, protège les agresseurs plus que les victimes. Nous avons un corps de règles, des incriminations et des délits précis, qui sont autant d'outils familiers à la fois aux magistrats et aux avocats. Quand on modifie la loi pénale pour ajouter à des dispositifs qui sont déjà relativement complexes, on n'est pas sûr qu'on va réellement améliorer la situation des victimes qu'il s'agit de protéger. C'est pourquoi, sans faire de juridisme, on a raison d'être prudent dans ces matières. De toute façon, sur des sujets qui, sur le plan humain, sont aussi difficiles et lourds de conséquences - comme sur des sujets qui le seraient moins, d'ailleurs - le rôle du juge est absolument vital : sa capacité d'appréciation de la réalité des situations, qui sont diverses, doit absolument être préservée.
Je suis prêt à ne pas m'opposer à un texte qui ferait consensus entre nous, mais je suis sceptique. Trois points sont pour moi des limites absolument infranchissables - et qui ne sont pas franchies, ce qui me permet de ne pas m'opposer à ce texte. Premièrement, il n'y a pas d'imprescriptibilité. Celle-ci, inventée au procès de Nuremberg, est une dérogation à un principe fondamental du droit qui dit que la justice ne peut plus être rendue dans des conditions permettant d'administrer les preuves du crime ou du délit après une certaine durée. D'ailleurs, avec le système que nous avons adopté, qui ajoute à l'anniversaire des 18 ans un délai de 30 ans, nous allons déjà très loin. Pourtant, c'est parfois parce qu'il y a prescription que le souvenir de la blessure peut remonter à la surface. À cet égard, je ne suis pas certain qu'en ayant voté les 30 ans nous ayons réellement rendu service aux victimes... En tout cas, je n'irai jamais jusqu'à l'imprescriptibilité.
Le deuxième point qui serait un très grand danger pour une démocratie, c'est la présomption irréfragable. Nier la possibilité d'un examen individuel de chaque affaire, qui permette de prendre en compte les circonstances et d'apprécier la réalité, c'est se débarrasser des juges ! Ce serait la fin de la reconnaissance du rôle du juge dans la société, ce serait scandaleux !
Évitons donc de créer des dispositions pénales qui seraient des « machines à Outreau », des machines à erreurs judiciaires. Nous ne franchissons pas cette limite, et c'est heureux. Il ne faut pas hésiter à l'expliquer, malgré une forme de terrorisme du militantisme de la présomption irréfragable, qui n'est pas acceptable dans une démocratie comme la nôtre, ou dans un État de droit.
Enfin, un équilibre a été proposé par notre rapporteur sur l'inscription dans la loi pénale de seuils d'âge. On comprend sa motivation : dire qu'en dessous d'un certain âge, on ne peut pas même admettre l'idée de la relation sexuelle avec l'adulte. Tout le monde partage cette idée, mais il faut aussi s'interroger sur les effets de l'inscription dans la loi pénale de seuils d'âge. Cela signifie qu'au-dessus de cet âge, on n'aurait pas le droit à la même protection, alors même qu'on est aussi vulnérable. Marie Mercier a beaucoup consulté les pédiatres, les psychologues, les psychiatres, qui ont parfaitement mis en évidence le fait que la vulnérabilité ne dépend pas de la date de l'anniversaire. Fixer un âge peut simplifier, mais peut aussi conduire à se préoccuper de la situation de la personne victime qui est en dessous de cet âge, mais a déjà une pratique sexuelle avérée, qui n'est pas de son âge peut-être, mais enfin qui existe, et à ne pas tenir compte de la victime qui est au-dessus du seuil d'âge et qui pourtant est beaucoup plus vulnérable que la précédente. La différence d'âge est un concept utile, et qui repose sur la confiance faite au juge, lequel doit apprécier la situation pour savoir s'il y a eu agression ou non. Le consentement n'est pas un bon instrument : ce qu'on utilise en droit pénal, c'est la contrainte. Se reposer sur le consentement, c'est rendre la victime moins protégée. Se reposer sur la contrainte, c'est faire reposer la charge de la preuve sur l'agresseur.
Je suivrai les propositions de notre rapporteur - jusqu'ici, mais pas plus loin !

Il n'est effectivement pas question d'aller plus loin que ce que nous proposons !

Je remercie Mme la rapporteure de son travail tout en responsabilité et tout en finesse, alors que plusieurs affaires surgissent dans l'espace public.
Le sujet est important et sensible. Certains pensent que la proposition de loi est inaboutie. Notre groupe considère majoritairement qu'elle marque une avancée, même si le débat n'est pas clos, particulièrement sur la question de l'âge.
Le texte comble un vide juridique. Mais d'autres questions devraient être abordées d'urgence : la prévention et l'éducation sexuelle dès le plus jeune âge ; la formation des professionnels ; la récidive des auteurs de crime ou d'agression sexuelle sur mineur ; les moyens de la justice et des forces de l'ordre, mais aussi des services de protection maternelle et infantile.
Je pense que nous adopterons cette proposition de loi telle que modifiée par certains des amendements qui nous seront présentés ce matin.

Nous sommes globalement tous d'accord.
La question de l'âge va continuer à faire débat. Je m'accroche à notre idée d'écart d'âge, qui me semble extrêmement importante.
Je suis d'accord avec Dominique Vérien : on est mineur jusqu'à dix-huit ans. On sait que le passage à l'acte se fait plutôt au lycée.
Je suis d'accord avec Mme Assassi sur la formation et les moyens. Nous en avons déjà longuement débattu dans les précédents rapports, dès 2017, soit bien avant la loi Schiappa.
Il est vrai qu'il n'y a pas assez de jurisprudence, mais la politique des petits pas permet quelques avancées.
Monsieur le président, j'ai bien noté que vous n'étiez pas favorable au fait d'aller plus loin en matière d'imprescriptibilité. Il existe des barrières juridiques qui permettent au Sénat de garder sa cohérence. Il faut prendre le temps du recul, voir ce que l'on a déjà fait et ce qui est mal appliqué. La loi est mal connue de nos concitoyens. Elle est mal appliquée par les magistrats, souvent faute de moyens, raison pour laquelle ces derniers sont régulièrement amenés à correctionnaliser.

Je remercie Mme la rapporteure de son travail très intéressant.
Cette proposition de loi constitue le énième texte sur la question. L'actualité montre que nos textes n'influent pas sur le comportement de certaines personnes...
Notre groupe sera probablement favorable au seuil de quinze ans. Je suis également d'accord pour que l'on n'adopte pas l'imprescriptibilité et pour que l'on ne mélange pas les genres.
En même temps, je trouve que cette proposition de loi, en créant une infraction autonome et en punissant ces agissements de vingt ans, rend les choses beaucoup plus claires. Mais j'aurais aimé que l'acte sexuel retenu par le texte ne soit pas limité à la pénétration : un acte sexuel commis sur un mineur ne saurait être considéré comme moins grave qu'un autre. Il faudrait également que l'acte sexuel soit défini dans le texte.
EXAMEN DES ARTICLES

Concernant l'article 45, considérant que l'objet du texte est la création d'une nouvelle infraction pénale, nous estimons qu'entretiennent une relation avec l'objet du texte les amendements qui modifient d'autres infractions sur mineur prévues par le code pénal, qui procèdent à des ajustements dans le code de procédure pénale pour donner à ces infractions leur pleine efficacité ou qui sont directement en lien avec le déroulement de l'enquête judiciaire. En revanche, je vous proposerai de déclarer irrecevables les cinq derniers amendements de la liasse, qui modifient le code du sport, le code de l'éducation et le code de l'action sociale et des familles, parce qu'ils sont vraiment trop éloignés de la politique pénale.
Ensuite, je vous rappelle que le texte est inscrit dans un espace réservé ; conformément à l'accord politique passé entre les groupes, la commission ne peut donc amender le texte qu'avec l'accord de l'auteur de la proposition de loi. Je me suis entretenue avec Annick Billon, qui m'a indiqué qu'elle était défavorable aux amendements COM-3, COM-4, COM-5 et COM-1. Je vous proposerai donc de ne pas trop nous attarder sur ces quatre amendements, sachant qu'ils pourront être redéposés en séance.

Un amendement relatif à la prescription pour non-dénonciation de mauvais traitements sur un enfant est-il considéré comme entrant dans le champ du texte ?
Article 1er

L'amendement COM-3 rectifié proposer d'introduire une présomption de contrainte, en cas de rapport sexuel entre un majeur et un mineur de quinze ans, la contrainte constituant un élément constitutif du crime de viol. Depuis 2018, le fait pour un majeur d'avoir une relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans est passible de sept ans d'emprisonnement, contre cinq auparavant. Je salue cette avancée mais je pense qu'il faut aller plus loin.
Pour ma part, je souhaite que l'on parle de « contrainte », et non d'« absence de consentement », car l'auteur est seul responsable de ses actes.
Contrairement au texte qui avait été voté à l'Assemblée nationale, le dispositif que je propose est conforme au principe constitutionnel de présomption d'innocence, proclamé par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque l'infraction ne sera pas systématique, dès lors qu'il faudra prouver l'acte, la nature de l'acte et démontrer que l'auteur connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime, et à celui d'égalité devant la loi, prévu à l'article 6 de la Déclaration. En effet, ce nouveau dispositif est exclu du champ d'application de l'atteinte sexuelle sur mineur de quinze ans. Aussi, le texte que je propose suit les recommandations de l'avis du Conseil d'État du 21 mars 2018.
Cet amendement permettrait de sanctuariser la protection des mineurs de moins de quinze ans. Selon le juge Édouard Durand, « le passage à l'acte de l'adulte est une perversion du besoin affectif de l'enfant » : en aucun cas, l'enfant ne peut être consentant à une relation sexuelle. Nous devons y mettre un terme.
L'amendement ne crée pas une infraction autonome qui aurait tendance à complexifier notre droit. Que la victime soit majeure ou mineure, le viol est un crime déjà inscrit dans le code pénal.
Je propose donc de fixer une présomption de contrainte pour protéger les mineurs de moins de quinze ans lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime.

La présomption irréfragable de contrainte n'est pas la voie choisie par l'auteur du texte. Nous ne pouvons donc pas accepter cet amendement.
L'amendement COM-3 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement COM-4 rectifié est un amendement de repli, avec un seuil d'âge à treize ans.

Pour les mêmes raisons, je suis défavorable à l'adoption de cet amendement.
L'amendement COM-4 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement COM-19 a pour objet de supprimer les mots « lorsque l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime ». Cette précision est superfétatoire et pourrait amener de la confusion.
L'amendement COM-19 est adopté.
L'amendement COM-18 vise à préciser que l'infraction est également constituée si l'acte de pénétration sexuelle est commis sur la personne de l'auteur. Cela répond à la remarque de Marie-Pierre de la Gontrie.
L'amendement COM-18 est adopté.
Article additionnel après l'article 1er

L'amendement COM-5 rectifié tend à inscrire dans le texte que la contrainte est présumée dans le cas de relations sexuelles entre mineurs, si l'un d'eux a moins de quinze ans, lorsque leur écart d'âge excède deux années ou lorsque l'un exerce sur l'autre une relation d'autorité de droit ou de fait.
C'est pourquoi je proposais d'envisager que, avant l'âge de quinze ans, un mineur peut consentir à des relations sexuelles avec un partenaire mineur si celui-ci est de moins de deux ans son aîné et s'il n'exerce aucune relation d'autorité, de dépendance ou de forme d'exploitation à son endroit.

L'amendement est lui aussi refusé par l'auteur de la proposition de loi. Avis défavorable.
L'amendement COM-5 rectifié n'est pas adopté.
L'objet de l'amendement COM-20 est de préciser que la contrainte morale ou la surprise peuvent également résulter de ce que la victime mineure était âgée de moins de quinze ans et ne disposait pas de la maturité sexuelle suffisante.
C'est avec cet amendement que nous augmentons la protection des mineurs âgés de treize à quinze ans au sein de la proposition de loi.

Cela laisse naturellement aux magistrats toute latitude pour apprécier les situations au cas par cas.

Je partage l'objectif d'une meilleure protection des mineurs âgés de treize à quinze ans. Je salue cette avancée, mais je sais qu'Alexandra Louis s'oppose à cette politique des petits pas et veut tout mettre à plat, bien qu'elle ait soutenu la loi Schiappa.
Madame la rapporteur, quelle est la définition juridique de l'expression « maturité sexuelle suffisante » ?

Je comprends l'objectif de cet amendement, mais je m'interroge sur sa portée juridique.
La contrainte morale ou la surprise sont déjà des paramètres constitutifs du viol. Le dispositif me semble relever, au mieux, d'une circulaire. Je ne vois pas très bien son utilité réelle dans le code, au-delà du geste symbolique.

Cet amendement peut être considéré comme une disposition interprétative. Il complète les dispositions qui figurent déjà à l'article 222-22-1 du code pénal. Dans une décision du 6 février 2015, le Conseil constitutionnel a confirmé qu'il s'agissait bien de dispositions interprétatives.
Madame Boyer, la majorité sexuelle n'existe pas en France. On la déduit, en creux, de l'atteinte sexuelle, pour laquelle le seuil est de quinze ans.
C'est en fait la jurisprudence qui va avoir vocation à préciser la maturité sexuelle. On ne peut pas travailler cette notion sans traiter celle de « discernement ». Celui-ci diffère du consentement : il permet de distinguer le bien du mal. On peut faire preuve de discernement, mais pas forcément sur tous les sujets. Les collégiens ne sont pas dans une sexualité installée. À cet égard, les expertises psychologiques sont extrêmement importantes. Il faut être très prudent avec la notion de discernement.

La « maturité sexuelle suffisante » est davantage une notion médicale. Que signifie-t-elle pénalement ?

La maturité, c'est quand on a conscience. La maturité sexuelle, c'est quand on a conscience de la portée et des implications d'un rapport sexuel.

Ne peut-on pas considérer qu'il s'agit d'un concept nouveau ? Il sera très important, si nous le faisons entrer dans la loi, de donner des explications précises. Il faudra décrire de manière détaillée les implications de son inscription dans la loi pénale, pour guider le juge et les avocats dans l'application de celle-ci.

La maturité est, pour un individu, la conscience de l'acte qu'il va commettre, c'est-à-dire la capacité à en mesurer l'aspect positif comme l'aspect négatif et donc à pouvoir porter un jugement éclairé sur celui-ci.
Il appartiendra aux magistrats de déterminer, en se fondant sur les expertises psychiatriques ou psychologiques, si, au moment où le fait reproché a été commis, l'enfant mineur avait conscience ou non de l'engagement qu'il prenait. Ce travail est extrêmement délicat, mais les magistrats le font tous les jours dans leur appréciation des situations.

Nous allons également évoquer le discernement dans le texte sur le code de la justice pénale des mineurs.
On parle depuis longtemps de discernement, sans que celui-ci soit défini dans la loi. Cela n'empêche pas que le terme soit déjà utilisé ! Dès lors, pourquoi n'utiliserions-nous pas le mot « maturité sexuelle » ?

Cet amendement est une disposition interprétative : c'est une piste qui est donnée. Il ne mérite pas que l'on se tourmente excessivement.
L'amendement COM-20 est adopté.
Articles additionnels après l'article 4

L'amendement COM-15 vise à ajouter dans la définition du viol la notion de sidération. Celle-ci est un blocage total qui protège de la souffrance en la distanciant. On entend souvent que les victimes n'ont pas bougé, qu'elles n'ont rien dit...
Annick Billon ne semblait pas opposée à cette précision de la définition.

Effectivement, elle n'est pas opposée à ce que l'on réfléchisse à cette proposition.
Cependant, celle-ci revient à adopter le point de vue de la victime et à retenir comme élément constitutif de l'infraction une donnée purement subjective. Cela prive l'agresseur de toute possibilité de se défendre.
Je comprends l'intention de cet amendement, mais, en l'état, il me semble compliqué de l'adopter. La discussion pourra continuer.

Je rappelle que c'est Muriel Salmona, qui a défini l'amnésie traumatique et qui a fait évoluer notre droit, qui insiste pour que la notion de sidération soit intégrée dans la définition du viol. Cette notion est totalement définie.
Je n'ai pas compris en quoi elle attentait à la défense de l'auteur des faits de viol, d'autant que la surprise fait partie de la définition du viol.
Les violeurs disent toujours qu'ils ne connaissaient pas l'âge de la victime et que celle-ci ne s'est pas défendue. De fait, celle-ci est sidérée. C'est ce que décrit Muriel Salmona.

Il faut être respectueux des droits des victimes, mais aussi des droits de la défense.
J'ai beaucoup discuté avec Muriel Salmona. Ce sont les neurosciences qui permettront d'apporter la preuve scientifique de l'existence de l'amnésie post-traumatique, mise en évidence par l'armée américaine avec la guerre du Vietnam. On sait aussi que peuvent se mettre en place dans le cerveau des dispositifs complexes de suggestion et d'autosuggestion.
L'amnésie traumatique n'étant pas encore démontrée scientifiquement, il n'est pas encore possible de l'inscrire dans la loi. Nous devons être prudents.
L'amendement COM-15 n'est pas adopté.
Les amendements COM-1 rectifié, COM-6 rectifié et COM-2 rectifié ont trait à l'imprescriptibilité.
Je rappelle que celle-ci ne s'applique qu'à des crimes contre le genre humain.
Les amendements COM-1 rectifié, COM-6 rectifié et COM-2 rectifié ne sont pas adoptés.
À fin de coordination, l'amendement COM-21 vise à faire figurer le nouvel article 227-24-2 du code pénal, instituant l'infraction de crime sexuel sur mineur à l'article 706-47 du code de procédure pénale.
L'amendement COM-21 est adopté.
L'amendement COM-10 rectifié bis concerne le Fijaisv : il tend à élargir la liste des infractions qui peuvent être inscrites à ce fichier.
Cet outil, qui a fait ses preuves, peut encore être enrichi.
Toute personne peut demander à être effacée du fichier, mais l'inscription n'est pas sans conséquence : elle empêche d'exercer certaines activités, oblige à se rendre à la gendarmerie...
L'amendement COM-10 rectifié bis est adopté.
Complémentaire du précédent, l'amendement COM-17 rectifié tend à un élargissement de la liste des décisions qui sont automatiquement inscrites au Fijaisv. J'y suis également favorable.
L'amendement COM-17 rectifié est adopté.
Mme Billon est défavorable à l'amendement COM-16.
L'amendement COM-16 n'est pas adopté.
L'amendement COM-11 rectifié bis a pour objet d'instaurer une peine complémentaire d'interdiction de contact avec les mineurs. Je suis favorable à cette mesure, que nous avions approuvée en 2018.
L'amendement COM-11 rectifié bis est adopté.
L'amendement COM-7 rectifié vise à un prélèvement sur les tissus embryonnaires après une IVG. Il nous paraît difficile de statuer sur cette question délicate actuellement. Je sollicite le retrait de l'amendement.

Je ne retirerai pas cet amendement, que je défendrai en séance.
Il me paraît important que l'on propose aux mineures victimes de crimes sexuels subissant une IVG de garder une preuve de celui-ci pour le cas où elles souhaiteraient agir en justice ultérieurement. Cette proposition leur serait faite au cours de la consultation préalable à l'intervention, obligatoire pour toutes les mineures.

Cet amendement me paraît extrêmement problématique. J'ignore s'il est recevable au regard de l'article 45 et de l'article 40 de la Constitution. En tout état de cause, je trouve problématique que l'on considère par principe qu'une mineure qui décide d'avoir recours à une IVG puisse être amenée à engager des poursuites judiciaires.
Au reste, la rédaction est assez floue : on ne sait pas qui décide du prélèvement.
Cet amendement mélange la protection des mineurs contre les agressions sexuelles et l'accès à l'IVG.

La rédaction est à peut-être à revoir, mais je souhaite que l'on retienne l'idée, portée notamment par la Maison des femmes de Saint-Denis et celle de Saint-Germain. C'est à leur demande que j'ai travaillé sur cette question.
Il est important que l'on autorise les mineures à prélever et à conserver des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux après une interruption de grossesse dans la perspective d'une éventuelle poursuite pénale ultérieure. Cela peut aussi permettre aux personnes frappées d'amnésie traumatique de disposer d'une preuve. Je ne vois pas pourquoi on les priverait de savoir ce qui leur est arrivé, alors que l'on est en train de réfléchir à l'imprescriptibilité.
Ce dispositif est cohérent avec les discussions que nous avons eues. Je conçois que ce soit compliqué, mais je souhaite aujourd'hui que nous ayons ce débat. Il s'agit de protéger les victimes et, surtout, de leur permettre d'avoir une réparation, ne serait-ce que psychologique.
L'objet de l'amendement n'est pas du tout de restreindre l'accès à l'IVG. Au contraire, il est de mieux protéger les victimes dans le temps.

Nous travaillons depuis longtemps sur ces sujets très difficiles. Nous avons toujours débattu avec beaucoup de respect et de sérénité, en nous enrichissant mutuellement de nos approches et de nos expériences. C'est ainsi que nous avons pu faire évoluer les choses.
Cet amendement vise à autoriser le prélèvement de tissus embryonnaires, après une IVG réalisée sur une jeune fille mineure, dans le but de réaliser des analyses génétiques permettant de confondre plus facilement l'auteur d'un viol dans le cas où une procédure judiciaire serait ouverte ultérieurement.
Actuellement, le code de la santé publique n'autorise ces prélèvements qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. De plus, un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la femme ayant subi l'IVG est mineure, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse. Cet amendement introduit donc une double rupture par rapport aux principes posés par le code de la santé publique : le prélèvement ne serait pas réalisé à des fins médicales ou scientifiques et les mineures seraient expressément concernées.
Il paraît difficile de statuer sur cette question très délicate, aux confins de la bioéthique, sans avoir sollicité des avis extérieurs. Je me demande en particulier s'il ne serait pas opportun d'encadrer un peu plus le dispositif, en le réservant à des situations laissant penser qu'une infraction a été commise, après un dépôt de plainte par exemple.

Cela pose également un problème de gestion de la preuve et fait naître un risque de mise en cause de personnes, alors même que l'on ne sait pas ce qui s'est passé au moment où l'acte a été commis. L'idée peut paraître intéressante, mais il convient de l'expertiser de manière très approfondie, d'en regarder très précisément toutes les conséquences et de cadrer le dispositif juridiquement.
Au reste, une décision aussi importante nécessite que l'on ouvre le débat avec d'autres commissions, notamment la commission des affaires sociales.
L'amendement COM-7 rectifié n'est pas adopté.
Les amendements COM-8 rectifié bis, COM-9 rectifié bis, COM-12 rectifié bis, COM-13 rectifié bis et COM-14 rectifié bis sont irrecevables en application de l'article 45 de la Constitution.
La proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Le sort des amendements examinés par la commission est retracé dans le tableau suivant :

Nous entendons maintenant, en visioconférence, M. Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux, Mme Hélène Fontaine, présidente de la Conférence des bâtonniers, M. Olivier Cousi, bâtonnier du barreau de Paris, M. Benoît Chabert, président de la Confédération nationale des avocats, Mme Estellia Araez, présidente du Syndicat des avocats de France, et Mme Catheline Modat, présidente de la Fédération nationale des unions de jeunes avocats.
Nous avons entendu le 16 décembre dernier M. Dominique Perben, chargé par Mme Nicole Belloubet, alors garde des sceaux, de présider une mission de réflexion sur l'avenir de la profession d'avocat, dans le contexte de la mobilisation contre la réforme des retraites.
Le rapport de cette mission a été remis au nouveau garde des sceaux, Éric Dupond-Moretti, le 26 août dernier. Il comporte treize recommandations, autour de trois axes : l'amélioration de la situation économique des avocats ; l'évolution de l'offre des avocats ; l'amélioration des relations entre les magistrats et les avocats.
Un groupe de travail présidé par la professeure Sandrine Clavel et Me Kami Haeri a également réfléchi au sujet plus spécifique de la formation des avocats, et remis son rapport au garde des sceaux le 6 octobre 2020.
La commission des lois du Sénat est pleinement consciente des difficultés rencontrées par la profession, en particulier par les avocats exerçant une activité judiciaire, lesquelles ont été amplifiées par la crise sanitaire.
Nous souhaitons poursuivre le travail de réflexion sur la vision que nous pourrions construire de la profession d'avocat et sur les évolutions législatives qui pourraient être nécessaires.
Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser la parole à tour de rôle pour un propos liminaire d'environ cinq minutes, puis, dans un second temps, nos collègues, en commençant par les rapporteurs pour avis du budget de la justice, Mmes Canayer et Vérien, vous adresseront quelques questions.
Je ne pourrai pas assurer l'ensemble de la présidence de cette réunion : Mme Di Folco, vice-président de la commission des lois, me remplacera.
J'ai d'excellents souvenirs de mes auditions devant la commission des lois du Sénat et vous remercie sincèrement de cette nouvelle invitation.
La nouvelle mandature du Conseil national des barreaux (CNB) va continuer à travailler suivant les lignes directrices arrêtées par le CNB lors de la précédente mandature. En termes de méthodologie, nous participons aux auditions toujours accompagnés du bâtonnier de Paris, Olivier Cousi, et de la présidente de la Conférence des bâtonniers, Hélène Fontaine. C'est un signe important pour vous, élus de la République, de savoir qu'autour de l'institution représentative qu'est le Conseil national des barreaux, les grandes forces Paris-province de la profession sont toujours unies.
Je me réjouis que vous nous auditionniez en même temps que les syndicats de la profession avec lesquels nous collaborons.
La mission Perben avait été instituée en pleine période de lutte de la profession sur la problématique des retraites, laquelle avait fait ressurgir avec une acuité particulière la nécessité de se pencher sur l'économie, les développements et l'avenir de notre profession d'avocat.
Le rapport Perben, au travers des propositions qui y sont formulées, est très pragmatique et bienveillant. Nous avons eu le sentiment d'avoir été écoutés, qu'une analyse avait été faite et des propositions concrètes formulées, ce qui diffère de la façon dont nous avions été entendus pendant plusieurs mois sur le sujet des retraites ou sur la réforme de la justice. Nous avions alors face à nous des pouvoirs publics qui ne comprenaient pas les évolutions de la profession d'avocat et ses revendications, qui étaient non pas pleurnichardes, mais légitimes.
Nous nous satisfaisons globalement de la façon dont les travaux ont été menés, aussi bien en termes de composition de la mission que de propositions qui en sont ressorties, dont certaines correspondent parfois mot à mot à des propositions validées par le Conseil national des barreaux.
Il faut voir comment ces propositions, sur lesquelles vous avez également travaillé, peuvent être mises en place. Comme elles sont bénéfiques pour les avocats, elles le seront également pour les citoyens et les justiciables, car l'activité des avocats est importante pour une justice de qualité.
On parle du recouvrement des honoraires, des évolutions de l'article 700 du code de procédure civile, mais aussi des questions d'égalité homme-femme, de formation initiale, d'association des avocats à la vie des juridictions, d'aide juridictionnelle. Ces questions ont vraiment été appréhendées par le groupe de M. Perben davantage que par les pouvoirs publics. Le ministre a certes fait des efforts, mais ils sont manifestement insuffisants. La comparaison entre ce que le ministre promet et les besoins actés dans le rapport est assez édifiante.
Je le redis, il faut maintenant passer du discours aux actes. Le ministre de la justice a évoqué un projet de loi dont les contours ne sont pas encore définis. Il serait intéressant que nous puissions y introduire un certain nombre d'évolutions avec le soutien des parlementaires, particulièrement du Sénat. Certains sujets sont récurrents, comme la force exécutoire de l'acte d'avocat qu'il serait intéressant de reprendre soit dans le projet de loi soit dans des amendements qui pourraient être adoptés avec votre appui.
Pour terminer, je veux dire que nous avons le sentiment, depuis plusieurs années, d'être mieux compris par votre commission et par le Sénat de manière générale que par d'autres. Je le dis en toute sincérité, et non pour vous flatter, mesdames, messieurs les sénateurs !
Merci pour cette invitation. Il est important que nous puissions être entendus tous ensemble : cela correspond à la façon de travailler de la mandature précédente, qui est reprise par la nouvelle.
En ce qui concerne le rapport Perben, les différents sujets évoqués avaient déjà été traités de façon approfondie par la profession, tant par le CNB que par la conférence des bâtonniers et le barreau de Paris. Nombre de propositions du rapport ont été reprises, quelquefois mot pour mot, de propositions faites par la profession. Certaines constituent vraiment une avancée : je pense à la force exécutoire de l'acte d'avocat, quelquefois décriée, mais pour laquelle nous nous sommes beaucoup battus.
J'évoquerai deux points essentiels du rapport.
L'aide juridictionnelle est une question extrêmement importante pour les avocats qui font du judiciaire. Dans le contexte de la réforme des retraites, il a été mis en lumière qu'une partie de la profession travaillait énormément sans être payée en conséquence. Le Gouvernement a relevé le montant de l'unité de valeur (UV). Dans le rapport Perben, il était proposé de porter ce montant à 40 euros, mais le Gouvernement l'a fixé à 34 euros. Il reste beaucoup à faire pour que le travail des avocats puisse être le plus possible payé à son juste prix. Les avocats sont toujours perdants, alors même qu'ils travaillent à perte. Il y a eu des avancées, mais elles ne sont pas satisfaisantes pour le moment.
La profession travaille beaucoup sur les modes alternatifs de règlement des différends (MARD). La procédure participative a été mise en place, notamment la procédure participative aux fins de mise en l'état. Si l'on veut que cela marche, il faut des incitations. Cela a été le cas pour la médiation, qui est passée à 12 UV. Il faut aller dans le même sens maintenant pour la procédure participative.
En ce qui concerne la force exécutoire de l'acte d'avocat, il s'agit d'une demande ancienne de la profession, qui a enfin été évoquée dans le rapport Perben. L'acte d'avocat est bien utilisé. Les avocats travaillent maintenant d'une autre façon : le divorce par consentement mutuel par acte d'avocat est un véritable succès. Mais il manque à l'acte d'avocat cette force exécutoire pour obtenir une égalité de traitement. Par exemple, pour la procédure participative de mise en l'état, il y a, d'un côté, une mise en l'état régalienne, qui va jusqu'au bout, et, de l'autre, une mise en état conventionnelle, qui ne va pas jusqu'au bout. Dans certains pays européens, cette force exécutoire est prévue. L'acte d'avocat offre une sécurité juridique accrue, comme l'a relevé l'Autorité de la concurrence.
La proposition de donner force exécutoire à l'acte d'avocat a été formulée dans le rapport Perben en cas d'accord entre les parties, notamment pour ce qui concerne tous les modes de règlement alternatif des différends.
La profession a fait un travail approfondi sur cette question. Donner une force exécutoire débloquerait la situation économique dans les cabinets d'avocats : elle permettrait à notre profession d'avancer en travaillant autrement.
Nous souhaitons que le rapport ne reste pas lettre morte. Beaucoup d'éléments sont extrêmement précieux, notamment sur le secret professionnel.
J'ajouterai ma voix au concert des propos du président Gavaudan et de la présidente Fontaine sur l'unité de la profession, qui sort renforcée des difficultés que nous avons vécues en 2020.
Le rapport Perben note l'augmentation considérable de la demande de droit dans la société, pour des raisons juridiques et judiciaires, de transparence, de compliance, de respect des règles environnementales, etc. La profession fait également le constat qu'elle n'a pas suffisamment développé son offre : pour proposer davantage de services juridiques et judiciaires, la profession doit avancer dans le sens des orientations du rapport Perben.
Nous entrons, pour cette nouvelle mandature, dans une période de propositions de la profession et de travail sur son évolution, avec les questions de secret professionnel, de formation, de discipline et d'organisation.
Nous avons le rapport Perben, le rapport Clavel, les propositions du garde des sceaux, des initiatives prises par des députés ou des sénateurs... Mais il manque un pilote. Le nouveau garde des sceaux nous apportera peut-être des réponses, mais nous avons le sentiment que de ne pas être suffisamment consultés en amont des propositions de réforme, qu'elles concernent la profession d'avocat ou la justice en général.
Nous sommes des juristes, des experts, des techniciens de la procédure et du droit. Pourtant, la profession d'avocat n'est pas consultée de manière systématique par les assemblées ou par le Gouvernement sur des questions purement juridiques. Pour prendre un exemple très récent, lorsque le projet de loi Avia sur la haine en ligne avait été proposé, des avocats, des spécialistes de la matière, avaient alerté sur le caractère anticonstitutionnel de ce texte. Il nous avait été répondu qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car le Conseil d'État n'avait pas trouvé à redire au projet de loi. Il se trouve que le Conseil constitutionnel a sanctionné ce texte...
Il faut signaler l'utilité des avocats pour la fabrication de la loi. Nous avons, et nous sommes les seuls, la capacité de vous donner des éléments sur le retour d'expérience des lois que vous votez. Par les relations que nous avons avec nos clients, personnes physiques ou personnes morales, nous avons connaissance des insatisfactions, des déceptions ou éventuellement des inquiétudes des Français.
Exemple très parlant, celui de la réforme de la procédure d'appel, avec le décret dit Magendie. Il faut peut-être faire un état des lieux de ces procédures. De ce point de vue, nous devons, et nous pouvons, être force de propositions à vos côtés.
Enfin, la profession d'avocat est perçue comme une activité judiciaire. Nous avons beaucoup souffert pendant le premier confinement de ne pas avoir la possibilité de travailler puisque les juridictions étaient fermées. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait que, particulièrement au barreau de Paris, 70 ou 75 % de l'activité des avocats est uniquement consacrée au conseil juridique. Il faut prendre en compte cet aspect pour aborder la question du périmètre de la consultation juridique et du droit. Comment maintenir les avocats au centre du système judiciaire, mais également de la perception juridique de nos concitoyens ? Nous devons éviter la concurrence perçue comme déloyale d'autres professions ou des plateformes en ligne de legal tech, par des entreprises qui ne respectent pas la déontologie, voire parfois le droit français.

Monsieur le bâtonnier, nous sommes sensibles à votre propos. La commission des lois du Sénat, bien avant que je ne la préside, a toujours pris soin d'auditionner la profession sur les différentes thématiques que nous devions traiter, singulièrement sur le texte relatif à la réforme de la justice. Vous avez trouvé dans cette maison des soutiens forts. Nous avons été à vos côtés, comme aux côtés des magistrats et des greffiers, pour défendre ce qui faisait notre ADN commun sur le rôle de la justice, son fonctionnement et la défense des intérêts des justiciables.
Sans doute pouvons-nous faire plus. Notre réunion d'aujourd'hui montre notre souci de mener un travail collectif - je tiens à vous rassurer !
Je vous en remercie. Je veux également signaler la présence, en ligne, de Me Emmanuel Raskin, qui représente le syndicat Avocats conseils d'entreprises (ACE).
- Présidence de Mme Catherine Di Folco, vice-président -
Après celle de nos représentants - le président du Conseil national des barreaux, la présidente de la conférence des bâtonniers et le bâtonnier du barreau de Paris -, qui fédèrent notre profession, voici la parole des syndicats, c'est-à-dire des structures qui défendent, au nom de leurs adhérents, des idées précises. Sachez néanmoins que toutes les personnes qui sont devant vous travaillent de concert ; le Conseil national des barreaux, la Conférence des bâtonniers et le bâtonnier du barreau de Paris travaillent ensemble et ces institutions sont toujours à l'écoute des syndicats. Par ailleurs, même si les idées défendues par les différents syndicats ne sont pas toujours les mêmes, nous désirons unir nos idées et les promouvoir.
La Confédération nationale des avocats (CNA) a cent ans d'existence ; elle regroupe des avocats orientés plutôt vers le judiciaire que le conseil, avec une vision enracinée dans les grands principes de la profession.
Nous avons été entendus par la commission Perben ; nous avons émis des propositions, dont beaucoup ont été suivies. La CNA avait à peu près les mêmes idées que les autres syndicats, mais je veux dire notre position sur les treize recommandations du rapport.
Sur l'aide juridictionnelle, la recommandation est bonne, mais il faut aller plus loin ; je rejoins les propos d'Hélène Fontaine et Jérôme Gavaudan à ce sujet.
Le renforcement de l'efficacité des ordonnances de taxation des honoraires du bâtonnier est essentiel. Cela peut paraître anecdotique, mais il est crucial qu'un avocat puisse recouvrer rapidement ses honoraires lorsque le bâtonnier les fixe.
J'en viens à la réforme de l'article 700 du code de procédure civile ; il s'agit de la possibilité pour un juge d'obliger la partie perdante à payer les frais d'avocat de la partie gagnante. Aujourd'hui, c'est une faculté laissée à la libre appréciation du juge. Il est proposé d'imposer la production de nos factures au juge pour qu'il puisse statuer sur des éléments précis. C'est une excellente idée, mais c'est dangereux, parce que le juge n'a pas non plus vocation à taxer les honoraires ; le CNB, la Conférence des bâtonniers et le barreau de Paris devraient rechercher une solution permettant d'empêcher le juge de fixer arbitrairement le montant à payer. Tout cela reste à définir.
Sur la protection des collaborateurs de cabinet, nous sommes d'accord à 100 % ; il faut mettre en place, dans les barreaux, des contrats groupés d'assurance de collaboration.
Sur l'égalité homme-femme au sein de la profession, nous sommes d'accord avec les propositions qui sont faites.
Sur la réforme de la procédure d'appel, nous sommes aussi d'accord. Aujourd'hui, la responsabilité de l'avocat peut être engagée à tout moment en raison de délais très stricts. Le rapport précise que ces délais, qui devaient raccourcir le temps de l'appel, ont été totalement inefficaces, car les procédures sont toujours longues, entre deux et trois ans.
Sur la formation des avocats, nous sommes également d'accord, mais il faut aller plus loin.
Sur le renforcement de l'efficacité des modes amiables de règlement des différends et l'acte d'avocat exécutoire, je souscris à ce qui disait Me Fontaine.
En revanche, nous voyons un grand danger dans la modification de la définition de la consultation juridique. Actuellement, la consultation juridique consiste en un travail de recherche et en la production d'une consultation écrite ; c'est une prestation intellectuelle. Le rapport propose que l'expression « prestation intellectuelle » disparaisse pour que la consultation juridique recouvre également l'opération consistant à appuyer sur un bouton d'ordinateur ; la consultation pourrait alors être faite par une machine. Il faut être très prudent.
Sur le financement des cabinets, la CNA n'a jamais été favorable à l'introduction de capitaux extérieurs dans les structures d'avocats, c'est-à-dire à la possibilité, pour un fonds d'investissement, de devenir actionnaire d'un cabinet d'avocats. Il est précisé dans le rapport que l'apporteur de capitaux pourrait ne pas être associé et ne pas avoir de droit de vote, mais, ne soyons pas naïfs, lorsqu'un financier apporte des capitaux, il a forcément une influence dans la direction d'une structure.
Sur le reste, nous sommes absolument d'accord.
Nous sommes favorables à la participation des avocats à la vie des juridictions. Aujourd'hui, lorsqu'un avocat appelle un juge, on lui répond parfois que celui-ci ne parle pas aux avocats. Le dialogue disparaît, ce qui aboutit généralement au conflit. Il est très important de rétablir le dialogue entre avocat et magistrat et la mise en place de temps annuels de concertation entre le bâtonnier local et le président du tribunal est une excellente idée.
En ce qui concerne l'accès des avocats à la magistrature judiciaire, sachez qu'un avocat qui veut devenir magistrat fait un stage de trente-deux mois sans être rémunéré, à l'issue de quoi on peut lui annoncer qu'il n'est pas intégré à la magistrature. Cela en fait hésiter certains pour s'engager dans cette carrière...
Enfin, nous sommes très attachés au secret professionnel. Ce n'est pas du corporatisme ; simplement, les ordres professionnels, les bâtonniers, les conseils de discipline sont là pour sanctionner les avocats qui commettent des fautes. Il n'est pas envisageable de substituer à cette juridiction ordinale une autre juridiction qui porterait un regard moral sur les actes d'un avocat. Le secret professionnel, seul moyen de garantir la liberté de nos clients et la spécificité de notre métier, doit être contrôlé par le bâtonnier. En le supprimant, on décrédibiliserait le bâtonnier et on transformerait l'avocat en un simple prestataire de services. Si nous prêtons serment, c'est parce qu'il y a des règles, dont le respect est surveillé par l'organe qui nous représente, le bâtonnier de notre ordre, et elles sont organisées par la conférence des bâtonniers et par le CNB. Nous sommes une profession réglementée et non des prestataires comme les autres.
Le syndicat des avocats de France (SAF) représente la partie de la profession qui s'occupe essentiellement de procédure judiciaire et qui travaille beaucoup à l'aide juridictionnelle, non par choix, mais parce que nos adhérents sont spécialisés dans des contentieux où de nombreux justiciables sont éligibles à cette aide : baux, consommation, droit des étrangers ou droit du travail du côté salarié.
L'avenir de notre profession passe par le respect de notre indépendance, que le Gouvernement semble vouloir mettre à mal. Je vais en donner trois exemples.
On a d'abord l'impression qu'il veut s'immiscer dans la réforme de la formation initiale des avocats, au travers du groupe de travail sur la formation des avocats, présidé par Sandrine Clavel et Kami Haeri, dit « Clavel-Haeri », alors que le CNB, notre institution représentative, a déjà une commission chargée de cette formation. J'y reviendrai.
Second exemple de l'immixtion des pouvoirs publics dans notre profession : la réforme de la discipline. Les pouvoirs publics veulent contrôler notre discipline en édictant nos règles déontologiques. Cela inquiète beaucoup la profession.
Enfin, dernier exemple : le projet de loi qui est envisagé par la Chancellerie, dans lequel le garde des sceaux formule des propositions qui ne sont pas souhaitées par la profession, plutôt que de mettre oeuvre celles que nous avons formulées lors des états généraux sur l'avenir de la profession d'avocat.
Pour garantir l'avenir de la profession, il faut améliorer l'indépendance économique des cabinets, donc assurer une rémunération décente des confrères qui acceptent de travailler à l'aide juridictionnelle. Il faut en outre que cette aide couvre mieux, dans l'intérêt du justiciable, des champs actuellement très mal indemnisés ; je pense aux petits litiges dans lesquels les enjeux financiers sont faibles. D'où la proposition, déjà ancienne, de créer des groupes de défense, financés par une majoration de la subvention allouée aux ordres au titre de l'aide juridictionnelle. Ces groupes permettraient de mieux indemniser les avocats confrontés à des contentieux techniques, qui exigent beaucoup de travail. Cette solution permettrait de mieux rémunérer les confrères et d'améliorer la qualité des prestations.
L'avenir de la profession passe également par l'amélioration de notre protection sociale ; la crise sanitaire l'a révélé. La profession a des propositions à faire en la matière.
L'indépendance passe aussi par la cessation des réformes législatives permanentes, tant sur le fond du droit que sur la procédure. La réforme de la procédure d'appel est un bon exemple ; cette réforme n'a aucunement amélioré les délais de procédure - au contraire - et elle a engendré des problèmes procéduraux pour les avocats et les magistrats.
Le SAF a émis des propositions, transmises depuis de nombreux mois au garde des sceaux et au directeur des affaires civiles et du sceau, pour réformer la procédure Magendie et simplifier les procédures d'appel au bénéfice des acteurs de justice et des justiciables, qui subissent un déni de justice à cause de chausse-trappes n'ayant d'autre intérêt que de limiter le nombre de dossiers.
Il faut donc stopper ces réformes législatives incessantes, mais il faut aussi améliorer le fonctionnement des juridictions. Pour que les avocats aient un avenir, travaillent correctement et gagnent de l'argent, les délais de procédure doivent être raccourcis. Les justiciables ne souhaitent pas attendre 18, 24 voire 36 mois pour que leur litige soit tranché. Il faut des moyens supplémentaires, afin d'améliorer ces délais, la qualité de la justice et l'intelligibilité des décisions. Si les justiciables ont le sentiment que la justice ne sert à rien, ils finiront par se faire justice eux-mêmes ; nous l'avons perçu pendant la crise des gilets jaunes.
Enfin, il faut se pencher sur la réforme de la formation initiale des élèves-avocats. On entend dire que les avocats sont trop nombreux ; ce n'est pas la question, le problème est que les avocats sont mal formés, car la formation initiale est financée non par l'État, mais par la profession. Il y a une solution simple à ce problème : le contrat d'apprentissage. Cela résoudrait la question du financement de la formation des élèves-avocats ; surtout, cela donnerait leur un statut, dont ils sont aujourd'hui privés. La formation en serait meilleure, car les élèves-avocats feraient, toute l'année, des allers-retours entre l'école et le cabinet.
La mission Clavel-Haeri se trompe en indiquant qu'il faut raccourcir la formation ; il faut la maintenir et en améliorer la qualité. On dit que les élèves ont hâte de se confronter à la vie professionnelle, mais ils n'ont pas de rémunération ; le contrat d'apprentissage répondrait à ces deux problèmes. La durée de la formation ne serait plus un handicap. Le SAF a étudié la faisabilité de cette formation en alternance ; nous avons envoyé cette étude à nos institutions représentatives et au garde des sceaux. Nous la tenons à votre disposition, mesdames et messieurs les sénateurs.
Enfin, il faut améliorer la protection des collaborateurs, qui se trouvent dans une situation complexe quand leur contrat de collaboration est rompu, ce qui peut se faire très facilement. Ils ne bénéficient pas de l'assurance chômage, ce qui est normal s'agissant d'une profession libérale et indépendante, mais ils devraient pouvoir bénéficier de couvertures supplémentaires, notamment d'un contrat d'assurance contre la perte de collaboration, qui doit être étendu à tous les barreaux et mutualisé.
La Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) a vocation à regrouper de jeunes avocats, mais pas uniquement. Nous comptons des confrères qui exercent une activité judiciaire et des avocats ayant une activité de conseil, dans des barreaux de différentes tailles. La population de nos adhérents est très diversifiée et représente bien la population des avocats.
Sur le rapport Perben, nous avons plusieurs observations à formuler. La mission confiée à notre confrère Dominique Perben était très ambitieuse ; malheureusement, il n'a peut-être pas eu le temps de conduire sa mission dans les meilleures conditions en raison de la crise sanitaire, puisqu'il a été missionné le 9 mars et a remis son rapport en août.
La manière dont Mme la garde des sceaux a analysé notre profession me paraît intéressante. Elle indique dans sa lettre de mission que son objectif est de « garantir aux avocats, dont la spécificité professionnelle est le fondement de notre démocratie, leur indépendance, leur liberté d'exercice, leur autonomie de fonctionnement, la viabilité de toutes les structures ». Elle identifie donc bien la spécificité de la profession, liée à notre statut de profession réglementée soumise à une déontologie, qui encadre tous nos actes, dans notre exercice professionnel et dans notre vie personnelle. Ces règles n'existent pas pour nous contraindre ; elles sont surtout là pour protéger nos clients.
Je ne vous cache pas qu'après avoir lu ce rapport avec beaucoup d'intérêt, nous y avons vu un manque d'ambition, ou à tout le moins nous aurions aimé qu'il aille plus loin. Certes, certaines propositions demandées depuis de nombreuses années par la profession sont reprises, notamment celles relatives à l'acte d'avocat, à l'exécution provisoire de la taxation des honoraires ou encore à la revalorisation de l'aide juridictionnelle.
Concernant la proposition de créer un observatoire de l'égalité homme-femme au sein de la profession, je voudrais dire que nous sommes déjà allés beaucoup plus loin en pratique. Par exemple, nous avons pris des mesures quant à l'égalité, non pas simplement homme-femme, mais par exemple en faveur des personnes en situation de handicap. De nombreux travaux ont été faits à cet égard au cours de la mandature précédente. Il faut donc nous écouter en amont : la profession a déjà avancé sur de nombreux sujets et elle est allée plus loin que les préconisations du rapport Perben, qui nous semble manquer d'ambition.
Par ailleurs, nous regrettons que cette réflexion sur l'avenir de la profession aborde la question de la collaboration uniquement sous l'angle de la rupture de contrat. Certes, nous sommes une profession d'indépendants et libéraux et ne bénéficions pas de l'assurance chômage. Et, en effet, se pose la question d'une assurance collective de la profession. Mais la collaboration, période de début d'activité, permet de mettre le pied à l'étrier des jeunes confrères pour le développement de leur activité.
En ce qui concerne la situation économique des confrères, d'autant plus compliquée durant l'année 2020, le rapport pointe une incapacité récurrente à nous imposer sur de nouveaux champs d'activité. Il me semble, au contraire, que la profession a multiplié son offre. La vision de notre profession est donc très critique et pessimiste. Les avocats sont pourtant novateurs : nous accompagnons nos clients dans l'évolution de leurs activités et nous savons également faire évoluer la nôtre, dans la cadre de nos règles déontologiques. C'est l'un des objectifs de chaque assemblée générale du CNB, nous oeuvrons pour qu'il y ait un avocat dès qu'il y a un besoin de droit.
En revanche, je suis en accord avec Dominique Perben sur le constat d'un accès limité à la justice, en raison des faibles capacités d'accueil. En effet, nous ne pouvons pas être satisfaits des délais de procédure : nous les subissons, tout comme les justiciables. Mais la capacité du système judiciaire à recevoir et à traiter les demandes de justice dans des délais acceptables n'est pas un paramètre que la profession peut maîtriser, puisque cela relève des pouvoirs publics. Nous sommes confrontés, chaque jour, à la carence des moyens de la justice, qui est la cause de notre absence de fonctionnement durant le premier confinement. La profession était prête à fonctionner, mais pas les juridictions - je ne jette pas la pierre aux magistrats. L'amélioration des moyens de la justice permettra de ne pas décourager certains justiciables de saisir la justice.
En matière de développement de l'activité, il me semble que nous avons su investir : nous sommes allés chercher d'autres marchés. Par ailleurs, se pose la question des financements au sujet desquels le rapport préconise l'ouverture à des capitaux. La FNUJA soutient depuis de nombreuses années cette proposition dans des conditions strictement encadrées. Cette mesure a été votée en assemblée générale lors de la dernière mandature du CNB. S'il faut aller dans ce sens, il existe également d'autres moyens comme l'apport d'affaires. C'est l'occasion pour la profession d'obtenir des ressources supplémentaires.
Un point extrêmement important, pourtant non repris dans le rapport Perben, est celui du maillage territorial - la FNUJA y est extrêmement attachée. Nous sommes, aujourd'hui, en mesure d'assurer un service de qualité aux justiciables, car nous sommes à côté d'eux. Nos clients ont besoin d'avocats à proximité. Pour maintenir la vie des barreaux, il faut maintenir celle des juridictions. Moins il y aura de juridictions, plus loin les justiciables auront à se déplacer. L'accès de proximité au droit nous paraît donc un élément primordial.
Nous partageons les inquiétudes du syndicat des avocats de France quant à l'intervention croissante des pouvoirs publics, notamment en matière de formation des avocats. Nous sommes très attachés aux prérogatives du CNB et au fait que la profession gère la formation.
Je rejoins grosso modo les propos qui ont été tenus. Nous constatons la déferlante de réformes que le justiciable et la profession a connue, tout spécialement depuis la mandature du Conseil national des barreaux de 2018 à 2020. Je ne compte pas la période de crise sanitaire, pour laquelle nous avons comptabilisé une cinquantaine d'ordonnances en moins d'un an. Je ne compte pas non plus les réformes de la justice venues amender celles, toujours pas digérées, de décembre 2019. Une autre réforme prise par voie réglementaire vient de tomber au mois de novembre dernier.
Je rappelle que la profession d'avocat a une double activité : le conseil et l'action judiciaire. La première est extrêmement importante pour les contentieux. Le règlement national des avocats nous définit comme des « partenaires de justice ». Nous devons travailler avec les magistrats tant les problèmes que rencontre la justice sont importants. Toutefois, on l'a bien compris, la profession d'avocat ne va pas se substituer au budget de l'État. En revanche, plutôt que de multiplier des procédures pour pallier cette carence, il est indispensable de pouvoir avancer avec des textes intelligibles par la profession et surtout par le justiciable. En effet, celui-ci est notre principal client en matière de conseil, qu'il soit un particulier ou une société. Nous défendons une valeur entrepreneuriale qui a son importance. L'absence d'accès aux tribunaux durant le confinement a mis nos clients - qu'il s'agisse des entreprises, des sociétés ou des particuliers - dans une extrême détresse. Pourtant, nous avons réussi à maintenir notre activité, car nous avons été forts et unis.
Beaucoup de choses positives ont été avancées dans le rapport Perben et l'ACE y est majoritairement favorable, même si certains travaux complémentaires doivent être menés. Si on écoute le justiciable et l'avocat qui ne travaille que pour le justiciable, au titre des valeurs fondamentales de la profession que sont son caractère libéral et son indépendance, les axes majeurs du rapport sont bien définis. Le secret professionnel doit être absolument préservé dans tous les domaines d'activité de l'avocat, ainsi que la souplesse économique nécessaire au fonctionnement des cabinets.
Souplesse économique, innovation, réflexion ne sont pas antinomiques avec le respect de nos garanties fondamentales et de notre socle déontologique. C'est la raison pour laquelle nous sommes favorables à certaines préconisations du rapport Perben : la pluridisciplinarité, l'ouverture des capitaux pour permettre, sinon une survie économique, l'ouverture de nouveaux horizons, naturellement sous le contrôle de nos règles déontologiques.
En matière de formation, il est important de souligner que la formation initiale n'est pas une redite universitaire. Nous avons besoin que nos jeunes avocats soient formés au management et à la dimension entrepreneuriale. Cette dernière vaut pour tous et pas seulement pour les gros cabinets d'affaires. Le collaborateur libéral ou l'avocat indépendant entrepreneur doit savoir gérer, communiquer, facturer, conclure des conventions d'honoraires, parler, rédiger, etc. Cette formation doit donc revêtir une dimension pratique plutôt que théorique, cette dernière étant du ressort de l'université.
Enfin, il nous faut nous rapprocher des magistrats. Peu importent les clivages, notamment politiques. La question est de travailler de concert pour la justice avec nos magistrats, les réformes que nous avons connues ne pouvant permettre la préservation de l'accès au droit. Le résultat des cinquante réformes en moins de dix ans pour la cour d'appel est quasi nul par rapport aux objectifs escomptés. Je ne pense pas que la solution judiciaire soit acceptable, dans l'intérêt du justiciable. Le rapport Perben propose ainsi de rallonger les délais couperets de caducité ou d'irrecevabilité, alors que nous pourrions revenir à la loyauté des débats du code de procédure civile, principe malheureusement modifié.
L'article 700 de ce code est également extrêmement important en ce qu'il responsabilise les protagonistes dans le procès : il est dans l'intérêt du justiciable d'avoir tenté, avant le procès, des modes de règlements alternatifs à l'amiable ou en ayant évité le litige par un conseil en amont plus efficient. Nous sommes également favorables à la définition de la consultation juridique à condition qu'elle soit définie sans être sans cesse évolutive. Je m'oppose, à cet égard, au fait de se fonder sur la jurisprudence qui n'est pas un texte normatif.

Nous avons eu un grand intérêt à entendre vos remarques respectives sur la profession d'avocat dans un temps moins contraint que la préparation d'un projet de loi. Ces tables rondes nous permettent d'avoir des points de vue complémentaires pour étayer notre réflexion.
Sur le sujet de l'aide juridictionnelle, à laquelle nous sommes particulièrement attachés et qui a été au coeur des débats du projet de loi de finances pour 2021, nous avons bien relevé que nous sommes au milieu du gué. Les préconisations du rapport Perben vont plus loin et le Sénat sera très attentif, lors des prochaines lois de finances, aux moyens alloués par le Gouvernement pour tenir l'objectif d'une unité de valeur à 40 euros. Nous tenons également à travailler à la mise en conformité des barèmes avec l'évolution des pratiques de la profession d'avocat, notamment en matière de médiation et de procédures amiables.
Par ailleurs, nous serons attentifs à la question du caractère exécutoire des actes des avocats, qui semble toutefois présenter des risques d'inconstitutionnalité. Nous serons amenés à y retravailler et à trouver une solution juridique.
Je vous remercie pour vos contributions.

J'ai bien noté votre volonté de rapprochement avec les magistrats, qui me paraît indispensable.
Permettez-moi de vous poser quelques questions, compte tenu de nos contraintes horaires, j'aimerais que vous nous transmettiez vos réponses par écrit.
Que pensez-vous du sujet de l'avocat en entreprise à propos duquel le rapport Perben, à la différence du garde des sceaux, qui y est favorable, n'a pas pris position ? Quelle condition faudrait-il lui donner ?
En matière d'égalité homme-femme, j'ai bien noté que vous avez déjà beaucoup avancé. Toutefois, il m'a semblé qu'une femme en province qui fait du droit pénal a plus de difficulté à gagner sa vie en tant qu'avocat. Aussi, quelles sont ces avancées ? Et que prévoyez-vous pour éviter cette situation qui est bien réelle ?

Nous vous remercions de votre participation et de vos contributions en réponse aux propos des deux rapporteurs. Nous vous souhaitons une belle année personnelle et professionnelle.
La réunion est close à 13 h 05.
La réunion, close à 13 heures, est reprise à 16 h 30.

Monsieur le garde des sceaux, merci d'avoir accepté de venir cet après-midi devant notre commission pour aborder ensemble le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Au moment où le Sénat a eu à connaître de la loi sur la réforme de la justice, nous avions évoqué avec votre prédécesseur la possibilité de traiter dans ce cadre la question du code de la justice pénale des mineurs. On nous a répondu qu'un texte spécifique y serait consacré. Puis, à la fin du débat parlementaire, on nous a demandé d'habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Vous n'y êtes pour rien, monsieur le garde des sceaux, mais cette manière de procéder avait suscité notre mécontentement.
Voilà maintenant que l'ordonnance arrive. Je ne reviendrai pas sur la discussion que nous avons eue au téléphone, la semaine dernière, au sujet de la lettre que vous aviez adressée aux juridictions en prévision de la mise en oeuvre de ce texte. Le Sénat en a été chagriné, en particulier la commission des lois.
Nous profiterons avec intérêt de votre présence, cet après-midi, pour évoquer avec vous ce dossier, sur lequel notre collègue Agnès Canayer, rapporteur, aura un certain nombre de questions à vous poser.
C'est un honneur pour moi de présenter, devant la commission des lois du Sénat, le projet de loi de ratification de l'ordonnance du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Vous l'avez rappelé, monsieur le président, je ne suis en rien responsable de la manière dont ce texte arrive devant le Sénat. Il ne serait donc pas juste que je sois le réceptacle de votre courroux.
Je suis fier de débattre avec vous de cette réforme attendue de longue date. Le texte, qui a fait l'objet d'une large concertation, a été enrichi en première lecture à l'Assemblée nationale. Il est l'aboutissement d'un travail de codification et de clarification qui s'est inscrit sur dix ans, période pendant laquelle se sont succédé quatre gardes des sceaux et presque autant de majorités. Les réformes successives s'étaient empilées sans cohérence, au gré des alternances politiques, transformant l'ordonnance de 1945 en un texte dont tous les professionnels s'accordent à dire qu'il est devenu illisible.
Cette réforme longuement mûrie et équilibrée arrive désormais devant vous. Elle parvient à répondre aux attentes des Français. Elle améliore la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants, en renforçant les principes fondamentaux de l'ordonnance de 1945. Elle consacre la primauté de l'éducatif, l'atténuation de la peine et la spécialisation des acteurs.
Monsieur le président, nous nous sommes expliqués au sujet du mépris ou de la condescendance que le ministère de la justice ou moi-même aurions pu afficher à l'encontre de la Chambre haute. Les journalistes de la télévision n'ont pas manqué de relayer l'expression de votre courroux. J'entends vous rassurer complètement sur ce point.
Certains ont manifesté leur inquiétude à l'Assemblée nationale, et d'autres le feront certainement au Sénat, quant au fait que les juridictions ne seraient pas prêtes pour cette réforme. À ma demande, les services du ministère ont procédé à des analyses de la situation, juridiction par juridiction, et nous avons souhaité informer chacune d'entre elles de la première mouture du texte, en précisant qu'il devait encore être examiné par le Sénat. Certains ont qualifié à juste titre cette lettre de circulaire « Canada Dry », car elle avait pour unique vocation de prévenir les professionnels de l'arrivée du texte. J'ai clairement précisé dans cette circulaire que ce texte ne pouvait pas en l'état servir de base au travail des juridictions, car il risquait d'être transformé et amodié au cours du processus législatif, même si je nourris la secrète espérance que les grands équilibres n'en seront pas modifiés. J'ai écrit cela en toutes lettres, sans aucune intention de ne pas considérer le Sénat. Je respecte la Haute Assemblée et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle.
J'espère qu'il ne s'agit pas là d'une polémique politicienne. Nous pouvons être d'accord ou bien nous opposer sur certains sujets, mais j'entends que nous poursuivions sur la voie d'échanges de bon niveau.
Cette réforme consacre une justice des mineurs plus efficace, plus lisible, plus rapide, et désormais prévisible pour tous. De nombreux mineurs ont été condamnés après avoir atteint leur majorité, à un moment où ils étaient de « jeunes majeurs » ou de « très vieux mineurs », si vous me permettez l'expression. La mise en examen n'était enserrée par aucun délai, ce qui a contribué à nourrir le « stock » des dossiers, puisque l'usage de ce mot néo-capitalistique est désormais consacré. Des gamins de seize ans ont dû attendre d'avoir vingt-deux ans pour être jugés. À la perte de temps s'ajoute l'inefficacité du message pédagogique, car tout père de famille sait qu'une sanction ou une mesure éducative n'a plus de sens si on l'inflige ou si on l'impose à ses enfants trois ans après les faits.
La rapidité de la première intervention judiciaire, sous la forme d'une audience de culpabilité, ne signifie pas la mise en place d'une justice expéditive, comme certains ont voulu l'affirmer. Les équilibres sont préservés, le temps de l'éducatif n'est pas réduit, mais il est au contraire encadré, et il peut être prolongé lorsqu'on juge que cela est nécessaire. Le travail éducatif s'inscrit ainsi dans un continuum.
Après l'audience de culpabilité, une autre audience est consacrée à la peine, avec dans l'intervalle l'application de mesures éducatives. Le regroupement de toutes les autres procédures en cours a le mérite de la rapidité et permet de prendre en compte les victimes. L'éducatif reste au coeur de cette réforme.
Quant aux étapes de l'examen du texte, elles montrent qu'il a donné lieu à un débat démocratique nourri. Vous en êtes d'ailleurs les garants. La commission des lois de l'Assemblée nationale a examiné près d'un demi-millier d'amendements, et les députés en ont examiné autant en séance publique, en décembre dernier.
À la question de savoir si les juridictions et les services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) seront prêts, je réponds que oui. Toutes les réformes ont commencé par être mal reçues. Il n'est qu'à voir la loi du 15 juin 2000 dite « loi Guigou », que personne ne songe plus à remettre en question. Elle a pourtant donné lieu à des manifestations devant la Chancellerie, place Vendôme, et je me souviens d'acteurs judiciaires qui n'hésitaient pas à jeter leurs codes par terre en signe de protestation. Persifleur, j'aimais dire alors qu'on ferait mieux de les lire, plutôt que de les jeter... Aucune réforme n'a jamais été accueillie à bras ouverts.
Concrètement, nous avons prévu des renforts de moyens dans les juridictions. Les services du ministère ont identifié une dizaine de juridictions qui souffrent d'une certaine fragilité. Elles ont été analysées et répertoriés. Nous avons affecté 72 magistrats supplémentaires au 1er septembre 2020, ainsi que 100 greffiers, qui ont constitué un renfort immédiat. Depuis 2018, 4 employés de greffe exercent désormais à Bobigny, ce qui satisfait à la demande exprimée par les chefs de juridiction.
La réforme a également été anticipée au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, grâce à la création de 252 emplois supplémentaires jusqu'en 2022. En complément, quatre-vingt-six éducateurs viennent d'être recrutés dans le cadre des budgets qui ont été alloués à la justice de proximité, qui constituent un appui inédit et légitime. Grâce à la mission mise en place par l'Inspection générale de la justice (IGJ), nous avons pu apporter une assistance méthodologique directe aux juridictions et aux services territoriaux de la PJJ pour la mise en place de la réforme. Je peux donc affirmer que les juridictions sont prêtes.
Nous avons également anticipé sa mise en oeuvre sur le terrain numérique de façon à ce que les dispositions nouvelles s'exercent plus rapidement.

Nous ne contestons pas la nécessité de mettre en oeuvre cette réforme, attendue, puisque l'ordonnance de 1945 a été réformée plus de quarante fois, donnant lieu à un certain nombre d'incohérences. Nous avons besoin d'une justice plus adaptée à l'évolution et aux besoins des mineurs.
Néanmoins, le délai prévu pour l'entrée en vigueur de cette réforme pose question. Les juridictions doivent faire face, comme nous tous, aux effets de la crise sanitaire. La récente grève des avocats a ralenti les procédures et augmenté les stocks - le mot n'est pas beau, mais il est concret pour décrire les dossiers qui s'empilent dans les tribunaux. Une mise en oeuvre dans un délai très rapproché, au 31 mars, soit un mois après la fin du processus législatif, risque d'être compliquée, même si vous l'avez anticipée. Quand bien même la « technique du sparadrap » serait efficace, et malgré des moyens supplémentaires, un certain nombre de juridictions, fragilisées, ne seront pas prêtes à assimiler cette réforme.
Nous avions eu ce débat au moment de l'examen du dernier projet de loi de finances. Comment tenir un délai aussi raccourci, alors que tous les stocks ne seront pas apurés, et que la période de transition entre l'ancienne et la nouvelle procédure n'aura pas toujours été solidement préparée techniquement, voire juridiquement ? La formation - si ce n'est l'information - de certains acteurs de cette justice des mineurs n'a pas été suffisamment affinée. Les moyens informatiques, dont le logiciel Cassiopée, sont loin d'être au point. Or d'autres réformes, comme celle du divorce ou celle du « bloc peine », ont montré que le manque de moyens informatiques nuisait à leur réalisation.
Comment entendez-vous tenir ce délai ? Quels moyens humains seront déployés ? Ce dernier problème n'est pas uniquement quantitatif : il faut certes des personnels en nombre - greffiers, magistrats, acteurs de la PJJ, etc. -, mais il faut aussi des personnels qui soient capables d'assimiler cette réforme d'ampleur. Les pratiques de la justice pénale des mineurs se trouvent totalement changées, notamment par le biais du mécanisme innovant de la césure. Nous sommes très inquiets aujourd'hui quant à une mise en oeuvre à délai rapproché, qui, selon nous, fragilisera les fondations d'une réforme essentielle, a fortiori dans le contexte actuel. Nous avons donc besoin de temps supplémentaire.
Ma deuxième question concerne le périmètre de la réforme. Seule une partie de la justice des mineurs - le volet pénal, c'est-à-dire répressif - est concernée. Qu'en est-il du principe éducatif, qui doit primer l'aspect répressif ? Comment entendez-vous articuler ces deux éléments indissociables de la justice des mineurs ?
Ma troisième question porte sur les mineurs non accompagnés (MNA) lesquels, se trouvant souvent happés par des réseaux, sont soustraits à la justice. Pensez-vous que la procédure de l'audience unique leur est adaptée ?
Comment envisagez-vous l'articulation du juge des libertés et de la détention (JLD), mesure ajoutée par l'Assemblée nationale pour répondre au principe d'impartialité du juge, tel que posé par le Conseil constitutionnel en application de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe de continuité du suivi par le juge des enfants qui n'interviendra plus dans ce cadre ?
Vous avez maintenu au sein du code de la justice pénale des mineurs la compétence du tribunal de police pour les contraventions des quatre premières classes. Cela nous paraît un peu anachronique avec la volonté de spécialisation des juridictions.
Enfin, bien que consciente de la volonté d'une justice plus rapide, dans l'intérêt d'un meilleur développement de l'enfant, je m'interroge tout de même sur la façon dont vous entendez faire respecter les délais fixés pour cette procédure, alors qu'ils ne sont qu'indicatifs.

Je souhaiterais, monsieur le garde des sceaux, vous poser une question qui n'a pas trait à ce texte, mais à l'urgence. Le Conseil constitutionnel, dont les décisions s'imposent à toutes les autorités, a demandé l'adoption d'un texte législatif concernant la possibilité des détenus de contester leurs conditions de détention pour indignité. Alors que vous aviez introduit une réforme en ce sens, à la faveur du projet de loi relatif au Parquet européen à la justice pénale spécialisée, vous y avez finalement renoncé, craignant que cela ne fût considéré comme un des innombrables cavaliers. Soit le Parlement examine une proposition de loi - or je vois mal comment elle pourrait être adoptée avant le mois de mars, compte tenu de la navette -, soit le Gouvernement dépose lui-même un projet de loi. Quand comptez-vous le faire ?
Concernant le présent texte, ne serait-il pas sage d'en reporter la date d'application de quelques mois, de manière que les juridictions puissent se préparer ?
Jean-Pierre Rosenczveig, avec qui nous avons longuement discuté, nous a fait remarquer qu'il est véritablement incompréhensible que l'on ne pose pas l'irresponsabilité pénale des mineurs de treize ans. Sur ce point, il conviendrait de mettre en conformité nos lois avec la convention internationale des droits de l'enfant et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est une question centrale, sur laquelle nous avons entendu les représentants de magistrats et d'avocats, ainsi que plusieurs éducateurs.
Enfin, la césure semble être une bonne idée, car cela permet de prendre une première décision : il est en effet nécessaire de donner à l'acte éducatif toute sa place. En revanche, le système pour les réitérants est différent : garde à vue, déferrement au parquet, le centre éducatif fermé pour les moins de seize ans et la détention provisoire pour les plus de seize ans, avec un tribunal qui statue en une seule fois. Pour ces mineurs-là, la philosophie générale du texte paraît ne pas s'appliquer.

En m'extrayant peut-être du sujet de cette audition, ma question porte sur les actes de naissance et le projet de loi relatif à la bioéthique. La rédaction de l'article 4 bis du texte, tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale, est conforme à ce que le Gouvernement avait défendu lors de la première lecture au Sénat. Elle remet en cause l'article 47 du code civil, qui, en résumé, pose le principe selon lequel les actes d'état civil étrangers font foi, sauf s'ils sont notoirement faux. Le Gouvernement a ainsi entendu faire obstacle à la transcription des actes de naissance des enfants nés par gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, contrairement aux exigences posées par la Cour européenne des droits de l'homme en matière d'effectivité et de célérité. La France a d'ailleurs plusieurs fois été condamnée... Les décisions de la Cour de cassation sur ce sujet font jurisprudence. Cela pose véritablement problème, notamment pour les mères seules, qui ne pourront pas adopter leur propre enfant. Un défaut de réciprocité des actes d'état civil est aussi en cause.
Êtes-vous à l'aise avec la rédaction de cet article 4 bis?

Je précise que le sujet de la bioéthique ne relève pas de notre commission, le texte ayant été renvoyé à une commission spéciale.

Monsieur le garde des sceaux, un certain formalisme est nécessaire à la procédure judiciaire, et trouve de multiples applications informatiques, mises en oeuvre par les greffiers, qui permettent aux avocats de suivre l'évolution d'un dossier.
Si l'on règle dans les détails la mise en oeuvre de l'ordonnance avant le vote du Sénat, quelles que soient les précautions de langage que vous aurez prises, on risque de vous entendre dire dans quelques jours que vous ne pourrez pas accepter des amendements du Sénat, même s'ils sont bons, car vous ne pourrez pas tenir votre calendrier.
Au fond, nous n'avons aucune préoccupation de politique politicienne : notre motivation est celle de la qualité et du respect du débat parlementaire. Si nous ne pouvons pas amender ce texte parce que les consignes ont déjà été données pour son application dans un délai très rapproché, ou si nous n'arrivons pas à un accord en commission mixte paritaire pour ce motif, qui pourrait être un motif non dit,...

cela constitue un problème pour les relations entre le Parlement et le Gouvernement. J'espère que ce n'est pas du « wishful thinking » que d'espérer une application de ce texte si protéiforme, si important et si ambitieux, dans un délai aussi rapproché, après le vote du Parlement.
Je m'associe à l'interrogation de notre collègue Jean-Pierre Sueur notamment, car, lorsque l'on fait une réforme aussi importante, un bouton de guêtre ne doit pas manquer. Je comprends que vous ayez sans doute été animé d'un souci d'efficacité, mais cela vient percuter le débat parlementaire dans des conditions très inhabituelles.

Le ministre de l'intérieur nous a confirmé tout à l'heure les chiffres dramatiques d'augmentation de maltraitance, de violences intrafamiliales, des chiffres qui nous avaient déjà présentés par les gendarmes et les procureurs pendant le confinement. Ces chiffres sont terribles, notamment dans le département du Nord, dont je suis élue. Les réitérations de violences, et les formes d'impunité que l'on rencontre parfois vis-à-vis des parents peuvent être à l'origine de bien des déstructurations d'enfants.
Je trouve qu'il est extrêmement douloureux que l'on ne s'intéresse aux jeunes qu'à partir du moment où ils deviennent délinquants. On pourrait intervenir bien en amont - il est d'ailleurs gênant d'associer la sanction à l'éducatif -, mais force est de constater que les services d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) sont surchargés, que les services de placement d'enfants sont retardés et que beaucoup de signalements ne connaissent pas de suite. Tous les enfants en situation de détresse ne deviennent pas délinquants, heureusement, mais il relève de notre responsabilité d'élus et de juristes de pouvoir en sauver quelques-uns. Lorsque j'étais adjointe à la sécurité, j'avais mis en place des travaux d'intérêt général (TIG) : les jeunes qui y venaient se rendaient compte que c'était la première fois que l'on s'intéressait à eux et qu'ils pouvaient montrer qu'ils savaient faire des choses...
Les services de PJJ étaient souvent récalcitrants à participer à nos réunions, suspicieux des élus. Or il faut que tout le monde soit solidaire pour sortir les enfants de la délinquance, quand cela est possible. En revanche, dès lors qu'il y a eu passage à l'acte, je suis convaincue qu'il faut punir. Mais je voulais vous alerter. Il est bien dommage de laisser évoluer les choses très négativement, et d'être réduits à faire de simples constats en aval.

Premièrement, le logiciel Cassiopée est-il prêt ?
Deuxièmement, il est prévu que les infractions de première à quatrième classe restent de la compétence du tribunal de police, tandis que celles de cinquième classe relèveraient du juge des enfants. Les infractions de quatrième classe, si elles ne présentent pas de particulière gravité lorsqu'elles sont commises par un adulte, révèlent en revanche, pour un enfant, un nécessaire dysfonctionnement, a minima familial. Peut-être conviendrait-il alors de passer plus rapidement devant le juge pour enfants.
Au moment de la rédaction de l'ordonnance, vous aviez prévu, dans les modules de placement, qu'un enfant puisse être aussi confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Vous avez supprimé une telle possibilité, par un amendement déposé à l'Assemblée nationale, et fait en sorte qu'un enfant puisse être placé dans un cadre familial ou chez une personne de confiance. Mais quid des enfants déjà confiés ? Je conçois qu'un enfant qui n'est pas encore pris en charge par les services départementaux ne soit pas confié à l'ASE. En revanche, un enfant déjà confié à l'ASE ne pourra pas être placé dans une famille au moment de la sanction et dépendra de la PJJ : c'est en quelque sorte une double peine, parce qu'il n'avait pas de famille de placement à l'origine. Je m'interroge donc sur cette situation.

Je m'associe à l'interrogation de mes collègues sur le respect du travail du Parlement, et du bicamérisme. Nous examinons ce texte en procédure accélérée, alors qu'il est pourtant si important. Nous n'aurons que deux jours pour légiférer : le texte n'est pas très long, certes, mais nous sommes susceptibles d'émettre des remarques sur les quelque 300 articles que contient l'ordonnance. Vous l'avez dit dans votre propos introductif, monsieur le garde de sceaux, le Gouvernement a évidemment la maîtrise de l'ordre du jour d'une semaine gouvernementale...
J'ai aussi des préoccupations concernant la mise en place d'une audience unique. Comment envisagez-vous cette procédure dans son déroulé, et sur le plan de la protection des mineurs ? Comment éviter que cette procédure ne laisse se développer une justice « expéditive », comme la qualifient certains ? Nous avons tous conscience de la volonté de désencombrer les juridictions, mais cela ne peut se faire au détriment des justiciables.

Vous avez affirmé, monsieur le garde des sceaux, que toute réforme rencontre son lot d'oppositions et de contestations. Mais on constate qu'un grand nombre de professionnels contestent la date de son entrée en vigueur : la présidente de la Conférence des procureurs généraux a ainsi indiqué que la date du 31 mars prochain était un non-sens. Au-delà des préoccupations corporatistes, il y a une réelle inquiétude. La circulaire traduit la nécessité de votre précipitation : pourquoi sinon auriez-vous eu besoin de la prendre ? Afin qu'il n'y ait pas de malentendu, ma remarque n'a rien à voir avec de l'amour propre ; la question c'est la loi, ce n'est pas le fait de savoir si le Sénat s'offusque d'avoir été ignoré. Comme Philippe Bas l'a souligné, le problème est que les choses sont déjà figées, de fait.
En outre, je souhaite savoir quelle est votre position s'agissant de l'ouverture par le procureur général près la Cour de cassation d'une information judiciaire à votre encontre, devant la Cour de justice de la République, après avis favorable de la commission des requêtes. À quel stade de la procédure pensez-vous que cela pourrait devenir problématique pour l'accomplissement de vos fonctions ?

Je souscris à ce qu'ont dit mes collègues Jean-Pierre Sueur, Philippe Bas et Marie-Pierre de La Gontrie sur la position compliquée dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Alors que cette réforme va être mise en place - cela fait longtemps que nous parlons de l'enfance délinquante, le texte est ancien, difficile et a été révisé une quarantaine de fois -, j'ai l'impression que le Gouvernement cherche à transformer le Parlement en chambre d'enregistrement des instructions qui auraient été données par le Président de la République. Je m'attendais à des débats plus ambitieux, afin d'avancer ensemble dans une seule et même direction et de trouver un équilibre entre justice et fermeté.
Considérant que le temps presse, vous avez décidé que cette réforme s'appliquerait le 31 mars prochain, et tout est déjà acté, si j'en crois le courrier que vous avez adressé aux professionnels de la justice. On nous parle sans cesse d'urgence : j'ai bien conscience que la pandémie a bousculé le calendrier, mais - je le dis sans aigreur ni orgueil -on ne peut pas continuer à avoir ce genre de relations entre le Parlement et le Gouvernement !
Georges Clemenceau disait : « Pendant une partie de ma vie, j'ai eu foi en la Chambre unique, comme émanation directe du sentiment populaire. J'en suis revenu, les événements m'ont appris qu'il faut laisser au peuple le temps de la réflexion. Le temps de la réflexion, c'est le Sénat. »
Je suis inquiète de la qualité d'un texte législatif qui a été remanié tellement de fois et de la capacité des professionnels de la justice à travailler dans les conditions que nous craignons.

Je souhaite connaître votre avis, monsieur le garde des sceaux, sur le discernement et sur le consentement, ainsi que sur l'accompagnement des familles dans l'éducation des jeunes. Qu'est-ce que le discernement ? Qu'est-ce que le consentement ?
Dérogeant peut-être à l'ordre des questions qui m'ont été posées, je vais d'abord répondre à l'aimable interpellation de Mme la sénatrice de La Gontrie. Mon crime, madame la sénatrice, est d'avoir exercé mes fonctions exactement comme l'auraient fait tous mes prédécesseurs, dans des circonstances analogues. J'ai suivi, en effet, les recommandations de mon administration.
Vous ne pouvez pas dire que c'est faux, vous n'en savez rien. Je le démontrerai !
Mon administration est composée de magistrats, et j'ai saisi pour une simple enquête - rien de plus, rien de moins - une autorité indépendante, elle aussi composée de magistrats, pour faire la lumière sur d'éventuelles fautes déontologiques pouvant avoir été commises par des magistrats qui, pour certains d'entre eux, n'ont pas déféré aux convocations qui leur avaient été adressées. Je veux vous dire très calmement, très aimablement et très respectueusement que, si l'objectif - comme cela a été déjà exprimé par certains - est de m'interdire de travailler, ceux-là en seront pour leurs frais. D'ailleurs, je travaille aujourd'hui, avec vous, sur le code de la justice pénale des mineurs. Ma réponse sera sans doute ultérieurement plus complète, très complète, mais je n'ai rien à craindre et je suis totalement serein.
Vous suggérez, madame la rapporteur, un report de la date d'entrée en vigueur de la réforme. Vous faites remarquer, à juste titre, qu'il y a un problème à superposer les anciens dossiers avec ceux qui feront l'objet de la nouvelle procédure. Mais si nous retardons la mise en oeuvre de cette loi, cela aggravera davantage ce problème de superposition.
Pourquoi, monsieur Bas, pensez-vous que la publication d'une circulaire vous interdirait de modifier le texte ? Cet argument est assez spécieux ! Pour ma part, je me suis en réalité contenté d'envoyer aux magistrats les très grandes lignes, et de votre côté, je ne pense pas que vous hésiterez à exercer vos droits de parlementaire : quelque quatre cents amendements ont été déposés à l'Assemblée nationale, et je ne crois pas un seul instant que vous vous priverez de déposer, vous aussi, les amendements que vous jugerez utiles.
Nous avons joint à la circulaire Canada Dry le guide de l'inspection générale de la justice (IGJ) pour l'entrée en vigueur de la réforme. Un tableau de simulation des orientations pénales règle la question du stock, tandis qu'un tableau de simulation règle celle du besoin d'audience. Dans le même esprit que la réponse que j'ai adressée à Mme de La Gontrie, je fais confiance en l'analyse de mes services : l'IGJ est faite des magistrats indépendants, qui ont expertisé et fait les analyses nécessaires.
Je prends acte des réticences à envisager une nouvelle procédure, mais cette loi est attendue depuis 2007. Trois jours de débats sont prévus, monsieur Bas, vous aurez donc toute latitude pour m'interroger avec la minutie et le pragmatisme qui sont les vôtres. Vous faites celui qui n'osera pas, mais, naturellement, vous oserez tout ce que vous estimerez utile à l'amélioration de ce texte ! D'ailleurs, j'ai retenu quelques amendements de l'Assemblée nationale.
Partout on me fait remarquer l'impréparation des juridictions à cette réforme, en dépit des moyens que nous avons déployés et de la volonté des services de rendre la réforme applicable : personne n'a le goût de l'effort inutile. Je rappelle que 72 magistrats ont été affectés le 1er septembre 2020, ainsi que 100 greffiers. Quelque 252 emplois nouveaux seront créés en 2022 et 86 éducateurs viennent d'être recrutés. Nous avons fait cela à la suite e l'analyse des services de la Chancellerie, qui n'ont aucun intérêt à nous dire que les juridictions sont prêtes alors qu'elles ne le sont pas ! Ce serait une catastrophe que d'envisager un texte inapplicable !
Vous êtes inquiet, monsieur Sueur, de ce que nous devons faire en réaction à la décision du Conseil constitutionnel en date du 2 octobre 2020 : je travaille activement pour que nous puissions être en conformité avec celle-ci.
On essaye de trouver le vecteur législatif pour introduire urgemment ce recours effectif dans notre droit. Je vous en dirai davantage demain, lorsque je vous recevrai.
Sur l'irresponsabilité, les magistrats devront systématiquement motiver le discernement des mineurs de moins de treize ans pour engager des poursuites. C'est un vrai débat. D'un point de vue international, toutes les législations diffèrent. Le discernement, au fond, c'est l'analyse du juge. Je ne crains pas la décision du juge, qui est prise sous l'égide de la philosophie de l'ordonnance relative à l'enfance délinquante de 1945, qui a été faite, non pas contre les enfants, mais pour les enfants.
J'ai entendu certains dire qu'il n'y avait plus d'enfants quand le crime était grave, comme si c'était à l'aune de la gravité d'un crime que l'on mesurait le discernement ! Un âge doit être évidemment fixé, mais il y aura toujours des débats en la matière... Il faut en réalité laisser au juge, qui est un professionnel de l'enfance, le soin d'analyser le discernement avec beaucoup de souplesse.
L'audience unique, quant à elle, est une procédure exceptionnelle enserrée dans des conditions très strictes, et réversible : à tout moment, le juge garde la main pour décider de revenir dans la procédure classique. Ce sont là de véritables garanties pour l'enfant.
Je ne peux pas tout de suite répondre à votre question, monsieur Leconte, la bioéthique n'étant pas à l'ordre du jour de cette réunion ; nous aurons certainement l'occasion d'en rediscuter.
Monsieur Bas, je vous ai déjà répondu. Je veux encore une fois vous rassurer sur votre pleine et entière capacité à amender ce texte.
Je suis d'accord, madame Lherbier, avec le fait qu'il faille s'efforcer de détecter plus vite, et en amont, la dérive des mineurs vers la délinquance. Je rappelle qu'il existe déjà des textes relatifs à la protection de l'enfant, adoptés en 2007 et en 2016, qui ne seront en aucune façon abrogés par le texte que nous examinerons.
S'agissant des mineurs qui sont déjà confiés à l'ASE, madame Vérien, la combinaison des dispositions civiles et pénales a vocation à se poursuivre. Cela n'aurait pas de sens d'affirmer que cette réforme balaye la protection et l'éducatif au profit de la répression !
Nombre d'amendements ont été déposés par la France Insoumise à l'Assemblée nationale, pour transférer le contentieux du tribunal de police vers le juge des enfants, dont on nous dit qu'il serait déjà surchargé. Nous nous sommes expliqués devant la représentation nationale et certaines précautions ont été prises, notamment en matière de droits de la défense.
Madame Cécile Cukierman, la procédure de saisine du tribunal pour enfants (TPE) aux fins d'audience unique est dérogatoire à la procédure de mise à l'épreuve éducative décidée par le parquet. La seule hypothèse qui permette le placement en détention provisoire dès le déferrement, hors cas d'ouverture d'information, correspond à la situation dans laquelle le mineur est jugé dans un délai de dix jours à trois mois sur la culpabilité et la sanction. Le TPE peut prononcer toute mesure éducative ou peine, et assortir une peine ferme d'emprisonnement d'un mandat de dépôt, sans condition de quantum ou de récidive. Une fois encore, la procédure est réversible.
J'entends bien ce que vous dites, madame Boyer, mais vous aurez trois jours de débat en séance publique le 26 janvier prochain. L'urgence, c'est aussi celle des justiciables, or la justice des mineurs n'est aujourd'hui plus adaptée. Il n'est pas cohérent qu'un enfant soit jugé trop tardivement ! Les professionnels, dans leur ensemble, réclament cette réforme, et les points névralgiques ont été pris en considération.
Les MNA sont justiciables du code de la justice pénale des mineurs. Le véritable problème avec les MNA réside dans leur identification. Beaucoup de ces identifications ont été réalisées grâce aux services des structures d'accueil et de protection judiciaire de la jeunesse au Maroc. Nous voulons régler cette question.
Enfin, le JLD doit être spécialisé, pour éviter le procès inéquitable, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

J'ai dû mal formuler ma question tout à l'heure, monsieur le garde des sceaux, si je juge la réponse que vous m'avez faite à deux reprises. Je n'ai aucune inquiétude sur notre capacité à exercer notre droit d'amendement. À vrai dire, ce droit ne nous est pas concédé par le Gouvernement, nous le tirons de la Constitution, et nous n'avons aucune espèce d'inhibition face à son exercice.

Mais comment faire en sorte que le jeu normal du processus législatif puisse aboutir - nous l'espérons, avec un accord en commission mixte paritaire qui prenne en compte le travail du Sénat -, si le débat est à l'avance fermé par le fait que la Chancellerie a déjà décidé ce que serait le dispositif final ? Je crois que vous êtes attaché, comme nous, à un débat de bonne foi. Je note l'ouverture que vous faites par avance à nos amendements, et la preuve par neuf viendra dans le débat parlementaire et dans les travaux de la commission mixte paritaire.
Usant de la même rhétorique, je pourrais vous dire que le débat est figé, et que je serai donc tenu d'accepter les amendements que vous présenterez ! Je souhaite vraiment que cette réforme entre vite en vigueur, parce qu'elle est importante, et j'ai préparé mes magistrats en prenant les précautions nécessaires.

Je n'ai pas vraiment obtenu de réponse à mes questions. Une fois encore, pourquoi uniquement se focaliser sur la partie pénale ? Quelle mesure comptez-vous mettre en place pour faire respecter les délais dans la procédure ? Les délais n'étant qu'indicatifs, on perçoit aisément le risque qu'ils ne soient pas respectés.
Je ne suis pas opposé, évidemment, à un code des mineurs plus large, comprenant un certain nombre de dispositions civiles. C'est seulement la temporalité qui fait que nous n'y sommes pas encore parvenus. Il y aurait même une cohérence à regrouper toutes les dispositions relatives aux mineurs dans un seul code.
Concernant les délais, il faut laisser une certaine souplesse. La philosophie du texte est de mettre tout de suite en place une mesure éducative, que l'on prendra en compte pour déterminer la peine. Je trouve que tout cela va dans le bon sens, pour en avoir discuté avec nombre de professionnels qui s'occupent de la justice des mineurs : c'est un grand texte.

Le Sénat fera son oeuvre pour faire en sorte que ce texte soit appliqué rapidement, dans de très bonnes conditions, et remplir son office. Il reste quelques questionnements substantiels, rappelés ici par Mme le rapporteur, notamment sur le respect des délais dans la procédure.
La pensée d'un haut magistrat a été invoquée précédemment pour dire que l'application de ce texte n'est pas possible...

Non, la présidente de la Conférence nationale des procureurs a dit qu'il s'agit d'un non-sens !
Les services se sont rapprochés et ont discuté d'un certain nombre de choses. Nous avons pris en considération toute la circonspection qui a été exprimée. De grands débats, notamment avec la directrice de la PJJ, ont eu lieu, pour que les choses soient aplanies.

Je rappelle à mes collègues que cela fait plus d'un an que des auditions se tiennent sur ce texte. Chacun est donc très attaché aux objectifs poursuivis par ce texte.
Je vous remercie de votre participation, monsieur le garde des sceaux.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion, suspendue à 17 h 50, est reprise à 18 h 30.

Nous recevons Jean-Louis Debré, ancien ministre de l'intérieur, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel.
Monsieur le président, merci de venir nous présenter le rapport que vous avait demandé le Gouvernement sur les conditions d'organisation ou de report des élections régionales et départementales de mars 2021. Rendu le 13 novembre dernier, ce rapport conclut qu'un report des scrutins à la fin du mois de juin 2021 « serait l'option susceptible de recueillir le soutien politique le plus large ».
Le Gouvernement a déposé un projet de loi en ce sens, que nous examinerons en commission le mercredi 20 janvier et en séance publique le mardi 26 janvier. Notre collègue Philippe Bas est le rapporteur de ce texte.
Lorsqu'on m'a demandé de réfléchir à la tenue des élections départementales et régionales, qui devaient avoir lieu en mars 2021, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait beaucoup d'arrière-pensées chez les uns et les autres : ceux qui m'avaient chargé de cette mission souhaitaient les reporter à beaucoup plus tard - après l'élection présidentielle de 2022 ; d'autres souhaitaient les reporter à une date proche de la rentrée de septembre prochain ; un troisième groupe de personnes souhaitait les maintenir à la date prévue.
J'ai tout de suite exclu le report des élections départementales et régionales après l'élection présidentielle : on ne peut pas confiner ainsi l'expression de la démocratie sans créer des problèmes politiques insurmontables ! La jurisprudence du Conseil constitutionnel n'autorise de surcroît un tel report que « dans un délai raisonnable », ce que n'est assurément pas un report de plus d'un an.
La philosophie des élections départementales et régionales ne s'inscrit pas dans le sillage de l'élection présidentielle : aux élections départementales, en particulier, on choisit un homme, une femme, au moins autant qu'une étiquette. Placer ces scrutins après l'élection présidentielle leur aurait donc donné une coloration politique, une passion politique qui n'était pas souhaitable. Cela aurait également produit une suite sans fin d'élections : les deux tours de la présidentielle, les législatives, le renouvellement du Sénat, puis les départementales, les régionales et les municipales !
J'ai également écarté le report des élections départementales et régionales au mois de septembre 2021 car je ne sais pas comment on conduit une campagne électorale lorsque les Français sont en vacances, à moins d'installer des permanences sur les plages ou à la montagne...
Il n'y avait donc qu'une seule solution : le report au printemps 2021. J'ai interrogé non seulement les membres du conseil scientifique, mais aussi d'autres scientifiques pour connaître leur regard sur l'évolution de la pandémie. À peu près tous m'ont dit - on ne parlait pas encore de nouvelles variantes du virus - que l'hiver était la période la plus critique et que, vraisemblablement, la chaleur étant un frein à la transmission du virus, le printemps l'était moins.
Il était aussi impossible de reporter les élections départementales et régionales en même temps que la campagne présidentielle. Imaginez que des candidats à la présidence de la République soient, en même temps, présidents de région et candidats à leur réélection !
Il n'y avait donc que le mois de juin 2021 pour organiser les élections départementales et régionales, et pas trop tard dans le mois, pour que ce ne soit pas trop proche des vacances. C'est donc la conclusion de mon rapport, qui en tire également les conséquences, notamment sur l'augmentation du plafond des dépenses électorales, et qui lance une réflexion sur le déroulement des scrutins.
Je le dis sans détour : je suis un ardent défenseur de la démocratie s'exprimant dans l'isoloir et dans les urnes. Si l'on veut éviter les pressions, si l'on veut que la République soit l'expression de choix personnels - et elle s'en est toujours bien sortie - il faut un scrutin à bulletins secrets dans l'isoloir.
Certains m'objectent qu'il y a beaucoup d'abstention et qu'il faut trouver d'autres moyens pour que les Françaises et les Français aillent voter. Certes, l'abstention est préoccupante mais il faudrait prendre du temps pour comprendre ses raisons, qui ne sont malheureusement pas que matérielles. Je reste donc très réservé sur le vote par correspondance.
Faisons un petit peu d'histoire. J'ai beaucoup de sympathie pour cette figure historique qu'est Léon Blum. Ce dernier avait déposé une proposition de loi donnant le droit de vote aux femmes. Mais, une fois aux affaires, il a abandonné ce projet, car les républicains lui ont fait valoir que la formation des jeunes femmes à l'époque, complètement dans la main de l'Église, pouvait avoir des conséquences sur les scrutins. Il s'est donc contenté de nommer trois femmes dans son gouvernement comme sous-secrétaires d'État.
Il n'y a pas que des pressions communautaires ; il peut aussi y avoir des pressions familiales ! J'ai beaucoup de sympathie pour les experts mais, tout au long de cette mission, à chaque fois que j'arrivais à une conclusion, j'ai téléphoné à mes conseillers politiques, qui sont les agricultrices et agriculteurs de mon ancien département, pour leur demander : qu'en penses-tu ? Sur le vote par correspondance, une agricultrice de Normandie m'a répondu : « ne fais pas ça ! Mon mari ne sait pas comment je vote et je ne veux pas qu'il le sache, car il m'imposerait de voter comme lui ».
On ne peut pas totalement exclure le vote par correspondance, mais il faut être très prudent. J'ai bien pris note qu'un certain nombre d'élus vantaient ses mérites mais, pour l'organiser, un marché public resterait nécessaire. Je me suis renseigné sur les entreprises qui pourraient postuler : il y avait parmi elles deux entreprises étrangères. N'avons-nous pas assez de problèmes comme cela, pour imaginer de confier l'organisation d'un vote politique à une entreprise étrangère ?
Le vote par correspondance est utilisé dans certains ordres professionnels et pour les députés des Français de l'étranger : au moment du dépouillement, un certain nombre de bulletins sont annulés du fait de leur irrégularité.
Dans une élection à deux tours, comment organiser le second quand on sait, qu'à la suite du premier, le dimanche et le lundi, les candidats organisent la fusion des listes, qu'il faut donc imprimer de nouveaux bulletins de vote et de nouvelles professions de foi, qu'il faut les envoyer dans toutes les campagnes et être sûr qu'elles arrivent avant le dimanche suivant ?
Enfin, imaginons qu'un mouvement social vienne perturber la distribution du courrier, au risque de bloquer l'expression du suffrage universel...
Le vote par procuration, en revanche, ouvre certaines possibilités d'action. Ainsi, j'ai proposé que chaque électeur puisse disposer de deux procurations. Il semble que le Gouvernement n'a pas retenu cette mesure, qui a pourtant fonctionné lors du second tour des élections municipales de juin 2020.
J'exclus complètement le vote par Internet. En effet, on ne peut pas garantir qu'il est impossible de retracer l'origine des votes. Or le principe dans la République est le secret du vote. Sans compter que tous les Français ne sont pas familiers d'Internet, ce qui serait source de confusions.
Je me résume : élections départementales et régionales en juin 2021, maintien des deux tours, maintien du scrutin avec isoloir, quelques votes par correspondance dans certains cas, deux procurations et pas de vote par Internet.
Faut-il prévoir une clause de revoyure automatique ? Non. Malgré la pandémie, on ne peut pas indéfiniment et automatiquement reporter les élections. Sinon, vous aurez des problèmes politiques et une contestation : on dira que les politiques se protègent et craignent les élections. Ce serait un coup porté à la démocratie ! En revanche, j'ai voulu que le conseil scientifique fournisse un rapport au cours du mois d'avril 2021, pour que chacun prenne ses responsabilités.
J'en viens au difficile problème de la campagne électorale. Elle risque de ne pas se dérouler dans les conditions habituelles mais il faut s'en accommoder. On peut l'organiser tout en assurant le respect des gestes barrières et des autres précautions d'usage.
J'ai recommandé aussi, pour lutter contre l'abstention, que le Gouvernement organise une campagne d'information sur le rôle exact du conseil régional et du conseil départemental, en montrant comment, dans tel village ou telle petite ville, leur action change la vie quotidienne des Français. Faire comprendre l'importance de ces scrutins encouragera nos concitoyens à aller voter !
Tels sont les éléments du consensus auquel nous sommes parvenus.
Ce n'est pas dans l'air du temps, mais j'ai été élevé comme ça : on ne reporte pas indéfiniment l'expression de la démocratie !

Je vous remercie d'avoir « décrypté » les conditions dans lesquelles vous avez exécuté la mission que le Gouvernement vous avait confiée. Votre rapport a été très éclairant pour nous. Nous l'avons lu la plume à la main !
Dans le même temps, sur l'initiative du président François-Noël Buffet, notre commission a constitué une mission d'information pour examiner d'éventuelles facilitations du vote à distance. Nos conclusions sont proches des vôtres.
Malgré l'intérêt que plusieurs d'entre nous, dont je fais partie, ont manifesté pour le vote par correspondance, nous avons considéré que le sujet ne pouvait pas mûrir d'ici les prochaines élections départementales et régionales, même reportées.
En tout état de cause, nous estimons qu'il serait dangereux d'envisager ces modes de votation comme des substituts au vote à l'urne, qui doit rester la modalité de droit commun pour l'exercice du droit de suffrage. Le vote par correspondance « papier » et le vote électronique doivent être appréhendés comme les procurations : il s'agit de permettre à un électeur qui ne peut pas se déplacer pour une raison valable, notamment de santé, d'exprimer son vote.
En effet, même si nous avions réglé toutes les questions que vous avez soulevées sur le vote à distance, la question de principe demeurerait : celle de la participation au scrutin dans les conditions les meilleures possible pour prévenir toute pression sur l'exercice du droit de suffrage. Avant l'instauration de l'isoloir - en 1913 seulement -, le patron de l'usine attendait parfois les ouvriers à la porte de la mairie pour leur remettre le bulletin de vote... L'isoloir est, de ce point de vue, le moins mauvais des systèmes !
Je considère que vous apportez des solutions pragmatiques pour l'organisation des prochaines élections départementales et régionales.
S'agissant du choix de la date, il faut dire que, au moment même où la mission vous était confiée, il n'était peut-être plus temps d'organiser dans de bonnes conditions des élections en mars 2021... Même si je n'étais initialement pas favorable à leur report, je crois qu'on ne pouvait plus faire autrement. C'est d'ailleurs ainsi que vous l'avez présenté !
Néanmoins, que ferons-nous si l'arrivée du vaccin ne permet pas, comme nous l'espérons, de sortir de l'impasse actuelle ? Vous avez examiné le problème dans toutes ses dimensions, y compris la dimension constitutionnelle. Un report des élections départementales et régionales au-delà de juin 2021 supposerait, naturellement, une nouvelle intervention du législateur. Mais dans quelle mesure serait-il autorisé par le Conseil constitutionnel ? Vous ne pouvez en préjuger, mais vous pouvez nous rappeler les règles applicables.
Vous avez évoqué des raisons pratiques pour ne pas retenir la date de septembre 2021. Mais il n'est pas interdit de tenir des élections en septembre : songeons aux élections sénatoriales, même si leur nature est différente.
Au-delà du mois de septembre, il faudra voter le budget de l'État et de la sécurité sociale, après quoi on entrera dans la période de l'élection présidentielle.
Ce qui n'aurait sans doute pas été constitutionnel maintenant - à savoir reporter les élections départementales et régionales à l'automne 2022 - pourrait-il l'être dans les prochains mois, si la situation sanitaire paraissait le justifier ?
Indépendamment de la dimension constitutionnelle, la question de l'opportunité politique et civique d'un tel report se poserait avec force. Vous l'avez d'ailleurs vous-même souligné.
À un moment donné, ne faudrait-il pas considérer que le report d'une élection est une solution de facilité ? La vraie réponse n'est-elle pas d'assurer la sécurité sanitaire du scrutin ? Quelles recommandations feriez-vous à cet égard, pour qu'une élection se déroule en période d'épidémie sans aggravation du risque sanitaire ? Un scrutin pourrait sans doute être organisé dans de bien meilleures conditions que ce qui se passe à la table de famille pendant les fêtes...
La démocratie doit pouvoir vivre normalement. Si une élection présidentielle avait été prévue en 2021, vous n'auriez certainement pas proposé son report, parce qu'il aurait fallu réviser les articles 6 et 7 de la Constitution. Bref, il faut s'habituer à organiser des scrutins dans un contexte d'épidémie, parce qu'on ne pourra pas toujours les reporter.
Reste une question accessoire, mais qui a son importance : certaines collectivités territoriales présentent un bilan de leur action face à la crise sanitaire, qui n'est pas forcément lié à la campagne électorale. En raison du report des élections départementales et régionales, ne faudrait-il pas assouplir les règles pour les dépenses engagées entre octobre et décembre derniers ?
Alfred de Musset a dit, en substance : heureux ceux qui n'ont qu'une vérité ; plus heureux et plus grands ceux qui, ayant fait le tour des choses, ont assez approché la vérité pour savoir qu'on ne l'atteindra jamais...
Quelle sera la position du Conseil constitutionnel sur le report des élections départementales et régionales de 2021 ? Je ne peux pas vous répondre.
Si l'on ne peut pas tenir les élections en juin prochain, ce ne sera pas beaucoup plus facile en septembre 2021. En outre, on sera entré dans la période des comptes de campagne de l'élection présidentielle : si j'ai proposé un report des scrutins en juin 2021, c'est justement pour échapper le plus possible à la dynamique de la campagne présidentielle.
En tout état de cause, face à la menace, la meilleure réponse est parfois de ne pas céder et de permettre l'expression de la démocratie.
En dehors des aspects juridiques, je crains que, si les élections départementales et régionales étaient reportées après l'élection présidentielle, vous ne puissiez pas endiguer la pandémie politique : vous serez vilipendés, accusés d'avoir peur et l'abstention s'aggravera.
Nous sommes capables d'organiser en juin prochain, de huit à dix-huit ou dix-neuf heures - au lieu peut-être de vingt heures -, des scrutins qui se déroulent dans le respect des gestes barrières et des autres mesures sanitaires, d'autant que, d'après les pouvoirs publics, plusieurs millions de personnes auront été vaccinées. Montrons que la démocratie est forte !
Comment comprendre qu'on puisse aller dans des supermarchés bondés - j'ai été effondré de ce que j'y ai vu récemment - et qu'il ne soit pas possible, pendant deux dimanches, d'aller à la mairie pour chanter la démocratie ? Je ne comprends pas...
Tenons les élections départementales et régionales en juin 2021, sereinement, en organisant la campagne électorale et une communication sur le rôle des élus. Je ne vois que des inconvénients à un report supplémentaire.
Au surplus, un report après l'élection présidentielle donnerait une coloration politique à des scrutins qui, surtout pour les élections départementales, doivent être avant tout de proximité. On réduit déjà le nombre de cantons ! Tout devient abstrait ! Ne portons pas atteinte à la démocratie de proximité ! Quand j'étais conseiller général, j'avais une gendarmerie dans mon canton ; aujourd'hui, il n'y en a plus. D'ailleurs, il n'y a plus rien !
Au nom de je ne sais quoi, on est en train de supprimer la proximité. Ne plaçons pas l'élection départementale, élection de proximité, dans une dynamique qui en ferait d'abord une élection politique !
Je souhaite, de tout coeur, que les pouvoirs publics montrent leur capacité à faire face au défi devant lequel est placée la démocratie !

Je partage toutes vos affirmations de principe. Néanmoins, dans la situation difficile où nous nous trouvons, il faut consentir des aménagements raisonnables aux principes, sans quoi on se retrouve dans une impasse.
La solution que vous proposez est la meilleure pour l'instant. Mais on sent bien qu'on ne sait pas quoi faire en cas de nouvelle dégradation de la situation sanitaire...
Si votre agricultrice de l'Eure ne sait pas résister à celui qui lui demande son vote par correspondance, elle ne résistera probablement pas non plus à son mari qui lui demande une procuration... Moi-même, sénateur des Français de l'étranger, je suis issu d'un vote où les procurations sont nombreuses - bien plus nombreuses que le nombre de voix requis pour obtenir un siège de sénateur -, ce qui est un réel problème. Pourtant, nous consentons un aménagement à cet égard parce qu'il faut bien trouver des solutions.
Les autres aménagements doivent-ils être absolument refusés ?
Dans votre rapport, vous démolissez le vote par correspondance. Je pourrais partager certaines de vos observations. Reste que, dans un certain nombre de situations, les Français de l'étranger n'ont pas le choix. En outre, un tel système fonctionne sans difficulté majeure dans d'autres pays : je ne pense pas seulement aux États-Unis mais aussi à l'Allemagne, entre autres grandes démocraties.
Ne pourrait-on pas accepter un peu plus d'aménagements raisonnables pour défendre globalement les principes auxquels vous êtes attaché ? Si, au bout du compte, les élections ne peuvent pas avoir lieu en juin 2021, nous serons face à un réel problème...
J'ai le sentiment que nous ne sommes pas prêts à examiner toutes les expériences étrangères permettant de trouver des solutions techniques certes non idéales, mais propres à nous sortir de la situation actuelle sans confiner l'expression démocratique ni modifier l'ordre des scrutins.
Le pire serait d'organiser un vote par correspondance de manière hâtive et mal préparée, ce qui tuerait cette modalité de vote pour longtemps.
En quelques semaines, il aurait fallu lancer un appel d'offres, ce qui n'est pas si facile, et s'assurer que l'entreprise choisie soit capable d'organiser quatre votes sur l'ensemble du territoire, en comptant le premier et le second tours.
À la fin de l'année dernière, beaucoup disaient : la solution, c'est le vote par correspondance. En novembre, alors que la campagne a déjà commencé, qu'on n'a rien anticipé et qu'on vit au jour le jour, on me demande de déclarer : « il faut un vote par correspondance » ? Le faire aurait été irresponsable ! Peut-être sera-t-il un jour plus utilisé, mais procédons avec sérieux. Dans les conditions actuelles, je le répète, nous n'avons pas la certitude qu'un tel scrutin se déroulerait dans de bonnes conditions.
Voyez aussi les polémiques que le vote par correspondance a ouvertes aux États-Unis. La France n'a pas besoin de cela aujourd'hui !
Si, demain, nous envisageons un vote par correspondance, je souhaite que le Gouvernement et les parlementaires prennent le temps de réfléchir à son organisation. Mais ne nous lançons pas dans un tel dispositif, qui n'est pas dans nos habitudes, alors que rien n'est prévu.
Gouverner, c'est prévoir. Je n'ai pas le sentiment que cela soit aujourd'hui la règle pour tout le monde. On ne prévoit rien... On lance : « vote par correspondance » ! Mais comment, avec qui ? Et quid du risque d'intrusion de puissances étrangères ? Nous devons avoir des certitudes à cet égard.
Oui, le vote par correspondance peut être un secours, mais pas s'il est organisé « à la va-vite » et sans précaution.

Je suis d'accord avec vous : il ne faut pas reporter davantage les élections départementales et régionales de 2021, mais s'adapter à la situation. Demain, nous aurons peut-être à faire face à un autre virus. À un moment, la vie doit reprendre !
Reste qu'il s'agit d'une vie un peu particulière : comment organiser une campagne électorale en respectant les règles sanitaires ? Faut-il permettre aux candidats de faire campagne à la télévision et la radio ? Des télévisions locales, comme France 3, pourraient-elles organiser des débats ?

Permettez-moi de citer à mon tour Alfred de Musset : « Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée ». Aujourd'hui, la porte est à demi ouverte, et nous n'avons plus de poignée...
Le Gouvernement s'est mis tout seul dans cette situation, à force de ne réfléchir qu'à une solution : le report des élections, en attendant que les choses aillent mieux. Résultat : nous n'avons pas su anticiper en mai dernier la situation du mois de mars 2021 et, au moment où vous avez commencé vos travaux, le report des scrutins départementaux et régionaux était devenu inévitable.
Un report supplémentaire me semble impossible, au nom de la périodicité raisonnable du scrutin et de sa loyauté. En conséquence, il faut se pencher sur les adaptations que d'autres pays ont su réaliser en amont, en particulier sur les nouvelles solutions trouvées pendant la campagne américaine. Or le texte qui arrive ne traite que du report des scrutins : pourquoi le Gouvernement ne se pose-t-il pas la question de l'organisation d'une campagne dont on sait qu'elle doit avoir lieu ? Puisqu'il faut tenir ces élections, nous devons innover !
Dans les standards internationaux, il est recommandé d'éviter les procurations, qui sont une solution naturelle, mais une mauvaise solution. La « double procuration » n'a pas été retenue dans le texte initial du Gouvernement. Cette réflexion simple, pour ne pas dire simpliste, nous pousse mécaniquement vers le report des élections départementales et régionales, ce qui est un dévoiement de la démocratie.
S'agissant du vote par correspondance, j'ai proposé, avec mon groupe, un texte qui permettrait d'éviter certains écueils d'organisation. J'entends les préventions, mais quand faudrait-il mettre en place le vote par correspondance pour qu'il puisse fonctionner ? Peut-on imaginer qu'il faille déjà y réfléchir pour l'élection présidentielle ?

Le rapport de Jean-Louis Debré représente assez bien ce qui ressort de nos différents échanges.
Le report d'une élection doit être réalisé en toute humilité, car la décision n'est pas simple à prendre. Il est facile d'exiger que la démocratie ne soit pas confinée, ce dont je suis fondamentalement convaincue, mais l'expérience des élections municipales a montré que, parfois, les électrices et les électeurs ne l'entendent pas de cette façon-là. L'abstention a été très forte, peut-être en raison de la rencontre entre la crise sanitaire et la crise politique.
Nous avons besoin de maintenir un arc républicain très soudé, pour que l'abstention ne s'aggrave pas davantage, ce qui fragiliserait les collectivités territoriales, que nos concitoyennes et nos concitoyens appréhendent parfois mal. Je pense surtout aux départements.
Il est impératif d'assurer la sécurité sanitaire le jour du vote, mais l'élection, c'est aussi la campagne. À l'heure où nous parlons, il y a lieu d'être inquiet pour la qualité du futur temps de campagne, même si de nouvelles formes peuvent être inventées. La fragilisation de certaines pratiques - qui relèvent peut-être de l'ancien monde mais qui ont fait leurs preuves - favorise les exécutifs sortants.
J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur le besoin de mieux faire connaître le rôle des départements et des régions. Est-ce le gage d'une participation supplémentaire ? Je n'en suis pas certaine. Il y a vingt ans, les gens appréhendaient-ils mieux la collectivité régionale ? Pas sûr. En tous cas, l'abstention ne fait qu'augmenter. Quoi qu'il en soit, si des spots publicitaires devaient être faits, il faudrait qu'ils soient conçus en fonction de l'intérêt général, sans valoriser telle ou telle majorité sortante.
Je pense, comme vous, que reporter les élections départementales et régionales en septembre 2021 n'apporterait guère de garanties supplémentaires. Nous avons déjà reporté des élections régionales, par exemple celles de décembre 2015. Et nous avons su faire. Mais nous n'étions pas à quelques mois d'une élection présidentielle. Il ne faut pas mélanger les enjeux électoraux.
En l'état, je ne suis pas favorable au vote par correspondance. En revanche, nous avons besoin de réfléchir aux modalités de la procuration, pour la simplifier et la rendre plus accessible. Il faut conserver le principe selon lequel le vote est individuel et peut être décidé jusqu'au dernier moment. Les sondages montrent, en effet, que près de 20 % des électeurs peuvent changer d'avis jusqu'à trois jours avant l'élection, voire même jusqu'au matin du vote.
Vous avez parlé de mieux populariser, de mieux vulgariser la connaissance des compétences des départements et des régions. Que pensez-vous de la volonté, affichée par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de présenter le projet dit loi dit « 4D » - décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification - en février prochain, avec un examen au Parlement pendant les élections régionales et départementales de juin 2021 ? Cela ne nuirait-il pas à lisibilité du rôle des collectivités territoriales ?

Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je comprends la difficulté de votre tâche, puisqu'il s'agit de choses importantes, à savoir l'organisation d'une élection, et qu'on ne doit évidemment considérer un bouleversement du calendrier qu'avec une extrême précaution, pour des raisons évidentes.
Il n'empêche que nous devons essayer de trouver une solution tenant compte de deux objectifs : le respect des échéances électorales et la garantie de bonnes conditions de déroulement du scrutin. Nous sommes ici pour essayer de trouver un point d'équilibre, dans cette situation d'incertitude.
J'étais d'accord avec l'essentiel de vos propos. Je crois au vote « physique » car l'acte de voter est l'un des plus importants dans une démocratie. Le vote par procuration ou par correspondance ne doit être que dérogatoire à ce principe général, tout comme le vote électronique. Nous ne devons pas nous incliner devant une espèce de « totem » technologique qui nous ferait perdre de vue l'essentiel.
Vous avez parlé de délai raisonnable...

Je me souviens que les élections municipales de 1995 ont été reportées de quelques mois. Et celles qui devaient se tenir en mars 2007 ont été reportées en mars 2008. Il y avait le risque de « télescopage » avec l'élection présidentielle... Aujourd'hui, la question sanitaire est venue tout bouleverser, y compris dans la société. Selon les époques, on compose plus ou moins avec les principes qui doivent nous guider. L'incertitude risque de planer encore quelques semaines, voire quelques mois. Nous n'avons pas de visibilité et nous naviguons à vue.
Les opérations de vote en elles-mêmes ne posent pas de problèmes même si, avec quatre scrutins, il y aura quelques difficultés matérielles pour les « routeurs » et les imprimeurs entre les deux tours, avec la possibilité de fusion de listes. Mais, comme l'a dit Cécile Cukierman, les élections départementales et régionales sont déjà « télescopées » par la situation que nous connaissons aujourd'hui. Les comptes de campagne vont sans doute être aménagés mais on peut s'interroger sur les conditions psychologiques et la sérénité nécessaires à la préparation de la campagne électorale.
Le scrutin départemental est individuel, contrairement au scrutin régional. On sait que la constitution de listes implique des discussions préalables longues et souvent compliquées. On peut d'ores et déjà être inquiet sur la bonne préparation de ces élections. C'est la première fois, à ma connaissance, que l'incertitude va peser autant sur un scrutin.
Pourquoi n'a-t-on pas anticipé ? Pour quelles raisons n'a-t-on pas réfléchi aux élections départementales et régionales dès le mois de mai 2020 ?
Je ne le sais pas, mais j'ai un sentiment. Je ne suis pas proche du Gouvernement, ni de personne, et je regarde tout cela avec beaucoup de distance. Au cours des auditions que j'ai faites, certains ne cachaient pas les conclusions auxquelles ils souhaitaient que j'arrive. Bien sûr, c'était maquillé par des arguments juridiques ou politiques. Mais l'idée était claire : on a eu les élections municipales, maintenant, on « file » sur l'élection présidentielle ! Et on dégage la voie ! Cela m'a stupéfait. On aurait dû me demander cela au lendemain même des élections municipales. Pourquoi avoir attendu ? En fait, on voulait que j'arrive à la conclusion qu'il fallait que l'on reporte tout après les présidentielles. Eh bien, dès le départ j'ai dit non. C'est pour cela qu'on ne me confiera pas de deuxième rapport...
Oui, il y a des incertitudes. Mais le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Il faut être volontaire. Si on est pessimiste, on ne fait plus rien, on attend, on se cache sous la table, on se planque dans la salle Médicis du Sénat, et on attend ! La France, ce n'est pas cela. La démocratie, c'est faire face et faire front.
L'impératif, c'est que les élections départementales et régionales aient lieu dans un délai raisonnable. Je n'anticipe pas la jurisprudence du Conseil constitutionnel - même si j'ai fait un stage dans cette maison. À mon époque, nous avions une jurisprudence bien précise, qui reposait sur la notion de délai raisonnable. À cet égard, je considère qu'il y a un risque à reporter les élections régionales et départementales après l'élection présidentielle. Cette dernière aura lieu au printemps 2022 et sera suivie des élections législatives. Cela reviendrait à reporter les élections régionales et départementales de quasiment deux ans. On sortirait du raisonnable.
Nous devons faire preuve d'imagination dans l'organisation matérielle des campagnes électorales. Celles-ci ne seront plus exactement celles qu'on a connues dans le passé, ou que la Troisième République a connues, avec des réunions sous les préaux. C'est fini, nous sommes à une autre époque ! Et je suis stupéfait qu'on ne réfléchisse pas aux transformations pratiques qui doivent être faites.
Sans doute, ce sera plus facile pour les élections régionales que pour les élections départementales. Pour les élections régionales, les candidats peuvent faire une expression directe. Pour les élections départementales, il faut passer des cantons aux regroupements de cantons et il n'y a pas de télévision ou de radio cantonale. Cela dit, on reçoit sans cesse des publicités, la sécurité sociale nous envoie des lettres, les impôts aussi... Pourquoi ne pourrait-on pas envoyer à chaque électrice et à chaque électeur un petit document bien fait sur l'action d'un conseil départemental ?
En parlant avec mes amis de l'Eure, je me suis rendu compte que, si les personnes d'un certain âge identifiaient bien le conseiller général, les jeunes ne l'identifiaient plus. Il faudrait pourtant leur expliquer que, s'il y a une subvention pour le club de rugby, si on a organisé des représentations culturelles, c'est certes grâce à la mairie, mais pas uniquement à elle : la communauté d'agglomération et le département ont aussi une action sociale, une action culturelle, une action économique.
J'ai demandé à un certain nombre de lycéens à quoi sert un conseiller général. Ils ont été très gentils, ils ne m'ont pas dit : « à rien » ! Mais il faut comprendre qu'on ne fait plus de campagne électorale comme il y a un siècle ! Et la responsabilité des pouvoirs publics est de promouvoir la connaissance de nos institutions, dès lors qu'il n'y a plus l'instruction civique à l'école. On n'apprend plus rien aux jeunes, ils sont dans leur portable, comment voulez-vous dès lors les intéresser aux campagnes électorales ? Donnons la possibilité aux candidats de communiquer par un certain nombre de mécanismes modernes. C'est aux pouvoirs publics d'organiser cela.
On m'a parlé d'une loi en préparation concernant les collectivités territoriales. C'est tout de même incroyable : en France, on fait des lois mais on ne les applique pas ! En l'espèce, pas la peine de faire des lois. Que l'on commence par faire fonctionner la démocratie locale, car la démocratie nationale ne fonctionnera que si la démocratie locale fonctionne. Quand je suis arrivé au Conseil constitutionnel, on examinait une loi qui était la troisième sur le même sujet. J'ai demandé à ce qu'on me fasse un bilan de l'application des deux premières. Il n'y avait pas de bilan, parce que les décrets d'application n'étaient pas encore sortis ! En fait, la loi est devenue un instrument de la communication politique...
Là, nous n'avons pas besoin de loi. Il suffit de prendre des gens qui connaissent le terrain et que ceux-ci regardent comment on peut faire connaître le rôle de la démocratie locale. En effet, entre le maire, le conseiller départemental, la communauté d'agglomération, la communauté de communes, la région, le Sénat, l'Assemblée, on s'y perd ! Au moins, l'instruction civique à l'école avait une conséquence, c'est que la démocratie, les gens la comprenaient ! Aujourd'hui, ils ne la comprennent plus. Nous devons donc organiser des campagnes, avec le ministère de l'intérieur, avec le ministère chargé des collectivités territoriales, et nous devons faire en sorte que les campagnes électorales permettent cette diffusion des idées.
Mais pas « à la va-vite » ! Je suis frappé de constater qu'on a attendu d'être devant l'obstacle pour essayer de trouver une solution. Pourtant, il y a des années qu'on aurait dû se préoccuper de l'évolution des campagnes électorales. Il suffit de regarder comment celles-ci se déroulent dans un certain nombre d'autres pays pour voir qu'ils sont en avance sur nous. Nous, nous sommes toujours dans les conceptions d'il y a un siècle... J'ai beaucoup aimé le mot « populariser ». Oui, il faut populariser, et faire en sorte qu'on comprenne ce que chacun fait !
Toutes les semaines, je faisais visiter le Conseil constitutionnel à des enfants. Un jour, est arrivé le président Giscard d'Estaing. Il a salué les enfants, mais ceux-ci ne le reconnurent pas. Du coup, je les ai réuni dans mon bureau et ai passé en revue avec eux les présidents de la Cinquième République. De Gaulle : « ah oui, il était général, il a fait la guerre et il est revenu ». C'était tout. Pompidou, Giscard : rien. Mitterrand ? « Ah oui, il était de gauche ». Chirac ? « Un type sympa, qui boit de la bière ». Le président suivant a dit « casse-toi pauv'con », et son successeur a fait de la moto pour aller voir sa copine ! C'était tout ce que des enfants de 15 ans avaient retenu de l'action de nos Présidents de la République. Et, quand je les ai interrogés ensuite sur l'action des députés, des sénateurs : rien.
On ne peut pas se plaindre de l'abstention et n'instruire nos enfants de rien. On ne leur raconte rien, on ne leur raconte pas l'Histoire de France. Je rêve que, comme Hippolyte Carnot avait envoyé en 1848 des directives à tous les instituteurs, on leur prescrive aujourd'hui de le faire. C'est indispensable si l'on veut lutter contre l'abstention. Il faut qu'un organisme réfléchisse sereinement, avec les moyens modernes de communication, à la manière dont les campagnes électorales vont se dérouler désormais.

Merci pour cette audition Monsieur le président.
La commission des lois du Sénat a travaillé, comme l'a rappelé tout à l'heure Philippe Bas, en novembre et décembre derniers, à un rapport d'information sur le vote à distance. Nous avons essayé de faire, dans les circonstances d'urgence qui étaient les nôtres, un travail de fond et d'analyse. Je vous en remettrai un exemplaire.
Ce point de l'ordre du jour a fait l'objet d'une captation vidéo qui est disponible en ligne sur le site du Sénat.
La réunion est close à 19 h 55.