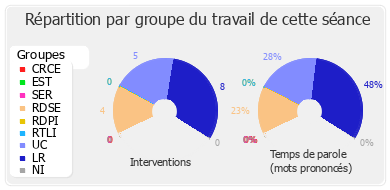Séance en hémicycle du 14 mai 2008 à 16h00
Sommaire
- Procès-verbal (voir le dossier)
- Candidatures à une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Souhaits de bienvenue à une délégation du sénat de la république démocratique du congo
- Politique étrangère de la france (voir le dossier)
- Nomination de membres d'une commission mixte paritaire (voir le dossier)
- Politique étrangère de la france
La séance
La séance est ouverte à seize heures cinq.

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

J’informe le Sénat que la commission des affaires économiques m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Mes chers collègues, il m’est particulièrement agréable de saluer la présence, dans nos tribunes, d’une délégation de sénateurs de la République démocratique du Congo, conduite par le président du Sénat, M. Léon Kengo Wa Dondo.
Cette visite contribue à renforcer les relations entre nos deux assemblées, que je souhaite voir se développer, notamment grâce à l’action menée par le groupe interparlementaire que préside notre excellent collègue et ami M. Jean-Pierre Cantegrit, sénateur représentant les Français établis hors de France.
Je forme des vœux, monsieur le président du Sénat de la République démocratique du Congo, pour la pleine réussite de votre visite, pour la vigueur du bicamérisme et pour que votre venue fortifie, s’il en était besoin, les liens qui unissent nos deux pays.
Nous sommes fiers et heureux de vous recevoir et nous espérons que vous garderez un bon souvenir de votre passage au Sénat de la République française. Sachez en tout cas que nous serons toujours honorés de vous voir revenir. Cordiale bienvenue !
M. le ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

L’ordre du jour appelle un débat organisé à l’initiative de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur la politique étrangère de la France.
Monsieur le ministre des affaires étrangères et européennes, mes chers collègues, le débat auquel nous allons procéder dans un instant correspond à une demande exprimée par M. le président de la commission des affaires étrangères, soucieux – on le comprend et on l’approuve – de réserver aux grandes orientations et à la mise en œuvre de la politique étrangère deux débats annuels dans notre hémicycle.
Convenons, mes chers collègues, que ce beau sujet, ce grand sujet, mérite bien que nous prenions le temps de ces débats spécifiques !
Pour le débat inaugurant cette nouvelle pratique, nous allons entendre d’abord le président de la commission des affaires étrangères, puis les orateurs des groupes se seront exprimés. Nous écouterons ensuite la réponse de M. le ministre des affaires étrangères et européennes, que nous remercions d’avoir bien voulu accepter ce débat et d’y participer personnellement.
Place donc au débat, auquel nous invite une actualité internationale plutôt dramatique.
La parole est à M. le président de la commission.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre commission a en effet pris l’initiative de proposer à la conférence des présidents l’inscription à l’ordre du jour du Sénat d’une séance consacrée à un débat sur la politique étrangère de la France dans toutes ses dimensions. Je vous remercie, monsieur le ministre, d’y avoir réservé un bon accueil !
La tenue de ce type de débat entre la représentation parlementaire et le Gouvernement me paraît indispensable pour avoir une vue d’ensemble de notre politique étrangère dans le monde, mais n’exclut nullement, bien entendu, l’organisation de débats thématiques et vient compléter les auditions au sein de la commission.
Ce premier débat s’inscrit à la confluence d’un certain nombre de démarches entamées par le Gouvernement qui devront déboucher sur des orientations fondamentales et des décisions importantes.
Le fait que notre commission traite à la fois des affaires étrangères et de la défense est un atout qui nous permet d’aborder ces questions de manière globale tant il est vrai que la manifestation de la force, en particulier au service de la paix et la stabilité mondiale, est un outil fondamental de la politique extérieure.
Les démarches entamées en matière de révision générale des politiques publiques, la RGPP, d’élaboration de livres blancs sur la politique étrangère et européenne et sur la défense et la sécurité nationale, le débat sur la place de la France dans l’OTAN, l’affirmation, avec le dispositif institutionnel issu du traité de Lisbonne, d’une politique étrangère et de défense européenne, la réforme des institutions internationales, singulièrement de l’ONU et de son Conseil de sécurité, sont autant de thèmes qui vont déterminer les fondamentaux de notre politique étrangère, permettre de définir nos objectifs et d’adapter nos moyens ainsi que nos ambitions, pour peu que celles-ci soient clairement définies et résultent d’un large consensus démocratique.
Je souhaite que ce débat puisse être organisé deux fois par an de manière à permettre à l’ensemble des sensibilités politiques représentées au Sénat de s’exprimer et de faire part, au-delà du travail spécifique de notre commission, de ses analyses et de ses convictions.
La mondialisation à laquelle nous sommes confrontés a profondément modifié les relations internationales au sein d’un monde désormais éclaté, instable et dangereux.
Depuis l’effondrement de l’Union soviétique, les blocs qui structuraient le monde et l’équilibre qui résultait de la dissuasion nucléaire mutuelle ont été remplacés par un monde multipolaire, au sein duquel un certain nombre de grandes puissances émergentes comme le Brésil, la Russie, la Chine, l’Inde, le Mexique ou l’Afrique du Sud deviennent des pôles économiques et politiques de développement, alors même que le poids relatif de l’Europe diminue. L’équilibre économique et politique du monde se déplace irréversiblement vers l’Asie.
De multiples forces s’exercent dans un monde instable, en devenir, dont on ne sait pas encore vers quel type d’équilibre il va évoluer. Le monde est plus instable comme en témoigne l’émergence de communautarismes en Afrique, dans les Balkans ou au Proche-Orient, qui suscitent un ensemble de conflits asymétriques et durables.
La dangerosité du monde s’est également accrue avec, pour ne citer que ces éléments, l’apparition de fondamentalismes, la montée en puissance des mafias, conséquence de l’affaiblissement des États, le terrorisme international et les menaces résultant d’une prolifération nucléaire incontrôlée. Mais il est aussi évident pour tous que, au nombre des nouvelles menaces, les dérèglements de l’environnement figurent en bonne place.
Enfin, le monde s’est considérablement dérégulé. Le système monétaire international issu des institutions de Bretton Woods a disparu. La régulation par le commerce dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce, l’OMC, est aujourd’hui bloquée et battue en brèche par la multiplication des accords commerciaux bilatéraux. L’ONU est contestée, faute de trouver les moyens de la réforme de son élargissement, et la mise en œuvre des politiques qu’elle préconise, en particulier en matière de développement, rencontre d’importantes difficultés. L’Europe, enfin, a été secouée par des mouvements centripètes avec le « non » des référendums français et néerlandais et les conflits d’intérêts qui résultent de son élargissement même.
Dans ce monde d’insécurité, les dividendes de la paix sont de plus en plus difficiles à engranger et nous assistons plutôt à une multiplication des conflits. Il nous faut également constater l’échec relatif de l’universalisme occidental, dont le modèle n’a pas rencontré l’adhésion. L’unilatéralisme, qu’a choisi jusqu’à une date récente la puissance américaine, et le développement des relations bilatérales, notamment à l’échelon économique, en sont les conséquences. L’un des principaux défis auquel nous sommes confrontés sera de développer des mécanismes d’interdépendance, de solidarité et d’homogénéité afin de forger l’amalgame permettant de passer d’un monde multipolaire à un multilatéralisme réel.
Dans ce contexte, que peut faire la France ?
À l’instar des auteurs du Livre blanc sur la politique étrangère et européenne de la France, Alain Juppé et Louis Schweitzer, nous pouvons assigner cinq objectifs à nos relations internationales : assurer la sécurité de la France et des Français et défendre nos intérêts dans le monde ; construire avec nos partenaires une Europe forte, démocratique et efficace ; agir dans le monde en faveur de la paix, de la promotion des droits de l’homme et du développement durable ; contribuer à l’organisation d’une mondialisation équilibrée et sûre ; assurer le rayonnement culturel de la France et du français.
Si notre politique étrangère et notre politique de défense s’inscrivent bien évidemment dans des alliances, elles demeurent des politiques nationales au service de l’intérêt de la France et de la sécurité des Français.
S’agissant de la politique de sécurité et de défense, le Livre blanc actuellement en cours de finalisation identifie clairement les nouvelles menaces auxquelles nous sommes confrontés. Nous aurons prochainement à en débattre et à prévoir les moyens mis à la disposition de la sécurité de notre pays dans le cadre de la future loi de programmation militaire.
Il est aujourd’hui évident que la sécurité de notre pays se joue non seulement à l’intérieur de nos frontières, mais aussi sur les théâtres d’opérations extérieures, et que cette politique nécessite donc des alliances fortes. Le renforcement des liens avec l’OTAN, le développement concomitant de la politique européenne de sécurité et de défense, qui est l’un des objectifs de la présidence française de l’Union européenne, ainsi que la consolidation d’une industrie européenne de l’armement sont les trois axes déterminants en la matière.
Notre commission a décidé d’envoyer des missions sur les principaux théâtres d’opérations où nos forces sont déployées et où notre diplomatie joue un rôle actif.
Ainsi, nous sommes récemment allés en Côte d’Ivoire, en Afghanistan, au Liban, en Bosnie-Herzégovine, et nous devons prochainement nous rendre au Kosovo et au Tchad.
Sur ces différents théâtres, la sécurité de la France et de l’Europe est engagée, tant il est vrai que la stabilité ou l’instabilité de ces régions ont des effets directs sur nos pays, que ce soit en matière de terrorisme, de sécurité des approvisionnements ou de lutte contre la drogue.
Il ressort de ces missions que la solution des conflits n’est en aucun cas militaire. Si la sécurité est naturellement indispensable au développement économique, politique et démocratique, nous avons pu constater, notamment en Afghanistan, que, dans ces conflits asymétriques, l’action militaire à elle seule ne peut aboutir.
Le succès des opérations qui sont menées dans ces différents pays dépendra essentiellement de notre capacité à assurer leur développement économique, à consolider leurs institutions et à les responsabiliser en les amenant à assumer eux-mêmes le maintien de l’ordre et le rétablissement de la paix.
Le deuxième objectif fondamental que doit poursuivre notre politique étrangère est la construction européenne.
De ce point de vue, nous approuvons pleinement les priorités définies dans le cadre de la présidence française de l’Union européenne, car elles correspondent aux défis actuels. Sans qu’il soit besoin de les reprendre, je redis que notre politique étrangère devra tendre tous ses efforts pour qu’elles aboutissent.
Face à ces défis, nous devons réagir avec humilité et solidarité envers nos partenaires, en recherchant en particulier l’accord franco-allemand, qui a toujours été l’élément indispensable et incontournable de la construction européenne. Il n’y a pas de vrai substitut au moteur franco-allemand, et cette assertion s’est particulièrement vérifiée dans les discussions qui ont abouti à la réforme des institutions telles qu’elles ont été définies dans le traité de Lisbonne, un succès que nous pouvons légitimement partager avec nos amis allemands.
La relance de la coopération avec le sud de l’Europe dans le cadre de l’initiative française pour l’Union pour la Méditerranée est une action heureuse. L’accord qui a été obtenu et la participation de l’ensemble des pays européens qui souhaitent s’y associer permettront sans doute un rééquilibrage de l’action de l’Europe vers le Sud, au travers de projets concrets destinés à développer les relations économiques et politiques entre les deux rives de la Méditerranée.
En outre, notre diplomatie doit contribuer à l’élaboration d’un système de gestion des crises internationales plus efficace, au sein duquel une politique des droits de l’homme, du développement durable et de l’environnement puisse se construire.
Certes, les droits de l’homme ne constituent pas en eux-mêmes le fondement d’une politique étrangère, mais leur défense est un élément essentiel, qui n’est ni incompatible ni contradictoire avec la défense de l’emploi ou de nos intérêts commerciaux.
Par ailleurs, nous devons poursuivre avec dynamisme la politique de défense de l’environnement. Les risques de conflits liés aux dérèglements de l’environnement comme, par exemple, les guerres pour l’eau, l’accroissement des mouvements migratoires dus à la pauvreté et à la faim ou la conquête de nouvelles ressources énergétiques font clairement partie des nouvelles menaces auxquelles nous sommes d’ores et déjà confrontés.
De ce point de vue, notre pays a fait preuve d’engagements forts qu’il convient de poursuivre.
Nous devons également contribuer à l’élaboration d’un ordre international stabilisé. Cela passe naturellement par la réforme des institutions internationales permettant l’inclusion des puissances émergentes à leur juste place, en particulier au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, mais aussi par une meilleure régulation de l’action économique au niveau mondial.
Sans ces réformes, il serait illusoire de croire possible la création d’un ordre international stable, garant de la sécurité du monde. Si nous ne réussissons pas, ce sont les forces de division, de repli et de fermeture, entraînées par l’exaltation des nationalismes et des égoïsmes, qui l’emporteront.
Enfin – et c’est l’une des constantes de notre politique étrangère –, nous nous devons de poursuivre l’action en faveur du rayonnement culturel de la France et de la langue française.
Cela passe naturellement par la défense de l’enseignement du français à l’étranger, par la multiplication des échanges culturels, par le développement de nos moyens audiovisuels et par la défense de la francophonie. La politique étrangère de la France consiste à faire entendre la voix de notre pays et à répondre à l’image qu’on attend de nous, en particulier en ayant un rôle de médiateur entre les blocs, de facilitateur et de conciliateur, rôle que nous permet d’endosser notre histoire, comme notre indépendance reconnue.
Pour atteindre ces objectifs, il me paraît évident qu’il faut arrêter la dégradation des moyens mis à la disposition de notre diplomatie.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et du groupe CRC.

Notre commission est certes, comme le Sénat dans son ensemble, particulièrement sensible à la problématique du redressement de nos finances publiques. La France ne pourra avoir un rayonnement politique que si elle s’appuie sur des finances publiques saines et fortes. Pour autant, cet objectif global ne doit pas nous faire oublier la réalité de ce que sont les moyens mis à la disposition du ministère des affaires étrangères et européennes.
Permettez-moi de rappeler que le budget de ce ministère, hors aide au développement, ne représente que 0, 7 % du budget général §et que, au cours des dix dernières années, le ministère a su réduire ses effectifs de 11 %.
Nous sommes aujourd’hui arrivés à un niveau d’étiage, et notre commission peut témoigner, au travers des missions et des déplacements qu’elle effectue à l’étranger, de ce que l’efficacité de nos diplomates ainsi que la pertinence de nos idées et de nos propositions se trouveraient naturellement amplifiées si nous pouvions soutenir notre politique par une participation financière accrue, que demandent d’ailleurs nos partenaires.
Cela est particulièrement vrai concernant nos contributions volontaires versées dans le cadre des institutions internationales. Il en va de même pour l’aide au développement, puisque l’objectif d’atteindre 0, 7 % du PIB s’éloigne encore du fait de l’aboutissement mécanique des annulations de dettes. Notre participation concrète, au-delà de nos bonnes intentions et de nos discours généreux, est le gage de notre crédibilité et la marque réelle de notre engagement et de notre solidarité.
Pour conclure, je souhaite affirmer fortement que la politique étrangère de la France ne saurait être autre. Défendre ses intérêts, ses positions, ses aspirations et son rang est non pas un privilège, mais un droit qu’elle ne saurait déléguer à quiconque.

Aucune nation ne pourrait le faire à sa place et si, au sein de nos alliances comme de l’Union européenne, nous devons rechercher la concertation et conjuguer nos forces avec nos partenaires pour élaborer des actions convergentes sur les grands problèmes du monde, nous ne pourrons atteindre notre objectif que dans le respect de notre libre consentement et de notre souveraineté.
Mais, pour être entendue, crédible et suivie, la France doit donner des exemples plutôt que des leçons. Remettre de l’ordre dans nos finances publiques, redresser notre économie, conforter les moyens de notre défense, ceux de la coopération avec les pays en voie de développement et de l’attraction culturelle : voilà autant de preuves de notre volonté de trouver notre place et de conserver notre influence dans le concert des nations. Tout cela, aussi, ne dépend que de nous.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ UC-UDF et du RDSE, ainsi que sur quelques travées du groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la diplomatie française a longtemps été considérée comme une référence.
En effet, la France a des atouts pour jouer un rôle important sur la scène internationale : elle s’affiche comme la cinquième puissance économique mondiale, elle possède encore le second réseau d’ambassades, elle siège en permanence au Conseil de sécurité, elle est représentée en bonne place dans les institutions internationales, elle compte 150 centres culturels et 270 lycées à l’étranger.
Un an après l’élection du chef de l’État et deux mois avant la présidence française de l’Union européenne, de nombreuses personnes, en France, mais peut-être plus encore à l’étranger, estiment que la diplomatie française procède d’une politique dont les choix se sont altérés et dont l’image s’est sensiblement ternie.
La politique étrangère de la France méritait bien un débat, et je remercie le président de la commission des affaires étrangères du Sénat d’en avoir demandé – et obtenu ! – l’organisation.
La présidence Sarkozy s’annonce à l’évidence comme celle d’un prétendu retour de la France sur la scène internationale, à marche forcée, entraînant souvent de légitimes crispations chez nos partenaires. Le chef de l’État semble s’être soudain pris de passion pour cet exercice difficile, mais il se comporte à l’étranger comme en France : beaucoup d’agitation volontariste et une amnésie chronique quant à ses promesses de campagne.
Le 26 avril 2007, au cours d’une conférence de presse visant à exposer sa vision de la politique étrangère, le candidat à l’élection présidentielle s’était alors prononcé pour une présence militaire en Afrique « réduite au maximum » et avait souhaité que la France mette fin à toute ambiguïté et complaisance dans ses relations avec ses partenaires arabes.
La tentation d’affirmer la présence française dans les moindres recoins du monde semble relever davantage d’une fuite en avant, voire d’improvisations, aux antipodes de la diplomatie efficace et reconnue qu’avait portée la France, notamment, lors de son refus de s’engager dans l’aventure irakienne de M. Bush.
La façon de procéder est pour le moins discutable et révèle souvent un mépris certain envers l’opinion publique et la représentation nationale. J’en veux pour preuve la très médiatique libération des infirmières bulgares, l’envoi d’un avion dans la jungle colombienne, les déclarations engageant militairement la France devant les parlementaires anglais, l’intervention dirigiste et inélégante envers la Chancelière allemande et les maladresses et ambiguïtés de la France dans ses relations avec la Chine à la veille des jeux Olympiques.
Cet état de fait me permet de souligner d’autant mieux l’importance de la mission sénatoriale conduite récemment avec succès par le président Poncelet, conjuguée à celle de Jean-Pierre Raffarin.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. –M. Robert Bret applaudit également.

Les nombreux faux pas que j’ai évoqués précédemment irritent les dirigeants étrangers et amusent souvent la presse internationale.
Notre diplomatie doit être forte, par son influence, mais aussi par sa capacité d’initiative ; enfin et surtout, elle doit être respectée.
Les premières déclarations du Président de la République et du Gouvernement ont marqué une inclination pour un alignement sur la politique « OTANienne » des États-Unis, inclination qui s’est trouvée puissamment confirmée depuis avec la décision d’envoyer quelque 700 soldats supplémentaires en Afghanistan, contre l’avis majoritaire des Français, moyennant un débat sans vote, à la volée, afin de donner à voir un semblant de démocratie. Faut-il rappeler que la politique étrangère n’est pas du seul ressort du Président de la République ?
Que s’est-il donc passé depuis un an après cette volte-face sur la vision de la gestion des crises ? Pourquoi accentuer notre présence militaire dans ce qui pourrait devenir le bourbier afghan ? Quels sont finalement les objectifs ? Les États-Unis ont dilapidé 127 milliards de dollars en sept ans, pour le résultat que l’on connaît. Cette opération coûterait la France un surcroît de dépense estimé à 150 millions d’euros.
Cette décision, qui va à l’encontre des objectifs affichés, ne permettra pas de trouver une solution politique et économique à la crise que connaît ce pays.

Elle aura, au contraire, pour effet d’aggraver les tensions dans la région et de placer notre pays dans un guêpier militaire aux très lourdes conséquences.
Dans ces conditions, renforcer notre dispositif militaire dans ce pays apparaît clairement comme un gage supplémentaire d’allégeance donné aux États-Unis. Mais cela constitue malheureusement un risque évident d’enlisement et d’engrenage dans une guerre aux objectifs flous, dans une région du monde terriblement sensible.
C’est aussi, à n’en pas douter, la contrepartie de la réintégration annoncée de notre pays dans les structures de commandement militaire d’une Alliance atlantique largement soumise aux États-Unis d’Amérique, alors même que la crise financière que connaît ce pays et les échéances électorales qui l’attendent constituent une source majeure d’incertitude.
Ces choix, qui apparaissent de plus en plus comme une dérive atlantiste d’une France rompant avec sa politique étrangère précédente, ne peuvent laisser peser le doute dans nos rapports nécessaires avec des pays comme la Russie – où nous nous sommes rendus avec M. le président de la commission des affaires étrangères –, qui sont particulièrement inquiets de la volonté américaine d’intégrer l’Ukraine et la Géorgie dans l’OTAN, et de l’engagement unilatéral des États-Unis d’implanter des radars ainsi qu’un dispositif antimissiles en Pologne et en Tchéquie.
Qu’en est-il, monsieur le ministre, de l’évolution des choix de la France sur ces questions ?
La politique étrangère de la France ne peut ignorer les nécessités économiques et énergétiques d’une présence terriblement étiolée de notre pays et de l’Europe dans de nouvelles relations économiques avec la Russie – j’y ai fait allusion précédemment en parlant de la Chine –, ou encore dans nos rapports avec le continent africain.
Cela s’applique également au Proche-Orient, toujours à la limite de l’embrasement, vivant en permanence dans un état de tension extrême, qu’illustre aujourd'hui le risque d’une nouvelle guerre civile au Liban. Avec ses partenaires européens, la France doit impérativement peser de tout son poids pour obtenir le retour des Israéliens et des Palestiniens à la table des négociations, afin que soient respectés les engagements pris lors de la conférence d’Annapolis et que, enfin, une solution de paix s’impose pour ces peuples.
Nous devons nous montrer plus efficaces. La France et l’Union européenne doivent être plus présentes dans les mois à venir. Qu’en est-il, monsieur le ministre, à la veille de la présidence française de l’Union européenne ?
Concernant la relation de la France avec l’Afrique, des déclarations souvent excessives, parfois gravissimes se sont enchaînées. Le discours le plus récent prononcé par le président au Cap, en Afrique du Sud, n’a en rien apaisé la tempête légitime ressentie par nos amis africains lors du discours de Dakar au mois de juillet 2007. En Afrique et dans le reste du monde, ce discours a été considéré comme dominateur, voire non dépourvus de relents racistes.
Même si, dans les mots, le discours du Cap avait pour objet d’infléchir les effets dévastateurs du discours de Dakar, il y a souvent un fossé entre les déclarations d’intention et les actes.
Dans mon intervention lors des débats budgétaires consacrés aux affaires étrangères, j’exhortais déjà le Gouvernement à plus de modestie dans sa politique étrangère. Oui, notre pays gagnerait à rompre avec une certaine arrogance et avec des certitudes dominatrices d’un autre âge.
En décembre dernier, la France se targuait d’être en phase avec les objectifs du Millénaire, à savoir consacrer 0, 7 % de son PIB à l’aide au développement, et ainsi, avec l’aide des pays du G8, réduire de moitié la pauvreté dans le monde d’ici à 2015. Avec 7, 2 milliards d’euros alloués en 2007, la contradiction est totale puisque l’aide française a diminué de 16 %. Nous savons que ce retard, ce recul sont gravissimes. L’Afrique est le premier continent touché, alors que l’aide publique au développement reste un levier majeur pour le développement de son économie.
Au 1er juillet 2008, la France assurera la présidence de l’Union européenne Dans ce contexte, elle doit impérativement garder le cap de ses engagements et conduire ainsi l’Europe à agir pour de nouveaux rapports Nord-Sud.
Ce sera notamment tout l’enjeu des accords de partenariat ACP-UE, dont nous avons débattu ici même en octobre. Ce texte, auquel nous n’avons pas été nombreux à nous opposer, ne respecte en aucune façon nos partenaires des pays ACP ; eux-mêmes le disent avec force. Il serait infiniment plus réaliste de repousser la signature de cet accord, prévue à la fin du mois de décembre 2008 – date à laquelle la France présidera l’Union –, et d’envisager une période transitoire, afin que les négociations puissent continuer.
Au mois de janvier, la fondation Gabriel Péri tenait un colloque à Dakar sur les enjeux agricoles africains. Un éminent agronome français demandait le droit pour les nations africaines de protéger leur agriculture vivrière dans le cadre de marchés communs régionaux par le biais de droits de douane importants. Pour cela, il est donc impératif non seulement de changer les règles de libre-échange fixées par l’OMC, mais aussi d’engager une réforme en profondeur de la PAC.
Devant la crise alimentaire à laquelle les pays pauvres doivent faire face, il y a urgence. Depuis mars 2007, les prix du soja et du blé ont augmenté respectivement de 87 % et 130 %, et les réserves mondiales de céréales sont à leur plus bas niveau.
Le précédent Président de la République, Jacques Chirac, a eu raison de rappeler récemment que, dans « le monde confronté au spectre des grandes famines..., cette conjonction des périls fait courir au monde un risque sans précédent ».
Quant à l’essor de ce que certains appellent l’« or vert », il apparaît certainement primordial pour des pays dits émergents comme le Brésil, la Chine, l’Inde, le Mexique, mais toute fuite en avant conduirait une nouvelle fois à des déséquilibres majeurs et accentuerait le fossé Nord-Sud.
Dernier coup d’éclat, et pas des moindres, qui atteste un engagement à géométrie variable de la France en matière de droits de l’homme : la visite en Tunisie, au cours de laquelle le fait d’asséner que « l’espace des libertés progresse » n’était pas forcément bienvenu. Plus de 1 000 opposants au régime sont emprisonnés, et le seul journal d’opposition encore autorisé était interdit de distribution !
Cette visite a, bien sûr, suscité de nombreuses et légitimes critiques. Les termes de ce voyage montrent bien ce que pourrait être le projet de l’Union pour la Méditerranée, tel que le souhaite le chef de l’État, réduit à une stricte zone de libre-échange, sans prendre en compte le développement et les échanges culturels.
La situation internationale est extrêmement difficile. Dans les régions du monde où pèsent des menaces de conflit, les tensions s’amplifient. Face à cela, la politique étrangère de la France a besoin de plus de cohérence et de plus de réalisme, considérant le monde tel qu’il est. Une telle politique ne peut être à la remorque d’une vision occidentale et unilatérale atlantiste d’une autre époque.
Notamment avec les pays émergents et l’Afrique, l’heure est de moins en moins à des stratégies de rapport de force ou de choc des civilisations. Il convient de contribuer plutôt, sans nostalgie ni prétention chimérique, mais au contraire avec modestie, ce qui n’exclut pas la détermination et le souci de l’efficacité, à la construction d’un monde multipolaire, à l’établissement de relations multilatérales. §

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la France est à l’origine de deux initiatives diplomatiques fortes et très positives ; d’autres suscitent des interrogations.
D’une part, la mise en place de l’Union pour la Méditerranée, présentée au départ comme un projet des Européens du Sud, appartient désormais, et c’est heureux, à l’ensemble de la Communauté européenne. Il s’agit d’un projet essentiel de coopération, d’un projet de canalisation concertée des flux migratoires, d’un projet de développement économique et donc de paix.
D’autre part, le traité simplifié a permis à la France, en partenariat avec l’Allemagne, de relancer la construction européenne, qui était en panne. Ce traité permettra aussi d’affirmer le poids de l’Union dans le concert de la mondialisation.

C’est pourquoi la présidence française devrait être à l’origine d’un renforcement des relations avec les organisations régionales. En effet, les solutions se trouvent souvent davantage dans la périphérie immédiate des pays concernés par les problèmes plutôt qu’aux Nations unies ou entre les mains des grandes puissances.
De nouveaux pôles émergent, en Asie, en Asie centrale, au Moyen-Orient, constitués autour d’organisations qui, pour certaines, veulent s’inspirer du modèle européen. Ce sont des partenaires d’avenir ; or nous les ignorons trop.
Nos relations sont trop faibles avec l’Organisation de coopération économique, l’OCE, qui rassemble les États musulmans non arabes.
Elles sont quasi-nulles avec l’Organisation de coopération de Shanghai, l’OCS, organisation stratégique au considérable potentiel énergétique, au sein de laquelle nous pourrions demander une place d’observateur comme l’ont fait les États-Unis, place qui leur a été refusée.
Nos relations sont inexistantes avec la Communauté économique eurasiatique ; l’établissement de telles relations nous aiderait pourtant à faire évoluer positivement la situation en Afghanistan, en impliquant des pays périphériques dont la présence est plus légitime.

Nos relations sont insuffisantes avec le G20, qui regroupe en particulier les cinq grands pays émergents : Chine, Inde, Brésil, Mexique et Afrique du Sud.
J’ajoute qu’il faut définir une méthode commune pour canaliser les fonds souverains ou nous protéger de ceux-ci. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les mesures que vous comptez prendre pour mettre en place une politique de l’Union ?
La présidence française doit aussi nous amener à optimiser les dépenses de notre ministère des affaires étrangères par la mise en place de conventions et par mutualisation.
Depuis plusieurs années, la tendance est à la contraction de l’activité des consulats des membres de l’Union. Je m’en réjouis, même si c’est insuffisant. Sans doute motivée par des considérations financières, cette tendance devrait aussi exprimer une volonté politique.
L’administration locale des pays de l’Union doit en effet être à même d’apporter l’entier soutien qui est dû à tous les citoyens des vingt-sept pays. Il faudrait que, d’ici à la fin de la législature, ces consulats aient perdu leur raison d’être. J’ajoute que trois ambassades à Bruxelles ne sont pas indispensables !
La France pourrait prendre une initiative exemplaire dans le domaine de la transcription des directives, où elle n’occupe que le seizième rang, ce qui n’est pas acceptable pour un pays qui s’apprête à présider l’Union.
Avec le président Haenel, j’avais proposé en 2001 de réserver une séance mensuelle du Parlement à la transposition des directives. Le Sénat a adopté cette proposition, mais l’Assemblée nationale n’en a même pas discuté. À l’occasion de la réforme des institutions visant à renforcer les pouvoirs du Parlement, cette proposition mérite d’être à nouveau considérée.
Dans le même esprit, je note que, pour 192 États membres de l’ONU, nous entretenons 163 ambassades. Il ne sert à rien de nous targuer d’avoir le deuxième réseau d’ambassades si celles-ci ne sont pas utilisées au maximum !
Il est difficile de qualifier de « petits » certains États dont le rôle politique est mineur et dont les échanges commerciaux sont très faibles non seulement avec la France, mais aussi avec les autres pays de l’Union. Il serait néanmoins de bon sens dans ces pays de mutualiser les ambassades avec ceux des vingt-sept États membres qui le souhaitent.
Pour conserver une ambassade, je propose la barre arbitraire de 50 millions d’euros d’exportations, sauf si le pays présente un intérêt stratégique pour nous. Sur cette base, ce sont environ soixante-dix pays situés au-dessous de ce seuil dans lesquels vingt à vingt-cinq ambassades pourraient, dans une première étape, être mutualisées pour les visas et les structures immobilières.
Ce mouvement, accompagné de certains renforcements, constituerait un redéploiement bienvenu, car, je le rappelle, en Chine ou en Inde, des villes de plusieurs millions d’habitants –avoisinant parfois dix millions ! – sont dépourvues de consulat ou de mission économique.
Monsieur le ministre, le Président de la République a souligné que le rapprochement avec les États-Unis ne signifierait pas l’alignement, synonyme de perte de liberté et d’influence. Ce rapprochement souhaitable pour mettre fin à un fondamentalisme anti-américain stérile et parfois même contre-productif ne doit pas nous faire perdre nos atouts.
Je rappelle toutefois l’affirmation du département d’État considérant les alliances comme étant à géométrie variable. Nos amis britanniques, pourtant alliés privilégiés des États-Unis, en avaient été ulcérés ! De plus, le statut d’hyperpuissance donne aux États-Unis l’illusion qu’ils ont mécaniquement raison, ce qui peut conduire aux pires désillusions. En d’autres siècles, les grandes puissances européennes ont subi cet hubris désastreux.
Quelques mots sur le Moyen-Orient, zone à très haut potentiel conflictuel que nous connaissons bien, où notre pays conserve une influence certaine et où nous représentons un espoir, parce que nous ne sommes pas inféodés.
Ne devons-nous pas nous écarter de la politique américaine vis-à-vis d’Israël, laquelle conduit parfois à l’aveuglement et ruine les espoirs de paix ? La sécurité d’Israël doit, bien sûr, être garantie par la communauté internationale, mais pas son impunité. Nous ne pouvons cautionner les éliminations ciblées et leur cortège de victimes civiles, ni nous taire face à la poursuite du développement des colonies prétendument sauvages, mais toujours tolérées par l’État israélien.

En 2006, lors de l’invasion absurde et catastrophique du Sud-Liban par l’armée israélienne, la France avait d’abord exigé un cessez-le-feu immédiat. Notre alignement, ensuite, sur les États-Unis fut une erreur. Dans cette région du monde tellement complexe, où la violence constitue souvent la réponse à un désaccord ou à un incident, l’expérience nous a appris qu’il fallait rechercher le consensus, quitte à faire des sacrifices.
On peut regretter qu’ait été interrompu sine die le dialogue avec la Syrie ; on peut également regretter que le dialogue soit si mesuré avec l’Iran. Car si on ne parle pas, que fait-on ?
Nous avons sans doute commis une faute – les affrontements armés interlibanais viennent le confirmer –, en n’exploitant pas au mieux l’arbitrage du Premier ministre et ministre des affaires étrangères du Qatar, Cheikh Hamad Bin Jassem Bin Jabor Al-Thani, pour sortir le Liban de la crise institutionnelle et en préférant une politique très proche de celle des États-Unis, alors que nous connaissons beaucoup mieux qu’eux cette partie du monde.
Je vous ferai part, mes chers collègues, d’une interrogation. L’implantation d’une base à Abou Dabi peut satisfaire notre aspiration à conforter nos positions dans la région. Cette décision a pu aussi être appréciée par le Qatar, siège de la plus grande base américaine au Moyen-Orient, Al-Oudeid, mais que ferons-nous si les États-Unis décident, unilatéralement, d’un conflit avec l’Iran ? Que répondrons-nous s’ils souhaitent utiliser notre base comme relais ? Je rappelle que 9 000 sociétés iraniennes ont leur siège à Dubaï, à quelques kilomètres d’Abou Dabi, et que l’Iran peut bloquer à tout moment le détroit d’Ormuz.
L’OTAN a-t-elle encore un objet ? L’adversaire, ou plutôt l’ennemi désigné, le Pacte de Varsovie, n’existe plus. N’est-ce pas le moment, alors qu’il est de plus en plus question de rallier le commandement intégré, de redéfinir les objectifs de l’OTAN ? Il n’est pas possible de faire croire à la Russie que le fait d’y intégrer l’Ukraine ou la Géorgie et d’installer en Tchéquie ou en Pologne des batteries antimissiles visant à se prémunir contre une attaque iranienne potentielle, ou plutôt improbable, sont des gestes amicaux !
Le vrai danger n’est-il pas le terrorisme international ? L’intégration de la Russie n’est-elle pas une réponse, peut-être provocatrice aux yeux de certains, mais en fait équilibrée et apaisante, déjà présentée par le président Poutine, et envisagée un moment par les États-Unis ?
Par ailleurs, l’OTAN, telle qu’elle existe, ne serait-elle pas un obstacle à la construction d’une défense européenne, dans la mesure où certains membres de l’Union européenne considèrent que l’organisation en tient lieu ?
Notre histoire nous a appris que, pour peser, notre diplomatie devait évoluer, comme les forces qui modifient les équilibres du monde. Or il ne semble pas que la diplomatie française ait accompli sa révolution culturelle.
Monsieur le ministre, vous devez mettre en œuvre une politique à la fois fidèle à nos principes et plus imaginative. Notre politique étrangère est, par tradition, soutenue par tous les groupes politiques de notre assemblée. Vous perpétuerez cette tradition en impulsant une indispensable réforme.
Applaudissements sur les travées du RDSE, de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat porte sur la politique étrangère de la France, mais notre pays devant assurer la présidence de l’Union européenne dans moins de cinquante jours, vous me permettrez d’évoquer la politique étrangère de l’Europe.
La présidence française, la douzième depuis les débuts de la construction européenne, et peut-être la dernière sous cette forme, intervient à un moment charnière.
En effet, le traité de Lisbonne devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2009, si tous les États membres ont achevé à cette date leur procédure de ratification – et j’espère que l’Irlande suivra.
La première priorité de la présidence française sera donc d’achever le processus de ratification et de préparer la mise en œuvre des principales innovations de ce traité.
À cet égard, vous pourrez peut-être nous dire, monsieur le ministre, quelle est la position française concernant la physionomie du futur service européen d’action extérieure, car j’ai cru comprendre qu’il existait de fortes divergences entre les États membres sur le positionnement de ce service, le périmètre de son action ou encore le nombre de ses agents.
Parmi les priorités de la présidence française, le renforcement de la politique étrangère et de défense commune occupe une place particulière. C’est en effet l’un des domaines qui suscite, vis-à-vis de l’Europe, le plus d’attentes chez les citoyens.
Or, si des progrès ont été réalisés ces dernières années, les États européens ne parviennent toujours pas à parler d’une seule voix face aux États-Unis ou aux nouvelles puissances émergentes, comme la Russie ou la Chine.
Qu’il s’agisse du Kosovo, de l’attitude à adopter à l’égard de la Chine ou encore de l’installation d’éléments du système de défense antimissiles américain en Pologne et en République tchèque, les vingt-sept États membres de l’Union européenne paraissent impuissants à définir une approche commune.
L’Union européenne ne parviendra à faire entendre sa voix sur la scène internationale que s’il existe une réelle unité entre les Européens.
Une nouvelle fois, l’Union européenne se retrouve en première ligne dans la région des Balkans. La stabilité de cette région, que vous connaissez bien, monsieur le ministre, constitue un véritable test pour la crédibilité de son action.
Elle doit donc concentrer ses efforts pour maintenir la paix entre les communautés et offrir une perspective européenne, qui paraît seule en mesure de freiner le retour des nationalismes.
Au Proche-Orient, alors qu’elle est membre à part entière du Quartet et qu’elle est de loin le premier contributeur en matière d’aide aux territoires palestiniens, l’Union européenne se retrouve à l’écart du processus politique des négociations entre Israël et les Palestiniens. On fait appel à l’Europe pour augmenter l’aide aux Palestiniens, mais lorsqu’il s’agit des questions politiques, elle est étrangement absente, les États-Unis jouant un rôle quasi exclusif.
Alors que notre pays est fortement impliqué dans la région, notamment au Liban, comment, monsieur le ministre, l’Union européenne compte-t-elle agir et exister politiquement pour contribuer à résoudre ce conflit qui peut avoir des conséquences majeures pour la sécurité internationale ?
Si l’Union européenne veut jouer un rôle accru sur la scène internationale, il est également indispensable qu’elle renforce ses liens avec la Russie.
En sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie est, en effet, pour l’Union européenne, un partenaire privilégié en matière de politique étrangère.
Ainsi la Russie joue-t-elle, vous le savez bien, monsieur le ministre, un rôle stabilisateur important dans la crise iranienne. Elle apporte son soutien à l’opération de l’OTAN en Afghanistan et elle vient de faire un geste fort en mettant à la disposition de l’Union européenne quatre de ses hélicoptères pour mener une opération au Tchad et en République centrafricaine, où les troupes de l’OTAN sont absentes.

La Russie demeure aussi un acteur important pour la stabilité des Balkans et de notre voisinage commun. Plus généralement, elle représente pour l’Union européenne son plus grand voisin, son premier fournisseur d’hydrocarbures et son troisième partenaire commercial.
Or, force est de reconnaître que, malgré le développement des relations économiques, l’Union européenne n’a pas su mettre en place un véritable partenariat stratégique avec la Russie.
Ainsi, depuis près de deux ans, les pays membres de l’Union ne parviennent pas à s’accorder pour lancer des négociations sur un nouvel accord avec la Russie, appelé à remplacer l’actuel accord de partenariat et de coopération.

La Pologne avait d’abord mis son veto en raison de l’embargo russe sur la viande en provenance de son territoire, puis ce fut au tour de la Lituanie, en raison de la fermeture par la Russie de l’oléoduc qui dessert sa raffinerie.
Certes, il est normal que tous les États membres fassent preuve de solidarité lorsqu’un pays est confronté à une difficulté particulière. Toutefois, le principe de solidarité ne doit pas être à sens unique et l’Europe dans son ensemble a besoin d’un partenariat avec la Russie, notamment sur le plan énergétique.
Dès lors, l’attitude de certains nouveaux États membres, consistant à prendre en otage l’ensemble des autres pays de l’Union pour régler leur contentieux bilatéral, voire leurs comptes historiques avec la Russie – même si l’on peut les comprendre ! – n’est pas acceptable.
Depuis la fin de la guerre froide, la Russie a considérablement évolué. Aujourd’hui, on ne peut plus continuer à la regarder avec des lunettes datant d’avant la chute du mur de Berlin.
À cet égard, je me félicite de l’annonce faite hier de la levée du veto des autorités lituaniennes, grâce aux efforts de la présidence slovène.
M. le ministre acquiesce.

L’adoption du mandat par les Vingt-Sept pourrait permettre de lancer enfin les négociations sur le nouvel accord, qui débuteraient véritablement sous la présidence française. Monsieur le ministre, quels axes la présidence française privilégiera-t-elle concernant le contenu du futur accord ? Je pense notamment au développement des relations économiques, à l’énergie ou encore à la coopération technologique.
Pourquoi ne pas envisager aussi de supprimer à terme l’obligation de visa ? Je vous rappelle, mes chers collègues, que la Russie est, avec plus de 400 000 visas délivrés annuellement à ses ressortissants, le pays auquel la France accorde le plus grand nombre de visas, devançant les pays du Maghreb. Pourquoi ne pas créer un véritable espace de libre circulation des personnes entre l’Union européenne et la Russie ? Le ministère des affaires étrangères semble d’ailleurs y être favorable. Cela permettrait de favoriser les échanges entre les citoyens et la mobilité des étudiants et des chercheurs, ainsi que de multiplier les contacts au niveau de la société civile.
C’est aussi le meilleur moyen de faire progresser la démocratie et les droits de l’homme en Russie, ce qui constitue un élément important.
La présidence française doit donc nous permettre de donner un nouveau souffle à la politique étrangère et à la politique européenne de sécurité et de défense.
Faisons le pari que l’Union européenne peut offrir une perspective européenne aux pays des Balkans, qu’elle peut contribuer à la stabilité en Afrique, qu’elle a un rôle à jouer dans le règlement du conflit au Proche-Orient, qu’elle peut entretenir des relations étroites avec les États-Unis, mais sur un pied d’égalité, et qu’elle peut nouer un véritable partenariat stratégique avec la Russie.
Ce n’est que de cette manière que nous parviendrons réellement à faire de l’Union européenne une « Europe puissance », capable de faire entendre sa voix dans la mondialisation.
Le renforcement de la défense européenne participe également à la mise en place d’une politique étrangère commune à l’échelle européenne. Dans cette optique, il est nécessaire de clarifier la position française à l’égard de l’OTAN, comme le souhaite le Président de la République ; sinon, on ne pourra pas progresser vers une politique européenne de sécurité et de défense réellement autonome.
Cela suppose non seulement de définir clairement les objectifs et le périmètre géographique de l’OTAN, ainsi que les rapports entre cette organisation et l’Union européenne, qui constituent les deux piliers de la sécurité européenne, mais aussi de reconnaître à la Russie une place dans l’architecture de la sécurité européenne et de ne plus la considérer comme un adversaire potentiel.
La réflexion qui préside à l’élaboration du Livre blanc de la défense et de la sécurité nationale doit tenir compte de ces considérations.
Nous comptons donc sur vous, monsieur le ministre, pour faire avancer ces sujets, qui répondent à de fortes attentes des citoyens.
À cet égard, la réussite de la présidence française dépendra beaucoup – et le Président Sarkozy l’a bien compris – de la solidité de l’axe franco-allemand. N’oublions pas que, si l’Europe a pu sortir de la crise dans laquelle elle était plongée depuis deux ans, à la suite des référendums négatifs français et néerlandais sur le traité établissant une Constitution pour l’Europe, c’est grâce à la relance du couple franco-allemand. Certes, le couple franco-allemand n’est plus suffisant pour entraîner une Europe à vingt-sept, mais il en reste le seul moteur, et ne serait-ce que l’apparence d’une divergence entre la France et l’Allemagne est, à coup sûr, le plus efficace des freins à la construction européenne.
Pour terminer, je citerai Fernand Braudel : « La seule solution d’une certaine grandeur française, c’est de faire l’Europe. »
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je veux, m’associant aux propos de notre collègue Robert Hue, remercier à mon tour le président de la commission, Josselin de Rohan, d’avoir pris l’initiative de ce débat et, surtout, de l’avoir obtenu.
Nous nous réjouissons, en effet, de pouvoir débattre aujourd’hui de la politique étrangère de la France. À douze mois du début du quinquennat du Président Sarkozy, il est trop tôt pour émettre des jugements définitifs sur une action, certes controversée, mais somme toute encore naissante...
Toutefois, il est temps de dresser déjà un premier bilan d’étape, de saisir les lignes directrices de la politique extérieure du nouveau Président de la République et de donner notre avis sur les orientations qui commencent à s’inscrire dans la dure matière de la réalité.
Le temps passe, notamment celui des promesses électorales non tenues, qui s’envolent d’autant plus rapidement que les faits sont têtus et résistent aux incantations verbales.
Pour poser les premières briques de ce bilan d’étape, je concentrerai mon intervention sur trois sujets qui me paraissent représentatifs de la politique extérieure du Président.
Le premier point concerne l’exercice solitaire du pouvoir. Vous aurez remarqué que je parle volontiers de la « politique extérieure du Président » sans évoquer le ministre des affaires étrangères.

Il s’agit là non point d’un fâcheux oubli, mais d’un simple constat : c’est l’Élysée qui commande, c’est l’Élysée qui propose et, souvent – infirmières bulgares, OTAN, Afghanistan –, c’est l’Élysée qui conçoit et, même, exécute la politique en choisissant lui-même les acteurs. Le domaine réservé se porte bien – trop bien à mon goût !
La personnalisation présidentielle de la politique extérieure atteint des sommets avec le nouveau locataire de l’Élysée. Et l’on voit ainsi s’envoler une promesse du candidat Sarkozy concernant la fin du « domaine réservé ».
Il est même envisagé, à l’occasion d’une prochaine réforme constitutionnelle – mais les résistances parlementaires seront fortes – d’accroître des pouvoirs du Président de la République en matière de défense et de politique étrangère.
Deuxième point : quelle est la « colonne vertébrale » de notre politique extérieure ? Quelle est la vision stratégique qui soutient l’action extérieure ? Il est difficile d’en saisir la consistance. Une politique étrangère doit non pas s’élaborer au gré de risques supposés, mais prendre en compte une vision d’ensemble du système international. On a du mal à en discerner les contours.
M. Sarkozy déclarait à la revue Politique internationale, dans l’édition du printemps 2007 : « ...je crois le temps venu de doter la diplomatie française d’une “doctrine”. Une doctrine, c’est une vision claire du monde, des objectifs de long terme et des intérêts que nous défendons. C’est un ensemble de valeurs qui guident notre action. C’est ce qui donne, dans la durée, un sens et une cohérence. C’est la condition de notre indépendance. »
On ne peut pas dire que, de Kadhafi à Ben Ali, les « valeurs » aient guidé l’action de l’Élysée.
Alors qu’il a déclaré, au printemps 2007 : « Ce n’est pas parce que la Chine et la Russie sont de très grandes puissances que l’on doit s’interdire de dénoncer les violations des droits de l’homme qui y sont commises. De ce point de vue, je dois dire que l’évolution de la Russie, ces derniers temps, me paraît préoccupante », on ne peut pas dire que le Président Sarkozy ait été très actif en la matière depuis son élection. Le responsable de la politique extérieure de la France est-il toujours inquiet de « l’évolution de la Russie » ?
De même, la « doctrine » ne sort pas renforcée d’une série de voyages d’affaires ayant amené le Président à signer des dizaines de protocoles commerciaux et de contrats millionnaires, dont on attend encore le bilan, chiffré en taux de réalisation.
Si l’on considère que le grand objectif de notre politique étrangère est de promouvoir nos intérêts économiques et commerciaux pour rendre la France plus forte dans la mondialisation, il faut le dire haut et fort, et non pas se cacher derrière des déclarations inefficaces et peu crédibles sur les valeurs et les droits de l’homme.
En revanche, on a bien enregistré le rapprochement atlantiste, les discours controversés sur les Africains, les hésitations douloureuses sur les jeux Olympiques en Chine, l’envoi de troupes en Afghanistan pour soutenir une guerre embourbée... Reconnaissez que tout cela ne dégage pas « une vision claire du monde, des objectifs de long terme et des intérêts que nous défendons ».
De surcroît, après des déclarations prônant la rupture avec une certaine politique en Afrique, des gages sont donnés aujourd’hui à des potentats africains, en tournant encore le dos à leurs peuples, toujours sacrifiés sur l’autel de la
Le troisième point concerne la Macédoine.
Nombre d’entre vous pourront s’étonner de m’entendre évoquer ce petit pays des Balkans.
Je le fais, d’abord, parce que j’en reviens. En fait, j’y ai déjà effectué trois séjours : le premier en tant que représentant de l’assemblée parlementaire de l’OSCE ; le deuxième, en 2005, comme membre de la délégation du Sénat pour l’Union européenne, séjour à la suite duquel j’ai été amené à rédiger un rapport sur la situation de ce pays de deux millions d’habitants ; et le troisième, voilà une semaine, en ma qualité de membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Cette mission donnera d’ailleurs lieu à un rapport qui est en cours d’élaboration.
Ensuite, si j’évoque ce pays, c’est parce qu’il constitue un excellent révélateur de notre politique étrangère, qui vient fort à propos corroborer, par l’exemple, les propos que je viens de tenir.
Monsieur le ministre, je n’en doute pas, vous connaissez bien la situation de ce pays puisque vous avez été pendant de longs mois le représentant reconnu et apprécié de l’Organisation des Nations-unies dans le Kosovo voisin. Vous n’ignorez rien de la fragilité démocratique de la Macédoine, malgré la signature des accords d’Ohrid et la mise en œuvre de la Constitution dite « Badinter », du nom de notre éminent collègue.
Avec une composition ethnique à l’image de ce que l’on rencontre souvent dans les Balkans, soit 60 % de Macédoniens, 30 % d’Albanophones et 10 % de minorités diverses, la Macédoine est coincée entre l’Albanie, la Grèce, le Kosovo – tout nouvellement indépendant et à majorité albanophone – et la Bulgarie, sans aucun accès à la mer. Deux de ses voisins sont déjà membres de l’OTAN et de l’Union européenne. Les autres aspirent à y entrer. C’est, bien sûr, aussi le cas de la Macédoine. Elle a d’ailleurs déjà avancé dans ces deux directions.
En effet, après avoir signé, en 2005, un accord de stabilisation et d’association, ASA, avec l’Union européenne, elle attend impatiemment qu’une date soit fixée pour engager les négociations en vue de son adhésion.
En ce qui concerne l’OTAN, ayant bénéficié du Plan d’action pour l’adhésion, ou MAP – –, la Macédoine espérait rejoindre l’Organisation, en même temps que l’Albanie et la Géorgie, lors du sommet de Bucarest, en avril dernier.
Et voilà que, patatras, lors de ce sommet, obnubilée par une douteuse affaire de dénomination portant sur la propriété du terme « Macédoine », la Grèce a opposé son veto à l’entrée de ce pays dans l’OTAN, faisant d’ailleurs peser sur lui la même menace pour la prochaine discussion sur son entrée dans l’Union européenne.
Lors du tour de table à Bucarest, personne ne s’est exprimé pour venir en aide à la petite Macédoine. Pis, la France, par la voix du Président de la République, a apporté son soutien à la Grèce dans sa démarche d’entrave à la Macédoine.
Était-il nécessaire d’en rajouter sur un tel sujet et de ternir ainsi des relations anciennes de franche amitié entre nos deux pays ? Faut-il rappeler que des dizaines de milliers de soldats français du conflit de 1914-1918 sont morts et enterrés sur cette terre de Macédoine ?
De surcroît, monsieur le ministre, les raisons évoquées ne peuvent manquer de nous laisser perplexes. Permettez-moi de vous citer l’interview donnée par le Président de la République à la presse grecque le 14 mars 2008, à Bruxelles : « J’ai indiqué que nous soutenions la position grecque. Les Grecs sont des amis. Et puis, vous savez, depuis qu’on a écrit un livre en Grèce sur “Sarkozy de Thessalonique”, je me sens obligé d’être solidaire. »
Dès lors, je m’interroge : les Macédoniens ne seraient-ils pas aussi nos amis ? Et, comme certains me l’ont malicieusement dit à Skopje, devraient-ils, eux aussi, écrire quelques livres ?
Mais la raison d’une telle attitude est plus simple : il faut « sauver le soldat Caramanlis »
Sourires

Monsieur le ministre, le jeu en valait-il la chandelle ?
Depuis le sommet de Bucarest, qui a précipité sa décision, le Parlement de Macédoine s’est autodissous. Les prochaines élections auront lieu le 1er juin. La rivalité non éteinte entre les communautés albanophones et macédoniennes est ravivée dans ce scrutin. Les albanophones se demandent déjà si, en fin de compte, il n’aurait pas mieux valu pour eux de rester plus proches de leurs voisins et frères kosovars ou albanais ou de s’en rapprocher dans l’avenir.
En outre, pendant que la Macédoine se consacrera au processus électoral, elle perdra un temps précieux, pourtant nécessaire pour pouvoir rendre, fin septembre, un dossier complet et argumenté à Bruxelles en vue de sa future adhésion à l’Union européenne.
Monsieur le ministre, je me demande si, au Quai d’Orsay, quelqu’un est en mesure de cautionner ce choix de la France. Que s’est-il passé entre la rive gauche et la rive droite ? Aurait-on englouti les espoirs de la Macédoine dans la Seine, au risque d’introduire dans ce pays si fragile des Balkans un nouveau risque de déstabilisation, dont la région n’a nul besoin ?
Nos amis américains ne s’y sont pas trompés, eux, car ils connaissent et mesurent les enjeux. Au moment où ils sont en train d’installer l’une de leurs ambassades les plus gigantesques à Skopje, à quelques kilomètres seulement de la base aérienne déjà en place au Kosovo, ils viennent de signer un accord de partenariat bilatéral avec la Macédoine dans le domaine militaire. C’est sans doute un geste de consolation à l’égard de nos amis macédoniens, en attendant des jours meilleurs pour ce petit pays, qui espère par ailleurs tant de la France, alors même qu’aucun ministre français ne s’y est rendu depuis plus de cinq ans, quand tous les autres pays qui comptent en Europe ne cessent d’y faire défiler leurs représentants !
Monsieur le ministre, je terminerai par une recommandation et une proposition.
La défense européenne piétine. À la veille de la présidence française, j’aimerais connaître les initiatives que la France proposera à l’Europe dans ce domaine, en particulier en matière d’industrie et de recherche de défense.
Je crains que la France, avec sa politique atlantiste, ne soit pas à l’heure actuelle en position de force pour séduire ses partenaires en matière de défense européenne. Avez-vous des propositions à nous présenter, monsieur le ministre, qui offrent d’autres perspectives que la simple résignation « OTANienne » ?
Nous savons que de nouvelles coopérations sont nécessaires, notamment dans le domaine de la sécurité ; nous savons tous que nos intérêts de sécurité ne sont pas dissociables de ceux de l’Europe.
Face aux différentes menaces, telles que le terrorisme et la prolifération nucléaire, mais aussi face aux risques climatiques et industriels, la coopération européenne civile et militaire est la rançon du succès.
J’ai le sentiment que la prochaine présidence française s’annonce avare de propositions nouvelles, mais j’espère me tromper.
En tout état de cause, je vous soumets l’idée suivante : la mise en place, sous la présidence française, d’une grande réunion de concertation sur la recherche duale, civile et militaire, regroupant tous les pays qui souhaitent y prendre part, sans exclusions, mais sans fausse attente d’un unanimisme paralysant. Elle intégrerait les industriels et les syndicats, les chercheurs et les laboratoires – tous y participeraient volontiers, j’en suis sûr – et permettrait de choisir deux ou trois grands programmes structurants, duaux – civils et militaires –, d’intérêt général, touchant aux technologies du futur dans le domaine spatial.
Il faut, en effet, discuter des priorités, choisir les programmes, prévoir un budget adéquat et équitablement partagé, et le plus tôt serait le mieux, monsieur le ministre !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de trois membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.
Je n’ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Jean Bizet, Dominique Braye, Jackie Pierre, Marcel Deneux, Jean-Marc Pastor, Daniel Raoul.
Suppléants : MM. René Beaumont, François Fortassin, Jacques Muller.
M. Roland du Luart remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.

Nous reprenons le débat sur la politique étrangère de la France.
Dans la suite de ce débat, la parole est à M. Robert del Picchia.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, les raisons qui ont conduit la commission des affaires étrangères à prendre l’initiative de ce débat sur la politique étrangère de la France ne manquent pas, non plus que les sujets qui pourront être abordés à cette occasion. Occupant une position particulière en tant que sénateur représentant les Français établis hors de France, je me prête volontiers à cet exercice. À cet égard, monsieur le ministre, j’aurai à vous entretenir, dans la deuxième partie de mon intervention, de quelques points qui concernent nos compatriotes résidant à l’étranger.
Auparavant, j’aborderai le thème de la mondialisation et évoquerai les défis que nous devons relever, à savoir les rapports entre l’Islam et l’Occident, les crises au Moyen-Orient, l’Afghanistan, le Liban, l’Europe, la défense européenne et l’Union de la Méditerranée.
Monsieur le ministre, je veux tout d’abord vous dire que je souscris pleinement aux propos qu’a tenus le président de la commission des affaires étrangères. Josselin de Rohan a parfaitement exprimé notre vision quant à l’avenir de la politique étrangère de la France et je partage ses inquiétudes sur le financement et les moyens de votre politique.
Pour le succès de la France dans la mondialisation, il est nécessaire de moderniser notre politique. Tel est d’ailleurs le sens de la réflexion engagée dans le Livre blanc. Encore faut-il que votre ministère dispose des moyens nécessaires à la conduite de sa mission et voie reconnu son rôle interministériel au cœur de notre stratégie mondiale.
La France doit se faire une place dans cette mondialisation, place qu’il lui appartient de défendre. À cet égard, les défis à relever sont nombreux.
Encore plus nombreux sont les conflits ou risques de conflits, qui ne manquent pas de susciter une forte inquiétude. Monsieur le ministre, crise après crise, en quelque point du globe, vous vous acquittez de votre mission au jour le jour. Chacun reconnaît votre engagement, duquel on ne peut que vous féliciter.
Les défis à relever sont ardus, et le président Sarkozy en a défini trois. Le premier d’entre eux, sans doute l’un des plus importants, est le suivant : comment prévenir une confrontation entre l’Islam et l’Occident ? Deuxième défi : comment intégrer dans le nouvel ordre global les géants émergents que sont la Chine, l’Inde et le Brésil ? Troisième défi : comment faire face aux risques majeurs que sont les difficultés de l’approvisionnement énergétique et le réchauffement climatique.
Je suppose que la présence de nos troupes en Afghanistan se justifie par notre volonté de faire face au premier de ces défis : éviter un conflit entre l’Islam et l’Occident. Si notre engagement est un devoir vis-à-vis de la communauté internationale, il n’en demeure pas moins, monsieur le ministre, comme nous avons pu le constater très récemment sur place, que la situation y est fort compliquée. Dans certaines régions, la sécurité est loin d’être assurée, comme l’attestent l’attentat commis récemment à Kaboul contre le président Karzaï et les combats qui se sont ensuivis.
Je tiens à rendre ici un hommage particulier aux militaires français détachés en Afghanistan. Faisant un excellent travail dans des conditions très difficiles et dangereuses, ils méritent tout notre respect et nos félicitations. Les officiers chargés de la formation de l’armée afghane sont très appréciés, de même que les militaires en mission de sécurité, qui savent, mieux que leurs homologues d’autres nationalités, se faire « accepter » par la population, tâche peu aisée.
Monsieur le ministre, nous sommes cependant plus enclins au pessimisme tant le scénario paraît devoir durer dans la mesure où l’armée afghane, dont la première mission consiste à livrer combat contre les talibans et à le gagner, n’est pas suffisamment opérationnelle.
Tant que la sécurité n’y sera pas assurée, l’Afghanistan ne bénéficiera pas d’investissements, pourtant déterminants pour son développement. Ce pays ne connaîtra pas non plus de succès durable si son peuple ne recueille pas les fruits tangibles d’un retour à la sécurité et à la paix. Enfin, faute de voir ces conditions réunies, la lutte contre la drogue restera infructueuse.
Monsieur le ministre, quelle politique la France entend-elle mener en Afghanistan ? Et quid du Pakistan, base arrière présumée des talibans ?
Prévenir une confrontation entre l’Islam et l’Occident consiste aussi à traiter les crises du Moyen-Orient. Celles-ci sont aujourd’hui multiples : l’Irak, le Liban, Gaza, Israël et la Palestine. Certes, elles sont différentes, mais elles sont aussi chaque jour de plus en plus interdépendantes.
Tout a été dit à propos du conflit israélo-palestinien, qui a fait l’objet de nombreuses tentatives de règlement. La paix dans la région, nous disait-on, se négociera d’abord entre Israéliens et Palestiniens avant la fin de l’année. Or le Premier ministre israélien parlait hier d’avancées, tout en relativisant les chances d’aboutir avant la fin de l’année à la formation d’un État palestinien. À défaut, nous en reviendrions à la situation qui prévalait avant le processus d’Annapolis.
Monsieur le ministre – et c’est ma deuxième question –, ne faut-il pas y voir l’annonce d’un nouvel échec avant la fin de l’année ?
Le Liban traverse lui aussi une crise brûlante. Le Hezbollah semble désormais imposer sa loi dans une large partie de Beyrouth. Cette victoire chiite sur le terrain humilie les sunnites et menace de nouveau le gouvernement de Fouad Siniora.
Monsieur le ministre, vous connaissez bien les hommes politiques de ce pays. Qu’est-il envisageable de faire ? Comment ne pas baisser les bras face à cette situation ? La stratégie du Hezbollah ne consiste-t-elle pas à se faire reconnaître un rôle qu’il considère être le sien, en violation des accords de Taëf ?
La diplomatie semble plutôt inefficace à ce jour, car elle ne peut plus agir pour la recherche de nouveaux équilibres incluant l’Iran et la Syrie.
J’en arrive au deuxième défi : comment intégrer dans le nouvel ordre global les géants émergents que sont la Chine, l’Inde et le Brésil ?
Le rôle de la France consiste, semble-t-il, à s’adapter à chacune de ces grandes puissances en formation. Pour autant, l’Afrique doit, elle aussi, réussir dans la mondialisation. La France veut en accélérer le développement, car l’Afrique reste encore à l’écart de la prospérité mondiale.
Pour construire cet ordre mondial plus juste, plus efficace que réclament nos peuples, pour une intégration en douceur dans la mondialisation de ces géants et de l’Afrique, la meilleure solution, y compris pour la France, ne résiderait-elle pas dans l’émergence d’une Europe plus forte, qui serait un acteur majeur sur la scène internationale et qui ferait de la coopération un aspect central de sa politique ?
Les priorités la présidence française de l’Union européenne pour faire progresser l’Europe sont connues : l’énergie, l’immigration, l’environnement. L’Europe de la défense fait aussi partie de ces priorités. Mes chers collègues, les progrès accomplis ces dernières années sont loin d’être négligeables puisque l’Union a conduit une quinzaine d’opérations sur notre continent, en Afrique, au Proche-Orient et en Asie. Il ne peut y avoir de développement ni de prospérité sans sécurité.
Ces interventions démontrent que la défense européenne peut être une réalité. Tout le monde s’accorde à dire que l’Union européenne et l’OTAN ne sont pas en compétition, mais sont complémentaires. Chaque membre de l’Union doit prendre sa part à la sécurité commune. Pour l’instant, seuls quatre pays, dont la France, financent la sécurité des Vingt-Sept. Cette situation est anormale et il faudra trouver une solution. Celle-ci consiste peut-être à sortir des critères de calcul du déficit budgétaire les dépenses en faveur de la défense. Dans la mesure où ces dépenses servent aussi à assurer la sécurité des autres pays, il ne serait pas anormal qu’elles ne soient pas prises en compte pour l’application de la fameuse règle des 3 %.
Mais, au-delà des instruments, nous avons aussi besoin d’une vision commune. Quelles sont les menaces qui pèsent sur l’Europe et avec quels moyens devons-nous y répondre ? Il faudra élaborer une stratégie européenne de sécurité, laquelle fait actuellement l’objet d’une réflexion. Mais, monsieur le ministre, peut-on faire preuve d’optimisme et envisager que les progrès dans ce domaine seront suffisants pour permettre l’approbation d’un nouveau texte pendant la présidence française de l’Union européenne ?
Enfin, avant d’évoquer la question des Français de l’étranger, permettez-moi d’aborder un thème cher au Président de la République, à savoir l’Union pour la Méditerranée.
Nicolas Sarkozy la voit fondée sur quatre piliers : l’environnement, le dialogue des cultures, la croissance économique et la sécurité. Si, au départ, le processus a connu quelques blocages, depuis lors, il a progressé, en particulier grâce à l’accord passé avec Angela Merkel. Il ne s’agit plus d’ignorer ce qui a déjà été accompli, à savoir le processus de Barcelone et le dialogue « 5 + 5 ». Bien sûr, l’Union européenne, à travers ses institutions, en particulier la Commission et le Parlement européen, doivent être acteurs de plein droit de l’Union pour la Méditerranée. Signalons que celle-ci doit être formalisée lors d’un sommet qui aura lieu à Paris le 13 juillet prochain.
Que proposera-t-on à ces pays du nord et du sud de la Méditerranée et aux autres partenaires de la France dans l’Union européenne ?
Monsieur le ministre, les Français qui résident à l’étranger sont sur le terrain. En tant que ministre des affaires étrangères, vous présidez l’Assemblée des Français de l’étranger. Aussi, je voudrais attirer votre attention sur le fait qu’il est rarement demandé aux élus de l’AFE leur point de vue sur tel ou tel sujet. Pourtant, ils connaissent bien leur pays d’accueil et la politique qui y est menée. C’est pourquoi ils pourraient utilement enrichir et compléter les rapports de nos diplomates grâce à leurs analyses et grâce aux informations dont ils disposent.
Voilà quelques années, l’AFE avait organisé des débats réunissant les délégués de différents pays et de hauts responsables du ministère des affaires étrangères, directeurs ou sous-directeurs de régions géographiques. Ces débats s’étaient avérés très enrichissants pour tous.

Peut-être pourriez-vous, monsieur le ministre, renouveler cette expérience à l’AFE ?
S’agissant du fonctionnement des services de votre ministère chargé des Français de l’étranger, il nous paraîtrait opportun – surtout si l’on pense aux évolutions de la direction générale de la coopération internationale et du développement, la DGCID – de créer une entité budgétaire réunissant l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, l’AEFE, et la direction des Français à l’étranger, la DFAE. Ainsi, de manière a priori plus logique et plus efficace, seraient regroupées au sein d’un même chapitre budgétaire toutes les actions concernant les Français de l’étranger.
Toujours dans le domaine budgétaire, je reviens sur cette idée – que je me permettrai de qualifier de mauvaise – de réaliser des économies sur les frais engagés par les ambassades pour la réception du 14 juillet. Si elle peut paraître anecdotique, cette mesure aura des implications, localement, pour les Français de l’étranger. En effet, ces manifestations organisées par nos ambassades à l’occasion de la fête nationale sont très appréciées, aussi bien par nos compatriotes vivant sur place que par de nombreux habitants du pays considéré.
Si j’ai bien compris, il est demandé aux chefs de poste de réduire le nombre de leurs invités et de les limiter aux personnalités représentatives de la communauté française.
Sourires

Cependant, il me paraît non seulement inopportun, mais encore irréaliste de vouloir faire des économies sur les frais de réception engagés pour la fête nationale. Comme vous le savez, la réception donnée ce jour-là est, pour la plupart de nos ressortissants, l’un des rares moments – et, pour beaucoup, le seul – où ils peuvent avoir un contact direct avec les agents diplomatiques et consulaires. En outre, il s’agit d’un lien républicain et populaire qui symbolise, mieux que tout autre, l’unité de la nation et la convivialité à l’étranger.
Comment expliquer, alors, à nos compatriotes qu’ils seront exclus de leur ambassade au moment de la plus grande fête républicaine de l’année ? Et comment les ambassadeurs vont-ils procéder pour désigner les personnes les plus représentatives ? Ils se mettront à dos, quoiqu’ils n’en puissent mais, une immense majorité de la communauté française, furieuse de cette situation. C’est bien dommage !
Monsieur le ministre, ne pourrait-on pas plutôt envisager de réaliser des économies sur d’autres frais de réception ?

Au moins, que la réception du 14 juillet se tienne et ne soit pas l’occasion de perturber les relations des ambassadeurs avec les élus et avec la communauté française !
Plus généralement, je tiens à dire que, à titre personnel– mais mon point de vue est sans doute partagé par nombre de mes collègues –, je désapprouve les mesures d’économies budgétaires imposées au ministère des affaires étrangères.

Il n’en a que trop subi ! Son budget diminue constamment. Il faut savoir s’arrêter !

M. Robert del Picchia. Monsieur le ministre, nous disons haut et fort que vous devez pouvoir disposer des moyens de votre politique. J’ajoute que nous sommes même prêts à voter en conséquence.
Ah ! sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC. – Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Sans aller plus loin, compte tenu du devoir de réserve auquel je suis astreint à ce fauteuil, je dirai que les derniers propos de M. Del Picchia font, me semble-t-il, l’objet d’une approbation unanime dans cet hémicycle.
La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, « abonnée » aux interventions d’une durée de quatre ou de cinq minutes, je n’aurai pas le temps de revenir sur la question de la formation et de l’affectation de nos diplomates, dont la procédure échappe parfois à la logique la plus élémentaire, s’agissant notamment de la pratique de la langue du pays d’accueil. J’avais traité ce point lors du débat budgétaire consacré à l’examen des crédits de la mission « Action extérieure de l’État », débat malheureusement écourté pour des raisons indépendantes de votre volonté, monsieur le ministre.
Je concentrerai l’essentiel de mon propos sur notre politique à l’égard de l’Iran.
Le pire n’étant jamais certain, Dieu merci, même si d’aucuns s’y étaient préparés, ne faudrait-il pas plutôt se préparer au meilleur s’agissant de cet important pays ?
Monsieur le ministre, pour quelle raison la France a-t-elle adopté des positions de plus en plus dures à l’égard de l’Iran, en particulier depuis l’élection du président Sarkozy ?
La plupart des grandes entreprises françaises présentes en Iran depuis plusieurs années se prononcent contre cette tendance. En outre, personne, à ce jour, n’a évalué les répercussions sur notre commerce extérieur – dont le déficit, faut-il le rappeler, atteint 38 milliards d’euros – de ces politiques de sanctions unilatérales, et ce alors que les possibilités d’engager des coopérations régionales sont de plus en plus nombreuses.
D’ailleurs, l’importance géostratégique de l’Iran n’échappe pas à ses voisins. La preuve en est que le président iranien a été l’invité d’honneur du Conseil de coopération du Golfe, en décembre dernier, à Doha. A contrario, il n’est qu’à considérer l’échec total du voyage qu’a effectué en janvier dernier le président George Bush dans la région, rentré chez lui « les mains vides », pour reprendre les titres de la presse qatarie et des autres pays du Golfe, après avoir tenté de liguer les pays du golfe Persique contre l’Iran.
De même, Son Altesse Cheikh Mohammed Al Maktoum, émir de Dubaï, accompagné d’une très imposante délégation, a effectué un voyage triomphal en Iran voilà quelques semaines. Le journal Khaleedj Times a publié à cette occasion une série d’articles insistant sur le fait que l’Iran était désormais un partenaire essentiel pour la stabilité de Dubaï et des Émirats, en considération des 200 milliards de dollars, selon une estimation, investis par les Iraniens et des nombreux Iraniens possédant un passeport émirati.
Je sais que Son Altesse l’émir de Dubaï se rend à Paris la semaine prochaine. À l’occasion de cette visite, il pourrait être interrogé sur cet important sujet, même si je crois connaître par avance sa position.
Monsieur le ministre, je rentre des États-Unis et j’ai écouté avec beaucoup d’attention l’intervention de John Mac Cain la semaine dernière. Il a promis, s’il était élu, la mise en place d’une politique énergétique indépendante pour les États-Unis afin d’éviter, a-t-il ajouté – c’est là que le propos prend tout son intérêt ! – de nouveaux morts liés à des conflits comme le conflit irakien, dont le seul objectif était de sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Amérique. CQFD ! C’est bien la preuve, s’il en était encore besoin, de ce que le conflit irakien n’était justifié par aucune autre raison.
Pour masquer cet échec, les États-Unis recherchent un bouc émissaire. L’Iran en est un idéal, car, comme Cyrano, il n’abdique par facilement l’honneur d’être une cible, ajoutant parfois la « super-provocation » à la provocation. L’Iran est-il une puissance militaire dont il faut avoir peur ? Ce pays n’a jamais, au cours de son histoire, pris l’initiative d’un conflit armé.
Monsieur le ministre, les chiffres de la CIA, vénérable établissement crédible, sont éloquents quant à la militarisation de la zone. L’Iran consacre 2, 5 % de son PNB à l’armement, les Émirats Arabes Unis, 3, 1 %, l’Arabie Saoudite, 10 %, le Qatar, 10 %, le Koweït, 5, 3 %, Bahreïn, 2, 5 % et Oman, 11, 2 %. Notre commerce extérieur est d’ailleurs fort reconnaissant aux pays du Golfe pour leur politique de surarmement !
Rétablissons le dialogue et les relations économiques, et cessons d’isoler l’Iran alors que les entreprises américaines elles-mêmes y reprennent pied. Faites ce que je dis et pas ce que je fais ! L’Iran compte 78 millions d’habitants et peut se vanter d’avoir le plus haut taux de scolarisation et de réussite des étudiants. C’est aussi un pays qui a une longue histoire et c’est le seul État-nation de la région ; d’où certaines réactions nationalistes.
Notre politique actuelle interdit tout espoir aux réformateurs, lors du prochain scrutin présidentiel. L’isolement renforce les extrêmes et le patriotisme. Il faut ajouter que, parfois, les dirigeants iraniens n’aident pas leurs amis. Toutes les provocations font reculer le dialogue. Les Iraniens sont sous embargo depuis si longtemps qu’ils ont appris à se passer de tout et de tout le monde.
L’Iran a des amis, ni naïfs ni dupes. Ce poker menteur risque de coûter cher. La stabilité de toute la région dépend aussi d’accords économiques et culturels. Je vous l’avoue, monsieur le ministre, j’ai fait un rêve : l’ouverture d’une Alliance française à Ispahan !
Applaudissements sur les travées du RDSE, ainsi que sur certaines travées de l ’ UC-UDF et de l ’ UMP.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat sur la politique étrangère de la France est une première : la commission des affaires étrangères et de la défense, son président, son bureau ont eu raison de le proposer, et je les en remercie.
Ce n’est qu’un pas, mais un pas important sur la voie de la valorisation de nos travaux et, surtout, d’un exercice plus efficace du contrôle par le Parlement de l’action du Gouvernement. Il ne faudrait pas s’arrêter en si bon chemin !
Le Parlement devrait pouvoir donner son avis sur les grands sujets de politique internationale, par exemple sur la participation de nos troupes à des conflits extérieurs. Le contrôle démocratique parlementaire semble plus que jamais nécessaire dans la mesure où notre vibrionnant Président de la République tend à tout accaparer, y compris la politique étrangère dans toutes ses déclinaisons.
Puisque la politique étrangère se fait à l’Élysée, M. le Président de la République devrait convenir que le bilan de sa première année n’est pas fameux. Il devrait notamment reconnaître les erreurs d’une politique brouillonne. Je citerai trois exemples pour l’illustrer.
Fallait-il, à l’automne dernier, qu’il félicite Vladimir Poutine d’avoir remporté des élections législatives ?

Soit !
Fallait-il qu’il complimente le dictateur Ben Ali parce que, selon lui, et contre toute réalité, « l’espace des libertés progresse » en Tunisie ?

Fallait-il adhérer à la politique de « guerre contre le terrorisme » du président Bush au moment même où celle-ci est clairement en faillite, au point que les néoconservateurs français, qui ne m’inspirent pas et qui avaient soutenu les différentes aventures guerrières de Bush, tendent à se démarquer de sa politique au Moyen-Orient ?
Cette fois, je n’entends pas votre réponse.

J’ai bien compris votre silence…
Nous sommes donc à l’heure d’un premier bilan d’étape, certes provisoire. Il est encore temps de rectifier le tir, mais je doute qu’on le fasse, et je vais vous dire pourquoi.
Sous la conduite du Président de la République, la France fait preuve, me semble-t-il, d’immobilisme et surtout d’impuissance. Dans le conflit entre Israël et la Palestine, la voix de la France semble se tarir.
Monsieur le ministre, nous avons remarqué vos nombreuses visites au Liban. Mais, sans vous incriminer, pour quels résultats ?
Face au très complexe et potentiellement dangereux dossier iranien, qui vient d’être longuement évoqué, la France semble calquer ses positions sur le modèle américain : y a-t-il encore des propositions françaises originales ? Quel est le bilan de la politique des sanctions ? Pensons-nous par nous-mêmes, monsieur le ministre ? (
Par ailleurs, et malgré les changements intempestifs des ministres, il y a un divorce flagrant entre notre pays et le continent africain : le journal Le Monde s’est fait l’écho récemment, le 26 avril 2008, de la remarque des ambassadeurs français en poste en Afrique qui soulignaient « la dégradation de l’image de la France sur le continent ».
Ainsi, se dessine petit à petit, depuis douze mois, l’effacement diplomatique de la France dans des régions qui nous sont très chères.
La poussive relance d’une « Union méditerranéenne » mal acceptée par nos partenaires européens ne suffira pas dans l’immédiat, me semble-t-il, à changer cette impression. Quand quelque chose bouge, je crains que ce ne soit dans la mauvaise direction.
En mettant ses pas dans les pas de George Bush, un président finissant, M. Sarkozy a fait un mauvais calcul. Il aurait été plus avisé de réfléchir à l’« après-Bush » et de poser les jalons d’une politique autonome de la France au lieu de s’embarquer dans un suivisme, au sein de l’OTAN, en Afghanistan, au Proche et au Moyen-Orient, qui ne peut pas servir à préparer l’avenir. Ce suivisme nous fait rentrer dans le rang ; en s’alignant au sein d’un fantasmagorique « bloc occidental », la France n’a plus le crédit international que lui conférait un positionnement original, autonome.
Aujourd’hui, monsieur le ministre, convenez-en, la seule rupture vérifiée concerne l’alignement progressif de la France !
J’étais de la mission envoyée récemment en Afghanistan sur l’initiative du président de Rohan, et vous comprendrez que je réserve la primeur et le détail de mes impressions aux membres de la commission. Je vous confesserai toutefois que, lorsque Nicolas Sarkozy confirme, lors de sa prestation télévisée du 24 avril, l’envoi de 700 soldats français en renfort, portant l’effectif total à plus de 3 200 hommes, je m’interroge !
Trois jours plus tard, l’argumentaire du ministre de la défense vole en éclats, quand le président afghan, Hamid Karzaï, échappe à un attentat dans le stade de Kaboul, pourtant sous protection des forces spéciales américaines et des forces de l’OTAN. Depuis des mois, les responsables de l’Alliance assuraient que l’armée afghane allait pouvoir prendre le relais et contrôler le centre du pays ! Ils sont cruellement démentis !
Dans les jours qui suivent, diverses attaques menacent à nouveau Kaboul, malgré la présence de 50 000 soldats occidentaux dans le pays. Et Washington parle aujourd’hui d’envoyer plusieurs dizaines de milliers d’hommes supplémentaires, transférés d’Irak.
Le processus politique est en panne, la corruption gangrène l’armée comme l’administration. Le président Sarkozy a préféré parler des horreurs talibanes. Mais, depuis bientôt sept ans en Afghanistan, les États-Unis, relayés par l’OTAN, n’ont apporté aucune solution politique ni formé une armée afghane, pas plus qu’ils n’ont libéré la population de la misère, du terrorisme et des milices.
À quoi sert l’engagement français ? L’Alliance atlantique dit détenir une réponse que la réalité de tous les jours vient démentir. On peut continuer à accumuler indéfiniment des moyens militaires pour tenter de sécuriser l’Afghanistan. Toutefois, il faut aussi avoir une vision régionale, notamment vis-à-vis du Pakistan voisin.
La frontière entre ces deux pays est longue de 2 500 kilomètres et traverse des zones très accidentées, difficiles à contrôler. Il est de notoriété publique que des bases des insurgés afghans existent dans les zones tribales du nord-ouest du Pakistan limitrophes de l’Afghanistan. Ces bases arrière leur permettent de poursuivre les hostilités contre les troupes ISAF, International Security Assistance Force, et contre les forces du gouvernement afghan.
Quelles sont les mesures susceptibles d’améliorer la situation sur cette frontière ? Quel est l’état d’esprit des nouvelles autorités pakistanaises ? Sont-elles disposées à coopérer ?
Par ailleurs, certaines évolutions régionales nous interpellent. Le nouveau gouvernement pakistanais se montre plus ouvert au dialogue avec les insurgés d’Al-Qaïda, et les États-Unis seraient, semble-t-il, disposés à encourager les négociations menées par Islamabad avec certains éléments extrémistes.
La décision d’envoyer de nouvelles troupes françaises en Afghanistan prend-elle en compte ces différents éléments ? De quelle manière notre diplomatie est-elle associée à ces évolutions ? Je n’aime pas trop les anecdotes, monsieur le ministre, mais il en est une qui me paraît significative : lorsque nous avons rencontré le président de la commission de la défense du Sénat afghan, que nous a-t-il dit ? Que si nous n’avions pas une position originale et de l’influence sur nos alliés, il valait mieux que nous nous retirions !

Le président de la commission de la défense du Sénat afghan, à Kaboul. Je pourrai même vous rapporter ici des propos un peu plus cinglants, mais je le ferai dans un cadre plus restreint.
Nous nous posons donc de vraies questions à ce sujet.
L’Afghanistan ne peut pas être isolé d’un contexte stratégique fort complexe, avec deux grands voisins instables et imprévisibles, l’Iran et le Pakistan, ce dernier possédant déjà, ne l’oublions pas, l’arme nucléaire. Plus loin l’Inde, puissance émergente, cherche aussi à jouer un rôle propre au niveau régional. De quelle façon la France et l’Union européenne peuvent-elles faire en sorte que ces différents acteurs régionaux puissent s’inscrire dans une dynamique de paix ? Certes, cela ne sera pas possible si l’on continue à suivre aveuglément des politiques qui ont failli.
L’évolution en Afghanistan est en rapport étroit avec l’environnement régional. La très forte présence des États-Unis en Asie centrale ne doit pas nous empêcher de développer une politique dans cette région. La prochaine présidence française de l’Union européenne pourrait être l’occasion de déployer des initiatives originales. Nous savons tous que, sans développement économique et social, sans libertés, il n’y a pas de sécurité possible. Lors de sa présidence de l’Union, la France ne pourrait-elle pas être le moteur d’une initiative régionale de paix ?
Ainsi, dirai-je en conclusion, ce premier débat du quinquennat, qui devra être suivi d’autres actes parlementaires, aura été l’occasion pour nous de faire entendre nos propositions, et quelquefois nos critiques.
Si je devais synthétiser ma pensée, je dirais que le problème à l’heure actuelle est que l’on ne voit pas quelle est la colonne vertébrale de l’action extérieure de la France. Quelle est sa méthode d’action ? En dehors de quelques coups médiatiques, on ne discerne pas les lignes de force et les priorités de sa politique étrangère. Je vous le dis avec gravité, monsieur le ministre, cette carence est, malgré tout, des plus préoccupantes.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, au moment où l’on prépare une révision constitutionnelle qui vise en particulier à renforcer les pouvoirs du Parlement, c’est bien le moins pour les sénateurs de débattre de la politique étrangère avec le Gouvernement. Je tiens à remercier M. le président de la commission des affaires étrangères d’avoir organisé le présent débat.
Je prends aujourd’hui la parole en ma qualité de membre de la commission des finances et de rapporteur spécial de la mission « Action extérieure de l’État ». Je souhaite que ma modeste contribution renforce le lien entre les ambitions politiques de la diplomatie voulue par le Président de la République et les instruments de la politique extérieure de l’État, mis en œuvre par une pluralité de ministères et d’agences.
De ces instruments, le ministère des affaires étrangères n’a pas le monopole, même s’il doit être un chef de file respecté et reconnu. Monsieur le ministre, être l’animateur d’une politique par nature interministérielle demande beaucoup de qualités, dont celle de gérer et de faire fructifier la diversité des ressources humaines et des profils dont dispose notre État, qu’il s’agisse de nos diplomates politiques, de nos diplomates culturels ou de nos diplomates économiques, pour les mettre au service de notre action à l’étranger.
Dans ce débat, je tiens à rappeler quelques évidences.
Sans prétendre être un spécialiste, je dirai néanmoins que le poids de notre parole à l’étranger est inséparable de ce que nous sommes à l’intérieur de nos frontières.
La portée de nos actes de politique étrangère dépend autant de l’imagination de notre diplomatie que du dynamisme de notre économie et du fonctionnement de notre armée, autant de notre réseau d’ambassades, au demeurant excellent, que du rayonnement de nos universités, autant de notre gestion des crises que de notre détermination à maîtriser nos finances publiques et à faire face à nos engagements européens, incontournables, en la matière.
L’influence réside sans doute moins aujourd’hui dans une politique conçue à cet effet que dans la vitalité propre de notre culture et de notre langue. Comme pourrait nous le dire M. le ministre, faites-moi de la bonne politique économique, budgétaire, éducative, culturelle, préservez un outil de défense crédible, et je vous ferai de la bonne politique étrangère !

À l’heure de la mondialisation, l’influence se mesure dans la capacité à être considéré comme une référence ou, ainsi que l’a indiqué M. de Rohan, comme un exemple. Le sommes-nous aujourd’hui ? Je vous en laisse juge, mes chers collègues.
En matière de politique étrangère, le succès se résume pour moi à trois mots : crédibilité, constance et indépendance.
La crédibilité, c’est ne jamais se payer de mots et toujours confronter ses discours à la possibilité de ses actes. L’approche de la diplomatie et de la défense vont bien souvent de pair.
La constance, c’est approfondir le sillon laissé par nos prédécesseurs et bien comprendre qu’un écart peut être perçu par nos partenaires, par nos amis, mais aussi par nos ennemis, comme un changement de cap, au risque de faire dérailler notre politique.
L’indépendance, c’est évidemment la clé de notre souveraineté et la clé de nos positions.

Monsieur le ministre, à l’aune de ces trois mots, vous pouvez comprendre quelle serait ma position si une évolution sur certains sujets majeurs, tels que l’OTAN, venait à être évoquée.
On comprend bien aussi que l’idée nouvelle d’Union pour la Méditerranée, idée forte et belle du Président de la République, ne prendra toute sa force que si elle est en mesure d’amener la paix sur l’autre rive de la Méditerranée, en Palestine, en Israël et, dès aujourd’hui, du moins le plus tôt possible, au Liban.

Dans les heurts actuels, qui rappellent les pages sombres de ce pays, c’est l’autorité de l’État et d’un gouvernement qui est défiée. La souveraineté du Liban reste visiblement pour certains insupportable.
Monsieur le ministre, confrontés aux troubles actuels, vous avez choisi jusqu’à présent la discrétion. Je ne vous le reproche pas. Vous avez privilégié l’attente, celle des résultats de la médiation de la Ligue arabe. Vous avez sans doute raison. Mais notre politique se mesurera à nos succès, à notre contribution à la concorde civile, alors que 18 000 Français vivent au Liban et que notre armée y est déployée. La prudence passée, il ne faudra pas hésiter, si c’est nécessaire, à mobiliser la communauté internationale tout entière, car la paix au Liban n’est pas seulement un enjeu de politique intérieure pour ce pays, c’est aussi un enjeu régional, pour la Méditerranée, pour le monde arabe, et un enjeu international pour le dialogue des civilisations.
Dans cette perspective, face à l’urgence des crises que le monde traverse, je tiens à dire ce que représente le Livre blanc, exercice terre à terre s’il en est, qui ne doit pas être un contrefeu à la révision générale des politiques publiques voulue par le Président de la République.
Pour cet exercice de prospective, dont la finalité doit être bien définie, deux écueils doivent être évités.
Le premier écueil est la facilité qui tendrait à une réduction de la voilure, qui ferait de l’action extérieure de l’État une variable d’ajustement budgétaire en faisant supporter aux 10 milliards d’euros annuels, correspondant à cette mission essentielle, les coupes que d’autres ministères s’ingénient à éviter, au prix d’une absence de réforme ou, ce qui revient au même, de réformes en trompe-l’œil.

Il y a bien entendu des évolutions à réaliser pour tenir compte de la réalité du monde d’aujourd’hui. Mais il ne faut pas transiger sur l’essentiel : notre réseau diplomatique doit rester universel, ce qui, je le rappelle, n’interdit pas les évolutions.
Il y a aussi des choix à accomplir, notamment celui, qui est sans cesse différé, entre multilatéralisme et bilatéralisme. Nos contributions internationales dépassent bien largement les crédits affectés à notre action bilatérale et à notre réseau. C’est la croissance des crédits mis à disposition des organisations internationales qui, au fil des années, a souvent préempté nos moyens d’actions à l’étranger. Dans une enveloppe budgétaire contrainte, le bilatéral paye, en quelque sorte, pour le multilatéral. Il est temps de rationaliser nos contributions internationales, de demander, avec nos partenaires, les mêmes efforts de gestion et les mêmes résultats aux organisations multilatérales que ceux que nous demandons à notre propre administration.
Ce n’est certes pas facile
M. le ministre opine

Dans le budget de l’action extérieure de l’État, il nous faut maîtriser tout risque inflationniste pour éviter de sacrifier l’essentiel : les ressources humaines nécessaires à une diplomatie politique, économique et culturelle d’excellence.
Le second écueil du Livre blanc serait de résumer notre diplomatie à une pure logique de moyens, alors qu’elle est fondamentalement une politique de puissance. Globalement, nous n’avons aucunement à rougir en regardant les chiffres de notre investissement budgétaire dans notre action extérieure par rapport à nos voisins.
Le futur lecteur du Livre blanc que je suis aspire à trouver dans ce document des objectifs clairs, un chemin vers des résultats tangibles que nous devons atteindre, un renouveau profond de certains instruments – je pense en particulier à la diffusion culturelle à l’étranger – et un recentrage sur des priorités essentielles. Ainsi, monsieur le ministre, laissons les questions d’immigration et de visas au ministère qui en a la charge.
C’est seulement ensuite, me semble-t-il, qu’il convient de dessiner une organisation plus efficace, non pas du seul Quai d’Orsay, mais de l’ensemble de l’action extérieure de l’État, et d’en présenter les conséquences budgétaires. Dans tout domaine de l’action de l’État, ce sont les objectifs qui sont premiers. Dès lors qu’ils sont clairement exprimés, le budget devrait n’être qu’une conséquence.
Pour que cette démarche aboutisse, il nous faut absolument entrer dans une culture d’évaluation des résultats de nos actions. Monsieur le ministre, nous savons, vous et moi, que les diplomates ont une sainte horreur des indicateurs de performance. Néanmoins, sans démarche d’évaluation et sans contrôle de gestion performant, nous ne pourrons pas réussir une réforme vers le haut de l’action extérieure de l’État.
Or, pour moi, comme pour nous tous, sans doute, la diplomatie n’est pas une nostalgie, où nous cultiverions le souvenir de Lafayette à Washington, la mémoire de l’Entente cordiale à Londres et celle de la Pologne d’avant-guerre à Varsovie, elle constitue l’expression de ce qui fait la force et le talent de notre pays, tel qu’il est aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens à mon tour à remercier M. de Rohan d’avoir organisé le présent débat.
Vous me permettrez d’adopter une tonalité quelque peu différente de celle des orateurs qui m’ont précédé.
Mes chers collègues, je suis étonné que l’on n’insiste pas sur les succès obtenus par la France depuis un an, grâce à l’action du Président de la République, du Gouvernement et de vous-même, monsieur le ministre.
Rappelons-nous dans quelle situation nous étions lorsque l’Europe était en panne. C’est grâce à la détermination, au courage et à l’opiniâtreté du Président de la République, qui a su convaincre la présidence portugaise, après avoir persuadé la présidence allemande, qu’a pu être signé le traité de Lisbonne, qui a insufflé de nouvelles chances à l’Europe.
Cet acquis, essentiel, permettra de renforcer la capacité de l’Europe de développer une politique étrangère et une politique de la défense qui est indispensable pour que la France s’affirme dans le monde. C’est un constat que personne, me semble-t-il, ne peut oublier.
Je tiens également, après d’autres intervenants, à évoquer l’idée très forte de l’Euroméditerranée.
J’ai assisté aux discussions de Barcelone. Je présidais alors le comité des régions d’Europe. Il n’est pas question de nier l’ambition de ce processus, de gommer certains résultats, mais force est de constater que nous étions en panne. Nous en sommes sortis grâce à la volonté, à l’affirmation d’un grand projet, d’une grande ambition du Président de la République.
Ce n’est pas parce que chacun est interpellé par les événements du Liban qu’il faut oublier l’importance d’une vraie politique d’union méditerranéenne.
Il a bien sûr fallu s’adapter à la réalité, tenir compte des souhaits des autres parties. Mais nous avons fait bouger les choses et nous avons enclenché un processus, qui, je l’espère, sera irréversible, car il est indispensable pour retrouver un équilibre de paix autour de la mer Méditerranée. C’est un autre constat que personne ne peut non plus oublier.
De même, il paraît difficile d’oublier l’action de la France en Afrique, dans une situation extrêmement difficile. Que l’on pense au Darfour et à la conférence sur le Soudan ou à l’opération EUFOR Tchad-RCA. Ces initiatives montrent la présence de la France en Afrique, sa volonté, sa capacité de promouvoir un certain nombre de démarches.
Sur l’Afghanistan, il ne suffit pas d’évoquer la décision d’envoyer des militaires sur place. Il faut aussi rappeler la démarche que la France initie afin de trouver des solutions à une situation d’une effroyable complexité. Ce n’est tout de même pas la faute de la France, ni celle de M. Sarkozy, si nous ne sommes pas encore sortis de cette affaire !
Nous avons su montrer de la détermination pour participer à la lutte contre le terrorisme et à la recherche d’une réponse politique.

Comment oublier la conférence de Paris ? Certes, elle n’a pas abouti à rétablir la paix entre la Palestine et Israël. Est-ce pour autant la faute de la France ?
Il est faux de prétendre que la France a été absente. La conférence de Paris a mobilisé des efforts, suscité des gestes politiques qui étaient indispensables sur cette douloureuse question.
Certes, au Liban, nous n’avons pas gagné. Est-ce pour autant la faute de la France ? Je veux pour ma part rendre hommage au ministre qui s’est beaucoup mobilisé, qui s’est efforcé de cultiver les chances de la paix contre des forces multiples, internes et externes, qui, hélas ! débouchent aujourd’hui sur une situation dramatique.
On ne peut pas oublier que les conclusions de la rencontre interlibanaise qui s’est tenue au château de la Celle-Saint-Cloud ont été reprises par la Ligue arabe. C’est en s’appuyant sur ces conclusions que l’on pourra demain, je l’espère, apporter des chances supplémentaires à la paix.
Bien entendu, nous aspirons tous à des résultats tangibles. Néanmoins, mes chers collègues, qui peut prétendre que la France pouvait à elle seule, et en un an, changer radicalement le cours du monde tout en conservant la possibilité de mener sa politique à la fois en son propre nom et par le canal européen ?
J’estime pour ma part très injuste de présenter comme un geste consenti aux États-Unis ou à l’OTAN un changement de stratégie qui vise à nous donner des chances supplémentaires de réussir l’Europe de la défense. J’ai tenu à exprimer ce sentiment, parce que je crois que notre pays a besoin de mesurer la chance qu’il a de pouvoir porter des messages dans le monde.
Pour autant, quand je ne suis pas d’accord, j’ose le dire. Or un point m’inquiète, et je ne parle là qu’à titre personnel : je suis inquiet de constater que, dans le cadre du projet de réforme institutionnelle, certains de nos collègues et amis députés envisagent certes de supprimer les référendums portant sur les élargissements de l’Union, mais d’introduire pour l’adhésion de la Turquie une clause spéciale visant à maintenir cette voie.
Mes chers collègues, chacun sait bien que le problème de l’adhésion de la Turquie n’a aucune chance d’être résolu avant dix ou quinze ans. Nous sommes engagés dans des négociations, il nous faut respecter notre engagement. Prendre une mesure particulière en maintenant le référendum dans ce seul cas serait une très grave erreur à l’égard de ce peuple qui a droit à notre respect, qui fait des progrès, qui sort d’un système pour aller vers un autre, et qui peut être aussi un facteur d’équilibre : les pays musulmans laïques, excusez-moi, ne sont pas si nombreux sur la planète ! J’ose l’affirmer ici : nous aurions sans doute mieux à faire que de risquer de leur donner à penser qu’ils sont mis à part et que, pour des raisons multiples, nous oublions leurs propres réalités et la chance que – à mes yeux – ils représentent pour l’équilibre du monde.
Vous constatez donc, mes chers collègues, que je ne suis pas idolâtre de la politique qui a été menée. Je voudrais cependant que, de temps en temps, on en rappelle les atouts exceptionnels. Pour ma part, je considère que la grande action qu’a développée le Président de la République depuis un an, c’est d’avoir sauvé l’Europe.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.

M. Jean-Guy Branger. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d’abord remercier très chaleureusement le président de la commission des affaires étrangères, M. Josselin de Rohan, d’avoir pris l’heureuse initiative d’organiser au Sénat un débat sur la politique étrangère de la France.
M. Jean-Louis Carrère s’exclame.

Il s’agit d’une question majeure, d’une question qui concerne l’avenir de notre pays et de sa capacité d’influence dans la gestion des affaires du monde. Dans cette action, vous ne ménagez pas votre peine, monsieur le ministre.
Toutes les études d’opinion et les sondages le montrent clairement : d’un côté, les Français semblent se méfier du monde, en avoir peur ; de l’autre, c’est dans l’Europe qu’ils placent leurs espoirs de pouvoir maîtriser encore les évolutions globales qu’ils ont trop l’impression de subir.
Ainsi, ils ne trouvent apparemment plus dans l’exception française en matière de défense ou de politique étrangère de quoi les rassurer quant au destin de leur pays, dont ils craignent que la puissance ne soit déclassée. Seul contrepoids susceptible d’équilibrer l’influence jugée parfois envahissante des États-Unis et d’amener ces derniers à prendre en compte le point de vue de leurs alliés historiques, l’Union européenne reste investie pour les Français d’un mandat redoutable : restaurer à l’horizon du xxie siècle l’ambition que la grandeur perdue n’a pas permis de réinvestir.
Dans un tel contexte, qu’est-ce qu’une politique étrangère de la France ? Quels en sont les conditions d’existence et le cadre d’exercice ?
Toute politique exige courage et volonté.

Cela est particulièrement vrai en matière diplomatique, tant les contraintes sont nombreuses et variées.
À mon sens, une politique étrangère rationnelle suppose à la fois une vision du monde et une vision de la France dans le monde. Que peut-elle en attendre ? Que peut-elle y faire ? Dans nombre de cas, il y a une prime à celui qui voit clair et ose dire ce que d’autres pensent sans avoir le courage de l’exprimer.
Que l’on aime ou non le personnage – moi, je l’aime ! –, le général de Gaulle avait une politique étrangère.

Avoir une politique étrangère, cela consiste d’abord à penser : il ne suffit pas d’avoir une volonté, il faut savoir ce que l’on veut ; et nous savons que le monde actuel a davantage besoin que chacun soit lui-même et assume ses choix.
Depuis que je suis parlementaire – cela fait maintenant quelques années ! –, j’ai toujours été très surpris de constater que, dans les déclarations de politique générale des divers gouvernements qui se sont succédé aux affaires, la politique étrangère se trouve réduite à la portion congrue.

Malgré le petit coup de clairon rituel sur « le rôle mondial de la France », je n’y décèle ni vue d’ensemble ni projet. J’observe également que nos dirigeants – ainsi que les médias – ne replacent jamais les sujets d’actualité dans une conception un tant soit peu générale, ou ne le font que rarement, … et que personne ne se préoccupe de la leur demander. Le débat d’aujourd’hui revêt donc une grande importance pour nous, car il nous offre une bonne – et rare ! – occasion d’être éclairés sur la politique étrangère de notre pays.
Nous avons la chance – j’abonde ici dans le sens de Jacques Blanc – d’avoir élu un Président de la République dont les principales qualités sont la volonté politique de prendre les décisions difficiles qui s’imposent et le courage d’en assumer les conséquences politiques. Nous pouvons être certains que la France saura faire entendre sa voix à l’extérieur avec force et courage.
L’activisme diplomatique n’est légitime que s’il constitue une réelle stratégie d’influence et l’expression d’une nouvelle ambition. Nous savons qu’il existe des limites objectives à notre politique étrangère, le constat a été dressé ces dernières années. Nous savons également que, malgré les contraintes budgétaires dont il était question tout à l’heure, il faut rompre avec un certain isolement : cela a été réalisé sur le plan européen, cela doit être confirmé sur le plan international. Rien n’est pire, en effet, que la marginalisation.

Je pense que la politique étrangère de la France doit se jouer à trois niveaux : national, européen et international.
Sur le plan interne, le deuxième réseau diplomatique et consulaire du monde connaît des difficultés financières qu’il ne faut pas nier : une réflexion et une réforme doivent être menées au nom de l’efficacité. Nous disposons sur ce point des excellents rapports budgétaires dans lesquels notre collègue Adrien Gouteyron, que nous avons entendu voilà quelques instants, a ouvert de nombreuses pistes de réforme.
Sur le plan européen, les choses se sont améliorées depuis l’échec du référendum de 2005 : cela doit être mis au crédit de l’action du Président de la République.
Le couple franco-allemand a retrouvé sa vitalité, et il faut s’en féliciter.

Comment ? Ce n’est pas le couple franco-italien ? J’ai encore confondu !

Il s’agit d’un axe majeur de notre diplomatie qui ne saurait être remplacé et dont l’affaiblissement ne saurait être compensé. Soyez-en convaincus, mes chers collègues : sans l’Allemagne, la France ne peut espérer rallier ses partenaires ou d’autres États extérieurs à l’Union à ses initiatives diplomatiques. C’est ce que certains appellent notre « capacité d’entraînement » et qui reste aujourd’hui un élément fondamental de notre politique étrangère.
Nous venons d’en faire l’expérience avec l’important dossier de l’Union pour la Méditerranée. Le couple franco-allemand est une réalité incontournable qu’il ne faut pas ignorer, même si nous ne sous-estimons pas le rôle crucial du volontarisme politique qui est à la base de la plupart des grandes décisions. Le couple franco-allemand est plus que jamais au cœur de l’Europe. Sans lui, rien n’est possible.
Sur le plan international, la difficulté est grande. Ni le remplacement de la bipolarité par un système marqué par la suprématie américaine, ni la position de force de la langue anglaise, qui va de pair avec l’affaiblissement de la francophonie, autre composante de notre diplomatie, ne constituent pour notre pays un contexte favorable.
Dès lors, comment, aujourd’hui, construire durablement une nouvelle capacité d’entraînement de la diplomatie française ? Comment ne pas tomber dans la rhétorique américaine ?

Le volontarisme politique existe ; il faut s’en féliciter. Il doit nous permettre de trouver, avec cohérence et habileté, une nouvelle marge de manœuvre. Ma conviction profonde est que, cette marge de manœuvre, il nous faut la chercher dans la mise en place d’une véritable politique étrangère européenne.
Le bilan de la politique étrangère européenne peut se résumer en un mot : insuffisance. En Europe, l’entreprise européenne a si bien réussi que la politique étrangère n’y a plus de raison d’être ; hors de l’Europe, en revanche, où cette politique est plus que jamais nécessaire, la diplomatie européenne se contente de discours qui ne sont pas suivis d’action, de financements qui ne sont jamais assortis de conditions.

Ainsi, depuis la chute du mur de Berlin, sur les grands sujets de la guerre et de la paix, de la démocratie, du développement, rien n’aurait été différent dans le monde sans l’Union et son « club de gentils membres ».
Il est donc temps pour l’Union de prendre en charge sa défense et sa sécurité, d’affirmer avec force une politique étrangère commune, de revoir sa définition des menaces, d’en finir avec l’illusion de vivre dans un monde où les conflits ne concernent que les autres. Il lui faut pour cela procéder aux réformes institutionnelles qui s’imposent, séparer le diplomatique du communautaire, réviser et harmoniser les politiques étrangères nationales, repenser enfin ce qui fait l’unité de son destin.
L’année prochaine, vingt ans se seront écoulés depuis la chute du mur de Berlin, l’Europe de l’Ouest aura trente ans d’expérience en matière de « coopération politique », la Communauté européenne aura franchi le cap du demi-siècle d’existence, la génération née après la guerre passera le flambeau à celle qui est née après Mai-68 ! Alors même que l’histoire de l’humanité connaît une phase d’accélération prodigieuse, dans cette période durant laquelle l’Europe, tout absorbée par sa propre gestation, s’est mise comme entre parenthèses du monde, la population mondiale a triplé, ainsi d’ailleurs que le nombre des États représentés aux Nations unies. Nous devons absolument prendre en compte ces évolutions et nous tourner vers l’avenir.
Exister face aux États-Unis sans se brouiller avec eux – oh que non ! –, exister en Europe sans sacrifier à un plus petit dénominateur commun émollient : c’est cette quadrature du cercle que la politique étrangère de la France doit résoudre pour trouver un espace.
J’ajoute que le retour de la Russie sur la scène internationale, avec ses ambitions de puissance et son rêve de grandeur, suscite en Europe et aux États-Unis interrogations et parfois inquiétudes. Il faut prendre en compte cette réalité.
Ma conviction, monsieur le ministre, est que l’avenir de notre diplomatie est européen. Les pays européens ont conquis – bien chèrement – le privilège historique d’être vaccinés contre la guerre. Elle est devenue pour eux une monstruosité qu’ils ne veulent plus ni subir ni commettre. N’ayant depuis trois siècles le souvenir historique que de guerres provoquées par eux-mêmes contre eux-mêmes et constatant qu’ils sont tous devenus pacifiques – voire pacifistes –, ils sont profondément rassurés.
La guerre, désormais, c’est pour les autres. Le chaos africain ne nuit qu’aux populations locales, les puissances émergentes d’Asie sont trop absorbées par leurs rivalités régionales pour s’intéresser à nous, les « États voyous » sont loin, et l’Amérique joue pleinement son rôle de gendarme mondial et de bouc émissaire universel. Laissons donc aux États-Unis l’ivresse de la puissance mondiale et le « sale boulot » de l’usage de la violence contre les violents ; concentrons-nous sur la défense bien comprise de nos intérêts économiques et sur l’image, qui nous va si bien, de vieux sages donneurs de leçons !
En effet, cette sagesse du lion devenu vieux, ce cynisme de l’irresponsable peut se défendre. Si nous sommes à l’abri des vents du siècle, si nous avons tout notre temps, alors nous pouvons continuer à nous émerveiller de ne mettre « que » cinq ou six ans à traduire dans les faits la modeste déclaration de Saint-Malo sur la sécurité de l’Europe, seulement dix ou douze ans pour appliquer les extraditions systématiques de terroristes entre nos États, et à nous extasier devant l’audace qui consistera à confier à une seule personne la responsabilité de Haut représentant de l’Union pour la politique étrangère et de sécurité commune, la présidence du Conseil des affaires étrangères ainsi que l’une des vice-présidences de la Commission, chargée de l’action extérieure.
Mais si la menace terroriste existait vraiment ? S’il était vrai qu’une bonne demi-douzaine de pays, très éloignés du modèle démocratique et animés de la haine de l’Occident, détenaient déjà des armes dangereuses ou étaient en passe de les obtenir ? Si des fanatismes inédits finissaient par jaillir des mégapoles monstrueuses d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, tournant contre les privilégiés de l’Ouest le désespoir de la jeunesse du monde ? Si les Américains finissaient par se lasser de payer toujours pour nous, en argent, en hommes et en réputation ? Et finalement, après tout, si nous étions les seuls à être vraiment vaccinés contre la guerre, comme semblent le montrer les combats qui ensanglantent actuellement le tiers de l’Afrique, l’embrasement permanent du Moyen-Orient et du Liban, les affrontements en Afghanistan, l’augmentation régulière des budgets militaires sur tous les continents autres que le nôtre ?
Qui était réaliste dans les années 1930 ? Les vieilles gloires qui se préparaient à un nouvel été 1914 ou le jeune officier qui écrivait Le Fil de l’épée sous les sarcasmes ? En 2008, monsieur le ministre, où est le réalisme ?
Shimon Peres a dit un jour : « Quand vous perdez votre ennemi, vous perdez votre politique étrangère. » Il est grand temps que les pays européens, et la France au premier chef, portent en terre les fantômes du xxe siècle et osent regarder en face les dangers et les défis des temps nouveaux.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP. – M. Philippe Nogrix applaudit également.
M. Robert del Picchia applaudit.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme chacun ici le sait, la politique étrangère de la France repose sur une tradition diplomatique, économique et culturelle s’appuyant sur un certain nombre de principes forts qui ont été énoncés dès la deuxième moitié du xxe siècle. Je veux bien sûr parler du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, du respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, du respect de l’État de droit ainsi que de la coopération entre les nations pour le maintien durable de la paix et la préservation de notre sécurité internationale.
Même si ces principes restent intangibles, le contexte international, caractérisé par des lignes de fracture de plus en plus profondes, une fragmentation de l’espace politique, des affrontements interethniques sur fond de cataclysmes naturels ou de crise alimentaire et une inquiétude croissante de nos concitoyens, nous oblige à réfléchir à une redéfinition des grands axes de notre politique étrangère. À cet égard, je vous suis reconnaissante, monsieur le ministre, d’avoir accepté le principe de ce grand débat aujourd’hui.
Notre politique étrangère doit bien évidemment être dynamique, courageuse et ambitieuse, tout en s’inscrivant dans le cadre des institutions européennes et internationales ainsi que dans un cadre national marqué par la nécessité de restrictions budgétaires et l’inquiétude de nos concitoyens. L’un de nos illustres prédécesseurs devenu Président du Conseil, Georges Clemenceau, ne martelait-il pas avec clairvoyance qu’« une politique étrangère et une politique intérieure, c’est un tout » ?
Notre pays, en termes démographiques, géographiques et budgétaires, n’est qu’un tout petit pays à l’échelle du monde. Mais il a de grandes ambitions ! Pour les mener à bien, il nous faut nous recentrer sur quelques objectifs essentiels. Car, vous le savez, nous serons jugés sur notre capacité à préserver et à développer une véritable « communauté d’influence » à travers le monde pour défendre des orientations communes.
Cette stratégie d’influence doit avoir deux pôles essentiels : d’une part, une rationalisation – ou plutôt une mise en synergie – de notre présence économique, culturelle, éducative et linguistique à l’étranger ; d’autre part, une action entièrement tendue vers un objectif d’appui à la démocratie et au progrès dans un monde de plus en plus globalisé.
Alors que, sur le terrain, le travail quotidien de nos chancelleries à travers le monde n’est plus à démontrer, force est bien de constater que notre capacité à déployer une stratégie d’influence s’affaiblit année après année.
Pourtant, partout dans le monde, il y a une attente, un besoin de France et de tout ce que notre pays peut représenter en termes de défense de valeurs communes de démocratie, de tolérance et de liberté. C’est cette image qui fait notre force et c’est cette image qu’il nous faut préserver.
Mais force est de constater que, souvent, nous ne savons pas répondre à cette attente, faute parfois d’un souci élémentaire de cohérence. Je ne citerai qu’un cas, celui d’un certain paradoxe en Afghanistan, pays où nous envoyons beaucoup de nos jeunes, mais où nous ne pouvons assurer une formation linguistique en français à ces soldats afghans qui nous la réclament, alors même que ce serait relativement peu coûteux.
Pour mieux prôner et incarner ces valeurs qui sont les nôtres, nous avons aussi besoin de les diffuser. Je ne peux donc qu’applaudir à la création de France 24 et aux efforts faits en matière d’audiovisuel extérieur sous l’égide de France Monde. Toutefois, nous ne pouvons agir seuls. C’est pourquoi nous devons absolument le faire dans le cadre de la francophonie et de TV5.
Je souhaiterais aussi vous dire, monsieur le ministre, combien il est important, si nous voulons gagner cette bataille de la francophonie, de ne pas nous tromper de cible. Celle des enfants, des jeunes, à qui il nous faut apprendre notre langue, est prioritaire.
Certes, nous avons un merveilleux réseau d’établissements scolaires aux quatre coins du monde, qui font notre fierté et qui nous permettent de former, outre nos petits nationaux, l’élite de nombreux pays. Cependant, nous ne pouvons plus aujourd’hui raisonner en termes d’élites. Il faut désormais que nous diffusions des programmes éducatifs en français destinés aux plus jeunes tranches d’âge, soit par le biais de la création d’une banque de programmes, soit par un grand nombre d’heures d’antenne réservées sur des chaînes comme TV5 ou France 24, soit par une télévision spécifique, sur Internet par exemple.
Aussi, je vous exhorte à vous rendre au Qatar pour y visiter la chaîne créée spécialement pour les enfants, Al Jazeera Children’s Channel. Voilà une chaîne dans laquelle la France a joué un rôle considérable en matière de conception des programmes, de conseils et de suivi. Nous pourrions peut-être nous en servir comme élément de référence pour une éducation à la francophonie ou tout du moins mettre en place avec elle un partenariat pour des programmes en français.
Partout, nous avons besoin de cohérence et de rationalisation. Cela passe bien sûr par la mutualisation et la valorisation des ressources.
Sans doute devrions-nous aussi nous interroger sur la pertinence d’une présence diplomatique, culturelle et économique qui se renouvelle environ tous les trois ans.
Dans de nombreuses zones du monde, les réussites économiques sont la conséquence de vieux réseaux relationnels, d’un travail de fourmi mis en place au fil des ans. Or il est affligeant de constater un si grand décalage entre les résultats de notre commerce extérieur et ceux de l’Allemagne, qui a pourtant une présence administrative et diplomatique moins importante ou tout du moins plus concentrée que la nôtre. Ne pourrions-nous accepter le principe d’une prolongation des durées de présence dans le pays de diplomates ou de responsables occupant des postes clés, quand ceux-ci le souhaitent eux-mêmes, qu’ils y ont fait leur preuve, et que c’est dans l’intérêt de notre pays ?
À ce propos, je voudrais vous dire combien je trouve dommageable qu’un bon nombre de diplomates, recrutés par la voie du concours de secrétaire des affaires étrangères sur le fondement de leurs connaissances de langues peu usitées, ne soient quasiment jamais affectés dans leur zone ou pays de compétence.

Ne vaudrait-il pas mieux envisager un tronc commun de recrutement, comme le fait la Grande-Bretagne qui choisit les meilleurs, puis les forme intensivement à la langue, à la culture et aux enjeux du pays d’affectation au sein d’une institution comme Wilton Park, dans le Sussex ?
Nombre d’améliorations ne coûteraient pas très cher à l’État, monsieur le ministre. Nous avons besoin de bon sens, et d’une analyse rigoureuse de nos forces et de nos faiblesses. À ce sujet, je voudrais rappeler que Jean-Pierre Raffarin, lorsqu’il était Premier ministre, avait créé un comité pour l’image de la France à l’étranger.
M. Jean-Louis Carrère s’exclame.

Vous ne vous étonnerez donc pas, monsieur le ministre, que l’élue des Français de l’étranger que je suis ne puisse s’empêcher d’évoquer les inquiétudes ainsi qu’une certaine amertume de nos compatriotes établis hors de France.
Les Français à l’étranger sont le meilleur atout de la France hors de ses frontières. Ils sont des relais d’opinion, des vecteurs d’influence, mais ils se sentent encore trop souvent ignorés, voire parfois méprisés, et ce malgré de notables progrès. Il ne faut en tout cas pas qu’ils soient les seules victimes des efforts nécessaires liés aux restrictions budgétaires. Ils sont en particulier très inquiets de la disparition de nombreux consulats, des menaces planant sur notre présence culturelle, dont le budget représente moins que celui du seul Opéra de Paris. Cela a été souvent dit !
N’est-il pas regrettable que nos compatriotes soient rarement invités lors de manifestations d’envergure nationale ? L’annonce officielle que la plupart d’entre eux ne seraient plus invités, faute de moyens, aux réceptions du 14 juillet dans leur pays de résidence a été un véritable choc pour eux. Comment ne pas comprendre leur émotion et leur amertume face à leur exclusion d’un événement aussi symbolique, le seul en principe à pouvoir rassembler toute leur communauté une fois par an pour célébrer les valeurs qui leur sont si chères ?
Par ailleurs, en période de tensions extrêmes et de rapatriement imposé pour préserver leur propre sécurité, nos concitoyens de l’étranger – victimes de catastrophes naturelles ou de crises politiques graves – devraient pouvoir bénéficier d’un véritable fonds public permanent de solidarité. Tel est le sens de la proposition de loi n° 224 que j’ai récemment déposée sur le bureau du Sénat avec mes collègues sénateurs représentant les Français établis hors de France.
Monsieur le ministre, j’aimerais également que vous vous penchiez avec attention sur les autres moyens permettant de renforcer notre présence à l’étranger.
Une réflexion doit être menée – je suis sûre que tous mes collègues, sénateurs et élus de l’Assemblée des Français de l’étranger, seraient ravis d’y contribuer – sur une mise en place rapide de mesures simples. Je pense, par exemple, à un véritable statut de l’élu des Français de l’étranger, à une rationalisation de la situation administrative ou fiscale de nos compatriotes, à une refonte des JAPD – journées d’appel de préparation à la défense –, à une revalorisation du rôle des consuls honoraires, qui, je le rappelle, sont entièrement bénévoles et mériteraient, comme cela se fait dans d’autres démocraties européennes et pour nos ambassadeurs, d’être invités à rencontrer une fois au moins au cours de leur mandat les autorités françaises à Paris, ou encore, je l’ai déjà évoqué, à un enseignement français qui irait bien au-delà de notre seul réseau d’enseignement.
Dans ce contexte, la création d’une collectivité outre-frontière souhaitée par nos collègues de l’AFE serait un progrès décisif.
Enfin, je voudrais vous dire notre émotion devant le drame birman et les conséquences désastreuses du cyclone sur ce peuple. Nous ne pouvons rester impassibles face à une telle tragédie. D’ailleurs, j’arrive à l’instant d’une conférence de presse qui s’est déroulée à l’Assemblée nationale avec des moines birmans.
Nous aimerions arriver à faire pression sur les pays de l’ASEAN en leur demandant de dépasser le sacro-saint principe de souveraineté afin de prendre en considération la souffrance de ce peuple. J’ai également suggéré que des parlementaires de différents pays européens cosignent un appel pour demander que soient largués en urgence par avion et par hélicoptère des vivres, de l’eau et des médicaments dans le delta de l’Irrawaddy. Cette action aurait bien sûr lieu en violation de l’espace aérien birman, mais je pense que nous devrions pouvoir y arriver.
Naturellement, nous ne pouvons agir seuls. C’est pourquoi je compte sur vous, monsieur le ministre, sur votre force de persuasion et sur votre croyance en ce principe du droit d’ingérence, je devrais même dire du devoir d’ingérence.
Tels sont les quelques éléments auxquels je vous remercie de bien vouloir apporter votre réflexion dans le souci de développer une politique étrangère qui ne soit pas une simple doctrine, mais qui tienne compte de l’élément le plus important qui soit : le respect des hommes.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.
Je remercie chacun des participants à ce débat. Je remercie également Mme Joëlle Garriaud-Maylam d’avoir parlé de l’actualité.
Je me suis prêté avec beaucoup de bonheur à ce nouvel exercice. Je vous en félicite, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, ainsi que vous tous, mais je vous rappelle que, le Gouvernement étant maître de l’ordre du jour, j’y suis également pour quelque chose…
Sourires.
J’espère que ce débat se renouvellera deux fois par an, comme vous l’avez souhaité, monsieur le président de la commission, et plus souvent si vous le voulez.
Je pensais sombrer parfois dans la torpeur : il n’en a rien été. Cela n’est pas vrai tout le temps ici, mais je ne nommerai personne !
Nouveaux sourires.
J’ai écouté avec attention les orateurs, et chacun d’entre eux m’a apporté beaucoup par ses critiques comme, parfois, par l’aspect positif de son intervention.
Face à l’abondance de vos propos, monsieur le président de Rohan, mesdames, messieurs les sénateurs, je ne pourrai pas toujours répondre directement à chacun, et je vous prie de m’en excuser. Il y a bien sûr des sujets communs, qui me mèneront au-delà de l’intervention des uns et des autres. Cependant, toutes vos interventions ont été intéressantes et riches en enseignements pour le ministre des affaires étrangères et européennes que je suis… pour l’heure !
Rassurez-vous, il ne s’agit nullement d’une annonce de démission. Je cherche seulement à paraître moins prétentieux !
Monsieur de Rohan, je vous remercie d’avoir souhaité ce débat. J’ai tenté, vous le savez, de multiplier les échanges avec les deux assemblées, et je continuerai à le faire.
Vous avez eu raison de souligner que la mondialisation est parvenue à un moment très délicat. En effet, et je me saisis de la phrase que vous avez prononcée, il y a eu la grande sortie des pays émergents, ceux que l’on cite toujours. Permettez-moi, d’ailleurs, de vous dire que vous vous trompez : la Russie n’est pas un pays émergent. Cela fait un moment qu’elle émerge. Je dirais même qu’elle émerge moins qu’avant. Il s’agissait donc d’un pays avec lequel il nous fallait de toute façon compter et avec lequel nous devions dialoguer, mais j’y reviendrai.
Certains pensent que la remise en cause de l’universalité des valeurs, à la faveur de cette mondialisation ou conjointement à elle, fait que les valeurs du monde occidental paraissent un peu périmées. Je ne suis pas d’accord. Je pense plutôt que chacun se sent un peu perdu parce que, ayons le courage de le dire, les pays riches vont être perdants par rapport aux pays pauvres pendant un certain temps. C’est ainsi, et bien malin qui prétendra le contraire ! Si la richesse et les valeurs doivent se partager, s’interpénétrer, cela ne se fera pas, au début, aux dépens des plus pauvres, et ce n’est que justice.
Quoi qu’il en soit, l’inquiétude est grande devant les délocalisations et les modes de travail de pays où l’armature sociale n’est pas aussi développée que dans nos pays.
En tout état de cause, si quelque chose devait fonder une réflexion générale, comme tout le monde aime à le faire et comme il était facile de le faire au moment des deux blocs – de ce point de vue, nous n’avions pas à nous creuser la tête ! –, si quelque chose devait non pas fédérer, mais donner un parfum très particulier et parfois inquiétant à cette réflexion sur la politique internationale, ce serait cette mondialisation qui nous met en concurrence avec l’ensemble des pays du monde, ce qui n’était pas le cas avant !
Nous sommes amenés à conduire une réflexion sur nos propres certitudes. Cette mondialisation s’opérera durant un nombre d’années – que j’espère le moins grand possible – aux dépens de nous-mêmes, de nos certitudes, voire de notre confort, alors même que ce dernier est très mal partagé à l’intérieur de notre pays, ce qu’il faut signaler. Nous n’en parlons pas assez.
Monsieur de Rohan, comme vous l’avez souligné, nous avons demandé la préparation de deux livres blancs auxquels vous participez. Leurs conclusions seront non pas notre seule boussole, mais des éléments avec lesquels il nous faudra tout de même compter.
Le premier de ces livres concerne la politique extérieure et le second la sécurité et la défense. Les deux sujets étant bien sûr liés, nous auront intérêt à les lire ensemble.
Vous avez souligné un certain nombre d’objectifs. Les membres de la commission du Livre blanc, dirigée par MM. Alain Juppé et Louis Schweitzer, qui ont très bien travaillé, les reprennent également. Nous parlerons de l’Afghanistan, du Liban, du Kosovo, du Tchad, etc. Nous parlerons, bien sûr, aussi de la construction européenne.
Je veux nous féliciter de la relance de l’Europe. Où serions-nous, nous Français qui avons voté « non » – pour ma part, j’ai voté « oui » –, si l’Espagne la première, pays qui avait approuvé la Constitution européenne par référendum, n’avait pas accepté d’aller de l’avant sur une idée du Président de la République – à l’époque, d’ailleurs, je ne la partageais pas complètement – qui a été acceptée par la présidence allemande et mise en œuvre par la présidence portugaise ? L’attitude des Espagnols a été une bonne surprise. Ils nous ont dit : faisons ça ensemble !
Les choses ont bougé, en particulier, je vous l’assure, grâce à la diplomatie française dont je ne saluerai jamais assez l’efficacité, bien entendu conditionnée à la politique de notre pays, l’érudition et la manière dont elle travaille dans le monde, au plus près des populations, beaucoup plus près d’ailleurs que d’autres diplomaties.
Il nous faut bien respecter le fait que notre réseau diplomatique soit le deuxième sur le plan mondial. J’ai bien entendu votre remarque, madame Garriaud-Maylam : avec un réseau moins étendu que le nôtre, l’Allemagne aboutit à de bien meilleurs résultats que nous dans le domaine industriel. C’est un point sur lequel il nous faudra réfléchir, même si je n’aurai peut-être pas le temps de le faire dans le cadre de ce débat car je m’intéresse surtout à vos questions.
Des projets concrets accompagnent cette relance de l’Europe. Je pense au projet d’Union pour la méditerranée, quelles que soient les petites péripéties qui l’émaillent.
Que valent d’ailleurs les péripéties franco-allemandes au regard de celles qui ont eu lieu entre les trois grands couples précédents ? Tous au début ont échangé sur un ton beaucoup plus violent que les échanges entre M. le Président de la République, Nicolas Sarkozy, et Mme la Chancelière, Angela Merkel. Consultez les journaux au sujet des échanges entre Mitterrand et Kohl, entre Giscard d’Estaing et Schmidt, entre Chirac et Schröder.
Je ne le crois pas, monsieur ! Cette polémique est inutile : moi, je me félicitais du ton !
Tous les présidents de la République française se sont disputés avec les Allemands avant de se réconcilier.
Cette fois, la réconciliation a été plus rapide, en particulier autour de l’Union pour la méditerranée.
Vous dites, monsieur le sénateur, que cela avait une autre allure : ça se discute !
Vous avez également souligné, monsieur le président de Rohan, les combats menés pour les droits de l’homme, qu’ils soient localisés, ce qui est important, certes, surtout quand on réussit – je pense à la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien –, mais aussi quand on ne réussit pas encore – je pense aux otages en Colombie –, ou qu’ils soient à l’échelle de la planète puisque les droits de l’homme ne se défendent pas seulement pour un prisonnier ou une personnalité.
On ne doit pas dénoncer les atteintes aux droits de l’homme uniquement lorsqu’il y a un prisonnier, on doit les dénoncer aussi en général, et nous l’avons fait.
Je pense au dispositif qui a été mis en œuvre pour les populations tchadiennes, pas pour les réfugiés qui viennent du Darfour, mais pour les populations déplacées du Tchad. En mettant en place la plus grande force jamais déployée par l’Europe, c’est aussi les droits de l’homme que nous défendons. Nous cherchons à protéger non pas les droits de M. Déby, mais les droits de l’homme des populations laissées sur le terrain ! Je pourrais citer beaucoup d’autres exemples.
Je pense aussi à l’accueil, qui a maintenant commencé, d’un certain nombre de chrétiens et d’autres réfugiés venus d’Irak. Aucun autre pays ne souhaitait les accueillir aussi largement que la France, sauf la Suède. C’est aussi cela la politique des droits de l’homme !
Je me suis rendu en Irak – mais d’autres que moi auraient pu y aller même si l’Irak n’était pas un pays très fréquenté – et j’ai rencontré ces Chaldéens, passés de 1, 2 million de personnes à 400 000, qui croupissent dans des camps en Jordanie ou ailleurs. C’est pourquoi j’ai pensé, avec l’accord de Brice Hortefeux – nous avons œuvré conjointement –, que des visas particuliers devaient leur être accordés.
Il y a également, vous l’avez souligné, de nouvelles règles à la mondialisation, des propositions pour la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, des propositions pour la paix au Moyen-Orient lorsque – hélas ! ou heureusement, je vous laisse libre de choisir – la présidence américaine sera aux mains d’une nouvelle administration.
Quoi qu’il en soit, ne me dites pas que la France est absente des tentatives de règlement du conflit du Moyen-Orient : elles n’ont jamais été aussi nombreuses, et il n’y a jamais eu autant de confiance, aussi bien de la part des Palestiniens que de la part des Israéliens. Si vous voulez faire la paix, il vaut mieux la faire avec les deux parties !
Cela vaut également dans tous les pays arabes. J’ai passé la journée d’avant-hier avec le président Bouteflika en Algérie : il se noue entre nos deux pays des rapports qui étaient impossibles voilà quelque temps. Certes, c’est une autre génération, dont je ne fais pas partie d’ailleurs : ça a changé, le ton a changé !
Ne croyez pas que nous soyons accusés d’être les suppôts des Américains. C’est entièrement faux ! Nous avons, avec les pays arabes, les pays du Golfe dont vous avez parlé, avec le Qatar, qui dirige l’actuelle mission de la Ligue arabe au Liban, des rapports très fraternels.
Il ne nous est rien reproché, et certainement pas de nous ingérer dans ce qui pourrait être un processus de paix.
Après Annapolis, nous avons mené la Conférence de Paris. Il y avait là une représentation exceptionnelle de l’ensemble des pays intéressés du Moyen-Orient, bien sûr, mais allant aussi du secrétaire général des Nations unies au plus petit pays.
Nous cherchions à réunir 5 milliards de dollars et nous avons obtenu 7, 7 milliards de dollars. Le point le plus important était non pas la contribution financière, mais l’élan politique ainsi exprimé.
La contribution qui m’a le plus ému est celle du Sénégal, pays musulman, un des pays les plus pauvres du monde, qui a donné 200 000 euros pour montrer qu’il y croyait. Il s’agit d’une réussite politique, et non d’une réussite liée à la charité ou à la solidarité ! Chypre, petite île partagée, a versé 2 millions de dollars, soit presque son budget !
Je tenais à vous rappeler ces petites choses, mesdames, messieurs les sénateurs.
Notre présence dans le monde est peut-être discutée par les Français, mais elle n’est pas discutée, je vous l’assure, par le reste de la communauté internationale. Au contraire, elle est même saluée, …
…et en disant cela je ne suis pas prétentieux. Il y a donc non pas un souffle, un grand air, mais un petit mouvement très particulier.
Sourires sur les travées du groupe socialiste.
Vous avez raison de le souligner, il n’y a pas assez d’argent pour notre rayonnement culturel. Cependant, en France, il n’y a pas assez d’argent en général. Et la dette est fantastique – 64 % du PIB –, sans compter le service de la dette. Qui est responsable de cet état de fait ? Pas moi !
Tous les gouvernements successifs ont eu des politiques qui consistaient à faire sans arrêt des promesses…
Tout à fait ! La gauche et la droite sont responsables. Que voulez-vous que j’y fasse ?
J’ai été très heureux de pouvoir maintenir le budget du Quai d’Orsay, qui n’a pas été revu à la baisse. Mais le Quai d’Orsay a été un modèle.
Ses effectifs ont diminué de 11 % sur dix ans, et vous l’avez souligné. Nous avions donc suivi toutes les consignes.
On ne peut pas réduire sans cesse les effectifs et maintenir un système universel.
Par ailleurs, un certain nombre de propositions sont contradictoires, madame Joëlle Garriaud-Maylam. Faut-il multiplier les consulats ? Certes, mais ils sont trop nombreux en Europe et nous ne pourrons pas tous les maintenir.
Ainsi, des expériences formidables sont tentées - à Berlin et au Sénégal – visant, à partir d’une réduction coordonnée non pas seulement des diplomates, vous l’avez dit, mais également des personnels issus notamment d’autres ministères, à nous permettre de réaliser certains ajustements très difficiles afin de pouvoir déplacer les personnels.
Nous devons, à l’évidence, à travers le monde, dans les pays émergents en particulier, faire montre d’un peu plus de réalisme par rapport aux besoins des populations.
Monsieur Hue, vous jugez sévèrement notre bilan après un an. Vous pensez que l’image de notre politique étrangère est terne. Moi, je ne le pense pas, ...
M. Bernard Kouchner, ministre. …mais sans doute ne suis-je pas objectif !
Sourires.
L’action internationale du Président de la République a certes été critiquée, mais elle a aussi été tant louangée que j’en ai parfois eu honte !
Peut-être cela a-t-il changé ; il y a eu des présentations personnelles. Regardez le bilan publié la semaine dernière par le très sérieux magazine The Economist, que je peux citer puisque les articles n’y sont jamais signés, et vous verrez !
Tout le monde s’étonne qu’on n’en ait pas fait plus mais on en a fait beaucoup ! Bien sûr, on n’en fait jamais assez.
Concernant l’Afrique, vous avez évoqué le discours du Cap prononcé par le Président de la République. Je pensais que vous alliez citer celui de Dakar.

Je l’ai cité en disant que le discours du Cap ne réglait pas le problème de celui de Dakar !
Soit ! Cependant, il y a quand même eu une correction. Les discours de Dakar et du Cap se complètent. Il y a eu beaucoup de changements d’affectation lors de la mise en place du gouvernement actuel. Ce qui compte, ce n’est pas le fait qu’un secrétaire d’État qui était chargé de la coopération soit désormais en charge de la défense - il en est d'ailleurs, me semble-t-il, très heureux ! -, c’est que la politique vis-à-vis de l’Afrique a changé.
Plusieurs d’entre vous ont cité le document établi par le Quai d’Orsay dans lequel celui-ci demandait aux ambassadeurs en poste en Afrique de donner leurs impressions. Est-ce plutôt négatif ? Je n’en sais rien. En tout cas, nos rapports avec l’Afrique ont changé, l’Afrique a changé, et nous avons changé.
Dans son discours du Cap, le Président de la République a dit très clairement que tous nos accords de défense allaient être révisés. Cela signifie qu’ils seront modifiés et que, très clairement, l’armée française n’est pas là pour maintenir des équipes au pouvoir. Cela signifie également que toutes les bases de l’armée française en territoire africain seront revues. Il n’en restera donc pas beaucoup et cela nous mettra dans une position semblable à celle des autres pays occidentaux, en particulier le Royaume-Uni, …
…qui a eu en Afrique une importance au moins comparable à la nôtre.
Voilà ce que nous allons faire et je crois qu’il était important de le souligner.
S’agissant de l’entente franco-allemande, qui a été malmenée par tout le monde, monsieur Hue, le dernier document franco-allemand établi entre Mme Merkel et M. Sarkozy qui concerne le point de discussion le plus difficile, c’est-à-dire l’Union pour la Méditerranée, résume vraiment le nouvel élan.
Quels pays a-t-on vu se mettre en avant, lors du sommet de Bucarest, pour refuser le MAP à la Géorgie et l’Ukraine, c'est-à-dire le plan d’action en vue de l’adhésion à l’OTAN ? D’abord, la France et l’Allemagne, l’Allemagne et la France ! C’est aussi une marque de la politique européenne et de l’importance de l’Europe. Il faudra bien que l’Europe ait une politique étrangère et une défense plus forte, vous l’avez vous-même dit, monsieur Hue.
Outre l’Allemagne et la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie et le Luxembourg, c'est-à-dire les six pays fondateurs, ont refusé le MAP, parce que nous constatons, étant les voisins de cette Russie nouvelle, qu’il faut avoir avec elle un dialogue et surtout adopter un nouveau ton.
J’ai bien noté vos propos, monsieur Hue. Il y a encore vingt ans - le mur de Berlin est tombé voilà dix-neuf ans -, la Russie était le cœur du communisme. Elle a changé de façon exceptionnelle, nous avons tous changé, reconnaissons-le.
À Bucarest, en tout cas, nous l’avons très largement souligné.
L’alignement sur les États-Unis, c’est un fantasme. Je peux le prouver en dressant la liste de tous les points sur lesquels nous divergeons avec ce pays. Je ne suis pas pro-américain par système, au contraire.
Sur le Kosovo, nous n’étions pas en accord. Sur le changement de climat, nous divergeons. Sur l’Afghanistan, nous n’avons pas la même politique. §Non, vous allez voir, on va changer. Si on ne change pas, nous aurons perdu. Or il ne faut pas que nous perdions.
Sur le Liban, nous avons mené une politique entièrement différente. Cela n’a pas marché pour le moment. Malheureusement, rien n’a fonctionné jusqu’à présent et il faudra bien que cela marche mais, franchement, nous n’en sommes pas responsables.
C’est toujours pareil : en politique extérieure comme en politique intérieure, si vous restez dans votre coin, personne ne vous accuse, mais si vous prenez des risques… Or le Moyen-Orient, plus particulièrement le Liban, est l’un des sujets les plus difficiles qui soient. Nous avons essayé et, en effet, nous étions à un cheveu de la réussite. Mais à un cheveu de la réussite, c’est l’échec.
Sur les trois points que l’initiative française avait amenés, qui étaient partagés par les chiites et les sunnites, par M. Hariri et par M. Berri, nous avons cru, durant une journée, que nous avions réussi. Ensuite, d’autres éléments, extérieurs pour la plupart, s’en sont mêlés. La Ligue arabe revient sur ces trois points après une série d’échecs.
On verra bien. Aujourd’hui, nous appuyons l’initiative de la Ligue arabe. Apparemment, une sorte de cessez-le-feu serait prévu, les barrages autour de l’aéroport seraient levés et une table ronde serait organisée au Qatar.
Celle que nous avions tenue en France, à la Celle-Saint-Cloud, avec le Hezbollah - Dieu sait si on me l’a reproché, à ce moment-là ! – avait été une réussite. Tout le monde se parlait, rappelait l’histoire, voulait travailler ensemble, puis, cela s’est dilué. Peut-être avions-nous mis trop d’espoir dans ces conférences.
J’ai évoqué la conférence de Paris pour la Palestine. Je me rendrai à Bethléem dans quelques jours pour une conférence importante des secteurs industriels privés palestinien et israélien. On verra si cela facilite la mise en œuvre de projets. Nous sommes présents en permanence dans la région. Il ne se passe pas de semaine sans qu’un membre du Gouvernement se rende en Israël et en Palestine. En ce moment, le président Bush est sur place ; j’espère qu’il réussira mais j’en doute, car les choses semblent bloquées.
En nous attelant à un certain nombre de projets, nous voulions que la vie quotidienne des Palestiniens change, qu’ils adoptent des projets qui étaient proposés et financés par la conférence de Paris.
De ce point de vue, nous sommes déçus, car les blocages israéliens demeurent, dans une trop large mesure. Même s’il a été décidé, à plusieurs reprises, de mettre un terme aux colonies de peuplement, et même si les Palestiniens sont convaincus aujourd'hui qu’il n’y en aura plus de nouvelle, celles qui existent continuent de se développer, ce qui n’est pas acceptable. Nous le disons très clairement, comme le Président Nicolas Sarkozy l’a affirmé à plusieurs reprises, et je suis sûr qu’il le dira encore lors de sa prochaine visite en Israël et en Cisjordanie prévue à la fin du mois de juin.
MM. Hue, de Montesquiou et Pozzo di Borgo ont évoqué la présence de l’Union européenne dans cette région.
L’Union européenne est présente dans le Quartet, particulièrement à travers son envoyé spécial, M. Tony Blair, que l’on entend beaucoup. Malheureusement, lui-même n’a fait lever que quatre barrages sur cinq cent quarante. Ce n’est pas assez.
La France a poussé pour que la station d’épuration de Beit Lahia dans la bande de Gaza, qui fut notre premier projet, reçoive 50 à 60 tonnes de ciment par jour. Le projet se poursuit. C’est un premier succès, certes insuffisant.
De nombreux orateurs ont évoqué, à juste titre, l’aide au développement.
D’abord, nous voulons, en ce domaine, changer de méthode, mais nous devons aussi multiplier les financements. Il faut notamment trouver des financements innovants. L’aide au développement, qui est la portion congrue, ne peut se satisfaire des sommes qui sont actuellement mises à sa disposition. J’espère donc que, les comptes de la nation se redressant, un effort supplémentaire pourra, dès l’année prochaine, être consenti.
Cela étant, nous ne respectons pas, tant s’en faut – nous ne sommes pas les seuls, mais ce n’est pas une raison -, les objectifs du Millénaire et nous ne sommes pas à 0, 7 %. Nous sommes très loin du compte, aux alentours de 0, 4 %. C’est déjà cela, mais je ne peux, bien entendu, m’en satisfaire. D’ailleurs, personne ne s’en satisfait, surtout pas les volontaires du développement, qui accomplissent un travail considérable.
La semaine dernière, s’est tenue une conférence sur l’assurance maladie dans les pays en développement, à travers des microcrédits privés et publics, et avec un financement public au départ. Nous travaillons sur ce sujet, qui est porteur de beaucoup d’espoirs. C’est une façon, me semble-t-il, efficace, de participer à l’aide au développement dans le secteur de la santé, de la part d’un pays qui a multiplié les initiatives dans le domaine de la santé.
Plusieurs orateurs ont critiqué un certain nombre des dépenses faites dans le cadre multilatéral plutôt que dans le cadre bilatéral.
La contribution de la France au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria s’élève à 300 millions d’euros. Retirer de l’argent à ce fonds, c’est priver les malades de traitement ! On ne peut pas faire cela. Il faut bien sûr trouver de l’argent pour le développement, mais nous ne pouvons pas renoncer à notre aide dans d’autres domaines.
Nous soutenons l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination, GAVI - General agreement on vaccination and immunization -, et, là aussi, nous investissons beaucoup d’argent, qui n’est pas visible. Je souhaiterais que l’argent de la France soit plus visible, mais ce n’est pas toujours possible quand on a investi dans ce domaine.
S’agissant de la Tunisie, je regrette de ne pouvoir davantage nuancer mes propos. Des progrès considérables ont été accomplis, notamment en ce qui concerne le droit des femmes, le respect des minorités religieuses et sur le plan économique et social, en matière d’emploi, de croissance et de logement, mais ce n’est pas suffisant. De nombreuses atteintes à la liberté de la presse ont été observées ; le nombre de prisonniers politiques - dont on nous dit qu’ils sont islamistes mais le sont-ils tous ? – suscite également de sévères critiques. Il faut en tout cas nuancer tout cela.
L’Union pour la Méditerranée progresse. Le rendez-vous du 13 juillet à Paris réunira tous les pays de la Méditerranée, de la rive sud, de la rive nord, et les pays de l’Union européenne. C’est la troisième visite que nous effectuons en Algérie, et j’ai été très heureusement surpris par l’accueil du président Bouteflika.
Je partage avec M. de Montesquiou l’opinion que les relations avec les organisations régionales, en particulier en Afghanistan, devraient être développées.
M’étant rendu en Afghanistan pendant dix ans en tant que médecin, je pense bien connaître ce pays. Certes, il faut aussi agir à la périphérie de l’Afghanistan ; certains sont opposés à l’aide mais d’autres veulent bien y participer, il faut donc travailler autour de cela.
Monsieur Carrère, je partage votre sentiment sur la nécessité de trouver une autre stratégie. D’ailleurs, c’est le sens du concept d’ « afghanisation ».
Le Président de la République a accepté - nous étions en effet le pays charnière - d’envoyer un bataillon supplémentaire, les 700 hommes de troupe dont vous avez parlé. Les Américains eux vont venir renforcer les Canadiens autour de la gigantesque base de Kandahar. Il l’a fait – et je crois qu’il a eu raison – à condition que la méthode change, que nous soyons plus proches des populations, que l’afghanisation corresponde aux projets des Afghans. Cela n’est pas facile, nous pouvons échouer, mais au moins faut-il le tenter.
Se contenter de survoler avec nos avions des populations qui sont parmi les plus pauvres du monde, cela risque très rapidement de nous faire passer pour des troupes d’occupation ; ensuite, ces populations nous préféreront les agents locaux que sont les talibans. Les paysans qui, le jour, travaillent très péniblement une terre aride se feront talibans la nuit.
Donc, dans chaque projet de la communauté internationale, il faut absolument renforcer la coordination entre les agents, les bataillons, les nations. Nous travaillons avec M. Kai Eide, le nouveau représentant du secrétaire général des Nations unies, à l’organisation de la conférence du 12 juin 2008. C’est Paris qui accueille ce forum de réflexion sur l’Afghanistan. Cette conférence de donateurs, sur le modèle de la Palestine, sera précédée quinze jours auparavant d’une conférence sur la société civile, où des programmes proposés par les ONG et les agences des Nations unies seront confrontés les uns aux autres.
Dans la première matinée de cette conférence du 12 juin, à laquelle le secrétaire général des Nations unies et un certain nombre de chefs d’État ou, à défaut, de ministres des affaires étrangères devraient être présents, il sera procédé à l’examen des progrès réalisés.
Sur ce dernier point, permettez-moi de vous dire que vous avez été assez injustes : six millions d’enfants afghans sont scolarisés, dont deux millions de femmes – je sais que l’on répète toujours les mêmes chiffres, mais c’est important pour ces enfants…
Non seulement je les cite, mais je les répète !
Écoutez, je connais ce pays par cœur ! Les villages où j’ai travaillé pendant des années ont maintenant une école ! Elles n’existaient pas auparavant, c’est donc que la situation s’est améliorée !

Il n’y a pas de professeurs formés ! On se contente de garder les enfants !
Eh bien, formons les maîtres, c’est cela l’« afghanisation » !
Il y a en Afghanistan des écoles, des routes, un système médical qui n’existaient pas…
Il n’y en a pas assez, monsieur Carrère, j’en conviens, mais il y a des routes, et davantage qu’avant.
Et surtout, des femmes sont élues. Le vote des femmes a été introduit en 2004, donc très récemment, et c’est un résultat de l’influence internationale.
Nous ne pouvons pas sans cesse dénigrer ce que nous faisons, sous prétexte que c’est nous qui le faisons. Nous sommes peut-être capables, de temps en temps, de bien faire les choses.
C’est étrange, je suis d’accord avec vous mais, dès que je le dis, c’est vous qui n’êtes plus d’accord !
Je suis d’accord avec vous sur l’idée qu’il faut se rapprocher, que chaque projet doit être pris en charge par les Afghans, mais ne dites pas que la partie est perdue d’avance, sinon le terrorisme et l’extrémisme religieux auront gagné ! Or, je ne le crois pas. Je pense au contraire que nous pouvons gagner, pas en occidentalisant les Afghans – nous n’allons pas leur exporter notre démocratie, puisqu’ils n’en veulent pas – mais en essayant de leur donner des responsabilités.
Ce que vous avez dit de l’armée afghane n’est pas juste. La police est très corrompue, c’est vrai, et il faut qu’elle change. Mais l’armée, qui compte 75 000 hommes, commence à n’être pas trop mal. Elle prendra le commandement de la région de Kaboul, la région centre, progressivement. Nous verrons bien ce qui en résultera. Cette manière de passer la main va, à mon avis, dans le bons sens.
Monsieur de Montesquiou, il faut en effet mutualiser les moyens des consulats, ceux des consulats européens et de consulats situés dans d’autres continents. Une expérience a été réalisée en Amérique centrale et s’est soldée par un échec : il s’agissait de petits postes qui n’avaient pas grand-chose à mutualiser. Nous devons cependant y être très attentifs car vous avez raison sur le fond : un effort de concentration reste à faire.
Concernant le retard pris dans la transposition des directives européennes, je vous signale que le classement de la France s’est amélioré…
…car nous avons transposé cinquante ou soixante directives. La situation commence à s’éclaircir. Par ailleurs, la classification des ambassades a déjà été décidée.
S’agissant du Liban, je l’ai dit, nous faisons ce que nous pouvons. La solution ne passera pas seulement par le soutien au seul pouvoir légitime, le gouvernement de M. Fouad Siniora, puisque l’élection du président n’a pas eu lieu. Je pense, mais je peux me tromper et je vous demande de me pardonner d’avance, qu’il ne faut pas négliger le rôle de l’armée. Elle représente le dernier corps constitué de ce pays qui ait résisté au morcellement, avec 70 000 hommes dont 70 % sont chiites. Il faut bien en tenir compte ! Je ne suis pas de ceux – même si j’ai été un peu déçu – qui critiquent l’attitude récente de l’armée libanaise.
J’ai parlé avec tous les protagonistes et, en particulier, avec le général Sleimane, qui m’a déclaré : « Si nous en avions fait plus, le pays éclatait et c’était la guerre civile. » Il faut prendre en considération son point de vue, même si je ne suis pas sûr qu’il ait entièrement raison. La Ligue arabe va peut-être se tourner, dans un premier temps, vers d’autres corps constitués, mais elle ne négligera pas l’armée.
Je regrette de devoir aborder ce sujet aussi vite et de manière si improvisée. Que s’est-il passé ? Un basculement s’est produit : les chiites ont longtemps été les plus pauvres et on les traitait comme quantité négligeable ; cette époque est désormais révolue, en tout cas au Liban et en Irak. Le général Aoun – même si je l’ai beaucoup critiqué – a compris ce mouvement, c’est le moins que l’on puisse dire, puisqu’il a approuvé le discours de M. Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah. Je ne vais pas jusque-là, bien au contraire ! Un basculement est donc intervenu en faveur de la population chiite, qui fait partie des communautés libanaises – je ne sais pas si c’est la plus importante, mais elle tend à le devenir.
J’ignore si nous allons reprendre une initiative au Liban. Si le président de la République, responsable de la diplomatie française – je n’en suis que le patron local, ici, au Quai d’Orsay – sent qu’il y a la moindre chance que nous soyons utiles à quelque chose, nous agirons. Nous avons participé à une initiative européenne, avec l’Espagne et l’Italie, car nous sommes les trois pays européens riverains de la Méditerranée les plus significatifs – on pourrait y ajouter la Grèce. Elle n’a pas été inutile et si une initiative de ce type est à nouveau possible, nous y participerons !
Monsieur Pozzo di Borgo, vous avez évoqué la future politique étrangère de l’Europe. L’exercice va être difficile, mais c’est l’espérance !
Il faudra prendre en compte le président du Conseil, celui de la Commission européenne, celui du Parlement européen et celui du pays qui assumera la présidence tournante de l’Union. Tout cela va être compliqué. Il faut y réfléchir, c’est ce que nous faisons. J’ai reçu hier soir un des trois groupes de ministres des affaires étrangères que nous avons constitués et qui viennent successivement à Paris : nous y parlons très ouvertement, librement et sans notes. Tous mes collègues sont très préoccupés par cette perspective et notamment par l’organisation du service européen d’action extérieure. Si ce service émane seulement de la Commission européenne, les politiques extérieures des États membres disparaîtront, ce qui serait très dangereux ! Il faut les maintenir, telle sera la tâche de la présidence française. Nous ne serons pas jugés seulement sur ce point, mais nous le serons en particulier sur ce point.
Si nous obtenons l’accord des Vingt-Sept sur des propositions de noms pour occuper tous ces postes et si nous parvenons, à partir de là, à esquisser la configuration du futur service d’action extérieure, nous aurons fait œuvre utile, mais ce ne sera pas facile !
Je me suis déjà exprimé sur la Russie. Nous sommes favorables à la multiplication des contacts avec la société civile en Russie, en liaison avec les responsables politiques. Je me rendrai dans quelques jours en Russie où je rencontrerai M. Medvedev pour la première fois.
Je sais qu’on reproche au Président de la République d’avoir téléphoné à M. Poutine, mais tout le monde l’a fait ! Par chance ou par malchance, il a été le premier à le faire, mais on n’a pas critiqué tous les chefs d’État qui l’ont fait après lui. Tous les présidents victorieux sont félicités par leurs pairs, c’est ainsi ! Je ne l’ai pas fait…
Si Nicolas Sarkozy avait été le deuxième à appeler, personne n’en aurait parlé !
La proposition sur la libre circulation et les visas est intéressante. Nous l’avons déjà faite pour les Serbie et elle n’a pas peu contribué à la victoire des démocrates aux élections législatives de dimanche dernier : je suis très fier d’y avoir contribué, car la voix de la France a beaucoup compté.
Les membres de l’Union européenne ont voté – pas tous, mais cela n’a pas d’importance – pour l’indépendance du Kosovo, parce qu’il n’y avait pas d’autre solution – c’est un sujet que je connais un peu : nous ne pouvions pas faire autrement ! Nous n’allions pas reproduire la situation de Chypre vingt-cinq ans plus tard, avec nos troupes entre les belligérants, car nous avons des soldats sur place et nous exerçons des responsabilités. En même temps, nous avons dit à la Serbie que cette indépendance ne constituait pas une défaite pour elle et qu’elle devait prendre le chemin de l’Union européenne.
M. Philippe Nogrix applaudit.
L’affaire n’est pas encore terminée, car il faudra constituer un gouvernement, mais les démocrates ont fait preuve d’une belle ténacité !
Nous avons amélioré les conditions de délivrance de nos visas. Vous savez que ce processus doit intervenir dans le cadre des accords de Schengen, mais dix-huit pays sur vingt-quatre l’ont fait à l’appel de la France, ce qui n’est pas mal.
M. Boulaud est parti, mais j’ai été très intéressé par ce qu’il a dit sur la Macédoine et je souhaiterais qu’on lui rapporte ma réponse.
Je veux bien que l’on s’intéresse à la cause de la Macédoine – personnellement, je connais très bien ce pays, j’y ai travaillé tout le temps pendant les deux ans où j’étais au Kosovo – mais elle est l’État entrant ! Nous avons un devoir de solidarité avec les États qui sont déjà membres de l’Union européenne, comme la Grèce. J’espère que, dans les deux mois qui viennent, le problème posé par le nom de cet État sera réglé et je serai le premier à souhaiter non seulement la bienvenue, mais un bon travail à la Macédoine.
Pour cela, la Macédoine doit consentir un petit effort et la Grèce un plus grand, j’en conviens. Je ne suis vraiment pas responsable des querelles historiques remontant à Alexandre le Grand et à la Macédoine antique. Nous n’avons pas négligé, bien au contraire, l’adhésion de la Macédoine puisque nous avons accueilli sa demande. C’était alors la Slovénie, premier pays à avoir quitté la fédération yougoslave, qui présidait l’Union européenne – tout un symbole ! –, elle ne voulait pas refuser la candidature de la Macédoine et nous ne voulions pas non plus refuser celle de la Serbie. Le processus prendra un peu plus de temps mais, croyez-moi, je suis sûr qu’il aboutira ! Je me rends compte que j’aurais dû parler de l’Ancienne république yougoslave de Macédoine ou ARYM, car on n’a pas le droit de prononcer le nom de Macédoine, mais ce n’est pas grave !
Bien sûr, les Macédoniens sont nos amis et les Grecs aussi. Que faire dans un tel cas ? Le refus d’un seul membre suffit à empêcher tout accord. De toute façon, les Grecs auraient opposé leur veto.
M. del Picchia a évoqué la nécessité d’éviter un conflit entre l’Islam et l’Occident. Nous nous y employons : la conférence d’Annapolis n’a pas encore échoué et je m’accroche à cet espoir. Les Palestiniens viennent en France et ne partagent pas votre sentiment, ils ne pensent pas que nous sommes les valets des États-Unis. Nous avons reçu trois ou quatre fois Abou Alla, l’interlocuteur de Mme Tzipi Livni – comme Abou Mazen est l’interlocuteur de M. Ehud Olmert. Il nous a dit qu’il n’excluait pas que les discussions se poursuivent au-delà de la fin de l’année. En effet, ce terme a été fixé par les Américains afin de permettre un dernier succès que pourrait revendiquer l’administration Bush – il n’y en a pas tellement ! Cela ne signifie pas que les pourparlers doivent s’arrêter. J’étais heureux d’entendre celui qui sera peut-être le président de l’Autorité palestinienne après Abou Mazen – s’il s’en va – dire que la discussion allait peut-être continuer.
Maintenant, l’Autorité palestinienne doit mener une autre discussion avec Gaza et le Hamas. Même si tout le monde a le droit de prendre des contacts, ce n’est pas à nous de décider que les Palestiniens doivent se parler entre eux. Nous les poussons à le faire, mais l’initiative leur appartient. Vous l’avez d’ailleurs dit, il est dans l’intérêt d’Israël qu’ils se parlent car la sécurité d’Israël suppose l’existence d’un État palestinien. C’est aussi simple que cela… mais très difficile à réaliser !
Vous avez souhaité l’émergence d’une Europe plus forte qui réponde aux défis de la mondialisation : oui, trois fois oui ! Il nous faut pour cela une défense européenne. C’est la seule façon de faire pièce à ce qu’on croit être la machine de guerre américaine, d’autant que, je le reconnais, le Pacte de Varsovie a disparu. À quoi sert l’OTAN aujourd’hui ? À mettre en application deux résolutions des Nations unies, la première concernant le Kosovo et la seconde l’Afghanistan. Telles sont les deux missions actuelles que l’Alliance assure au nom de la communauté internationale.
Quand on dit que la France réintègre l’OTAN, il faut bien voir que nous n’y gagnons rien, sauf de permettre à nos officiers de réintégrer la chaîne de commandement dont ils sont absents. Sinon, en ce moment, l’une des deux missions de l’OTAN que j’ai évoquées est commandée par un général français. Nous sommes bien dans l’OTAN !
D’ailleurs, qui nous y a fait revenir ? C’est François Mitterrand, qui a fait participer le premier nos avions aux opérations en Bosnie. Ensuite, qui a voulu que nous regagnions l’ensemble du dispositif, y compris le commandement Sud ? C’est Jacques Chirac, qui n’a d’ailleurs pas obtenu gain de cause pour le commandement Sud.
Maintenant, nous ne prétendons plus à rien, nous voulons simplement prendre notre place. Il n’est pas question de renoncer à l’autonomie de nos armes atomiques, nous conservons une indépendance absolue dans ce domaine, mais nous sommes dans l’OTAN. Qu’y gagnerons-nous ? Tout simplement que nos officiers soient au courant des plans stratégiques.
Monsieur Carrère, je vous ai déjà largement répondu. S’agissant de l’Irak, je vais y retourner. Nous avons ouvert un consulat à Erbil, qui fonctionne très bien. À partir de ce consulat, nous allons essayer, avec les Irakiens, de développer une chaîne de dispensaires pour que la population soit prise en charge.
Nous n’avons pas le temps d’analyser ce qui se passe maintenant, mais nous assistons, là aussi, à une lutte des chiites contre les sunnites.
Le gouvernement a déclaré la guerre à l’armée du Mahdi. J’ai volontiers reconnu l’importance de s’intéresser au monde chiite, mais il existe aussi des problèmes propres au pays. Après la visite de M. Ahmadinejad à Bagdad, on peut parler d’une nouvelle donne : nous verrons bien quelles en seront les conséquences.
M. Carrère a en outre évoqué les propos du président de la commission de la défense du Sénat afghan, qui est un homme du Sud. Le président Karzaï va être confronté à de solides adversaires : il faut s’en réjouir, car c’est cela, la démocratie ! Il est d’ailleurs bien normal que certains désapprouvent complètement sa politique !
En tout état de cause, pour répondre à la critique formulée, il est vrai que si les Français sont venus en Afghanistan simplement pour renforcer l’effort militaire, cela n’a guère d’intérêt. Il faut que nous changions la donne et que nous fassions preuve, aux côtés des Afghans, d’une imagination qui leur permette de prendre ensuite le relais. Je partage entièrement le sentiment de M. Carrère sur ce point. Nous verrons bien ce qui se passera lors de la conférence des donateurs du 12 juin prochain.
Monsieur Gouteyron, je vous remercie de vos réflexions sur la notion d’influence. Nous verrons s’il est possible d’accroître la nôtre ; cela dépendra du succès des réformes en cours, qui doivent nous permettre de faire face dans de meilleures conditions à la mondialisation.
S’agissant du Livre blanc, nous allons procéder à une nécessaire « redistribution » de notre réseau diplomatique. Nous ne savons pas jusqu’où cela nous conduira, mais le processus est pour le moment bien entamé. En particulier, l’expérimentation menée à Berlin et au Sénégal, où le personnel est très nombreux, s’avère être un succès.
Monsieur Jacques Blanc, je vous remercie de m’avoir adressé tant de louanges au sujet du bilan d’une année de diplomatie. Comme j’ai plutôt l’habitude d’essuyer des critiques, que l’on me permette d’être sensible à de tels propos, même s’ils ont été excessivement élogieux !
Sourires
La conférence de Paris a été un succès qui a été remarqué, je vous l’assure, dans le monde entier.
M. Branger a parlé d’« activisme en politique extérieure ». Cette formule ne m’a guère plu : était-elle utilisée dans un sens positif ou négatif ? Quoi qu’il en soit, on entend toujours déplorer un manque de volonté politique, mais s’il suffisait de volonté politique pour faire bouger les choses, ce serait trop facile ! Il faut aussi prendre en compte les conditions objectives du pays.
Finalement, je revendique, monsieur Branger, cette dimension activiste. Cette forme de diplomatie s’avérera, je l’espère, plus solidaire. Les choses vont trop lentement, paraît-il, pourtant certains prétendent que cela va trop vite, avec des décisions prises tous les jours et de nombreuses réformes en chantier. Il faudrait savoir !
Mme Garriaud-Maylam a souligné une des difficultés majeures auxquelles se heurte notre effort diplomatique : les moyens dont nous disposons s’essoufflent. Il va falloir trouver une solution, sinon nous n’aurons plus les moyens de notre politique extérieure. Cela est très clair.
Je pourrais vous raconter de nombreuses anecdotes à ce propos, mais je me contenterai de relever que je ne parviens pas à trouver les quelques dizaines de milliers d’euros qui suffiraient pour engager de modestes réformes, néanmoins utiles. Il ne s’agit pourtant pas de montants énormes pour un pays comme la France ! C’est un peu affligeant ! Je voudrais que les moyens du développement soient à la disposition des postes consulaires. L’Agence française de développement doit développer ses programmes, mais il faut que nos ambassadeurs puissent disposer de moyens leur permettant de mieux faire sentir la présence de la France ! J’ai la volonté de faire évoluer les choses sur ce plan !
On ne peut pas comparer le rôle des ambassadeurs à celui des préfets sans leur accorder de moyens financiers. Nous devons nous donner les moyens d’exercer notre influence.
Madame Garriaud-Maylam, je vous remercie de vos propositions concernant la formation de nos diplomates.
Par ailleurs, je suis entièrement d’accord avec vous s’agissant de l’accueil des étrangers à Roissy. Cela étant, ne trouvez-vous pas que l’accueil réservé aux Français y est tout aussi scandaleux ?
Marques d’approbation sur diverses travées.
Comment peut-on traiter ainsi, guère mieux que des valises, ceux qui arrivent dans nos aéroports ? Et le tableau est encore plus sombre si l’on débarque au petit matin ! Dans tous les aéroports du monde, même dans les pays les plus pauvres, l’accueil est plus chaleureux.
Mêmes mouvements
J’indiquerai maintenant à MM. de Rohan, Hue, Boulaud, del Picchia et Carrère, à propos de l’Afghanistan, que nous menons une guerre non pas contre les Afghans, mais à leurs côtés, contre le terrorisme, contre l’islamisme extrême, contre les talibans. Si ce n’est pas ainsi que notre action est perçue, il faut changer d’approche et, si la situation ne s’améliore pas, nous devrons nous retirer de ce pays. En effet, si nous ne parvenons pas à faire évoluer la perception de notre présence par la population, nous n’avons aucun intérêt à rester en Afghanistan.
Cela étant, je vous le rappelle, nous ne faisons qu’appliquer une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies. En France, certains estiment qu’il s’agit d’une « guerre américaine ». Certes, les opérations menées en Afghanistan ont fait suite aux attentats du 11 septembre 2001, mais elles ont été décidées par le Conseil de sécurité de l’ONU. La situation est donc tout à fait différente de celle qui prévaut en Irak. Quoi qu’il en soit, en cas d’échec, il faudra en tirer les conséquences. Je vous invite tous à suivre les développements de la conférence de Paris.
La défense européenne est pour nous un sujet essentiel ; elle constitue d’ailleurs l’une des priorités de la présidence française de l’Union européenne. Les éléments dont je dispose me font dire qu’elle ne fonctionne pas si mal que cela. Lors de la conférence de Bucarest, M. Bush a d’ailleurs reconnu que l’Europe avait elle aussi le droit de mettre en place sa propre défense. On peut comprendre cela comme un « feu vert » donné aux Européens, même si nous n’avons pas à solliciter d’autorisation, car les États-Unis ne disposent pas d’un droit de veto en la matière ! En tout cas, ces propos de M. Bush ont frappé les esprits européens, ce qui va peut-être faciliter la nécessaire mise sur pied d’une défense européenne autonome.
Je vous réponds volontiers, monsieur Carrère.
Permettez-moi d’abord de formuler un constat : nous en sommes à la troisième résolution assortie de sanctions. Dans les prochains jours, Téhéran recevra une lettre du groupe des Six, composé de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la France, de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Ce message contient une proposition de dialogue extrêmement précise et développée. Je le redis, la France a toujours prôné l’association étroite de menaces de sanctions et d’offres de dialogue, les unes ne pouvant aller sans les autres. D’éminents émissaires iraniens, porteurs de messages précis, sont venus en France. Le dialogue a bien eu lieu, mais nous n’avons abouti à aucun résultat, le seul souhait de nos interlocuteurs étant manifestement que nous nous rendions à Téhéran pour saluer M. Ahmadinejad. Vous en conviendrez, ce n’est pas très simple ! Si aucune avancée ne peut être obtenue, le dialogue s’éteindra, mais nous essayons.
Ainsi, voilà vingt jours, je me suis entretenu avec M. Mottaki pendant une heure et demie au Koweït. Nous discutons sans cesse avec l’Iran, mais les autorités de ce pays se bornent à nous inviter à nous rendre à Téhéran, sans formuler aucune proposition concrète. Cela ne signifie nullement que nous allons mettre fin au dialogue, au contraire.
À cet égard, j’ai trouvé intéressante la réunion qui s’est tenue à Londres le 2 mai dernier. En effet, à ma grande surprise, le groupe des Six est parvenu à adopter une position unanime. La Chine et la Russie considèrent, tout comme nous, que l’Iran peut représenter une menace.
Je ne puis vous révéler la teneur du message adressé à Téhéran avant que ses destinataires ne l’aient reçu – il sera rendu public aussitôt après –, mais je vous assure qu’il s’agit d’un texte fort. Ce message comporte, outre une lettre d’accompagnement, des propositions de dialogue extrêmement précises. Jusqu’à présent, nous n’avons jamais réussi, par exemple, à faire comprendre aux Iraniens que nous ne sommes pas opposés à ce qu’ils se dotent d’installations nucléaires civiles et que nous sommes d’ailleurs prêts à les y aider, comme la Russie l’a indiqué, mais que, en revanche, le développement de leur potentiel nucléaire militaire nous inquiète tous fortement. En tout état de cause, la France a montré qu’elle était prête au dialogue.
J’ai bien entendu les propos de M. del Picchia sur ce sujet. Il me semble que, en effet, nous ne devons pas faire de discrimination. Demain, nous devrons pouvoir admettre la Serbie et la Macédoine dans l’Union européenne, mais ensuite nous devrons nous déterminer sur le cas de la Turquie. Sur ce dossier, je n’ai pas à développer mon point de vue, qui n’est pas exactement identique à celui du Président de la République, lequel dirige la diplomatie française. C’est peut-être l’un des rares sujets sur lesquels nous avons des points de désaccord très précis.
Pour l’heure, examinons les chapitres les uns après les autres : trente sur trente-cinq restent à étudier, et il faudra encore une dizaine d’années pour mener à bien ce travail. Dans ce cadre, nous entretenons des rapports très réguliers avec ce pays. Je m’y suis rendu voilà trois mois et M. Jouyet y était encore la semaine dernière, pour évoquer notamment l’Union pour la Méditerranée. L’atmosphère des discussions peut encore s’améliorer, mais l’évolution est encourageante compte tenu des positions de départ.
Je vous remercie infiniment, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, pour ce débat qui m’a beaucoup apporté. Je me tiens à votre disposition pour renouveler l’expérience.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et de l ’ UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Je tiens à remercier à mon tour M. le ministre et l’ensemble des intervenants pour ce débat très intéressant.
Le débat est clos.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Richert.