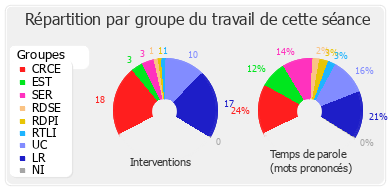Séance en hémicycle du 31 octobre 2023 à 14h30
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Mathieu Darnaud.

La séance est reprise.

L’ordre du jour appelle, à la demande du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, la discussion de la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives, présentée par Mme Cathy Apourceau-Poly, Mme Éliane Assassi, Mme Laurence Cohen et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 926 [2022-2023], résultat des travaux de la commission n° 60, rapport n° 59).
Dans la discussion générale, la parole est à Mme Silvana Silvani, auteure de la proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je commencerai mon intervention en évacuant d’emblée un malentendu : une loi d’amnistie ne contrevient pas à la séparation des pouvoirs fondant notre ordre républicain.
Au travers de cette proposition de loi, nous ne remettons pas en cause les jugements passés, donc l’action de la justice, puisque nous ne revenons pas sur les peines ou les amendes prononcées. Nous demandons seulement que les femmes et les hommes condamnés voient leur sanction amnistiée.
Cette loi d’oubli et d’apaisement est une tradition qui remonte aux lois constitutionnelles de 1875. Après cette date, il était d’usage d’ouvrir chaque législature par une mesure de clémence visant à la réconciliation nationale.
En ces murs, le sénateur Victor Hugo plaida le 22 mai 1876 pour l’amnistie des communards dans les termes suivants : « Les sociétés humaines, douloureusement ébranlées, se rattachent aux vérités absolues et éprouvent un double besoin, le besoin d’espérer et le besoin d’oublier. […] Je demande l’amnistie. Je la demande dans un but de réconciliation. » L’amnistie des communards prit finalement effet le 14 juillet 1880. L’objectif était de permettre au peuple révolutionnaire de Paris de réintégrer le camp de la République.
Le 24 mai 1936, lorsque 600 000 manifestants montent au Mur des Fédérés pour commémorer la Commune, le cortège demande l’amnistie des militants syndicaux et des antifascistes. Le 7 juin 1936, l’amnistie figure parmi les premiers projets de loi déposés, aux côtés de la semaine des 40 heures et des congés payés, par le Gouvernement du Front populaire.
Le 22 mai 1968, enfin, le Sénat vote l’amnistie pour les infractions et les sanctions consécutives à des fautes disciplinaires et professionnelles commises à l’occasion de ce que l’on appela alors « les événements ».
Nous le voyons au travers de ce bref rappel, à différentes époques, lorsqu’un événement social d’une ampleur exceptionnelle survient, le législateur sait considérer que les sanctions consécutives à l’action militante ne doivent pas demeurer, afin de faciliter la réconciliation nationale.
La présente proposition de loi concerne les infractions punies de moins de dix ans d’emprisonnement commises lors de conflits du travail, à l’occasion d’activités syndicales ou revendicatives. Elle ne concerne en aucun cas les casseurs présents dans les manifestations.
Nous proposons également d’amnistier les sanctions disciplinaires. L’inspection du travail serait donc chargée de veiller à ce que les mentions de ces faits soient retirées des dossiers des intéressés. Notons, à cet égard, que le Conseil constitutionnel a validé cette possibilité dans une décision du 20 juillet 1988, en indiquant que le législateur pouvait « étendre le champ d’application de la loi d’amnistie à des sanctions disciplinaires ou professionnelles dans un but d’apaisement politique ou social ».
Par ailleurs, comme dans la loi du 20 juillet 1988, nous demandons la réintégration des salariés licenciés.
Nous proposons enfin de supprimer les informations nominatives et les empreintes génétiques collectées sur les militantes et les militants lors des mobilisations sociales, notamment à l’occasion des manifestations contre la réforme des retraites. Je rappelle que ce fichage, initialement réservé aux délinquants sexuels, a été élargi à de nombreux domaines, dont la dégradation de biens, ce qui revient à assimiler des syndicalistes à des criminels !
Notre groupe parlementaire a donc fait le choix de s’inscrire dans une longue tradition sociale et républicaine.
Les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution de 1946 protègent l’action collective, qui est aujourd’hui attaquée de toutes parts.
Ce droit, inhérent à toute démocratie, reconnu par notre Constitution, est remis en cause par la répression du Gouvernement contre les militantes et les militants, mais également par les stratégies d’intimidation utilisées par le patronat dans les entreprises.
Cette intimidation prend la forme du chantage à l’emploi, de menaces physiques par des barbouzes recyclés en milices patronales, comme du temps du SAC (service d’action civique). Avec les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K, je m’insurge contre ces procédures qui criminalisent l’action revendicative et attaquent en plein cœur le droit de résister.
J’ai une pensée pour toutes ces femmes et tous ces hommes victimes de leur engagement militant en faveur des autres.
Je pense à Alexandre Pignon, secrétaire départemental de la fédération des activités postales et de télécommunication des Pyrénées-Orientales et postier à Perpignan, visé par une plainte pour entrave à la liberté du travail.
Je pense aux dix salariés de l’entreprise Sonelog, dans le Vaucluse, qui ont été licenciés pour faute lourde après s’être mis en grève pour exiger de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires.
Je pense à Loris Taboureau, employé de restauration à Disneyland Paris, licencié en raison de son engagement lors de la grève du parc d’attractions menée, au printemps dernier, pour réclamer une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail.
Je pense également à cette employée de 23 ans du Leclerc de Vallauris, dans les Alpes-Maritimes, renvoyée pour avoir exercé son droit de grève et avoir manifesté son opposition à la réforme des retraites.
Je pense enfin à Sébastien Menesplier, secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l’énergie de la CGT, convoqué le 6 septembre dernier au commissariat.
Au total, près de mille militantes et militants sont aujourd’hui sous la menace de licenciements, de sanctions disciplinaires, de convocations ou de poursuites judiciaires.
Toutefois, que reproche-t-on à ces femmes et à ces hommes ? D’avoir défendu un idéal qui les dépasse, des convictions en faveur d’une société plus juste, plus égalitaire, plus humaniste ou plus écologiste. Ces femmes et ces hommes, qui s’opposent avec leurs moyens à la destruction de notre société sont considérés aujourd’hui comme des délinquants ou des criminels ! Mais qu’ont-ils fait, si ce n’est manifester leur exaspération en usant de leur droit à la parole et la résistance ?
Selon le douzième rapport du Défenseur des droits et de l’Organisation internationale du travail (OIT), établissant un baromètre de la perception des discriminations dans l’emploi, « les pratiques antisyndicales, parmi lesquelles les discriminations, ne sont pas un phénomène isolé, tant dans le secteur privé que dans le secteur public ». Ainsi, 46 % des personnes interrogées estiment avoir été discriminées du fait de leur activité syndicale. Quelque 67 % des syndiqués perçoivent leur engagement comme un risque professionnel.
Ces chiffres montrent qu’une partie du patronat continue à nier la légitimité de l’engagement syndical et met en place des stratégies antisyndicales, afin de dissuader les salariés de se syndiquer et de s’organiser collectivement.
Le Gouvernement n’est pas en reste en la matière, car, en réponse aux manifestations et aux concerts de casseroles, il a pris des interdictions préfectorales et déployé l’ensemble de la panoplie des munitions contenues dans les armureries de la police.
À l’usage disproportionné de la force à l’encontre des jeunes mobilisés contre la réforme des retraites dans leurs lycées ou dans leurs universités, se sont ajoutées des sanctions administratives et pédagogiques. Dans les lieux de travail comme dans les lieux d’études, la répression n’a pourtant pas sa place. Ces femmes et ces hommes en lutte sont ainsi considérés comme des fauteurs de troubles à l’ordre public…
Or qui sont les fauteurs de troubles ? Les patrons voyous, qui refusent de payer leurs impôts en France et délocalisent les entreprises pour satisfaire les intérêts des actionnaires ? Ou ces femmes et ces hommes, qui luttent pour défendre leurs droits, pour garder leur dignité ou pour préserver leur environnement ?
Pour conclure, mes chers collègues, avec ce texte, nous vous proposons d’amnistier les faits commis dans le cadre de conflits du travail, d’activités syndicales ou revendicatives dans l’entreprise, ou encore de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
La majorité sénatoriale devrait se souvenir que, en 2002, elle a adopté une loi d’amnistie qui couvrait les infractions commises dans le cadre de conflits du travail et de mouvements revendicatifs.
Monsieur le garde des sceaux, la liberté de manifester et la liberté syndicale sont des éléments nécessaires dans une démocratie, car elles permettent au débat de s’enrichir et à une partie de l’opinion de s’exprimer. Le rôle du ministère du travail est d’agir pour protéger les syndicalistes, plutôt que d’adresser, comme cela a été fait, un vade-mecum sur l’autorisation administrative des licenciements pour fait de grève des salariés protégés ou de représentants du personnel…
Pour notre part, nous avons toujours été du côté de celles et de ceux qui luttent pour faire respecter leurs droits, pour une société plus juste et plus solidaire. Pour l’ensemble de ces raisons, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi présentée par Cathy Apourceau-Poly et plusieurs sénateurs membre du groupe CRCE-K, dont notre ancienne collègue la présidente Éliane Assassi, a pour objet l’amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives.
Je commencerai tout d’abord par rappeler le cadre général de l’amnistie, loi d’exception dont la pratique est de plus en plus limitée.
Le quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution dispose que l’amnistie relève de la loi. Comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel, « sur le fondement de ces dispositions, le législateur peut enlever pour l’avenir tout caractère délictueux à certains faits pénalement répréhensibles, en interdisant toute poursuite à leur égard ou en effaçant les condamnations qui les ont frappés ». Les effets de l’amnistie sont définis aux articles 133-9 à 133-11 du code pénal. L’article 133-10 prévoit que l’amnistie « ne préjudicie pas au tiers » ; les préjudices civils peuvent donc être indemnisés.
Historiquement, les lois d’amnistie poursuivent deux finalités.
La première est le retour à la paix civile ou l’apaisement des passions après des périodes de troubles particulièrement déstabilisatrices. On pense, par exemple, à la fin de la guerre d’Algérie. L’amnistie tend, par l’extinction de l’action publique et la libération des personnes détenues, à permettre le retour de tous à la vie civile. C’était le but de la loi du 10 janvier 1990 portant amnistie d’infractions commises à l’occasion d’événements survenus en Nouvelle-Calédonie, par exemple.
La seconde finalité est le désengorgement des juridictions de contentieux de masse considérés comme de faible importance. C’est en ce sens que peuvent être interprétées les lois d’amnistie votées après les élections présidentielles sous la Ve République, jusqu’à la présidence de Jacques Chirac.
Les lois d’amnistie, qui se sont multipliées au cours des années 1980, ont été l’objet de critiques de plus en plus nombreuses.
De fait, depuis 1990, aucune loi d’amnistie n’a plus été adoptée en lien avec des événements ou un territoire donné, et les revendications portées en ce sens ont été écartées par le Président de la République. Plus récemment, la pratique des lois d’amnistie proposées par le Gouvernement à la suite des élections présidentielles n’a pas été reconduite à l’occasion des élections de 2007. La dernière loi de ce type date donc de 2002, et cette pratique semble abandonnée depuis lors.
Outre que de telles lois semblent le fait du prince et seraient plus fréquentes qu’autrefois avec le passage au quinquennat, la tolérance de la société à voir des infractions, dont la plupart relèvent du quotidien – ainsi des infractions routières – rester impunies semble désormais faible.
Le nombre d’infractions exclues du champ des lois d’amnistie avait, en conséquence, progressivement augmenté, au point d’interroger sur la légitimité du choix des infractions susceptibles d’être amnistiées.
Bien qu’elles tirent toutes les conséquences juridiques de l’évolution de la jurisprudence relative aux lois d’amnistie, ces critiques peuvent également être adressées au texte en discussion.
La première de ces critiques concerne le caractère mal défini de la notion de « mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux ». Cette notion paraît très étendue, au point d’être potentiellement insaisissable, voire de poser des difficultés d’interprétation.
La loi pénale étant d’interprétation stricte, toute imprécision tend à priver un dispositif d’effet. Des divergences d’interprétation sont cependant possibles et pourraient être dommageables sur des questions d’amnistie.
La seconde critique, plus importante, concerne le champ de l’amnistie prévu. Il est particulièrement large, puisqu’il concerne la plupart des délits survenus « à l’occasion » de conflits du travail ou de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux. Ce champ dépasse les seuls manifestants venus défendre une cause ; il inclut également ceux qui ont pu se joindre à eux dans l’intention de commettre des délits.

Naturellement, nous avons en tête les images des casseurs qui ont agi lors des événements de ce printemps.
La proposition de loi s’étend par ailleurs à toutes les infractions passées, sans limitation en amont dans le temps.
Enfin, l’amnistie, telle qu’elle est proposée, concerne non seulement les délits, mais aussi toutes les sanctions disciplinaires touchant les salariés du secteur privé, les fonctionnaires, les étudiants et les élèves. Pour ces deux dernières catégories de personnes, elle entraîne, s’il y a eu exclusion, réintégration desdits étudiants ou élèves dans l’établissement universitaire ou scolaire.
Certes, la proposition de loi prévoit des exceptions à l’amnistie.
Ainsi, aux termes de l’article 3, les étudiants ou élèves exclus à la suite de faits de violence et amnistiés ne seraient pas réintégrés de plein droit dans l’établissement. Les fautes lourdes ayant conduit au licenciement ne seraient pas non plus comprises dans le champ de l’amnistie.
Surtout, l’article 1er dispose que ne seraient pas couvertes par l’amnistie les violences à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique ayant entraîné une incapacité de travail, non plus que les atteintes volontaires à l’intégrité d’un mineur de moins de 15 ans ou d’une personne particulièrement vulnérable.
Ces exceptions paraissent cependant insuffisantes. Plusieurs types d’atteintes aux personnes et aux biens, comme le vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours, seraient amnistiés en application du texte, s’il était adopté.
Du point de vue tant des personnes auxquelles elle pourrait s’appliquer que des infractions comprises dans son champ, la proposition de loi paraît aller bien au-delà de l’objectif de protection du droit à l’action collective et syndicale visé par ses auteurs, comme l’a rappelé Mme Silvana Silvani.
Mon propos ne vise nullement à lutter contre l’action syndicale ou contre les syndicalistes ; simplement, il considère la proposition de loi selon le spectre plus large, que je viens de développer.
Bien qu’elle soit digne d’intérêt, la proposition de loi ne constitue pas, aux yeux des membres de commission des lois, une réponse souhaitable à la gestion des troubles qui sont survenus au cours des dernières années.
En effet, la commission a considéré que les garanties entourant l’action publique et les procédures relatives aux mesures disciplinaires touchant les salariés, fonctionnaires, étudiants et élèves permettent de prendre en compte de manière adéquate et proportionnée les événements survenus à l’occasion de conflits sociaux ou d’actions revendicatives et qu’une amnistie générale serait inadaptée.
En conséquence, la commission n’a pas adopté la proposition de loi présentée par le groupe CRCE-K. Elle vous demande, mes chers collègues, de faire de même.
Applaudissements sur les travées des groupes UC et Les Républicains.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous nous retrouvons aujourd’hui dans le cadre de l’ordre du jour réservé au groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
La proposition de loi dont nous débattons a pour objet, comme l’a indiqué Mme la sénatrice Silvani, d’amnistier les contraventions et délits punis de moins de dix ans d’emprisonnement, lorsqu’ils ont été commis à l’occasion de conflits du travail, d’activités syndicales ou de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux.
Si vous le voulez bien, arrêtons-nous un instant sur les mots, car, en droit, la sémantique compte double, si j’ose dire. Le mot « amnistie » nous vient du latin amnestia, emprunté au grec ancien amnêstía, qui signifie « un oubli ». L’amnistie peut donc être juridiquement comprise comme une forme d’oubli, d’amnésie législative, qui serait consentie pour satisfaire un souhait du corps social. Il peut s’agir de rétablir la paix civile après des événements collectifs particulièrement douloureux. Tel était le cas après la guerre d’Algérie.
À ces amnisties événementielles se sont succédé des amnisties générales, une forme de solde de tout compte pratiqué systématiquement par la gauche, mais aussi par la droite, entre 1981 et 2002 à la suite des élections présidentielles.
Cette « tradition », dont l’objet originel avait muté, s’est finalement éteinte voilà plus d’une vingtaine d’années et, disons-le clairement, il ne paraît pas opportun de la ressusciter.
En réalité, un tel oubli n’avait rien d’un pardon, mais tout d’une renonciation coupable venant affaiblir l’autorité de l’État et remettre en question l’indépendance de la justice.
En 2023, une telle loi d’amnistie ne ferait qu’aggraver la discorde et nourrir l’impunité, alors même que les voies de l’apaisement ont été trouvées et que le dialogue social a été renoué lors d’une grande conférence sociale le mois dernier.
Au-delà du principe, sur lequel nous sommes en désaccord, cette proposition de loi pose deux difficultés majeures.
Tout d’abord, elle aurait pour effet d’amnistier un champ très large d’infractions, passibles d’une peine pouvant atteindre dix ans de prison. Par exemple, seraient amnistiés plusieurs types d’atteintes aux personnes et aux biens, comme le vol précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours. Pour rappel, cette infraction est punie de sept ans d’emprisonnement.
Un vol commis lors d’une manifestation serait donc amnistié. Voilà ce que vous nous proposez.
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Ensuite, les circonstances dans lesquelles s’inscrirait cette amnistie sont particulièrement larges et laisseraient, en réalité, planer le doute sur des faits qui méritent évidemment une réponse pénale.
M. Pascal Savoldelli s’exclame.
En effet, la proposition de loi pose comme condition que les faits aient été commis à l’occasion de « mouvements collectifs revendicatifs », une notion également très large et peu circonscrite. Elle emporterait des effets de bord importants, et je ne suis pas certain que vous les ayez tous mesurés.
À titre d’exemple, là encore, votre loi d’amnistie s’appliquerait-elle aux événements qui ont secoué notre pays en juillet dernier ? Je vous pose la question, parce qu’un certain nombre de vos alliés politiques…
Exclamations sur les travées du groupe CRCE-K.
… ont indiqué que les émeutes de juillet dernier étaient en réalité une « révolte populaire », ce terme ayant même été repris par le Syndicat de la magistrature.
Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.
En l’occurrence, la notion très large – trop large – que vous avez choisie fait, à l’évidence, planer le doute.
Or il n’y a aucun doute : il ne s’agissait pas d’une révolte, mais de délinquants, très jeunes pour la plupart. Il était impératif de rétablir l’ordre républicain.
Tel était l’objet d’ailleurs de ma circulaire du 5 juillet 2023 relative au traitement des infractions commises par les mineurs dans le cadre des violences urbaines et aux conditions d’engagement de la responsabilité de leurs parents. J’y demandais « une réponse ferme, rapide et systématique », ainsi que l’engagement de la responsabilité des parents, chaque fois que c’était possible et pertinent.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour saluer l’engagement des magistrats et des greffiers, qui nous ont permis, par leur action efficace et immédiate, de rétablir, avec les forces de sécurité intérieures, l’ordre républicain dans un temps record.
Que les choses soient clairement dites, c’est chaque fois à l’occasion – et souvent au prétexte – de tels mouvements collectifs que se sont produits au cours des dernières années de nombreuses violences urbaines, des pillages ou des actes de vandalisme et de dégradation. Or de tels actes n’ont absolument rien à voir avec l’expression légitime de revendications collectives.
C’est pour cette raison que je mène une politique pénale claire et ferme. Elle se résume ainsi : le droit de manifester, oui, bien sûr ; le droit de tout démolir et de s’en prendre aux forces de l’ordre, non !
Tel fut l’objet de ma dépêche du 18 mars 2023 relative au traitement judiciaire des infractions commises à l’occasion des manifestations ou des regroupements en lien avec les contestations contre la réforme des retraites, qui m’a d’ailleurs valu une contre-circulaire « Canada Dry », si j’ose la qualifier ainsi, du Syndicat de la magistrature. Je rappelle d’ailleurs à toutes fins utiles que seul le garde des sceaux conduit la politique pénale au nom du Gouvernement, tout en étant responsable devant le Parlement.
Je veux être très clair : il n’est pas souhaitable que des personnes ayant commis des délits passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans d’emprisonnement soient amnistiées.
Le Gouvernement ne souhaite pas que l’on puisse offrir une impunité aux casseurs, aux pillards, aux vandales, qui ne recherchent aucune réconciliation, mais qui, bien au contraire, se repaissent en permanence du désordre.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI, ainsi que sur des travées des groupes UC et Les Républicains. – Protestations sur les travées des groupes CRCE-K et SER.

Vous savez très bien que tel n’est pas l’objet de la proposition de loi. Vous travestissez la réalité. Nous visons les syndicalistes !
Les mesures d’amnistie prévues par cette proposition de loi n’ont rien d’un remède, d’autant qu’elles instillent un poison : le sentiment que la justice ne serait pas indépendante.
Je le rappelle, les juges de notre pays sont totalement indépendants, et c’est très bien ainsi.
Par ailleurs, cette amnistie ne contribuerait pas à enterrer des querelles passées.
Elle provoquerait la stupéfaction – c’est un doux euphémisme – chez la plupart de nos compatriotes qui ont été témoins des pillages et des destructions. Elle creuserait davantage le fossé entre la plupart de nos concitoyens, qui sont attachés à la stabilité républicaine, et ceux qui guettent la moindre faiblesse des institutions.
En effet, s’il est évident que le droit de manifester et le droit de se mettre en grève sont parmi les plus fondamentaux de notre République indivisible, démocratique, laïque et sociale, ces droits s’exercent dans le cadre de la loi, que nous devons tous respecter.
Pensez un instant, s’il vous plaît, aux commerçants qui ont vu leurs vitrines systématiquement détruites pendant les manifestations des « gilets jaunes » ou pendant le mouvement contre la réforme des retraites.
Pensez-vous qu’ils comprendraient que l’on amnistie ceux qui ont pillé ou incendié leur enseigne, qui à la fois fait leur fierté et leur procure leurs revenus ?
Ce n’est pas un bon message à adresser à ceux qui, dans les moments difficiles que traverse notre nation, font le choix de la résilience, du dialogue et du suffrage, plutôt que de la violence.
Exclamations sur les travées du groupe CRCE-K.

Tenir de tels propos, pour un garde des sceaux, ce n’est pas terrible !
M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Les signataires de la proposition de loi indiquent vouloir notamment amnistier le secrétaire général de la Fédération nationale des mines et de l’énergie de la CGT.
Mmes Cathy Apourceau-Poly et Céline Brulin acquiescent.
Bien que je ne puisse commenter une enquête en cours – je le rappelle avec force, et c’est bien normal, la justice est indépendante et tranchera l’affaire en question en toute liberté, dans le respect de tous nos principes –, avez-vous bien réfléchi aux conséquences concrètes de la portée très vaste de votre texte ?
En effet, en application de ladite proposition de loi, seraient amnistiés nécessairement les individus ayant violemment caillassé, place de la Nation, des camions et des militants de la CGT lors de la manifestation du 1er mai 2021, faisant une vingtaine de blessés selon l’organisation syndicale elle-même.
Sourires sur les travées des groupes SER et CRCE-K.
Je note enfin que cette proposition de loi ne prévoit aucune exception en ce qui concerne la commission d’infractions en lien avec des motifs sexistes, homophobes, racistes ou antisémites.
Par exemple, votre proposition de loi permettrait d’amnistier des auteurs de cris tels que « Mort aux juifs ! », lors de certaines manifestations qui peuvent dégénérer.
Vives protestations sur les travées du groupe CRCE-K.
Vous partez du principe que, dans une manifestation, toutes les infractions qui pourraient être commises de façon périphérique doivent être amnistiées.
Vous n’avez pas réfléchi aux conséquences et aux effets de bord du texte que vous présentez.
Au contraire, madame la sénatrice, je suis en plein dedans !
Je le répète, si nous appliquions votre texte à la lettre, un vol commis dans le cadre d’une manifestation serait amnistié, de même que d’autres débordements.
Je le dis clairement, mesdames, messieurs les sénateurs, pour le Gouvernement, cette situation est d’autant moins acceptable qu’une telle amnistie serait totalement contraire à la politique pénale que je mène.
Dans ma circulaire du 10 octobre dernier relative à la lutte contre les infractions susceptibles d’être commises en lien avec les attaques terroristes subies par Israël depuis le 7 octobre 2023, j’ai demandé aux procureurs de la République de la sévérité contre les actes antisémites et les apologies du terrorisme.
Il en va de même, d’ailleurs, pour des propos racistes, antimusulmans, sexistes ou homophobes qui seraient proférés dans de telles circonstances. Ma position est claire, nette et définitive : l’amnistie ne serait pas alors acceptable.
Votre proposition de loi n’exclut pas non plus les incitations à la haine, à la violence ou à la discrimination envers les forces de l’ordre ou les élus, puisque seuls sont exclus les actes de violence ayant entraîné une interruption temporaire de travail. Vous comprendrez, là encore, que ces dispositions ne sont pas acceptables.
Dans un contexte de radicalisation du débat public et de propagation des discours de haine, il n’apparaît pas opportun d’adopter de telles mesures d’amnistie.
Les victimes d’infractions, et avec eux la grande majorité des Français, attendent que la justice, à laquelle nous avons redonné des moyens inédits – je veux remercier le Sénat, une fois encore, d’y avoir largement contribué par ses votes –, soit rendue en toute indépendance lorsque des infractions sont commises, y compris dans les moments de tension que nous avons pu connaître au cours de ces dernières années.
Oui, en temps de paix et dans une grande démocratie, c’est bien une justice indépendante qui est garante de notre pacte social, pas une loi d’amnistie.
M. Stéphane Le Rudulier applaudit.

Mon intervention se fonde sur l’article 36 de notre règlement.
Monsieur le garde des sceaux, l’initiative parlementaire est un droit. Comme toute initiative, elle est évidemment perfectible.
Il existe un autre droit fondamental, qui est le droit d’amendement.
Si, comme nous, vous avez à cœur de défendre notre République – elle est également, je vous le rappelle, une République sociale aux termes de la Constitution –, si, comme vous le dites, notre proposition de loi soulève, dans sa version initiale, autant d’écueils, et si vous partagez notre volonté de préserver ces corps intermédiaires que sont les organisations syndicales, vous pouvez tout à fait formuler toutes les propositions d’amendements que vous souhaitez.
Au Sénat, nous nous sommes toujours inscrits dans une logique de travail constructif avec l’ensemble de nos collègues comme avec le Gouvernement.
Monsieur le garde des sceaux, dans cet hémicycle, nous n’avons jamais été les porte-parole de telle ou telle organisation syndicale. Je vous invite à régler directement les griefs que vous pourriez avoir avec certaines d’entre elles.
Enfin, monsieur le garde des sceaux, nous ne pouvons accepter deux écueils.
Le premier est l’amalgame qui, in fine, vise à mettre sur le même plan des responsables syndicalistes et celles et ceux qui ont cassé et pillé pendant les manifestations et pendant les émeutes.
Le second est tout aussi insupportable et inacceptable. Il consiste à sous-entendre que les auteurs de cette proposition de loi permettraient, au travers de leur texte, que soient tenus dans notre pays des propos antisémites.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – Mme Mélanie Vogel applaudit également.

Vous le savez, cela ne correspond ni à notre histoire ni à nos valeurs. Il est inacceptable de laisser entendre que telle serait notre intention, de surcroît avec l’aide d’alliés que nous ne connaissons pas et qui ne sont pas les nôtres.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – M. Sébastien Fagnen applaudit également.

Acte est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue.
La parole est à M. le garde des sceaux.
Madame Cukierman, jamais je n’ai dit que vous partagiez ces valeurs.
Je dis simplement que la proposition de loi que vous nous présentez, telle qu’elle est rédigée, permet en réalité d’amnistier toutes les infractions qui sont commises dans le cadre de manifestations.
Convenez que cela puisse poser problème au Gouvernement ! J’ai cité plusieurs exemples. Je ne dis pas que vous êtes du côté des voleurs.
Exclamations sur les travées du groupe CRCE-K.
Si, demain, dans le cadre d’une manifestation, des propos antisémites, sexistes ou homophobes – vous ne les ferez évidemment jamais vôtres, je connais votre histoire – devaient être tenus, alors ils seraient amnistiés.
Vous me permettrez d’affirmer, une fois encore, mon désaccord.

M. le président. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. Jérôme Durain.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte que nous étudions aujourd’hui tend à prévoir l’amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives.
L’amnistie est une tradition ancienne. Héritière de la grâce royale à ses origines, elle fut bien vite appropriée par la République. Victor Hugo disait à son propos qu’elle était « la porte de la clémence ouverte par la force ».
Toutefois, cette tradition ancienne n’est jamais allée de soi. J’en veux pour preuve cette citation d’Hervé Bazin : « L’amnistie est l’expédient des gouvernements faibles ».
Si cette tradition semble morte depuis 2002, elle n’est pas totalement sortie des esprits. Des collègues du groupe Les Républicains la défendent parfois pour de petites infractions routières. Des événements politiques forts pourraient la faire ressusciter.
Les sénateurs communistes s’étaient déjà distingués en déposant, en novembre 2012, une proposition de loi sur le sujet, qui fut examinée par le Sénat en février 2013.
La majorité sénatoriale de l’époque avait d’ailleurs adopté ce texte, soutenu par des personnalités éminentes et peu suspectes de vouloir laisser prospérer la chienlit ! Je pense à MM. François Patriat, Didier Guillaume, Gérard Collomb, Jean-Michel Baylet, Jacques Mézard, à Mme Patricia Schillinger ou encore à MM. François Rebsamen, Thani Mohamed Soilihi et Jean-Noël Guérini…
À l’époque, l’ambition était d’apaiser les tensions sociales qui avaient été identifiées après le quinquennat du président Sarkozy. De nombreux combats syndicaux avaient agité le pays : Continental, les « cinq de Roanne » – cinq syndicalistes de la CGT qui avaient tagué des « Casse-toi, pauv’con ! » sur des murs roannais avant d’être relaxés en 2014 –, ou encore Molex.
Pour jauger la présente initiative parlementaire de nos collègues communistes, il nous faut nous interroger sur le contexte : est-il similaire ?
Si vous me permettez d’utiliser un vocabulaire à connotation monarchique, le règne d’Emmanuel Macron n’a pas été de tout repos sur le plan social. Nous avons tous en tête l’épisode catastrophique des retraites, lors duquel l’exécutif s’est montré sourd à la contestation sociale, tout en laissant s’exercer une lourde répression.
Nous comprenons bien l’objectif de nos camarades du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, qui amorcent une tentative de réanimation de cette tradition : consacrer une « amnistie sociale » aux manifestants ayant participé aux mouvements sociaux de ces dernières années et ayant notamment été interpellés et condamnés pour des faits de violences et de dégradations urbaines voilà quelques mois, lors du passage en force de la réforme des retraites.
Depuis lors, les tensions dans le pays se sont encore accrues. Les liens entre l’exécutif et nos concitoyens n’ont cessé de se distendre. Le recours à la violence comme moyen d’action politique s’est exacerbé.
Nous l’avons constaté au travers de la prolifération du nombre de Black Blocs présents lors des manifestations liées au mouvement des « gilets jaunes », ainsi que pendant la réforme des retraites. Nous l’avons vu aussi dans la détermination grandissante des mouvements écologistes venus contrer les projets de mégabassines à Sainte-Soline.
En réaction, le Gouvernement multiplie les réformes violentes et les lois liberticides. Il nourrit les tensions par des politiques sociales et économiques délétères, doublées d’une stratégie de maintien de l’ordre particulièrement discutable.
Aussi, il peut être légitimement considéré, à certains égards, que les droits des Français – notamment en matière syndicale et de droit à manifester – ont été largement mis à mal au cours des dernières années.
Ces droits sont pourtant constitutionnellement garantis par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que par le préambule de la Constitution de 1946. Ils ne sauraient, de ce fait, être restreints.
Bien évidemment, nous ne considérons aucunement que le droit à manifester est un droit à casser. Nous ne cautionnons nullement les violences, les heurts et les attaques envers les forces de l’ordre ou contre des bâtiments et biens mobiliers, qu’ils soient publics ou privés.
Toutes et tous, sur les travées de cet hémicycle, nous sommes des partisans du maintien de l’ordre public. Ceux qui utilisent aujourd’hui la brutalité comme outil de lutte dévoient les justes combats qui poussent nos concitoyennes et concitoyens à se mobiliser et à sortir dans la rue.
Toutefois, ces faits de violences ne sauraient être pleinement décorrélés de leur contexte. Nous connaissons depuis quelques années un climat particulier, presque inédit.
À la crise économique et sociale est venue s’agréger une crise sanitaire, avec la pandémie de covid-19, suivie d’une guerre meurtrière en Ukraine, aux portes de l’Europe. La recrudescence des conflits à l’échelle planétaire n’est pas non plus de nature à apaiser l’humeur du pays.
Cette atmosphère anxiogène contribue, de fait, à alimenter le ressentiment des Français envers des gouvernants perçus comme impuissants, à court de solutions et incapables d’endiguer ce phénomène.
Hélas, force est de constater que parfois – nous le déplorons –, ce ressentiment se transforme en une violence qui s’est exprimée dans l’espace public au cours des derniers mois.
Je le redis, nul ici ne cautionne ces actes. Dans une société démocratique et moderne, aux mœurs pacifiées, de tels débordements ne sont pas acceptables. Mais alors que notre nation est plus divisée que jamais, nous ne saurions ainsi balayer une main tendue envers des personnes qui, par colère ou par dépit, ont pu participer récemment à certains débordements.
Aussi, il semble nécessaire de noter que ce texte ne concerne que les personnes ayant commis des actes réprimés par le code pénal et pour lesquels la peine encourue n’excède pas dix ans d’emprisonnement.

Par ailleurs, il n’exonère aucunement les personnes susceptibles de bénéficier de cette amnistie des réparations ayant trait à des condamnations relevant du droit civil.
Il nous semble important de préciser que les communes et établissements pourront ainsi toujours bénéficier de la réparation du préjudice subi lors d’un mouvement social.
Il nous semble également important de rappeler qu’un amalgame a parfois été de mise entre des casseurs et des manifestants de bonne foi.
Nous le rappelons avec force : l’intimidation, la criminalisation et la discrimination des militants syndicaux, associatifs et politiques ne sont pas dignes de notre État de droit.
Monsieur le rapporteur, nous avons entendu les critiques que vous avez formulées en commission. Vous estimiez notamment que le périmètre de l’article 1er de cette proposition de loi était bien trop large, tant sur le plan temporel que dans son champ d’application.
Nous prenons acte de cette appréciation, sans toutefois souscrire pleinement à ces arguments. Nous notons que la loi de 2013 nous semble plus précise et bornée que celle qui nous est soumise aujourd’hui.
J’ai même des interrogations sur la portée de ce texte en matière de droits des migrants. Des militants d’extrême droite ne pourraient-ils pas en bénéficier ?
Mes chers collègues, le droit d’amnistie n’a plus été utilisé depuis 2002. Est-il indispensable à l’unité du pays ? Il pourrait être utile, mais n’apaiserait pas les tensions d’un coup de baguette magique.
Les sénateurs socialistes estiment que cette proposition de loi aura au moins le mérite de mettre en exergue le fossé qui s’est creusé entre les Français et l’exécutif, ainsi que le besoin vital d’apaisement au sein de notre population.
Considérant que le texte fait peser quelques risques juridiques, que la navette parlementaire pourrait toutefois lever, nous nous dirigerons vers une abstention bienveillante.
Applaudissements sur les travées du groupe SER. – M. Pierre Barros applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi déposée par nos collègues communistes soulève une question de fond : le législateur peut-il s’arroger le droit d’amnistier des délits commis dans le cadre de mouvements sociaux ?
Certes, le constituant de 1946 a reconnu le droit de grève comme un droit fondamental, mais ce principe doit toujours être articulé avec d’autres principes généraux de notre droit, ceux qui garantissent, par exemple, l’ordre public, nécessaire pour assurer la quiétude de chacun.
Comme l’a si justement souligné notre rapporteur, Jean-Michel Arnaud, la définition des faits concernés par l’amnistie, telle qu’elle est formulée dans cette proposition de loi, semble beaucoup trop large et évasive, tandis que les exceptions prévues sont rendues quasiment inapplicables par la règle elle-même.
En outre, l’adoption de cette proposition de loi entraînerait des effets qui vont bien au-delà de ceux que voulaient originellement obtenir ses auteurs.
Commençons par évacuer tout malentendu. Si l’exercice du droit de grève, du droit syndical ou encore du droit de manifester a pu entraîner des poursuites abusives, des mesures disciplinaires excessives ou des licenciements injustifiés, ces derniers doivent évidemment être contestés devant les juridictions compétentes. Si nous considérons que ces voies de recours sont insuffisantes, voire défaillantes, envisageons de légiférer pour les améliorer. Toutefois, ces dérives, aussi condamnables soient-elles, ne peuvent en aucun cas justifier une énième loi d’amnistie. Celle-ci n’apporterait aucune solution : elle serait non seulement inutile, mais aussi inappropriée.
Comme le disait si justement l’honorable juge Diplock, on doit éviter d’user « d’un marteau-pilon pour casser une noix, si le casse-noix suffit ».
Loin de moi l’idée de remettre en cause le rang constitutionnel du droit de manifester, des droits syndicaux et du droit de grève, mais leur exercice doit s’équilibrer avec le respect de l’ordre public. De ces droits ne peut découler le chaos ou une contestation effrénée. L’étendue du champ de cette proposition de loi pourrait être perçue comme une offense à la plus grande majorité de nos concitoyens, qui sont tout à fait capables de manifester leur mécontentement sans débordements, heurts ou violences.
Ainsi, ni la manifestation ni la grève ne sont condamnables en soi ; en revanche, leurs excès le sont lorsqu’ils troublent l’ordre public.
Par ailleurs, si l’objectif de cette proposition de loi est de ramener le syndicalisme à son âge d’or, en le rendant plus attrayant par une promesse d’immunité – voire d’impunité –, je pense fondamentalement que l’on fait fausse route, car la réalité est tout autre.
Le contexte actuel que connaît notre pays appelle au contraire à un surcroît de responsabilisation de nos représentants syndicaux ou des porte-voix de mouvements revendicatifs. J’espère, pour ma part, que le monde syndical restera un acteur responsable, qui préférera toujours le dialogue à l’entêtement et au désordre.
D’un point de vue purement philosophique, l’amnistie est un geste de pardon, plus largement de reconstitution de la concorde sociale, voire de pacification des mémoires. Le pardon des pouvoirs publics, comme l’histoire sociale le montre, intervient généralement quand l’ordre public a failli. Or je ne crois pas que la France en soit arrivée à un tel point.
En tout état de cause, l’amnistie ne peut être associée à une autorisation accordée à la violence ou à des débordements de toutes sortes. Je pense très sincèrement que l’adoption de ce texte constituerait un bien mauvais signal adressé à l’ensemble de nos concitoyens : ils pourraient ainsi se demander pourquoi ils devraient respecter la loi si, dorénavant, nous cédons, ne serait-ce que de manière ponctuelle, à la tentation de l’amnistie.
L’amnistie, c’est aussi la négation même de la compétence du législateur. On nous demande en effet de voter un texte qui méconnaîtrait l’application de la législation déjà en vigueur.
C’est, en outre, la remise en cause du principe d’égalité des citoyens devant la loi. Pourquoi, en effet, respecter les principes fondamentaux de notre ordre public, si aucune conséquence légale n’y est associée ?
De plus, comme cela a été souligné, cette proposition de loi remet en question le rôle du juge, voire l’articulation des pouvoirs entre l’autorité judiciaire, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Force est de constater que les lois d’amnistie perturbent la lisibilité de cet équilibre institutionnel.
Enfin, et pour conclure, la potentielle dérive autoritaire dénoncée par les auteurs de cette proposition de loi ne saurait avoir comme réponse une dérive judiciaire. Il s’agirait là d’une schizophrénie juridique, qui consisterait à condamner d’une main, en droit commun, des faits répréhensibles, et à amnistier de l’autre ces mêmes faits dans certaines circonstances, par le biais d’une loi d’exception. La Haute Assemblée, qui a toujours été au rendez-vous pour prendre ses propres responsabilités, ne peut accepter cela !
Ni les conditions de fond ni les conditions de forme ne sont donc réunies pour l’adoption d’un tel texte. Vous l’aurez compris, mes chers collègues, les sénateurs du groupe Les Républicains sont par principe hostiles à toute loi d’amnistie de cette nature, et c’est la raison pour laquelle ils voteront contre cette proposition de loi.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la grave détérioration des conditions de vie de nos compatriotes a fatalement conduit à une explosion de la contestation sociale.
La colère gronde jusque dans les classes moyennes, dont on a trop longtemps cru qu’elles étaient préservées. Dans notre société, les tensions s’aggravent et la stratégie de division du peuple français opérée par Emmanuel Macron accentue encore cette tendance.
Dernièrement, le recul de l’âge de départ à la retraite a été la cause légitime de grandes manifestations : des Français de tous horizons politiques et de toutes origines sociales ont défilé côte à côte. Malheureusement, des violences ont systématiquement été commises, non par des manifestants, mais par des personnes issues de mouvements radicaux ou anarchistes venues profiter de l’occasion. C’est la raison pour laquelle cette proposition de loi me paraît dangereuse : non seulement son adoption consacrerait le sentiment d’impunité, mais, pis encore, elle légitimerait les violences commises.
Mes chers collègues, les violences nuisent aux contestations sociales depuis dix ans. Elles ont nui notamment aux manifestations contre la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite loi El Khomri, aux revendications des « gilets jaunes » et au juste et indispensable combat contre la réforme des retraites. Plus généralement, elles ont desservi tous les combats légitimes.
Plus récemment, la mort de Nahel a tristement prouvé que tout événement, si douloureux et regrettable soit-il – je ne reviens pas sur les circonstances de cette affaire particulière –, peut toujours servir de prétexte à un déferlement de violence. J’en veux pour preuve le rapport rendu conjointement par l’inspection générale de l’administration (IGA) et l’inspection générale de la justice (IGJ), dans lequel sont analysés les « profils et motivations des délinquants interpellés à l’occasion de l’épisode de violences urbaines » : il montre que l’émotion causée par la mort de cet adolescent a joué un rôle très mineur dans les motivations des pillards.
Si cette proposition de loi était adoptée, il suffirait dès lors de se revendiquer d’une cause sociale pour pouvoir se livrer à des actes de violences et de vandalisme en toute impunité.
Il convient toutefois de ne pas oublier que, derrière les auteurs de tels actes, il y a surtout des victimes, dont le préjudice doit être reconnu et réparé.
Derrière le casseur qui se revendique opportunément de telle ou telle cause, il y a un ouvrier privé de sa voiture, un artisan privé de ses locaux, un commerçant privé de son outil de travail et de ses biens. Leur cause sera toujours plus forte et plus juste que celle du délinquant ou du vandale !
Oui, je vous l’accorde, la gestion de notre pays par Emmanuel Macron est aussi horripilante sur la forme que désespérante sur le fond, mais rien ne saurait légitimer que l’on commette des actes de violence et de pillage.
Mes chers collègues, je parle ici non pas uniquement en tant que membre de la représentation nationale, mais aussi au nom de tous ceux qui comme moi, fils d’ouvrier syndiqué, petit-fils et arrière-petit-fils de mineur, ne veulent plus voir des luttes sociales légitimes décrédibilisées et pourries par la violence minoritaire de ceux qui n’y voient qu’un prétexte pour semer le trouble.
S’il faut rappeler que le droit de manifester est constitutionnel, il ne faut pas en faire un droit à l’insurrection.
Il y a des profiteurs de crises financières comme il y a des profiteurs de crises sociales : de grâce, combattons-les tous !
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre pays a connu des mouvements de contestation majeurs au cours de l’année 2023. Heureusement, tous n’ont pas donné lieu à des débordements. Certains, en revanche, ont dégénéré en des actes de violence d’une rare intensité.
Nous avons récemment assisté à des scènes de chaos, qui ont profondément choqué nos concitoyens. Des drames ont été évités de justesse, grâce au professionnalisme des forces de l’ordre, auxquelles mon groupe veut rendre hommage.
Quoi de plus légitime que de manifester son opposition aux textes que nous votons ? Quoi de plus inacceptable que de le faire en s’affranchissant du cadre républicain ?
Des centaines de membres des forces de l’ordre ont été blessés lors de différentes manifestations où ont été commis des dégradations, des incendies volontaires, etc. : autant d’actes qui font peser un risque majeur sur la sécurité de nos concitoyens.
Les mêmes scènes de chaos se sont reproduites lors de la mise en place de retenues d’eau, les fameuses mégabassines. Là encore, il est légitime que les oppositions s’expriment. Il paraît néanmoins important de rappeler que ces projets ont été décidés par des instances démocratiques et qu’ils sont susceptibles de recours devant des tribunaux indépendants et impartiaux. Nous sommes en démocratie, ne l’oublions pas. Les manifestations que nous avons vues à ces occasions étaient, en revanche, d’une autre nature. Des individus fanatiques, armés de battes de baseball, de barres de fer, de boules de pétanque et de cocktails Molotov, étaient là pour casser, que ce soit de la bassine ou du flic : nous ne pouvons pas l’accepter.
Les sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky nous proposent d’exempter de condamnations tous ceux qui se sont rendus coupables de délits au cours de mouvements collectifs revendicatifs.
Au-delà de l’imprécision extrême du périmètre visé, comment accepter une telle négation du droit ? Comment imaginer que le déroulement de mouvements collectifs revendicatifs puisse constituer une circonstance de nature à exonérer les délinquants de toute poursuite et de toute condamnation ?
Si le droit de grève et son exercice doivent être protégés, ce droit ne s’étend pas à la commission d’infractions. Même si celles-ci se déroulent lors de mouvements revendicatifs, elles demeurent néfastes pour la société et nos concitoyens.
La circonstance de mouvements collectifs revendicatifs devrait être considérée comme aggravante plutôt que comme atténuante. En effet, la commission des infractions est facilitée lors d’attroupements et leurs conséquences peuvent être bien plus sérieuses qu’en d’autres occasions.
Il arrive par ailleurs que des manifestations constituent en elles-mêmes des infractions, si elles ont été interdites par l’autorité investie des pouvoirs de police qui a estimé qu’il y avait un risque de trouble à l’ordre public. La présence d’écharpes tricolores à certaines de ces manifestations nous a consternés : des élus ont encouragé nos concitoyens à ne pas respecter la loi. Ils ont été la caution paradoxale d’actes de violence antidémocratiques.
Celles et ceux qui encouragent la violation des lois n’ont pas leur place dans les chambres où ces lois sont votées.
Nous considérons que la défense des droits et des libertés des individus doit s’exercer dans les urnes, plutôt que dans la rue. La loi est faite par les représentants de la Nation, il est essentiel qu’elle s’applique à tous.
« Ce qui préserve de l’arbitraire, c’est l’observance des formes », disait avec sagesse Benjamin Constant. La contestation dans notre pays ne peut pas s’affranchir des formes sans porter atteinte à la démocratie.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires s’oppose donc aux dispositions de ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.
Applaudissements sur les travées du groupe UC .

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j’ai fait mon droit dans une autre vie, sous la houlette de Jean-Jacques Dupeyroux, avec Maurice Cohen comme professeur du droit des comités d’entreprise.
J’ai aussi suivi de très près l’avancée, à l’Assemblée nationale, des lois Auroux, qui, rappelons-le, ont établi un peu d’équilibre dans le droit syndical à l’intérieur de l’entreprise. Je me souviens très bien, à l’époque, des syndicats jaunes, des chiens des vigiles que leurs maîtres laissaient aller sur les piquets de grève, de la tentative d’instaurer le vote plural aux prud’hommes, tentative qu’un jeune député de talent, Alain Richard, a d’ailleurs fait censurer par le Conseil constitutionnel – je rappelle que cette mesure « sympathique » permettait aux employeurs de voter plusieurs fois, quand les salariés ne pouvaient voter qu’une seule fois…
Autrement dit, je connais un peu le droit du travail et le droit syndical. Le doyen Badinter pointait que les notables vieillissants parlaient d’eux dans leurs discours. Voilà que cela m’arrive à moi aussi…
Sourires.

Mes chers collègues, on imagine difficilement une société libre et ouverte dans laquelle le droit de manifester son mécontentement serait systématiquement entravé par des mesures coercitives. C’est dans cette faculté que réside la différence entre une démocratie et une dictature – je crois que nous pouvons tous nous accorder sur ce constat.
Le constituant de 1946 a reconnu le droit de grève, mais non le droit à la violence. L’exercice du droit de grève et celui de manifester, qui l’accompagne, doit s’articuler avec les autres principes généraux du droit, qui garantissent le nécessaire ordre public, afin d’assurer la quiétude et la sécurité de chacun.
La proposition de loi qui nous est soumise pourra paraître séduisante à certains, si l’on pense aux faits qui ont pu accompagner la réforme des retraites et le mouvement des « gilets jaunes », il y a quelques années. Nous ferions ainsi table rase du passé et le Parlement accorderait une forme de pardon généralisé.
Or le pardon ne peut pas viser des agissements contraires à l’ordre républicain. Certaines infractions ne peuvent en aucun cas figurer dans une loi d’amnistie. Certes, le texte exclut de l’amnistie les violences commises contre les personnes dépositaires de l’autorité publique, mais il reste muet sur les autres violences et sur les dégradations des biens, dont il faut d’ailleurs déplorer la très forte progression ces dernières années.
L’amnistie est un geste de pardon, de reconstitution de la concorde sociale et de pacification des mémoires. Elle ne saurait être une autorisation généralisée accordée aux débordements de toutes sortes.
De plus, je pense sincèrement que l’adoption de cette proposition de loi constituerait un signal de bien mauvais augure adressé à tous les manifestants.
M. le garde des sceaux acquiesce.

Nul ne peut nier, en effet, que le principe même d’une loi d’amnistie créerait un appel d’air. Pourquoi respecter la loi si les contrevenants ne subissent aucune conséquence juridique de leurs actes ?
C’est pourquoi le principe d’égalité des citoyens devant la loi doit s’appliquer, de même que les principes fondamentaux relatifs au respect de l’ordre public.
En dépit du travail et des efforts des membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, aucun consensus ne se dégage au sein du Parlement sur une telle proposition de loi : ni les conditions de fond ni celles de forme ne sont en effet réunies pour son adoption, d’autant que certains événements ont fait des victimes et entraîné beaucoup de dégâts, sans parler des manques à gagner de petits commerçants, des voitures brûlées, etc.
Si l’on peut comprendre, voire partager, la colère sociale, son expression doit rester dans le cadre des lois de la République. Tel n’est pas le cas lorsque l’on commet des infractions passibles de dix ans d’emprisonnement.
Comme nous l’a rappelé notre rapporteur, Jean-Michel Arnaud, dont je tiens à saluer le travail, la commission des lois est défavorable à l’adoption de ce texte.
Vous l’aurez compris, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées des groupes UC, RDSE et INDEP, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains. – M. Olivier Bitz applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je remercie le groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky d’avoir inscrit ce texte à l’ordre du jour des travaux du Sénat. L’examen de cette proposition de loi intervient en effet à un instant tout particulier pour notre démocratie.
Alors que le Gouvernement se montre toujours plus incapable de répondre aux crises, alors que les élus et les pouvoirs publics échouent à remplir leurs missions premières – protéger l’intérêt général, garantir à chacune et à chacun de manger à sa faim, de se loger, de vivre de son travail, de se reposer, d’avoir les mêmes droits que ses voisins, de ne pas craindre les discriminations, d’envisager un avenir commun sur une planète vivable –, ce sont bien souvent les manifestants, les syndicalistes, les militants, les mouvements sociaux qui sont attaqués. Ils le sont plus que les pollueurs, les évadés fiscaux, les exploiteurs, les racistes et les sexistes.
L’État a failli et ce sont ses enfants qui trinquent. Ils trinquent d’ailleurs deux fois : en payant le prix de ses mauvais choix politiques et en payant celui de les contester.
Évoquons tout d’abord le prix des mauvais choix politiques de l’État. Je pense, par exemple, aux questions climatiques. Selon les dernières données publiées le 3 octobre dernier, nous pouvons affirmer que la trajectoire actuelle des émissions de gaz à effet de serre de la France nous conduira à violer nos propres engagements internationaux, européens et nationaux. Pendant ce temps, le Gouvernement s’entête à poursuivre un projet climaticide et injuste, vieux de trente ans, la réalisation de l’autoroute A69.
De même, malgré la promesse présidentielle de 2017, le Gouvernement ne demande plus l’interdiction du glyphosate à l’échelon européen. Je rappelle que ce produit est un herbicide « total », qui tue tous les végétaux, sans distinction, sauf ceux qui sont génétiquement modifiés pour lui résister, et que ses effets sur la santé humaine, mais aussi sur notre modèle agricole, ne sont plus à démontrer.
Dans le même temps, le Gouvernement est incapable de répondre à l’urgence sociale, encore accentuée par l’inflation. Un huitième de la population française ne mange pas à sa faim ; un tiers des étudiants sautent des repas. Alors que la France compte plus de 9 millions de pauvres, les 500 Françaises et Français les plus riches ont vu leur fortune croître de 5 % l’année dernière.
Rien ne saurait justifier une telle aggravation des inégalités et rien ne peut étouffer la colère qu’elle nourrit.
C’est la raison pour laquelle les citoyennes et les citoyens se mobilisent et grossissent les rangs des mouvements sociaux – nous étions ainsi des millions dans la rue pour combattre la réforme des retraites. C’est pourquoi des militants passent leurs week-ends à essayer de protéger la nature, les arbres, l’eau, que ce soit à Sainte-Soline, dans le Tarn ou encore à Notre-Dame-des-Landes.
J’en viens maintenant au prix de la contestation, puisque tel est le sujet de notre discussion.
Au lieu d’être entendus, au minimum respectés, les mouvements sociaux sont criminalisés. Cette criminalisation a atteint son apogée au moment de la contestation massive contre la réforme des retraites : des passants, qui ne manifestaient même pas, se sont retrouvés au poste de police parce qu’ils sortaient d’un restaurant au mauvais moment.
Pour la première fois depuis un demi-siècle, un dirigeant syndical national, qui n’avait aucun lien direct avec les faits reprochés, a été convoqué par la gendarmerie. Dans trois semaines, trois syndicalistes comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Bordeaux. Selon la CGT, quelque 600 travailleurs et travailleuses seraient ainsi ciblés par des procédures disciplinaires à la suite des mobilisations contre la réforme des retraites.
De manière similaire, des militants écologistes sont criminalisés, parce qu’ils s’opposent à cette aberration écologique que constituent les mégabassines. Ils se battent pour notre accès commun à l’eau, non pour se faire plaisir : nous aimerions, toutes et tous, passer des week-ends de détente entre amis et n’avoir jamais à choisir entre la décision de prendre le risque de se retrouver dans le coma et la perspective de voir nos biens communs confisqués.
Toutefois, le schéma et la doctrine de maintien de l’ordre en France, alors que la répression s’intensifie de manière constante et systémique, rendent l’action de manifester et de militer de plus en plus difficile. Ce n’est pas le fruit du hasard.
L’immense majorité des personnes arrêtées ne font d’ailleurs pas partie des individus violents, dont nous condamnons, bien sûr, les méthodes.
Cette situation est grave, non seulement parce que la cause des manifestants est juste, mais aussi parce que la démocratie meurt si elle cherche à criminaliser les opposants au pouvoir. C’est le propre d’un gouvernement démocratique, sa condition existentielle, sa définition même, que de permettre, et plus encore, d’organiser et de protéger la contestation, le débat, les luttes politiques, y compris contre lui. Il lui revient de garantir la liberté d’expression à celles et à ceux dont il déteste les idées.
C’est donc pour rétablir la confiance en la vitalité de notre démocratie que le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires soutient les objectifs de cette proposition de loi. Nous avons entendu, bien sûr, les remarques formulées par le garde des sceaux : le calibrage du dispositif est sans doute trop large. Nous faisons donc confiance au Gouvernement et à nos collègues de l’Assemblée nationale pour amender ce texte. En tout cas, le signal politique envoyé à nos concitoyens sera bien meilleur si cette proposition de loi est adoptée que si elle est rejetée.
Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées du groupe CRCE-K.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, j’évoquerai tout d’abord des faits qui se sont produits il y a plus de soixante-dix ans. Ils font partie de l’Histoire, de notre histoire : je pense à la grande grève des mineurs de 1948 à laquelle des milliers d’entre eux ont participé. Plusieurs centaines de syndicalistes, essentiellement issus du Nord et du Pas-de-Calais, ont alors été licenciés, condamnés à des amendes ou à des peines de prison, y compris ceux qui avaient été résistants à l’occupant nazi sept ans plus tôt. Voilà autant de vies brisées, d’hommes et de familles victimes d’une parodie de justice qui ne leur a laissé aucune chance de se défendre. Leur combat a duré plusieurs années. Ils ont finalement été réhabilités par Mme Taubira, lorsqu’elle était garde des sceaux. Parmi eux, je citerai Norbert Gilmez, syndicaliste de la CGT, qui a été victime d’une injustice profonde. Jusqu’à la fin de sa vie, il aura répété : « J’étais syndicaliste, pas délinquant. »
Mes chers collègues, voici résumée en une phrase notre proposition de loi : ils sont syndicalistes, pas délinquants.
Ils s’appellent Sébastien Menesplier et Mathieu Pineau de la fédération nationale des mines et de l’énergie de la CGT, Sophie Bournazel de l’entreprise People & Baby – je pourrais aussi citer trois autres salariés de cette entreprise –, Nicolas Constantin, délégué d’un entrepôt logistique du Pontet…
Ils sont syndicalistes chez VertBaudet : dans cette entreprise du Nord, quatre-vingts femmes payées au Smic ont décidé de se mettre en grève pour obtenir des augmentations. La direction a fait intervenir la force publique à de nombreuses reprises ; des salariées ont été blessées et certaines ont été envoyées à l’hôpital ; les plaintes en justice se sont succédé.
Des syndicalistes de la fédération du commerce, ayant donc pourtant toute légitimité pour intervenir dans ce conflit, ont été interpellés chez eux, au petit matin, devant leur famille. La répression s’est tellement généralisée qu’un syndicaliste, Mohammed, a été interpellé par de faux policiers, qui l’ont gazé, roué de coups, puis jeté d’une voiture en marche après lui avoir dérobé ses papiers. Dans le même temps, la direction continuait d’assigner ses salariées en justice : elle en a les moyens et le temps !
Je pourrais citer plusieurs centaines de syndicalistes victimes de procédures, de convocations, d’amendes, de mises en examen, de mesures disciplinaires.
Cette proposition de loi portant amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives vise à leur rendre justice, conformément à l’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, selon lequel « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Or, aujourd’hui, nous assistons souvent à des actes relevant de l’acharnement, parfois individuel, à des arrestations arbitraires, qui conduisent à des procédures pénales.
Comme si la répression patronale ne suffisait plus à maintenir le système, le Gouvernement y ajoute, monsieur le garde des sceaux, la répression d’État en utilisant l’appareil judiciaire. La démocratie sociale et la liberté syndicale semblent un obstacle pour votre gouvernement.
Cette répression s’est d’ailleurs amplifiée avec la réforme des retraites où la violence des procédures arbitraires à l’encontre des syndicalistes a donné lieu à une tribune parue dans la presse au mois de juin dernier intitulée : « Pour les libertés syndicales contre toutes les entraves à l’engagement militant et citoyen ! » Celle-ci a été signée par plusieurs centaines de militants syndicaux, associatifs, de nombreux intellectuels, chercheurs, enseignants et universitaires.
Au-delà de la pression judiciaire opposée aux syndicalistes se pose aussi la question des entraves tout au long de la carrière : blocage de l’évolution professionnelle, perte de promotions et de revenus.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez fait l’amalgame entre les faits commis à l’occasion d’une mobilisation syndicale et les violences urbaines et les actes antisémites. Ce n’est pas acceptable ! Ces faits n’ont aucun rapport avec les manifestations syndicales ni avec ceux qui sont visés par notre proposition de loi – vous le savez d’ailleurs très bien. §Il ne s’agit pas, pour nous, de ne pas sanctionner les casseurs, les Black Blocs, qui ont durement attaqué les syndicalistes dans les manifestations.
Comme vous l’avez rappelé en préambule, l’amnistie ne signifie pas l’absence de sanctions judiciaires. Ce texte vise uniquement à annuler les sanctions commises lors de mouvements sociaux.
M. le garde des sceaux proteste.

Votre condamnation de l’idée d’amnistie est étonnante, alors que vous-même, le 17 mai 2020, avez répondu à un journaliste d’Europe 1 : « J’aurais souhaité que le Président de la République renoue avec la tradition régalienne de la grâce présidentielle ou de la loi d’amnistie. »
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre histoire a produit plusieurs lois d’amnistie, dès 1791, après mai 68, après la guerre d’Algérie, après les événements en Nouvelle-Calédonie. Il faut le répéter : celles-ci ont vocation à demeurer exceptionnelles.
Or la proposition de loi que nous examinons prévoit des dispositions particulièrement larges, en fonction des circonstances. Son adoption n’aurait pas pour conséquence, je le crains, de contribuer à l’apaisement social, mais elle pourrait être facilement interprétée comme l’instauration d’un droit à la violence et à la commission de délits dans toute manifestation sociale.
Devons-nous prendre ce risque ? Est-ce là un modèle que nous souhaitons promouvoir ?
Le champ de l’amnistie prévue par l’article 1er est lui aussi très large, puisque peuvent être amnistiées les personnes morales et physiques pour des infractions commises « avant la promulgation de la présente loi ».
J’ai le plus grand respect pour celles et pour ceux qui, par leur action syndicale, associative et politique, ont fait notre pays et continueront de défendre des acquis sociaux pour le bénéfice de tous.
À l’épreuve des faits, cette amnistie serait-elle pour autant juste en toutes circonstances ? Faut-il essentialiser tous les mouvements et acteurs sociaux ? Prenons le cas de l’un des derniers mouvements sociaux connus. Peut-on dire que seul l’intérêt général ait animé les émeutes des mois de juin et juillet derniers ? Si une émotion sincère a entraîné son déclenchement, après des soirs d’émeute, il en est finalement resté la destruction et la souffrance sociale dans des villes et quartiers sans écoles, transports, magasins, services publics.
Pourtant, cette loi d’amnistie pourrait s’appliquer à ces événements, dévoyant la nature même des opinions légitimement défendues, dévoyant sans doute aussi vos propres intentions originelles, mes chers collègues.
Je crains par ailleurs que certains ne se drapent a posteriori dans un intérêt général soudainement révélé pour échapper à leurs responsabilités dans une approche bien individualiste, ce qui serait un comble et deviendrait préjudiciable à l’ensemble des forces associatives et syndicales de notre pays.
Je note que la proposition de loi contient quelques restrictions opportunes, comme celles qui visent les élus. Je doute cependant que celles-ci puissent suffire.
Il me paraît important d’évoquer les victimes et la réparation des dégâts. Il est prévu que, même en cas d’amnistie, les victimes conservent le droit de faire reconnaître le préjudice subi et d’en obtenir réparation. Y a-t-il vraiment réparation si l’on sait que l’infraction ne pourra plus donner lieu à des poursuites ou, si une condamnation est déjà intervenue, qu’un terme sera immédiatement apporté à son exécution ? Nous sommes en droit de nous poser la question.
Mes chers collègues, nous avons plus que jamais besoin que chacun reprenne sa place, que les juges et avocats puissent agir en toute conscience, que les acteurs sociaux et associatifs puissent négocier et agir dans la concertation, manifester quand il le faut et que les actions délictuelles puissent être jugées séparément, avec le plus grand discernement possible.
Pour cette raison, mes chers collègues, je ne crois pas que l’amnistie constitue un outil approprié. Vous l’avez compris, le groupe RDSE votera contre cette proposition de loi.
Applaudissements sur les travées du groupe RDSE.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous voilà rassemblés pour examiner la proposition de loi déposée par Mme la sénatrice Cathy Apourceau-Poly et plusieurs membres du groupe CRCE-K, dont l’objet est de prévoir l’amnistie de faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et revendicatives.
Dans le contexte de « polycrise » que nous traversons, les Français sont en proie à de nombreuses inquiétudes, que celles-ci concernent l’emploi, le pouvoir d’achat, leur capacité d’accès aux soins ou encore, plus largement, leur avenir dans une société frappée par le réchauffement climatique. Les élus que nous sommes ne peuvent pas y être insensibles.
Ces inquiétudes ont pu s’exprimer encore récemment dans la rue, à l’occasion de mouvements sociaux et syndicaux.
Si ces mouvements constituent la mise en œuvre concrète de libertés et de droits qui nous sont chers et qui sont garantis par notre bloc de constitutionnalité, comme la liberté syndicale ou le droit de grève, ces mouvements ont aussi été l’occasion pour certains de commettre des actes violents, punis par la loi.
L’idée qui sous-tend ce texte est qu’il y aurait derrière la répression de ces actes une intention de restreindre l’exercice de ces libertés, ce qui constitue un risque pour notre État de droit. Il faudrait donc, pour protéger celles-ci, pardonner les auteurs de faits commis au nom d’un intérêt supérieur, dont l’appréciation est somme toute subjective – comme si la défense de l’intérêt général devait inévitablement conduire à commettre une infraction ou un délit.
Au groupe RDPI, nous tenons à réaffirmer notre attachement à la liberté syndicale et notre plus grand respect pour la mobilisation sociale.
Toutefois, si l’action collective constitue un rouage essentiel de la démocratie, nous considérons que la justice, l’ordre public et l’efficacité de la réponse pénale sont tout aussi importants pour le bon fonctionnement d’une démocratie.
La mise en œuvre par le législateur du pardon républicain, notamment à des fins de rétablissement de la concorde sociale, pourrait, ici, avoir un effet inverse et, au contraire, fracturer un peu plus notre société. Elle heurterait le principe d’égalité devant la loi, auquel les Français sont tout aussi attachés.
Par ailleurs, eu égard au caractère hautement sensible des conséquences qu’implique une telle loi, il est impératif que son champ d’application soit clairement déterminé et le plus restrictif possible. Or, comme cela a été mis en lumière lors de nos discussions en commission, le champ de l’amnistie prévue par ce texte est particulièrement large. En visant les délits survenus « à l’occasion » de conflits sociaux, de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, l’amnistie pourrait concerner des personnes ayant rejoint ces mouvements dans l’intention même de commettre des délits.
C’est absolument inacceptable à nos yeux.
La plus grande fermeté doit s’appliquer à l’encontre de ceux qui, délibérément, n’ont pas hésité à faire usage de la violence, quand bien même celle-ci ne serait dirigée que contre des biens. Il est du rôle, voire du devoir du législateur d’affirmer haut et fort que toute violence est contraire à l’ordre républicain.
Si un texte visant un objet similaire émanant du même groupe parlementaire a pu être adopté en 2013, il faut souligner que le texte présenté aujourd’hui est bien plus généreux. En effet sont visés les délits passibles de moins de dix ans d’emprisonnement, contre cinq ans dans le précédent texte. En outre, toutes les infractions entrant dans le cadre prévu et commises avant la promulgation de la loi seraient susceptibles d’être amnistiées, alors que le texte de 2013 délimitait précisément dans le temps les infractions entrant dans le champ de l’amnistie.
Plus largement, il faut reconnaître que l’acceptabilité de telles lois par l’opinion est aujourd’hui plutôt discutable. Elles pourraient en effet résonner chez nos concitoyens comme un encouragement aux formes les plus violentes de mobilisation, alors que c’est au renforcement du dialogue social et à la définition des bases d’un nouveau contrat social qu’il faudrait travailler.
En conclusion, si nous reconnaissons la nécessité de protéger les droits fondamentaux, nous estimons cependant que cette proposition, telle qu’elle est formulée, soulève des inquiétudes majeures de nature à porter préjudice à la cohésion nationale. Pour ces raisons, les membres du groupe RDPI se prononceront contre ce texte.
Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – Mme Maryse Carrère applaudit également.
Je reprends la parole pour rectifier certains propos prononcés par Mme Apourceau-Poly.
Madame la sénatrice, j’ai lu votre tweet m’accusant de faire des amalgames. Non, ce n’est pas le cas !
Ma position exprime le droit, et c’est bien naturel.
J’ai parfaitement compris l’objet de cette proposition de loi, mais j’en dénonce les effets de bord, que vous n’avez, à mon sens, pas bien mesurés.
Je reprends votre texte, sous votre contrôle.
« L’amnistie prévue à la présente loi s’applique aux personnes physiques… » Voilà qui ne donne pas matière à contestation.
« Sont amnistiés de droit […] les délits passibles de moins de dix ans d’emprisonnement… » Permettez-moi de vous faire remarquer au passage que vous ne trouverez pas dans l’histoire d’amnisties aussi larges, mais peu importe. Cela n’est pas l’objet de notre débat.
« À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux… » Ainsi, si, dans le cadre d’une manifestation, un manifestant brûle un véhicule, il sera amnistié. Voilà ce que, nécessairement, expressément, et non pas implicitement, cela signifie !
Je suis bien évidemment pour le droit de manifester, qui est consacré par la Constitution, mais certains tordus profiteront de votre texte pour commettre des exactions. Si, un samedi après-midi, je participe à une manifestation en exprimant un certain nombre de revendications et que je dévalise un magasin de prêt-à-porter, je bénéficierai de l’amnistie prévue par cette proposition de loi, parce qu’un tel délit est passible de moins de dix ans d’emprisonnement et qu’il est commis dans le cadre d’une manifestation. Telle est la réalité de votre texte et vous comprenez bien que je ne peux y être favorable.
Puisque vous parlez d’amalgame, je reviens à des déclarations que vous avez reprises et que j’ai faites lorsque j’étais avocat et pas encore ministre. De grâce, resituez ces propos dans le contexte de l’époque, qui était celui du covid-19. J’étais alors convaincu qu’il fallait éviter des contaminations dans le mode clos qu’est la prison en envisageant soit des grâces, soit des amnisties, pour des raisons de santé et de salubrité publiques. C’est d’ailleurs ce qu’a fait Nicole Belloubet.
Pour ne rien vous cacher, sur la question de la surpopulation carcérale, j’ai moi-même défendu un texte, que le Sénat a voté, prévoyant des libérations sous contrainte pour que, lorsqu’il reste un reliquat de l’ordre de trois mois et que le détenu peut bénéficier d’un logement à l’extérieur, on puisse de droit envisager sa libération pour éviter une sortie sèche.
Je ne suis pas en contradiction avec moi-même, puisque les circonstances sont totalement différentes.
Je persiste à croire que Nicole Belloubet a eu raison d’agir comme elle l’a fait et de prendre ces mesures qui relevaient du domaine réglementaire, puisque prévalait alors l’état d’urgence sanitaire. Cependant, madame la sénatrice, ce que j’ai dit n’aurait en aucune façon permis à des voyous d’échapper à la répression et à l’opprobre social qui doivent s’ensuivre.
Je le répète, j’ai bien compris l’objet de votre texte, mais il est présenté de telle façon qu’il entraîne des effets de bord qui n’ont pas été mesurés. Aussi, comme beaucoup de ceux qui se sont exprimés à la tribune, je ne souhaite pas qu’il soit adopté.
Madame la sénatrice, je ne fais aucun amalgame. J’ai lu votre texte avec beaucoup d’attention et d’intérêt. Son vote serait un très mauvais signal, me semble-t-il, adressé à l’ensemble de nos compatriotes, plus particulièrement au petit commerçant qui a vu son magasin dévasté. Peut-il, lui, entendre que celui qui a fait cela, parce qu’il l’a fait dans le cadre d’une manifestation, doit être amnistié ? C’est invraisemblable !
Sur cette question, comme sur certains autres sujets, je pense avoir l’esprit assez clair : s’il y a eu des amalgames aujourd’hui sur l’amnistie, madame la sénatrice, je vous le dis avec infiniment de respect, ils sont de votre fait.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion des articles de la proposition de loi initiale.
Chapitre IER
Amnistie des délits commis à l’occasion d’activités syndicales et revendicatives
I. – L’amnistie prévue à la présente loi bénéficie aux personnes physiques et aux personnes morales.
Sont amnistiés de droit, lorsqu’ils ont été commis avant la promulgation de la présente loi, les délits passibles de moins de dix ans d’emprisonnement et les contraventions commis dans les circonstances suivantes :
1° À l’occasion de conflits du travail ou à l’occasion d’activités syndicales ou revendicatives de salariés, d’agents publics, de professions libérales ou d’exploitants agricoles, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics ;
2° À l’occasion de mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux, relatifs aux problèmes liés à l’éducation, au logement, à la santé, à l’environnement et aux droits des migrants, y compris au cours de manifestations sur la voie publique ou dans des lieux publics.
II. – Sont exclus de l’amnistie prévue par la présente loi les délits de violences à l’encontre d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, mentionnés au 4° des articles 222-12 et 222-13 du code pénal, et ayant entraîné une incapacité de travail.
Sont enfin exclues de l’amnistie prévue par la présente loi les atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique d’un mineur de quinze ans ou d’une personne particulièrement vulnérable mentionnées aux 1° et 2° des mêmes articles 222-12 et 222-13 et à l’article 222-14 du même code.
L ’ article 1 er n ’ est pas adopté.
Lorsqu’elle intervient après condamnation définitive, l’amnistie est constatée par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d’office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 778 du code de procédure pénale.
En l’absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L ’ article 2 n ’ est pas adopté.
I. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I de l’article 1er, en tant qu’ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou qu’ils sont susceptibles d’être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, par tout salarié ou agent public, à l’exception des faits mentionnés au second alinéa du II du même article 1er.
L’inspection du travail veille à ce qu’il ne puisse être fait état des faits amnistiés. À cet effet, elle s’assure du retrait des mentions relatives à ces sanctions dans les dossiers de toute nature concernant les travailleurs qui bénéficient de l’amnistie.
II. – Sont amnistiés les faits commis dans les circonstances mentionnées au I de l’article 1er, par les étudiants ou élèves des établissements universitaires ou scolaires, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu à des sanctions disciplinaires.
L’amnistie implique le droit à réintégration dans l’établissement universitaire ou scolaire auquel le bénéficiaire de l’amnistie appartenait, à moins que la poursuite de ses études ne l’exige pas.
Toutefois, l’amnistie n’implique pas de droit à réintégration lorsque l’intéressé a été exclu de l’établissement à la suite de faits de violence.
L ’ article 3 n ’ est pas adopté.
I. – Tout salarié ou agent public licencié pour une faute, autre qu’une faute lourde, commise à l’occasion de l’exercice de sa fonction de représentant élu du personnel, de représentant syndical au comité social et économique ou au comité d’entreprise, ou de délégué syndical et ayant fait l’objet d’une amnistie au titre de la présente loi, est, sauf cas de force majeure, réintégré dans le poste qu’il occupait avant son licenciement ou dans un poste équivalent.
La demande de réintégration est présentée à l’auteur du licenciement dans un délai d’un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit du prononcé de la sanction.
En cas de changement d’employeur en application des articles L. 1224-1 ou L. 1224-3 du code du travail, la réintégration du salarié s’effectue chez l’employeur succédant.
En cas de défaut de réponse de l’employeur à la demande de réintégration, celle-ci est acquise dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
En cas de refus de l’employeur, le salarié ou l’agent peut saisir, en référé, la juridiction compétente, qui peut ordonner la réintégration sous astreinte.
Le salarié réintégré bénéficie pendant douze mois, à compter de sa réintégration effective, de la protection attachée au délégué syndical prévue aux articles L. 2411-1 à L. 2437-1 du même code.
II. – Les contestations relatives à l’amnistie des sanctions disciplinaires définitives sont portées devant l’autorité ou la juridiction qui a rendu la décision.
L’intéressé peut saisir cette autorité ou juridiction en vue de faire constater que le bénéfice de l’amnistie lui est effectivement acquis.
En l’absence de décision définitive, les contestations sont soumises à l’autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite.
L’exécution de la sanction est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande ; le recours contentieux contre la décision de rejet de la demande a également un caractère suspensif.
L ’ article 4 n ’ est pas adopté.

Chapitre IV
Effets de l’amnistie et fichage des informations nominatives et des empreintes génétiques
I. – L’amnistie prévue à la présente loi efface les condamnations prononcées ou éteint l’action publique en emportant les conséquences prévues aux articles 133-9 à 133-11 du code pénal et aux articles 6 et 769 du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Elle entraîne, sans qu’elle puisse donner lieu à restitution, la remise des peines et des mesures de police et de sûreté.
Elle fait obstacle au recouvrement du droit fixe de procédure mentionné à l’article 1018 A du code général des impôts.
Toute référence à une sanction ou à une condamnation amnistiée sur le fondement de la présente loi est punie d’une amende de 5 000 euros.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au quatrième alinéa du présent I. L’article 131-38 du code pénal s’applique aux peines encourues.
II. – En cas d’instance sur les intérêts civils, le dossier pénal est versé aux débats et mis à la disposition des parties.
Si la juridiction de jugement a été saisie de l’action publique avant la promulgation de la présente loi, cette juridiction reste compétente pour statuer, le cas échéant, sur les intérêts civils.
III. – L’amnistie entraîne la suppression des empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies dans les fichiers de police ainsi que l’ensemble des informations nominatives relatives aux infractions mentionnées à l’article 1er recueillies à l’occasion des procédures d’enquête et des procédures judiciaires dans les fichiers de police judiciaire.
L’infraction prévue au premier alinéa du II de l’article 706-56 du code de procédure pénale est amnistiée lorsqu’elle a été commise à l’occasion de faits amnistiés en application du I de l’article 1er de la présente loi.

Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l’article 5, je vous informe que, comme les articles précédents n’ont pas été adoptés, si celui-ci ne l’était pas non plus, l’article 6, qui est relatif à la mise en application de la loi, deviendrait sans objet.
En conséquence, il n’y aurait dans ce cas plus lieu de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, tous les articles la constituant ayant été rejetés ou étant devenus sans objet. Aucune explication de vote sur l’ensemble ne sera possible.
Je vous invite donc à prendre la parole maintenant, si vous souhaitez vous exprimer sur ce texte.
La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

Une grande partie du groupe GEST aurait aimé voir ce texte aboutir, non pas qu’il soit parfait, des limites ayant été pointées, notamment en ce qui concerne le champ d’application de l’article 1er, mais parce qu’il intervient dans un contexte assez particulier de contraction des libertés publiques, où toutes les formes de militantisme sont contraintes par un certain nombre de dispositions législatives ou des actions administratives ou policières qui ne laissent pas de nous inquiéter.
Dans notre pays, le schéma du maintien de l’ordre est à la dérive et provoque nombre de violences lors de certaines manifestations. Cela va dans les deux sens. Les dispositifs policiers sont parfois tellement disproportionnés qu’ils semblent sonner comme un appel à la confrontation. Ainsi, les dernières manifestations contre la réforme des retraites ont donné lieu à une multiplication des gardes à vue qui n’ont pas débouché sur grand-chose, des centaines de personnes ayant été libérées sans aucune charge. Voilà qui est révélateur d’un problème.
Nous avons aussi observé de nombreuses tentatives d’intimidation de responsables syndicaux, qui se font parfois réveiller à six heures du matin par la police, sans parler du déploiement massif d’outils de surveillance contre les militants écologistes.
Je le répète, nous sommes dans un moment assez particulier pour les libertés publiques, qui touche tant les militants écologistes que les responsables ou militants syndicaux. Ce texte était un signal bienvenu. Il aurait certainement pu être sensiblement amélioré par la navette parlementaire. Pour cela, il aurait fallu que le Sénat le vote. Tel était notre souhait.

Monsieur le garde des sceaux, aucun des arguments développés pour justifier le rejet de cette proposition de loi ne me paraît valable.
Vous avez déclaré que le vote de ce texte conduirait à amnistier des auteurs de propos racistes et antisémites. La présidente du groupe CRCE-K, Cécile Cukierman, vous a répondu.
Je rappelle d’ailleurs que ce sont les communistes qui, à l’Assemblée nationale, par la voix de Fabien Roussel, ont déposé une proposition de résolution visant à lutter contre la banalisation des discours de haine dans le débat public, dont l’objet est de rendre inéligibles les auteurs de propos racistes et antisémites. Or c’est vous, monsieur le garde des sceaux, qui vous êtes à l’époque opposé à son adoption. Je le regrette, car l’on voit en permanence, sur les plateaux de télévision et ailleurs, un individu plusieurs fois condamné pour des propos racistes et antisémites, ce qui ne l’empêche pas d’être candidat à toutes les élections.
Par ailleurs, vous avez déclaré tout à l’heure à la tribune que cette proposition de loi n’était pas opportune dans la mesure où, dans notre pays, le dialogue social était rétabli. Allez discuter avec des syndicalistes qui se battent tous les jours pour l’amélioration des conditions de travail et l’augmentation des salaires : ils sont loin de partager votre sentiment !
Enfin, vous avez répété que vous compreniez l’intention qui nous animait, mais que la rédaction du texte péchait. S’il en était véritablement ainsi, vous aviez tout loisir, comme l’a indiqué Cathy Apourceau-Poly, de proposer des amendements visant à l’améliorer.
Je le répète, nous considérons que cette proposition de loi est absolument nécessaire. Dans notre pays, le monde syndical et le mouvement social doivent avoir la possibilité de s’exprimer sans être criminalisés, comme c’est trop souvent le cas aujourd’hui.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.

Je mets aux voix l’article 5.
J’ai été saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l’une, du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste– Kanaky, l’autre, du groupe Les Républicains.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 21 :
Le Sénat n’a pas adopté.
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Je rappelle que, les articles 1er à 5 n’ayant pas été adoptés, cet article est devenu sans objet.
Tous les articles de la proposition de loi ayant été rejetés ou étant devenus sans objet, je constate qu’un vote sur l’ensemble n’est pas nécessaire.
En conséquence, la proposition de loi portant amnistie des faits commis à l’occasion de mouvements sociaux et d’activités syndicales et représentatives n’est pas adoptée.
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures cinq, est reprise à seize heures quinze.

L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, de la proposition de loi constitutionnelle visant à abroger l’article 40 de la Constitution, présentée par Mme Éliane Assassi, MM. Éric Bocquet, Pascal Savoldelli et plusieurs de leurs collègues (proposition n° 732 [2022-2023], résultat des travaux de la commission n° 65, rapport n° 64).
Dans la discussion générale, la parole est à M. Pascal Savoldelli, auteur de la proposition de loi constitutionnelle.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je salue ma collègue et amie Éliane Assassi, qui nous regarde peut-être et qui était la première cosignataire de cette proposition de loi constitutionnelle.

Débattre d’une proposition de loi constitutionnelle portant abrogation de l’article 40, c’est d’abord s’inscrire dans une dynamique de réforme de la Constitution – une dynamique engagée et accélérée voilà quelques jours par le Président de la République, lui qui a relancé le débat.
La Constitution donne du sens à l’État de droit. Force est toutefois de constater qu’aujourd’hui la perte de sens est généralisée, tant notre démocratie semble vaciller et notre République paraît fragilisée, amoindrie.
D’année en année, de crise politique en crise politique, des « gilets jaunes » au mouvement contre la réforme des retraites, la question de l’intervention citoyenne a fait irruption dans le débat public. Au sortir de chacune de ces crises, la capacité de nos institutions à lui ouvrir un débouché a systématiquement été interrogée et souvent jugée insatisfaisante, voire insuffisante.
L’acuité de cet enjeu s’est révélée particulièrement vive ces derniers mois, durant le mouvement social contre la réforme des retraites. Une très grande majorité de Français ont en effet manifesté contre une réforme qu’ils estimaient injuste et brutale.
Le mouvement a ensuite pris un autre caractère : c’est contre la vie démocratique même de nos institutions que nos concitoyens se sont exprimés dans la rue. Ils l’ont fait contre l’article 49.3, bien sûr, mais aussi, et de manière plus inattendue, contre l’article 40 de notre Constitution.
C’est en effet cet article qui a été invoqué pour bloquer la proposition de loi du groupe Liot (Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires) d’abrogation de la réforme des retraites portant l’âge légal de départ à 64 ans, puisqu’il rend irrecevable toute proposition dont l’adoption « aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». En d’autres termes, le Gouvernement a le droit de défendre une telle mesure, mais pas la représentation nationale !
M. le garde des sceaux acquiesce.

Beaucoup de nos concitoyens ont alors découvert cet artifice. Son usage est apparu déraisonnable, injustifié et impropre au débat démocratique et à la cohésion sociale.
C’est l’article 40 qui a restreint le droit de proposition de la représentation nationale.
C’est l’article 40 qui a empêché – donc contrarié – l’expression de la démocratie sociale.
Cet article a été identifié comme un étau institutionnel et démocratique, dépossédant les individus de leur citoyenneté. Depuis, juristes, constitutionnalistes, citoyens, s’interrogent légitimement.
En tant que législateurs, nous avons la responsabilité de saisir le moment opportun pour une réforme constitutionnelle, lorsque les institutions semblent en décalage avec la volonté du peuple souverain. C’est au regard de cette responsabilité que nous proposons l’abrogation de l’article 40.
Deux raisons nous y conduisent.
En premier lieu, il s’agit d’apporter un nouveau souffle à la démocratie.
« Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. » Voilà ce qu’indique l’article 28 de la Constitution de 1793.
Le général de Gaulle lui-même affirmait en 1958 : « C’est donc pour le peuple que nous sommes, au siècle et dans le monde où nous sommes, qu’a été établi le projet de Constitution. »
En 2023, nous traversons une crise profonde de la démocratie aussi bien que de la légitimité de nos institutions. Nous traversons aussi une crise de confiance dans le parlementarisme, pourtant garant de la représentation nationale.
Pourquoi évoquer cela ?
Aborder l’abrogation de l’article 40 de la Constitution, c’est d’abord interroger le pouvoir du Gouvernement, celui du Parlement, mais aussi celui des citoyens. C’est un débat sur la légitimité et sur la légalité.
Le Sénat est à la bonne place pour poser les jalons d’un tel cheminement, puisqu’il se distingue de l’Assemblée nationale, où les recours à l’article 49, alinéa 3, à l’article 40 et aux motions de censure se nourrissent et se répondent – « Acquiescement du ministre »…
M. le garde des sceaux rit.

L’irruption des citoyens dans les choix politiques et budgétaires est aujourd’hui un fait. Ceux-ci s’interrogent sur les outils mis à leur disposition pour exercer leur citoyenneté, mais aussi leur droit d’intervention concernant le budget de la Nation.
Ce qui lie les citoyens au budget de la Nation, ce sont d’abord les services publics, ciment de la République dans tous les territoires. Mes chers collègues, comment les citoyens peuvent-ils s’approprier ces services publics s’ils n’en ont pas la maîtrise ?
Chaque fois que des habitants, des syndicalistes ou des élus locaux demandent les moyens de la sauvegarde ou du développement de leurs services publics, les amendements concernés sont frappés d’irrecevabilité : sauvegarder les lignes de bus RATP ? Irrecevable. Augmenter les bourses pour les étudiants ? Irrecevable. Service public de l’énergie ? Irrecevable. Je pourrais continuer cette liste. D’aucuns pourraient évoquer un tri dans les initiatives politiques…
L’article 40 rendant la démocratie sociale irrecevable, il est temps de l’abroger.
En second lieu, il est nécessaire de dépasser ce qui constitue un outil d’entrave au débat parlementaire.
Cette réflexion n’est pas nouvelle. Elle dépasse les clivages politiques et a été défendue par toutes les sensibilités politiques, et ce dans les deux chambres.
Elle a été exprimée par le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, dit comité Balladur, chargé de la révision constitutionnelle lancée par Nicolas Sarkozy en 2008. Les présidents des commissions des finances à l’Assemblée nationale et au Sénat, respectivement Didier Migaud et Jean Arthuis, ont alors plaidé – en vain – pour la fin de ce qu’ils qualifiaient de « forme d’autocensure parlementaire ».

Une forme d’autocensure, et aussi d’incohérence, puisque, dans le même temps, il est possible de créer une nouvelle dépense fiscale ou d’élargir une niche fiscale existante sans que l’article 40 puisse s’appliquer, alors même que l’État ou la sécurité sociale voient leurs recettes minorées.

Malgré l’article 40, il est possible de reporter des crédits de dizaines de milliards d’euros.
Malgré l’article 40, la mise en réserve d’une partie des crédits budgétaires est possible.
N’assistons-nous pas à un « deux poids, deux mesures » ?
Plus largement, la question posée est celle de la définition du travail parlementaire et, in extenso, du droit d’amendement. Avec l’article 40, ce droit est-il assuré ou bien confisqué ?
Si la Ve République est le fait majoritaire, l’article 40 non seulement limite les capacités de proposition de l’opposition, par définition minoritaire, mais, surtout, restreint la capacité d’initiative des parlementaires de la majorité.

Sous la Ve République, le Parlement se contenterait-il d’adhérer à un budget ou de s’y opposer ? Quoi qu’il en soit, son rôle d’élaboration est aujourd’hui indéniablement restreint. Finirait-on par parler d’un budget des cabinets ministériels accompagnés par l’expertise de cabinets privés plutôt que d’un budget de la Nation ?
Ces deux raisons exposées, permettez-moi de contrer l’argument qui nous a été opposé, selon lequel l’article 40 constitue un garde-fou. Non, son abrogation ne constituera pas un facteur d’aggravation de la dette et des déficits publics.
La commission des lois a majoritairement jugé « l’abrogation impossible et son assouplissement aventureux ». L’argument principal mis en avant est le risque d’accélération des déficits.
L’état de nos comptes publics nous indique pourtant bien que l’article 40 n’a jamais permis d’atténuer la dette ou les déficits publics. Pis, depuis la dernière révision constitutionnelle, notre dette publique s’est considérablement accrue. S’agit-il donc de restreindre les déficits ou le droit parlementaire ?
Si comparaison n’est pas raison, signalons, de même, qu’il existe dans la moitié des pays de l’OCDE un droit d’initiative parlementaire illimité. Ces pays présentent des niveaux de dettes différents, ce qui démontre qu’il n’y a pas de corrélation avec le niveau d’endettement, mais aussi que l’abrogation de l’article 40 n’est pas contraire aux engagements européens pris par la France.
Autre comparaison, les assemblées des collectivités territoriales votent des dépenses et des recettes tout au long de l’année. En théorie, elles ne peuvent enregistrer de déficit, puisque leur budget doit respecter le principe d’équilibre, …

… théorie rarement démentie par les faits, tant les procédures de mise sous tutelle ont été rares ces dernières années.
Les collectivités peuvent toutefois emprunter librement, donc s’endetter – une dette saine, puisque, sans elle, nous n’aurions jamais pu construire une seule école ou un seul service public. Surtout, cette dette ne représente que 10 % du total de la dette publique, en baisse de 3, 5 % en 2022.
C’est bien la démonstration de l’esprit de responsabilité des élus locaux. Pourquoi les parlementaires, dont beaucoup sont rodés à l’élaboration d’exercices budgétaires grâce à leurs expériences locales, ne seraient-ils pas, eux, empreints de cette responsabilité ?
Pour conclure cet exposé, je reviens sur les notions de légalité et de légitimité.
Celles-ci forment le cœur du sujet, dès lors que l’on s’interroge sur une réglementation qui n’est nécessaire qu’à une économie libérale et de compétition, qui vit sur la dette publique. Tout cela nous pose une question de fond : à qui sert l’article 40 ? De quel État est-il l’instrument de pouvoir ? Pour quoi ? Comment ?
Il s’agit là d’une contradiction inhérente à la Constitution de la Ve République, qui précise pourtant que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Son aboutissement demeure la démocratie sociale, laquelle est consacrée par l’expression de « République sociale ».
Le peuple français n’est pas « irresponsable ». La représentation nationale ne l’est pas non plus.
Responsabiliser, c’est légitimer.
Légitimer la démocratie parlementaire et la démocratie sociale, c’est apporter un nouveau souffle à la République.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K. – MM. Guy Benarroche et Patrice Joly applaudissent également.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous ne connaissons que trop bien les contraintes enserrant notre droit fondamental d’amendement. Elles sont nombreuses : 49.3, vote bloqué, article 45… S’y ajoute le fameux principe de l’irrecevabilité financière des initiatives parlementaires inscrit à l’article 40 de notre loi fondamentale, cette contrainte n’étant pas des moindres.
La proposition de loi présentée par nos collègues communistes a le mérite de la simplicité et de la clarté, puisqu’elle abroge purement et simplement l’article 40 de la Constitution.
Certes, la critique de cet article n’est pas une idée neuve ; elle semble avoir suscité un regain d’attention médiatique et politique en raison d’une actualité récente, notamment à l’occasion de la réforme des retraites. J’en veux pour preuve la teneur même de l’exposé des motifs de la proposition de loi qui nous est soumise. Il démontre, s’il en était besoin, que ce texte a été pensé pour des raisons essentiellement conjoncturelles.
Aussi respectables et compréhensibles soient-elles, ces raisons doivent être appréciées en tenant compte de l’exigence de sérénité et avec le recul qui doit présider, en toute hypothèse, à une révision constitutionnelle.
Loin de moi l’idée de balayer d’un revers de main ce sujet important au regard des frustrations ou du mécontentement de nos collègues qui s’élèvent parfois, dès lors que certaines de leurs initiatives sont frappées d’irrecevabilité financière. Il s’agit de fait d’un débat pleinement légitime pour notre assemblée.
Deux questions essentielles doivent être posées.
Est-il envisageable de voter l’abrogation de l’article 40 de la Constitution proposée par nos collègues communistes ?
À défaut, pourrions-nous adopter une atténuation ou un assouplissement de sa lettre ?
En préambule, je rappelle que le principe d’irrecevabilité financière s’inscrit dans la logique de rationalisation du parlementarisme voulue par le constituant de 1958. Cette disposition est conforme à l’idée que le Parlement a vocation non pas à déterminer le budget de l’État, mais seulement à le discuter et à l’examiner, garantissant ainsi le respect de « l’objectif d’équilibre des comptes des administrations publiques » énoncé à l’avant-dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution.
Il me paraît d’ailleurs utile d’évoquer ici que l’article 40 de la Constitution fait partie de ces rares articles – une trentaine – qui n’ont jamais été modifiés depuis 1958. Il est en effet le produit d’une histoire constitutionnelle de plus de cent quarante ans et, en quelque sorte, comme le souligne Anne Levade, un point d’aboutissement de réflexions et de pratiques engagées à partir du XIXe siècle.
Une telle abrogation serait-elle donc devenue plus pertinente aujourd’hui ? Je ne le pense pas. Au contraire, elle serait moins opportune que jamais.
D’un point de vue budgétaire, d’abord, dans un contexte que nous connaissons tous, une telle abrogation paraîtrait particulièrement contradictoire avec les objectifs que la France se donne quant au sérieux de la gestion de ses deniers publics.
Il ne s’agit nullement ici de présenter les parlementaires comme irresponsables financièrement : le Gouvernement n’a pas eu besoin du Parlement pour présenter des budgets systématiquement déficitaires depuis 1974. En revanche, je ne déduis pas de cet état de fait qu’il n’y aurait aucun risque budgétaire à ouvrir plus largement aux parlementaires la possibilité de proposer des initiatives dépensières : l’accroissement des initiatives législatives créant ou aggravant les charges publiques se traduirait mécaniquement par une augmentation des dépenses publiques.
D’un point de vue institutionnel, ensuite, l’équilibre propre au débat budgétaire est connu de tous et il serait remis en cause. D’un côté, le Gouvernement sollicite une somme de crédits pour réaliser certaines opérations et mettre en œuvre la politique sur laquelle il s’est engagé et est responsable devant l’Assemblée nationale ; de l’autre, le Parlement accorde ou refuse tout ou partie de ces crédits, en allant, le cas échéant, jusqu’à renverser le Gouvernement.
D’un point de vue politique, enfin, cette abrogation paraîtrait particulièrement malvenue dans le contexte que traversent nos institutions, marqué par une majorité relative à l’Assemblée nationale. Pour le dire autrement, en période de majorité absolue, une réforme ou une abrogation de l’article 40 pourrait ne produire aucun effet majeur ; cependant, la logique même de la rationalisation du parlementarisme consiste à donner au pouvoir exécutif les moyens de faire face aux contraintes inhérentes à une majorité relative, qui ne signifie en aucun cas qu’il appartient aux oppositions de gouverner.
Dès lors, l’assouplissement de l’article 40 de la Constitution est-il envisageable ?
Faut-il par exemple supprimer les propositions de loi du champ des dispositions soumises à l’irrecevabilité financière ? Même si tel est l’usage dans les deux chambres, il serait paradoxal de l’inscrire dans la Constitution, sauf à sous-entendre que les propositions de loi n’ont guère de chance de prospérer sans l’aval de l’exécutif – celles-ci étant par conséquent sans danger pour les finances publiques, nous pouvons lâcher la bride au pouvoir législatif, ce qui serait en quelque sorte une façon de dévaloriser les propositions de loi.
Faut-il alors permettre la compensation de la création ou de l’aggravation des charges publiques ?
Cela présenterait certes l’avantage de garantir que la masse des charges elle-même n’augmente pas, mais cela permettrait de facto au pouvoir législatif de redessiner totalement le budget proposé par le Gouvernement comme il l’entend, du moins en dépenses. In fine, à quoi servirait encore l’article 40 ? Poussons le raisonnement jusqu’à la caricature : ne serait-ce pas une remise en cause du monopole du Gouvernement sur l’initiative des projets de loi de finances ?

Faut-il ensuite qualifier plus précisément les ressources et les charges concernées ? Il me semble que c’est ici entrer dans une complexité qui ne peut être source que de nouvelles problématiques. Un parlementaire est-il toujours capable de chiffrer la portée financière de sa proposition ou de son amendement de manière certaine et sincère ?
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Faut-il enfin permettre la discussion d’amendements jugés irrecevables ? Quel en serait véritablement l’intérêt ?
Le calendrier, surtout en matière de projets de loi de finances ou de projets de loi de financement de la sécurité sociale, n’est-il pas assez contraint ? Les débats parlementaires ne sont-ils pas suffisamment lourds ? Aller au-delà de ce que la pratique permet d’ores et déjà – à savoir la prise de parole sur l’article concerné par l’amendement jugé irrecevable – ferait courir le risque d’une instrumentalisation à des fins d’obstruction, raison pour laquelle je n’y suis pas favorable.
Par ailleurs, dans le cadre des auditions, l’amélioration des procédures actuellement en vigueur a été évoquée, notamment sur deux points essentiels. Le premier point est le renforcement de la motivation des décisions d’irrecevabilité.

Cela peut être une piste à explorer. Néanmoins, mes chers collègues, je vous indique que la procédure actuelle permet déjà d’obtenir un complément de motivation.

Le second point est la formalisation d’une voie de recours.
Sur le principe, l’idée semble séduisante. Encore faut-il la confronter au nombre d’amendements à objet financier – plusieurs dizaines de milliers par législature. Je vois mal comment un tel recours serait compatible avec les impératifs de bonne tenue et de délai raisonnable du débat parlementaire. Qui plus est, quel serait l’organe le plus pertinent pour mener à bien un tel contrôle ?
Je rappelle à toutes fins utiles que le réexamen d’une décision d’irrecevabilité rendue par le président de la commission des finances est d’ores et déjà possible directement auprès de ce dernier. Cela achève de convaincre qu’une telle réforme ne paraît pas souhaitable.

De surcroît, ces pistes de réflexion relèvent davantage du règlement des assemblées que de la Constitution elle-même.

En conclusion, mes chers collègues, je vous propose de rejeter la présente proposition de loi, la réflexion collective ne me semblant pas tout à fait mûre sur ce sujet.
Je remercie néanmoins nos collègues communistes de la réflexion stimulante à laquelle ils nous engagent. Je remercie également tous les présidents de groupe ainsi que le président de la commission des finances de s’être rendus disponibles dans un délai si court pour me faire part de leurs observations.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je salue également Mme Assassi, si elle nous regarde.
Sourires.
Monsieur Savoldelli, je vous remercie de nous contraindre à la réflexion : c’est un exercice toujours infiniment utile.
Inchangé depuis 1958, l’article 40 de la Constitution constitue une limite objective à l’initiative des parlementaires et au droit d’amendement. Il forme un modérateur contribuant à concilier le respect de l’initiative parlementaire avec les exigences d’équilibre des finances publiques et de qualité des débats parlementaires.
C’est vrai : l’article 40 a souvent été décrié, et ce dès 1958. Pourtant, force est de constater qu’il a résisté à toutes les tentatives de modification ou d’abrogation dont il a pu faire l’objet, et ce à maintes reprises. Toutefois, il a aussi compté des parlementaires pour le défendre. Il a d’ailleurs résisté à cette proposition de loi, puisque la commission des lois du Sénat ne l’a pas adoptée.
En réalité, l’article 40 de la Constitution s’inscrit pleinement dans l’équilibre institutionnel de la Ve République. À ce titre, il ne constitue en rien une limitation excessive de l’initiative parlementaire.
L’article 40 de la Constitution, d’abord, est l’une des clés de voûte de l’équilibre institutionnel de la Ve République.
Il est souvent affirmé que la Ve République s’est construite en opposition avec le régime de la IVe République. Cela est vrai sur bien des aspects ; pourtant, des éléments de continuité existent.
Comme la IVe République, la Ve République est un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs sont partagés entre différents organes constitutionnels qui collaborent.
C’est un régime dans lequel le Gouvernement est politiquement responsable devant le Parlement, en contrepartie de quoi il lui est reconnu le pouvoir de déterminer et de conduire la politique de la Nation.
Par certains aspects, la Constitution du 4 octobre 1958 s’inscrit dans un mouvement de rationalisation du parlementarisme déjà engagé en 1946.
L’irrecevabilité financière de l’article 40 n’est ainsi pas une pure création du constituant de 1958.
Elle n’est d’ailleurs pas une spécificité française, des dispositions similaires existant dans la plupart des démocraties parlementaires – « Acquiescement du sénateur »…
Sourires.
Nouveaux sourires.
Exclamations amusées sur les travées du groupe CRCE-K.
La règle de l’irrecevabilité financière trouve en effet ses origines sous la IIIe République : dans la résolution Berthelot votée le 16 mars 1900, puis dans l’instauration en 1920 d’une procédure d’irrecevabilité financière générale dans le règlement de la Chambre des députés.
Par la suite, cette règle fut constitutionnalisée par l’article 17 de la Constitution de la IVe République, qui disposait qu’« aucune proposition tendant à augmenter les dépenses prévues ou à créer des dépenses nouvelles ne pourra être présentée lors de la discussion du budget, des crédits prévisionnels et supplémentaires ».
Enfin, reprenant la loi du 31 décembre 1948 portant fixation pour l’exercice 1949 des maxima des dépenses publiques et évaluation des voies et moyens, dite loi des maxima, le décret du 19 juin 1956 a imposé une compensation pour toute proposition affectant les finances publiques.
L’article 40 de la Constitution n’a fait que donner une pleine effectivité à la règle de l’irrecevabilité financière. En effet, contrairement aux Républiques précédentes, l’application de cette règle n’est plus laissée à l’unique appréciation des assemblées parlementaires : le Gouvernement peut invoquer l’article 40 en séance publique, et le Conseil constitutionnel s’est reconnu compétent pour assurer son respect. La règle de la recevabilité financière, inscrite à l’article 40 de la Constitution, n’est donc pas une innovation de la Ve République.
Hier comme aujourd’hui, la règle de la recevabilité financière constitue une nécessité qui n’a rien d’excessif.
Vous le savez, l’article 20 de la Constitution charge le Gouvernement de déterminer et de conduire la politique de la Nation. En cela, il est responsable devant le Parlement.
Il est notamment responsable de l’équilibre du budget pour lequel il présente, chaque année, un projet de loi de finances.
C’est une quasi constante dans toutes les démocraties modernes : c’est au Gouvernement qu’il revient de préparer le budget, qu’il présente ensuite au Parlement pour être discuté.
Il n’est cependant pas concevable que des initiatives parlementaires, sans accord du Gouvernement, puissent altérer les équilibres budgétaires qu’il a définis, en assumant sa responsabilité devant le Parlement.
Cela reviendrait non seulement à saper les efforts fournis chaque année par le Gouvernement pour tendre vers l’équilibre de nos finances publiques, mais aussi à diluer la responsabilité qu’il tient de l’article 20 de la Constitution.
Par ailleurs, la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (Lolf) a assoupli les conditions de recevabilité des amendements de crédits portant sur une loi de finances. En effet, son article 47 précise que « la charge s’entend, s’agissant des amendements s’appliquant aux crédits [de] la mission ».
Ainsi, si le Gouvernement reste le seul compétent pour créer une mission, les parlementaires peuvent modifier à la hausse ou à la baisse les crédits des programmes composant une mission ou créer un nouveau programme, à condition de ne pas augmenter les crédits de la mission.
Au-delà de la lettre de l’article 40, la pratique suivie par les assemblées et le Conseil constitutionnel laisse une grande marge d’appréciation au Parlement pour la mise en œuvre de l’irrecevabilité financière.
Ainsi, le Conseil constitutionnel ne se déclare compétent pour connaître d’une violation de l’article 40 que lorsque le Parlement s’est préalablement prononcé. Cette règle du « préalable parlementaire » souligne le rôle central exercé par le Parlement dans la procédure.
Les assemblées ont su s’approprier ce rôle, à tel point qu’une partie de la doctrine n’hésite pas à qualifier le Parlement de juridiction de premier degré, l’appel étant réservé au juge constitutionnel.
Ainsi, les rapports de recevabilité financière des amendements et des propositions de loi représentent des « bréviaire[s] indispensable[s] pour connaître et comprendre les subtilités de l’application de l’article 40 de la Constitution », comme le relevait le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand.
Le rapport d’information sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements à l’Assemblée nationale de 2022 d’Éric Woerth et le rapport d’information sur la recevabilité financière des amendements et des propositions de loi au Sénat de 2014 de Philippe Marini détaillent avec précision la jurisprudence abondante et bien établie de la recevabilité financière par les présidents successifs de la commission des finances de chaque chambre.
Les présidents de la commission des finances visent de façon continue à concilier le respect des exigences organiques et constitutionnelles avec la volonté de favoriser l’initiative parlementaire.
Toute décision de recevabilité financière est motivée et peut faire l’objet d’une explication détaillée à la demande du parlementaire auteur de l’amendement par le président de la commission des finances.
Enfin, les statistiques ne permettent pas de conclure à une censure massive des amendements sur le fondement de l’article 40. Lors de la précédente législature, seulement 8, 4 % des amendements déposés en séance publique ont été déclarés irrecevables, et seulement une proposition de loi.
Vous l’avez compris, le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition de loi constitutionnelle.
Je ne suis pas certain que faire de l’article 40 de la Constitution le responsable de tous nos maux nous apporte une quelconque solution, car il n’est que l’un des instruments classiques du parlementarisme rationalisé.
D’ailleurs, en cohérence avec la position de la commission des lois, je note que, parmi les quarante propositions pour une révision de la Constitution utile à la France émises par le Sénat en 2018, aucune ne visait l’article 40.
En outre, une éventuelle réflexion sur l’irrecevabilité financière des propositions de loi et des amendements parlementaires devrait de toute évidence s’inscrire dans le cadre d’un débat beaucoup plus large sur la modernisation et l’équilibre de nos institutions.
Le Président de la République a annoncé des travaux transpartisans en ce sens et je sais d’ores et déjà que le Sénat y prendra toute sa part.
Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, INDEP, RDSE, UC et Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, en préambule, permettez-moi d’adresser à mon tour un clin d’œil à notre ancienne collègue Éliane Assassi, en espérant qu’elle nous regarde.
Je pense pouvoir affirmer que nous sommes nombreux dans cet hémicycle à être passés, un jour ou l’autre, sous les fourches caudines de la commission des finances, après qu’un amendement auquel nous tenions a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.
Je suis d’ailleurs intervenu personnellement plusieurs fois en séance à ce sujet – moins toutefois que notre ancien collègue Jean-Pierre Sueur, qui avait à juste titre fait de cette question un leitmotiv
M. le garde des sceaux sourit.

À titre d’exemple, lors de l’examen du projet de loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante à la fin de l’année 2021, j’ai proposé un amendement visant à réintroduire le stage obligatoire de préparation à l’installation pour les futurs entrepreneurs. Ce stage, organisé par les chambres des métiers et de l’artisanat, était selon moi un gage de réussite pour les jeunes entreprises.
Par le passé, ce stage était intégralement autofinancé, car la ressource que constituaient les redevances de formation acquittées par les stagiaires couvrait les frais d’organisation. Cet amendement ne créait donc aucune charge ni pour les chambres des métiers ni pour l’État ! Pourtant, il a été déclaré irrecevable par la commission des finances au motif que « la dépense découlant de l’organisation de ces formations ne [pouvait] être compensée par la ressource que constitue la redevance acquittée par les stagiaires ».
Un autre amendement, que j’ai déposé en 2019, visait à donner la possibilité à la Collectivité européenne d’Alsace – vous connaissez mon attachement à cette région
Sourires.

Au demeurant, je rappelle à mon tour, comme l’a fait mon collègue Pascal Savoldelli avant moi, que les collectivités locales doivent bien entendu veiller à l’équilibre de leur budget et que, si elles décident d’exercer des compétences nouvelles et d’assumer des charges supplémentaires, elles doivent naturellement diminuer d’autres dépenses ou créer d’autres recettes.
Il est parfois difficile, mes chers collègues, de comprendre la logique des irrecevabilités prononcées, dont les motivations sont – j’ose le dire ! – lapidaires et non susceptibles de recours.
Faut-il pour autant abroger l’article 40, comme le suggèrent les auteurs de la proposition de loi constitutionnelle dont nous sommes saisis ? La question se pose assurément, surtout si l’on se souvient que deux éminents présidents, respectivement de la commission des finances du Sénat et de celle de l’Assemblée nationale, Jean Arthuis et Didier Migaud – il ne s’agit pas de n’importe qui ! –, ont fait cette même proposition dès 2008.

Pour ma part, comme le rapporteur et les membres de la commission des lois, je ne suis pas favorable à cette proposition de loi constitutionnelle. En revanche, je considère que des voies conduisant à un assouplissement de l’article 40 doivent être sérieusement recherchées, et ce pour plusieurs raisons.
Depuis près de treize ans que je siège dans cette maison, j’observe que l’interprétation de la commission des finances est devenue de plus en plus sévère et stricte. Sa jurisprudence s’enrichit régulièrement de nouvelles décisions, dont tous les auteurs des amendements déposés ultérieurement doivent ensuite tenir compte.
À titre d’exemple, avant 2019, on estimait que, lorsqu’elle pouvait être absorbée à moyens constants, une hausse de charge imposée à une institution pouvait être considérée comme une simple charge de gestion. Ce n’est plus le cas depuis lors, comme le montre l’un des cas que je viens d’évoquer.
Par ailleurs, il est clair que l’article 40 nuit à la qualité du débat budgétaire. En empêchant les parlementaires d’arbitrer entre les dépenses des différents ministères, il bride assurément le débat sur le volet relatif aux dépenses du projet de loi de finances. Surtout, il empêche quelquefois – je suis prêt à vous le prouver – de proposer des réformes de structure permettant pourtant d’améliorer l’efficacité de l’action publique. Dans ce dernier cas, le véritable sens de l’article 40 est perdu. L’article tue ainsi certainement quelques initiatives parlementaires qui permettraient pourtant d’atteindre l’objectif du constituant !
D’ailleurs, si l’article 40 empêchait la dérive de la dépense publique, cela se saurait ! Faut-il rappeler ici que notre endettement s’élève à plus de 3 000 milliards d’euros ?

Une paille, en effet !
Quant aux comparaisons internationales, elles montrent que l’article 40 est un verrou de trop grande ampleur. Comme l’a indiqué mon collègue Pascal Savoldelli, dans la majorité des pays de l’OCDE, le pouvoir d’amendement des parlementaires en matière financière n’est tout simplement pas encadré.
M. Pascal Savoldelli acquiesce.

Enfin, et cet argument a été avancé par notre collège Roger Karoutchi il y a déjà quelques années, l’article 40 a été introduit en 1958 dans notre Constitution pour mettre fin aux errances budgétaires de la IVe République ! Tant que l’État présentait un budget à l’équilibre, la règle avait du sens. Elle en a beaucoup moins depuis quarante ans, alors qu’un budget en déséquilibre est voté chaque année.
« Eh oui ! » sur les travées du groupe CRCE-K.

Que faire dans ces conditions ? Quels assouplissements apporter ?
Si d’aventure, monsieur le garde des sceaux, un projet de loi constitutionnelle de modernisation et de rééquilibrage de nos institutions venait à voir le jour, ce serait incontestablement une bonne occasion de revenir sur ce parlementarisme rationalisé à la française, qui limite trop significativement l’initiative parlementaire.
Dans l’attente d’une telle modification, très hypothétique bien sûr, pourquoi ne pas modifier le règlement des assemblées parlementaires ?
D’abord, il s’agirait d’harmoniser les pratiques entre le Sénat et l’Assemblée nationale, lesquelles sont à l’heure actuelle différentes. Je sais bien, et vous l’avez écrit, monsieur le rapporteur, que des améliorations ont été apportées, mais vous avez aussi eu l’honnêteté de relever les différences, de taille pour certaines, existant entre les deux assemblées.
Ensuite, nous pourrions favoriser le contact préalable avec les auteurs des amendements susceptibles de poser un problème financier, plutôt que de leur opposer une fin de non-recevoir qui coupe court à tout débat. La commission des finances pourrait même, le cas échéant, suggérer des modifications afin de rendre ces amendements recevables.
Il est précisé dans le rapport que des contacts sont pris à cette fin. Je dois dire que je ne suis pas parmi les heureux – les chanceux – qui ont pu bénéficier de tels conseils.
Enfin, vous avez également eu l’honnêteté de le souligner, monsieur le rapporteur, une réforme, une modification, une adaptation du règlement des assemblées, serait susceptible de renforcer la motivation des décisions d’irrecevabilité et de formaliser une voie de recours sérieuse.
À cet égard, on rappellera ici que c’est le président de la commission des finances qui examine la recevabilité financière des amendements. Il le fait certes à titre consultatif, à la demande du président de la commission saisie au fond, mais sa position est bien entendu toujours suivie. Je n’ai pas souvenir que la commission des lois, où je siège depuis tant d’années, ait jamais examiné un amendement ayant été déclaré irrecevable par le président de la commission des finances au titre de l’article 40.
Sur ces différents axes de travail, monsieur le rapporteur, j’ai bien noté, à la lecture de votre rapport, que vous estimiez que la procédure déjà en vigueur au Sénat « donn[ait] satisfaction ». Pour ma part, je n’en suis pas certain – et c’est un euphémisme.
Vous évoquez les courriers électroniques motivant les déclarations d’irrecevabilité qui nous sont adressés ; or ceux-ci sont lapidaires. J’en tiens à votre disposition, monsieur le rapporteur. Je l’ai dit, les réponses du président de la commission des finances aux demandes d’explications complémentaires interviennent souvent après la tenue de la réunion de la commission, voire de la séance publique, c’est-à-dire trop tard. Or cela n’apporte pas grand-chose d’avoir raison trop tard !

Vous évoquez qu’il est déjà possible de saisir le président de la commission des finances d’un « recours gracieux ». Combien de recours gracieux de ce type ont été adressés aux présidents respectifs des commissions des finances ? Combien ont abouti ?
Bien entendu, pour apporter ces différents assouplissements dans un domaine juridiquement sensible et difficile, on le sait bien, une expertise préalable du Conseil constitutionnel serait tout à fait utile, voire nécessaire, à condition que le principe d’une réforme des règlements des assemblées parlementaires puisse être décidé et acté.
En tout état de cause, et je terminerai sur ce point, mes chers collègues, le statu quo n’est selon moi pas possible. En effet, d’une part, l’article 40 limite trop fortement l’initiative parlementaire, d’autre part, on doit légitimement s’interroger sur la cohérence d’un dispositif qui autorise des parlementaires à créer des dépenses fiscales de plusieurs milliards d’euros tout en interdisant une aggravation, même minime, d’une charge publique.
Telles sont les quelques observations, monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, dont je souhaitais vous faire part.
Vous l’avez compris, je ne voterai pas cette proposition de loi constitutionnelle, mais je demande ardemment que, dans cette maison, dans les assemblées parlementaires, on envisage d’examiner ces questions et de leur donner une suite sérieuse.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, l’article 40 de notre Constitution interdit aux parlementaires d’aggraver la dépense publique ou de réduire les impôts. Il leur est impossible de dégrader l’équilibre de nos finances publiques.
Le constat est sans appel : l’existence de cet article ne suffit pas à nous prémunir contre le fléau de la dette publique. Les intérêts de la dette nous ont coûté 50 milliards d’euros cette année et pourraient atteindre 70 milliards d’euros à l’avenir.
Nos collègues du groupe CRCE-K nous proposent aujourd’hui d’abroger l’article 40. Or cet article est l’un des rares qui n’aient pas été modifiés depuis 1958. Y toucher, vous l’avez rappelé, monsieur le rapporteur, c’est revenir sur l’esprit du parlementarisme rationalisé, dont cet article est l’un des principaux garants. Doit-on pour autant s’en indigner au point de souhaiter son abrogation ?
Le privilège de la dépense budgétaire appartient à l’exécutif. Est-ce un mal ? Nous ne le pensons pas, tant que ce privilège reste encadré. Il y va de l’équilibre de nos institutions. Bien sûr, nous ne sommes pas plus dépensiers que le Gouvernement, mais il suffirait que nous le soyons pour précipiter la France vers le naufrage.
Plutôt que de vouloir accaparer un pouvoir qui nous conduirait, sans aucun doute, à succomber aux tentations, à céder aux dérives en tous genres et aux propositions démagogiques et électoralistes, renforçons notre pouvoir de contrôle afin d’éviter toute gabegie.
Peut-être le problème n’est-il pas cette limitation qui peut donner à certains le sentiment d’être empêchés. Peut-être le véritable problème est-il dans la lecture que nous faisons de nos institutions. Oui, le Gouvernement dispose du privilège budgétaire, mais le Parlement a, lui, un pouvoir de contrôle. Dans ces conditions, pourquoi passons-nous trois mois à examiner le projet de loi de finances et seulement trois semaines à l’évaluer ?
Abroger l’article 40 reviendrait donc à repenser l’esprit de nos institutions. Si vous pensez que nos institutions ne fonctionnent pas bien et si vous souhaitez les déséquilibrer, nous sommes plutôt de ceux qui souhaitent changer la façon de les incarner.
En revanche, le Gouvernement jouit d’un privilège budgétaire, non plus constitutionnel, mais factuel et totalement inique : celui de pouvoir accaparer des ressources, bien trop souvent aux dépens des collectivités territoriales, et ce malgré l’article 72-2 de notre Constitution, censé protéger nos collectivités contre toute non-compensation financière.
Combien de décisions prises passent outre cet article 72-2, malgré une jurisprudence constitutionnelle très stricte ? Tant de dépenses sont imposées à nos collectivités, qui sont pourtant de bien meilleures gestionnaires que l’État !
Oui, nous souhaitons conserver l’esprit de notre Constitution, de toute la Constitution, et nous tenir du côté de ceux qui veulent réincarner nos institutions plutôt que les déséquilibrer. Il semblerait qu’il faille non pas abroger l’article 40, mais le compléter au profit des collectivités territoriales.
Le groupe Les Indépendants – République et Territoires votera donc contre cette proposition de loi constitutionnelle.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, il est dommage qu’aucun membre de la commission des finances ne participe à notre débat – probablement parce que se tient en ce moment même une réunion sur le projet de loi de finances. Cela nous aurait permis d’avoir un débat contradictoire et de bénéficier d’explications bienvenues.
Nous en avons rêvé, le groupe CRCE-Kanaky l’a fait : proposer la suppression de l’article 40.
Monsieur le garde des sceaux, seuls 8 % des amendements sont déclarés irrecevables au titre de l’article 40 ; ce n’est pas beaucoup, dites-vous. Pourtant, quand ces amendements sont les vôtres, c’est cruel ! Voyez-vous, nos amendements sont un peu comme nos enfants : ce sont toujours les plus beaux.
Sourires.

Jean Arthuis et Didier Migaud ont été cités à de nombreuses reprises.
Didier Migaud, en séance publique à l’Assemblée nationale, le 23 mai 2008, déclarait que, « pour soutenir l’abrogation de l’article 40, nous estimons que le droit d’amendement doit être exercé dans toute sa plénitude par l’ensemble des parlementaires ».
Il réitérait le 10 février 2010 : « Mes chers collègues, faute d’avoir su convaincre une majorité d’entre vous de supprimer l’article 40, comme nous l’avions proposé avec Jean Arthuis – une référence ! –, je m’efforce d’appliquer cette disposition avec le discernement et la souplesse qui s’imposent. Je travaille, du reste, sur des assouplissements possibles de cette règle, dans le souci de favoriser mieux encore l’initiative parlementaire. » Il est vrai que des assouplissements relèvent des règlements de nos assemblées.
Nous avons eu de nombreux débats sur cette question. Le groupe Union Centriste, dans son ensemble, n’est pas favorable à la suppression de l’article 40.
Nous avons assisté à des débats totalement ubuesques sur certains sujets, par exemple lorsqu’il s’est agi d’augmenter le salaire des secrétaires de mairie. Nous avons déposé un amendement en ce sens, mais il a été déclaré irrecevable au titre de l’article 40, alors qu’une telle augmentation n’aurait pas créé de charge nouvelle, car elle se serait faite de manière bornée, non pas parce que nous sommes bornés, mais parce que le budget des collectivités est, lui, borné. Il ne peut pas être en déficit. Notre amendement n’aurait donc pas dû être déclaré irrecevable.
Notre proposition d’accorder la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux n’ayant pas de délégation a elle aussi été déclarée irrecevable au titre de l’article 40, alors qu’une telle protection entre dans le cadre du budget de la collectivité, qui, je le répète, ne peut pas être en déficit.

Par ailleurs, pourquoi l’appréciation portée sur la recevabilité d’un amendement est-elle différente à l’Assemblée nationale et au Sénat ? Il faudrait pour le moins harmoniser les critères d’appréciation, les différences devenant totalement grotesques et inexplicables.
Cela fait seize ans que je siège dans cette maison, aucun des recours que j’ai déposés n’a abouti ! Peut-être que mes amendements sont très mauvais, mais j’ai plutôt tendance à penser que ce sont les recours qui ne fonctionnent pas…
Monsieur le garde des sceaux, l’article 40 nous est également opposé lorsque nous proposons de réaliser des économies, en luttant par exemple contre la fraude sociale.
Il faut savoir qu’un étranger vivant en France, par exemple un Américain, qui dispose d’un contrat de travail, d’une carte de séjour et d’une carte Vitale, continue de bénéficier de ses droits lorsque son titre de séjour expire et qu’il n’est plus en situation régulière. Aussi, alors qu’il n’y a pas de lien aujourd’hui entre le service des étrangers et les organismes de sécurité sociale, nous proposons d’établir une connexion entre eux. Or cette proposition a été déclarée irrecevable – boum, article 40 ! –, alors qu’elle permettrait notamment de réaliser des économies.
Lorsque nous proposons des amendements, une évaluation devrait avoir lieu et, si elle montre que leur adoption n’entraînerait pas d’économies, l’article 40 pourrait être invoqué, puisqu’il sert justement à cela. Lorsque nos amendements sont déclarés irrecevables sans une telle évaluation, cela crée naturellement une certaine frustration.
Mes collègues l’ont dit, l’article 40 n’empêche pas les budgets en déficit. À cet égard, j’évoquerai quelques exemples frappants, notamment le développement du logiciel Louvois, qui a coûté pratiquement 465 millions d’euros. Le Parlement n’y est pour rien, le Gouvernement est capable de créer tout seul un déficit abyssal.
Je rappellerai également la construction de la centrale de Flamanville.
M. André Reichardt s ’ exclame.

J’en viens à un autre sujet important, les études d’impact. Celles-ci sont mal chiffrées, alors qu’elles induisent des votes. Or il n’existe aucun moyen d’attaquer une étude d’impact au motif que le financement d’un texte n’est pas assuré ou qu’elle n’est pas assez éclairante, l’étude d’impact n’étant pas un objet juridique. C’est donc assez déloyal à l’égard du Parlement. Deux recours ont néanmoins été formés devant le Conseil constitutionnel en raison des insuffisances de l’étude d’impact de la loi relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense.
Vous le voyez, la situation est donc relativement déséquilibrée entre le Parlement, qui est brimé par l’article 40, et le Gouvernement, qui ne donne pas forcément aux parlementaires les informations suffisantes pour lui permettre de juger de la qualité de tel ou tel élément.
Parce qu’il estime que les conditions ne sont pas réunies pour supprimer l’article 40, le groupe Union Centriste votera contre cette proposition de loi constitutionnelle. À titre personnel, par conviction et aussi par amitié pour Éliane Assassi, je voterai ce texte, car j’estime qu’il faut absolument faire évoluer cet article.
Il faut en effet davantage prendre en considération la nature des amendements qui sont proposés, notamment lorsqu’ils sont bornés et concernent les collectivités territoriales, le Sénat étant particulièrement impliqué sur ces sujets. Je ne reviendrai pas sur les amendements visant à augmenter le salaire des secrétaires de mairie ou à accorder la protection fonctionnelle aux conseillers municipaux n’ayant pas de délégation, qui sont des cas typiques. Il faudrait tout de même que l’on puisse discuter de ces questions avec la commission des finances avant l’examen du projet de loi de finances pour 2024, que nous entamerons dans quelques jours.
Monsieur le garde des sceaux, vous avez évoqué les quarante propositions pour une révision de la Constitution utile à la France formulées par le Sénat et rappelé qu’aucune ne visait l’article 40. Je pense que, dans le cadre de ces travaux, le problème que pose cet article a été totalement oublié.
Les déclarations d’irrecevabilité suscitent de la frustration, alors qu’un certain nombre des amendements concernés sont totalement pertinents – je pense à ceux qui visent à réaliser des économies. C’est injuste pour les parlementaires. Il faut par ailleurs réfléchir au cas des amendements qui sont bornés et à une harmonisation avec l’Assemblée nationale.
Je remercie le groupe CRCE-Kanaky d’avoir inscrit cette proposition de loi constitutionnelle à l’ordre du jour de nos travaux.
Mme Dominique Vérien applaudit.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je remercie tout d’abord le groupe CRCE-K d’avoir déposé la proposition de loi constitutionnelle qui nous est aujourd’hui soumise et que nous soutenons, je le dis d’emblée.
Notre système politique place le vote du budget au cœur de la relation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.
Nous le savons – nous le voyons trop souvent avec le recours à l’article 49, alinéa 3, de la Constitution–, le pouvoir d’établir les dépenses appartient au Gouvernement et à sa majorité dans notre système politique et constitutionnel. Ce constat vise non pas à remettre en cause le privilège de l’exécutif en matière budgétaire, mais à contester sa suprématie presque absolue.
Le Gouvernement et sa majorité sont les seuls à pouvoir engager les dépenses de l’État. En miroir, l’initiative de création ou d’aggravation de charges publiques est proscrite en principe pour les parlementaires.
Si l’objectif de sérieux et de rigueur des comptes publics est partagé par tous, l’incapacité de créer de nouvelles dépenses, mais surtout l’interprétation de l’article 40 sont un réel problème pour le Parlement, car ils nuisent à sa capacité d’agir et de mettre en œuvre sa volonté. De plus, l’application stricte de cet article n’a en rien empêché la dégradation des comptes publics et l’accroissement de la dette, comme vient de le démontrer avec brio Nathalie Goulet.
De fait, l’article 40 peut concrètement être utilisé comme un outil politique de censure du Parlement, en particulier des groupes de l’opposition. Récemment, l’utilisation abusive de cet étau budgétaire lors du débat sur la réforme des retraites a profondément inquiété députés et sénateurs.
« En effet, l’exception d’irrecevabilité financière invoquée à l’endroit de propositions de loi a récemment donné lieu à de vifs débats politiques, dans un contexte marqué par une majorité devenue relative à l’Assemblée nationale. » Ainsi s’exprime Stéphane Le Rudulier dans son rapport.
L’interprétation subjective de ce qui constitue une charge publique provoque régulièrement la censure contestable de certains amendements, à l’instar de la déclaration d’irrecevabilité ayant frappé un amendement déposé par les sénateurs écologistes visant à instaurer le bio dans les cantines scolaires. Pourtant, loin d’induire une charge publique supplémentaire, cet amendement, s’il avait été adopté, aurait pu entraîner une baisse de la dépense publique.
J’ai personnellement été victime de l’article 40, un amendement que j’avais déposé visant à permettre la création d’une réserve pour les marins-pompiers de Marseille ayant été déclaré irrecevable. Ma proposition n’a pu être adoptée que parce que le Gouvernement a accepté de déposer un amendement à l’objet similaire au mien.
Oui, il est fait une interprétation stricte, trop stricte, de ce qui constitue une charge publique.
Certains d’entre nous, quelle que soit leur sensibilité politique, ont par le passé déposé des amendements visant, par exemple, à prévoir des consultations de prévention ou des prises en charge susceptibles de permettre à long terme de réaliser de nombreuses économies – consultations en addictologie ou consultations de vaccination contre les virus HPV. On ne prend pourtant jamais en compte les dépenses que de telles consultations permettraient d’éviter ni les économies qu’elles permettraient de réaliser dans le futur.
L’absence de discussion conduit à un appauvrissement du parlementarisme. Tel qu’il est appliqué, l’article 40 ne permet même pas aux auteurs des amendements ou des propositions de loi déclarés irrecevables de défendre leur travail et d’expliquer qu’il n’entraînerait pas une détérioration des finances publiques, voire qu’il pourrait au contraire les assainir.
Alors que nombre de ministres déplorent ce qu’ils appellent le dérapage des dépenses liées aux arrêts maladie, par exemple, pourquoi ne pas permettre la discussion d’amendements ou de propositions de loi tendant à explorer de nouvelles pistes susceptibles de permettre la mise en œuvre d’une médecine du travail plus efficace et valorisée ?
Par ailleurs, que faire quand l’exécutif fait des annonces sans les budgétiser ? Pourquoi interdire aux parlementaires de proposer des mesures permettant par exemple la purification de l’air dans nos hôpitaux ou le nécessaire accompagnement financier par l’État d’un réel développement des transports publics dans nos territoires ?
Le rapporteur a souligné les difficultés rencontrées lors de l’examen du projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (3DS) : « Alors même que ces textes impliquent souvent la discussion de la répartition des compétences entre collectivités territoriales, des amendements tendant à modifier celle-ci sont régulièrement considérés comme créant de nouvelles charges et, partant, sont déclarés irrecevables. » Monsieur le garde des sceaux, il devient kafkaïen, pour ne pas dire impossible, de débattre d’une répartition des compétences et d’une réorganisation territoriale, celles-ci impliquant forcément de nouvelles charges. De tels débats sont pourtant nécessaires.
Loin de responsabiliser les parlementaires en les rendant attentifs à la dépense publique, l’article 40 les tient en marge de leurs obligations.
Son application aux propositions de loi a plusieurs conséquences.
Tout d’abord, elle réduit la portée de l’initiative parlementaire. En effet, comment proposer sans dépenser ? L’exemple de l’instauration d’un revenu universel est à cet égard éclairant. Si des études montrent les bénéfices économiques d’une telle mesure, y compris pour le budget de l’État, comment expliquer qu’il ne soit possible d’en discuter que par des voies législatives non normatives – propositions de résolution, débats ou questions écrites ?
En outre, monsieur le garde des sceaux – nul doute que vous serez sensible à cet argument –, l’article 40 a un effet assez pervers. À titre d’exemple, en matière pénale, lorsqu’une adaptation du droit est nécessaire, les parlementaires semblent avoir tendance, parce qu’ils ne peuvent pas proposer de mesures d’accompagnement coûteuses, à se replier sur des sanctions, telles de nouvelles peines de prison ou la création de nouvelles incriminations, sans prendre en compte la charge de travail qui en résultera pour les tribunaux ou le système pénitentiaire. Pas d’irrecevabilité dans ce cas-là !
Nous regrettons, monsieur le rapporteur, monsieur le garde des sceaux, qu’aucune des pistes d’assouplissement évoquées n’ait paru souhaitable à la commission, ne serait-ce que l’exclusion des propositions de loi de l’article 40 pour éviter le jeu de dupes qu’a constitué par exemple l’étude de la proposition de loi d’abrogation de la réforme des retraites portant l’âge légal de départ à 64 ans déposée par le groupe Liot à l’Assemblée nationale.
Le groupe GEST s’engage en faveur d’un parlementarisme raisonnable et affirmé et votera, je le rappelle, cette proposition de loi constitutionnelle.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.
Applaudissements sur les travées du groupe CRCE-K.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, dans notre Constitution, l’article 40 est un outil constitutionnel comparable à l’article 49, alinéa 3, dont la seconde salve s’abat sur l’Assemblée nationale. Tout comme lui, il s’apparente à une véritable tenaille, qui enserre la capacité des parlementaires – en l’espèce, à proposer une nouvelle dépense. L’article 49.3, c’est le couperet ; l’article 40, c’est la tenaille.
Souhaitant renforcer ici la démocratie parlementaire, nous demandons l’abrogation de cet article.
Mes chers collègues, la cohérence politique de notre groupe est incontestable, et nous avons pour nous la constance.
Le rapporteur de ce texte, notre collègue Stéphane Le Rudulier, a estimé que le paradoxe de finances publiques qui sombrent depuis les années 1970 alors même que les parlementaires étaient interdits de dépenser était un argument qui paraît « fallacieux ». Nous souscrivons !
Chers collègues de la majorité, vous vous apprêtez néanmoins à voter un cinquantième budget en déficit d’affilée. Mais, si l’endettement public était de 74 milliards d’euros en 1978, il atteint le montant faramineux de 3 046 milliards d’euros au second trimestre de cette année.
Si vous n’avez pas directement majoré les dépenses, vous ne vous êtes pas privés de rogner les recettes fiscales, en multipliant les réductions d’impôt, crédits d’impôt, niches fiscales et autres formes de démantèlement des recettes de l’État. Vous en avez le droit, car ce n’est pas stricto sensu une « dépense » : c’est bien, au sens de l’article 40 de la Constitution, une « diminution des ressources publiques », que vous gagez par une autre recette. Enfin, si c’est légistiquement vrai, c’est politiquement trompeur !
Si toutes les majorations du prix du tabac que vous avez demandées en créant ou prolongeant des niches fiscales avaient effectivement eu lieu, le paquet de cigarettes avoisinerait sans nul doute aujourd’hui les 1 000 euros ! Voilà le sérieux budgétaire prôné par les tenants de la rigueur…
Les membres du Gouvernement, notamment le ministre actuel de l’économie, M. Bruno Le Maire, se plaisent à fustiger des oppositions dépensières, alors qu’elles n’ont pas le droit de l’être par voie d’amendement.
Finalement, toute l’argumentation consiste à présumer l’irresponsabilité budgétaire des parlementaires, un comble quand les propositions de recettes nouvelles que notre groupe formule à hauteur de dizaines de milliards d’euros chaque année, à l’occasion de chaque loi de finances, sont rejetées au nom d’une « doctrine fiscale de la terre brûlée ».
Les parlementaires se font hara-kiri et, d’une certaine manière, entérinent leur soumission à l’exécutif, au seul motif qu’il « détermine et conduit la politique de la Nation », conformément à l’article 20 de la Constitution. Chers collègues, ne déposez plus d’amendements sur aucun texte, de sorte à vous appliquer vos propres préconisations !
Vous reconnaissez, monsieur le rapporteur, que le Gouvernement est seul légitime à formuler certaines propositions. Vous reconnaissez que l’article 40 est un outil contre le progrès social et, enfin, qu’il vous empêche de vous confronter à vos paradoxes en matière budgétaire.
Nous allons examiner un budget avec 358 amendements choisis par le seul Gouvernement, dans le cadre du détestable 49.3, exonérant ainsi ces nouvelles dispositions d’étude d’impact, donc de chiffrage financier. L’irresponsabilité n’est pas toujours là où on le croit…
Vous balayez tour à tour toute proposition de réforme de l’article 40 de la Constitution, au profit d’une amélioration timide de l’explication des raisons pour lesquelles il s’abat sur les parlementaires. Ne feignez pas de vouloir nous expliquer ce que nous comprenons bien assez…
Cette modification à la marge, éventuellement, du règlement du Sénat revient à nier l’importance démocratique du sujet.
Notre rapporteur a comparé notre Parlement au Parlement britannique. C’est un mauvais exemple, tant celui-ci est lui-même particulièrement bâillonné et pris dans des dynamiques majoritaires… Le Parlement français est quant à lui singulier : il est particulièrement maltraité et dépossédé de prérogatives budgétaires.
Monsieur le rapporteur, vous ne voulez pas de l’abrogation. Vous considérez qu’il faut conserver un corset parlementaire. Au moins pouviez-vous considérer de le desserrer !
Vous l’avez fait lors de notre échange, lequel a été cordial, respectueux et apprécié de part et d’autre. Vous dénonciez, vous aussi, l’effet couperet.
Vous avez avancé des propositions fort intéressantes, qui auraient pu nous rassembler, comme l’exigence de l’évaluation du coût effectif d’un amendement ou l’exercice d’un droit d’appel. Vous avez déclaré dans votre intervention que l’on aurait pu imaginer un aménagement pour fixer le montant de l’impact budgétaire de tel ou tel amendement, pour décider finalement qu’un tel aménagement était aventureux et qu’il n’était pas de saison.
Ces propositions n’apparaissent pas dans le texte, et c’est bien dommage. Décidément, on ne peut pas toucher à la loi d’airain de l’article 40 !
Toutes ces pistes sont refusées aujourd’hui. Chacun semble se complaire dans l’impuissance budgétaire. Pour notre part, nous nous réjouissons d’assister à un vrai débat autour d’une vision commune du Parlement, plaidant légitimement pour donner aux parlementaires les moyens de donner les moyens à la Nation.
Applaudissements sur les travées des groupes CRCE-K et SER. – Mme Nathalie Goulet et Vincent Louault applaudissent également.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je commencerai mon propos par une anecdote presque insignifiante dans la vie d’un parlementaire : voilà deux semaines, lors de l’examen de la proposition de loi renforçant la sécurité des élus locaux et la protection des maires, j’ai déposé mon premier amendement, lequel visait à élargir la protection fonctionnelle.
Je me suis heurté à la règle de l’article 40 de la Constitution, interdisant qu’un amendement conduise soit à une diminution des ressources publiques, soit à la création ou l’aggravation d’une charge publique. Rien de plus banal.
En conséquence de cette irrecevabilité, j’ai pris la parole dans l’hémicycle pour interpeller la ministre, et j’ai obtenu du Gouvernement l’engagement d’étudier le sujet et de déposer un amendement au cours de la navette.
D’où un étonnement légitime : n’aurait-il pas été plus simple que nous examinions directement l’amendement sénatorial, plutôt que d’être réduits à attendre et espérer sans certitude un amendement du Gouvernement ?

Bien entendu, la question de la recevabilité financière est celle de la maîtrise de la dépense publique. Cependant, sur ce point, nous faisons face à un premier paradoxe.
Comme chacun sait, le fondement de l’article 40 est de laisser au Gouvernement le privilège de la dépense publique, ce qui sous-entend que le Parlement n’aurait pas la pleine capacité de savoir ce qui est bon ou non pour notre budget.
Nous l’admettons. Ainsi, lors de l’examen des missions du projet de loi de finances, nous avons souvent du mal à évaluer le montant exact et réel des dépenses que nous proposons… Sauf qu’en laissant au Gouvernement ce privilège, la dette publique n’a jamais cessé de s’aggraver ! Les budgets présentés depuis des décennies n’ont jamais été réellement équilibrés.
Autrement dit, l’aggravation de la dépense publique que nous observons est produite uniquement par l’exécutif. Je crois qu’un tel constat doit nous amener à nous interroger sur la pertinence du critère financier comme argument dans la limitation du droit d’amendement.

Notre frustration est donc légitime, tout comme l’est l’examen d’une solution radicale. Je pense ici à celle que proposent les auteurs de la présente proposition de loi constitutionnelle : l’abrogation de l’article 40 de la Constitution.
Pour autant, je ne crois pas que ce soit la meilleure réponse à apporter.
Je veux rappeler les mots de Michel Debré lorsqu’il présentait la future Constitution de la Ve République : « Le projet de Constitution, rédigé à la lumière d’une longue et coûteuse expérience, comporte certains mécanismes très précis qui n’auraient pas leur place dans un texte de cette qualité si nous ne savions qu’ils sont nécessaires pour changer les mœurs. » Parmi ces mécanismes, nous pouvons compter ceux qui entourent le droit d’amendement, et plus particulièrement l’article 40.
En guise d’exemple, nous avons tous souffert, l’an dernier, de la manière dont s’est déroulé l’examen du projet de loi de finances. Qu’avons-nous constaté ? Une inflation significative du nombre d’amendements, conduisant à des débats bridés.
J’en tirerai deux conclusions : d’une part, malgré l’article 40, nous sommes bien capables d’amender ; d’autre part, en dépit de limitations peut-être excessives, nous sommes tout de même capables de trop amender.
Si chacun avait su montrer, au cours de ces dernières décennies, de la mesure et un usage raisonnable et sans excès de son droit, limitant au possible les amendements d’appel ou ceux dont le sort qui leur serait réservé était si évident qu’ils n’avaient que peu d’intérêt à être discutés, alors peut-être aurions-nous pu envisager une ouverture du droit d’amendement.
Rien ne l’indique, hélas ! Certes, le droit d’amendement est essentiel à notre Parlement. Ce droit doit être protégé et défendu. Nous le disons avec d’autant plus de conviction que le RDSE est un petit groupe, qui compte grandement sur ce droit pour s’exprimer.
Mais, de manière paradoxale, c’est aussi parce qu’il est limité et encadré qu’il trouve encore une forme d’intérêt et de légitimité.
Ces limites ordonnent notre discussion et nos échanges. Elles frustrent souvent, mais, sans elles, chacun sait combien nous risquerions de perdre du temps à discuter autour de dispositifs irréalisables et de débats sans contenu concret.
Aussi, vous l’aurez compris, mes chers collègues, nous voterons majoritairement contre cette proposition de loi constitutionnelle.
Mme Nathalie Goulet applaudit.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, c’est au moment même où l’équilibre budgétaire de l’État est le plus fragile, car la puissance publique a joué son rôle de protection pour nos concitoyens, qu’il nous est proposé de supprimer un dispositif qui vient, précisément, réguler la dépense publique. C’est un curieux paradoxe.
L’irrecevabilité financière des initiatives parlementaires est le fruit d’une rationalisation progressive et maîtrisée du parlementarisme.
Cette évolution est observable dans la plupart des démocraties parlementaires comparables à la nôtre, tout simplement parce qu’elle répond, partout, aux mêmes nécessités : celle de contenir l’extension croissante de la dépense publique, et celle qui consiste à partager la contrainte de l’équilibre budgétaire avec celle ou celui qui propose une dépense supplémentaire.
L’irrecevabilité financière prend racine en France sous la IIIe République, pourtant traditionnellement présentée comme étant l’âge d’or du parlementarisme dans notre pays. Dès 1920, on la retrouve dans le règlement de la Chambre des députés. Elle sera, par la suite, confirmée au niveau constitutionnel, par l’article 17 de la Constitution de 1946.
Il est donc inexact de relier ce mécanisme de régulation de la dépense publique au régime de la Ve République.
L’irrecevabilité financière des initiatives parlementaires est aujourd’hui prévue à l’article 40 de notre Constitution, que nos collègues communistes nous invitent à supprimer.
Jugé nécessaire par le constituant originaire durant les travaux préparatoires de la Constitution de la Ve République et jamais modifié depuis 1958, ce dispositif suscite immanquablement des frustrations, liées, finalement, à la confrontation entre volonté politique et principe de réalité.
De fait, l’envie de dépenses nouvelles est sans limites et, évidemment, tous les besoins sont bien loin d’être couverts. Mais celui qui propose la dépense nouvelle ne peut s’affranchir de la question de la recette. La contrainte concernant l’équilibre budgétaire doit être partagée.
Les décisions d’irrecevabilité fondées sur l’article 40 s’appuient sur une jurisprudence constitutionnelle et sur une pratique de nos assemblées exigeante. Cette procédure a d’ailleurs d’ores et déjà fait l’objet d’assouplissements dans le cadre d’un travail d’harmonisation entre les deux chambres, au bénéfice de l’initiative parlementaire.
Comme l’indique le rapporteur, dont je tiens à saluer le travail, « l’application de l’article 40 de la Constitution n’a jamais été aussi uniforme […] entre l’Assemblée nationale et le Sénat, répondant à la critique traditionnellement adressée d’une appréciation “à géométrie variable” de l’irrecevabilité financière ».
Au-delà, sur le fond, le filtre de l’article 40 constitue, de notre point de vue, un rempart indispensable contre l’excès de dépenses publiques.
Le vrai sujet est bien là, mes chers collègues : est-ce vraiment le moment d’ouvrir les vannes de la dépense publique, alors même que la situation financière de l’État est déjà très préoccupante ?
Comme chacune et chacun le sait, la dette de notre pays s’élève aujourd’hui à plus de 3 000 milliards d’euros, soit 110 % du PIB. C’est le résultat de budgets votés en déséquilibre depuis 1974 par toutes les majorités successives.
Pour se convaincre de l’intérêt de l’article 40, il suffit d’observer le spectacle offert par certains de nos collègues à l’Assemblée nationale à l’occasion de l’examen de chaque texte budgétaire.
Sur les 2 942 amendements déposés en commission sur la première partie du projet de loi de finances pour 2024 par les groupes d’opposition, 90 % tendaient à engager des dépenses supplémentaires.
Par exemple, le cumul des amendements du groupe LR avoisinait, selon les estimations du rapporteur général de la commission des finances, près de 100 milliards d’euros de charges publiques additionnelles pour le budget de l’État :…

… 6 milliards d’euros pour la réforme de la TVA sur les carburants ; 4 milliards d’euros pour la création d’un régime universel d’investissement locatif privé ; 3, 7 milliards d’euros pour la TVA à 5, 5 % pour les travaux de rénovation des logements pendant deux ans ; 3 milliards d’euros pour le crédit d’impôt visant à financer l’amortissement des emprunts contractés en vue de l’acquisition d’un logement neuf ; 2 milliards d’euros pour le rehaussement des plafonds du quotient familial…
Les groupes populistes sont ont également apporté leur contribution à cette velléité dépensière déraisonnable.
La Nupes a ainsi proposé, dans un véritable concours Lépine de l’amendement le plus incongru, d’augmenter le quotient familial des propriétaires d’animaux
Sourires sur plusieurs travées.

Les députés RN ont quant à eux proposé d’exonérer tous nos concitoyens de moins de 30 ans de l’impôt sur le revenu…
Toutes ces mesures démagogiques se chiffrent en dizaines de milliards d’euros et ne proposent naturellement aucune compensation crédible.
À la lumière de ces exemples, je vous laisse imaginer, mes chers collègues, ce que représenterait une suppression pure et simple des irrecevabilités financières !
Les oppositions, parce qu’elles s’exonèrent bien souvent de la contrainte budgétaire, usent et abusent du droit d’amendement, pour promouvoir, à grand renfort de communication, des positionnements politiques à destination de cibles électorales – chacun le sait ici.
Historiquement, le Sénat peut s’enorgueillir d’avoir toujours privilégié une approche plus responsable et constructive. Ainsi, plutôt que de supprimer l’article 40, le groupe RDPI suggère de poursuivre la réflexion sur les conditions de son application.
Par exemple, il pourrait être utile de soumettre l’application de l’article 40 au principe du contradictoire. À cet égard, notre groupe regarde avec bienveillance la proposition de résolution déposée par notre ancien collègue Jean-Pierre Sueur et ses collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain au début de cette année, laquelle visait à donner à l’auteur d’un amendement susceptible d’être déclaré irrecevable la possibilité d’adresser des observations écrites ou orales. Une telle évolution nous semble opportune.
Parmi les autres pistes méritant d’être explorées figure la mise en place d’un mécanisme de recours interne devant le bureau du Sénat ou un groupe créé à cet effet.
Si ces propositions comportent bien évidemment le risque d’alourdir davantage la procédure législative, elles ont au moins le mérite, contrairement à cette proposition de loi constitutionnelle, de préserver des garde-fous contre le basculement vers une gestion intenable de nos finances publiques.
Applaudissements sur les travées du groupe SER.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la procédure parlementaire peut donner lieu à des batailles politiques, et la politique à des batailles de procédure.
En témoignent la discussion parlementaire relative à la réforme des retraites, puis celle sur la proposition de loi du groupe Liot, à l’Assemblée nationale, qui visait à son abrogation.
Cette proposition de loi était, selon certains, irrecevable au titre de l’article 40, dont il est ici question, et aurait donc été inconstitutionnelle. Et pourtant, il y avait matière à débat parlementaire…
Faut-il abroger ou non l’article 40 de la Constitution ?
Comme l’ont affirmé plusieurs de mes collègues, les parlementaires seraient-ils, par nature, irresponsables, voire incompétents, sur le plan budgétaire ?
Sans l’article 40, l’exécutif serait-il démuni de tous les outils constitutionnels dont il dispose pour contrôler le Parlement, outils dont il se sert pourtant régulièrement, de plus en plus et, selon certains, de façon légèrement excessive ?
Les articles 49.3, 44.3 ou encore diverses règles des assemblées elles-mêmes ne suffisent-ils pas à contraindre le pouvoir législatif ?
N’est-il pas temps, en réalité, de libérer les parlementaires, et, comme le suggéraient Didier Migaud et Jean Arthuis, de les responsabiliser et de rééquilibrer notre édifice institutionnel pour redonner de la force à notre démocratie ?
Notre réponse est « oui », car notre volonté est de « reparlementariser » le régime.
Si la Constitution de 1958 institue, en théorie, un régime parlementaire doté d’un exécutif fort, la pratique qu’en ont eu le général de Gaulle et ses successeurs fait que nous vivons, hors périodes de cohabitation, au sein d’un système présidentialiste.
Malgré les diverses évolutions qu’elle a connues, notamment avec la réforme de 2008, notre pratique de la norme juridique suprême maintient le Parlement sous la domination de l’exécutif, par l’instauration de mécanismes de parlementarisme rationalisé. Et la pratique de l’exécutif actuel, malgré sa majorité relative, est à l’apogée de ce phénomène de domination, confinant parfois à l’abus.
Comme le précisa le commissaire du gouvernement Janot en 1958, la disposition de l’article 40 constitutionnalisait la loi dite des maxima, prévue par l’article 14 de la Constitution de 1946.
Pourtant, contrairement à cette loi, qui autorisait le Parlement à compenser une augmentation de charge publique par une diminution des dépenses à due concurrence, la Constitution du 4 octobre 1958 a ôté aux parlementaires l’initiative de la dépense, en leur retirant toute possibilité de compensation.
Le champ de l’article 40, qui était déjà très étendu, a, de plus, été élargi par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui a elle-même poussé à une convergence, encore imparfaite, entre l’Assemblée nationale et le Sénat. Ainsi, les charges publiques visées concernent l’ensemble des administrations publiques entrant dans le calcul des déficits et de la dette publique, donc également les collectivités territoriales.
La révision de 2008, qui visait le rééquilibrage des pouvoirs, a néanmoins conservé le mécanisme des irrecevabilités législatives.
Dans un rapport de l’OCDE datant de 2014, on observe que, parmi les 38 pays qui composent l’organisation, 52 % disposent d’un pouvoir législatif détenant un pouvoir d’amendement illimité, quand 24 % peuvent modifier le budget dans le cadre de limites posées par l’exécutif. Si l’on résume, les trois quarts des pays de l’OCDE peuvent totalement ou partiellement intervenir en matière budgétaire !
Pour le quart restant, certains sont uniquement autorisés à réduire les postes existants – le Chili et le Royaume-Uni –, d’autres à approuver ou à rejeter le budget – la Grèce et l’Irlande –, ou encore à intervenir selon d’autres règles.
Ainsi, en Australie, le corps législatif n’a qu’un pouvoir d’amendement sur les nouvelles politiques. Au Canada et en Corée du Sud, le corps législatif est autorisé à modifier le budget sous réserve de l’approbation de l’exécutif.
Ce que nous retenons, c’est que la France se distingue, parmi tous les autres pays qui lui sont comparables, en ce que le pouvoir législatif ne peut que réaffecter les ressources à l’intérieur du budget total ; il ne peut ni diminuer les ressources ni aggraver l’équilibre.
Pour ses promoteurs, l’objectif principal assigné à l’article 40 était d’assurer une gestion sérieuse des finances publiques. Force est de constater que l’objectif est loin d’être atteint.
Le président Paul Reynaud avait livré, au moment des travaux préparatoires de la Ve République, la prophétie suivante : « Les parlementaires vont devenir des économes devant un gouvernement dépensier. »
Comme le soulignaient Didier Migaud et Jean Arthuis en 2008, les parlementaires sont devenus des « sages budgétaires » : à l’Assemblée nationale comme au Sénat, entre 4 % et 8 % seulement des amendements parlementaires sont déclarés irrecevables au titre de l’article 40.
Pourtant, la dette publique était de 1 200 milliards d’euros en 2008 et se situait, à la fin de l’année 2022, autour de 2 950 milliards d’euros, avec une augmentation sans précédent sous la présidence d’Emmanuel Macron.
Les effets pervers de l’article 40 s’observent dans de multiples techniques de contournement, par la formulation de propositions de rapport ou par le mécanisme du célèbre « gage tabac », autant de techniques qui nuisent à la sincérité du débat parlementaire, voire affranchissent les parlementaires de l’estimation du coût réel des mesures proposées. Contrairement aux apparences, le mécanisme du gage produit, en réalité, de la déresponsabilisation.
Ces effets pervers s’observent également lors de l’examen du projet de loi de finances. L’article 47 de la loi organique relative aux lois de finances permet aux parlementaires d’amender exclusivement au sein de la même mission, aboutissant à des situations invraisemblables. Peut-on encore considérer que le vote du budget par le Parlement relève d’un acte démocratique lorsque l’on connaît la marge de manœuvre dont il dispose ?
Le comité Balladur avait proposé d’assouplir le régime de l’irrecevabilité financière de sorte que les amendements et les propositions des parlementaires ne soient irrecevables que lorsqu’ils entraînent une aggravation des charges publiques, et non d’une seule charge publique.
Comme l’a rappelé en commission mon collègue Éric Kerrouche, dont je salue ici le travail qu’il mène sur ces sujets, Jean Arthuis et Didier Migaud avaient avancé qu’une telle réforme aurait vidé l’article 40 de son contenu. Alors qu’ils présidaient respectivement les commissions des finances du Sénat et de l’Assemblée nationale, ils avaient affirmé que seule la suppression de cet article permettrait un réel renforcement des pouvoirs du Parlement et une responsabilisation des élus.
Par ailleurs, la suppression de l’article 40 de la Constitution constituerait un gage efficace contre l’hyperprésidentialisation de la Ve République et permettrait de rétablir un équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, ce dernier bénéficiant toujours d’autres armes dans l’arsenal procédural et, la plupart du temps – même si ce n’est pas toujours –, du fait majoritaire.
La suppression de l’article 40 de la Constitution n’exclut pas, bien au contraire, le maintien d’un contrôle interne au Parlement, donc une révision du règlement des assemblées allant dans le sens du renforcement de la fonction de contrôle et d’évaluation, ce qui nécessite, bien sûr, davantage de moyens humains et financiers.
Par exemple, les textes d’initiative parlementaire pourraient être soumis au contrôle d’une commission restreinte, composée de représentants de la majorité et de l’opposition, qui seraient contraints de motiver leurs avis, favorables comme défavorables.
Mes chers collègues, nous ne considérons pas que la suppression de l’article 40 encouragerait les parlementaires à la gabegie. Elle est, au contraire, l’occasion de responsabiliser les élus et ouvre de nouvelles perspectives d’initiative législative.
Si cette mesure ne se suffit pas par elle-même, elle va dans le sens du renforcement du poids de l’institution parlementaire et participerait, si elle était votée, à la vitalité démocratique de notre pays.
C’est pourquoi mon groupe votera en faveur de cette proposition de loi constitutionnelle du groupe CRCE-K, à l’exception, bien sûr, de notre collègue Claude Raynal, qui, en tant que président de la commission des finances, ne prendra pas part au vote.
Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.

La discussion générale est close.
La commission n’ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l’article unique de la proposition de loi constitutionnelle initiale.
L’article 40 de la Constitution est abrogé.

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. V. Louault, Mmes L. Darcos et Bourcier, MM. Brault et Malhuret, Mme Lermytte, M. A. Marc, Mme Paoli-Gagin et MM. Chevalier, Wattebled, Capus et L. Vogel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La Constitution est ainsi modifiée :
1° L’article 47 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit de présenter ou d’adopter une loi de finances dont la section de fonctionnement est en déficit. »
2° L’article 47-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit de présenter ou d’adopter une loi de financement de la sécurité sociale dont l’ensemble des charges dépasse l’ensemble des recettes. »
La parole est à M. Vincent Louault.

Il s’agit d’un amendement d’appel – un appel au secours –, que je retirerai.
La charge de la dette s’élève, nous l’avons tous dit, à quelque 50 milliards d’euros. Je suis né en 1972 : 50 ans, 50 milliards d’euros. Je ne souhaite pas qu’à mes 70 ans, cette somme ait atteint 70 milliards…
Nous devons donc lancer une réflexion sur la modernisation de nos institutions. Je remercie d’ailleurs le groupe CRCE-K d’avoir lancé ce débat d’importance, car les anciens du Sénat m’ont tous prévenu de la dureté de l’application de cette disposition, destinée à empêcher le débat parlementaire.
Je reviens à mon amendement. Il y va de l’avenir de notre pays : même si on ne rembourse pas les dettes, le poids des intérêts commence à être difficilement admissible.

Je comprends parfaitement cet amendement d’appel, j’en partage même l’intention.
Néanmoins, je formulerai trois remarques à son propos.
En premier lieu, l’objet de cet amendement est très éloigné du texte que nous examinons, qui porte sur l’article 40 de la Constitution. L’idée est en effet de s’inspirer, par un effet de miroir, de la règle d’or et même de la double règle d’or qui s’applique aux collectivités territoriales : l’exigence d’un équilibre au sein de la section de fonctionnement et au sein de la section d’investissement, mais également l’interdiction d’emprunter pour financer les dépenses de fonctionnement. Cela peut certes prêter à débat, mais de manière totalement indépendante.
En second lieu, l’un des arguments opposés à nos collègues communistes concernant l’abrogation ou la modification de l’article 40 consiste en la volonté de ne pas alourdir la procédure législative en matière de finances publiques. Or amender l’article 47-1 de la Constitution dans le sens proposé alourdirait justement cette procédure.
En troisième lieu, enfin – on pourrait toutefois en débattre –, si le déficit avait été totalement interdit lors d’une crise comme celle de la covid-19, nous aurions été confrontés à certaines complications lors de l’exécution budgétaire et de l’élaboration du budget.
Toutefois, je le répète, sur le principe, je suis d’accord pour discuter de cette disposition.
Je n’ai rien à ajouter aux propos du rapporteur, tout a été clairement dit et l’exemple convoqué était pertinent.

Cette règle d’or, nous avons essayé, dans cette maison, lors de la révision constitutionnelle de 2008, de l’instaurer au travers d’un amendement du célèbre Alain Lambert – ancien sénateur de l’Orne –, mais sans succès. Lors de la prochaine révision constitutionnelle, nous pourrons peut-être réétudier cette éventualité.
En attendant, nous ne voterons pas cet amendement.

J’ai pris connaissance de votre amendement, mon cher collègue ; il est, disons, étonnant…
Vous dites que vous n’allez pas le maintenir, soit ; mais ce n’est pas un appel au secours, c’est un amendement bâillon !
Sourires sur diverses travées.

Tout d’abord, le Conseil constitutionnel, garant de la Constitution, censurerait assurément votre règle d’or ; pourtant, alors que vous le savez pertinemment, vous déposez tout de même votre amendement.
Ensuite, deuxième motif d’étonnement, votre groupe, Les Indépendants – République et Territoires, vient justement de déposer une proposition de loi visant à créer un énième produit d’épargne sans intérêt et qui creuserait le déficit public en privant l’État de recettes fiscales – et vous allez jusqu’à proposer d’exonérer ce produit de droits de mutation à titre gratuit !

Franchement, quelle est la sincérité de votre appel au secours ? On peut toujours essayer, mais le geste est un peu populiste…
En outre, je ne veux pas défendre le Gouvernement, mais chacun sait que l’État, comme les collectivités territoriales, doit pouvoir s’endetter pour mener ses politiques publiques. On ne peut pas faire d’investissement public, y compris dans les collectivités territoriales, sans s’endetter.
En deuxième lieu, je vous entends souvent dire – je pense notamment à votre collègue Malhuret – qu’il faut gérer les finances publiques comme les finances des ménages ou des entreprises, mais allez donc discuter avec des chefs d’entreprise, demandez-leur s’ils n’ont pas besoin de s’endetter pour assumer des investissements, ils vous répondront ! Demandez à un boulanger s’il achète son four à pain au comptant ou à crédit ! Demandez-vous aussi combien de familles ont les moyens d’acheter leur voiture au comptant !
Bref, cet amendement bâillon n’est pas dans l’esprit de notre proposition de loi constitutionnelle et il est d’un niveau démagogique sans comparaison par rapport aux contributions que nous avons entendues au sein de cet hémicycle. Vous avez indiqué avoir l’intention de le retirer ; si vous le faites, vous ferez preuve de responsabilité.

Je vais mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle.
Je rappelle que le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Je veux ajouter quelques touches à ce débat.
Au préalable, je tiens à remercier l’ensemble des collègues de tous les groupes de leurs interventions et de l’intérêt qu’ils ont porté à notre proposition d’abrogation de l’article 40 de la Constitution.
Ensuite, notre collègue André Reichardt, au nom du groupe Les Républicains et de la majorité sénatoriale, a demandé « ardemment » que soit donnée une « suite sérieuse » à ce débat. Eh bien, chers collègues de la majorité sénatoriale, la balle est donc dans votre camp ! Allez-y, donnez « ardemment » une suite sérieuse à ce débat !
Par ailleurs, je vous ai trouvé un point commun, parmi de nombreux autres, monsieur le rapporteur et monsieur le garde des sceaux. M. Le Rudulier nous indique d’abord que cette proposition de loi constitutionnelle est conjoncturelle, l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale, où il n’y a qu’une majorité relative, justifiant le parlementarisme rationalisé. Le Gouvernement, par le truchement du garde des sceaux, vous rejoint, monsieur le rapporteur, et vous nous donnez, main dans la main, la même explication : cet article serait « la clé de voûte de la Ve République » et s’inscrirait même dans le prolongement de la IVe République ; rien que cela…
À l’appui de son argumentation, M. Dupond-Moretti se réfère à l’article 20 de la Constitution. Sans doute, monsieur le garde des sceaux, aux termes de cet article, « le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation », mais n’oubliez-vous pas quelque chose ? Le quinquennat et l’inversion du calendrier ! Le Président de la République est élu avant les députés ! Il est là, le problème de l’utilisation des articles 49.3, 40, etc. ! Les élections législatives sont maintenant déterminées par le choix du Président de la République, même si c’est parfois avec des résultats un peu douloureux. Tout le monde l’a bien compris !
Je conclus en revenant sur les éventuelles suites à donner. Si l’on peut apporter des modifications en ce sens dans le règlement intérieur de chacune des deux chambres, même si celui de l’Assemblée nationale n’est pas de notre ressort, il faut le faire : toute avancée sera bonne à prendre. Cela dit, j’y insiste, si nous constatons tous que les choses ne vont pas, si nous dressons tous le diagnostic d’un déficit d’initiative parlementaire, il y a un caractère d’urgence. L’idéal serait donc d’adopter le principe de l’abrogation de l’article 40, car cela enclencherait une dynamique en faveur de la révision constitutionnelle.

Plus personne ne demande la parole ?…
Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi constitutionnelle visant à abroger l’article 40 de la Constitution.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.

Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.
Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 22 :
Le Sénat n’a pas adopté.

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 6 novembre 2023 :
À seize heures et le soir :
Projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (procédure accélérée ; texte de la commission n° 434 rectifié, 2022-2023).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-sept heures cinquante.