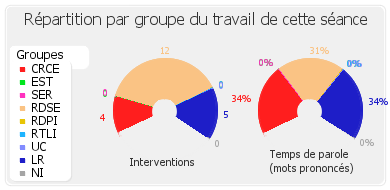Séance en hémicycle du 29 janvier 2008 à 16h15
Sommaire
La séance
La séance, suspendue à douze heures trente-cinq, est reprise à seize heures quinze, sous la présidence de M. Christian Poncelet.

La séance est reprise.

M. le président. Un éminent collègue que beaucoup d'entre nous appréciaient particulièrement nous a quittés dans les derniers jours de l'année 2007.
M. le Premier ministre, Mme le garde des sceaux, M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent.

Serge Vinçon, sénateur du Cher et président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées de notre Haute Assemblée, est mort le 16 décembre dernier.
C'est peu de dire que, toutes et tous, nous avons ressenti, à l'annonce de son décès, une grande douleur, une profonde tristesse et une extrême affliction.
Serge Vinçon a été emporté dans la force de l'âge, au faîte d'une carrière qui était loin d'être achevée.
Vous me pardonnerez de penser aussi, en cet instant, aux trois gendarmes morts tragiquement alors qu'ils accomplissaient leur devoir, et que nous avons enterrés ce matin.
La mort de Serge Vinçon a mis un terme brutal et prématuré à un parcours sans fautes ni failles.
Son dernier combat, il l'a livré voilà un an, après l'accident cardiovasculaire qui l'avait brutalement atteint, nous plongeant déjà dans la consternation, à quelques jours des fêtes de fin d'année.
Serge Vinçon était un homme doté d'une force morale peu commune. Il a puisé jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, dans cette formidable énergie qui l'a toujours habité le courage infini de faire face aux lourdes responsabilités que lui avaient confiées ses concitoyens et ses collègues du Sénat, qui l'estimaient tant.
Serge Vinçon était aussi un grand serviteur de la personne humaine, unanimement respecté, au parcours exceptionnel et à l'engagement républicain exemplaire, un homme à la fidélité inaltérable, aux convictions intransigeantes, à l'engagement passionné.
Né à Bourges il y a moins de cinquante-neuf ans, au coeur même de ce département du Cher qu'il aimait tant, Serge Vinçon était l'aîné d'une famille de neuf enfants. Il revendiquait ses origines modestes et y était demeuré profondément fidèle.
Professeur au collège de Saint-Amand-Montrond, il se fera très vite remarquer pour ses qualités pédagogiques et sera unanimement apprécié et aimé de ses élèves comme de ses collègues.
Très tôt, il manifeste aussi un goût aigu pour les affaires publiques.
Élu une première fois en 1977 conseiller municipal de la capitale du Boischaut, il en deviendra maire en 1983, à trente-quatre ans.
Il sera réélu sans discontinuer jusqu'à ce que la vie le quitte. Son attachement indéfectible à sa ville ne sera jamais démenti et c'est pour distinguer son action dynamique que lui sera notamment remise, en 1995, une « Marianne d'or » à la mairie de Saint-Amand-Montrond.
Parallèlement, presque naturellement, Serge Vinçon deviendra président de l'association des maires du Cher en 1995. En 2001, il sera distingué du titre de président de Ville et Métiers d'Art, avant de devenir, l'année suivante, président de l'association homologue européenne.
Passionné par sa ville, Serge Vinçon le fut aussi par son département du Cher.
Élu sénateur en septembre 1989, il sait, dès son arrivée au sein de la Haute Assemblée, se faire apprécier de tous. Qui ne se souvient de son extrême courtoisie, de son attention aux autres, de la finesse de son intelligence et du respect qu'il apportait aux opinions de chacune et de chacun ?
Approfondissant encore son implication locale, Serge Vinçon fut élu, en 1992, conseiller général du canton de Saint-Amand-Montrond. Réélu en 1998, il présida alors aux destinées de l'assemblée départementale jusqu'en 2001. Il y déploya l'efficacité qui est très vite devenue sa marque, en faveur de l'aménagement du territoire et du développement économique de son département. Il fut toujours soucieux de mettre en valeur l'histoire et la richesse culturelle de ce département central dans lequel, dit-on, « battent puissamment les trois coeurs de la France ».
Auditeur de la quarante-septième session de l'Institut des hautes études de défense nationale en 1994-1995, il cultiva un intérêt jamais démenti pour les questions de défense. À ce titre, il fut désigné, en 1995, au Rassemblement pour la République, secrétaire national chargé de la défense, puis, en 1996, président fondateur de l'association Diplomatie et Défense.
Il fut aussi, à partir de 1993, rapporteur pour avis du budget des forces terrestres au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. Une nouvelle page de son activité parlementaire s'écrivit alors.
Dès février 1996, il fut élu au bureau de cette même commission, à laquelle il allait montrer tant d'attachement.
Réélu au Sénat en 1998, il fut porté à la fois aux fonctions de vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense et de secrétaire national chargé des affaires européennes du Rassemblement pour la République. Dans ces nouvelles responsabilités, Serge Vinçon suscitera l'estime de tous par la pertinence de ses analyses, mais aussi par ses qualités humaines incomparables.
Continuant à remplir ses différents mandats, il décida en mars 2001 de ne pas se représenter à la présidence du conseil général du Cher, afin de privilégier le lien direct avec ses chers administrés saint-amandois. Ces derniers lui manifesteront sans réserve leur confiance en le renouvelant, encore une fois, à la tête de la commune.
Fort de ce parcours exemplaire, Serge Vinçon fut alors désigné par ses pairs aux fonctions de vice-président du Sénat. Chacun, dans cet hémicycle, se souvient de son doigté, de sa compétence et de son savoir-faire, et - pourquoi ne pas le dire ? - de sa gentillesse dans la conduite, parfois délicate, de nos débats.
La douce et talentueuse autorité dont Serge Vinçon fit preuve dans ces fonctions, puis, plus tard, à la tête de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, révélait à l'évidence une facette de sa personnalité : un homme profondément cultivé, subtil, à l'intelligence aiguisée, et qui aimait les autres sans faire de distinctions selon les fonctions ou les grades.
Parallèlement à son engagement politique, Serge Vinçon avait montré, dès son adolescence, une réelle passion pour la poésie et l'écriture. Sa réserve naturelle l'avait conduit à ne révéler que tardivement ce jardin secret. Il aura attendu l'an 2000 pour publier son premier recueil, intitulé Proésie, craignant jusqu'au dernier instant de se révéler sous un jour singulier. Il nous fit parfois, au Sénat, le plaisir de quelques démonstrations de son talent, rosissant, chaque fois, sous les compliments, comme un débutant.
« L'art est un jeu. Tant pis pour celui qui s'en fait un devoir », écrivait Max Jacob. Il est vrai que la poésie était pour Serge Vinçon, comme il l'avouait lui-même, l'achèvement de sa liberté de pensée, la soupape par laquelle il exprimait ses émotions les plus profondes.
Sa ville de Saint-Amand-Montrond fut l'objet constant de son inspiration, allant jusqu'à la mise en musique d'une de ses poésies.
En 2004, élu de la région Centre, Serge Vinçon démissionnera de son mandat, en application de la loi sur le cumul des mandats, mais il réalisera alors son voeu le plus cher en étant élu, en octobre de la même année, président de notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Il ne cessera alors d'être ce président plein de finesse, compétent, dynamique, assidu et efficace, que tous ici ont apprécié.
Assurant parallèlement la présidence active de groupes d'amitié, avec la Slovénie et avec la Jordanie, Serge Vinçon portait haut les couleurs du Sénat et ne dédaignait pas de porter aussi haut son engagement au service d'une certaine idée de la grandeur de notre nation.
C'est dans cet esprit qu'il prit une part active à la réforme du service national et à la professionnalisation de nos forces armées.
Serge Vinçon était de ces hommes publics chaleureux, toujours bienveillants et sachant s'intéresser à chacun, un homme d'une absolue fidélité envers les siens, d'une réelle authenticité dans l'engagement : double exigence qui s'impose, oui, qui s'impose à chacune et à chacun d'entre nous et qui demeure, sans aucun doute, la qualité éminente des grands serviteurs de la République.
Serge Vinçon restera pour tous une référence. Jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité de ses forces, jusqu'à ses derniers jours, il poursuivit sa tâche.
Il avait insisté, en juillet dernier, pour que la commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dont il était membre, se réunisse au Sénat, ce lieu où il apporta, avec modestie et efficacité, sa contribution personnelle à la démonstration permanente qu'il est une enceinte privilégiée de la réflexion et de la sagesse.
Ainsi fut Serge Vinçon, notre collègue, notre ami. Ce fils de la République en fut un serviteur éminent. S'il fit honneur au Sénat, à son département et à sa ville, il fut aussi l'honneur de la République.
À ses collègues de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, unanimement touchés par la disparition de leur cher président, j'exprime toute la compassion du Sénat.
À ses collègues du groupe de l'UMP, cruellement éprouvé par la disparition, en moins d'un an, de quatre des siens, j'adresse mes sentiments de vive et profonde sympathie.
À son épouse, Bernadette, à sa fille, Maud, à ses parents et à tous ses proches qui vivent intensément la douleur de la séparation d'un être aimé, je tiens à dire combien nous partageons leur chagrin. Qu'ils soient assurés que, dans ces murs, la figure, la voix et le souvenir de Serge Vinçon resteront présents, à la mesure de l'homme d'exception qu'il fut.
Que Serge Vinçon repose en paix !
Je vous invite maintenant, monsieur le Premier ministre, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, à observer une minute de silence en mémoire de notre collègue.
M. le Premier ministre, Mme le garde des sceaux, M. le secrétaire d'État, Mmes et MM. les sénateurs observent une minute de silence.
Madame, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le Sénat est une tribune. Les hommes y existent d'abord par leur voix. Nous n'entendrons plus celle de Serge Vinçon.
Cette voix qui, je m'en souviens, se mêla à plusieurs reprises à la mienne lors de combats politiques communs, cette voix qui parlait avec douceur des Français, mais avec fermeté de la France, cette voix s'est éteinte le 16 décembre dernier.
Au moment de rendre hommage au sénateur du Cher, ancien vice-président du Sénat, j'ai relu quelques-unes de ses dernières interventions. J'ai retrouvé dans leur ton tout ce qui nous rendait Serge Vinçon si précieux, et qui, je m'empresse de l'ajouter, le rendait si utile à la France.
La justesse des termes, signe d'une connaissance exacte et, pour ainsi dire méticuleuse, des dossiers ; l'équilibre de la réflexion, indice de sa probité intellectuelle ; la parfaite courtoisie de l'homme, reflet de son élégance tranquille : tout cela recommandait le sénateur Vinçon à l'estime de tous.
Propriété des termes, équilibre des parties, ces qualités étaient d'abord celles de l'enseignant. Serge Vinçon avait su en faire celles de l'élu.
Le professeur de lettres était devenu maire de Saint-Amand-Montrond en 1983, président du conseil général du Cher en 1998, président de la commission de la défense, des affaires étrangères et des forces armées du Sénat en 2004.
Cette trajectoire récompensait l'homme de convictions et de rassemblement qu'il était.
Au sein de la commission de la défense, sa maîtrise des dossiers l'avait imposé comme l'un des plus brillants avocats de l'ambition stratégique et militaire française.
Serge Vinçon voulait une défense réactive, dotée de la doctrine et des équipements les plus modernes et les plus adaptés aux conditions géopolitiques. Il avait, je m'en souviens, oeuvré de manière décidée en faveur de la professionnalisation des armées.
Dans ce combat déjà ancien, j'avais trouvé en lui l'appui d'une conviction libre et éclairée.
Bourbonnais, Berry, Boischaut : Serge Vinçon avait son territoire aux confins de ces vieux pays français. Il en connaissait presque chaque famille, chaque paysage. Son amour de la nation trouvait là ses sources.
Pour Saint-Amand-Montrond, sa ville, il avait composé des poèmes. Reconnaissons la sincérité de l'homme à cette attention inattendue. Nous avons tous l'amour de nos territoires ; Serge Vinçon, homme de lettres, homme de coeur, avait pris le temps de l'exprimer, à sa manière attachante. En consacrant une Cité de l'or à la tradition locale de l'orfèvrerie, il avait montré que le raffinement, la richesse et le rêve existent au coeur des pays les plus discrets.
Serge Vinçon obéissait à la rigueur de ses mandats sans étouffer la sensibilité de son tempérament. Son engagement politique n'altérait pas la tempérance de ses jugements, ne rompait jamais le fil de son humanisme.
Il avait le sens des responsabilités historiques, la conscience profonde de ce que chaque homme doit à sa ville, à sa terre et à son pays.
Il honorait cette assemblée de son dévouement et de sa droiture.
Sa hauteur morale et intellectuelle était mise au service d'une certaine idée de la France. Je serai fidèle à son souvenir si j'ai pu rappeler en quelques mots tout ce que la République lui doit.
Au nom du Gouvernement, mais aussi en mon nom personnel, j'adresse à sa famille et à ses proches le témoignage de notre affection.

Je vous remercie, monsieur le Premier ministre, de vous associer personnellement et au nom du Gouvernement à la tristesse qui est la nôtre.
Mes chers collègues, conformément à notre tradition, nous allons interrompre nos travaux pendant quelques instants en signe de deuil.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, est reprise à dix-sept heures.


J'informe le Sénat que, en application de l'article 67 du règlement, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat présente une motion tendant à proposer au Président de la République de soumettre au référendum le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution.
Ce n'est pas la première fois qu'une motion tendant à renvoyer un projet de loi au référendum est déposée sur le bureau de notre assemblée, mais c'est la première fois qu'une telle motion concerne un projet de loi de révision constitutionnelle, dont la procédure d'adoption est prévue par l'article 89 de la Constitution.
Certes, il est arrivé que l'article 11 de la Constitution, auquel renvoie notre règlement, ait pu être utilisé pour réviser la Constitution, mais il s'agit d'un point de droit controversé sur lequel il me paraît préférable, avant de constater la recevabilité de cette motion, de consulter la commission des lois.
Je propose donc de suspendre la séance pour laisser le temps à celle-ci de donner son avis sur ce point.
Monsieur le président de la commission des lois, de combien de temps souhaitez-vous disposer pour examiner la recevabilité de la motion ?

Quinze minutes au moins me paraissent nécessaires. Mais nous sommes à vos ordres, monsieur le président !

À quoi bon réunir la commission avant de savoir si la motion est recevable ? Vérifions d'abord cela : nous gagnerons du temps !

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.

La séance est reprise.
La parole est à M. le président de la commission des lois, pour faire part des conclusions de la commission sur la motion déposée par Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Et elle s'est prononcée grâce à des pouvoirs donnés par des absents ! C'est une honte !

Elle a constaté, d'une part, que le projet de loi dont le Sénat est saisi était, non un projet de loi simple, mais un projet de loi constitutionnelle et, d'autre part, qu'il nous était soumis dans le cadre de la procédure de l'article 89 de la Constitution, sur l'initiative du Président de la République, non dans le cadre de la procédure de l'article 11.
Pour ces deux motifs, la commission des lois estime que la motion tendant à soumettre à référendum ce projet de loi est irrecevable.

Le Sénat va se prononcer sur la recevabilité de cette motion référendaire.
J'indique d'ores et déjà que j'ai été saisi par M. Henri de Raincourt, au nom du groupe UMP, d'une demande de scrutin public.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, je ferai d'abord observer que le bureau du Sénat aurait, en principe, dû être saisi pour se prononcer sur la recevabilité de cette motion.
En tout état de cause, la décision appartient à notre assemblée tout entière et non à la commission des lois, qui a d'ailleurs statué avec des pouvoirs d'emblée suspects puisque ceux qui les ont donnés ne savaient pas qu'elle allait se réunir. §
Nous avons déposé, en vertu de l'article 67 de notre règlement, une motion tendant à soumettre au référendum le projet de loi constitutionnelle dont nous devons débattre aujourd'hui.
L'article 67 indique que seuls les textes portant sur les matières définies à l'article 11 de la Constitution relèvent de ce type de motion.
Avec les cosignataires de cette motion, j'affirme que notre demande est légitime, et cela pour deux raisons.
Premièrement, un débat doctrinal existe depuis les deux précédents de 1962 et 1969, dates auxquelles deux projets de loi portant révision de la Constitution ont été soumis au référendum par le général de Gaulle.

Non, ce ne sont pas des précédents puisque ces révisions s'appuyaient sur l'article 11, qui a d'ailleurs été modifié depuis !

Qu'on conteste ou non le bien-fondé du recours, à l'époque, à l'article 11, ces précédents existent et, dès lors, soumettre au référendum ce projet de révision est juridiquement acceptable.
MM. Pierre Avril et Jean Gicquel, dans leur ouvrage de référence sur le droit parlementaire, le confirment : « L'application de l'article 89 de la Constitution n'est pas exclusive en matière de révision, comme l'a montré le précédent de la loi n°62-1292 du 6 novembre 1962, dont les articles 1er et 2 révisent les articles 6 et 7 de la Constitution en instituant l'élection au suffrage universel du Président de la République. Adoptée suivant la procédure de l'article 11 de la Constitution par le référendum du 28 octobre 1962, cette loi avait naturellement été soustraite à l'élaboration parlementaire. »
Rien n'empêche une mise en oeuvre de l'article 11 sur une révision constitutionnelle. Certains pourraient tenter de s'opposer à cette démarche, ce que fait apparemment la majorité de la commission des lois, en indiquant que l'article 11 s'appliquerait aux seuls projets de loi, excluant de son champ les lois organiques et constitutionnelles.
Là encore, si le doute peut exister, la doctrine est claire. MM. Prélot et Boulouis, dans leur ouvrage Institutions politiques et droit constitutionnel, sont explicites : « L'article 11 mentionne ?tout projet de loi?. Or cette formule englobe bien les projets de loi de révision comme les autres. Il ne pourrait en être autrement que si une exclusion particulière était indiquée. Tel n'est pas le cas. »
J'ajouterai que le fait que nous soyons dans une procédure globale de ratification, dont la révision est l'un des éléments au titre de l'article 54 de la Constitution, légitime plus encore notre démarche.
Notre deuxième argument, une fois la recevabilité juridique démontrée, est plus politique.
Je vous rappelle que l'article 89 de la Constitution pose le principe du référendum pour le vote d'une révision de la Constitution.
C'est le Président de la République, et lui seul, qui décide de s'interposer entre le Parlement et le peuple pour clôturer la discussion en convoquant le Parlement en Congrès.
Contrairement à ce qui est prétendu, il n'est pas valorisant pour les assemblées de supplanter le peuple. Affirmer les droits du Parlement, c'est lui permettre de répondre à la démarche du Président de la République en se déclarant en quelque sorte incompétent et en renvoyant la décision au peuple.
À l'heure où l'on parle beaucoup des droits du Parlement, n'est-ce pas un point fondamental que de permettre aux parlementaires de ne pas accomplir un déni de démocratie en ne validant pas définitivement une révision de la Constitution que le peuple avait, de fait, censurée deux ans auparavant ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous estimons donc que, politiquement et juridiquement, cette motion tendant à soumettre le présent projet de révision constitutionnelle est pleinement recevable et doit être maintenant discutée par notre assemblée.
Applaudissements sur les travées du groupe CRC ainsi que sur certaines travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame la ministre, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, nous entamons en cet instant un débat qui n'est ni secondaire ni médiocre : nous allons traiter de l'avenir politique du continent européen et de la place particulière de notre patrie républicaine en son sein.
Je crois que l'importance du sujet mérite de la délicatesse dans l'écoute des arguments qui vont être présentés.
Enfin quoi ! Notre assemblée ne se prévaut-elle pas souvent de sa sagesse, de la distance qu'elle met à l'égard des passions ? Et voilà que, au moment où s'amorce la discussion sur l'une des questions clés du débat - il s'agit, ni plus ni moins, de la méthode ! -, est convoquée de manière impromptue une commission qui, bien sûr, a toute légitimité à donner son avis, mais dont nous savons tous qu'elle n'est pas l'organe qui aurait dû se prononcer sur la recevabilité de cette motion : c'est le bureau du Sénat qui aurait dû le faire.
Et elle tranche, alors qu'elle vient d'être convoquée à l'instant même, en votant avec des procurations !

Personne ne peut le croire ! Ce sont des facéties que l'on croyait réservées à des assemblées moins constitutionnelles que les nôtres...
Nous allons en fait devoir répondre à deux questions de fond.

M. le président. Pardonnez-moi de vous interrompre, monsieur Mélenchon, mais je tiens à préciser, pour la clarté du débat, que les pouvoirs dont disposaient certains de nos collègues ont été déposés ce matin. Par conséquent, les intéressés ne savaient pas que ce débat aurait lieu à l'ouverture de cette discussion.
Vives exclamations sur les mêmes travées.

Je vous remercie de cette précision, monsieur le président. J'ai presque le sentiment qu'elle vient à l'appui de ma démonstration !

En effet, nos collègues, ce matin, ne pouvaient pas savoir pour quoi ils donnaient pouvoir, par définition. Merci de l'avoir précisé !

Nous savons tous que deux questions nous sont posées.
La première porte sur l'appréciation que nous portons, en conscience, librement, sur le contenu du traité.
La seconde concerne la façon de trancher.
Cette seconde question n'est pas purement formelle. Elle touche à l'idée qu'on se fait, non seulement du fonctionnement de la démocratie française, mais, plus généralement, de la crise que traverse l'Union politique européenne, qui est d'abord une crise de confiance des peuples, quelle que soit l'analyse qu'on fasse des racines de cette crise.
Car enfin, cela éclate aux yeux de tous ! C'est ce qui explique pourquoi, de manière folle, les gouvernements signataires ont pu décider que faisait partie de la méthode du traité le fait que l'on ne consulterait nulle part les peuples par référendum !
Et l'on a pu voir la Slovénie, présidant pour la première fois l'Union européenne, donner des leçons au Portugal, démocratie confirmée, pour qu'il n'organise pas un référendum !
Quant aux électeurs roumains, appelés pour la première fois à désigner leurs représentants au Parlement européen, ils ont été plus de 70 % à s'abstenir. C'est bien la preuve d'une crise immense de la démocratie sur ce continent...

...et la première des réponses que l'on devrait apporter, c'est de tout faire pour y augmenter la force de la démocratie !
Certes, nous pouvons être minoritaires. Vous pouvez ne pas nous suivre dans nos arguments. Vous pouvez considérer que nous nous trompons, qu'il convient de ratifier ce traité par la voie parlementaire, et cette argumentation a d'ailleurs sa dignité. Mais que l'on ne nous cloue pas la bouche avec des procédés aussi artificiels que ceux que vous utilisez ! Nous voulons pouvoir parler...

...et dire qu'en cette matière nous croyons que, conformément à notre histoire la plus profonde et à nos traditions, il n'est d'autre souverain que le peuple, qui s'est déjà prononcé sur ce même sujet...

...et à qui, toujours plus durs et entêtés, vous annoncez par vos méthodes brutales que vous entendez le priver de son droit à la parole !
Voilà ce qui est en cause et il me coûte de devoir dire, car j'ai beaucoup de respect pour le président de la commission des lois, que le procédé utilisé est misérable !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, sans vouloir aborder le fond d'un débat qui peut nous diviser...
Sourires sur les travées de l'UMP.
Plusieurs sénateurs socialistes. Combien de divisions ?...
Sourires

Oui : combien de divisions ?
Donc, sans vouloir aborder le fond, je pense, monsieur le président, que nous touchons, avec cette affaire de recevabilité - et je m'en tiendrai à ça - à un point particulièrement sensible et délicat s'agissant du sujet qui nous occupe et des procédures constitutionnelles qui peuvent être mises en oeuvre.
J'aurais préféré, moi aussi, que ce soit le bureau qui soit appelé à trancher. Mais, après tout, vous avez choisi de consulter la commission des lois, elle a donné un avis : ne chipotons pas...

...puisque vous allez tout à l'heure, monsieur le président, demander au Sénat de se prononcer sur la recevabilité, ...

... et que toute autre manière de faire aurait été un coup de force contre la libre décision de cette assemblée. Donc, je vous donne volontiers acte de cette demande.
Mais le problème, c'est que, pour la première fois depuis longtemps, le Sénat nous suggère de revenir sur la doctrine fondamentale selon laquelle la révision constitutionnelle peut emprunter soit la voie de l'article 11 soit celle de l'article 89.

M. Michel Charasse. Je vous ai écouté, monsieur le président de la commission des lois, et je parle sans pouvoirs !
Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Par conséquent, vous pouvez m'écouter !
L'article 11 de la Constitution dit que peut être soumis au référendum « tout projet de loi » : il ne précise pas constitutionnelle ou ordinaire !

J'ajoute que, quand on lit l'article 89, on s'aperçoit que, si le « projet de loi constitutionnelle » existe en pratique, il ne figure pas dans cet article, qui ne parle que de « projet ou proposition de révision ».
C'est pour des raisons purement pratiques qu'on a pris l'habitude d'appeler ces textes « projets de loi constitutionnelle » pour les distinguer des projets de loi ordinaire, dont l'initiative appartient au Premier ministre, alors que, pour les projets de révision, appelés donc par commodité « projets de loi constitutionnelle », l'initiative appartient au président de la République.
Les autorités constitutionnelles n'avaient, avant 1962, qu'une seule solution, la voie de l'article 89, pour modifier la Constitution - en tout cas, c'est ce qu'ont toujours pensé les rédacteurs et les commentateurs de la Constitution de 1958. Jusqu'au jour où le général de Gaulle a décidé qu'un projet de loi ordinaire - puisque les projets de loi constitutionnelle, ça n'existe pas - dont il n'était pas formellement l'auteur serait, sur proposition du Gouvernement et par la voie de l'article 11, soumis au référendum pour modifier une disposition de la Constitution, et non des moindres : l'élection du Président de la République au suffrage direct.
La doctrine s'est divisée. Cette assemblée, sous l'autorité du président Monnerville, s'est très vivement opposée au Président de la République, ...

... mais il se trouve que les Français ont adopté par un référendum de l'article 11 et ont ainsi validé sans contestation possible la procédure choisie par le général de Gaulle. Aussi, lorsqu'en 1969 le général de Gaulle a engagé, à nouveau en vertu de l'article 11, un processus référendaire pour réformer les règles constitutionnelles concernant le Sénat et les régions, il n'y a plus eu de controverse sur la question du choix entre l'article 11 et l'article 89.
J'en veux pour preuve qu'un président que j'ai aimé et servi, et qui, en 1962, n'a pas été le dernier à s'opposer à la procédure alors choisie par le général de Gaulle, a dit et a écrit dans la revue Pouvoirs en avril 1988 que, dès lors que le peuple français avait validé la procédure de l'article 11, il fallait admettre qu'il y avait bien deux procédures, celle de l'article 11 et celle de l'article 89.

Il a seulement ajouté qu'il considérait que seules des questions simples pouvaient être posées par référendum de l'article 11 car, lorsqu'il y avait un texte ou des questions complexes, il était préférable que le vote référendaire soit éclairé préalablement par un débat parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, comme le veut l'article 89.
Donc, mes chers collègues, la République a le choix entre deux procédures : soit l'article 89, si l'on veut un débat préalable dans les deux chambres ; soit l'article 11, comme l'a décidé le général de Gaulle à deux reprises.

La seule différence, c'est que, pour l'article 11, le président n'a l'initiative que s'il est saisi d'une proposition référendaire par le Gouvernement ou le Parlement, alors que, pour l'article 89, il décide librement, sans que personne ne lui demande rien, s'il choisira, après débat parlementaire, le Congrès ou le référendum.
Mes chers collègues, je conclus : cette procédure de l'article 11 a été validée par le peuple et l'on ne voit pas ce qui, littéralement, dans la Constitution, dès lors qu'aucun de ses articles ne parle de « projet de loi constitutionnelle », pourrait conduire à considérer que seuls les projets de loi ordinaires peuvent être soumis au référendum de l'article 11, d'autant plus que par deux fois la pratique, validée par le peuple, a dit le contraire.
Alors, mes chers collègues, faire décider aujourd'hui par le Sénat- et par cette seule assemblée - que seul l'article 89 peut être employé pour une révision de la Constitution, c'est une manière indirecte de remettre en cause - et, monsieur le président, il doit quand même y avoir quelques gaullistes encore présents dans cet hémicycle, ...

... j'en vois, et je les sais sincères ! -, la doctrine du père de la Constitution qu'est le général de Gaulle et la sanction donnée par la souveraineté nationale en 1962.

M. Michel Charasse. C'est la raison pour laquelle opposer l'irrecevabilité constitue un retour en arrière insupportable.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, madame le garde des sceaux, messieurs les secrétaires d'État, mes chers collègues, on nous parle d'améliorer les relations entre l'exécutif et le législatif, de changer les méthodes du Sénat... Billevesées !
Rien de tout ça, au contraire, et je tiens à protester, une fois de plus, contre les méthodes employées, qui sont indignes, non seulement du Sénat, mais de la démocratie !
Depuis des années, je répète que le règlement de notre assemblée prévoit que, pour les décisions prises en commission, un membre de la commission considérée ne peut donner pouvoir que s'il est en mission ou s'il est malade, et depuis des années je demande que cette règle s'applique !
Or la majorité viole cette règle tous les jours. Les commissions sont organisées de telle manière qu'il y a toujours des pouvoirs pour les membres de la majorité !

Cette situation est tout à fait scandaleuse. Et que l'on ne prétende pas que l'on va changer les choses !
Au Sénat, décidément, il n'y a que les absents qui décident. Cela a été le cas tout à l'heure en commission puisqu'il y a eu, grâce aux pouvoirs préparés, quatorze voix d'un côté, alors qu'il n'y avait que huit présents de ce côté-là, ce qui signifie en vérité que nous, membres de l'opposition, nous étions en majorité...

De même, a été demandé dans cet hémicycle il y a un instant un scrutin public, ce qui signifie que, une fois de plus, ce sont les absents qui décideront !
On peut parler du général de Gaulle, de sa Constitution et de précédents, mais croyez-vous, mes chers collègues, que c'est cela, la démocratie ? Sûrement pas !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Je mets aux voix la recevabilité de la motion.
Je rappelle que je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin a lieu.
Il est procédé au comptage des votes.

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 71 :
Le Sénat n'a pas retenu la recevabilité de la motion référendaire.

En application de l'article 30 du règlement, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat demande la discussion immédiate de la proposition de loi constitutionnelle présentée par elle-même ainsi que MM. Robert Bret, Jean-Luc Mélenchon, Charles Gautier, Jean Desessard et Mme Alima Boumediene-Thiery visant à compléter l'article 11 de la Constitution par un alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité contenant des dispositions similaires à celles d'un traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit soumise à référendum.
La demande de Mme Nicole Borvo Cohen-Seat est signée par au moins trente sénateurs.
Conformément au quatrième alinéa de l'article 30 du règlement, il va être procédé à l'appel nominal des signataires.
Huissier, veuillez procéder à l'appel nominal.
La présence d'au moins trente signataires ayant été constatée, il va être procédé à l'affichage de la demande de discussion immédiate sur laquelle le Sénat sera appelé à statuer, conformément à l'article 30 du règlement, à la fin de l'ordre du jour prioritaire de la présente séance.
La demande va être communiquée sur-le-champ au Gouvernement.
La règle veut que le débat sur cette demande de discussion ne puisse intervenir qu'après la fin de l'examen en séance publique du ou des textes inscrits à l'ordre du jour. Toutefois, la tradition constante du Sénat est d'interpréter l'article 30 du règlement comme permettant l'examen de la demande de discussion immédiate à la fin de la séance publique au cours de laquelle elle a été formulée. Nous débattrons donc de cette demande à la fin de la séance d'aujourd'hui.

Nous reprenons la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le Premier ministre.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la délégation pour l'Union européenne, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, voilà soixante ans qu'en France, avec détermination et constance, l'intérêt national épouse l'ambition européenne ; soixante ans que la passion française trouve dans l'aventure européenne son horizon, son aboutissement, l'élargissement de ses perspectives aux dimensions plus vastes de notre continent ; soixante ans que le rêve européen reçoit de l'initiative française ses élans et ses caps.
Soixante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est plus qu'une ambition, plus qu'une aventure, plus qu'un rêve : elle est cette réalisation commune à laquelle vingt-sept pays libres se sont joints pour s'accorder mutuellement les garanties de la paix et partager les réussites de l'intégration économique et monétaire.
Gouvernements de gauche ou de droite, de l'Ouest ou de l'Est, tous ont bâti notre maison commune, qui est sans équivalent au monde. L'entreprise européenne est inédite, radicalement nouvelle. Nulle part ailleurs un tel défi n'a été lancé : unir un continent ravagé par des siècles de guerres et d'hostilité ; créer un ensemble continental cohérent, quand les anciens empires européens avaient laissé le souvenir de tant de luttes ; construire les moyens d'agir collectivement, tout en préservant les spécificités nationales, si chèrement acquises.
La construction européenne est en train de réussir ce pari que beaucoup jugeaient insensé. L'Union européenne a beaucoup de compétences, beaucoup de pouvoirs, mais sa force ne vient ni de la contrainte armée ni de la domination d'une coalition d'États sur les autres.
Sa force, c'est la libre volonté d'union qui joint ses États membres. Les élargissements successifs en sont la preuve éclatante.
Sa force, c'est son mode de décision démocratique, que ce soit au Conseil ou au Parlement européen, et ce caractère démocratique est notablement renforcé par le traité de Lisbonne.
Sa force, c'est la synthèse entre les institutions démocratiques de l'Union et l'identité préservée des États membres, synthèse que le traité de Lisbonne réaffirme clairement.
La seule vraie force de contrainte qui régisse l'Union, c'est le respect du droit, pierre angulaire de la construction européenne. Le règne du droit démocratiquement élaboré a remplacé en Europe celui de la violence comme moyen de contrainte ultime. C'est un progrès fondamental, qui fait de l'Europe une vraie terre de civilisation, ainsi qu'un exemple pour d'autres régions du monde.
C'est afin de saluer le rôle du droit européen que j'ai profité de ma rencontre avec Jean-Claude Juncker, vendredi dernier, à Luxembourg, pour accomplir la première visite d'un Premier ministre français auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
Constatons-le une fois de plus, avec une reconnaissance particulière pour ceux dont le courage a précédé et préparé nos efforts : devant cet exceptionnel objet de fierté qu'est l'Europe, les hésitations, les lenteurs, les réticences ont toujours cédé le pas. Ils doivent continuer de le faire aujourd'hui.
Faut-il le rappeler, j'ai été moi-même opposé au traité de Maastricht, un texte imparfait, dans lequel les avancées économiques de la construction ne recevaient pas, selon moi, une contrepartie politique suffisante. Je n'ai pas été le seul à redouter l'avènement d'une Europe boiteuse, incapable de gouverner comme il l'aurait fallu l'intégration économique poussée qu'elle se promettait d'atteindre.
J'ai constaté depuis lors, comme beaucoup d'autres, que mes craintes n'étaient pas infondées. Aujourd'hui, le traité de Lisbonne leur répond et les apaise. À l'heure où l'accueil des anciens pays de l'Est exige une adaptation de nos procédures, il clarifie le fonctionnement politique de l'Europe et il en renforce opportunément les structures.
Encore cette satisfaction institutionnelle n'est-elle pas la seule raison de mon intervention : d'autres motifs relèvent de mon sentiment intime, et je sais qu'ils parlent aux Français.
Dans le projet européen converge, mesdames, messieurs les sénateurs, l'essentiel de nos héritages culturels et humains. L'expérience démocratique, universitaire, scientifique et industrielle : autant de domaines dans lesquels l'histoire a donné à nos pays le privilège d'une fertilité séculaire !
Nous sommes - vous, moi, Français, Européens - les détenteurs d'un grand patrimoine intellectuel, artistique, philosophique et institutionnel commun. De Londres à Athènes, de Madrid à Varsovie, nous sommes les héritiers de cet espace à la fois charnel et imaginaire où nos manières de vivre et de penser s'enracinent.
Je vous livre cette conviction personnelle, telle qu'elle m'a toujours guidé : plus le XXIe siècle se révèlera secoué de tensions nouvelles, travaillé par le déplacement des lignes de partage, tiraillé de conflits, plus grande nous apparaîtra la valeur de l'espace d'équilibre européen !
Au service de cet idéal de progrès et de rayonnement, le Président de la République a réclamé la constitution d'un groupe de réflexion, capable de projeter sur l'avenir les traits de notre projet européen. Le Conseil européen de décembre 2007 a décidé la création du groupe « Horizon 2020-2030 », présidé par Felipe Gonzales.
Ce groupe veut poser sans détour les questions que l'Europe adresse à notre génération, et dont la réflexion institutionnelle ne doit pas faire oublier la primauté. Quel modèle de société voulons-nous pour l'Union ? Quelle identité ? Quelles frontières ? Quelle civilisation désirons-nous construire ensemble ? Mesdames, messieurs les sénateurs, ces grandes interrogations coïncident avec l'étape institutionnelle que nous devons franchir aujourd'hui.
Avec le traité de Lisbonne, la France reprend la main en Europe, et c'est l'Europe elle-même qui se trouve relancée. Il y a quelques mois seulement, sous le coup de notre hésitation, l'Europe marquait un temps d'arrêt. Le double « non » français et néerlandais l'entravait. L'inquiétude et le doute tournaient tous les regards vers nous. Pourquoi ? Parce que nous les éprouvions nous-mêmes.
Nicolas Sarkozy a pesé de toute sa volonté pour que soit dépassée cette querelle franco-française qui s'est révélée sans issue. Il a compris que les partisans du « non » et ceux du « oui », s'ils ne s'accordaient pas sur une même idée de l'Europe, partageaient le même désir de la voir avancer. Il s'est alors efforcé de transcender les clivages qui, en divisant la France, immobilisaient l'Europe.
Il s'est engagé, pendant la campagne présidentielle, à ce qu'aboutissent, rapidement, nos points de consensus. Sa promesse était réaliste, transparente. Elle a été invariable : négocier un nouveau traité, plus simple, qui concrétise les avancées institutionnelles urgentes, tout en prenant acte des craintes exprimées par le « non » majoritaire ; une fois ce traité négocié, le faire valider le plus rapidement possible par le Parlement.
Tout au long de sa campagne, Nicolas Sarkozy a énoncé à haute voix sa stratégie pour l'Europe. Personne - je dis bien « personne » ! - ne peut lui reprocher d'être resté fidèle à ce qu'il avait dit, fidèle à ce qu'il a fait.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Pierre Fauchon applaudit également.
C'est fort de la confiance que les Français lui ont accordée...
...que le Président de la République, en coordination avec Mme Angela Merkel, alors présidente de l'Union européenne, a négocié le traité nouveau. Et c'est fort de cette même volonté que nous allons faire aujourd'hui un pas essentiel vers sa ratification.
Mesdames, messieurs les sénateurs, convenons que le Président de la République, en prenant la mesure des craintes françaises, a fait tomber devant nous la plupart des obstacles à ce vote.
Le premier obstacle était la nature même du texte. La notion de constitution paraissait redoutable, elle a disparu. Le traité de Lisbonne complète et affine les traités existants. Il respecte le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, rebaptisé traité sur le fonctionnement de l'Union, sans se placer au-dessus d'eux. Les symboles constitutionnels ont disparu.
Le deuxième obstacle était la concurrence libre et non faussée, dont le texte de 2005 faisait un objectif pour l'Europe. Le texte actuel la replace au rang plus juste de « moyen » du dynamisme économique.
Le troisième obstacle, effacé lui aussi, était l'incertitude sur le rôle des parlements nationaux. Le traité de Lisbonne le renforce dans des proportions tout à fait remarquables. Pour la première fois, grâce au contrôle de subsidiarité, un traité européen vous ouvre la possibilité de peser sur les propositions de la Commission.
Conformément au désir des Français, le même traité renforce le rôle et les compétences des États et des collectivités territoriales. Il précise et éclaire leurs prérogatives. Il indique ainsi, explicitement, que la sécurité nationale reste « de la seule responsabilité de chaque État membre ». Pour préserver les services publics, auxquels nos concitoyens sont attachés et il le rappelle régulièrement, le rôle déterminant des autorités nationales, régionales et locales dans leur organisation se voit désormais garanti.
Enfin, et c'est là le principal motif d'optimisme, le traité de Lisbonne assure à l'Europe des moyens d'action renouvelés.
Je suis convaincu que les Français, dans leur majorité, ne se défient pas d'une Europe qui bouge, qui décide et qui intervient. Ce qu'ils redoutent, c'est exactement le contraire : c'est une Europe inerte, pesante, engoncée dans des procédures qui la ralentissent et la condamnent à l'impuissance.
Le traité de Lisbonne éloigne cette menace par plusieurs dispositions.
Le choix d'un président du Conseil européen, élu pour deux ans et demi renouvelables, va conférer à l'institution politique suprême un visage et une stabilité.
La nomination d'un Haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, jouissant de moyens renforcés, permettra à l'Union de développer une véritable politique extérieure commune.
Le nouveau traité ouvre la possibilité, pour un groupe d'États, de créer des coopérations structurées dotées de pouvoirs larges. Il crée, pour la défense européenne, ce cadre d'action dont les crises régionales rappellent régulièrement la nécessité.
Le traité instaure un processus de décision plus démocratique et plus efficace. Il élargit le champ de la majorité qualifiée, mesure de bon sens pour permettre de surmonter les blocages que la règle du consensus occasionnait inévitablement, dans une Europe plus vaste et plus nombreuse.
Au Conseil, les pays les plus peuplés, comme la France, seront favorisés par le choix de la double majorité comme mode de vote. Le Parlement européen verra ses pouvoirs renforcés.
Ce sont là les gages d'un progrès de la vie démocratique en Europe.
Cependant, mesdames, messieurs les sénateurs, le traité de Lisbonne ne s'arrête pas à ces dispositions institutionnelles.
Pour coordonner nos politiques économiques, il institutionnalise l'Eurogroupe et lui confère un pouvoir de décision.
La question énergétique s'annonce, avec le problème environnemental, comme l'un des grands défis du siècle prochain. Pour le relever, le nouveau traité instaure le principe essentiel de la solidarité entre États membres. Il offre au Conseil la possibilité d'adopter les mesures nécessaires, en cas de difficulté d'approvisionnement énergétique.
Chaque pays possède, en matière sociale, ses approches, ses traditions et ses exigences. Pour qu'elles soient reconnues de manière respectueuse, les partenaires sociaux se voient confirmés dans leurs missions. Le traité de Lisbonne instaure une clause sociale générale, de portée très large. Aux termes de cette clause, l'Union devra prendre les exigences sociales en compte dans l'ensemble de ses politiques. Par ce biais, je tiens à le répéter devant vous, la pérennité de nos services publics reçoit de l'Europe une garantie exceptionnelle, la plus forte depuis les prémices de notre engagement communautaire.
M. Jean-Patrick Courtois applaudit
Tous ici, nous avons redit notre détermination à faire de l'Europe un vaste espace de liberté, de sécurité et de justice. Pour y parvenir, le traité de Lisbonne améliore la manière dont peuvent être traités, à l'échelon européen, des sujets comme l'immigration, légale ou illégale, et le rapprochement des législations pénales. Pour mieux lutter contre la criminalité transfrontalière, le traité attribue à Eurojust des moyens plus importants. Il prévoit la possibilité de créer un parquet européen.
Il dote enfin l'Union d'une charte des droits fondamentaux jouissant d'une valeur juridique égale à celle des traités.
Acceptons-en les promesses : le traité de Lisbonne apparaît aujourd'hui comme une chance unique de réconcilier la prudence légitime des Français avec leur ambition européenne. Après le référendum, on nous a expliqué qu'il existait une France du « oui » et une France du « non » ; qu'une partie du pays résistait à la poursuite de la construction communautaire ; que deux camps, aux frontières nettes, se dressaient l'un contre l'autre.
La vérité, mesdames, messieurs les sénateurs, c'est qu'il n'existe qu'une seule France, qu'elle souhaite jouer tout son rôle dans la construction européenne...
...et que si elle a pu faire preuve de beaucoup de circonspection devant les manières d'y parvenir, elle tient, avec le traité de Lisbonne, une réelle occasion d'accomplir sa volonté selon ses voeux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, la dernière décennie, jalonnée de querelles, aura été pour les institutions européennes et pour ceux qui espèrent en elles une décennie d'épreuves.
Nous avons connu le traité d'Amsterdam, qui, à peine signé, était aussitôt remis en question. Nous avons connu le débat entre fédéralistes et partisans d'une Europe intergouvernementale. Au terme de ce débat, nous avons connu le traité de Nice, délicat à négocier, et le projet constitutionnel européen, impossible à conclure.
Nous avons eu plus que notre part de lassitude et de conflit. Aujourd'hui, avec le traité de Lisbonne, plus réaliste, centré sur des équilibres plus respectueux du dessein français, une part du rêve original revit, une part de la ferveur initiale redevient possible.
Le rôle et les compétences des États membres sont réaffirmés, par-delà les inquiétudes. Les moyens d'action de l'Union sont confortés, par-delà toute impuissance. La parole est rendue à l'essentiel, c'est-à-dire à l'expression de nos priorités politiques.
La présidence française du second semestre 2008 va jouir d'une faveur marquée : elle aura la possibilité de recentrer sur ces priorités un débat trop longtemps confisqué par les questions institutionnelles. Elle aura la possibilité d'agir.
Que demandent les citoyens européens aujourd'hui ? Ils demandent une lutte efficace contre le réchauffement de la planète ; une politique énergétique axée sur la sécurité des approvisionnements ; une véritable politique commune de l'immigration, dont le chef du gouvernement espagnol a appuyé l'idée voilà quelques semaines à Paris ; une politique européenne de défense enfin digne de ce nom ; des mesures particulièrement vigilantes de stabilisation et de transparence pour les marchés financiers ; enfin, le lancement d'une revue générale des politiques européennes, de leur efficacité et de leur coût, analogue à la revue générale des politiques publiques que mon gouvernement mène en France.
Entre ces priorités politiques européennes et nous, il n'y a plus que l'adhésion au traité de Lisbonne. Pour nous consacrer de manière durable à la préparation de l'avenir, pour mettre en oeuvre les choix les plus clairs des Français, il n'y a plus qu'un texte à ratifier.
La France, future présidente, sera largement responsable de la mise en oeuvre technique et politique du traité au 1er janvier 2009. Pour jouer dans l'Europe le rôle de moteur et de référence auquel elle prétend, elle se doit de ratifier ce traité le plus rapidement possible.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Michel Mercier applaudit également.
Le Président de la République a décidé en conséquence de saisir le Conseil constitutionnel dès le lendemain du Conseil européen de Lisbonne, avant même d'amorcer les procédures de ratification.
Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 20 décembre dernier. Sa décision a conduit à la rédaction du projet de loi qui va vous être présenté par Mme le garde des sceaux et par M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes.
Ce projet de loi constitue la première étape, indispensable, à la ratification du traité de Lisbonne par la France. Il dépose entre vos mains, mesdames, messieurs les sénateurs, de larges espérances : celles de la France, qui croit à son avenir européen, celles de l'Europe, qui guette l'impulsion française avec une attention extrême. Je veux croire que le Sénat sera l'interprète de cette double espérance. §
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi constitutionnelle qui vous est présenté est le préalable à la ratification du traité de Lisbonne. Ce traité, le Premier ministre vous l'a dit, est ambitieux. Il est nécessaire.
La procédure de ratification doit respecter deux étapes. Nous devons commencer par réviser notre Constitution. Il faut la rendre compatible avec certaines dispositions du nouveau traité. Le Parlement sera ensuite amené à se prononcer sur un projet de loi autorisant la ratification du traité de Lisbonne.
C'est la première étape qui nous occupe aujourd'hui.
Dans sa décision en date du 20 décembre 2007, le Conseil constitutionnel a relevé dans le traité des dispositions qui appellent une révision de notre Constitution. Votre collègue, rapporteur de la commission des lois, M. Patrice Gélard, l'a excellemment montré dans son rapport.
Il s'agit tout d'abord des dispositions concernant les compétences et le fonctionnement de l'Union.
Le Conseil constitutionnel a identifié les stipulations prévoyant de nouveaux transferts de compétences au profit des institutions de l'Union européenne. Ces transferts ont pour effet d'affecter les conditions d'exercice de la souveraineté nationale.
Le Conseil constitutionnel avait fait les mêmes constatations en 1992 pour le traité de Maastricht et en 1997 pour le traité d'Amsterdam.
Ces nouveaux transferts concernent par exemple la coopération judiciaire en matière pénale. Ils concernent aussi la création d'un parquet européen compétent pour poursuivre les auteurs d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne.
Une seconde série de stipulations rend nécessaire une modification de notre Constitution. Elle concerne les nouvelles prérogatives reconnues aux parlements nationaux.
La première prérogative, c'est la faculté pour les parlements nationaux, et donc pour le parlement français, de s'opposer à une décision du Conseil européen mettant en oeuvre une procédure de révision simplifiée des traités.
La deuxième prérogative, ce sont les pouvoirs reconnus à chaque assemblée parlementaire dans le cadre du contrôle du respect du principe de subsidiarité. Cette prérogative permet à une majorité de parlements nationaux de s'opposer à une proposition de la Commission qui empiète sur les compétences des États membres.
La troisième prérogative, c'est la possibilité, pour le parlement national et en droit de la famille, de s'opposer au recours à la clause passerelle. Cette procédure permet, si le Conseil l'accepte à l'unanimité, de passer d'une procédure législative spéciale à la procédure législative ordinaire. Les parlements nationaux pourront s'y opposer.
Ces possibilités nouvelles renforcent les pouvoirs du Parlement. Elles nous amènent à compléter la Constitution.
Cette révision constitutionnelle est donc techniquement nécessaire.
Le projet de loi constitutionnelle qui vous est soumis est un dispositif en trois temps. L'Assemblée nationale l'a approuvé en première lecture le 16 janvier dernier, sans lui apporter de modification.
Le premier temps, c'est d'engager la procédure de ratification du traité. C'est l'objet de l'article 1er. Il est d'application immédiate. Il lève les obstacles constitutionnels à la ratification du traité de Lisbonne.
Le deuxième temps, c'est de modifier le titre XV de la Constitution pour tirer les conséquences du traité de Lisbonne. C'est l'objet de l'article 2.
Ces dispositions ne deviendront applicables qu'à l'entrée en vigueur du traité.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne entrainera des changements de forme, puisque le titre XV de la Constitution sera désormais intitulé « De l'Union européenne », car le traité de Lisbonne unifie les trois piliers de l'Union européenne issus du traité de Maastricht.
Le traité substitue également l'Union européenne à la Communauté européenne. Ces changements terminologiques provoquent des modifications des articles 88-1, 88-2, 88-4 et 88-5 de la Constitution.
L'entrée en vigueur du traité de Lisbonne entrainera également des changements de fond.
La nouvelle rédaction de l'article 88-1 inscrit dans la Constitution de façon pérenne le consentement du constituant aux transferts de compétence prévus par les traités, tels qu'ils résultent du traité de Lisbonne.
Deux articles nouveaux sont ensuite ajoutés au titre XV. Ils permettront au Parlement français d'exercer les prérogatives nouvelles qui lui sont reconnues par le traité de Lisbonne.
Le premier, l'article 88-6, concerne le respect du principe de subsidiarité. Les assemblées parlementaires en seront les garants. Si une assemblée estime que ce principe a été méconnu, elle pourra adresser aux institutions européennes un avis motivé dans un délai de huit semaines. Elle pourra également déférer à la Cour de justice de l'Union européenne l'acte qui lui paraît contraire au principe de subsidiarité. Ce recours devra être formé dans un délai de deux mois.
Le second article nouveau, l'article 88-7, concerne la modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne. En effet, le traité permet aux Parlements nationaux de s'opposer à une décision des institutions de l'Union de passer de l'unanimité à la majorité qualifiée dans différents domaines. Ce droit d'opposition devra être exprimé dans les six mois suivant la transmission de la proposition.
Le troisième temps du projet de loi, c'est de supprimer les références au traité constitutionnel, puisque celui-ci est devenu sans objet. C'est le but de l'article 3 du projet de loi constitutionnelle. Les références supprimées sont celles qui figurent aux articles 3 et 4 de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005.
Voilà l'équilibre général du texte que je vous présente aujourd'hui.
Comme vous le voyez, le Gouvernement s'est strictement limité à l'objectif de permettre une ratification rapide du traité de Lisbonne.
Les relations entre les institutions européennes et nos institutions, ainsi que la construction européenne elle-même, soulèvent - je le sais bien - de nombreuses questions constitutionnelles.
Dans son rapport, le sénateur Patrice Gélard a soulevé certaines de ces questions. Elles revêtent une importance évidente. Mais ces questions seront débattues en leur temps, lorsque nous examinerons la révision constitutionnelle issue des travaux du comité présidé par Édouard Balladur.
Pour l'heure, nous en sommes non pas à faire évoluer nos institutions, mais à permettre la modernisation des institutions européennes. C'est l'objectif primordial. Nous ne devons pas en dévier.
Le présent projet de loi ouvre la voie à une avancée fondamentale de la construction de l'Europe. Ne la retardons pas.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Pierre Fauchon applaudit également.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.
Monsieur le président, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, monsieur le président de la délégation pour l'Union européenne, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, comme vient de vous l'indiquer Mme le garde des sceaux, le Conseil constitutionnel, dans une décision en date du 20 décembre 2007, a estimé qu'une révision de la Constitution était nécessaire avant la ratification du traité de Lisbonne. Il a également précisé que le traité de Lisbonne était différent du traité constitutionnel, ce qui justifie une nouvelle analyse de ses dispositions.
Les travaux de la commission des lois, dont je remercie le président et le rapporteur, M. Patrice Gélard, ont également parfaitement exposé les enjeux de notre débat.
Le traité de Lisbonne est le fruit d'une volonté politique collective pour apporter une solution à un problème inédit : deux États membres fondateurs de l'Europe ont, par la voie d'un référendum, rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe.
Le blocage n'a pas été immédiat. En effet, dix-huit États membres, représentant 56 % de la population européenne, avaient approuvé le traité constitutionnel. Deux autres l'ont encore approuvé après ces deux « non ». Six mois plus tard, le 26 janvier 2007, vingt États se sont réunis à Madrid pour demander la poursuite de la ratification du traité constitutionnel. Pour la première fois dans l'histoire de la Communauté européenne et de son union, l'Europe se réunissait sans la France, et, qui plus est, pour débattre de son avenir.
À cette époque, certains ont cru à une impasse du projet européen, qui se serait enlisé dans une alternative impossible entre élargissement et approfondissement. Toutefois, quelle que soit sa sensibilité, chacun sentait bien qu'une union forte de vingt-sept États ne pouvait en rester aux traités existants et à leur seule vocation économique.
Avec le traité de Nice, l'Union européenne ne peut pas affronter les défis internationaux ou globaux, tout simplement parce qu'elle n'a pas révisé ses règles de fonctionnement. Or notre première attente, la première attente de nos enfants, de ceux qui, en 2005, ont dit « oui » ou « non », c'est que l'Europe prenne enfin sa place dans le monde, à la hauteur de sa puissance économique.
Il faut qu'elle puisse mieux incarner ce qu'elle est, ce qu'elle a toujours été, ce qu'elle devient à vingt-sept : une véritable civilisation reposant sur des valeurs communes et partagées, ...
...comme l'avait justement anticipé l'un de mes prédécesseurs ici présent dès 1976.
Comment faire vivre ce projet alors que la présidence du Conseil tourne toutes les vingt-six semaines et que, dans nombre de domaines, un seul État peut bloquer les décisions ? L'addition des volontés ne fonctionne pas, parce que la règle de l'unanimité entrave la prise de décision.
Comment faire partager un tel projet lorsque, au-delà de ces blocages, le fonctionnement de l'Union n'est pas assez démocratique : les citoyens ne sont pas associés, le Parlement européen n'a que des pouvoirs limités, les Parlements nationaux ne jouent qu'un rôle trop modeste et la démographie est mal prise en compte ?
Il est donc urgent de changer ce cadre si nous voulons une Europe vivante, active, influente et, surtout, capable de remplir les missions qui lui sont confiées.
La première des missions de l'Union, la promotion de la paix, ne peut être réalisée sans que les États se donnent clairement pour objectif la prévention des conflits et sans qu'ils s'engagent ensemble à développer leurs capacités de défense.
L'autre mission essentielle de l'Union européenne est de relever les défis globaux du xxie siècle pour mieux défendre ses citoyens et leurs intérêts.
Ces intérêts et ces défis, quels sont-ils dans un proche avenir ?
Ce sont la gestion des migrations, le changement climatique, la nouvelle donne énergétique, la solidarité face aux grandes catastrophes et, bien sûr, la lutte contre le terrorisme.
Dans ces domaines, ce que les Européens ne feront pas ensemble, personne ne le fera pour eux et dans leur intérêt. Et il est urgent d'agir, urgent pour l'Europe de donner l'exemple. Il est donc impératif de disposer de moyens juridiques nouveaux.
Le traité de Lisbonne dote l'Union de ces moyens, par l'extension de la majorité qualifiée, la création d'une présidence stable du Conseil, la mise en place d'un Haut représentant et d'un service européen d'action extérieure, l'établissement d'une coopération structurée en matière de défense et la reconnaissance de nouvelles bases juridiques pour l'énergie et la lutte contre le changement climatique. C'est une véritable clarification institutionnelle, comme l'a rappelé M. le Premier ministre.
Mais il apporte également une réponse aux préoccupations soulevées par nos concitoyens. Il promeut des valeurs nouvelles, plus solidaires. L'Europe a pour objectif de protéger les citoyens dans la mondialisation. En revanche, la « concurrence libre et non faussée » ne figure plus parmi les finalités de l'action européenne.
La France pourra garantir l'accès aux services publics sur tout notre territoire à un prix abordable sans se heurter aux règles de concurrence ou du marché intérieur.
La représentation nationale pourra se prononcer sur les projets européens et veiller au respect des compétences entre les États et l'Union européenne à travers le contrôle de la subsidiarité.
Pour la première fois, les Parlements nationaux contribueront à la prise de décision européenne et seront les gardiens de la répartition des compétences entre l'Union et les États membres. Ce traité est donc plus démocratique, comme l'a souligné M. le Premier ministre.
Ce traité est donc le premier à avoir été signé par les vingt-sept États membres, le premier à avoir fait l'objet d'un accord en dépassant les clivages anciens, entre États plus ou moins peuplés, entre nouveaux et anciens États membres, entre pays ayant dit « oui » et pays ayant dit « non », et ce grâce à l'initiative du Président de la République et au travail remarquable des présidences allemande et portugaise.
Par ailleurs, compte tenu de l'abandon de la démarche constitutionnelle, ce traité sera ratifié par la voie parlementaire dans vingt-six États membres, et notamment les Pays-Bas. La seule exception est l'Irlande, dont la constitution ne permet pas d'emprunter cette voie pour approuver un traité européen.
L'engagement de la France dans une procédure de ratification parlementaire était fondamental pour nos partenaires, car il a donné enfin de la crédibilité à la perspective d'un autre traité pour l'Europe et a permis d'en définir le contenu en tenant compte des propositions françaises.
Le traité ne résume bien entendu pas le projet européen. C'est clair. Mais il crée une dynamique nouvelle, et c'est sa principale vertu.
Déjà, la Hongrie a ratifié le traité, et près d'une vingtaine d'États membres s'apprêtent à le faire dès le premier semestre de l'année 2008. Il est symbolique que les premières ratifications soient venues d'anciens pays du bloc de l'Est et de ceux qui ont cru que leur liberté se trouvait au sein de l'Union européenne.
Déjà, le Danemark manifeste son souhait d'entrer de plain-pied dans la construction européenne et d'abandonner ses protocoles, qui le placent à la marge de certaines politiques de l'Union.
Pour notre part, nous aborderons notre présidence le 1er juillet prochain avec une dynamique nouvelle, avec un bon traité, qui pose les jalons sur la voie d'une Union européenne plus démocratique, plus forte et tournée vers l'avenir.
Enfin, comme M. le Premier ministre l'a souligné, ce traité nous permet aussi de clore un débat institutionnel qui n'avait pas été résolu depuis les années quatre-vingt-dix et de nous consacrer à l'essentiel, ...
...c'est-à-dire aux projets politiques que nous voulons porter.
Mesdames, messieurs les sénateurs, le traité permet de développer de vraies politiques de la défense, du développement durable, de l'énergie, de croissance plus solide grâce à un nouvel espace de recherche et de formation, et de gestion des mouvements migratoires.
Mais le traité n'en définit pas le contenu. C'est aux dirigeants européens, au Parlement et aux citoyens, qui disposeront d'un pouvoir d'initiative, qu'il appartient d'en décider.
Notre présidence du Conseil de l'Union européenne en sera l'occasion. Bien entendu, notre présidence ne pourra pas tout faire. Mais elle ouvrira la voie pour qu'une nouvelle page soit écrite après le cinquantième anniversaire de l'Europe. Après s'être construite elle-même, l'Europe doit aujourd'hui trouver sa place dans le monde. Grâce à cette révision et à ce traité, elle en a aujourd'hui la possibilité.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le projet de loi constitutionnelle que nous devons examiner aujourd'hui ne doit pas nous étonner.
En effet, il a beaucoup de points communs avec celui que nous avions adopté en 2005.

En outre, ce texte se conforme strictement à la décision du Conseil constitutionnel.
Sur ce point, permettez-moi de formuler un regret. Le Conseil constitutionnel a un peu tendance à ne pas suffisamment motiver ses décisions s'agissant des incompatibilités avec la Constitution. À l'avenir, ses motivations devraient, me semble-t-il, être plus précises.
Le texte ne contient rien de plus, rien de moins que ce que le Conseil constitutionnel préconisait. C'est aussi la raison pour laquelle la révision que nous entamons aujourd'hui ne va pas aussi loin que celle qui avait été engagée en 2005.
Autre élément, le texte du Gouvernement a été adopté sans modifications par l'Assemblée nationale. Aucun amendement n'a été adopté. Là encore, je voudrais exprimer un regret.
J'ai néanmoins découvert qu'il existait, en dehors des parlementaires et du Gouvernement, une autre autorité qui a le droit d'amendement. Cette autorité, c'est le bureau de la séance de l'Assemblée nationale, qui s'est permis d'ajouter trois amendements, sans vote naturellement, pour des raisons qui sont difficilement explicables, en remplaçant l'expression « À l'article... » par « Dans l'article... ».

Cette modification me paraît complètement inopérante : je demanderai au service de la séance du Sénat de bien vouloir rétablir le texte original, lequel était mieux rédigé que le texte qui nous est parvenu de l'Assemblée nationale, corrigé par le service de la séance.

Eh oui, il faut dire les choses telles qu'elles sont !
Une précision s'impose cependant : il ne s'agit nullement aujourd'hui de ratifier le traité. Celui-ci sera ratifié ultérieurement, si nous modifions la Constitution - il faut le préciser, car j'ai l'impression, après les débats que nous avons eus tout à l'heure, que certains ne l'avaient pas compris.
Protestations sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.

Nous sommes là simplement pour réviser la Constitution et pour permettre éventuellement la ratification du traité. Cela signifie qu'il n'y a dans le texte qui nous est proposé aujourd'hui ni débordement, ni ajout, ni complément au texte initial, parce que le seul but de ce texte est de permettre la ratification, et rien d'autre.
Permettez-moi d'exprimer trois regrets, et un regret d'ordre général.
Le regret général, c'est qu'à chaque fois que l'on ratifie un traité, nous sommes quasiment obligés de modifier la Constitution. Certains pays ont adopté des formules qui leur permettent de ne pas avoir à modifier à chaque fois leur constitution : c'est le cas, par exemple, du Portugal, qui a des dispositions beaucoup plus générales. C'est la raison pour laquelle, dans mon rapport, j'ai repris les propositions du professeur Joël Rideau, qui éviteraient une modification de la Constitution à chaque adoption d'un nouveau traité, avec des garde-fous néanmoins.
J'en viens à mes trois regrets.
Le premier, c'est le maintien de l'obligation du référendum pour l'admission de nouveaux États au sein de l'Union européenne, parce que nous ne savons pas utiliser le référendum dans notre pays. En France, nous utilisons toujours le référendum, non pas pour adopter un texte ou adopter une décision, mais pour sanctionner ou pas le Gouvernement. Ce n'est pas un référendum : c'est un plébiscite.
Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.

Je craindrais, par exemple, que l'entrée de la Norvège au sein de l'Union européenne ne soit refusée parce que le Gouvernement ou tel ministre aurait déplu à l'opinion publique.

Personnellement, je pense qu'une formule permettrait de conjuguer à la fois le référendum et la possibilité de l'utiliser plus souvent : ce serait d'établir, comme dans près de la moitié des pays européens, un seuil de 50 % de votants en deçà duquel le référendum est inopérant - je ferme la parenthèse.
Les ministres nous ont donné l'assurance qu'au moment de la révision constitutionnelle, qui devrait intervenir au printemps, nous pourrions reprendre cette question du référendum obligatoire pour l'entrée de nouveaux États : nous sommes en effet le seul pays européen à admettre cette procédure.

Vous avez soutenu cette disposition l'année dernière, monsieur le rapporteur !

Nous pourrons donc revoir cette disposition le moment venu, au printemps.

Le deuxième regret, c'est le maintien de la règle de la réciprocité dans le principe du vote des ressortissants européens aux élections locales.

La réciprocité n'est plus nécessaire puisque les ressortissants européens ont tous le droit de vote aux élections locales ; c'est automatique. Nous pourrons corriger cette situation, là encore, au moment de la révision constitutionnelle du printemps.
Le troisième regret a trait à un problème de terminologie juridique.
Dans le texte de la Constitution, on utilise le vocabulaire habituel des traités européens, c'est-à-dire un mélange d'anglais, de français et d'allemand qui n'a pas de précision juridique.
Or nous avons adopté, dans les traités précédents et dans le traité de Lisbonne, un texte qui n'a pas de valeur juridique pertinente : c'est l'acte législatif européen, qui est défini non pas sur le fond mais par la forme. Nous aurons donc des actes législatifs européens de nature réglementaire. Le problème est simple : certains lecteurs de la Constitution risquent de faire la confusion entre l'acte législatif européen et l'acte législatif français, qui ne sont pas toujours de même nature.
Ces regrets étant exprimés, j'en viens au fond du texte. Celui-ci compte trois articles, dont un article tout à fait important, et deux articles de coordination.
L'article 1er, c'est celui qui permet la ratification du traité de façon générale. Le Parlement sera naturellement libre de le ratifier ou non, selon la procédure engagée par le chef de l'État.
Il faut également noter l'autorisation de remplacer partout la mention de la Communauté européenne par celle de l'Union européenne.
C'est à l'article 2, le plus important, que sont mises en place les différentes innovations ou transformations de notre Constitution.
Tout d'abord, comme l'a souligné avec talent Mme le garde des sceaux, le texte proposé pour l'article 88-1 est la disposition générale applicable à tous.
Le texte proposé pour l'article 88-2 concerne le mandat d'arrêt européen. On pouvait penser que l'article 88-1 suffisait, mais l'article 88-2 permettrait de tenir compte des éventuelles modifications ultérieures concernant l'application du mandat d'arrêt européen. Par conséquent, je ne suis pas opposé à cet article.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier le 3°, qui fait référence aux actes législatifs européens dont il est question à l'article 88-4 ; ce sont des dispositions formelles, ainsi que le 4°.
Les textes proposés pour les articles 88-6 et 88-7, en revanche, mettent en place de nouveaux droits pour le Parlement, et nous devons nous en féliciter. Mme le garde des sceaux nous a présenté ces nouveaux droits.
L'article 88-6 dispose le droit pour chacune des chambres du Parlement de présenter un avis motivé sur l'application du principe de subsidiarité et de former un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne.
Aux termes de l'article 88-7, les deux chambres pourront, par le vote d'une motion adoptée en termes identiques, s'opposer à ce que les règles de la majorité soient modifiées. Nous sommes donc face à un véritable droit de veto reconnu à chaque parlement européen.
Qu'il me soit permis, monsieur le président, à propos de ces articles 88-6 et 88-7 de la Constitution, de souhaiter très rapidement la refonte de notre règlement, afin de permettre la veille nécessaire à leur application. Celle-ci pourrait être confiée à un comité des affaires européennes, c'est-à-dire à l'heure actuelle à la Délégation pour l'Union européenne, qui serait, comme cela se produit dans un grand nombre de pays européens, l'organe chargé de surveiller en permanence ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg.
M. Robert del Picchia applaudit.

Ces remarques étant faites, la commission des lois vous propose, mes chers collègues, d'adopter le projet de loi constitutionnelle tel qu'il nous vient de l'Assemblée nationale.
Applaudissements sur les travées de l'UMP. - Mme Anne-Marie Payet applaudit également.

M. le président. Mes chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation du Parlement de Moldavie, conduite par son président M. Marian Lupu, et présente à Paris à l'invitation du Sénat.
Mme le garde des sceaux, M. le secrétaire d'État, Mmes, MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Les relations interparlementaires entre nos deux pays sont très actives. Elles apportent une remarquable contribution au renforcement de nos relations bilatérales comme en témoigne le choix qui vient d'être fait du Sénat, en liaison avec l'Assemblée nationale et le Parlement hongrois, pour assister le Parlement moldave dans le renforcement de ses capacités administratives.
J'en profite pour saluer notre collègue Mme Josette Durrieu, présidente active du groupe interparlementaire d'amitié France-Moldavie du Sénat.
Je forme le voeu que ce séjour permette d'approfondir et de renforcer nos relations avec ce pays qui est profondément attaché à la culture européenne et à la défense de la francophonie et de la diversité culturelle.
Je joins à ce salut cordial exprimé par le Sénat l'expression de ma considération personnelle pour le Président Lupu, dont j'admire notamment la maitrise exceptionnelle de notre langue.
Applaudissements.

Nous reprenons la discussion du projet de loi constitutionnelle, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant le titre XV de la Constitution.
Dans la suite de la discussion générale, la parole est à M. le président de la délégation pour l'Union européenne.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, jusqu'à présent, la question du référendum a tenu, dans une partie de la classe politique française, une grande place dans le débat sur le traité de Lisbonne. Une place trop grande, à mon avis, car soumettre ou non un traité au référendum, rappelons-le, est une prérogative du Président de la République. Or le Président de la République, je le souligne à mon tour, s'est clairement prononcé, avant son élection, pour une ratification par la voie parlementaire. Ce choix était d'autant plus significatif que tous les autres candidats, sans exception, étaient favorables à un référendum.

La question a donc été tranchée l'année dernière par le vote du 6 mai, confirmé par le vote du 17 juin.

Nous ne sommes pas devant un problème de légitimité.
D'ailleurs, chacun peut le constater, il n'y a pas dans les profondeurs du pays, comme aurait dit le général de Gaulle, un appel pressant à un nouveau référendum. Ainsi, la question ne se pose, à mon avis, ni en droit ni en fait.

Venons-en au projet de révision constitutionnelle qui nous est soumis.
La décision de non-conformité qui a été rendue par le Conseil constitutionnel est dans la lignée de ses précédentes décisions sur le même sujet.
Quel est le raisonnement du Conseil ? Le traité de Lisbonne transfère de nouvelles compétences à l'Union, essentiellement en matière de justice et d'affaires intérieures ; il change les modalités d'exercice de certaines des compétences transférées, en étendant à de nombreux domaines la procédure où le Conseil décide à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen ; il contient également des clauses particulières permettant de modifier certaines règles sans passer par la procédure de révision ordinaire. Ainsi, comme le souligne le Conseil constitutionnel, le nouveau traité affecte « les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale » et appelle donc une révision constitutionnelle.
Nous sommes là dans une parfaite continuité avec les cinq précédentes décisions concernant la révision des traités européens.
De même, le projet de loi constitutionnelle s'en tient, comme ses prédécesseurs, à la révision strictement nécessaire pour permettre l'approbation du traité précis sur lequel le Conseil constitutionnel a été consulté.
Comme l'a rappelé le doyen Gélard, d'autres pays membres procèdent différemment : ils ont inséré dans leur Constitution une clause européenne de portée générale et n'ont pas, de ce fait, à réviser leur Constitution aussi souvent que nous.
Faudrait-il s'inspirer de cet exemple ? Je ne le crois pas. Bien sûr, notre procédure est plus compliquée, forcément plus lente. C'eût été un beau symbole que la France soit la première à ratifier le traité de Lisbonne, mais notre procédure comportait trop d'étapes pour que ce soit possible. Nous serons donc le deuxième pays à le faire.
Mais là n'est pas l'essentiel. En visant à chaque fois les transferts de compétences tels qu'ils sont organisés par un traité précis, nous nous obligeons à examiner dans toutes ses conséquences chaque étape de la construction européenne. Nous prenons la pleine mesure des enjeux sans éluder aucune question de droit. En outre, nous nous prononçons selon la procédure parlementaire la plus exigeante, impliquant l'accord des deux assemblées et la majorité des trois cinquièmes du Congrès. De cette manière, on ne peut nous reprocher de faire avancer l'Europe en tapinois !
On aurait également pu concevoir que le projet de révision soit l'occasion de prendre en compte les propositions de la commission Balladur concernant le titre XV de la Constitution. Mais le risque aurait été grand que le débat se focalise sur l'obligation de référendum pour toute nouvelle adhésion, avec le risque d'introduire une confusion dans l'opinion, car le traité de Lisbonne n'a rien à voir avec la question des élargissements futurs. Il me semble donc que l'approche retenue pour le projet de révision constitutionnelle doit être approuvée.
Cependant, une conséquence de cette approche est que le jugement porté sur le projet de révision dépend avant tout, qu'on le veuille ou non, du jugement porté sur le traité. Comme la révision ne sert qu'à permettre la ratification d'un traité bien précis, c'est en fonction de ce traité que chacun de nous va se prononcer en réalité. Pourtant, nous devons essayer de ne pas anticiper sur l'examen du traité lui-même. Une chose après l'autre...
Je voudrais donc seulement rappeler que ce texte trouve en grande partie sa source dans la Convention sur l'avenir de l'Europe où le Sénat était représenté par Robert Badinter et moi-même. Je constate d'ailleurs que l'on y retrouve un certain nombre des préoccupations que nous avons essayé, avec d'autres, de faire valoir au fil des ans.
Je citerai d'abord les droits fondamentaux.
Nous souhaitions que les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux soient inscrits dans le droit primaire de l'Union. C'était ce que prévoyait le traité constitutionnel. Sous une autre forme, le traité de Lisbonne parvient au même résultat. En particulier, de nombreux droits sociaux seront ainsi reconnus par l'Union : le droit à l'éducation, le droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, la protection en cas de licenciement injustifié... Ces droits seront garantis par les juges nationaux et européens. Par ce biais, nous verrons progresser l'harmonisation sociale en Europe, qui est si souhaitable.

Non, c'est interdit par le texte ! Ne dites pas des choses qui ne sont pas !

Vous pourrez vous exprimer tout à l'heure, mon cher collègue !
Je citerai ensuite la construction de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, que vous avez rappelée, madame le garde des sceaux.
Face au développement de la délinquance internationale, on ne peut admettre que les États membres réagissent en ordre dispersé. Mais, dans le même temps, pour renforcer la confiance mutuelle qui est le fondement de la coopération judiciaire et policière, il faut des normes communes et des instruments communs. Sur ce point, le nouveau traité fera sauter le verrou de la décision à l'unanimité, qui, trop souvent, a conduit à des demi-mesures.
Désormais, le Conseil des ministres décidera dans presque tous les cas à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. De plus, l'attribution à l'Union de la personnalité juridique lui permettra de conclure des accords internationaux en matière de coopération policière et judiciaire. L'Union aura enfin les outils nécessaires pour conduire une action efficace dans ces domaines.
Une autre préoccupation que nous avons mise en avant était l'association des parlements nationaux, thème sur lequel le Sénat insiste depuis longtemps.
Les avancées dans ce domaine sont également très importantes. C'est d'ailleurs l'un des aspects qui rendent aujourd'hui nécessaire une révision de notre Constitution. Les parlements nationaux - on n'insistera jamais assez sur ce point - deviennent des acteurs de la construction européenne.

Le Sénat va donc devenir l'un des acteurs de la construction européenne. Certes, c'est déjà le cas, mais cette action sera d'une autre nature et d'une autre ampleur.
Le rôle des Parlements ne sera plus seulement de contrôler l'action européenne de leurs gouvernements, comme nous le faisons, mais si mal. Ils interviendront dans le processus de décision européen lui-même pour veiller à ce que l'Union respecte le fameux principe de subsidiarité et réponde ainsi à une préoccupation qui est s'exprimée à l'occasion du dernier référendum : l'Europe en fait trop ou le fait mal.
C'est une responsabilité importante, car si nous parvenons à recentrer l'action de l'Union vers les domaines où elle est vraiment nécessaire, nous aurons fait un pas important vers la réconciliation de l'Europe avec les citoyens.
Enfin, une autre préoccupation que nous avons cherché à faire valoir était l'exigence de souplesse.
Tout le monde aspire à tourner enfin la page du débat institutionnel. Tout le monde espère que nous n'aurons plus de traité sur ce sujet avant longtemps. Afin que cela soit possible, il faut que les traités contiennent une marge d'évolution, j'allais dire une souplesse, sans avoir à relancer toute la mécanique des conférences intergouvernementales.
M. Jean-Luc Mélenchon s'exclame.

Les quelques thèmes que j'ai évoqués sont là pour montrer que le traité de Lisbonne repose sur un héritage de plusieurs années de débats où notre assemblée a apporté sa pierre.
Plus généralement, ce traité me paraît réussir une large synthèse. Bien des courants politiques en Europe, c'est le cas sur toutes nos travées ici, ont contribué à la construction de l'Union, n'est pas, monsieur Mauroy ? Dans notre pays, chacun à leur manière, les démocrates-chrétiens, les libéraux, les socialistes et les gaullistes ont apporté une contribution. Tous sont pour quelque chose dans les équilibres du nouveau texte. Dans le même temps, le traité de Lisbonne sera un trait d'union entre anciens et nouveaux États membres, puisque, pour la première fois, tous, les Vingt-Sept, auront participé aux décisions sur un pied de complète égalité.
Sur cette base, nous pourrons enfin tourner la page institutionnelle et nous concentrer sur le contenu des politiques communes ainsi que sur les grandes questions comme la croissance et l'emploi, le développement durable ou l'élargissement. La présidence française, vous l'avez dit, monsieur le secrétaire d'État, devra être une étape dans ce recentrage, en même temps qu'elle verra - espérons-le - l'achèvement du processus de ratification.
Mais nous ne devons pas oublier les leçons des référendums en France et aux Pays-Bas. C'est en montrant qu'elle est efficace, qu'elle donne des résultats correspondant aux attentes des citoyens que la construction européenne retrouvera un soutien plus large et plus solide. Plus tôt nous sortirons du débat institutionnel, plus tôt nous pourrons passer aux autres questions qui préoccupent nos concitoyens.

M. Hubert Haenel, président de la délégation pour l'Union européenne. C'est, me semble-t-il, un grand argument pour approuver aujourd'hui la révision constitutionnelle et ratifier demain le traité de Lisbonne.
Applaudissementssur les travées de l'UMP. - M. Pierre Fauchon applaudit également.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, près de cinquante ans après sa création, l'Europe n'a jamais autant passionné, mais j'ai aussi envie de dire qu'elle n'a jamais autant divisé. La raison en est peut-être tout simplement que chacun voudrait l'Europe à son image. Pour la droite, l'Europe se doit d'être libérale ; pour la gauche, elle doit être de gauche. Rien de plus logique à condition d'ajouter que l'Europe est ce que nous en faisons, ou plutôt ce que les peuples décident d'en faire.
C'est dans le débat politique, c'est dans la confrontation des idées que se font les majorités, celles qui déterminent les orientations à donner aux politiques européennes. Si l'on n'a pas compris cela, je pense que l'on saisit mal le sens de la construction européenne, ou alors il peut y avoir une contradiction avec l'idéal européen, qui n'est autre que l'ambition de bâtir « une communauté de destin » entre les peuples qui y participent. Cette communauté de destin est l'un des plus grands projets politiques jamais entrepris.
À cette histoire, les socialistes ont fortement contribué et j'aimerais ici réaffirmer l'engagement européen des socialistes français, de tous les socialistes français.
À l'image de la construction européenne, fruit d'un compromis entre des projets politiques et institutionnels différents, le traité de Lisbonne permet d'avancer sans nous satisfaire complètement. Il renoue avec la tradition des « petits pas », celle de modifications partielles des traités existants, difficilement intelligibles pour les citoyens.
Soyons vigilants, car toute une série de dérogations permettent aux États membres de s'affranchir des dispositions du traité. C'est le cas notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et en ce qui concerne la Charte des droits fondamentaux. Il faudra donc s'assurer que cette souplesse ne se réalise pas au détriment des droits, de la sécurité juridique et de l'égalité entre les citoyens européens.
Nous regrettons également l'absence d'harmonisation en matière sociale et fiscale, tout comme nous restons sur notre faim quant à une véritable réorientation de la gouvernance de la zone euro en faveur de la croissance et de l'emploi, dont la crise financière et bancaire, qui reste toujours sous-estimée par le Gouvernement, nous rappelle l'urgence et la nécessité.
Pour autant, ce traité comporte un certain nombre d'avancées qui nous paraissent essentielles pour le fonctionnement de l'Union européenne et ses compétences : la création d'une présidence stable de l'Union, la création d'un Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, le renforcement des pouvoirs du Parlement européen, l'adoption d'un protocole sur les services publics, une référence à des nouveaux défis tels que la solidarité énergétique ou le changement climatique, ou encore la procédure de contrôle renforcé des Parlements nationaux.
J'aimerais insister sur ce dernier point, car il me semble tout à fait primordial que la représentation nationale s'implique davantage dans le contrôle et le suivi des politiques européennes.

Celles-ci sont désormais des enjeux de politique nationale, et pour que les citoyens s'approprient la construction européenne, il faudra que le Parlement fasse de même en exerçant pleinement ses nouvelles prérogatives en matière de contrôle de subsidiarité vis-à-vis de la Commission et du Gouvernement.

Le contrôle politique de l'action du Gouvernement à Bruxelles doit également donner l'occasion aux assemblées de discuter plus régulièrement et en amont des positions que le Gouvernement va défendre au sein du Conseil des ministres. Mes chers collègues, il n'est pas normal que nous soyons consultés seulement la veille des conseils européens, alors que les arbitrages sont bien souvent déjà rendus. Ce renforcement du droit de regard de la représentation nationale s'inscrit d'ailleurs dans la logique du renforcement des pouvoirs du Parlement, qui me semble être une proposition acceptée aujourd'hui par tous. Nous attendons qu'elle débouche sur une vraie concrétisation.
Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre dans un contexte mondial inquiétant, parce que nous n'avons pas le droit de pratiquer la politique de l'autruche ou de nous en remettre à des lendemains incertains, parce qu'il faut donner une perspective de sortie à la crise politique de l'Europe, nous sommes favorables au traité de Lisbonne et voterons en faveur de la ratification du traité, ...

...comme l'ensemble des partis socialistes d'Europe.
J'aimerais cependant souligner que cet engagement des socialistes pour l'Europe se double d'une ambition, celle de réaliser une Europe du progrès social, et d'une exigence, celle de construire une Europe des citoyens.
Si la construction européenne est un succès indéniable pour la paix du continent, il n'en demeure pas moins que le désenchantement des citoyens face au projet européen montre qu'elle a aujourd'hui besoin d'un nouvel élan, d'un nouveau projet et, surtout, d'une nouvelle méthode.
Ce n'est pas véritablement une avancée que d'éviter de soumettre la ratification du traité de Lisbonne au peuple français alors que ce dernier, cela a été dit plusieurs fois, avait rejeté le traité constitutionnel européen en 2005. C'est au contraire un mauvais service à lui rendre, ou plutôt à ne pas lui rendre.
Qu'on ait été pour le « oui » ou pour le « non » en 2005, il est une leçon indéniable : la participation active des citoyens aux orientations de la construction européenne est devenue un impératif démocratique.
Or le chef de l'État escamote le débat après le référendum de 2005. C'est un jeu dangereux, pour l'engagement européen de la France et des Français, dont il portera la responsabilité.
Il n'est plus possible de continuer à parler d'Europe seulement tous les trois ou quatre ans à l'occasion de la révision d'un traité. L'Union européenne est une réalité quotidienne, qui façonne notre pays.
À vouloir passer en force, les antagonismes trop longtemps tus se cristallisent, sans pour autant faire progresser le projet européen.
Dans ce contexte, notre position sur le projet de révision constitutionnelle exprime cette ambition et cette exigence. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour répondre non pas à une question qui porte sur la ratification du traité, mais à une question simple : acceptez-vous de modifier la Constitution pour permettre la ratification ultérieure du traité de Lisbonne ?
Pour cela, il me semble incohérent de répondre négativement à un préalable incontournable au débat sur la ratification du traité.
Nous ne pourrions, en effet, être favorables au traité et contre la révision de la Constitution, qui, si elle était refusée, empêcherait, d'une part, tout recours au référendum ou, d'autre part, tout examen par voie parlementaire.
Les deux procédures de révision constitutionnelle, parlementaire ou référendaire, ne sont pas substituables, interchangeables. Si l'une échoue, l'autre ne peut être utilisée. Cela signerait donc l'interruption du processus de ratification.
Qui peut croire que le Président de la République, malgré ce que j'ai entendu ce soir, accepterait de s'accommoder de la Constitution, en organisant un référendum sur la ratification sans révision préalable ? Qui peut croire à un référendum qui ne porterait que sur la révision constitutionnelle ?
À l'inverse, nous ne pouvons pas non plus donner un blanc-seing à la méthode choisie par Nicolas Sarkozy tout au long de ce processus. Nous avons durant toute la campagne pour l'élection présidentielle - ai-je besoin de le rappeler ? - défendu la voie référendaire pour la ratification. On ne peut, en effet, ignorer l'ampleur du débat de 2005 et faire tout pour qu'il n'existe plus.
Les socialistes s'opposent à la décision frileuse du chef de l'État de recourir à la ratification du traité par voie parlementaire et marqueront leur désaccord en s'abstenant sur la révision constitutionnelle.
C'est pour nous la seule façon d'être en cohérence avec nos idées. C'est pour nous la seule manière d'exiger un débat démocratique sans mettre en péril le traité, de défendre la forme autant que le fond.
Enfin, j'aimerais rappeler que, au-delà des dispositions juridiques du traité, ce qui comptera, en définitive, ce sera la volonté politique de mettre en oeuvre toutes ces dispositions pour faire avancer le projet européen. Car l'aventure européenne est une aventure politique. L'Europe peut être de droite comme elle pourra être demain, je l'espère, de gauche.
Les socialistes ont un message pour l'Europe, un projet alternatif à celui prôné par la droite de ce pays : directive sur les services publics, augmentation du budget communautaire, véritable gouvernement économique européen, politique d'investissements publics dans les infrastructures et la recherche. Nous défendons ces initiatives chaque jour dans les instances européennes.
La France prendra la présidence de l'Union européenne le 1er juillet de cette année. Mes chers collègues, si je puis me le permettre, je demande solennellement au Gouvernement d'engager une véritable délibération collective sur ces questions, par exemple en défendant l'idée d'une directive horizontale sur les services publics en Europe ou en proposant un réel renforcement de la gouvernance de la zone euro et la modification des critères du pacte de stabilité et de croissance.
Les socialistes seront mobilisés pour faire progresser leurs idées et démontrer aux Français que, au-delà des traités, une autre Europe est possible, pas forcément celle qui serait à l'image de la politique menée par Nicolas Sarkozy.
En deux mots, nous ne voulons pas d'une Europe purement intergouvernementale, d'une Europe sécuritaire et néolibérale, d'une Europe des élites contre le peuple. Mais nous aspirons à une Europe démocratique, s'appuyant sur la délibération et l'adhésion des peuples, une Europe solidaire et de progrès social.
Mes chers collègues, ce traité permettra à l'Europe de continuer à avancer vers cette « communauté de destin » qui fonde le rêve européen. Toutefois, nous devons être exigeants, car ce rêve ne sera plus si l'Europe n'apporte pas l'espérance, la perspective de débat et de progrès.
Nous sommes devant un défi immense mais fondateur : réconcilier les citoyens et le projet européen. En d'autres termes, nous devons faire en sorte que le citoyen n'ait plus peur de l'Europe et que l'Europe n'ait plus peur du regard des citoyens.
Il y va de notre responsabilité, de notre conception de la démocratie, mais aussi de notre avenir commun.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.
Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Monsieur le président du Sénat, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le président de la délégation pour l'Union européenne, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, alors que nous venons de saluer la mémoire de notre collègue Serge Vinçon, qui restera pour l'ensemble de ses amis l'exemple même de la gentillesse, de la compétence et de la probité, je souhaite rappeler qu'il y a bientôt dix ans, au début du mois de février 1998, nous quittait un collègue qui fut un grand Français et un grand Européen, je veux parler de Maurice Schumann.

Porte-parole de la France libre aux côtés du général de Gaulle, fondateur et président du Mouvement républicain populaire, Maurice Schumann était aussi l'ardent défenseur de l'amitié franco-allemande et le promoteur exigeant de la construction européenne.
Il était profondément gaulliste, ardemment Européen, passionnément Français.
L'UMP est fière de ses grands européens, mais elle sait aussi qu'elle doit partager cet héritage avec tous ceux qui ont agi avec tous les présidents de la ve République - il serait injuste de ma part de ne pas saluer ici l'action de Jacques Chirac -, mais aussi toutes celles et tous ceux qui, avec Pierre Pflimlin, Raymond Barre, Jacques Delors ou Simone Veil, ont marqué l'Europe de « leur cicatrice ».
Malgré ces engagements pluralistes, l'Europe s'est progressivement éloignée de ses peuples. Un immense silence a accompagné l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Union, un profond doute s'est exprimé pour le traité de Maastricht et, puisqu'il n'avait pas été entendu comme un avertissement, en 2005, ce doute s'est fait refus.
Dans une démocratie, ce ne sont pas les électeurs qui ont tort, ce sont les candidats ou les projets qui ne sont pas toujours à la hauteur des espoirs qu'ils suscitent !
C'est pourquoi il appartient à chacun d'entre nous de se remettre en cause pour essayer, là où il se trouve, d'apporter des réponses nouvelles à l'avenir de notre continent.
Chers collègues, je vous parle ici avec la sincérité de mon expérience. Le résultat du référendum de 2005, je l'ai vu, très tôt, avec une immense tristesse, inscrit dans l'évolution continue de la déception populaire à l'égard de l'Europe. On peut dire honnêtement que les causes sont multiples : la question de la Turquie, la réforme des retraites, la cassure au sein du PS, les délocalisations, la directive Bolkestein. Tout cela a sans doute compté.
Mais mon sentiment profond est que les Français ont dit tout haut ce que les peuples européens, qui n'ont pas été consultés par référendum, pensaient tout bas. Je crois, en effet, que la contestation est venue, cette fois, de certains pro-européens eux-mêmes.
Je veux dire que le vote des antieuropéens n'auraient pas suffit. Après le « non » néerlandais, j'ai été convaincu de cette analyse par Jean-Claude Juncker, le président de l'Eurogroupe, quand il m'a appris que les jeunes Luxembourgeois avaient voté massivement « non » au référendum du Grand-duché. Comment des jeunes, nés « trilingues », ne connaissant pas le chômage et vivant au coeur de l'Europe peuvent-ils dire « non » à leur avenir ? Ils ne sont pas anti-européens, ils sont sans doute - il nous faut y réfléchir - pour une Europe différente.
Pour la première fois, massivement, les Européens se sont divisés, et une grande partie d'entre eux ont rejoint les anti-européens. Là, je crois est notre erreur, nous nous sommes trompés de message. En plaçant le débat européen sur le terrain constitutionnel, nous avons donné le sentiment que notre projet n'était qu'institutionnel.
Nous avons parlé du moteur quand les peuples nous demandaient de parler de la destination. Les eurocrates nous ont égarés en nous faisant croire que la mécanique c'était de la politique. On nous demandait des projets et nous débattions des structures.
Pour beaucoup d'Européens, l'Europe existe aujourd'hui, le débat traditionnel sur la construction est maintenant dépassé.
La question n'est plus la paix en Europe, mais ce que doit faire l'Europe pour la paix du monde. La question n'est plus la monnaie unique, mais comment l'Europe protège-t-elle sa monnaie pour mieux défendre ses entreprises ? La question n'est plus de multiplier les échanges de jeunes, mais comment améliorer le classement mondial de nos universités ? La question n'est plus « l'Europe, oui ou non ? », mais comment rendre le projet européen, fort, juste et moderne ?
Le Président de la République française a entendu ces messages populaires.
Il a proposé un traité qui, à la fois, débloque la gouvernance européenne et clôt le débat institutionnel.
Il a replacé la question du travail au coeur du projet européen en s'engageant pour que l'emploi en Europe redevienne prioritaire dans la gouvernance économique et monétaire de l'Union.
Il a relancé l'Europe de la défense et, simultanément, il a construit une relation apaisée avec les États-Unis, notamment à propos de l'OTAN.
Il a donné une nouvelle perspective à l'Europe, un nouvel horizon, avec le projet d'Union pour la Méditerranée.
L'espoir européen redevient possible.
Le traité de Lisbonne n'est pas un traité « au rabais », cela a été dit. Au contraire, à bien des égards, il est même plus abouti que ne l'était le traité constitutionnel. Il apporte des réponses précises, à la fois à ceux qui ont voté « non » et à ceux qui souhaitaient que l'Europe aille de l'avant.
Le vote des Français ne pouvait être ignoré.
L'UMP est trop attachée au principe de subsidiarité et à l'existence des États-nations pour mésestimer cette inquiétude qui existe à l'égard de la construction européenne et qui nuit, évidemment, à son avenir. Le traité de Lisbonne apporte donc des réponses concrètes à la crainte manifestée par certains de voir surgir un « super État » européen.
Ce traité renonce, en particulier, à reprendre tous les attributs caractéristiques d'un État pour désigner les institutions européennes. On ne parle plus de « Constitution », mais de « traité ». Le terme de « ministre des affaires étrangères de l'Union » a été abandonné comme celui de « lois européennes ». Les symboles même de l'Europe, comme le drapeau et l'hymne, ne sont plus mentionnés dans le traité ; je souhaite cependant qu'ils restent très présents dans nos pratiques.

Dans le même ordre d'idées, la Charte des droits fondamentaux ne figure plus dans le corps même du nouveau traité et, comme le faisait remarquer tout à l'heure le président Hubert Haenel, si tout cela change peu juridiquement, cela change beaucoup politiquement.
La Constitution européenne était considérée, selon les cas, comme un point d'arrivée pour les « euroréalistes », ou comme un point de départ pour les plus fédéralistes. Le traité de Lisbonne clôt le débat institutionnel pour longtemps.
Ce nouveau traité comporte de nombreuses garanties afin que l'Union européenne ne s'écarte pas de sa mission. L'Union européenne dispose, en effet, de compétences d'attribution qui doivent être exercées de manière stricte. Elle n'a pas la compétence de sa compétence, comme le terme « constitution » pouvait, à tort, le faire croire.
Par ailleurs, le principe de subsidiarité est réaffirmé, l'Union n'est légitime pour intervenir que pour autant qu'elle est mieux à même d'agir que les États membres.
Bien entendu, les mécanismes prévus par le traité constitutionnel pour mieux contrôler l'exercice des compétences de l'Union européenne ont été maintenus.
Je pense à la procédure dite du « carton jaune », qui permet aux parlements nationaux de demander à la Commission européenne de revoir un projet qu'ils jugent contraire à la subsidiarité, et à la procédure dite du « carton rouge », qui leur permet de saisir la Cour de justice après l'adoption d'un texte.
Non seulement le traité de Lisbonne conserve ces avancées, mais il les complète par une troisième procédure dite du « carton orange », qui permet à une majorité de parlements nationaux d'obtenir - et c'est important - l'interruption de la discussion sur un texte au nom du respect du principe de subsidiarité.
En instaurant ainsi cette véritable « question préalable » à l'encontre d'un texte qui outrepasserait les compétences de la Commission européenne, le traité de Lisbonne renforce le contrôle politique - et donc démocratique - de la construction européenne.
Pour le Sénat, le traité de Lisbonne constitue une exceptionnelle avancée.
Jusqu'à présent, en vertu de l'article 88-4 de la Constitution, le Sénat était, comme l'Assemblée nationale, destinataire des projets ou propositions d'actes comportant des dispositions de nature législative. Le Gouvernement, qui pouvait lui soumettre d'autres textes, aura d'autres possibilités, et le Sénat aura également d'autres opportunités. Les pouvoirs du Sénat étaient limités, jusqu'à ce jour, puisqu'il ne pouvait adopter que des résolutions.
Avec le traité de Lisbonne et les modifications qu'il nous est proposé d'apporter à la Constitution, les attributions du Sénat se trouvent substantiellement renforcées.
Le nouvel article 88-6 prévoit que le Sénat peut « émettre un avis motivé sur la conformité d'un projet d'acte législatif européen au principe de subsidiarité », c'est-à-dire sur un projet qui nous paraîtrait en dissonance avec le principe de subsidiarité.
Par ailleurs, le Sénat pourra « former un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité ».
Enfin, concernant la procédure de révision simplifiée, le nouvel article 88-7 de la Constitution prévoit qu'il appartiendra à l'Assemblée nationale et au Sénat d'adopter, le cas échéant, une motion en termes identiques pour s'opposer à une modification des règles d'adoption d'actes de l'Union européenne au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération civile.
Mes chers collègues, vous le voyez, le traité de Lisbonne est une avancée en matière de renforcement des garanties démocratiques.
Il en est de même de la question de l'élargissement de l'Union, qui a constitué un autre motif d'inquiétude. Là encore, le traité de Lisbonne apporte des améliorations notables, puisqu'il introduit une référence aux fameux critères d'adhésion adoptés en 1993.
À cet égard, le groupe UMP, et le doyen Gélard l'a dit, ne peut que saluer le choix du Gouvernement de ne pas ouvrir, à l'occasion de cette révision constitutionnelle, des débats sans rapport avec le traité, à l'image de l'avenir du débat sur l'article 88-5 relatif aux conditions d'approbation des futures adhésions à l'Union.
C'est là une marque de sagesse, comme l'a dit M. Patrice Gélard, le rapporteur de la commission des lois. Qu'il me permette d'exprimer mon avis : gardons l'arme référendaire tant qu'avec la Turquie on n'aura pas substitué un projet de partenariat privilégié à l'actuel processus d'adhésion.
Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP. - M. Yves Pozzo di Borgo applaudit également.

Le traité de Lisbonne ne change pas substantiellement la nature de l'Union européenne, comme avait pu le faire le traité de Maastricht en 1992 ou le traité constitutionnel. Il s'apparente davantage à l'Acte unique, au traité d'Amsterdam ou au traité de Nice, qui ont tous fait l'objet d'une ratification parlementaire.
C'est pourquoi l'UMP considère que la ratification de ce traité, tout comme la modification constitutionnelle qui doit la précéder en vertu de la décision du Conseil constitutionnel, ne nécessite pas de convoquer un référendum.
Au demeurant, comme l'a observé, là encore, le président Hubert Haenel, il convient de rappeler que Nicolas Sarkozy a toujours été très clair, lors de la campagne pour l'élection présidentielle, sur son intention de faire adopter le traité simplifié par voie parlementaire. Je reconnais que le président Jean-Pierre Bel a dit clairement que, dans le débat présidentiel, sur ces sujets, nos positions étaient contraires. Le peuple a arbitré. Les Français se sont prononcés en toute connaissance de cause.
L'urgence pour la France n'est donc pas aujourd'hui de rouvrir un débat sur l'avenir de l'Europe ni de revenir sur le choix de 2005. Dès l'année prochaine, les Français auront l'occasion de se prononcer, lors des élections européennes. Faisons du rendez-vous de 2009 un grand débat politique ! S'il y a des élections à politiser, je souhaite que ce soient les élections européennes, parce que ce sont elles qui influenceront le cours de l'organisation des institutions telles qu'elles seront mises en application par le traité de Lisbonne.
L'urgence pour la France est de retrouver toute sa place dans l'Union européenne, en montrant qu'elle est exemplaire, c'est-à-dire en ratifiant vite ce traité.
Dans un monde dangereux, nous avons besoin des avancées que prévoit le traité en faveur d'Europol et d'Eurojust. Nous avons également besoin de faire progresser la politique étrangère et de sécurité commune, comme le prévoit le traité.
Enfin, nous avons un besoin urgent d'une gouvernance économique et sociale renforcée. J'observe, à cet égard, que le traité apporte des garanties concernant les services d'intérêt général, qui ont suscité un grand débat en 2005, et qui répondent aux attentes actuelles de la société française.
L'Europe du traité de Lisbonne, mes chers collègues, est plus sociale que celle de l'Acte unique de 1986, plus démocratique que celle du traité de Maastricht de 1992, et plus efficace, bien sûr, que celle du traité de Nice de 2001. Cette Europe n'est certes pas parfaite, mais elle représente un progrès.
Je vous parle directement, très simplement, mais avec une profonde conviction, qui est pour moi une exigence : si je n'avais qu'une idée à retenir, qu'un message à transmettre de mon expérience de trois ans à Matignon, je dirai que j'ai trouvé la France trop souvent avec les volets clos.
On a parfois le sentiment que le monde entre chez nous par inadvertance, malgré nous. On a quelquefois le sentiment que, par l'ignorance ou par l'arrogance, on va s'imposer au monde. Mais ni l'ignorance ni l'arrogance ne nous aident à vivre le monde.
La croissance à deux chiffres de la Chine, la montée de l'intelligence indienne, la balkanisation du monde et ses innombrables conflits régionaux, la mondialisation du terrorisme... tout devient inquiétant, même les bonnes nouvelles. Quand la Chine s'éloigne du communisme et s'engage dans le monde pour la diversité culturelle, certaines voix expriment leur crainte. Pourtant, le danger le plus grand, pour moi, est celui d'une Chine repliée sur son nationalisme, plutôt qu'une Chine ouverte et interdépendante du monde.
M Yves Pozzo di Borgo applaudit.

Aujourd'hui, deux véhicules sont lancés à toute vitesse l'un contre l'autre : d'un côté, « la globalisation économique », cette mondialisation qui se veut totale et qui se vit comme la fin de l'histoire ; de l'autre, « la diversité culturelle », qui voit la planète comme un monde multipolaire dans lequel les forces préfèrent l'équilibre à la domination. Plus les deux véhicules se rapprocheront, plus le débat se réduira au dialogue entre la Chine et les États-Unis.
La France ne peut rester spectatrice de l'histoire qui s'écrit sous ses yeux, elle, dont la vocation universelle est de parler à tout le monde, comme l'a encore dit récemment le Président de la République.
C'est en inspirant l'Europe de sa vision de l'histoire que la France mène son combat de civilisation. Parce que la France et l'Europe ont inventé « l'humanisme de la diversité », le monde a besoin d'elles pour assurer son équilibre, pour assurer sa survie.
L'Europe est née pour la paix des siens, son destin est maintenant la paix de tous. Elle seule peut éviter le choc qui se prépare. L'Europe a construit le message que le monde attend : c'est dans le respect de la diversité que se lève l'unité.
Chers collègues, cet enjeu est géant, ne soyons pas minuscules. Approuver ou rejeter, c'est, certes, la responsabilité de chacun de nous. Le choix est respectable, mais, face à l'histoire, le silence, le boycott, l'indifférence seraient coupables.
En concluant, je pense à Helmut Kohl, qui a réussi à rassembler les deux Allemagnes terriblement divisées par des idéologies meurtrières. Il citait souvent cette espérance : « Lorsque l'esprit européen arpente les sentiers de l'histoire, il faut l'attraper par les bords de sa chemise. ».
Le groupe UMP sera donc positivement présent à ce rendez-vous de la France en Europe.
Applaudissements prolongés sur les travées de l'UMP et sur plusieurs travées de l'UC-UDF.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour examiner un texte dont l'importance est fondamentale pour l'avenir de la France et de la construction européenne.
Le projet de loi constitutionnelle présenté à notre assemblée fait suite à la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 2007, par laquelle il jugeait que la ratification du traité de Lisbonne, signé le 13 décembre dernier, devait être précédée d'une révision de la Constitution française.
La décision du Conseil constitutionnel appelle donc l'intervention du pouvoir constituant pour lever la déclaration d'inconstitutionnalité. On aurait pu légitimement penser, conformément au principe posé par le deuxième alinéa de l'article 89 de la Constitution française, que c'est le peuple qui se prononcerait sur le texte par référendum.
Le deuxième alinéa de l'article 89 dispose en effet : « Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. ».
On aurait même pu envisager pour relancer la construction européenne et pour que l'Union européenne « suscite à nouveau l'enthousiasme de nos concitoyens », selon les mots prononcés par Nicolas Sarkozy le 8 septembre 2006 à Bruxelles, de coupler la révision de notre Constitution et la ratification du traité de Lisbonne dans le cadre d'un seul et même référendum.
On le sait, ce n'est pas l'option retenue par le Président de la République, qui a décidé de contourner le peuple et de recourir à la voie parlementaire, aussi bien pour faire adopter le présent projet de loi modifiant notre Constitution que pour obtenir l'autorisation de ratification du traité de Lisbonne. C'est certainement ce que le Premier ministre appelait tout à l'heure « transcender les clivages »...
Tel est donc l'enseignement tiré du « non » français de 2005 : le peuple ayant manifesté un vif intérêt pour la construction européenne et ayant, en toute connaissance de cause, rejeté le traité constitutionnel, il faut aujourd'hui le contourner, l'écarter de la construction européenne pour adopter une copie de la défunte « Constitution européenne ».
En tout état de cause, la procédure choisie subtilise ce projet de loi à la réflexion citoyenne et alimente le déficit démocratique qui gangrène la construction européenne.
On nous rétorquera bien entendu que les « interprètes de la souveraineté nationale » ont tout autant de légitimité à se prononcer pour la France et pour l'Union européenne. Mais c'est oublier qu'en 2005 ce que les parlementaires validaient à 90 % au Congrès à Versailles, le peuple le rejetait quelques mois plus tard à 55 %.
Ce décalage entre la volonté populaire et ses représentants doit être pris en compte. Aussi réaffirmons-nous que seul le peuple, notre peuple, peut défaire ce qu'il a fait !
Ensuite, le Gouvernement fait valoir que le traité de Lisbonne est différent du traité établissant une constitution pour l'Europe.
Votre Gouvernement, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, prétend qu'il s'agit d'un « traité simplifié [...] tenant compte des fortes craintes exprimées par le ?non? majoritaire ». Raison de plus, mes chers collègues, pour le soumettre au référendum ! Mais, vous le savez bien, tel n'est pas le cas.
Au-delà de la méthode intergouvernementale choisie pour l'élaboration du traité, marquée - comme vous le savez aussi, monsieur le secrétaire d'État - par des marchandages interétatiques au détriment de l'idée d'un intérêt général de l'Union, le contenu même du traité ne répond pas aux attentes de la majorité de nos concitoyens.
Le traité de Lisbonne amende les traités existants : le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne. Le candidat Sarkozy avait annoncé, pendant la campagne pour l'élection présidentielle, qu'il ferait ratifier par la voie parlementaire un « mini-traité » ou un « traité simplifié » qui prendrait en considération les attentes des Français ayant rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe.
Or, le nouveau traité, qui compte plus de 250 pages, n'est pas un « mini-traité ». Ce texte qui empile les amendements aux traités en vigueur avec des modifications d'articles renvoyant elles-mêmes à d'autres articles n'est pas non plus un « traité simplifié ». Vous le savez comme moi, le traité de Lisbonne est tout simplement illisible pour les non-spécialistes. L'ambition initiale de simplification a bel et bien été écartée. L'illisibilité du traité rend ainsi impossible tout débat citoyen - en tout cas, c'est le but recherché !
Plus précisément, comme tous les observateurs peuvent le constater, le traité de Lisbonne reprend, en règle générale, le contenu du traité constitutionnel.
Certes, le terme « constitution » a été abandonné, de même que la référence aux symboles comme l'hymne ou le drapeau, mais le déficit démocratique et l'orientation libérale de toutes les politiques européennes demeurent intacts. D'un point de vue institutionnel, rien n'est fait pour combler le déficit démocratique de l'Union.
Le statut et la fonction de la Banque centrale européenne, par exemple, demeurent fondés sur le principe d'indépendance politique à l'égard des États. Son statut et ses missions confortent son choix d'une politique fondée sur la lutte contre l'inflation et le respect du pacte de stabilité. Ce choix s'inscrit en totale contradiction avec les déclarations de Nicolas Sarkozy qui disait notamment, le 21 février 2007 pendant la campagne électorale, vouloir « une Europe où la politique monétaire ait pour objectifs la croissance et l'emploi et pas seulement l'inflation ».
La Banque centrale européenne restera guidée par les exigences dogmatiques d'un euro fort au service des marchés financiers, contre l'emploi et la croissance réelle. La Banque centrale européenne, en poursuivant son objectif de stabilité des prix, poursuit son cycle de resserrement monétaire, qui se traduit principalement par des taux directeurs élevés par rapport à des taux très faibles de croissance réelle.
Même s'ils ont tenté de minimiser l'incidence de l'aggravation de la crise financière américaine sur l'économie de la zone euro, les ministres européens des finances n'ont pu éviter d'annoncer une prochaine révision significative à la baisse de la croissance économique dans la zone euro pour 2008. Rien n'indique donc que la Banque centrale européenne reverra ses taux à la baisse. Les conséquences risquent d'être dramatiques pour les pays de la zone euro déjà étouffés par ces taux d'intérêt élevés.
En outre, en dépit du mécontentement grandissant et de la méfiance des citoyens à l'égard de la question sociale, de leurs plaintes sur le passage à l'euro qui a fait perdre le sens de la mesure et permis une valse des étiquettes sur les produits de grande consommation notamment, aucune réorientation de la politique monétaire de la Banque centrale européenne n'a été engagée. Les agitations du Président de la République n'y ont rien changé : il avait promis de donner des « coups de boutoir » sur l'approche européenne des dossiers financiers, nous les attendons toujours...
Si les souhaits des Français avaient été effectivement entendus, le traité de Lisbonne aurait instauré un contrôle politique de la Banque centrale européenne par les Parlements européen et nationaux et une politique monétaire sélective, au service de la réalisation d'objectifs chiffrés et contraignants en termes d'emploi. Les taux d'intérêt de la Banque centrale européenne baisseraient d'autant plus que les crédits qu'elle refinance serviraient à des investissements programmant plus d'emplois et de formation ; les taux seraient relevés pour les crédits servant à financer des opérations financières ou spéculatives. L'actualité illustre l'urgence d'une telle mesure.
Malheureusement, force est de constater que rien n'a changé. Les institutions européennes n'ont pas été réformées, elles n'ont pas été démocratisées non plus. Les pouvoirs seront toujours concentrés dans les instances non élues, comme la Commission européenne ou encore la Cour de justice des communautés européennes qui détient, je vous le rappelle, une part essentielle du pouvoir législatif dans l'Union européenne et, par voie de conséquence, dans chacun des États membres. À la différence de nos juridictions, cette Cour statue pour l'avenir par dispositions générales et opposables à tous, comme la loi elle-même.
Si le traité de Lisbonne, comme le traité établissant une constitution pour l'Europe, semble à première vue amorcer une évolution positive concernant les parlements nationaux, à y regarder de plus près, on constate que les prérogatives reconnues aux parlements sont absolument insuffisantes.
Sans entrer dans le détail, rappelons, tout d'abord, que les résolutions votées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution n'ont aucun caractère contraignant, monsieur Raffarin. Ensuite, concernant l'évolution relative à l'application du principe de subsidiarité, le protocole n° 2 annexé au traité de Lisbonne ne fait pas des parlements nationaux les nouveaux garants du respect du principe de subsidiarité, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, n'est-ce pas, Hubert Haenel ? De plus, le pouvoir reconnu aux parlements nationaux de s'opposer à la mise en oeuvre de la procédure de révision simplifiée n'est qu'un pouvoir d'empêchement relatif et ne constitue en aucun cas un pouvoir de proposition.
Enfin, le traité de Lisbonne ne change rien non plus au contenu des politiques économiques et sociales européennes. Le nouveau traité reconduit, contrairement aux déclarations de Nicolas Sarkozy, la « concurrence libre et non faussée ». Car, si cette mention ne figure plus parmi les objectifs de l'Union, elle est reprise dans un protocole annexé au traité qui a la même valeur juridique contraignante que le traité proprement dit. Le principe de la « concurrence libre et non faussée » reste donc la référence de toutes les politiques. Les services publics restent soumis aux règles de la concurrence - article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Prétendre avoir fait un geste fort en faisant disparaître cette mention de la concurrence des objectifs de l'Union ne constitue rien de moins qu'une simulation d'acte politique, un simulacre de rupture.
Par ailleurs, certains d'entre nous l'ont évoqué, la Charte des droits fondamentaux adoptée en 2000, qui faisait partie intégrante du traité constitutionnel européen, a été retirée du corps du texte : quel beau symbole ! Certes, comme le précise l'article 6 du traité sur l'Union européenne, dans sa nouvelle rédaction, elle « a la même valeur juridique que les traités », mais un protocole annexé au traité prévoit que la Charte n'est pas applicable à la Pologne ou au Royaume-Uni, ce qui est fort regrettable !
D'autre part, il est rappelé à l'article 6-1 du traité sur l'Union européenne, dans sa nouvelle rédaction, que « les dispositions de la Charte n'étendent en aucune manière les compétences de l'Union ». De plus, la version de la Charte qui sera retenue est celle qui figure dans l'ancien projet de traité constitutionnel, dont on sait qu'elle vide certains articles de toute substance. C'est ainsi que les droits et libertés inscrits dans la Charte des droits fondamentaux sont restreints ou mis purement et simplement à l'écart. Voilà le prétendu nouveau traité que le Président de la République veut faire ratifier sans la participation du peuple !
Non, les mandataires que nous sommes n'ont pas le droit de bafouer la volonté directement et clairement exprimée par leurs mandants ! Les parlementaires ont le pouvoir de faire respecter la volonté du peuple et d'imposer le référendum, en votant contre cette révision de notre Constitution.
Oui, chaque parlementaire est aujourd'hui placé devant ses responsabilités ! Chers collègues, le déficit démocratique dont souffre l'Union européenne ne sera certainement pas résorbé en contournant le peuple. C'est pourquoi les membres du groupe CRC et moi-même voterons contre ce projet de loi constitutionnelle. J'invite mes collègues soucieux de faire respecter la démocratie dans notre pays à faire de même !
Applaudissements sur les travées du groupe CRC et sur quelques travées du groupe socialiste.

Monsieur le président, madame le garde des sceaux, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, il y a trois ans, le Parlement adoptait un projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution, en vue de permettre la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe.
Cette loi est restée lettre morte après la victoire du « non » au référendum. Elle disparaît aujourd'hui avec le nouveau projet de loi constitutionnelle soumis à notre approbation, qui modifie de nouveau le titre XV de la Constitution.
Pour la clarté du débat, ce projet appelle des considérations distinctes relatives au traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 et à son contenu, à la décision rendue le 20 décembre 2007 par le Conseil constitutionnel et à la procédure de ratification de ce traité par la voie parlementaire, retenue par le Président de la République.
Le traité de Lisbonne simplifie, dans la mesure du possible, et améliore, par rapport au droit antérieur - c'est-à-dire par rapport au traité de Nice -, les règles de fonctionnement de l'Union européenne, afin de les adapter à la situation nouvelle qui résulte, notamment, de l'élargissement de l'Union à vingt-sept membres.
Il procède ainsi à une nouvelle pondération des droits de vote des États membres, plus proche des réalités démographiques ; il permet, dans certains domaines, la substitution progressive d'une règle majoritaire à la règle de l'unanimité ; il dote l'Union d'un président du Conseil durable et d'un Haut représentant unique pour les affaires étrangères ; il renforce les coopérations entre États membres dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, des contrôles aux frontières ainsi que dans le domaine judiciaire, notamment en matière pénale ; il s'efforce également de rendre le fonctionnement de l'Union européenne plus démocratique, en associant davantage le Parlement européen et les parlements nationaux au processus d'adoption ou au contrôle des actes européens, en particulier au regard du principe de subsidiarité.
À ces différents égards, après l'échec du traité constitutionnel du 29 octobre 2004, désormais caduc, le traité de Lisbonne apparaît comme une chance à saisir pour les vingt-sept États membres qui l'ont signé et il mérite d'être ratifié.
Deuxième considération : la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 décembre 2007 doit être rappelée. Par cette décision, le Conseil constitutionnel a estimé que l'autorisation de ratifier le traité de Lisbonne nécessitait, au préalable, une révision constitutionnelle. Bien entendu, cette décision n'a pas pour conséquence une obligation absolue de révision constitutionnelle. La révision n'est un préalable nécessaire que si, comme nous le pensons, l'approbation de ce traité apparaît souhaitable.
Cette approbation appelle une révision pour deux séries de raisons.
D'une part, le traité de Lisbonne transfère des compétences affectant les conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale dans des matières nouvelles - par exemple, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile ou pénale - ou encore, il modifie les modalités d'exercice de compétences déjà transférées dans des conditions affectant la souveraineté nationale - par exemple, en attribuant un nouveau pouvoir de décision au Parlement européen ou en substituant, dans certaines conditions, une règle de majorité qualifiée à la règle de l'unanimité au sein du Conseil européen.
D'autre part, et c'est plus rare, le traité reconnaît aux Parlements nationaux des prérogatives qu'aucune disposition constitutionnelle ne leur attribue jusqu'à présent. La révision doit, pour ainsi dire, combler un vide en donnant au Parlement ce pouvoir. Il en va ainsi des stipulations permettant au Parlement d'intervenir, fût-ce par un avis, pour veiller à limiter les interventions de l'Union européenne lorsque les objectifs qu'elle poursuit pourraient être atteints par les États membres.
Pour ce qui concerne l'essentiel, les transferts de compétences, la Constitution ne comporte pas, comme vous le savez, de clause générale autorisant une fois pour toutes les transferts de compétences opérés au bénéfice de l'Union européenne - nous y sommes, monsieur le doyen Gélard !
L'adoption d'une telle clause - que le comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République, présidé par M. Édouard Balladur, n'a d'ailleurs pas recommandée - ouvrirait un débat inutile et incertain à nos yeux.
Notre procédure d'approbation des traités européens, qui fait intervenir périodiquement le pouvoir constituant, peut apparaître à certains égards excessivement complexe, mais elle constitue une garantie protectrice de la souveraineté nationale.
Il est par conséquent inévitable que le pouvoir constituant, déjà appelé à plusieurs reprises à tirer les conséquences de la construction européenne, notamment en 2005, dans le cadre du traité constitutionnel, soit conduit à modifier à plusieurs reprises les mêmes dispositions. C'est notamment ce qui explique que le Sénat soit invité aujourd'hui, au travers de la rédaction présentée dans le projet de loi en discussion pour l'article 88-2 de la Constitution, à s'y reprendre à deux fois s'agissant des règles applicables au mandat d'arrêt européen, domaine dans lequel, le Gouvernement en conviendra, la nécessité de la révision ne s'imposait pas d'évidence.
Enfin, une troisième considération tient à l'intention, manifestée clairement et de longue date par le Président de la République, de soumettre à la représentation nationale plutôt qu'au référendum le projet de loi autorisant la ratification du traité dit simplifié.
Cette considération ne peut toutefois nous arrêter, à condition du moins de ne pas confondre la procédure de ratification du traité et la révision constitutionnelle qui en est le préalable.
En réalité, le refus du peuple souverain d'approuver, lors du référendum du 29 mai 2005, le traité constitutionnel du 19 octobre 2004 n'implique en rien que le projet de révision constitutionnelle soit soumis au référendum. Rappelons, à cet égard, que la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, intervenue en vue de l'approbation de la constitution européenne, a été adoptée par le Congrès.

Ainsi, aucune règle de parallélisme des formes ne s'impose, et la voie par laquelle sera approuvé le traité de Lisbonne, référendaire ou parlementaire, est à vrai dire indifférente par rapport au débat qui nous occupe aujourd'hui.
Du reste, même s'il reprend - pourquoi le cacher ? - nombre des dispositions du traité constitutionnel, notamment l'essentiel des dispositions institutionnelles figurant aux titres Ier et II de ce dernier, le traité de Lisbonne ne reprend pas les mêmes objectifs et constitue incontestablement un nouveau traité pour faire repartir une Europe en panne.
Mes chers collègues, depuis plus de trente ans, le Sénat et le Congrès avec lui ont toujours accepté de lever les obstacles constitutionnels à la construction européenne : création d'un grand marché intérieur européen avec l'Acte unique, création d'une monnaie commune avec l'euro, élargissement après la chute du mur de Berlin. Gardons à l'esprit que la construction européenne a été et demeure un gage de paix, de prospérité, de liberté.
Le groupe du Rassemblement démocratique social et européen, s'il veut rester lui-même, ne peut qu'être profondément européen. S'il est un domaine où la diversité des sensibilités qui s'y expriment disparaît pour faire place à une profonde unité, c'est bien celui de l'Europe, puisqu'elle est sa raison d'être.
Sans doute, beaucoup d'entre nous auraient souhaité que l'on suive la voie référendaire pour la ratification du traité. Cela nous aurait fait faire l'économie d'un nouveau débat dans quelques jours. Mais, nous le répétons avec force, le projet de loi constitutionnelle est neutre par rapport à ces considérations.
Comment pourrait-on prétendre être favorable à cette ratification, quelles qu'en soient les modalités, si elle devait être rendue impossible faute d'approbation par le Congrès du projet de loi qui nous est soumis, à la suite des recommandations du Conseil constitutionnel ? Le principe de réalité, auquel notre groupe est attaché, nous conduit à ne pas courir le risque d'un nouveau rejet, même si le texte est imparfait et que beaucoup de questions restent sans réponse. Je pense notamment ici à l'indispensable gouvernance économique de l'Europe, qui devrait être notre priorité à l'heure de la mondialisation, à la remise en cause des critères d'adhésion, trop larges à mes yeux, établis à Copenhague, à l'extension indéfinie de nos frontières par un élargissement incontrôlé.
J'ajoute que si le Président de la République, en étroite collaboration avec les responsables de l'Europe, notamment Mme Angela Merkel, n'avait pas pris l'initiative d'une relance, nous serions encore dans l'attente d'un plan « B », cet objet non identifié qui semble n'avoir été livré à l'opinion, par les partisans aujourd'hui sans voix du rejet du traité établissant une Constitution pour l'Europe, que pour encourager nos compatriotes à voter massivement « non » lors du référendum de 2005.
C'est pour éviter de nouvelles rechutes et donner un nouvel élan à l'Europe que notre groupe votera à l'unanimité le projet de loi constitutionnelle qui nous est soumis.
Applaudissements sur les travées du RDSE, de l'UC-UDF et de l'UMP.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-deux heures, sous la présidence de Mme Michèle André.